|
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
TANIDRAZANA - FAHAFAHANA -
FANDROSOANA
|
|
UNIVERSITÉ DE TOLIARA
|
|
|
|
FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
|
|
DÉPARTEMENT D'ÉTUDES
FRANÇAISES
|
1
OPTION : PRAGMATIQUE
LA PRAGMATIQUE : NARRATIVITÉ,
PERFORMATIVITÉ
ET DÉLOCUTIVITÉ
GÉNÉRALISÉES
Ensemble des travaux en vue de l'obtention
de
l'Habilitation à Diriger des
Recherches (HDR)
Présenté par Jean Robert RAKOTOMALALA
Maître de Conférences à la Faculté
des Lettres et des Sciences Humaines et Sociales
Université de Toliara (Madagascar)
Sous la direction scientifique de M. Clément
SAMBO
PROFESSEUR
Université de Toliara (Madagascar)
2
1. ILLOCUTION ET NARRATIVITÉ
RÉSUMÉ
Cet article tente de résoudre l'aporie
méthodologique entre la généralisation de la
performativité à tous les énoncés face à
l'impossibilité de ranger dans l'illocutoire les insultes ou la
flatterie comme le soutiennent les textes de Ducrot et d'Anscombre. La solution
que nous apportons à cette aporie méthodologique est
l'introduction de l'algorithme narratif dans l'évaluation de
l'illocutoire de telle manière que les énoncés qui ne
rentrent pas dans la généralisation ne soient plus renvoyer dans
le perlocutoire, une notion qui ne peut pas relever de la linguistique.
Mots clés : performativité, illocutoire, algorithme
narratif, fuite du réel
Abstract
This article attempts to resolve the methodological aporia
between the generalization of the performativity all facing impossible
statements stored in the illocutionary insults or flattery as it is supported
in Ducrot and Anscombre texts. The solution that we bring to this
methodological aporia is the introduction of the narrative algorithm in the
evaluation of the illocutionary so statements that do not fit in the
generalization are no longer return in the perlocutionary, a notion that cannot
fall under linguistics.
Key words: performativity, illocutionary, narrative
algorithm, the real leak 1.1. INTRODUCTION
Ce qui se profile derrière ce titre qui affiche le
décloisonnement de disciplines en sciences humaines, à savoir :
la pragmatique et la sémiotique, est d'abord le refus de
considérer autre chose que le langage dans une analyse qui s'attache au
rapport des locuteurs avec l'énonciation, plus
précisément, c'est le refus de considérer le langage comme
une tautologie du réel. En effet, s'il est admis que le langage
relève d'une théorie de l'action, ceci implique que le monde
extralinguistique n'est pas un référent ultime mais que la
motivation essentielle de l'énonciation est une modification du rapport
interlocutif.
Ensuite, il s'agit de se doter d'un appareillage linguistique
qui par ailleurs est considéré comme l'essence du langage. Selon
Bernard Victorri le protolangage serait un langage du hic et nunc qui
répond à une exigence pratique d'une action dans le monde. Il est
effectivement d'agir sur le monde dans la perspective de l'ici et maintenant.
De cette manière, le langage est alors une tautologie du réel.
Par contre, le protolangage au niveau du plan
ontogénique peut être illustré à partir du langage
enfantin dans sa fonction symbolique. On sait qu'un enfant produit cri et
sourire en fonction d'une cause physiologique. L'enfant cri quand il se trouve
dans un état d'inconfort,
3
la réaction des entourages adultes à ce cri lui
apprend que son cri a une fonction symbolique, dès lors il produit du
cri sans qu'aucune cause physiologique soit présent, mais il veut
par-là, par exemple, contraindre sa mère à rester
auprès de lui. C'est là une illustration du langage en action qui
montre que le référent n'est qu'un simulacre, c'est ce que nous
précise Jean Petitot de la manière suivante :
« La relation dominante est la relation signifiant /
signifié (la cause du désir et non pas la validité du
jugement), le référent n'étant qu'un tenant lieu (un
artefact, un simulacre, un trompe-l'oeil) » (BRANDT & PETITOT, 1982,
p. 25)
Autrement dit, le mouvement de la référence ne
s'arrête jamais à l'objet dénoté, il le traverse
pour un système de renvois de signe à signes, un système
de renvois défini par la théorie des interprétants de
Charles Sander Peirce (1979). Qualifier le référent de simulacre,
c'est lui donner la possibilité d'être une sémiotique. En
d'autres mots : la véritable référence est ce que montre
l'énonciation en termes d'acte de langage. C'est ce que nous exprime
Jean-Claude Anscombre avec son style propre : « Un principe
conversationnel général qui est que l'on ne parle pas pour ne
rien dire ni pour ne rien faire. » (ANSCOMBRE, 1980, p. 87)
Le « ne rien dire » signifie que toute communication
est toujours une communication sur le monde, c'est la fonction
référentielle dans la théorie fonctionnelle de Roman
Jakobson, mais cela ne suffit pas d'avoir un référent, il faut
encore et surtout que la communication ait une portée interlocutive,
c'est cela qu'implique le « ne rien faire »
Algirdas Julien Greimas qui n'évolue pas dans le cadre
de la pragmatique reconnaît également que le monde ne peut pas
être un référent ultime mais le lieu de manifestation du
sens, c'est-à-dire qu'il propose de cette manière une
sémiotique du monde naturel :
« Il suffit pour cela de considérer le monde
extralinguistique non plus comme un référent « absolu »
; mais comme le lieu de la manifestation du sensible, susceptible de devenir la
manifestation du sens humain, c'est-à-dire de la signification pour
l'homme, de traiter en somme le référent comme un ensemble de
systèmes sémiotiques plus ou moins explicites ». (GREIMAS A.
J., 1970, p. 52)
Pour attester la nécessité d'introduire au sein
de la pragmatique la logique narrative ou la transformation narrative à
des fins d'identification des actes de langage, nous allons reprendre ici le
cheminement de l'acquisition du langage aussi bien au niveau au ontologique
qu'au niveau phylogénétique.
L'enfant, à certain âge, ne dispose pas encore du
lexique nécessaire ni de la grammaire pour communiquer. Cela n'implique
pas qu'il est incapable de communiquer dans les cadres du présent et de
sa présence au monde. Pour pallier au défaut de nomination,
l'enfant se contente de montrer à l'aide de son index, l'objet de son
désir pour que les adultes obtempèrent dans la mesure du
possible. Ce geste de la monstration est à l'origine des
déictiques dans le langage.
L'enfant peut avoir quelques lexiques concernant les objets de
son intérêt immédiat, mais là encore son
protolangage est de nature déictique. Ce qui veut dire que l'enfant ne
peut
4
communiquer que sur des événements
présents au monde, garantis par sa propre présence. Cette
coprésence de l'événement et des locuteurs fait que le
protolangage peut se passer de la grammaire. L'observation du parler enfantin
nous permet alors de conclure que la caractéristique la plus
évidente du protolangage est qu'il demeure sans grammaire.
Ce défaut de grammaire est dû essentiellement au
fait qu'il est incapable de projection temporelle puisque fait uniquement du
présent et que de la sorte, il n'a pas besoin de situer les choses ni
dans le temps ni dans l'espace puisqu'on parle uniquement des choses
présentes au sens.
Autrement dit, le protolangage est pratiquement tautologique ;
de nature indicielle, il s'organise dans le champ sensitif en tant que
prolongement des sens. De cette manière, il est de très faible
portée cognitive parce qu'incapable de métalangage et encore
moins de connotation, il ne peut que dénoter ce que les sens
perçoivent de façon métonymique. Bref, c'est un
système de communication qui ne dispose ni de mécanisme
anaphorique permettant l'identification du référant sous de
formes diverses, ni de mécanisme d'enchâssement autorisant la
récursivité.
Il s'agit là d'un observable de l'acquisition de la
parole au niveau ontologique qui ne diffère nullement de
l'hypothèse de l'acquisition de la parole au niveau
phylogénétique. C'est ce que semble souligner le passage suivant,
d'auteurs pluridisciplinaires enquêtant sur le langage originel :
« Homo erectus aurait parlé (il y a environ un
million d'années) une sorte de langage "Tarzan", très frustre,
que le linguiste Dereck BICKERTON a proposé d'appeler protolangage.
[...], le Protolangage serait un système beaucoup plus rudimentaire. Les
phrases du protolangage auraient été composées de quelques
mots juxtaposés, sans ordre bien défini, du genre Alfred manger
banane ou Alfred lapin tuer. En somme le vocabulaire aurait été
déjà présent, mais pas la grammaire. Un tel système
de communication suffit de fait à échanger de l'information
factuelle, ce qui aurait permis à cette espèce de s'adapter aux
conditions environnementales très diverses qu'elle a dû rencontrer
lors de son expansion hors du berceau africain. » (DESSALES, PIQ, &
VICTORRI, 2006)
De cette pluridisciplinarité, Victorri (2002) tire une
conclusion selon laquelle le passage du protolangage vers le langage est une
contrainte sociale qui cherche la préservation de l'espèce des
dangers des comportements dits « intelligents » au niveau individuel
mais complètement antisociaux. Nous pouvons également avoir un
observable équivalent de ce basculement dans notre société
actuelle, à des échelles diverses. Au niveau de la nation, il y a
l'ordre constitutionnel qui informe tous les types de pouvoir de manière
à garantir la paix entre compatriotes. Nous incluons à dans le
type de pouvoir, le pouvoir de la rue, à côté des pouvoirs
classiques : législatif, judiciaire, exécutif. Au niveau
transnational, il y a notamment les différentes conventions et chartes
ratifiées par plusieurs nations à travers un organisme
délibératif tel que les Nations Unies.
5
Mais plus encore, en dépit de l'apparente domination
des religions allogènes dans les pays d'Afrique, il faut admettre que
cette intrusion n'a fait que laminer les religions traditionnelles qui sont
issues des premières littératures. Par premières
littératures, il faut entendre ces récits à l'aube de
l'humanité qui instituent une régulation du social. Du mythe au
conte en passant par les proverbes, ces récits forment ce qu'on appelle
maintenant oraliture, un juste regain d'intérêt après
plusieurs siècles de mépris au profit de ce que l'on appelle
pompeusement « texte d'auteur », lamineur également.
En effet, il est loisible d'observer dans les mariages
traditionnels, en opposition simultanément au mariage religieux et au
mariage civil, des pratiques sémiolinguistiques qui relèvent des
mythes. Parmi lesquelles, nous pouvons citer l'interdit de l'inceste,
D'après les textes de Victorri, le passage du
protolangage vers le langage naît de la nécessité de
raconter des événements qui ne sont plus, ou qui ne sont pas
encore, de manière à créer un spectacle linguistique
devant des auditeurs auprès de qui le locuteur poursuit des buts
pragmatiques. Les textes de Victorri sont le fruit d'une recherche
interdisciplinaire dans le but s'expliquer pourquoi il y avait un goulot
d'étranglement sur le plan phylogénétique.
C'est-à-dire, il s'agit de répondre à la question de
savoir ce qui a fait se tarir une branche de l'Homo erectus : le
Néanderthalien et qu'est-ce qui a permis à notre espèce
d'éviter cette extinction.
Trois types d'explication de cette extinction ont
été avancés, à savoir : le climat, une
épidémie ou la compétition. Mais ces causes
exogènes sont écartées les unes après les autres
car elles ne sont pas conformes à la capacité d'adaptation de
l'homo sapiens, d'autant qu'elles n'expliqueraient pas pourquoi une
branche de l'homo erectus avait résisté à ces catastrophes
généralisées. En effet, la thèse du climat,
à la période de la glaciation qui aurait conduit à la
disparition de gros gibiers dont dépendait l'homme pour se nourrir
s'effrite contre la survivance même de nos ancêtres communs. Il en
est de même pour les thèses de l'épidémie ou de la
compétition. Autrement dit, toutes causes exogènes ne peuvent pas
expliquer la disparition du Néandertalien, justement parce qu'elles
entrent en contradiction avec la survivance du cousin proche du
Néandertalien : notre ancêtre archaïque.
On sait aujourd'hui que l'hominisation de l'espèce a
duré à peu près sept à huit millions
d'années, l'apparition d'homo erectus, il y a environ un peu
plus d'un million d'années, et l'homo sapiens, à peine
huit cent mille ans. Autrement dit, de l'homo erectus à
l'homo sapiens, coïncide exactement le passage du protolangage au
langage. C'est-à-dire que l'hominisation de l'espèce n'est pas un
fait aussi simple comme le ferait croire ce scénario dessiné ici
à grands traits, mais il semble qu'en matière de langage,
l'étape cruciale a été la fabrication du premier outil
comme aptitude à la symbolisation, il s'agit du silex biface du chasseur
paléolithique.
Le fait pertinent, pour notre propos, dans la fabrication d'un
tel outil est la conversion de la topothèse en chronothèse. Pour
émonder le jargon, disons que l'outil libère l'homme de
l'événementiel ou du factuel par refus du hic et nunc
pour introduire une dimension temporelle dans son appréhension du
monde. En effet, l'outil implique nécessairement un
6
objet absent qui est remplacé par son image, c'est cet
objet absent qui détermine la forme de l'outil, c'est-à-dire son
sens, ce à quoi il est destiné. La linguistique
praxématique qui se refuse de se situer dans le sillage du
structuralisme saussurien fonde d'ailleurs notion du praxème sur cette
base de l'outil symbolisant, voici ce qu'en dit Robert Lafont :
« L'hominisation de l'espèce commence lorsque
l'individu se sert d'un objet pour en modifier un autre en vue d'une action que
ce second assume : lorsque le chasseur modifie la forme d'un caillou pour en
faire une arme contre un gibier éventuel. Éventuel : il faut bien
dans l'opération de fabrication d'un instrument, qu'un troisième
objet soit absent et remplacé par son image. La "certitude sensible"
nécessaire au travail est prise en charge par la représentation.
Un langage qui relaie le geste déictique est là pour
épouser le mouvement de naissance de l'activité
sémiotique. Le sens surgit. C'est ce sens que nous lisons quand nous
interprétons comme instrument la modification non accidentelle d'un
silex : le signe d'une activité qui opère dans l'absence de son
objet. » (LAFONT, 1978, p. 19)
C'est ce qui a permis à la praxématique de
définir le praxème (monème) comme unité de
production de sens et non doué de sens, une position qui s'inscrit
adéquatement dans la thèse de la relativité linguistique,
découverte pourtant au sein du structuralisme :
« Mais le praxème n'est pas exactement le
monème ou le morphème. Ou il ne l'est, si l'on veut, que comme
unité formelle. [...]. Il n'est pas "doué d'un sens". Il est
l'unité pratique de production du, ce qui est fort différent ;
comme l'acte produit par l'outil, lui-même produit par le travail, ne se
confond pas avec l'outil, même si la forme de l'outil lui donne
déjà une forme. » (LAFONT, 1978, p. 29)
Ainsi, s'il est admis que le langage opère en l'absence
de son objet à titre d'outil, sa dimension pragmatique devient une
évidence majeure que l'on peut rattacher à son origine. La
pragmatique comme modification de rapport interlocutif ou intersubjectif est
à la source des premières mises en forme discursive.
Pratiquement, toutes les disciplines en sciences humaines s'accordent pour
appeler ces premières formes discursives de « mythe », dont la
propriété essentielle est son anonymat par lequel il tire son
efficience pragmatique. Ce qui veut dire exactement que la fonction du mythe
est de réguler la société. Il y a donc lieu de supposer
que c'est un défaut de langage qui aurait conduit à l'extinction
du Néanderthalien : une cause endogène.
On constate que chez les mammifères sociaux, les
compétitions au sein du groupe aboutissent à des combats qui ne
se soldent que très exceptionnellement à la mise à mort du
vaincu (LORENZ, 1970) puisque la régulation se fit au niveau biologique.
Chez l'homme, par contre, la régulation se fait au niveau socioculturel
et non au niveau biologique :
« Les comportements à prohiber, tels que tuer
son frère ou son père par exemple, font l'objet d'interdits
explicites dans toutes les sociétés humaines. » (VICTORRI,
2002)
Ces interdits explicites sont accomplis, de manière
illocutoire, par les mythes qui racontent comment les choses se sont
passées au commencement. De cette manière raconter ce qui s'est
passé c'est éviter qu'il ne se reproduise. Il serait très
intéressant d'analyser le
7
caractère fabuleux de l'histoire narrée dans les
mythes, mais il y a lieu de croire que le fabuleux des mythes a pour source une
cause interne : c'est un langage qui est en train de se construire et que par
la suite, le caractère exclusivement oral de sa transmission n'a fait
que renforcer la place des référents évolutifs
fictionnels. Mais que racontent exactement les mythes ? Ils racontent des
crises de violence à cause de rivalité pour mener le groupe ou
pour la possession des femmes ou même pour la possession des ressources.
Voici comment Victorri présente cette narrativité dont la force
illocutoire est d'interdire :
« Notre thèse peut alors se résumer de
la manière suivante. Pour échapper aux crises récurrentes
qui déréglaient l'organisation sociale, nos ancêtres ont
inventé un mode inédit d'expression au sein du groupe : la
narration. C'est en évoquant par la parole les crises passées
qu'ils ont réussi à empêcher qu'elles se renouvellent. Le
langage humain s'est forgé progressivement au cours de ce processus,
pour répondre aux besoins nouveaux créés par la fonction
narrative, et son premier usage a consisté à établir les
lois fondatrices qui régissent l'organisation sociale de tous les
groupes humains. » (VICTORRI, 2002)
Cet auteur souligne par ailleurs qu'une étape
importante de cet acheminement vers le langage est la ritualisation du
comportement narratif : il faut raconter périodiquement les
récits des crises pour éviter leur conséquence qui risque
d'être infini. Nous allons maintenant voir de près ce que c'est la
narrativité. Mais désormais, nous retenons de cette introduction
que la narrativité est commandée par des buts pragmatiques.
Dresser le spectacle linguistique d'un événement qui n'est plus a
pour but illocutoire d'interdire qu'il se reproduise, dès lors il faut
comprendre les premières littératures, que sont les mythes, comme
un principe de régulation sociale qui protège
l'intérêt collectif contre des déchaînements de
violence commandés par des intérêts individuels. C'est
faute de disposer de cette narrativité qui fait passer le protolangage
vers le langage que la branche du Néandertalien s'est
complètement éteinte.
1.2. LA NARRATIVITÉ
Dans les sciences humaines, la narratologie est une discipline
à part entière, mais elle tend de plus en plus à envahir
tout le champ cognitif de diverses disciplines. En tout cas, la
narrativité fait échec à la volonté de diviser les
textes en types parmi lesquels on distingue : l'informatif, l'explicatif,
l'argumentatif, le descriptif. En réalité, un texte ne peut pas
être défini exclusivement par un seul type, une description de
femme peut être, par exemple, un argument sur sa séduction et peut
expliquer en outre pourquoi tel ou tel individu s'est ruiné pour
elle.
Par contre ce qui semble être une certitude, c'est que
tout texte est de nature narrative. Cette position dominante de la
narrativité dans tous les textes est expliquée de la
manière suivante par Umberto ECO :
«Face à l'ordre "Viens ici", on peut
élargir la structure discursive en une macroproposition narrative du
type "il y a quelqu'un qui exprime de façon impérative
8
le désir que le destinataire, envers qui il
manifeste une attitude de familiarité, se déplace de la position
où il est et s'approche de la position où est le sujet
d'énonciation". C'est, si on le veut, une petite histoire,
fût-elle peu importante.» (ECO, 1985, p. 185)
Autrement dit, toute production linguistique de rang de
l'énoncé reçoit son intelligibilité par son
insertion dans la logique narrative, comme le montre cette narrativisation de
l'ordre « Viens ici » dans ce passage. Les textes littéraires,
poème ou prose se plient également à une logique narrative
qui permet de dire qu'ils prennent naissance à partir d'un manque et
qu'ainsi, leur énonciation a pour but la liquidation du manque.
Un autre argument pour la prégnance du narratif dans
tout discours nous vient de BARTHES qui soutient son universalité et sa
capacité de s'inscrire dans n'importe quelle sémiotique : «
Innombrables sont les récits du monde. C'est d'abord une
variété prodigieuse de genres, eux-mêmes distribués
entre des substances différentes, comme si toute matière
était bonne à l'homme pour lui confier ses récits : le
récit peut être supporté par le langage articulé,
oral ou écrit, par l'image, fixe ou mobile, par le geste ordonné
de toutes les substances ; il est présent dans le mythe, la
légende, la fable, le conte, la nouvelle, l'épopée,
l'histoire, la tragédie, le drame, la comédie, la pantomime, le
tableau peint, le vitrail, le cinéma, les comics, le fait divers, la
conversation. De plus, sous ses formes presque infinies, le récit est
présent dans tous les temps, dans tous les lieux, dans toutes les
sociétés ; le récit commence avec l'histoire même de
l'humanité. » (BARTHES, 1966, p. 1)
Cette dernière remarque qui consiste à dire que
le récit commence avec l'histoire même de l'humanité
n'est pas sans confirmer les résultats des recherches sur l'origine
du langage ; à savoir que l'hominisation de l'espèce
coïncide avec le passage du protolangage vers le langage. Cette
convergence nous permet de dire que la narrativité est l'essence du
langage.
Par ailleurs, d'Etienne Souriau (1950) à Greimas
(1966b) en passant par Vladimir Propp (1970 (or. 1958)), les récits
servent à la découverte de la narrativité. Cette
procédure de découverte du mécanisme narratif à
partir du matériau du récit est une démarche
déductive mais confirme une fois de plus la prégnance de la
narrativité dans l'acquisition du langage. De plus, il est très
instructif de constater que le matériau narratif de cette
découverte soit justement des contes populaires (PROPP) ou des mythes
(GREIMAS), c'est-à-dire des productions linguistiques que l'on peut
ranger dans ce que nous avons appelé ici « première
littérature ». Ainsi, GREIMAS (1966b, pp. 29-30) est parvenu
à une description simple de l'algorithme narratif :
« Une sous-classe de récits (Mythes, contes,
pièces de théâtre, etc.) possède une
caractéristique commune qui peut être considérée
comme la propriété structurelle de cette sous-classe de
récits dramatisés : la dimension temporelle, sur laquelle ils se
trouvent situés, est dichotomisée en " un avant vs un
après".
À cet "avant vs après" discursif correspond
ce qu'on appelle un "renversement de situation" qui, sur le plan de la
structure implicite, n'est autre chose qu'une inversion des signes du contenu.
Une corrélation existe ainsi entre les deux plans : »
9
Avant
|
?
Après
|
Contenu inversé
|
|
Contenu posé
|
En parlant de sous-classe de récits, nous ne
pouvons que conclure à une attitude prudentielle à une
étape précise de la recherche, car nous avons déjà
pu constater avec Umberto ECO la généralisation de la
narrativité à tout texte. Néanmoins, on peut tenir cet
algorithme pour valable pourvu qu'il soit compris comme une version faible de
celui-ci :
« Un récit idéal commence par
une situation stable qu'une force quelconque vient perturber. Il en
résulte un état de déséquilibre ; par l'action
d'une force dirigée en sens inverse, l'équilibre est
rétabli ; le second équilibre est semblable au premier mais les
deux ne sont jamais identiques. » (TODOROV, 1971-1978, p.
50)
De cette exploration de la narrativité, nous
retenons ceci : une fois le monde converti en récit, la catégorie
du réel s'évanouit comme une question inutile. En effet, selon
les thèses de B. VICTORRI, le langage serait né par la
nécessité d'évoquer une crise passée chez les
populations du paléolithique. C'est-à-dire qu'il s'agit de
transférer des événements abolis du passé dans le
présent de l'énonciation sous forme de spectacle
linguistique.
Cette manière de faire s'adresse avant tout
à l'intelligence et de cette manière s'inscrit dans un rapport
interlocutif. Il s'ensuit que la conformité du récit à ce
qui s'était passé vraiment importe peu, ce qui compte c'est la
logique narrative qui s'y expose, une logique que l'on peut résumer de
la sorte : une lutte pour la hiérarchie sociale conduirait à
l'anéantissement de toute la population par un déchaînement
de violence incontrôlable. L'objectif de notre apprenti narrateur, celui
du paléolithique, était donc de parvenir à
développer cette matrice sémantique de manière à
obtenir l'adhésion du public sur la valeur illocutoire de son
récit. En effet, la logique narrative fait en sorte qu'une minute de
récit peut contenir cent ans d'histoire. Mais voyons comment VICTORRI
s'imagine les choses :
« Supposons alors que notre apprenti
narrateur arrive à faire comprendre qu'il veut évoquer l'un des
acteurs de cette crise passée, en utilisant quelque
procédé mimétique : imitant l'une de ses
particularités physiques, un animal qu'il aimait chasser, son cri
favori, etc. Le succès d'une telle évocation était
susceptible de produire une impression très forte sur tout le groupe :
pour la première fois l'image d'un membre disparu du groupe
apparaît devant eux, chacun prenant conscience que les autres partagent
la même « vision ». Ce qui était cantonné dans
des mémoires individuelles devient l'objet d'une attention collective,
acquiert une présence intersubjective, « magique », qui frappe
profondément les esprits. Le narrateur peut alors progresser tant bien
que mal dans son proto-récit, faisant revivre les personnages devant le
groupe subjugué, conscient de vivre collectivement une expérience
tout à fait nouvelle. Cette conscience collective renforce la
cohésion du groupe et lui confère un nouveau pouvoir. »
(VICTORRI, 2002)
Nous retenons de cette hypothèse tout à
fait probable que s'il y a référence évolutif fictionnel
dans de pareils récits, c'est parce que le narrateur s'efforce de
référer à un personnage de manière
métonymique (le cri de l'animal qu'il aime chasser) ou synecdochique ou
métaphorique, d'une part, parce que c'est un langage qui est en train de
se construire et
10
d'autre part parce qu'il se trouve dans l'obligation d'obtenir
l'adhésion de son auditoire. Ce sont référents
évolutifs fictionnels qui ont conduit par la suite les analystes
à les comprendre comme une dimension du merveilleux, alors qu'en
réalité, il s'agit d'un problème de
référence qui n'empêche pas l'intelligibilité de la
logique narrative. Actuellement, puisque nous ne sommes plus confrontés
à un problème de référence avec les outils
sémantico-grammaticaux dont nous disposons, ces références
évolutives nous semblent être une naïveté du
narrateur, ce qui a longtemps porté un discrédit aux
récits oraux comme les mythes ou les contes.
Il y a donc avantage à penser que c'est la logique
narrative qui rend supportables les référents évolutifs
fictionnels et quelques autres incohérences dans les textes
concernés. Le paradoxe de cette situation peut s'expliquer par
confrontation avec le langage des mathématiques. Quand dans un
énoncé, nous lisons ax2 + bx + c = 0, nous ne nous
demandons pas de quel « x » il s'agit, ni quel est le
référent de « x », nous devons agir de même dans
les récits qui sont commandés par des buts pragmatiques.
Il faut bien admettre pourtant que la réalité
est le lieu duquel le langage s'est levé, mais dans la mesure où
ce n'est plus un protolangage, mais justement un langage, il s'est
arrogé le droit à l'autonomie pour servir essentiellement le
rapport interlocutif. Cependant, il ne faut pas radicaliser l'autonomie
linguistique, car en réalité, il s'agit d'affirmer la
propriété isomorphe du langage et du monde des objets ; pour
l'illustrer faisons appel à Robert de MUSIL :
« [...], si l'on veut un moyen commode de distinguer
les hommes du réel des hommes du possible, il suffit de penser à
une somme d'argent donnée. Toutes les possibilités que
contiennent, par exemple, mille marks, y sont évidemment contenues qu'on
les possède ou non ; le fait que toi ou moi les possédions ne
leur ajoute rien, pas plus qu'à une rose ou à une femme. Mais
disent les hommes du réel, "le fou les donne au bas de laine et l'actif
les fait travailler"; à la beauté même d'une femme, on ne
peut nier que celui qui la possède ajoute ou enlève quelque
chose. C'est la réalité qui éveille les
possibilités, et vouloir le nier serait parfaitement absurde.
Néanmoins, dans l'ensemble et en moyenne, ce seront les mêmes
possibilités qui se répéteront, jusqu'à ce que
vienne un homme pour qui une chose réelle n'a plus d'importance qu'une
chose pensée. C'est celui-là qui, pour la première fois,
donne aux possibilités nouvelles leur sens et leur destination, c'est
celui-là qui les éveille. » (MUSIL, 1982, pp. 18-19)
Autrement dit, que ce soit un événement
réel, ou un événement raconté ; il implique
toujours la même intelligibilité narrative. Très
brièvement, la logique narrative est une disposition
d'intelligibilité qui empêche qu'à aucun moment un
élément simple ne renvoie qu'à lui-même. La logique
narrative fait que le monde n'est pas un référent ultime, mais
qu'en passant à travers lui, le mouvement de la référence
s'arrache de la nécessité d'existence pour s'engager vers une
référence textuelle que nous appellerons à la suite de
RIFFATERRE « référence horizontale » (1979, p. 37 et
passim) qui est un renvoi de texte à texte.
Ce qui veut dire encore que la signification cesse
d'être celle du discours synthétique et bascule vers l'univers de
la vérité analytique. C'est de cette manière que le
langage s'autonomise et qu'il y a lieu de dire qu'une fois le monde converti en
discours la catégorie du
11
réel s'évanouit comme une question inutile. La
référence horizontale fait que dès qu'une figure du monde
est posée dans un discours, la référence au monde
extralinguistique importe peu, ce qui devient important c'est
l'intelligibilité de la figure en ce qu'elle peut être autrement.
La figure s'inscrit dans un parcours temporel où elle peut perdre des
propriétés et en acquérir d'autres. De cette
manière, il n'y a rien que du langage dans le langage.
Dans la logique narrative, les contraires ne s'opposent pas
mais coexistent en polémiquant. C'est ainsi que dans la
sémiotique narrative, le programme narratif consiste en un passage d'un
état de disjonction vers un état de conjonction à un objet
du désir. Avec son style propre, QUINE nous apprend avec une pointe
d'exacerbation la même chose, c'est-à-dire, l'impossibilité
du langage d'être une tautologie du réel :
« C'est pourquoi que j'ai dit et redit et au fil des
années qu'être, c'est être la valeur d'une variable. Plus
précisément, ce que l'on reconnaît comme être est ce
que l'on admet comme valeurs des variables liées. » (QUINE, 1980,
p. 51)
Nous allons nous servir de cette dernière
propriété du narratif pour essayer de résoudre le
problème de la question de l'obligation juridique introduite dans la
compréhension de la valeur illocutoire.
1.3. L'ILLOCUTOIRE
Nous savons que dans un premier temps la performativité
est rattachée à des verbes sui-référentiels,
c'est-à-dire des verbes qui accomplissent ce qu'ils signifient moyennant
une énonciation à la première personne du présent
de l'indicatif. On constate effectivement que ces verbes ne fonctionnent pas de
la même manière que ceux qui décrivent une action dans
l'univers extralinguistique. Dire par exemple : je laboure la terre
implique la présence d'une portion de terre et d'un outil de labour
comme la bêche sans parler de l'énergie que le laboureur doit
déployer et d'autres foules d'environnements dans le monde
extralinguistique qui rendent possible le labour.
Contrairement à cela, dire Je vous remercie
fait référence à sa propre énonciation pour
l'accomplissement de l'acte de remercier. Il n'est question ici de renvoyer
à des référents extralinguistiques. On peut nous
rétorquer dans ce dernier exemple que « je » et « vous
», renvoient à des référents extralinguistiques. Cet
argument tombe si l'on tient compte de la définition des pronoms dans
les textes de BENVENISTE (1970). Il s'agit, en effet, pour ces pronoms de ce
que BENVENISTE appelle « individus linguistiques » parce qu'ils
naissent d'une énonciation :
« Les formes appelées traditionnellement
« pronoms .personnels », « démonstratifs » nous
apparaissent maintenant comme une classe d'«individus linguistiques»,
de formes qui renvoient toujours et seulement à des « individus
», qu'il s'agisse de personnes, de moments, de lieux, par opposition aux
termes nominaux qui renvoient toujours et seulement à des concepts. Or
le statut de ces « individus linguistiques » tient au fait qu'ils
naissent d'une énonciation, qu'ils sont produits par cet
événement individuel et, si l'on peut dire, « semel-natif
». Ils sont engendrés à
12
nouveau chaque fois qu'une énonciation est
proférée, et chaque fois ils désignent à neuf.
» (BENVENSITE, [1974] 1981, p. 83)
Ainsi définie, la performativité ne concerne que
des éléments limités de la langue et ne mérite pas
par conséquent l'engouement ayant conduit à l'émergence de
la pragmatique comme discipline. Pour prendre la mesure de cette
émergence, reprenons la distinction entre l'énoncé
performatif et l'énoncé descriptif.
Un énoncé performatif accomplit ce qu'il
signifie. Ce qui implique qu'il ne peut pas être soumis à la
question de la véridiction bien qu'AUSTIN ait parlé de
performativité insincère. Mais le fait le plus important demeure
être la sui-référentialité : pour accomplir un acte
de langage, il n'est besoin que de l'énonciation dans les conditions
décrites supra. Par contre, un énoncé descriptif
(constatif dans le vocabulaire d'AUSTIN) peut être soumis au test de la
véridiction et sanctionné de vrai si les conditions
extralinguistiques sont conformes à ce qui est dit et de faux dans le
cas contraires.
La distinction semble radicale, mais plus tard, AUSTIN s'est
aperçu que même les énoncés constatifs peuvent avoir
un préfixe performatif ; il s'ensuit une généralisation de
la performativité à tous les énoncés, c'est ce qui
a rendu à la pragmatique sa lettre de noblesse. Ainsi, par exemple, dire
que La terre est ronde équivaut à J'affirme que la
terre est ronde. Les deux énoncés accomplissent une
affirmation ; implicite dans le premier et explicite dans le second. Leur force
illocutoire est donc une affirmation.
Il est vrai qu'accomplir une affirmation relève d'une
énonciation, mais la question que nous allons soulever revient à
se demander à consiste exactement une affirmation dans le contexte
interlocutif. En tenant compte de l'émergence du langage relativement
à la narrativité, il y a lieu de croire qu'elle a pour but
d'emporter l'adhésion de l'interlocuteur sur ce qui est affirmé
sans qu'il faille vérifier si cette adhésion est acquise ou non.
Cette vérification entre en contradiction avec la théorie car
elle rejette l'énonciation dans le constatif.
Autrement dit, faire une affirmation, c'est une intention qui
consiste à faire passer l'interlocuteur du scepticisme vers un
état de croire ou quelque chose de ce genre. Dès lors nous
retrouvons l'algorithme narratif à la base de l'émergence du
langage comme le soulignent les textes de VICTORRI auxquels nous faisons
référence. Il nous semble que cette narrativité est un
argument décisif dans la saisie et l'évaluation de la
performativité. S'il nous faut un argument de plus pour attester que la
narrativité est l'essence du langage, il n'est que de renvoyer à
PEIRCE dont l'édification sémiotique se base également sur
un principe de transformation narrative :
« Comment le développement est-il possible ?
Comment la science, l'art et la technologie évoluent-ils ? PEIRCE
répond que la synthèse n'est possible que grâce à la
représentation. Être et devenir, c'est être
représentable, et il affirme que la représentation est une
succession ordonnée ». (PEIRCE, 1979, p. 62)
13
Ce qui veut dire si les actes de langages sont possibles,
c'est parce que le devenir est inscrit dans l'être et que toute
communication n'est pas une tautologie du réel mais une intention de
modifier le rapport intersubjectif par une mise en commun entre destinateur et
destinataire de la même représentation comprise comme une
transformation ou une succession ordonnée d'états.
Ainsi, se représenter la terre comme ronde, c'est une
manière de s'opposer à toutes autres formes de la terre et vise
à partager cette information à autrui selon la logique de
disjonction et de conjonction d'objet, avec cette différence près
que l'objet du désir est ici un objet fiduciaire. S'il en est ainsi, il
devrait en être de même pour tous les autres types d'acte de
langage. Pourtant, ce n'est pas sur la base de la narrativité que les
tenants de la pragmatique fondent leur analyse, mais plutôt sur une
participation de l'interlocuteur. Tout se passe comme si l'acte de langage ne
peut pas être accompli sans l'adhésion effective de
l'interlocuteur au désir du locuteur.
Pour nous bien situer au niveau terminologique qui n'est pas
sans incidence avec l'évolution de la théorie vers la
performativité généralisée telle que cette
dernière est esquissée ici, rappelons que :
« Pour remplacer la distinction insuffisante qu'il
avait d'abord tracée entre le performatif et le constatif, AUSTIN
propose dans How to Do Things with Words, de distinguer plutôt le fait
d'énoncer une phrase avec une certaine signification (meaning),
constituée par ce qu'il appelle « le sens (sense) et la
référence » (acte locutionnaire), et le fait
d'énoncer une phrase avec une certaine force (acte illocutionnaire),
c'est-à-dire le fait de l'utiliser pour une assertion, une question, un
ordre, un avertissement, un souhait, etc. » (BOUVERESSE, 1971, pp.
385-386).
S'il est admis qu' « illocutoire »1 et
« illocutionnaire » désigne exactement la même chose,
adopter la terminologie signifie donc accepter la généralisation
de la performativité, et il est employé à cet effet. Ceci
admis, essayons de résoudre le problème de l'illocution
décrite hors de la narrativité.
Chez DUCROT, la pragmatique s'inscrit dans une
sémantique qui s'oppose également à faire du langage une
tautologie du réel parce qu'il conçoit l'interprétation
d'un énoncé comme une lecture de la description de son
énonciation :
« Autrement dit le sens d'un énoncé est
une certaine image de son énonciation, image qui n'est pas l'objet d'un
acte d'assertion, mais qui est, selon l'expression des philosophes anglais du
langage, « montrée » : l'énoncé est vu comme
attestant que son énonciation a tel ou tel caractère (au sens ou
un geste expressif, une mimique, sont compris comme montrant, attestant que
leur auteur éprouve telle ou telle émotion) » (DUCROT, 1981,
p. 30)
Avec une telle définition, il est évident que
DUCROT se situe dans le performatif implicite. C'est-à-dire qu'il
effectue le choix délibéré, dans le champ de la
performativité généralisée, d'ignorer les
constatifs qui contiennent un préfixe performatif. Ce choix est
1 Il est préférable d'employer «
illocutoire » à cause de son économie
14
largement justifié dans la mesure où ses
analyses concernent des morphèmes comme « puisque » ou «
mais ».
Ce qui veut dire que le problème qui nous
intéresse est ailleurs, il est dans l'introduction de l'allocutaire ou
de l'interlocuteur dans la compréhension de l'illocutoire. Tout en
admettant que locuteur et allocutaire n'ont pas de réalité
empirique, ce qui implique qu'ils sont des individus linguistiques au sens de
BENVENISTE, DUCROT fait intervenir néanmoins la référence
extralinguistique dans la caractérisation de l'énonciation. Voici
le passage qui justifie l'introduction subreptice de la référence
mondaine dans un domaine qui l'exclut :
« J'admets en effet, comme il est devenu banal de
l'admettre, qu'on ne peut décrire le sens d'un énoncé sans
spécifier qu'il sert à l'accomplissement de divers actes
illocutoires, promesse, assertion, ordre, question, etc. Or reconnaître
cela, c'est reconnaître que l'énoncé commente sa propre
énonciation en la présentant comme créatrice de droits et
de devoirs. Dire que c'est un ordre, c'est dire par exemple que son
énonciation a le pouvoir exorbitant d'obliger quelqu'un à agir de
telle ou de telle façon ; dire que c'est une question, c'est dire que
son énonciation est donnée comme capable par elle-même
d'obliger quelqu'un à parler, et à choisir pour ce faire un des
types de parole catalogués comme réponses » (DUCROT,
Ibid)
Lu de cette manière, l'illocutoire fait du langage non
plus une tautologie du réel, mais l'inverse, un créateur du
réel. Dans le cas de l'ordre, cela est très clair puisque l'ordre
oblige celui à qui il est donné à agir conformément
à son contenu sémantique. En effet, si quelqu'un me demande
d'ouvrir la porte, je peux rester parfaitement silencieux et donner pour toute
réponse une réaction musculaire. Il y a donc
interpénétration du linguistique avec la réalité
à la manière d'un pouvoir démiurgique.
Mais que va-t-on conclure dans le cas où l'ordre
d'ouvrir la porte est parfaitement compris de l'interlocuteur et qu'il refuse
d'obéir ? Doit-on conclure que l'ordre n'a pas été
effectué ? Ou encore va-t-il falloir, comme le soutiennent certaines
théories, que l'ordre place l'interlocuteur devant l'alternative
d'obéir ou de désobéir ? Ou bien, va-t-on conclure que le
démiurge a perdu ses pouvoirs ?
Toutes ces questions tombent d'elles-mêmes si l'on prend
soin de faire soigneusement la différence entre les conventions
linguistiques qui allient une forme à un contenu et les conventions
sociales qui peuvent être reprises en termes linguistiques mais qui
existent en dehors du langage. En effet, il existe des situations où des
conventions sociales viennent appuyer les conventions linguistiques. Ainsi, une
déclaration qui atteste de la réussite à un examen ne peut
être faite que par des membres du jury. C'est ce qu'on appelle des «
personnes habilitées » dans le langage d'AUSTIN.
Les membres du jury ressortent de conventions sociales que
garantissent des institutions. En réalité, les personnes
habilitées de cette sorte ne sont jamais absentes de toute organisation
sociale et leurs paroles, dans les conditions rituelles requises, sont
effectivement créatrices de droits et de devoirs. Mais du point de vue
épistémologique, cette
15
référence à des conventions sociales
risque d'amener l'analyse à renoncer aux énoncés que ne
supporte aucune convention sociale.
Aucune convention sociale ne vient au secours d'un acte
linguistique comme la promesse. Il n'y a pas d'institution qui garantit la
promesse. Ce qui veut dire que l'acte de langage que constitue le fait de dire
« Je promets » peut être effectué par tout sujet
parlant. S'il existait quelque chose comme une convention sociale garantissant
la promesse, alors tout ce qui est promis doit être tenu. Justement, le
rappel sous forme de sentence qui consiste à dire « chose promise,
chose due » témoigne du non accomplissement de certaine promesse ;
et nous sommes confrontés tous les jours, dans le monde de la
publicité, à des promesses qui ne sont jamais tenues.
Quand GREIMAS nous dit que le monde n'est pas un
référent ultime (1970, p. 52), il nous indique que la
véritable référence est un système de renvois de
signe à signes. De ce point de vue, il se situe dans le sillage de
HJELMSLEV pour qui dans le langage, il n'y a que du langage comme le souligne
le passage suivant qui commente la position de SAUSSURE sur la
préexistence de la substance au signe :
« Mais cette expérience pédagogique, si
heureusement formulée qu'elle soit, est en réalité
dépourvue de sens, et Saussure doit l'avoir pensé lui-même.
Dans une science qui évite tout postulat non nécessaire, rien
n'autorise à faire précéder la langue par la "substance du
contenu" (pensée) ou par la "substance de l'expression" (chaîne
phonique) ou l'inverse, que ce soit dans un ordre temporel ou dans un ordre
hiérarchique. Si nous conservons la terminologie de Saussure, il nous
faut alors rendre compte - et précisément d'après ses
données - que la substance dépend exclusivement de la forme et
qu'on ne peut en aucun sens lui prêter d'existence indépendante.
» (HJLEMSLEV, 1968-1971, p. 68)
Ce qui nous permet de comprendre que lire la description d'une
énonciation pour interpréter le sens d'un énoncé -
au sens de DUCROT - c'est lier une forme à une substance.
C'est-à-dire : demeurer dans le langage. De cette manière, nous
pouvons éviter, au niveau épistémologique de
procéder à la mise à l'écart comme
conséquence du choix entre la cohérence et la complétude.
Rappelons que l'introduction de l'allocutaire dans la compréhension de
l'illocution écarte les énoncés du type « je promets
». Nous pouvons illustrer cette relation de la forme de
l'énonciation à une substance qui fait office dans cette
sémiotique de force illocutoire.
Dans une Faculté, le nom et le prénom du Doyen
sont parfaitement connus du milieu, mais ce n'est pas la même chose que
de s'adresser à lui par son prénom, par son nom ou par son titre
bien que ces trois moyens énonciatifs renvoient exactement au même
référent. Tout se passe de telle manière que le mouvement
de la référence ne s'arrête pas à cet individu
extralinguistique, mais le traverse pour atteindre ce que montre la forme de
l'énonciation. Ainsi, le prénom montre une certaine
intimité dans le rapport interlocutif, le nom patronymique
témoigne d'une certaine distance et le titre affiche une distance
maximale.
16
Le fait que le mouvement de la référence ne
s'arrête pas au réel extralinguistique est ce que nous appelons
dans ce travail fuite du réel qui permet de s'intéresser à
la performativité sans préoccuper d'aucun problème de
véridiction puisque la pragmatique se déroule au niveau de
l'analycité. Il s'ensuit qu'il faut centrer l'évaluation de la
performativité au niveau de l'énonciateur, exclusivement, puisque
c'est lui qui réalise l'énonciation d'après des choix qui
visent justement des buts pragmatiques.
Le problème épistémologique que nous
tentons de résoudre par adoption de cette méthode
d'évaluation peut se résumer de la sorte : puisqu'on ne peut pas
tout étreindre, il faut donc choisir entre la cohérence et
l'exhaustivité ; ou choisir entre la forme et le sens. Cependant, il
faut admettre avec Ivan ALMEIDA que :
« Le style d'une telle épistémologie
est devenu, tout naturellement, celui de l'epokhé, de la mise entre
parenthèses, soit sous forme d'abstraction, soit sous forme
d'Ausschaltung, d'écartement. Or, une mise entre parenthèses
n'est possible que sur la base d'une reconnaissance préalable de ce
qu'on exclut. Et cela au risque de retenir à l'intérieur de la
parenthèse, sous forme de différents types de contamination, la
mémoire du domaine exclu. » (ALMEIDA, 1997)
Clarifions alors notre option dans le traitement de ce
problème. En se rappelant l'objet de ce travail qui consiste à
interroger l'implication de la narrativité dans le traitement de
l'illocutoire, nous pouvons dire que le rapport interlocutif - au centre de la
pragmatique - est un facteur de l'hominisation de l'espèce. Or,
d'après les textes de VICTORRI cette hominisation est un passage du
protolangage vers le langage par le moyen de la narration qui poursuit un but
pragmatique. C'est-à-dire, il s'agit d'une instrumentalisation du
langage dans le champ du rapport interlocutif.
Ce but pragmatique peut être in
præsentia, c'est-à-dire, analytique comme l'atteste la
présence de préfixe performatif dans les énoncés ;
ou in absentia, c'est-à-dire catalytique quand la
performativité est lue seulement par la forme de l'énonciation.
Dans le premier cas, un ordre, par exemple, peut s'énoncer comme suit :
Je vous ordonne d'ouvrir la fenêtre.
On voit très mal comment refuser à cet exemple
l'effectuation d'un ordre. En effet, la séquence « ouvrir la
fenêtre », obtenue par transformation infinitive à cause de
la coréférentialité de l'objet second et du sujet du verbe
enchâssé, est commentée par « je vous ordonne ».
Un commentaire qui engage l'énoncé dans la
sui-référentialité, c'est donc une fuite du
réel. On peut dire que la séquence qui commente a pour fonction
de désambiguïser, et à partir de là, postuler que
l'ordre a le pouvoir exorbitant d'obliger quelqu'un à agir - même
si ce quelqu'un est considéré comme un individu linguistique -
devient un postulat inutile.
Dans le deuxième où le processus illocutoire est
catalytique, il nous faut nous référer à l'argument de
LAFONT qui considère la fabrication du silex biface, d'un outil comme
hominisation de l'espèce. Justement, il faut bien dans
l'opération de fabrication d'un instrument, qu'un troisième objet
soit absent et remplacé par son image. La "certitude sensible"
nécessaire au travail est prise en charge par la
représentation. (1978, p. 19). Autrement dit, en l'absence d'un
préfixe performatif, la force illocutoire d'un énoncé se
lit
17
dans la forme de son énonciation au même titre
que la forme d'un outil représente déjà le travail qu'il
permet d'effectuer.
Dès lors, l'énonciation comme production
d'énoncé est une forme de travail qui permet d'accomplir un autre
travail ; et nous retrouvons le style épistémologique de
HJELMSLEV qui nous apprend que :
« Le sens devient chaque fois la substance d'une
forme nouvelle et n'a d'autre existence possible que d'être la substance
d'une forme quelconque » (1968-1971, p. 70)
Il n'y a donc rien à extraire ni à abstraire,
chaque énonciation est une forme qui permet d'accomplir un acte de
langage, puisque l'émergence du langage au lieu et place du protolangage
est commandée par des buts pragmatiques et que ces buts sont accomplis
par la narrativité. Autrement dit, il n'est pas question d'exiger la
coopération de l'interlocuteur pour rendre compte de la force
illocutoire d'un énoncé, il suffit pour cela d'inscrire
l'énonciation dans le cadre de l'algorithme narratif.
Ainsi, pour reprendre l'ordre, il suffit de comprendre, dans
la perspective du temps dichotomisé dans le narratif, qu'avant
l'énonciation d'une forme linguistique, il n'y a pas d'ordre et
après, l'ordre est effectué. Autre avantage de cette
radicalisation de l'analyse dans le cadre exclusif de la narrativité, la
distinction opérée à l'initial de la théorie entre
analyse conversationnelle et analyse discursive n'a plus de pertinence qu'au
niveau de choix du corpus ; puisque la généralisation de la
performativité à tous les énoncés emprunte la voie
de la narrativité qui est l'essence du langage ; que l'on se rappelle
ici la manière dont Umberto ECO assigne à la narrativité
d'être la trame de tout énoncé.
De cette manière, on peut pareillement rendre compte de
la force illocutoire d'une promesse par l'immanence de l'analyse au sein de la
narrativité. L'illocutoire est une force qui apparaît ipso
facto lors d'une énonciation.
Une promesse a pour but de rassurer le destinataire de la
parole, elle est produite à cet effet qu'elle contienne ou non le verbe
promettre. Ce qui veut dire que sentant l'inquiétude de son
interlocuteur, le locuteur peut recourir à la promesse pour faire passer
cette inquiétude vers la quiétude sans qu'il faille juger par la
suite de l'effectivité de l'acte ainsi produit par la tenue de la
promesse qui peut être un temps relativement long. Du moment que
quelqu'un présente à son énonciation une forme
reconnaissable comme promesse, la promesse est effectuée ipso
facto
Travaux cités
ALMEIDA, I. (1997, Mai). Le style
épistémologique de Louis Hjlemslev. Consulté le Juin
20, 2012, sur Texto:
http://www.revue-texto.net/Inedits/Almeida_Style.html
BARTHES, R. (1966). Introduction à l'analyse
structurale des récits. Dans B. e. Alii, Recherches
sémiologiques: L'analyse structurale du récit (pp. 1-27).
Paris: Seuil.
18
BENVENISTE, E. (1970). Appareil formel de
l'énonciation. Langages, pp. 12-18.
BOUVERESSE, J. (1971). La parole malheureuse, de l'alchimie
linguistique à la grammaire philosophique. Paris: Les éditions de
minuit.
DESSALES, J.-L., PIQ, P., & VICTORRI, B. (2006, Mars 20).
" A la rechcerhce du langage originel". Consulté le Mai 5,
2013, sur halshs-00137573, version 1:
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00137573
DUCROT, O. (1981). Analyses pragmatiques. Les actes de
discours, Communications 32., pp. 11-60.
ECO, U. (1985). Lector in fabula ou la coopération
interprétative dans les textes littéraires. Paris: Grasset.
GREIMAS, A. J. (1966b). élements pour une
interprétation des récits mythiques. Dans B. E. Barthes,
Recherches sémiologiques: l'analyse structurale du récit
(pp. 28-59). Paris: Seuil.
GREIMAS, A. J. (1970). Du sens, Essais de
sémiotique,1. Paris: Seuil.
HJLEMSLEV, L. (1968-1971). Prolégomènes
à une théorie du langage. Paris: éditions de
Minuit.
LAFONT, R. (1978). Le travail et la langue. Paris:
Flammarion.
LORENZ, K. (1970). Trois essais sur le comportement animal et
humain. Paris: Seuil.
MUSIL, R. d. (1982). L'homme sans qualités.
Paris: Seuil.
PEIRCE, C. S. (1979). Ecrits sur le signe. (G.
DELEDALLE, Trad.) Paris: Seuil.
PROPP, V. (1970 (or. 1958)). Morphologie du conte.
Paris: Seuil.
QUINE, V. O. (1980). à la pousuite de la
vérité. Paris: Larousse.
RIFFATERRE, M. (1979). La production du texte. Paris:
Seuil.
SOURIAU, E. (1950). Les deux cent mille situations
dramatiques. Paris : Flammarion.
TODOROV, T. (1971-1978). Poétique de la prose, Choix,
suivi de nouvelles recherches sur le récit. Paris: Seuil.
VICTORRI, B. (2002). Homo narrans: le Rôle de la
narration dans l'émergence du langage". Langages, 146, pp.
112-125.
19
2. LE SIGNE EN PRAGMATIQUE
RÉSUMÉ
Une des difficultés majeures de la théorie des
actes du langage est l'oubli de l'affirmation de Saussure selon laquelle, la
langue est une forme et non une substance. Une affirmation que renforce la
sémiotique de Hjelmslev qui distingue une forme et une substance du
contenu. C'est donc sur la forme que s'appuie la théorie des actes du
langage. C'est ce que nous essayons de montrer ici en affirmant que dans le
langage, il n'y a que du langage.
Mots clés : illocutoire, constatif, substance, forme,
accomplir
ABSTRACT
One of difficulties in theory act of language is the
forgetting of Saussure's statement by way the langue is a form, not a
substance. A statement reinforced in Hjelmslev's semiotics who distinguish a
form and a substance in the content. So, the theory of language act is
supported by the form. That is what we attempt to show by this statement: in
the language there is nothing else than language.
Key words: illocutionary, constative, substance, form, perform
2.1. INTRODUCTION
Rappelons pour mémoire, qu'au début, la
linguistique était une philologie; mais la faille de cette cherche tient
au fait qu'elle est idéologiquement une généalogie qui
cherche à rattacher la langue étudiée à une racine
prestigieuse qui est généralement le grec - puisque c'est la
langue de la philosophie - ou l'hébreux - langue d'une grande religion
révélée. C'est ainsi qu'elle fut abandonnée au
profit du structuralisme saussurien.
L'édifice saussurien est une avancée majeure,
mais son inconvénient peut être résumé par
l'exclusion du locuteur de la sphère de la linguistique de telle
manière que le langage se présente comme une tautologie du
réel comme si sa fonction essentielle était de suppléer la
présence impossible des choses.
En parlant des actes du langage, le signe cesse d'être
un simple système de renvois aux objets du monde. Le blocage de ce
renvoi relève du caractère non falsifiable des actes de langage
qui sont tout simplement - au plein du verbe « être » comme
dans "Il était une fois" de l'exorde des contes - . Les
énoncés falsifiables sont susceptibles d'être
confrontés au monde référentiel et de la sorte
sanctionnés de vrai ou de faux selon leur conformité aux
choses.
Les énoncés falsifiables, appelés par
AUSTIN de "constatifs" participent à une théorie du signe
précise. Nous savons que la linguistique pré-saussurienne fut
plutôt de la philologie; une sorte de quête de la langue originelle
à partir de laquelle dérivent les langues actuellement connues.
Autrement dit, l'édification saussurienne est l'avènement de la
linguistique
20
structuraliste dont nous retenons trois caractères
principaux. Tout d'abord, la question de l'arbitraire du signe, ensuite la
structure du signe et la question de la forme.
En ce qui concerne cette structure du signe, nous pouvons dire
que l'édification saussurienne se situe au niveau dénotatif:
c'est la combinaison du signifiant et du signifié qui constitue le
signe, et le signe ainsi obtenu sert à désigner un objet du
monde. Il est évident que SAUSSURE n'a jamais envisagé la notion
de signe en fonction du monde imaginaire tel que le sphinx ou le minotaure,
mais cela n'enlève en rien à la scientificité de son
élaboration.
En effet, en tenant compte que le signifiant est la face
matérielle du signe et le signifié la face conceptuelle du signe,
SAUSSURE précise qu'avant l'apparition du langage ces deux faces ne sont
qu'une masse amorphe. La masse du son indistinct pour le signifiant et la masse
non moins indistincte de la pensée:
« Prise en elle-même, la pensée est
comme une nébuleuse où rien n'est nécessairement
délimité. Il n'y a pas d'idées préétablies,
et rein n'est distinct avant l'apparition de la langue.
En face de ce royaume flottant, les sons offriraient-ils
par eux-mêmes des entités circonscrites d'avance? Pas davantage.
La substance phonique n'est pas plus fixe ni plus rigide; ce n'est pas un moule
dont la pensée doive nécessairement épouser les formes,
mais une matière plastique qui se divise à son tour en parties
distinctes pour fournir les signifiants dont la pensée a besoin. »
(SAUSSURE, 1982, p. 155)
Si la conclusion tirée de cette présentation de
la constitution du signe est exacte; c'est-à-dire l'affirmation selon
laquelle:
« La linguistique travaille sur le terrain limitrophe
où les éléments de deux ordres [l'ordre du son et l'ordre
de la pensée] se combinent; cette combinaison produit une forme et non
une substance. » (Ibid. p. 157);
En revanche, cette question de masse qui préexiste au
langage n'est pas soutenable.
Le premier argument qui peut militer contre cette
préexistence est la facture trop réaliste de la
présentation. Tout se passe comme si les idées étaient des
entités réelles qu'il suffit de cueillir dans une forme sonore
pour les rendre intelligibles. Par ailleurs, s'il suffit d'accueillir dans une
forme sonore les entités des idées pour faire langue on ne
s'expliquera pas la relativité linguistique. Parce qu'on ne saura pas
comment expliquer pourquoi les Inuits ont plus d'une trentaine d'expressions
pour désigner la neige et pourquoi les Français n'en ont
qu'une.
En tout cas, ce réalisme ne peut pas expliquer pourquoi
des idées de chose qui n'existe pas ont une forme linguistique si
justement la masse amorphe des idées préexiste à la
langue. En effet, cette conception de la linguistique est combattue par de
nombreux auteurs car elle consiste à faire du langage une
étiquette que l'on colle sur les objets. Si cela était vrai, il y
aurait eu une correspondance de termes à termes entre les langues.
Chez CASSIRER par exemple, le langage est une contribution
à la construction du monde des objets:
21
« Le langage n'entre pas dans un monde de perceptions
objectives achevées, pour adjoindre seulement à des objets
individuels donnés et clairement délimités les uns par
rapport aux autres des "noms" qui seraient des signes purement
extérieurs; mais il est lui-même un médiateur dans la
formation des objets; il est, en un sens, le médiateur par excellence,
l'instrument le plus important et le plus précieux pour la
conquête et la construction d'un vrai monde d'objets. » (CASSIRER,
1969, pp. 44-45)
Il est vrai que le monde extralinguistique est l'univers sur
lequel le langage s'est levé, mais il n'est pas moins vrai que le
langage est autonome et qu'une fois le monde converti en langage la
catégorie du réel s'évanouit comme une question inutile.
La thèse que nous soutenons ici est donc que dans le langage, il n'y a
que du langage. C'est ce que nous dit avec son style propre LAFONT Robert:
« Pour autant que nous avancions à
l'intérieur du langage, nous ne connaîtrions jamais que lui et
n'atteindrons pas une réalité objective, devant laquelle il
s'établit en même temps qu'il en pose l'existence. Nous demeurons
pris au spectacle linguistique » (LAFONT, 1978, p. 15)
Cette fuite du réel dans la conception du signe
linguistique ne doit pourtant pas être radicalisée au point
d'accorder la prééminence au monde des idées par rapport
au monde des objets comme c'est le cas dans la philosophie de PLATON; pour
éviter cette radicalisation il suffit d'accepter qu'ils ont des
propriétés isomorphes. Le passage suivant permet de rendre compte
de cette isomorphie:
« [...], si l'on veut un moyen commode de distinguer
les hommes du réel des hommes du possible, il suffit de penser à
une somme d'argent donnée. Toutes les possibilités que
contiennent, par exemple, mille marks, y sont évidemment contenues qu'on
les possède ou non ; le fait que toi ou moi les possédions ne
leur ajoute rien, pas plus qu'à une rose ou à une femme. »
(DE MUSIL, 1982, pp. 18-19)
Le propre du possible est qu'il s'accommode de n'être
pas du tout réalisé. Mais alors que reste-t-il de nos moyens pour
nous rendre compte du possible? La réponse à cette question est
tellement évidente qu'elle est presque occultée par cette
évidence: il nous reste le langage pour parler du possible.
C'est ainsi que HJELMSLEV pour trancher entre la conception du
signe comme renvoi à quelque chose d'autre et du signe comme autonomie
refuse de parler de signe mais de fonction sémiotique qui unit
deux grandeurs: l'expression et le contenu et conclut que:
« Le sens devient chaque fois substance d'une forme
nouvelle et n'a d'autre existence possible que d'être la substance d'une
forme quelconque. » (HJLEMSLEV, 1968-1971, p. 70)
Ce qui veut dire que la face conceptuelle du signe ne peut
exister que dans la face matérielle et ne peut en aucune manière
lui préexister. Prenons un exemple de nature quelque peu
métaphorique pour illustrer cette relation de solidarité entre
les éléments ou les fonctifs d'une sémiotique. Soit une
masse d'argile. La masse d'argile ne peut contenir aucune idée ou aucune
pensée. Cependant, si l'on donne forme à l'argile, cette forme
contient nécessairement une idée ou une pensée comme en
témoigne les statuettes d'argile ou toute
22
sculpture dans d'autres matières. Robert LAFONT fait
partie des linguistes qui sont sensibles à cette solidarité entre
les termes d'une sémiotique quand il nous apprend que:
« L'hominisation de l'espèce commence lorsque
l'individu se sert d'un objet pour en modifier un autre en vue d'une action que
ce second assume: lorsque le chasseur modifie la forme d'un caillou pour en
faire une arme contre un gibier éventuel. Éventuel: il faut bien,
dans l'opération de fabrication d'un instrument, qu'un troisième
objet soit absent et remplacé par son image. La "certitude sensible"
nécessaire au travail est prise en charge par la représentation.
Un langage qui relaie le geste déictique est là pour
épouser le mouvement de naissance de l'activité
sémiotique. Le sens surgit. C'est ce sens que nous lisons quand nous
interprétons comme instrument la modification non accidentelle d'un
silex: le signe d'une activité qui opère dans l'absence de son
objet. » (LAFONT, 1978, p. 19)
D'après ce passage, nous en concluons que pour LAFONT,
la modification non accidentelle d'un objet est le signe d'une activité
sémiotique en l'absence d'une activité pratique: c'est ce qu'il
faut admettre par inscription du sens dans une forme. Justement, c'est ce qui
se trouve précisé chez HJELMSLEV:
« Nous constatons donc dans le contenu
linguistique, dans son processus, une forme
spécifique, la forme du contenu, qui est
indépendante du sens avec lequel elle se trouve en
rapport arbitraire et qu'elle transforme en substance de contenu
» (HJLEMSLEV, 1968-1971, pp. 70-71)
Les démonstrations de HJELMSLEV pour
l'applicabilité de cette substance et forme du contenu au niveau de
l'expression sont nombreuses, notamment la comparaison entre deux
prononciations différentes de la même chose entre deux langues
différentes dans le cadre d'un emprunt, pour un exemple
contextualisé, nous n'avons qu'à comparer la différence de
forme entre [divai] et [dyv?]. Ce que les deux formes possèdent en
commun est leur substance ou le sens de l'expression.
La langue malgache a un énorme avantage pour la mise en
évidence de la forme et de la substance de l'expression puisqu'elle est
formée de plusieurs dialectes qui justement marquent des
différences de formes pour la même substance de l'expression.
Ainsi, pour ne citer que cet exemple, nous avons [aumbi], [umbi], [umbe],
[aumbe], [?aub] comme différentes formes de réalisation de
l'expression du nom du zébu en malgache.
Si ce principe d'isomorphisme entre l'expression et le contenu
est admis, nous allons maintenant nous focaliser sur la forme du contenu comme
un pari pour la forme afin de mettre en évidence que si la pragmatique
est une théorie de l'action, c'est parce qu'elle est avant tout une
analyse de la forme du contenu.
2.2. LA PRAGMATIQUE ET LA THÉORIE DE
L'ACTION.
La communication sur le modèle linguistique implique
toujours un destinateur et un destinataire. D'un premier abord, il s'agit de
communiquer une information. Cependant, il faut admettre que cette vision n'est
qu'une synecdoque croissante. À côté de l'acte de langage
qui
23
consiste à informer, existe une foule d'autres actes,
impossible à énumérer car constituant une liste ouverte
dont voici les plus courants, il nous semble: demander, donner une information,
expliquer, argumenter, approuver, désapprouver, saluer, se
présenter, présenter, décrire, conclure, résumer,
introduire, exposer, etc.
Comme le dit KOLMOGOROV et CHAÏTIN, « une
série de hasards est une série dans laquelle il n'est d'autre
détermination des membres que leur énumération »
(SAVAN, 1980, p. 11), il nous faut donc caractériser les actes de
langage pour convertir la série de hasards en une suite
prévisible. Le premier caractère des actes de langage est qu'ils
sont une lecture d'une forme: la forme du contenu.
Certaines formes de contenu sont répertoriées en
langue et sont facilement identifiables. Ainsi, par exemple, l'acte de langage
qui consiste à informer est pris en charge par une forme que l'on
appelle "phrase déclarative", la demande d'information relève
d'une phrase interrogative; la manifestation d'un étonnement, par une
phrase exclamative; et la mise en relief d'un constituant de phrase par une
structure emphatique. On peut appeler ces premières formes de "forme
générique" parce que chacune d'elles peut contenir une liste
infinie. Cette dernière remarque nous amène à la
présentation d'une deuxième forme en étroite relation avec
la substance du contenu.
C'est ici que l'analyse de LAFONT sur la forme prend toute sa
pertinence: la modification non accidentelle d'une forme est en vue d'une
action que cette forme permet d'accomplir. Par ailleurs, il est très
instructif de faire remarquer que le verbe anglais "to perform" qui se traduit
par "accomplir" en français est à la source de la
découverte de la notion de performativité.
Ceci nous permet d'embrayer dans la deuxième
caractérisation des actes de langage. Il n'est plus question ici de
forme générique mais de forme individualisée dont
l'apparition est appelée "token". C'est-à-dire, une occurrence
singulière d'énoncé que l'on appelle énonciation.
Pour mieux clarifier le "token", il est préférable de reproduire
le texte de Peirce, son inventeur, à travers une citation qu'en fait
RECANATI:
« Une façon usuelle d'estimer le volume d'un
manuscrit ou d'un livre imprimé est de compter le nombre des mots. Il y
aura ordinairement à peu près vingt "le" par page, et bien
sûr ils comptent comme vingt mots. Dans un autre sens du mot "mot",
cependant, il n'y a qu'un seul "le" en français; et il est impossible
que ce mot soit visible sur une page, ou audible dans une séquence
sonore, pour la raison qu'il n'est pas une chose singulière ou un
événement singulier. Il n'existe pas; il détermine
seulement des choses qui, elles existent. (...) Je propose de l'appeler un
type. Un événement singulier qui n'a lieu qu'une
fois et dont l'identité est limitée à cette occurrence, ou
un objet singulier (une chose singulière) qui est en un certain point
singulier à un moment déterminé (...) comme ce mot-ci ou
celui-là, figurant à telle ligne, telle page de tel exemplaire
particulier d'un livre, recevra le nom de token2.
» (RECANATI, 1979, p. 72)
2 Dans Écrits sur le signe, PEIRCE
appelle le token "sinsigne" dans lequel mot la syllabe sin
est la première syllabe de semel, simul, singulier, etc.). (PEIRCE,
1979, p. 31)
24
Il est indiscutable qu'une action ne peut jamais
être un type, mais toujours un token parce qu'elle est toujours
localisée singulièrement dans le temps et dans l'espace.
Même si l'on accomplit exactement à la manière d'un
métronome la même action au même endroit. Chacune de ces
actions se distinguent les unes des autres par leur différence dans le
temps. C'est le cas par exemple d'un ouvrier dans une chaîne de montage.
Il en est exactement de même de l'énonciation. C'est que nous
apprend justement Jean-Claude ANSCOMBRE:
« Si on entend par réalisation cet
événement historique qu'est la production de l'objet, nous
parlerons alors d'énonciation: c'est le fait d'apparition d'une
occurrence de l'énoncé type » (ANSCOMBRE, 1980, p.
63)
Dès lors, en articulant l'énonciation et
l'énoncé, on s'aperçoit que l'énonciation est une
production de forme qui indique ce qu'elle accomplit: une action dans le
langage plus connue sous l'expression acte de langage. Maintenant la question
qui va nous guider consiste à déterminer ce qu'est une
action.
Une action se caractérise par son inscription
dans une temporalité close que la sémiotique appelle algorithme
narratif dont voici le schéma:
Avant Après
Contenu inversé Contenu
posé
C'est ce qu'on appelle algorithme narratif de GREIMAS
(GREIMAS, "Eléments pour l'interprétation des récits
mythiques", [1966b]1981, p. 30) mais il est trop daté qu'il est
préférable de prendre sa version plus neutre chez
TODOROV:
« Un récit idéal commence par
une situation stable qu'une force quelconque vient perturber. Il en
résulte un état de déséquilibre ; par l'action
d'une force dirigée en sens inverse, l'équilibre est
rétabli ; le second équilibre est semblable au premier mais les
deux ne sont jamais identiques. » (TODOROV, 1971-1978, p.
50)
Autrement dit, pour caractériser une forme, il
suffit de l'inscrire dans la temporalité close du narratif et de la
sorte de mesurer la modification entre le temps initial et le temps final sans
qu'il faille par la suite vérifier dans le référent
mondain ce changement parce qu'il est accompli ipso facto par
l'énonciation de la forme en tenant compte de la fuite du réel
discutée plus haut.
Ainsi, pour reprendre le cas du verbe "promettre",
verbe présent dans les textes d'AUSTIN et toujours cité en pareil
cas. En disant "je promets", j'accomplis une promesse parce que la forme de
l'outil linguistique a cette signification et que de la sorte mon intention est
de faire passer le destinataire de l'incertitude à la certitude ou de
quelque chose de ce genre. L'acte de langage est toujours accompli dans et par
l'énonciation comme condition nécessaire et
suffisante.
Maintenant en précisant le rapport entre forme
et sens nous pouvons illustrer que le même sens peut s'incarner dans
plusieurs formes et qu'ainsi chaque forme montre une action précise en
dépit de l'identité du sens.
25
François RECANATI réalise une application
intéressante du pari sur la forme opérée à la fois
par HJELMSLEV dans son analyse de la sémiotique et en même temps
par LAFONT sous forme d'instrumentalisation du langage.
2.3. CARACTÉRISATION DES ACTES DU LANGAGE.
Analyse de la forme et rapport du locuteur au langage. Pour la
pragmatique, il faut distinguer énoncé et énonciation de
telle manière que si l'attention est focalisée sur
l'énoncé, le signe a pour mission de renvoyer à la
dénotation par l'intermédiaire de son signifié. C'est la
conception moderne du signe qui date avec SAUSSURE. Par contre, si l'attention
porte sur l'énonciation, le signe exhibe sa forme pour montrer l'acte de
langage que cette forme permet justement d'accomplir.
2.3.1. LA FORME
On peut comprendre que la forme est ce qui détermine le
sens d'une chose et que cette forme est une conséquence d'un travail qui
n'a pas pour fin cette forme elle-même mais un autre travail qui peut
être accompli par cette forme. Dès lors, le langage comme une mise
en forme de contenu selon la sémiotique de HJELMSLEV indique ce qui peut
être accompli par l'énonciation. De la sorte, nous pouvons
comprendre que l'énonciation est cet acte linguistique qui permet de
produire un énoncé et notre intention dans la production d'un
énoncé est de modifier un rapport interlocutif.
Il est évident que dans cette production, en fonction
des paramètres connus sur les acteurs de la communication, nous
cherchons le meilleur moyen pour que la forme obtenue soit le plus efficace
tout en permettant de respecter les conventions de politesse. En effet, c'est
l'énonciation qui donne la forme de l'énoncé et comme le
souligne DUCROT:
« Interpréter un
énoncé, c'est y lire une description de son énonciation.
Autrement dit, le sens d'un énoncé est une certaine image de son
énonciation, image qui n'est pas l'objet d'un acte d'assertion,
d'affirmation, mais qui est, selon l'expression des philosophes anglais du
langage, « montrée » : l'énoncé est vu comme
attestant que son énonciation a tel ou tel caractère (au sens
où un geste expressif, une mimique, sont compris comme montrant,
attestant que leur auteur éprouve telle ou telle émotion)
». (DUCROT, 1980, p. 30)
Cette remarque se situe dans la perspective d'une
performativité généralisée, car dans un premier
temps, le performatif est compris un acte langage défini par ce que
signifie l'expression. C'est le cas des verbes comme "promettre" dont l'analyse
pragmatique consiste à dire qu'en disant "je promets", je ne me
décris pas en train de promettre au même titre que dire "je
travaille" je suis en train de me décrire travaillant, mais seulement en
train d'accomplir une promesse. Il s'ensuit que, d'une part, la
performativité de "je promets" est présentée comme le type
de la classe des verbes qui accomplissent ce dont ils signifient, et que
d'autre
26
part, "je travaille" est le type de la classe des verbes
définis par la tradition structuraliste comme réalisant des
énoncés constatifs.
Nous avons donc, d'une part des énoncés
performatifs parce que compris non pas comme constatant un état de chose
dans le monde extralinguistique, mais accomplissant ce qu'ils signifient;
accomplissement autrement impossible que dans et par le langage. D'autre part,
nous avons les énoncés constatifs dont la fonction est de
représenter un état de chose.
Le passage cité à l'instant de DUCROT est un
refus de cette distinction car il assure l'assomption du constatif au rang du
performatif en signalant que le performativité ne fait pas
nécessairement l'objet d'une mention; mais seulement montrée par
la forme de l'énoncé, le matériau linguistique offert
à notre observation.
On peut présenter schématiquement cet observable
de la manière suivante. Nous savons que le verbe dire est la matrice du
paradigme du schéma de la communication dans la mesure où il
implique nécessairement trois groupes nominaux qui sont des
actants selon la terminologie de Lucien TESNIÈRE (
[1959] 1982, p. 105 & passim) repris par GREIMAS ([1966] 1982) pour
identifier le sujet, l'objet et l'objet second qui correspondent respectivement
aux rôles de destinateur, d'objet et de destinataire.
Dès lors, le pseudo constatif "je travaille" devient
l'objet d'une communication qui part d'un destinateur vers un destinataire,
modifiant de la sorte un rapport interlocutif. Une modification que nous
n'interpréterons pas dans le sens développé ci-contre par
DUCROT:
« J'admets en effet, comme il est devenu banal de
l'admettre, qu'on ne peut décrire le sens d'un énoncé sans
spécifier qu'il sert à l'accomplissement de divers actes
illocutoires, promesse, assertion, ordre, question, etc. Or reconnaître
cela, c'est reconnaître que l'énoncé commente sa propre
énonciation en la présentant comme créatrice de droits et
de devoirs. Dire que c'est un ordre, c'est dire par exemple que son
énonciation y est présentée comme possédant ce
pouvoir exorbitant d'obliger quelqu'un à agir de telle ou telle
façon ; dire que c'est une question, c'est dire que son
énonciation est donnée comme capable par elle-même
d'obliger quelqu'un à parler, et à choisir pour ce faire un des
types de parole catalogués comme réponses." (DUCROT, 1980, p.
30)
Nous estimons plutôt que devoirs et obligations versent
la théorie pragmatique dans l'extralinguistique au risque de diluer la
différence entre acte de langage et action dans le monde. Pour
éviter cet inconvénient, nous proposons que ce pseudo constatif
soit analysé dans le cadre de la spectacularisation discursive que
définit la structure actancielle comme un parcours du désir ou
tout au moins un investissement du désir:
«Une première observation permet de retrouver
et d'identifier, dans les deux inventaires de PROPP et de SOURIAU, les deux
actants syntaxiques constitutifs de la catégorie "sujet" VS "objet". Il
est frappant, il faut le noter dès maintenant, que la relation entre le
sujet et l'objet, que nous avons eu tant de peine, sans y réussir
complètement, à préciser, apparaisse ici avec un
investissement identique dans les deux inventaires, celui du "désir".
» (GREIMAS, [1966] 1982, p. 176)
27
Ce qui veut dire très exactement que la motivation de
toute énonciation est une opération discursive qui se
définit comme passage d'un état de disjonction vers un
état de conjonction d'objet selon la visée
téléologique de la communication. C'est ainsi que la
communication d'information modifie un rapport interlocutif.
C'est-à-dire que le but pragmatique visé par "je travaille" est
d'informer le destinataire d'un état de chose dont je crois qu'il est
dépourvu.
De cette manière, la généralisation du
performatif à tous les énoncés donne naissance à de
nouveaux paradigmes: le performatif explicite et le performatif implicite.
Ainsi notre exemple cesse d'être un simple constatif et peut se
réécrire comme suit:
1. Je vous informe que je travaille
Cependant, il faut admettre que l'implicite est de nature
foncièrement ambigüe, une ambiguïté qui doit être
réduite par le contexte mais permettant au locuteur d'accomplir une
préservation de la face en laissant au destinataire le choix de
l'interprétation de l'acte de langage qui lui convient le mieux. En
effet, dans la tradition pragmatique notre exemple reçoit plutôt
la formulation (2):
2. J'affirme que je travaille
La différence entre (1) et (2) permet d'expliquer cette
préservation de la face. En interprétant notre constatif initial
en tant que (1), il se peut que je tente de bloquer une intention de mon
interlocuteur de me demander de lui rendre service dans l'immédiat sans
qu'il soit pertinent que mon énoncé s'affiche comme
réalisant ce blocage. En l'interprétant en tant que (2), je tente
peut être de dissuader mon interlocuteur d'un reproche concernant ma
paresse.
Autrement dit, le signe sémiotique en pragmatique se
dote comme le souligne RECANATI d'un double destin, il est à la fois
transparent et opaque. Transparent, il s'efface devant l'objet signifié
pour permettre à celui d'être présent symboliquement.
Opaque, il exhibe sa forme pour montrer l'acte linguistique qu'il accomplit:
« La seule solution au paradoxe du signe consiste en
l'assomption qu'outre la transparence et l'opacité, il y a un
troisième état du signe, la
transparence-cum-opacité. Le signe ni transparent, ni
opaque, est à la fois transparent et opaque, il se
réfléchit dans le même temps qu'il représente
quelque chose d'autre que lui-même » (RECANATI, 1979, p. 21)
Ce statut du signe en pragmatique a contribué une
modification terminologique. Comme il est rare que le préfixe
performatif qui réalise la réflexion de l'énoncé
sur lui-même est souvent absent, c'est le terme d'illocutoire qui est
désormais chargé de rendre compte de la performativité
dans les analyses comme nous avons pu le constater chez DUCROT qui commente
l'implicite en ces termes:
28
« [Or] on a fréquemment besoin, à la
fois de dire certaines choses, et de pouvoir faire comme si on ne les avait pas
dites, de les dire, mais de façon telle qu'on puisse en refuser la
responsabilité" (DUCROT, 1972, p. 5)
La première raison invoquée est une forme de
tabou linguistique qui risque de faire perdre la face à celui qui se
hasarde à outrepasser cet interdit. Dans certaine situation, il n'est
pas politiquement correct de se plaindre sous peine d'offenser les personnes
dont le quotidien est justement ce dont vous vous plaignez. Par exemple
être contraint de dormir à même le sol. Alors, il ne vous
reste qu'à dire que "le sol est dur".
La seconde origine de l'implicite avancée par DUCROT
est que tout ce qui est dit peut être contredit. Ainsi, il serait
très maladroit de dire invite-moi au restaurant parce que j'en ai envie.
Il suffit de tenter cette invitation en disant dans un contexte précis
"j'ai faim". Pour conclure cet auteur notre cette belle formule:
« Le problème général de
l'implicite,(...) est de savoir comment on peut dire quelque chose sans
accepter pour autant la responsabilité de l'avoir dit, ce qui revient
à bénéficier de l'efficacité de la parole et de
l'innocence du silence » (Ibid. p. 12)
En définitive, le passage qui mène du
performatif à l'illocutoire n'est pas très claire, on ne peut pas
le concevoir comme une rupture épistémologique car l'emploi de
cette dernière terminologie n'éclipse pas la première.
Tout au moins on peut soupçonner dans sa présentation chez Alain
REY un retour aux sources où le paradigme est constitué par
"locutoire", "perlocutoire" et "illocutoire" et auquel cas l'illocutoire semble
privilégier l'implicite. Cet auteur, qui est avant tout un lexicologue
voit d'abord dans l'illocutionnary force le préfixe
in- qui lui permet de dire dans une présentation de
l'ouvrage fondateur d'AUSTIN:
« Élargissant sa remarque sur les
énoncés et les verbes performatifs, Austin a ensuite tenté
de définir une force propre au langage en acte, indépendante de
son pouvoir systématique et virtuel à transmettre du sens. Cette
force dénommée illocutionnary force, s'ajoute à l'acte
d'expression et de transmission du sens (locutionary act); elle apparaît
dans toute énonciation lorsqu'on la replace dans les conditions
concrètes qui définissent les circonstances de la communication.
Elle est in-locutionary, car elle se produit 'en énonçant', 'dans
l'énonciation active'; elle se distingue par-là de perlocutionary
qui qualifie les effets produits par l'énonciation' (et 'par
l'énoncé agissant sur autrui'). » (REY, 1976, p.
181)
Cette pérégrination en territoire morphologique
nous permet de retrouver que le signe en pragmatique assume effectivement le
double destin d'être à la fois transparent et opaque pour
intégrer la force illocutoire dans le cadre de la préservation de
la face de manière à être une théorie de la
modification du rapport interlocutif.
Travaux cités
ANSCOMBRE, J.-C. (1980). "Voulez-vous dériver avec
moi?". Dans Rhétoriques, Communications (Vol. 16, pp. 61-123).
Paris: Seuil.
29
CASSIRER, E. (1969). "Le langage et la construction du monde des
objets". Dans C. e. Alii, Essais sur le langage (pp. 37-68). Paris:
Les Editions du Minuit.
DE MUSIL, R. (1982). L'homme sans qualités.
Paris: Seuil.
DUCROT, O. (1972). Dire et ne pas dire, Principe de
sémantique linguistique. Paris: Herman.
DUCROT, O. (1980). "Analyses pragmatiques". (Seuil, Éd.)
Communications(32). GOFFMAN, E. ([1974] 1984). Les rites
d'interaction. Paris: Editions du minuit. GREIMAS, A. J. ([1966] 1982).
Sémantique structurale. Paris: Larousse.
GREIMAS, A. J. ([1966b]1981). "Eléments pour
l'interprétation des récits mythiques". Dans R. BARTHES, &
alii, Introduction à l'analysestructurale du récit (pp.
28-59). Paris: Seuil.
HJLEMSLEV, L. (1968-1971). Prolégomènes
à une théorie du langage. Paris: éditions de
Minuit.
LAFONT, R. (1978). Le travail et la langue. Paris:
Flammarion.
MUSIL, R. (1982). L'homme sans qualités. Paris:
Seuil.
PEIRCE, C. S. (1979). Ecrits sur le signe. (G.
DELEDALLE, Trad.) Paris: Seuil.
RECANATI, F. (1979). La transparence et l'énonciation,
Pour introduire à la pragmatique. Paris: Seuil.
REY, A. (1976). Théories du signe et du sens, 2.
Paris: Klincksieck. SAUSSURE, d. F. (1982). Cours de Linguistique
Générale. Paris: Payot.
SAVAN, D. (1980, Juin). "La sémeiotique de Charles
S.Peirce". Au delà de la sémiolinguistique: la
sémiotique de C.S. Peirce, pp. 9-23.
TESNIÈRE, L. ( [1959] 1982). Eléments de
syntaxe structurale. Paris: Klincksieck. TODOROV, T. (1971-1978).
Poétique de la prose. Paris: Seuil.
30
3. LA SYNECDOQUE.
Résumé :
Pour une lecture intertextuelle dont le but est
d'accroître la lisibilité, disons que la synecdoque reprend la
figure de Cendrillon. Longtemps négligée au profit de la
métaphore et de la métonymie, elle s'avère la plus
intéressante puisqu'elle est dans l'essence du langage. L'article
néanmoins a pour mission de montrer que le principe synecdochique est
à l'oeuvre dans le choix de forme en vertu de son implication dans le
rapport interlocutif.
Mots clés : synecdoque, métonymie,
métaphore, inaliénable, conventionnel
Abstract :
For an Intertextual reading whose goal is to increase the
readability, say that the Synecdoche takes up the figure of Cinderella. Long
overlooked in favour of metaphor and the metonymy, it turns out the most
interesting since it is in the essence of the language. Article nevertheless
has for mission to show that the synecdochique principle is at work in the
choice of form under his involvement in the interaction face act report.
Key words: Synecdoche, metonymy, metaphor, inalienable,
conventional
La synecdoque a permis à TODOROV (TODOROV, 1970) de
mettre NIETZSCHE (NIETZSCHE, 1887) au goût du jour, en ce qui concerne
notamment la question de l'oubli comme principe fondamental au coeur de la
possibilité du langage. Sans le mécanisme de la synecdoque, le
langage serait devenu hors portée de tout apprentissage puisqu'il
s'apparenterait à une tautologie du réel. La relativité
linguistique connue sous le nom de "thèse de Sapir Whorf" est une
démonstration qui atteste que le langage ne peut pas être une
tautologie du réel mais que chaque langue présente une
organisation particulière de ce réel.
En effet, cette thèse consiste à dire que chaque
communauté linguistique organise différemment le concept des
choses à travers son système lexical. Ainsi, pour donner un
exemple, on s'aperçoit qu'une communauté d'éleveurs
possède un vocabulaire plus riche pour dénommer la robe des
zébus qu'une communauté de bureaucrate dans la même aire
linguistique. A fortiori, deux communautés linguistiques
différentes auront une conception différente de la même
réalité. Cette dernière affirmation est soutenue par Ernst
CASSIRER (1969, pp. 44-45) quand il pose que le langage est une contribution
à la construction du monde des objets :
« Le langage n'entre pas dans un monde de perceptions
objectives achevées, pour adjoindre seulement à des objets
individuels donnés et clairement délimités les uns par
rapport aux autres des « noms » qui seraient des signes purement
extérieurs et arbitraires; mais il est lui-même un
médiateur dans la formation des objets; il est, en un sens, le
médiateur par excellence, l'instrument le plus important et le plus
précieux dans la conquête et pour la construction d'un vrai monde
d'objets. »
De cette dernière remarque, il suffit d'ajouter que
dans l'état actuel de nos connaissances, toute tentative de
résoudre l'origine du langage n'est qu'une hypothèse
31
fondée sur la supposition que l'ontogenèse de la
parole reproduit les étapes de la phylogénèse (LAFONT,
1978, p. 63). Autrement dit, ce qui se passe dans l'acquisition de la parole
chez l'enfant serait mutatis mutandis le schéma de
l'acquisition de la parole au niveau de l'espèce humaine. Toutefois, il
faut accepter que l'ontogénèse de la parole se fait au sein de
l'univers linguistique donné des adultes qui réalisent dans des
découpages spécifiques de l'univers référentiels.
L'acquisition du langage n'est pas un processus ex nihilo, elle prend sa source
dans le logosphère déjà construit.
Cette dernière remarque permet de rompre avec le
mentalisme de la psychologie qui avance que le langage est l'expression de la
pensée, comme s'il s'agissait d'une simple extériorisation. En
définitive, chaque sujet ne parle pas depuis « l'intérieur
de sa tête », mais depuis la langue maternelle déjà
là qu'il investit, depuis les discours des autres, les paroles des
autres, masse discursive qui précède et organise a priori le
rapport du sujet à lui-même, à autrui et au monde. C'est
ainsi qu'il y a relativité linguistique.
Il y a lieu de croire que la relativité linguistique
est en relation étroite avec la notion de synecdoque. Il faut distinguer
la relativité linguistique de l'arbitraire du signe linguistique, car ce
dernier est issu des contrastes entre les langues. En revanche, c'est la
possibilité des langues elles-mêmes, donc du langage qui, dans sa
relativité, dépend de la synecdoque.
Pourtant, dans la littérature de la rhétorique,
cette figure fait office de puînée maltraitée au profit de
ces deux aînées que sont la métaphore et la
métonymique. La remarque suivante de Gérard GENETTE (GENETTE,
1972, p. 25)est très instructive à ce propos:
« Comme on a déjà pu s'en aviser, il
suffit maintenant d'additionner ces deux soustractions : le rapprochement
dumarsien3 entre métonymie et synecdoque et l'éviction
fontanière4 de l'ironie, pour obtenir le couple figural
exemplaire, chiens de faïence irremplaçables de notre propre
rhétorique moderne: Métaphore et Métonymie. »
L'analyse que nous proposons dans cet exposé suit la
réhabilitation amorcée par le groupe u (DUBOIS J. , et al., 1982)
qui définit la métaphore comme une double synecdoque et on ne
peut que suivre le commentaire de TODOROV à cet égard:
« Tout comme dans les contes de fées ou dans
le Roi Lear, où la troisième fille, longuement
méprisée, se révèle être à la fin la
plus belle ou la plus intelligente, Synecdoque, qu'on a longtemps
négligée - jusqu'à ignorer son existence - à cause
de ses aînées, Métaphore et Métonymie, nous
apparaît aujourd'hui comme la figure la plus centrale. » (TODOROV,
1970, p. 30)
L'introduction de la dimension pragmatique du langage a
exacerbé cette relativité au point que les expressions
linguistiques s'opacifient pour exhiber la subjectivité de
l'énonciateur en termes d'actes de langage. Dès lors nous sommes
plus dans un processus de
3 De Dumarsais (César Chesneau),
17ème siècle.
4 De Fontanier (Pierre), 19ème
siècle.
32
signification du signe constitué de signifiant et de
signifié, mais dans un processus de symbolisation dont la
sémiosis est un système de renvois de signe à signes.
C'est là un point important où la pragmatique
rejoint la sémiotique triadique de Charles Sanders PEIRCE, notamment
dans la théorie des interprétants telle qu'elle se définit
dans la définit dans la conception suivante :
« Un signe ou representamen est un Premier qui se
rapporte à un second appelé son objet, dans une relation
triadique telle qu'il a la capacité de déterminer un
Troisième appelé son interprétant, lequel assume la
même relation triadique à son objet que le signe avec ce
même objet ... Le troisième doit certes entretenir cette relation
et pouvoir par conséquent déterminer son propre troisième
; mais, outre, cela, il doit avoir une seconde relation triadique dans laquelle
le representamen, ou plutôt la relation du representamen avec son objet,
soit son propre objet, et doit pouvoir déterminer un troisième
à cette relation. Tout ceci doit également être vrai des
troisièmes du troisième et ainsi de suite indéfiniment...
(2.274) » (PEIRCE, 1978, p. 147)
Il appert de cette définition du signe triadique
qu'elle mélange à la fois le processus de signification et le
processus de symbolisation. Dans la première partie de la
définition, il est dit que le premier renvoie à son second ; il
s'agit là du mouvement de la dénotation privilégié
par la doctrine saussurienne. Mais quand il est ajouté que cette
première relation doit être capable de déterminer un
troisième qui interprète la première relation, nous sommes
dans un processus de symbolisation qui s'articule sur un renvoi de chose
à choses.
L'analyse de Michel LE GUERN confirme ce système de
renvois quand il entend par symbole la possibilité pour un
signifié de devenir le signifiant d'autre chose et ainsi de suite :
« On pourra donc dire qu'il y a symbole quand le
signifié normal du mot employé fonctionne comme signifiant d'un
second signifié qui sera l'objet symbolisé ». (1972, p.
40)
C'est de cette manière que la « balance » est
prise pour le symbole de la justice parce que le signifié de la balance
devient justement l'expression de la notion de justice en ce que ce
signifié peut être compris comme une objectivité
mécanique de tout ce qui est présenté sur la balance, et
ce signifié est défini par la symbolisation comme immanente
à la justice. Si le processus relève purement de la
signification, on voit mal comment quelque chose qui est déjà
défini par les dictionnaires - donc par convention sociale - comme
étant un instrument de mesure des massifs pour en faciliter notamment le
commerce, peut renvoyer à la justice de manière stable comme s'il
s'agissait d'une signification.
Autrement dit, la question qui va nous guider maintenant est
de savoir pourquoi la symbolisation se greffe de manière parasite sur la
signification. C'est une question qui n'est pas triviale en considérant
que le principe d'économie inscrit dans la double articulation du
langage a pour but d'éviter la surcharge de la mémoire alors que
paradoxalement le symbole dédouble littéralement la signification
en ajoutant à côté de la relation signifiant /
signifié une autre : le symbolisant et le symbolisé.
33
On peut répondre à cette question de plusieurs
manières, mais celle qui va être privilégiée dans
cet exposé s'inscrit dans le cadre de la pragmatique. La démarche
consiste à dire que si le langage n'est pas une tautologie du
réel c'est parce qu'il embraye sur la dimension interlocutive en termes
d'actes de langage.
Sous quelques réserves, cette option correspond
à la thèse praxématique dont voici - il nous semble - la
meilleure expression :
« De l'objet, la nomination ne nous dit rien de ce
qu'il est pratique d'en dire. La logosphère est un spectacle de
réalité que l'homme a « monté » au cours de son
histoire, pour les services qu'il en attendait.
L'homme ainsi n'atteint jamais le sens des choses - la
formule elle-même est privée de sens -, mais le sens qu'il donne
aux choses et qui accompagne, facilite son action sur les choses ».
(LAFONT, 1978, p. 16)
C'est-à-dire que signifier implique toujours des actes,
et en tenant compte que le langage est avant tout pour une communication, nous
en déduisons qu'au niveau cognitif, ces actes sont de nature
linguistique donnent son intelligibilité au rapport interlocutif. Pour
éviter de revenir sur de longs développements de la
théorie des actes du langage, prenons un exemple pour clarifier les
choses.
Très peu de femmes connaissent bien les
propriétés physiques d'un diamant mais elles savent toutes que
c'est un objet très rare si bien qu'elles sont convaincues que c'est un
véritable symbole de l'amour. Autrement dit, offrir à une femme
du diamant en guise de symbole de l'amour, c'est la convaincre de la
sincérité de cet amour. C'est de cette manière que
s'opère le renvoi de signe à signes : du diamant à
l'amour, on passe par la sincérité et la conviction. Il nous
semble aussi que c'est dans cette dérivation illocutoire que se
vérifie l'hypothèse d'Adam SCHAFF qui considère que
langage et connaissance sont les deux faces d'une seule et même chose.
D'ailleurs, c'est une thèse qui fait l'unanimité
des linguistes et des philosophes que d'admettre que le langage influence notre
mode de perception de la réalité :
« Cette thèse signifie exactement ceci que le
langage, qui est un reflet spécifique de la réalité, est
également, dans un certain sens, le créateur de notre image du
monde. Dans ce sens que notre articulation du monde est du moins dans une
certaine mesure la fonction de l'expérience non seulement individuelle,
mais aussi sociale, transmise à l'individu par l'éducation et
avant tout par le langage. » (SCHAFF, 1969, p. 236)
C'est une expérience facilement vérifiable, mais
là où le bât blesse dans la formulation de cette
thèse c'est que partout l'exemple avancé revient à dire
pratiquement la même chose : la différence lexicale au niveau
quantitatif entre les dénominations de la neige par les Inuits et par
les langues européennes tout en oubliant de signaler que si les Inuits
ont un lexique plus riche pour dénommer la notion, c'est que chaque
lexique renvoie à d'autres signes qui enregistrent des
expériences.
34
Ce qui veut dire que la relativité linguistique n'est
pas dans la diversification des langues mais dans la manière dont chaque
langue opère le renvoi de signe à signes. Bien que le terme de
relativité linguistique ne soit nullement présent chez HJLEMSLEV,
nous avons toutes les raisons de penser que son effort d'analyse sur le
principe d'isomorphisme en termes de substance et forme du contenu est une
autre forme d'expression de cette pensée :
« Seules les fonctions de la langue, la fonction
sémiotique et celles qui en découlent, déterminent sa
forme. Le sens devient chaque fois substance d'une forme nouvelle et n'a
d'autre existence possible que d'être la substance d'une forme
quelconque. » (HJLEMSLEV, 1968-1971, p. 70)
Ce qui veut dire que le sens, dépendant de l'univers
référentiel, est identique dans toutes les langues, mais
seulement, sa mise en forme engendre la relativité linguistique en se
diversifiant dans chaque langue. Une diversification qui découle du
principe de renvoi de signe à signes. Autrement, la
traductibilité entre les langues serait impossible.
Il est vrai comme le fait remarquer MARTY (MARTY, 1980, p.
29)que l'oeuvre de Peirce est compliquée par une terminologie lourde, et
de plus fluctuante. En plus on reproche à la théorie du signe
triadique d'une part, le fait que tout est signe et que, d'autre part, le
processus de renvoi de signe à signes est un processus ad
infinitum.
La seule réponse que l'on peut avancer contre cette
remarque est le protocole mathématique avancé par Joëlle
RÉTHORÉ (RETHORE, 1980, p. 32). En résumé, la
question est de savoir comment le nombre « 1 » peut renvoyer au
nombre « 2 » ; dès lors l'introduction du nombre « 3
» comme interprétant de la relation entre « 1 » et «
2 » permet de trouver la raison « n+1 » de ce processus. Il
n'est plus alors difficile de prévoir un processus de renvois à
l'infini puisque les entiers naturels sont infinis.
Si le lexique d'une langue n'est qu'un système dans
lequel le signifiant est relié au signifié pour engendrer la
désignation d'un objet du monde, au sens philosophique de ce dernier
terme, alors il serait une série de hasard, car : «
D'après KOLMOGOROV et CHAÏTIN, une série de hasards est une
série dans laquelle il n'est d'autre détermination des membres
que leur énumération. » (SAVAN, 1980, p. 11)
Au contraire, il y a lieu de penser que le lexique d'une
langue est fonction du principe de renvoi de signe à signes. Mais le
principe de renvoi de signe à signes qui fait que le langage est aussi
un instrument de connaissance n'est pas un principe unique. Il existe des
lexiques par le biais desquels le renvoi de signe à signes se signale
par un trouble de la référentialité. Ces lexiques sont en
gros ce que nous appelons « trope », et parmi les tropes nous allons
nous attacher particulièrement à la synecdoque.
Il nous semble que ce survol des théories mises en
cause est nécessaire. Leur convergence sur le point où la
symbolisation prend le pas sur la signification n'est pas seulement un garant
scientifique, mais surtout, elle va nous permettre de prendre la synecdoque
sous le double processus de la signification et de la symbolisation et que
sa
35
motivation fondamentale est commandée par des buts
pragmatiques qui sont une inscription du sujet dans le langage.
Évidemment, les résultats sont extensibles aux autres tropes.
Plus précisément, il s'agit de considérer
les tropes, et en particulier la synecdoque, comme des actes de langage. En
effet, nous pouvons nous prévaloir de deux cautions pour une telle
démarche. La première nous vient de Catherine KERBRAT-ORECCHIONI
(KERBRAT-ORECCHIONI, 1994) qui s'attache à démontrer l'existence
de trope illocutoire. La seconde, plus intéressante, est un
détournement de la logique par Benoît de CORNULIER vers le domaine
de la pragmatique. Un détournement qui emprunte la voie de
l'onomasiologie pour affecter à un signifiant une signification
déjà exprimable en langue.
Ce détournement est appelé «
détachement du sens » dont voici la formulation :
"Détachement (fort) du sens : (P & (Psignifie Q)) signifie Q"
(CORNULIER, 1982, p. 132)
Autrement dit, lorsque l'énonciateur décide
explicitement ou implicitement que tel segment linguistique doit être
interprété de telle ou telle manière, ce segment
linguistique signifie ce que lui est assigné en vertu de cette
interprétation. C'est ce qui se passe exactement dans la synecdoque.
Soit l'exemple classique de « un village de 10 toits ».
« Toit » est un lexique qui existe
déjà dans la langue concernée. Au nouveau de la
signification, son signifié peut se résumer en ceci : partie qui
recouvre les murs d'une maison afin de protéger des intempéries.
Dès lors, il s'ensuit dans son emploi en discours tel montré par
cet exemple, il y a un trouble référentiel : un village n'est pas
composé seulement de toits. Ce trouble est indiciel de la voie
d'interprétation qui force à comprendre qu'une maison n'est pas
seulement faite de toit, ce qui impose de lire « toit » par
conjonction avec l'interprétation que lui fournit le terme «
village » dont il est l'adnominal.
Ce qui revient à dire que « toit » tout en
continuant à signifier "toit" met en arrière-plan cette
signification au profit de la symbolisation qui renvoie au signe « maison
». C'est de cette manière que cette synecdoque que l'on qualifie de
particularisante signifie plus. Autrement dit, en se servant de la logique du
calcul propositionnel tel qu'il est converti sous la notion de
détachement du sens de CORNULIER, nous avons l'interprété
« toit » et l'interprétant « maison » sous
l'interprétation forcée par le contexte que « toit »
renvoie à « maison ». Il faut rappeler que dans cette
démarche que c'est la conjonction de l'interprétant avec
l'interprétation qui impose l'interprétant, et ceci est, il faut
le reconnaître, un acte de langage imposé par l'énonciation
qui consiste à donner une règle d'interprétation d'un
élément du langage pour qu'il puisse renvoyer à un autre
élément, exprimable également dans ce langage et ainsi de
suite indéfiniment selon la théorie des interprétants de
PEIRCE.
CORNULIER a eu effectivement une plume heureuse en accouchant
les lignes suivantes qui pointent sur un acte de sémiotisation
inédite - ce qui nous permet d'assumer l'assomption des figures au sein
des actes de langage - sans que cela mette en péril
l'intercommunication, même dans le langage courant :
36
« Le détachement du sens est donc un principe
qui permet à un langage de s'incorporer n'importe quel
élément nouveau comme signe de n'importe quelle valeur qu'on
puisse déjà y exprimer. En ce sens, l'inventivité
sémiologique est arbitraire, radicalement et totalement, dans la mesure
où le détachement fort du sens a la force d'une règle. De
fait, en principe «P» peut être n'importe quoi. »
(CORNULIER, 1982, p. 136)
Il est très remarquable dans les dessins des enfants,
à cause justement de leur maladresse, qu'un tracé confus ne peut
représenter leur maman qu'en vertu de la légende qui
l'interprète comme tel, il en est exactement de même pour les
signalisations des panneaux routiers : ils signifient en vertu du code de la
route.
La réussite de cet acte, s'il faut le mettre dans le
cadre de conditions de félicité d'AUSTIN, est garantie par deux
choses. Premièrement, la contradiction entre « toit » avec sa
situation d'adnominal de « village » force l'allocutaire à
identifier la figure. Deuxièmement, en identifiant la figure, il a
l'indice dans le segment « village » pour suivre
l'interprétation imposée par le contexte. À savoir que
« village » lui-même est une synecdoque particularisante pour
désigner un type de groupement de maisons, c'est ce qui permet à
« toit » de renvoyer à « maison ».
De la même manière, pour prendre l'exemple
éculé de "voile" pour renvoyer à « bateau », on
s'aperçoit qu'il n'y a pas de raison - même par simple
connaissance encyclopédique - qu'une voile puisse être
aperçue en mer sans le bateau auquel elle est attachée comme
élément moteur de l'énergie éolienne. C'est ce qui
force à comprendre l'expression comme une figure synecdochique dans la
mesure où elle est comprise comme une partie d'un tout.
Du point de vue de l'émetteur, on peut se demander
pourquoi telle partie et non telle autre qui est choisie par le locuteur. Pour
y répondre, il faut faire intervenir la notion d'universaux
linguistiques. Il nous semble que la nomination indirecte d'objet du monde
relève d'une dimension affective fortement ancrée dans l'homme.
Dans la mesure où les mots sont multidimensionnels, et Robert LAFONT a
parfaitement raison de dire que le praxème - l'équivalent du
monème chez MARTINET - n'est pas doué de sens mais est un outil
de production du sens (1978, p. 29), ils sélectionnent dans leur emploi
un parcours d'évocations irréductible aux problèmes de
signification tels que cela est défini par les dictionnaires.
Dès lors, il y a lieu de comprendre que si deux signes,
respectivement littéral et figuratif, peuvent atteindre la même
référence, c'est que l'un relève de la convention sociale
et que l'autre, idiosyncratique est une inscription du sujet dans le langage
par un ajout de dimension affective selon un processus de renvois de signe
à signes.
Dans les exemples que nous avons donnés, on peut
comprendre dans le premier que c'est la partie qui assure la protection contre
les intempéries qui est l'objet de la focalisation de la figure. C'est
cette valeur protectrice de la maison qui est mise en avant comme s'il
s'agissait de mettre à distance l'époque où
l'humanité se refusait dans des cavernes. Cette dimension affective est
ancrée dans le langage puisqu'elle entre en relation intertextuelle,
à
37
la manière d'une homothétie, dans d'autres
expressions comme " avoir un « toit »" Par ailleurs, « toit
» est aussi à son tour une synecdoque qui désigne un
ensemble de matériaux les plus divers disposés sur des pannes
afin de protéger une maison des intempéries.
Dans le deuxième exemple, il n'est que de se
référer à l'immolation d'Iphigénie à Aulis
pour solliciter à Éole de lever le vent afin que les bateaux des
Spartes puissent se faire justice à Troie, pour rendre compte de
l'affectivité qui s'attache à la voile. Tout se passe comme si
sans voile, il n'était pas question de navire. Il faut aussi admettre
que du point de vue du sens. C'est la voile qui signale de loin un bateau de ce
genre. De la sorte, pour communiquer cette information
référentielle, il est plus logique de parler de voile que de
bateau. Ensuite, s'il faut ajouter que les navires sont également un
instrument de communication entre les hommes, surtout en termes de circulation
de marchandises, alors le terme de voile dans sa légèreté
peut également renvoyer à ce parcours d'évocations sous
forme de promesse sur la trame d'un avatar puisque la navigation en voile est
tributaire des caprices de la nature.
Cette exemplification montre bien qu'il ne s'agit pas du tout
de changement de sens mais d'un parcours d'évocations dans un
système de renvois de signe à signes. Il n'est même pas
possible de suivre la voie tracée par TODOROV dans cette perspective qui
donne le commentaire suivant en constatant la bévue de la théorie
substitutive :
« Fontanier est un des rares à être
conscient de la différence entre les deux opérations; il
définit les tropes comme la substitution d'un signifié à
un autre, le signifiant restant identique ; et les figures, comme la
substitution d'un signifiant à un autre, le signifié étant
le même ». (TODOROV, 1970, p. 28)
En effet, il s'agit d'un système de renvois que
prennent en charge les mots dans la mesure où ils sont eux-mêmes
synecdochiques d'une pluralité d'expériences réduites en
un seul : le mot, suivant en cela le principe d'oubli qui a fait dire à
NIETZSCHE que l'homme est un animal métaphorique. Ce qui veut dire en
définitive qu'il n'y a pas de substitution de quoi que ce soit, mais
simplement d'oubli contre l'oubli conventionnel : en éclipsant le sens
littéral de « toit » la figure fait tomber celui-ci dans un
oubli volontaire, c'est-à-dire un epokhé ou une mise
entre parenthèses.
Mais une mise entre parenthèses de la sorte ne peut se
faire que sous la reconnaissance préalable de ce qui est ainsi
oublié. En oubliant que « toit » est une agglomération
de matériaux pour une fonction précise on se rappelle qu'il est
un aggloméré pour un objet supérieur à lui : la
maison.
De nouveau, faisons dialoguer les auteurs. Dans un article
publié dans un ouvrage collectif, Jacques DERRIDA tente de montrer le
concept de différance (avec un « a ») en partant de la
thèse de SAUSSURE selon laquelle dans la langue il n'y a que des
différences, et voici l'un des résultats :
« On pourrait ainsi reprendre tous les couples
d'opposition sur lesquels est construite la philosophie et dont vit notre
discours pour y voir non pas s'effacer l'opposition mais s'annoncer une
nécessité telle que l'un des termes y apparaisse comme la
différance de l'autre, comme l'autre différé dans
l'économie du même
38
(l'intelligible comme différant du sensible, comme
sensible différé ; le concept comme intuition
différée - différante ;[...] » (DERRIDA, 1968, p.
56)
On perçoit pourtant à la lecture du texte entier
dans lequel s'inscrit ce passage que DERRIDA y exprime le malaise de
l'impossibilité de saisie de la différance comme entité
représentable, bien que plus tard, il a abandonné ce doute :
« Le gramme comme différance, c'est alors une
structure et un mouvement qui ne se laissent plus penser à partir de
l'opposition présence/absence. La différance, c'est le jeu
systématique des différences, des traces des différences,
de l'espacement par lequel les éléments se rapportent les uns aux
autres. » (DERRIDA, 1987 (éd. or. 1972), p. 38)
Ce qui est intéressant dans cette évolution,
c'est qu'elle s'inscrit, dans le dialogue des textes, en écho avec la
thèse de NIETZSCHE (Cf. (KREMER MARIETTI, 2001)) pour qui les figures
rhétoriques sont l'essence du langage, parce qu'elles procèdent
par symbolisation, c'est-à-dire, par renvoi de signe à signes que
DERRIDA appelle ici rapport des éléments les uns aux autres.
Exactement, ce rapport paradigmatique des
éléments, car c'est de cela qu'il s'agit, se lit dans les mots
(pour émonder le jargon) que nous utilisons pour nommer les choses.
C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le mot comme une cristallisation
d'expériences. Une cristallisation qui peut naître du contact aux
choses ou du contact aux mots dans un mouvement de
complémentarité. Et déjà, nous retrouvons l'aspect
synecdochique du mot, car une pluralité d'expériences est
réduite en une dans le mot. Il faut reconnaître encore que ce
mouvement synecdochique n'est pas simple mais double.
D'abord, le mot comme un tout individué renvoie
à une foule d'éléments qu'il subsume, ensuite, il entre
aussi en tant qu'élément d'une autre unité qui le subsume
à son tour avec d'autres comme le souligne l'affirmation suivante :
« La praxis linguistique rend compte du réel
en transférant à l'« l'unité de typisation »
toutes les occurrences dont la variété n'importe pas au message,
en ramenant à l'« unité de hiérarchie signifiante
» toutes les occurrences présentes en une. Le praxème ne
produit du sens qu'en ce qu'il est cette double unité » (LAFONT,
1978, p. 134)
En effet, et pour illustrer, les premières occurrences
qui font le type permettent d'appeler « arbre » une foule d'individus
comme peuplier, eucalyptus, manguier, citronnier, etc. Le rapport de ces
individus à arbre est un rapport synecdochique, chaque individus
reproduit aussi le même rapport avec ses sous individus, et ainsi de
suite indéfiniment. Les occurrences qui font l'unité de
hiérarchisation sont une décomposition du mot « arbre »
en unités plus petites : racines, tronc, branches, feuilles, etc. de
telle manière que arbre soit synecdochique de ces
éléments. Chaque unité plus petite entretient le
même rapport avec ses sous unités et ainsi de suite
indéfiniment.
Quand on dit dans le domaine de la technique automobile «
arbre de transmission », le mot unité « arbre »
sélectionne « tronc » comme synecdoque
généralisante ; et quand on
39
parle d'« arbre syntagmatique » en linguistique ou
d'« arbre généalogique » en anthropologie, la
sélection opte pour « racines » ou « branches »
selon le sens d'orientation des ramifications.
Cette même analyse de l'unité mot en tant que
double articulation se retrouve sous une forme plus technique et rigoureuse
chez le groupe u (DUBOIS J. e., 1982). Mais pour éviter le piège
des sèmes, il y a lieu de dénoncer que les analyses
componentielles sont restrictives.
En effet, rien n'interdit au mot unité « arbre
» de renvoyer à « sève », à «
écorce », à « bourgeon », à « fleur
», à « fruit » ; et plus encore à des
éléments qui ne sont pas constitutifs de l'unité arbre
dans l'une ou l'autre articulation. Par exemple, à « oiseau »,
à « vent », à « vie » etc. mais ce dernier
type de renvoi ne saurait plus concerner la synecdoque.
En tout état de cause, nous préférons
parler du mot unité d'un foyer d'évocations. Mais pour le cas de
synecdoque les parcours d'évocations seront limités à la
double articulation du mot tel que cela est défini par LAFONT. Cette
spécification de la synecdoque nous impose de lever une
ambiguïté native de la définition de la synecdoque.
Reprenons alors la définition la plus citée :
Cette définition semble être claire. Elle montre
le point d'intersection entre la métonymie et la synecdoque : un
changement de nom ; en même temps qu'elle montre leur différence.
Dans la synecdoque, le changement concerne un rapport de la partie au tout dans
un sens du plus vers le moins qui permet de parler de synecdoque
généralisante et du moins vers le plus engendrant ce que l'on
appelle synecdoque particularisante.
Or, il est très curieux de constater qu'un ouvrage qui
est toujours cité et qui se distingue par sa clarté et sa
pertinence dans l'approche de la métaphore et de la métonymie,
citant exactement la même définition de DUMARSAIS ci-dessus nous
livre la remarque suivante : « Pour la synecdoque de la partie pour le
tout ou du tout pour la partie, le processus est le même que dans le cas
de la métonymie » (LE GUERN, 1972, p. 15).
Et ce processus, nous croyons le comprendre dans
l'exemplification suivante qui a pour but d'asseoir
épistémologiquement la théorie de la métonymie :
« Par exemple, si j'invite le lecteur à relire
Jakobson, cela n'implique pas de ma part une modification interne du sens du
mot « Jakobson ». La métonymie qui me fait employer le nom de
l'auteur pour désigner un ouvrage opère sur un glissement de
référence ; l'organisation sémique n'est pas
modifiée, mais la référence est déplacée de
l'auteur au livre. » " (LE GUERN, 1972, p. 14)
Le processus, donc, qui semble fonder la définition
réside dans ce que LE GUERN appelle glissement de la
référence. C'est ce glissement de la référence qui
est commun à la synecdoque et la métonymie. Il s'ensuit que
certains exemples qu'il donne comme étant des métonymies sont des
synecdoques dans notre perspective.
En effet, s'il est indubitable, sans qu'il soit
nécessaire pour l'instant de faire la démonstration de la preuve
que dire relisez Jakobson, le nom « Jakobson » est
métonymique. Par contre, dans la remarque suivante où un exemple
issu des textes de Zola est présenté
40
comme ayant la même facture, c'est-à-dire,
être une métonymie au même titre que l'exemple
précédent, le doute est permis :
« Quand Zola écrit : « de grosses voix se
querellaient dans les couloirs, le mot « voix » ne change pas de
contenu sémantique ; l'utilisation du mot « voix » pour
désigner des personnes qui parlent n'entraîne qu'une modification
de la référence. La relation qui existe entre les voix et les
personnes qui parlent, tout comme la relation qui existe entre Jakobson et son
livre, se situe en dehors du fait proprement linguistique : elle s'appuie sur
une relation logique ou une donnée de l'expérience qui ne modifie
pas la structure interne du langage » (ibid. p. 14).
Il est inutile dans l'espace de ce travail de se prononcer sur
les causes de cette confusion, il faut remarquer par ailleurs que cette
confusion est presque une permanence dans la littérature
dédiée. Tout le monde semble s'accorder sur la
nécessité de faire la distinction entre métonymie et
synecdoque mais n'arrive pas souvent à maintenir cette distinction dans
les exemples. Pour n'en citer qu'un autre cas qui justifie notre remarque
à l'instant, il n'est que d'évoquer que le même exemple de
« voile » pour « « bateau » apparait à
l'entrée métonymique et à l'entrée synecdoque dans
le Dictionnaire de linguistique et des Sciences du langage (DUBOIS J.
e., 1994).
Il suffit donc de dire ici que la synecdoque et seulement la
synecdoque implique un glissement de la référence - pour
réutiliser cette expression - entre des éléments
constitutifs du mot unité, que ces éléments se trouvent
dans le mot compris comme unité typisation ou dans le mot compris comme
unité de hiérarchie signifiante.
Dès lors, on ne peut pas accepter que « voix
» soit métonymique de « personnes » puisque le concept de
personne - en tant qu'unité de hiérarchie signifiante, donc une
synecdoque des éléments qu'elle subsume - implique
linguistiquement le concept de voix qui est un élément inclus
dans l'unité « personne ». Il s'agit donc d'une synecdoque.
C'est une des conséquences de la remarque de TODOROV sur l'analyse des
textes de NIETZSCHE que nous avons évoquée au tout début
de cet article.
Par ailleurs, la réduction de cette synecdoque à
la métonymie est préjudiciable à la lecture
littéraire des textes de Zola. Ce point de jonction entre la
linguistique et la littérature ne doit pas être
négligé. Sur le plan énonciatif, la synecdoque de Zola
permet de rendre compte que 1°, le narrateur ne voit pas les personnes qui
se querellaient, il ne fait qu'entendre des voix et reconnaît le
caractère conflictuel des échanges. 2°, la querelle demeure
verbale et ne s'est pas encore commuée confrontation en physique.
Ce qui veut dire qu'en disant que « des grosses voix se
querellaient dans les couloirs » Zola entend bien modaliser son
énonciation par une sorte de création d'une isotopie de la
querelle. Autrement dit, son énonciation insiste sur le fait qu'il
s'agit d'une querelle à l'exclusion de ses paradigmes par le fait de
poser comme sujet du verbe l'expression synecdochique « voix »
à la place de ce qui est attendu : « personnes ».
C'est de cette manière qu'il peut véhiculer
d'autres informations, par exemple en qualifiant ces voix de « grosses
», il indique implicitement que les personnes en question sont
41
des hommes et non des femmes car la voix est un indice du
sexe. Nous sommes alors dans le domaine de la modalisation autonymique de
Jacqueline AUTHIER-REVUZ, (1995) car en choisissant la synecdoque, l'auteur,
non seulement crée l'isotopie de la querelle, mais en outre, donne une
information sur le sexe des protagonistes, et l'on peut ajouter que le sens
impliqué dans la narration est l'ouïe et non la vue ; ce qui donne
une facture de réalisme de la description ou plus exactement, ce qui
donne une « illusion référentielle », pour utiliser
cette expression de RIFFATERRE (1982).
En changeant de théorie d'analyse, nous allons nous
apercevoir que c'est exactement l'énonciation qui est mise à
contribution dans la synecdoque. Nous pouvons prendre la séquence «
des grosses voix » comme interprété et « se
querellaient » comme interprétant. La conjonction de
l'interprété à l'interprétant donne une
interprétation qui implique l'interprétant. Il s'agit donc pour
Zola d'imposer la querelle par l'utilisation de la synecdoque.
D'autre part, et c'est là l'objectif de cette
communication, la synecdoque et les figures sémantiques s'inscrivent
dans une perspective des actes du langage. Rappelons très
brièvement que dans une première approche, disons heuristique,
l'acte de langage est un accomplissement du sens signifié par un verbe
sous une énonciation au présent de l'indicatif et à la
première personne. C'est le cas du verbe « déclarer »
par exemple. Depuis, on s'est aperçu des actes indirects qui font
l'économie des verbes performatifs dans la réalisation. C'est la
combinaison des deux qui peut être comprise comme la théorie
énonciative standard. Puis avec l'analyse des délocutifs du type
« merci » il est devenu naïf de vouloir à tout prix
chercher le verbe performatif. Dans cet exemple, en effet, on peut, dans une
perspective générative, avoir : « je vous dis merci »
où l'acte de langage pertinent n'est pas dans le verbe mais dans le nom
« merci » par délocutivité.
Cette dernière performativité est le propre du
détachement du sens dans sa version forte. C'est par cette règle
du détachement du sens que le langage s'incorpore
d'éléments nouveaux pour quelque chose que l'on peut
déjà signifier dans ce langage. Autrement dit, l'acte de langage
qui se profile derrière la synecdoque est une production du sens qui
investit la dimension autonymique de la figure.
« Voix », dans l'exemple qui nous occupe, est
interprété par l'interprétant « personne » et
renvoie donc à « personne » par cette interprétation
que l'on appelle synecdoque. Faire des figures est donc un acte de langage qui
consiste à créer un nouveau signe. Cette créativité
est gouvernée par le principe de la double articulation du
praxème, en ce qui concerne la synecdoque. TODOROV a raison, les figures
ne peuvent être traitées dans une théories substitutives,
elles continuent de signifier littéralement tout en se dotant d'une
réflexivité qui attire l'attention sur elles et qui leur
permettent de renvoyer à d'autres signes.
Renforçons maintenant la règle du
détachement du sens par la sémiotique triadique. Jacques DERRIDA,
en s'opposant au structuralisme appelle déconstruction du signe le
concept de « différance ». Ce post-structuralisme suppose que
les contraires ne s'opposent pas mais coexistent dans une structure
polémique. Nous ne sommes plus alors dans une linguistique
42
qui fait dériver le signe du rapport entre signifiant
et signifié pour désigner un objet du monde.
L'intelligibilité des signes leur vient du renvoi systématique
à d'autres signes comme nous avons eu l'occasion de le constater dans
l'analyse de la synecdoque à partir de la double organisation
synecdochique de l'unité mot.
On peut dire dans ce cas que le mot synecdochique est un
premier, il renvoie au second qu'il ne faut pas confondre ici avec le
référent, par l'intermédiaire de l'application de la
règle synecdochique. C'est ainsi que « voix » renvoie à
« personnes » et « personnes » à son tour à
d'autres éléments de même niveau.
En définitive : synecdoque, détachement du sens,
différance, autonymie, sémiotique triadique relèvent du
même principe, le renvoi systématique de signe à signes que
consignent particulièrement les tropes. C'est ce principe qui
empêche au langage d'être une tautologie du réel par une
inscription de la subjectivité à la base des actes du langage.
Illustrons cela par un exemple de synecdoque.
En prenant la synecdoque au sens étymologique de
compréhension simultanée, nous renforçons le rejet de la
théorie substitutive en même temps que nous renforçons que
le principe de renvoi, en aucun moment, n'escamote pas le premier terme, mais
se sert de lui pour renvoyer au second, en fonction de buts pragmatiques.
Il est très remarquable de constater que les gens de la
campagne, soumis aux aléas climatiques quant à leur moyen de
subsistance, usent d'expressions qui semblent avoir pour fonction de conjurer
le sort. Cette attitude linguistique est particulièrement vivace
à Madagascar. Elle peut se comprendre sur la base d'un rapport aux
divinités qui accordent ou refusent leur bienveillance en fonction du
comportement linguistique des vivants.
Or, il faut constater à la suite de FREUD (FREUD, 1912)
que le rapport aux divinités en tant que sacrées est toujours
marqué par une ambivalence : il est fait de crainte et d'adoration en
même temps. Dès lors, on s'aperçoit que la crainte engendre
l'euphémisme qui peut s'analyser comme une synecdoque croissante ou
expansive. En évitant de nommer certaines choses de crainte de heurter
les divinités, il est utilisé une expression de très
grande généralité.
Ainsi, en ce qui concerne l'élevage, le campagnard
élève des poules, des oies et des canards, le plus souvent. Mais
de crainte que les divinités comprennent comme une fatuité s'il
en parle directement, le campagnard les désigne par biby
[bête]. La raison de cette synecdoque est que les divinités
sont également responsables des autres bêtes et non pas seulement
des siens. Selon cette perspective, la synecdoque est aussi une forme de
préservation de la face.
Pour terminer, en tenant compte que les diverses
théories qui ont été présentées pour
analyser la synecdoque comme essence du langage, n'arrivent pas à faire
une démarcation nette de la question du sens, il nous faut donc
évoquer une autre théorie qui est arrivée à faire
une radicalisation de la forme. Il s'agit du Prolégomènes
à une théorie du langage de Louis HJELMSLEV (HJLEMSLEV,
1968-1971).
43
Nous pouvons dire que chez HJELMSLEV, la démarche est
plus confiante parce qu'au lieu de parler de sens il fait appel à la
notion absolument neutre de « grandeur ». Mais au lieu de faire
nous-même la glose de cette théorie féconde, donnons la
parole à un commentateur à qui nous devons la relecture de
l'ouvrage selon ses nouvelles indications :
« Pour HJELMSLEV le langage ne contient rien que du
langage. La sémantique n'existe pas. Il n'existe qu'un plan d'expression
et un plan de contenu, appliqué à un inventaire. Mais rien ne dit
que l'expression doive être nécessairement sonore ni le contenu
nécessairement conceptuel, ces deux niveaux ne sont définis que
relationnellement, et ne s'appliquent qu'à tout inventaire qui en est
doté. Il n'y a donc rien à abstraire, car il n'y a pas de noyau,
pas de sèmes, pas de classèmes, pas de traits pertinents »
(ALMEIDA, 1997)
Ce qui lui a permis de concevoir le principe d'isomorphisme
entre l'expression et le contenu et que de la sorte : « Le sens devient
chaque fois substance d'une forme nouvelle et n'a d'autre existence possible
que d'être substance d'une forme quelconque. » (HJLEMSLEV,
1968-1971, p. 70)
Or s'exprimer en trope, c'est changer de forme de lire le
monde, et cette forme, par sa différence avec d'autres formes, indique
la force illocutoire de l'expression. Pour illustrer cette dernière
remarque, nous allons nous servir d'une synecdoque qui passe inaperçue
à cause de son évidence même.
Il s'agit de notre usage des noms propres. C'est pratiquement
universel maintenant qu'un individu possède un nom et au moins un
prénom. Sauf, circonstance particulière, on choisit l'un ou
l'autre. Si l'on choisit le nom, la valeur illocutoire est la marque de
distance respectueuse qui est une interdiction de la familiarité. Si
l'on choisit le prénom, c'est la marque de la réduction de la
distance en témoignage d'une intimité. Il est évident que
choisir l'un ou l'autre, c'est faire une synecdoque ; car c'est exprimer une
partie pour la totalité. Il en va de même, si par
affectivité, le prénom lui-même est encore tronqué :
au lieu de dire, par exemple Robert, on se contente de Rob ou de Bob.
Pareillement pour l'utilisation d'hypocoristique.
En conclusion, la raison qui pousse les analystes vers la voie
de la rhétorique restreinte, sous le couple métaphore et
métonymie seulement, paraît maintenant, comme le signale GENETTE
(GENETTE, 1970), être une méconnaissance du mécanisme de la
synecdoque : le principe de renvoi de signe à signes qui est au coeur de
l'essence du langage.
Travaux cités
ALMEIDA, I. (1997, Mai). Le style
épistémologique de Louis Hjlemslev. Aarhus, Danemark.
AUTHIER-REVUZ, J. (1995). Les non coïncidences du dire et
leur représentation méta-énonciative. Paris: Thèse
de Doctorat d'état.
CASSIRER, E. (1969). "Le langage et la construction du monde
des objets", dans Essai sur le langage. Paris: Minuit.
44
CORNULIER, B. (1982). "Le détachement du sens" dans Les
Actes de Discours, Communications,32. Communications, p. 132.
DERRIDA, J. (1968). "La différance". Dans P. Sous la
Direction de SOLLERS, Théorie d'ensemble (p. 56). Paris:
Seuil.
DERRIDA, J. (1987 (éd. or. 1972)). Positions.
Paris: éditions de Minuits.
DOMINE, F. (1988, Octobre). "Dumarsais, es tropes ou des
différents sens". Mots(17), pp. 234 - 235.
DUBOIS, J. e. (1982). Rhétorique
Générale. Paris: Seuil.
DUBOIS, J. e. (1994). Dictionnaire de linguistique et des
sciences du langage. Paris: Larousse.
FREUD, S. (1912). Totem et tabou, interprétation par la
psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs. Paris: Payot.
GENETTE, G. (1970). "Rhétorique restreinte", dans
Recherhces rhétoriques,. Paris: Seuil. GENETTE, G. (1972). Figure
III. Paris: Seuil.
GRANGER, G. (1982, juin). "A quoi servent les noms propres".
Langages.
HJLEMSLEV, L. (1968-1971). Prolégomènes
à une théorie du langage. Paris: éditions de
Minuit.
KERBRAT-ORECCHIONI. (1994). Rhétorique et pragmatique:
les figures revisitées. (persée, Éd.) Langue
française, 101.
KREMER MARIETTI, A. (2001, Mars). "Nietzsche, la
métaphore et les sciences cognitives". Revue tunisienne des
études philosophiques(28 - 29).
LAFONT, R. (1978). Le travail et la langue. Paris:
Flammarion.
LE GUERN, M. (1972). Sémantique de la métaphore
et de la métonymie. Paris: Larousse.
MARTY, R. (1980, Juin). "La sémiotique
phanéroscopique de Charles S. Peirce". Langages, p. 29.
NIETZSCHE, F. (1887). Généalogie de la
morale. Paris: Gallimard. PEIRCE, C. S. (1978). Ecrits sur le signe.
(G. Deledalle, Trad.) Paris: Seuil.
PERALDI. (1980, Juin). "introduction" in La sémiotique
de Charles Sanders Peirce. Langages, 58.
RETHORE, J. (1980, Juin). "La sémiotique triadique de
C. S. Peirce". Langages(58), p. 32.
RIFFATERRE, M. (1982). "illusion référentielle"
dans Littérature et réalité. Paris: Larousse.
SAVAN, D. (1980, Juin). "La séméiotique de
Charles S. PEIRCE". Langages(58), p. 11.
45
SCHAFF, A. (1969). Langage et connaissance. Paris:
éditions Anthropos.
TODOROV, T. (1970). "Synecdoques", dans Recherches
rhétoriques, Communications,16. Paris: Seuil.
46
4. SYNECDOQUE ET LANGAGE DES OEUVRES D'ART
RÉSUMÉ
Le but de cet article est de rompre avec la confusion entre
synecdoque et métonymie en montrant que la synecdoque est une figure du
tout pour la partie ou de la partie pour le tout au sein d'une totalité
inaliénable. Par contre, la métonymie s'organise entre
éléments contigus au sein d'un ensemble conventionnel. L'objet
d'illustration de cette différence est un poème de Jean TOULET
Mots clés : synecdoque, métonymie,
préservation de la face, illocutoire, décomposition
sémantique.
ABSTRACT
The goal of this article is to break with muddle between
synecdoche and metonymy in showing that synecdoche is a figure of all for the
part or the part for the all among a totality inalienable. On the contrary, the
metonymy is organized between adjoining elements within a conventional whole.
The illustration object is a poem of Jean-Paul TOULET.
Key words: synecdoche, metonymy, face work, illocutionary,
semantic component
4.1. CADRE THÉORIQUE
Le but de ce projet est de montrer que la synecdoque, en tant
qu'essence du langage, peut servir d'herméneutique dans l'analyse des
poèmes considérés comme des oeuvres d'art. Pour tester
cette hypothèse, nous allons prendre comme preuve de la
démonstration le diptyque de Jean Paul TOULET suivant :
"Étranger, je sens bon. Cueille-moi sans remords
:
Les violettes sont le sourire des morts."5
Pour commencer, prenons une des définitions la plus
citée de la synecdoque, celle qui se trouve dans Sémantique
de la métaphore et de la métonymie (LE GUERN, 1972) :
« La synedoque est donc une espèce de
métonymie, par laquelle on donne une signification particulière
à un mot qui, dans le sens propre, a une signification plus
générale ; ou, au contraire, on donne une signification
générale à un mot qui, dans le sens propre, n'a qu'une
signfication particulière. En un mot, dans la métonymie, je
prends un mot pour un autre, au lieu que dans la synecdoque je prends le plus
pour le moins ou le moins pour le plus. » (LE GUERN, 1972, p. 12)
Il s'agit là d'une définition empruntée
à DUMARSAIS. Cette définition date de 1730. Mais elle a le
mérite de faire la distinction entre la métonymie et la
synecdoque, selon la remarque de LE GUERN lui-même. Une distinction dont
la postérité a eu du mal à maintenir compte tenu
5
http://www.florilege.free.fr/toulet/les_contrerimes.html
47
de la confusion des exemples qui sont tantôt
présentés comme métonymiques, tantôt relevant de la
synecdoque.
Parmi ces confusions, la plus célèbre nous
semble être celle d'un ouvrage de référence destiné
au milieu universitaire. Il s'agit du Dictionnaire de linguistique et des
sciences du langage par DUBOIS, Jean ; GIACOMO, Mathée ; GUESPIN,
Louis ; MARCELLESI, Jean-Baptiste et Christiane et MEVEL, Pierre (DUBOIS J. e.,
1994). Ouvrage hexacéphale mais qui donne sous l'entrée «
métonymie » l'exemple de « une voile à l'horizon
». Puis, à l'entrée « synecdoque », nous
lisons ceci :
« Quand un locuteur, intentionnellement, notamment
pour des raisons littéraires, ou une communauté linguistique,
inconsciemment, assignent à un mot un contenu plus étendu que son
contenu ordinaire, il y a synecdoque : « voile » pour « navire
» [...] »
Dans le domaine de la rhétorique, il est admis
généralement que la synecdoque est une sorte de métonymie
et que de la sorte elle finit par être absorbée par cette
dernière. Dès lors, ce qui explique la confusion, c'est la
polarisation sur la métaphore et la métonymie qualifiée
par Gérard GENETTE de rhétorique restreinte (GENETTE, 1970), une
polarisation favorisée par l'observation de deux mécanismes
opposés entre les deux. La métaphore opère au niveau de la
sélection, donc de l'axe paradigmatique pour faire trope et la
métonymie s'organise au niveau de la contiguïté, donc de
l'axe syntagmatique.
Roman JAKOBSON est un de deux qui légitiment cette
confusion. D'abord en définissant, suite au schéma de la
communication, la fonction poétique comme la projection des
équivalences paradigmatiques sur l'axe syntagmatique (JAKOBSON, 1981
(ed. or. 1964), p. 221). Ensuite en reprenant dans Essais de linguistique
générale (Ibid.) l'article « Deux aspects du langage et
deux types d'aphasie » publié en 1956.
C'est l'attitude générale jusqu'à la
publication par le Groupe de Liège (DUBOIS, Jacques ; EDELINE, Francis ;
KLINKENBERG, Jean-Marie ; MINGUET, Philippe ; PIRE, François et TRINON,
Hadelin de la Rhétorique Générale (DUBOIS J. , et
al., 1982). Dans cet ouvrage il est démontré que la
métaphore est une double synecdoque.
Si la réhabilitation de la synecdoque est ainsi
généralement admise, elle n'empêche pas la confusion de
s'installer. Aussi, cette communication est-elle un projet de
désambiguïsation. En passant par la synecdoque, elle visera la
métaphore dans ce diptyque. En effet, il est très curieux de
constater que les auteurs qui acceptent la position de la Rhétorique
Générale se contente de reprendre le même exemple qui
sert d'illustration à la métaphore, parmi eux TODOROV (TODOROV,
1970) et LE GUERN (LE GUERN, 1972)
Cette reprise du même exemple peut être comprise,
selon le principe du détachement du sens de Benoît DE CORNULIER
(CORNULIER, 1982, pp. 125-182), comme un acte de langage dans lequel, le
récitant ne fait qu'un acte locutoire sans s'engager sur la
validité de la théorie qui a permis d'écrire l'exemple. En
conséquence, il rejette la théorie.
48
On peut résumer de la sorte la règle du
détachement du sens : si quelqu'un dit une chose et que par des
procédures diverses, allant de l'implication à
l'interprétation explicite, assigne à ce qui est dit la valeur
d'un autre signe, on peut conclure que ce que signifie cet autre signe est
accompli de manière illocutoire.
Voyons cette règle à l'oeuvre dans l'exemple
suivant.
3. La terre est ronde, et cela est une affirmation des
scientifiques6.
En ce qui concerne cette dissociation annoncée, nous
pouvons rendre compte du détachement du sens à partir des textes
de LE GUERN qui écrit ceci de sa lecture de la Rhétorique
générale du groupe u :
« Pour ces auteurs, « la métaphore se
présente comme le produit de deux synecdoques ». Un exemple
permettra de mieux comprendre leur manière d'analyser ce
mécanisme : si un « bouleau » est transformé
métaphoriquement en « jeune fille », on aura abouti à
la métaphore par une synecdoque généralisante faisant
passer de « bouleau » à « fragile » puis une
synecdoque particularisante remplaçant « fragile » par «
jeune fille » (LE GUERN, 1972, p. 13)
Or, cette métaphore du « bouleau » pour
référer à « jeune fille » est exactement le
même exemple qui sert au Groupe de Liège d'illustration au fait
que la métaphore est une combinaison de deux synecdoques. Pourtant de la
manière que LE GUERN l'insère dans son analyse, on ne peut pas
trouver d'indice, même au niveau typographique, qui signale qu'il a
emprunté l'exemple à ces auteurs.
De ce point de vue, au niveau énonciatif, on peut
croire que le commentaire souscrit au sens du commenté. Car tout se
passe comme s'il y avait une adhésion à la théorie
commentée par appropriation énonciative de l'exemple. C'est ce
qu'indique l'absence d'indice permettant de le rattacher aux auteurs de la
Rhétorique générale.
Nous avons, en insérant les propos dans le cadre de la
règle du détachement du sens :
4. Voici un exemple, j'affirme la théorie par cet
exemple
Quand il ajoute quelques lignes plus loin, dans la même
page :
« Cette théorie, séduisante par son
ingéniosité, présente toutefois un grave
inconvénient : elle ne semble pas compatible avec les résultats
obtenus pas JAKOBSON à partir de l'observation clinique des cas
d'aphasie » (Ibid.),
on peut conclure de la même manière que
l'énonciateur accomplit l'acte de rejeter la théorie sans qu'il
faille chercher dans la séquence un verbe performatif qui soit
équivalent à rejeter. Car c'est la combinaison des deux passages
cités dans le texte en cours et dans le texte d'origine qui fait signe
et que ce signe renvoie au rejet par le caractère globalement
dépréciatif de la dernière citation. En tout cas, dire
d'une chose qu'elle a un grave
6 C'est de cette manière que la règle
du détachement du sens prend en charge le classique exemple : les
scientifiques affirment que la terre est ronde.
49
inconvénient et démontrer cet
inconvénient dans le même discours, équivaut à
conseiller de ne pas prendre cette chose au sérieux.
C'est exactement une extension au niveau discursif de ce qui
est produit dans l'exemple conversationnel suivant :
5. Pouvez-vous me passer le miel ?
Pour gloser cet exemple dans le cadre du détachement du
sens, nous allons emprunter à KERBRAT-ORECCHIONI son analyse du pareil
exemple : « Sans croyance à la littérarité, il ne
peut exister de trope. Semblablement :
« Tu peux me passer le sel ? » n'est à
considérer comme une requête « indirecte » qu'à
la condition d'admettre « normalement » toujours, une telle structure
(de par en l'occurrence son schéma prosodique) sert à
réaliser un autre acte de langage (demande d'information), et que plus
généralement, certaines « formes de phrases » ont pour
vocation d'exprimer telle valeur illocutoire plutôt que telle autre -
[...] » (KERBRAT-ORECCHIONI, 1994, p. 59)
Ce qui signale, en effet, à la réception de (3)
qu'il ne faut pas le prendre pour ce qu'il est : une interrogation sur la
capacité de passer le sel est l'évidence de cette
possibilité, alors la question serait une tautologie du possible, car
l'autre option qui consiste à demander à un handicapé
physique grave la possibilité de passer le sel est une pure
cruauté. C'est ainsi que l'interrogation s'engage dans le trope
illocutoire puisque :
« Dans le « trope illocutoire », les
contenus engagés dans ce mécanisme de renversement
hiérarchique sont de nature pragmatique (ce sont des valeurs
illocutoires), et non sémantique - mais cette différence mise
à part, le phénomène est à bien des égards
similaire à celui qui caractérise la métaphore ou
l'antiphrase ». (KERBRAT-ORECCHIONI C. , 1994, p. 58)
Ce qui veut dire que de l'interrogation, comme acte
affiché, dérive un autre illocutoire. Ce qui permet d'identifier
cet illocutoire dérivé, est l'échec pragmatique de
l'illocutoire affiché. Ce qui revient à dire que demander
quelqu'un sur la possibilité de faire quelque chose, c'est lui demander
de le faire. C'est cela qu'il faut entendre par requête.
Ce qui veut dire que l'illocutoire dénoté est la
requête et que l'interrogation devient du connoté dans (3). Ce qui
veut dire que ce trope illocutoire est commandé par une question de
préservation de la face laquelle permet de recourir, au cas où
l'illocutoire dérivé connaît une mauvaise réception,
à l'illocutoire affiché. C'est ce qu'implique DUCROT en ces
termes :
« Le problème général de
l'implicite, (...) est de savoir comment on peut dire quelque chose sans
accepter pour autant la responsabilité de l'avoir dit, ce qui revient
à bénéficier à la fois de l'efficacité de la
parole et de l'innocence du silence. » (DUCROT, 1972, p. 12)
Cette migration des données de l'analyse
conversationnelle vers l'analyse de discours se réalise à la
manière d'une homothétie. Au fait, il s'agit de réduire
leur différence de n'être plus que celle de la forme du corpus.
Elle permet de rendre compte dans ce travail du rejet de la
50
position du Groupe p. par LE GUERN qui a également du
mal à faire la différence entre synecdoque et métonymie.
Il cite comme exemple de métonymie « voix », de son occurrence
dans l'extrait de texte de Zola suivant :
6. De grosses voix se querellaient dans les
couloirs
C'est plutôt une synecdoque et nous allons
démontrer comment en reprenant l'analyse en décomposition
sémique du groupe p. à travers son interprétation par
Ladislav VÀCLAVIK qui en fait une application dans son travail :
« Selon le Groupe u, l'analyse des tropes conduit
à deux types de décomposition sémantique : conceptuelle
(désignée par E) et référentielle (Ð). Prenons,
par exemple, la classe sémantique des « voitures ». On peut la
considérer du point de vue référentiel : la voiture se
compose de différentes parties (châssis, axes, roues,
amortisseurs, moteur etc.) qui sont, entre elles, dans un rapport de produit
logique. Mais on peut regarder la voiture aussi du point de vue conceptuel : la
voiture est une classe de sous-classes (Peugeot, Citroën, Rolls-Royce,
etc.). (VACLAVIK, 2009)
L'intérêt de ce détour est qu'il montre
que le concept qui fonde la théorisation de la métaphore en
double synecdoque est un principe généralisé permettant au
langage d'être efficacement économique par recours à la
synecdoque. Du fait que cet exemple n'est pas emprunté au Groupe p.
implique que ce principe est accepté. Néanmoins, nous allons
faire une remarque qui concerne le mode de décomposition
référentielle.
Lorsque l'on parle de référent, il s'agit d'une
donnée extralinguistique. A priori cela ne saurait plus
concerner la linguistique et c'est cela qui a conduit JAKOBSON à
considérer que la relation de contiguïté qui
caractérise la métonymie est externe au langage. Notre
réponse à cette affirmation est qu'une fois le monde versé
dans le langage la catégorie du réel s'évanouit comme une
question inutile. Une autre manière de comprendre cette fuite du
réel se trouve sous la plume de Robert de MUSIL :
« [...], si l'on veut un moyen commode de distinguer
les hommes du réel des hommes du possible, il suffit de penser à
une somme d'argent donnée. Toutes les possibilités que
contiennent, par exemple, mille marks, y sont évidemment contenues qu'on
les possède ou non ; le fait que toi ou moi les possédions ne
leur ajoute rien, pas plus qu'à une rose ou à une femme. »
(MUSIL, 1982, p. 18)
Ou, si l'on veut, il faut admettre qu'il existe une
propriété isomorphe des noms et des choses : celle de se
comprendre par le système de renvois de chose à choses ou de nom
à noms. Ce qui veut dire que la décomposition
référentielle est toujours de nature linguistique comme le
stipule cette analyse qui précise celle du groupe p. :
« La praxis linguistique rend compte du réel
en transférant à l'« unité de typisation »
toutes les occurrences dont la variété n'importe pas au message,
en ramenant à l'« unité de hiérarchie signifiante
» toutes les occurrences présentes en une. Le praxème ne
produit du sens qu'en ce qu'il est cette double unité » (LAFONT,
1978, p. 134)
51
4.2. PRATIQUE
Nous pouvons affirmer à partir de ces efforts
théoriques que les noms sont des unités denses dans la langue.
Renforce cette densité, la possibilité de convertir tous les
autres parties du discours en nom par le moyen d'adjonction d'article et c'est
un bel exemple d'autonymie.
Cette densité provient du fait que le nom, en tant
qu'unité de typisation, renvoie à une multitude
d'éléments dotés des mêmes propriétés
(la classe du nom, arbre = peupliers, orangers, pommiers, baobab, etc.) par
oubli des différences individuelles qui importent peu au message, et
c'est une synecdoque particularisante. En tant qu'unité de
hiérarchie signifiante, il renvoie également à des
éléments plus petits (arbre = tronc, branches, feuilles, etc.).
Nos dictionnaires usuels choisissent les éléments subsumés
par l'unité de hiérarchie signifiante comme définition de
manière synecdochique. C'est ce que montre ici la présence de
« etc. »
Notre poème commence par le mot « Étranger
». Puisqu'il s'agit d'un nom commun, normalement, il doit comporter un
déterminant à cause de son insertion dans le discours. Mais cette
absence de déterminant n'est pas imputable à une infraction au
code linguistique. Elle est une conséquence d'un emploi
spécifique des noms communs : le vocatif. Le vocatif sert à
interpeller. C'est sa spécialisation illocutoire qui ne fait pas l'objet
d'une assertion ou d'une affirmation, mais seulement montrée par la
forme de l'énonciation. (Cf. (DUCROT, 1980, p. 30)). En l'occurrence,
l'absence d'article sur un nom commun inséré dans le discours.
Il s'agit donc d'un processus de renvoi qui permet à la
production d'un signe « Y » de signifier « Z » qui est de
nature illocutoire. CORNULIER appelle ce mécanisme de renvoi de signe
à signes « détachement du sens ». C'est de cette
manière que produire un vocatif équivaut à interpeller.
C'est une particularité des langues comme le
français qui connaît un genre grammatical d'étendre
celle-ci aux inanimés. En effet, si dans le monde des vivants, la
distribution en masculin et féminin est justifiée parce que
certains êtres vivants sont sexués ou du moins ont des traits
sexuels apparents, il n'en va pas de même dans le règne
végétal et encore moins dans l'univers du minéral. Il en
résulte qu'en langue, l'indice du registre du genre est l'article - ou
plus exactement les déterminants nominaux - et les adjectifs ou les
catégories traitées comme telles par la grammaire. C'est de cette
manière que « étranger », ici, reçoit une marque
grammaticale du genre parce qu'il dérive de la catégorie
d'adjectif par conversion, en dépit de l'absence de tout article.
Cette dernière remarque nous autorise d'envisager le
mot qui nous occupe du point de vue de son articulation sémiotique avec
les autres éléments de la langue. Cette articulation peut
correspondre au concept de « différance » (Cf. (DERRIDA,
1968), ou l'articulation de la substance et de la forme de contenu dont voici
le principe régissant : « Seules les fonctions de la langue, la
fonction sémiotique et celles qui en découlent,
déterminent sa forme. Le sens
52
devient chaque fois substance d'une forme nouvelle et n'a
d'autre existence possible que d'être la substance d'une forme
quelconque. » (HJLEMSLEV, 1968-1971, p. 70)
Ainsi dans notre exemple, « étranger » est
une forme du contenu « homme » - compte tenu de la remarque sur les
langues qui connaissent le genre - dans une perspective synecdochique parce que
ce n'est pas la totalité de la classe « homme » qui peut
être qualifiée d'"étranger", mais une partie seulement.
« Étranger » se comprend donc en tant que forme de substance :
homme qui n'a pas de lien de parenté avec le locuteur.
Nous voyons bien par explicitation de cette forme que le mot
« étranger » est une synecdoque particularisante pour homme.
Nous pouvons alors maintenant nous demander à quoi sert cette
synecdoque.
En anticipation des résultats de notre analyse, puisque
jusqu'à présent nous n'avons traité que le seul
élément qui commence le texte, nous pouvons dire que cette
synecdoque se justifie par le fait que par sa forme elle a pour valeur
illocutoire le respect de l'interdit de l'inceste.
Pour conforter cette réponse, embrayons-nous
immédiatement sur l'analyse du destinateur de la parole.
Commençons par l'identifier. En s'adressant à un étranger
sous une forme de contenu qui vise à préserver l'interdit de
l'inceste, il n'est pas excessif de conclure que le destinateur de la parole
est une femme.
Évoquons deux lieux communs pour corroborer cette
indentification sexuelle. Le premier de ces lieux communs consiste à
dire que la femme relève de l'être et l'homme du faire, dans le
cadre de la séduction. Rappelons qu'étymologiquement «
séduire » signifie « détourner du droit chemin ».
Il semble que ce premier lieu commun soit largement confirmé par notre
poème.
La mention de l'homme est strictement réduite à
l'emploi de ce vocatif si l'on ne tient pas compte de son implication dans
l'ordre « cueille-moi sans remords ». Autrement, tout le reste du
poème se caractérise par une description de la femme. Une
première description est constituée par l'attribution de
l'adjectif « bon » à la femme par le biais du verbe «
sentir » dont la relation avec le «sens » n'est plus à
démontrer, puisqu'il s'agit de mettre à contribution l'olfaction.
La description est donc une description d'état, ce qui renforce le lieu
commun évoqué.
Pour démystifier, faisons recours à la
règle de détachement du sens. Excepté le vocatif, l'on
sait facilement que tout le reste du poème doit concerner la femme,
puisqu'il s'agit d'une opération de séduction. La grammaire
traditionnelle définit « je » comme un pronom de la
première personne du singulier. BENVENISTE, s'oppose à cette
interprétation en arguant qu'on ne peut pas lui assigner un nom dont il
est le pronom. Ainsi, c'est de la manière suivante que ce professeur du
Collège de France entend donner une dimension fondamentalement
pragmatique à son approche de la question :
53
« L'acte individuel d'appropriation de la langue
introduit celui qui parle dans sa parole. C'est là une donnée
constitutive de l'énonciation. La présence du locuteur à
son énonciation fait que chaque instance de discours constitue un centre
de référence interne. Cette situation va se manifester par un jeu
de formes spécifiques dont la fonction est de mettre le locuteur en
relation constante et nécessaire avec son énonciation. Cette
description un peu abstraite s'applique à un phénomène
linguistique familier dans l'usage, mais dont l'analyse théorique
commence seulement. C'est d'abord l'émergence des indices de personne
(le rapport je-tu) qui ne se produit que dans et par l'énonciation : le
terme « je » dénotant l'individu qui profère
l'énonciation, le terme « tu », l'individu qui y est
présent comme allocutaire. » (BENVENISTE, 1970, p. 14)
Ce qui veut dire que dans la cadre de cette communication
amoureuse, ce « je » est également de nature synecdochique
parce qu'en dépit de sa singularité numérative, il renvoie
à toutes les femmes qui peuvent de la même manière
s'approprier cette énonciation. Ici, aussi, la référence
singulière de la femme désignée par « je », si
pour autant cette désignation est acceptée, sont toutes les
femmes qui peuvent assumer la même énonciation. C'est là le
propre de la communication littéraire : permettre aux lecteurs d'assumer
au niveau énonciatif ce qui est écrit dans le texte.
Benoît de CORNULIER, en dénonçant
l'attitude qui conçoit les onomatopées comme de mauvais signes
motivés, en arrive à montrer indirectement le rôle
fondamental de la synecdoque dans le fonctionnement de la langue. L'argument de
cette dénonciation consiste à dire que le langage peut s'imiter
lui-même. C'est ce que l'on appelle signe autonymique dont nous livrons
ci-après une des premières définitions que nous devons au
logicien philosophe Rudolf CARNAP qui se trouve en citation chez Alain REY
(REY, 1976, p. 224) :
« Puisque le nom d'un objet peut être
arbitrairement choisi, il est très possible de prendre pour nom de la
chose la chose elle-même, ou, pour nom d'une espèce de choses, les
choses de cette espèce. Nous pouvons, par exemple, adopter la
règle suivante : au lieu du mot allumette, une allumette sera toujours
placée sur le papier. Mais c'est le plus souvent une expression
linguistique qu'un objet extralinguistique qui est utilisée comme sa
propre désignation. Nous appelons autonyme une expression
utilisée de cette manière. ».
Cette autonymie peut se faire de deux manières,
à l'intérieur du langage lui-même ou à
l'extérieur. Pour ce dernier cas, voici ce qu'il en est dit :
« [...] comme quand un philosophe disant « je
» réfère à soi-même, personne
singulière, mais seulement en tant qu'exemple d'humanité, de
sorte que « je » paraît avoir une référence
universelle ; de même, quand on montre une cigarette en disant : Ceci
t'empoisonnera, l'objet singulier de la référence
littérale peut, pris comme type, « référer »
pour ainsi dire à toutes les cigarettes ou à leur classe. »
(CORNULIER, 1982, p. 138)
De ce point de vue, on peut comprendre facilement la remarque
précédente qui transfert à toutes les femmes dans une
situation de séduction ce qui est assumé par « je »
dans le poème. Par ailleurs il faut accepter que la distance qui
sépare le « je » à l'individu
54
biographique est une distance très fluctuante, voire
incommensurable comme le stipule RIMBAUD dans sa révolte contre la
littérature de son époque : « je est un autre ». Par
ailleurs, nous pensons qu'il ne faille pas chercher des données
biographiques pour comprendre l'oeuvre, la biographie de l'auteur est souvent
mal connue ou inconnaissable et les textes qui la prend en charge tourne
très vite à l'hagiographie.
Le deuxième lieu commun est aussi l'identification de
la femme à la passivité et l'homme à l'action. Cette
deuxième condition d'identification est également satisfaite dans
le poème. Ce qui l'assure est l'ordre donné par la femme dans
cueille-moi sans remords. Celui qui doit accomplir cet ordre est
l'homme et le patient de cette action est la femme.
Cependant, du point de vue de la parole, dans ce poème,
l'homme est allocutaire, c'est donc la femme qui est du côté de
l'action. Cette remarque ne permet pas de conclure que le deuxième lieu
commun est contredit. Il s'agit de dire, au contraire, que dans
l'opération de séduction, c'est la femme qui l'exerce sur l'homme
et l'homme séduit a pour mission de conquérir la femme.
En d'autres perspectives, en mesurant à l'aune du
détachement du sens cette conjonction d'un ordre verbal et
l'exécution impliquée, on s'aperçoit que le poème
renvoie à l'intuition des psychanalystes selon laquelle le
véritable sexe c'est la femme (Cf. (BRANDT, 1982). En effet, du fait de
la forme de la substance « homme » qui, justement, à cause de
cette synecdoque qui renvoie à la notion d'interdit de l'inceste ; la
communication qui est à sens unique se qualifie de communication
amoureuse. Cela ne contrevient pas du tout au deuxième lieu commun. En
dernier ressort et pour dire les choses sans fioritures, il faut croire qu'en
amour, c'est la femme qui se constitue en objet de quête.
Or, il n'est plus à démontrer que dans la
sémiotique narrative, objet de quête et objet de valeur sont une
seule et même chose et qu'en outre la valeur d'usage se confond avec la
valeur d'échange. C'est pour cette raison que dans ce diptyque, la
parole est exclusivement féminine. Du coup, « étranger
» cesse d'être une simple synecdoque, il devient aussi une
métaphore de l' « ignorance » via un terme
intermédiaire « non initié ».
Ce qui a permis au Groupe u d'afficher la métaphore
comme une double synecdoque, c'est que les termes de départ et
d'arrivée de la métaphore possède un point d'intersection.
Cette intersection peut s'étendre à l'un et à l'autre, par
synecdoque, de telle manière que l'un peut renvoyer à l'autre par
symbolisation. Il est d'une expérience banale de constater qu'un
étranger, dans une maison, par exemple, ne cesse de poser des questions
sur le fonctionnement de cette maison jusqu'au jour où la maison lui
sera devenue familière. Dès lors, le terme « non
initié » peut être compris comme une synecdoque
particularisante du terme « étranger » et synecdoque
généralisante de « ignorant » (l'étranger est
celui qui ne vient pas du pays et celui qui ne vient pas du pays ignore les
moeurs de ce pays). C'est ce qui permet de prendre « étranger
» comme une métaphore de l'"ignorant".
Ainsi, si la parole est exclusivement féminine dans ce
diptyque, c'est que dans une logique narrative, la métaphore de
l'ignorance impose le mouvement inverse ; celui de
55
parcourir le chemin qui mène de l'ignorance vers la
connaissance. C'est une pareille démarche narrative qui fait donner un
sens métaleptique au verbe « connaître » dans la plupart
de ses emplois dans la Bible comme dans celui-ci : Elkana connut Anne.
(Samuel 1, 19). On comprend alors que la valeur illocutoire de cette parole de
femme est une invitation - ou une requête - à entamer cette
démarche de reconnaissance.
Mais il faut reconnaître qu'il ne s'agit pas là
de la valeur illocutoire primitive car avant tout, cette parole féminine
a pour but pragmatique d'informer l'homme de certaines qualités de la
femme. De là, de cette valeur illocutoire primitive en dérive une
autre. Il n'est pas inutile de donner un commentaire de cette dérivation
illocutoire à travers le texte de Jean-Claude ANSCOMBRE : « Ainsi
le décodage de la requête « ouvrez la fenêtre »
dans « il fait chaud ici » nécessite de la part de l'auditeur
un raisonnement complexe dont les grandes lignes seraient :
Une opération de type implicature : « L a dit
: « il fait chaud ici » entraîne « L a chaud »
».
Un principe conversationnel général qui est
que l'on ne parle pas pour ne rien dire ni pour ne rien
faire.7 La motivation la plus claire de L pour dire qu'il a
chaud est de désirer de se rafraîchir.
Une loi de discours : communiquer un désir, c'est
demander la satisfaction de ce désir. L demande à ce qu'on le
rafraîchisse. La façon la plus rapide de le satisfaire serait
d'ouvrir la fenêtre. » (ANSCOMBRE, 1980, p. 87)
Pour donner raison à FREUD qui définit le
féminin comme caractérisé par un manque : le désir
du pénis - par opposition à l'angoisse de castration de l'homme -
il suffit d'intégrer son raisonnement à la logique narrative qui
fait naître le texte à partir d'un manque. Cette dernière
remarque permet de voir une nouvelle synecdoque dans le terme «
étranger ». Si nous avons pu découvrir en termes de
substance et forme de contenu que ce terme est une synecdoque particularisante
pour « homme » afin que l'énonciation puisse souscrire
à l'interdit de l'inceste qui est une valeur universelle ; maintenant,
on s'aperçoit qu'il est aussi une synecdoque croissante pour «
pénis ».
De ce point de vue, il semble que la femme contrevient au
second lieu commun qui, rappelons-le, assigne à la femme un rôle
passif. Cependant, il faut admettre ici que l'activité de la femme est
tout simplement verbal qui engage son allocutaire à des actions
définies par l'illocutoire dérivé que résume le
point (C) du mécanisme exposé par ANSCOMBRE. Dès lors, le
deuxième lieu commun est respecté car en communiquant son
désir, la femme fait agir l'homme. C'est cela le propre de la
requête. C'est ce qui se confirme littéralement dans «
cueille-moi sans remords » où la femme est l'objet de l'action de
l'homme.
La question qui va nous guider maintenant est de savoir par
quel mécanisme pragmatique, la femme convertit son propre désir
en instauration du manque chez l'homme bien que nous ayons entraperçu
cela sous la formulation de la requête comme illocutoire
dérivé d'une affirmation, à l'instant.
7 « Faire » dans le sens performatif de J.L. AUSTIN
56
Cette question nous amène à commenter la
séquence « je sens bon » avec conjointement « cueille-moi
sans remords ».
S'il est admis que le premier topique consiste à dire
que « la femme est » par opposition au fait que « l'homme fait
», il ne faut pas croire qu'il s'agit de la dimension ontologique de la
femme. Au contraire, la question ontologique ne saurait pas retenir une
linguistique qui s'occupe des variables de la forme du contenu,
conformément à l'affirmation de HJELMSLEV pour qui le sens
devient à chaque fois la substance d'une forme nouvelle et n'a d'autre
existence possible que d'être la substance d'une forme quelconque.
Ce qui veut dire qu'il est plus pertinent de convertir
l'affirmation péremptoire de l'être de la femme en affirmation de
paraître. C'est ce que l'industrie cosmétique a parfaitement
compris, notamment en matière de parfumerie.
Justement, la femme, en tant que substance de contenu, se
présente ici sous la forme d'un « je sens bon ». Tout se passe
comme si la femme ayant perdu la phéromone au cours de la
phylogénie se signalait à son partenaire sexuel par l'artifice du
parfum. Mais définir la femme du point de vue olfactif seulement est
réducteur. Ce qui nous amène à comprendre qu'il s'agit
là encore d'une synecdoque de la partie au tout.
Ce dire « je sens bon », en tant que synecdoque, est
caractéristique de la sexualité féminine, parce qu'il est
motivé par une question de préservation de la face comme le
souligne cette remarque de FREUD :
« Le développement des inhibitions sexuelles
(pudeur, dégoût, pitié) s'accomplit de bonne heure chez les
petites filles, et rencontre moins de résistance que chez les jeunes
garçons. Chez les filles également, le penchant au refoulement
sexuel paraît jouer un plus grand rôle, et lorsque les pulsions
sexuelles partielles se manifestent, elles prennent de préférence
la forme passive » (FREUD, 1962, p. 128)
Le paradoxe de cette synecdoque est qu'au lieu de minimiser la
séduction féminine, elle fonctionne comme une censure qui
interdit la totalité en même temps qu'elle la postule. Il ne
s'agit pourtant pas d'une interprétation psychanalytique de l'interdit
mais d'une exploitation du processus de renvoi qui fait que la substance femme
s'incarne dans plusieurs formes dont une seule est mentionnée par le
poème. Autrement dit, dans le processus de renvoi synecdochique - il en
va de même pour les renvois métonymiques - l'interdit absolu ne
peut pas exister, il implique toujours une transgression de l'interdit en
désignant l'objet de l'interdit à la convoitise.
C'est ainsi que cette parole qui semble être innocente
en définissant une forme de la substance « femme » en appelle
à la connaissance des autres formes que peuvent prendre cette substance,
au sens métaleptique du verbe connaître tel que cela est
exprimé un peu plutôt. Nous pouvons donc conclure que c'est par la
synecdoque comme censure que la parole féminine convertit son propre
désir en désir masculin.
On peut encore expliquer cette conversion d'une autre
manière convergente.
57
Elle s'organise au sein de la différence entre le
réel et le possible. Le concept de possible fut introduit en philosophie
par Wilhelm LEIBNIZ, pour la première fois, pour exprimer que le
réel peut prendre une autre forme comme on peut le constater dans des
énoncés simples comme celui-ci :
7. Si cette table n'était pas là, on ne se
cognerait pas à chaque fois pour ouvrir la fenêtre.
Depuis, la notion de possible n'a plus quitté toute
sémiosis dans n'importe quel domaine. À titre de preuve, il n'est
que de commenter cette affirmation de BOUDOT en citation chez Jean-Claude
PARIENTE :« Une théorie féconde du réel exige la
pensée de l'irréel » (PARIENTE, 1982, p. 43).
C'est-à-dire que notre évocation à
l'irréel n'est pas un renvoi à quelque chose de nul et non avenu
mais au contraire, à une autre forme du réel qui est
frappée d'inexistence au point que Luidwig WITTGENSTEIN nous apprend que
: « L'existence et l'inexistence des états de choses
constituent la réalité » (2.06) (WITTGENSTEIN, 1961, p.
86). Ou, encore mieux : « (...), nous ne pouvons imaginer aucun objet
en dehors de la possibilité de sa connexion avec d'autres objets
» (2.0121) (ibid, p, 32)
En définitive, la réalité de
l'affirmation « je sens bon », de par sa nature synecdochique, n'est
compréhensible que par sa possibilité de connexion avec autres
choses définies par la substance « femme ». Dire le moins pour
le plus a donc cet effet puissant et irrépressible de provoquer la
quête de la totalité par instauration du manque par la censure.
Autrement dit, de cette synecdoque croissante, on
s'aperçoit que le possible n'est pas ce qui s'oppose au réel mais
ce qui lui diffère éternellement.
Dans la mesure où l'activité de parole la
convertit en outil qui permet d'accomplir un travail. C'est une autre
manière d'expliquer la force illocutoire comme le suggère cette
analyse de Robert LAFONT :
« [...] lorsque le chasseur modifie la forme d'un
caillou pour en faire une arme contre un gibier éventuel.
Éventuel : il faut bien, dans l'opération de fabrication d'un
instrument, qu'un troisième objet soit absent et remplacé par son
image » (LAFONT, 1978, p. 19).
Autrement, l'activité qui produit la parole, ou pour se
fondre dans la terminologie d'AUSTIN : l'acte locutoire détermine par sa
forme une force illocutoire que l'on peut comprendre ici comme l'injonction
à l'homme de mener une quête de la totalité interdite et en
même temps postulée par la synecdoque.
Il s'agit d'une quête qui se trouve confirmée par
la séquence « cueille-moi sans remords ». Cette
séquence du texte a une particularité : l'adverbial sans
remords modifie le verbe « cueillir », mais la question cruciale
est de savoir pourquoi il le modifie puisque c'est l'objectif de la parole
féminine, après tout.
58
La première explication prend encore la voie de la
synecdoque dans la séquence « je sens bon » qui renvoie
à « fleur ». C'est une synecdoque particularisante parce que
tout ce qui sent bon n'est pas une fleur. Or, cueillir une fleur permet
peut-être de la sentir, mais c'est aussi un acte qui mène la fleur
assurément à la mort. On comprend maintenant pourquoi la
requête est modifiée par l'adverbial sans remords.
En outre, quand on se rend compte que celui qui
s'énonce de la sorte est identifié à la femme, cette
synecdoque préside à l'obtention de la métaphore
femme-fleur via l'intermédiaire « sentir bon ». Sans entrer
dans les détails de ce processus, voici en résumer ce
mécanisme : « Fleur » est une synecdoque particularisante de
« sentir bon » qui est à son tour une synecdoque
généralisante pour « femme ».
L'adverbial « sans remords » reprend alors la
question du Dasein de HEIDEGGER lorsqu'il affirme que :
« Le finir désigné par la mort ne
signifie pas un être-à-la-fin du Dasein, mais un être pour
la fin de cet étant. La mort est une guise d'être que le Dasein
assume dès qu'il est. « Dès qu'un homme vient à la
vie, il est assez vieux pour mourir » » (HEIDEGGER, 1984, p.
197)
Tout se passe comme si la femme intimait à l'homme
l'ordre de profiter de la vie même si cela se fera au détriment de
la femme. En effet, comme pour nous empêcher de manquer cette
interprétation, la seconde partie du poème renforce l'isotopie de
la fleur par une autre synecdoque très visible, la mention des «
violettes » avec une syllepse du nombre. C'est une synecdoque de la partie
pour le tout, c'est-à-dire, c'est un renvoi à fleur par mention
d'un élément de sa classe.
Pourtant, il ne suffit pas d'affirmer qu'il s'agit d'une
synecdoque, mais encore de justifier sa motivation. En effet, n'importe quel
élément de la classe du nom « fleur » aurait pu faire
l'affaire pour cette synecdoque, mais le choix de cette fleur précise
est motivé par le fait qu'une lecture synecdochique en son endroit
permet de retrouver sur le plan du signifiant le mot « viol ». Pour
dire les choses clairement, « violettes » renvoie à «
viol » par interprétation de l'adverbial « sans remords
».
Dès lors, « cueillir » n'est plus à
lire littéralement, et c'est une métaphore attestée qui
renvoie au fait de prendre la virginité d'une femme qui implique un viol
consenti ou non. De la manière où cette dernière partie
est énoncée : les violettes sont présentées comme
le sourire des morts ; il s'ensuit la même relation de différence
entre l'amour et la mort au même titre que le possible n'est pas ce qui
diffère du réel mais ce qui lui diffère
éternellement.
Tout se passe comme si pour déjouer la mort comme
horizon inéluctable de la vie - c'est dans ce sens que HEIDEGGER
précise le Dasein comme un être pour la mort et non comme
une simple fin du Dasein - la vie devenait un engagement à
l'amour, et cela pour deux raisons.
Premièrement, Dans la conception populaire l'orgasme
reçoit une conception de « petite mort » comme si en faisant
l'amour nous apprenons littéralement à maîtriser la mort.
Deuxièmement, en faisant l'amour nous nous donnons la chance d'avoir un
autre soi-même,
59
instaurant de la sorte dans la discontinuité de la vie
par la mort, une continuité par la naissance d'un enfant.
En prenant ensemble les deux arguments, leur
complémentarité devient une évidence. Si l'orgasme est une
petite mort de laquelle on revient, l'enfant est ce qui nous permet de revenir
de la mort futur, parce que par synecdoque, c'est une partie de nous-même
- démontrée par la découverte de l'ADN8 - qui
nous survit. Décidément, connaître la femme dans le sens
biblique du terme c'est en même temps apprivoiser la mort et la
déjouer.
C'est de la sorte que le viol, obtenu par
interprétation synecdochique du terme « violettes » devient
à son tour une synecdoque de l'initiation à l'amour, à
cause de sa conjonction avec le sens métaphorique de « cueillir
». Et de nouveau, en tenant compte du deuxième lieu commun, la
passivité de la femme dans le rapport amoureux, on peut dire que tout
acte d'amour est un viol du corps féminin.
Cette dernière remarque va nous permettre de mieux
comprendre pourquoi les violettes - désormais femme-fleur et viol du
corps féminin - a pour attribut le sourire des morts.
Dans l'expression « sourire des morts » nous avons
un oxymore qui est rendu possible par le renvoi métonymique de chose
à choses. Pour une première interprétation, dans la mesure
où la mort est un horizon inéluctable de la vie, « sourire
» devient une synecdoque de l'aspect positif de la vie qui va
s'abîmer inexorablement dans la mort. Une synecdoque particularisante qui
renvoie à la femme-fleur au moment où l'homme la cueille -
littéralement et dans tous les sens - parce que la mort renvoie par
métonymie aux larmes tandis que la femme renvoie par synecdoque à
la vie symbolisée par la naissance d'enfant.
Il y a lieu de croire que cette dernière synecdoque est
une valeur universelle associée à la femme puisqu'une preuve
inattendue dans une culture très éloignée de l'implication
culturelle du français l'atteste : la progéniture est
appelée dans la langue malgache « menakin'ny aina »,
littéralement « l'huile de la vie » que nous
préférons traduire par « chair de la vie » parce que
par métalepse, les liquides séminales au moment de l'orgasme
deviendra plus tard cette chair vivante qu'est l'enfant. Cependant, le sens
littéral n'est pas à écarter puisque dans les
péripéties de la vie, l'huile qui adoucit les dures frictions de
la vie se présente sous la forme de l'enfant, fruit de l'amour.
Ainsi, l'adverbial « sans remords » a pour valeur
illocutoire d'annuler le scrupule de l'homme devant la violence de la
cueillette, devant le viol du corps de la femme dans l'acte d'amour et dans le
travail de la femme pendant la parturiente. Il en résulte une sorte de
sacralité de la femme qui se sacrifie ainsi sur l'autel de l'amour.
Travaux cités
8 Acide désoxyribonucléique
60
ANSCOMBRE, J.-C. (1980). "Voulez-vous dériver avec moi?".
Dans Rhétoriques, Communications (Vol. 16, pp. 61-123). Paris:
Seuil.
BENVENISTE, E. (1970). "L'appareil formel de
l'énonciation". Langages(17), pp. 12 - 18.
BRANDT, P. A. (1982). Quelques remarques sur la
véridiction, Hommages aux Jefalumpes. Paris: Institut de Langue
Française.
CORNULIER, B. (1982). "Le détachement du sens" dans Les
Actes de Discours, Communications,32. Communications, p. 132.
DERRIDA, J. (1968). "La différance". Dans P. Sous la
Direction de SOLLERS, Théorie d'ensemble (p. 56). Paris:
Seuil.
DUBOIS, J. e. (1982). Rhétorique
Générale. Paris: Seuil.
DUBOIS, J. e. (1994). Dictionnaire de linguistique et des
sciences du langages. Paris: Larousse. DUCROT, O. (1972). Dire et ne
pas dire, Principes de sémantique linguistique. Paris: Hermann.
DUCROT, O. (1980). "Analyses pragmatiques". (Seuil, Éd.)
Communications(32).
FREUD, S. (1962). Trois essais sur la théorie de la
sexualité. Paris: Gallimard.
GENETTE, G. (1970). "Rhétorique restreinte", dans
Recherhces rhétoriques,. Paris: Seuil. HEIDEGGER, M. (1984).
L'être et le temps. édition électronique hors
commerce.
HJLEMSLEV, L. (1968-1971). Prolégomènes
à une théorie du langage. Paris: éditions de Minuit.
JAKOBSON, R. (1981 (ed. or. 1964)). Essais de linguistique
générale. Paris: Editions du Minuit.
KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1994). "Rhétorique et pragmatique:
les figures revistées. Langue française, 101(1), pp. 57
- 71.
LAFONT, R. (1978). Le travail et la langue. Paris:
Flammarion.
LE GUERN, M. (1972). Sémantique de la métaphore
et de la métonymie. Paris: Larousse. MUSIL, R. (1982). L'homme
sans qualités. Paris: Seuil.
PARIENTE, J.-C. (1982). "LEs noms propres et la
prédication dans les langues naturelles". Dans J. MOLINO, Les noms
propres (pp. 37-65). Paris: Larousse.
REY, A. (1976). Théorie du signe et du sens.
Paris: Klincsieck.
TODOROV, T. (1970). "Synecdoques", dans Recherches
rhétoriques, Communications,16. Paris: Seuil.
VACLAVIK, L. (2009). Le voyage, la femme et la poésie
dans l'oeuvre de poétique de Marcel Thiry - Essai d'un modèle
triadique. Roumanie: Thèse de Doctorat d'état.
61
WITTGENSTEIN, L. J. (1961). Tractatus logico-pholosophicus.
Paris: Gallimard.
62
5. LE DÉTACHEMENT DU SENS
RÉSUMÉ
La règle du détachement du sens que nous devons
à Benoît de CORNULIER permet à n'importe quelle
sémiotique de s'incorporer un sens déjà exprimable dans un
langage donné. Elle permet entre autres de caractériser les actes
illocutoires. Une expression est produite avant tout pour signifier, mais de la
forme de l'expression, on peut convenir d'une attitude du locuteur. Cette forme
participe à la fois d'une convention que met en évidence la
règle du détachement du sens.
Mots clés : sémiotique, sens, détachement du
sens, illocutoire, convention
ABSTRACT
The rule of the detachment of the meaning that we owe to
Benoît de CORNULIER allows any semiotics to incorporate a sense already
expressible in a given language. It allows among others to characterize the
illocutionary acts. An expression is produced primarily to mean, but from the
form of expression, we can agree on an attitude of the speaker. This form is
both a Convention that highlights the rule of detachment of the meaning.
Key words: Key words: semiotics, sense, detachment of the
meaning, illocutionary, convention
L'analyse qui va être proposée ici est une
exploitation de la règle du détachement du sens comme principe
qui permet d'accomplir un acte de langage par le biais d'une
interprétation fournie par la relation entre l'interprété
et l'interprétant. Cependant, Benoît de CORNULIER, à qui
nous devons la mise à jour de cette notion de détachement du
sens, distingue deux types de détachement : la version faible et la
version forte.
La version faible accepte n'importe quel système
sémiotique au niveau du plan de l'expression auquel est assignée
une interprétation qui impose un interprétant
nécessairement de nature linguistique. Cette conversion d'un
système sémiotique quelconque en système linguistique est
plutôt banalement exploitée dans la communication humaine pour
effectuer des actes illocutoires.
Rappelons pour mémoire que selon HJELMSLEV, il faut
entendre par sémiotique une fonction qui relie deux grandeurs qui se
définissent ainsi mutuellement comme plan de l'expression et plan de
contenu. Nous devons préciser que cette sémiotique milite contre
l'idée que le signe est signe de quelque chose qui lui est
extérieur, une rupture épistémologique amorcée par
la théorie du signe saussurienne mais qui va au-delà.
En effet, chez SAUSSURE, c'est la combinaison du signifiant et
du signifié qui forme le signe, et le signe ainsi obtenu sert à
désigner un objet du monde. En revanche, pour HJELMSLEV la
sémiotique n'est qu'une fonction :
« Pour ce faire, nous cesserons pour le moment de
parler de signes car, ne sachant ce qu'ils sont, nous cherchons à les
définir, pour parler de ce dont nous avons
63
constaté l'existence, c'est-à-dire de la
FONCTION SÉMIOTIQUE posée entre deux grandeurs : EXPRESSION et
CONTENU. » (HJLEMSLEV, 1968-1971, pp. 66-67)
Cette définition n'implique pas qu'une
sémiotique soit nécessairement de nature linguistique. C'est ce
que confirme GREIMAS en posant l'existence d'une sémiotique du monde
naturel, une autre manière de présenter le principe
d'isomorphisme entre le mot et la chose :
« Il suffit pour cela de considérer le monde
extralinguistique non plus comme un référent « absolu »
; mais comme le lieu de la manifestation du sensible, susceptible de devenir la
manifestation du sens humain, c'est-à-dire de la signification pour
l'homme, de traiter en somme le référent comme un ensemble de
systèmes sémiotiques plus ou moins explicites ». (GREIMAS,
1970, p. 52)
Chez WITTGENSTEIN, nous pouvons aussi constater cette
affirmation du principe d'isomorphisme entre mot et chose quand il dit que :
« (...), nous ne pouvons imaginer aucun objet en dehors de la
possibilité de sa connexion avec d'autres objets » (2.0121)
(WITTGENSTEIN, 1961, p. 30).
Il est inutile de produire d'avantage de preuves de ce
principe d'isomorphisme, faisons remarquer tout simplement à la
lumière de cet aphorisme du philosophe viennois que la connexion de
chose à chose n'est autre chose que l'établissement d'une
fonction sémiotique entre deux grandeurs. Poursuivons, par contre, un
autre cheminement de la sémiotique.
SAUSSURE, en définissant le signe linguistique, n'a
pas, lui non plus, manqué de remarquer que le monde naturel peut
être signifiant. Il pose ce système signifiant comme existant
à côté de la linguistique :
« On peut donc concevoir une science qui
étudie la vie des signes au sein de la vie sociale ; elle formerait une
partie de la psychologie sociale, et par conséquent de la psychologie
générale ; nous la nommerons sémiologie (du grec
sëmeîon, « signe ». Elle nous apprendrait en quoi
consistent les signes, quelles lois les régissent. Puisqu'elle n'existe
pas encore, on ne peut pas dire ce qu'elle sera ; mais elle a droit à
l'existence, sa place est déterminé d'avance. La linguistique
n'est qu'une partie de cette science générale, les lois que
découvrira la sémiologie seront applicables à la
linguistique, et celle-ci se trouvera ainsi rattachée à un
domaine bien défini dans l'ensemble des faits humains. » (SAUSSURE,
1982, p. 33)
BENVENISTE n'accepte pas cette hiérarchisation qui fait
de la linguistique un territoire banlieusard de la sémiologie, il
inverse cette hiérarchie en précisant que toute sémiotique
se construit sur le modèle linguistique. Ce qui veut dire in fine
que le dernier interprétant de tout système
sémiotique est la linguistique :
« Toute sémiologie d'un système
non-linguistique doit emprunter le truchement de la langue, ne peut donc
exister que par et dans la sémiologie de langue. Que la langue soit ici
instrument et non objet d'analyse ne change rien à cette situation, qui
commande toutes les relations sémiotiques ; la langue est
l'interprétant de tous les autres systèmes, linguistiques et
non-linguistiques. » (BENVENISTE E. , [1974] 1981, p. 60)
64
En définitive, que l'on se meuve dans une
sémiotique non linguistique ou que l'on évolue dans une
sémiotique linguistique, l'intelligibilité d'un système
sémiotique demeure la fonction sémiotique unissant deux
grandeurs, terme absolument neutre dont se sert HJELMSLEV pour désigner
les fonctifs d'une fonction. Position théorique qui dispense de
définir ce que c'est un signe et qui a l'avantage de permettre à
une sémiotique d'être le fonctif d'un langage : sémiotique
connotative ou sémiotique métalinguistique. Une position
théorique saluée par ALMEIDA en ces termes :
« Pour Hjelmslev le langage ne contient rien que du
langage. La sémantique n'existe pas. Il n'existe qu'un plan d'expression
et un plan de contenu, appliqué à un inventaire. Mais rien ne dit
que l'expression doive être nécessairement sonore ni le contenu
nécessairement conceptuel. Ces deux niveaux ne sont définis que
relationnellement, et ne s'appliquent qu'à tout inventaire qui en est
doté. Il n'y a donc rien à abstraire, car il n'y a pas de noyau,
pas de sèmes, pas de classèmes, pas de traits pertinents. Il n'y
a, somme toute, qu'un inventaire, et tout se trouve dans l'inventaire. »
(ALMEIDA, 1997)
Pour illustrer cette fonction sémiotique, nous pouvons
prendre l'exemple suivant : 1. « Les plantes xérophiles
possèdent des racines aériennes sous forme d'épine
».
Dès lors, à la lumière de cet exemple,
nous pouvons dire qu'observer des plantes, c'est les constituer en
sémiotique, c'est-à-dire en système signifiant qui
s'adjoint du contenu par la fonction sémiotique. On parlera alors de
sémiotique des plantes justifiant la célèbre affirmation
de SAUSSURE (1982, p. 157) selon laquelle, la langue est une forme et non une
substance.
HJELMSLEV (1968-1971, p. 68 et passim) nous prévient
que rien n'autorise de faire précéder la langue par la «
substance de contenu » et démontre qu'il y a un principe
d'isomorphisme qui fait qu'il existe une forme et une substance à la
fois du contenu et de l'expression et que de la sorte: "Le sens devient
chaque fois substance d'une forme nouvelle et n'a d'autre existence possible
que d'être la substance d'une forme quelconque." (HJLEMSLEV, 1968-1971,
p. 70)
La confusion post-hjelmslevienne de l'interprétation de
ce principe d'isomorphisme est semblable à celle de la mise à
jour de l'arbitraire du signe de la part de SAUSSURE (1982, p. 100). En voulant
démontrer l'arbitraire du signe, la théorie fait intervenir le
référent. La critique portée par BENVENISTE ([1966] 1982,
p. 52) à ce sujet voit dans le rapport des parties du signe, une
nécessité et ; dans celui du signe au référent,
l'arbitraire.
Il existe pourtant une analyse qui démontre que le sens
se lit sur la forme. Nous sommes alors très loin de la simplification
qui consiste à faire des signes linguistiques des désignations
d'objets du monde. Au contraire, le signe est inscrit dans un schème
d'action sur le monde au même titre que les objets dont nous nous
servons. Voici un passage que nous jugeons explicatif de la théorie du
signe chez HJELMSLEV :
65
« L'hominisation de l'espèce commence lorsque
l'individu se sert d'un objet pour en modifier un autre en vue d'une action que
ce second assume : lorsque le chasseur modifie la forme d'un caillou pour en
faire une arme contre un gibier éventuel. Éventuel : il faut bien
dans l'opération de fabrication d'un instrument, qu'un troisième
objet soit absent et remplacé par son image. La "certitude sensible"
nécessaire au travail est prise en charge par la représentation.
Un langage qui relaie le geste déictique est là pour
épouser le mouvement de naissance de l'activité
sémiotique. Le sens surgit. C'est ce sens que nous lisons quand nous
interprétons comme instrument la modification non accidentelle d'un
silex : le signe d'une activité qui opère dans l'absence de son
objet. » (LAFONT, 1978, p. 19)
Autrement dit, cette théorie du signe nous apprend que
le mouvement de la référence ne s'arrête à la
désignation de l'objet auquel cas le signe est totalement arbitraire. Le
fait nouveau est donc que la forme signe permet de connaître ce qu'elle
permet d'accomplir moyennant une utilisation que Benveniste appelle
énonciation. Ce qui nous situe d'emblée dans la théorie de
l'action. C'est de cette manière que l'on peut assumer l'affirmation
selon laquelle le langage ne peut pas être une tautologie du
réel.
De ce point de vue, le rapprochement que l'on fait entre
SAUSSURE et PEIRCE est un rapprochement conflictuel qui met en évidence
leur différence irréductible. L'équivalence se situe entre
HJELMSLEV et PEIRCE. Quand la sémiotique du linguiste danois assigne
à l'identité du signe une fonction, cela veut dire exactement que
tout est signe pourvu qu'il soit pris en charge par la fonction
sémiotique. C'est ce qui se passe également chez PEIRCE :
« [...], il n'a pas été plus en mon
pouvoir d'étudier quoi que ce fût - mathématiques, morale,
métaphysique, gravitation, thermodynamique, optique, chimie, anatomie
comparée, astronomie, psychologie, phonétique, économie,
histoire des sciences, whist, hommes et femmes, vin, métrologie, si ce
n'est comme étude de sémiotique » (LW 422) (MARTY, 1980, p.
29)
Cette première analogie est renforcée par une
autre plus importante à nos yeux. Les textes de
Prolégomènes à une théorie du langage nous
apprennent qu'une sémiotique connotative peut être à son
tour devenir l'expression d'une nouveau contenu et ainsi de suite
indéfiniment. Il en est exactement de même de la définition
du signe chez PEIRCE :
« Un signe ou representamen est un Premier qui se
rapporte à un second appelé son objet, dans une relation
triadique telle qu'il a la capacité de déterminer un
Troisième appelé son interprétant, lequel assume la
même relation triadique à son objet que le signe avec ce
même objet ... Le troisième doit certes entretenir cette relation
et pouvoir par conséquent déterminer son propre troisième
; mais, outre, cela, il doit avoir une seconde relation triadique dans laquelle
le representamen, ou plutôt la relation du representamen avec son objet,
soit son propre objet, et doit pouvoir déterminer un troisième
à cette relation. Tout ceci doit également être vrai des
troisièmes du troisième et ainsi de suite indéfiniment...
» (2.274) (PEIRCE C. S., 1979, p. 147)
De cette longue discussion dans laquelle nous avons fait
référence à des auteurs de divers horizons, il nous semble
que la théorie qui considère que le référent
extralinguistique
66
n'est pas le référent ultime est plus conforme
à notre utilisation du langage. C'est une théorie plus puissante
parce qu'elle permet de rendre compte de la performativité de nos
énonciations. Pour une illustration sommative de cette théorie
sémiotique, nous allons prendre un exemple banal, facilement observable
dans les milieux citadins et qui va nous permettre que la véritable
référence des signes est le rapport interlocutif. Observons alors
(2) :
2. Chien méchant
Il s'agit d'un écriteau qui s'affiche
généralement sur le portail des domaines privés. Cette
affichette se décline dans toutes les langues et est souvent
accompagnée d'une représentation graphique d'une tête de
chien, bouche ouverte, montrant ses crocs. En admettant que les
différentes représentations sont globalement équivalentes,
nous préférons alors faire l'analyse du signe iconique. La raison
de cette préférence est une souscription au fait que les fonctifs
d'une sémiotique sont solidaires.
La première remarque que nous allons présenter
est toujours en relation avec la théorie du signe discutée
précédemment. À la réception d'un message de ce
genre, le destinataire ne se contente pas de conclure à la
présence d'un chien doté d'une qualité définie
comme méchante dans le domaine - ce serait privilégier uniquement
la fonction désignative -. Il analyse le message surtout en fonction du
rapport interlocutif et se considère comme averti par le signe ainsi
produit.
On peut maintenant supposer le problème qui se posera
aux analphabètes ou à des gens qui ne comprennent pas le
français. Pour sortir de cette impasse la société s'est
dotée de signe iconique qui représente un chien. Nous retrouvons
alors la pertinence de la sémiotique qui n'est pas forcément
linguistique. Cette dernière remarque est en même l'occasion
d'articuler cette théorie du signe au détachement du sens.
Benoît de CORNULIER nous présente le
détachement faible du sens selon la formulation suivante :
((P & (P implique Q)) implique Q (CORNULIER, 1982, p. 127)
Dans cette thèse, il est soutenu que si on peut
démontrer P et que si de plus P implique Q, alors la production de P
revient à produire Q. Autrement dit, l'idée du détachement
faible du sens est qu'à toute sémiotique - qui n'est pas
nécessairement linguistique - est assignée un interprétant
et que la conjonction d'un interprété avec une
interprétation implique l'interprétant. C'est ce que laisse
prévoir le système de parenthèses dans la formule : la
production de P conjointement avec l'interprétation que (P implique Q)
implique Q.
On s'aperçoit alors que, dans notre exemple, afficher
sur un portail l'icône d'un chien méchant et que cet affichage
implique que l'on avertit, c'est littéralement accomplir un
avertissement. Ce qui veut dire exactement que la règle du
détachement du sens est une formulation qui permet de rendre compte de
la force illocutoire de toute sémiosis. Il est très remarquable
de constater que la généralisation de la performativité,
à tous les énoncés, due
67
à l'introduction de l'implicite dans la théorie,
un implicite compris comme l'absence du préfixe performatif au niveau de
la structure de surface, peut être également étendue
à toute sémiosis.
Cette sur-généralisation consiste à
déplacer la question de la référence de la forme « de
quoi parle le signe ? » (dénotation) à « pourquoi la
sémiose est-elle produite ? ». Ou, plus précisément,
le mouvement de la référence, c'est-à-dire,
l'interprétation, n'est pas épuisé par la première
question, mais en passant par elle, finit dans la seconde et montre clairement
que toute communication a pour but de modifier un rapport interlocutif. Ce qui
revient à dire avec CARNAP que syntaxe et sémantique sont
commandées par des buts pragmatiques.
Étant donné que notre analyse du
détachement du sens aboutit à cette
sur-généralisation, il convient maintenant de s'interroger sur le
rapprochement entre HJLEMSLEV et PEIRCE puisque le point de départ de
cette analyse est une interrogation sur le statut du signe. Autrement dit, nous
voulons commenter par ce rapprochement la remarque suivante de BENVENISTE :
« La difficulté qui empêche toute
application particulière des concepts peirciens, hormis la tripartition
bien connue, mais qui demeure un cadre trop général, est qu'en
définitive le signe est posé à la base de tout l'univers
entier, et qu'il fonctionne comme principe de tout ensemble, abstrait ou
concret. L'homme entier est signe. Mais finalement ces signes, étant
tous signes les uns des autres, de quoi peuvent-ils être signes qui NE
SOIT PAS signe ? » (BENVENISTE E. , [1974] 1981, pp. 44-45)
On peut répondre de diverses manières à
cette question posée, mais il nous semble judicieux de prendre cette
question comme un commentaire de la théorie des interprétants
dans la sémiotique triadique. D'après la définition du
representamen (Cf. supra), l'interprétant est soumis au
régime du « ainsi de suite et indéfiniment »,
ce qui implique que le processus sémiotique ne s'arrête jamais.
La réponse donnée à ce problème
par Joëlle RHÉTORÉ (1980, p. 32) est une introduction de ce
qu'il appelle « protocole mathématique ». C'est-à-dire,
pour que les entiers naturels ne soient pas une série de hasards, il
faut trouver une règle permettant leur énumération car une
série de hasard n'a d'autre détermination des membres que leur
énumération selon KOLMOGOROV et CHAÏTIN, cités par
SAVAN (1980, p. 11). Cette règle sera donc n+1, dès lors les
entiers naturels sont une progression arithmétique de raison « 1
», de la sorte le régime ainsi de suite et indéfiniment est
largement acceptable. Cette règle permet d'organiser la théorie
triadique de la sorte : 1 renvoie à 2 par l'intermédiaire de 3
qui introduit la règle, ou pour dire les choses dans la terminologie de
PEIRCE : le premier renvoie au second par l'intermédiaire d'un
troisième. Ce qui a permis à RÉTHORÉ donner la
conclusion suivante : « Tout est signe du moment qu'il est saisi par la
pensée, qui est une tiercéité, c'est-à-dire une
médiation entre le monde des Possibles (premier) et le monde des
Existants (second). La pensée met en relation des premiers avec les
seconds ; elle est donc ce qui permet de les concevoir et de les relier ; elle
est donc nécessairement d'une nature différente »
(RÉTHORÉ, 1980, p. 33)
68
Appliquons ce protocole mathématique à notre
exemple.
Le premier est l'icône du chien qui renvoie à un
existant : l'animal ainsi dénommé par l'intermédiaire
d'une loi « la méchanceté ». Le premier est
qualifié d'être le monde des possibles, c'est-à-dire de
simples « peut-être » pas nécessairement
réalisés, explique le fait que dans le monde, il n'existe deux
langues qui nomment de manière identique le même existant, hormis
les cas d'emprunt dans lequel le matériel phonique subit la forme
phonologique de la langue cible. On s'aperçoit déjà que le
premier le choix arbitraire d'une forme dans le mouvement de la
dénotation et non dans celui de la signification : « La
catégorie de la Priméité est celle du commencement, de la
nouveauté, de la liberté, de la possibilité et de
l'indétermination » (SAVAN, 1980, p. 11)
C'est pour cette raison que BEVENISTE ([1966] 1982, p. 51)
montre clairement que l'arbitraire du signe n'est pas dans le signe, dans le
rapport du signifiant au signifié mais dans le rapport du signe ainsi
obtenu avec le référent. C'est cela aussi qui constitue la raison
fondamentale que PEIRCE ne commence pas par les êtres cardinaux mais par
les êtres ordinaux. Ce premier indique en effet que c'est un esprit qui
nomme les choses et non les choses qui possèdent des noms qu'il s'agit
de trouver ou de retrouver.
Ce principe de l'arbitraire ne doit pas nous conduire à
penser que le signe doit être dyadique : une simple relation du premier
au second. Il ne faut pas non plus conclure qu'en faisant du premier une
synthèse du signifiant et du signifié, on obtienne un signe
triadique par adjonction du référent. Le premier n'admet pas
cette division.
Par ailleurs, il faut aussi reconnaître que le
troisième ne peut pas être le signifié. Le troisième
est de l'ordre de la loi qui permet une progression non hasardeuse et non de
l'ordre de la loi pour autoriser la dénotation.
L'intelligence qui a mis sur son portail l'icône d'un
chien avec l'interprétant « méchant » vise par cette
interprétation à avertir les destinataires d'un danger possible
d'une effraction. Cet avertissement à son tour lui permet
d'éviter des conflits éventuels à son tort en cas de
morsure. Éviter ce tort, lui permet de maintenir une bonne relation de
voisinage. Une bonne relation de voisinage lui permet de demander l'aide des
voisins en cas de problème qu'il ne peut lui-même résoudre,
et ainsi de suite indéfiniment.
Nous voyons maintenant que l'interprétant est de nature
dynamique que ne saurait enregistrer aucun dictionnaire. Il n'y aura jamais un
dictionnaire des interprétants alors que les dictionnaires des
signifiés sont courants. L'interprétant est bel est bien un
processus ad infinitum par lequel, l'interprétant devient
à son tour un premier et engage de nouveau une nouvelle relation
triadique, l'interprétant de cette nouvelle relation triadique, à
son tour devient un premier, et ainsi de suite indéfiniment.
La question qui mérite notre attention est maintenant
de savoir si le processus peut s'arrêter. En revenant au protocole
mathématique à l'origine de cette discussion, il semble que le
processus ne s'arrête jamais, il est virtuellement en progression
indéfinie, mais seulement l'esprit ne peut pas suivre cette progression
indéfinie de la même manière qu'il ne
69
vient à l'esprit de personne de suivre la progression
de la suite des nombres entiers naturels jusqu' à un million, par
exemple. C'est pour cela que Robert MARTY introduit l'idée de
stabilisation du processus : « On peut dépasser cette apparente
contradiction en introduisant la notion de processus convergent, ainsi
défini : à partir d'un certain rang, la suite des
interprétants (donc aussi celle des objets) devient stationnaire,
c'est-à-dire qu'interprétants et objets se reproduisent ad
infinitum identiques à eux-mêmes, (...) » (MARTY, 1980,
pp. 3738)
On affirme souvent que les textes de PEIRCE contiennent une
présentation pragmatique des signes, notre analyse du détachement
du sens milite dans ce sens. On peut rappeler brièvement cette
convergence en reprenant notre exemple. Ainsi, l'interprété est
l'icône du chien, et l'interprétant est l'écriteau «
chien méchant ». Dès lors, en application de la règle
du détachement du sens (variante faible), la conjonction de
l'interprété avec l'interprétant implique
l'interprétant ; en l'occurrence l'affirmation d'un animal
dénommé chien et qui est doté d'une qualité
reconnue méchante, et faisant cette affirmation, l'auteur du signe
avertit, etc.
L'analyse de DUCROT corrobore également cette
théorie de l'interprétant dans la sémiotique triadique
quand il affirme que :
« Interpréter un énoncé, c'est y
lire une description de son énonciation. Autrement dit, le sens d'un
énoncé est une certaine image de son énonciation, image
qui n'est pas l'objet d'un acte d'assertion, d'affirmation, mais qui est, selon
l'expression des philosophes anglais du langage, « montrée » :
l'énoncé est vu comme attestant que son énonciation a tel
ou tel caractère (au sens où un geste expressif, une mimique,
sont compris comme montrant, attestant que leur auteur éprouve telle ou
telle émotion) ». (DUCROT, 1980, p. 30)
Ce qui veut dire exactement que l'énoncé
n'assume le mouvement de la référence que par
l'interprétant que lui fournit l'énonciation. Il suffit d'ajouter
que l'énonciation accomplit au moins un acte de langage pour retrouver
la série d'interprétants dans la préoccupation pragmatique
comme nous l'avons essayé de montrer dans notre exemple.
En effet, le plus souvent, l'analyse pragmatique se contente
d'identifier à la manière des tropes, un acte illocutoire
littéral et un autre dérivé pour arriver à ce que
KERBRAT-ORRIOCHINI appelle trope illocutoire :
« (...) « Tu peux me passer le sel ? » peut
être considéré comme un trope dans la mesure où
l'énoncé signifie bel et bien « Passe-moi le sel »,
comme en témoignent l'enchaînement, et le fait que les conditions
de réussite auxquels est soumis un tel énoncé sont pour
l'essentiel celles qui caractérisent la requête ,et non celles qui
sont propres à la question (en tant que question, l'énoncé
est non « relevant » donc susceptible d'échouer ») : de
même que dans une métaphore, ses conditions de
vérité concernent avant tout le sens dérivé, de
même en cas de trope illocutoire, ses conditions de réussite sont
liées à la valeur dérivée et non point
littérale. » (KERBRAT-ORECCHIONI C. , 1994, p. 59)
70
Mais démêler l'acte littéral de l'acte
dérivé, n'est-il pas verser dans une activité
métalinguistique ?
Et HJLEMSLEV de nouveau. Dans son effort théorique de
traiter les problèmes de significations à partir de la forme,
HJELMSLEV distingue deux types de sémiotiques symétriquement
inverses. La première est appelée sémiotique connotative.
La sémiotique connotative est une sémiotique dont le plan de
l'expression est déjà une sémiotique. L'exemple qui sert
à HJELMSLEV à illustrer la connotation est la notion de style. On
peut opposer ainsi dans un texte un style vernaculaire qui au-delà de ce
qui est dit, montre dans la manière de dire le lien solidaire du
locuteur à une communauté régionale par opposition au
style nationale qui tend à neutraliser cette appartenance
régionale. La définition qui en est proposée est la
suivante : « Il semble donc légitime de considérer
l'ensemble des connotateurs comme un contenu dont les sémiotiques
dénotatives sont l'expression, et de désigner le tout
formé par ce contenu et cette expression du nom de SÉMIOTIQUE, ou
plutôt de SÉMIOTIQUE CONNOTATIVE. » (HJLEMSLEV, 1968-1971,
pp. 151-152)
La deuxième est appelée
métasémiotique. C'est une sémiotique dont le plan de
contenu est lui-même une sémiotique. HJLEMSLEV qualifie la
métasémiotique de scientifique : « D'ordinaire, une
métasémiotique sera (ou pourra être) entièrement ou
partiellement identique à sa sémiotique objet. La linguistique
par exemple, qui décrit une langue, aura elle-même recours
à cette langue dans sa description » (HJLEMSLEV, 1968-1971, p.
152)
La différence entre sémiotique scientifique et
sémiotique non scientifique mérite d'être analysée
pour éviter toute méprise. Nous comprenons par catalyse, de la
manière avec laquelle sont présentées les deux
sémiotiques, que la sémiotique connotative n'est pas
scientifique. La méprise à éviter se situe au niveau de
l'analyse. Dans les objets littéraires ou objets poétiques, les
descriptions valent toujours comme commentaires. C'est-à-dire, une
application du principe d'immanence qui ne saurait accepter des objets
extérieurs qu'à titre de confirmation de l'analyse. Ce qui veut
dire que l'objet littéraire est une hiérarchie qui se trouve
décrite par les connotateurs.
C'est ce que l'on peut visualiser par la formule suivante, en
admettant que le symbole E vaut pour l'expression, que R indique la relation
sémiotique et C, le contenu :
(E R C) R C = sémiotique connotative.
Il n'y a pas de raison que la sémiotique connotative ne
puisse pas connaître un processus ad infinitum
théoriquement, puisque la stabilisation prévue par Robert MARTY
(supra) implique qu'à un certain moment la progression devient
stationnaire. On aura donc la visualisation suivante :
(((E R C) R C1) R C2) R Cn+1
Ce qui veut dire que la sémiotique connotative, si elle
n'est pas scientifique n'implique qu'elle doit être laissée hors
du champ de la scientificité comme le montrent les travaux d'analyse en
sémiotique littéraire.
71
En revanche, la sémiotique métalinguistique est
une hiérarchie décrivante, et c'est en cela qu'elle est
scientifique ; en effet, étant donné qu'elle est aussi une
sémiotique, nous pouvons reprendre les mêmes symboles afin d'en
donner la visualisation suivante :
E. R (E R C)
Le métalangage peut aussi connaître une
progression ad infinitum sous la même réserve
indiquée par Robert MARTY :
(((E. R (E R C))1 R (E R C))2 R (E R C)n+1
La formule du métalangage peut être comprise
comme une autre version de la sémiotique triadique mutatis mutandis.
L'objection sérieuse que l'on peut opposer à ce
rapprochement est que dans la sémiotique de HJELMSLEV le signe est
biplan tandis que le signe de PEIRCE est triadique. Cependant, nous ne pouvons
pas retenir cette objection, car le style épistémologique de
HJELMSLEV est pour le moins original dans le traitement du problème des
sciences de signification.
On peut résumer de la sorte ce problème :
d'abord, il faut choisir entre la cohérence et la complétude. En
choisissant la cohérence, on limite le domaine d'analyse au risque de
retenir de manière implicite la mémoire du domaine exclu.
Ensuite, il faut choisir entre le formalisme et la signifiance. On peut dire
que le style d'une telle épistémologie réside dans la
nécessité d'appliquer le principe de renoncement. Dans le
traitement de ces problèmes, le style épistémologique de
HJELMSLEV est une radicalisation de ce principe de renoncement, c'est ce que
nous apprend l'analyse suivante d'Ivan ALMEIDA :
« Au contraire le principe du pari, que l'on peut
attribuer implicitement au style de Hjelmslev consiste, quant à lui,
dans la radicalisation dynamique du principe de renoncement : parier qu'une
radicalisation de la rigueur formaliste peut mener à une visualisation
du sens, parier qu'une radicalisation de l'immanence peut, par besoin interne,
déboucher dans la complétude. En d'autres termes, que le sens est
une prolongation de l'horizon du formalisme, et que la transcendance est une
conséquence dynamique de l'immanence. » (ALMEIDA, 1997)
Autrement dit, la sémiotique de HJELMSLEV est un
formalisme ; la fonction sémiotique unit deux grandeurs : l'expression
et le contenu avec la possibilité que cette sémiotique soit
l'expression d'un nouveau contenu comme dans la sémiotique connotative
ou que le contenu d'une expression soit déjà une
sémiotique, ce qui arrive dans un métalangue.
En focalisant notre attention sur le métalangage, on
s'aperçoit que le premier E est exactement un premier. Dès lors,
rien ne nous interdit de considérer le deuxième E contenu dans la
parenthèse comme un second auquel renvoie le premier par
l'intermédiaire de C.. On peut nous reprocher que cette analyse est un
peut tirer par les cheveux. Mais nous allons voir qu'en la moulant sur la
règle du détachement du sens, elle gagne une certaine
pertinence.
Illustrons cela par un exemple qui nous est fourni par CORNULIER
lui-même :
« De fait, en principe « P » peut être
n'importe quoi. Soit, en notant par rrrhh un rot, la suite «
dialoguée » de comportements :
72
-- Rrrhh !
-- Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
-- Ça veut dire que je serais bien content que tu t'en
ailles.
Dans cette espèce de dialogue, le demandeur
d'éclaircissement est informé que le roteur serait bien content
qu'il s'en aille, et cela sans qu'il soit pertinent d'aller contrôler si,
à l'instant où il rota, le roteur prétendait
déjà signifier ce qu'à l'instant suivant il prétend
signifier ; car ce qui signifie son désir, ce n'est pas simplement le
rot, c'est la conjonction de celui-ci avec l'interprétation que le
roteur en donne. » (CORNULIER, 1982, p. 136)
L'avantage de la version faible du détachement est
qu'elle pose P comme un premier absolu. Dans cet exemple, justement, il est
clair que le rot à lui tout seul n'est qu'un
épiphénomène lié à la digestion auquel cas
son statut de signe est indiciel et non symbolique. Dans le cas où il
est produit volontairement, en dehors de toute relation indiciel avec la
digestion, il est un signe symbolique ; et le propre d'un symbole9
est qu'il est un premier absolu. C'est pour cette raison qu'il faut lui
adjoindre un interprétant. L'interprétant en tant que second doit
déjà appartenir au langage d'interprétation, il pose une
limite sinon le symbole pouvant signifier tout à tout instant deviendra
asémantique par excès de signification. C'est ce que
précise CORNULIER en ces termes :
« Quel que soit P, quel que soit Q, ((P & (P
signifie Q)) signifie Q).«Peu importe que P soit une « proposition
» ou un « fait ». Évidemment, si Q ne signifie rien dans
un langage donné, la conjonction d'un acte quelconque P, avec une
interprétation P signifie Q dans ce langage, ne produit aucun sens par
détachement du sens, faute que Q signifie quelque chose. Q doit donc
déjà appartenir au langage de l'interprétation. Mais cela
n'est pas vrai de « P » : pour que le détachement du sens
dérive Q, il est indifférent que « P » ait
déjà une définition dans le langage de
l'interprétation qui justement lui en assigne une. » (CORNULIER,
1982, p. 136)
Si Q doit déjà appartenir au langage
d'interprétation, il doit être une sémiotique,
c'est-à-dire de la forme (E R C). Autrement dit, nous pouvons lire le
métalangage que nous réécrivons avec des indices pour les
besoins de l'explication :
E1 R (E2 R C)
comme le fait que E1renvoie à E2 par
l'intermédiaire de C.
En définitive, nous pouvons dire que sémiotique
triadique, sémiotique métalinguistique et détachement du
sens sont différentes formulations de la même chose : le
fonctionnement d'un signe. L'exemple donné ci-dessus semble être
établi pour les besoins de la cause. En conséquence, il nous faut
un exemple authentique pour illustrer qu'entre les différentes
formulations, le détachement du sens est préférable
à cause de sa simplicité.
Soit le dessin suivant qui peut être la production d'un
enfant :
9 Nous employons ici symbole au sens peircien.

73
Ce dessin n'est pas « maman » qu'en vertu de la
légende qui le spécifie. Ce faisant, l'enfant accomplit une
affirmation qui consiste à attribuer un nom à l'icône qu'il
vient de réaliser, et cette affirmation est une nomination, la
nomination est une obéissance à la règle selon laquelle il
est interdit de s'adresser à ses propres parents par leur nom, cette
obéissance renvoie marque le respect, le respect témoigne de
toute l'affectivité de l'enfant envers sa mère et ainsi de suite
indéfiniment.
Nous tenons donc comme une validité de la
théorie du détachement du sens cette convergence avec la
séméiotique de PEIRCE et avec la sémiotique de HJELMSLEV.
En somme, le détachement est un principe qui permet d'analyser les
implicites qui sont à l'origine de la dérivation illocutoire.
Travaux cités
ALMEIDA, I. (1997, Mai). Le style
épistémologique de Louis Hjlemslev. Consulté le Juin
20, 2012, sur Texto:
http://www.revue-texto.net/Inedits/Almeida_Style.html
ARISTOTE. (1985). Poétique. Paris: LEs Belles
Lettres.
BANGE, P. (1992). Analyse conversationnelle et Théorie
de l'action. Paris: Les éditions Didier.
BENVENISTE, E. ([1966] 1982). Problèmes de
linguistique générale,1. Paris: Gallimard. BENVENISTE, E.
([1974] 1981). Problèmes de linguistique générale, II.
Paris: Gallimard.
BROWN, P., & LEVINSON, S. C. ([1978] 2000).
Politeness, some universals in language usage. Cambridge: Cambridge
University Press.
CORNULIER, B. (1982). "Le détachement du sens" dans Les
Actes de Discours, Communications,32. Communications, pp. 125-182.
DUCROT, O. (1972). Dire et ne pas dire, Principe de
sémantique linguistique. Paris: Herman.
DUCROT, O. (1980). "Analyses pragmatiques". (Seuil, Éd.)
Communications(32). GOFFMAN, E. ([1974] 1984). Les rites
d'interaction. Paris: Editions du minuit. GREIMAS, A. J. (1970). Du
sens, Essais de sémiotique,1. Paris: Seuil.
74
GRICE, H. P. ([1975] 1979). Logique et Conversation. Dans
Communications, 30 (pp. 5772). Paris: Seuil.
HJLEMSLEV, L. (1968-1971). Prolégomènes
à une théorie du langage. Paris: éditions de
Minuit.
KERBRAT-ORECCHIONI. (1994). Rhétorique et pragmatique:
Les figures revistées. Langue française n°1, pp.
57-71.
KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1994). "Rhétorique et
Pragmatique: les figures revisitées". Langue française,
volume 101, N°1, pp. 57-71.
LAFONT, R. (1978). Le travail et la langue. Paris:
Flammarion.
LAKOFF, R. (1973). The logic politeness. Dans Papers from
the eight regional meeting (pp. 183-228). Chicago: Chicago linguistic
society.
MARTY, R. (1980). "La sémiotique phanéroscopique
de Charles S. PEIRCE". Dans P. François, La Sémiotique de
Charles S. PEIRCE. Paris: Larousse.
MARTY, R. (1980). "La théorie des
interprétants". Dans F. PERALDI, Au-delà de la
sémiolinguistique (pp. 37-39). Paris: Larousse.
PEIRCE, C. S. (1979). Ecrits sur le signe. (G.
DELEDALLE, Trad.) Paris: Seuil.
RECANATI, F. (1979). La transparence et énonciation.
Pour introduire à la pragmatique. Paris: Seuil.
RÉTHORÉ, J. (1980). "La sémiotique
triadique de C.S. Peirce. Dans F. PERALDI, Au-delà de la
séiolinguistique, la sémiotique de C.S. PEIRCE (pp. 32-37).
Paris: Larousse.
RICOEUR, P. (1975). La métaphore vive. Paris:
Seuil.
SAUSSURE, d. F. (1982). Cours de Linguistique
Générale. Paris: Payot.
SAVAN, D. (1980). "La séméiotique de Charles
Sanders Peirce". Dans F. PERALDI, Au-delà de la
sémiolinguistique, La sémiotique de C.S. Peirce (Peraldi,
Trad., Vol. 58, pp. 9-27). Paris: Larousse.
SEARLE, J. R. ([1972] 1996). Les actes de langage.
Paris: Hermann.
VICTORRI, B. (2002). Homo narrans: le Rôle de la
narration dans l'émergence du langage". Langages, 146, pp.
112-125.
WITTGENSTEIN, L. J. (1961). Tractatus
logico-pholosophicus. Paris: Gallimard.
75
6. MÉTONYMIE
RÉSUMÉ :
Très souvent les analystes croient que la
métonymie est pour pallier la carence de nomination. Une
hypothèse mise à jour par VENDLER, notamment en ce qui concerne
la communication dans les restaurants où le client est
dénommé par le nom du menu qu'il a commandé. Pour notre
part, il nous semble que faire métonymie est bien plus, cette figure
entre dans la question de la préservation de la face puisqu'elle permet
d'éviter de nommer ce qui peut choquer au profit d'une expression plus
neutre, en rapport de contiguïté avec le terme censuré.
Mots clés : illocutoire littéral, illocutoire
dérivé, figure, symbolisation, métonymie, valeur
émancipatrice
ABSTRACT:
Very often the analysts believe that the metonymy is to
compensate the lack of appointment. A hypothesis updated by VENDLER, notably as
regards the communication in the restaurants where the client is referred to by
the name of the menu he ordered. For our part, it seems that metonymy is much
more, this figure enters in the question of the preservation of the face since
it allows to avoid to appoint what may shock in favor of a more neutral term,
in report of contiguity with the censored term.
Key Words: illocutionary literal, illocutionary derived,
figure, symbolization, metonymy emancipatory value
Ce travail s'inscrit dans le sillage des "Figures
revisitées" (KERBRAT-ORECCHIONI, 1994), un article qui mesure à
l'aune de l'illocutoire les figures qui s'installent entre l'illocutoire
affiché formellement et l'illocutoire dérivé.
L'illocutoire affiché est compris comme littéral et le
dérivé comme figuratif. Mais c'est ce dernier qui est pertinent
dans la communication.
Un exemple que nous devons à Paul GRICE permet
d'illustrer la pertinence de l'illocutoire dérivé, et en
même temps de préciser la généralisation de la
notion. Cet exemple, le voici : deux amis s'en vont chez l'un. Le visiteur en
voyant un chien devant la maison de son ami lui demande : est-ce que votre
chien mord ? Celui-ci répondit que non. Alors, il s'en va caresser le
chien et se faisait mordre. Il jette un regard interrogateur à son ami
qui explique : mon chien est dans le salon et n'est pas celui-là.
L'intérêt de cet exemple réside dans la
confusion entre illocutoire littéral et illocutoire
dérivé. En posant la question, il s'agit pour le visiteur de
savoir s'il va se faire mordre ou pas. Contrairement à cela, la
réponse qui a été fournie s'est appuyée uniquement
sur le référent du possessif « votre ». Pareille
méprise peut apparaître dans les tropes illocutoires ; mais le
plus souvent le récepteur décode correctement l'imbrication du
littéral dans le dérivé.
Cependant, il nous faut ici immédiatement une mise au
point. Les prédicats de littéral et de non littéral qui se
sont installés depuis la tradition antique comportent un
inconvénient
76
en dépit de leur opérativité. En effet,
dans le cas des figures sémantiques, la distribution entre sens
littéral qu'il faut ignorer et le sens dérivé qu'il faut
lire relève d'une théorie substitutive que condamne l'analyse de
TODOROV qui fait la distinction soigneuse entre signification et symbolisation,
dans les termes suivants :
« C'est la signification qui ne peut être que
littérale. Les poètes qui l'ont affirmé ont
été meilleurs linguistes que les professionnels : les mots ne
signifient que ce qu'ils signifient, et il n'y a aucun autre moyen de dire ce
qu'ils disent ; tout commentaire fausse leur signification. Quand Kafka dit
« un château » il veut dire un château.
Mais c'est la symbolisation qui est infinie, tout
symbolisé pouvant devenir à son tour symbolisant, ouvrant ainsi
une chaîne de sens dont on ne peut arrêter le déroulement.
Le château symbolise la famille, l'État, Dieu, et encore beaucoup
d'autres choses. Il n'y a pas de contradiction entre les deux, et c'est
Rimbaud10 qui avait raison. » (TODOROV, 1970, p. 35)
Ce qui implique que le sens littéral au même
titre que le sens symbolique sont lus en même temps afin de faire sortir
les mots de la rigidité du concept et de donner aux mots ce que Barthes
appelle valeur émancipatrice dont voici l'approche :
« [...]; la fonction du récit n'est pas de
représenter, elle est de constituer un spectacle qui reste encore
très énigmatique, mais ne saurait être d'ordre
mimétique ; la réalité d'une séquence n'est pas
dans la suite «naturelle» des actions qui la composent, mais dans la
logique qui s'y expose, s'y risque et s'y satisfait : on peut dire d'une autre
manière que l'origine d'une séquence n'est pas l'observation de
la réalité, mais la nécessité de varier et de
dépasser la première « forme » qui se soit offerte
à l'homme, à savoir la répétition, une
séquence est essentiellement un tout au sein duquel rien ne se
répète ; la logique a ici une valeur émancipatrice - et
tout le récit avec elle. » (BARTHES, 1981, p. 32)
Cette logique narrative a pour fonction d'interdire simplement
que le langage soit une tautologie du réel, sinon on ne s'expliquera pas
pourquoi il y a relativité linguistique et surtout, pourquoi il y a une
théorie de l'action en linguistique. Cette valeur émancipatrice
est contenue dans le processus symbolique dont la métonymie est
l'exemple par excellence, en anticipation de notre hypothèse dans ce
travail.
Bref, le rapport entre sens littéral et non
littéral n'est pas entre un sens qu'il faut enterrer dans les cendres et
un sens qu'il faut exhiber au dehors, mais entre un sens qui est montré
littéralement et un renvoi symbolique à un sens que la forme du
sens littéral autorise. C'est-à-dire un rapport entre
énoncé et énonciation. Mais le renvoi symbolique est un
processus ad infinitum selon la définition du signe dans la
sémiotique triadique de PEIRCE parce qu'il s'agit justement d'une valeur
émancipatrice qui nous affranchit de la rigidité du concept et de
cette manière interdit que le langage soit une tautologie du
réel.
10 En disant à Georges IZAMBARD et Paul
DEMENY, ses professeurs, que le texte est à comprendre
littéralement et dans tous les sens
77
Autrement dit, il n'y a pas moyen de réduire le signe
triadique en signe dyadique par le truchement de l'ajout du
référent dans le couple signifiant et signifié de
manière à obtenir le triangle d'Ogden et de Richards :
« Mais pour l'analyse des acceptions de « sens
» [meaning] qui est ici notre objet principal, il est souhaitable de
commencer par les relations des pensées, des mots et des choses tels
qu'on les retrouve dans le cas de discours réflexifs, qui ne sont pas
compliqués par des modifications émotives, diplomatiques ou
autres ; et, en ce qui les concerne, le caractère indirect des relations
entre les mots et les choses est le point qui mérite en premier lieu
l'attention. » (OGDEN & RICHARDS, 1976, p. 114)
Nous voyons par ce passage que cette analyse du signe qui se
débarrasse des connotations qui y sont appelées «
modifications émotives, diplomatiques ou autres » nous engage dans
le sens littéral qui relève de la signification et non de la
symbolisation comme le fait remarquer ci-dessus TODOROV.
Tout autre est la conception du signe triadique chez PEIRCE.
En partant de l'idée que rien ne peut être dit vrai d'une
unité absolument simple, suivant en cela la position de PLATON dans
Parménide, il semble que l'on ne peut pas conclure de
l'idée de signe du renvoi d'une unité simple à une autre
unité simple. Justement, c'est cette dernière remarque qui
constitue le point de divergence entre PEIRCE et PLATON ; ce dernier, voulant
corriger la première affirmation entend diviser l'unité
absolument simple en dyade constituée d'un sujet et d'un
prédicat. PEIRCE rétorque alors qu'il n'y a rien à gagner
à supposer des unités de genre puisque si rien n'est vrai de
l'une ou de l'autre, leur différence est fausse. C'est ainsi que PEIRCE
commence par les êtres ordinaux et non cardinaux pour obtenir la
définition du signe suivant :
« Un signe ou representamen est un Premier qui se
rapporte à un second appelé son objet, dans une relation
triadique telle qu'il a la capacité de déterminer un
Troisième appelé son interprétant, lequel assume la
même relation triadique à son objet que le signe avec ce
même objet ... Le troisième doit certes entretenir cette relation
et pouvoir par conséquent déterminer son propre troisième
; mais, outre, cela, il doit avoir une seconde relation triadique dans laquelle
le representamen, ou plutôt la relation du representamen avec son objet,
soit son propre objet, et doit pouvoir déterminer un troisième
à cette relation. Tout ceci doit également être vrai des
troisièmes du troisième et ainsi de suite indéfiniment...
(2.274) " (PEIRCE, 1978, p. 147)
En dépit de la contemporanéité de
SAUSSURE (1857-1913) et de PEIRCE (1839-1914), très peu de travaux de
sémiolinguistique se réclament de cette définition, parce
que sa conception du signe est une véritable coupure
épistémologique. Cette coupure épistémologique peut
être interprétée de diverses manières. Il ne faut
pas surtout pas figer la conception du signe triadique car il a une valeur
émancipatrice au sens de BARTHES. Ce qui justifie ce rapprochement entre
le passage cité de BARTHES et la définition du signe triadique
qui nous semble être deux points convergents.
Le premier point concerne la possibilité du signe : il
n'y a pas de signe que pris en charge par un discours, ou plus exactement par
une énonciation. Hors énonciation, le signe n'est
78
qu'une virtualité figée par les dictionnaires en
dépit des éditions successives qui permettent de voir le
changement. C'est pour cette raison que BARTHES refuse le mimésis
(ne saurait pas d'ordre mimétique) au profit d'une
sémiosis relevant d'une logique narrative qui n'accepte la
répétition parce que l'être y perd ou gagne des
propriétés.
Pareillement chez PEIRCE, la théorie des
interprétants interdit aux signes d'être une tautologie du
réel. Si, effectivement, le signe ne fait que renvoyer à son
objet en dehors de tout interprétant ou troisième, il serait
mimétique et rendrait toute énonciation comme une question
inutile, car à chaque fois que nous utilisons un signe il renverrait de
manière immuable à son objet et rien de plus.
Cette dernière remarque nous renvoie au deuxième
point de congruence. BARTHES l'appelle « valeur émancipatrice
» et PEIRCE le rend par l'adverbial « ainsi de suite
indéfiniment » dans le processus de renvoi de troisième
à troisièmes. Pour la valeur émancipatrice, disons que -
pour rependre ici une littérature universelle de la marâtre - si
Cendrillon, dans le récit, passe des cendres - d'où le nom de
Cendrillon - de son logis aux fastes du palais royal, la transformation
d'état ne lui assigne pas seulement le prédicat « être
riche » mais la met aussi en rapport avec toutes les jouissances inscrites
dans la richesse en tant que concept.
Pour le processus ad infinitum du troisième
dans le signe triadique, prenons un exemple banal qui a le mérite de
nous faire voir que l'illocutoire écarté du signe dyadique peut
faire office d'interprétant, donc de motivation des signes.
La vie dans les campagnes malgaches est organisée de
telle manière que le paddy qui va être pilé pour le
dîner soit mis à sécher le matin dans un endroit sûr
pour permettre à toutes les forces vives de s'occuper des travaux des
champs. Que quelqu'un du groupe, une fois au champ, dise : « il va
pleuvoir », il a visiblement produit un signe qui est un premier, et ce
premier est totalement libre, il aurait pu être : « le ciel est
nuageux » ou encore « nous allons essuyer de grosses gouttes ».
L'objet de ce premier ou son second est l'état de chose climatique
caractérisé par l'imminence de la pluie.
Dès lors, le premier troisième de ce signe qui
noue et sépare en même temps le premier et le second comme
différents est une affirmation dont le but est de faire
croire à l'imminence de la pluie. Du même coup est accompli un
avertissement, c'est-à-dire, un autre illocutoire
relatif au séchage de paddy. Sur ce dernier illocutoire se greffe la
requête que quelqu'un aille ramasser le paddy. La
requête de ramasser le paddy accomplit le conseil qui
consiste à dire qu'il n'est pas bon de dormir le ventre vide. Ne pas
avoir le ventre vide permet de restaurer les forces. Avoir des forces permet de
continuer les travaux des champs. Et ainsi de suite indéfiniment, car
les travaux des champs constituent l'essence existentielle des campagnards.
À partir du conseil comme acte de langage, la dérivation
illocutoire se stabilise en actes équivalents dont il est inutile de
faire l'énumération puisque la dimension existentielle de
l'être humain peut être conçue comme une série de
conseils, manifestée notamment dans les sociétés modernes
par l'existence du conseil d'administration.
79
Cette stabilisation est conforme, à quelque chose
près, à ce que Robert MARTY appelle « Théorie des
interprétants » (MARTY, 1980, pp. 37-38). En effet, nous savons que
dans la définition du signe triadique, le troisième entretient
une relation triadique authentique avec le premier et le second de telle
manière qu'il peut déterminer un autre troisième. Et ainsi
de suite indéfiniment.
Quand on sait en outre que le troisième est de l'ordre
de la loi qui instaure la prévisibilité contre une progression
hasardeuse du sens, l'illustration du troisième devient un protocole
mathématique. Or ce protocole mathématique n'est pas
présent dans les textes de PEIRCE, mais c'est tout de même une
approche acceptable de ce que nous avons appelé « motivation »
du signe qui interdit la tautologie. Prenons connaissance de la formulation de
ce protocole mathématique sous les plumes de David SAVAN :
« L'ajout d'un troisième terme dans la
série introduit la possibilité d'une progression
régulière non-hasardeuse. La loi minimale d'une série peut
être, par exemple, « n+1 ». La loi qu'introduit le
troisième terme fait le lien entre le premier et le second et entre le
second et le troisième. C'est le principe de synthèse puisqu'il
unifie la série : (a) Il représente la relation entre le premier
et le second ; (b) il représente sa propre relation au second et (c) il
représente le fait que la relation entre le premier et le second est la
même que celle entre le second et le troisième. » (SAVAN,
1980, p. 12)
En effet, présenté sous cette formule de
progression arithmétique, le troisième permet
l'énumération des entiers naturels jusqu'à l'infini. Mais
il est évident que personne n'est tentée de faire cette
énumération, l'essentiel est de savoir qu'il y a une règle
de progression qui permet la prévisibilité. Pour notre part, il
suffit de dire que la synthèse opérée par le
troisième est ce qui autorise de dire qu'une minute de récit peut
contenir cent ans d'histoire, ou, plus terre à terre, ce qui permet de
faire cette activité rédactionnelle que l'on appelle
synthèse, ou encore, la synopsis d'un texte qui permet de tout voir d'un
seul coup d'oeil.
Par ailleurs, il y a lieu de croire que la valeur
émancipatrice de la logique narrative est une intelligibilité
narrative par laquelle le discours peut avoir une expression minimaliste, une
sorte de mise en abyme, pour emprunter cette expression à la
poétique, qui noue et sépare la situation initiale de la
situation finale par le moyen de ce que l'on appelle la transformation
narrative. La valeur émancipatrice est donc ce qui interdit au signe de
se fixer en soi mais de renvoyer à un autre qui s'épelle
différence.
Cette deuxième explication de la valeur
émancipatrice pose, de la sorte, la transformation comme un
troisième, car comme le précise David SAVAN à partir des
textes de PEIRCE, le troisième est un intermédiaire, un
médiateur :
« Tout ce qui est intermédiaire entre deux
choses et qui les réunit est un troisième. Les exemples que
PEIRCE nous en propose sont, entre autres, une route entre deux points, un
messager, le moyen terme d'un syllogisme, un interprète. Les habitudes,
les lois et le langage sont également des troisièmes. »
(Ibid.)
Toute la sémiotique dite École de Paris
(GREIMAS, 1981, p. 30) se fonde sur cette intelligibilité narrative,
d'où l'importance de la clôture dans la dichotomisation temporelle
du
80
récit en « avant » et en un «
après », laquelle clôture indique que le temps des
péripéties est fini. La notion de troisième est pourtant
déjà présente dans l'antiquité, chez ARISTOTE, bien
que GRÉIMAS semble n'en avoir pas pris connaissance, en ces termes :
« La limite fixée à l'étendue en
considération des concours dramatiques et de la faculté de
perception des spectateurs ne relève pas de l'art ; car s'il fallait
présenter cent tragédies, on mesurerait le temps à la
clepsydre, comme on l'a fait dit-on quelque fois. Par contre la limite conforme
à la nature même de la chose est celle-ci : plus la fable a
d'étendue, pourvu qu'on en puisse saisir l'ensemble, plus elle a la
beauté que donne l'ampleur, et, pour établir une règle
générale, disons que l'étendue qui permet à une
suite d'événements, qui se succèdent suivant la
vraisemblance ou la nécessité, de faire passer le héros de
l'infortune au bonheur ou du bonheur à l'infortune, constitue une limite
suffisante. » (1451a) (ARISTOTE, 1985, p. 41)
C'est parce que la fable (actuellement le récit, au
sens large) est un signe triadique et que sa synthèse est possible parce
que l'état initial et l'état final caractérisés par
une inversion de propriété est lié par un troisième
: le discours qui fait passer de l'état initial à l'état
final (passage de la fortune à l'infortune dans les textes d'ARISTOTE).
Or il faut admettre que la transformation narrative est un acte de langage
fondamental par ce qu'elle est une suppression et adjonction de
propriétés pour un sujet donné. C'est ainsi qu'un roman de
milles pages, par exemple, peut avoir une synthèse d'une page. Ensuite,
la synthèse elle-même renvoie au texte original par
l'intermédiaire d'une opération discursive, et ainsi de suite.
Il nous semble qu'il est possible de démontrer que la
métonymie est un signe triadique dont le premier est la forme
signifiante manifestée, le second ce à quoi renvoie le premier,
et le troisième est une force illocutoire qui unit le premier au second.
Nous verrons que ce second n'est pas le référent comme cela
semble être suggéré dans le passage suivant :
« Par exemple, si j'invite le lecteur à relire
Jakobson, cela n'entraîne pas une modification interne du sens du mot
« Jakobson ». La métonymie qui me fait employer le nom de
l'auteur pour désigner un ouvrage opère sur un glissement de
référence ; l'organisation sémique n'est pas
modifiée, mais la référence est déplacée de
l'auteur sur le livre. » (LE GUERN, 1972, p. 14)
Cette remarque est peut être descriptive de la
métonymie d'une manière pratique, mais elle n'est pas explicative
du mécanisme de la métonymie car le glissement de la
référence de la sorte existe aussi bien dans la synecdoque que
dans la métaphore, elle est donc bien propre à en entretenir la
confusion entre métonymie et synecdoque.
Au contraire, il faut tout d'abord accepter le principe selon
lequel la métonymie est un phénomène linguistique et que
la question de la référence de cette sorte est baptisée
par tout le monde d'extralinguistique. Ce qui veut dire que le discours
privilégie la relation du signifiant au signifié au
détriment du référent pour accéder à une
autonomie qui participe de ce que BARTHES appelle « valeur
émancipatrice ». Une autonomie formulée en ces termes par
Charles P. BOUTON :
« Le discours est une re-création qui
défie les lois de la réalité pour atteindre à une
exigence supérieure de la spéculation humaine permise justement
par le langage.
81
En ce sens le discours est générateur d'une
vérité, ou d'une erreur qui reflète dans son essence
même, l'essence de l'humain » (BOUTON, 1979, p. 202)
Autrement dit, pour expliquer la métonymie ou d'autres
phénomènes linguistiques, il ne faut pas introduire la notion de
référent parce que l'autonomie du linguistique le convertit en
vérité analytique. Appliquons cette analycité à
l'exemple qui nous occupe.
Que ce soit un Jakobson réel ou un Jakobson de fiction
; le fait de dire « prenez votre Jakobson » à une classe
d'étudiants aboutirait à une incompatibilité
sémantique que si, par ailleurs, il est dit qu'il a écrit un
livre. C'est cette incompatibilité sémantique qui signale la
figure, car désormais la dimension cognitive du mot « Jakobson
» implique le renvoi au fait qu'il a écrit un livre. Du coup, le
possessif « votre » indique que c'est du livre que chaque
étudiant peut s'approprier et non de l'auteur.
C'est cela la symbolisation qui permet un renvoi
métonymique de chose à choses et que nous rapporte WITTGENSTEIN,
avec son style propre, en cet aphorisme : « Lorsque je connais l'objet, je
connais également l'ensemble des possibilités de son occurrence
dans des états de choses » (2.0123) (WITTGENSTEIN, 1961, p. 31)
À cause de cette règle de possibilités
d'occurrence, nous sommes loin de la simple relation dyadique du signifiant et
du signifié mais dans une relation triadique authentique par laquelle
« JAKOBSON » se lit comme un premier qui rend renvoie à un
second « le livre » par le moyen d'un troisième
constitué par le fait que « JAKOBSON est l'auteur d'un livre
». Mais dire que JAKOBSON est l'auteur d'un livre, c'est accomplir une
affirmation, et de cette première force illocutoire peut en
dériver d'autres comme flatter JAKOBSON d'être un auteur, ou celle
de conseiller de suivre ses indications contenues dans le livre, ou encore de
se méfier de certaines de ses affirmations, et ainsi de suite. En de
mots plus simples, la métonymie focalise l'attention sur le mot
exprimé au détriment de ce à quoi il renvoie.
Cette analyse permet maintenant d'exprimer la
différence irréductible entre métonymie et synecdoque.
Dans la synecdoque le renvoi se fait entre éléments de niveaux
différents marqués par une hiérarchie,
c'est-à-dire, entre un et un seul élément contenant et ses
éléments contenus ; tandis que dans la métonymie le renvoi
est entre éléments de même niveau définis par ce que
WITTGENSTEIN appelle possibilités d'occurrence inscrites dans la forme
de l'objet qui origine le renvoi. Faire métonymie, c'est donc produire
un signe qui renvoie à un autre signe de même niveau tandis que la
synecdoque opère dans des niveaux hiérarchisés.
Pour continuer prenons alors une définition de la
métonymie pour illustrer cette thèse, et par la même
occasion de corriger ce qu'il y a de trompeur dans cette définition.
Cette définition, la voici :
« Figure par laquelle on met un mot à la place
d'un autre dont il fait entendre la signification. En ce sens
général la métonymie serait un nom commun à tous
les tropes ; mais on la restreint aux usages suivants : 1° La cause pour
l'effet ; 2° l'effet pour la cause ; 3° le contenant pour le contenu
; 4° le nom du lieu où la chose se fait
82
pour la chose elle-même ; 6° le nom abstrait pour
le concret ; 7° les parties du corps
regardées comme le siège des sentiments ;
8° le nom du maître de la maison pour la maison elle-même ;
9° l'antécédent pour le conséquent. » (LE GUERN,
1972, p. 12)11
Cette définition comporte une certaine forme de
redondance qui rend malaisée son utilisation. En effet, toute
introduction de dimension temporelle dans la métonymie convertit
celle-ci en métalepse comme le précise l'article suivant :
« Métonymie de focalisation dans la
chaîne de l'action : suggestion de la conséquence sous-tendue par
expression de la cause ; et, inversement, évocation de la cause par
expression de la conséquence. » (MORIER, 1981, p. 667)
Cette confrontation élimine de la définition de
la métonymie les usages 1 et 2 ainsi que 9. Il nous reste alors les
usages 3, 4 et 5. Leur caractère de signe triadique sera analysé
dans les exemples qui suivent. En ce qui concerne l'usage 3, métonymie
du contenant pour le contenu, nous avons l'exemple authentique suivant :
1. "Père, tout est possible pour toi, éloigne de
moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux!" (De
l'Évangile selon saint Marc. 14,32-36)
Tout d'abord, il faut faire remarquer que la « coupe
» dont il est question dans cette prière constitue dans un second
temps une métaphore. En effet, il faut admettre que « coupe »
renvoie ici à la mort imminente qui guette Jésus pour avoir
chassé les officiers romains de change du temple, sous prétexte
que le temple est destiné à la prière et non au commerce.
Pareille action a pour conséquence une condamnation à la
crucifixion au mont de Golgotha.
Ce qui veut dire que la coupe contient bien la mort, mais
cette mort n'est pas du poison liquide, mais une mort lente consécutive
à des tortures. Mais cette métaphorisation de la métonymie
n'a qu'une portée faible par rapport à la pertinence pragmatique
de la métonymie.
Cette pertinence, nous allons la puiser dans la
littérature. L'exaltation des martyrs consiste justement à
préférer la mort que de renoncer à ses idéaux. Tel
est l'exemple célèbre de Socrate qui a choisi de boire la
cigüe pour éviter le déshonneur de se plier à
l'accusation de corrupteur de la jeunesse à partir de sa relation avec
Alcibiade. Cette attitude qui consiste à boire le poison
(Pharmakon) a donc pour finalité de préserver la face,
de préserver l'identité de SOCRATE en tant que philosophe de la
maïeutique.
Mais la métonymie dit plus que cette
préservation de la face. Dans le rapport qui unit Jésus à
son père, on peut conclure à un voeu d'obéissance
consécutif au fait que Jésus est envoyé pour sauver
l'humanité du péché. D'ailleurs, de ce point de vue, le
nom propre « Jésus » est une antonomase. Cependant, il faut
tenir compte que pour accomplir sa mission, Jésus doit mourir. C'est
cette mort qui est alors le contenu de la coupe. Mais ce serait faire une
offense à Dieu, son père, que de croire qu'il l'envoie purement
et simplement à la mort. Dès lors, il faut comprendre la
métonymie comme un refus de blasphémer. De cette
11 Définition attribuée à
Littré par LE GUERN
83
introduction de la force illocutoire de la figure, il est
aisé de comprendre cette métonymie au sein de la
sémiotique triadique :
Le premier est la coupe.
Le second est la mort (contenu abstrait du concept de poison
liquide qui donne la mort).
Le troisième est cette force illocutoire : un
euphémisme qui permet d'éviter de blasphémer.
De ce premier illocutoire dérive un deuxième qui
s'énonce comme une procédure d'évitement interdisant de
parler des choses qui angoissent. Donc, c'est une sorte d'euphémisme.
Nous retrouvons alors dans cette métonymie particulière la
nécessité de l'implicite tel qu'il est commenté en ces
termes par DUCROT :
« Le problème général de
l'implicite, (...) est de savoir comment on peut dire quelque chose sans
accepter pour autant la responsabilité de l'avoir dit, ce qui revient
à bénéficier à la fois de l'efficacité de la
parole et de l'innocence du silence. » (DUCROT, 1972, p. 12)
Dans le cas qui nous occupe, on s'aperçoit alors que la
métonymie du contenant pour le contenu est une combinaison de
préservation de la face au sens de GOFFMAN (Cf (VIELFAURE, 1974)) et un
euphémisme qui interdit de parler des choses qui risquent de modifier
dangereusement le rapport interlocutif, en même temps que c'est un
évitement de nommer les choses qui angoissent, surtout celles qui sont
en relation avec la mort, cette grande inconnue.
Cette métonymie à elle toute seule est
susceptible d'être l'indice d'une interprétation complexe. Elle
nous apprend, entre autres, que Jésus doit faire confiance à
Dieu, mais il ne doit pas connaître les desseins de Dieu. En effet, s'il
connaît ces desseins lui-même, tout d'abord, il n'y a plus de
rapport hiérarchisé entre Dieu le père et lui, dès
lors il sera dans une situation sacrilège de parricide. Ensuite, la
connaissance de ces desseins videra le sacrifice de tout son contenu parce que
Jésus peut y aller allègrement.
En conséquence, la métonymie, en focalisant
l'attention sur la coupe, nous signale que si Jésus connaît
qu'elle contient la mort, l'accès à la modalité de cette
mort lui est interdit, d'où son angoisse qui l'empêche de parler
de cette mort que par la voie de la métonymie. De la sorte, le sacrifice
a toutes ses valeurs.
L'utilisation de la métonymie n'est pas aussi anodine
à l'égard du statut de Jésus. Nous savons que les meurtres
par empoisonnement se fait le plus souvent par boisson, mêlée de
poison, ingurgitée. C'est une manière tout à fait humaine
au point que certain emploi linguistique du mot « coupe » et nul
autre contenant, semble s'être spécialisé dans cette
métonymie. C'est une manière tout à fait humaine parce
qu'elle permet justement de tuer sans accepter la responsabilité du
meurtre, tel que cela est montré par DUCROT au niveau de l'implicite
linguistique. Ainsi, en parlant de coupe, Jésus s'inscrit dans sa
dimension humaine en se signalant qu'il est mortel comme tout homme.
84
Dans un autre registre, disons moins religieux, il existe une
métonymie qui ressemble à quelque chose près, à
l'emploi de coupe dans cet exemple. Il s'agit de l'expression qui sert à
qualifier certains hommes : « coureur de jupon ». La force
illocutoire qui relie le premier et le second dans cette expression est un
euphémisme qui permet d'éviter de parler des choses qui risquent
de froisser les susceptibilités.
Autrement dit, la métonymie n'a pas pour fonction de
conférer au discours une allure concrète ou réaliste, et
encore moins d'être un ornement. Au contraire, elle est commandée
par un but pragmatique.
En ce qui concerne la métonymie du lieu pour la chose
qui se fabrique en ce lieu, nous en avons une qui passe inaperçu
à force de présence au quotidien. Il s'agit de la voiture du nom
de TOYOTA.
D'habitude dans l'industrie automobile, c'est le nom du
créateur qui est attaché aux objets produits. C'est ainsi que la
marque Citroën est due à l'ingénieur André
Citroën. Ce qui veut dire que le troisième qui unit le premier :
Citroën humain, au second : Citroën voiture, est le fait que l'humain
est ingénieur en construction automobile. De cette première
affirmation dérive une seconde : l'affirmation de la fierté
d'avoir pu mener à terme un projet difficile et ainsi de suite en
référence à la particularité de la voiture. C'est
ce que la tradition appelle « antonomase » qui, en définitive,
est une autre nomination du mécanisme de la métalepse
En revanche, quand l'objet porte le nom de la ville de
production, le lien entre le premier et le second manifeste l'effacement du
sujet individuel de la construction au profit de sujet collectif. On
s'aperçoit alors que la métonymie, en faisant passer le lien de
l'individuel vers le collectif, développe un argumentaire au même
titre que les mythes qui sont une expression de la sagesse collective et en
même temps que mémoire collective.
En effet, l'insertion de ce signe dans la sémiotique
triadique se présente sous le schéma suivant : le premier est
Toyota, ville du Japon, le second est Toyota, voiture japonaise, et le
troisième ne consiste pas à dire : on construit cette voiture
dans cette ville, mais à dire que la ville construit cette voiture. Du
coup, on décèle que la métonymie comporte une synecdoque.
Ce n'est pas toute la ville qui travaille à la construction mais une
partie seulement. De ce premier interprétant dérive une seconde :
la métonymie flatte l'amour propre de la population de la ville.
Pour la métonymie du nom abstrait pour le concret,
signalons tout simplement qu'elle permet de violer une règle
grammaticale, celle du nombre des noms abstraits dérivés
d'adjectifs :
« Ainsi, les noms abstraits dérivés
d'adjectifs, paraphrasables par « le fait d'être A » : «
Blancheur » = « le fait d'être blanc » n'est pas comptable
et l'on n'a pas * deux blancheurs, *des blancheurs ; etc. mais on n'a pas non
plus *un peu de blancheur, *de la blancheur." De même certaines
nominalisations, telle « venue » : *deux venues, *des venues, *de la
venue, *un peu de venue. » (MILNER, 1978, p. 35)
85
Autrement dit la valeur émancipatrice dont parle
BARTHES peut se trouver également dans la métonymie. Le pas qu'il
faut franchir ici, c'est réduire le récit à une dimension
minimale de manière à assurer la généralisation de
la narrativité à tous les énoncés, un pas que
n'hésite pas à franchir Umberto ECO :
« Face à l'ordre «Viens ici», on
peut élargir la structure discursive en une macroproposition narrative
du type «il y a quelqu'un qui exprime de façon impérative le
désir que le destinataire, envers qui il manifeste une attitude de
familiarité, se déplace de la position où il est et
s'approche de la position où est le sujet d'énonciation».
C'est, si on le veut, une petite histoire, fût-elle peu importante.
» (ECO, 1985, p. 138).
Nous en concluons que dès qu'il y a passage d'un
état à l'autre, il y a narrativité. En conséquence,
dans la métonymie du nom abstrait vers concret, il y passage d'absence
de nombre vers une possibilité de marque de nombre, donc il n'est pas
faut d'attribuer à la métonymie la valeur émancipatrice.
Ainsi dans l'exemple suivant :
2. Vos bontés sont immenses.
Le premier est « bontés » au pluriel.
Le second est constitué par les faveurs obtenues
Le troisième qui lie le premier au second est la
bonté (au singulier) de l'individu, désigné par le
possessif « vos » qui lui a permis de faire des actes de
bonté. Il s'ensuit que dire d'un individu qu'il est bon est non
seulement faire une affirmation mais aussi qu'il est capable de don afin de
soulager la souffrance d'autrui, etc.
Il ressort de l'analyse de ces exemples que la
métonymie est de nature illocutoire lorsqu'elle est prise en charge par
la sémiotique triadique. Il ne faut pas croire pourtant que la
métonymie est épuisée par ces trois types, suite à
l'élimination des métalepses. Il nous semble que cette typologie
est arbitraire, ou du moins une série de hasards ; car tout type de
renvoi à des éléments de même niveau par le biais
d'un interprétant (au sens de PEIRCE) sans que ces
éléments possèdent un sème commun est une
métonymie.
Il en résulte que motiver la métonymie à
partir d'une carence de vocabulaire, donc comme un mécanisme de
catachrèse n'est pas tellement souhaitable, car d'après notre
analyse qui introduit la force illocutoire dans la compréhension de la
métonymie, cette fonction se relègue au second plan. Pourtant,
c'est ce qui se dit dans le passage suivant :
« Le fait que la métonymie serve tout
naturellement à fournir les mots qui manquent au vocabulaire s'explique
d'ailleurs très facilement : l'objet qui n'a pas de nom sera
désigné d'un objet qui est étroitement en relation avec
lui ; il suffit pour cela que le contexte élimine les
possibilités de confusion entre les deux objets. Une lexicalisation
préalable n'est pas nécessaire pour qu'une métonymie ou
une synecdoque soit employée en catachrèse. » (LE GUERN,
1972, p. 91)
Il existe cependant des exemples qui semblent confirmer la
métonymie de catachrèse. Dans les restaurants, les serveurs
s'enquièrent et notent les noms des plats choisis par les
86
clients sans chercher à relier la commande aux noms des
clients qu'ils n'ont pas d'ailleurs demandés. Comme quelque durée
temporelle s'écoule entre le temps de la commande et l'arrivée du
plat, le serveur est bien embêté pour se rappeler qui a
commandé quoi. Alors il prononce à voix bien distincte le nom du
plat pour interpeller le client. Par exemple :
3. Le sandwich au fromage
Supposons maintenant que le client, bien satisfait, a
laissé un large pourboire conséquent sur la table, alors le
serveur en question peut dire :
4. Le sandwich au fromage est généreux
Pour atténuer le caractère péremptoire
de la métonymie de catachrèse, commençons par dire qu'il
en existe d'autres qui s'appliquent à des noms bien connus, nous avons
d'ailleurs eu l'occasion de le constater dans les exemples (1) et (2). Par
contre dans (3), il est difficile de se prononcer puisque la métonymie
équivaut à un acte de baptême qui attribue un nom propre
sur un objet qui possède déjà un nom commun.
Par ailleurs, on peut dire que l'analyse de la
métonymie suivant la sémiotique triadique n'est pas incompatible
avec la règle du détachement du sens : (P & (P signifie Q))
signifie Q de CORNULIER sur le point suivant :
« Le détachement du sens est donc un principe
qui permet à un langage de s'incorporer n'importe quel
élément nouveau comme signe de n'importe quelle valeur qu'on
puisse déjà y exprimer. En ce sens, l'inventivité
sémiologique est arbitraire, radicalement et totalement, dans la mesure
où le détachement fort du sens a la force d'une règle.
» (CORNULIER, 1982, p. 136)
En effet, PEIRCE définit le premier comme ce qui est
absolument libre pour renvoyer à un second qui le limite via un
troisième qui lie le premier au second. En explicitant, la règle
du détachement du sens, nous verrons qu'il correspond à la
définition du signe chez PEIRCE. P est l'interprété
[premier], Q est l'interprétant [second] et l'interprétation est
donnée par la séquence (P signifie Q) [troisième].
Voyons cette correspondance à l'oeuvre dans l'exemple
suivant qui est dû à CORNULIER :
5. Rrrhh ! -- Qu'est-ce que ça veut dire, ça? --
Ça veut dire que je serais bien content que tu t'en ailles. (CORNULIER,
Ibid.)
Dans (5), l'unité sémiotique (au sens de
BENVENISTE) « Rrrhh » ne signifie absolument rien. Seulement, ici, il
signifie parce que son auteur lui assigne une interprétation. Or, nous
venons de voir que la métonymie met en place un mécanisme de
renvoi entre élément de même niveau dont l'indice est une
incompatibilité sémantique. Il en résulte que le premier
élément vaut pour le second via une interprétation
encadrée par l'incompatibilité sémantique. Et, justement,
c'est cela le fondement du détachement du sens. Si dans la formule du
détachement du sens (P et (P signifie Q)) implique Q, « [...],
on peut appeler P l'interprété, Q l'interprétant, et la
proposition « (P signifie Q) » l'interprétation. L'idée
du détachement (faible) du sens est que la conjonction d'un
interprété avec une interprétation implique
l'interprétant. » (CORNULIER, 1982, p. 127)
87
Voyons un autre exemple qui a l'avantage d'être
observable par tout sujet, en montrant une somme d'argent donnée, on
peut dire :
6. C'est mon bazar
Dans (6), « mon bazar » est l'interprétant,
la somme d'argent est l'interprété, représenté par
le démonstratif « ce » et (6) l'interprétation. Quand
on sait que la règle du détachement du sens (variante forte)
stipule que la conjonction d'un interprété à une
interprétation signifie l'interprétant, alors une somme
donnée renvoie à ce que l'on dit à quoi elle est
destinée. C'est ce que laisse prévoir clairement le
système de parenthétisation de la formule (P & (P signifie
Q)) signifie Q. Ce qui veut dire que c'est toute la séquence entre
parenthèses qui devient un signe qui renvoie à un autre signe. On
peut donc dire de (6) qu'il s'agit là d'une métonymie in
praesentia en établissement explicitement l'égalité
des signes « argent » et « bazar ». Par contre, si l'on dit
en référence à une somme s'argent :
7. Ce bazar est maigre,
la métonymie est bien attestée. C'est le type de
métonymie le plus évoquée dans la littérature
dédiée parce que c'est une métonymie in absentia,
donc plus sensible. Cet exemple semble être forgé pour le besoin
de la cause, pourtant c'est un exemple authentique des pays pauvres dont cet
article est issu. L'indice de la métonymie est encore ici une
incompatibilité sémantique du sujet et de l'attribut,
incompatibilité qui force à appliquer une interprétation
définie ici comme la règle du détachement du sens.
En effet, sans entrer dans des préoccupations
étymologiques, on peut constater que l'enchâssement multiple de
métonymies dans cet exemple fait migrer l'analyse commencée au
sein du détachement du sens vers le signe triadique.
Tout d'abord, « bazar » est une métonymie de
contenant pour contenu. Dans les pays concernés, il désigne en
effet le panier que l'on amène pour faire le marché. Ensuite le
marché lui-même est désigné par le nom de bazar dans
la mesure où il contient les produits, notamment, de premières
nécessités dont la population a besoin. C'est encore une
métonymie du contenant pour le contenu. Enfin, comme la loi du
marché implique des transactions via une monnaie, le plus souvent
nationale dans les pays pauvres, on a la métonymie initiale de (7).
En somme, il existe une compatibilité presque
identitaire de la règle du détachement du sens avec la
sémiotique triadique, et celles-ci à leur tour sont identiques au
mécanisme de la métonymie. Il nous semble dès lors que
parler de règle métonymique comme possibilité pour un
langage de donner une forme nouvelle à un contenu déjà
exprimable n'est pas trivial. L'enjeu dans la métonymie - et dans les
tropes en général - est de confier à une forme nouvelle
une substance de contenu, afin que cette forme exhibe sa dimension illocutoire
et celle-ci la dimension culturelle du langage au sein de la relativité
linguistique.
Une forme de contenu exprimée pour la première
fois dans la glossématique comme prédestinée à
l'analyse des actes de langages définis comme montrés - comme le
disent les philosophent anglais du langage - et non pas faisant l'objet d'un
acte d'assertion ou
88
d'affirmation. (DUCROT, 1980) Dans ces conditions, c'est la
forme du contenu qui montre l'illocutoire d'une énonciation. Cette forme
est définie de la sorte : « Seules les fonctions de la langue, la
fonction sémiotique et celles qui en découlent,
déterminent sa forme. Le sens devient chaque fois substance d'une forme
nouvelle et n'a d'autre existence possible que d'être la substance d'une
forme quelconque. » (HJLEMSLEV, 1968-1971, p. 70)
Ainsi, en donnant la forme « bazar » à la
substance de contenu inscrite dans la forme « argent », on peut
exhiber la dimension culturelle de la métonymie. En choisissant cette
forme, le destin de l'argent est scellé. Ce qui permet de voir un
illocutoire de refus dans (8) comme réplique à quelqu'un qui est
venu nous emprunter de l'argent.
8. Je n'ai plus que mon bazar
Suivant cette intervention de la règle du
détachement du sens, nous pouvons maintenant reprendre les exemples (3)
et (4). Interpeller quelqu'un par l'expression sandwich au fromage
n'implique pas que l'individu en question n'a pas de nom; c'est
l'évidence même.
Au contraire, en tenant compte du fait que si le nom propre a
un fonctionnement hapax, c'est parce qu'il a pour fonction, entre autres, de
faciliter l'orientation dans le social (MOLINO, 1982). Il s'ensuit donc que
dans les exemples (3) et (4), nous avons une métonymie in absentia
qui exprime l'identité du nom inconnu - et non pas inconnaissable -
à la nouvelle forme via cette nécessité pratique
d'orientation dans le social.
Autrement dit, les métonymies de ce genre n'ont pas,
à proprement parler, une fonction de réduction d'une lacune
lexicale ; elles ont pour fonction de convertir un nom commun en nom propre, de
manière momentanée comme cela se passe en anthroponomie de
manière à réaliser une individuation.
En effet, il n'est pas rare qu'un enseignant, de philosophie
par exemple, soit appelé par ses étudiants « transcendance
» par métonymie du fait que ce mot intervient souvent dans ses
explications. Dans ce cas, la métonymie ne comble pas un vide mais donne
une forme nouvelle à la substance de contenu défini par le statut
d'enseignant, sous la perspective d'une caricature.
Travaux cités
ALMEIDA, I. (1997, Mai). Le style épistémologique
de Louis Hjlemslev. Aarhus, Danemark. ARISTOTE. (1985). Poétique.
Paris: LEs Belles Lettres.
AUTHIER-REVUZ, J. (1995). Les non coïncidences du
dire et leur représentation méta-énonciative. Paris:
Thèse de Doctorat d'état.
BARTHES, R. (1981). Introductin à l'analyse struturale
du récit . Dans Copmmunications, 8 (p. 32). Paris: Seuil.
BOUTON, P. C. (1979). La signification, Contribution à
une linguistique de la parole. Paris: Klincksieck.
89
CASSIRER, E. (1969). "Le langage et la construction du monde
des objets", dans Essai sur le langage. Paris: Minuit.
CORNULIER, B. (1982). "Le détachement du sens" dans Les
Actes de Discours, Communications,32. Communications, p. 132.
DERRIDA, J. (1968). "La différance". Dans P. Sous la
Direction de SOLLERS, Théorie d'ensemble (p. 56). Paris:
Seuil.
DERRIDA, J. (1987 (éd. or. 1972)). Positions.
Paris: éditions de Minuits.
DOMINE, F. (1988, Octobre). "Dumarsais, des tropes ou des
différents sens". Mots(17), pp. 234 - 235. DUBOIS, J. e.
(1982). Rhétorique Générale. Paris: Seuil.
DUBOIS, J. e. (1994). Dictionnaire de linguistique et des
sciences du langage. Paris: Larousse. DUCROT, O. (1972). Dire et ne
pas dire, Principes de sémantique linguistique. Paris: Hermann.
DUCROT, O. (1980). Analyses pragmatiques. Communications, pp.
11-60.
ECO, U. (1985). LEctor in fabula, ou la Coopération
interprétative dans les textes littéraires. Paris:
Grasset.
FREUD, S. (1912). Totem et tabou, interprétation par
la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs. Paris: Payot.
GENETTE, G. (1970). "Rhétorique restreinte", dans
Recherhces rhétoriques,. Paris: Seuil. GENETTE, G. (1972).
Figure III. Paris: Seuil.
GRANGER, G. (1982, juin). "A quoi servent les noms propres".
Langages.
GREIMAS, A. J. (1981). "Eléments pour
l'interprétation des récits mythiques". Dans R. BARTHES,
Introduction à l'analysestructurale du récit (pp.
28-59). Paris: Seuil.
HJLEMSLEV, L. (1968-1971). Prolégomènes
à une théorie du langage. Paris: éditions de
Minuit.
KERBRAT-ORECCHIONI. (1994). Rhétorique et pragmatique: les
figures revisitées. (persée, Éd.) Langue
française, 101.
KREMER MARIETTI, A. (2001, Mars). "Nietzsche, la métaphore
et les sciences cognitives". Revue tunisienne des études
philosophiques(28 - 29).
LAFONT, R. (1978). Le travail et la langue. Paris:
Flammarion.
LE GUERN, M. (1972). Sémantique de la métaphore
et de la métonymie. Paris: Larousse.
MARTY, R. (1980, Juin). "La sémiotique
phanéroscopique de Charles S. Peirce". Langages, p. 29.
90
MILNER, J.-C. (1978). De la syntaxe à
l'interprétation, quantités, insultes, exclamations. Paris:
Seuil. MOLINO, J. (1982, Juin). "Le nom propre dans la langue".
Langages(66), pp. 5-20.
MORIER, H. (1981). Dictionnaire depoétique et de
rhétorique (éd. 3ème édition). Paris: PUF.
NIETZSCHE, F. (1887). Généalogie de la morale. Paris:
Gallimard.
OGDEN, C., & RICHARDS, I. (1976). The meaning of meaning.
Dans A. REY, Théorie du signe et du sens, 2 (A. REY, Trad.,
Vol. 2, p. 114). Paris: Klincksieck.
PEIRCE, C. S. (1978). Ecrits sur le signe. (G.
Deledalle, Trad.) Paris: Seuil.
PERALDI. (1980, Juin). "introduction" in La sémiotique de
Charles Sanders Peirce. Langages, 58. RETHORE, J. (1980, Juin). "La
sémiotique triadique de C. S. Peirce". Langages(58), p. 32.
RIFFATERRE, M. (1982). "illusion référentielle" dans
Littérature et réalité. Paris: Larousse.
SAVAN, D. (1980). "La séméiotique de Charles
Sanders Peirce". Dans F. PERALDI, Au-delà de la
sémiolinguistique, La sémiotique de C.S. Peirce (Peraldi,
Trad., Vol. 58, pp. 9-27). Paris: Larousse.
SCHAFF, A. (1969). Langage et connaissance. Paris:
éditions Anthropos.
TODOROV, T. (1970). "Synecdoques", dans Recherches
rhétoriques, Communications,16. Paris: Seuil. VIELFAURE, C. (1974).
Les Rites d'interaction, d'E. Goffman. Communication et langages,
n°24, p. 123. WITTGENSTEIN, J. L. (1961). Tractatus
logico-philosophicus. Paris: Gallimard.
91
7. L'ILLOCUTOIRE DES FIGURES RÉSUMÉ :
En fonction du principe d'économie du fonctionnement
linguistique qui s'interdit le seuil du langage hapax et le seuil du langage
infinitisé, le principe de l'oubli comme mécanisme synecdochique
est partout à l'oeuvre dans le langage, notamment dans les figures.
Cette étude tend à montrer que les figures sont commandées
par des buts pragmatiques. En effet, la figure met en jeu le sens
littéral et le sens figuré. Ce qui veut dire que la figure est un
choix du locuteur en fonction des buts qu'il recherche dans le rapport
interlocutif
Mots clés : paternité, littéral,
figuratif, énonciation, illocutoire, préservation de la face,
métaphore
ABSTRACT:
On the basis of the principle of economy of linguistic
functioning which prohibits hapax language threshold and the threshold of the
infinite language, the principle of oblivion as a mechanism synecdochique is
everywhere at work in language, especially in the figures. This study tends to
show that the figures are controlled by pragmatic goals. Indeed, the figure
involves literally meaning and figuratively meaning. Which means that the
figure is a choice of speaker based on the goals that it searches the report
interaction
Key words: fatherhood, literal, figurative, enunciation,
illocutionary, preservation of the face, metaphor
La sémantique générative à partir
des travaux de Georges LAKOFF s'inspire effectivement des données de la
grammaire générative et transformationnelle laquelle distingue
une structure profonde qui aboutit à une structure de surface en passant
par des transformations diverses. La motivation de cette théorie prend
naissance du constat de la généralisation des performatifs
à tout le langage pour sortir de la dichotomie constatif vs performatif
qui semble n'être qu'un palier heuristique dans les travaux d'AUSTIN. En
définitive, selon que le verbe performatif soit présent ou absent
de la structure de surface, on a affaire respectivement à un performatif
primaire ou performatif secondaire; ou encore la dichotomie performatif direct
et performatif indirect.
Il y a une réelle difficulté d'attribuer la
paternité de la pragmatique en tant que dernière-née de la
linguistique. AUSTIN et SEARLE sont souvent cités pour avoir vraiment
rompu avec la sémantique traditionnelle. Mais avant eux, de la
même manière que SAUSSURE a défini le projet de
sémiologie comme science de la vie des signes au sein de la
société, à côté de la linguistique
structurale, il y a également lieu d'admettre que c'est Charles MORRIS
qui avait, pour la première fois, jeté les bases de la
pragmatique quand il identifiait dans toute sémiotique la distribution
complémentaire suivante : la syntaxe est l'étude de la relation
des signes entre eux, la sémantique désigne l'étude de la
relation des signes avec les objets auxquels ils sont applicables et la
pragmatique, enfin, qui est l'étude de la relation des signes
92
à leurs interprètes. À peu près,
à la même époque que MORRIS, dans le vieux continent,
Rudolf CARNAP définissait le domaine de la pragmatique comme une
référence aux utilisateurs de la langue.
Ici encore la paternité de MORRIS peut être mise
en doute, car le mot « pragmatique » avec un sens quelque peu
différent est apparu dans les textes du sémioticien Charles
Sander PEIRCE en 1938, et MORRIS n'est autre que le disciple du
sémioticien. On peut comprendre le pragmatisme de PEIRCE à partir
de son opposition au doute cartésien. Cette idée de pragmatisme
conduit PEIRCE à penser que ce n'est pas l'autorité ni la raison
qui décident de la signification mais l'action. Non pas l'action
individuelle, mais la mise à l'épreuve publique
c'est-à-dire que la pensée humaine trouve son point de
départ uniquement dans un doute pratique et elle est dirigée vers
une fixation des croyances (connaissances) à travers des
expériences qui déterminent des habitudes.
Si le pragmatisme ainsi compris n'est pas le sens que la
théorie pragmatique véhicule actuellement, il n'en demeure pas
moins que la théorie de la sémiotique triadique peut servir
d'argument à la revendication de paternité. Le numéro 58
de la revue Langages (1980) est entièrement dédié
à la lecture de la sémiotique de Charles Sander PEIRCE. L'article
de David SAVAN inaugurant ce volume est explicite quant à
l'authentification de la paternité. Prenons-en connaissance :
« Comme il existe trois types de representamen ou de
relation-signe, il s'ensuit qu'il existe trois sémiotiques subsidiaires.
Premièrement la grammaire formelle qui est l'étude des fondements
des signes étudiés en eux-mêmes et indépendamment de
leurs relations avec leurs objets ou leurs interprétants.
Deuxièmement, la logique ou la critique qui est l'étude de la
relation des signes à leurs objets. Troisièmement la
rhétorique formelle qui est l'étude de la relation des signes
à leurs interprétants, PEIRCE a repris ces termes à la
philosophie grecque et à la philosophie médiévale, mais il
est évident qu'il a anticipé sur la syntaxe, la sémantique
et la pragmatique. » (SAVAN, 1980, p. 9)
On ne manque pas de remarquer l'identité substantielle
de cette interprétation qui date de 1867 avec la distribution de CARNAP
ou celle de MORRIS, et si elle est admise, il ne nous reste plus qu'à
interpréter dans ce sens la théorie du signe triadique pour
authentifier définitivement la paternité. Parmi les
définitions les plus citées, celle-ci vient en première
place :
« Un signe ou representamen est un Premier qui se
rapporte à un Second appelé son objet, dans une relation
triadique telle qu'il a la capacité de déterminer un
Troisième appelé son interprétant, lequel assume la
même relation triadique à son objet que le signe avec ce
même objet ... Le troisième doit certes entretenir cette relation
et pouvoir par conséquent déterminer son propre troisième
; mais, outre, cela, il doit avoir une seconde relation triadique dans laquelle
le representamen, ou plutôt la relation du representamen avec son objet,
soit son propre objet, et doit pouvoir déterminer un troisième
à cette relation. Tout ceci doit également être vrai des
troisièmes du troisième et ainsi de suite indéfiniment...
(2.274). » (PEIRCE C. S., 1979, p. 147)
93
On connaît les propriétés de ces trois
instances du signe triadique. La catégorie de la priméité
est celle du possible qui s'accommode de n'être point actualisé.
La sécondéité est le mode de l'existant et la
tiercéité est l'ordre de la loi qui instaure la
prévisibilité comme une conséquence logique de la
sémiosis.
La priméité est donc le domaine de l'arbitraire.
Mais nous sommes loin du conflit qui opposait naguère SAUSSURE et
BENVENISTE sur ce point, car il faut admettre que cette pure possibilité
repose sur une convention que le code lui-même impose. En effet, les
tropes nous enseignent tous les jours qu'un signifiant donné auquel
l'habitude associe un signifié donné peut recevoir d'autres
signifiés totalement étrangers aux premiers. Cependant, cette
prolifération de signifié par le code n'est pas du type
cancéreux. C'est-à-dire, ce n'est pas une fluctuation
incontrôlable, sinon on ne comprendra pas pourquoi le langage dispose de
plusieurs unités lexicales, par exemple, pour s'en tenir à
celles-là, car les unités linguistiques peuvent se trouver en
deçà et au-delà.
En réalité, s'il y a possibilité pour un
signifiant de recevoir des signifiés diversifiés que la
diachronie finit par lexicaliser par voie de délocution ou non -
Saussure a déjà abordé cette question sous la question de
la mutabilité des signes - c'est parce que le langage s'interdit deux
pôles qu'il exploite partiellement. D'un côté, il y a
l'interdit d'un langage hapax mais qui se réalise dans les noms propres,
pour des raisons évidentes de surcharge des mémoires qui risque
de compromettre la communication, car avant tout, le langage a pour mission de
nous libérer du poids néfaste du réel pour accomplir
l'autonomie linguistique. Les noms propres sont en effet des
éléments difficilement mémorisés dans la langue.
D'autre part, le langage réduit à un seul
élément ne saurait non plus être le fonctionnement normal
du langage. Pourtant, nous avons quelquefois recours à ce langage
monolithique. Quand nous sommes pris en défaut de nomination, nous
employons des termes au sens très générique du type «
machin » ou « chose ». Le langage est un équilibre entre
ces deux pôles extrêmes. Mais si cet équilibre est possible,
c'est parce que la tiercéité, l'ordre de la loi, donc de la
prévisibilité, engage la sémiosis dans ce que nous pouvons
appeler un parcours d'évocations.
Illustrons cette propriété du signe de renvoyer
à d'autres signes, une propriété qui atteste de la
propriété isomorphe du mot et de la chose que résume
WITTGENSTEIN en cet aphorisme : « [...], nous ne pouvons imaginer
aucun objet en dehors de la possibilité de sa connexion avec d'autres
objets » (2.0121) (WITTGENSTEIN L. J., 1961).
Soit le mot « zébu ». Dans la culture
malgache, il y a ce que l'on peut appeler une civilisation du zébu dans
laquelle, l'animal en fonction de sa robe sert de contre-don à la
cérémonie fortement marquée par la transcendance verticale
comprise comme un rapport de l'homme avec les divinités, alors que dans
la culture européenne, d'une manière générale,
c'est au contraire la civilisation de la vache en fonction de la place qu'y
prennent les produits laitiers.
94
Dans le premier cas, la connexion est une dimension
spirituelle de la vie tandis que dans le second, c'est la dimension
matérielle qui est mise en avant. C'est ainsi que le mot «
zébu » renvoie à « sacrifice », à «
prêtre », à « office », à « offrande
», à « foule »
etc. et que de l'autre côté, le
mot « vache » renvoie à « lait », « beurre
», « fromage », « tartine », etc.
Il suffit de faire remarquer que chaque palier du parcours
peut être le point de départ d'une nouvelle orientation de
l'arthrologie. C'est de cette manière que nous concevons cet ad
infinitum qui rebute plus d'un des meilleurs linguistes français
dont BENVENISTE, de la lecture de l'oeuvre de PEIRCE en plus du fait que la
terminologie de PEIRCE est des plus fluctuantes.
À cela, il faut ajouter un autre facteur qui a
contribué à une méconnaissance de l'oeuvre du
sémioticien de l'autre côté de l'Atlantique : presque
à la même époque, l'édifice de SAUSSURE est
publié à titre posthume par ses étudiants, il y a une
sorte de domination de l'oeuvre de SAUSSURE dans le ciel de la linguistique
quand le texte rassemblé et traduit par Gérard DELEDALLE faisait
son apparition en Europe.
La deuxième illustration doit prendre en compte une
dimension énonciative. Soit l'énoncé « il va pleuvoir
» produit dans un contexte d'agriculture de la campagne malgache. Si la
tiercéité stipulée par l'énonciateur est un acte
illocutoire de mise en garde, alors les dérivations illocutoires
successives peuvent également être infinies : donner l'ordre de
ramasser les paddy qui sont en train de sécher, s'arroger le pouvoir
réaliser cet ordre, destiner cet ordre à une personne
précise qui de la sorte n'a plus l'ascendance, faire preuve de grand
expérience, dominer l'autre, se dispenser de la tâche
impliquée, etc. évidemment si la tiercéité
convoquée dans cet énoncé peut être comprise comme
une attente de cette pluie afin que les plantes soient arrosées, nous
allons dans une autre arthrologie.
Ce deuxième exemple qui nous semble être
l'argument fondamental qui permet de comprendre que, parmi les pères de
la pragmatique qui se sont illustrés chacun de manière
différente, la sémiotique triadique se révèle
être une théorie puissante qui inclut par sa conception
elle-même la dimension pragmatique du langage. Mais ce qu'il faut retenir
dans cette illustration de la théorie des interprétants, c'est
qu'elle permet l'équilibre du langage entre les deux extrêmes. En
effet, l'ordre de la loi qu'est la tiercéité non seulement
autorise une prévisibilité, mais surtout, il est ce qui permet le
changement de sens.
Avec l'essor de la linguistique, nous savons actuellement que
la théorie substitutive des tropes ne peut plus être
défendue. Les tropes sont une illustration de cet équilibre que
le langage maintient entre les deux pôles hapax et monolithique, et tel
qu'il se présente l'interprétant dans la sémiotique
triadique, il est ce qui fonde la théorie des figures comme une
modification de contenu et non une substitution de signe, le premier
étant égal à lui-même pour renvoyer à son
objet. Dès lors, c'est le troisième du signe triadique qui permet
la variation du sens dans les tropes.
La deuxième illustration de la nature de processus de
la sémiosis nous a permis de comprendre la dimension pragmatique de la
sémiotique triadique. La question est maintenant de savoir si les tropes
sont de nature pragmatique en tant que changement de sens.
95
Pour répondre à cette question, il nous faut
passer par deux détours qui sont une affirmation sur le langage. La
première affirmation est celle de NIETZSCHE : « la métaphore
est l'essence du langage » nous rapporte TODOROV qui revoit à
l'aune de la linguistique moderne cette affirmation et conclut que c'est de la
synecdoque qu'il s'agit en réalité. En effet, la synecdoque est
un mécanisme qui permet l'oubli les différences individuelles au
profit du plus petit dénominateur commun. (Cf. (TODOROV, 1970, pp.
28-29) qui cite NIETZSCHE).
C'est la question de l'être et du paraître qui est
ainsi renouvelée. Position que ne désavoue pas le groupe u, une
dizaine d'années plus tard. Cependant, il faut reconnaître que le
groupe est moins catégorique sans que la raison de cette restriction
soit apportée. Néanmoins, dans l'ensemble, on peut admettre que
la synecdoque est au coeur du langage :
« Dans tous nos discours, les sèmes essentiels
apparaissent certes, mais enrobés d'une information
supplémentaire inessentielle, non point redondante, mais
latérale. Selon ce point de vue, presque toutes nos dénominations
sont synecdochiques » (DUBOIS, et al., 1982, p. 36)
S'il faut interpréter la logique du raisonnement du
père de la linguistique structurale quand il dit que dans la langue
il n'y a que des différences, certes il ne s'agit de la même
différence dont parle NIETZSCHE. La différence qu'il faut oublier
chez le philosophe est celle qui permet de définir un type dans le sens
où quand on dit : « L'eau bout à 100° », il ne
s'agit pas d'une eau déterminée, isolée de ses semblables,
en dépit de la présence de l'article défini singulier qui
fonctionne ici au titre de générique. Il s'agit de n'importe
quelle eau, par oubli justement de leur différence. Cette unité
de typisation dans la terminologie de LAFONT ne retient que les
éléments pertinents à l'identification. « La praxis
linguistique rend compte du réel en transférant à
l'unité de typisation toutes les occurrences dont la
variété n'importe pas au message, en ramenant à
l'unité de hiérarchie signifiante toutes les occurrences
présentes en une. La praxème ne produit du sens qu'en ce qu'il
est cette double unité. » (LAFONT, 1978, p. 134)
C'est ainsi qu'en tant qu'unité de hiérarchie
signifiante, un arbre sera décomposé de la manière
suivante : racines et tronc et branches et feuilles. C'est la
décompostion sur le mode référentiel ou mode ð selon
le groupe ì (DUBOIS J. , EDELINE, KLINKENBERG, & MINGUET, 1977, p.
47 et passim). En tant qu'unité de typisation, le concept arbre sera :
peuplier ou eucalyptus ou platane, etc. Ce dernier type de décomposition
est appelé par le Groupe ì : décomposition sur le mode
conceptuel ou mode Ó.
La validité de la différence dans la langue chez
SAUSSURE ne saurait donc concerner l'identification des unités
sémiotiques de la première articulation de cette manière.
Elle n'est pas dans l'unité de la hiérarchie signifiante, mais
dans ce que Robert LAFONT appelle unité de typisation qui fonctionne par
ajout ou suppression de traits caractéristiques
Il est évident que plus on remonte dans la classe des
unités de typisation, on finit par arriver à des abstractions
comme « végétal » et au-delà du
végétal, on peut avoir « vivant ».
96
Ces exemples nous montrent que l'oubli des différences
caractéristiques est ce qui permet au langage de maintenir
l'équilibre entre les deux extrêmes, justifiant du coup que, sur
un plan diachronique, c'est tout le langage qui est tropique, plus exactement
synecdochique, car du point de vue synchronique le caractère tropique du
langage n'est que partiel du fait que la mémoire collective oublie la
nature figurative de la dénomination. Le mot grève
illustre bien cette amnésie de la mémoire collective.
Désignant d'abord, une bande de terrain couvert de sable ou de graviers
bordant un plan d'eau, il a fini par signifier directement la cessation
volontaire du travail dans un but protestataire ou revendicatif. Ce qui est
oublié, c'est que l'acquisition de ce sens dérive d'une pratique
politique des Grecs dont la première victime fut TEMISTOCLE (471 avant
J.C.) : les réunions qui visent à l'exercice de la
démocratie par comptage de voix sur l'ostrakon (tesson de
poterie) se passaient sur une grève. Ainsi, on peut tenir l'expression
« je suis en grève » pour une dérivation
délocutive car s'il décrit un état de chose, en même
temps, son énonciation atteste l'opposition à une situation, donc
l'intimation de changer cette situation, comme ce fut le cas sur la
grève athénienne jadis.
Autrement dit, le mot grève dans le sens actuel
était d'abord une métonymie. C'est une métonymie
fréquente. Elle consiste à nommer l'endroit de production pour
l'objet produit en cet endroit. D'une manière générale, la
métonymie de ce type est motivée par l'excellence de l'objet. Par
exemple un cachemire désigne une laine de chèvre du cachemire
Cet exemple nous permet de comprendre que cette figure est de
nature tropique, car il s'agit bien de cela, même si actuellement, les
locuteurs du français ne perçoivent plus cette dérivation
délocutive. La question est donc de savoir s'il y a des raisons qui nous
autorisent d'étendre cette dimension illocutoire à toutes les
figures.
Nous ne pouvons pas encore tirer de conclusion sur ce point
que si nous mentionnons la singulière aventure de la synecdoque, lisible
par intertextualité avec celle de Cendrillon de Charles
PERRAULT. La cadette oubliée au profit de ses deux soeurs
aînées se fut révélée à la fin plus
intéressante. De la même manière, la synecdoque,
définie négligemment comme une sorte de métonymie fut
longtemps éclipsée par cette dernière et la figure reine :
la métaphore. Cette aventure intertextuelle, voici comment TODOROV la
décrit :
« Tout comme dans les contes de fées ou dans
le ROI LEAR, où la troisième fille, longuement
méprisée, se révèle être à la fin la
plus belle ou la plus intelligente, Synecdoque, qu'on a longtemps
négligée - jusqu'à ignorer son existence - à cause
de ses aînées, Métaphore et Métonymie, nous
apparaît aujourd'hui comme la figure la plus centrale (FOUQUELIN et
CASSIRER l'avaient pressenti). » (TODOROV, 1970, p. 30)
La réhabilitation vient de chez le groupe u qui atteste
à deux reprises en deux endroits différents que la
métaphore est une double synecdoque complémentaire. Il en est de
même pour la métonymie mais dans cette dernière les
synecdoques sont de fonctionnement inverse. Dès lors, c'est faux de
croire que c'est la métaphore qui est l'essence du langage, mais c'est
bel et bien la synecdoque.
Il est vrai que la rhétorique traditionnelle
pêche par une démultiplication classificatoire, au contraire, les
recherches actuelles tendent maintenant vers un mouvement inverse de
97
réduction. La théorie des figures gagne ainsi en
puissance explicative sans qu'elle puisse évincer de l'habitude les
dénominations redondantes dans le champ des figures. De cette
manière, il y a lieu de faire une distinction nette entre la synecdoque,
comprise comme une sorte de métonymie et la métonymie
elle-même. Cette distinction est nécessaire afin que les
mêmes exemples ne soient évoqués pour illustrer les deux
figures. C'est malheureusement le cas de l'un de nos dictionnaires de
référence à l'usage des étudiants : le
Dictionnaire de linguistique (DUBOIS, et al., [1973] 1982).
L'histoire de la rhétorique est
décidément vouée à connaître
régulièrement des soubresauts. Si TODOROV a bien accepté
la réhabilitation de la synecdoque opérée par le groupe
hexacéphale de liège, les linguistes du groupe ì, il faut
reconnaître que des résistances se font savoir dont celle de
Michel LEGUERN, auteur, pourtant, d'un ouvrage de référence
très éclairant sur la question de la métaphore (LEGUERN,
1972). Nous tenons cependant pour établie la distribution suivante que
nous devons à Parfait DIANDUÉ BI KACOU :
« -Lorsque le rapport du signifiant au
signifié est un rapport de substitution totale, nous parlons du «
degré englobant ». C'est donc la métaphore. Exemple :
cheminée vivante (fumeur)
-lorsque le rapport du signifiant au signifié est
un rapport inné, naturel, consubstantiel, nous parlons du «
degré naturel ». C'est donc la synecdoque. Exemple : demander la
main d'une fille.
- Lorsque le rapport du signifiant au signifié est
un rapport créé, conditionné, nous parlons du «
degré non-naturel ». C'est donc la métonymie. Exemple : la
rue revendique sa liberté. » (DIANDUÉ BI KACOU,
2008)
Faute d'avoir aménagé ces distinctions
nécessaires, JAKOBSON (1963) et LEGUERN (1973), par exemple,
considèrent que la synecdoque n'est qu'une sorte de métonymie. La
source de la confusion étant le fait que les deux figures se
construisent sur une relation de la partie au tout.
Avec cette différence près que dans la
synecdoque cette relation de la partie au tout, est au sein d'une
totalité aux parties inaliénables tandis que, dans la
métonymie, les deux parties qui forment la totalité existent
l'une indépendamment de l'autre. En outre dans la synecdoque, le
mouvement tropique peut aller dans les deux sens. Quand il est dans le sens de
la partie au tout, on parle de synecdoque particularisante ou de synecdoque
décroissante puisque l'on évoque la partie pour le tout. Ainsi,
quand on dit un troupeau de cinq têtes, il s'agit d'une
synecdoque décroissante, l'expression tête est mise pour
l'animal tout entier ; en revanche quand on dit : faites rentrer les animaux,
la synecdoque est décroissante parce l'expression animal
désigne un ensemble infini alors qu'à travers elle on veut
désigner les animaux domestiques en nombre fini.
Pour la métonymie, les deux parties qui forment un tout
permettent tout simplement d'évoquer l'une pour l'autre et cela,
uniquement dans un sens conventionnel. Par exemple : boire un
verre.
98
Notre première thèse consiste à dire que
l'on emploie des tropes pour éviter au langage un défaut de
fonctionnement, soit par basculement dans le seuil monolithique, soit par
glissement dans le seuil d'un langage infinitisé. Ces deux seuils ont
pour conséquence de rendre le langage inapte à la communication,
pourtant dans le fonctionnement du langage lui-même nous nous approchons
de ces seuils.
Quand nous sommes pris en défaut de nomination, nous
utilisons le langage monolithique dans des expressions comme « chose
», « truc », « machin ». Ces expressions sont de
nature synecdochique : une synecdoque généralisante puisqu'on dit
le plus pour le moins. « Chose » désigne tout ce à quoi
nous pouvons référer alors que dans l'énonciation de ce
mot en tant qu'événement unique, nous faisons
référence à un individu linguistique précis.
Nous approchons également du langage infinitisé
dans le fonctionnement hapax des noms propres dans lequel la
répétition est interdite. C'est le blocage de la métaphore
car des individus semblables reçoivent des noms différents. Le
langage infinitisé a une utilité pratique dans l'anthroponymie,
mais il présenterait tellement de difficultés sérieuses si
les hommes n'ont pas la possibilité de dire leur propre nom dans cette
activité illocutoire que l'on appelle « se présenter ».
Mais s'il faut nommer chaque feuille des arbres d'un nom différent, on
ne s'en sortira pas même pour un seul arbre du fait qu'aucune feuille
n'est pas capable de se présenter. Alors, pour s'en sortir, on applique
les tropes comme le signale ce passage de NIETZSCHE :
« Comment se forment en effet les mots et les
concepts qu'ils contiennent ? « Tout concept - dit Nietzsche - naît
de la comparaison de choses qui ne sont pas équivalentes. S'il est
certain qu'une feuille n'est jamais parfaitement égale à une
autre, il est tout aussi certain que le concept de feuille se forme si on
laisse tomber arbitrairement ces différences individuelles, en oubliant
l'élément discriminant » (1873, p. 181)" (DI CESARE, 1986,
p. 98)
La seconde thèse est une affirmation du
caractère illocutoire des tropes. Il y a lieu de croire que le choix des
locuteurs pour employer une expression désignative parmi toutes les
possibles n'est pas neutre. Ce choix montre une attitude devant la chose
nommée. C'est le cas particulièrement des euphémismes qui
sont une manifestation de tabou linguistique. Cette explication correspond
exactement à la problématique qui a conduit à la
généralisation du performatif dans tout le langage, une attitude
non neutre étant exactement une attitude motivée. Pour faire la
jonction entre ce que nous nommons ici « attitude motivée » au
sein du langage et la théorie de l'énonciation, nous allons nous
référer à François RECANATI. RECANATI a un parcours
singulier, véritable lacanien, il fut convié par Roland BARTHES
à une charge de conférences à l'École des Hautes
Études en Sciences Sociales, mais dès la deuxième
année, il enseignait la philosophie analytique aux apprentis
sémiologues médusés ; le « coupable » est le
séminaire d'Oswald DUCROT qui avait découvert la même
discipline dix ans plutôt, dans la même École qu'il
fréquentait assidûment pendant une décennie. L'enseignement
de l'année en question (1976 - 1977) paru en 1979 sous le titre de
La Transparence et l'énonciation, pour introduire à la
pragmatique, aux éditions du Seuil (L'Ordre
Philosophique) (RECANATI, 1979), tant la « conversion » fut radicale
(RECANATI, 2001).
99
Cet ouvrage est une bonne vulgarisation des travaux de John
Langshaw AUSTIN. Nous retenons de ses arguments contre la transparence du
langage celui-ci qui nous paraît fondamental : un énoncé
représente un fait mais il est en lui-même un fait observable,
donc signifiant sans que cette signification fasse l'objet d'une mention :
« Un énoncé a un sens s'il représente un fait, auquel
cas il est signe de ce fait ; par ailleurs, son
énonciation, qui est aussi un fait peut
témoigner pour l'auditeur de l'état psychologique du locuteur :
l'énoncé représente un fait, et le fait de son
énonciation montre que le locuteur est dans tel état
psychologique » (RECANATI, 1979, p. 94)
L'énonciation comme fait apparaît clairement
quand on se pose la question de savoir pourquoi le sens prend cette forme de
l'énonciation et non de telle autre. Prenons un exemple contraire afin
de faire mieux ressortir la particularité de telle énonciation.
Que l'on dise ou non que le chat est sur le lit ne change rien au fait
qu'il existe un chat et qu'il est sur le lit. Alors, il faut conclure que le
fait de le dire n'est pas une tautologie du réel mais poursuit un but
pragmatique, c'est-à-dire que son énonciation a pour but de
modifier un rapport interlocutif.
Le fait de le dire constitue une énonciation dont la
force illocutoire est définie comme une affirmation. Dès lors, il
faut admettre que la motivation la plus claire d'une affirmation est de faire
croire. Tout se passe de la manière suivante : avant mon
énonciation, j'estime que mon interlocuteur ignore où se trouve
le chat et après, il le sait. Autrement dit, l'affirmation est un acte
qui prend naissance de l'occasion de la parole.
On peut transposer cette conclusion sur les tropes. Les tropes
portent sur un segment linguistique précis et sont identifiables par une
rupture isotopique. Ils peuvent donc être contenus dans une affirmation,
dans une interrogation, ou encore dans d'autres illocutoires. Ce qui nous
permet de comprendre que leur force illocutoire est dérivée par
rapport à celle qui le contient ; et il y a lieu de croire que la force
illocutoire des tropes s'articule sur la notion de préservation de la
face qui nous impose de taire les paroles de mauvais augure et de dire les
paroles de bon augure.
Il est un tabou linguistique universel : parler du sexe dans
la mesure où cet organe sert à la miction et qu'il se trouve
à proximité de l'organe de déjection. Or tout ce que nous
rejetons de ces organes porte la marque de la pourriture à hauteur de
mort, donc compris comme une violence contre la vie. C'est cette part de
pourriture de la vie que BATAILLE appelle la part maudite qui est
à l'origine des tabous entourant ces parties. Si de plus, l'acte sexuel
est compris comme une transgression d'un interdit : la souillure qui marque
notre animalité par opposition au monde du travail marqué par
l'ordre et l'humanité ; on comprend mieux que ce tabou linguistique est
une manière de taire les paroles de mauvais augure comme le souligne le
passage suivant :
«La vérité des interdits est la
clé de notre attitude humaine» : «sans le primat de
l'interdit, l'homme n'aurait pu parvenir à la conscience claire et
distincte, sur laquelle la science est fondée»; «l'homme est
un animal qui demeure "interdit" devant la mort, et devant l'union
sexuelle». Les interdits ne sont pas imposés du dehors et
ils
100
ont pour objet fondamental de contrer, faute
d'éliminer, la violence : la violence de la mort et la violence de la
sexualité -- la part maudite. Les interdits entourant la mort concernent
le mort, le cadavre et ce qui s'y apparente (les excrétions), et le
meurtre. Devant la nature (la décomposition, la pourriture, l'ordure, la
saleté), devant son animalité, l'homme ne peut éprouver
que la nausée (dégoût, répugnance,
écoeurement, effroi, horreur) : Freud avait bien fait remarquer que la
station verticale de l'homme diminue l'acuité de son odorat; mais, en
même temps, la nausée -- le dégoût des ordures et des
odeurs naturelles qui atteint son summum en toute société
parfumée et aseptisée -- en face de l'animalité contribue
à la station verticale et, de là, à l'oralité...
» (LEMELIN, 1996)
Mais, l'interdit a ceci de paradoxal : il n'y a pas d'interdit
absolu ; ce que l'interdit censure, en même temps il le postule.
Justement, ce mouvement de la censure et de la postulation, nous l'obtenons
dans le mouvement des tropes en vertu du principe selon lequel « nommer,
c'est faire exister ». Ainsi, nous nommons le sexe par le terme absolument
neutre de « chose » que le contexte désambiguïse.
De la même manière quand nous disons «
prendre un verre » pour « boire » la métonymie a pour
effet de préserver la face sous le terme absolument neutre de verre, car
le verre ne peut pas conduire à l'ivresse qui risque de nous renvoyer
à notre propre animalité par absence de pudeur.
Pareillement quand Jésus, dans sa prière au
Gethsémani dit « éloigne-moi de cette coupe » ; la
métonymie « coupe » lui permet de taire l'affront qui consiste
à considérer Dieu son père comme un donneur de poison
à son enfant bien que la métonymie ait ici une coloration
métaphorique.
Même quand on dit « voile » pour « bateau
», la préservation de la face n'est plus très bien sentie
actuellement, mais si l'on admet qu'avant la maîtrise de l'énergie
à vapeur, c'est le moyen essentiel de communication entre pays mais
c'est ce qui peut aussi amener la guerre comme en témoigne la guerre de
Troie qui a valu à Iphigénie d'être sacrifiée
à Aulis pour permettre aux Spartiates de voguer sur la mer afin de mener
la guerre aux Troyens.
Une parole flatteuse ou galante comme « jolie robe »
adressée à une femme rentre dans la même catégorie
parce que la robe est métonymique du corps qui la porte. Cette parole
permet d'éviter d'aborder de front la question du corps de la femme ;
elle fonctionne à la fois comme une censure et postulation du corps et
de cette manière nous ne tombons pas dans l'animalité.
Cependant, la valeur illocutoire des tropes ne s'inscrit pas
toujours au niveau irénique selon un principe de coopération dans
le parcours conversationnel, elle peut être aussi dans le registre
polémique. Ainsi, dans les insultes quand on qualifie quelqu'un de
« singe », c'est lui dénier les propriétés de
l'humain pour lui attribuer celles de l'animal mentionné. Autrement dit,
si la généralisation du performatif à tous les
énoncés est acceptée, il s'ensuit logiquement que les
tropes ont aussi une valeur illocutoire. C'est ce que nous avons tenté
de démontrer dans ces pages.
101
Travaux cités
DI CESARE, D. (1986, Juilet). "Langage, oubli et
vérité dans la philosophie de Nietzsche". Histoire,
épistémologie, langage, pp. 91 - 106.
DIANDUÉ BI KACOU, P. (2008, août).
éditions publibooks. Récupéré sur Google
books:
http://www.publibook.
com/boutique2006/detaillu-1878PB.HTML
DUBOIS, J., EDELINE, F., KLIKENBERG, J.-M., MINGUET, P., PIRE,
F., & TRINON, H. e. (1982). Rhétorique Générale.
Paris: Seuil.
DUBOIS, J., EDELINE, F., KLINKENBERG, J.-M., & MINGUET, P.
(1977). Rhétorique de la poésie: lecture linéaire,
lecture tabulaire. Bruxelles: Editions Complexes.
DUBOIS, J., GIACOMO, M., GUESPIN, L., MARCELLESI, C., MARCELLESI,
J.-B., & MEVEL, J.-P. ([1973] 1982). Dictionnaire de Linguistique.
Paris: Larousse.
LAFONT, R. (1978). Le travail et la langue. Paris:
Flammarion.
LEGUERN, M. (1972). Sémantique de la métaphore et
de la métonymie. Paris: Larousse.
LEMELIN, J. M. (1996). L'expérience ou
l'évènement tragique. Consulté le août 17,
2013, sur
https://www.google.mg/#bav=on.2,or.r_qf.&fp=d6bc00e82892d683&q=lemelin+:+exp%5E%
C3%A9rience+t+%C3%A9v%C3%A9nement+tragique:
www.ucs.mun.ca/~lemelin/EVENEMENT.html
PEIRCE, C. S. (1979). Ecrits sur le signe. (G.
DELEDALLE, Trad.) Paris: Seuil.
RECANATI, F. (1979). La transparence et l'énonciation,
Pour introduire à la pragmatique. Paris: Seuil.
RECANATI, F. (2001). La conjoncture d'Oswald DUCROT, vingt
ans après. Récupéré sur Institut Jean
Nicod:
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/05/33/11/PDF/ijn_00000162_00.pdf
SAVAN, D. (1980, Juin). "La sémeiotique de Charles
S.Peirce". Au delà de la sémiolinguistique: la
sémiotique de C.S. Peirce, pp. 9-23.
TODOROV, T. (1970). "Synecdoques", dans Recherches
rhétoriques, Communications,16. Paris: Seuil.
WITTGENSTEIN, L. J. (1961). Tractatus logicophilosophicus, suivi
de Investigations philosophiques. Paris: Gallimard.
102
8. MÉTAPHORE ET FEMME
RÉSUMÉ
Cette étude vise à rendre compte de la collision
entre la métaphore et la comparaison. Il s'ensuit que ce travail refuse
d'accepter de considérer la métaphore comme une comparaison avec
ellipse des outils de comparaison. Dans le phénomène
métaphorique, c'est une vision du monde qui a pour cadre la
préservation de la face. Tandis que dans la comparaison, le sujet
parlant s'inscrit dans la dimension cognitive du rapport interlocutif.
Autrement dit, la métaphore est passionnelle tandis que la comparaison
est pédagogique. Ou encore, il y a lieu de considérer la
métaphore dans l'ordre du désir, par contre la comparaison
opère au niveau de la validité du jugement.
Mots clés : métaphore, comparaison, désir,
jugement, passion
ABSTRACT
This study aims to report on the collision between metaphor
and comparison. It follows that this work refused to accept to consider the
metaphor as a comparison with comparison tools ellipse. In the metaphorical
phenomenon, it is a vision of the world which is the preservation of the face.
While in comparison, the speaking subject fits into the cognitive dimension of
the interaction report. In other words, the metaphor is passionate while the
comparison is educational. Or again, it is necessary to consider the metaphor
in the order of desire, however the comparison operates at the level of the
validity of the judgment.
Key words: metaphor, comparison, desire, judgment, passion
La littérature sur la métaphore a connu ces
dernières années une fluctuation sans précédent.
Témoigne de cette augmentation vertigineuse, une ambigüité
native de la métaphore : TODOROV (1970, p. 28) nous rapporte que l'adage
selon lequel la métaphore est l'exception s'accompagne naturellement de
son contraire : la métaphore est la règle. Une
ambiguïté que tranche GENETTE en ces termes:
« Le mouvement séculaire de réduction
de la rhétorique semble donc aboutir à une valorisation absolue
de la métaphore, liée à l'idée d'une
métaphoricité essentielle du langage poétique - et du
langage en général ». (GENETTE, 1972, p. 36)
Pour désambigüiser, ce travail va commencer par
s'interroger sur la collision entre la comparaison et la métaphore.
Ensuite, dans une perspective pragmatique, du mécanisme de la
métaphore, il traitera de la métaphore et de la synecdoque. Pour
terminer, il traitera, toujours dans une démarche pragmatique, de la
métaphoricité de la femme ; à partir de cette remarque de
Jean PETITOT :
« La relation dominante est la relation
signifié/signifiant (la cause du désir et non pas la
validité du jugement), le référent n'étant qu'un
tenant lieu (un artefact, un simulacre, un trompe-l'oeil) servant de support.
» (PETITOT, 1982, p. 25)
103
Pour commencer observons la collision entre métaphore
et comparaison. Le premier problème de la métaphore qui va
être élucidé est d'abord sa connexion avec la comparaison.
En effet, des auteurs affirment que la métaphore est une comparaison
sans outil de comparaison. La position de LE GUERN sur ce point est très
claire et instructive. Cet auteur n'admet pas que la métaphore soit une
comparaison elliptique.
La raison de ce refus réside dans une distinction
étymologique d'où dérive le terme de « comparaison
» en français : « Le mot même de comparaison fournit un
outil mal commode et son ambiguïté gêne parfois le
grammairien. Dans la terminologie grammaticale, il remplace deux mots latins
qui correspondent à des notions bien distinctes, la « comparatio
» et la « similitudo ». Sous le nom de « comparatio »
sont groupés tous les moyens qui servent à exprimer les notions
de comparatif de supériorité, d'infériorité et
d'égalité. La « comparatio » est donc
carctérisée par le fait qu'elle fait intervenir un
élément d'appréciation quantitative. La « similitudo
», au contraire, sert à exprimer une jugement qualitatif, en
faisant intervenir dans le déroulement de l'énoncé
l'être, l'objet, l'action ou l'état qui comporte à un
degré éminent ou tout au moins remarquable la qualité ou
la caractéristique qu'il importe de mettre en valeur. » (LE GUERN,
1972, p. 52)
La métaphore relève de la similitude et non de
la comparaison. La comparaison qui permette cette confusion d'approche de la
métaphore est celle d'égalité. D'après cette
information donnée par LE GUERN, il ne faut pas confondre
l'opération de comparaison qui est une évaluation quantitative et
l'opération de similitude qui fait intervenir la qualité bien que
les deux opérations puissent recourir aux mêmes outils
linguistiques entre les termes impliqués.
On sait que la comparaison utilise des outils comme plus +
adjectif+ que et ses variantes, tandis que l'opération de
similitude est restreinte à une expression d'égalité et
emploie les outils du type semblable à, pareil
à, tel, etc. Mais les deux constructions peuvent utiliser
en commun l'outil « comme ». Il en résulte que la question
qu'il nous faut résoudre est de savoir s'il l'on a affaire à des
comparaisons ou à des similitudes dans ce cas.
On peut supposer que dans la comparaison, l'opération
est du domaine cognitif. Elle consiste à faire accéder à
l'inconnu à partir du connu. Ainsi quand ont dit :
1. La terre est ronde comme une orange
Il s'agit dans cet exemple de faire connaître la forme
de la terre à partir d'un observable. Il est évidemment
très difficile de se rendre compte de la forme sphérique de la
terre, étant donné la différence incommensurable
d'échelle entre l'homme et la planète; et qu'au moment de
l'affirmation, l'humanité ne disposait pas de moyen de s'arracher de la
gravitation pour observer la terre du dehors.
Autrement dit, la comparaison est un moyen cognitif de faire
passer l'inconnu au connu au même titre que dans les langages
formalisés comme la mathématique, dans une équation, on se
sert du connu pour arriver à la connaissance de l'inconnu. Par exemple,
si l'inconnu est « x » ; l'équation ax + b = 0 sera
résolue par passage du même côté des connus. Ce qui
nous
104
donne : ax = -b ; dès lors x = -b/a. Le signe
d'égalité de la mathématique relève de la
comparaison de deux grandeurs. Il en est exactement de même dans
l'exemple suivant où ce qui motive l'énonciation est le
désir de faire connaître la force du fils à partir de la
force du père qui est connue :
2. Il est aussi fort que son père
Par contre, dès que les termes mis en rapport par
l'outil linguistique entretiennent une rupture isotopique manifeste, il faut
conclure que « comme » exprime la similitude. C'est le cas de
l'affirmation célèbre d'Éluard :
3. La terre est bleue comme une orange
Il ne s'agit plus là d'affirmer de faire avancer la
connaissance de la terre à partir de quelque chose qui est connu, mais
de donner à la métaphore son sens étymologique d'image,
c'est-à-dire de transport d'un lieu à l'autre. Ce changement de
topique dans la linguistique moderne est évalué en termes
d'isotopie. Ce qui permet de dire que métaphoriser est une
manière de voir.
Dans l'exemple (3), ce n'est pas la connaissance de la terre
qui est la motivation de l'énonciation, mais une certaine image de la
terre, une certaine vision de la terre qui ne relève plus de
l'objectivité partagée, mais disons d'une objectivité
subjective au même titre qu'un enfant pleure quand on lui dit que le
Petit Chaperon Rouge est mort. Donnons encore des exemples qui, malgré
leur proximité, marquent néanmoins la distance qui sépare
la comparaison de la similitude.
4. Pierre est aussi fort que Paul
Dans cet exemple, on remarque que le comparé et le
comparant entre dans le même ordre de quantité de force, il s'agit
donc d'une comparaison puisqu'ils appartiennent exactement à la
même isotopie. Ce qui ne sera pas le cas dans l'exemple (5) qui suit :
5. Pierre est fort comme un lion12
Puisqu'il n'y a pas de commune mesure quantitative entre la
force de Pierre en tant qu'être humain et la force d'un lion. On peut
alors conclure que ce comparant qui est en rupture isotopique ne fait pas
intervenir une comparaison mais une similitude, donc une métaphore,
c'est-à-dire une transposition d'un topique à l'autre.
Le problème qui empêche de voir une
métaphore dans (5) est la présence de l'adverbe de la similitude
« comme » que les analystes attachent à la
comparaison. Ce qui en fait justifie la définition de la
métaphore comme elliptique de l'outil de comparaison. En effet, quand on
dit que : « On tend à voir dans la figure « comparaison »
une opération discursive pleine de bon sens et sans envol ni
mystère, tandis qu'on réserve à la métaphore le
privilège de l'intuition poétique, à qui les
affinités des choses sont révélées dans les
éclairs de la génialité.
12 Je dois le contraste de ces exemples à LE
GUERN (LE GUERN, 1972)
Il est aisé de voir que cette distinction risque
d'être purement formelle. Il suffirait donc de biffer un petit adverbe,
dans une « comparaison » pour la transformer en «
métaphore » ? Et l'on abâtardirait une métaphore en y
glissant le même adverbe ? C'est pourtant ce qui se passe, bien souvent.
» (MORIER, 1981, p. 671)
On constate qu'il y a une nette volonté de
séparer la métaphore de tout adverbe avilissant ou d'emploi
déshonorant. La raison en est qu'il y a une confusion entre comparaison
qui intervient entre des éléments du même topique et la
métaphore qui se sert de l'outil de la similitude qui réalise le
transport entre éléments situés sur des isotopies
différentes. La fonction métaphorique est de réduire la
différence isotopique.
Même LE GUERN, le premier qui a introduit cette
différence entre la comparatio et la similitudo, n'ose
pas franchir ce pas de crainte d'avilir la métaphore qui est victime
d'une hagiographie. Il se contente de dire que la similitude et la
métaphore appartiennent au même registre mais elles sont
différentes :
« La distinction que le mécanisme de la
similitude maintient entre les deux représentions garde à l'image
plus d'épaisseur concrète, mais ne lui donne pas la même
force de persuasion que l'identification établie par la
métaphore. On peut rendre compte de la différence des effets
produits en disant que la similitude s'adresse à l'imagination par
l'intermédiaire de l'intellect, tandis que la métaphore vise la
sensibilité par l'intermédiaire de l'imagination. » (LE
GUERN, 1972, p. 57)
Faute de pouvoir gloser sur la différence entre
sensibilité et imagination, nous allons confronter cette dernière
remarque aux exemples qui servent à illustrer le scepticisme d'un MORIER
qui ne fait pourtant pas la différence entre similitudo et
comparatio. En tout cas, de pareille remarque relève de ce que
nous appelons ici une hagiographie de la métaphore, comme si la
métaphore ne pouvait qu'être une invention de poète de
bonne naissance et ne peut pas du tout être attribuée à la
plèbe.
Voici ces exemples : Comparaison en forme
Les eaux fuyaient comme de mouvants miroirs
Les flots glissaient le long du bord comme de vertes
couleuvres
L'amour est pareil à un oiseau qui chante
L'aurore, telle une déesse aux doigts couleur de rose
...
105
Raccourci métaphorique
Les eaux fuyaient, mouvants miroirs (Hugo)
Les flots le long du bord glissent, vertes couleuvres
(Hugo)
L'amour est un oiseau qui chante
L'Aurore aux doigts de rose (Homère) (MORIER, 1981, p.
671)
106
Nous remarquons que tous les exemples de gauche sont anonymes,
peut-être de formation plébéienne, tandis que leur
conversion dans la colonne de droite fait surgir des auteurs
célèbres à un exemple près. Il semble alors que la
consécration de la forme sans outil explicite de liaison vise à
préserver la métaphore de l'atteinte de la plèbe. C'est
une attitude que condamne NIETZSCHE, nous verrons comment se passe cette
condamnation dans la deuxième partie de ce travail.
Parallèlement à la différence entre
performatif explicite et performatif implicite, nous sommes enclin à
croire qu'il faut appeler les exemples de la colonne de gauche «
métaphore explicite » et ceux de la droite « métaphore
implicite ». Puisque de la même manière, que ce soit dans (6)
ou dans (7), l'énonciation accomplit une affirmation, avec cette
différence près que (6) comporte le préfixe performatif,
alors que (7) l'économise.
6. J'affirme que la terre est ronde
7. La terre est ronde
En effet, en appliquant aux exemples de gauche la règle
de détachement de sens définie par CORNULIER en cette formule :
« Détachement (fort) du sens: (P & (P signifie Q)) signifie
Q.
Cette formule peut se paraphraser de diverses manières
telles que : asserter conjointement que P, et que cette assertion de P signifie
que Q, revient à asserter que Q ; signifier que P et que P signifie Q,
c'est indirectement signifier que Q ; dire conjointement que P, et que ce
disant on dit que Q, c'est dire que Q ; etc. » (CORNULIER, 1982, p.
132)
De cette manière en prenant le comparé comme P,
c'est-à-dire la séquence Les eaux fuyaient, et comme Q :
comme de mouvants miroirs ; on s'aperçoit que
l'énonciation n'a pas pour but d'asserter P, mais au contraire
d'asserter Q, autrement dit, de faire une métaphore en voyant à
la place des eaux qui fuyaient des mouvants miroirs.
En d'autres mots, de la représentation
communément admise en langue d'un segment de réalité du
monde, encore que l'on peut se demander que fuyaient les eaux,
l'énonciation impose une vision idiosyncrasique, preuve encore - s'il
faut le rappeler - de la relativité linguistique.
Maintenant, en passant dans la colonne de droite,
évoquons la version paradigmatique du détachement du sens :
« Thèse (faible) de détachement du sens: (P & (P
signifie Q)) implique Q.
(...), on peut appeler P l'interprété, Q
l'interprétant, et la proposition « (P signifie Q) »
l'interprétation. L'idée du détachement (faible) du sens
est que la conjonction d'un interprété avec une
interprétation implique l'interprétant." (CORNULIER, 1982, p.
127)
Faisons l'analyse pas à pas. D'abord HUGO affirme P,
ensuite il affirme Q. Présentée de cette manière la double
affirmation ne fait pas métaphore. Il faut donc admettre que HUGO a mis
Q comme interprétant de P, dès lors il a impliqué que Q,
c'est-à-dire que les eaux qui fuyaient sont de mouvants miroirs. En
conclusion, nous disons que métaphoriser est un acte de langage qui
impose une vision du monde particulière au même titre que quand un
enfant
107
juxtapose à un dessin informe le commentaire «
maman », il donne sa vision du monde. Sans le commentaire, rien ne permet
de dire que le dessin représente sa maman. Visionnons cet exemple :

Ce qui n'est pas le cas pour la comparaison au sens de
comparatio. Dire que la terre est ronde comme une orange n'a
pas pour but d'asserter « l'orange » mais d'affirmer « la
rondeur » de la terre. La comparaison, au sens strict, est un cas
où le détachement du sens n'opère pas. Le signal qui
indique qu'il s'agit de comparatio est que l'élément
comparant, non seulement n'entre pas en rupture isotopique, mais en plus ne
viole pas le code linguistique.
Dans la comparatio, le comparant illustre tout
simplement une propriété du comparé qu'il possède
également par une sorte d'homothétie, une variation
d'échelle qui interdit que le comparé soit assimilé au
comparant. Contrairement, dans la métaphore explicite,
l'élément « comme » - ou ses variantes - relève
de la similitude réalise l'identité du comparant au
comparé. Ce qui permet dans le cas de la métaphore in
absentia de prendre le comparant comme une anaphore du comparé dans
une parfaite autonymie. C'est ce prévoit la règle du
détachement du sens au niveau de la similitudo et que
WITTGENSTEIN dit dans cette formule : « L'identité de l'objet,
je l'exprime par l'identité du signe et non pas au moyen d'un signe
d'identité. » (5.53) (WITTGENSTEIN, 1961, p. 80)
Si dans la métaphore explicite, au sens que nous venons
de définir à l'instant, l'élément « comme
» marque que la partie à sa droite est dérivée de la
partie à sa gauche, dans la métaphore implicite, en revanche,
c'est la simple juxtaposition qui indique cette dérivation. En tout cas,
dans l'un ou l'autre forme, la métaphore illustre parfaitement la
remarque de DANESI et PERRON sur la sémiotique narrative
considérée comme théorie intégrée :
« La perspective greimassienne de la cognition permet
de postuler que le mode narratif du traitement des informations sensorielles et
de leur organisation en structures narratives par l'entremise d'un «
parcours génératif » constitue un trait fondamental de
l'esprit et peut être considéré comme une extension de
l'expérience sensorielle dans le domaine de la pensée abstraite.
On retiendra que cette théorie est une « théorie
intégrée », car elle tente d'expliquer la sémiosis en
termes d'un complexe corps/esprit/discours. La signification commence par le
corps, est transférée à l'esprit, et finit dans le
discours. » (DANESI & PERRON, 1996, p. 29)
Cette dernière remarque renforce l'idée que
métaphoriser est avant tout une manière de voir et que le langage
est une vision du monde. Ce qui nous permet de nous engager dans la
deuxième partie de ce travail.
Nous allons commencer par parler de la motivation de la
métaphore pour terminer sur le mécanisme de la
métaphore.
108
NIETZSCHE nous assure que la métaphore est le langage
des premières nations, ce n'est que dans une évolution
diachronique, à cause certainement de la mort de la métaphore par
usure, qu'une partie du langage est perçue comme non
métaphorique. Tel est par exemple le cas d'un professeur qui demanderait
à ses élèves de prendre une feuille, aucun de ses
élèves n'irait sortir et prendre une feuille de plante.
On peut constater chez NIETZSCHE, la critique sceptique du
langage qui se présente en ces termes chez CASSIRER :
« Le langage n'est pas, pour elle, [la critique
sceptique] un organon de connaissance, de véritable appréhension
de l'être ; c'est lui, au contraire, qui s'interpose toujours entre les
hommes et la réalité, qui tisse sans cesse le voile de Maïa
et nous y enveloppe de plus en plus. » (CASSIRER, 1969, p. 64)
Mais chez lui cette critique sceptique ne sonne pas comme un
destin, au contraire, il vise à la libération du langage de la
métaphore originelle qui semble avoir fixé une fois pour toute la
seule interprétation du monde. C'est ce que l'on peut constater dans la
remarque suivante que nous rapporte DI CESARE Donatelli :
« La thèse de Nietzsche est qu'on peut
constater dans les différentes langues une même transformation de
concepts : l'idée de « bon » dérive de « «
noble », « aristocratique », l'idée de « mauvais
» provient de « plébéien. » (DI CESARE,
1986)
À la lecture de ce passage, on comprendra mieux
pourquoi suggestion est faite ici d'appeler de métaphore
explicite les transports topiques qui font apparaître un outil
de la similitudo. En effet, le langage a imposé comme
vérité que la métaphore soit un transport qui se passe
d'outil de transport. Tout se passe comme si l'on voulait ennoblir la
métaphore par cette exclusion de l'outil de la similitudo et de
la sorte la préserver de l'atteinte de la plèbe. Témoigne
de cette tendance, la définition que voici de la métaphore chez
DUMARSAIS, en citation chez LE GUERN :
« La métaphore est une figure par laquelle on
transporte pour ainsi dire, la signification d'un mot à une autre
signification qui ne lui convient qu'en vertu d'une comparaison qui est dans
l'esprit » (Traité des tropes, II, 10) (LE GUERN, 1972, p.
54)
Or il faut admettre que cet ennoblissement ne corresponde
à aucune réalité. La métaphore est la seule
manière d'accéder à l'appréhension du monde que
l'on soit aristocrate ou que l'on soit plébéien. Il est
évident que l'activité de philologie ne peut jamais être
exhaustive puisque le témoignage linguistique d'une époque
révolue peut toujours faire défaut, notamment pour des
sociétés qui se sont mises tardivement à
l'écriture. Néanmoins, nous pouvons çà et là
fournir des exemples étymologiques qui attestent que la métaphore
est la matière originelle du langage.
Le premier exemple qui va nous servir d'illustration de cette
position est le « clic » de la souris de l'ordinateur qui a
donné naissance au verbe « cliquer ». Nous savons que le
« clic » est une onomatopée qui reproduit le bruit de la
souris quand on appuie dessous. Le verbe est ici bel et bien
métaphorique dans la mesure où il est dans un rapport analogique
avec ce qu'il désigne. Cette métaphore se maintient en
dépit du fait que dans les ordinateurs portables, la
109
souris est remplacée par un « touch pad
[touche feutrée]» qui ne provoque aucun clic. Il en va de
même du verbe « claquer » ou du nom de l'oiseau « coucou
».
Être de bonne naissance ou non est encore souvent une
question cruciale de nos jours parce que nous avons oublié que les mots
qui en rendent compte étaient au départ métaphoriques.
Deux exemples malgaches dans leur opposition suffisent à éclairer
ce figement de la métaphore. Un « andevo [esclave]» est
quelqu'un qui ne mérite rien tandis qu'un « andriana
[seigneur]» a tous les droits ; le seul droit du premier est d'être
au service du second. Ce que l'on oublie très vite est que le mot «
esclave » est une métaphore obtenue par dénégation de
toutes les propriétés de l'humain sauf celle de servir les
seigneurs. La preuve en est qu'un individu de bonne naissance peut être
appelé Razanakondevo dans le but de conjurer le sort.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas mentionner linguistiquement la bonne
étoile de quelqu'un selon son astrologie de peur de fâcher les
divinités qui peuvent dès lors lui refuser cette ascendance
positive.
La position de NIETZSCHE - philosophe du langage - est une
radicalisation de la métaphore au point qu'il définit l'homme
à travers la fiction, comme le souligne cette lecture de NIETZSCHE par
DI CESARE : « En tant que procédé métaphorique de
connaissance, en tant que recherche de l'identité dans la
différence, la fiction est inévitable. Elle constitue le
fondement de toute interprétation et l'homme a justement besoin
d'interpréter le monde ; elle est
« cet instinct qui pousse l'homme à former des
métaphores, cet instinct fondamental de l'homme dont on ne peut faire
abstraction un seul instant, car on ferait abstraction de l'homme
lui-même ». (1873 p. 195). » (DI CESARE, 1986, p. 99)
En ramenant cette remarque de l'homme comme être
métaphorique dans ses conséquences linguistiques, on
s'aperçoit que le langage s'interdit deux seuils. Chaque seuil rend la
communication impossible. Le premier seuil est celui du langage hapax
qui se réalise pourtant dans les noms propres :
« Un langage infinitisé, correspondant
symétrique de l'infinité des événements du monde,
ne serait susceptible d'aucun apprentissage, l'occasion nouvelle prenant tout
à coup au dépourvu la puissance signifiante. Il ne soutiendrait
aucune communication. Il ne serait pas langage du tout, n'étant fait que
d'hapax. » (LAFONT, 1978, p. 129)
L'autre seuil interdit est le langage monolithique (LAFONT,
1978, p. 133) réduit à un seul élément qui pourrait
tout dire. Si un tel langage existe, nous perdrons également la
possibilité de communiquer parce que le langage ne comportera plus de
différence qui est le support du sens. Il nous reste alors à
naviguer entre ces deux seuils en métaphorisant, selon le passage
suivant de NIETZSCHE que nous rapporte DI CESARE :
« Comment se forment en effet les mots et les
concepts qu'ils contiennent ? « Tout concept - dit Nietzsche - naît
de la comparaison de choses qui ne sont pas équivalentes. S'il est
certain qu'une feuille n'est jamais parfaitement égale à une
autre, il est tout aussi certain que le concept de feuille se forme si on
laisse tomber
110
arbitrairement ces différences individuelles, en
oubliant l'élément discriminant » (1873, p. 181)" (DI
CESARE, 1986, p. 98)
C'est de cette manière que NIETZSCHE comprend
l'hominisation de l'espèce à partir de la faculté de
métaphoriser. TODOROV qualifie ce mouvement de synthèse du
multiple en une seule unité de synecdoque (TODOROV, 1970, p. 29) ; en
effet, si l'on transpose au mot « arbre » le principe d'oubli, ce mot
englobe peuplier, eucalyptus, manguier, etc. comme
hyponymes, alors on peut parler de synecdoque de la partie pour le tout.
Seulement, en pensant que la naissance du concept est une vision qui unifie
plusieurs zones du réel par oubli des différences individuelles,
on est dans le mécanisme de la métaphore : l'identification du
non identique.
Autrement dit, la manière dont NIETZSCHE
présente la métaphore est une critique de la question
philosophique de l'être et du paraître pensée comme une
certitude, alors que ce n'est qu'une métaphore. Dès lors, on
s'aperçoit que la véritable nature de la métaphore est un
oubli des différences afin d'accéder à une forme qui
satisfasse le désir humain dans son appropriation du monde des
objets.
Du même coup, la métaphore de NIETZSCHE est une
métaphore primaire et celle analysée par la rhétorique est
dérivée, une métaphore de la métaphore dans
laquelle l'investissement du désir se révèle être
une dimension illocutoire de la figure. C'est cet oubli des différences
qui d'ailleurs a permis au Groupe u de définir la métaphore comme
une double synecdoque (1982, p. 190), selon le schéma
général du tableau suivant :
|
Schéma général
|
|
a)
|
(Sg + Sp)?
|
|
|
Métaphore possible
|
Bouleau -3 flexible -3 jeune fille
|
b)
|
(Sg + Sp) ?
|
|
|
Métaphore impossible
|
Main -3 homme -3tête
|
c)
|
(Sp + Sg) ?
|
|
|
Métaphore impossible
|
vert -3 bouleau -3 flexible
|
d)
|
|
(Sp + Sg) ?
|
|
|
|
Métaphore Bateau ? voiles ? veuves
possible
|
111
Prenons la métaphore (a) qui consiste à
désigner une jeune fille par le terme bouleau. C'est
une combinaison d'une synecdoque généralisante (Sg) et d'une
synecdoque particularisante sur le mode conceptuel (?). On oublie d'abord que
tout ce qui est flexible n'est pas un bouleau, on obtient alors la synecdoque
généralisante « bouleau », ensuite, on oublie que la
fille n'est pas seulement flexible, et l'on obtient la synecdoque
particularisante flexible. Finalement, sont oubliées les
différences entre « bouleau » et « jeune fille »
pour les identifier à partir de leur propriété commune :
la flexibilité.
Cet exemple est authentique au niveau du texte qui
l'insère. Il montre que la métaphore en s'appuyant sur le
véhicule « flexible » met en évidence un
caractère de l'objet ainsi dénommé en fonction du
désir du sujet dénommant. Cette remarque nous amène
à la troisième et dernière partie de notre travail.
Quand ANSCOMBRE définit une loi de discours selon
laquelle communiquer un désir, c'est demander la satisfaction de ce
désir (1980, p. 87), le plus souvent cette communication se fait de
manière indirecte dans le but de préservation de la face issue
des travaux de Erwin GOFFMAN dans une perspective sociologique : « Un
individu "garde la face" lorsque la ligne d'action qu'il suit manifeste une
image de lui-même consistante, appuyée par les jugements et les
indicateurs venus des autres participants, et confirmée par ce que
révèlent les éléments impersonnels de la situation.
Il est alors évident que la face n'est pas logée à
l'intérieur ni à la surface de son possesseur, mais qu'elle est
diffuse dans le flux des événements de la rencontre, et ne se
manifeste que lorsque les participants cherchent à déchiffrer
dans ces événements les appréciations qui s'y expriment.
La ligne d'action d'une personne pour d'autres personnes est
généralement de nature légitime et
institutionnalisée » (GOFFMAN, 1984, p. 10)
Par la suite, cette idée a fait irruption au sein de la
pragmatique, grâce notamment aux travaux de Penelope BROWN et Stephen
LEVINSON (2000 [1978]) en termes de théorie de la face. Un panorama qui
brosse l'évolution diachronique de cette question se trouve dans un
article de Carasela ENACHE et de Gabriela POPA. (ENACHE & POPA, 2008). Pour
résumer cette théorie de la face, il n'est que de commenter
l'exemple suivant :
8. Saika mba hangataka afo [Je voudrais demander du
feu]
Dans la traduction française, notons que le
conditionnel présent est une combinaison du passé marqué
par le morphème de l'imparfait -ais et du futur par le morphème
-r- . Ce qui est rendu en malgache par le morphème saika qui
exprime une chose qui a failli se passer et la marque du futur dans le verbe
hangataka par le morphème h-.
Cette combinaison permet de garder la face ; en cas de refus,
on peut évoquer le passé qui n'est plus de la requête, et
en cas de satisfaction, on s'en réjouit puisque la marque du futur
implique que c'est encore un projet. Encore qu'ici, cette marque du futur
peut
112
également servir à garder la face en
présentant la requête comme un projet qui n'est pas
encore.
Cette explication de ce que nous appelons préservation
de la face est nécessaire pour comprendre que parler de la femme comme
objet du désir masculin peut être dangereux pour la face. C'est ce
que nous apprend le passage suivant des textes de François FLAHAULT :
« Mais enfin, imaginons qu'un garçon et une
fille soient bons amis: ils se trouvent apparemment dans ce cas favorable.
Pourtant, que l'un vient à « tomber » amoureux de l'autre, et
la question du « je t'aime » va se poser douloureusement à lui
(ou elle), à cause de l'augmentation considérable des enjeux qui
accompagnent ce changement (...).
C'est la peur de cet ébranlement de sa propre
identité qui conduit chacun à éviter la situation qui se
noue dans l'illocutoire explicite (performatif) pour lui préférer
l'implicite. » (FLAHAULT, 1978, p. 51)
La raison de cet ébranlement redouté est que le
sujet désirant ne peut plus traiter d'égal à égal
à l'autre sujet désiré puisque la catégorie du
désir installe en lui un manque qui l'affaiblit. Surtout, il va perdre
la face en cas de refus d'avoir osé croire être en droit de faire
cette requête. Pourtant, il lui est impossible de se taire, alors il ne
lui reste plus que la voie de l'implicite qui peut prendre la forme d'une
métaphore, le plus souvent produite dans le cadre d'une oeuvre d'art.
C'est le cas du nu féminin artistique, de l'Aphrodite de Cnide
(Praxitèle) en 350 avant J.C. à L'origine du monde
(COURBET) de 1866.
L'implicite dans l'oeuvre de COURBET est spécifiquement
métaphorique dans la mesure où c'est une anatomie précise
de la femme, jamais reproduite en art sans artifice de masque, qui est
désignée par l'expression origine du monde parce que
tout humain est née d'une femme et que le monde n'est pas sans le
langage des hommes pour le recréer. En appliquant à cette
métaphore picturale (au sens littéral) la règle du
détachement du sens, nous verrons que l'implicite en tant que
défini ici comme préservation de la face à traves la
métaphore correspond exactement à ce qu'en dit DUCROT : « Le
problème général de l'implicite, (...) est de savoir
comment on peut dire quelque chose sans accepter pour autant la
responsabilité de l'avoir dit, ce qui revient à
bénéficier à la fois de l'efficacité de la parole
et de l'innocence du silence. » (DUCROT, 1972, p. 12)
En effet, en tenant compte du fait que dans la règle du
détachement du sens, la conjonction d'un interprété avec
une interprétation vaut pour assertion de l'interprétant, alors,
on ne peut pas taxer COURBET de quoi que ce soit parce que justement il n'a
fait que peindre l'origine du monde. Ce qui n'est pas une activité
répréhensible par aucune morale.
Nous voyons très bien avec cette brève lecture
d'exemple que la métaphore n'a pas pour but de comparer, mais de donner
une forme nouvelle à un sens déjà exprimable dans le
langage, et dans le cas qui nous occupe, cette nouvelle forme imposée
par la métaphore permet d'éviter de prononcer un interdit
linguistique afin de ne pas blasphémer, ou tout simplement, afin de ne
pas heurter les sensibilités de manière à ne pas perdre la
face. Nous
113
avons donc avantage à comprendre la métaphore
à partir du principe d'oubli qu'à partir de la comparaison si la
thèse de la double synecdoque est acceptée.
Maintenant, nous allons faire une déambulation dans le
domaine religieuse afin d'y voir comment se manifeste la préservation de
la face dans la métaphore qui permet de ne pas blasphémer.
Il est inutile de reproduire ici le texte de la Genèse
puisqu'on peut y référer sans problème dans la mesure
où il s'agit d'une littérature universelle. L'essentiel est de
comprendre que dans ce récit, il est un interdit qui fut
transgressé par Adam et Ève. L'objet de cet interdit est le fruit
de « l'arbre de la connaissance du bien et du mal ».
On peut prendre à la lettre la signification de cet
interdit à partir de l'interprétation du serpent qui indique que
goûter au fruit de cet arbre peut rendre égal à Dieu qui
connaît tout, c'est-à-dire connaître la totalité.
Cette totalité est définie comme l'ensemble du bien et du mal. On
comprend alors que ce que la censure interdit, c'est la totalité. Il
s'ensuit déjà que nous avons une synecdoque parce que le bien et
le mal, dans leur opposition définit le signe sous le concept de
différance, (avec un « a ») forgé par DÉRRIDA,
n'est qu'une opposition qui pourrait être pris comme type pour
représenter la totalité présentée comme suit :
« Le même est précisément la différance (avec
un « a ») comme passage détourné et équivoque
d'un différend à l'autre, d'un terme de l'opposition à
l'autre. On pourrait ainsi reprendre tous les couples d'opposition sur lesquels
est construite la philosophie et dont vit notre discours pour y voir non pas
s'effacer l'opposition mais s'annoncer une nécessité telle que
l'un des termes y apparaisse comme la différance de l'autre, comme
l'autre différé dans l'économie du même
(l'intelligible comme différé du sensible, comme sensible
différé ; le concept comme intuition différée -
différante ; la culture comme nature différée -
différante ; tous les autre de la physis - technè, nomos,
société, liberté, histoire, esprit, etc.) » (DERRIDA,
1968, pp. 56-57)
En d'autres mots, lorsque nous sommes devant la croisée
des chemins, la certitude est que tous les chemins sont possibles mais nous ne
pouvons qu'en prendre un seul ; la totalité des chemins nous est
interdite. Dès lors, la synecdoque se mue en métaphore in
absentia qui consiste à nous conseiller qu'on ne peut pas tout
étreindre à la fois, il nous faut choisir. La magie de cette
métaphore est encore inscrite dans la synecdoque qui place l'interdit au
sein de la différance, pour que nous puissions nous apercevoir que
l'interdiction est ce qui nous permet d'accéder au choix : transgresser
ou obéir.
Déjà, la métaphore se lit comme une
préservation de la face de tout le monde, car elle nous apprend que
l'interdiction est la voie qui nous amène à la liberté du
choix et nullement à la contrainte. Si l'arbre n'était pas dans
le jardin, c'est à ce moment que le choix ne serait plus et que la
contrainte aurait triomphé.
Mais si de plus on apprend que : « Elle en prit un et en
mangea. Puis elle en donna à son mari, qui était avec elle, et il
en mangea lui aussi. Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient,
ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. » (TOB, 1985, pp. 3,
6-7)
114
On se retrouve dans une séquence propre au
mécanisme de la règle du détachement du sens dont le
calcul propositionnel peut être reformulé de la sorte : Si P,
alors Q, signifie Q. autrement dit, ici, ce qui est interprété
est toutes les séquences qui comportent le verbe « mangea »,
l'interprétant est la séquence qui contient « alors ».
Il s'ensuit que dans la mesure où la conjonction d'un
interprétant avec une interprétation signifie
l'interprétant, nous avons la métaphore qui fait passer «
fruit défendu » à la « sexualité ». C'est
ici que nous pouvons, à notre manière, appliquer la thèse
de la métaphore comme double synecdoque développée par le
Groupe u.
Rappelons qu'il y a deux cas possibles dans l'inventaire du
groupe de liège : la combinaison d'une synecdoque
généralisante sur le mode conceptuel et d'une synecdoque
particularisante sur le même mode. D'ailleurs, la métaphore
obtenue par cette combinaison est la plus sentie puisque l'on peut s'apercevoir
rapidement de la rupture d'isotopie. Ensuite il y a la métaphore - moins
sentie - obtenue par la combinaison d'une synecdoque
généralisante et d'une synecdoque particularisante sur le mode
conjonctif.
Pour notre cas, c'est la combinaison sur le mode
distributionnel ou mode ? qui est concernée. D'une part, en ce qui
concerne le terme d'arrivée, nous avons la « nudité »
(Cf. l'origine du monde de COURBET à l'instant) qui est une synecdoque
généralisante pour la sexualité ; et de l'autre
côté, dans le terme de départ, nous avons le fruit
défendu qui est une synecdoque particularisante pour la
sexualité. Tout se passe alors de telle manière que la
consommation du fruit défendu est une consommation sexuelle.
Nous voyons alors clairement que cette métaphore est un
euphémisme qui permet d'éviter de blasphémer ou tout au
moins d'éviter de heurter les sensibilités. C'est pour cette
raison que nous avons appelé cette métaphore une métaphore
de préservation de la face dans la mesure où elle nomme de
manière implicite ce qui est frappé de tabou linguistique dans le
discours normal, et a fortiori dans le discours religieux.
Le passage suivant permet d'expliquer pourquoi c'est la femme
qui mangea en premier le fruit défendu, mais de peur de
blasphémer à notre tour, nous préférons exploiter
cette logique dans un autre corpus. Voici ce passage qui est une lecture de
l'érotisme chez Georges BATAILLE : « Tel que Lacan l'enseigne
à propos d'Antigone, la beauté «est, dans l'objet, ce qui la
désigne au désir» : «le désir a pour objet le
désirable»; «l'objet du désir est d'abord la
beauté féminine» dans la fulguration ou l'obstination du
désir. La «figure attrayante de l'érotisme» est la
même pour les hommes et les femmes, c'est la «nudité
féminine» : c'est l'union de la beauté féminine et de
l'obscénité animale qui distingue l'objet du désir. En
même temps que la beauté (de la femme), qui est un signe du
souverain, éloigne du travail et de l'animalité, elle
«annonce un aspect animal plus lourdement suggestif» : l'annonce des
«parties honteuses» (pileuses). «La beauté
négatrice de l'animalité, qui éveille le désir,
aboutit dans l'exaspération du désir à l'exaltation des
parties animales». » (LEMELIN, 1986)
115
Quand BAUDELAIRE donne le titre de « Le beau navire
» à l'un de ses poèmes dans le recueil Les Fleurs du
mal, ce titre est une métaphore parce que l'objet décrit
dans le poème n'est pas un navire mais une femme :
9. Quand tu vas balayant l'air de ta jupe large,
Tu fais l'effet d'un beau navire qui prend le large Chargé
de toile et va roulant
Suivant un rythme doux, et paresseux, et lent.
Dans cet extrait, commençons par identifier les termes
sur lesquels se fondent la métaphore. Le terme d'arrivée de la
métaphore, ou pour insérer l'analyse dans le cadre de la
théorie de l'énonciation via la règle du
détachement du sens, l'interprété de la métaphore
est un « tu ». Si c'était un « elle », alors l'objet
de la description est hors du circuit de la communication, c'est « la
personne absente » selon la révision des pronoms de la conjugaison
par BENVENISTE (1982 (or. 1966), pp. 251-257).
En reprenant à note compte la remarque de FLAHAULT
à propos de l'ébranlement du rapport interlocutif quand il est
question de dire « je t'aime », nous avons ici un implicite
caractéristique que peut résumer cette formule de Jean-Claude
ANSCOMBRE : « [...] communiquer un désir, c'est demander la
satisfaction de ce désir » (1980, p. 87)
Il faut bien que le destinataire de la parole sache ce que le
destinateur pense de sa personne, et que cette pensée prenne la voie
métaphorique, alors cette métaphore est une manière de
montrer ce que l'on ne peut pas dire selon la règle de l'implicite. Du
même coup, l'on constate que la logique narrative fait naître le
texte à partir d'un manque. L'objectif de la métaphore est une
conjonction d'avec l'objet du désir.
Mais cet objet du désir consiste à
réduire le « tu » de manière synecdochique à une
partie seulement. Une partie qui est désignée par une
métonymie du contenant pour le contenu dans l'emploi du terme «
jupe » ; à moins que l'on considère « jupe » comme
un attribut féminin, alors ce ne sera pas une métonymie mais une
synecdoque. De nouveau, la métonymie a pour mission de montrer ce qui ne
peut pas être dit.
Si en plus, on s'aperçoit que c'est cette
métonymie qui est le véritable point focal de la métaphore
: la jupe est animée d'un mouvement rythmique qui est
interprété par le mouvement du navire qui prend le large. En
analysant la source de ce mouvement de la jupe, ce qui se met en
évidence est qu'il s'agit de la marche. Une marche qui n'est pas
définie comme joignant un point à l'autre, mais qui a une
visée autotélique selon la définition suivante :
« Il en est ici du discours comme de la marche. La
marche habituelle a son but en dehors d'elle-même, elle est un pur moyen
pour parvenir à un but, et elle tend incessamment vers ce but, sans
tenir compte de la régularité ou de l'irrégularité
des pas séparés. Mais la passion, par exemple, la joie
sautillante, renvoie la marche en elle-même, et les pas
séparés ne se distinguent plus entre eux par ceci que chacun
rapproche davantage vers un but ; ils sont tous égaux, la marche n'est
plus dirigée vers un but, mais a lieu plutôt pour elle-même.
Comme de la sorte les pas séparés ont
116
acquis une importance égale, l'envie devient
irrésistible, de mesurer et de subdiviser ce qui est devenu identique de
nature, de la sorte est née la danse. » (TODOROV, 1977, p.
191)
En effet, dans ce poème de BAUDELAIRE, le verbe «
aller » n'a pas de complément circonstanciel indiquant le but de la
marche. La description, en faisant silence sur le but de la marche, indique
clairement qu'il s'agit de considérer la marche pour elle-même. De
cette manière, il est permis de la comprendre comme une danse de la
partie désignée par la métonymie « jupe ». Cette
visée autotélique est ce qui a permis justement à JAKOBSON
de définir la fonction poétique (1960, p. 218) ; ce qui veut dire
que la métaphore comme poétisation du corps féminin est
une stratégie qui permet de préserver la face.
C'est-à-dire de passer par une forme de sublimation poétique dont
la fonction est d'éviter de rabaisser l'humanité de la femme dans
ce qu'elle a de commun avec l'animal : le charnel ; d'éviter à
l'homme de se rabaisser au rang de l'animal par une mise à distance de
la jouissance, un interdit de la jouissance immédiate qui permet le
transport de ce qui ne peut être dit vers le dicible.
Cette dernière remarque nous amène vers
l'interprétant ou le terme de départ de la métaphore : le
navire qui prend le large, représenté par la poupe de
manière synecdochique. Il est évident que parler du navire est
sortir absolument de tout jugement moral, donc c'est une manière de
contourner l'interdit de nommer certaines parties du corps féminin,
puisque nommer, c'est faire exister (SARTRE, 1998, p. 66)
La question qui va nous guider maintenant est de savoir
pourquoi, la métaphore a pour interprétant l'image d'un
navire.
En plus des différentes figures qui organisent cette
métaphore - métonymie et synecdoque - nous allons nous attacher
maintenant au mécanisme exclusif de cette métaphore.
Le navire est caractérisé par deux mouvements
bien connus des marins mais aussi observables quand il quitte le port pour
aller vers le large. Il s'agit en fait d'un double mouvement : le roulis et le
tangage. En retrouvant donc ce point commun entre l'interprété et
l'interprétant, nous pouvons encore reprendre l'illustration de la
métaphore comme une double synecdoque.
D'abord, le mouvement du navire est une synecdoque
généralisante du roulis et du tangage, ensuite le roulis et le
tangage est une synecdoque particularisante de la jupe qui balaie l'air, parce
que le mouvement de balayage renvoie justement à ces roulis et tangage,
sinon la figure métaphorique n'est pas possible. Il s'agit effectivement
d'une métaphore parce qu'elle impose une vision du monde qui n'entre pas
en contradiction avec l'interdit entourant l'animalité de l'homme mais
qui au contraire élève l'homme en tant que créateur
d'image dont le lien n'est pas donné dans la nature. En outre, le
mouvement du navire est de telle sorte que l'observateur ne peut voir que sa
poupe, ce qui implique que la métaphore est une peinture d'une femme qui
marche devant l'observateur comme une sorte de phénomène de
117
voyeurisme que nie justement la métaphore - il n'est
pas interdit de regarder un navire qui pend le large -
En conclusion, il y a lieu de considérer que la
métaphore ne se distribue pas seulement en métaphore in
praesentia et en métaphore in absentia, mais il faut aussi
introduire la distinction entre métaphore explicite qui fait
apparaître un outil de similitudo et la métaphore implicite qui en
fait l'économie. Dans cet extrait de poème de BAUDELAIRE, nous
avons une métaphore explicite. Mais il s'agit d'un outil de similitude
tout à fait original, car c'est l'expression « tu fais l'effet de
» qui en rend compte. Nous sommes donc loin du scrupule dubitatif d'un
MORIER ou d'une distinction sceptique d'un LE GUERN.
Travaux cités
ANSCOMBRE, J.-C. (1980). "Voulez-vous dériver avec
moi?". Dans Rhétoriques, Communications (Vol. 16, pp. 61-123).
Paris: Seuil.
BEVENNISTE, é. (1982 (or. 1966)). Problèmes
de linguistique géénrale, 1 (Vol. 1). Paris: Gallimard.
BROWN, P., & LEVINSKY, S. (2000 [1978]). Politeness.
Some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University
Press.
CASSIRER, E. (1969). "Le langage et la construction du monde
des objets" . Dans J.-C. PARIENTE, Essais sur le langage. Paris:
éditions du Minuit.
CORNULIER, B. (1982). "Le détachement du sens" dans Les
Actes de Discours, Communications,32. Communications, p. 132.
COURBET, G. L'origine du monde. L'orignie du monde.
Musée d'Orsay, Paris.
DANESI, M., & PERRON, P. (1996). "Sémiotique et
Sciences cognitives". Consulté le Mars 24, 2013, sur
http://french.chass.utoronto.ca/as-sa/ASSA-No1/Vol1.No1.PerronDanesi.pdf
DERRIDA, J. (1968). "La différance". Dans P. Sous la
Direction de SOLLERS, Théorie d'ensemble (pp. 41-65). Paris:
Seuil.
DI CESARE, D. (1986, Juilet). "Langage, oubli et
vérité dans la philosophie de Nietzsche". Histoire,
épistémologie, langage, pp. 91 - 106.
DUBOIS, J., EDELINE, F., KLINKENBERG, J. M., MINGUET, P.,
PIRE, F., & TRINON, H. (1982). Rhétorique
Générale. Paris: Larousse.
DUCROT, O. (1972). Dire et ne pas dire, Principes de
sémantique linguistique. Paris: Hermann.
ENACHE, C., & POPA, G. (2008). "Théories
linguistiques dans le domaine de la politesse". Dans Annales Lettres de
l'Université Valahia de Târgovi°te (pp. 137 - 142).
Târgovi°te: Valahia Press University.
FLAHAULT, F. (1978). La parole intermédiaire.
Paris: Seuil.
118
GOFFMAN, E. (1984). Les rites d'interaction. Paris:
éditions du Minuit.
JAKOBSON, R. (1960). Essai de linguistique
générale. Paris: aux éditions de Minuit. LAFONT, R.
(1978). Le travail et la langue. Paris: Flammarion.
LE GUERN, M. (1972). Sémantique de la métaphore et
de la métonymie. Paris: Larousse.
LEMELIN, J. M. (1986). evenement.html.
Consulté le mars 30, 2010, sur
www.ucs.mun.ca:
www.ucs.mun.ca/~lemelin/EVENEMENT.html
MORIER, H. (1981). Dictionnaire depoétique et de
rhétorique (éd. 3ème édition). Paris:
PUF.
PETITOT, J. (1982). "Sur la décidabilité de la
véridiction". Document de recherches, IV(31).
Praxitèle. Aphrodite de Cnide. Antiquités
grecques (sculpture) Rez-de-chaussée - Section 16. . Musée de
Louvre, Paris.
SARTRE, J.-P. (1998). La responsabilité de
l'écrivain. Paris: Verdier.
TOB. (1985). "Genèse". Dans TOB, Bible (pp.
4-63). Paris: Société biblique française.
TODOROV, T. (1970). "Synecdoques", dans Recherches
rhétoriques, Communications,16. Paris: Seuil.
TODOROV, T. (1977). Théories du symbole. Paris:
Seuil.
WITTGENSTEIN, L. J. (1961). Tractatus logico-pholosophicus.
Paris: Gallimard.
119
9. LA SIRÈNE, I OU A RÉSUMÉ :
Cette étude tente de montrer que l'envie de
transgression est fortement ancrée dans l'homme. Cependant, l'ordre
social ne peut exister sans interdit parce la liberté absolue conduirait
à un déferlement de violence dont l'interdit a pour mission de
contrer. Il n'existe pas non plus d'interdit absolu. C'est ainsi que cette
étude tend à prouver que la femme est au centre d'un interdit qui
la désigne à la convoitise. C'est pour illustrer ces positions
que nous faisons ici recours au mythe de la sirène dans sa version du
Sud-Ouest malgache.
Mots clés : mythes, femme, interdit, transgression,
postulation
ABSTRACT :
This study attempts to show that the desire for transgression
is strongly anchored in human. However, the social order cannot exist without
banned because absolute freedom would lead to a surge of violence which the
forbidden aims to counter. There is no absolute ban. Therefore, this study
tends to prove that the woman is at the center of a banned which refers to
lust. It is to illustrate these positions that we here use the myth of the
mermaid in its version of the South-West Madagascar.
Key words: myths, woman, forbidden, transgression, postulation
9.1. INTRODUCTION
Si le changement de hiérarchie opéré par
Rudolf CARNAP (cf. (BANGE, 1992)), à savoir que la sémantique et
la syntaxe sont commandées par des buts pragmatiques est accepté,
dès lors, on peut faire un exercice de style
épistémologique qui consiste à traiter d'un mythe d'un
point de vue pragmatique en pariant sur la forme pour atteindre le sens.
Appelons cette attitude « épistémologie du pari ».
Ce faisant, nous souscrivons à l'analyse d'Ivan ALMEIDA
(1997) sur l'ouvrage fondateur de Louis HJELEMSLEV (1968-1971) en linguistique
et dont la conclusion est que l'essence donc, de la notion de style
(épistémologique) est la mise en oeuvre du général
dans le particulier. Cependant, nous n'avons pas la prétention de suivre
tous les points qui ont permis à ALMEIDA de dénoncer, à la
suite de sa lecture de l'ouvrage du linguiste considéré à
la fois comme linguistique et épistémologique, l'impasse
sémantique des sciences de signification dans la considération de
la forme une logique comme une abstraction de la matière linguistique.
Il nous suffit ici d'accepter la radicalisation de la mise entre
parenthèse avec une préalable reconnaissance de ce qui
été écarté. C'est l'épistémologie du
pari pour la forme.
Cette mise à l'écart est devenue une
caractéristique de l'épistémologie moderne : le sens est
sacrifié au profit de la forme selon une logique qui consiste à
dire que l'on ne peut tout avoir. Si l'on se soumet à la
cohérence, on doit perdre en complétude et vice-versa et si l'on
choisit la rigueur, on doit sacrifier une partie de la signifiance et
vice-versa. C'est cette
120
attitude qui prévaut en linguistique dans son
orientation soit en syntaxe ou soit en sémantique.
C'est toute la problématique mise à jour par
Noam CHOMSKY dans sa distinction entre phrase sémantiquement correcte
mais agrammaticale et phrase grammaticale mais sémantiquement
incorrecte. Il nous semble que la pragmatique comme nouveau paradigme au sein
de la science linguistique ne s'est pas départi de cette
épistémologie de l'écartement. À ce titre, la
nouvelle hiérarchisation du paradigme établie par CARNAP est
révolutionnaire.
Ainsi, dans ce projet de pragmatique d'un mythe, nous allons
aborder la radicalisation de l'epokhé, la mise à
l'écart, par l'autre bout que nous pouvons appeler le pari de la forme,
qui, évidemment s'inscrit dans l'épistémologie du pari
pour éviter la stratégie du renoncement.
9.2. LE PARI DE LA FORME
Dans le style épistémologique que nous tentons
de mettre en évidence, nous constatons que CARNAP et HJELEMSLEV,
s'opposent sans entrer en contradiction : disons que c'est l'envers et la face
d'une seule et même chose. Si chez CARNAP, la radicalisation part de la
signifiance pour atteindre la forme, au contraire, chez HJELMSLEV, c'est la
radicalisation de la forme qui va lui permettre d'atteindre le sens.
Faisons donc le pari de la forme avec HJELEMSLEV. Certes, on
doit à Ferdinand de SAUSSURE l'édification du structuralisme en
linguistique à partir de la distinction nécessaire entre forme et
substance qui se résume à ceci :
« La linguistique travaille donc sur le terrain
limitrophe où les éléments de deux ordres se combinent :
Cette combinaison produit une forme et non une substance » (SAUSSURE,
1982, p. 157)
Mais avant d'en arriver à cette conclusion voici ce que
le linguiste genevois dit :
« Prise en elle-même, la pensée est une
nébuleuse où rien n'est nécessairement
délimité. Il n'y a pas d'idées préétablies
et rien n'est distinct avant l'apparition de la langue.
En face de ce royaume flottant, les sons offriraient-ils
par eux-mêmes des entités circonscrites d'avance ? La substance
phonique n'est pas plus fixe ni plus rigide ; ce n'est pas un moule dont la
pensée doive nécessairement épouser les formes, mais une
matière plastique qui se divise à son tour en parties distinctes
pour fournir les signifiants dont la pensée a besoin » (Ibid., p.
155).
Cette manière de voir entre en contradiction avec la
notion de système dont se réclame le langage. Ainsi, chez Robert
LAFONT l'autonomie linguistique qui exprime l'aspect systémique du
langage efface la dialectique langue et pensée au profit d'une
productivité du sens par l'activité linguistique quand il affirme
que le praxème n'est pas un outil doué de sens mais un outil de
production du sens. Le sens est interne au langage - plus exactement à
la praxis linguistique - mais n'est pas quelque chose du dehors que le langage
se saisit :
121
« Pour autant que nous avancions à
l'intérieur du langage, nous ne connaîtrions jamais que lui et
n'atteindrons pas une réalité objective, devant laquelle il
s'établit en même temps qu'il en pose l'existence. Nous demeurons
pris au spectacle linguistique » (LAFONT, 1978, p. 15)
Une spectacularisation discursive qui nous a permis par le
biais de l'algorithme narratif d'éliminer de la théorie de
l'énonciation la notion de perlocutoire comme une conséquence de
l'agir linguistique dans l'agir pratique. De manière similaire, Ernst
CASSIRER parle de la contribution du langage dans la construction du monde des
objets :
« Le langage n'entre pas dans un monde de perceptions
objectives achevées, pour adjoindre seulement à des objets
individuels donnés et clairement délimités les uns par
rapport aux autres des « noms » qui seraient des signes purement
extérieurs et arbitraires ; mais il est lui-même un
médiateur dans la formation des objets ; il est, en un sens, le
médiateur par excellence, l'instrument le plus précieux pour la
conquête et pour la construction d'un vrai monde d'objets »
(CASSIRER, 1969, pp. 44-45)
La thèse de la relativité linguistique
développée par Édouard SAPIR et Benjamin Lee WHORF, connue
également sous le nom de thèse de Sapir-Whorf, soutient
également l'idée que le langage ne peut pas être une
tautologie du réel. On peut multiplier les arguments qui vont dans ce
sens mais nous pensons que ceux que nous avons produits ici sont amplement
suffisants pour ce que nous avons à dire et à soutenir : c'est
dans une activité individuée que le langage produit du sens et
que ce sens n'est pas dans les objets.
Autrement dit, lorsqu'on parle de propriété
isomorphe du langage et du monde des objets, on souligne leur plus petit
dénominateur commun, à savoir, ils sont tous les deux des outils
de production de sens. C'est ce qui nous permet de dire qu'une fois le monde
converti en discours la catégorie du réel s'évanouit comme
une question inutile. Un exemple immédiat peut rendre compte de cette
dernière remarque.
Le diamant est une pierre précieuse faite de carbone
pur. Selon une conception dictionnairique du langage, la partie à gauche
de la copule « être », dans la phrase précédente
est un terme d'entrée, et la partie à droite est l'analyse ou
sens hors discours.
Insérer dans un discours le diamant produit du sens
relatif à son analyse. La première grande moyenne de ce sens
développe l'isotopie de la parure féminine, la deuxième
grande moyenne est l'utilisation du diamant comme pierre industrielle. Prenons
le premier cas. Le sens produit par le diamant dans un roman ou dans une
peinture ou par un diamant réel est le même. Il est même
possible d'identifier une dérivation illocutoire - que d'autres auraient
appelé de perlocutoire - permanente dans les discours qui insère
de cette manière le diamant : faire plaisir à une femme.
Nous en concluons ceci, dans le sens analytique de la
perspective dictionnairique autorise l'identification du
référent. Par contre le sens produit par la pratique
individuée dans un discours est une sémiotique pure
libérée du référent. C'est sur cette base que se
situe le style épistémologique de HJELMSLEV que l'on peut
comprendre comme un refus de
122
considérer autre chose que le langage dans le langage.
En effet, dans le rapport formalisme et sens, la radicalisation de la forme
chez HJELMSLEV est un pari qui a pour horizon le sens.
Ainsi, pour ce linguiste danois, dans le langage il n'y a que
du langage. La sémantique n'existe pas, il n'y a qu'un plan de
l'expression et un plan de contenu reliés par la fonction
sémiotique. C'est ainsi qu'il développe son raisonnement à
partir de la notion absolument neutre de « grandeur » qu'implique
toute fonction sémiotique. Il n'y a somme toute qu'un inventaire et tout
se retrouve dans l'inventaire. Conformément à cette ligne de
conduite que nous appelons le pari de la forme, voici sa réaction
à l'idée de pensée nébuleuse de SAUSSURE que la
langue structurerait :
« Mais cette expérience pédagogique, si
heureusement formulée qu'elle soit, est en réalité
dépourvue de sens, et SAUSSURE doit l'avoir pensé lui-même.
Dans une science qui évite tout postulat non nécessaire, rien
n'autorise à faire précéder la langue par la «
substance du contenu » (pensée) ou par la « substance de
l'expression » (chaîne phonique) ou l'inverse que ce soit dans un
ordre temporel ou dans un ordre hiérarchique » (HJLEMSLEV,
1968-1971, p. 68)
Pour mieux comprendre la position théorique de
HJELMSLEV, il nous faut circonscrire avec précision ce qu'il faut
appeler sens. Pour ce faire, reprenons la distinction entre le sens
référentiel du projet dictionnairique et le sens discursif qui
prend naissance à partir d'une pratique individuée. Le sens qui
concerne la fonction sémiotique est ce sens discursif. Par ailleurs pour
illustrer la fonction sémiotique, HJELMSLEV ne part pas des mots mais
d'une phrase déclinée en français « je ne sais pas
», en danois « jeg véd det ikke » en anglais « I do
not know », en finnois « en tiedä », en esquimau «
naluvara », et dit que ce qui reste de commun à ces plusieurs
versions est le « sens », (Cf. (HJLEMSLEV, 1968-1971, p. 75)).
Pour éviter toute confusion, nous devons parler
à cet égard de programme de sens inscrit dans une forme
linguistique. De cette manière, nous pouvons concilier le sens
dictionnairique et le programme de sens et soutenir le principe d'isomorphisme
entre les mots et les choses comme cela semble ressortir du passage suivant que
nous préférons à une longue explication :
« Un langage qui relaie le geste déictique est
là pour épouser le mouvement de naissance de l'activité
sémiotique. Le sens surgit. C'est ce sens que nous lisons quand nous
interprétons comme instrument la modification non accidentelle d'un
silex : signe d'une activité qui opère dans l'absence de son
objet » (LAFONT, 1978, p. 19)
Dans une autre acception du principe d'isomorphisme, celui-ci
se place entre le plan du contenu et le plan de l'expression. En outre, si l'on
admet qu'une pensée est une pensée de quelque chose, il y a une
forte tendance à croire que le monde des objets est le
référent du langage. Mais c'est une hypothèse que nous
avons déjà rejeté car ce serait faire du langage une
tautologie du réel. En tout cas, selon GREIMAS, le monde n'est pas un
référent ultime (Cf. (GREIMAS, 1970, p. 52)). En effet, le sens
est dans l'action que nous projetons sur le monde référentiel :
le sens est signe d'une activité qui opère en l'absence de son
objet.
C'est ainsi que nous lisons dans la forme di silex biface une
activité que l'on peut mener par cette forme, c'est cela le pari de la
forme : une radicalisation de la forme qui a pour horizon le sens. Maintenant,
testons cette épistémologie du pari sur un mythe.
9.3. LE MYTHE DE L' « AMPELAMANANISA »
L'objectif de cette analyse est de montrer comment le mythe
opère une censure qui se présente en même temps comme une
postulation de ce qu'il interdit. Autrement dit, il s'agit de confirmer que :
« Le sens devient chaque fois substance d'une forme nouvelle et n'a
d'autre existence possible que d'être substance d'une forme quelconque.
» (HJLEMSLEV, 1968-1971, p. 70)
Prenons connaissance de ce mythe.
Laha teo ampelamananisa, Il était une fois une femme aux
ouïes
nisy lahy lahilahy io Il y avait un homme
ty asa ?e fa i ty maminta avao Son métier, il ne fait que
de la pêche
Zay ro ameloma ?e ty anane no ho ty valini ?e
Ie njaik'anjo ie nandeha namita anjiake
ane
C'est ainsi qu'il fait vivre ses enfants et sa femme
Un jour il était allé pêcher en mer
|
ine
|
Ka laha tane ie tinanja ?e ty raha vinta
|
Et quand il était là-bas, quelque chose avait
accroché son fil
|
« Ka nao lahy hoy i, ino raha mitanjaka vinta toy
mampahere aze io ?
Et il s'était dit : qu'est ce qui peut bien accrocher
ce fil pour qu'il soit ainsi rigide ?
Tsy manao ty sananjo toy fa hafahafa Ça ne fait pas comme
tous les jours,
mais c'est étrange
Eo moa nahoda iny tsereke, laha sinonto ?e vinta ine ka laha
nisolea ka laha nisolea bakao tomponjano one iano...
L'homme était alors perplexe, quand il avait
retiré le fil, ça avait résisté,
résisté, puis le maître des eaux en sortit, ... la
sirène
Le nanombo nahoda iny Alors, le monsieur s'est évanoui
123
Ka mamombo nahoda iha hoy raha iny fa tsy raha hamono anao zaho
dra miseho aminao fa hamelo anao ka mitefa iha
Il ne faut pas s'évanouir lui disait la chose car je ne
vais pas te tuer même si je t'apparais mais te faire vivre, donc assieds
toi
La nitefa moa nahoda iny nifoha, nivelo njaike
Et le monsieur s'est assis, revenu à lui, vivant de
nouveau
Hatao akory iha hoy nahoda iny hananeke io?
Hatao akore aho hoy fa tsika ho antana ?areo any fa ho mpivale
Que faire de toi, lui disait le monsieur, maintenant ?
Que faire de moi disait -elle mais nous allons vers ton
village pour être époux et épouse
Ho mpivale ? Être époux et épouse ?
Ka laha mpivale ka hanao akore ? Si nous épousons
qu'adviendra-t-il ?
Tsika ho mpivale fe ty raha faly ahy: tsy volany ty manao hoe
« ampelamananisa » zay fa faly anay
Nous serons époux mais il m'est tabou de me dire «
femme aux écailles », cela nous est tabou
« Eka » hoy nahoda iny « Oui » disait le
monsieur
Eo moa iny le nandesi ?e nahoda iny an-tana atoy i e
Eo teraka iaby ty hoe « ao koa lahy Zatovo fa Zatovo ty
anara?e nahoda io, manambale zao ampelamananisa zao kea ie ao
Bibiolo raha zao ie, olo ty anabo ?e, biby ty ambani?e fa
manao fia io ka misy ohi?e ro misy isa ?e
Cela était et le Monsieur l'amenait ici dans le
village
Et c'est de là que naissait la rumeur : « il est
là Zatovo, parce c'est Zatovo le nom de ce monsieur, qui épousait
une femme aux ouïes »
C'est un animal humain (monstre) parait-il, le buste est
humain mais le bas fait poisson et a une queue et a des écailles
E hoy ty olo Eh disaient le gens
Eny, eny fa malaky fa tapasiry fa bevoky raha iny, le niteraka
roa, ampela noho lehilahy
Lafa te hanjo roze mandeha ie andese ?e anjiaka ene aja rene
baky najo kea moly an-tanà atoy, no izao avao ty asa ?e zisike be aja
reny
Le temps passait, puis parce que c'est un conte, on fait vite
: la sirène fut enceinte et accoucha de deux enfants : une fille et un
garçon
124
Quand ils ont envie de se baigner, elle amène ces
enfants en mer et après s'être baignés ils rentrent au
village, ils faisaient comme ça jusqu'à ce que les enfants furent
grands.
Ela ty ela, mitsiko ty etoe mitsiko ty eroa, ka ty ampela
manambaly an-tanà moa lahy afaka azy ty iny tsiko fa nahare tike ka
meloka mivola an'i Zatovo hoe :
« Zaho lahy Zatovo tsy vitako ty tsikotsiko atao ahy
sananjo fa zaho holy fa be anako retia ka laha roze marary angalao lomotse,
laha siloke angalao taolam-pia hatabaka azy »
« tsy atao kolahy zao fa iha abe efa latsak'anaka amiko
fa moremoretse aho ka enganao. »
Aia moa tsy mete ampelamananisa ine fa nandeha avao ie, ana ?e
rene tsy nandese ? e fa ty vata ?e ro nandeha ka la miantsa antsa avao iea
Eny iha zatovo e ! Zaho fa hole zao
Laha marary ty anantsika
Tabaho taolam-pia a!
Laha siloke ty anantsika
Fahano lomotse
Nandeha i, nandeha i, ie kea fa amolo-jiake eo ie niantsa
jaiky ie
Eny iha zatovo e ! Zaho fa hole zao
Laha marary ty anantsika
Tabaho taolam-pia a!
Laha siloke ty anantsika
Fahano lomotse
125
Le temps passait, on médit par ici et par là, il
s'agit justement de femmes mariées au village qui ne peuvent pas
s'interdire de médire et celle-ci est au courant et dit ainsi à
Zatovo :
« Moi, Zatovo, je ne supporte plus ces médisances
sur moi tous les jours, alors je vais rentrer puisque mes enfants sont
déjà grands et s'ils tombent malades cherche leur des algues,
s'ils ne se portent pas bien amènent d'os de poisson et badigeonne les
avec »
« il ne faut pas faire ainsi, surtout que tu m'as
déjà donné des enfants, je m'ennuie un peu et tu me
quittes.
Toujours est-il que la sirène n'a pas
cédé et elle est partie, elle n'a pas emmené ses enfants
mais c'est elle seule qui est partie en vocalisant comme -ci :
Tu es ici Zatavo mais moi, je rentre Si nos enfants tombent
malades Badigeonne-les d'os de poisson S'ils ne se sentent pas bien Sers-les
d'algues
Elle est partie, partie, et quand elle fut au bord de la mer,
elle a vocalisé encore une fois
Tu es ici Zatavo mais moi, je rentre Si nos enfants tombent
malades Badigeonne-les d'os de poisson S'ils ne se sentent pas bien Sers-les
d'algues
La i Ampelamananisa anjiake eo la nijorobo ie la any ie anjiake
any fa tsy hita amy zay
Quand elle fut dans l'eau, elle y plongea et on ne peut plus la
voir.
Zay lahy ty tantara ?e ampelamananisa ie fotora?e ty niboahay
vezo mba anjiake ato ka tsy zaho lahy ty mavande fa olo-be taloha.
Loha manenke tsy mahatapa-doha. Torahiko ny vy le mivimby
C'est cela l'histoire de la femme aux écailles source
de notre population vezo de la mer. Ce n'est pas moi qui ai menti mais les
anciens. Tête qui acquiesce ne se fait pas couper. Je jette la pierre sur
le fer qui ferraille13.
126
La première caractéristique qui saute aux yeux
à la réception de ce récit mythique est sa nature
fictionnelle, il existe des indices formels de cette nature, d'abord, il y a ce
que Roman JAKOBSON (Cf. (1981, pp. 238-239)) appelle exorde des conteurs, ici,
nous avons le célèbre « il était une fois ».
Cette marque formelle de la fiction est un paradoxe. Elle
embraie le récit dans l'ordre de la fiction, c'est cela sa fonction.
Mais quand on considère que cette marque se décline au mode
indicatif, de mode grammatical embraie le récit dans la catégorie
du réel. Ce mécanisme d'exorde est une forme - c'est une marque
formelle - qui dote le récit d'une force illocutoire
dérivée de l'affirmation que nous allons appeler avec Jean Marie
SHAEFFER (1999) « suspension volontaire d'incrédulité
».
Ensuite, vers la fin du récit, nous avons une clausule
spécifique au dialecte « tête qui acquiesce ne se fait
pas couper. Je jette la pierre sur le fer qui ferraille ». En tant
que formule, cette clausule accomplit la même force illocutoire
dérivée.
Cet encadrement du récit, au début et à
la fin absolus, par des formes dont l'énonciation produit la même
force illocutoire devient à leur tour une forme qui permet d'expliquer
le paradoxe de la suspension d'incrédulité. Disons
d'emblée dans cette solution que les textes mythiques sont les premiers
langages : on les retrouve partout et ils appartiennent à des temps
immémoriaux. Comme tels, rien ne les précède ; ils sont
une forme de lire le monde et produisent du sens en même temps qu'ils se
construisent. Appelons cela la « prégnance de la forme ».
Ce qui veut dire exactement qu'il importe peu que les ancrages
spatio-temporels du récit soit flous, qu'il met en scène des
personnages qui n'ont aucun pendant à la réalité, qu'il
comporte des trous dans l'enchaînement logique des
événements, car sa fonction n'est pas de décrire le monde
mais de lui donner un sens. C'est ainsi qu'il est une forme de lire le monde
parce que c'est une forme qui produit du sens. Sous quelques réserves,
cette prégnance de la forme correspond à la remarque suivante de
Jean-Claude PARIENTE :
13 Notre traduction
127
« C'est dans le cas de la fiction que tout se passe
comme si on avait affaire à un autre réel. Mais la fiction se
distingue de l'énoncé irréel précisément
parce qu'elle ne s'annonce pas comme irréelle ; elle ne comporte pas de
présomption d'irréalité, elle met au contraire tout en
oeuvre pour se faire admettre comme réalité. (...) Il se situe
ainsi de lui-même par rapport au réel ; il manifeste sa
finalité qui n'est pas de décrire une autre
réalité, mais se servir par un moyen détourné
à l'analyse de la réalité » (PARIENTE, 1982, p.
43)
Le deuxième point qui fascine dans le récit
mythique concerne le plan autorial. On ignore qui parle dans les récits
mythiques. Dans le cas précis du mythe qui nous occupe, cet anonymat est
encore un indice du caractère fictionnel du récit.
Cependant, ce trait caractéristique franchit un pas de
plus dans le pari de la forme. En effet, on peut remarquer que les personnages
du récit sont présentés par l'article indéfini. Il
en est de même pour les cadres spatio-temporels. C'est par
cohérence anaphorique que par la suite qu'ils sont repris par un
défini. Pourtant la langue dispose du nom propre que ce soit en
anthroponymie ou en toponymie pour donner un contour personnalisé.
Même le nom propre « zatovo » appliqué à l'homme
semble être annulé en tant que tel car c'est une reproduction d'un
caractère commun propice à l'éclatement de l'amour et qui
possède un pendant qui fait le point focal de cette analyse chez la
femme. Or la fonction de l'indéfini est justement de pointer une forme
en ce qu'elle n'est pas les autres. Par contre les définis
sélectionnent des éléments parmi ses semblables. Il existe
évidemment des nuances d'emploi à cette matrice fonctionnelle des
déterminants du nom que nous déployons si rapidement.
Mais on peut être assuré que les articles
indéfinis désignent une forme suivant une perspective de
programme de sens. Ce qui nous permet de dire en hypothèse que le mythe
est un pari de la forme et qu'il possède une dimension
épistémologique indéniable parce que c'est un
système de signification.
Mais ce mythe n'est pas seulement un pari de la forme dans sa
manière de lire le monde il l'est aussi dans son contenu. Nous ne
disconvenons pas qu'il y ait plusieurs manières de lire un mythe et
c'est cette pluralité de lecture qui fut longtemps
privilégiée par les analystes en dépit de l'existence
indéniable d'un point focal qui génère la signification
à partir d'une forme.
Cette forme de contenu est un jeu sur le signifiant, attestant
au-delà du cadre théorique de son émergence le principe
sémiotique, à savoir que c'est la radicalisation de la forme qui
permet d'atteindre le sens dans les sciences de signification dont les textes
mythiques ou les textes littéraires.
Pour atteindre ce point focal dans cette déambulation
aléthique, il nous faut suivre pas à pas les indices qui
jalonnent cette piste.
9.4. L'ÉVANOUISSEMENT DE L'HOMME
On peut admettre que l'évanouissement est une
conséquence d'un choc que l'organisme ne peut pas supporter, il peut
s'agir d'un choc physique ou d'un choc émotionnel
128
qui provoque une affluence d'adrénaline dans le coeur.
Si cette approche est acceptée, on peut se demander pourquoi l'homme
s'évanouissait.
Comme rien dans le texte ne permet de conclure à un
choc physique, l'homme est donc victime d'un choc émotionnel. Plus
précisément, c'est sa perception de la femme qui a
provoqué son évanouissement. Ici encore, il y a un nouveau
paradoxe. L'homme est présenté comme ayant femme et des enfants
car il est dit que c'est de la pêche qu'il nourrit sa famille. Ce qui
veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas la femme. Alors, il
y a lieu de croire que ce qui le fait s'évanouir c'est la vision de la
nudité féminine.
Nous en concluons que le texte, sans jamais le dire, nous
montre que la nudité féminine possède un caractère
sacré, et selon les analyses de Sigmund FREUD dans Totem et
Tabou, le sacré a une double dimension : il est à la fois
à craindre et à vénérer. (FREUD, Totem et Tabou,
[1912]1993, p. 99 et passim) On peut maintenant mieux comprendre
l'évanouissement de l'homme : c'est la crainte de la puissance du
sacré. Mircea ELIADE aussi, dans Le Sacré et le Profane,
(1956), nous confirme que le sacré possède un double aspect
ambivalent : il est attirant et repoussant, il est bénéfique mais
aussi dangereux.
Bref, si cette analyse est acceptée, nous pouvons dire
que faire de la pragmatique textuelle, c'est lire dans le texte le
mécanisme de production de sens qui se greffe sur l'histoire
narrée. Ici, énoncer l'événement de
l'évanouissement a pour valeur illocutoire l'attribution d'une
qualité à la femme : la faire passer d'un statut de profane vers
un statut de sacré.
Dans l'enchaînement logique du récit, cette
sacralité est aussi montrée de manière indicielle par un
autre trait confirmé ailleurs : l'étrangeté qui marque
l'entrée dans un espace sacré. C'est ainsi que, pour prendre un
exemple d'une littérature universelle, le Dieu d'Abraham s'est
révélé à Moïse sous une forme très
étrange : un buisson ardent mais qui ne se consume pas.
Si la vie profane se caractérise par l'ordinaire et le
naturel, le sacré par opposition se dessine comme ce qui est
extraordinaire : c'est l'étrangeté. Dans le récit, nous
savons que l'homme est un pêcheur et c'est par ce moyen qu'il subvient
à ses besoins et à ceux de sa famille. Il est donc un familier de
la mer et de ses poissons.
Mais ce jour fatidique de la pêche en mer, il est
confronté à l'extraordinaire : sa pêche lui avait
ramené une femme poisson. C'est en quelque sorte une double
étrangeté : au lieu de pêcher du poisson il attrape une
femme nue, et en plus la femme nue possède des écailles.
Ainsi, s'il est permis de dire que l'étrange
dérive de l'ordinaire comme paradigme, il se révèle avant
tout comme une forme. Une forme dont l'étrangeté est
inquiétante parce que l'on ne sait pas encore lui donner un sens. En
linguistique, on parle de terme non marqué et de terme marqué
quand on comprend ce dernier comme dérivé du premier. En ce qui
nous concerne, c'est l'étrangeté qui est le terme
dérivé.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas de dérivation que par
adjonction d'un trait supplémentaire à la propriété
commune. C'est ainsi que ce récit en tant que déploiement de
forme noue en même
129
temps le poisson et la femme-poisson - pour ainsi dire - et
les pose comme différents. L'homme est un pêcheur et vit du
poisson comme son ordinaire. Il doit également vivre de la femme mais
pas comme son ordinaire puisque la femme se dévoile à lui dans
son étrangeté et de cette manière ouvre à l'homme
l'espace de sa sacralité.
L'étrangeté de la femme est indexée au
moins sur deux plans. D'abord, elle vit dans l'eau comme les poissons sans
être tout à fait un poisson, mais un dérivé de
poisson. Autrement dit, ici encore, il y a un lien qui les noue et qui les
différencie : leur destin commun est d'être pêché par
l'homme et de le nourrir. Mais la consommation de poisson n'est pas la
consommation de la femme si l'on peut s'exprimer ainsi.
Mais pour rendre compte de cette différence selon la
perspective de cet exposé, nous allons faire une application stricte de
l'épistémologie du pari. Rappelons brièvement que le
problème de l'épistémologie moderne comme l'a
souligné Ivan ALMEIDA se résume à ceci : dans les sciences
de signification, on ne peut pas tout tenir et il faut choisir soit la forme ou
soit le sens.
Redonnons-lui la parole pour indiquer dans quel sens
exactement cette application stricte peut dévoiler le mécanisme
de production du sens à travers la forme :
«Au contraire le principe du pari, que l'on peut
attribuer implicitement au style de Hjelmslev consiste, quant à lui,
dans la radicalisation dynamique du principe de renoncement : parier qu'une
radicalisation de la rigueur formaliste peut mener à une visualisation
du sens, parier qu'une radicalisation de l'immanence peut, par besoin interne,
déboucher dans la complétude. En d'autres termes, que le sens est
une prolongation de l'horizon du formalisme, et que la transcendance est une
conséquence dynamique de l'immanence. » (ALMEIDA, 1997)
Cette radicalisation de la forme peut se comprendre dans son
application au récit qui nous occupe comme une censure et postulation,
ouvrons un dernier sous-titre qui reprend l'objectif qui se profile dans le
titre de cet exposé.
130
9.5. CENSURE ET POSTULATION DU SEXE FÉMININ
Parler du sexe féminin est une tâche ardue et
même risquée. Le sexe en général est frappé
d'un tabou qui nous contraint à des procédures d'évitement
comme l'euphémisme.
Benveniste a forgé les néologismes «
Blasphémie et euphémie » pour intituler un article qui joue
sur la censure et la postulation. Nous extrayons de cet article le passage
suivant pour introduire notre propos : « (...) pour mieux voir les
ressorts de la blasphémie, on doit se référer à
l'analyse que FREUD a donnée du tabou.
« Le tabou, dit-il, est une prohibition très
ancienne, imposée du dehors (par une autorité) et dirigée
contre les désirs les plus intenses de l'homme. La tendance à la
transgresser persiste dans son inconscient ; les hommes qui obéissent au
tabou sont ambivalents à l'égard du tabou ». Pareillement,
l'interdit du nom de Dieu refrène un des désirs les plus intenses
de l'homme : celui de profaner le sacré. » (BENVENISTE E. , [1974]
1981, p. 255)
Autrement dit, blasphémer c'est profaner le
sacré. Dans la mesure où nous avons dit que le sexe d'une
manière général est frappé d'un tabou, il acquiert
une sacralité par un interdit de prononcer que Benveniste appelle «
tabou linguistique ». Mais comme l'interdit du tabou ne supprime pas le
désir profond de profanation du sacré, le langage humain
contourne l'obstacle du châtiment par des procédures
d'évitement parmi lesquelles l'euphémisme.
La définition classique de l'euphémisme consiste
à dire qu'il s'agit d'un moyen détourné pour éviter
de choquer dans la parole. Pour une mise à jour de cette
définition, nous dirons que l'euphémisme a pour force illocutoire
la transgression d'un interdit tout en permettant de refuser la
paternité de cette transgression.
Prenons un exemple très banal : dire à un
thésard que son travail fera un très bon mémoire de
maîtrise14, c'est lui faire perdre la face,
c'est-à-dire transgresser la règle de préservation de la
face initiée par Erwin GOFFMAN et mise à jour par BROWN et
LEVINSKY tout en évitant toute réplique du genre « Qu'est-ce
que vous insinuer ? ». Question à laquelle on ne peut
répondre que par une dénégation. De la même
manière dire à quelqu'un que ce qu'il a fait n'est pas
très bien, lui laisse croire que c'est au moins bien alors qu'en
réalité c'est franchement mauvais.
Ainsi, comme nous avons interprété
l'évanouissement de l'homme par la vue de la nudité
féminine, c'est-à-dire par une confrontation au sacré,
l'idée de profanation, de blasphème ne doit pas être bien
loin. L'homme s'évanouit par la terreur d'avoir accéder au
sacré mais la femme le rassure que ce sacré ne va pas le tuer
mais le faire vivre.
14 Je dois cet exemple à François
FLAHAULT: La parole intermédiaire, 1978, Seuil, Paris.
131
Justement « ce faire vivre » est un
euphémisme littéral et dans tous les sens. Ce qui apparait
à l'homme dans la nudité de la femme, ce n'est pas seulement son
corps mais son sexe dans toute son étrangeté puisque
différent. De la même manière que le poisson fait vivre
l'homme, la consommation du sexe féminin introduit aussi la
continuité de la vie dans la discontinuité de l'existence
individuelle. C'est pour cela qu'une fois cette mission sacrée accomplie
le récit insiste sur l'appel de la sirène à donner de
l'algue et de l'os de poisson aux progénitures afin qu'elles se
maintiennent en vie lorsque la mère ne sera plus là.
La vulve est aussi ce qui fait vivre parce que s'il est admis
que la détumescence du pénis est assimilée à sa
mort comme le confirme l'idée de l'orgasme comme petite mort, c'est
l'horizon de la vulve qui le réveille dans la nudité
féminine - et comme l'ambivalence du sacré oblige - et le tue
aussi.
Mais tout cela n'est pas dit de manière
blasphématoire comme ici et pour laquelle nous faisons des excuses, mais
par euphémisme : l'homme qui s'évanouit est une forme signifiante
dans le récit et qui projette du sens. Enfin, pour honorer
l'épistémologie du pari, parlons maintenant de la clé de
lecture.
S'il est accepté que le titre est une mise en abyme de
tout le récit en se présentant comme un résumé
intratextuel, ce qui saute aux yeux est qu'elle est une exhibition de la forme
seulement, car une femme qui a des écailles ou des ouïes
dépassent l'entendement et ne peut donc avoir de sens que d'être
insensé.
Pourtant la pérennité du récit qui
traverse le temps dit tout le contraire. En effet, l'exhibition de la forme est
dans la nudité de la femme si la thèse de la mise en abyme est
acceptée. Mais ce qui s'exhibe surtout dans la nudité du corps de
la femme est sa vulve qui s'appelle « isy » dans le dialecte de
production du récit, et justement le dire c'est blasphémer. C'est
elle que l'on peut appeler « étrangeté inquiétante
» chez FREUD qui nous affirme que ce n'est pas seulement la sortie de
l'ordinaire qui est angoissant mais aussi parce que « Unheimlich »
serait tout ce qui aurait dû rester caché, secret, mais se
manifeste. (FREUD, 1919)
Dès lors, pour contourner l'interdit, on exhibe une
autre forme comme déformation de la forme interdite.
La voyelle finale [i] est déplacée de son point
d'articulation, reculée en arrière par pudeur et devient un [a].
C'est cela l'euphémisme ici : une censure et une postulation du mot
tabou qui désigne le sexe féminin. L'attribut du féminin
est bel et bien sa vulve et non des écailles, consommable au même
titre que le poisson. La même procédure d'évitement a servi
à de beaucoup de poètes, pour ne parler que de RIMBAUD nous
pouvons citer ce vers extrait du poème « Les voyelles » :
"A noir, E blanc, I rouge, U vert, O, bleu : voyelles Je dirai
quelque chose de vos naissances latentes : A, noir corset velu des mouches
éclatantes Qui bombinent autour des puanteurs cruelles
132
Golfes d'ombre : E, candeurs des vapeurs et des tentes, Lances
des glaciers fiers, roi blancs, frissons d'ombelles ; I pourpres, sang
craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;
U, cycles vibrements divins des mers virides. Paix des
pâtis semés d'animaux, paix des rides, Que l'alchimie imprime au
grand front studieux ;
O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges :
O, l'Omega, rayon violet de Ses Yeux" (RIMBAUD, 1984, p. 91)
Il n'est pas question ici de faire l'étude
intégrale de ce poème, car l'essentiel est de démontrer
que face à l'inquiétante étrangeté, il n'est que de
l'exprimer par des moyens détournés de telle manière que
l'on bénéficie de ce que DUCROT appelle " efficacité de la
parole et innocence du silence " (1972, p. 12) dans la perspective de
l'implicite en pragmatique.
On peut renforcer notre grille de lecture par
d'élément nouveau qui va nous servir à honorer
l'épistémologie du pari dans son imbrication avec l'illocutoire.
Cet élément nouveau c'est l'intertextualité.
Ce poème pour bénéficier à la fois
de l'innocence du silence et de l'efficacité de la parole se sert de
deux sémiotiques dont le point d'intersection est la forme. La
première sémiotique qui bénéficie de
l'efficacité de la parole est un corpus de voyelles (A, E, I, U, O), et
la deuxième sémiotique qui bénéficie de l'innocence
de la parole est la partie intime de la femme.
Ainsi, si le A (majuscule) est noir c'est parce que la forme
de cette voyelle dans sa version majuscule représente la toison
féminine dans le geste de dévoilement effectué par Baubo
(d'autres analystes pensent qu'il faut renverser la voyelle). Rappelons que
Baubo qui est une servante, pour faire sortir Déméter de son
chagrin d'avoir perdu Perséphone ravie par Hadès s'est
retroussée et s'est penchée en avant pour dévoiler son
intimité. Un dévoilement qui fut capable de faire sortir
Déméter de son chagrin morbide. Cf. (PICARD, 1995).
La voyelle E, dans cette perspective est une vision de profil
du sexe féminin, la barre centrale de la voyelle représente
l'excroissance qui barre dans la nature féminine que représente
à son tour la voyelle I.
La voyelle "I" est décrite par la couleur pourpre. Pour
signifier que cela n'est pas le fait d'un hasard, il est évoqué
une particularité de cette voyelle dans "sang craché" qui ne peut
que renvoyer au sang des menstrues en tenant compte de l'isotopie
métaphorique. L'objectif de cette mention n'est pas d'introduire un
intrus dans le système euphorique de l'érotisme
133
mais d'orienter la lecture isotopique en vertu de cette
remarque suivante de BATAILLE que nous rapporte Alain ROGER : « La
beauté de la femme désirable annonce ses parties honteuses:
justement ses parties pileuses, ses parties animales E...] La beauté
négatrice de l'animalité, qui éveille le désir,
aboutit dans l'exaspération du désir à l'exaltation des
parties animales! E...] La beauté humaine, dans l'union des corps,
introduit l'opposition de l'humanité la plus pure et de
l'animalité des organes, E...] Rien de plus déprimant, pour un
homme, que la laideur d'une femme, sur la laideur des organes ou de l'acte ne
ressort pas. La beauté importe au premier chef en ce que la laideur ne
peut pas être souillée et que l'essence de l'érotisme est
la souillure ». (ROGER, 1987)
En définitive, ce mythe de l'Ampelamanisa obéit
à un trait universel: l'impossibilité de nommer le sacré -
soit pour éviter le blasphème, soit pour éviter la
contamination - qui est ici un retour à l'animalité, donc une
négation de l'humanité. Le travail énergique de refus de
ce retour à l'animalité se manifeste au même titre que le
cadavre est enterré pour éviter toute contamination de la mort.
Dans le cadre de la censure du sexe féminin, ce qui risque de contaminer
est la souillure. Mais paradoxalement, c'est de la fermentation de la
pourriture que la vie peut prendre naissance, et c'est à cet effet que
la féminité est symbolisée par l'eau.
Rappelons pour mémoire que le sacré qui appelle
le blasphème est le sacré divin, et la religion n'a voulu retenir
que cela, mais il existe aussi le sacré maudit dont la transgression
provoque la contamination de la souillure. En tout cas comme le souligne
FREUD:
« L'homme qui enfreint un tabou devient tabou
lui-même, car il possède la faculté dangereuse d'inciter
les autres à suivre son exemple. Il éveille la jalousie et
l'envie: pourquoi ce qui est défendu aux autres serait-il permis
à lui. Il est donc réellement contagieux, pour autant que son
exemple pousse à l'imitation, et c'est pourquoi il doit lui-même
être évité. » (FREUD, [1912]1993, p. 30)
Nous pouvons maintenant mieux comprendre la censure qui
d'opère à l'endroit du sexe féminin: c'est le retour
à l'animalité à partir de laquelle l'humanité s'est
levée. Pourtant la beauté de la femme, tout en censurant cette
animalité la postule. La beauté de la femme est ce qui est
représentable contrairement à son sexe comme l'explique le texte
d'Alain ROGER:
« L'objet d'abord. Il n'est pas insignifiant que le
terme "nature" désigne "les parties qui servent à la
génération, surtout dans les femelles des animaux. La nature
d'une jument"; mais aussi d'une femme, réduite à sa
femellité, c'est-à-dire sa bestialité: vulve et
pilosité. On aurait là un îlot de nature
irrémédiable, un réduit irréductible, que la
culture ne peut que circonscrire comme son Autre, la Chose, l'innommable, sinon
dans la langue anatomique (neutralisation scientifique) ou les
métaphores animales, qui soulignent brutalement la naturalité de
la "bête". CHOÏROS, en grec, signifie à la fois la vulve et
le petit cochon; il en va de même du PORCUS latin. Le Français,
plus sensible au pelage, semble-t-il - les Grecques et les Romaines
s'épilaient -, dit la "chatte" ou la "motte", plus basse encore dans la
hiérarchie naturelle, et l'on aimerait posséder la liste
universelle, le catalogue argotique, le bestiaire obscène des noms et
surnoms dont la vulve fait l'objet. » (ROGER, 1987, p. 182)
134
Cette observation que ROGER définit dans l'aire
culturelle de l'Occident ne contredit pas la présente analyse qui, par
contre, appartient à l'aire orientale; nous permet de dire qu'il s'agit
là d'un universel de représentation que nous tentons d'expliquer
par le paradoxe de la censure et de la postulation. La question qui va nous
guider maintenant est de savoir pourquoi il y a censure.
Il y a censure parce qu'il y a dans l'humanité une
volonté de refréner le déferlement de violence dans la
possession des femmes comme cela est théorisé par FREUD dans
Totem et Tabou et que nous pouvons constater dans l'universalité
du tabou de l'inceste. Il y a également censure parce que :
« En tant que terme référentiel de la
relation la plus importante de la famille, la femme (la soeur) est l'objet
d'une conceptualisation complexe. Cette femme référentielle se
trouve partagée entre deux identités, celle de femme (sexuelle)
et celle de soeur ("femme de famille"), qui cohabitent dans le même corps
mais qui ne se manifestent jamais en même temps. » (MORAL-LEDESMA,
2000, p. 52)
Il y a surtout censure parce que l'innommable est
désigné par l'interdit même à la convoitise, une
convoitise qui n'est pas pour l'objet lui-même mais dans le sentiment de
transgression qui permet à l'homme de réduire la femme à
l'animalité à laquelle la femme ne peut pas se défendre
dans son inscription dans le social, soit parce qu'elle n'a pas la force
nécessaire, soit parce que biologiquement c'est une quête inscrite
dans sa nature. En outre, la transgression a ceci de voluptueux, elle permet de
déjouer - peut être de manière médiatisée -
la violence de la mort dans la régénération de la vie
à travers la femme qui justifie les premières sculptures de
l'humanité sous forme de femme stéatopyge (30.000 ans av. J.C.),
ou peut-être non médiatisée en tant qu'affirmation de la
vie dans l'érotisme qui suspend la violence de la mort sans la supprimer
au même titre que la transgression, d'une manière
générale, lève l'interdit sans le supprimer. La balance
entre censure et postulation peut être résumée par cette
remarque quelque peu énervée de QUINE à propos de
l'être:
« C'est pourquoi que j'ai dit et redit et au fil des
années qu'ÊTRE C'EST ÊTRE LA VALEUR D'UNE
VARIABLE. Plus précisément, ce que l'on reconnaît
comme être est ce que l'on admet comme valeurs des variables
liées. » (QUINE, 1993, p. 51)
Ce qui nous permet de dire que le corps de la femme - et c'est
là la raison de son enfermement dans du tchador dans certaines
civilisations et de leur interdiction du stade olympique dans la Grèce
antique - comme celui de l'homme est articulé pour le travail, mais en
même temps, ce corps féminin transgresse le monde du travail qui
se définit par sa transitivité pour verser dans le monde de
l'art, de l'artifice ou de la parure pour devenir intransitif ou
réflexif. Autrement dit, les variables liés de l'être de la
femme sont la censure et la postulation du sexe.
L'idée d'hyperbolisation et d'abolition dont parle
ROGER ne sont donc pas des moments inconciliables ou des choix de l'artiste
dans la représentation, ni même une question de goût du
jour. Ils sont les deux aspects de la sacralité, respectivement le
sacré à vénérer et le sacré de l'horreur.
Autrement dit, le corps de la femme est métonymique de son sexe et sa
135
séduction provient de ce qu'il détourne le monde
du travail vers le monde du jeu qui met en jeu la vie elle-même. Pour
renforcer cette idée, il n'est que de rappeler la différence
entre l'or et le fer. Du fer proviennent des outils permettant le travail, mais
de l'or on ne peut tirer que de la parure qui met en jeu le paraître au
détriment de l'être de travail. Du même coup, la vie est
mise en jeu puisque le travail c'est le pain selon un aphorisme qui a pris
naissance dans les émeutes de la faim du Paris du XIXème
siècle. En définitive la femme comme sémiotique est
toujours un signe autonymique.
Travaux cités
ALMEIDA, I. (1997, Mai). Le style
épistémologique de Louis Hjlemslev. Consulté le Juin
20, 2012, sur Texto:
http://www.revue-texto.net/Inedits/Almeida_Style.html
BANGE, P. (1992). Analyse conversationnelle et Théorie
de l'action. Paris: Les éditions Didier.
BENVENISTE, E. ([1974] 1981). Problèmes de
linguistique générale, II. Paris: Gallimard.
CASSIRER, E. (1969). "Le langage et la construction du monde
des objets". Dans C. e. Alii, Essais sur le langage (pp. 37-68).
Paris: Les Editions du Minuit.
DUCROT, O. (1972). Dire et ne pas dire, Principes de
sémantique linguistique. Paris: Hermann.
FREUD, S. ([1912]1993). Totem et tabou, Quelques concordances
enter la vie psychique dessauvages et celle des névrosés. (W.
Marièlene, Trad.) Paris: Gallimard.
FREUD, S. (1919). L'inquiétante
étrangeté - Les classiques des sciences sociales.
Récupéré
sur
classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/.../inquietante_etrangete.html:
http://dx.doi.org/doi:10.1522/030149457
GREIMAS, A. J. (1970). Du sens, Essais de
sémiotique,1. Paris: Seuil.
HJLEMSLEV, L. (1968-1971). Prolégomènes
à une théorie du langage. Paris: éditions de
Minuit.
JAKOBSON, R. O. (1981). Essais de Linguistique
générale,1. Paris: Editions de minuit. LAFONT, R. (1978).
Le travail et la langue. Paris: Flammarion.
MORAL-LEDESMA, B. (2000). "sexe des femmes, sexe de soeurs :
les organes génitaux féminins à Chuuk (Micronésie).
Journal de la société des océanistes, 110,
49-63.
PARIENTE, J.-C. (1982). "LEs noms propres et la
prédicationdans les langues naturelles" in Langages, 66. Dans J. Molino,
Le nom propre, (pp. 37-65). Paris: Larousse.
PICARD, C. (1995). "L'épisode de Baubo dans les
mystères d'Eulesis". Histoire des Religions (Revue), pp.
220-255.
QUINE, W. V. (1993). La poursuite de la vérité.
Paris: Seuil.
136
RIMBAUD, A. (1984). Poésies. Paris: Librairie
Générale Française.
ROGER, A. (1987). "Vulva, Vultus, Phallus". Communications,
46, pp. 181-198. SAUSSURE, d. F. (1982). Cours de Linguistique
Générale. Paris: Payot. SCHAEFFER, J.-M. (1999).
Pourquoi la fiction? Paris: Seuil.
137
10. CENSURE ET POSTULATION DU CORPS FÉMININ
RÉSUMÉ :
Cette étude met en évidence la différence
radicale entre l'homme et la femme à partir de l'analyse du mythe
biblique, celui d'Adam et d'Ève. Il en ressort que si l'homme appartient
au monde profane du travail, par contre, la femme appartient au monde
sacré. Il faut se rappeler que le sacré est ambivalent. Il y a le
sacré vénérable et le sacré exécrable. La
femme cumule ces deux sacralités. Mais dans la mesure où le
sacré s'entoure d'interdit. La séduction féminine provient
de la transgression d'un interdit fondamental : le monde sacré du jeu
qui définit la femme selon le principe de l'intransitivité.
Mots clés : sacré, profane, interdit,
totalité, transgression, séduction, postulation.
Abstract
This study highlights the radical difference between the man
and the woman from the analysis of the biblical myth, that of Adam and Eve. It
appears that if the man belongs to the secular world of work, however, the
woman belongs to the sacred world. It must be remembered that the sacred is
ambivalent. There is the sacred venerable and the execrable sacred. The woman
has these two properties of sacred. But to the extent where the sacred
surrounds himself banned. Feminine seduction comes from a fundamental banned
transgression: the sacred world of the game that defines women according to the
principle of the intransitivity.
Key words: sacred, profane, forbidden, totality, transgression,
seduction, postulation.
10.1. INTRODUCTION
On peut dire que depuis toujours le sexe féminin est
vigoureusement refoulé, censuré de diverses manières. On
peut même dire que toutes sémiotiques confondues n'ont fait que
censurer le sexe féminin parmi lesquelles la violence de l'excision.
Néanmoins, l'objectif de cette communication n'est pas de militer pour
l'égalité des sexes et encore moins de militer pour le
féminisme. Son objectif est moins ambitieux : observer l'aspect
pragmatique de cette censure en tenant compte que ce que la censure interdit,
elle la postule en même temps ; et nous pouvons dire, en anticipation de
notre formulation du problème que ce que la censure interdit, c'est la
totalité comprise comme une autonomie, ou comme signe autonymique.
Autrement dit, ce qui se profile derrière ce titre est
une illustration particulière de l'affirmation selon laquelle «
nommer, c'est faire exister ». Une affirmation que partagent en même
temps linguistes et anthropologues bien qu'il y ait certaines réserves
sur ce pouvoir de l'énonciation. Commençons par sortir de ces
réserves.
On oppose toujours à cette idée que nous voulons
développer sous la thématique de la femme que le monde est
l'univers sur lequel le langage s'est levé. Ce qui veut dire très
exactement que le langage ne crée rien puisque le monde lui
préexiste. À considérer cette
138
objection dans une stricte interprétation, on aboutit
logiquement à la notion de langage étiquette. Mais l'idée
de langage étiquette se heurte à son tour à la question de
la relativité linguistique mis à jour par Édouard SAPIR et
Benjamin Lee WHORF, plus connue sous le nom de thèse de SAPIR-WHORF.
(WHORF, 1980) Ainsi en Hopi, il n'y pas de notion d'indéfini
incompatible au nombre comme cela se présente en français avec
les articles du et qui n'a pas de pluriel pour déterminer les
noms de substance continue comme l'eau, ou l'air.
On remarque également qu'en malgache, une langue qui ne
connaît ni le genre ni le nombre dans laquelle l'article partitif et
l'indéfini pluriel n'existent pas. Il ne s'agit pas d'interpréter
cette absence comme inexistence de déterminant pour les
catégories visées. Jean-Claude MILNER démontre que
l'expression du partitif et de l'indéfini pluriel dans beaucoup de
langue est un zéro phonétique, noté Ø, (MILNER,
1978).
En effet, si le langage ne consiste qu'à donner des
étiquettes aux référents mondains, on ne s'explique pas
pourquoi les choses ne sont pas nommées de la même manière
dans toutes les langues naturelles. SAUSSURE pense que cette différence
nominative est une conséquence de l'arbitraire du signe (SAUSSURE, 1982,
p. 100 et sv). On connaît le déplacement de l'arbitraire
opéré par BENVENISTE à partir des arguments propres
à SAUSSURE lui-même :
« Ainsi du signe linguistique. Une des composantes du
signe, l'image acoustique, en constitue le signifiant, l'autre, le concept, en
est le signifié. Entre le signifiant et le signifié, le lien
n'est pas arbitraire ; au contraire, il est NÉCESSAIRE. (...) Ce qui est
arbitraire, c'est que tel signe, et non tel autre, soit appliqué
à tel élément de la réalité, et non à
tel autre. » (BENVENISTE, [1966] 1982, pp. 51-52)
Nous voulons suggérer que l'on ne peut parler
d'arbitraire dans le sens saussurien ou dans le sens de BENVENISTE qu'a
posteriori, quand on ne peut plus remonter la démarche
phylogénétique ayant fait passer le protolangage au niveau du
langage. La thèse de la relativité linguistique va dans ce sens :
pour une société d'éleveur de zébu, il est crucial
de pouvoir nommer les bêtes non seulement en fonction de la couleur de
leur robe mais également en fonction de leur morphologie pour les
services attendus de ces animaux : ainsi par exemple, un zébu sans
bosses est appelé en malgache baria parce que les zébus
de la sorte ont un comportement farouche et difficile à mettre au pas
pour les travaux des champs comme pour piétiner la rizière avant
le repiquage. Par contre ils sont très spectaculaires dans le
savika15 où le héros doit s'accrocher d'une
manière ou d'une autre à hauteur de l'encolure de l'animal qui se
débat à travers des sauts pour se débarrasser de l'homme.
Ce caractère morphologique importe peu au citadin malgache qui ignore
complètement pourquoi l'équipe nationale de foot est
appelée Barea16 de Madagasikara.
15 Une manière spécifique de
d'affronter les boeufs à mains nues en s'accrochant à lui par les
biais de son coup et de sa bosse afin de le faire tomber. Le savika n'est pas
à confondre avec le torero.
16 Juste une variante lexicale de baria
139
Cet exemple montre que les mots n'ont pas pour fonction de
nommer les choses mais de créer un parcours de renvois que justifie la
définition du signe dans la théorie triadique de PEIRCE,
notamment dans la notion d'interprétant :
« Un signe ou representamen est un Premier qui se
rapporte à un second appelé son objet, dans une relation
triadique telle qu'il a la capacité de déterminer un
Troisième appelé son interprétant, lequel assume la
même relation triadique à son objet que le signe avec ce
même objet ... Le troisième doit certes entretenir cette relation
et pouvoir par conséquent déterminer son propre troisième
; mais, outre, cela, il doit avoir une seconde relation triadique dans laquelle
le representamen, ou plutôt la relation du representamen avec son objet,
soit son propre objet, et doit pouvoir déterminer un troisième
à cette relation. Tout ceci doit également être vrai des
troisièmes du troisième et ainsi de suite indéfiniment...
» (PEIRCE, 1979, p. 147)
Nous allons maintenant, suite à l'exemple du baria
à l'instant, voir que c'est ce système de renvois que nous
préférons appeler « parcours d'évocations » qui
engendre les différences entre les langues, parce que chaque
société à l'intérieur d'une nation a un parcours
d'évocations différent les uns des autres.
HJELMSLEV, dans son analyse de la fonction sémiotique
qui s'établit entre « expression » et « contenu »
arrive à la même conclusion en partant de la comparaison de
plusieurs langues. Il en ressort que ce qui reste commun à toutes ces
langues est le sens qui prend une forme différente dans chacune d'elles
:
« Tout comme les mêmes grains de sable peuvent
former des desseins dissemblables, et le même nuage prendre constamment
des formes nouvelles, ainsi, c'est également le même sens qui se
forme ou se structure différemment dans différentes langues.
Seules les fonctions de la langue, la fonction sémiotique et celles qui
en découlent, déterminent sa forme. » (HJLEMSLEV, 1968-1971,
p. 70)
C'est dans ce sens que « nommer, c'est faire exister
» puisque le mot a cette particularité de générer, en
passant par le référent, ce parcours d'évocations qui
diffère d'une société à l'autre au sein de la
même communauté linguistique en fonction, justement, de la
fonction sémiotique et celles qui en découlent. Parmi les
linguistes sensibles à cette question, nous pouvons citer Charles P.
BOUTON qui note au niveau de l'ontogénie de la parole deux
démarches opposées mais complémentaires dont voici la
seconde : « Dans un second moment, le mot devient en lui-même
générateur de sensations, de sentiments, d'idées. Le
langage devient en soi un procédé de connaissance. »
(BOUTON, 1979, p. 265)
C'est ce que l'on appelle communément «
démarche sémasiologique ». Pour sa part, l'Allemand Ernst
CASSIRER soutient que le langage contribue à la construction du monde
des objets : « L'idée ne préexiste pas au langage, elle se
forme en lui et par lui » (CASSIRER, 1969, p. 66)
Il faut entendre par idée, l'idée de toute chose
à laquelle nous pouvons penser. Ce qui ne signifie pas que les choses
n'existent pas indépendamment du langage, mais elles ne peuvent pas
être saisies en dehors du langage qui leur assigne le lien de chose
à choses nécessaire à leur connaissance. C'est ce que
souligne PEIRCE en ces termes : « être et devenir,
140
c'est être représentable » (SAVAN,
1980, p. 11). Nous pouvons encore évoquer le logicien QUINE pour
soutenir que le langage instaure la continuité dans un monde discontinu
pour les services que l'homme en entend : « C'est pourquoi que j'ai dit et
redit et au fil des années qu'être c'est être la valeur
d'une variable. Plus précisément, ce que l'on reconnaît
comme être est ce que l'on admet comme valeurs des variables
liées. » (QUINE, 1993)
En définitive, lorsque l'on dit que « nommer,
c'est faire exister » ; il ne s'agit pas de croire à une puissance
démiurgique qui crée en même temps le nom et la chose ;
mais au contraire, il s'agit de la puissance de liaison qui relie une chose aux
autres selon un processus cognitif que résume cet aphorisme de
WITTGENSTEIN : « [...], nous ne pouvons imaginer aucun objet en dehors
de la possibilité de sa connexion avec d'autres objets »
(2.0121) (WITTGENSTEIN, 1961, p. 30)
On peut multiplier, de la sorte, les références
qui visent à montrer que le langage est un instrument
privilégié de connaissance, c'est-à-dire d'organisation du
réel qui se présente sous une forme discontinue. C'est à
ce titre seulement que l'on peut rejeter l'idée du langage
étiquette au profit d'un langage de construction.
Il nous semble que l'on ne peut plus, dans l'état
actuel de nos connaissances, faire obstacle à l'idée du langage
qui se situe au coeur du schème cognitif puisque l'idée de
langage étiquette est complètement ruinée. En effet, en
écho lointain au principe d'oubli que NIETZSCHE assigne au langage :
« Le mot (le concept) ne désigne un fait ou un
phénomène qu'à l'aide de l'abstraction en omettant
plusieurs de leurs traits.
« Tout concept naît de l'identification du non
identique. Aussi certainement qu'une feuille n'est jamais tout à fait
identique à une autre, aussi certainement le concept de feuille a
été formé grâce à l'abandon
délibéré de ces différences individuelles,
grâce à un oubli des caractéristiques » mais cette
identification de la partie au tout est une figure de rhétorique : la
synecdoque. (NIETZSCHE la nomme tantôt métaphore, tantôt
métonymie) » (TODOROV, 1970, pp. 28-29)
Jean PETITOT, d'un seul coup de plume, scelle de
manière convaincante l'inscription du langage dans le cognitif :
« La relation dominante est la relation
signifié / signifiant (la cause du désir et non pas la
validité du jugement), le référent n'étant qu'un
tenant lieu (un artefact, un simulacre, un trompe l'oeil) servant de support
» (BRANDT & PETITOT, 1982, p. 25)
Tout concourt donc à nous permettre de voir un peu plus
clair dans notre problématique : s'il y a censure, c'est parce ce que ce
tabou linguistique a des attaches plus fortes à la dimension cognitive
du langage pour laquelle la référence ne s'arrête plus au
réel - qui n'est qu'un simulacre - mais le traverse pour atteindre le
parcours d'évocations. Il y a tabou linguistique parce qu'une fois le
monde pris dans les rets du schème cognitif, la catégorie du
réel s'évanouit comme une question inutile. Il s'agit là
d'une conclusion à laquelle, avec son style propre, Robert de MUSIL nous
convie :
« [...]. Toutes les possibilités que
contiennent, par exemple, mille marks, y sont évidemment contenues qu'on
les possède ou non ; le fait que toi ou moi les
possédions
141
ne leur ajoute rien, pas plus qu'à une rose ou
à une femme. Mais disent les hommes du réel, "le fou les donne au
bas de laine et l'actif les fait travailler"; à la beauté
même d'une femme, on ne peut nier que celui qui la possède ajoute
ou enlève quelque chose. C'est la réalité qui
éveille les possibilités, et vouloir le nier serait parfaitement
absurde. » (MUSIL, 1982, pp. 18-19)
Cette dernière remarque permet de comprendre pleinement
que dans le langage, il n'y a que du langage qui s'autonomise dans un parcours
d'évocations. Une autonomie qui est au coeur de la pragmatique et qui
permet à cette discipline d'éviter le piège de la
confusion entre langage et substance. C'est à cette confusion que
HJLEMSLEV semble faire allusion dans la remarque suivante :
« A priori, on pourrait peut-être supposer que
le sens qui s'organise appartient à tout ce qui est commun à
toutes les langues, et donc à leurs ressemblances ; mais ce n'est qu'une
illusion, car il prend forme de manière spécifique dans chaque
langue ; il n'existe pas de formation universelle, mais seulement un principe
universel de formation. » (HJLEMSLEV, 1968-1971, p. 98)
Ce que nous allons essayer d'illustrer par l'exemple suivant.
Un individu habitant seul dans un appartement peut - dans l'intention de
signifier sa présence - laisser lumières et
téléviseurs allumés comme signe de sa présence au
moment où il est justement dehors. Ou encore, afficher sur son portail
l'écriteau « chien méchant » réalise accomplit
l'avertissement souhaité qu'il existe ou non un chien à
l'intérieur du domaine. De la même manière la
reconnaissance d'une forme sémiotique entraîne toujours un
parcours d'évocations que manifestent les actes de langage. C'est
pourquoi que la sanction d'un acte de langage n'est pas la véridiction
mais son apparition dans une existence token-réflexive,
c'est-à-dire qu'un acte de langage n'est ni vrai ni faux, mais il est -
au sens plein de ce verbe « être » - tout simplement.
Il nous semble que le passage du protolangage vers langage est
une manifestation du parcours d'évocations dans la pragmatique.
Autrement dit, l'émergence du langage est une question de pragmatique et
que les premiers langages sont consignés dans ces premières
littératures que nous appelons mythe.
10.2. DU PROTOLANGAGE AU LANGAGE EN PASSANT PAR LA
PRAGMATIQUE
Rappelons pour mémoire que, selon la perspective
communément admise et suivant en cela Charles MORRIS, dans le domaine de
la linguistique, il faut distinguer trois cas : la sémantique qui est
l'étude du rapport du signe avec le monde ; la syntaxe, l'étude
du rapport du signe entre eux et la pragmatique, l'étude du rapport des
signes à leurs interprètes (MORRIS, 1971, p. 21)
Cette présentation peut être appelée une
théorie additionnelle dans laquelle la pragmatique vient s'ajouter
à la sémantique et à la syntaxe ; les trois branches de la
linguistique sont ainsi chacune autonome. Ce n'est pas ainsi pourtant que
Rudolf CARNAP conçoit les choses quand il dit que La pragmatique est
la base de tout pour la linguistique
142
(CARNAP, 1942, p. 13). Voici comment Pierre BANGE nous
présente cette orientation de CARNAP sur la question de la pragmatique
:
« C'est en fait une conception radicalement
différente qui est suggérée : la présentation de
CARNAP introduit à l'analyse fonctionnelle du langage dans laquelle les
structures linguistiques sont considérées comme des moyens
commandés et guidés par des buts pragmatiques et permettant de
les réaliser. » (BANGE, 1992, p. 9)
On peut étayer cette intuition de CARNAP à
partir d'autres recherches qui tentent de remonter les origines du langage sur
le plan phylogénétique. Ainsi, l'hypothèse du goulot
d'étranglement dans le parcours de l'hominisation de l'espèce
aurait conduit à un saut qualitatif du langage.
Ce qu'il est convenu d'appeler avec le linguiste Dereck
BICKERTON « protolangage » peut être compris comme un langage
sans grammaire mais suffisamment efficace pour une communication qui
s'opère aux sens - présence simultanée des locuteurs et du
référent - à l'instar du langage enfantin qui, le plus
souvent, n'est qu'une vocalisation du geste déictique. En effet,
l'évidence première dans le geste déictique est
l'impérative présence simultanée de celui qui montre, de
l'objet montré et de celui à qui on le montre. De cette
manière, la situation d'énonciation supplée à la
carence de grammaire.
Remarquons que le protolangage ne se réduit pas
seulement à l'histoire de l'espèce ou au langage enfantin sur le
plan ontogénétique, il est formalisé de diverses
manières, dans l'arbitrage des sports collectifs, par exemple, à
cause de son efficacité dans le cas où arbitres et joueurs ne
parlent pas la même langue ; ce qui arrive très souvent dans les
sports de haut niveau. Il est également à l'oeuvre dans les
panneaux de signalisation routiers ; il interfère même dans la
communication quotidienne sous forme de gestuelle acquise par
répétition de la même situation.
Mais l'inconvénient majeur du protolangage est qu'il
est incapable de narration, c'est-à-dire, incapable de parler d'un
événement du passé et encore moins de faire une projection
dans le futur. Autrement dit, le protolangage ne permet pas la mise en place
d'une mémoire collective dont l'avantage indiscutable se présente
actuellement dans la notion de République comprise comme la soumission
de l'intérêt individuel à l'intérêt
collectif.
De la même manière que dans une
République, il faut que cet intérêt collectif soit
consigné matériellement dans ce que l'on appelle «
Constitution » comme faisant l'unanimité du plus grand nombre et
sur laquelle s'appuie toute forme de pouvoir : l'exécutif, le
législatif et le juridique ; il fallut à nos ancêtres un
moyen de publication de l'intérêt collectif : la narration. C'est
ce qui aurait abouti à la complexification du protolangage, l'amenant
à basculer dans le langage. En effet :
« Raconter une histoire, c'est le plus souvent
s'extraire de la situation présente pour introduire un autre cadre
spatio-temporel, y faire surgir des personnages réels ou imaginaires,
les faire vivre, agir, penser, parler sur une espèce de «
scène verbale » que l'on dresse devant son auditoire, en
déroulant, plus ou moins vite selon les besoins, le fil d'une
temporalité que l'on maîtrise entièrement et que l'on met
au
143
service de la dynamique des événements qui
se succèdent sur cette scène, qui peut elle-même, à
son tour, se déplacer pour suivre un acteur, une intrigue, jusqu'au bout
du monde s'il le faut. » (DESSALES, PIQ, & VICTORRI, 2006)
Mais pour conforter la position annoncée supra de
CARNAP, il nous faut encore expliquer pourquoi il est nécessaire de
raconter. Pour reprendre le parallélisme évoqué à
l'instant, on peut dire que s'il est impératif d'analyser la
constitutionnalité des actions ou décisions des pouvoirs, c'est
afin de préserver l'ordre public, de prévenir un
déferlement de violence provoqué par un sentiment d'injustice.
Pareillement, dans l'hominisation de l'espèce :
« Faire partie d'une société humaine,
c'est adhérer, le plus souvent sans réserve, à des
histoires qui racontent l'origine du groupe social et qui définissent du
même coup les comportements qui scellent l'appartenance à ce
groupe. Tous les mythes et religions fondent les interdits sur des
récits mettant en scène des personnages sacrés
(ancêtres ou dieux) qui violent précisément ces interdits
» (ibid.).
On voit très bien que raconter une histoire de la sorte
est guidé par un but pragmatique : empêcher la violation d'un
interdit qui désorganiserait l'ordre social :
« Une étape importante dans ce processus peut
avoir consisté à ritualiser le comportement narratif : au lieu
d'attendre qu'une crise éclate, il est en effet plus efficace
d'organiser des manifestations régulières pour évoquer ces
scènes ancestrales et les actes à prohiber. C'est tout au long de
cette évolution du comportement social que les techniques narratives
auraient progressé, se seraient affinées et complexifiées,
en devenant aussi de plus en plus conventionnelles. La langue mère,
munie de toutes ses propriétés syntaxiques et sémantiques
qui caractérisent le langage humain, serait l'aboutissement de ce
processus. » (ibid.)
S'il est donc admis que la coordination présentielle
d'actions telle que la chasse aux gros gibiers comme les mammouths ne requiert
pas un langage sophistiqué dans la mesure où gibiers et chasseurs
sont présents en même temps, il s'ensuit donc une
sémiotique du monde naturel interprétée de manière
immédiate plus ou moins de la même façon à cause de
leur répétition.
En revanche, communiquer sur un objet absent de manière
à dresser un spectacle linguistique, nécessite de la grammaire,
notamment la récursivité et ce que la grammaire traditionnelle
appelle « aspect », à côté des anaphores et des
indicateurs spatiotemporels. Bref, une spectacularisation discursive à
la source de la théorie actancielle initiée par la grammaire
puissancielle de TESNIÈRE ( [1959] 1982) et prolongée par GREIMAS
(GREIMAS, [1966] 1982).
Cependant, il ne faut pas croire que l'idée d'une
absence symbolisée est complètement hors de portée du
protolangage. Le protolangage participe déjà d'une logique
narrative en opposant les propriétés du passé et du futur
(avant vs après) dans la fabrication du premier outil : le silex biface.
C'est ce que nous apprend Robert LAFONT dans le passage suivant :
« L'hominisation de l'espèce commence lorsque
l'individu se sert d'un objet pour en modifier un autre en vue d'une action que
ce second assume : lorsque le chasseur
144
modifie la forme d'un caillou pour en faire une arme
contre un gibier éventuel. Éventuel : il faut bien dans
l'opération de fabrication d'un instrument, qu'un troisième objet
soit absent et remplacé par son image. La "certitude sensible"
nécessaire au travail est prise en charge par la représentation.
» (LAFONT, 1978, p. 19)
Il est curieux de remarquer que LAFONT parle également
d'hominisation de l'espèce dans la fabrication d'un outil. Ceci n'est
pas pour nous étonner car ce père de la praxématique
considère l'unité de la première articulation, non pas
comme doué de sens, mais comme un outil de production du sens :
« Il (le praxème) n'est pas « doué
d'un sens ». Il est l'unité pratique de production de sens, ce qui
est fort différent ; comme l'acte produit par l'outil, lui-même
produit par le travail, ne se confond pas avec l'outil, même si la forme
de l'outil lui donne déjà une forme » (LAFONT, 1978, p.
29)
Ce que LAFONT attache à l'unité de la
première articulation, la pragmatique le confie à
l'énonciation en termes d'actes de langage et dans la mesure où
Umberto ECO (1985, p. 138) opère une généralisation de la
narrativité à toute énonciation, nous pouvons conclure
avec la voix de B. VICTORRI cette identité entre la fonction narrative
et la dimension pragmatique du langage :
« Notre thèse peut alors se résumer de
la manière suivante. Pour échapper aux crises récurrentes
qui déréglaient l'organisation sociale, nos ancêtres ont
inventé un mode inédit d'expression au sein du groupe : la
narration. C'est en évoquant par la parole les crises passées
qu'ils ont réussi à empêcher qu'elles se renouvellent. Le
langage humain s'est forgé progressivement au cours de ce processus,
pour répondre aux besoins nouveaux créés par la fonction
narrative, et son premier usage a consisté à établir les
lois fondatrices qui régissent l'organisation sociale de tous les
groupes humains. » (VICTORRI, 2002)
Comme parmi ces lois fondatrices, il y a l'interdit de
l'inceste, nous pouvons donc maintenant traiter notre objectif final, à
savoir la censure et la postulation du corps féminin. Or, il faut
reconnaître que ces lois fondatrices se présentent, bien entendu,
de manière narrative avec toutes les ressources encore
insoupçonnées de la narrativité, mais prennent la forme
d'un mythe.
Le problème du mythe est qu'il se dote de fabuleux,
c'est-à-dire, la deixis am phantasma de Karl BULHER mise
à la mode par Claude CALAME (2004) par opposition à la deixis
demontratio oculo , respectivement, une référence interne et
une référence externe au discours qui atteste comme le dit BOUDOT
que le recours à la fiction est encore une analyse du réel :
« Nous appelons ici « fiction » la
tentative de constituer par le discours et en lui un monde différent du
monde réel : la volonté balzacienne de « faire concurrence
à l'état civil » en serait une illustration. C'est dans le
cas de la fiction que tout se passe comme si on avait affaire à un autre
réel. Mais la fiction se distingue de l'énoncé
irréel précisément parce qu'elle ne s'annonce pas comme
irréelle ; elle ne comporte pas de présupposition
d'irréalité, elle met au contraire tout en oeuvre pour se faire
admettre comme réalité. L'énoncé irréel
s'exprime en recourant au conditionnel. Il se situe ainsi
145
de lui-même par rapport au réel ; il
manifeste sa finalité qui n'est pas de décrire une autre
réalité, mais de servir par un moyen détourné
à l'analyse de la réalité. « Une théorie
féconde du réel exige la pensée de l'irréel »
écrit M. Boudot. » (PARIENTE, 1982, p. 43)
Ce qui veut dire que les mythes sont une analyse du
réel et qu'ils sont les premières expressions d'une intelligence
programmatique dont l'élaboration vise une culture anthropologique.
Cette dernière remarque est de nous permettre de traiter notre
problème à partir d'une littérature universelle : le mythe
dans la Bible.
10.3. LA CENSURE ET LA POSTULATION DU CORPS
FÉMININ
Le premier argument à cette censure nous vient d'un
texte mythique, celui de la genèse. Il appert de ce récit que la
femme est un interdit majeur. L'indice qui atteste de cet interdit est la
disproportion entre la punition d'Adam et d'Ève. Adam pour avoir
mangé du fruit de l'arbre défendu est condamné au travail
pour vivre tandis qu'Ève a pour punition d'accoucher dans la douleur et
qu'entre elle et le serpent se maintiendra éternellement une
inimitié.
Dans la mesure où nous évoluons dans le cadre de
la pragmatique, il y a lieu de préciser d'abord l'enjeu de l'analyse.
Certains analystes pensent que les mythes sont des folklores et ne
méritent pas l'attention du fait de leur anonymat et de leur
caractère fabuleux. C'est oublier un peu trop vite que ces textes sont
les premiers à instituer la mémoire collective par une
socialisation du sens qui s'y expose et que ce sens s'autonomise en
recréant le réel :
« [...]; la fonction du récit n'est pas de
« représenter », elle est de constituer un spectacle qui nous
reste encore très énigmatique, mais qui ne saurait être
d'ordre mimétique; la « réalité » d'une
séquence n'est pas dans la suite «naturelle» des actions qui
la composent, mais dans la logique qui s'y expose, s'y risque et s'y satisfait;
on pourrait dire d'une autre manière que l'origine d'une séquence
n'est pas l'observation de la réalité, mais la
nécessité de varier et de dépasser la première
forme qui se soit offerte à l'homme, à savoir la
répétition : une séquence est essentiellement un tout au
sein duquel rien ne se répète; la logique a ici une valeur
émancipatrice -- et tout le récit avec elle; il se peut que les
hommes réinjectent sans cesse dans le récit ce qu'ils ont connu,
ce qu'ils ont vécu; du moins est-ce dans une forme qui, elle, a
triomphé de la répétition et institué le
modèle d'un devenir. » (BARTHES, 1966, p. 26)
En effet, il est complètement inutile de chercher
à identifier la référence mondaine d'un personnage d'un
récit, même le récit autobiographique dresse une distance
incommensurable entre l'individu social et l'individu mis en spectacle
discursif dans le roman parce qu'à côté des performances
sémantiques du texte, il faut aussi tenir compte de la dimension
pragmatique ayant guidé l'énonciation du texte. Une dimension
pragmatique qui fait advenir des actes de langage, but ultime de la production
narrative.
Ainsi donc, le personnage d'Adam ou d'Ève a un
fonctionnement autonymique comme indiqué dans le passage suivant :
146
« C'est en effet un principe général et
simple que de représenter des éléments d'une classe, ou
tous les éléments d'une classe, ou cette classe en tant que
telle, etc., par l'un quelconque de ces éléments qu'on peut, dans
ce rôle, appeler type (c'est un usage naturel de ce mot). Cela peut se
faire soit « à l'intérieur » de l'énoncé,
[comme dans les exemples précédents] où une position
nominale est occupée par une chose qui se trouve être une
reproduction d'éléments linguistiques : soit à
l'extérieur, comme quand un philosophe disant je réfère
à soi-même, personne singulière, mais seulement en tant
qu'exemple d'humanité, de sorte que je paraît avoir une
référence universelle ; de même, quand on montre une
cigarette en disant : Ceci t'empoisonnera, l'objet singulier de la
référence littérale peut, pris comme type, «
référer» pour ainsi dire à toutes les cigarettes ou
à leur classe. » (CORNULIER, 1982, p. 138)
Ce qui veut dire qu'Adam n'est qu'un masque d'autorité
au sens défini par Claude CALAME (CALAME, 2004) qui permet de parler des
conditions de l'homme et de même pour Ève qui trace les conditions
de la femme.
La transgression a donc pour mission de révéler
que l'homme et la femme n'appartiennent pas au même monde. L'homme est un
être de travail dans le monde profane tandis que la femme est un
être de jeu dans le monde sacré. Le monde du travail est
un faire être tandis que le monde du jeu relève du paraître.
Si par le travail, l'homme se sépare de la nature, en revanche la femme
- n'étant pas condamnée au travail - demeure dans la nature et
suscite les mêmes interdits attachés à la nature, à
savoir : la sacralité de la nature.
La disproportion de la punition s'explique alors de
manière aisée. La transgression n'a pas modifié le statut
de la femme. Sa punition consiste à rester dans sa nature, un être
biologique qui a pour fonction de donner la vie. D'ailleurs, à ce
niveau, il y a lieu de croire que le nom propre affiche le caractère
primordial de la pragmatique par rapport à ses soeurs sémantique
et syntaxe. Exactement comme dans Cendrillon ; où la
dernière-née, longtemps négligée, se
révèle à la fin être la plus importante.
Le nom propre dans la vie quotidienne comporte tout
l'investissement affectif des parents. C'est-à-dire, dans la mesure
où l'amour est le moyen privilégié d'instaurer la
continuité dans la vie pour s'opposer à la discontinuité
imposée par la mort inéluctable. Dès lors parents,
investissent dans cette continuité ce qu'ils n'étaient pas
arrivé à faire, ou tout au moins, leur catégorie du
désir dans ce sens que l'on ne peut désirer ce que l'on
possède déjà.
Dans les discours qui participent plus ou moins à la
littérarité, le caractère autonymique des noms propres
font qu'ils se présentent comme des instructions d'un programme qui
s'accomplit de manière performative, ou pour dire les choses autrement,
ils sont comme une mise en abyme : une échelle réduite qui prend
de vitesse tout le roman. Ainsi, on retrouve la même opposition quant
à l'investissement du désir dans les noms d'ADAM et d'ÈVE
qui scellent d'un seul coup leur destin respectif.
Pour accroître la lisibilité de ce dont nous
allons parler maintenant, prenons connaissance de l'autonymie chez son
inventeur :
147
« Puisque le nom d'un objet peut être
arbitrairement choisi, il est très possible de prendre pour nom de la
chose la chose elle-même, ou, pour nom d'une espèce de choses, les
choses de cette espèce. Nous pouvons, par exemple, adopter la
règle suivante : au lieu du mot allumette, une allumette sera toujours
placée sur le papier. Mais c'est le plus souvent une expression
linguistique qu'un objet extralinguistique qui est utilisée comme sa
propre désignation. Nous appelons autonyme une expression
utilisée de cette manière. » (CARNAP, 1976).
On peut donc en déduire que le signe autonymique se
caractérise par l'intrusion du référent dans le signe,
c'est ce qu'illustre singulièrement les noms propres comme « Dupont
» désignant l'homme qui habite près du pont.
Pareillement, nous savons qu'Adam est ainsi nommé
puisqu'il est né de la terre. L'étymologie officielle
hésite en effet entre deux significations de ce nom propre, d'une part,
on interprète le vocable comme signifiant « homme » de son
origine hébraïque, d'autre part, en ajoutant la lettre « h
» à la finale, on obtient adamah qui signifie terre.
À notre avis, c'est adamah qui est la véritable
étymologie, l'étymologie « homme » ne saurait pas
être retenue puisqu'il n'y a pas possibilité de concevoir l'homme
que par opposition à la femme. Cette opposition n'est
révélée qu'à partir de la transgression qui
définit l'homme comme à la fois un être de transgression et
un être de travail. Nous pensons que c'est par hagiographie que l'on
attache le nom à « homme » à Adam, parce que ce qui
définit l'homme c'est le travail de la terre de laquelle il est
tiré.
La femme est par contre tirée de l'homme mais
ÈVE ne signifie pas « être tiré de l'homme » mais
« vie ». Mais dire qu'Ève est tirée de l'homme n'est
pas une affirmation neutre. Tout d'abord, il faut reconnaître que
l'affirmation est une demande de croire d'autant plus que le contexte
général de l'affirmation est religieux. Ce qui veut dire que
l'affirmation n'est pas susceptible de contestation. Ensuite, il y a la
volonté de subordonner la femme à l'homme de par cette origine
dérivée. Autrement dit, l'affirmation a pour conséquence
de donner un statut inférieur à la femme.
La question qui va nous guider maintenant est de savoir
d'où vient cette minimisation de la dérivée. En toute
logique, cette minimisation est une conséquence de la volonté de
contrer par une dimension culturelle la puissance du naturel. La puissance de
ce naturel est une logique qui a fait que l'homme ait succombé à
la tentation alors que la femme a obéi à une ambition : devenir
l'égale de Dieu.
En effet, il est dit que la femme a été
subornée par le serpent qui lui faisait miroiter que la transgression de
l'interdit permet d'accéder à la même connaissance que Dieu
tandis que la transgression de l'homme est de nature passionnelle puisqu'elle
n'a pour seul motif que l'incapacité de dire non à Ève, de
dire non à la nature.
Par l'énergique travail - tu ne mangeras qu'à la
sueur de ton front -, l'homme met à distance la nature,
c'est-à-dire qu'il tente de s'arracher de la nature, mais le mouvement
même par lequel il tente de s'arracher de la nature le ramène
à la nature avec cette illusion
148
de la contrôler au même titre que le langage qui
informe la nature est une recréation de cette nature.
En travaillant la terre, l'homme s'arrache de la nature, non
pas de manière absolue, mais par une forme de mise à distance qui
lui permet de commander à la nature. De la même manière en
dérivant la femme de l'homme, le récit a pour but de
contrôler la femme. Ainsi, dans l'iconographie religieuse, ce
contrôle de la femme fait que les diverses sémiotiques figuratives
effacent sur un point précis la féminité. Pour ne citer
qu'un exemple typique, il n'est que de renvoyer à CRANACH l'Ancien qui
représente Ève avec une feuille qui vient à point
nommé pour occulter le sexe de la femme (CRANACH).
Cette occultation est ce que nous avons appelé une mise
à distance ou plus exactement « une censure » qui est le
pendant négatif de la maxime selon laquelle « nommer, c'est faire
exister » comme le souligne cette réflexion de SARTRE : «
L'écrivain, qu'il le veuille ou non, est un homme engagé dans
l'univers du langage : « nommer, c'est faire exister » (SARTRE,
1998, p. 66)
Une illustration très appropriée de cette maxime
se trouve dans un des romans de STENDHAL, La Chartreuse de Parme, au
moment où le comte de Mosca, voyant s'éloigner la voiture qui
emporte la Sanseverina, sa fiancée, et le jeune Fabrice, provoque au
niveau du discours le subtil mouvement de débrayage
diégétique qui fait passer l'énonciation du narrateur
(extradiégétique) vers perspective intradiégétique
où c'est le héros qui parle directement :
« Il devenait fou ; il lui sembla qu'en se penchant
ils se donnaient des baisers, là, sous ses yeux. Cela est impossible en
ma présence, se dit-il ; ma raison m'égare. Il faut se calmer ;
si j'ai des manières rudes, la duchesse est capable, par simple pique de
vanité, de le suivre à Belgirate ; et là, ou pendant le
voyage, le hasard peut amener un mot qui donnera un nom à ce qu'ils
sentent l'un pour l'autre ; et après, en un instant, toutes les
conséquences » (STENDHAL, 1839, p. 167)
La dernière remarque de ce passage est très
instructive : l'énonciation de ce que cette fiancée et de ce que
ce jeune garçon sentent l'une pour l'autre aura toutes les
conséquences, c'est-à-dire, selon la définition de la
sémiotique, le signe engendra un parcours d'évocations qui est
une modalité d'existence. Dès lors nous pouvons comprendre que ne
pas nommer, c'est faire disparaître.
Sur la base de la théorie des interprétants de
la sémiotique triadique de PEIRCE, nous avons indiqué dans ce
travail que nommer une chose, n'est pas lui coller une étiquette mais
lui permettre de renvoyer à d'autres choses selon le principe du
parcours d'évocations. Ce qui veut dire que ne pas nommer c'est
interdire ce parcours d'évocations.
Nous voyons maintenant se dessiner ce que la censure interdit
exactement. Dire que le fruit interdit est celui de l'arbre de la connaissance
du bien et du mal, c'est implicitement dire que ce que la censure interdit,
c'est la totalité : une omniscience qui est le privilège des
dieux. Puisque la catégorie du bien et la catégorie du mal
constitue la totalité, cela prouve qu'il n'y a
149
pas d'objet doté de neutralité absolue, chaque
objet oscille entre le mal et le bien, sinon chaque objet appartient à
l'une ou à l'autre catégorie.
Avec toute l'ambivalence du sacré, ce qui est mal dans
le récit de la Genèse est la femme qui appartient au monde
sacré du jeu, au monde sacré de l'apparence. C'est pour cette
raison qu'elle est subordonnée à l'homme pour éviter le
déferlement du mal dans le monde profane du travail. Notons que la femme
n'est pas le mal en soi, mais c'est cette incursion de l'homme dans le monde
sacré du jeu qui est dangereux pour l'homme parce que le monde
sacré du jeu divise les objets en utilitaires et en luxes.
Les utilitaires sont ceux qui permettent le travail auquel
l'homme est assigné, mais le luxe est ce qui exige le jeu de l'apparence
à l'image exacte des bijoux. Et comme pour limiter les
dégâts du jeu de l'apparence dans le monde profane de l'utilitaire
ou dans le monde profane du travail, il est assigné à la femme,
à la suite de la transgression, une fonction utilitaire : enfanter. Le
caractère utilitaire de l'enfantement est souligné par
l'adverbial « dans la douleur » ; car si ce n'est pas
nécessairement utile, la femme se serait encore soustraite à
cette fonction « douloureuse ».
Mais le problème est que pour enfanter la femme a
besoin de séduire. Une séduction qui se définit comme un
détournement de l'utilitaire vers le luxe, vers le jeu. Autrement dit,
s'il est accepté que c'est la fonction qui crée l'organe, si la
forme masculine se détermine par son aptitude à travailler, par
contre la forme féminine se définit par sa capacité
à susciter le désir, la convoitise parce qu'elle n'est que jeu
d'apparence propre à détourner l'homme du monde du travail, du
monde de l'utilitaire.
Ce qui veut dire exactement que la morphologie masculine est
de nature transitive. L'homme est un être de travail et il est
associé au « faire ». Par contre, la morphologie
féminine est réflexive. La femme est associée à
« être ». Elle assure une forme de complétude qui
instaure le manque du côté du masculin. De ce point de vue «
complétude » et « totalité » sont synonymes et
c'est pour cette raison que la censure interdit la totalité.
Pour illustrer cette différence, prenons une
sémiotique qui prend sa source dans la tradition hellénique. On
sait que les jeux olympiques ont pour but de glorifier les dieux par la
beauté du corps humain. Mais détail important, le stade olympique
est interdit aux femmes parce que la beauté du corps humain doit
être l'oeuvre d'un effort individuel caractérisé par la
transitivité de l'effort. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, il suffit
de se référer au discobole (LANCELOTTI) qui sur le plan
anatomique montre la tension de l'effort.
Il a fallu attendre Praxitèle pour que le nu
féminin entre dans les moeurs de la cité hellénique,
notamment avec la sculpture dite « Aphrodite de Cnide ». La raison de
cette censure de la femme des stades s'explique par le fait que la
beauté féminine ne s'obtient pas par un modelage à partir
de l'effort, mais de manière naturelle, c'est ce qui impose du
même coup la réflexivité du corps féminin, autrement
dit, sa nature de forme autonymique que décline TODOROV en un principe
d'intransitivité :
150
« Il en est ici du discours comme de la marche. La
marche habituelle a son but en dehors d'elle-même, elle est un pur moyen
pour parvenir à un but, et elle tend incessamment vers ce but, sans
tenir compte de la régularité ou de l'irrégularité
des pas séparés. Mais la passion, par exemple, la joie
sautillante, renvoie la marche en elle-même, et les pas
séparés ne se distinguent plus entre eux par ceci que chacun
rapproche davantage vers un but ; ils sont tous égaux, la marche n'est
plus dirigée vers un but, mais a lieu plutôt pour elle-même.
Comme de la sorte les pas séparés ont acquis une importance
égale, l'envie devient irrésistible, de mesurer et de subdiviser
ce qui est devenu identique de nature, de la sorte est née la danse
» (TODOROV, [1977] 1991, p. 191).
L'interdit de la censure se précise de plus en plus. Ce
qui est intolérable est l'intransitivité qui est du domaine du
luxe. La difficulté à parler du corps féminin
réside justement dans cette forme d'indicible de
l'intransitivité. Par exemple, les jambes d'une femme ne renvoient pas
à la marche mais à la danse, et la danse est une exhibition qui
provoque la convoitise : le désir de s'approprier le corps de la femme.
C'est cette appropriation qui est interdite.
On comprend mieux maintenant pourquoi seul l'homme est
condamné au travail puisque la femme est de nature intransitive. Et s'il
y a un travail énergique de négation de cette
intransitivité dans l'assignation de l'enfantement à la femme,
c'est parce que cette intransitivité est aussi le moteur
énergique de la séduction : privé de fonction utilitaire,
le corps de la femme est donc un luxe destiné au plaisir des sens. Une
séduction d'autant plus forte qu'elle est censurée par la
fonction utilitaire.
En effet, lorsque l'on s'aperçoit que le corps de la
femme n'est pas apte à l'effort physique, c'est-à-dire quand on
sait que ce corps n'a pas de but utilitaire, on est obligé de conclure
que ses formes épanouies ont d'autres destinations : susciter le
désir pour elles-mêmes ; tout se passe donc comme si la femme
était destinée au plaisir, la fonction utilitaire n'étant
qu'un artefact, un simulacre. Il s'agit là d'une sémiotisation du
corps de la femme ; une sémiotisation qui n'est pas de l'ordre du signe
arbitraire mais du signe autonymique, qui n'est pas de l'ordre de la
dénotation mais de celui de la connotation en termes de linguistique.
C'est-à-dire que cette sémiotique connotative
correspond plus exactement au système de renvois caractéristiques
de la théorie des interprétants chez PEIRCE. En termes
pragmatiques, cette sémiotique connotative consiste à dire que le
corps de la femme en même temps qu'il invite à la consommation
sexuelle s'affiche également comme un interdit en tant que dilapidation
d'énergie en pure perte à cause de l'intransitivité de
l'objet du désir. C'est cela l»interdit de la totalité :
l'obligation de voir dans le corps de la femme un « autre soi-même
» et non un objet du désir.
D'une manière semblable, la position de Beatriz
MORAL-LEDESMA à propos de son analyse des sexes de la femme chez la
population micronésienne manifeste également cet interdit de la
totalité :
« En tant que terme référentiel de la
relation la plus importante de la famille la femme (la soeur) est l'objet d'une
conceptualisation complexe. Cette femme référentielle se trouve
partagée entre deux identités, celle de femme (sexuelle) et
celle
151
de soeur (femme de famille) qui cohabitent dans le
même corps mais qui ne se manifeste jamais en même temps. [...]
Cette séparation stricte des identités féminines
hébergées par un seul corps, cet éloignement de la femme
sexuelle que la soeur doit opérer est une mesure radicale pour
éviter l'inceste » (MORAL-LEDESMA, 2000).
Nous devons ajouter à cette remarque en fonction du
mécanisme métonymique, l'origine de la théorie du
déplacement en psychanalyse : c'est le corps de la femme elle-même
qui est un système de renvois métonymiques à son sexe.
C'est ce qui explique la radicalisation de la mise sous voile de ce corps dans
certaines sociétés musulmanes fondamentalistes.
Il nous semble que la psychanalyse de ce point de vue a tort
de caractériser le féminin par l'envie du pénis. Certes,
si l'on adopte cette position, la femme est caractérisée par
l'absence de pénis comme plénitude ; mais il ne faut pas oublier
que c'est le corps même de la femme qui, dans sa plénitude
naturelle se présente comme un phallus, donc comme un objet du
désir.
En effet, dans les sémiotiques du corps féminin,
la présentation oscille entre hyperbolisme ou abolitionnisme. C'est de
cette censure et postulation que rend compte cette remarque : « [Ces]
les premières représentations féminines associent
l'hyperbole vulvaire et l'abolition du visage. » (ROGER, 1987)
Autrement dit, il s'agit d'une monstration de la femme
sexuelle au dépens de la femme sociale, ou de la femme-soeur selon
l'analyse de MORAL-LEDESMA. Mais ce qui atteste surtout le principe de renvoi
métonymique du corps de la femme est le passage suivant :
« J'ai même supposé, naguère,
que, dans cette réduction génitale, la femme était
fétichisée, vulve ithyphallisée. L'idée
paraîtra peut-être moins fantastique si l'on songe que d'autres
statuettes, différentes, il est vrai des précédentes,
puisqu'elles ne s'inscrivent pas dans un losange, sont manifestement
phalliques. Ainsi celle de Mauern, interprétée par Zotz comme une
figure androgyne, mais aussi celles de Sireuil et du Lac Trasimène,
ainsi que plusieurs figurines sibériennes de Malta et de Bouriet. M.
Camus y voit des « vulves ithyphalliques », mais dans une acception
différente de la mienne, puisque, dans ces exemples, le phallus
émerge en quelque sorte de la vulve, tandis que je prétends, pour
les Vénus rhomboïdales, que c'est toute la femme qui est
ithyphallisée dans sa vulve. » (ROGER, 1987, p. 184)
Dire que c'est toute la femme qui est ithyphallisée,
c'est impliquer que c'est tout le corps de la femme qui devient un objet du
désir instaurant de la sorte le manque du côté masculin,
contrairement à la psychanalyse qui soutient l'envie du pénis du
côté féminin. Cette intuition des iconographes dans
l'ityphallisation du corps de la femme montre au moins une chose : elle est en
parfaite adéquation avec le mythe de la Bible, à savoir que la
condamnation de l'homme au travail se justifie par le fait que le corps de la
femme ithyphallisée est inapte au travail. Une inaptitude qui qui engage
la femme dans la voie de l'érotisme.
En effet, selon la suggestion de Per Aage BRANDT, il est clair
que le véritable sexe, c'est la femme et l'homme n'en est que la
catalyse. C'est que nous montre le jeu de l'absence et de la présence du
phallus dans le carré sémiotique suivant :
Disjonction
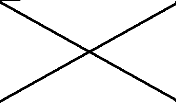
Conjonction
Etre
[présence du phallus]
Non-paraître [Signifiant]
Paraître
[absence du phallus]
Non être
[signifié]
152
S'il est admis que le carré sémiotique est un
dispositif logique qui permet d'obtenir une conjonction à partir d'une
disjonction, autrement dit une logique médiatrice qui a pour fonction de
concilier les contraires ; on s'aperçoit de ce carré que c'est la
femme qui est le signifiant du sexe et l'homme n'en est que le contenu - sans
jeu de mots - Ce qui veut dire exactement, comme le souligne PETITOT, que c'est
la relation entre signifiant et le signifié (la cause du désir et
non la validité du jugement).
On comprend dès lors pourquoi, le féminin
déclenche un parcours d'évocations infinies, une pléthore
de significations qui lie latéralement le signifiant « femme »
à d'autres signifiants et ainsi de suite indéfiniment comme le
stipule la théorie des interprétants dans la sémiotique
triadique de PEIRCE. On commence maintenant à bien cerner la censure qui
frappe la femme aussi bien dans l'univers linguistique dans l'univers
social.
Lorsque nous disons que c'est la totalité que la
censure interdit, c'est parce que nous avons, d'abord, une image synecdochique
de cette totalité dans le mythe étudié. Ce qui est
interdit c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, c'est
exactement l'ensemble du bien et du mal qui constitue la totalité de ce
qui peut arriver à l'homme.
Le bien et le mal est aussi le tragique destin de l'homme
puisque dans la beauté féminine se réalise la
coïncidentia oppositorum que le Groupe mû considère
comme le trait de la poéticité dans la théorie de la
médiation (DUBOIS, et al., 1977, p. 82). En effet, il n'est plus
à démontrer que le bien et le mal dans la sexualité est la
coïncidence de la volupté et de la souillure comme transgression de
l'interdit de l'infect : un retour à l'animalité par
transgression du mal sacré. FREUD ne nous apprend-il pas que : «
(...) est enfin « tabou », au sens littéral du mot, tout ce
qui est à la fois sacré, dépassant la nature des choses
ordinaires, et dangereux, impur, mystérieux. » (FREUD, [1912]1993,
p. 23)
Il nous semble que les trois adjectifs qualifiant le
sacré sont extensibles à la femme. La femme ne ressort pas de
l'ordinaire puisqu'elle n'appartient pas au monde du travail mais au monde du
luxe, du non utilitaire de la catégorie des bijoux. Elle est
mystérieuse par la sanction de l'absence du pénis qui fait que
son érogénéité est partout et nulle part. Elle est
impure naturellement à cause non seulement des menstrues mais aussi de
son humidité sexuelle. Autrement dit, il faut admettre également
que selon l'ambivalence du sacré - désignant à la
153
fois l'interdit vénérable et l'interdit
exécrable -, la femme est sacrée en hébergeant sur le
même corps le sacré vénérable et le sacré
exécrable.
Dans un article qui vise à démontrer que
l'idéogramme [se] chinois sur une période diachronique allant
jiaguwen (inscriptions divinatoires sur écailles et os datant
du XIVème siècle au XIème
siècle av. J.C.) au style sigillaire, en chinois xiaozhuan, en
passant par le jinwen (inscriptions sur bronze datant du
XIème au Vème siècles av. J.C.) qui
était courant à l'époque des Han (206 av. J.C.) signifie
à la fois couleur et sexualité. Mais le point
intéressant dans cet article est l'attestation du caractère impur
de la femme :
« En ce qui concerne les caractères
péjoratifs, ils ne représentent souvent pas des qualités
exclusivement féminines. On ne voit pas, par exemple, pourquoi,
sauf
préjugé, des notions telles que duo { J
paresseux, nao { J haïr/en
colère, jian crime sexuel, ou pire encore, poisson
pourri,
devraient être représentées par des
picto-idéogrammes composés de l'élément femme.
» (SIAU, 1990)
Nous pouvons multiplier les remarques de ce genre à
partir d'autres sources telles que les Voyelles de Rimbaud qui, en
deux endroits, associe le féminin au sacré exécrable :
« A, noir corset velu des mouches
éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles » (Strophe
1)
« I, pourpres, sang craché, rire des
lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes
» (strophe 2) (RIMBAUD, 1984, p. 91)
On peut prendre ce poème comme un pendant du
célèbre tableau intitulé Origine du monde
(COURBET, 1886) qui présente l'intimité féminine avec
un réalisme inédit en peinture :

Mais, en définitive, il suffit de reconnaître ici
que la totalité interdite par la censure est justement cette coexistence
du vénérable et de l'exécrable. Le vénérable
et l'exécrable relèvent du sacré en ce qu'ils sont
interdits de contact afin de les préserver des dangers de contamination
: préjudice pour le premier cas, souillure pour le second. Il s'ensuit
alors, dans la mesure où la femme cumule les deux sacrés, une
troisième forme de la totalité interdite : il n'y a pas
d'interdit absolu, chaque interdit appelle sa transgression.
154
Autrement dit, l'acte sexuel est interdit parce que c'est une
profanation du sacré vénérable puisque la femme est
l'origine du monde, en même temps, c'est une non séparation du
bien et du mal parce que c'est un contact avec le sacré
exécrable. . C'est de cette manière que l'interdit désigne
l'objet de l'interdit à la convoitise ou que la censure postule ce
qu'elle interdit. Nous retrouvons alors le sens étymologique du verbe
séduire (seducere) qui veut dire « détourner du droit chemin
».
Enfin, une dernière interprétation de la
totalité se trouve exécutée dans un genre
spécifique de poème appelé « blason ». S'il est
admis que l'érogénéité du corps féminin est
partout et nulle part, on comprend pourquoi le langage est incapable de parler
du corps de la femme que dans un morcelé métonymique. Le recours
au dictionnaire pour le terme « érogène » est d'une
parfaite inefficacité.
Le dictionnaire usuel définit d'érogène
une zone dont la stimulation provoque un plaisir sexuel, mais ne nous dit pas
pour qui. Ainsi, il convient de définir l'érogène dans un
rapport intersubjectif. Ce qui est érogène l'est à la fois
pour les deux partenaires. Ensuite, en tenant compte de la différence
entre l'homme - qui est un être de travail - et la femme - qui est un
être sacré - on s'aperçoit que cette dernière finit
par érotiser tout son corps - ithyphallisé - parce que l'interdit
le désigne à la convoitise avec toute la volupté de
l'angoisse de la transgression.
Pour montrer un exemple de cette totalité
érotisée, il n'est que de faire référence à
un poète suffisamment connu qu'on peut dire que la teneur de son oeuvre
relève de la mémoire collective - sous quelques réserves.
Il s'agit de Baudelaire.
Commençons par quelques remarques sur le titre de
l'ouvrage : « Fleurs du mal » La première remarque consiste
à dire que le titre, souvent, fonctionne comme une matrice à
partir de laquelle le texte se développe : « Le modèle que
je propose pour la réalisation lexicale du paragramme est donc
l'expansion d'une matrice. Étant lexicale, cette expansion se fait sous
la forme de mots liés par une grammaire, tandis que Saussure pensait
à un paragramme phonétique ou graphémique. Contrairement
à la séquence qu'elle engendre, la matrice n'est que
sémantique au lieu d'être, elle aussi, lexicale ou
graphémique, comme elle le serait dans la conception saussurienne du
locus princeps. Au lieu donc de fragments de mots dispersés le long de
la phrase, chacun d'eux enchâssé dans un mot de la phrase, nous
avons des mots ou des groupes de mots, chacun d'eux enchâssé dans
un syntagme dont la construction reflète et extériorise la
configuration sémantique interne du mot noyau ou de la donnée
sémantique que ce mot actualiserait. » (RIFFATERRE, 1979, p. 78)
La deuxième remarque est que le titre matrice -
attribut de la femme selon Baudelaire - reproduit exactement la double
sacralité de la femme : à la fois vénérable et
exécrable. En effet, cet oxymore obéit au principe de non
séparation du bien et du mal qui projette dans l'univers sacré.
Si le mal est littéralement manifeste dans ce titre, le bien par contre
prend une dimension synecdochique parce que seul un élément de
l'ensemble « bien » est désigné : Fleurs.
155
Franchissons maintenant une dernière étape. Ce
qui est mal doit être l'objet d'un interdit de contact, et même de
nomination ; mais comme l'interdit désigne l'objet à la
convoitise du fait de cet interdit lui-même, on comprend que l'objet du
désir ne soit pas seulement le sexe féminin au sens strict mais
tout le corps féminin par déplacement métonymique. Ainsi,
quand dans la deuxième strophe du « Le Beau navire », nous
avons :
« Quand tu vas balayant l'air de ta jupe large,
Tu fais l'effet d'un beau vaisseau qui prend le large,
Chargé de toile, et va roulant
Suivant un rythme doux, et paresseux, et lent. »
Il est évident que sur un plan intertextuel, cette
description est l'actualisation d'une matrice qui s'avère être le
mot « callipyge » dont l'étymologie grecque signifie tout
simplement « belles fesses ». L'argument permettant cette
interprétation est qu'un vaisseau prenant le large est vu en poupe.
Cependant, en dépit de ce parcours d'évocation
qui érotise le corps féminin, il ne faut pas oublier que la femme
est en même temps un être social. Ainsi, face au désordre
que provoquerait dans le monde profane du travail, le corps féminin
comme foyer de convoitises autotéliques ; se crée la prohibition
de l'inceste comme une valeur universelle. Cela n'implique pourtant pas que la
femme permise, parce qu'en dehors d'un rapport incestueux, ne soit pas
interdite. En fait le véritable interdit, en ce qui concerne notre
corpus est cette transgression de la séparation du mal et du bien que
l'on retrouve clairement dans le mouvement de l'inhumation pour
préserver les vivants de la contamination de la putréfaction de
la mort.
Ainsi donc, le véritable sacré est la perte de
l'utilitaire qui projette l'homme dans une dépense d'énergie sans
compensation en retour que la volupté de transgression du
décloisonnement du bien et du mal. C'est en ce sens que le corps de la
femme est censure de l'animalité et en même temps sa postulation
dans la volupté de la transgression. C'est-à-dire
coïncidence de l'animalité de l'humanité, et le parcours
d'évocations, à la vision de la nudité féminine, se
nourrit de cet interdit.
Travaux cités
BANGE, P. (1992). Analyse conversationnelle et Théorie
de l'action. Paris: Les éditions Didier.
BARTHES, R. (1966). "Introduction à l'analyse
structurale des récits" dans Communications, 8. Dans B. e. alii,
Recherches sémiologiques: L'analyse structurale du récit
(pp. 1-27). Paris: Seuil.
BENVENISTE, E. ([1966] 1982). Problèmes de
linguistique générale,1. Paris: Gallimard.
BOUTON, P. C. (1979). La signification, Contribution à
une linguistique de la parole. Paris: Klincksieck.
BRANDT, P. A., & PETITOT, J. (1982). "Quelques
remarques sur la véridiction" Hommage aux Jefalumpes. Paris:
CNRS.
156
CALAME, C. (2004). Jeux énonciatifs et masques
d'autorité poétique. Paris: Les Belles Lettres.
CARNAP, R. (1942). Introduction to semantics. Cambridge,
Mass: Harvard University Press.
CARNAP, R. (1976). Autonymie et reflexivité. Dans R.
alain, Théories du signe et du sens (pp. 223-232). Paris:
Klincksieck.
CASSIRER, E. (1969). "Le langage et la construction du monde
des objets". Dans J.-C. PARIENTE, Essais sur le langage (pp. 37-68).
Paris: Les Editions du Minuit.
CORNULIER, B. (1982). "Le détachement du sens" dans Les
Actes de Discours, Communications,32. Communications, pp. 125-182.
COURBET, G. (1886). L'origine du monde.
Encyclopédie Encarta,Erich Lessing, Art resource, NY.
Musée d'Orsay, Paris.
CRANACH, L. (s.d.). Adam et Ève. Adam et
Ève,1526, Huile sur bois, 117,1 X80,5 cm. Courtauld institute,
Londres.
DESSALES, J.-L., PIQ, P., & VICTORRI, B. (2006, Mars 20).
" A la rechcerhce du langage originel". Consulté le Mai 5,
2013, sur halshs-00137573, version 1:
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00137573
DUBOIS, J., EDELINE, F., KLIKENBERG, J.-M., MINGUET, P., PIRE,
F., & TRINON, H. (1977). Rhérotique de la poésie: lecture
linéaire et lecture tabulaire. Paris: éditions complexe.
ECO, U. (1985). Lector in fabula ou la coopération
interprétative dans les textes littéraires. Paris:
Grasset.
FREUD, S. ([1912]1993). Totem et tabou, Quelques
concordances enter la vie psychique dessauvages et celle des
névrosés. (W. Marièlene, Trad.) Paris: Gallimard.
GREIMAS, A. J. ([1966] 1982). Sémantique
structurale. Paris: Larousse.
HJLEMSLEV, L. (1968-1971). Prolégomènes
à une théorie du langage. Paris: éditions de Minuit.
LAFONT, R. (1978). Le travail et la langue. Paris: Flammarion.
LANCELOTTI, [. C. (s.d.). Le discobole. Scala / Art
Resource, NY. Museo Nationale Romano delle terme, Rome.
MILNER, J.-C. (1978). De la syntaxe à
l'interprétation: quantités,insultes, exclamations. Paris:
Seuil.
MORAL-LEDESMA, B. (2000). Sexe des femmes, sexe des soeurs :
les organes génitaux féminin s à Chuuk (Micronésie)
. Journal de la Société des océanistes, 110,
49-63.
MORRIS, C. (1971). Writtings on the General Theory of
Signs. Paris: Mouton. MUSIL, R. d. (1982). L'homme sans
qualités. Paris: Seuil.
157
PARIENTE, J.-C. (1982). "Le nom propre et la prédication
dans les langues naturelles". Langages, 66, 37-65.
PEIRCE, C. S. (1979). Ecrits sur le signe. (G.
DELEDALLE, Trad.) Paris: Seuil. QUINE, W. V. (1993). La poursuite de la
vérité. Paris: Seuil.
RIFFATERRE, M. (1979). La Production du texte. Paris:
Seuil.
RIMBAUD, A. (1984). Poésies. Paris: Librairie
Générale Française. ROGER, A. (1987). Vulva, Vultus,
Phallus. Communications, 46, 181-198. SARTRE, J.-P. (1998). La
responsabilité de l'écrivain. Paris: Verdier. SAUSSURE, d.
F. (1982). Cours de Linguistique Générale. Paris:
Payot.
SAVAN, D. (1980). "La séméiotique de Charles
Sanders Peirce". Dans F. PERALDI, Au-delà de la
sémiolinguistique, La sémiotique de C.S. Peirce (Peraldi,
Trad., Vol. 58, pp. 9-27). Paris: Larousse.
SIAU, S.-c. (1990). Nu-se "femme-couleur: comportements corporels
à partir des formes. Cahiers de linguistique - Asie orientale Vol.
19, n°2, pp. 253-266.
STENDHAL. (1839). La Chartreuse de Parme. Paris:
Flammarion.
TESNIÈRE, L. ( [1959] 1982). Eléments de
syntaxe structurale. Paris: Klincksieck.
TODOROV, T. ([1977] 1991). Théories du symbole.
Paris: Seuil.
TODOROV, T. (1970). "Synecdoques", dans Recherches
rhétoriques, Communications,16. Paris: Seuil.
VICTORRI, B. (2002). Homo narrans: le Rôle de la narration
dans l'émergence du langage". Langages, 146, pp. 112-125.
Récupéré sur
http://www.lattice.cnrs.fr/.
WHORF, B. L. (1980). "Les noms de quantité en
Européen commun et en Hopi". Dans R. Alain, La Lexicologie (pp.
179 - 181). Paris: Klincksieck.
WITTGENSTEIN, L. J. (1961). Tractatus logico-pholosophicus.
Paris: Gallimard.
158
11. LA SÉDUCTION RÉSUMÉ
Parler de la séduction revient à opposer le
monde du travail et le monde du jeu. Dans le monde du travail, l'effort est
transitif ; c'est donc le monde profane de la production. Dans le monde du jeu,
il n'est plus question de produire, mais de jouir. C'est ainsi que le monde du
jeu est celui de la sacralité par laquelle l'homme s'arrache de sa
condition d'humain pour renouer avec la transcendance verticale. Dès
lors le ressort de la séduction est de nous détourner du monde du
travail pour nous abîmer dans le mode du jeu. C'est ce que nous tentons
de démontrer dans cette analyse du mythe de la Genèse.
Mots clés : séduction ; production ;
complétude ; manque ; intransitivité ; transitivité ;
profane ; sacré.
ABSTRACT
Talk about seduction means to opposite to the world of work
and the world of the game. In the world of work, the effort is transitive;
Therefore, the profane world of production. In the world of the game, there is
no longer question of produce, but to enjoy. Therefore, the game world is that
of the sacredness which man pulls out his human condition to reconnect with
vertical transcendence. Therefore the spring of seduction is to divert us from
the world of work to damage us in the mode of the game. This is what we are
trying to demonstrate in this analysis of the myth of Genesis.
Key words: seduction, production, completeness, lack,
intransitivity, transitivity, profane, sacred,
En se référant à l'oeuvre de Jean
BAUDRILLARD, il paraît que la séduction revient à produire
un signe, mais un signe vide. Si cette question est reprise en pragmatique, il
s'agit de voir dans quelles conditions s'opère cette vacuité et
en quoi consiste dans ce cas l'opérativité de la
séduction.
Lorsque l'on dit que la séduction n'est pas dans
l'ordre de la loi mais dans l'ordre de la règle c'est parce qu'elle a
pour but non pas de transcender une motivation secrète d'organisation du
social, mais elle a pour but de jouer sur la règle qui ne connaît
que son arbitraire. C'est ainsi que BAUDRILLARD oppose loi et règle :
« La règle joue sur un enchaînement immanent de signes
arbitraires, alors que la loi se fonde sur un enchaînement transcendant
de signes nécessaires » (BAUDRILLARD, 1979, p. 182)
Pour illustrer cet arbitraire absolu de la règle, il
n'est que de penser à la règle du jeu d'échec ou du
football. Dans le jeu d'échec, il y a des règles de
déplacement des pièces qui n'ont aucune motivation que le but
poursuivi par le jeu : faire échec et mat au roi en fonction de ces
règles. Pareillement, dans le football, l'objectif est de marquer des
buts, non pas selon le moyen le plus efficace mais en appliquant des
règles. Mais faire échec au roi ou marquer
159
des buts n'a de sens qu'en vertu des règles arbitraires
qui les promeuvent à l'existence. Autrement dit, nous avons des
réalités qui ne peuvent exister que par l'appareillage
linguistique qui les définissent. C'est ce que l'on appelle en
pragmatique semel-natif ou suis generis, une qualité
que l'on attribue aux actes de langage.
C'est ainsi que l'observation des énoncés permet
de conclure que leur énonciation vaut pour une « affirmation
», une « requête », une « objection », une
« déclaration », un « compliment », une «
approbation », une « réfutation », etc. ; une «
séduction ». Cette performativité
généralisée est notée par SEARLE sous la formule
F(x) qui résume le fait qu'à tout énoncé « x
» est attachée une fonction F qui montre la force illocutoire de
l'énonciation de « x ». (SEARLE, [1972] 1996, p. 54 et
passim). Par exemple, l'énoncé la terre est ronde a pour force
illocutoire une affirmation ; ou encore autre chose selon un contexte plus
large. En d'autres termes, cet énoncé accomplit une affirmation,
c'est cela sa performativité.
L'arbitraire réside dans le fait qu'il existe, au sein
d'une même langue, une infinité de moyens, pour accomplir une
affirmation. Le point commun de tous ces moyens est qu'ils imposent au
destinataire de la communication une croyance à la vérité
de ce qui est dit. Des moyens qui sont définis par l'arbitraire de cette
langue.
Il est donc permis de comprendre que la séduction joue
sur l'arbitraire que la femme produit par détournement de l'utilitaire
dans le domaine du jeu. C'est de cette manière que la femme se pose en
objet de valeur qui provoque un manque chez le sujet de quête qu'est
l'homme. En effet, ce qui fait la différence entre le jeu et le travail,
c'est que ce dernier a un but extérieur à lui. Dès lors,
qu'importe la manière de travailler, l'important c'est ce but externe.
En revanche dans le jeu, il n'y a d'autre but que le jeu, le plaisir de jouer
quel que soit l'enjeu de ce jeu. C'est en cela que le jeu est séduisant
parce qu'il est intransitif : il ne vaut que par la règle arbitraire du
jeu.
La séduction féminine provient de l'attrait de
l'interdit, tout d'abord le corps est fait pour le travail pour en jouir des
résultats ; mais le corps de la femme a en plus cette faculté de
nous détourner du monde du travail pour nous abîmer dans le monde
de la jouissance, c'est cela la première forme de totalité
interdite. Ensuite, ce monde de la jouissance immédiate est aussi celui
des oeuvres d'art qui se définissent par leur complétude. Mais
comment caractériser la complétude ?
On peut caractériser la complétude comme quelque
chose qui ne connaît pas le manque. Sur ce plan, nous savons que la
logique narrative fait naître le récit à partir d'un manque
et a pour but de le liquider. Autrement dit, la complétude a pour
mission de nouer les deux contraires ou les deux oppositions. Pour reprendre un
récit exemplaire qui a donné naissance à la théorie
sémantique, reprenons le conte populaire russe où l'annonce par
le roi du rapt de la princesse engage le processus qui va la ramener au palais.
Mais antérieurement à cet algorithme narratif, nous avons une
présentation assez convaincante de la complétude chez ARISTOTE
:
160
« La limite fixée à l'étendue en
considération des concours dramatiques et de la faculté de
perception des spectateurs ne relève pas de l'art ; car s'il fallait
présenter cent tragédies, on mesurerait le temps à la
clepsydre, comme on l'a fait dit-on quelque fois. Par contre la limite conforme
à la nature même de la chose est celle-ci : plus la fable a
d'étendue, pourvu qu'on en puisse saisir l'ensemble, plus elle a la
beauté que donne l'ampleur, et, pour établir une règle
générale, disons que l'étendue qui permet à une
suite d'événements, qui se succèdent suivant la
vraisemblance ou la nécessité, de faire passer le héros de
l'infortune au bonheur ou du bonheur à l'infortune, constitue une limite
suffisante. » (1451a) (ARISTOTE, Poétique, 1985, p. 41)
De ce point de vue, et pour prendre un raccourci, disons que
cette temporalité close de la narrativité qui donne aux choses sa
complétude. Autrement dit, la complétude du côté
féminin provient du fait que son corps affiche la totalité en
parcourant la distance qui sépare et noue en même temps le travail
et l'érotisme. PLATON définit l'érotisme à partir
de la notion de manque par son origine parentale, son père est
l'abondance (Poros) et sa mère est la pénurie (Penia) ou la
pauvreté. (PLATON, 2011). Ce qui veut dire encore que l'érotisme
prend naissance à partir d'un manque pour parvenir à l'abondance,
c'est-à-dire, atteindre la totalité interdite.
Dès lors, il faut comprendre que la totalité
interdite est aussi celle du noeud qui noue et sépare en même
temps la pauvreté et l'abondance. En considérant maintenant que
l'érotisme concerne les êtres sexués, notamment les
êtres humains, cette dernière remarque nous amène vers un
mythe qui relève de la littérature universelle : le mythe de la
faute originelle.
Pour guider notre lecture de ce mythe, présentons
d'abord l'algorithme narratif qui va permettre son intelligibilité :
« Un récit idéal commence par une
situation stable qu'une force quelconque vient perturber. Il en résulte
un état de déséquilibre ; par l'action d'une force
dirigée en sens inverse, l'équilibre est rétabli ; le
second équilibre est semblable au premier mais les deux ne sont jamais
identiques. » (TODOROV, Poétique de la prose, Choix, suivi de
nouvelles recherches sur le récit, 1971-1978, p. 50)
Cet algorithme est d'une très grande
généralité, il est même à l'origine du
passage du protolangage (caractéristique de la plupart des
mammifères supérieurs) vers le langage pour l'espèce
humaine et définit du même coup cette humanité. C'est ce
que souligne Bernard VICTORRI en ces termes :
« Notre thèse peut alors se résumer de
la manière suivante. Pour échapper aux crises récurrentes
qui déréglaient l'organisation sociale, nos ancêtres ont
inventé un mode inédit d'expression au sein du groupe : la
narration. C'est en évoquant par la parole les crises passées
qu'ils ont réussi à empêcher qu'elles se renouvellent. Le
langage humain s'est forgé progressivement au cours de ce processus,
pour répondre aux besoins nouveaux créés par la fonction
narrative, et son premier usage a consisté à établir les
lois fondatrices qui régissent l'organisation sociale de tous les
groupes humains. » (VICTORRI, 2002)
161
C'est à ce double titre de l'algorithme narratif,
à la fois une grille de lecture et acte de langage, que nous allons
entamer la lecture de la Genèse dans sa composante de la faute
originelle.
La situation stable initiale est sous le signe de l'abondance
: toute la nature du jardin d'Eden est à la disposition du premier
couple. Ensuite, la force qui vient perturber cet équilibre est la
transgression de l'interdit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Quelle sera donc la force dirigée en sens inverse pour rétablir
l'équilibre ?
En effet, il faut se rendre compte que le
déséquilibre provoqué par cette transgression est une
modification de la propriété de la terre. Si avant elle donnait
l'abondance au premier couple, maintenant, elle est devenue ingrate. En
conséquence, la force dirigée en sens inverse pour
l'équilibre est la condamnation de l'homme au travail.
Tout se passe donc comme si cette logique narrative ne
concernait pas la femme. Le seul élément de réponse dont
nous disposons est la nature de la punition de la femme : tu enfanteras dans la
douleur. Alors, nous ne pouvons que conclure à une structure de
récits emboîtés l'un sur l'autre. Nous proposons de la
sorte que le premier récit, celui qui enchâsse le second, est
celui de l'homme condamné au travail pour retrouver l'équilibre
initial, avec cette spécification que les deux équilibres ne sont
pas identiques mais seulement semblables.
Qu'en est-il donc du récit enchâssé ?
Nous constatons qu'à l'initial du récit, l'homme
et la femme bénéficient pareillement de l'abondance de la nature,
mais ils n'ont pas le même statut. Disons que dans ce rapport l'homme est
l'élément neutre, non marqué et la femme le terme
marqué de l'opposition. Ce qui justifie cette distribution est une
spécification de la femme. Elle ne fut pas créée pour
elle-même mais pour être la compagne d'Adam :
« L'homme donna donc un nom aux animaux domestiques,
aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas l'aide qui est
capable d'être son partenaire. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme
dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et referma la chair
à sa place. Avec cette côte le Seigneur fit une femme et le
conduisit à l'homme. En la voyant celui-ci s'écria : « Ah !
Cette fois voici un autre moi-même, qui tient de moi par toutes les
fibres de son corps. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son
compagnon qu'elle fut tirée. » » (Bible, Genèse, 1982,
pp. 2, 20-23)
Rappelons qu'en linguistique, il faut entendre par terme non
marqué, le terme qui ne présente pas de particularité et,
par terme marqué, celui qui est compris par dérivation du
premier. C'est ce que résume l'expression « autre moi-même
» dans le passage ci-dessus. Ce qui nous permet de dire que l'histoire du
terme marqué est incluse dans celle du non marqué.
En reprenant l'algorithme narratif, l'indice qui va rendre
possible la reconstitution du récit de la femme, le récit
enchâssé, est la nature de sa punition. On peut en toute logique
admettre que les deux ont transgressé le même interdit, mais pas
de la même manière parce que les punitions ne sont pas
identiques.
162
Selon l'algorithme narratif, une force dirigée en sens
inverse rétablit l'équilibre, mais l'équilibre final n'est
jamais identique à l'équilibre initial mais lui est seulement
semblable. Autrement dit, si la punition de la femme est d'enfanter dans la
douleur, c'est que logiquement sa faute est relative à cette punition.
On peut comprendre qu'avant la faute, la situation est telle que la femme jouit
de la même manière de la prodigalité de la nature dans le
jardin d'Éden. Ce qui signifie qu'ils sont à l'abri des besoins
matériels avant la faute à cause de la bienveillance que leur
accorde leur Dieu.
Suite à la transgression de l'interdit, cette
prodigalité de la nature cessa et l'homme est obligé de
travailler pour vivre. La femme n'a pas subie la même condamnation parce
que le rôle que Dieu lui a assigné est d'être la compagne de
l'homme. C'est-à-dire que l'homme se trouve dans une situation de manque
et que c'est la femme qui, selon la logique narrative, doit combler ce
manque.
Dans cette fonction de la femme nous retrouvons une partie de
la propriété d'Éros : la pénurie, mais cette
pénurie est du côté de l'homme et non de la femme.
Symétriquement, nous savons que l'autre partie qui donne à
Éros son unité est l'abondance qu'il recevait de son père,
cette abondance est donc du côté de la femme. Une abondance que
confirme depuis toujours et actuellement le morcellement métonymique
infini du corps de la femme dans un genre discursif précis : le blason
du corps féminin. Ce qui veut dire très clairement que la faute
de la femme est de s'être constituée en corps érotique pour
l'homme comme le souligne cette réflexion de Bataille : « La
« figure attrayante de l'érotisme » est la même pour les
hommes que pour les femmes, c'est la « nudité féminine
» » (LEMELIN J. M., 1996)
C'est ce qui explique la nature de la punition de la femme. On
peut accepter qu'en général et en moyenne, l'érotisme
aboutisse à l'acte sexuel et que la conséquence de cet acte est
l'enfantement. Autrement dit, la femme est punie ce par quoi elle a
pêché.
En résumé, le parcours général des
récits thématise l'érotisme ou la séduction. Mais
l'homme et la femme dans ce parcours ont un itinéraire
symétriquement inverse. Si l'homme part du manque vers sa liquidation,
la femme caractérisée par son abondance érotique se donne
à l'homme.
Pour continuer, embrayons maintenant vers la pragmatique pour
confirmer cette hypothèse que la séduction féminine a pour
base l'érotisme qui ajoute à la fonction mécanique du
corps sa plastique comme forme de beauté qui s'élève en
objet de quête. En définitive, si la virilité masculine
assigne à l'homme le travail, en revanche la féminité
désigne la femme à la convoitise par instauration d'un manque du
côté de l'homme. La première remarque qui s'impose à
l'observation est que la beauté est quelque chose d'indicible. C'est
cette propriété qui justifie l'intervention de la pragmatique
dans ce travail. Reprenons les choses en ce qui nous intéresse.
Dans un premier temps, la thèse la plus admise en
matière de science des signes est la transparence de ces derniers. Tout
se passe comme si la fonction du signe était seulement de
163
désigner son référent. C'est une
thèse qui consiste à faire du langage une tautologie du
réel. C'est la position générale qui se situe dans le
sillage de SAUSSURE.
La première brèche à cet édifice
saussurien est la découverte de la relativité linguistique
au-delà du concept de l'arbitraire du signe. La thèse de
l'arbitraire du signe peut se résumer en ceci : le même
référent est désigné par des signifiants divers
selon les langues. L'inconvénient majeur de cette thèse est de
nous faire croire que les signes linguistiques ne sont que des
étiquettes que l'on attache à des référents. La
relativité linguistique connue sous le nom de thèse Sapir-Whorf,
noms des linguistes qui ont procédé à sa mise à
jour, stipule que le même référent est
désigné par des signifiants numériquement
différents entre les langues ou, au sein d'une même langue,
numériquement différent selon la communauté. Ainsi, dans
la langue malgache, la communauté d'éleveurs à plus d'une
centaine de lexique pour désigner la robe d'un zébu, en fonction
de la forme de l'animal, de la couleur de sa robe, des interdits relatifs
à ces animaux, etc. alors que pour le citadin, un zébu est noir,
blanc, ou rouge. C'est à-dire monochromatique.
Bien que GREIMAS ne fasse pas de lien entre la
relativité linguistique et sa position en ce qui concerne la
théorie des référents, nous croyons que l'expression la
plus aboutie de cette relativité linguistique est consignée dans
la remarque selon lequel le monde extralinguistique n'est pas un
référent ultime :
« Il suffit pour cela de considérer le monde
extralinguistique non plus comme un référent « absolu »
; mais comme le lieu de la manifestation du sensible, susceptible de devenir la
manifestation du sens humain, c'est-à-dire de la signification pour
l'homme, de traiter en somme le référent comme un ensemble de
systèmes sémiotiques plus ou moins explicites ». (GREIMAS,
1970, p. 52)
Ce qui veut dire que le mouvement de la
référence ne s'arrête jamais au réel mais le
traverse pour embrayer dans la relation intersubjective que l'on appelle acte
de langage dans un système de renvois à l'infini comme le
précise la théorie des interprétants chez PEIRCE :
« Un signe ou representamen est un premier qui
entretient avec un second appelé son objet, une relation triadique si
authentique qu'elle peut déterminer un troisième, appelé
son interprétant, à entretenir avec son objet la même
relation triadique qu'il entretient lui-même avec ce même objet.
[...] Le troisième doit certes entretenir cette relation et pouvoir par
conséquent déterminer son propre troisième. [...] Tout
ceci doit être vrai des troisièmes du troisième et ainsi de
suite indéfiniment ; [...] » (PEIRCE C. S., 1979, p. 147)
Pour rester dans le registre de notre exemple relatif à
la relativité linguistique, parlons d'un zébu appelé
« volavita » à cause de sa robe pie noire. Ce type de
zébu est l'animal par excellence chez les Malgaches pour faire des
offrandes à Dieu afin de lui demander d'accorder sa bienveillance aux
hommes. On comprend alors que le signifiant (representamen dans le vocabulaire
de PEIRCE) renvoie à l'animal par l'intermédiaire de cette
cérémonie d'offrande (interprétant) qui implique toute la
vie sociale des Malgaches sous la perspective des transcendances verticale et
horizontale. Il est évident qu'il est vain d'énumérer les
éléments de cette vie sociale en tant qu'interprétants
parce qu'ils sont infinis.
164
De ces remarques, nous en concluons que les signes
linguistiques ne se contentent pas de désigner leur
référent, mais ils montrent quelque chose de leur locuteur. Nous
retrouvons alors la définition de la pragmatique. Rappelons pour
mémoire que l'étude du rapport des signes entre eux s'appelle la
syntaxe, le rapport des signes avec l'univers sémantique relève
de la sémantique et quand on étudie le rapport des signes
à leur locuteur, on fait de la pragmatique.
Il est devenu courant, depuis la performativité
généralisée de dire que l'acte de langage ne fait pas
l'objet d'une mention mais il est seulement montré : «
Interpréter un énoncé, c'est y lire une description de son
énonciation. Autrement dit, le sens d'un énoncé est une
certaine image de son énonciation, image qui n'est pas l'objet d'un acte
d'assertion, d'affirmation, mais qui est, selon l'expression des philosophes
anglais du langage, «montrée» : l'énoncé est vu
comme attestant que son énonciation a tel ou tel caractère (au
sens où un geste expressif, une mimique, sont compris comme montrant,
attestant que leur auteur éprouve telle ou telle émotion) ».
(DUCROT, 1981, p. 30)
Pour illustrer, nous allons prendre un exemple, si quelqu'un
nous dit : La terre est ronde ; on conclut que l'acte de langage qui
s'accomplit dans cette énonciation est une affirmation. En effet, la
reconstruction du préfixe performatif dans le sens de cette
énonciation permet de mettre cela en évidence : J'affirme que
la terre est ronde.
Il suffit d'ajouter que ce n'est pas uniquement la production
de signe linguistique qui permet d'accomplir un acte de langage pour permettre
à la séduction d'être traitée par la pragmatique.
D'autres sémiotiques, en effet, peuvent aussi y subvenir comme le montre
l'exemple suivant.
Quand pour faire croire, aux éventuels cambrioleurs,
une présence dans la maison ; le résident peut laisser les
lumières et le poste téléviseur allumés.
Dans cette perspective, il n'est pas inutile de rappeler que
toutes sémiotiques ne peuvent être intelligibles que par la prise
en charge de moyen linguistique, il en est ainsi particulièrement des
signes indiciels comme les empreintes laissées sur les berges du Nil,
lors de la décrue, ont permis jadis, aux Égyptiens, de
créer les hiéroglyphes.
Nous sommes loin de la position de SAUSSURE pour qui la
sémiologie est l'étude de la vie des signes au sein du social et
la linguistique n'en n'est qu'un territoire (SAUSSURE, [1972] 1982, p. 33).
À juste titre, BENVENISTE rétorque à cette affirmation que
la linguistique est le modèle de toute sémiotique :
« Les rites symboliques, les formes de politesse
sont-ils des systèmes autonomes ? Peut-on vraiment les mettre au
même plan que la langue ? Ils ne se tiennent dans une sémiologique
que par l'intermédiaire d'un discours : le « mythe », qui
accompagne le « rite » ; le « protocole » qui règle
les formes de politesse. Ces signes, pour naître et s'établir
comme système, supposent la langue, qui les produit et les
interprète. » (BENVENISTE, [1974] 1981, p. 50)
165
Cette dernière remarque nous permet de poser de
manière désambigüisée la sémiotique de la
séduction à partir d'une prise en charge de la langue. Pour
autant, il faut reconnaître que la séduction est avant tout un
code visuel qui se base sur le corps féminin comme signe produit par la
femme (en fonction d'une proxémique et de l'habillement).
Une relecture des travaux de GREIMAS confirme cette position
hiérarchiquement supérieure de la langue par rapport aux autres
sémiotiques. En outre la formulation pose clairement que le langage est
un instrument d'appropriation et de modélisation de la
réalité comme nous allons tenter de le faire dans cette question
de la séduction :
« La perspective greimassienne sur la cognition
permet de postuler que le mode narratif traite des informations sensorielles et
les organise en structures narratives par l'entremise d'un « parcours
génératif ». Ce mode constitue un trait fondamental de
l'esprit et peut être considéré comme une extension de
l'expérience sensorielle dans le domaine de la pensée abstraite
» (DANESI & PERRON, 1996, p. 153)
C'est ce parcours génératif narrativisé
que nous allons essayer de reconstruire dans ce travail afin de préciser
au-delà de son intuition la notion d'apparence chez BAUDRILLARD. En
effet, la réflexion de cet auteur semble tendre à nous faire
comprendre que la séduction s'appuie sur la surface comme si la pure
apparence est un signifiant sans signifié, ou selon son expression
« un signe vide » :
« Qu'est-ce qui séduit dans le chant des
Sirènes, dans la beauté d'un visage, dans la profondeur d'un
gouffre, dans l'imminence de la catastrophe, comme dans le parfum de la
panthère ou dans la porte qui s'ouvre sur le vide? Une force
d'attraction cachée, la puissance d'un désir? Termes vides. Non:
la résiliation des signes, la résiliation de leur sens, la pure
apparence. Les yeux qui séduisent n'ont pas de sens, ils
s'épuisent dans le regard. Le visage maquillé s'épuise
dans son apparence, dans la rigueur formelle d'un travail insensé.
Surtout pas un désir signifié, mais la beauté d'un
artifice. » (BAUDRILLARD, 1979, p. 107)
C'est ici qu'il nous faut recourir aux armes de la pragmatique
pour mieux comprendre ce que c'est la résiliation des sens.
À force d'avoir voulu avec SAUSSURE déduire le
signe de la combinaison d'un signifiant et d'un signifié, et le signe
ainsi obtenu sert à désigner un objet du monde, on oublie trop
souvent qu'il existe une sémiotique des objets naturels dont le propre
est résumé par LAFONT en ces termes :
« L'hominisation de l'espèce commence lorsque
l'individu se sert d'un objet pour en modifier un autre en vue d'une action que
ce second assume: lorsque le chasseur modifie la forme d'un caillou pour en
faire une arme contre un gibier éventuel. Éventuel: il faut bien,
dans l'opération de fabrication d'un instrument, qu'un troisième
objet soit absent et remplacé par son image. La "certitude sensible"
nécessaire au travail est prise en charge par la représentation.
Un langage qui relaie le geste déictique est là pour
épouser le mouvement de naissance de l'activité
sémiotique. Le sens surgit. C'est ce sens que nous lisons quand nous
interprétons comme instrument la modification non accidentelle d'un
silex: le signe d'une activité qui opère dans l'absence de son
objet. » (LAFONT, 1978, p. 19)
166
Si donc, il est accepté que le support de la
séduction est le corps féminin, il s'agit bien d'une
sémiotique du monde naturel, avec cette différence près
que le corps de la femme, avec ou sans artifice, diffère
éternellement du corps masculin par sa possibilité de
résilier le travail (et/ou la guerre) de par sa fragilité ;
dès lors, force est de chercher à quoi peut servir un corps qui
n'est pas doué pour le travail. C'est ainsi que l'on s'aperçoit
que ce corps résilie le sens (du travail) au profit de l'exhibition de
la même manière qu'un bijou résilie le sens en tant que
produit pour assumer la fonction de parure.
Pour s'exprimer sans artifice, on peut dire que si les jambes
d'un homme se définissent par sa puissance motrice en vue du travail,
par contre celle d'une femme se définit par l'exhibition. C'est la
raison pour laquelle, le corps de la femme, dans certains pays du monde doit
être caché dans des vêtements spécifiques
institutionnalisés. C'est ce que nous appelons dans ce travail
l'intransitivité d'une forme. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une
forme dont l'utilité pratique n'est pas dans le travail qu'elle permet
d'accomplir mais dans la jouissance qu'elle suscite pour elle-même. C'est
cela l'intransitivité, une forme qui ne relève pas de l'ordre de
la production mais de l'ordre du jeu avec ses règles rituelles qui
relèvent de l'arbitraire.
Roman JAKOBSON définit la fonction poétique par
cette intransitivité ou plus précisément par cette
réflexivité de la forme sur elle-même : « La
visée (Einstellung) du message en tant que tel, l'accent mis sur le
message pour son propre compte est ce qui caractérise la fonction
poétique. » (JAKOBSON, 1981, p. 218)
C'est ce que nous dit avec son propre style TODOROV dans le
passage suivant :
« Il en est ici du discours comme de la marche. La
marche habituelle a son but en dehors d'elle-même, elle est un pur moyen
pour parvenir à un but, et elle tend incessamment vers ce but, sans
tenir compte de la régularité ou de l'irrégularité
des pas séparés. Mais la passion, par exemple, la joie
sautillante, renvoie la marche en elle-même, et les pas
séparés ne se distinguent plus entre eux par ceci que chacun
rapproche davantage vers un but ; ils sont tous égaux, la marche n'est
plus dirigée vers un but, mais a lieu plutôt pour elle-même.
Comme de la sorte les pas séparés ont acquis une importance
égale, l'envie devient irrésistible, de mesurer et de subdiviser
ce qui est devenu identique de nature, de la sorte est née la danse
» (TODOROV, [1977] 1991, p. 191)
C'est cela l'érotisme, une attraction de la forme
féminine qui nous plonge dans l'univers du jeu rituel par opposition au
travail qui vise la production. Autrement dit, la séduction
relève de la consommation et non de la production, donc de la
dilapidation du fruit du travail comme en témoigne la parure des femmes.
Ce qui veut dire en définitive que fonction poétique et
séduction sont une seule et même chose. Prenons le match de foot
pour un exemple plus explicite. Le match de foot n'est pas une production mais
un jeu, avec tout l'arbitraire des règles du jeu, mais on dirait que
c'est toute la planète entière qui investit dans ce jeu mais dont
les spectateurs ne sont motivés que par la passion du jeu pour le jeu
pour laquelle ils sont prêts à tous les sacrifices, surtout
financiers.
167
Nous voyons maintenant comment le mythe de la genèse a
pour matrice sémantique l'interdit qui désigne à la
convoitise l'objet de l'interdit. En effet, la punition d'Adam est une
promulgation d'une loi selon laquelle il faut travailler pour vivre alors que
la punition d'Ève est une attestation du jeu comme transgression de
cette loi.
Maintenant la question qui va nous guider peut se
résumer en ceci : comment Ève opère-t-elle la
transgression de cet interdit ?
Nous savons que l'essence de la pragmatique est l'acte de
langage et que cet acte se mesure dans un rapport interlocutif, alors pour
répondre à cette question, nous allons émettre
l'hypothèse suivante qui fait la force de la pragmatique : toute
production d'énoncé a pour but de modifier un rapport
intersubjectif suivant en cela Jean-Claude ANSCOMBRE qui nous apprend qu'il
existe : « Un principe conversationnel général qui est
que l'on ne parle pas pour ne rien dire ni pour ne rien faire. »
(ANSCOMBRE, 1980, p. 87)
Ce qui veut dire que nous pouvons analyser dès le
départ l'interdiction du récit de la Genèse qui porte sur
l'arbre de la connaissance du bien et du mal à travers l'implicite dont
voici l'approche de DUCROT : « Le problème
général de l'implicite, [tel qu'il a été
présenté dans les premières pages], est de savoir comment
on peut dire quelque chose sans accepter pour autant la responsabilité
de l'avoir dit, ce qui revient à bénéficier à la
fois de l'efficacité de la parole et de l'innocence du silence.
» (DUCROT, 1972, p. 12)
L'objet de l'interdit est nommé « arbre de la
connaissance du bien et du mal ». À cette époque de
l'interdiction, l'homme ne travaillait pas, il vivait de la
générosité de la nature : il consommait du fruit des
arbres du Jardin d'Éden, mais déjà, il lui était
interdit de manger le fruit de l'arbre qui se trouve au centre du jardin. Le
texte se refuse à nommer autrement cet arbre. Cependant, il nous donne
des indices qui permettent d'identifier cet arbre. C'est cela la loi de
l'implicite, impliquer dans le discours une énigme à
résoudre de telle manière qu'il y a adhésion à
l'énonciation à la découverte de la solution. La raison de
ce langage énigmatique est qu'il y a des choses que l'on ne peut pas
dire mais seulement montrer.
Dans un article original, BENVENISTE nous montre le
fonctionnement du tabou linguistique. Certains mots de la langue sont interdits
de prononciation afin de préserver la face des locuteurs. (BENVENISTE,
[1974] 1981) Notons tout de suite qu'il n'y a pas d'interdit absolu. Tout
interdit appelle sa transgression. Parmi les interdits linguistiques les plus
forts se trouve le champ lexical du sexe, il s'agit là d'un interdit
universel. Nous pouvons résumer ces tabous linguistiques par la notion
de censure et postulation, ce que la censure interdit, elle la postule en
même temps.
Ce qui nous permet d'affirmer que le texte de la Genèse
est une censure et postulation du sexe féminin, la subtilité du
texte de la Genèse consiste éviter à parler du sexe tout
en le laissant entendre selon une logique implacable.
Tout d'abord, au moment où il n'y avait qu'Adam seul,
le concept de sexe ne peut pas exister pour la simple raison qu'il n'y a pas de
fonctionnement sexuel. Par ailleurs, il faut
168
admettre avec DERRIDA que les choses n'existent pas en soi
mais par la trace des autres en lui :
« Il s'agit de produire un nouveau concept
d'écriture. On peut l'appeler gramme ou
différance. Le jeu des différences suppose en
effet des synthèses et des renvois qui interdisent qu'à aucun
moment, en aucun cas, un élément simple soit présent en
lui-même et ne renvoie qu'à lui-même. Que ce soit dans
l'ordre du discours parlé ou du discours écrit, aucun
élément ne peut fonctionner comme signe sans renvoyer à un
autre élément qui lui-même n'est pas présent. Cet
enchaînement fait que chaque "élément " - phonème ou
graphème - se constitue à partir de la trace en lui des autres
éléments de la chaîne ou du système. Cet
enchaînement, ce tissu, est le texte qui ne se produit que dans la
transformation d'un autre texte » (DERRIDA, [1972] 1982, p. 37).
En tenant compte que les mythes ont pour mission de nous
raconter comment les choses se sont passées pour la toute
première fois, nous pouvons dire que sous l'isotopie sylvestre se cache
une isotopie sexuelle. En effet, ce texte est une révélation du
sexe. Pour preuve, le premier couple humain s'est aperçu de sa
nudité après la consommation du fruit de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal.
Mais le sexe ne se serait jamais révélé
sans la création d'Ève. C'est le sens de l'exclamation « Ah
! Cette fois, voilà un autre moi-même », l'autre
moi-même est un être à la fois identique et
différent, et la différence est de nature sexuelle. C'est pour
cette raison du mythe qu'il n'y a qu'un seul sexe comme le précise le
passage suivant : « On peut faire l'hypothèse que le
féminin est le seul sexe, et que le masculin n'existe que par un effort
surhumain pour en sortir. Un instant de distraction, et on retombe dans le
féminin. Il y aurait un privilège définitif du
féminin, un handicap définitif du masculin. »
(BAUDRILLARD, 1979, p. 30)
En outre, il faut constater que le fruit défendu
était apparu pour la première fois à Ève par la
médiation du serpent, mais en tenant compte de la disproportion des
punitions de la transgression, on s'aperçoit très vite que
l'arbre au fruit défendu n'est qu'une métaphore de la femme qui
est le véritable sexe. Ce qui est défendu, c'est le sexe
féminin, on comprend alors pourquoi la punition de la femme est
d'enfanter dans la douleur.
Par contre l'homme qui a le droit de manger le fruit de tous
les arbres du jardin sauf justement le fruit de l'arbre-femme est
condamné à la production parce que chez lui, la transgression est
un choix délibéré entre le fruit de la production et le
fruit de la passion séduction que lui a offert Ève. Dès
lors nous retrouvons littéralement une isotopie de l'interdit de la
totalité.
Pour Adam, l'interdit de la totalité est celui qui
l'empêche de manger le fruit de l'arbre-arbre et le fruit de
l'arbre-femme. Pour Ève, l'interdit de la totalité est
d'être à la fois un corps physique pour la production et en
même temps être un corps sexuel pour la consommation
Pour le sexe, d'une manière générale,
l'interdit de la totalité est de savoir qu'il s'agit en même temps
d'un organe pour le fonctionnement métabolique et en même temps
pour le
169
fonctionnement érotique. Pour le corps féminin,
les artifices de la beauté dans la parure sont en même temps une
censure et une postulation du corps féminin.
Enfin, l'interdit de la totalité est aussi cette fusion
du masculin et du féminin dans la passion amoureuse.
Pour terminer, il n'est que de constater cette
singulière coïncidence entre les textes de la Bible qui fait de la
femme un être pour l'homme et de la remarque suivante de BAUDRILLARD :
« Ce qui séduit n'est pas tel ou tel tour féminin, mais
bien que c'est pour vous. » (1979, p. 96).
C'est ce qui nous ramène vers KANT en ce que la
beauté d'une femme et d'un bijou sont une seule et même chose :
« Or, dit Kant, si juger une chose belle est
indépendant de la détermination de sa fin éventuelle, de
son utilité, du besoin physique ou moral auquel elle répond,
alors sa forme, dans un tel jugement, est appréhendée sans
considération d'une fin. [...]. La finalité sans fin, c'est la
manière dont une chose nous apparaît, sans référence
à une fonction ou à un modèle général, comme
ayant une unité propre, tout à fait singulière : ce que la
tradition la plus ancienne exprime par la notion d'harmonie. » (KANT,
2009).
C'est ce qu'illustre littéralement l'adjectif «
callipyge » qui veut dire littéralement « belles fesses
», autrement dit, une finalité sans fin. On peut dire que la
fonction de cette partie du corps est de permettre de s'asseoir, mais à
cause de sa beauté chez les femmes, elle s'inscrit également dans
le registre de la finalité sans fin, c'est-à-dire dans le
registre de la séduction. C'est cela également l'interdit de la
totalité.
Le poids de cet interdit est tel qu'il semble être un
déni de l'humanité par retour à l'animalité si bien
que même les textes qui veulent les transgresser ne peuvent le faire que
sous le couvert de l'implicite.
Travaux cités
ANSCOMBRE, J.-C. (1980). "Voulez-vous dérivez avec moi?
Communications, 32, Les actes de Discours, pp. 61- 124.
ARISTOTE. (1985). Poétique. Paris: Les Belles
Lettres. BAUDRILLARD, J. (1979). De la séduction. Paris:
éditions Galilée.
BENVENISTE, E. ([1974] 1981). La blasphémie et
l'euphémie. Dans E. BENVENISTE, Problèmes de linguistique
générale, 2 (pp. 254-257). Paris: Gallimard.
BENVENISTE, E. ([1974] 1981). Problèmes de
linguistique générale, 2. Paris: Gallimard.
Bible. (1982). Genèse. Dans Bible, Bible, Ancien et
Nouveau Testament (pp. 5-63). Paris: Société biblique
française.
170
DANESI, D., & PERRON, P. (1996). Sémiotique et
Sciences cognitives. Récupéré sur Zotero:
http://www.chass.utoronto.ca/french/as-sa/ASSA-No1/PPMD1/html
DERRIDA, J. ([1972] 1982). Positions. Paris: aux
éditions du minuit.
DUCROT, O. (1972). Dire et ne pas dire, Principes de
sémantique linguistique. Paris: Hermann. DUCROT, O. (1981).
Analyses pragmatiques. Les actes de discours, Communications 32., pp.
11-60. GREIMAS, A. J. (1970). Du sens, Essais de sémiotique,1.
Paris: Seuil. JAKOBSON, R. O. (1981). Essais de Linguistique
générale,1. Paris: Editions de minuit.
KANT. (2009, 5 29). KANT, Troisième moment, une
finalité sans fin . Récupéré sur Dacodoc:
http://www.dacodoc.fr/kant-troisieme-moment-finalite-fin-398841.html
LAFONT, R. (1978). Le travail et la langue. Paris:
Flammarion.
LEMELIN, J. M. (1996). L'expérience ou
l'évènement tragique. Consulté le août 17,
2013, sur
https://www.google.mg/#bav=on.2,or.r_qf.&fp=d6bc00e82892d683&q=lemelin+:+exp%5E%
C3%A9rience+t+%C3%A9v%C3%A9nement+tragique:
www.ucs.mun.ca/~lemelin/EVENEMENT.html
PEIRCE, C. S. (1979). Ecrits sur le signe. (G.
DELEDALLE, Trad.) Paris: Seuil.
PLATON. (2011, Septembre 21). Le Banquet de Platon.
Récupéré sur Atramenta:
http://www.atramenta.net/lire/le-banquet/35181/1#oeuvre_page
SAUSSURE, d. F. ([1972] 1982). Cours de Linguistique
Générale. Paris: Payot.
SEARLE, J. R. ([1972] 1996). Les actes de langage, Essai de
philosophie du langage. Paris: Herman , Editeurs des Sciences et des
arts.
TODOROV, T. ([1977] 1991). Théories du symbole.
Paris: Seuil.
TODOROV, T. (1971-1978). Poétique de la prose, Choix,
suivi de nouvelles recherches sur le récit. Paris: Seuil.
VICTORRI, B. (2002). Homo narrans: le Rôle de la narration
dans l'émergence du langage". Langages, 146, pp. 112-125.
Récupéré sur
http://www.lattice.cnrs.fr/.
171
12. LA DÉLOCUTIVITÉ DU SAOTSA : AGIR
PHYSIQUE DEVENU AGIR LINGUISTIQUE
RÉSUMÉ
Chez BENVENISTE, le délocutif se trouve être un
rapport de dire. ANSCOMBRE et DUCROT contestent cette définition
restrictive et voient dans le délocutif une dimension performative. Mais
le propre de la performativité est de suspendre la
référence extralinguistique au profit de la
sui-référentialité. Ce qui veut dire que la
délocutivité est une conversion d'un agir physique vers un agir
linguistique. C'est le cas précis du « saotsa » qui
désigne une offrande aux divinités et le verbe « misaotra
» qui sert à accomplir un acte de langage.
Mots clés : « saotsa », merci,
performativité, délocutif, rapport interlocutif, agir.
ABSTRACT
In BENVENISTE, the delocutive is found be a report said.
ANSCOMBRE and DUCROT challenge this restrictive definition, see the delocutive
a performativity dimension. But the hallmark of the performative is to suspend
the extralinguistic reference to the benefit of the sui-referentiality. Which
means that the delocutivite is a conversion from physical Act to a linguistic
act. This is the case of the verb 'saotsa' which means an offering to the
deities and the «misaotsa» verb which is used to perform an act of
language.
Key words: « saotsa », thanks, performativity,
delocutive, interlocutive report, acting.
Le principe fondamental de l'agir linguistique initié
par les travaux d'AUSTIN ([1962]1970) a permis à ANSCOMBRE et DUCROT de
revoir la notion de verbes délocutifs mis à jour par BENVENISTE.
La révision importante est dans l'introduction de la
performativité dans le délocutif, c'est ce qui explique le titre
de ce travail: la dérivation délocutive convertit un agir
physique en un agir linguistique qui justifie la
sui-référentialité accordée aux performatifs.
Ainsi, pour illustrer ce principe qui va être
développé et d'accroître de la sorte la lisibilité
de ce travail, nous allons soumettre à notre analyse l'exemple phare de
BENVENISTE, repris un peu partout. En filigrane de nos explications se trouve
la thèse que le langage porte la trace d'une dimension
mythico-religieuse comme le montre la première littérature que
sont les mythes et apparentés.
Les textes de BENVENISTE attestent que le verbe "saluer" est
dérivé d'un discours qui comporte le terme "salut" dans une
perspective locutionnaire ou formulaire à cause, probablement, de la
haute fréquence de ce discours dans le rapport humain ([1966] 1982, p.
277). Le fait nouveau que notre hypothèse suggère est que le
paradigme duquel dérive le délocutif est un discours qui
accompagne un rituel dont le but est d'obtenir le salut de l'homme face aux
aléas existentiels.
Ce rituel est un rapport avec les divinités. Si l'on ne
veut se référer qu'à la Bible, on peut comprendre que le
salut est une quête permanente: de Caïn et Abel à la
colère mémorable de
172
Jésus Christ dans le temple de Jérusalem, le
sacrifice en offrande est le point focal du rituel de cette quête. Mais
il est une illustration autrement explicite de ce salut non performatif:
« Jésus regarda autour de lui et vit des
riches qui déposaient leurs dons dans les troncs à offrandes du
temple. Il vit une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces de
cuivre. Il dit alors:
- Je vous le déclare, c'est la
vérité: cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car
tous les autres ont donné comme offrande de l'argent dont ils n'avaient
pas besoin; mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle avait
pour vivre » Luc (21, 1-4)
Nous devons comprendre que si cette veuve a offert tout ce
qu'elle a pour vivre c'est que le salut prend la voie du don et du contredon.
L'humain doit faire des offrandes aux Dieux en retour du don de la vie que ces
derniers accordent à l'homme. Appelons cela la dimension sacrée
du salut. Ce qui veut dire très exactement que l'expression « salut
» ou « je vous salue » est un délocutif de l'acte de
faire des offrandes à des fins de quête de salut. Autrement dit,
dire « salut » à quelqu'un, c'est proférer une parole
de bon augure pour que les dieux les entendent afin qu'ils accordent ou non
leur bienveillance qui consiste à maintenir l'homme en vie.
La première dérivation délocutive de ce
salut non performatif est constituée par son passage du sacré
vers le profane: les salutations sont données en vertu de la
transcendance horizontale qui caractérise une communauté. La
délocutivité de BENVENISTE a pour matrice cette première
dérivation, elle fait l'économie de la dimension religieuse.
Ce préliminaire va nous aider à comprendre que
le "saotsa" qui a donné le délocutif "misaotra" peut être
élevé au rang d'un universel linguistique parce qu'il a pour
traduction française "merci" qui a donné à son tour le
délocutif "remercier" ou l'autodélocutif "merci".
Commençons par observer le rapport délocutif dans la langue
française.
On sait qu'étymologiquement, le mot "merci" qui
était du féminin a pour sens "salaire", "récompense",
"solde" et que les auteurs chrétiens lui donnaient le sens de
"bienveillance", "pitié" et "grâce céleste". La
dérivation délocutive s'est fait au seul profit de la version
profane: on dit "merci" pour accomplir l'acte de remerciements sans
intervention d'un objet matériel qui soit compris comme salaire ou
solde. C'est cela le passage de l'agir physique vers l'agir linguistique, un
passage rendu célèbre dans l'éducation des enfants
à qui on demande de dire "merci" quand ils reçoivent une
faveur.
Pour les besoins de la cause nous allons nous servir de
l'exemple malgache, le mot "saotsa", à cause de la vivacité des
cérémonies d'offrande en dépit de la présence de la
religion chrétienne qui, en tant que religion allogène, n'a fait
qu'un laminage de la religion traditionnelle sans arriver à la faire
disparaître. Ce choix d'une langue qui n'appartient pas à la
famille indoeuropéenne poursuit un double but.
D'abord, il milite en faveur du caractère fondamental
de la notion de langage comme un principe d'économie. En effet, il est
démontré par LAFONT (LAFONT, 1978) que le langage
173
comporte deux seuils interdits, le langage monolithique
où un seul élément suffit à tout dire. Pourtant ce
premier seuil interdit surgit quand le locuteur est en panne de nomination et a
recours à des expressions comme machin ou chose, ou
encore dans le x du langage formel de la mathématique.
Le deuxième seuil interdit est le langage
infinitisé où à chaque événement nouveau
correspond une nouvelle expression. La transgression de cet interdit existe
aussi dans l'onomastique qui possède un fonctionnement hapax. On peut
facilement comprendre la nécessité de ces transgressions
partielles, notamment en ce qui concerne l'anthroponymie ou la toponymie. Si
l'onomastique ne fonctionne pas en hapaxologie, c'est l'orientation dans le
social qui est mise en danger par impossibilité d'identifier de
manière univoque un individu ou un lieu, ce qui veut dire une mise en
danger de l'organisation sociale.
En ce qui concerne les noms communs, c'est le principe
d'économie qui prévaut comme le souligne cette remarque de
Friedrich NIETZSCHE, établie pour dénoncer la moralisation
à partir de termes linguistiques comme ce qui justifie la
différence entre la noblesse et la plèbe :
« Tout concept naît de la comparaison de choses
qui ne sont pas équivalentes. S'il est certain qu'une feuille n'est
jamais parfaitement égale à une autre, il est tout aussi certain
que le concept de feuille se forme en laissant tomber ces différences
individuelles, en oubliant l'élément discriminant. »
(NIETZSCHE, 1873, p. 181)17
Au-delà de notre conviction personnelle, nous tenons
pour validité de ce raisonnement sa reprise chez TODOROV (1970, p. 29)
pour traiter de la question de la synecdoque et qui lui permet d'étayer
le caractère de double synecdoque de la métaphore avancé
pour le groupe de Liège (DUBOIS J. , et al., 1982), sans parler de la
défense de cette idée dans un article de DI CESARE qui milite
ouvertement pour le constructivisme en linguistique. (DI CESARE D. , 1986)
Ce principe d'économie appliqué à la
délocutivité permet de poursuivre le second but. La
délocutivité fait passer un agir physique dans l'agir
linguistique. Il s'agit donc de revoir la notion sous la perspective de
l'intertextualité de manière à attester l'idée de
la performativité comme individu linguistique au sens de BENVENISTE
comme le précise la remarque suivante:
« Or le statut de ces « individus linguistiques
» tient au fait qu'ils naissent d'une énonciation, qu'ils sont
produits par cet événement individuel et, si l'on peut dire
« semel-natif ». Ils sont engendrés à nouveau chaque
fois qu'une énonciation est proférée, et à chaque
fois ils désignent à neuf. » (BENVENISTE E. , [1974] 1981,
p. 83)
Nous retrouvons dans ces « individus linguistiques »
la notion de token qui caractérise l'énonciation comme
sui-référentielle. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas
être soumise au test de la véridiction. C'est une confirmation
au-delà de son domaine d'émission de la réflexion de
GRÉIMAS selon laquelle, le monde n'est pas un référent
ultime (GREIMAS, 1970, p. 52).
C'est ce que nous avons appelé ailleurs une fuite du
réel comme le semble prouver l'analyse suivante de Jean PETITOT : «
La relation dominante est la relation signifiant / signifié
17 Cité à partir du Le livre du
philosophe
174
(la cause du désir et non pas la validité du
jugement), le référent n'étant qu'un tenant lieu (un
artefact, un simulacre, un trompe-l'oeil) » (BRANDT & PETITOT, 1982,
p. 52)
Malgré l'obédience saussurienne de la
terminologie, il s'agit là d'une avancée remarquable au niveau
épistémologique qu'il faut ranger du côté de
HJELMSLEV. Ce linguiste danois conçoit la sémiotique comme une
fonction qui réunit deux grandeurs : l'expression et le contenu, sans
faire intervenir en aucun moment le référent. La
difficulté est de faire abstraction du référent occasion
du sens : pour ce faire, HJELMSLEV nous invite à comparer dans plusieurs
langues la même proposition ou la même phrase afin de nous
apercevoir que : « [...] dans le contenu linguistique, dans son
processus, une forme spécifique, la forme du contenu, qui est
indépendante du sens avec lequel elle se trouve en rapport arbitraire et
qu'elle transforme en substance de contenu. » (HJLEMSLEV, 1968-1971, pp.
70-71)
Autrement dit, l'expression possède une forme et une
substance, il en est de même pour le contenu. Ce qui veut dire que quel
que soit le niveau abordé dans la science linguistique, on rencontre une
fonction sémiotique qui relie une forme et une substance.
Il n'est pas peut être superflu de rappeler un autre
argument qui justifie le rapprochement épistémologique entre Jean
PETITOT et Louis HJELMSLEV en même temps qu'il évacue le
référent comme une question inutile. PETITOT définit le
carré sémiotique comme un dispositif logique qui a pour mission
de convertir une disjonction en conjonction. Ainsi, le son existe
indépendamment du référent, mais par le dispositif logique
du carré sémiotique ces deux entités deviennent des
grandeurs analysables par leur mise en forme et devenir de la sorte les
fonctifs du signe sémiotique. Nous pouvons visualiser cette logique dans
le carré sémiotique ci-dessous, à partir de l'aventure de
l'être et du paraître :
|
disjonction
|
|
Être (Référent)
|
Paraître (son)
|
|
|
|
|
Signifiant
|
signifié
|
Conjonction = signe
La lecture de ce carré sémiotique commence par
l'opposition entre le référent, c'est-à-dire ce qui est et
ce qui ne fait que paraître: le son. Le langage s'obtient par le travail
énergique de la négation qui convertit le paraître en
"signifiant" et l'être en "signifié" de telle manière que
leur rapport n'est plus d'opposition mais de contenant à contenu, ou
pour reprendre la terminologie de HJELMSLEV, un rapport d'expression à
contenu; c'est-à-dire: être une sémiotique. C'est pour
cette raison que nous pouvons dire qu'une fois le monde versé dans le
discours, la catégorie du réel s'évanouit comme une
question inutile; c'est le cas précis de la
175
délocutivité en notre sens. Dès lors,
nous sommes pris dans la spectacularisation discursive dans laquelle nos
actions ont pour but de modifier le rapport intersubjectif.
Puisque le délocutif est compris par
référence à une énonciation antérieure, il
nous semble alors que sa propriété la plus essentielle est la
suspension de la référence extralinguistique qui est
présente dans la locution primitive. Dès lors le délocutif
est produit afin d'accomplir un acte de langage dérivé de la
première valeur énonciative.
En tout cas, il ne serait pas péremptoire de penser que
le délocutif, en s'organisant dans une référence de signe
à signes bloque la dénotation pour s'ériger en action. En
d'autres termes, la référence du délocutif à une
énonciation antérieure ne suspend pas seulement la
référence extralinguistique, mais surtout, convertit le dire en
faire, et de la sorte, nous libère du poids néfaste du
réel: c'est de cette manière que le langage s'autonomise dans la
fiction qu'il permet d'accomplir.
Les pages qui vont suivre ont pour but de démontrer que
cette conversion est motivée par le principe d'économie qui
interdit au langage d'être infinitisé ou d'être
monolithique. Le délocutif, en définitive, du moins en ce qui
concerne les performatifs primaires, est une soustraction de la fonction
dénotative au profit de la fonction performative de manière
à éviter le fonctionnement hapax du langage. Il faut comprendre
ce principe d'économie comme une dérivation illocutoire à
partir d'une énonciation antérieure qui, elle, est non exempte de
valeur dénotative. C'est une autonomisation de l'accomplissement de
l'acte du langage, justement par expulsion du dénoté.
Avant d'avancer des exemples, nous tenons à marquer
notre souscription à la thèse de DUCROT qui reproche à
BENVENISTE d'avoir donné au délocutif une définition trop
restrictive. En effet, nous devons admettre avec O. DUCROT, la
généralisation des délocutifs vers d'autres
éléments qui ne sont pas des locutions. C'est le cas
précis des délocutifs lexicaux comme « Monsieur » ou
« Madame ».
Selon l'étymologie attestée, « monsieur
» signifie : « mon cher », mais à cause de la
délocutivité, il n'est plus outrecuidant de dire « Mon cher
Monsieur ». Pareillement pour « Madame ».Cette expression
désigne le titre donné par les employés d'un domaine
à la maîtresse de ce domaine. Mais actuellement, on dit madame par
simple respect et non plus parce que la femme est maitresse d'un domaine.
Le premier exemple qui va nous occuper concerne un emprunt. Il
va nous permettre d'invalider l'analyse de la linguistique contrastive qui
s'organise en termes de changement de sens : une extension ou une restriction
dans la langue cible. Au contraire, ce qui se passe en réalité
est que les emprunts subissent la loi de la délocutivité.
On peut dire sans risque de se tromper que Madagascar avant
l'arrivée des colons est une société sans école.
Nous ne voulons pas dire sans éducation parce que celle-ci se niche dans
une vaste littérature orale qui comprend les mythes, les contes et
autres genres regroupés sous le terme d' « oraliture ».
176
L'avènement de l'institution scolaire s'accompagne de
la sorte d'une forme d'emprunt linguistique. L'analyse souvent
privilégié dans ce domaine se base sur la dénotation pour
expliquer le changement de sens. Ainsi, le mot « Monsieur » pour
lequel O. DUCROT (1981, p. 49) nous convainc du caractère
délocutif subit encore une seconde délocutivité. Cette
expression, à l'origine, dénote l'individu de sexe masculin avec
une forte valeur affective puisqu'il signifie exactement « mon cher
».
Au cours de l'appropriation de cette expression par les
locuteurs Malgaches, elle s'intègre souvent avec un discours qui
désigne le maître d'école qu'elle a fini par s'associer
exclusivement à cette fonction scolaire. S'il s'agit d'un simple emprunt
comme on le croit ordinairement, on ne comprendra jamais pourquoi dans la
langue cible, il a pris le préfixe « ra- »
Le préfixe « ra- » est une marque de respect
dans l'anthroponymie malgache. De cette manière, il ne doit pas
être utilisé pour des noms propres anthroponymiques, sauf s'il y a
des raisons contraires, comme dans le cas de la prosopopée. Cette
adjonction de préfixe devait être un argument majeur pour
dissuader les tenants de la linguistique contrastive de parler
négligemment de restriction de sens.
L'adjonction reprend effectivement la valeur
énonciative perçue par les Malgaches. Par contraste, les
Malgaches auraient compris probablement que l'individu à qui l'on
s'adresse par le terme de « monsieur » bénéficie de
tous les égards de son interlocuteur. Ainsi, par référence
à cette première valeur illocutoire, les Malgaches font une sorte
d'hypercorrection en adjoignant le morphème préfixal « ra-
» qui sert justement à marquer ce respect. Seulement, ils ne
pensent pas que ce respect est intrinsèque à l'individu, ils
pensent qu'il est dû au fait que l'individu est le détenteur du
savoir.
C'est ainsi que l'emprunt se décline en « Ramose
» et non en simple « mose /muse/». « Ramose » a alors
rompu avec le lien affectif pour garder seulement le sens imposé par son
énonciation et il est produit à la seule fin de témoigner
de ce respect. C'est donc l'intégration délocutive qui a
primé sur les intégrations sémantique et phonétique
au point que quand l'autorité du savoir est une femme, les
élèves n'hésitent à parler de « ramose madamo
» qui signifie une dame enseignante, mais littéralement un Monsieur
Madame.
Cette analyse nous montre que dans le cas d'emprunt de langues
en contact, ce qui prime, ce n'est pas une réorganisation de
sèmes qui ferait conclure à une extension ou restriction de sens
très peu justifiées, d'ailleurs, celle-ci est à l'oeuvre
en permanence dans la production de sens métaphorique qui peut aboutir
à un figement lexical ou non, comme dans le cas du mot grève.
Mais au contraire, c'est une conséquence pragmatique qui organise
l'emploi et l'arrangement sémique.
En outre, il faut tenir compte que l'organisation
sémique est dépendante du contexte, ce qui signifie que tous les
sèmes disponibles sont inscrits dans le mot, mais l'emploi dans un
177
contexte en modifie l'arrangement comme nous allons tenter de
le montrer de manière empathique (QUINE, 1993, p. 73)18 dans
les exemples suivants :
Dans un cours de mathématique, si le professeur demande
à ses élèves de prendre une feuille, il y a fort à
parier que celui-ci veut faire écrire. En revanche, dans un cours de
biologie végétale où il est question de faire des
observations sur une plante, la même injonction fera saisir une partie de
plante aux élèves. De la même manière dans un
atelier de métallurgie, cet ordre fera prendre des métaux en
feuille.
Ainsi, si le délocutif s'affiche comme une
performativité, il y a lieu maintenant de dire quelques mots de la
performativité généralisée. On peut comprendre la
généralisation du performatif à tous les
énoncés de la manière suivante. Une phrase simple du type
de (1) est en réalité une complétive comme le montre
(2):
1. La séance est ouverte
2. Je déclare que la séance est
ouverte
(1) permet d'accomplir l'ouverture de la séance en
question. (2) autorise également cette action, mais à la
différence près, il indique celui qui agit. Cette indication
introduit une nouvelle force illocutoire: la déclaration qui occupe une
position mineure par rapport à l'ouverture. Il ne faut pas confondre
cette remarque avec les exemples du type descriptif ou constatif dans la
terminologie d'Austin, comme celui-ci:
3. Je travaille la terre
Ce dernier est l'objet d'une phrase matrice indiquant la
force illocutoire de l'énoncé, mais ne peut pas être
performatif en lui-même. Sa performativité se dévoile donc
de la transformation suivante:
4. J'affirme que je travaille la terre
Autrement dit, il faut admettre que les verbes qui indiquent
des actions sur le monde ou des états du monde ne peuvent pas construire
une phrase indépendante que par une démarche heuristique. Il leur
faut en effet le préfixe performatif pour mettre en évidence leur
statut énonciatif, c'est ce que nous montre le contraste entre (3) et
(4). Symétriquement inverse, les performatifs primaires ne peuvent pas
non plus être à la source d'une phrase indépendante que par
décision théorique, et c'est la thèse adoptée par
AUSTIN ([1962]1970); pour une performativité effective, et non pas
seulement virtuelle, il faut leur adjoindre une subordonnée
complétive ou tout simplement un GN objet. C'est ce que nous pouvons
constater dans (5) et (6)
5. Je te promets que tu auras un résultat
rapide
18 Je dirai que l'empathie est cette disposition qui
consiste à considérer autrui pour créer l'harmonie autour
de soi et ainsi être amené à essayer de donner forme aux
paroles à partir du point de vue de l'interlocuteur.
178
6. Je te promets un résultat rapide
Il s'ensuit que l'idée de phrase indépendante
est complètement ruinée par la théorie de
l'énonciation. En effet l'édifice structuraliste de SAUSSURE ne
tient pas compte du locuteur et encore moins du rapport interlocutif.
Cependant, il faut reconnaître que cette position heuristique a permis de
mettre en évidence le caractère systémique du langage dont
le prolongement s'avère être la grammaire générative
et transformationnelle, au lieu et place du fourvoiement philologique.
De la même manière qu'AUSTIN fut contraint
d'étendre à tous les énoncés la
performativité, ANSCOMBRE également défend la thèse
d'une délocutivité généralisée qui prend
aussi naissance sur le refus de la possibilité d'une phrase
indépendante. Voici comment il présente cette
délocutivité généralisée:
« Une hypothèse enfin : nous avons vu que si
X* est un verbe performatif, l'acte de X* réalisé en disant je0
X* que... est illocutoirement dérivé de l'acte primitif
d'assertion je1 X* que... Par ailleurs, la délocutivité
généralisée engendre la valeur performative de je0 X*
que..., à partir de l'assertion je1 X que... où X est le verbe
dans son sens non performatif. On voit l'analogie. On peut donc se demander si,
dans le cas de la performativité des verbes, la dérivation
illocutoire qu'ils dénotent n'est pas en quelque sorte la
«coupe» synchronique de ce processus diachronique qu'est la
délocutivité généralisée. N'en serait-il pas
ainsi pour tout délocutif généralisé? »
(ANSCOMBRE, 1979, p. 84)
Maintenant que le cadre théorique du travail est
clarifié, il nous est donc loisible de passer à un exercice
d'application en démontrant que le "saotse", à l'origine, est une
faveur que l'on donne en reconnaissance d'une faveur primitive finit par
devenir délocutif. Il en est exactement de même pour le cas de son
homologue français "merci" comme l'attestent encore l'expression "Dieu
merci" ou le dérivé "une lutte sans merci".
Dans la culture malgache, le « saotsa »
décrit une activité rituelle qui consiste à donner aux
ancêtres et aux divinités du présent qui assume une double
fonction. La première consiste à remercier les divins d'avoir
accordé leur bienveillance aux humains et, la seconde a pour mission de
les honorer afin qu'ils accordent leur bienveillance pour la
cérémonie ou pour l'activité que l'homme a l'intention
d'accomplir (circoncision, mariage, enterrement, voyage, commémoration,
etc.)
Le "saotsa" ne peut être effectué que par
l'officiant désigné par la société au même
titre qu'une messe chrétienne ne peut être effectuée que
par un prêtre. Il s'ensuit que la logique du saotsa est celle du
potlatch: une économie qui interdit l'accumulation sous peine de bloquer
le cycle naturel des échanges. C'est ainsi qu'à chaque
première moisson, l'homme malgache destine une gerbe de riz aux Dieux
afin qu'ils continuent à prodiguer leur faveur à l'agriculture
humaine. C'est cela la logique du potlatch: un don et un contre don.
Dans toute croyance à la divinité, c'est Dieu
qui nous donne les ressources nécessaires à notre vie, en
conséquence, nous devons le remercier par des présents.
179
Ce premier sens est le sens objectif, censé être
premier de l'expression. Mais déjà ce sens premier ne va pas de
soi. Pour nous rendre compte de cette complication inattendue, il n'est que de
nous référer à la nature des présents par
référence à l'opposition entre la catégorie du
réel et la catégorie du possible selon deux auteurs viennois :
Robert de MUSIL et Ludwig Josef WITTGENSTEIN. On peut résumer
l'idée fondamentale de ces auteurs par l'aphorisme suivant : « 2.06
- L'existence et l'inexistence d'états de faits constituent la
réalité » (WITTGENSTEIN L. J., 1961, p. 35)
Autrement dit, la réalité est constituée
par l'ensemble de ce qui est et de ce qui n'est pas. Ce qui veut dire
exactement que la réalité connaît une censure qui lui
interdit la totalité comme le ferait un syntagme vis-à-vis d'un
paradigme : en un point du syntagme, seul un élément du paradigme
peut apparaître. Appliquons maintenant ces remarques sur le « saotse
» en tant que présent pour leur donner une consistance.
À considérer le statut de Dieu à
l'égard de ses créations dont particulièrement l'homme, il
y a quelque absurdité à vouloir lui donner en présent ce
qu'il a lui-même créer. Il faut dès lors une instance
narrative pour combler le manque constitutif du « saotse - présent
». Cette instance narrative postule ce que la censure interdit : la
totalité. Elle indique le sens du présent dans une perspective
sémiotique qui n'est pas dénotative comme le prévoit la
linguistique saussurienne mais métalinguistique engendrant la connexion
de chose à choses consignée par WITTGENSTEIN de la manière
suivante : « 2.0123 - Lorsque je connais un objet, je connais
également l'ensemble des possibilités de son occurrence dans des
états de chose » (WITTGENSTEIN L. J., 1961, p. 32)
Ainsi, un « saotse - présent » dénote
une libation et / ou une immolation à l'occasion d'un rituel religieux
où l'homme officiant « affirme » sa gratitude envers Dieu de
leur avoir laissé vivre, lui et les siens pour les biens qui leur ont
été prodigués. Dès lors, le « saotse -
présent » emprunte la voie de la synecdoque et de la
métonymie sous la perspective de la partie pour le tout.
C'est-à-dire que l'aliment de l'homme est du végétal et de
l'animal. Le premier est représenté métonymiquement par le
breuvage considéré comme l'ambroisie des Dieux et le second,
synecdochiquement par l'animal du sacrifice.
Nous pouvons maintenant mieux comprendre pourquoi nous avons
parlé d'économie de potlach ou de dilapidation entre les humains
et les Dieux : dans une économie de potlach, il n'y a pas
d'accumulation, son principe est de dilapider dans une forme
cérémonielle ce que l'on a gagné afin que le cycle de
production revienne à son point de départ. Ainsi, l'homme en
donnant à Dieu ce qui lui a été offert, s'interdit
l'accumulation de crainte que Dieu refuse d'en donner une nouvelle fois. Le
« saotse - présent » en définitive est une dilapidation
à l'endroit du bienfaiteur pour signaler que l'homme sacrifie tout
à lui afin qu'il continue sa prodigalité.
C'est pour cette raison que le « saotse - présent
» entre en occurrence avec la notion de « remerciement » qui est
le sens indiqué par l'instance narrative dont la fonction discursive est
de liquider le manque caractéristique de la réalité.
180
Cette indication du sens par l'instance narrative est
nécessaire pour différencier le simple envie de faire une orgie
alimentaire de l'acte rituel de remerciements pour honorer les
divinités. En outre cette instance narrative a également pour
mission de marquer la distance qui sépare le sentiment religieux qui
reconnaît que l'homme doit tout à Dieu et le caractère
foncièrement partiel des présents en tant que catégorie du
réel. C'est pour cette raison que par délocutivité, le
proverbe suivant ou ses nombreux équivalents est toujours en occurrence
avec un « saotse - présent » :
Tantely tapa-bata io fa ny fonay ro mameno azy (c'est
un demi-boisseau de miel mais c'est nos coeurs qui le
remplissent)19.
En définitive, sans l'instance narrative, tout
présent demeure marqué par le manque caractéristique de la
réalité. De cette manière, il est clair qu'aucun «
saotse - présent » ne peut pas se suffire à lui-même
car ce serait faire de l'aumône à celui à qui nous devons
tout. Ce proverbe intervient justement pour combler le manque
caractéristique du présent. Discourir dans le sens de ce
proverbe, c'est-à-dire, présenter une offrande qui
représente le végétal et / ou l'animal et spécifier
en même temps que c'est la reconnaissance de la prodigalité de
Dieu, constitue ce que l'on appelle « misaotra » ou « remercier
»
Puisque la nature du « saotse - présent » est
ainsi clarifiée, nous pouvons maintenant l'envisager du point de vue de
la délocutivité. Ce premier sens du « saotse » est
reproduit par l'instance narrative dans le discours qui en fait mention lors du
rite cultuel. Mais comme ce rite cultuel est produit à la seule fin de
remercier les divinités pour leur bienveillance, il s'ensuit qu'on peut
faire le « saotse » en l'absence de tout présent, en disant
tout simplement « misaotse » qui est cette fois-ci une forme verbale
et non plus une forme nominale appartenant à la locution de la
cérémonie.
Nous retrouvons alors une parfaite illustration de la
définition originale du délocutif : « un verbe est dit
« dénominatif » s'il dérive d'un nom ;
déverbatif, si d'un verbe. Nous appellerons délocutifs des verbes
dont nous nous proposons d'établir qu'ils sont dérivés de
locutions » (BENVENISTE, [1966] 1982, p. 277)
De là, la forme délocutive est attestée,
on dit « misaotra » à la seule fin d'accomplir l'acte de
remercier. Il s'agit en quelque sorte d'une forme d'homothétie qui
déplace la valeur énonciative de l'ordre du divin vers l'ordre
humain. Cette homothétie se justifie dans la mesure où :
« La création de verbes délocutifs
s'effectue sous la pression de nécessités lexicales, elle est
liée à la fréquence et à l'importance des formules
prégnantes dans certains types de culture. » (BENVENISTE, [1966]
1982, p. 279)
En effet, dans la culture de l'Afrique insulaire qui se
retrouve sans doute en Afrique continentale, le Dieu providence qui pourvoie
à tous les besoins de l'homme mérite un présent afin qu'il
continue à prodiguer sa bienveillance. C'est de cette manière que
l'homme
19 Notre traduction
181
africain clôt un discours, au début des travaux
agricoles, au cours duquel, l'instance narrative demande à Dieu
d'accorder sa bénédiction pour la fertilité du sol que
l'homme va travailler. Il n'est pas ainsi étonnant que l'un des tout
premiers arts religieux soit un Venus steatopyge, témoignant du culte de
fécondité. De la même manière, au moment de la
récolte, l'homme se doit de faire un présent à Dieu.
Maintenant, le paradoxe que nous devons résoudre dans
cette économie de potlatch consiste à se demander comment on peut
faire présent à Dieu des choses qu'il a lui-même
prodiguées.
La notion de détachement de sens de B. de CORNULIER va
nous permettre de résoudre ce paradoxe. La véritable fonction du
détachement du sens est de nous dire que le langage ne peut pas
être une tautologie du réel. Voici un extrait de l'article qui
permet cette conclusion: « Dans l'énoncé du
détachement fort du sens (§E) le contenu de « P » et de
« Q » est quelconque. C'est ce qu'on peut mieux faire voir en
explicitant ainsi la portée des variables propositionnelles x :
Quel que soit P, quel que soit Q, ( (P & (P signifie Q)
) signifie Q).
Peu importe que P soit une « proposition » ou un
« fait ». Évidemment, si Q ne signifie rien dans un langage
donné, la conjonction d'un acte quelconque P, avec une
interprétation P signifie Q dans ce langage, ne produit aucun sens par
détachement du sens, faute que Q signifie quelque chose. Q doit donc
déjà appartenir au langage de l'interprétation. Mais cela
n'est pas vrai de « P » : pour que le détachement du sens
dérive Q, il est indifférent que « P » ait
déjà une définition dans le langage de
l'interprétation, qui justement lui en assigne une. (...) Le
détachement du sens est donc un principe qui permet à un langage
de s'incorporer n'importe quel élément nouveau comme signe de
n'importe quelle valeur qu'on puisse déjà y exprimer. En ce sens,
l'inventivité sémiologique est arbitraire, radicalement et
totalement, dans la mesure où le détachement fort du sens a la
force d'une règle. » (CORNULIER, 1982, p. 136)
C'est ainsi que le discours qui accompagne l'offrande indique
clairement qu'il s'agit d'un merci en reconnaissance de la prodigalité
des divinités envers l'homme et non d'une aumône, ce qui serait un
sacrilège. Il est remarquable de constater que ce qui empêche les
dons d'être compris comme une aumône est justement le discours qui
l'accompagne. C'est pour cette raison que le discours qui accompagne l'objet
matériel du "saotsa" le présente toujours comme sanctionné
par l'incomplétude caractéristique de la catégorie du
réel. Que l'on se rappelle des deux pièces de la veuve dans le
temple.
On remarque en effet que dans la présentation du
"saotsa", on place le breuvage et le morceau de viande sur un autel et puis
dans le discours qui suit, il faut dire obligatoirement que ce sont les
"saotsa" en reconnaissance de la bienveillance divine. Autrement dit, en
suivant en cela la règle du détachement du sens, on
s'aperçoit que la présentation du "saotsa" est un acte de
reconnaissance. De là, un observateur extérieur à l'office
peut commenter par le délocutif de BENVENISTE ce qu'il voit en disant
"Misaotra io olona io [Cette personne remercie]"
182
En revanche, la délocutivité
généralisée consistera à dire à une personne
que l'on reconnaît être votre propre bienfaiteur : "je vous
remercie" en dehors de tout présent, ou sous la perspective de la
performativité généralisée en lui disant "je vous
dis merci"/ "je vous dis que je vous remercie". Il s'ensuit que dans l'espace
conversationnel au quotidien, dire « merci » ce n'est pas seulement
accomplir l'acte de remerciement mais c'est surtout confirmer la modification
d'une relation intersubjective à travers l'instance de narration qui
fait acte de gratitude.
C'est de cette manière que le délocutif
généralisé fait passer une activité physique vers
une activité de langage sous le sceau de la
sui-référentialité. La
sui-référentialité est souvent présentée de
manière quelque peu réductrice à notre avis. Dans le
cheminement de la pragmatique, elle est dressée en face d'une
linguistique qui considère les signes comme de simples
éléments de représentation qui se substituent aux choses.
De cette manière, le délocutif est compris comme un signe qui
bloque cette référence en s'exhibant comme forme qui permet
d'accomplir un acte linguistique défini.
Dans une deuxième évolution de la pragmatique,
la sui-référentialité n'est pas considérée
comme un simple blocage de la référence mondaine mais que le
mouvement de la référence ne s'y arrête pas mais la
traverse pour atteindre un autre niveau du langage, celui de l'action. Ce
niveau a pour mission de modifier le rapport dans l'univers du discours dont
rend compte la sémiotique narrative ou la sémiotique
transformationnelle. C'est ce que nous appelons intelligibilité
narrative qui est la possibilité de nous présenter un spectacle
linguistique devant nous et de nous imaginer ce qui se passerait s'il est
vrai.
Il n'est pas inutile ici de rappeler une thèse que nous
avons avancée ailleurs à partir de la position de Pierre BANGE
que voici :
[...], les énonciations vont être
considérées comme des actions verbales en
relation avec une situation de communication qui comporte des dimensions
spatio-temporelles et surtout sociales ; comme des actions accomplies par un
locuteur en produisant un énoncé dans une langue naturelle
vis-à-vis d'au moins un récepteur, dans le but de modifier la
situation antérieure à l'acte d'énonciation en provoquant
une réaction du ou des interlocuteurs (une réaction interne,
cognitive, qui peut elle-même déclencher des réactions
verbales et/ou comportementales » (BANGE, 1992, p. 9)
Cette thèse consiste à dire que c'est une «
trace narrative » qui rend intelligible l'illocution. En effet, la
narrativité est surtout un algorithme qui fait passer une figure d'un
état à l'autre, conformément à l'intuition de
WITTGENSTEIN qui postule que l'existence et l'inexistence d'états de
chose constituent la réalité. Explorons cette hypothèse
afin de la clarifier et d'en tester la validité. Elle est
également présente chez un autre auteur viennois. Robert de
MUSIL, avec son style propre présente cet aphorisme de WITTGENSTEIN en
ces termes : « [...]. Toutes les possibilités que contiennent,
par exemple, mille marks, y sont évidemment contenues qu'on les
possède ou non ; le fait que toi ou moi les possédions ne leur
ajoute rien, pas plus qu'à une rose ou à une femme. »
(MUSIL, 1982, pp. 18-19)
183
On retrouve la même idée chez Jacques DERRIDA
([1972] 1982) dans le concept de différance (avec un « a »),
chez Paul KLEE (1977) en termes de devenir. C'est une idée qui
s'avère être un point central dans les sciences linguistiques et
dans les sciences cognitives qu'on peut multiplier à loisir les
références. Cependant, nous allons en faire l'économie
pour nous intéresser à son adaptation dans le cadre de la
pragmatique.
En introduisant la dimension temporelle dans l'algorithme
narratif, GRÉIMAS nous indique qu'un parcours figuratif connaît
une clôture absolue à travers la suppression-adjonction de
sèmes ou de propriétés. Ainsi, pour reprendre une figure
du monde familière dans les contes populaires qui ont permis de mettre
au point la théorie de la transformation narrative. Cette figure
emblématique est Cendrillon, elle est présente sous toutes les
latitudes sous la thématique de la marâtre. Pour identifier la
propriété pertinente de Cendrillon, au début du
récit, il n'est que d'analyser l'antonomase qui est à l'origine
de son nom.
L'antonomase est définie par les rhéteurs comme
une figure qui fait passer un nom propre en nom commun ou un nom commun en nom
propre. Pour le nom Cendrillon, il s'agit évidemment du passage du nom
commun vers le propre. En effet, ce nom est une transformation hypocoristique
du nom "cendre". L'hypocorisme étant, selon Henri MORIER, est une forme
laudative d'ironie qui consiste à créer un « terme
susceptible d'atténuer une chose blâmable » (MORIER, 1981, p.
519). En effet, brimée par sa marâtre, l'orpheline est
obligée de dormir à même le sol auprès du foyer, les
nuits d'hiver pour bénéficier un peu de la chaleur du feu sous
les cendres si bien que son vêtement est décoloré par les
cendres. C'est ainsi qu'elle est appelée du nom de Cendrillon.
Cependant, au cours du bal annuel où le prince se doit
de choisir sa future épouse, c'est Cendrillon
métamorphosée par une fée qui l'a emporté sur
toutes les jeunes filles parées pour la circonstance. On comprend alors
que la suppression-adjonction de propriétés est le passage du
malheur vers le bonheur. Autrement dit, ce qui constitue le parcours figuratif
est une borne absolue de part et d'autre de la transformation qui insère
la figure dans une temporalité close.
Le point le plus important qu'il faut retenir de la
temporalité close qui prend en charge une figure du monde est qu'elle
dessine la totalité de la figure qu'il faut comprendre comme l'ensemble
des possibilités inscrites en elle. Que l'on se rappelle à propos
l'aphorisme de WITTGENSTEIN ou la monnaie-femme de MUSIL. Mais, à la
lumière de l'exemple de Cendrillon, nous devons tenir compte qu'une
seule des possibilités peut être actualisée.
Cette propriété du narratif, c'est-à-dire
la logique narrative inscrite dans la suppression-adjonction, nous apprend que
le réel est caractérisé par une censure qui interdit la
totalité. Pour métaphoriser, c'est comme si l'on se trouvait
à la croisée des chemins. Évidemment, l'on ne peut prendre
qu'un seul, les autres chemins ne s'évanouissent pas, ils sont là
comme possible, et l'individu a tout loisir de discourir ce qu'aurait
été sa vie s'il avait pris un autre chemin. Dès lors, si
la censure interdit la totalité, elle la postule en même temps.
C'est ce double mouvement de l'interdit et de la postulation qui fait que le
mouvement de la référence ne s'arrête plus au réel
mais le traverse pour atteindre la postulation du possible.
184
De ce point de vue, si le « saotsa » acquiert une
délocutivité, c'est parce que la logique narrative du
récit dont il dérive étale sur le même niveau le
réel et le possible dans un mouvement de référence
réciproque qu'institue le mécanisme de la suppression-adjonction.
En effet, nous savons que le « saotse » est motivé par un
sentiment humain qui fait croire à la bienveillance de Dieu, notamment
en ce qui concerne l'agriculture. Pour commencer la période culturale,
l'homme, dans une cérémonie cultuelle, demande à Dieu
d'accorder sa bienveillance et de faire en sorte que la culture donne et
demande pardon à l'avance de devoir transgresser la terre-mère
dans le labourage.
En retour, au moment de la récolte, l'homme se doit de
remercier Dieu par des présents pour le solliciter de continuer à
être bienveillant, car selon la logique narrative Dieu aurait pu
être malveillant. C'est cela le possible qui s'accommode de ne pas
être actualisé selon l'expression de Robert MARTY (MARTY, 1980)
dans son analyse de la priméité de la sémiotique triadique
de PEIRCE. En tout cas, le discours premier du « saotse » s'organise
autour de la distance qui sépare et noue en même temps la
malveillance de la bienveillance.
S'il en est ici, c'est-à-dire que si le discours
premier dont dérive le délocutif du « saotse » permet
justement la dérivation délocutive, c'est parce qu'il se situe
dans la trame narrative d'un spectacle linguistique, une fuite du réel,
qui déploie sur le même niveau de la figure la malveillance et la
bienveillance comme autant de possibles. D'autre part, il y a lieu d'identifier
en amont du « saotse » une autre trame narrative bornée par
l'absence et la présence de récolte.
Faire le « misaotra » se comprend alors comme une
postulation de la totalité qu'interdit la censure du réel. La
dérivation délocutive se comprend de la sorte comme une
postulation de la totalité, non plus parce le réel opère
une censure mais parce que le délocutif suspend la
référence à la réalité pour une
référence illocutoire dans un discours antérieur.
Ce qui veut dire que la logique temporelle introduite par
l'instance de narration est un algorithme narratif qui fait que les contraires
ne s'opposent pas mais coexistent en polémiquant et qui se contente
d'une transformation du rapport intersubjectif sans se préoccuper
d'aucune référence extralinguistique. Dans le cas qui nous
occupe, dire « merci » en tant que token et non en tant que
type n'est l'accomplissement d'un acte de remerciement que parce son
énonciation modifie le rapport intersubjectif des interlocuteurs. Disons
que d'homme libre, celui qui dit « merci » devient redevable et
contraint à cet état jusqu'à acquittement de sa dette. Une
dette qui prend la voie du potlatch sous forme d'étalement-dilapidation
de richesse en contre partie de la bonne récolte. Mais il faut
reconnaître que dans la dérivation délocutive, cet
étalement-dilapidation se convertit en acte verbal
L'introduction de la logique narrative au sein de la
pragmatique est un argument qui milite contre la nécessité de
contextualisation de la communication qui relèguera dans les oubliettes
les énoncés dont on ignore les contextes d'émission.
Autrement dit, la trace narrative est suffisamment puissante pour permettre de
comprendre l'acte d'énonciation mis
185
en jeu. L'intervention de la logique narrative dans la
performativité permet de minimiser le rôle du contexte.
Il nous semble aussi permettre de faire l'économie de
l'explication en quatre phases du processus délocutif chez DUCROT et
ANSCOMBRE. .
S'il est accepté que c'est une trace narrative qui rend
intelligible l'illocutoire, alors le délocutif peut se présenter
comme un cas spécifique d'intertextualité que nous proposons
d'appeler « interillocutoirité » par reprise d'une valeur
illocutoire présente dans un discours premier par mention du segment
linguistique qui focalise cette valeur à la seule fin de l'accomplir
dans le discours second. Cette interrelation entre des valeurs illocutoires a
pour mission d'éviter au langage d'être infini,
conformément au principe d'économie dont nous avons fait l'un des
arguments de notre explication dans ce travail.
Pareille explication peut aussi faire, au niveau
théorique, de l'économie des différentes étapes
proposées par ANSCOMBRE et DUCROT. Car, il faut reconnaître que ce
long détour, pose le problème de la hiérarchisation
diachronique comme nous le verrons dans les exemples qui vont suivre.
À ce titre, nous admettons volontiers le principe mise
à jour par Ducrot, selon lequel, des doublons morphologiques dans le
langage impliquent une référence à des énonciations
antérieures :
« Il est donc nécessaire si le nominalisme ne
doit pas être circulaire, d'expliquer que des emplois où un
segment linguistique a la valeur S1 amènent à conférer
à ce même segment une valeur tout autre S2. Cette
métamorphose, on peut, je crois, la fonder sur l'énonciation
» (DUCROT, 1981, p. 48)
C'est de cette manière que nous allons tenter
d'expliquer la présence en français de deux mots de même
forme mais qui ont des sens différents, il s'agit du mot «
grève ». Le sens S1 du mot « grève »
désigne l'espace géographique qui borde un plan d'eau. La
question est alors maintenant de savoir d'où vient que le mot «
grève » actuellement désigne un engagement politique en vue
de modifier le rapport entre employés et employeur.
Il nous semble que la métamorphose est en relation avec
un fait ancien qui se passait dans le premier pays de la démocratie :
Athènes. Nous reconnaissons volontiers que l'événement est
historique et que sans le secours d'une base de données facilement
accessible sur le réseau, l'explication nous aurait
échappé complètement. En effet, l'on sait que quelques 400
av. J.C. les Athéniens ont coutume d'aller à la grève (S1)
pour décider de l'avenir politique de la cité. Au cours de l'une
de ces réunions, ils ont décidé de l'éviction de
Thémistocle du pouvoir par inscription d'avis sur des ostrakon
mis en évidence par des fouilles archéologiques.
C'est par référence à l'acte accompli sur
cette grève, qui est un pur acte de discours : bannir quelqu'un (au
même titre qu'ennoblir ou marier) que le mot « grève S2
» désigne l'arrêt volontaire du travail pour obtenir un
changement de conditions.
186
Ainsi, dire «je suis en grève » n'est pas une
simple description de l'arrêt volontaire du travail, mais il est surtout
une modification du rapport intersubjectif entre employeur et employés.
Cette valeur illocutoire dérive de ce qui s'est passé pour
Thémistocle dans l'Antiquité grecque : une modification du
rapport entre le peuple et le roi en termes d'ostracisme.
Ce deuxième exemple nous montre que le délocutif
n'aboutit pas toujours à la création d'un verbe, il peut aussi
concourir à la création d'un nouveau sens par figement d'un
délocutif. Ce qui semble alors être un doublon homonymique dans le
langage n'est qu'une conséquence d'une inter- illocution dans laquelle
l'illocutoire dérivé suspend la référence
extralinguistique pour ne garder que la référence
interillocutoire.
Il peut encore y avoir d'autres dérivations qui ne sont
pas forcément délocutives. Par mesure d'économie et par la
prégnance d'une expression dans une culture ou dans une langue
donnée, le même signifiant est repris pour un sens nouveau mais
proche de la valeur délocutive. C'est ce que nous avons quand on dit par
exemple :
7. Il ne faut pas grever le budget
où « grever » est le synonyme d' «
obérer » et signifie « affaiblir par un excès de dettes
».
Les deux exemples que nous venons de traiter militent en
faveur du changement de sens fondé sur une énonciation en termes
d'interillocution. Ce terme sert à désigner performativité
du délocutif par référence à une valeur
énonciative initiale d'un discours qui décrit un rite ou une
pratique de nature fortement sociale. Autrement dit, l'énonciation
première est une affirmation qui repose sur un constat tandis que la
seconde, le délocutif, se libère de cette nécessité
de présence au monde pour s'autonomiser en vue d'une modification d'un
rapport interlocutif.
Références
ANSCOMBRE, J.-C. (1979). "Délocutivité
benvenistienne, délocutivé généralisée et
performativité". Langue Française, 42, pp. 69-84.
AUSTIN, J. L. ([1962]1970). Quand dire, c'est faire.
Paris: Seuil.
BANGE, P. (1992). Analyse conversationnelle et Théorie
de l'action. Paris: Les éditions Didier. BENVENISTE, E. ([1966]
1982). Problèmes de linguistique générale,1.
Paris: Gallimard. BENVENISTE, E. ([1974] 1981). Problèmes de
linguistique générale, II. Paris: Gallimard.
BRANDT, P. A., & PETITOT, J. (1982). "Sur la
décidabilité de la véridiction" dans Hommage aux
Jefalumpes. 8 - 32.
CORNULIER, B. (1982). "Le détachement du sens" dans Les
Actes de Discours, Communications,32. Communications, pp. 125-182.
DERRIDA, J. ([1972] 1982). Positions. Paris: aux
éditions du minuit.
DI CESARE, D. (1986, Juilet). "Langage, oubli et
vérité dans la philosophie de Nietzsche". Histoire,
épistémologie, langage, pp. 91 - 106.
187
DUBOIS, J., EDELINE, F., KLIKENBERG, J.-M., MINGUET, P., PIRE,
F., & TRINON, H. (1982). Rhérotique de
la poésie: lecture linéaire et lecture
tabulaire. Paris: Larousse.
DUCROT, O. (1981). Analyses pragmatiques. Les actes de
discours, Communications 32., pp. 11-60.
GREIMAS, A. J. (1970). Du sens, Essais de
sémiotique,1. Paris: Seuil.
HJLEMSLEV, L. (1968-1971). Prolégomènes
à une théorie du langage. Paris: éditions de
Minuit.
KLEE, P. (1977). Théories de l'art moderne.
Paris: Gonthier.
LAFONT, R. (1978). Le travail et la langue. Paris:
Flammarion.
MARTY, R. (1980, Juin). "La sémiotique
phanéroscopique de Charles S. Peirce". Langages, p. 29.
MORIER, H. (1981). Dictionnaire de poétique et de
rhétorique (éd. 3ème édition). Paris: PUF.
MUSIL, R. d. (1982). L'homme sans qualités.
Paris: Seuil.
NIETZSCHE, F. (1873). Vérité et mensonge au
sens extra moral. Paris: Aubier-Flammarion.
QUINE, W. V. (1993). La poursuite de la
vérité. Paris: Seuil.
TODOROV, T. (1970). "Synecdoques", dans Recherches
rhétoriques, Communications,16. Paris: Seuil.
WITTGENSTEIN, L. J. (1961). Tractatus logicophilosophicus,
suivi de Investigations philosophiques.
Paris: Gallimard.
188
13. LA DÉLOCUTIVITÉ ET LES
SALUTATIONS
RÉSUMÉ :
S'il est admis que le langage porte une trace
mythico-religieuse, la salutation entre de plein pied dans cette
catégorie. En effet, la salutation est avant tout dans la transcendance
verticale : le salut ne peut provenir que du créateur comme en
témoigne l'expression anglaise « Save our soul ». Le passage
de la salutation vers la transcendance horizontale est de nature
délocutive et finit par engendrer une surdélocutivité. La
première délocutivité résulte du fait que personne
ne peut se suffire à lui-même, et la surdélocutivité
intervient quand le salut est compris comme une simple marque de politesse.
Mots clés : salut, salutation, transcendance verticale,
transcendance horizontale, délocutif, surdélocutif, nature.
ABSTRACT:
If it is admitted that the language bears a trace
mythic-religious, greeting enters full foot in this category. Indeed, the
greeting is primarily in the vertical transcendence: Salvation can come only
from the creator as evidenced by the phrase "Save our soul ". The passage of
the greeting towards horizontal transcendence is by delocutive nature and
eventually cause a surdelocutivite. The first delocutivite results that no one
can stand on its own, and the surdelocutivite occurs when salvation is
understood as a simple mark of politeness.
Key words: Hi, greeting, vertical transcendence, horizontal
transcendence, delocutive, surdelocutive, nature.
Commençons par prendre connaissance des salutations. On
peut supposer qu'à l'origine le salut a le sens d'être hors de
danger dans la perspective d'un univers animiste ou tout au moins d'un univers
qui accepte la transcendance divine. Une fois que l'on admet l'existence d'un
créateur, on croit également que la sauvegarde des Dieux qui
s'accorde ou se refuge est une ordonnance du monde dans le sens
précisé par HEIDEGGER de la sorte :
« L'ouverture d'un monde donne aux choses leur
mouvement et leur repos, leur éloignement et leur proximité, leur
ampleur et leur étroitesse. Dans l'ordonnance du monde est
rassemblée l'ampleur, à partir de laquelle la bienveillance
sauvegardante des dieux s'accorde ou se refuse. Et même la
fatalité de l'absence de Dieu est encore un mode de l'ordonnance du
monde. » (HEIDEGGER, 1987 [1949], p. 48)
Le salut est donc bel et bien cette bienveillance divine qui
s'accorde et qui est l'objet de quête de l'homme. Comme en
témoignent les découvertes dans la grotte de Lascaux, un site
daté du paléolithique, l'homme est pris dans une double
transcendance qui le relie à la fois aux divinités et aux autres
dans la perspective du salut.
Quand le salut concerne l'existence au monde visible, il
implique l'idée de protection qui fait que l'on soit
épargné des dangers non pas par ses propres forces ou ses propres
actions
189
mais parce que les divinités ont accordé leur
bienveillance. Dans le vernaculaire malgache, nous trouvons trace de cette
implication théologique dans le langage.
Il ne faut pas croire que la population malgache est une
population acquise totalement à la religion chrétienne ou
à quelques autres religions allogènes. La transcendance verticale
de l'homme malgache le relie aux divinités en passant par les
ancêtres. Ces divinités ne sont pas clairement définies.
Elles concernent les êtres vivants, elles sont dans les
végétaux aussi bien que dans les animaux. Elles sont aussi dans
l'eau, dans la terre, dans les pierres, bref elles sont partout. Ce qui veut
dire en définitive que les malgaches sont dans animistes.
Cet animisme fait que toute chose est sacrée et que
cela implique que tout changement que l'homme doit accomplir dans l'ordre des
choses doit être précédé d'une prière
à ces divinités. Dans la tradition, on ne coupe pas un arbre sans
faire une prière pour ce changement ne soit pas néfaste mais
apporte le salut de l'homme. Pareillement, avant de commencer un travail de
labour, il faut au préalable tenir un discours qui relève de
l'excuse de devoir toucher à la terre mère et de la sorte de
pouvoir demander le salut de l'homme.
Si ces traditions religieuses envers l'inerte commencent
à se perdre actuellement, il en est d'autres qui ne sont pas prêt
de s'abolir en dépit du laminage des religions allogènes. Le
comportement des Malgaches envers les animaux est très spécifique
à ce propos. Donnons-en deux exemples.
Le premier, c'est qu'il faut tuer une poule. Il s'agit de
verser le sang de cet animal. Dès lors cette action ne peut pas
être faite par une femme dont le rôle est de donner la vie.
Ensuite, il faut demander pardon à la poule de devoir la tuer. Cette
demande de pardon consiste à dire à la poule de ne pas se mettre
en colère mais de bénir l'action afin que l'homme puisse avoir
son salut en ingérant la poule. Comme il ne s'agit pas seulement de
s'adresser à la poule mais surtout de se mettre en relation avec les
divinités, c'est le doyen de la maison qui s'acquitte de cette
prière et vers la fin de la prière, il asperge de l'eau la
tête de la poule afin qu'elle ne souffre pas trop et ce n'est qu'alors
qu'il peut trancher le coup de l'animal.
Le deuxième exemple peut être
considéré comme une expansion de ce premier. Dans l'immolation
d'un zébu, le sacrifice rituel connaît deux étapes.
Après la prière de demande de bénédiction pour le
salut de l'homme, l'officiant donne l'ordre d'asperger d'eau la tête du
zébu pour la même raison de moindre souffrance. Puis, on tranche
le coup de l'animal. L'officiant recueille des morceaux de viande choisis :
foie et bosse ; et les offre aux divinités sur un plateau rituel. C'est
cela la première étape.
La seconde étape intervient lorsque les viandes sont
cuites. De la même manière l'officiant offre sur le plateau rituel
les mêmes morceaux mais déjà cuits. La raison de ces
rituels est de supplier les Dieux d'accorder le salut des hommes en
dépit du fait qu'il perturbe l'ordonnance du monde en tuant un animal
qu'il n'a pas créé.
Il y a lieu de croire que cette quête de salut
était un universel humain, ou encore un universel humain si l'on
intègre dans la réflexion les religions modernes. La parousie est
une quête de salut pour l'humanité. En effet, il est permis
d'accorder foi à cette universalité en
190
tenant compte des témoignages de la grotte de Lascaux.
L'art pariétal (15.000 ans avant J.C.) est une divinisation des animaux
qui sont ainsi tombés dans le domaine du sacré et devenant du
coup objet de prière.
L'opposition se situe dès lors entre l'homme et
l'animal divin. Dans la société préhistorique si l'animal
venait à disparaître, la disparition de l'homme aurait
été aussi certaine. C'est ainsi que l'homme demandait son salut
dans les figures pariétales d'animaux. Autrement dit, la première
religiosité est une quête de salut.
Maintenant, il nous faut franchir un pas de plus et observer
un autre phénomène qui implique le salut. Il s'agit d'interroger
l'érotisme dans son rapport au salut.
Le premier indice qui va nous mener à ce rapport est
encore le principe selon lequel, dans le monde animiste, il faut demander le
pardon des divinités avant de toucher à la nature. Nous
émettons alors l'hypothèse suivante, la femme relève de la
nature mais pas l'homme.
Nous retrouvons exactement le même rapport que
précédent, d'un côté il y a la femme
divinisée et l'humanité qui divinise. On peut encore dire d'une
autre manière cette opposition : l'homme est un être de guerre et
de travail mais la femme appartient au monde divin du sacré en tant que
nature. L'interdit de l'inceste est une forme de cette différence entre
la femme divinisée et l'humanité divinisant.
L'on sait que sans interdit de l'inceste il y aurait
déferlement de la violence pour la possession de la femme. C'est que
nous montre sans jamais le dire le mythe d'OEdipe que l'on peut résumer
ainsi : l'identité de sexe entraîne la rivalité et la
différence de sexe suscite le désir. C'est cela l'explication du
parricide de Laïos par OEdipe lui-même, suivi immédiatement
du mariage de ce fils meurtrier à sa propre mère Jocaste.
Tout cela est connu, mais le fait nouveau qui mérite
notre attention est que le rapport avec une femme non incestueuse n'est pas
dépourvu d'interdit. Un interdit qui provient du fait que toute
jouissance de la nature est une modification de cette nature ; dès lors
cette modification de la nature exige que l'on demande pardon aux
divinités. Voilà pourquoi, il est toujours nécessaire,
pour la possession d'une femme, de demander le salut de l'homme par une
immolation de zébu. Ce rituel de la quête du salut prenait la
forme du cuissage par le roi, dans l'époque féodale, afin de
conjurer le sort.
En outre, quand on sait que le monde du féminin est le
monde pur du jeu de l'apparence par opposition au monde du travail du masculin
; on comprend l'interdit entourant la femme. L'interdit entourant la femme a
pour mission de freiner la frénésie de violence que risque de
produire le désir. Il s'agit d'une sorte de mise à distance pour
contrer la jouissance immédiate. Il s'ensuit alors le paradoxe mais
juste suivant : c'est l'interdit qui désigne la femme à la
convoitise, autrement dit, l'interdit a pour corollaire sa transgression, une
transgression qui ne supprime pas l'interdit :
« L'interdit donne de la valeur, une valeur sexuelle
ou érotique, à l'objet de l'interdit; l'objet est
«désigné par l'interdit même à la
convoitise» : «c'est l'interdiction qui pèse sur lui qui l'a
désigné au désir» [cf. Girard]; il y a «don
paradoxal de l'objet
191
de convoitise», le désir ayant pour objet la
perte et le danger. Dans l'exubérance du don ou la dépense des
ressources -- et l'acte sexuel est un «don d'énergie
exubérante» --, «le respect, la difficulté et la
réserve l'emportent sur la violence»; mais «[...] le
renoncement souligne réciproquement la valeur séduisante de
l'objet». » (LEMELIN, 1996)
La question de l'érotisme comme attribut féminin
consiste à dire que c'est la nudité féminine qui est
érotique aussi bien pour l'homme que pour la femme ; parce que
l'érotisme en tant que jeu autotélique s'oppose au monde du
travail. Ce jeu autotélique se comprend mieux avec les autres attributs
féminins : les bijoux. Les outils tirent leur valeur du travail qu'ils
permettent d'accomplir, tandis que les bijoux, ne permettant d'accomplir aucun
travail, tirent leur valeur par leur opposition au monde du travail, en
justifiant leur existence par la convoitise dans l'étalement de leur
beauté comme luxe.
Cette dernière remarque renforce l'interdit entourant
la femme. Le luxe n'est pas une accumulation mais au contraire une dilapidation
exubérante. Il s'ensuit une nouvelle interprétation de
l'interdit. L'interdit qui frappe la femme est également cet interdit du
luxe. Le travail a pour but de permettre à l'homme de vivre, mais quand
la richesse produite par le travail est risquée dans le désir
d'un bijou, l'homme risque sa vie elle-même dans la dilapidation de
richesse. C'est ce risque qui se présente comme un interdit dans le
monde du travail mais dont la transgression est passionnante par l'angoisse que
la transgression elle-même crée.
On comprend alors pourquoi la transgression qui arrache
l'homme du monde du travail vers le monde du jeu a pour corollaire la
quête du salut dans un jeu verbal où l'homme joue à croire
que les divinités écoutent et entendent sa voix, que les
divinités apprécient les offrandes qu'il leur présente.
C'est pour la même raison les offrandes sont toujours la quintessence de
ce que l'homme a de plus précieux, de plus luxueux : la partie fine dans
le sacrifice animal (le foie, la bosse, le miel, l'alcool) ; la
virginité de la femme dans le sacrifice humain.
Si dans la Genèse, l'homme est condamné au
travail, c'est parce que le monde pur du jeu est un monde de dilapidation dans
lequel l'homme ne peut se maintenir. Ce qui est interdit dans le monde du
travail est le jeu, parce que dans le jeu l'homme risque sa vie. C'est pour
cette raison qu'à chaque fois que l'homme transgresse cet interdit, il
prie pour obtenir le salut qui provient seulement des divinités
responsables de l'ordonnancement du monde.
Puisque risquer la vie est un interdit dans le monde du
travail, par expansion de cet interdit, nous pouvons aussi comprendre
l'interdit qui entoure la mort. Le défunt, de par sa source latine, est
celui qui ne fonctionne plus, il est ainsi en pleine transgression du monde du
travail. S'il est interdit de tuer, c'est parce que la mort arrache l'homme de
manière définitive du monde du travail dans lequel l'homme est
condamné et, du monde profane le projette dans le monde sacré des
interdits. Les rites funéraires sont alors à comprendre comme une
quête de salut, d'une part, pour éviter la contamination de la
violence de la mort et ; d'autre part, pour bien séparer le monde
profane du travail du monde sacré des interdits.
192
Il est interdit de tuer, mais cette interdiction peut
être levée - et non supprimée - par des rituels qui
convertissent le meurtre en sacrifice. Le propre du sacrifice par immolation
est qu'il est un acte rituel qui consiste à renoncer à un bien
pour un autre plus grand, c'est-à-dire une quête du salut de
l'homme au sein de la transcendance verticale. Autrement dit, le sacrifice est
une valeur d'échange et non une valeur d'usage en termes
d'économie. Lorsque l'on tue un zébu pour la boucherie, il s'agit
d'une valeur d'usage ; quand il est tué en sacrifice, c'est la valeur
d'échange qui est actualisée au sein d'une quête de
salut.
Donnons un dernier exemple pour illustrer le sacrifice comme
valeur d'échange afin de bien préciser le statut du salut.
Dans la mythologie, il y a un sacrifice célèbre.
Quand, sous l'égide d'Agamemnon, les Grecs ont levé une
armée pour aller reprendre Hélène ravie par le Troyen
Pâris, leur flotte fut bloquée par des vents nuls à Aulis.
C'est alors que le devin Calchas révéla que la divine
Artémis, déesse de la chasse, punissait ainsi les grecs pour
avoir abattu des animaux sauvages et que pour apaiser sa colère, il faut
sacrifier Iphigénie, la fille d'Agamemnon.
C'est le célèbre sacrifice à Aulis. Nous
voyons très bien alors que le sacrifice a pour but la réussite
d'une entreprise humaine. Autrement dit, pour le salut de l'homme. L'immolation
d'une jeune fille vierge est monnaie courante dans les temps anciens ; ainsi,
nous apprenons que pour changer le lit du fleuve Maninday dans le Sud-Ouest de
Madagascar, il a fallu sacrifier une jeune fille vierge afin qu'en cas de crue
le fleuve n'inonde pas le tombeau royal dont la colère serait
très préjudiciable à l'activité humaine.
Témoignent de ce sacrifice les banians de Miary.
S'il en est ainsi du salut, il nous faut maintenant l'embrayer
sur la délocutivité. BENVENISTE définit la
délocutivité de la manière suivante : « Un verbe
est dit « dénominatif » s'il dérive d'un nom ; «
déverbatif », si d'un verbe. Nous appellerons DÉLOCUTIFS des
verbes dont nous nous proposons d'établir qu'ils sont
DÉRIVÉS DE LOCUTIONS » ([1966] 1982, p. 277)
Un dénominatif est par exemple le verbe «
s'évertuer » qui dérive de « vertu » et un
déverbatif, la conversion d'un verbe en nom comme « création
» à partir de « créer ». Le rapport ainsi mis en
évidence est donc un rapport morphologique.
Nous n'avons plus besoin, à la lumière de cette
définition, de définir ce que c'est une locution, il suffit de
comprendre qu'une locution est un discours qui se caractérise par une
forme plus ou moins stabilisée par le fait qu'il a pour mission de
modifier un rapport interlocutif qui implique la double transcendance. En ce
qui concerne le salut tel qu'il est décrit ici, l'homme s'adresse aux
divinités dans des formules rituelles pour accomplir sa quête ou
plus exactement sa requête relative aux interdits.
Ce discours rituel contient matériellement le mot
« salut » ; et lorsque l'on se rend compte que le propre du rituel
est une permanence de la forme, on comprend facilement pourquoi le segment de
discours ainsi concerné soit appelé « locution ». De
cette première remarque il faut passer à une seconde pour
comprendre le mouvement délocutif.
193
Le rapport interlocutif avec les divinités ne peut pas
être effectué par n'importe qui. Il faut que ce soit une personne
habilitée à le faire puisque la puissance divine peut être
dangereuse pour une personne faible. C'est ainsi que les femmes et les enfants
sont toujours écartés de la fonction de prêtrise. Mais le
prêtre - dans une acception très large - n'officie pas toujours
pour lui-même, puisqu'il est une personne habilitée, tout humain
en quête de salut s'adresse à lui.
BENVENISTE, avec son style propre nous rapporte cette
différence d'office avec son explication du cas moyen en ces termes :
« Sur le sens général du moyen, tous
les linguistes s'accordent à peu près. Rejetant la
définition des grammairiens grecs, on se fonde aujourd'hui sur la
distinction que PÂNINI, avec un discernement admirable pour son temps,
établit entre PARASMAIPADA « mot pour un autre » (=actif), et
L'TMANEPADA, « mot pour soi » (=moyen). À la prendre
littéralement, elle ressort en effet d'oppositions comme celle dont le
grammairien hindou fait état : skr. YAJATI « il sacrifie »
(pour un autre, en tant que prêtre) et YAJATE, « il sacrifie »
(pour soi en tant qu'offrant) » (BENVENISTE, [1966] 1982, p. 170).
C'est quand le prêtre officie pour autrui, son discours
peut être commenté par quelqu'un d'autre qui voulait rapporter
l'événement en disant : il fait le salut pour tel mariage ou tel
autre événement qui met l'individu en position de transgression
d'interdit. Comme le factitif est à l'origine de plusieurs verbes, par
exemple « faire la roue » c'est « rouler », « faire le
tremble » c'est trembler. C'est ainsi que faire le salut a donné
naissance par délocutivité au verbe « saluer », il ne
s'agit pas là d'une simple dérivation morphologique, étant
donné que le prêtre officiant intercède en faveur d'une
autre personne, c'est cette différence que précise la remarque
suivante :
« Soit le verbe latin SALUTARE, « saluer ».
La formation en est limpide ; SALUTARE dérive de SALUS-TIS ; c»est
donc, à strictement parler, un dénominatif en vertu d'une
relation qui semble évidente. En réalité le rapport de
SALUTARE à SALUS exige une autre définition ; car le SALUS qui
sert de base à SALUTARE n'est pas le vocable SALUS, mais le souhait
SALUS ! » (BENVENISTE, [1966] 1982, p. 277)
La racine historique du délocutif « saluer »
est donc religieuse. Si le prêtre salue pour un mariage, c'est parce que
l'union d'un homme à une femme - au sens strict - est un interdit dans
la mesure où c'est une débauche d'énergie au service du
jeu pur des sens. Si cela est admis, il nous faut maintenant expliquer pourquoi
la vie sociale avec ou sans relation à la transcendance verticale n'est
possible sans salutation. En effet, il est très instructif de constater
que rencontre et séparation sont l'occasion de salutation.
Commençons d'abord par le comportement vernaculaire qui
intègre une croyance aux divinités. Le pluriel du mot signale le
caractère animiste de cette croyance comme nous le verrons dans
l'analyse de la salutation.
Il existe une donnée qui permet de comprendre la
démocratisation de la salutation à tous les membres de la
société. La vie est rythmée par l'activité diurne
et le sommeil nocturne.
194
Pendant l'activité diurne, les esprits malfaisants ont
une moindre efficacité à cause de la lumière du jour et la
solidarité des humains qui sont à portée de voix ou
à portée de regard. Mais pendant le repos nocturne cette
vigilance collective ne peut plus être tenue, à cause à la
fois de l'obscurité et du sommeil. Ce qui veut dire que pendant la nuit,
chaque individu est livré à lui-même, et c'est ce moment de
séparation absolue qui favorise les actions des esprits malfaisants
puisque l'individu est vulnérable.
C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de se
saluer au réveil pour renouer avec la transcendance horizontale. Mais en
quoi consistent les salutations en ce moment d'éveil ? C'est une
salutation qui ne comporte pas souvent le verbe « saluer » bien qu'on
la comprenne à partir de la valeur illocutoire de ce verbe.
Il s'agit en fait de demander comment s'était
passé la nuit. À première vue, donc, l'acte illocutoire
accompli est une interrogation. Pour que cette interrogation soit comprise
comme un acte de salutation, il faut faire intervenir la notion de
dérivation illocutoire ou de trope illocutoire.
ANSCOMBRE présente la dérivation illocutoire
comme un moyen de préservation de la face quand on est contraint de
solliciter quelqu'un à une action. Voici cette présentation
à partir d'un exemple:
« -Pouvez-vous ouvrir la fenêtre ?
Très grossièrement, I1 est la question VOUS
EST-IL POSSIBLE D'OUVRIR LA FENÊTRE ? et I2 la requête OUVREZ LA
FENÊTRE, POUVOIR étant le marqueur requérant - si rien ne
s'y oppose - l'application de la loi de discours : « Questionner quelqu'un
sur ses possibilités de faire une action F, c'est lui demander de faire
F » (ANSCOMBRE, 1980, p. 87)
La notion de trope illocutoire ne diffère pas
sensiblement de la notion de dérivation illocutoire comme en
témoigne le passage extrait suivant des textes de KERBRAT-ORIOCCHIONI
:
« [...], « Tu peux me passer le sel ? »
peut être considéré comme un trope dans ma mesure où
l'énoncé signifie bel et bien « Passe-moi le sel »,
comme en témoigne l'enchaînement, et le fait que les conditions de
réussite auxquelles est soumis un tel énoncé sont pour
l'essentiel celles qui caractérisent la requête, et non celles qui
sont propres à la question ( en tant que question,
l'énoncé est non « relevant », donc susceptible
d'« échouer » : de même que dans une métaphore,
ses conditions de vérité concernent avant tout le sens
dérivé, de même en cas de trope illocutoire, ses conditions
de réussite sont liées à la valeur dérivée
et non point littérale. » (KERBRAT-ORECCHIONI, 1994, p. 59)
Nous avons présumé que la question de la
première rencontre, au matin, qui porte sur la manière dont
s'était passé la nuit, a pour mission d'accomplir une salutation.
Mais cette présomption ne va pas de soi parce qu'elle n'est garantie ni
par la notion de dérivation illocutoire ni par le trope illocutoire que
de manière indirecte. Ce qui fait problème par rapport
195
aux exemples allégués dans les notions
convoquées, c'est qu'ici la question ne porte pas sur la
possibilité de faire quelque chose mais sur un état de chose.
Il nous faut donc expliquer la particularité de cette
question pour la comprendre comme trope illocutoire. La question a une base
intertextuelle. En effet, elle n'est posée que sur la base de
l'état des personnes lors de la dernière entrevue, un état
que l'on souhaite se maintenir car conforme aux quêtes de salut qui ont
cours dans les rites. La question revient donc à se demander si les
divinités continuent d'accorder leur salut aux hommes.
C'est bien par métalepse que la question glisse des
divinités aux hommes puisque comme il est souligné plus haut,
seuls les prêtres peuvent traiter avec les divins. En plus traiter avec
les divins exigent des formules rituelles. GOBARD, dans une analyse de la
composante magique du langage nous dit la même chose :
« "Amen" peut correspondre pour une traduction
simplement cognitive à "qu'il en soit ainsi", ou familièrement
à "d'accord" ou "okay". La substitution du seul signifié
privé de son signifiant magique démontre aussitôt que c'est
bien le signifiant absolu qui fonctionne comme tel.
"Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
d'accord".
L'effondrement instantané de la formule rituelle
lorsqu'elle s'active au niveau de la dénotation d'un accord ordinaire
est bien la preuve que l'on ne traite avec le surnaturel que grâce
à un langage extralinguistique » (GOBARD, 1980, p. 193)
Il faut entendre par langage extralinguistique ici, les
formules rituelles qui ne supportent pas de modification signifiant dans une
démarche sémasiologique, un langage destiné au rapport
interlocutif avec la transcendance verticale.
On voit bien maintenant que faute de pouvoir traiter avec le
divin sans offrande, il n'est pas possible d'établir un lien direct avec
lui. Le détour métaleptique est là pour contourner
l'obstacle. Il s'ensuit une démocratisation de l'acte de salut. Pour
justifier cette démocratisation, il n'est que d'analyser
l'euphémisme caractéristique de l'enchaînement à la
question:
3. Nafohany [il m'a remis debout]
Dans cette traduction, nous avons le pronom impersonnel "il"
qui est décrit dans la grammaire traditionnelle comme un pronom de la
troisième personne à quoi BENVENISTE rétorque c'est le
pronom de la personne absente ou de la non-personne:
« La troisième personne représente en
fait le membre non marqué de la corrélation de personne. C'est
pourquoi il n'y a truisme à affirmer que la non-personne est le seul
mode d'énonciation possible pour les instances de discours qui ne
doivent pas renvoyer à elles-mêmes, mais prédiquent le
procès de n'importe qui ou n'importe quoi hormis l'instance même,
ce n'importe qui ou n'importe quoi pouvant toujours être muni d'une
référence objective. » (BENVENISTE, [1966] 1982, pp.
254-255)
196
La non-personne est ce qui est exclue par les instances de
discours « je » et « tu » qui sont des individus
linguistiques. Dans la mesure où les divinités ne se manifestent
pas par une instance de discours, elles sont donc une non-personne. C'est dans
ce sens que LEVINAS parle d'« illéité » (LEVINAS,
1992). Ce « il » de la traduction est imposé par le fait que
l'on ne peut pas traiter avec les divinités comme un allocutaire
susceptible de devenir un « je » que dans les moments sacré de
l'office.
Quand on sait que ces offices ont globalement pour but de
demander le salut des hommes auprès des divinités, ce salut est
envisagé comme un état qui perdure et non comme un état
ponctuel au moment de l'office, il est normal que ce salut soit envisagé
de manière détournée dans le vécu profane de tous
les jours. C'est ce que nous montre l'euphémisme « il » pour
renvoyer à une divinité pour éviter de la nommer au risque
de provoquer sa colère. Ce rapport de prudence avec la divinité
est bien expliqué dans la Bible au moment où Moïse va
rencontrer Dieu : « Va avertir le peuple de ne pas se
précipiter pour me voir. Sinon beaucoup d'entre eux mourraient.
Même les prêtres, qui peuvent pourtant s'approcher de moi, doivent
se purifier, de peur que je n'intervienne contre eux » (EXODE, pp.
19, 21-22)
Par ailleurs, FREUD précise que, parmi les objectifs du
tabou, il y a la nécessité de protéger les humains
contre la puissance ou la colère des Dieux ou des démons
(FREUD, Totem et Tabou, [1912]1993, p. 22). En ce qui concerne les prohibitions
religieuses, l'interdit de s'approcher des Dieux fonctionne de la même
manière : un tabou qui vise à protéger les hommes de la
puissance divine comme nous le pouvons constater ci-dessus, dans le passage de
l'Exode. Cette interdiction s'étend aussi au niveau
linguistique : « Tu ne prononceras pas mon nom de manière
abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit
ainsi » (EXODE, 1982, pp. 20, 7)
Ainsi, à partir de cette démocratisation, saluer
n'est plus le privilège des prêtres d'autant plus que la
séquence linguistique pour l'accomplir ne contient plus
nécessairement le terme de la locution de crainte de blasphémer,
car il ne s'agit pas d'un moment sacré d'un rituel, mais d'un moment du
vécu profane au quotidien. En définitive, cette salutation est
accomplie comme telle par interpénétration de la transcendance
horizontale et de la transcendance verticale.
La transcendance verticale interdit la référence
directe aux divinités dans la question qui manifeste la salutation.
C'est pour cela que la salutation ne fait pas référence directe
au salut que seules les divinités peuvent prodiguer ou refuser. Nous
avons vu que le rapport entre ce salut et la question est métaleptique.
L'enchaînement atteste cette référence indirecte par
l'utilisation du « il » qui est un moyen naturel pour désigner
la non personne. Rappelons que la non-personne est à la fois la personne
qui n'est pas impliquée en tant qu'acteur dans la communication.
C'est-à-dire les personnes qui ne sont ni destinateurs ni destinataires
de la parole mais qui peuvent en être l'objet. Et également, les
objets du monde qui ne peuvent pas être locuteurs dans une communication
sauf personnification ou allégorie. Il ne faut pas oublier qu'en outre,
la non personne est aussi les divinités ou les puissances surnaturelles
dont les noms sont frappés de tabou linguistique.
197
Cependant, on peut économiser cette explication en
faisant intervenir le mécanisme de la règle du détachement
du sens. Prenons d'abord connaissance de la version faible de cette
règle : « Règle (faible) de détachement du sens:
Si on peut démontrer P, si de plus on peut démontrer (P signifie
Q), alors on peut démontrer Q. (CORNULIER, 1982, p. 127)
Cette règle porte le numéro de paragraphe «
C » et elle correspond au théorème « C' » que nous
reproduisons également ci-contre :
« Thèse (faible) de détachement du
sens: ((P & (P signifie Q)) implique Q. Dans les formulations C et C' du
détachement du sens, on peut appeler P L'INTERPRÉTÉ, Q
L'INTERPRÉTANT, et la proposition « (P signifie Q) »
L'INTERPRÉTATION. L'idée du détachement (faible) du sens
est que la conjonction d'un interprété avec une
interprétation implique l'interprétant. » (Ibid.)
Dès lors questionner quelqu'un du réseau de la
transcendance horizontale sur le comment il a passé la nuit, c'est faire
référence indirecte au fait que pendant la nuit chaque individu
est livré à lui-même avec pour seule protection le salut
qui s'accorde ou se refuse de la part des divinités. Si cette question
fonctionne comme P dans le cadre de la thèse du détachement du
sens, alors on peut accepter que poser cette question, c'est y lire, dans le
cadre des tabous linguistiques liés aux divinités, une question
sur son salut. C'est donc questionner sur son salut, selon la thèse du
détachement du sens.
L'objection qui peut être soulevée maintenant
contre cette première application de la règle du
détachement est consistante pour être passée sous silence.
Questionner sur le salut d'un individu, n'est pas le saluer.
Ainsi, pour résoudre la contradiction entre ce que nous
prétendons démontrer et cette objection, il nous faut faire
intervenir, une seconde fois, la règle du détachement du sens
à partir d'un autre interdit.
Nous avons pris connaissance dans l'analyse du salut qu'il
appartient à une locution parce que faisant partie d'une formule
rituelle à partir de laquelle les prêtres, et exclusivement eux,
ou quelqu'un d'équivalent, s'adressent à Dieu pour demander le
salut des hommes. L'interdiction revient alors à dire qu'il faut
être un prêtre pour être autorisé à parler de
salut, car le salut est un privilège des Dieux.
Si, en plus, l'on sait que le salut ne peut pas être
commandé mais seulement suggéré - comme d'ailleurs toute
requête - on comprend pourquoi il nous faut appliquer de nouveau
appliquer la règle du détachement du sens. En effet, il y a lieu
de croire que l'interdit est une contrainte et que toute contrainte cherche une
issue la moins coûteuse. Voici justement un exemple emblématique
de cet interdit. Il s'agit de la prière de Jésus Christ dans le
jardin de Gethsémané : « Ô mon Père, tout
t'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non
pas ce que je veux, mais ce que tu veux! » (De l'Évangile
selon saint Marc. 14,36)
Cet interdit empêche à l'homme ordinaire a
fortiori de présumer du salut de qui il s'inquiète en vertu
de la transcendance horizontale. Ce qui explique que son souhait se mue
198
en question. C'est ce que nous pouvons retrouver de nouveau
dans la règle du détachement du sens.
Dans le premier résultat de la règle nous avons
dit que poser une question sur la manière dont quelqu'un a passé
la nuit implique une question sur son salut. Ce résultat à son
tour devient un P et ce P signifie Q que l'on salue, donc par la règle
du détachement faible, c'est saluer dans le sens illocutoire.
Nous retenons de ces explications que la
délocutivité peut connaître un enchâssement multiple
sous la contrainte d'interdit linguistique et que la délocutivité
est une citativité illocutoire. C'est-à-dire que la locution de
laquelle dérive le terme délocutif est performative, une
performativité qui motive tout le discours contenant la locution, voire
motivant la transcendance verticale et la transcendance horizontale sous la
perspective de la quête du salut. Les discours qui correspondent à
cette définition sont innombrables et traversent les temps et les
espaces qu'il nous semble que l'on peut tenir cette conclusion comme
pertinente.
Afin de la conforter observons une autre apparition de la
salutation dans une sémiotique autre que linguistique. Ce faisant, nous
souscrivons entièrement à la remarque de BENVENISTE qui remanie
le paradigme saussurien entre linguistique et sémiologie. Saussure pense
que la linguistique est un territoire parmi la sémiologie qu'il assigne
à l'étude de la vie des signes au sein de la
société. (SAUSSURE, 1982, p. 33). Voici ce changement de
paradigme :
« Toute sémiologie d'un système
non-linguistique doit emprunter le truchement de la langue, ne peut donc
exister que par et dans la sémiologie de langue. Que la langue soit ici
instrument et non objet d'analyse ne change rien à cette situation, qui
commande toutes les relations sémiotiques ; la langue est
l'interprétant de tous les autres systèmes, linguistiques et
non-linguistiques. » (BENVENISTE E. , [1974] 1981, p. 60)
Pour accomplir une salutation, dans le cadre du stress de la
concentration de populations dans les grandes agglomérations, voici
quelques expressions - au sens sémiotique de ce terme - qui ne sont pas
du tout linguistiques mais relèvent d'autres codes comme le gestuel, le
visuel ou le sonore, mais interprétées comme salutation revient
pratiquement à « saluer », c'est-à-dire, accomplir par
leur production un acte de langage que l'on qualifie de salutation.
Parmi ces expressions, nous pouvons citer le hochement de
tête, la main portée à hauteur de la tête (forme
dérivée du salut militaire), la main levée à
n'importe quelle hauteur avec la paume en avant, etc. En ce qui concerne les
automobilistes, l'expression interprétée est soit un coup
d'avertisseur, soit un appel de phare. À celles-là, on peut
ajouter les différentes manifestations vocales inanalysables produites
au moment des rencontres.
La remarque que nous devons produire sur ces exemples consiste
à dire que nulle part, il n'est fait mention du mot « salut »
ni du verbe « saluer », ni même mention de quelque chose qui
puisse être qualifié de linguistique, pourtant la salutation est
accomplie. Cet
199
accomplissement ne doit pas nous rendre perplexe puisque dire
« salut )) dans les conditions décrites dessus suffit à
saluer selon la délocutivité.
Cette description fait qu'il n'y a pas de raison à ce
que l'on s'oppose au fait que l'on remplace ce « salut »
délocutif, forme ritualisée, par d'autres sémiotiques.
C'est ce que prévoit la règle de détachement fort du sens
dont voici la formulation et le commentaire allant dans le sens de ce que nous
voulons expliquer :
« Quel que soit P, quel que soit Q, ((P & (P signifie
Q)) signifie Q).
[...]Le détachement du sens est donc un principe
qui permet à un langage de s'incorporer n'importe quel
élément nouveau comme signe de n'importe quelle valeur qu'on
puisse déjà y exprimer. En ce sens, l'inventivité
sémiologique est arbitraire, radicalement et totalement, dans la mesure
où le détachement fort du sens a la force d'une règle.
» (CORNULIER, 1982, p. 136)
C'est ainsi que, en application de la règle de
détachement du sens (version forte), des sémiotiques qui ne sont
plus linguistiques, donc sans relation morphologique du tout avec la locution
originale, reprend la valeur illocutoire du paradigme dans les conditions
d'énonciation équivalente, pour accomplir cette valeur
illocutoire. Cependant, il ne faut pas croire que cette valeur illocutoire est
exactement la même que celle dont elle dérive. Les salutations
effectuées dans ces sémiotiques privilégient exclusivement
la transcendance horizontale.
On s'aperçoit alors que la salutation ainsi
dépourvue de relation avec les divinités n'est plus perçue
comme une quête de salut, mais une quête de reconnaissance dans le
réseau de transcendance horizontale. C'est pour cette raison que cette
salutation peut se permettre d'accueillir diverses formes sémiotiques.
Sinon, les hochements de tête, les levers de chapeau, la main
donnée, etc. produit au moment de la première rencontre, ne
signifient aucune valeur illocutoire. Ce qui veut dire que « saluer »
dans sa version citadine est devenu l'effectuation d'une reconnaissance, une
reconnaissance qui a donné naissance à la possibilité de
l'énonciation suivante :
4. Je salue le courage de cet homme
Que l'on interprète, en seconde application de la
règle du détachement du sens, ces salutations dans d'autres
sémiotiques comme une simple marque de politesse n'empêche pas que
la marque de politesse s'effectue sur la base de cette reconnaissance.
Même, quand la salutation prend une forme linguistique, les contraintes
de la trépidation de la ville continuent de s'appliquer de telle
manière qu'il suffit de dire «bonjour )) pour accomplir la
salutation. Une salutation qui ne s'interprète plus comme :
5. Je souhaite que vous ayez un bon jour.
Ce qui veut dire que la règle du détachement du
sens (variante forte) peut servir d'appui pour expliquer le
phénomène de la délocutivité conformément
à son enrichissement chez
200
DUROT qui la formule comme suit : « Je prendrai pour
E1, le signifiant salus muni de la signification S1, et pour E2, ce même
signifiant, mais compris comme S2. Si l'on admet que E2 est
dérivé de E1, il est assez facile de tenir cette
dérivation pour délocutive. » (DUCROT, 1980, p. 48)
En définitive, saluer dans cette
surdélocutivité est une manière d'accomplir une fonction
phatique dans le sens Bronislav MALINOWSKI : établir un contact entre
membre d'un même réseau de transcendance horizontale.
Travaux cités
ANSCOMBRE, J.-C. (1980). "Voulez-vous dériver avec
moi?". Dans Rhétoriques, Communications (Vol. 16, pp. 61-123).
Paris: Seuil.
BENVENISTE, E. ([1966] 1982). Problèmes de
linguistique générale,1. Paris: Gallimard. BENVENISTE, E.
([1974] 1981). Problèmes de linguistique générale, II.
Paris: Gallimard.
CORNULIER, B. (1982). "Le détachement du sens" dans Les
Actes de Discours, Communications,32. Communications, pp. 125-182.
DUCROT, O. (1980). "Analyses pragmatiques". (Seuil, Éd.)
Communications(32). EXODE. (1982). Bible. Paris:
Société biblique française.
FREUD, S. ([1912]1993). Totem et tabou, Quelques
concordances enter la vie psychique dessauvages et celle des
névrosés. (W. Marièlene, Trad.) Paris: Gallimard.
GOBARD, H. (1980). "Diglossie ou tétraglossie,
tétragénèse du langage". Dans B. GARDIN, & J.-B.
MARCELLESI, Sociolinguistique, Approches, Théories, Pratiques
(pp. 191-195). Paris: Presses Universitaires de France.
HEIDEGGER, M. (1987 [1949]). Les chemins qui ne mènent
nulle part. Paris: Gallimard.
KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1994). "Rhétorique et
Pragmatique: les figures revisitées". Langue française,
volume 101, N°1, pp. 57-71. Récupéré sur
Persée.
LEMELIN, J. M. (1996). L'expérience ou
l'évènement tragique. Consulté le août 17,
2013, sur
https://www.google.mg/#bav=on.2,or.r_qf.&fp=d6bc00e82892d683&q=lemelin+:+exp%5E%
C3%A9rience+t+%C3%A9v%C3%A9nement+tragique:
www.ucs.mun.ca/~lemelin/EVENEMENT.html
LEVINAS, E. (1992). De Dieu qui vient à l'idée.
Paris: Librairie philosophique J. Vrin. SAUSSURE, d. F. (1982). Cours
de Linguistique Générale. Paris: Payot.
201
202
14. À PROPOS DE MORPHÈME «MBA
»
RÉSUMÉ :
Le morphème « mba » est d'une haute
fréquence dans le rapport interlocutif car il sert à
atténuer une requête ou une affirmation. Il est donc perçu
comme un adverbial mais en réalité, son fonctionnement vise la
préservation de la face dans la mesure où se locuteur se trouve
en position de faiblesse par rapport à son interlocuteur. Il y donc lieu
de comprendre que c'est un adoucisseur au sens pragmatique de ce terme et du
coup, il est en position de surdélocutivité.
Mots clés : « mba », prière, adoucisseur,
préservation de la face, rapport interlocutif.
Abstract :
«Mba» morpheme is a high frequency in the
interaction report because it is used to reduce a query or statement. It is
therefore seen as an adverbial, but in reality, its operation is the
preservation of the face where is speaker is in a weak position compared to his
interlocutor. It is therefore understand that it is a softener to the pragmatic
meaning of this term and in this way, it is in a position to
surdelocutivite.
Key words: «mba», prayer, softener, preservation of the
face, report interaction.
À l'instar des analyses pragmatiques de détail
de DUCROT (Analyses pragmatiques, 1980), nous allons essayer de
démontrer que certains morphèmes ne sont pas
compréhensibles que par référence à
l'énonciation et que certains de leurs emplois les rangent dans ce que
BENVENISTE appelle « délocutif »
Nous allons commencer par le morphème « mba
». Il y a lieu de comprendre ce morphème comme un adverbe. Il a
donc pour fonction de modaliser le verbe afin de montrer une attitude du
locuteur dans le rapport interlocutif. Quand on parle de modalisation,
très souvent on pense seulement aux verbes modaux, mais depuis la notion
de modalisation autonymique développée par Jacqueline
AUTHIER-REVUZ, on peut dire que la modalisation fait que la séquence
linguistique montre une attitude du locuteur tout en continuant à
signifier comme les autres éléments du discours (AUTHIER-REVUZ,
2001), autrement dit, les modaux ne sont pas uniquement des verbes.
On peut dire que d'une manière globale, le
morphème « mba » est au service de la préservation de
la face. La question de la face a pris naissance dans les textes de GOFFMAN qui
est un sociologue et fut depuis appropriée par la pragmatique. Cette
appropriation est normale parce que justement la communication tient compte du
rapport interlocutif et que de la sorte il est important de modaliser ce qui
est dit de manière à préserver une forme
d'équilibre entre les interlocuteurs, sinon la question de la
hiérarchie se posera de manière cruelle. Voici comment GOFFMAN
présente cette notion de face de ses textes :
203
« Un individu "garde la face" lorsque la ligne
d'action qu'il suit manifeste une image de lui-même consistante,
appuyée par les jugements et les indicateurs venus des autres
participants, et confirmée par ce que révèlent les
éléments impersonnels de la situation. Il est alors
évident que la face n'est pas logée à l'intérieur
ni à la surface de son possesseur, mais qu'elle est diffuse dans le flux
des événements de la rencontre, et ne se manifeste que lorsque
les participants cherchent à déchiffrer dans ces
événements les appréciations qui s'y expriment. La ligne
d'action d'une personne pour d'autres personnes est généralement
de nature légitime et institutionnalisée. ». (GOFFMAN, 1984
(éd. or. 1974), p. 10)
De la sorte, en fonction de la modalisation des
énoncés, on peut garder ou perdre la face. C'est pour cette
raison que nous définissons ces deux possibilités dans
l'hypéronyme "préservation de la face". Dans la
littérature anglaise de la pragmatique cette préservation de la
face reçoit le concept de "face work". Parmi les auteurs qui
ont contribué à la mise en place de la notion de "face work" au
sein de la pragmatique, nous pouvons citer Robin LAKOFF (1974) qui s'inspire
des travaux de H. Paul GRICE (1975). Autrement dit, la préservation de
la face est au coeur de la question de la politesse dans la communication,
notamment dans le parcours conversationnel. Le modèle le plus
opératoire semble être celui de Pénélope BROWN et
Stephen LEVINSON ([1978] 2000). Cependant, la radicalisation de l'opposition
entre communication irénique (harmonieuse) et communication agonale
(conflictuelle) fut tempérée par (KERBRAT-ORRIOCHIONI, 1996) qui
soutient que ces deux faces de la communication ont tendance à coexister
dans l'échange verbal, mais cela n'implique pas que la
préservation de la face ne soit pas une quête permanente dans
toute énonciation.
De ce préliminaire, nous pouvons inférer que le
morphème "mba", qui nous intéresse, sert à la
préservation de la face en tenant compte de ses divers emplois dans le
discours. Il ne serait pas faux de traduire "mba" par « prière
» mais dans le cadre d'évolution de ce travail il est
l'équivalent pragmatique exact de "je vous en prie" ce qui nous permet
de comprendre sur la base de la grammaire générative, cf.
(CHOMSKY, 1975) que ce morphème doit toujours être un
élément de la phrase matrice et a pour mission de donner un effet
adoucisseur à l'énonciation.
Plus précisément, la fonction pragmatique de ce
morphème est de modaliser un autre acte de langage: la demande ou la
requête ou quelque chose d'équivalent comme la sollicitation.
Cette dernière remarque va nous permettre de mieux caractériser
la demande et ses équivalents.
On peut inscrire la demande dans le cadre de la
catégorie désir dont la propriété est
caractérisée par un manque. C'est ce que nous apprend la logique
narrative qui fait naître le texte à partir d'un manque comme le
souligne l'algorithme narratif (GREIMAS, [1966b]1981, pp. 29-30); ce qui veut
dire que l'on ne peut désirer que ce que l'on ne possède pas. Il
en résulte que la condition d'existence d'une demande est que le sujet
demandant n'a pas les moyens de satisfaire ses propres désirs, ou en
termes sémiotiques, qu'il n'a pas les moyens de réaliser la
conjonction avec son objet de désir. C'est pour cette raison que la
demande
204
s'adresse toujours à quelqu'un d'autre que le demandeur
considère comme disposant des moyens nécessaires à la
conjonction d'objet.
Dès lors, il s'avère que la satisfaction du
désir dépend entièrement de l'autre, il est donc
nécessaire de le mettre dans de bonnes dispositions pour qu'il
s'exécute dans le sens du demandeur. Dans la langue malgache, l'un des
moyens de cette mise à bonnes dispositions est justement le
morphème "mba". D'un premier abord, "mba" est un morphème qui
sert à adoucir une demande. Ce qui veut dire très exactement que
"mba" est non seulement un adverbe mais en outre il rendre dans la
catégorie de ce que BENVENISTE appelle "individu linguistique" selon la
définition suivante:
« Les formes appelées traditionnellement
«pronoms personnels», «démonstratifs» nous
apparaissent maintenant comme une classe d'«individus linguistiques»,
de formes qui renvoient toujours et seulement à des
«individus», qu'il s'agisse de personnes, de moments, de lieux, par
opposition aux termes nominaux qui renvoient toujours et seulement à des
concepts. Or le statut de ces «individus linguistiques» tient au fait
qu'ils naissent d'une énonciation, qu'ils sont produits par cet
événement individuel et, si l'on peut dire,
«semel-natif». Ils sont engendrés à nouveau chaque fois
qu'une énonciation est proférée, et chaque fois ils
désignent à neuf. » (BENVENISTE E. , [1974] 1981, p.
83)
"Mba" en tant qu'individu linguistique possède encore
un caractère singulier: il ne peut avoir de référence
extralinguistique mais seulement sui-référentiel dans la mesure
où il ne désigne pas mais sert seulement à accomplir un
acte linguistique à propos d'un autre. C'est ce que permet de mettre en
évidence le contraste des exemples suivants:
1. Omeo rano aho [donne-moi de l'eau]
2. Mba omeo rano aho [Je vous prie de me donner de
l'eau]20
On peut considérer que dans (1) le locuteur accomplit
une injonction tandis que dans (2), la demande telle qu'elle se présente
dans (1) est convertie par le morphème mba en une sollicitation
de faveur. Cette interprétation du morphème est semble-t-il son
premier emploi. Du point de vue du rapport interlocutif, voici le
mécanisme mis en jeu dans le contraste de ces deux exemples.
On peut admettre sans discussion que dans la plupart des cas
celui qui donne de l'ordre est habilité à le faire. Une
habilitation qui lui vient d'une position hiérarchique
supérieure. Nous pouvons constater cela facilement dans la
hiérarchie militaire. C'est pareil cas dans toute forme
d'administration. Nous n'en voulons pour preuve que la formule d'exorde dans
les demandes écrites qui est reproduite suivant à titre
d'exemple:
20 On peut aussi accepter par
référence aux buts pragmatiques la traduction suivante "donne-moi
de l'eau s'il vous plaît". Mais il faut noter que l'expression s'il vous
plaît n'existe pas en malgache que sous forme d'emprunt [raha
sitrakao]
205
3. J'ai l'honneur de solliciter votre haute bienveillance de
...
L'intérêt de cette formule est qu'elle affecte de
signes symétriquement inverses les acteurs de la communication.
Commençons paradoxalement par le destinataire de la parole. Tout
d'abord, faisons remarquer que le terme d'adresse est un "vous" qui est une
marque de respect dans son refus d'une familiarité ou, ce qui revient au
même, dans l'instauration d'une distance dans le rapport interlocutif.
Ce qui veut dire dans le cadre de la préservation de la
face que l'introduction du morphème "mba" dans la demande a pour effet
de rehausser le destinataire de la parole à un rang supérieur, et
symétriquement, le destinateur se retrouve dans une position
inférieure parce que dépendant du bon vouloir du destinataire.
Contrairement à cela, dans (1), nous avons une
inversion des signes des valeurs aux actants de la communication. Dans (1),
c'est le destinateur de la parole qui se trouve dans une position
hiérarchiquement supérieure. On peut admettre en effet que la
possibilité de donner un ordre implique une hiérarchie dans le
rapport interlocutif selon lequel on ne peut pas donner un ordre à son
supérieur. C'est qu'attestent les répliques du genre: "vous
n'avez pas à me donner des ordres" ou "je n'ai pas à recevoir vos
ordres" dont le but pragmatique est de remettre chacun à sa place.
La question de place au sens de rapport interlocutif est
discutée par François FLAHAULT. Cette question est cruciale si
d'un rapport d'amitié, l'un des acteurs de la communication veut passer
à un rapport amoureux, sur la base de la remarque suivante: «
L'illocutoire - qui n'est absent d'aucune parole, fût-ce la plus anodine
- prend appui sur le « QUI TU ES POUR MOI, QUI JE SUIS POUR TOI », y
revient, le modifie, en repart ; rien ici n'étant réglé
une fois pour toutes. » (FLAHAULT, 1978, p. 70)
En effet, un individu peut avoir plusieurs rapports sociaux
avec un autre. Or, il faut admettre que ce qui atteste de ces rapports est
l'interlocution. Ainsi, en essayant de reprendre à notre compte
l'exemple de FLAHAULT, au bureau le rapport entre le directeur et sa
secrétaire est en faveur du premier. Qu'il vient à être
prononcé entre eux le mot amour, ce rapport peut être
bouleversé. C'est ce qui a permis à FLAHAULT de faire le
commentaire ci-après :
« Mais enfin, imaginons qu'un garçon et une
fille soient bons amis: ils se trouvent apparemment dans ce cas favorable.
Pourtant, que l'un vient à « tomber » amoureux de l'autre, et
la question du « je t'aime » va se poser douloureusement à lui
(ou elle), à cause de l'augmentation considérable des enjeux qui
accompagnent ce changement [...].
C'est la peur de cet ébranlement de sa propre
identité qui conduit chacun à éviter la situation qui se
noue dans l'illocutoire explicite (performatif) pour lui préférer
l'implicite. » (FLAHAULT, 1978, p. 51)
À la lumière de ces remarques, nous pouvons
mieux comprendre la différence entre (1) et (2). Dans le premier
exemple, l'illocutoire accomplit un ordre bien que formellement c'est
206
le mode impératif qui focalise cette injonction. Nous
pouvons, ici, reprendre un argument de DUCROT qui lui sert à
caractériser l'ordre: devant un ordre, il n'y a que deux
possibilités; y obéir ou refuser d'obtempérer.
Dans le cas où l'on y obéit, malgré soi,
on atteste alors de la position hiérarchiquement supérieure de
son auteur. Sinon, on ne lui accorde pas cette position. Autrement dit, comme
le fait remarquer FLAHAULT, la question de place dans le rapport interlocutif
n'est pas réglée une fois pour toutes. Ce qui veut dire que
"mba", à la différence de ses équivalents pragmatiques
dans d'autres langues permet d'éviter de poser frontalement la question
de la place parce qu'il met toujours le destinataire en position
supérieure.
Cette dernière remarque nous amène à
identifier, dans le rapport interlocutif, l'individu linguistique destinataire
de la parole à qui l'on doit obéissance. Une obéissance
qui assure l'assomption de ce destinataire à un rang supérieur.
Nous verrons dès lors que le morphème qui nous intéresse
porte la trace mythico-religieuse du langage.
Notons qu'à l'origine, une prière a toujours
pour destinataire une divinité. À bien observer les récits
cosmogoniques, il y a toujours un être suprême à qui nous
devons tout. Cette divinité accorde ou refuse sa bienveillance selon un
principe que HEIDEGGER appelle "ouverture du monde":
« L'ouverture d'un monde donne aux choses leur
mouvement et leur repos, leur éloignement et leur proximité, leur
ampleur et leur étroitesse. Dans l'ordonnance du monde est
rassemblée l'ampleur, à partir de laquelle la bienveillance
sauvegardante des dieux s'accorde ou se refuse. » (HEIDEGGER, [1949]1987 ,
p. 48)
Nous pouvons comprendre alors que l'individu linguistique
destinataire d'une prière est celui auquel l'énonciation garantit
l'assomption à un rang supérieur, d'une manière ou d'une
autre. Atteste de cette assomption la prière de Jésus dans le
jardin de Gethsémani: « Père, tout est possible pour toi,
éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce
que tu veux! » (De l'Évangile selon saint Marc. 14,32-36)
La raison de cette prière est que Jésus ne se
sent pas prêt à subir la mort, il est très angoissé
par cette mort imminente et tente de le faire différer par cette
intervention. Pourtant, cette intervention qui est l'expression de sa propre
volonté doit céder le pas si elle n'est pas conforme à la
volonté de son Père. Ce qui veut dire qu'en cas de
non-conformité, Jésus doit accepter la mort au même titre
qu'il a accepté la vie qui lui vient de son Père.
Il n'est pas question d'accepter que la prière contenue
dans l'utilisation du préfixe performatif "mba" soit une assomption du
destinataire au rang d'une divinité. Mais on peut admettre dans le
parcours conversationnel entre être humain que "mba" est une
dérivation délocutive d'une prière adressée
à une divinité ou à la transcendance verticale. En effet,
quand on fait une prière rituelle au cours d'une offrande à une
transcendance verticale, la prière est préfixée d'un "mba"
par lequel l'"ouverture d'un monde" fait que l'on ne commande pas à
cette transcendance, mais on spécifie qu'il sera fait selon sa
volonté en dépit du désir humain.
207
En ce qui concerne le "mba" du parcours conversationnel qui
est caractérisé par la transcendance horizontale,
c'est-à-dire que le parcours conversationnel s'établit entre les
humains - il est patent que la prière dans le cadre de la transcendance
verticale ne reçoit jamais de réponse linguistique - nous avons
une attestation du caractère éminemment social du langage. Ce
caractère social découle du fait qu'il est extrêmement
difficile, voire impossible, pour un individu de vivre en autarcie. C'est cette
difficulté, ou cette impossibilité, que contourne l'emploi de
"mba" comme nous allons le constater un peu plus loin. L'échange
commercial est aussi un commerce linguistique.
En résumé, on peut dire que "mba" joue le
rôle de préfixe performatif à tout énoncé qui
accomplit une demande à autrui afin d'oblitérer l'aspect
injonctif de l'énonciation. Bien entendu dans le commerce
monétarisé, on peut accepter que le produit obtenu par une somme
d'argent est exactement la valeur d'échange de ce produit, mais il y a
la valeur d'usage qui peut être cruciale pour l'acheteur. Ce qui
implique, en fonction de cette valeur d'usage, que l'acheteur a
intérêt à inscrire sa quête dans le registre
irénique afin d'être servi au mieux.
Le registre irénique de la communication est d'autant
plus nécessaire quand la demande n'implique aucune valeur
d'échange mais seulement une valeur d'usage. C'est ce qui se passe par
exemple quand quelqu'un doit demander du feu à son voisin:
4. Saika mba hangataka afo aho [je voudrais vous demander
du feu]
La traduction est ici des plus malaisées parce que la
valeur du conditionnel relève de la combinaison du passé et du
futur. Le passé, plus exactement l'imparfait rendu par la
désinence ais suppose que la demande n'est plus dans le cas
où elle risque d'importuner le destinataire. Le futur, marqué par
le morphème r, signale que la demande est d'actualité si
le destinataire veut bien y souscrire.
On retrouve dans la source de la traduction cette combinaison
du passé et du futur. Le passé se trouve dans saika qui
signifie "avoir failli" et le futur se trouve dans le morphème h
de hangataka dont le l'infinitif mangataka signifie
"demander". Ce qui implique que le morphème "mba" a pour mission de
convertir la demande en une prière.
Nous pouvons donc dire qu'en préfixant la demande par
"mba" le destinateur affiche une distance maximale entre lui et le
destinataire, une distance dans laquelle il est au bas de l'échelle.
Tout se passe comme si cette distance était incommensurable et quand
elle venait à être réduite - et non supprimée par la
demande - l'énonciation donne au destinataire toute latitude d'accepter
ou de refuser le contenu de la prière.
Nous avons exactement la même chose dans la formule
"avoir l'honneur" qui est devenue un exorde des lettres personnelles. En disant
"j'ai l'honneur" le locuteur stipule qu'il n'a même pas le mérite
de s'adresser au destinataire mais que devant solliciter malgré lui la
bienveillance de son interlocuteur, il confère à la communication
une réduction de la distance incommensurable comme un honneur. Ainsi, la
demande est une modification du rapport interlocutif dans lequel le
destinataire est rehaussé. Le destinateur n'en est pas moins
208
rehaussé mais il se préserve d'être au
même pied d'égalité que le destinataire, car la distance
est définie comme incommensurable et que, de toute manière, le
destinateur est caractérisé par un manque qu'il n'est pas en
mesure de liquider. C'est à cette modification du rapport interlocutif
que se destine le morphème mba par assomption du
destinataire.
Benveniste a peut être défini de manière
quelque peu laconique - c'est son style propre - les individus linguistiques
dans une section où, pour la première fois, le terme
d'énonciation est caractérisé par son occurrence dans un
acte individuel d'appropriation du langage. Ce qui a pour effet de convertir
l'entité virtuelle qu'est le langage en de discours. Ce qui veut dire
que la référence à l'énonciation convertit le
discours en token sur lequel se base la sémiotique triadique de
PEIRCE.
Dans la mesure où l'individu linguistique par
excellence est le "je" défini comme désignant celui qui parle; il
s'ensuit, suivant en cela RECANATI qui traite l'énonciation dans le
cadre de la "token réflexivité" (RECANATI, 1979, p. 91 &
passim), nous pouvons donc admettre que "mba" est un individu linguistique qui
prend seulement naissance dans une énonciation qui ne peut se faire sans
le "je". Cet acte linguistique promeut littéralement à
l'existence un rapport interlocutif dans lequel le destinataire de la parole
est élevé pratiquement au rang du divin. C'est cette assomption
qui - par l'énonciation de "mba" - jette de l'ombre au destinateur; mais
il faut tenir compte que pouvoir commercer avec le divin est un honneur qui
élève également le destinateur de quelque manière.
Nous voulons prévenir par cette remarque la tentation de comprendre que
le fonctionnement de "mba" consiste à rabaisser le locuteur, car
l'objectif général de toute prise de parole n'est pas seulement
d'éviter faire perdre la face son interlocuteur mais aussi de garder sa
propre face.
Il ressort de cette première analyse que le
morphème se combine avec une injonction et a pour mission de convertir
cette injonction en demande de faveur de telle manière que le
requérant se trouve en attente du bon vouloir de celui à qui il
demande quelque chose. Autrement dit, la présence de « mba »
dans un énoncé interdit que l'énonciation soit comprise
comme une imposition ou comme un ordre. C'est donc une forme de politesse qui
permet d'éviter d'agresser la face de son interlocuteur. Rappelons pour
mémoire qu'être poli dans le cadre conversationnel, c'est
éviter de blesser l'autre par ses propres paroles; c'est ce qu'il faut
entendre ici par "préservation de la face".
En définitive, le morphème « mba »
entre dans un schème argumentatif ; c'est-à-dire en indexant
l'énonciation sur le registre de la politesse, son emploi se
révèle aussi être une stratégie argumentative qui
vise l'obtention de ce qui est demandé. La politesse impliquée
par le morphème « mba » ne vise pas seulement à
préserver la face de l'interlocuteur mais aussi celle du locuteur. En
effet, en employant « mba » dans sa demande, le locuteur tout en
affichant son désir marque aussi sa disposition à se soumettre
à la volonté de l'interlocuteur qui peut éventuellement
refuser. Mais il faut reconnaître, conformément à la maxime
selon laquelle "noblesse oblige", on ne peut pas décemment accepter
l'assomption à un rang élevé et refuser de daigner prendre
en considération la demande de quelqu'un qui s'affiche comme infiniment
plus faible que soi.
209
La société malgache est fortement ancrée
dans la transcendance et il a fort à parier que "mba" est un
délocutif d'un rituel sacré. En effet, c'est une double
transcendance qui caractérise l'individu.
La première transcendance est celle qui relie
l'individu avec les divinités comprises comme des êtres qui
accordent ou refusent leur bienveillance. Voilà pourquoi des rituels
sont prévus pour que les hommes puissent s'acquitter des obligations qui
leur sont dues. Ces obligations qui se présentent sous forme d'offrandes
sont une manière d'honorer les divinités, mais ont surtout pour
finalité de mettre ces êtres supérieurs dans de bonnes
dispositions afin qu'ils accèdent à la demande de faveur des
hommes. Ces demandes de faveur s'accomplissent dans une forme linguistique
spécifique que l'on appelle "prière" et c'est au cours de ces
prières qu'intervient le morphème "mba", puisqu'on ne peut pas
commander les divinités de qui l'existence de l'homme dépend.
C'est la transcendance verticale.
La deuxième transcendance unit l'individu avec les
autres membres de la société. Elle est appelée
transcendance horizontale, est d'une grande importance pour notre propos. Elle
signifie que l'existence individuelle implique l'existence d'autrui, et il nous
semble que la première actualisation de cette transcendance horizontale
est justement une pragmatique communicationnelle. On peut l'illustrer de
diverses manières.
Quand le boulanger veut former son fils, il l'envoie chez
l'instituteur et quand l'instituteur veut avoir du pain, il envoie son fils
chez le boulanger et ainsi de suite indéfiniment, entre le
médecin et l'instituteur, entre le couturier et lui, entre le
maçon et lui, entre le transporteur et lui, entre le cultivateur et lui,
etc.
La transcendance horizontale est donc l'expression de
l'interdépendance entre les membres d'une communauté. Même
celle qui est prétendument classée d'individualiste, comme en
Europe, ne peut pas échapper à cette transcendance horizontale
comme en témoignent les formules de politesse dans les bureaux de tabac
ou autres lieux d'échanges commerciaux. C'est ainsi que toute demande
est formulée de manière à s'engager dans une direction
irénique.
5. Le monde s'il vous plaît !
(5) est un exemple typique que l'on peut entendre couramment
dans les échanges commerciaux. On sait que l'auteur de (5) veut avoir le
journal Le monde dont il sait le lieu fournisseur. Toutefois, il faut
faire remarquer qu'il n'entend pas se procurer gratuitement l'article car le
rapport est avant tout commercial. Dès lors la formule de politesse
« s'il vous plaît » peut paraître paradoxale. En effet,
a priori il n'y a pas de raison d'employer la formule de politesse
puisque l'échange est équitable dans sa symétrie: le
vendeur a besoin d'argent et l'acheteur a besoin de journal.
Cette équité semble impliqué chaque
partenaire de l'échange trouve son compte, il y a donc lieu de se
demander pourquoi l'acheteur subordonne au plaisir de la vendeuse l'acquisition
du journal qu'il veut.
210
La réponse est que le rapport commercial est celui de
l'offre et de la demande. La sémiotisation de ce rapport montre que le
demandeur est du côté du manque et ce dont il a besoin du produit
marchand est la valeur d'usage et non la valeur d'échange. Par contre,
du point de vue du commerçant, ce dont il a besoin du produit est
justement la valeur marchande qui est une plus-value inscrite dans la valeur
d'échange. C'est cette différence qualitative de valeur
recherchée par chaque partenaire de l'échange qui fait que le
manque est du côté de la demande.
Autrement dit, en repensant cette différence
qualitative des valeurs dans le cadre de la transcendance verticale, on
s'aperçoit que la valeur à laquelle les divinités sont
sensibles n'est pas une valeur d'usage mais une valeur d'échange dont la
plus-value est l'honneur. En revanche, pour les demandeurs que sont les hommes,
la quête concerne la valeur d'usage. C'est ce qui explique les fastes et
les luxes des rituels de communication avec le divin.
En adoptant une seconde translation qui nous permet de faire
passer ces valeurs de la transcendance verticale vers la transcendance
horizontale, on retrouve la même asymétrie entre la valeur
d'échange et la valeur d'usage au profit de la première. Il
existe un fait incontestable qui confirme cette asymétrie. Dans les
crises inflationnistes: la raréfaction de marchandises ne modifie pas la
valeur d'usage comme le souligne la sentence qui stipule que la plus belle
femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Au contraire, quand le produit
se raréfie, la valeur d'échange tend à l'augmentation, un
phénomène bien connu dans l'économie de marché.
Nous en concluons que si l'argent venait à manquer, il
en résulte de pauvres individuellement, mais si c'est la marchandise qui
venait à faire défaut, c'est toute l'organisation sociale qui est
modifiée par cette absence. Ce qui veut dire précisément
que l'on peut avoir de l'argent, mais sans les journalistes qui produits les
journaux, cet argent ne sert à rien par rapport à la question du
désir qui anime l'acheteur. Autrement dit, le véritable manque
est du côté de la valeur d'usage et non du côté de la
valeur d'échange; et c'est pour cette raison que l'acheteur oriente le
parcours conversationnel dans une direction irénique.
On peut résumer de la sorte la logique qui
entraîne dans la direction irénique la demande :
Un manque crée une tension. Il en résulte que
l'on peut disposer d'argent et être en manque parce que le produit fait
défaut. Dès lors, la transcendance horizontale de l'existence se
comprend mieux. Puisque l'autarcie individuelle n'est qu'une ascèse
utopique, le travail des autres est nécessaire à la satisfaction
de notre propre désir selon la logique de la valeur d'usage. Nous devons
ajouter à cela une autre logique à titre de renforcement: on ne
peut pas désirer ce que l'on possède déjà mais
seulement le mettre en usage.
Ainsi, un boulanger use de son pain, fruit de son travail,
mais désire le fromage fruit du travail du fermier. Ce qui veut dire que
le pain ne peut provenir que du boulanger qui de la sorte est
élevé à un rang supérieur pour tout demandeur de
pain, et; symétriquement, le fromage ne peut provenir que du fromager
qui sera sollicité par tout demandeur de fromage,
211
c'est ce rapport de dépendance ou, plus
précisément d'interdépendance qui justifie la direction
irénique du parcours conversationnel. C'est cela qui explique la
performativité de « mba » et des expressions analogues. Mais
il faut remarquer que dans la transcendance horizontale, la prière
impliquée par l'emploi du morphème a perdu tout caractère
sacré. C'est en cela que le "mba" profane est un délocutif du
"mba" sacré.
Ce qui signifie exactement qu'aux fastes et luxes dans la
communication avec le divin correspondent fastes et luxes linguistiques dans la
communication profane. Précisons cette remarque. L'évidence
première est de constater que temple, église et mosquée
font l'objet d'un faste et d'un luxe particuliers parce ce sont des lieux de
célébration d'un culte, c'est-à-dire, lieu de
communication avec le divin au cours de laquelle l'homme est
caractérisé par un manque.
Parallèlement, dans la communication profane, faute de
pouvoir verser dans le faste et luxe matériels, le demandeur enrichit
les valeurs illocutoires de son énonciation. C'est ce que prévoit
l'intuition d'ANSCOMBRE quand il dit que: « D'une façon
générale, tout énoncé est la réalisation
d'au moins d'un acte illocutoire. » (ANSCOMBRE, 1980, p. 66)
On peut même soutenir que mettre son interlocuteur dans
de bonnes dispositions est un universel linguistique en ce qui concerne la
prise de parole dont le but pragmatique est de liquider un manque. C'est
à cet effet qu'est convoqué cet exemple (5) qui, visiblement est
dans une langue qui n'a pas de parenté linguistique avec la langue
malgache.
L'analyse de la transcendance verticale milite en faveur de
cette universalité. Que l'on accepte ou non une hiérarchie au
sein des divinités, tous les récits cosmogoniques soutiennent
l'existence d'un créateur initial. Tout dépend de ce
créateur initial. Si cela est admis, on constate que notre environnement
et même nous dépendent de ce créateur initial.
Dans la religion chrétienne, ce créateur initial
est Dieu. Dès lors, ce qui est évident est la distance
incommensurable qui sépare les humains de Dieu au point que la
communication dans la transcendance verticale se fait toujours dans un rituel
strict qui a pour but de manifester l'incommensurabilité de cette
distance. L'épisode de l'"exode" où Dieu allait communiquer le
décalogue à Moïse permet d'en rendre compte: « Va
avertir le peuple de ne pas se précipiter pour me voir. Sinon beaucoup
d'entre eux mourraient. Même les prêtres, qui peuvent pourtant
s'approcher de moi, doivent se purifier, de peur que je n'intervienne contre
eux » (EXODE, pp. 19, 21-22)
La raison de cet avertissement vient du fait que l'omnipotence
divine ne laisse rien présager de ce qu'il va faire, ainsi il vaut mieux
éviter de s'approcher de lui de crainte que par un manquement
involontaire aux honneurs et respects qu'on lui doit, il nous fasse
disparaître. C'est l'interprétation de la première partie
du passage ci-dessus. La deuxième partie renforce la première. En
effet, quand il est dit que les prêtres doivent de se purifier c'est
parce que la pureté - est un des critères rituels de la
communication avec le divin - réduit la distance qui sépare les
humains de Dieu sans jamais l'abolir. On comprend alors que tout manquement au
protocole rituel soit un sacrilège parce c'est une tentative d'abolition
de la distance.
212
Une situation pratiquement identique dans la transcendance
horizontale non pas seulement dans les chancelleries mais également dans
diverses institutions que l'on peut résumer en ces termes: il ne faut
pas témoigner d'une familiarité avec son supérieur sous
peine d'être compris voulant traiter d'égal à égal,
mais cependant il faut cultiver une relation amicale avec lui de manière
à bénéficier de sa mansuétude. Une attitude que
FREUD croyait être le propre seulement des peuples primitifs:
« L'attitude des peuples primitifs à
l'égard de leurs chefs, rois et prêtres, est régie par deux
principes qui se complètent, plutôt qu'ils ne se contredisent : on
doit se préserver d'eux et on doit les préserver. Ces deux buts
sont obtenus à l'aide d'une foule de prescriptions tabou. » (FREUD,
[1912]1993, p. 36).
Bref, la sacralité du divin (ou des puissants du monde)
entraîne une ambiguïté des attitudes envers lui: on a besoin
de le vénérer pour qu'il continue à nous accorder sa
bienveillance, et en même, il ne faut pas trop s'approcher de lui pour ne
pas se donner une occasion de lui manquer de respect. Voici un exemple de
l'emploi de "mba" qui illustre cette ambiguïté:
6. Mba ho vitan'izay koa ny ratsy [Que ceci close le
mal]
Il s'agit là d'une formule que l'on utilise vers la fin
d'une visite de condoléances. Cette formule marque effectivement la fin
de la visite parce qu'elle annonce que les visiteurs se sont acquittés
de leur devoir et que désormais ils peuvent partir vers d'autres
obligations, ou selon le cas rester pour la veillée.
D'après cette présentation nous pouvons
identifier facilement les acteurs de la communication, le destinateur est un
membre de la famille du défunt qui reçoit les visiteurs et le
destinataire sont ces derniers. Mais cette identification n'épuise pas
les acteurs de la communication. Si on en reste à ces deux acteurs, la
présence de "mba" devient très problématique.
Il est évident que celui qui parle a pour interlocuteur
les visiteurs, donc il demeure dans le cadre de la transcendance horizontale,
mais en même temps, à cause du préfixe "mba", il s'adresse
également à la transcendance verticale parce que si
c'était en son pouvoir, il ne voudrait plus de la mort. Mais comme
d'après sa croyance à la transcendance verticale, la vie et la
mort ne peuvent que provenir de Dieu. C'est cette démultiplication du
destinataire qu'assume le préfixe performatif "mba".
Cependant, on ne peut pas conclure qu'il s'agit là
d'une prière, car parmi les interlocuteurs se trouvent les visiteurs. Le
dédoublement de destinataire a pour conséquence de modifier
l'acte accompli par le préfixe performatif. Il s'agit d'un souhait. Le
désir de l'homme est que la mort qu'il désigne synecdochiquement
par le terme ny ratsy [le mal] s'arrête à cette occasion.
Mais en même temps il sait qu'il ne peut pas commander à Dieu, il
ajoute le préfixe "mba". L'explication de ce changement tient dans la
délocutivité.
213
BENVENISTE définit la délocutivité par
rapport au dire et non par rapport au faire: « On voit ainsi que,
malgré l'apparence, SALUTARE n'est pas dérivé d'un nom
doté de la valeur virtuelle d'un signe linguistique, mais d'un syntagme
où la forme nominale se trouve actualisée comme "terme à
prononcer". Un tel verbe se définit donc par rapport à la
locution formulaire dont il dérive et sera dit DÉLOCUTIF. »
(BENVENISTE É. , 1966, p. 278)
Pourtant, DUCROT qui est proche de BENVENISTE ne le suit pas
dans cette définition tout en acceptant l'idée de
dérivation. DUCROT situe la délocutivité dans un rapport
de faire: « On sait que le substantif latin SALUS possède, au
moins, les deux acceptions suivantes:
-- S1 = santé (d'où l'on tire: maintien en
bonne santé, conservation).
-- S2 = salutation.
Je prendrai pour E1 le signifiant salus muni de la
signification S1 et pour E2, ce même signifiant, mais compris comme S2.
Si l'on admet en outre que E2 est dérivé de E1, il est assez
facile de tenir cette dérivation pour délocutive. On admettra
qu'à un premier stade, seul existe le mot E1. À un second, ce mot
serait utilisé (en vertu de sa valeur sémantique S1!) comme
formule pour saluer. Par politesse on souhaite bonne santé aux gens
qu'on rencontre, en leur disant « Salus! » (= «E1!»). Le
troisième stade est celui de la dérivation délocutive,
où se crée un nouveau mot E2, dont le signifiant, salus, est
identique à celui de El et dont la signification est : acte qu'on
accomplit, notamment, en employant E1, c'est-à-dire en disant «
Salus!» (= «E1!»). À un quatrième stade enfin,
important pour ce que je vais dire, par la suite, à propos du
performatif, la formule «Salus!» peut être
réinterprétée à partir de la nouvelle valeur S2, ce
qui amène à la comprendre comme «E2!». D'où
l'idée que pour accomplir une salutation, on énonce ce que l'on
fait, à seule fin de le faire. Et cela n'est certainement pas faux ;
mais cela représente, il faut le voir, l'aboutissement très
indirect d'un long processus. » (DUCROT, 1980, pp. 48-49)
À la lumière de cette mise au point, nous
pouvons admettre que "mba", à l'initiale est un segment linguistique
à l'intérieur d'un discours spécifique dont le but
pragmatique est de demander une faveur à Dieu sans pourtant lui
commander. Ensuite, par une première délocutivité, en
passant dans la transcendance horizontale, le même morphème sert
à demander une faveur à autrui sans commander ni pour autant le
prendre pour Dieu. (Mba omeo rano).
Enfin, à l'instant, dans (6), toujours par
délocutivité, mba sert à accomplir un souhait par
dédoublement du destinataire. Cette dernière
délocutivité se présente une synthèse de "mba" dans
la transcendance verticale (valeur de prière) et de "mba" dans la
transcendance horizontale (valeur de demande).
Le souhait comme acte de langage a ceci de commun avec la
demande de prendre naissance à partir d'un manque. Ce qui est
souhaitable s'épelle toujours comme une différence avec le
réel, une différence à partir de laquelle DERRIDA a
forgé le concept de
« différance » (avec un «
a ») dans lequel s'introduit la temporalisation du différer.
L'exposé
214
de ce concept prendra trop d'espace dans ce travail qu'il est
préférable de renvoyer à DERRIDA lui-même :
« Il s'agit de produire un nouveau concept
d'écriture. On peut l'appeler gramme ou
différance. Le jeu des différences suppose en
effet des synthèses et des renvois qui interdisent qu'à aucun
moment, en aucun cas, un élément simple soit présent en
lui-même et ne renvoie qu'à lui-même. Que ce soit dans
l'ordre du discours parlé ou du discours écrit, aucun
élément ne peut fonctionner comme signe sans renvoyer à un
autre élément qui lui-même n'est pas présent. Cet
enchaînement fait que chaque "élément " - phonème ou
graphème - se constitue à partir de la trace en lui des autres
éléments de la chaîne ou du système. Cet
enchaînement, ce tissu, est le texte qui ne se produit que dans la
transformation d'un autre texte. » (DERRIDA, [1972]1987 , p. 37)
Ce qui nous permet de comprendre que le souhaitable n'est pas
ce qui s'oppose au réel mais ce qui lui diffère
éternellement. Il n'est peut-être pas inutile de rendre compte de
la différence entre le réel et le souhaitable. Le réel se
caractérise par le fait qu'il est un amenuisement du souhaitable. Le
souhaitable tant qu'il n'advient pas se présente comme un enrichissement
du réel parce qu'il appartient au monde de l'idéel. Ainsi, le
souhaitable est délivré du poids néfaste du réel
caractérisé par le manque. C'est de cette manière que le
concept de "différance" autorise à comprendre (6) comme une
transformation de ce qui aurait pu être une simple prière en un
souhait.
S'il est admis selon la thèse de SEARLE que
l'illocutoire est une matrice de proposition comme il le dit dans la notation
du passage suivant :
« Nous pouvons représenter les distinctions
que nous avons faites au moyen du symbolisme suivant : les actes
illocutionnaires (un très grand nombre d'entre eux au moins) sont de
forme générale :
F(p)
où la variable « F » prend ses valeurs
parmi les procédés marqueurs de force illocutionnaire, « p
» représentant des expressions qui expriment des propositions.
» (SEARLE, [1972] 1996, pp. 69-70) ;
Alors, les expressions de souhait qui abondent dans le rapport
interlocutif possèdent un préfixe performatif garanti par le
morphème « mba ». Suite à ces différents
éclairages, nous pouvons reprendre l'exemple (4), converti ici en (7)
pour illustrer l'enrichissement de l'illocutoire dans la question du
désir:
7. Saika mba hangataka afo aho [Je voudrais demander du
feu]
Le saika en tant que marque du passé
définit le contenu propositionnel de (7) en un désir
déjà refoulé. Le morphème h du futur
assigne au contenu propositionnel d'être un projet qui n'est pas encore.
Ce qui veut dire que le contenu propositionnel appartient d'une part à
un passé qui n'est plus et à un futur qui n'est pas encore, pour
reprendre ici la mensuration du temps chez Saint AUGUSTIN:
215
« Mais comment diminue le futur ? Comment en est-ce
de lui ? Il n'est pas encore. Comment d'autre part, croît la passé
? Il n'est déjà plus. La seule explication c'est que dans
l'âme même qui opère ainsi, il y a trois actes, attente,
vue, souvenir, le passage se fait par la vue de l'attente au souvenir. Que le
futur ne soit pat pas encore, qui le nie ? Dans l'âme il y a toutefois
attente du futur. Que le passé ne soit déjà plus, qui le
nie ? Dans l'âme toutefois il y a souvenir du passé. Que le moment
présent, passage réduit à un point, n'ait aucune
étendue, qui le nie ? » (AUGUSTIN, 1982, p. 386)
Le morphème "mba" s'applique en même temps
à ce passé et à ce futur. Il en ressort que nous avons
dans (7) une démultiplication du "je" d'énonciation. D'abord, il
y a le "je" qui ne veut pas importuner le destinataire et qui affiche son
désir comme appartenant déjà au passé; ensuite le
"je" qui maintient son désir mais le projetant dans un futur
indéterminé. Puis, le "je" qui traite toutes ces diverses
attitudes comme une prière par l'emploi du morphème "mba". Enfin,
le "je" d'énonciation matérialisé dans
l'énoncé et qui prend en charge ces trois premiers. Puisque ces
multiples "je" sont différés, c'est-à-dire qu'ils
n'adviennent pas au réel, nous pouvons alors conclure que (7) se
décline sous le registre du souhaitable. C'est ainsi que l'utilisation
de "mba" sert à accomplir un souhait au même titre que ce qui se
passe dans (6).
Tout se passe comme si le temps pouvait être
granulé. Il s'agit en fait d'étaler sur le même niveau le
passé qui n'est plus et le futur qui n'est pas encore de manière
à avoir la logique temporelle de la narrativité que GREIMAS
(GREIMAS, [1966b]1981) dichotomise en un « avant » et un «
après ». Cet algorithme narratif permet de mieux comprendre la
portée de la préservation de la face inscrite dans la formule
mba qui nous occupe.
Le paradoxe de la temporalité peut être
résolu par l'intervention de deux mensurations distinctes. Appelons la
première "temporalité ouverte" qui constitue notre vécu au
premier degré. C'est un temps qui avance inexorablement en convertissant
le futur en passé. Comme pour racheter cette entropie
désespérante du temps physique, le langage s'est doté
d"une autre temporalité qui traverse cette première, c'est la
"temporalité close" ou le "temps du récit".
Le propre de la temporalité close est de prendre
naissance à partir d'une énonciation. C'est donc encore un
individu linguistique dont la particularité est d'enrichir le
vécu au premier degré. En effet, la temporalité close se
caractérise par un commencement absolu et une fin absolue entre lesquels
s'opère une transformation. Ce qui veut dire que l'on ne peut
réciter qu'une histoire qui a déjà fini. Ce qui veut dire
encore que l'intelligibilité du vécu au premier degré
s'enrichit de sa ponctuation par des récits comme si le temps pouvait
être granulé: la logique narrative se greffe sur le vécu au
premier degré pour lui donner une consistance. C'est ainsi que dans (7),
nous avons deux temporalités closes, celle qui envisage la demande dans
le passé révolu et celle qui le projette dans un futur non encore
advenu. C'est de cette manière que le locuteur évite d'importuner
le vécu au premier degré de son destinataire: il refuse de
greffer ses temporalités closes à la temporalité ouvert de
son interlocuteur. Il s'agit là d'une réalisation de l'implicite
de DUCROT
216
Mais il existe un autre emploi fascinant de "mba" qui ne peut
que donner du fil à retordre à la linguistique classique, c'est
le cas de (8):
8. Mba nahavita asa aho [J'ai pu (quand même) terminer
le travail]
La contradiction de cet énoncé réside
dans l'incompatibilité entre le morphème "mba" et le
morphème du passé du verbe. En effet, les emplois de "mba"
attestent d'une manière générale l'accomplissement d'une
prière dans la transcendance verticale d'abord, puis ensuite dans la
transcendance horizontale. Le propre de la prière, avons-nous dit, est
dans le fait qu'elle est le dernier recours à autrui quand notre
ressource propre ne permet pas d'obtenir l'objet de notre quête.
Autrement dit, "mba" engage toujours, d'une manière ou d'une autre le
futur. C'est en cela que se situe l'incompatibilité dont nous venons de
parler.
Si l'on se cantonne dans une sémantique traditionnelle
qui exclut pareille contradiction, cette phrase sera qualifiée
d'incorrecte, pourtant cette structure qui allie "mba" et le passé est
produite naturellement par le locuteur malgache. Il faut faire remarquer que le
langage n'est pas à une contradiction près et que cela semble
faire partie des universaux du langage. En effet, en français, nous
avons exactement la même structure qui combine le passé et le
futur. Il ne s'agit pas du temps grammatical du conditionnel présent
comme nous l'avons vu dans la traduction de (4) et (7) [Je voudrais demander du
feu]; mais d'une forme qui permet de faire une préservation de la face
quand on veut effectuer un acte de langage précis: la proposition. Il
est possible effectivement en français de faire une proposition par
référence intertextuelle à la sentence qui stipule que
"L'homme propose et Dieu dispose".
De prime abord, la possibilité de cette sentence
implique aussi la dimension transcendantale verticale du langage; et de la
même manière que nous avons pu constater dans l'analyse de "mba"
il y aussi ici un passage du sacré vers le profane par
intertextualité ou par délocutivité: "L'homme propose et
la femme dispose". Cette deuxième sentence ne s'éclaire que par
référence à la première, et l'on peut la tenir pour
délocutive dans la mesure où l'on peut comprendre que ce qui est
mise en jeu dans les deux cas concerne la soumission de celui qui demande
à son destinataire. C'est ce qui apparaît exactement dans la
proposition du type de (9):
9. Si on allait danser
Sans entrer dans les détails, nous pouvons admettre que
le "si" hypothétique engage l'énonciation sous la modalisation
d'un projet alors que l'imparfait la rejette dans un passé
indéterminé qui n'est plus.
L'énonciation de la demande ou de la proposition est
présentée à la fois comme appartenant au passé et
au futur puisque le sujet de l'énonciation envisage, à la fois,
la renonciation à son objet de désir et, en même temps, il
le maintient dans un projet de quête. C'est-à-dire, il envisage un
état de disjonction d'objet qui se trouve dans le passé et un
état de conjonction d'objet qui appartient au futur. Il s'agit pour lui
d'avoir la possibilité de nier la
217
demande en cas de refus en opposant que c'est
déjà du passé, ainsi son honneur est sauf puisqu'il est
déjà disposé à la renonciation d'objet.
C'est cette ambiguïté qui permet de
préserver la face qui a fait dire ceci à DUCROT : « Le
problème général de l'implicite, (...) est de savoir
comment on peut dire quelque chose sans accepter pour autant la
responsabilité de l'avoir dit, ce qui revient à
bénéficier à la fois de l'efficacité de la parole
et de l'innocence du silence. » (1972, p. 12)
Cependant, l'explication de (8) ne suit pas cette combinaison
temporelle qui a pour but la réservation de la face. La
préservation de la face est obtenue ici par délocutivité
de "mba"
"Mba" passe, ici, de l'effectuation d'une prière
à son résultat à la manière d'une métalepse.
Autrement dit, la préservation de la face consiste à se refuser
le mérite du travail accompli mais à l'attacher à la
générosité du destinataire de la prière avant le
commencement des travaux. Pour mieux comprendre ce mécanisme de la
métalepse, il faut tenir compte que dans la tradition ou dans le
vernaculaire malgache, il n'est pas question de commencer un travail important
comme le labourage des rizières sans demander la
bénédiction des divinités. Ce qui signifie que si les
travaux étaient accomplis, c'est parce que Dieu et les ancêtres
ont accordé leur bienveillance. C'est ainsi que le mérite leur
revient et "mba" sert à leur rattacher ce mérite.
Travaux cités
ANSCOMBRE, J.-C. (1980). "Voulez-vous dériver avec
moi?". Dans Rhétoriques, Communications (Vol. 16, pp. 61-123).
Paris: Seuil.
AUGUSTIN, S. (1982). confessions. Paris: Seuil.
AUTHIER-REVUZ, J. (2001, Novembre). "Les non coïncidences
du dire et leur représentation métaénonciative.
étude de linguistique et discursive de la modalisation autonymique".
Marges linguistiques, pp. 149-154. Consulté le Septembre 09,
2010, sur
www.marges-linguistiques.
com: http//
www.marges-linguistiques.com
BENVENISTE, E. ([1974] 1981). Problèmes de
linguistique générale, II. Paris: Gallimard. BENVENISTE,
É. (1966). Problèmes de linguistique
générale,1. Paris: Gallimard.
BROWN, P., & LEVINSON, S. C. ([1978] 2000). Politeness,
some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University
Press.
CHOMSKY, N. (1975). "Remarques sur la nominalisation". Dans C.
noam, Questions de sémantique (pp. 73-132). Paris: Seuil.
DERRIDA, J. ([1972]1987 ). Positions. Paris:
éditions de Minuits.
DUCROT, O. (1972). Dire et ne pas dire, Principes de
sémantique linguistique. Paris: Hermann. DUCROT, O. (1980).
Analyses pragmatiques. Communications, pp. 11-60.
Récupéré sur Persée.
218
EXODE. (1982). Bible. Paris: Société
biblique française. FLAHAULT, F. (1978). La parole
intermédiaire. Paris: Seuil.
FREUD, S. ([1912]1993). Totem et tabou, Quelques concordances
enter la vie psychique dessauvages et celle des névrosés.
(W. Marièlene, Trad.) Paris: Gallimard.
GOFFMAN, E. (1984 (éd. or. 1974)). Les rites
d'interaction. Paris: Editions du minuit.
GREIMAS, A. J. ([1966b]1981). "Eléments pour
l'interprétation des récits mythiques". Dans R. BARTHES, &
alii, Introduction à l'analysestructurale du récit (pp.
28-59). Paris: Seuil.
GRICE, H. P. (1975). "Logicand conversation". Dans C. e. al.,
syntax and semantics 3 (pp. 41-58). Californie: Harvard University
Press.
HEIDEGGER, M. ([1949]1987 ). Les chemins qui ne mènent
nulle part. Paris: Gallimard. KERBRAT-ORRIOCHIONI, C. (1996). La
conversation. Paris: Seuil.
LAKOFF, R. (1974). "what can you do with words, politeness,
pragmatics and performativeness. Berkeley studies in syntax and
semantic, pp. 1-55.
RECANATI, F. (1979). La transparence et énonciation.
Pour introduire à la pragmatique. Paris: Seuil.
SEARLE, J. R. ([1972] 1996). Les actes de langage, Essai de
philosophie du langage. Paris: Herman, Éditeurs des Sciences et des
arts.
219
TABLE DES MATIÈRES
1. Illocution et narrativité 2
1.1. Introduction 2
1.2. La narrativité 7
1.3. L'illocutoire 11
Travaux cités 17
2. LE SIGNE EN PRAGMATIQUE 19
2.1. Introduction 19
2.2. La pragmatique et la théorie de l'action. 22
2.3. Caractérisation des actes du langage. 25
2.3.1. la forme 25
Travaux cités 28
3. La synecdoque. 30
Travaux cités 43
4. Synecdoque et langage des oeuvres d'art 46
4.1. Cadre théorique 46
4.2. Pratique 51
5. LE DÉTACHEMENT DU SENS 62
Travaux cités 73
6. Métonymie 75
Travaux cités 88
7. L'ILLOCUTOIRE DES FIGURES 91
Travaux cités 101
8. Métaphore et femme 102
Travaux cités 117
9. LA SIRÈNE, I ou A 119
9.1. Introduction 119
9.2. Le pari de la forme 120
9.3. Le mythe de l' « ampelamananisa » 123
9.4. L'évanouissement de l'homme 127
9.5. Censure et postulation du sexe féminin 130
Travaux cités 135
10. Censure et postulation du corps féminin 137
10.1. Introduction 137
10.2. Du protolangage au langage en passant par la pragmatique
141
10.3. La censure et la postulation du corps féminin 145
220
Travaux cités 155
11. La séduction 158
Travaux cités 169
12. La délocutivité du saotsa : agir physique
devenu agir linguistique 171
Références 186
13. La délocutivité et les salutations 188
Travaux cités 200
14. À propos de morphème «mba
» 202
Travaux cités 217
| 


