|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham

Aspects Juridiques, Comptables et Fiscaux
et Proposition d'une Méthodologie
d'Audit.
Minoteries Industrielles :
Page 1
MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L'OBTENTION DU
DIPLOME
NATIONAL D'EXPERT COMPTABLE
PAR
M. Hicham TOUIL
Membres du jury
Président du jury : Monsieur Mohamed HDID -
Expert-comptable DPLE Directeur de recherche :
M. Mohamed HARKATI Expert-Comptable
DPLE
Suffragants :
M. Fessal KOHEN
Expert-Comptable DPLE
M. Abdelfattah HIFDI Expert-Comptable
DPLE
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 2
Table des matières
DEDICACE 9
REMERCIEMENTS 10
AVERTISSEMENT 11
INTRODUCTION GENERALE 12
Première partie : Statut particulier des
minoteries au Maroc : analyse
juridique, réglementaire, comptable et fiscale
21
Introduction à la première partie
22
Chapitre 1 : Le Marché Céréalier au
Maroc 24
Section 1 : Intervenants sur le marché
céréalier au Maroc 25
1- L'acteur public : Office National Interprofessionnel des
Céréales et Légumineuses
(O.N.I.C.L) 25
2- Les acteurs privés 25
a. Les commerçants collecteurs 25
b. Les commerçants négociants stockeurs
26
c. Les commerçants détaillants 26
d. Les coopératives des céréales
27
e. Les minoteries industrielles 27
f. Les moulins artisanaux 27
g. Les autres industries 28
Section 2 : Régimes de commercialisation
30
Section 3 : Importation des céréales et
commerce extérieur. 33
1. Principe de liberté d'importation des
céréales 34
2. Personnes habilitées à réaliser les
importations des céréales. 34
3. Dépôt par les importateurs d'une
déclaration préalable (déclaration initiale
d'importation) 34
4. Dépôt d'une caution de bonne
exécution 34
5. Justification de la réalisation des opérations
d'importation 35
6. Restitution de la caution de bonne exécution
35
Section 4 : Politique de stockage. 36
1. Infrastructures et capacité de stockage 36
2. Mesures prises par les pouvoirs publics pour améliorer
les infrastructures de stockage. 37
a) Octroi d'une prime de construction 37
b) Octroi d'une prime de magasinage 38
c) Obligation du respect de stock de sécurité
38
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 3
3. Constats et chiffres sur les capacités de stockage
38
a) Capacité de stockage disponible 38
b) Nature et âge des installations existantes
40
c) Répartition régionale de la capacité
de stockage 40
d) Rentabilité de la fonction stockage 40
e) Subventions 41
Chapitre 2 : La transformation des céréales
au Maroc 42
Introduction 43
Section 1 : Minoterie industrielles 43
1. Définition réglementaire 43
2. Etat des lieux des minoteries industrielles au Maroc
45
a) Nombre et capacité d'écrasement des
minoteries industrielles 45
b) Répartition géographique 45
c) Les minoteries industrielles entre le libéralisme
hésitant et l'administration totale des
pouvoirs publics. 45
Section 2 : Minoterie artisanales 48
1. Définition réglementaire 48
2. Etat des lieux des minoteries artisanales au Maroc
48
a) Les écrasements des minoteries artisanales
48
b) L'activité de meunerie artisanale 48
c) Les services connexes à la mouture du b1é
(nettoyage et triage du blé, tamisage de la
farine sont proposés sur le lieu même du moulin
artisanal). 48
Section 3 : Processus d'écrasement des
céréales 49
1. Réception Matières premières
49
a) Réception des blés 49
b) Réception des autres matières
premières 49
2. Stockage des matières premières 50
a) Stockage des blés en silos 50
b) Stockage des autres matières premières
50
3. Préparation des blés 50
a) Nettoyage et mouillage des blés 50
b) Stockage et repos du blé nettoyé dans les
silos 51
4. Mouture du grain 51
5. Traitement de la farine 52
a) Ensachage et palettisation automatique des farines
52
b) Mélange industriel des farines 53
6. Stockage des produits finis 53
a) Stockage des farines 53
b) Stockage des sous-produits 54
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 4
Section 4 : Produits de la minoterie 54
1. Définitions des produits de la minoterie 55
a) Farine de blé tendre 55
b) Farine complète de blé tendre 55
c) Semoule 55
d) Finot 55
e) Farine de blé dur 55
f) Farine complète de blé dur 55
2. Caractéristiques chimiques et minérales des
produits de la minoterie 55
Chapitre 3 : Réglementation juridique,
administrative et particularités
comptables et fiscales des minoteries 57
Section I- Organisation professionnelle du secteur
58
1. L'Office National Interprofessionnel des
Céréales et Légumineuses (ONICL) 58
a) Statut juridique 58
b) Missions 58
c) Activités principales 59
d) Ressources humaines et implantation géographique
59
e) Ressources financières 60
2. Organisation du marché 60
e) L'aspect associatif du secteur meunier 60
3. Dispositions relatives à la vente de la farine du
blé tendre : Libre et subventionnée 61
a) Farine libre du blé tendre 61
b) Farine subventionnée du blé tendre : FNBT
et Farine Spéciale Blé Tendre (FSBT) 62
c) Mesures prises par les pouvoirs publics en faveur de la
farine subventionnée 62
4. Gestion de stocks et comptabilité matière.
64
a) Registre des entrées du blé 65
b) Registre de mouture 65
c) Registre des mouvements de produits 65
Section 2- Modalités de répartition du
contingent de la farine nationale du blé tendre et
de la farine spéciale destinées aux
provinces du sud. 66
1. Répartition du contingent entre les préfectures
et provinces. 67
2. Répartition du contingent entre les centres de
fabrication et modalités de livraison 67
a) Répartition du contingent entre les minoteries
68
b) Modalités de livraison de la farine
subventionnée 69
Section 3- Primes et subventions octroyées par
l'ONICL aux minoteries 70
1. Prime compensatrice de la farine subventionnée
70
a) Fixation du prix de référence : prix
d'achat du blé du stockeur auprès du producteur
ou importation du blé dans le cadre des accords du
Maroc avec les pays étrangers. 70
b) Prix de vente du blé par le stockeur au minotier
pour la fabrication de la farine
subventionnée 71
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 5
c) Fixation du prix de vente de la farine
subventionnée aux consommateurs 72
2. Transport de la farine nationale bu blé tendre pris en
charge par les minoteries 72
3. Subvention forfaitaire perçue par les minoteries sur
les farines libres. 72
Section 4- Particularités fiscales des minoteries
76
1. Les taxes fiscales 76
a) En matière d'IS 76
b) En matière de TVA 77
2. Les taxes parafiscales 78
a) Taxe de commercialisation. 78
b) Taxe sur la vente de farine aux boulangeries 78
c) Amendes infligées suite aux contrôles des
services de l'hygiène 79
Section 5 : Particularités comptables
80
1. Organisation de la comptabilité d'une minoterie
industrielle 80
a) Particularités comptables par rapport au CGNC et
absence des normes comptables
spécifiques 80
b) Normalisation comptable proposée par
l'expérience française 80
2) Proposition de subdivisions de comptes et de schémas
d'écritures pour la minoterie
industrielle marocaine 83
a) Comptes proposés pour la minoterie 83
Section 6 - L'intervention des entreprises
céréalières sur le marché à terme
85
1) Intervention de l'entreprise céréalière
sur le marché à terme : les opérations
réalisées
sur le contrat blé 85
2) Caractéristiques du marché à terme et
des opérations traitées 86
Section 7- Obligations contractuelles des minoteries
87
1. Contrat d'approvisionnement avec les commerçants
céréaliers 87
2. Contrat d'approvisionnement avec les boulangeries
88
a) Intérêts des parties 89
b) Engagement d'approvisionnement du boulanger 89
c) Contrepartie de l'engagement de fourniture : l'avantage
accordé à la boulangerie 89
Conclusion de la première partie 91
Deuxième partie : Méthodologie d'Audit
d'une Minoterie 92
Introduction de la deuxième partie 93
Chapitre 1 : Prise de connaissance de l'entreprise et
analyse des risques
identifiés 95
Section 1- Le diagnostic de la minoterie industrielle
96
1. Le diagnostic stratégique 96
a) Stratégie de domination 96
b) La stratégie de spécialisation 96
c) La stratégie de différenciation 97
d)
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 6
Tableau résumant les stratégies des
minoteries industrielles. 98
2. Le diagnostic de gestion 100
a) Les indicateurs de production 100
b) Analyse des indicateurs de production 101
3. Le diagnostic financier ou la revue analytique
103
a) Etude d'un bilan 104
b) Etude d'un compte de produits et charges 105
Section 2 : Identification des risques 106
1. Les caractéristiques générales de
l'activité 106
a) L'activité 106
b) Les sites de production et de stockage 107
c) La détention et les liens 107
2. L'organisation de l'approvisionnement 108
a) Les relations avec les fournisseurs 108
b) La gestion des approvisionnements 109
3. Les moyens de production et la politique d'investissement
110
a) Les moyens de production et la politique
d'investissement 110
b) Les contrats liés à l'exploitation
111
c) Tableau de bord 112
4. La politique de commercialisation 112
a) Clients, produits et prix 112
Section 3 : L'outil de production et de stockage,
éléments prépondérants de l'actif
immobilisé 115
1. La réglementation relative aux normes de
sécurité : obligations des entreprises 115
a) Les équipements de travail : entretien pour
garantir la sécurité des employés (code du
travail) 116
b) Les installations classées : les silos et les
installations de stockage (code de
l'environnement) 116
c) Incidence sur les comptes des travaux d'entretien et
de rénovation effectués en
application des mesures du code de travail et du code
l'environnement. 117
2. Présentation d'un guide de réalisation des
travaux en vue de se conformer aux
obligations d'hygiène et de sécurité.
118
3. Traitement comptable et fiscal des travaux d'entretien et
de rénovation 118
a) Comptabilisation en charges ou en immobilisations ?
118
Section 4 : Contingent et droits de mouture,
éléments incorporels nécessaires à
l'exploitation : l'expérience française
à exploiter par la profession marocaine. 120
1. L'exploitation de l'expérience française
121
2. Exposé des notions de contingent et des droits de
mouture 121
a) Contingent 121
b) Droits de mouture 122
c) Cession des droits de mouture 122
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 7
Section 5 : Importance de stock dans une minoterie
industrielle 123
1. L'évaluation des stocks de matières
premières 123
2. L'évaluation des stocks de farine 124
Chapitre 2- Audit des principaux cycles
d'activité des minoteries industrielles
125
Section 1 : Cycle achats/fournisseurs. 128
1. Evaluation du contrôle interne 128
a) Remarques préalables 128
b) Questionnaires de contrôle interne d'achat de
blé 129
2. Révision des comptes 132
a) Matières premières 132
b) Charges externes : entretien du matériel
133
Section 2 : Cycle Ventes/clients. 135
1. Evaluation du contrôle interne 135
a) Remarques préalables 135
b) Revue du circuit de vente de la farine et questionnaires
de contrôle interne. 136
2. Evaluation du contrôle des comptes 140
a) Ventes de farine 140
b) Comptes clients 140
Section 3 : Cycle Gestion des stocks. 141
1. Evaluation du contrôle interne 141
a) Procédure d'inventaire physique et permanent
141
b) Obligation de tenue des comptes matières
vis-à-vis de l'ONICL 143
c) Méthodes d'évaluation des stocks
144
2. Révision des comptes 147
a) Test de contrôle du stock de la farine par la
sacherie 147
b) Test de contrôle du stock de la production de
farine par la consommation électrique
149
Chapitre 3- Audit des créances et des dettes
vis-à-vis de l'Etat 151
Section 1- Nature des créances parafiscales
152
1. La prime forfaitaire sur l'achat du blé tendre
152
2. La prime de compensation sur la farine nationale du
blé tendre (FNBT) 152
Section 2- Contrôle des comptes des créances
parafiscales 153
Section 3 - Nature des dettes parafiscales
154
1. La taxe de commercialisation 154
2. Transport ONICL 154
3. Les amendes pénales suite au contrôle de
l'hygiène 154
Section 4 - Contrôle des comptes des dettes
parafiscales 155
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 8
Conclusion de la deuxième partie
157
Conclusion générale 158
Bibliographie 160
Lexique en arabe 162
Annexes 163
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 9
DEDICACE
Je dédie ce mémoire à mes chers parents en
témoignage d'estime, de respect et de vénération. Toutes
les lettres ne sauraient trouver les mots qu'il faut pour exprimer à
juste titre mon profond amour et ma gratitude à votre égard pour
tout ce que vous avez sacrifié pour assurer mon bien être et celui
de ma famille.
Je dédie ce mémoire également :
A toute ma famille : puisse Dieu nous garder unis pour
toujours.
A tous mes enseignants : aucune dédicace ne sera en mesure
de vous remercier assez pour tout le savoir que vous m'avez transmis.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
REMERCIEMENTS
Je ne saurais exprimer mes remerciements symbole de gratitude
et de reconnaissance à Monsieur Mohamed HARKATI, mon Directeur de
recherche, dont la richesse d'esprit, la générosité et le
professionnalisme sont pour moi une indéniable
référence.
Mes remerciements les plus sincères s'adressent
à chacun des membres du jury, professionnels et professeurs
chevronnés dont la participation m'honore.
Mes remerciements vont également à tous ceux qui
ont participé de près ou de loin, soit par la documentation, soit
par leurs conseils et éclairages, à l'aboutissement de cette
recherche.
Je profite de cette occasion pour remercier le Directeur de
l'ISCAE, les enseignants et les Experts Comptables qui participent activement
à la formation au Diplôme National d'Expert Comptable.
Page
10
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
AVERTISSEMENT
Compte tenu des recommandations formulées par le jury
lors de l'agrément du sujet du présent mémoire, j'ai
procédé à quelques modifications par rapport au plan
initial déposé dans la notice. Ces modifications ont
concerné les points suivants :
? Changement du titre de la première partie qui est
devenu « Le statut particulier des minoteries au Maroc : analyse
juridique, réglementaire comptable et fiscale »
? Ajout d'une section 5 du chapitre 3 de la première
partie intitulée les particularités comptables.
? Les chapitres 1 et 2 de la deuxième partie ont
été regroupés dans un seul chapitre intitulé «
Prise de connaissance de l'entreprise et analyse des risques identifiés
».
? Le chapitre 3 est devenu le chapitre 2 avec comme
intitulé « audit des principaux cycles d'activité des
minoteries industrielles : cycle achats fournisseurs, cycle gestion des stocks
et cycle ventes clients ».
? Mettre un chapitre 3 dans la deuxième partie
intitulé : « audit des créances et dettes vis-à-vis
de l'Etat ».
Par ailleurs, suite aux diverses observations et questions
soulevées au fur et à mesure de ma réflexion, des
modifications et réaménagements au niveau des titres de certains
paragraphes et sections ont été imposés lors de la
rédaction définitive sans toutefois remettre en cause les
développements envisagés initialement.
Page
11
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
INTRODUCTION GENERALE
Page
12
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Filière céréalière et plan
Maroc Vert
La filière céréalière constitue
une des principales filières de la production agricole au Maroc. Elle
joue un rôle multiple en ce qui concerne les emblavements annuels des
terres cultivables, la formation du produit intérieur brut agricole,
l'emploi dans le milieu rural et l'utilisation des capacités de
transformation industrielle. Les céréales sont
représentées essentiellement par les cultures du blé
tendre, de l'orge, du blé dur et du maïs. Le sorgho et le riz sont
également pratiqués mais avec une importance marginale.
Les politiques liées au secteur céréalier
ont toujours été intégrées dans celles des produits
dits stratégiques, incluant outre les céréales, les huiles
et le sucre. Ces produits ont pour longtemps été soumis à
une intervention directe des pouvoirs publics le long des filières.
Actuellement, le secteur céréalier
bénéficie d'un fort soutien des pouvoirs publics à travers
l'instauration de la stratégie du plan Maroc vert et les
mécanismes de soutien financier à travers la caisse de
compensation.
Cette stratégie concerne un secteur qui contribue
à hauteur de 19% au PIB, dont 15% dans l'agriculture et 4% en
agro-industrie1. Ce secteur emploie plus de quatre millions de ruraux et
crée des milliers postes d'emploi chaque année dans le domaine de
l'agro-alimentaire.
Ce secteur joue un rôle déterminant dans les
équilibres macro-économiques du pays. Il supporte une charge
sociale importante, étant donné que les revenus de 80% des
quatorze millions de ruraux dépendent de l'agriculture.
L'agriculture joue un rôle crucial dans la
stabilité économique et sociale de notre pays puisque ce secteur
porte la lourde responsabilité de la sécurité alimentaire
de millions de consommateurs marocains.
Pour promouvoir ce secteur, le plan Maroc vert a limité
les contraintes entravant le développement de l'agriculture comme suit
:
1 Site du ministère de l'agriculture (
www.agriculture.gov.ma)
année 2012
Page
13
1-
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Faible investissement agricole L'investissement
agricole se caractérise par :
? Une faible utilisation des facteurs de production : Faible
utilisation des engrais et taux de mécanisation moins important que
certains pays européens.
? Participation du système bancaire dans le
financement des projets agricoles peu importante.
? Une Faible subvention au secteur agricole : les subventions
accordées à l'agriculture marocaine représentent à
peine 8% du revenu agricole.
? Une faiblesse du tissu de l'agro-industrie qui ne
représente que 24% de l'ensemble des unités industrielles
nationales, et transforme à peine le tiers de la production.
2- Faible organisation
Très faible niveau d'organisation et une quasi-absence
de l'organisation professionnelle du secteur (Nombre faible des associations
professionnelles).
3- Encadrement insuffisant
L'agriculture nationale souffre d'une gestion traditionnelle des
exploitations.
4- Ressources en eau limitées
La dégradation des eaux de surface et souterraines est
une cause d'un système d'irrigation non
efficient.
5- Foncier morcelé.
Le morcellement excessif des exploitations agricoles avec une
multiplicité de régimes juridiques constituent une entrave
à l'investissement.
Ainsi, pour remédier à ces contraintes, la
stratégie Plan Maroc Vert est basée sur deux grands fondements
:
Page
14
1er fondement : Faire de l'agriculture le principal
levier de croissance sur les quinze prochaines années à travers
:
? Le renforcement de la part de l'agriculture dans le produit
intérieur brut (PIB)
? La création de millions d'emplois
supplémentaires.
? La lutte contre la pauvreté
? L'accroissement de la valeur des exportations pour les
filières où le Maroc est
compétitif (agrumes, olivier, fruits et
légumes).
2ème fondement : Création d'un
partenariat gagnant-gagnant entre l'amont productif et l'aval commercial et/ou
industriel (dont le secteur meunier).
Les pouvoirs publics se doivent de développer le
secteur de la transformation des céréales (secteur meunier).
Secteur meunier au Maroc
Le secteur meunier compte actuellement 200
moulins2. C'est l'axe Casablanca - Fès qui connaît la
plus forte concentration d'unités industrielles, mais la distribution
géographique demeure cependant assez large en raison du caractère
pondéreux de la matière qui impose l'installation des minoteries
à proximité des lieux de consommation.
Les minoteries artisanales sont réparties dans tout le
pays et ont une capacité d'écrasement annuelle importante. Elles
assurent indifféremment la mouture de blé importé et du
blé local.
La proportion de celui-ci étant cependant
étroitement liée à la qualité de la campagne
céréalière au Maroc et des conditions agro-climatiques de
chaque saison.
Selon les études réalisées par la
fédération des minoteries industrielles (FMN)3, le secteur
meunier au Maroc connaît actuellement des points forts et des points
faibles qui sont cités ci-après :
2 ONICL, Mars 2013
3 Etude stratégique réalisée
en 2009 avec l'appui de l'union européenne dans le cadre de programme
d'appui des associations professionnelles
Page
15
1- Points forts
Concernant l'environnement de la meunerie marocaine, cette
dernière n'a pas de gros problèmes d'accès aux produits et
services nécessaires à son activité :
· Ressources humaines : La disponibilité
des ressources humaines est assurée par plusieurs organismes à
savoir : L'Institut de Formation de l'Industrie Meunière (IFIM) et
l'Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV).
· Emballages : L'industrie de l'emballage lui
fournit ses besoins en articles d'emballage
· Transport : Le parc des poids lourds roulant
au Maroc lui fournit l'appoint requis en moyens de transport
· Financement : Le système bancaire
assure les sources de financement pour ses investissements et son
exploitation.
· Etudes et expertise : Certains bureaux
assurent le conseil nécessaire au cas par cas (expertise technique,
financière, juridique...)
2- Points faibles
2-1- Une surcapacité pénalisante et une
disparité régionale de l'utilisation de cette
capacité.
Une bonne partie des minoteries industrielles n'utilisent pas
la totalité de leurs capacités d'écrasement. Ces
entreprises produisent en priorité la farine nationale du blé
tendre (FNBT) dont la quantité est régie par voie
réglementaire et ensuite vient la production de la farine libre. Cette
surcapacité est due à une saturation de la demande de la farine
sur le marché national.
Les données statistiques disponibles mettent en
évidence cette réalité :
· Un taux d'utilisation de capacité au niveau
national pour le blé tendre, le blé dur et l'orge de 62,11 %
Les données statistiques mettent aussi en
évidence une disparité régionale du taux d'utilisation de
capacités
Page
16
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
2-2- Un secteur plombé par le système
d'exploitation de la farine nationale du blé tendre (FNBT).
Placé dans une logique administrative, le secteur se
trouve plombé et son dynamisme hypothéqué.
En effet, cette logique administrative vise à la fois
pour l'agriculteur, un prix rémunérateur, et pour le consommateur
final un prix accessible à son pouvoir d'achat. Un équilibre
jamais trouvé en raison des pratiques et distorsions (risque de
percevoir la subvention sans avoir vendu réellement la farine
nationale).
Le système de gestion de la farine nationale «
faussement subventionnée : perception d'une subvention sans avoir
livré réellement la FNBT », développé en
parallèle avec une farine de luxe « faussement libre : vente de la
farine nationale comme une farine libre avec la perception du prix de la farine
libre », a encouragé toutes les distorsions au niveau de la
commercialisation et de la transformation.
Dans ce sens, l'objectif des pouvoirs publics s'en trouve
perverti, et le secteur minotier reste plombé par une gestion
rentière des « quotas ».
La différence de qualité entre la farine de luxe
et la FNBT (se rapportant au taux de cendre) ne justifie nullement
l'écart de prix entre les deux produits qui passe du simple au double.
La forte demande sur la FNBT induit d'une part une augmentation de son prix
(à cause de la spéculation illégale), et d'autre part en
fait un produit d'appel pour l'écoulement des produits libres.
2-3- Un secteur qui a besoin de modernisation en
dépit de l'émergence d'unités de profil
nouveau.
Actuellement, on peut affirmer que l'image traditionnelle
d'une minoterie dominée par des entreprises familiales, relativement
vulnérables parce qu'elles ne développent pas de stratégie
commerciale et se basent sur des rapports personnalisés avec les
grossistes quotataires... a considérablement changé.
Page
17
Certes, il existe encore de petites unités
régionales gérées de manière traditionnelle, mais
les minoteries traitant de gros volumes sont désormais des entreprises
bien structurées sur le plan commercial, technique et administratif.
Selon les études réalisées sur le
secteur, les minoteries industrielles sont en majorité très
vétustes. Le taux de vétusté moyen du matériel,
estimé à travers le pourcentage des immobilisations amorties
s'élève à 77% de l'ensemble des minoteries.
Néanmoins, on assiste actuellement à
l'émergence d'unités modernes, équipées avec des
machines issues de la dernière technologie, dirigées par de
jeunes cadres et mobilisant des compétences à la hauteur des
exigences du métier. Mais il existe toujours un pan de l'industrie,
marqué par la vétusté et que seul l'entretien
coûteux du matériel et le niveau élevé de
maintenance des équipements permet à certaines unités de
sauvegarder un certain niveau de production. Cela génère bien
entendu des surcoûts non négligeables, ce qui permet aux moulins
les plus âgés, à défaut d'être
compétitifs sur le prix et la qualité, de s'appuyer sur la
proximité géographique de la clientèle et la garantie
d'écrasement d'un quota de blé destiné à la
FNBT.
Consommation de la farine au Maroc
Les produits céréaliers font partie du panier
quotidien des ménages. Ils constituent une source d'énergie et de
nutriments dont l'importance reste prédominante et varie en fonction des
milieux de résidence et des catégories socio-économiques.
En effet, les céréales constituent l'aliment de base de la
population marocaine. La consommation annuelle de farine industrielle
représente selon les régions entre 60 à 100 Kg par
habitant. L'urbanisation croissante et les évolutions de la
société semblent provoquer de nouveaux types d'achat, tels
l'augmentation du volume de pain acheté aux dépens de l'achat de
céréales et farines pour la panification domestique.
Le marché du pain se caractérise en milieu
rural et dans les milieux populaires urbains par la prédominance de la
panification domestique. Ceci s'explique par des raisons physiques (faible
nombre de boulangeries en milieu rural), culturelles (le pain fait à la
maison est considéré comme meilleur que celui acheté dans
une boulangerie) et surtout économiques (coût au kg plus
avantageux).
Page
18
Les études réalisées au
Maroc4 par le ministère de l'agriculture et la
fédération nationale des minoteries ont démontré la
place fondamentale de la farine du blé tendre, du blé dur et
d'autres céréales dans la consommation des ménages
marocains.
Intérêt du sujet
Les minoteries industrielles sont des entreprises qui
connaissent plusieurs particularités juridiques et réglementaires
nécessitant de la part de l'Expert-Comptable une bonne maîtrise
pour mener à bien ses missions d'audit légal ou contractuel.
Ces particularités concernent les aspects suivants :
· La relation élargie entre les minoteries
industrielles et l'Office National Interprofessionnel des
Céréales et Légumineuses (ONICL), organisme chargé
par l'Etat pour la régulation du secteur.
· Le respect de la minoterie des obligations
légales en matière d'approvisionnement en céréales
et de vente de la farine.
· Le respect des obligations légales en
matière de suivi des stocks des céréales et de la farine
et établissement des déclarations périodiques à
l'ONICL.
· La réception par les minoteries industrielles
des primes et subventions auprès de l'ONICL calculées à
partir des paramètres définis dans les textes de loi et des
circulaires de l'administration.
· Le paiement des taxes parafiscales calculées
à partir des paramètres définis dans les textes de loi et
des circulaires de l'administration.
· L'importance de certains éléments dans
le bilan des minoteries (Immobilisations corporelles et stocks)
L'objectif de ce mémoire est de fournir à
l'Expert-Comptable chargé du suivi d'une telle entreprise un guide
opérationnel présentant les nombreuses spécificités
du secteur, dont notamment l'environnement réglementaire assez dense.
Le cadre de la mission d'audit légal ou contractuel a
été retenu car il permet d'évoquer de façon plus
détaillée le contrôle des procédures internes et des
comptes de la minoterie industrielle. Un questionnaire de révision de
ces procédures et des comptes, adapté aux
spécificités de la profession, est proposé dans ce
mémoire.
4 Etude stratégique réalisée en
2009 avec l'appui de l'union européenne dans le cadre de programme
d'appui des associations professionnelles.
Page
19
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Ce mémoire sera organisé en deux grandes parties
:
1ère partie : Statut particulier des minoteries :
Analyse juridique, réglementaire, comptable et fiscale.
Cette première partie sera consacrée à
la description de l'environnement d'une minoterie. La présentation des
particularités juridiques, réglementaires, comptables et fiscales
sera précédée d'un portrait détaillé de la
profession et de son évolution.
2ème partie : Proposition d'une méthodologie
d'audit
La seconde partie proposera quant à elle une
méthodologie pour la conduite d'une mission d'audit légal ou
contractuel où seuls les points présentant une
particularité dans ce secteur seront mis en relief, alors que les
problèmes déjà bien connus des professionnels par ailleurs
ne feront l'objet d'aucun traitement particulier.
Page
20
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Première partie : Statut particulier des
minoteries au Maroc : analyse juridique,
réglementaire, comptable et fiscale
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page
21
Introduction à la première partie
Page
22
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
La transformation des céréales au Maroc se fait
essentiellement par des minoteries industrielles de grande taille. Celles-ci
nécessitent des investissements importants et prennent
généralement la forme d'une société anonyme.
Ces entités nécessitent l'intervention de
l'Expert Comptable pour la révision de leurs comptes ou pour
réaliser des missions d'audit légal ou contractuel.
Comme dans tout secteur d'activité, L'Expert Comptable
appelé à exécuter l'une de ces missions doit s'informer
sur les particularités du secteur et acquérir une connaissance
approfondie dans ce domaine. Du fait que les céréales sont la
matière première des minoteries, l'Expert comptable doit bien
maîtriser le fonctionnement du marché céréalier
(Chapitre 1).
La nature des minoteries industrielles ainsi que le processus
et les produits de la transformation sont des éléments qui
doivent être connues par l'Expert Comptable avant d'entamer sa mission.
Ces informations sont nécessaires pour réaliser des travaux
d'audit (les indicateurs d'écrasement lors de la revue analytique,
vérification des stocks des produits finis, .....) (Chapitre
2)
Les relations juridiques et administratives entretenues par
les minoteries avec l'office national interprofessionnel des
céréales et légumineuses (ONICL) ainsi que les
particularités fiscales et comptables sont des éléments
importants que doit connaître l'Expert Comptable pour mener à bien
sa mission (Chapitre 3)
Page
23
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Chapitre 1 : Le Marché Céréalier
au
Maroc
Page
24
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Le premier chapitre de cette première partie sera
consacré à la description du fonctionnement du marché
céréalier au Maroc.
En effet, ledit marché se caractérise par
l'intervention de l'Etat à travers son organisme public « Office
National Interprofessionnel des Céréales et
Légumineuses» « O.N.I.C.L » et d'autres
acteurs économiques (section 1).
On traitera également dans ce chapitre les
régimes de commercialisation des céréales (section 2),
l'importation et le commerce extérieur des céréales
(section 3) et enfin les politiques de stockage suivie dans ce
secteur (section 4).
Section 1 : Intervenants sur le marché
céréalier au Maroc
1. L'acteur public : Office National Interprofessionnel
des Céréales et Légumineuses (O.N.I.C.L)
L'Office National Interprofessionnel des
Céréales et des Légumineuses, créé en 1937,
est un établissement public doté de la personnalité morale
et de l'autonomie financière. Il est placé sous la double tutelle
du Ministère de l'Agriculture et du Ministère des Finances.
Ses principales missions s'attellent au suivi de
l'état d'approvisionnement du marché en céréales,
légumineuses et dérivés et à l'organisation du
marché.
Le détail des missions de l'ONICL sera exposé
dans le cadre du chapitre 3 de cette première partie.
2. Les acteurs privés
a. Les commerçants collecteurs
Les commerçants collecteurs sont des négociants
qui procèdent à la collecte des céréales
auprès des agriculteurs et à la vente aux consommateurs
directement dans les souks (RAHBAS) et aux commerçants négociants
stockeurs.
Les commerçants collecteurs disposent rarement de
moyens de stockage importants, mais en revanche, ils sont souvent
propriétaires de camions avec lesquels ils acheminent les
céréales vers les grands centres.
Page
25
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Ces commerçants sont des personnes physiques qui
travaillent dans l'informel sans autorisation de l'office national des
céréales et légumineuses.
B. Les commerçants négociants
stockeurs
Les commerçants négociants des
céréales, personnes physiques ou morales, exercent le commerce
des céréales dans les propriétés agricoles, les
entrepôts, sur les marchés ruraux et urbains ou sur tout autre
lieu d'achat admis par les autorités locales et aux jours fixés
par ces dernières.
Toutefois, avant le commencement de leur activité, les
commerçants négociants stockeurs devront faire une
déclaration d'existence à l'ONICL en précisant notamment,
la situation et la consistance des locaux destinés au commerce et au
stockage des céréales et des légumineuses. La loi 12-94 a
supprimé en 1994 l'agrément qui était exigé pour la
négociation et le stockage des céréales.
Ces commerçants disposent de moyens de stockage
importants d'une capacité totale couverte de 37,2 Millions de quintaux
environ5. Leurs ressources financières sont constituées par des
fonds propres et d'avances sur marchandises consenties par les banques.
Les commerçants négociants stockeurs reprennent
les céréales auprès des commerçants collecteurs et
assurent la livraison aux minoteries industrielles. Ils sont autorisés
à réaliser les opérations d'importations et d'exportations
des céréales.
C. Les commerçants détaillants
Les commerçants détaillants s'approvisionnent
sur les lieux d'achats autorisés (souks et marchés),
auprès des petits producteurs, et des commerçants collecteurs.
Pour les céréales vendues sans licences, et
dans les mêmes conditions, ils s'approvisionnent auprès des
organismes coopératifs et des commerçants négociants
stockeurs.
5 ONICL, Avril 2011
Page
26
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
d. Les coopératives des
céréales
Les coopératives agricoles spécialisées
dans le commerce et le stockage des céréales (Coopératives
Agricoles Marocaines « CAM ») sont regroupées à
l'intérieur de l'union des coopératives agricoles marocaines
(UNCAM) et de l'association marocaine des commerçants en
céréales et légumineuses (A.M.C.C.L).
Ces coopératives possèdent une capacité
de stockage couverte de 4,69 Millions de quintaux6 constituée
essentiellement par des magasins. Elles disposent d'importants moyens de
commercialisation (réseaux de distribution importants et moyens de
transport) et reçoivent des crédits « warrantages »
intéressants au prorata des programmes d'achat approuvés par le
Ministère de l'Agriculture.
Elles bénéficient donc d'avantages financiers
(crédits « warrantages » sans plafond à des taux
d'intérêt faibles.
Les coopératives sont présentes dans la
quasi-totalité des provinces, alors que les commerçants
négociants stockeurs de céréales tendent à se
concentrer dans les grandes villes des zones de production.
E. Les minoteries industrielles
Les minoteries industrielles sont des installations de
moutures ayant pour objet l'écrasement des céréales en vue
de leur commercialisation.
Concernant l'intervention des minoteries industrielles sur le
marché céréalier, la loi 12-94 sur l'ONICL a
autorisé ces dernières à pratiquer des achats directs de
blé dur pour les besoins de leurs usines. Elles sont de ce fait
assimilées aux commerçants négociants stockeurs de
céréales (article 13 de la loi 12-94)
F. Les moulins artisanaux
Ces entreprises sont réparties dans les petits centres
des zones rurales ainsi que dans certains quartiers urbains des grandes
agglomérations.
Les minoteries artisanales doivent limiter leur activité
à :
6 ONICL 2011
Page
27
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
? L'écrasement des grains que les particuliers leur
apportent.
? La production et la vente de farine destinée à
la consommation familiale de leur clientèle.
g. Les autres industries
Cette catégorie regroupe les moulins industriels et
semi-i industriels à orge, les maïseries et les brasseries. Ces
différentes industries peuvent acheter céréales et
légumineuses dans la limite de leurs propres besoins.
La figure n°1 ci-dessous présente d'une
manière synoptique les différents intervenants sur le
marché céréalier7.
7 Ce schéma est repris d'une étude sur
le secteur meunier réalisée en 2009 par la
fédération nationale des minoteries « étude
stratégique sur les perspectives d'évolution du secteur meunier
».
Page
28
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Figure 1 : Intervenants sur le marché
céréalier
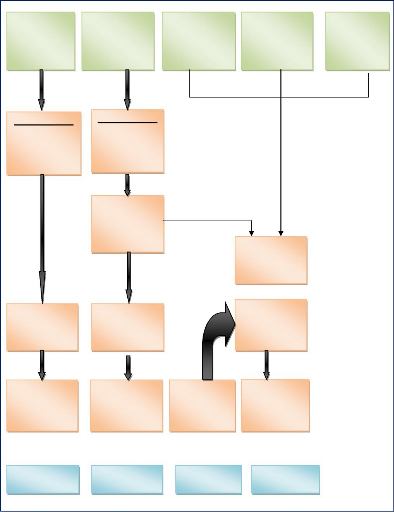
Intermédiaire 1
Auto
consommation
Vente au souk
selon besoin de
trésorerie
Production vivrière
Circuit 1
Moulin artisanal
Production marchande
Consommateurs
Intermédiaire 2
Petit collecteur
au niveau du
souk
Commerçants
négociants
de
céréales
Halles aux grains
Circuit 2
Production (agriculteurs organisés en
coopératives
Coopératives
et/ou
commerçants
Circuit 3
Distribution sur le marché local
Consommateurs
Unités
industrielles
Production
(gros
agriculteurs)
Circuit 4
Importateurs
Page
29
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Section 2 : Régimes de commercialisation
L'orientation des pouvoirs publics vers la
libéralisation de commercialisation a été
matérialisée par la promulgation de la loi 12-94 dont ses grands
traits sont agencés autour de deux points essentiels :
? La mise en place d'une nouvelle organisation du marché
des céréales. ? La révision de la mission de l'ONICL.
En vertu de cette loi, adoptée en 1995, le commerce
des céréales est libre, mais l'ONICL se réserve toujours
un rôle déterminant, notamment en matière de suivi de la
filière céréalière en général et
celle du blé tendre en particulier.
Depuis l'adoption de cette loi, les céréaliers
peuvent livrer leur production aux coopératives, aux commerçants
privés ou directement aux minoteries. Les produits livrés sont
soumis à une taxe de commercialisation perçue par l'ONICL pour
contribuer à la couverture des dépenses de cet organisme,
notamment en ce qui concerne les frais de stockage.
La campagne de commercialisation de la récolte
nationale du blé tendre commence chaque année vers la
première semaine du mois de juin. Les coopératives agricoles
marocaines (CAM) et les commerçants collecteurs jouent le principal
rôle d'approvisionnement des minoteries. La collecte et
l'écoulement des produits peuvent concerner le circuit des minoteries
industrielles ou encore celui de la minoterie artisanale. Toutefois, l'ONICL
est chargé du suivi de l'ensemble de la campagne de commercialisation
avec une approche beaucoup plus exigeante au niveau du circuit industriel.
La mise sur le marché des céréales
diffère selon deux principaux critères, à savoir
l'importance des productions dans les différentes régions et les
besoins d'autoconsommation au niveau des exploitations agricoles.
Page
30
Le marché céréalier au Maroc se
caractérise par l'existence simultanée de deux
marchés8 : Un marché traditionnel dont les
transactions commerciales s'effectuent au niveau des places dites souks ruraux
hebdomadaires et halles aux grains. Ce marché est animé par les
petits et moyens agriculteurs, des commerçants intermédiaires
(collecteurs) et des consommateurs.
Les principales transactions sur ce marché sont
destinées à l'autoconsommation et la satisfaction des besoins des
marchés locaux et des ménages.
Toutefois, une partie non négligeable de la production
locale traitée au niveau de ces places est remontée par les
collecteurs aux organismes stockeurs et minoteries opérant dans le cadre
du marché organisé.
Un marché organisé dont les activités de
commercialisation, de stockage, d'importation, d'exportation et transformation
industrielle sont régies par la loi n°12-94 relative à
L'ONICL et la loi n° 13-89 relative au commerce extérieur, telles
qu'elles ont été modifiées ou complétées et
par les textes pris pour leur application.
Les opérateurs intervenant dans le cadre du
marché organisé sont régis par l'article 11 de la loi
12-94 précitée. Les intervenants sont constitués de
commerçants négociants stockeurs, des coopératives
agricoles et des transformateurs industriels. Ces opérateurs sont
organisés dans le cadre d'associations ou fédérations
professionnelles ci-après :
? Les Coopératives Agricoles Marocaines (CAM) et leur
union nationale (UNCAM): elles interviennent essentiellement dans
l'importation, la collecte et la distribution aux minoteries industrielles.
? La Fédération Nationale des Négociants en
Céréales et Légumineuses (FNCL).
? La Fédération Nationale de la Minoterie (FNM).
Dans le cadre du marché organisé, l'ONICL
organise annuellement une campagne de collecte et de commercialisation du
blé tendre local.
8 « Commercialisation des céréales et des
légumineuses au Maroc » étude de l'ONICL,
www.onicl.org.ma
Page
31
L'Etat fixe au titre de chaque campagne, par
arrêté, un régime spécifique pour la collecte de la
récolte du blé tendre selon l'importance que revêt celui-ci
dans la production céréalière et la fabrication de la
farine subventionnée à partir de ce blé.
Il fixe, notamment, les conditions d'achats du blé
tendre par les organismes stockeurs et les livraisons aux minoteries
industrielles pour la fabrication de la farine subventionnée.
Ainsi, au titre de la collecte de la récolte d'une
année, les mesures édictées par l'arrêté sont
reprises par des circulaires exposant les modalités pratiques
d'application de l'arrêté et concernent, notamment :
? La fixation d'un prix référentiel d'achat du
blé tendre de la production nationale pour une qualité standard.
Ce prix intègre toutes les charges, taxes et marges inhérentes
à l'achat auprès des producteurs et à la livraison aux
minoteries industrielles. Il peut être, le cas échéant,
majoré de bonifications ou minoré de réfactions, dont les
taux sont négociables entre les parties concernées et ce
après la réalisation de l'opération d'agréage.
? Les organismes stockeurs (commerçants en
céréales et Coopératives Agricoles Marocaines et leurs
Unions), bénéficieront d'une prime de magasinage d'un montant par
quintal et par quinzaine sur les quantités de blé tendre de
production nationale acquises et déclarées à l'ONICL et
mises en stock au niveau des magasins ou silos déclarés à
cet organisme. La prime de magasinage est octroyée jusqu'à fin
avril de chaque année et concerne uniquement les stocks provenant
d'achats effectués jusqu'à une date donnée.
? Les quantités de blé tendre de production
nationale, acquises et déclarées à l'ONICL durant la
période définie par voie de circulaire, donnent droit à
une subvention forfaitaire. Celle-ci correspond à la différence
entre le prix référentiel d'achat et le prix de vente aux moulins
pour la fabrication des farines libres commercialisées sur le
marché intérieur.
? L'ONICL organise des appels d'offres auprès des
organismes stockeurs pour l'achat du blé tendre destiné à
la fabrication des farines subventionnées. Les organismes adjudicataires
livrent les quantités de blé aux minoteries au prix uniforme,
à qualité standard par quintal. La différence entre le
prix résultant des appels d'offres et le prix de cession uniforme
indiqué ci-dessus fait l'objet d'une régularisation à
opérer par l'ONICL avec les adjudicataires.
Page
32
Section 3 : Importation des céréales et
commerce extérieur.
L'appoint nécessaire à la satisfaction de la
demande locale en blé tendre est assuré par l'importation.
Les volumes importés en blé tendre
dépendent de la récolte locale et fluctuent selon les
années. Au niveau réglementaire, l'importation des
céréales est organisée par les textes suivants :
· Loi 12-94 relative à l'ONICL (article 24).
· Loi 17-96 complétant la loi 12-94
· Décret n° 2-97-512 du 28 octobre 1997
relatif à la caution de bonne exécution des opérations
d'importation des céréales et légumineuses.
· Arrêté conjoint du ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation et du ministre de
l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts
n°1172-02 du 18 juillet 2002 fixant le montant de la caution de bonne
exécution des opérations d'importation des céréales
et légumineuses et ses produits dérivés.
· Circulaire n°1/2012 relative aux modalités
d'importation et d'exportation des céréales et
légumineuses et ses produits dérivés.
Ces textes énoncent les règles suivantes en
matière d'importation :
· Principe de liberté d'importation des
céréales
· Personnes habilitées à réaliser les
importations des céréales.
· Dépôt par les importateurs d'une
déclaration préalable (déclaration initiale
d'importation)
· Dépôt par les importateurs d'une caution de
bonne exécution
· Justification de la réalisation des
opérations d'importation
· Restitution de la caution de bonne exécution
Page
33
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
1. Principe de liberté d'importation des
céréales
La loi 12-94 relative à l'ONICL énonce le
principe de liberté d'importation des céréales qui
déclare dans son article 24 que :
« L'importation et l'exportation des
céréales, des légumineuses et des produits qui en sont
dérivés sont libres et s'effectuent conformément à
la législation en vigueur relative au commerce extérieur
».
2. Personnes habilitées à réaliser
les importations des céréales.
L'importation ne peut être faite que par les personnes
définies dans l'article 11 la loi 12-94, c'est-à-dire les
commerçants négociants ayant déposé les
déclarations d'existence auprès de l'ONICL.
3. Dépôt par les importateurs d'une
déclaration préalable (déclaration initiale
d'importation)
En vertu de la loi 17-96 complétant la loi 12-94 (article
24) :
« Les personnes physiques ou morales visées
à l'article 11 ci-dessus, qui envisagent de procéder à des
opérations d'importation ou d'exportation des céréales et
des légumineuses, sont tenues de produire à l'Office une
déclaration, contre récépissé, dans les formes
prescrites par ses soins après consultation des parties
concernées ».
La circulaire n°1/2012 citée ci-dessus, stipule
que la déclaration initiale d'importation doit être
déposée auprès du Service Extérieur de l'ONICL dont
dépend le siège social de l'opérateur et ce au moins cinq
(5) jours francs avant le passage de la marchandise en douane.
4. Dépôt d'une caution de bonne
exécution
Les importateurs doivent, avant toute opération
d'importation, déposer auprès de l'Office, simultanément
au dépôt de la déclaration initiale d'importation, une
caution de bonne exécution dont le montant et les modalités de
constitution sont fixés par l'administration. En cas
d'inexécution de l'opération d'importation, le montant de la
caution est acquis à l'office.
Page
34
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
En vertu de l'arrêté n° 1172-02 du 7 Joumada
I 1423 (18 Juillet 2002) fixant le montant de la caution de la bonne
exécution des opération d'importation des céréales
et des légumineuses et les modalités de remise du
récépissé , le montant de la caution de bonne
exécution des opérations d'importation des céréales
et des légumineuses est fixé comme suit :
? Blés : 5 Dirhams par quintal.
? Maïs, orges, légumineuses ou autres : .3 Dirhams
par quintal.
Ces montants ont été fixés depuis
l'année 2002 et ils n'ont subi aucun changement depuis cette date.
5. Justification de la réalisation des
opérations d'importation
L'importateur est tenu de déposer également
:
? Avant l'arrivée du navire, une déclaration
d'exécution annonçant l'arrivée du navire
accompagnée du Connaissement. Dans le cas où une cargaison aurait
fait l'objet d'un transbordement avant son arrivée au Maroc, un bon
à délivrer pourrait, si nécessaire, être
exigé pour établir la correspondance avec le bon de livraison
d'origine. En ce qui concerne les importations par voie terrestre, ils font
l'objet de lettres de voiture à rapprocher avec le bon de livraison.
? Au plus tard à la fin du chargement du navire, une
déclaration complémentaire d'achèvement de
l'importation.
6. Restitution de la caution de bonne exécution
La réalisation de l'opération d'importation des
céréales et légumineuses doit intervenir en
conformité avec les dispositions réglementaires, dans un
délai n'excédant pas trois mois pour les blés, et quatre
mois pour les autres céréales et légumineuses. Ce
délai comprend la période allant jusqu'à la date limite
d'arrivée figurant dans la déclaration initiale et le mois
additionnel prévu par le décret n° 2-08-289.
Exceptionnellement, ce délai pourrait être
prorogé d'un mois supplémentaire sur demande de l'importateur,
dûment argumentée et après accord du service central de
l'ONICL. Au-delà de ce délai, la caution de bonne
exécution est acquise, en totalité, sauf cas de force majeure
dûment justifié.
Page
35
L'arrivée de la marchandise au port de
déchargement est matérialisée par l'attestation d'escale
délivrée par la capitainerie du port. Quant à la
réalisation de l'opération d'importation, elle doit être
justifiée par le connaissement et l'attestation d'importation
délivrée par l'Administration des Douanes et Impôts
Indirects. L'attestation d'importation doit faire référence
obligatoirement au numéro du récépissé
délivré par l'ONICL pour le passage de la marchandise.
En cas de bonne exécution, la caution est
restituée à l'importateur par le service extérieur
concerné de l'ONICL contre décharge dûment visée par
l'importateur. Dans le cas contraire, cette caution est transmise au service
central de l'ONICL à charge pour l'importateur concerné de
fournir les justificatifs du cas de force majeure qui a empêché
l'exécution de l'opération en question. Si le cas de force
majeure ne peut pas être retenu, le montant de la caution est acquis
à l'ONICL et ce, conformément aux dispositions de l'article 24 de
la loi n° 12-94 telle qu'elle a été complétée
par la loi n°17-96 et le décret n°2-97-512.
Section 4 : Politique de stockage.
Le stockage des céréales est un des facteurs
les plus importants pour assurer la sécurité alimentaire du pays.
En effet, compte tenu du décalage entre le rythme de la production et
celui de la consommation, toute politique de régulation du marché
ne peut être qu'illusoire si elle ne considère pas la fonction
stockage.
Il est exposé ci-après certains constats et
statistiques concernant ladite politique.
1. Infrastructures et capacité de stockage
La capacité de stockage est de 42 millions de
quintaux9. La collecte est actuellement assurée par plusieurs
entités dont la contribution à la constitution des stocks est
variable : les commerçants négociants stockeurs dominent avec une
part de marché de 89% et les coopératives avec 11%.
Avec la suppression de l'agrément, tout individu
disposant de capitaux et maîtrisant théoriquement le savoir-faire
nécessaire peut entreprendre une telle activité, sous
réserve de tenir l'ONICL informé des flux des produits et de
fournir les statistiques y afférentes.
9 ONICL 2011
Page
36
Points forts du système de collecte et de
stockage10 :
· Bonne couverture territoriale.
· Proximité par rapport aux producteurs.
· Adaptation aux modes de transaction traditionnels
(faible bancarisation des agriculteurs, capacités de transport
rudimentaires...).
Points faibles du système de collecte et de stockage :
· Absence totale de traçabilité due aux
mélanges de blés lors du déchargement.
· Infrastructure de stockage défaillante car les
silos portuaires et les minotiers n'engrangent qu'un faible volume, le reste
est stocké en vrac dans les magasins ou en sacs empilés.
· Caractère rudimentaire de la manutention au
niveau des exploitations se traduisant par un taux important de corps
étrangers (pierres, chaume, graines de plantes parasites, etc...).
· Non homogénéité des blés
empêchant la « caractérisation » en termes de
paramètres techniques (poids spécifique, taux
protéinique...).
· Faible protection contre les ravageurs se traduisant
par des pertes non négligeables dues aux rongeurs et insectes
(sitophilus, bophilus, etc...).
· Transport n'obéissant à aucune exigence
particulière, ce qui fait qu'on assiste aussi bien à un transport
non spécifique en sacs et plus rarement en vrac par bennes.
· Réception chez les collecteurs, notamment les
petits commerçants, s'effectuent avec un simple contrôle visuel,
sans véritable contrôle « qualité ». Le taux
d'humidité n'est pas connu. Le poids est mesuré par des bascules
de faible précision.
2. Mesures prises par les pouvoirs publics pour
améliorer les infrastructures de stockage.
a) Octroi d'une prime de construction
Une prime de construction et d'équipement des
unités de stockage de graines (en dehors de l'activité portuaire)
est accordée par l'Etat. Elle varie entre 100 et 150 dhs la tonne, selon
la capacité de l'unité de stockage à construire.
10 Stockage des céréales : Un handicap
majeur pour la filière, article publié en 2009 sur le journal
MAGHRESS.
Page
37
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Cette prime de construction, fixée dans le cadre des
incitations financières de l'Etat a été introduite en 2010
en vue de la promotion de l'agriculture marocaine dans le cadre du Plan Maroc
Vert11.
B) Octroi d'une prime de magasinage
En ce qui concerne le blé tendre de production
nationale, l'ONICL accorde aux coopératives et aux commerçants
des céréales une prime de magasinage, d'entretien et de gestion
fixée à 2 dh le quintal par quinzaine. Les quantités de
blé tendre doivent être convenablement stockées et leur
mode de stockage doit faciliter le contrôle de la quantité et de
la qualité.
Le montant de cette prime est fixé annuellement par un
arrêté ministériel. En 2012, son montant est de deux
dirhams par quintal.
C) Obligation du respect de stock de
sécurité
L'affectation du blé aux minoteries tient compte des
programmes établis par l'Office selon l'importance des contingents qui
leur sont attribués. Un stock dit de sécurité de
blé tendre est instauré par l'ONICL. Il correspond
théoriquement à une quantité pouvant répondre aux
besoins d'écrasement pendant une période de 3 mois.
4. Constats et chiffres sur les capacités de stockage
a) Capacité de stockage disponible 12
La capacité de stockage des organismes stockeurs se
répartit comme suit :
Répartition de la capacité de stockage
disponible des organismes spécialisés (coopératives
et
commerçants stockeurs)
|
Type d'organismes
|
Capacité disponible (en million Qx)
|
Capacité disponible
(en %)
|
|
Commerçants stockeurs
|
37,12
|
89%
|
|
Coopératives
|
4,69
|
11%
|
|
Total
|
41.8
|
100%
|
11 Fond de développement agricole, les aides
financières de l'Etat pour l'encouragement du secteur agricole, document
élaboré par le ministère de l'agriculture et le Plan Maroc
Vert, avril 2011.
12 ONICL, 2012
Page
38
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Ce tableau met en évidence l'importance du secteur
spécialisé dans le stockage (coopératives et
commerçants stockeurs) puisqu'il totalise 41.8 millions de quintaux.
i. Commerçants stockeurs
Les commerçants stockeurs sont des opérateurs
privés qui interviennent dans le commerce et le stockage des
céréales et des légumineuses sur pratiquement l'ensemble
du territoire national. Le groupe actuellement actif, au nombre de 245
détient 89% de la capacité totale de stockage, soit 37.12
millions de quintaux.
Répartition de la capacité de stockage couverte
des commerçants négociants stockeurs13
Type de stockage
|
Capacité 1000 qx
|
Part %
|
Magasins
|
26,80
|
73%
|
Silos
|
10,94
|
27%
|
Total
|
37,12
|
100 %
|
|
ii. Les coopératives (SCAM et CMA)
Les coopératives, au nombre de 72, sont des organismes
coopératifs habilités à commercialiser les
céréales et légumineuses. Elles comprennent les
Sociétés Coopératives Agricoles Marocaines (SCAM) et les
Coopératives Marocaines Agricoles (CMA), l'ensemble étant
regroupé en Union des Sociétés Coopératives
Agricoles Marocaines (USCAM). Ces coopératives sont présentes
dans toutes les provinces. Elles détiennent 11% de la capacité
totale, soit 4,69 millions de quintaux.
13 ONICL, 2012
Page
39
Répartition de la capacité de stockage couverte
des coopératives14
|
Stockage couvert
|
Capacité 1000 qx
|
Part %
|
|
Magasins
|
2.35
|
51%
|
|
Silos
|
2.34
|
49%
|
|
Total
|
4,69
|
100 %
|
b) Nature et âge des installations existantes
Les installations de stockage existantes présentent des
âges différents pouvant atteindre plus de 40 ans, avec des
structures très modernes ou très anciennes mais dans un
état relativement bon. Des opérations de rénovation des
équipements ont été déjà
réalisées. D'autres sont en voie de l'être par certaines
coopératives. Cependant plusieurs d'entre elles ont subi des changements
importants.
C) Répartition régionale de la
capacité de stockage
La répartition de la capacité de stockage
régionale n'est pas uniforme. En effet, 60 % de la capacité
disponible est localisée dans quatre régions économiques :
le centre, le centre nord, le nord-ouest et le centre sud. La région du
centre détient à elle seule le tiers de la capacité
disponible.
D) Rentabilité de la fonction stockage
La faible rentabilité de la fonction de stockage,
confirmée par les enquêtes de l'ONICL, inquiète fortement
les professionnels sur l'avenir d'un secteur ou une bonne partie des
entreprises enregistrent des pertes.
Cette faible rentabilité est attribuée à
divers facteurs dont principalement la sous-utilisation des capacités,
la rémunération insuffisante de l'opération de stockage et
des charges fiscales élevées.
14 ONICL 2012
Page
40
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
e) Subventions
Dans l'aide financière instituée par l'Etat en
faveur du secteur agricole, l'arrêté conjoint du ministre de
l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur
n°369-10 du 26 janvier 2010 fixant les modalités de l'aide de
l'Etat à la construction et à l'équipement des
unités de valorisation des produits agricoles a fixé le taux de
la subvention pour la construction des unités de stockage des
céréales à 10% par unité dans la limite d'un
montant de 3 200 000 dhs par unité.
Page
41
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Chapitre 2 : La transformation des
céréales au Maroc
Page
42
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Introduction
La minoterie industrielle se trouve en position centrale entre
la production agricole et les utilisateurs (industriels ou consommateurs). Elle
assure la valorisation des céréales et fournit l'aliment de base
à la majorité de la population marocaine.
La transformation des céréales est
assurée par une infrastructure de production constituée de deux
types de minoteries : Les minoteries industrielles (section 1)
et les minoteries artisanales (section 2).
L'Expert Comptable, lors de ses missions d'arrêté
ou certification des comptes aura à s'informer sur le processus
d'écrasement des céréales (section 3) et
des produits résultant de la mouture (Section 4) afin
de lui permettre d'assurer le contrôle de la production de la farine, des
issus du blé et les inventaires permanents et physiques des
matières premières, consommables et produits finis.
Section 1 : Minoterie industrielles
1. Définition réglementaire
La loi 12-94 dans son article 14 a défini la minoterie
industrielle comme étant une installation de mouture qui procède
à l'écrasement des céréales en vue de la
commercialisation des produits en résultant.
La loi exige que les bâtiments dans lesquels la
minoterie industrielle est exploitée soient indépendants de tous
autres locaux servant à des activités commerciales ou
industrielles autres que les activités annexes à la minoterie
industrielle, telles que la biscuiterie et la fabrique de pâtes
alimentaires et couscous.
En outre, les aménagements et installations de la
minoterie doivent permettre d'assurer dans les meilleures conditions
d'hygiène le magasinage et le conditionnement des céréales
ainsi que la fabrication et la vente des produits conformément aux
caractéristiques physiques, chimiques et technologiques, ainsi qu'aux
normes de fabrication, de présentation et de livraison fixées par
la réglementation en vigueur.
Page
43
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Pour permettre à l'ONICL de réaliser les
opérations de contrôle, l'organisation administrative et
commerciale de la minoterie doit être conçue de manière
à permettre ces opérations de contrôle.
Soumission du démarrage et de la remise en
marche des minoteries à une
déclaration
administrative15
L'arrêté du ministre de l'agriculture et de la
mise en valeur agricole n° 431-97 du 8 Kaada 1417 (18 Mars 1997) fixant
les conditions d'exercice du métier de la meunerie industrielle a
prévu dans l'article 1er « la déclaration de l'installation
de minoteries industrielles nouvelles, de la remise en marche de minoteries
arrêtées mais encore munies de leur outillage ou de la
transformation des minoteries existantes, est déposée à
l'ONICL, contre remise immédiate d'un récépissé
».
L'article 2 du même arrêté prévoit
: En ce qui concerne les projets d'installation de
nouvelles minoteries et la transformation d'établissements existants, la
déclaration doit être accompagnée des documents suivants
:
· Le plan du terrain et sa situation dans la
ville.
· Le plan d'implantation des bâtiments actuels et
futurs.
· Les plans de construction ou plan de masse tels
qu'ils sont approuvés par les autorités
compétentes.
· La nomenclature du matériel à
installer assorties de ses caractéristiques techniques et de
l'indication de son origine.
· Le plan de montage du matériel.
· Le diagramme de mouture du moulin.
· La capacité de production
envisagée.
La déclaration doit être
déposée à l'ONICL avant le lancement des travaux de
construction ou de transformation.
15 Cf. annexe n°3 relatif au modèle de la
déclaration de démarrage d'une minoterie industrielle au Maroc
Page
44
Dans le cas où une remise en marche d'une minoterie
arrêtée pour une durée supérieure à 3 mois,
la loi exige le dépôt de la même déclaration qui doit
indiquer la date et les motifs de l'arrêt du travail ainsi que la
description de l'état de l'outillage installé et l'indication de
la capacité de production.
2. Etat des lieux des minoteries industrielles au
Maroc
A) Nombre et capacité d'écrasement des
minoteries industrielles
Les minoteries industrielles se composent de près de
200 unités de production présentant une
capacité de transformation totale de 109 millions de
quintaux16.
B) Répartition géographique
La répartition géographique des minoteries
industrielles se caractérise par une grande dispersion sur le territoire
national et leur éloignement des zones de production. En effet, l'axe
Casablanca-Kenitra abrite plus de 60% de l'effectif de la minoterie
industrielle. Cette forte concentration spatiale est à l'origine de
certaines contre-performances traduites par un taux d'utilisation des
capacités qui ne dépasse pas 62% de l'ensemble de l'appareil de
production.
Cette grande dispersion engendrera des coûts de
transport élevés vers les provinces qui ne disposent pas
d'unités de production de la farine.
C) Les minoteries industrielles entre le
libéralisme hésitant et l'administration totale des pouvoirs
publics.
i. Libéralisme hésitant17
Malgré la libéralisation, le secteur meunier
continue à souffrir de contraintes qui vont à l'encontre de cette
politique.
La suppression du monopole de l'importation a donné
une large latitude aux minoteries dans leurs rapports avec les fournisseurs de
blé. Cela a incontestablement amélioré le degré de
contrôle par les minoteries de leur approvisionnement en blé.
D'autant plus que les moulins sont autorisés depuis la campagne des
années 1994-1995 à effectuer des achats directs auprès des
producteurs locaux.
16 ONICL, 2011
17 Etude stratégique du secteur meunier au
Maroc réalisée par la FMN en 2009
Page
45
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Cette politique qualifiée de « libéralisme
hésitant » s'explique essentiellement par la recherche constante
d'une compatibilité entre la dynamique des marchés
intérieurs avec le marché mondial d'une part, et la recherche de
la sécurité alimentaire et du maintien des prix raisonnables
à la consommation d'autre part.
Cela met malheureusement en exergue l'inadéquation de
ces réponses incomplètes aux exigences de la
sécurité alimentaire, qui prennent la forme d'une réaction
à l'urgence mais qui ne règlent pas le problème pour
l'avenir.
Le contrôle de la marge de mouture et son maintien
à un niveau inférieur à son niveau réel
résultant des paramètres normaux de la production a induit une
distorsion dans les coûts de transformation. Les minoteries ont ainsi
fonctionné sur une longue durée avec des « pertes comptables
», ce qui ne permet pas d'évaluer rigoureusement les performances
des entreprises. La survie financière de nombre d'entre elles n'a
été rendue possible que par l'absence d'un renouvellement des
équipements.
Une proportion non négligeable des minoteries a
adopté une attitude d'attente et a retardé les dépenses de
modernisation. Celles qui ont engagé des investissements pour
étendre et améliorer leurs équipements se retrouvent avec
des coûts fixes (charges financières des financements de
l'investissement, dotations aux amortissement ou redevances de
crédit-bail des investissements) d'autant plus importants que le taux
d'utilisation des capacités est faible. Le bilan d'une grande partie de
l'effectif des minoteries indique que le secteur dans sa majorité est en
stagnation : l'actif et le passif circulant est prédominant au
détriment des emplois fixes et des capitaux permanents, ce qui signifie
qu'on utilise du matériel et des constructions totalement amortis et
acquis depuis un grand nombre d'années pour se donner l'illusion d'une
rentabilité marginale.
Cet état de choses fragilise la situation des
entreprises face à l'évolution de la technologie qui apporte
à la fois une amélioration de la qualité et du rendement.
Il leur serait difficile en effet, à défaut d'un cash-flow
significatif et d'un historique de bilan rassurant, d'accéder au
financement que requiert une activité hautement capitalistique.
Page
46
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
ii. Administration totale de l'Etat de la branche «
Farine nationale subventionnée »
L'approvisionnement des minoteries industrielles en
blé tendre pour la fabrication de la farine nationale est
entièrement géré par l'ONICL. Les minoteries ne peuvent
choisir, ni le fournisseur, ni l'origine du blé qu'elles
reçoivent, mais la réglementation prévoit l'agréage
contradictoire, le recours à l'arbitrage avec possibilité de
refus de la marchandise si celle-ci est reconnue comme étant non
marchande.
Bien que les minoteries puissent créer des
sociétés de collecte et commercialisation ou d'importation de
blé, elles ne sont pas autorisées à acheter en
priorité leur blé à ces sociétés ; la
répartition de l'offre disponible, de blé local ou importé
étant effectuée par l'Administration dans une optique de
minimisation du coût global de la subvention et de transport.
Chaque minoterie dispose d'un quota de Farine Nationale
(subventionnée) qu'elle doit vendre obligatoirement à des
commerçants dits "Quotataires".
Les quotas d'écrasement de la FNBT sont
déterminés annuellement par l'Etat.
Les prix d'achat du blé tendre par les minoteries et
le prix de vente des farines de blé tendre sont fixés par la
Commission Interministérielle des Prix.
Page
47
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 48
Section 2 : Minoterie artisanales
1. Définition réglementaire
La minoterie artisanale à blés et/ou à
céréales secondaires est définie comme étant une
installation de mouture qui procède à l'écrasement des
grains que les particuliers lui apportent à moudre ou bien qu'ils
acquièrent auprès d'elle à cette fin.
Contrairement à la minoterie industrielle qui doit
déposer sa déclaration à l'ONICL, l'installation, la
transformation et le transfert des minoteries artisanales à blés
et/ou à céréales secondaires ne sont soumis qu'à
une déclaration écrite adressée à l'autorité
administrative locale.
Ces minoteries contribuent d'une manière significative
à la couverture des besoins des consommateurs en produits
céréaliers.
2. Etat des lieux des minoteries artisanales au Maroc
A) Les écrasements des minoteries
artisanales
La meunerie artisanale représente une activité
dont le poids est inférieur à celui de la minoterie industrielle.
La capacité des minoteries artisanales est difficile à
estimer.
B) L'activité de meunerie artisanale
Les écrasements en milieu rural représentent 90
% des écrasements des meuneries artisanales. Le blé dur, le
b1é tendre et l'orge occupent des places sensiblement
équivalentes.
C) Les services connexes à la mouture du
b1é (nettoyage et triage du blé, tamisage de la farine sont
proposés sur le lieu même du moulin artisanal).
Ces services sont assurés par le moulin lui-même
ou par du personnel, en général des femmes assez
âgées, qui n'ont aucune relation formelle avec l'artisan -
meunier.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Section 3 : Processus d'écrasement des
céréales
L'auditeur doit avoir une connaissance minimale du processus
technique d'écrasement des céréales afin qu'il soit en
mesure de porter un jugement sur l'importance des charges de production
résultant de l'écrasement du blé et de réaliser des
tests de cohérence sur les valeurs
déclarées au bilan des produits et des issus
(sons, ).
Pour cette raison, il est utile de présenter un
aperçu sur le processus d'écrasement du blé18. La
fabrication de la farine passe par les étapes ci-après :
1. Réception Matières premières
A) Réception des blés
La livraison du blé se fait ordinairement en vrac, par
camions. La livraison du blé peut également se faire par
train.
Après pesage du camion sur un pont bascule, le
blé est vidé dans une fosse de réception. IL est
transporté à l'aide d'un transporteur à chaîne ou
à vis jusqu'à un élévateur, puis il est
acheminé jusqu'à un pré-nettoyeur. De là, il
rejoint les cellules de blés sales par élévateurs et
transporteurs.
B) Réception des autres matières
premières
La réception des autres matières
premières (Améliorants : gluten, acide ascorbique, farine de
fève...) se fait en sacs. Ils sont généralement
conditionnés sur des palettes.
Le gluten, utilisé en plus ou moins grande
quantité, peut être réceptionné également en
vrac
Page 49
18 Guide de la meunerie française,
www.meuneriefrancaise.com.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 50
2. Stockage des matières premières
A) Stockage des blés en silos
Dans les minoteries industrielles, les blés sont
stockés suivant les qualités réceptionnées, dans
des cellules verticales, en béton ou métalliques, à
vidange par gravité et/ou à reprise mécanique.
B) Stockage des autres matières
premières
Les autres matières premières sont
stockées sur palettes dans des zones dédiées à cet
effet.
Si le gluten est stocké en vrac, il dispose de
cellules spécifiques de capacité moyenne (20 - 25 t).
3. Préparation des blés
a) Nettoyage et mouillage des blés
Les différentes qualités de blé
prévues pour une fabrication spécifique sont extraites en
même temps des cellules du silo blé pour être
mélangées et constituent une « mouture ». Chaque
débit d'extraction de silos est commandé par un distributeur.
Le blé est ensuite repris par élévateur
pour être acheminé vers l'atelier de nettoyage et de mouillage au
moyen d'un transporteur.
Le blé passe sur un magnétique pour être
trié, épierré, brossé et aspiré, à
l'aide d'un nettoyeur séparateur, d'une épointeuse, d'un
épierreur et éventuellement d'un trieur.
Le blé subit encore une opération de mouillage
pour lui donner un taux d'humidité approprié, facilitant la
mouture. L'humidification est obtenue par adjonction de 2 à 4% d'eau
suivant les récoltes afin d'obtenir un blé à 16-17%
d'humidité.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 51
b) Stockage et repos du blé nettoyé dans
les silos
Une fois mouillé, le blé subi un temps de repos
nécessaire à la pénétration de l'eau à
l'intérieur du grain. Il sera plus ou moins prolongé (12 à
72 heures) selon la nature de l'amande (l'intérieur du grain). Ce repos
s'effectue dans les cellules de conditionnement du nettoyage également
appelées « cellules de repos ».
Le grain ainsi préparé est ensuite
acheminé vers le moulin après un passage dans une
épointeuse (l'épointeuse est utilisée pour effectuer un
nettoyage soigné, par friction, de la plupart des céréales
et graines), un séparateur magnétique et une peseuse (avant 1er
broyeur).
4. Mouture du grain
Afin de libérer les divers éléments
constituant le grain de blé, ce dernier est sassé, broyé
et tamisé.
Ces opérations sont réalisées au moyen
de machines : broyeurs, claqueurs, convertisseurs, plansichters et
réducteurs à sons, qui sont situées à
différents niveaux du moulin afin de favoriser la manutention par
gravité. Les broyeurs, les claqueurs et les convertisseurs se situent
généralement dans le moulin à un niveau inférieur
à celui des plansichters. Le transport des produits est majoritairement
effectué par pneumatique.
Broyeurs
Un broyeur est un appareil formé de quatre cylindres
cannelés tournant deux à deux en sens inverse à des
vitesses différentes. Il a pour but de séparer l'amande (semoule
et farine) de l'enveloppe (son gros et fin).
Plansichters
C'est un équipement qui effectue une opération
dénommée « blutage » ou « tamisage ». Ce sont
des appareils composés de tamis superposés garnis de tissus de
nylon (ou métal) dont les mailles sont adaptées au travail de
classification recherchée.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 52
Ils extraient la farine et classent les autres produits en cours
de transformation dont on poursuivra la mouture.
Tous les produits sont ainsi classés par grosseur : les
refus, les semoules, les farines :
? Les refus sont soumis à une nouvelle réduction
sur les broyeurs,
? Les semoules sont dirigées vers les claqueurs ou
convertisseurs, qui les réduisent à l'état de farine,
? Les différentes qualités de farines obtenues
sont immédiatement collectées et dirigées vers les silos
idoines.
?
Claqueurs et convertisseurs
Ce sont des appareils formés de quatre cylindres lisses
(non cannelés), ayant pour but la production de farine à partir
des semoules.
Après chaque passage de claquage ou de convertissage, les
produits sont blutés une seconde fois.
Détacheurs et brosses à sons
Le détacheur est un appareil permettant la
libération de diverses particules de produits de moutures
amalgamés sous forme de plaquettes après passage entre les
cylindres lisses.
La brosse à sons est un appareil destiné au
traitement des enveloppes du blé après broyage pour
séparer les farines adhérant à celles-ci (enveloppes).
5. Traitement de la farine
a) Ensachage et palettisation automatique des
farines
Une partie des farines vrac, en silos, est reprise pour
être ensachée dans des sacs en papier de 25 kg, 50 kg et 100 kg et
mise sur palettes.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 53
L'ensachage peut être réalisé sur poste
fixe ou sur carrousel, selon un système à valve ou à
gueule ouverte. Une zone de palettisation avec tapis peut être
présente.
b) Mélange industriel des farines
Le mélange des farines permet de combiner
différentes qualités de farines entre elles avec divers
ingrédients (gluten, additifs ....)
L'opération peut être effectuée soit dans
une mélangeuse discontinue, soit en continu dans le circuit :
? En amont de la mélangeuse, les différentes
farines sont extraites des cellules et sont successivement pesées dans
une trémie sur pesons ainsi que les ingrédients, puis introduits
dans la mélangeuse. Un pré-mélange d'additifs peut
être introduit en amont de la mélangeuse.
? En aval de celle-ci, les nouvelles farines ainsi
constituées sont stockées dans des cellules
spécialisées et/ou de pré-chargement et/ou
ensachées.
6. Stockage des produits finis
Les produits finis sont soit les farines provenant
directement du moulin, soit celles issues des différentes phases
complémentaires.
Les farines sont pesées par bascules et stockées
dans différentes cellules spécialisées.
Les différents sous-produits sont les gros sons, les
fins sons, les remoulages. La farine basse est une farine impropre à la
consommation humaine. Ces produits sont stockés dans des cellules
spécialisées.
a) Stockage des farines
Les farines sont stockées pendant un délai court,
de l'ordre de 10 à 20 jours :
En vrac :
Les types de stockage de farines en vrac peuvent être
très variables. Ils sont soit de grande capacité (cellules en
béton ou métalliques de 50 à 200 tonnes), soit de
capacité plus réduite (cellules métalliques, en panneaux
de particules de bois mélaminés, en polyester armé, plus
rarement en toile).
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 54
L'alimentation et l'extraction sont le plus souvent
pneumatiques, mais l'alimentation mécanique est encore
présente.
En sacs :
Au niveau de l'ensachage, une zone de palettisation avec
tapis peut être présente.
Après ensachage, les farines en sacs sont
palettisées et dirigées vers un magasin de stockage.
b) Stockage des sous-produits
Toutes les issues sont stockées en vrac dans des
cellules spécialisées.
Section 4 : Produits de la minoterie
Les produits de la minoterie sont constitués
principalement par les farines de blé tendre, les semoules de blé
dur et enfin les issues et déchets.
Les premières peuvent être classées en
plusieurs catégories selon la qualité du grain utilisé :
farines de blé tendre « Plates », « rondes », «
luxes », « secondes » suivant les types de blé, les
issues représentent 18 à 20% du poids initial.
Les produits élaborés par la minoterie sont
utilisés essentiellement par les ménages. Pour la
préparation domestique du pain et du couscous, et dans une moindre
mesure, par les boulangeries.
Un Arrêté du ministre de l'agriculture et de la
pêche maritime (arrêté n° 2318-09 du 7 ramadan 1430, 28
août 2009) a défini les caractéristiques des produits de
blé tendre et de blé dur fabriqués et mis en vente par la
minoterie industrielle.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 55
1. Définitions des produits de la minoterie
A) Farine de blé tendre
Produit amylacé et glutineux provenant de la mouture
industrielle fine des grains de blé tendre.
B) Farine complète de blé tendre
Produit issu de la mouture intégrale industrielle des
grains de blé tendre. Au cours de cette mouture, le grain est
réduit en particules fines d'amandes de son et de germe.
C) Semoule
Produit granulé issu de la mouture industrielle des
grains de blé dur.
D) Finot
Produit granulé fin issu de la mouture industrielle des
grains de blé dur.
e) Farine de blé dur
Produit amylacé el glutineux issu de la mouture
industrielle fine des grains de blé dur.
f) Farine complète de blé dur
Produit issu de la mouture intégrale industrielle des
grains de blé dur. Au cours de cette mouture, le grain est réduit
en particules fines d'amande, de son et de germe.
2. Caractéristiques chimiques et minérales
des produits de la minoterie
L'arrêté du ministre de l'agriculture a fixé
des caractéristiques chimiques et physiques pour chaque produit
fabriqué. Ces critères sont les suivants :
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Exemple de normes de quelques farines
Farine
|
FNBT
|
Farine fleur
Du blé tendre
|
Farine de luxe du
blé tendre
|
Taux de
minéralisation
|
Entre 0,8 et 1,5%
|
0,5%
|
Entre 0,51 et 0,65%
|
Taux de refus
nul au tamis
|
Ouverture de maille
de 500 microns
|
Ouverture de maille
de 200 microns
|
Ouverture de maille
de 500 microns
|
Teneur en
protéine minimale
|
9,5%
|
9,5%
|
9,5%
|
Acidité
grasse
|
Maximum de 0,07%
|
Maximum de 0,07%
|
Maximum de 0,06%
|
|
Page 56
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Chapitre 3 : Réglementation juridique,
administrative et particularités comptables
et
fiscales des minoteries
Page 57
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 58
Section I- Organisation professionnelle du secteur
1. L'Office National Interprofessionnel des
Céréales et Légumineuses (ONICL)
A) Statut juridique
Comme signalé dans le chapitre 1 de la première
partie, l'Office National Interprofessionnel des Céréales et des
Légumineuses(ONICL) est un établissement public, doté de
la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Soumis à la tutelle de l'Etat, l'ONICL a pour mission de
veiller au respect de la réglementation.
b) Missions
Selon les dispositions de la loi 12-94, l'ONICL a pour
principale mission de suivre l'état d'approvisionnement du pays en
céréales et en légumineuses et leurs
dérivés.
Il est également chargé :
· Des missions d'étude : Etude des mesures
législatives et réglementaires de nature à organiser le
marché des céréales, des légumineuses et
dérivés.
· Des missions de contrôle : afin d'assurer
l'exécution des mesures législatives en place.
· Des missions de constituer ou de faire constituer un
stock de sécurité en céréales.
· De gérer et exploiter des silos à
céréales portuaires existants, de développer et
créer d'autres capacités de réception des
céréales.
· De réaliser des opérations
particulières d'importation et d'exportation de blé.
· De gérer un système d'information des
marchés céréaliers et de développer les
données et statistiques correspondantes.
· D'apporter l'assistance technique et l'information
nécessaires aux intervenants sur le marché des
céréales et des légumineuses et de leurs
dérivés dans les différents domaines de leurs
activités,
·
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
De contribuer à la modernisation du secteur de la
minoterie et de susciter la constitution d'associations professionnelles qui
servent de trait d'union entre les professionnels et l'Administration.
c) Activités principales
Ses principales activités sont les suivantes :
· Suivi de l'état d'approvisionnement du
marché des céréales, des légumineuses et de leurs
produits dérivés.
· Suivi de la collecte et des prix des
céréales et légumineuses ;
· Suivi de l'approvisionnement en blés des
minoteries industrielles et de l'exécution du contingent en farines
subventionnées.
· Suivi des opérations d'importation des
céréales et légumineuses et gestion des contingents
tarifaires préférentiels.
· Paiement des primes compensatrices et de frais pour le
compte de l'Etat, savoir :
+ Primes compensatrices sur les farines
subventionnées produites par les minoteries industrielles.
+ Primes de magasinage pour le blé tendre
collecté dans le cadre de la récolte nationale et stocké
par les organismes stockeurs.
+ Frais de transport des farines subventionnées aux
minoteries industrielles.
+ Frais de transport relatifs aux opérations
ponctuelles (approvisionnement du marché en
céréales).
d) Ressources humaines et implantation
géographique
Pour s'acquitter de ses missions, l'ONICL s'est doté de
structures centrales composées de 10 divisions, des attachés de
direction, de la Trésorerie Paierie ainsi que de services
extérieurs comprenant 16 services régionaux et 8 services
provinciaux.
Page 59
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 60
e) Ressources financières
Les ressources relatives aux opérations propres de
l'ONICL proviennent essentiellement de la taxe parafiscale,
dénommée taxe de commercialisation des céréales et
des légumineuses (locales et importées) et des produits et
bénéfices provenant de son patrimoine et de ses
opérations.
Les ressources relatives au « compte de blé tendre
et farine », proviennent en grande partie des subventions de l'Etat.
2. Organisation du marché
Les règles de fonctionnement du marché
céréalier fixées par la loi 12-94 sont comme suit :
a) Principe de liberté d'exercice du commerce de
céréales
b) Déclaration préalable d'existence pour les
commerçants des céréales
c) Constitution de stock de sécurité
d) Minoteries
e) Organisation professionnelle des minotiers : Associations
régionales des minoteries et fédération nationale des
minoteries
Les points signalés dans les titres ci-dessus (a, b, c
et d) ont été déjà abordés avec
détail dans les développements précédents.
Seulement le point « e » fera l'objet d'un détail dans le
paragraphe ci-dessus.
e) L'aspect associatif du secteur
meunier
La loi 12-94 a obligé les meuniers à s'organiser
en associations régionales (Association Professionnelle de la
Minoterie).
Ces associations sont regroupées en une
Fédération Nationale de la Minoterie.
Les associations professionnelles régionales des
minoteries sont dissoutes de plein droit au jour de la création de la
fédération nationale de la minoterie. Donc, il n'existe plus
d'associations professionnelles dès lors qu'il existe une
fédération nationale.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 61
L'ensemble de l'actif et du passif desdites associations est
transféré à la Fédération Nationale de la
Minoterie qui est subrogée à ladite Association dans tous ses
droits et obligations.
La Fédération Nationale de la Minoterie est
chargée de donner à l'Administration des avis sur toute question
d'ordre technique concernant le secteur de la minoterie industrielle.
Pour exercer un contrôle sur le domaine associatif du
secteur meunier, il est adjoint à la Fédération Nationale
de la Minoterie un Commissaire du Gouvernement, désigné par
l'Administration, qui assiste, avec voix consultative, aux réunions
annuelles de cette fédération. Il veille au bon fonctionnement
des organes de la Fédération conformément à la
règlementation en vigueur.
3. Dispositions relatives à la vente de la farine
du blé tendre : Libre et subventionnée19.
a) Farine libre du blé tendre
Les farines libres incluent la farine libre de luxe et les
autres types de farines libres.
Ces farines sont dites libres essentiellement parce qu'elles
ne bénéficient pas de subvention au niveau de leur distribution.
Ceci dit, il y a lieu de noter d'une part, que le blé utilisé
pour leur fabrication bénéficie de soutien au niveau du
producteur, de l'organisme stockeur et du minotier pour la période
éligible à la subvention forfaitaire. De même, il y a lieu
de préciser que les pouvoirs publics énoncent les prix des
transactions du blé servant à leur fabrication, et ce à
différents stades du processus, afin d'orienter les prix de ventes
(aussi bien au niveau de l'agriculteur, du stockeur que du minotier).
Ce type de farine est commercialisé à des prix
libres à toutes les catégories d'utilisateurs (distributeurs,
boulangeries, pâtisseries). Cependant, la farine libre de luxe sert aussi
à fabriquer le pain vendu actuellement à 1,20 DH la pièce
de 200 grammes (suivant l'accord de modération signé entre les
boulangeries et les pouvoirs public en 2010).
19 Etude sur les produits subventionnés dans le
cadre du système de compensation, Etude du conseil national de la
concurrence réalisée en juin 2012, site du conseil de la
concurrence «
conseil-concurrence.ma
»
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 62
b) Farine subventionnée du blé tendre :
FNBT et Farine Spéciale Blé Tendre (FSBT).
Il s'agit de farines qui sont subventionnées à
tous les niveaux de la filière y compris au stade de la distribution
(minoteries vers grossistes), et dont les prix sont réglementés
par l'Etat au niveau de l'organisme stockeur, du minotier et de la distribution
jusqu'au consommateur.
La FNBT est vendue aux ménages au prix de 100 dhs le
sac de 50 kg (soit 200 DH/q), et ce dans des centres
bénéficiaires préétablis par les pouvoirs publics.
La FSBT, quant à elle, est distribuée directement dans les
provinces du Sud par le biais de l'OCE au prix de 100 dhs/quintal.
C) Mesures prises par les pouvoirs publics en faveur
de la farine subventionnée
Il est promulgué chaque année un
arrêté ministériel qui fixe les conditions d'achat du
blé tendre destiné à la fabrication de la farine
subventionnée ainsi que les conditions de fabrication, de
conditionnement et de mise en vente desdites farines.
Les mesures prises par cet arrêté sont les suivantes
:
a) Fixation d'un prix référentiel d'achat du
blé tendre de la production nationale. Ce prix vise à garantir un
revenu fixe aux agriculteurs nationaux.
b) En vue d'optimiser les frais de transport et le montant
des subventions accordées par l'Etat, l'acquisition du blé tendre
peut faire l'objet d'appel d'offres organisées par l'ONICL auprès
des opérateurs céréaliers (Commerçants et
coopératives).
c) Le prix du blé tendre offert dans le cadre des
appels d'offre de l'ONICL provient de la
production nationale et de l'importation s'entend d'une
qualité standard et peut intégrer :
? Frais de stockage
? Marge de l'intervenant
? Frais de transport jusqu'à la minoterie industrielle
? Frais de livraison
d) La livraison du blé destiné à la
fabrication de la FNBT se fait à un prix de cession fixé par
l'arrêté. Il était de 258,80 dhs/quintal en 2012.
e) Une restitution est accordée aux commerçants
céréaliers et qui est égale à la différence
entre le prix de cession aux minoteries industrielles et le prix de revient
d'acquisition du blé tendre.
f)
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 63
Les composantes du coût de revient de la farine
subventionnée :
A titre d'exemple, dans l'arrêté de l'année
2012, les montants par rubriques ont été les suivantes :
Frais d'approche : 2 dhs par quintal écrasé
Marge de mouture : 31,25 dhs/quintal
écrasé (farine nationale de blé tendre)
31,61 dhs/quintal écrasé (farine
spéciale)
Prix formulaire de son : 150 dhs/quintal
g) Les taux d'extraction de la farine subventionnée.
On entend par taux d'extraction le rapport entre le poids de la farine extraite
hors issus et le poids du blé écrasé. :
Taux d'extraction : 81% pour la FNBT
74% pour la farine spéciale
h) Prix de revient des farines subventionnées:
FNBT : 325,375 dhs/quintal
Farine spéciale : .342,432 dhs/quintal
i) Les frais de transport sont pris en charge par l'ONICL, il
en est de même lorsque les prix offerts dans les appels d'offre
n'intègrent pas les frais s'y rapportant.
j) Les prix de vente au quintal des farines aux divers
intervenants sont les suivants :
FNBT
· Prix de la farine emballée sortie minoterie :
182 dhs
· Prix grossiste : 188 dhs
· Prix public : 200 dhs
FARINE SPECIALE
· Prix de la farine emballée sortie minoterie : 87
dhs
· Prix public : 100 dhs
k) Les montants des primes de la compensation accordée
par l'ONICL aux minoteries sont les suivants (par quintal) :
· FNBT : 143,375 dhs
· Farine saharienne : 238,375 dhs
· Farine spéciale : 255,432 dhs
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 64
l) Le conditionnement des farines subventionnées
exigé par l'arrêté est le suivant :
· Sacs de 50 Kg nets (le coût est à la charge
des minoteries industrielles)
· Bandes vertes de 50 cm de largeur placée au milieu
des deux faces du sac
· Le prix de vente doit être affiché sur les
deux faces du sac.
IL y a lieu de constater que :
· Toutes les farines bénéficient de
subventions selon des modalités différentes.
· La FNBT et la FSBT sont les seules catégories
à bénéficier d'une subvention de la collecte de la
production de leur blé jusqu'au stade de leur distribution en gros ;
· Les prix sont réglementés à tous
les stades pour le blé tendre qu'il soit destiné à la
fabrication des farines subventionnées ou libres mais selon des
modalités différentes.
· Les prix des farines subventionnées sont
fixés par Arrêté.
· Les prix des farines dites libres sont libres.
Néanmoins, une part importante de la farine libre de luxe est
destinée à la fabrication du pain à 1,20 DH la
pièce.
4. Gestion de stocks et comptabilité
matière.
Pour exercer un contrôle efficace sur l'activité
des minoteries et éviter les fraudes, un contrôle matière
est exigé par la loi 12-94. En effet, les coopératives de
commercialisation des céréales et des légumineuses et
leurs unions, les commerçants en céréales et
légumineuses et en produits dérivés, les minoteries
industrielles, les industries utilisatrices de céréales et de
légumineuses, les boulangers, les biscuitiers, les fabricants des
pâtes alimentaires et de couscous doivent tenir une comptabilité
matière retraçant les entrées, les sorties, les
utilisations des céréales et des légumineuses et de leurs
dérivés, permettant d'obtenir quotidiennement un inventaire
permanent.
Cette comptabilité doit être
présentée à toute réquisition des agents de
l'Office et des fonctionnaires habilités, à cet effet.
Cette comptabilité est matérialisée par
la tenue des registres pré-numérotés suivants,
conçus par l'ONICL
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 65
a) Registre des entrées du blé
Il retrace les mouvements journaliers du blé,
c'est-à-dire :
? Entrées du blé (achat du blé
auprès des collecteurs, des producteurs et des
organismes stockeurs)
? Sorties du blé pour l'écrasement.
? Stock restant à la fin de chaque jour.
Ce registre est détaillé par nature de
céréale (blé tendre import, blé tendre local libre,
blé
tendre licencié, )
Chaque page du registre est composée de plusieurs
colonnes : Date de l'opération, libellé de l'opération,
noms des livreurs, référence, nature de céréales
(blé tendre libre, blé tendre licencié, blé tendre
importé), entrées, sorties et stock par nature de
céréale, observations.
B) Registre de mouture
Il retrace les écrasements journaliers des
céréales et les produits fabriqués.
Chaque page du registre est composée de plusieurs
colonnes : Date, n° de la mouture, blés mis en mouture (en
quintaux) par nature de céréales, nature des produits de la
mouture (farine complète, farine incomplète, farine
boulangère, son,....), observations.
C) Registre des mouvements de produits
Il retrace les mouvements journaliers (stock, entrées de
la fabrication, sorties pour la vente, stock fin journée) des farines et
son.
Chaque page du registre est composée de plusieurs
colonnes : Date, Mouvements (stock report, entrées de la fabrication,
sortie pour la vente ou toutes autres causes), observations.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 66
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Section 2- Modalités de répartition du
contingent de la farine nationale du blé tendre et de la farine
spéciale destinées aux provinces du sud.
Dans le but de permettre aux consommateurs à faible
revenu de disposer de la farine du blé tendre, l'Etat subventionne le
prix à la consommation pour un contingent fixé annuellement. Le
différentiel entre le prix de revient de la FNBT et son prix de vente
réglementé, est réglé par l'Etat aux minoteries
industrielles à travers l'ONICL.
Mécanisme de gestion de la compensation de la
FNBT
Le mécanisme, institué par la circulaire
interministérielle n°6 du 15 juin 2001, telle que modifiée
par la circulaire n° 1 du 19 juin 2003, définit le rôle de
chacun des intervenants dans la gestion du contingent. Ainsi :
· Une commission interministérielle
détermine les dotations annuelles à affecter aux
différentes provinces et préfectures. Ces dotations sont
arrêtées sur la base d'un certain nombre de critères
définis par ladite circulaire ;
· Une commission mixte ONICL et représentants de
la minoterie (comité technique chargé du plan de fabrication)
répartit le contingent entre les différentes minoteries. Cette
répartition est basée sur un certain nombre de critères
fixés d'un commun accord et appliqués uniformément
à toutes les unités ;
· Les minoteries industrielles sont libres de choisir
leurs commerçants dépositaires et deviennent responsables du
ravitaillement des centres qui leur sont affectés. Elles doivent, en
outre, respecter les conditions prescrites dans ladite circulaire (programme de
fabrication, qualité, emballage, ...), pour produire les
quantités de la FNBT qui leur sont accordées.
Les services extérieurs de l'ONICL assurent le suivi
de l'exécution du contingent :
· Ils communiquent quotidiennement les relevés
des ventes par client, aux autorités provinciales ou
préfectorales, aux délégations du commerce
intérieur et aux services de la répression des fraudes,
· Ils effectuent, dans le cadre de commissions
conjointes avec les services de la répression des fraudes, des
prélèvements d'échantillons de farine aux fins de
contrôle de qualité.
· L'ONICL règle la charge de la compensation,
à chaque minoterie, sur la base des relevés quotidiens
précités.
Page 67
La circulaire n°6 du 15 juin 2011 a organisé les
modalités de répartition du contingent de la farine nationale du
blé tendre et de la farine spéciale destinée aux provinces
du sud.
Cette note circulaire a mis l'accent sur les points suivants
:
1. Répartition du contingent entre les
préfectures et provinces.
La détermination des dotations semestrielles à
affecter aux préfectures et provinces de même que leur
révision sont arrêtées par une commission
interministérielle définie par la circulaire.
Cette commission fixe également les dotations à
accorder aux centres bénéficiaires relevant des
différentes préfectures et provinces, en distinguant les
quantités à affecter au commerce, à la boulangerie et aux
intendances et assimilées.
La commission interministérielle prend en
considération dans ses travaux :
· Le niveau du contingent fixé par le gouvernement
;
· L'évaluation de la situation de
l'approvisionnement du marché en farines ;
· Les spécificités régionales telles
que les habitudes alimentaires et le caractère céréalier
de chaque région ;
· Le pouvoir d'achat des consommateurs ;
· Les demandes exprimées par les préfectures
et les provinces.
2. Répartition du contingent entre les centres de
fabrication et modalités de livraison
Un centre de fabrication est constitué d'une ou de
plusieurs minoteries implantées dans une province ou dans les
préfectures d'une même wilaya.
La répartition du contingent entre les différents
centres de fabrication et l'élaboration du plan d'approvisionnement qui
en découle sont arrêtées par un comité technique
défini par circulaire.
Dans ses travaux, le comité technique prend en
considération :
· Le niveau des dotations accordées aux
préfectures et provinces ;
· La nécessité d'assurer un
équilibre relatif de la répartition de la production de la farine
nationale de blé tendre et de la farine spéciale destinée
aux provinces du sud entre les différents centres de fabrication ;
·
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 68
Les particularités de l'approvisionnement et de la
consommation des farines dans certaines provinces et préfectures ;
· La minimisation des coûts de transport.
a) Répartition du contingent entre les
minoteries
Toute minoterie industrielle outillée pour la
trituration de blé tendre et dont les installations et les
équipements ont été reconnus conformes aux dispositions de
la réglementation en vigueur peut participer au contingent.
La répartition du contingent entre les minoteries est
faite par application de ratios de répartition, calculés sur la
base des écrasements de blé tendre destinés au
marché local, réalisés au titre des deux derniers
exercices (juillet à juin ou janvier à décembre) selon la
formule suivante :
· Ci = Ri*Qc
· Ci = contingent à allouer à la minoterie
:
· Qc = contingent accordé au centre de
fabrication
· Ri = ratio de répartition revenant à la
minoterie i déterminé comme suit :
· Ri = Ei/Ec
· Ei = écrasements des deux derniers exercices de la
minoterie i
· Ec = écrasements des deux derniers exercices
des minoteries du centre de fabrication considéré.
Les minoteries bénéficiaires de contingent, sont
tenues :
· De ne produire et de ne mettre en vente la farine
subventionnée que dans le cadre des programmes notifiés ;
· De préserver la qualité de la farine
subventionnée, en se conformant aux normes fixées par la
réglementation en vigueur ;
· De conditionner la farine subventionnée dans
l'emballage prévu par la réglementation en vigueur ;
· D'étaler la vente des contingents mensuels, qui
leur sont accordés, sur les 3 décades du mois ;
· De ne pas subordonner la vente de la farine
subventionnée à l'acquisition de tout autre produit ou
sous-produit de la minoterie industrielle.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 69
b) Modalités de livraison de la farine
subventionnée
i. Affectation aux minoteries de centres
bénéficiaires
Les services régionaux de l'ONICL procèdent
à la désignation des minoteries chargées d'approvisionner,
sous leur responsabilité, les centres bénéficiaires qui
leur sont affectés, et ce dans la limite des contingents alloués
à ces minoteries.
Dans ces affectations, les services régionaux ou
provinciaux de l'ONICL prennent en considération :
? Le plan d'approvisionnement établi par la commission
technique
? Les modes de transport de farine les plus
économiques.
ii. Choix des commerçants
Les minoteries sont tenues d'arrêter les listes de leurs
commençants, ainsi que les dotations mensuelles correspondantes. Ces
commerçants doivent remplir les conditions suivantes :
? Appartenance à la profession du commerce des produits
alimentaires justifiée par l'inscription au registre du commerce et aux
rôles de l'impôt de la taxe professionnelle ? Fourniture d'une
attestation fiscale de soumission aux marchés publics récente
;
? Disponibilité d'un local adéquat et accessible
au contrôle.
Les commerçants sont choisis parmi ceux exerçant
dans les centres bénéficiaires de dotations. Toutefois, en cas
d'absence de commerçants au niveau de certains centres, les minoteries
doivent désigner leurs commerçants parmi ceux exerçant
dans les centres les plus proches.
Les listes des commerçants choisis par les minoteries,
doivent être déposées par ces dernières
auprès des services de l'ONICL.
iii. Livraison de la farine subventionnée aux
commerçants
La dotation allouée à un commerçant ne doit
pas dépasser 200 quintaux par mois et par minoterie.
Lorsque l'approvisionnement d'un centre
bénéficiaire est assuré par plusieurs minoteries, un
commerçant ne peut être livré que par deux minoteries au
maximum.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 70
iv. Livraison de la farine nationale de blé tendre
aux boulangeries
Les boulangeries sont tenues d'enlever
régulièrement la quantité de farine subventionnée
qui leur est attribuée. En cas de non-enlèvement desdites
quantités ou de leur non utilisation pour la panification des pains
réglementaires correspondants, les dotations allouées à
ces boulangeries peuvent être transférées au secteur du
commerce.
Section 3- Primes et subventions octroyées par
l'ONICL aux minoteries
Les subventions allouées par l'ONICL aux minoteries
industrielles sont au nombre de trois : 1. Prime compensatrice de la
farine subventionnée
Comme signalé ci-dessus, la prime compensatrice est
égale à la différence entre le prix de revient et le prix
de vente de ladite farine.
a) Fixation du prix de référence : prix
d'achat du blé du stockeur auprès du producteur ou importation du
blé dans le cadre des accords du Maroc avec les pays
étrangers.
Les pouvoirs publics fixent le prix de référence
(Il a été fixé en 2012 à 290 dhs le quintal). Ce
prix de référence est utilisé comme base de
négociation entre le stockeur et le producteur. En outre, il peut
être majoré de bonification ou minoré de réfaction
en fonction de la qualité de la récolte de l'année. Une
fois le prix négocié établi, le stockeur va y ajouter ses
charges et sa marge pour obtenir le prix auquel il est prêt à
vendre le produit au minotier, prix qui peut être égal,
inférieur ou supérieur à 290 DH pour le quintal.
De même, les commerçants stockeurs recourent
à l'importation du blé tendre avec un prix soutenu par l'ONICL
à travers le mécanisme de régulation (remboursement du
différentiel du prix si le prix de l'importation est supérieur au
prix référentiel fixé par les pouvoirs publics).
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 71
b) Prix de vente du blé par le stockeur au
minotier pour la fabrication de la farine subventionnée
Dans une deuxième phase intervient le deuxième
prix fixé par les pouvoirs publics. Il s'agit du prix de cession de
blé au minotier (il a été fixé en 2012 à
258,80 DH/q). Ce prix est généralement inférieur au prix
de cession espéré par le stockeur. La différence entre les
deux prix (c'est-à-dire le prix offert par l'organisme stockeur dans le
cadre de l'appel d'offre et le prix fixé par les pouvoirs publics) donne
lieu au versement par l'ONICL d'une subvention appelée «
différentiel de prix ».
Il est à signaler que le choix de l'organisme stockeur
qui approvisionne les minoteries est effectué sur la base d'appels
d'offres qui permettent de sélectionner les offres qui débouchent
sur le moins de subventions possibles.
En effet, des appels d'offres sont lancés par l'ONICL
auprès des stockeurs pour sélectionner progressivement ceux qui
vont offrir les prix les plus bas par rapport au prix formulaire de cession de
blé au minotier. Plus le prix de soumission de l'organisme stockeur se
rapproche du prix formulaire de cession à la minoterie, moins importante
sera la subvention allouée par l'ONICL au stockeur dans la mesure
où cette subvention correspond à la différence entre le
prix retenu à l'appel d'offre et le prix formulaire de vente au
minotier, lequel a été de 258,80 DH/q en 2012.
Il s'agit des prix les plus bas offerts par les organismes
stockeurs pour acquérir le blé tendre destiné à la
fabrication des farines subventionnées.
Exemple
Un stockeur achète à l'agriculteur sa production
de blé à 270 DH/q à laquelle il ajoute 7 DH/q de frais et
marges. Son offre de prix à l'ONICL sera alors la suivante : 270 +7= 277
DH/q. La subvention dont il pourra bénéficier si son offre est
retenue par l'ONICL devient alors 277258,80= 18,20 DH/q. Si un autre organisme
stockeur soumissionne avec une offre moins élevée (273 DH/q par
exemple), il sera sélectionné puisque la subvention ne serait que
de 14,20 DH/q.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 72
c) Fixation du prix de vente de la farine
subventionnée aux consommateurs
Interviennent ensuite les deux stades de distribution et de
détail. Le prix de vente de la minoterie aux grossistes reste
inférieur au prix de revient. Ce prix de vente au grossiste a
été fixé en 2012 à 182 dhs le quintal, alors que le
prix de revient est évalué par les pouvoirs publics à
325,375 dhs le quintal. La différence, soit 143,375 DH/quintal constitue
une compensation, correspondant à la subvention servie par l'ONICL au
minotier.
2. Transport de la farine nationale bu blé tendre
pris en charge par les minoteries
Le transport de la farine nationale du blé tendre de la
minoterie au grossiste est supporté par cette dernière et fait
l'objet de remboursement par l'ONICL sur présentation d'un dossier
comportant l'état des ventes de la FNBT.
Le coût du transport était fixé en 2011
à 18dhs/quintal.
3. Subvention forfaitaire perçue par les minoteries
sur les farines libres.
L'organisme stockeur acquiert le blé sur la base d'une
négociation à partir du prix de référence. Il le
vend à la minoterie au prix formulaire de 260 dhs le quintal pour la
fabrication des farines dites libres (et non à 258,80 DH/q comme pour
les farines dites subventionnées). La différence entre le prix de
référence et le prix de vente à la minoterie, fixé
par les pouvoirs publics, correspond à la «subvention
forfaitaire» perçue d'abord par le minotier lors de la
période primable (période de la récolte nationale), puis
par l'organisme stockeur sur les stocks déjà acquis et
déclarés et qui restent après cette période.
Pour l'année 2012, le différentiel était
de 30 DH/q (différence entre le prix référentiel d'achat
de 290 DH/q et le prix formulaire rendu moulin de 260 DH/q) versé par
l'ONICL). Cette subvention correspond à un montant forfaitaire
fixé par l'Etat annuellement quels que soient les prix effectifs d'achat
et de vente du blé.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 73
Exemple
La minoterie achète auprès de l'agriculteur sa
production de blé tendre à 290 DH/q (prix fixé par les
pouvoirs publics). Les quantités achetées pendant la
période de récolte est de 12 000 quintaux.
La subvention est fixée à 30 Dhs/q et la minoterie
présente le dossier afin de percevoir une subvention forfaitaire de 360
000 dhs
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 74
Résumé du mode de fonctionnement de la
subvention
Farine subventionnée
La filière suit 4 étapes importantes
Etape 1:
De l'agriculteur à l'organisme stockeur ou prix
à l'importation
· Un prix de référence : prix de cession
du blé de l'agriculteur à l'organisme stockeur ou prix de
référence fixé par les pouvoirs public pour les
importations.
- Prix de référence 2012 : 290 DH / q
· Prix de référence: prix théorique
à verser à l'agriculteur, base de négociation - Prix
convenu de la transaction peut être supérieur ou inférieur
à 290 DH Etape 2:
Du stockeur au minotier
· Prix de cession à la minoterie souhaité par
le stockeur : Prix de la transaction + coûts et marge. Dans les faits, le
prix de cession est fixé par Arrêté, pouvant être
supérieur ou inférieur au prix souhaité.
- Prix de cession en 2011: 258,80 DH / q
· Le différentiel entre le prix de cession à
la minoterie (258,8 dhs) et le prix présenté dans le cadre de
l'appel d'offre est subventionné par l'Etat. l'ONICL lance chaque
année des appels d'offre pour sélectionner les stockeurs qui
offrent le prix le plus bas (moins de subventions).
- Subvention « différentiel de prix » en
2011: 22 DH /q
· L'Etat paye en plus une subvention de magasinage de 2 DH
/ quintal / quinzaine. - Subvention magasinage en 2011: 9,4 DH /q
Etape 3:
Du minotier au commerçant
dépositaire
· Prix d'achat du minotier (258,80) + plus frais et marges
donnent un - Prix fixé par Arrêté de 325,375 DH /
q.
· Les pouvoirs publics fixent un prix de vente du minotier
vers le grossiste
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
- Prix de vente fixé par Arrêté: 182 DH /
q
? La différence entre le prix de revient et le prix de
vente correspond à une subvention fixée par
Arrêté
- Subvention forfaitaire au minotier de 143,375 DH /
q
? L'Etat paye en plus, le transport du minotier vers le
commerçant dépositaire
- Subvention moyenne du transport en 2011: 18 DH / q.
Etape 4:
Du commerçant dépositaire aux
ménages
? Le commerçant dépositaire, grossiste : les prix
des transactions sont fixés par Arrêté
- Il achète à 182 DH /q et vend au
détaillant à 188 DH / q
? Le détaillant vend au consommateur à un prix
fixé par Arrêté
- Prix public de la FNBT : 200 DH / q
NB : il y a lieu de signaler que les prix peuvent être
soumis à des variations d'une année par
rapport à l'autre. Les chiffres indiqués
correspondent à ceux existant durant l'année 2012 .
Farines libres issues de la production
locale

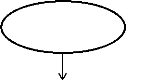
Agriculteur
290 dhs/ q
Stockeur

260 dhs/ q
Minoterie industrielle
SUBVENTION
FORFAITAIRE
30
DH
+
MAGASINAGE
2 DH/q
PAR QUINZAINE
Page 75
|
Farine de luxe (pain 1,2 dhs)
|
|
Autres farines libres
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 76
Section 4- Particularités fiscales des
minoteries
1. Les taxes fiscales
a) En matière d'IS
i. Fait générateur de la comptabilisation de la
prime de compensation accordée par L'Etat aux minoteries
industrielles20.
Sur le plan comptable, les primes de compensation sont des
produits qui doivent être comptabilisés dans l'exercice au cours
duquel ils sont acquis quelle que soit la date de leur encaissement
conformément au principe de la spécialisation des exercices
(C.G.N.C, page 116).
Mais sur le plan fiscal, le code général des
impôts dans son article 9- II prévoit que les subventions, primes
et dons reçus de l'Etat sont des produits imposables à rapporter
à l'exercice au cours duquel ils ont été effectivement
perçus.
Cette notion de perception n'est pas claire, signifie-t-elle
l'encaissement ou la notification de la subvention par l'ONICL ?
Pour enlever cette ambigüité, l'administration
fiscale a confirmé dans une réponse publiée sur son site
internet que la prime de compensation comptabilisée parmi les produits
de l'exercice d'acquisition doit être rapportée à
l'exercice d'encaissement effectif pour la détermination du
résultat fiscal de l'entreprise bénéficiaire.
A notre avis, la prime de compensation constitue un
complément de chiffre d'affaires. Elle doit être
comptabilisée dans les écritures de l'exercice dans lequel elle a
pris naissance. Sur le plan fiscal, elle doit être déduite. En
revanche, les encaissements reçus au cours de l'exercice sont à
réintégrer.
ii. Cotisation minimale applicable aux minoteries
En vertu de l'article 144-D du code général des
impôts, le chiffre d'affaires à prendre en considération
pour le calcul de la cotisation minimale est composé de la somme des
rubriques suivantes :
20 Réponse de la direction
générale des impôts, site :
www.tax.gov.ma
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 77
? Le chiffre d'affaires proprement dit résultant de la
vente de la farine, du son et de l'emballage. Ce chiffre d'affaires est soumis
au taux actuel de 0,25%.
? Les compensations reçues de l'ONICL au titre de la
vente de la farine nationale du blé tendre revêtent le
caractère d'un complément du chiffre d'affaires sont soumises au
taux actuel de 0,25%.
Du fait que les primes de compensation sont prises en compte
dans la base imposable à l'IS suivant la date de leur perception, la
base de la cotisation minimale doit prendre en compte les prises
encaissées et non les primes comptabilisées.
? Les produits financiers et les produits non courants sont
soumis au taux de 0,5%.
b) En matière de TVA
i. Demande d'achat en exonération de la taxe sur la
valeur ajoutée sur les biens, d'équipements destinés au
réaménagement d'une minoterie21
Selon une réponse de la Direction des impôts, la
minoterie ne peut prétendre à l'exonération de TVA sur les
biens d'équipement du fait que l'activité du minotier est
exonérée de la T.V.A sans droit à déduction sachant
que jusqu'à 2007, les minoteries bénéficiaient d'une
réduction de 50% de la TVA sur les biens d'équipement (loi 30-85
de la TVA).
La réduction de la TVA à 50% était
prévue par l'article 101,2° du livre d'assiette et de
recouvrement.
ii. L'activité de la minoterie (vente de farine) est
une vente exonérée sans droit à déduction.
L'activité de vente de farine est une vente
exonérée sans droit à déduction en vertu de
l'article 91 du code générale des impôts.
Cet article prévoit : « Exonérations sans
droit à déduction, Sont exonérées de la taxe sur la
valeur ajoutée :
I.- A) Les ventes, autrement qu'à consommer sur place,
portant sur :
1°- le pain, le couscous, les semoules et les farines
servant à l'alimentation humaine ainsi que les céréales
servant à la fabrication de ces farines et les levures utilisées
dans la panification »
21 Réponse de la direction
générale des impôts, site :
www.tax.gov.ma
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 78
2. Les taxes parafiscales
A) Taxe de commercialisation.
En vertu du décret n° 2-96-298 du 13 Safar 1417
(30 Juin 1996), Il est institué au profit de l'ONICL, une taxe
parafiscale dénommée "taxe de commercialisation des
céréales et des légumineuses", perçue sur les
quantités transformées par les industries utilisatrices en ce qui
concerne le blé, l' orge, le maïs et le riz, et à la
commercialisation en ce qui concerne les légumineuses alimentaires et
les autres céréales.
Le montant de cette taxe est fixé au 30 juin 1996 comme
suit :
|
?
|
Blés .
|
1,90 Dirham au quintal ;
|
|
?
|
Autres céréales
|
0,80 Dirham au quintal ;
|
|
?
|
Légumineuses .
|
1,00 Dirham au quintal.
|
Cette taxe est recouvrée en vertu d'états
dressés par l'ONICL. Son produit est versé directement par les
redevables à l'Office.
La taxe de commercialisation est prélevée par
les minoteries industrielles sur ses fournisseurs de blé tendre lors de
son approvisionnement. Les taxes ainsi collectées sont reversées
à l'ONICL.
B) Taxe sur la vente de farine aux boulangeries
La taxe boulangère est une taxe collectée par
les minoteries industrielles lors de la vente de la farine aux boulangeries
industrielles ou artisanales.
Cette taxe est ajoutée à la facture de vente de
la farine à la boulangerie et versée par la minoterie
industrielle à l'ONICL.
La valeur unitaire de cette taxe est de l'ordre de 0,40 dhs le
quintal. Elle est prélevée par l'ONICL sur le montant de la prime
de compensation.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 79
c) Amendes infligées suite aux contrôles
des services de l'hygiène
Les produits fabriqués par les minoteries industrielles
(farines et sous-produits) font l'objet de contrôle par les agents de
l'ONICL qui sont habilités à constater les fraudes commises par
les entreprises de minoteries industrielles en application de la loi
n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les
marchandises promulguée par le dahir n° 1-83- 108 du 9 moharrem
1405(5 octobre 1984)
Les agents de l'ONICL dressent un procès-verbal des
infractions relevées.
Des amendes allant de 200 dhs à 48 000 dhs sont
infligées aux contrevenants.
Des peines d'emprisonnement peuvent être
prononcées par les tribunaux selon la gravité des faits
constatés.
Une circulaire en date du 8 juin 2011 de l'ONICL a
défini les modalités de contrôle de la farine
subventionné selon les étapes suivantes :
Portée et fréquence des contrôles
Le contrôle consiste à mener des investigations
au niveau des unités de production et porte sur les farines
ensachées et prêtes à la livraison. La fréquence de
contrôle doit être en moyenne de deux fois par mois et par
minoterie.
Prélèvement d'échantillons et
constatations directes
Les agents de l'ONICL procèdent au
prélèvement d'échantillons. Le contrôle porte
également sur les conditions d'emballage et d'étiquetage des
farines.
Analyses
Les échantillons sont acheminés vers les
laboratoires d'analyse agréés et doivent être
accompagnés d'une étiquette portant la mention « Analyse
urgente ». Dès réception du bulletin d'analyse, une fiche de
saisie doit être complétée.
Instruction des dossiers contentieux
Les dossiers contentieux doivent être adressés
dans un délai ne dépassant pas 72 heures aux services de la
répression des fraudes en vue de leur transmission aux juridictions
compétentes.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 80
Section 5 : Particularités comptables
1. Organisation de la comptabilité d'une minoterie
industrielle
A) Particularités comptables par rapport au
CGNC et absence des normes comptables spécifiques
La loi comptable ouvre la possibilité à certaines
branches d'activités de se doter de plans comptables sectoriels. A titre
d'exemple : les établissements de crédit, les compagnies
d'assurance, les coopératives, les promoteurs immobiliers
sont dotés de plans comptables
professionnels sectoriels.
Jusqu'à ce jour, les instances gouvernementales n'ont pas
doté le secteur de la meunerie industrielle d'un plan comptable
spécifique à l'instar d'autres secteurs.
La nature de quelques opérations comptables
spécifiques (comptes de charges par nature,
comptes de produits par nature, comptes de tiers
spécifiques, ) nécessite l'adoption d'un
plan comptable
spécifique ou d'un avis de conformité du Conseil National de la
Comptabilité comme fut le cas en France.
B) Normalisation comptable proposée par
l'expérience française
Le Conseil National de la Comptabilité de la France a
publié le 12 octobre 1983 l'avis de conformité N° 15 relatif
au plan professionnel à l'usage des industries de la meunerie. Cet avis
faisait suite à la modification profonde du Plan Comptable
Général intervenue en 1982.
Il n'existe pas de guide professionnel spécifique
indiquant de façon exhaustive les enregistrements comptables à
respecter. On ne peut donc s'appuyer que sur les adaptations prévues
à l'appui de cet avis de conformité22.
22 Inspiré du mémoire d'expertise
comptable intitulé : mission d'examen des comptes annuels d'une
minoterie, COGEN ERIC, année 2000.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 81
Les modifications qui ont été apportées par
cet avis sont somme suit :
(1) Les immobilisations incorporelles
On peut relever la création des comptes spécifiques
suivants :
2081 Droits de mouture : ce sont les droits de mouture
achetés auprès des autres minoteries industrielles
2082 Contingent : c'est le montant maximal des
écrasements octroyé à une minoterie industrielle.
Autres comptes d'actif créés par le plan comptable
professionnel :
29081 - Provisions pour dépréciation des droits de
mouture 29082 - Provisions pour dépréciation du contingent
D'emblée, l'absence de comptes d'amortissement de ces
droits est à noter. Le PCG Français, dans ses articles 322-2 et
331-8, donne la définition des immobilisations amortissables : «
immobilisations dont le potentiel des services attendus s'amoindrit normalement
d'une manière irréversible avec le temps, l'usage, le changement
des techniques ou toute autre cause. En raison des difficultés de mesure
de cet amoindrissement, l'amortissement consiste, généralement,
dans l'étalement de la valeur des biens amortissables sur leur
durée probable de vie. »
Les droits de mouture et contingents ne subissent pas de
dépréciation irréversible. Ainsi la valeur d'un
contingent, attribué en 1938, n'a, dans la plupart des cas, subi aucune
décote depuis cette date, bien au contraire.
Cependant, la constitution d'une provision pour
dépréciation peut être nécessaire afin de respecter
le principe de prudence dans l'élaboration des comptes annuels.
(2)
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 82
Comptes de tiers Seuls deux comptes sont à remarquer :
4421 - Taxe céréalière à la charge
du producteur 4472 - Taxe céréalière à la charge du
collecteur
Ces comptes permettent un suivi des dettes de l'entreprise en
fonction du débiteur de la taxe.
(3) Comptes de charges
Deux comptes particuliers sont créés :
6246 - Redevance branchement SNCF
6375 - Redevances versées aux agences de Bassins
Ils n'appellent pas de commentaire particulier. On note
également la présence du compte 63531 - taxe BAPSA.
(4) Comptes de produits
Certaines activités spécifiques ont
nécessité la création des comptes suivants :
7061 - Stockage intermédiaire
7062 - Magasinage du stock de sécurité
Les minoteries disposent de silos parfois vides et sont donc
conduites à réaliser des prestations de stockage.
On note également que les cessions de blé ou
d'électricité doivent être comptabilisées dans des
sous-comptes des « produits des activités annexes ». Enfin,
des comptes spécifiques sont à utiliser pour les subventions
liées aux opérations d'exportation.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 83
2) Proposition de subdivisions de comptes et de
schémas d'écritures pour la minoterie industrielle marocaine
a) Comptes proposés pour la minoterie
L'expérience professionnelle en matière d'audit
et de révision des comptes des minoteries industrielles a
révélé l'insuffisance des dispositions dans ce secteur.
Aussi, pour y remédier, il paraît opportun d'adopter des comptes
spécifiques au plan comptable marocain afin qu'il soit adapté au
secteur de la minoterie industrielle. Ces comptes concernent les postes
suivants :
Comptes de bilan
345- Etat débiteur
345101- Subvention forfaitaire
Ce compte enregistre les créances de cette nature de la
minoterie vis-à-vis de l'ONICL.
345102 Prime compensatrice sur la farine
subventionnée
Ce compte enregistre les créances de cette nature de la
minoterie vis-à-vis de l'ONICL.
445- Etat créditeur
445801 Taxe boulangère
Ce compte enregistre à son crédit les taxes
boulangères collectées par les minoteries lors de la vente de la
farine aux boulangeries
445802 Taxe de commercialisation
Ce compte enregistre à son crédit les taxes de
commercialisation collectées par les minoteries lors de l'achat du
blé tendre.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 84
445803 Amendes pénales
Ce compte enregistre à son crédit les amendes
mises à la charge des minoteries lors des contrôles des agents de
l'ONICL.
Comptes de produits et charges
Charges et produits
Les comptes d'achats de matières premières sont
subdivisés en fonction des matières et
fournitures achetées (Achats de blé
licencié, Achats du blé libre, )
Les comptes d'achat de blé doit englober en plus du
prix d'achat du blé les frais suivants : Les honoraires de l'organisme
d'agréage du blé, le transport du blé, le mali ou le boni
sur quantité transportée et la prime forfaitaire du blé
lors de la compagne annuelle de collecte du blé tendre.
La prime forfaitaire de l'achat du blé tendre lors de
la compagne de collecte devrait être comptabilisée au
crédit du compte de charge relatif à l'achat de blé tendre
et non dans un compte de produits ; cette prime est considérée
comme une réduction du prix d'achat et non un complément de
chiffre d'affaires.
712104 Prime compensatrice de FNBT
La prime compensatrice est comptabilisée dans un compte
de chiffre d'affaires et non dans le compte subvention car elle est
considérée comme un complément de chiffre d'affaires.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 85
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Section 6 - L'intervention des entreprises
céréalières sur le marché à terme
Le Maroc souffre depuis plusieurs années de
périodes de sécheresse poussant ainsi les pouvoirs publics
à importer une grande quantité de blé afin de combler le
déficit en cette matière.
La loi 12-94 n'autorise pas les minoteries industrielles
à importer du blé. En conséquence, les minoteries ne
peuvent pas réaliser d'économie sur l'achat de leur
matière première afin de réaliser de bonnes marges sur la
vente de la farine.
C'est pour cette raison que certains importants groupes
minotiers recourent à la stratégie d'intégration en amont
en procédant à la création de leurs entités
céréalières.
Cette section est axée sur les principales
stratégies d'intervention pour les entreprises
céréalières sur le marché à terme. Outre la
transparence qu'il procure à ses utilisateurs, le principal
intérêt du marché à terme réside dans la
possibilité qu'il offre de sécuriser les transactions et de
gérer le risque de prix.
1) Intervention de l'entreprise
céréalière sur le marché à terme : les
opérations
réalisées sur le contrat
blé23
L'entreprise céréalière doit à la
fois assurer la sécurité des approvisionnements du pôle
meunerie du groupe pour éviter une rupture du rythme de production, et
la sécurité du prix d'achat. Elle peut opter pour un achat
anticipé de la matière première ou au contraire pour un
achat réalisé plus tard, au moment qui lui semblera
opportun24.
? A priori, le fait d'avoir réalisé un achat
anticipé du blé élimine le risque de prix (parfois, un
marché à terme risque aussi d'entraîner des
conséquences néfastes si les prix lors de la livraison sont
inférieurs aux prix du marché à terme). Toutefois,
apparaît alors un risque de compétitivité. L'entreprise qui
aura acheté le blé et l'aura stocké (cas de livraison
immédiate), de façon à éviter le risque de
quantité et à figer le coût de ses approvisionnements,
risque de subir une perte de compétitivité par rapport à
ses concurrents qui auront pu bénéficier d'une éventuelle
baisse des prix pour s'approvisionner. Il en est de même pour
l'entreprise ayant conclu un contrat forward (cas de la livraison
différée) d'approvisionnement pour une date
déterminée.
23 Inspiré du mémoire d'expertise
comptable intitulé : l'industrie de la meunerie, analyse des
particularités et impact sur la mission du réviseur, BOUREL
Epouse DESORME STEPHANIE, nov 2002.
24 Inspiré du mémoire d'expertise
comptable : aspects particuliers des risques des prix et de change dans les
sociétés de négoce international de
céréales, LIEBART CHRISTIAN, novembre-décembre 1992.
Page 86
? Si en revanche, le céréalier attend pour
s'approvisionner, Il s'expose au risque de prix. Entre temps, si les prix
augmentent, il supportera des coûts élevés qui l'obligeront
soit à augmenter le prix de vente de son produit, soit à
réduire sa marge bénéficiaire (pour les produits
libres).
Ainsi, que le céréalier ait opté pour la
première solution ou pour la seconde, on peut considérer qu'il
est en position spéculative sur le marché physique. Dans le
premier cas, tout se passe comme s'il anticipait une hausse des cours, et donc
se prémunissait contre elle, en achetant par anticipation. Dans le
second cas, il se met dans une hypothèse de baisse des cours, et
courrait alors le risque de prix à la hausse.
2) Caractéristiques du marché à terme
et des opérations traitées
Le marché à terme autorise une grande souplesse
de gestion des approvisionnements. Effectivement, dans le premier cas, si le
céréalier a conclu des contrats d'approvisionnement forward avec
des négociants pour éviter le risque de quantité, il
connaît le prix d'achat. Cependant, si le cours auquel est conclu le
contrat forward ne le satisfait pas parce qu'il estime qu'il devrait baisser,
il peut utiliser le marché à terme pour tenter de réduire
le coût de son approvisionnement, en prenant une position sur celui-ci.
Cette intervention lui permet alors d'éviter de fixer le prix en
profitant d'une éventuelle évolution favorable des cours tout en
assurant par le contrat à livraison différée la
sécurité de ses débouchés.
A l'inverse, le céréalier qui veut se
prémunir contre une hausse des cours, peut profiter, grâce au
marché à terme, d'un niveau de cours jugé favorable. La
solution consiste à acheter des contrats à terme au cours actuel
(jugé intéressant) sur une échéance proche de la
date d'achat prévue et à revendre ces contrats lorsqu'il trouvera
un vendeur de blé sur le marché physique.
La couverture effectuée à l'aide de contrats
à terme consiste donc à prendre une position symétrique et
opposée sur un marché à terme de celle prise sur le
marché physique. L'opération est soldée par la revente ou
le rachat des contrats ainsi souscrits en couverture lors de la
réalisation de la transaction finale sur le marché physique.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 87
Section 7- Obligations contractuelles des
minoteries
Dans cette section, il sera mis l'accent sur les aspects
contractuels des minoteries dans leurs relations avec d'une part, le
fournisseur du blé (commerçants céréaliers) et
d'autre part, avec la boulangerie industrielle et artisanale.
1. Contrat d'approvisionnement avec les commerçants
céréaliers
L'achat du blé auprès des organismes stockeurs,
soit pour la fabrication de la farine libre, soit pour la fabrication de la
farine subventionnée doit faire l'objet d'un contrat d'achat dont le
modèle est établi par l'ONICL dans ses différentes notes
circulaires.
L'intérêt de ces contrats est double :
· Pour l'ONICL : permettre d'exercer un
contrôle des entrées de chaque minoterie et d'évaluer les
achats et les écrasements au niveau national.
· Pour les minoteries industrielles :
c'est un outil de gestion dans la mesure où ces contrats constituent des
supports de justifications des entrées de blé.
De plus, pour l'octroi des différentes subventions de
la part de l'ONICL cette dernière exige la présentation des
contrats d'achat du blé.
Le modèle de contrat commercial établi par l'ONICL
doit mentionner les éléments suivants :
· Les références de l'acheteur et du
vendeur
· La quantité du blé acheté
· La qualité du blé tendre
· Le prix du blé
· Mode de transport
· Le logement
· Le paiement
· Arbitrage
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 88
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Ces contrats constituent pour l'Expert-Comptable un moyen de
contrôle des achats annuels du blé tendre afin de réaliser
les investigations nécessaires sur les comptes des achats.
Une fois les fournisseurs choisis, l'ONICL adresse aux
minoteries leurs fournisseurs de blés (organismes adjudicataires) par le
biais d'une consultation contenant les informations suivantes :
? Numéro de la consultation
? Organisme livreur ? Quantité à livrer
? Le mois de la livraison
2. Contrat d'approvisionnement avec les boulangeries25
Vu les habitudes de consommation de la farine au Maroc, les
consommateurs choisissent de fabriquer leur pain à la maison.
Néanmoins, on assiste aujourd'hui au développement de la
panification dans les boulangeries industrielles et artisanales et ce suite au
développement de la société marocaine.
Dans ces conditions, les minoteries industrielles marocaines
n'ont pas développé des relations fortes avec les boulangeries
sauf quelques exceptions.
Si on se réfère à l'expérience
française, on remarque que les minoteries ont tissé des relations
commerciales et financières très solides, ce qui a
constitué un segment de marché assez important pour ces
minoteries.
Pour bénéficier des retombées de cette
expérience, il paraît utile de présenter les aspects les
plus importants des contrats tissés entre les minoteries et les
boulangeries françaises.
En France, le contrat d'approvisionnement de la farine est
défini comme une convention par laquelle la boulangerie s'engage
à s'approvisionner en farine auprès d'une minoterie industrielle
en contrepartie d'avantages reçus de cette dernière. Il s'agit
d'un contrat synallagmatique, pratique des meuniers qui cherchent ainsi
à s'assurer un débouché stable et régulier dans la
boulangerie artisanale.
25 Inspiré du mémoire d'expertise
comptable intitulé : mission d'examen des comptes annuels d'une
minoterie, COGEN ERIC, année 2000
Page 89
a) Intérêts des parties
Motivées par la recherche de la fidélisation de
la clientèle, les minoteries sont à l'origine de nombreux
partenariats avec les boulangeries. En contrepartie d'un soutien commercial,
financier, technique, le boulanger s'engage à acheter la farine du
meunier, à développer une gamme de produits en respectant des
diagrammes de fabrication préétablis.
Une minoterie peut accorder un prêt, une caution au
boulanger qui s'installe ou s'agrandit ; à la condition expresse que
celui-ci s'approvisionne auprès du meunier en farine pour couvrir ses
besoins.
Ces partenariats sont d'autant plus importants que le secteur
de la boulangerie artisanale est un segment de marché rentable et qu'il
représente une part importante de la farine vendue sur le marché
national.
B) Engagement d'approvisionnement du boulanger
Cet engagement est régi par des règles relatives
à la durée et à la quantité stipulée dans
l'engagement de fourniture de la farine.
C) Contrepartie de l'engagement de fourniture :
l'avantage accordé à la boulangerie
a) Avance de trésorerie
En contrepartie du contrat de fourniture, une avance de
trésorerie peut être accordée par la minoterie au
boulanger. Souvent, elle prend la forme de prêt à l'installation,
aide au financement de l'acquisition du fonds de commerce du boulanger.
Parfois, elle peut servir à l'achat de matériel de boulangerie
(fours, agencements...).
b) Prêt « chambre à farine »
Le meunier assure auprès de son client la livraison en
sacs. Afin d'obtenir une meilleure souplesse dans l'approvisionnement et
diminuer le prix de revient de la farine, il est préférable de
livrer en vrac. Il propose alors au boulanger de lui vendre une chambre
à farine, qui sera installée chez le commerçant selon les
plans et devis acceptés par celui-ci. Ce matériel est
financé par la minoterie qui ouvre un compte « Prêt chambre
à farine ». En contrepartie, le boulanger s'engage à
s'approvisionner auprès de celui-ci.
c)
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 90
Mise à disposition d'une chambre à farine
Une variante au contrat précédent consiste pour le
meunier à mettre en dépôt, à titre gratuit, le
matériel qui sera installé chez le boulanger. En contrepartie,
celui-ci s'engage à s'approvisionner auprès de son
fournisseur.
d) Prêt bancaire cautionné par le meunier
Le boulanger qui doit financer son installation souscrit
généralement un emprunt auprès d'un organisme financier.
Le meunier peut, en contrepartie de l'engagement de fourniture, se
déclarer caution des engagements souscrits par le boulanger envers la
banque.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 91
Conclusion de la première partie
Les techniques comptables et fiscales relatives aux
opérations réalisées par les minoteries industrielles
découlent essentiellement des particularités spécifiques
aux activités exercées par celles-ci.
Dans la pratique, et afin de permettre une grande rigueur dans
la gestion, on se rend compte qu'une organisation bien précise doit
être mise en place afin de canaliser tous les mouvements de fonds issus
de l'ensemble des opérations exercées depuis l'approvisionnement
du blé, à tire libre ou licencié, jusqu'à la
commercialisation de la farine en passant par les différents
procédés touchant les différentes subventions ou primes
compensatoires ou l'Etat intervient en tant que régulateur voire un
gestionnaire au quotidien du secteur des minoteries industrielles.
Il est donc impératif que les schémas
d'écritures comptables utilisés garantissent une grande
fiabilité des éléments financiers permettant une analyse
rapide des opérations en cours et un suivi permanant de
l'exhaustivité des ventes facturées de la farine et du son et
surtout les règlements de celles-ci par les clients, notamment ceux en
compte ou le risque est important.
En outre, on trouve chez les minoteries industrielles des
pratiques comptables et extra-comptables qui ont été mises en
place dans un objectif de faciliter le contrôle des mouvements de la
mouture, la concordance de la sacherie avec les ventes et la consommation de
l'énergie avec l'écrasement.
Ces éléments serviront de base à
l'auditeur pour l'établissement de sa stratégie d'audit d'une
minoterie dont nous allons développer les principales étapes dans
la deuxième partie de ce mémoire : Méthodologie d'audit
d'une minoterie industrielle.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 92
Deuxième partie : Méthodologie
d'Audit
d'une Minoterie
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 93
Introduction de la deuxième partie
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 94
Cette deuxième partie tente de définir les moyens
et les diligences à mettre en oeuvre visant à l'expression d'une
opinion sur la fiabilité et la sincérité des comptes d'une
minoterie industrielle.
Après avoir exprimé en première partie les
particularités juridiques, comptables et fiscales liées au
secteur de la minoterie, il sera abordé, dans un premier temps la prise
de connaissance de l'entreprise et l'évaluation des risques liés
à la mission.
La dernière phase de cette deuxième partie sera
consacrée à l'analyse classique des cycles les plus importants en
insistant sur les particularités liées à cette
activité.
Enfin, le dernier chapitre de la deuxième partie sera
dédié à l'analyse du cycle créances et dettes
parafiscales.
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 95
Chapitre 1 : Prise de connaissance de
l'entreprise et analyse des risques
identifiés
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Préalablement à l'exécution de la mission
d'audit, il convient en premier lieu de procéder à une prise de
connaissance approfondie de la minoterie industrielle en vue d'établir
un plan de mission présentant les principaux risques de l'entité
auditée.
Cette prise de connaissance sera réalisée en deux
étapes :
? Le diagnostic de la minoterie industrielle (Section
1)
? L'identification des risques (Section 2)
Section 1- Le diagnostic de la minoterie
industrielle26
Le diagnostic d'une minoterie industrielle mettra le point sur
les trois volets suivants :
1. Le diagnostic stratégique
Différentes stratégies peuvent être
élaborées par les minoteries industrielles. Leur exposition ici a
pour objectif de faciliter la compréhension du contexte concurrentiel de
ces entités.
A) Stratégie de domination
L'objet de cette stratégie est d'atteindre une certaine
taille qui permettra à la minoterie d'occuper une place de leader sur le
marché et d'atteindre un niveau de coût de production lui
permettant d'affronter les concurrents.
Objectif : les minoteries industrielles ont pour
objectif d'écraser des quantités importantes de blé leur
procurant une place de leader sur le marché. Leur politique s'appuie sur
les économies d'échelle.
Produits : les produits (farines) sont peu
différenciés ; la concurrence s'exerce sur les prix. L'outil de
production est fortement mécanisé et automatisé.
Clients : la capacité de production de la
minoterie est très importante et peut satisfaire les besoins d'un grand
nombre de clients.
B) La stratégie de spécialisation
Cette stratégie vise à concentrer les efforts sur
un segment de marché, de produits ou d'espace
géographique pour dégager un avantage concurrentiel
maximal.
On se trouve en présence de deux types de minoteries :
? Celles qui exploitent un marché qui existe
déjà (minoteries qui s'adaptent)
? Celles qui ont une constante volonté de
développer un marché nouveau (minoteries qui
innovent)
26 Diagnostic inspiré du mémoire
d'expertise comptable : l'industrie de la meunerie, analyse des
particularités et impact sur la mission du réviseur, BOUREL
Epouse DESORME STEPHANIE, Novembre 2002.
Page 96
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Page 97
La spécialisation par l'adaptation
Objectif : il s'agit des minoteries de taille
modeste exploitant un marché très étroit.
Produits : cette exploitation
spécialise de manière importante la structure de l'outil de
production par la technologie.
Il s'agit par exemple de la farine biologique et des produits
diététiques. Les issus sont utilisés pour élaborer
des aliments de l'élevage biologique.
Clients : vente directe sur le marché,
réseaux de distribution spécialisés, boulangeries ou
minoteries ayant leurs propres réseaux de distribution.
La clientèle est très spécifique et les
potentialités de développement restent limitées, ce qui
fragilise le marché, même si la fidélisation est
importante.
La spécialisation par l'innovation
Objectif : pour ces minoteries,
l'innovation technologique est permanente, la valorisation du savoir-faire les
positionne en avance sur les concurrents.
Produits : ces minoteries
écrasent toute matière nouvelle transformable en farine (autres
que le blé et l'orge, exemple : farine de châtaigne pour aliment
de bébé). D'importants groupes agro-alimentaires disposent de
bureaux d'études pour la réalisation de produits très
spécifiques.
Clients : l'exploration de
micros-marchés par les minoteries innovantes permet à ces
dernières d'être à l'abri de la concurrence.
c) La stratégie de différenciation
Cette stratégie s'appuie sur toutes les
caractéristiques du produit (emballage, technique,
marque, ) pour dégager une différence que le client
appréciera et acceptera de payer.
Objectif :
la stratégie est axée sur la préservation du
niveau de marché de la farine pour assurer une rentabilité
correcte de l'activité et fidéliser la clientèle. Il
s'agit souvent de minoteries de taille moyenne à importante, leaders du
marché.
Produits : l'éventail de
qualités proposées est défini après concertation
entre la minoterie et le client. Certaines entreprises abordent pour cela le
concept de farines à la carte en fonction de l'utilisation de celle-ci
et du processus engagé pour l'élaboration du produit final.
Clients :
? Les boulangeries et les pâtissiers
Les boulangeries et les pâtisseries constituent une
clientèle préférée, avec laquelle la minoterie
développe des relations étroites : fidélisation par la
fourniture d'une farine de luxe.
Page 98
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
· Les industries utilisatrices et les laboratoires de
grandes surfaces : la stratégie de filière.
La volonté est de s'éloigner des marchés
standards ou le prix est la seule base de négociation, pour tenter de
capter des marchés spécifiques exigeants techniquement mais ou la
concurrence est moins vive.
La politique de différenciation peut s'appliquer par :
· La mise en place de réseaux au sein de la
filière blé/farine/pain en réunissant
céréaliers, meuniers et distributeurs à partir d'une
volonté commune de travailler en partenariat.
· La différentiation par les marques,
appliquée à la distribution de la farine en sachet pour
l'utilisation ménagère, avec un succès important au niveau
du consommateur final.
d) Tableau résumant les stratégies des
minoteries industrielles.
Stratégie
poursuivie
|
|
Points forts
|
|
Points faibles
|
Domination
|
·
|
Maîtrise de marché
|
·
|
Produits peu
|
|
·
|
Economie d'échelle
|
|
différenciés
|
Spécialisation par l'adaptation
|
·
|
Produits différenciés (farines bio, produits
diététiques)
|
·
|
Créneau de marché étroit
|
|
·
|
Adaptation à l'évolution du style de vie
|
·
|
Spécialisation de
|
|
·
|
Circuit court Pas de délai de
paiement, trésorerie immédiate, peu
|
|
l'outil de production
|
|
|
d'impayés
|
·
|
Dépendance à
|
|
·
|
Politique de fidélisation de la clientèle par une
étroite relation vendeur/acheteur
|
|
l'égard d'une clientèle ou d'un
|
|
·
|
Issus utilisés pour les aliments des élevages
bio
|
|
produit.
|
Spécialisation
|
·
|
Produits différenciés
|
·
|
Produits ponctuels
|
par l'innovation
|
·
|
Innovation technologique permanente
|
·
|
Micros marchés
|
|
·
|
Marchés à forte valeur ajoutée, de niche
|
·
|
Dépendance à
|
|
·
|
Recherche constante de nouveaux produits et de nouveaux
marchés
|
|
l'égard d'une clientèle ou d'un
|
|
·
|
Savoir-faire unique.
|
|
produit.
|
|
·
|
Politique de fidélisation de la clientèle par une
étroite relation vendeur/acheteur
|
|
|
|
Page 99
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
|
Suite du tableau précédent :
résumé des stratégies des minoteries
industrielles
Stratégie
poursuivie
|
Points forts
|
Points faibles
|
Différenciation
|
· Fidélisation
|
L'effort réalisé par la
|
Clientèle
|
· Rentabilité
|
minoterie pour réaliser
|
artisanale
|
· Outils de développement de la boulangerie
|
la différenciation
|
|
artisanale
|
entraîne des coûts
|
|
· Politique de fidélisation de la clientèle
par une étroite relation vendeur/acheteur
|
élevés
|
Différenciation
|
· Proposition de solutions spécifiques
|
· Marchés
|
Industries
|
· Capacité d'innovation importante
|
spécifiques
|
utilisatrices et
|
|
exigeant
|
laboratoires des
|
|
techniqueme
|
grandes surfaces.
|
|
nt
|
|
|
· Dépenses de recherche.
|
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
2. Le diagnostic de gestion
a) Les indicateurs de production
La revue des principales étapes de production de la farine
permet de comprendre les rapports quantitatifs retenus dans le métier de
meunerie.
Dans le métier de la meunerie, on peut dégager
trois rapports de production :
i. Le taux d'extraction
La mouture du blé est mesurée par le taux
d'extraction. Ce taux est fonction du type de la farine. Plus le taux
d'extraction est élevé, plus la production de la farine est
importante et la rentabilité s'améliore.
Taux d'extraction = poids de farine extraite /poids du
blé mis en
oeuvre
ii. Le taux de rendement
Tous les produits provenant de la mouture : farines et
sous-produits, comparés aux blés mis en
oeuvre, forment le
taux de rendement. Ce taux avoisine les 100%, il tourne entre 98% à
100%.
Taux de rendement = poids de farine extraite et
sous-produits /poids du
blé mis en oeuvre
iii. La freinte de production
La freinte de production est la perte de quantité, les
principaux facteurs de cette perte sont les suivants :
La teneur en humidité : le
blé est humidifié lors de l'opération de nettoyage par
l'eau ; les produits obtenus durant la mouture sont séchés.
Selon les caractéristiques du blé acheté,
une perte peut être constatée : 100 Kg achetés à 16%
d'humidité, le produit fini contient 15% d'humidité, soit une
perte de 1%.
En revanche, un excédent peut être
constaté si le taux d'humidité des blés achetés est
inférieur au taux de produit final (années de
sécheresse).
Le taux d'impureté : ce
taux influe sur le taux de rendement ; l'opération de nettoyage qui
prépare le blé pour la mouture consiste à le
débarrasser de ses impuretés.
Page
100
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
b) Analyse des indicateurs de production
Les services de contrôle de gestion des minoteries
établissement des tableaux de bord de
production afin de suivre le cycle de la mouture, et de constater
d'éventuelles anomalies dues
essentiellement aux cas suivants :
? Déficience du matériel de production
? Quantité de matières premières non
intégrées dans le tableau de bord (erreurs dans les
calculs)
? Mauvaise qualité des blés achetés
? Détournement de stock de matières
premières ou de produits finis.
Des tableaux établis à partir de cas vécus
sont fournis ci-après :
Rendement de matière première
(blé)
Tableau de calcul des quintaux du blé
écrasé
|
Blé
|
Unité
|
Total
général
|
Quantité de blé mise en oeuvre
par
type farine
|
|
Farine
luxe
|
Farine
normale
|
FNBT
|
|
Stock initial
|
Ql
|
134 958
|
15 625
|
80 456
|
38 877
|
|
(+) Achats blé
|
Ql
|
21 697
|
3 169
|
11 623
|
6 905
|
|
(-) Stock final
|
Ql
|
13 958
|
1 395
|
8 941
|
3 622
|
|
(=) Blé écrasé (A)
|
Ql
|
142 697
|
17 399
|
83 138
|
42 160
|
Farines et issus
|
Farines et
issus
|
U
|
Total
général
|
Quantité de blé mise en oeuvre
par
type farine
|
Total
|
Issus
|
|
F.L
|
F.N
|
FNBT
|
|
Ventes (+)
|
Ql
|
146 043
|
10 923
|
62 829
|
42 139
|
115 891
|
30 152
|
|
(+) SF
|
Ql
|
15 469
|
2 365
|
5 346
|
2 615
|
10 326
|
5 143
|
|
(-) SI
|
Ql
|
19 618
|
1 456
|
4 596
|
8 526
|
14 578
|
5 040
|
|
Farine
fabriquée (B)
|
Ql
|
141 894
|
11 832
|
63 579
|
36 228
|
111 639
|
30 255
|
|
B/A%
|
|
99,4%
|
68%
|
76%
|
85%
|
|
|
Page
101
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Les taux résultant du rapport B/A% expriment les taux
d'extraction par nature de farine. Plus le taux se rapproche de 100%, plus la
rentabilité de l'écrasement augmente.
NB : Pour avoir une farine de meilleure
qualité, le taux des issues est plus élevé pour la farine
de luxe (100-68 = 32%) et pour la farine normale (100-76 = 24%).
Quant à la farine nationale, le taux des issus est moins
élevé (100-85 = 15%).
Page
102
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
3. Le diagnostic financier ou la revue analytique
La revue analytique des postes du bilan et du compte de
produits et charges permet d'identifier les flux significatifs, d'analyser les
fluctuations et les tendances qui sont des éléments essentiels
pour le bon déroulement de la mission d'audit.
L'analyse des derniers états de synthèse de la
minoterie permet de mettre en évidence les variations des postes
significatifs par rapport à :
? Aux exercices précédents :
les variations anormales doivent être bien étudiées avec
attention. Les explications seront à chercher auprès du directeur
financier ou du contrôleur de gestion. En cas d'incohérence, le
plan de mission devra être modifié afin de prévoir un
sondage approfondi sur un ou plusieurs postes.
? Aux statistiques du secteur : au Maroc, on
remarque l'absence d'un organisme qui centralise et fournit des statistiques du
secteur de la minoterie industrielle. Les associations du secteur ne publient
pas des études financières du secteur meunier afin de ressortir
des références de comparaison. En l'absence de ces
références, on ne peut que recourir à l'OMPIC pour obtenir
les états de synthèse des minoteries les plus importantes afin de
dégager des ratios du secteur. Dans le cas où les ratios de
l'entité auditée sont incohérents par rapport à
ceux du secteur, il convient de rechercher l'explication auprès de le
Direction Générale. Des contrôles plus approfondis sont
à prévoir dans de telles situations.
Il est exposé ci-après un tableau
synthétique présentant les différents ratios
proposés dans le cadre d'une mission d'audit avec méthode de
calcul.
Page
103
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
a) Etude d'un bilan
|
Poste
|
Méthode de calcul
|
Commentaire
|
|
Immobilisations corporelles
outil de production et de stockage.
|
Val Brute immob/Total
actif* 100
|
Si le poste augmente, il convient de s'interroger sur la nature
de l'investissement
: automatisation, économie d'énergie, .
|
|
Amortissement des
immobilisations
Degré d'amortissement
|
Cumul amorti/Val brute
immob*100
|
Le poste d'amortissement est généralement
élevé en raison du coût élevé du
matériel. Une hausse de ce taux signifie un vieillissement de l'actif
immobilisé.
|
|
Stock Rotation
|
Stock de blé/
Achats de blé *360 Jours
(ou)
Stock de farines /
Vente de farines *360 Jours
|
Pour le compte de stock, on peut signaler deux cas de figures
:
Un taux de rotation lent : cela peut signifier
des risques de détérioration ou de péremption, d'où
l'éventualité de constater une dépréciation.
Un rythme lent peut engendrer des problèmes de stockage
(coût, conditions de stockage,....)
Un taux de rotation élevé : signe
de bonne gestion de la production. A l'extrême, un taux
élevé peut signifier la difficulté du respect des
délais de livraison (risque de litige avec certains clients ou perte
d'un certain nombre de contrats). Une sous-estimation d'un stock de
sécurité peut en être à l'origine.
|
|
Stock Valeur
|
Stock/Total actif *100
|
Une augmentation du poste stock peut signifier des
problèmes dans la gestion de l'approvisionnement ou la production
(écoulement de la farine). Un examen des mouvements et des dates
d'entrée en stocks des matières premières et de la
production des farines est indiqué dans ce cas de figure.
|
|
Créances clients Durée de
crédit client
|
Clients/
CA HT*100
|
Tout accroissement de ce délai génère des
risques de non recouvrement. Il faut s'interroger sur la procédure de
relance client et analyser les créances par catégorie de client
(grossistes, grandes et moyennes surfaces, restaurants, hôtels,....). En
effet, les conditions de créances clients diffèrent d'un type
à l'autre.
|
|
Dettes fournisseurs matières
Durée de crédits fournisseur
|
Dettes fournisseurs blé/
Achat blé*100
|
Lorsqu'il y a des achats intra-groupes (sociétés
céréalières qui font partie du groupe), il faut dissocier
ces dettes des autres.
Le délai fournisseur doit être suivi conjointement
avec le délai client afin de ne pas déséquilibrer la
trésorerie.
|
Page
104
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
b) Etude d'un compte de produits et charges
|
Poste
|
Méthode de calcul
|
Commentaire
|
|
Chiffre d'affaires
|
|
Le chiffre d'affaires évolue en fonction des
éléments suivants :
· Taux de rendement du blé
· Prix des issus du blé (son)
· Prix de vente de la farine : ce prix varie en fonction de
:
1) Type de clientèle
2) Type de farine produite
· Quotas de la farine nationale du blé tendre
octroyée chaque année à la minoterie industrielle.
|
Coût des matières consommées
(blé, améliorants et emballages)
|
Coût des matières
premières/
CAHT*100
|
Le poids des achats de matières premières
(blé, améliorants et emballages) appelle une attention
particulière pour l'examen de ce
poste.
L'évolution des prix des achats du blé influe sur la
rentabilité de la minoterie.
|
Valeur ajoutée
|
VA/CAHT
*100
|
La valeur ajoutée est à mettre en parallèle
avec :
· Les prix de vente des farines
· Le coût d'achat de matières premières
(en cas de mauvaise qualité du blé, la minoterie procède
à l'achat des améliorants dont le prix est cher)
|
Charges de personnel
|
Charges
de personnel/
CAHT
*100
|
L'automatisation de la production a permis la maîtrise
de ces charges.
Autres facteurs de maîtrise de ces charges :
· centralisation des services
administratifs au niveau du groupe
· externalisation de certaines fonctions (logistique par
exemple)
|
Résultat financier
|
Résultat
Financier/
CAHT*100
|
Si la minoterie a contracté des crédits bancaires
pour le financement des investissements, le résultat financier sera
fortement négatif en raison du montant important de financement.
|
Résultat avant impôt
|
Résultat
Avant impôt/
CAHT*100
|
Le résultat avant impôt des minoteries
industrielles est assez modeste.
Ce résultat faible est dû aux facteurs suivants
:
· Marge très faible des farines vendues (les prix
des approvisionnements et ceux des ventes sont déjà connus sur le
marché et sont très faibles)
· Si une minoterie contracte des crédits bancaires
pour le financement des investissements de rénovation, les charges
financières pèseront lourdement sur le résultat avant
impôt qui peut même se solder par un déficit dans les
premières années).
|
|
Page
105
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
|
Section 2 : Identification des risques
L'objectif de cette étape est la prise de connaissance
approfondie de la minoterie industrielle à travers l'appréhension
des risques attachés à ce secteur d'activité et à
la minoterie elle-même. La détection des risques d'audit aidera
à adopter une approche d'audit adaptée.
Des questionnaires adaptés à la minoterie ont
été mis en place ci-après afin d'évaluer les
risques d'audit. A chaque questionnaire, l'auditeur peut intégrer un
commentaire, puis affecter un niveau de risque au point soulevé :
Risque élevé
|
E
|
Point non maîtrisé par la société,
ou élément très significatif de l'activité dont la
procédure est à tester (approvisionnement à un pourcentage
important auprès d'une société
céréalière du groupe)
|
Risque moyen
|
M
|
Niveau de risque intermédiaire
|
Risque faible
|
F
|
Elément non significatif de l'activité.
|
|
Il peut annexer une feuille de travail pour étayer son
appréciation.
1. Les caractéristiques générales de
l'activité
Ce questionnaire permet d'identifier les caractéristiques
essentielles de la minoterie afin de la
situer dans son environnement.
a) L'activité
Caractéristiques générales de
l'activité
|
Oui/non/
NA
|
Commentaire
|
Réf
|
Volume d'activité
|
|
|
|
· Quel volume de farine, la minoterie écrase-t-elle
annuellement ?
> Petite meunerie : < 240 000 Qx
> Moyenne meunerie : entre 240 000 Qx et 1 000 000 Qx
> Grande meunerie : > à 1 000 000 Qx
|
|
|
|
E
|
|
M
|
|
F
|
|
|
Capacité
d'écrasement
|
|
|
|
· Est-ce que la minoterie a procédé
à un nouvel investissement induisant une
nouvelle capacité
d'écrasement, quel est la capacité d'écrasement
ajoutée ?
· Ou est-ce que la minoterie a procédé
à un désinvestissement (par cession ou
abandon d'une ligne de
production ? Quel est l'impact sur la capacité d'écrasement ?
|
·
|
|
|
E
|
|
M
|
|
F
|
|
|
Page
106
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
|
b) Les sites de production et de stockage
Caractéristiques générales de
l'activité
|
Oui/non/N
A
|
Commentaire
|
Réf
|
Structure géographique
|
|
|
|
· La minoterie compte-t-elle un grand nombre
d'unité d'exploitations
décentralisées ?
· Si oui, le suivi de ces entités est-il
satisfaisant ?
· Une visite est-elle prévue pour ces unités
? les mesures de sécurité ont été prévues
?
· Un plan de site (site de production et de stockage)
est-il établi ?
|
·
|
|
|
E
|
|
M
|
|
F
|
|
|
|
c) La détention et les liens
Caractéristiques générales de
l'activité
|
Oui/non/
NA
|
Commentaire
|
Réf
|
Appartenance à un groupe
|
|
|
|
· La minoterie appartient-elle à un groupe ?
· Comment se positionne la minoterie dans le groupe
(mère ou filiale) ?
· Un organigramme du groupe est-il établi ?
· Quelles sont les principales activités du groupe
?
· Quelle est la situation de la branche minoterie au
sein du groupe (croissance ou déclin) ?
· Quelle est la part du chiffre d'affaires de la branche
minoterie au sein du groupe ?
· Combien de société composent la branche
minoterie ?
· Quelles sont les relations de la minoterie au sein du
groupe ?
· En amont : approvisionnement au sein d'une
société céréalière.
· En aval : vente aux boulangeries, industriels,
· Les transactions sont-elles significatives ?
|
·
|
|
E
|
|
M
|
|
F
|
|
Existence de filiales
|
|
· La minoterie a-t-elle des filiales ? (nom, nombre,
taille, chiffre d'affaires, date d'acquisition).
· Quelles sont les activités des (stratégie
de diversification, de concentration) ?
· Les filiales sont-elles dans une situation
financière difficile ?
|
·
|
|
|
E
|
|
M
|
|
F
|
|
|
Page
107
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
|
2. L'organisation de l'approvisionnement
Les minoteries ont des fournisseurs divers
(commerçants céréaliers, agriculteurs, fournisseurs de
sacheries, fournisseurs des améliorants,.....). Cette situation appelle
l'auditeur à cibler les relations minoterie/fournisseurs, afin de
s'assurer qu'il n'y pas de risque de dépendance, de risque non
approvisionnement (rupture, mauvaise qualité,.....).
a) Les relations avec les fournisseurs
Caractéristiques générales de
l'activité
|
Oui/non/
NA
|
Commentaire
|
Réf
|
Topologie des fournisseurs.
|
|
|
|
· Quel est le nombre de fournisseurs (dépendance)
?
· Quelle est la nature des fournisseurs d'approvisionnement
?
· Organismes stockeurs (Céréaliers)
· Agriculteurs
· Dans le cas d'un groupe de sociétés, la
minoterie s'approvisionne-t-elle au sein du groupe ?
· Dans l'affirmative, les conditions sont-elles normales
?
· Dans le cas contraire, une convention a-t-elle
été établie ?
|
·
|
|
|
E
|
|
M
|
|
F
|
|
|
Gestion des fournisseurs
|
|
|
|
· Une liste des fournisseurs autorisés à
livrer la société est-elle établie ?
· Cette liste est-elle régulièrement mise
à jour et contrôlée ?
· Les fournisseurs sont-ils mis en concurrence lors des
engagements pris ?
· La décision quant au choix définitif du
fournisseur revient-elle à une personne habilitée du service
approvisionnement ?
· Le délai de règlement est-il «
normal » par rapport aux délais pratiqués couramment dans la
profession ?
· Sinon, se renseigner sur la structure qualitative des
fournisseurs : expérience, spécificité.
|
·
|
|
|
E
|
|
M
|
|
F
|
|
|
|
Page
108
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
|
b) La gestion des approvisionnements
La fonction approvisionnement doit être parfaitement
maîtrisée. Un suivi des achats de blé est
réalisé au niveau des quantités et de la qualité.
En effet, cette étape influe directement sur la qualité de la
farine.
Caractéristiques générales de
l'activité
|
Oui/non/
NA
|
Commentaire
|
Réf
|
Gestion des approvisionnements
|
|
|
|
· Comment sont gérés les approvisionnements
en blé ? décrire la procédure.
· L'approvisionnement en blé libre est-il
systématiquement formalisé par un contrat ?
· Les contrats et les confirmations sont-ils signés
par une personne habilitée?
· Un tableau de suivi des contrats d'approvisionnement
signés existe il ?
· Dans la négative, sur quelle base le suivi des
approvisionnements est-il réalisé ?
· Les engagements afférents aux contrats sont-ils
identifiables de manière exhaustive ?
|
·
|
|
|
E
|
|
M
|
|
F
|
|
Traitement des
décaissements
|
|
|
|
· Toutes les dépenses sont-elles
justifiées par un contrat ou un ordre de paiement approuvé par le
responsable approvisionnement ?
· Les livraisons de blés sont-elles
contrôlées avant le paiement ?
> Un contrôle des quantités par le biais des
bons de pesage.
> Une analyse du blé acheté par la
procédure d'agréage interne
(agréeur interne de la minoterie)
> Un contrôle du prix facturé par le
rapprochement avec le prix
figurant dans le contrat d'achat du
blé.
· Les litiges relatifs aux livraisons sont-ils
exhaustivement identifiés ?
· Dans l'affirmative, décrire la procédure y
afférente.
|
·
|
|
|
E
|
|
M
|
|
F
|
|
|
Page
109
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
|
3. Les moyens de production et la politique
d'investissement
Ces questionnaires ont pour objectif de connaître les
options retenues par la minoterie dans la phase de production, à savoir
les moyens utilisés, le respect des normes de sécurité et
les relations avec les tiers.
a) Les moyens de production et la politique
d'investissement
La minoterie investit peu. L'absence de progrès
technologique important et la robustesse des matériels sont des
explications souvent avancées. Toutefois, le vieillissement de l'outil
peut être la cause de nombreux problèmes (pertes d'énergie,
irrégularité de la qualité de
production, remplacement fréquent des pièces de
rechange, ).
Les moyens de production et la politique
d'investissement
|
Oui/non/
NA
|
Commentaire
|
Réf
|
Caractéristiques des
installations
|
|
|
|
· Quel est le type d'équipement industriels
(caractéristiques, ancienneté) ?
· Quelle valeur brute représente l'outil de
production et de stockage par rapport au total bilan ?
· Quel est le taux de dépréciation ?
|
·
|
|
|
E
|
|
M
|
|
F
|
|
|
Politique d'investissement
|
|
|
|
· L'entreprise a-t-elle investi récemment ou
a-t-elle un projet d'investissement dans son outil de production ou de stockage
?
· Pour quelle nature d'investissement :
> Augmentation de la capacité de fabrication :
automatisation,
écrasement, nettoyage.
> Economie d'énergie
> Augmentation des capacités de stockage.
> Conditionnement (chaîne d'ensachage)
> Logistique : transport en vrac par camion
· S'agit-il d'une rénovation d'un matériel
ancien ou d'investissement dans du matériel neuf ?
· Quel est le montant de l'investissement ?
· Quelle sont les sources de financement ?
|
·
|
|
|
E
|
|
M
|
|
F
|
|
|
|
Page
110
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
|
b) Les contrats liés à
l'exploitation
Les contrats d'assurance : Les
réglementations deviennent de plus en plus draconiennes à tous
les niveaux (sécurité des salariés, atteinte à
l'environnement, protection des consommateurs), la responsabilité des
dirigeants est de plus en plus recherchée .La souscription d'une police
d'assurances « dommage et risques d'exploitation » doit être
adaptée à l'activité de la minoterie.
Les contrats de maintenance : l'entreprise
doit souscrire aux contrats de maintenance (Entretien régulier des
installations pour permettre de conserver aux équipements leur niveau de
performance et de sécurité) en vue d'appréhender tous
risques de dangers (explosion,...).
Les moyens de production et la politique
d'investissement
|
Oui/non/
NA
|
Commentair
e
|
Réf
|
Assurance
|
|
|
|
? L'entreprise est-elle assurée contre :
> Les dommages aux tiers, les responsabilités
assurance RC
> Les dommages aux biens, les pertes d'exploitation
multirisques
industriels.
> Risques financiers : assurance-crédit
> Les véhicules : flotte automobile
|
|
|
|
E
|
|
M
|
|
F
|
|
|
Maintenance
|
|
|
|
? L'entreprise a-t-elle souscrit des contrats de maintenance
concernant les zones
de production et de stockage :
> La révision d'appareils électriques et de
levage, de ventilation.
> La désinfection et la dératisation.
|
|
|
|
E
|
|
M
|
|
F
|
|
|
|
Page
111
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
|
c) Tableau de bord
Les moyens de production et la politique
d'investissement
|
Oui/non/
NA
|
Commentaire
|
Réf
|
Tableaux de bord de production
|
|
|
|
? L'entreprise établit-elle :
? Des tableaux de bord de suivi de production, des rendements,
de la
freinte (périodicité) ?
? Des budgets de production ?
? Un comparatif entre budget/réalisé est-il
réalisé régulièrement ?
? Décrire la procédure de collecte
d'informations.
|
|
|
|
E
|
|
M
|
|
F
|
|
|
|
4. La politique de commercialisation
L'objectif de ce questionnaire est d'appréhender les
choix de la minoterie en matière de commercialisation.
a) Clients, produits et prix
Pour mieux adapter la politique de commercialisation, il faut
cerner le type de clientèle (volume/type de clientèle,
répartition géographique,....). Le marché de la meunerie
est en pleine concurrence en raison des prix de vente qui ne peuvent pas subir
d'augmentation. Certaines minoteries jouent sur les politiques de
diversification et d'économie d'échelle afin d'améliorer
leur résultat.
Page
112
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
|
La politique de commercialisation
|
Oui/non/
NA
|
Commentaire
|
Réf
|
Structure de portefeuille clients
|
|
|
|
· Quelle est la structure du portefeuille clients : nombre
de clients par type de clientèle :
> Grandes surfaces (supers et hypermarchés).
> Grossistes
> Epiceries et détaillants
> Industries utilisatrices (biscuiteries, couscousseries,
fabricants de
pâtes,.....)
> Hôtels et restaurants
· Quel est la part du chiffre d'affaires
réalisée par type de clientèle ?
> Grandes surfaces (supers et hypermarchés).
> Grossistes
> Epiceries et détaillants
> Industries utilisatrices (biscuiteries, couscousseries,
fabricants de
pâtes,.....)
> Hôtels et restaurants
· Quelle est la répartition géographique des
clients ?
· A-t-on perdu un client ou un groupe de clients importants
?
|
·
|
|
|
E
|
|
M
|
|
F
|
|
|
Gamme des produits proposés
|
|
|
|
· Obtenir la liste des farines commercialisées
· Existe-il une volonté de différenciation
(farines spécifiques, farines bio) ?
· Quels sont les types de conditionnement ?
|
·
|
|
|
E
|
|
M
|
|
F
|
|
|
|
Page
113
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
|
La politique de commercialisation
|
Oui/non/
NA
|
Commentaire
|
Réf
|
Prix pratiqués et marges
|
|
|
|
· Quels sont les prix pratiqués ?
> Prix de vente moyen par quintal
> Prix moyen de vente par quintal par type de client.
> Evolution du prix moyen de vente.
|
|
|
|
|
Niveau de risque
|
|
|
E
|
|
M
|
|
F
|
|
|
|
Page
114
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Section 3 : L'outil de production et de stockage,
éléments prépondérants de l'actif
immobilisé
En raison du fort taux de mécanisation des minoteries
industrielles, ces dernières engagent des investissements qui
nécessitent des fonds importants.
La charge résultant de l'amortissement de ces
immobilisations pèse lourdement sur le résultat de la
minoterie.
Lors d'un nouvel investissement, les outils de production
sont en état neuf et ne nécessitant pas un entretien important.
En revanche, un matériel en état de vieillisse nécessite
des entretiens coûteux.
Une problématique se pose à ce niveau : Quel est
le traitement comptable et fiscal des travaux d'entretien et de
rénovation des moyens de production. Est-ce qu'ils sont des
immobilisations ou des charges ?
Avant de discuter cette problématique, il sera
traité de la réglementation relative aux normes de
sécurité, d'hygiène et des travaux d'entretien et de
rénovation à réaliser sur les matériels et
outillages de la minoterie.
1. La réglementation relative aux normes de
sécurité : obligations des entreprises
Au Maroc, on assiste à une sensibilisation croissante
des entreprises face aux problèmes d'hygiène et de
sécurité. Ce phénomène s'explique par la prise de
conscience de la part des dirigeants et des pouvoirs publics.
Les principaux risques rencontrés sont ceux
liés aux équipements de travail, aux explosions et incendies
inhérents à l'exploitation des silos et installations de stockage
de céréales et de la farine.
Page
115
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
a) Les équipements de travail : entretien pour
garantir la sécurité des employés (code du travail)
L'article 24 de la loi n° 65-99 relative au code du
travail dispose : « De manière générale, l'employeur
est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de
préserver la sécurité, la santé et la
dignité des salariés dans l'accomplissement des
tâches qu'ils exécutent sous sa direction et de veiller au
maintien des règles de bonne conduite, de bonnes moeurs et de bonne
moralité dans son entreprise ».
Pour cette raison, les dirigeants de la minoterie
industrielle doivent prendre les mesures nécessaires afin de
rénover et d'entretenir tous les équipements présentant un
certain danger pour le personnel de l'entité.
En France, la réglementation oblige les minoteries
à rédiger et appliquer un plan de conformité afin de
rénover le matériel et outillage.
B) Les installations classées : les silos et
les installations de stockage (code de l'environnement)
Dans le cadre de la sécurité et de la
protection de l'environnement, la loi sur l'environnement a
édicté un certain nombre de règles visant à
sauvegarder l'environnement de toute dégradation d'une installation
classée dangereuse.
En effet, la loi relative à la protection et à
la mise en valeur de l'environnement (Loi n°11-03 promulguée par le
dahir n°1-03-59 du 12 mai 2003) expose dans son article 11 : « Toute
personne qui détient ou exploite une installation classée est
tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et lutter
contre la pollution de l'environnement et la dégradation du milieu
naturel, conformément à la législation, à la
réglementation et aux normes et standards environnementaux en vigueur.
En outre, elle est tenue de se soumettre à toute inspection ou
contrôle éventuel effectué par les autorités
compétentes ».
Page
116
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
En vertu de l'article 10 de cette même loi « La
demande du permis de construire afférente à une installation
classée n'est recevable par l'administration que lorsqu'elle est
accompagnée par l'autorisation, le récépissé de
déclaration ou d'une étude d'impact sur l'environnement, tel que
prévu par les articles 49 et 50 de la loi sur l'environnement ».
c) Incidence sur les comptes des travaux d'entretien
et de rénovation effectués en application des mesures du code de
travail et du code l'environnement.
La mise en oeuvre de ces dispositions peut entraîner
des coûts très importants dans les entreprises industrielles. Il
s'agira notamment des dépenses liées à un audit
général du parc des machines afin de déterminer les
travaux à réaliser portant notamment sur l'accès des zones
dangereuses, les protections contre les projections ou chutes d'objets, les
systèmes de commande, les dispositifs d'arrêt d'urgence,
d'alarme...
En vue de situer l'entreprise par rapport à ces
obligations, l'auditeur doit se faire communiquer les plans de
rénovation, car il en découle les investissements à
prévoir. Ainsi, il prendra connaissance des travaux prévus
initialement, de ceux réalisés, et de ceux restant à
réaliser. Le but est de s'assurer du respect de l'application des mises
aux normes dans les délais impartis et ensuite de leur correcte
appréhension lors de l'établissement des comptes annuels.
Page
117
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
2. Présentation d'un guide de réalisation
des travaux en vue de se conformer aux obligations d'hygiène et de
sécurité.
Il a été estimé utile de
présenter en annexe un extrait du projet du guide des travaux à
réaliser par les minoteries sur le plan technique. Ce document a
été élaboré conjointement par : L'ONICL, la
fédération nationale des minoteries et la direction de la
protection des végétaux, des contrôles techniques et de la
répression des fraudes sous le titre « Référentiel
d'Autocontrôle de la Minoterie Industrielle ».
3. Traitement comptable et fiscal des travaux d'entretien
et de rénovation
Une attention particulière est à apporter au
traitement comptable et fiscal des travaux réalisés pour le
compte de la minoterie en vue de se conformer aux exigences
réglementaires en matière de sécurité et
d'hygiène. Ces dépenses, constituent-elles des charges ou des
immobilisations ?
a) Comptabilisation en charges ou en immobilisations
?
a-1- Comptabilisation en charges
En général, si les dépenses visent
à maintenir le matériel en état de fonctionnement
conformément à des nouvelles normes de sécurité,
elles sont comptabilisées en charges.
Exemples :
? Les dépenses d'audit du matériel existant
pour dresser le bilan des travaux à entreprendre,
? Les vérifications périodiques des
matériels à caractère obligatoire soit par du
personnel interne qualifié et agréé soit
par recours à un organisme agréé ? Entretien des
installations électriques et appareillages de levage, les
extincteurs d'incendie, les installations de gaz.
? Entretien des cuves, réservoirs, citernes.
Toutefois, si certaines charges sont importantes, il est
possible de les étaler sur une période de deux à quatre
ans par exemple.
Page
118
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
a-2- Comptabilisation en immobilisations
Certaines dépenses réalisées par la
minoterie en vue de se conformer aux normes de sécurité et
d'hygiène peuvent être immobilisées dans le cas où
elles augmentent la valeur du matériel ou, de manière
appréciable, ses rendements ou sa capacité.
L'enregistrement en immobilisations s'applique en cas de :
· Réduction substantielle des risques de
dysfonctionnement ou d'arrêts d'activité liés à des
accidents du travail,
· Allongement de la durée probable d'utilisation
(travaux de rénovation générale),
· Ajout de fonctionnalités nouvelles :
· Accroissement des performances (augmentation du
rendement, de la productivité),
· Réduction des coûts de production
initialement prévus,
· Amélioration de la qualité de
production. Exemples :
Installation de nouveaux systèmes de
sécurité : systèmes d'aspiration de poussières,
protecteurs limitant l'accès aux zones dangereuses, protecteurs isolant
les éléments dangereux, interrupteurs permettant d'assurer le
verrouillage électrique, dispositifs d'arrêt d'urgence dans les
zones dangereuses, dispositif d'avertissement sonore ou lumineux...,
acquisition d'une habitation pour respecter la distance entre les silos de
stockage et la première habitation.
Page
119
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Section 4 : Contingent et droits de mouture,
éléments incorporels nécessaires à l'exploitation :
l'expérience française à exploiter par la profession
marocaine.
Comme exposé dans la première partie, le nombre
de moulins au Maroc a augmenté régulièrement,
créant une surcapacité pénalisante : Une question se pose
alors à ce niveau : comment corriger ce dysfonctionnement ?
Le plan vert a mis parmi ses objectifs stratégiques :
la concentration progressive des minoteries industrielles avec accroissement de
la capacité et diminution du nombre d'unités.
Une mesure préconisée par le plan vert mentionne
l'engagement de l'Etat à consolider la restructuration du secteur
meunier en le ramenant dans une première phase à 100
unités autour de 10 à 15 groupes.
La profession est disposée à appliquer cette
mesure du plan Maroc vert si l'Etat introduit de mécanismes juridiques
flexibles pour la sortie.
Les modalités de sortie et les incitations qui
l'accompagnent, telles que l'exonération de plus-values en cas de
réactualisation de la valeur des actifs ou la négociation des
droits de sortie.
La modernisation et la restructuration peuvent être
aisément facilitées par l'introduction de « droits
négociables de transformation » (DNT).
Ces droits peuvent être utilisés par les
minotiers pour assurer une sortie qui ne les privent pas de tirer avantage du
fonds de commerce capitalisé.
L'élaboration de textes juridiques et
réglementaires pourrait être faite en concertation entre la
profession et les autorités de tutelle.
Page
120
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
1. L'exploitation de l'expérience
française27
La profession en France a introduit le « droit de mouture
» comme mesure d'accompagnement de la restructuration du secteur minotier.
En effet, après 1929, le contingent fut introduit (à la demande
des minotiers). En 1938 le système de contingent a été
fixé pour l'ensemble des moulins français. Ce contingent
représente le plafond d'écrasement de chaque moulin.
Ce système est assorti de 3 règles:
a) Interdiction de création de nouveaux
moulins
b) La capacité d'écrasement est
plafonnée : contingent
c) Les droits liés au contingent ne sont
négociables qu'entre meuniers : droits de mouture
Le système n'est pas figé puisque les
cotisations volontaires obligatoires (CVO) permettent le rachat des contingents
dans le but de comprimer les capacités réelles de production
(suspension de ce rachat en 1965).
Le droit de mouture est venu compléter le dispositif
permettant ainsi au minotier de transformer son contingent en droit de mouture
en vue de cession ou de location.
2. Exposé des notions de contingent et des droits
de mouture
a) Contingent
La définition du contingent est la quantité
maximum de blé qu'un moulin est autorisé à écraser
annuellement.
Ce contingent peut être cédé, en bloc,
à autre meunier qui peut donc l'ajouter à son propre contingent
sans subir d'abattement (principe actuel : des abattements existaient
auparavant). Il constitue un droit incorporel inséparable du fonds de
commerce. En cas de fusion de moulins, un nouveau contingent global est
affecté.
27 Mémoire d'expertise comptable : industrie
de la meunerie : analyse des particularités et impact sur mission du
réviseur, BOUREL .EP. DESORME STEPHANIE, Novembre 2002.
Page
121
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Le contingent ne s'applique qu'à la farine
destinée à la consommation française. Les autres
débouchés (exportation, alimentation animale,...) ne sont pas
réglementés.
B) Droits de mouture
Pour mieux réguler le marché, les pouvoirs
publics français ont instauré en 1953 les droits de mouture : un
moulin peut transformer totalement ou partiellement son contingent en droits de
mouture cessibles.
Il est alors appliqué un abattement sur le contingent
pour obtenir l'équivalent en droits de mouture selon des
modalités relativement complexes.
Il est important de noter que ces opérations de
transformation ont un caractère irréversible.
C) Cession des droits de mouture
Le moulin acquéreur des droits cédés par
son confrère a donc une capacité d'écrasement
supérieure. Il existe cependant un plafond d'écrasement
fixé à un certain nombre de quintaux par an qui peut seulement
être dépassé par dérogation accordée par le
ministre de l'agriculture et sous certaines conditions.
Ces droits de mouture sont ensuite librement cessibles et ne
font l'objet d'aucun abattement contrairement à la transformation d'un
contingent en droits de mouture.
Le marché des droits de mouture est assez soutenu et
donne lieu à des transactions financières conséquentes.
Pour les minoteries qui ont acquis des droits de mouture,
lesdits droits sont considérés comme des immobilisations
incorporelles.
Le suivi des capacités d'écrasement de
blé par moulin est assuré par 1' ONIC, organisme para-public.
Un agrément préalable à la cession des
droits de mouture doit être demandé au ministère de
l'agriculture par les deux moulins intéressés.
La cession de ces droits est matérialisée par un
acte, généralement établi sous seing privé, qui
donne droit à la perception par 1' Etat de droits d'enregistrement.
Page
122
Section 5 : Importance de stock dans une minoterie
industrielle
Dans les minoteries industrielles, on relève une
importance du compte stocks dans le bilan de ces entités.
Ce stock constitué de plusieurs types doit faire
l'objet d'une attention particulière de la part de l'auditeur.
Le contrôle des quantités en stock est
facilité par l'existence des registres d'entrées de blé,
de céréales (pour la collecte) et de sorties de farine. Les
éventuelles anomalies sont recherchées avec les dirigeants.
Seules demeurent inconnues les quantités de
matières premières autres que le blé (gluten
principalement) et les diverses matières consommables (emballages par
exemple).
La durée du cycle de fabrication est très courte
(à peine 30 minutes; seule la préparation du blé, et
notamment son séchage, peut durer plusieurs heures). Les produits en
cours de fabrication sont donc négligeables.
A travers ma modeste expérience dans ce secteur, il a
été constaté que les risques d'erreurs sur les stocks
proviennent de leur valorisation et non de leur quantification qui est
généralement assurée par la tenue des registres
obligatoire et par le suivi rigoureux de l'ONICL.
C'est pour cette raison que ce mémoire tentera de
porter un aperçu sur les méthodes de valorisation de stock par
type de matière ou produits.
1. L'évaluation des stocks de matières
premières
S'agissant de produits interchangeables (par opposition aux
produits identifiables), l'évaluation du stock peut être
effectuée selon deux méthodes :
? la méthode du coût moyen
pondéré,
? la méthode dite du "premier entré / premier
sorti".
Le choix s'opère, selon le mémento comptable
Francis Lefebvre, en faveur de la méthode qui "fournit la meilleure
traduction du flux des articles".
Page
123
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Les blés, de diverses qualités, sont souvent
mélangés pour obtenir la farine souhaitée. Les blés
entrés en silos les premiers ne sont donc pas forcément d'abord
utilisés les premiers.
Quelque soit la méthode pratiquée par la
minoterie industrielle, il doit faire l'objet du contrôle par l'auditeur
pour s'assurer de sa correcte application.
On veille à ne pas oublier d'ajouter au prix des
matières les frais accessoires tels que les transports ou les
commissions sur les achats de blé.
2. L'évaluation des stocks de farine
La farine est évaluée à son coût de
production conformément aux règles du CGNC. Ce coût est
composé :
· du coût d'acquisition des matières
consommées pour sa production,
· des charges directes et indirectes de production
· La tenue d'une comptabilité analytique facilite
cette évaluation. En son absence, le coût de production d'un
quintal de farine peut être calculé en divisant le total des
comptes de charges relatifs à l'approvisionnement et à la
production par le nombre de quintaux produits dans l'exercice.
Certaines charges sont cependant à ne pas retenir :
· les frais de distribution (coûts des chauffeurs,
amortissement des camions de livraison, frais de déplacements
engagés pour les livraisons,...),
· les frais financiers,
· les charges non courantes,
Page
124
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Chapitre 2- Audit des principaux
cycles d'activité des minoteries
industrielles
Page
125
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Selon le manuel des normes d'audit de l'Ordre des Experts
Comptables du Maroc, l'Expert Comptable, auditeur légal ou contractuel,
doit prendre connaissance et apprécier les procédures relatives
à la fonction comptable de l'entreprise afin d'orienter et de moduler
les techniques de contrôle à mettre en oeuvre.
L'auditeur doit donc s'assurer que des procédures de
contrôle interne existent et qu'elles permettent d'assurer la
fiabilité des informations utilisées pour l'élaboration
des états de synthèse.
Il s'informe auprès des dirigeants et la direction
financière sur l'organisation des différents services de
l'entité et se fait remettre le manuel des procédures mis
à jour.
Il procède à des tests pour s'assurer que les
procédures décrites sont appliquées d'une manière
constante dans le temps. Ces tests permettront de dégager les points
forts et faibles de l'organisation.
La mission d'examen des comptes sera ainsi basée sur le
degré de fiabilité révélé par ces tests.
Il convient de préciser que la minoterie est une
entreprise de production dont l'organisation est assez simple. L'essentiel de
l'activité se concentre sur la transformation d'une matière
première de base (le blé) en un produit fini principal (la
farine). Schématiquement, on retrouve souvent une organisation reposant
sur quatre services :
? Le service approvisionnement en matières
premières (blé),
? Le service fabrication de la farine et maintenance,
? Le service livraison,
? Les services généraux (direction, administration,
services commerciaux).
L'auditeur établit un schéma synoptique de
circulation des documents, notamment
comptables, lui permettant de suivre leur acheminement depuis
leur création ou réception
jusqu'à leur classement.
Page
126
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Ce chapitre est consacré à la méthodologie
d'audit en se focalisant sur les cycles les plus spécifiques d'une
minoterie industrielle, savoir :
? Cycle achat/fournisseurs du blé et autres achats
spécifiques.
? Cycle ventes /clients.
? Cycle stock matières premières (blé),
produits finis (farine) et produits résiduels (sons)
L'élaboration d'une méthodologie d'audit concerne
deux composantes : l'évaluation du système de contrôle
interne et le contrôle des comptes.
Afin de donner un sens pratique à ce mémoire, il
sera procédé à une présentation d'un guide
d'évaluation du contrôle interne ainsi qu'un guide de
contrôle des comptes.
Page
127
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
|
Section 1 : Cycle achats/fournisseurs.
1. Evaluation du contrôle interne
a) Remarques préalables
Le contrôle interne de la fonction achats d'une
minoterie industrielle couvre les aspects suivants :
· Le déroulement de la procédure
approvisionnement depuis l'expression de besoin en matières
premières (blé) jusqu'au règlement du fournisseur.
· Les déclarations à établir pour le
compte de l'ONICL.
Il convient de rappeler les particularités suivantes au
niveau de la fonction approvisionnement en blé :
· Les achats du blé auprès des producteurs
(agriculteurs) ne sont pas justifiés par des factures. A défaut
de factures, les services financiers des minoteries établissent des bons
de dépenses pour chaque achat de blé auxquels sont jointes les
copies des CIN de ces agriculteurs. Ce constat constitue pour l'auditeur une
source de risques, dans la mesure où les achats de blé peuvent se
révéler fictifs.
· Il est en règle générale
établi un contrat commercial d'acquisition des céréales
(tendre, dur et autres céréales) précisant les
spécificités de ces dernières. L'exploitation de ces
contrats permettra de valider les comptes des achats de blé.
· Le choix des fournisseurs du blé tendre pour la
fabrication de la FNBT n'est pas libre. Il est édicté par l'ONICL
qui organise chaque année un appel d'offre aboutissant au choix des
fournisseurs pour chaque minoterie. La liste des fournisseurs
sélectionnés est notifiée par l'ONICL à cette
dernière.
· L'achat du blé tendre est accompagné par
l'opération d'agréage. L'agréage donne lieu à une
bonification ou une réfaction qui vient en augmentation ou en diminution
du prix d'achat du blé tendre. Les minoteries industrielles disposent
généralement d'un service agréage qui contrôle le
blé lors du chargement sur les camions ou les wagons du train. Ce
service signe un bulletin d'agréage concomitamment avec le fournisseur
du blé tendre.
Page
128
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
b) Questionnaires de contrôle interne d'achats
de blé
i. Questionnaire relatif au contrôle interne de l'achat du
blé libre.
ii. Questionnaire relatif au contrôle interne du
blé destiné à la fabrication de la FNBT (blé
licencié).
iii. Questionnaire relatif aux correspondances avec l'O.N.I.C.L
dans le volet achats.
i. Achats de blé destiné
à la fabrication de la farine libre
|
Points de contrôle
|
Oui/ Non
|
Obser- -vation
|
Réf FT
|
|
Y a-t-il une procédure permettant de déterminer les
besoins en blé dans les moulins ?
Si oui, ce besoin est-il inscrit sur des documents standards
Prénumérotés ?
|
|
|
|
|
Les achats de blé font-ils l'objet d'une mise en
concurrence entre les fournisseurs de blé (organismes stockeurs,
agriculteurs et importateurs) ?
|
|
|
|
|
Les achats de blé font-ils l'objet d'un bon de
commande prénumérotés ? Qui signe le bon de
commande ?
|
|
|
|
|
La réception du blé fait-elle l'objet d'un
contrôle qualité au niveau de la réception ? Existe-t-il
une procédure d'agréage ?
|
|
|
|
|
La réception du blé fait-elle l'objet de pesage au
niveau du pont bascule installé au niveau de l'entrée de la
minoterie ?
|
|
|
|
|
Le service réception établit-il un bon de
réceptions pré-numérotées ? Y-a-t-il un
contrôle de concordance des quantités entre la
demande d'achat, le bon de commande et le bon de réception
?
|
|
|
|
|
Y a-t-il un contrôle entre la facture reçue, la
demande d'achat, le bon de commande, le bulletin d'agréage, le bon de
réception et les tickets de pesage ?
|
|
|
|
|
Les achats de blé font-ils l'objet d'un contrat
d'acquisition suivant le modèle prévu par les circulaires de
l'ONICL ?
|
|
|
|
Page
129
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Suite du questionnaire : Achats de blé
destiné à la fabrication de la farine libre
|
Points de contrôle
|
Oui/Non
|
Observa- -ation
|
Réf FT
|
|
Les réceptions du blé sont-elles inscrites au
niveau du registre des entrées du blé ?
|
|
|
|
|
Les résultats d'agréage sont-ils exploités
pour demander au fournisseur une réfaction ou lui attribuer une
bonification ?
S'il y une réfaction ou une bonification, est ce qu'elles
sont mentionnées sur les factures d'achat de blé ?
|
|
|
|
|
En cas d'acquisition du blé lors de la compagne de
commercialisation du blé tendre, s'assure-t-on que les achats sont
payés au prix référentiel fixé par la circulaire
annuelle ?
|
|
|
|
|
S'assure-t-on que le paiement des factures d'achats de blé
se fait après contrôle de la liasse complète (facture, bon
de commande, demande d'achat, bon de Réception, bulletin
d'agréage, tickets de pesage, bonification ou réfaction ?
|
|
|
|
|
Y-a-t-il un contrôle des enregistrements comptables des
achats de blé ?
|
|
|
|
|
Les avoirs font-il l'objet d'un bon de retour
pré-numérotés ?
|
|
|
|
|
Synthèse du questionnaire.
|
|
|
|
Page
130
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
ii. Achats de blé destiné à la
fabrication de farine subventionnée (FNBT)
Dans ce questionnaire, il sera traité seulement des
spécificités des achats de blé destiné à la
fabrication de la farine nationale du blé tendre, les points normaux
sont déjà traités au niveau du questionnaire du blé
libre.
|
Points de contrôle
|
Oui/ Non
|
Obser
|
Réf FT
|
|
Quel est le quota de blé à acheter auprès
des
fournisseurs agréés par l'ONICL résultant de
l'appel d'offres lancé par ce dernier ? (A rapprocher avec la circulaire
semestrielle de l'ONICL fixant le quota de FNBT à produire).
|
|
|
|
|
La minoterie est-elle en possession des consultations pour le
choix des fournisseurs du blé destiné à la fabrication de
la FNBT de la part de l'ONICL ?
|
|
|
|
|
A-t-on procédé à l'archivage de ces
consultations ?
|
|
|
|
|
La réception du blé fait-elle l'objet de bons de
chargement signés conjointement par le céréalier et le
représentant de la minoterie (généralement,
l'agréeur) ?
|
|
|
|
|
la facture d'achat fait-elle un objet d'un rapprochement avec le
bon de chargement ?
|
|
|
|
|
L'agréage du blé se fait-il sur la base de la
norme
publiée par l'arrêté gouvernemental ?
Le service agréage dispose-t-il de cette norme ?
La norme est prévue par l'arrêté
n°2324-12 du 29 mai 2012.
|
|
|
|
|
Le bulletin d'agréage a-t-il donné lieu à
une réfaction ou à une bonification en cas de divergence de
l'agréage avec les normes ? Y a-t-il un rapprochement entre la facture
et le bulletin d'agréage ?
|
|
|
|
|
Les prix payés au fournisseur du blé se fait-il au
prix fixé par l'arrêté Ministériel (ce prix
était 258,50 dhs/QL pour 2012)
|
|
|
|
Page
131
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
iii. Obligations réglementaires au niveau des
correspondances Minoteries/O.N.I.C.L
|
Points de contrôle
|
Oui/ Non
|
Obser
|
Réf FT
|
|
S'assurer de l'envoi des déclarations à l'ONICL.
-déclaration journalière.
-déclaration hebdomadaire.
-déclaration de quinzaine.
-déclaration mensuelle.
|
|
|
|
|
Le service de gestion de stock de la minoterie dispose-t-il d'un
suivi de
stock des différentes matières et produits de la
minoterie
(blé, farines et issues) ?
Un rapprochement est-il effectué entre le système
de
gestion de stock et les déclarations envoyées
à l'ONICL ?
|
|
|
|
|
Les déclarations envoyées à l'ONICL
sont-elles correctement archivées ?
|
|
|
|
|
Le registre des entrées du blé est- il tenu
à jour ?
Y a-t-il une distinction entre les différents types de
blé sur le Registre ?
|
|
|
|
|
Synthèse du questionnaire.
|
|
|
|
2. Révision des comptes
a) Matières premières
a-1- Achats de matières premières
(blé)
L'article 25 de la loi 12-94 relative à l'ONICL impose
la tenue des registres retraçant les mouvements par nature de
blé. Il retrace notamment pour chaque journée les
quantités de blé réceptionnées et celles mises en
oeuvre. Les minoteries tiennent en fait une comptabilité
"matière" pour le blé.
Cette obligation réglementaire est mise à profit
par l'auditeur pour effectuer des contrôles arithmétiques de
cohérence.
Page
132
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
L'intégralité des quantités mises en
oeuvre figure sur le registre des mouvements du blé. Les pertes de
quantités, pour des raisons indépendantes de la volonté de
la minoterie, et les destructions volontaires de blé de mauvaise
qualité sont à constater par un huissier qui dresse un
procès-verbal de constatation.
Les différences significatives doivent faire l'objet de
recherches approfondies (détournements de matières, erreurs lors
de la facturation par les fournisseurs,...).
Un contrôle de vraisemblance ou un global test du poste
achats de blé peut être effectué d'une manière
simple à partir du registre obligatoire des entrées du
blé. Il suffit d'y ajouter une colonne reprenant le prix d'achat de
chaque entrée pour obtenir le total annuel qui devrait être
conforme au solde du poste achats de blé.
Il est encore possible d'obtenir les mêmes
données à partir du « registre des mouvements des produits
», les opérations sont ventilées par nature de
céréales.
a-2- L'indépendance des exercices pour les achats
de matières premières « blé »
Il faut être vigilant sur le respect de la règle
d'indépendance des exercices, sous peine d'altérer la
fiabilité du résultat. Les achats de blé
représentent la charge la plus importante d'une minoterie. Il est
nécessaire de s'assurer par des sondages appropriés de
l'exhaustivité des achats et leur entrée en stock.
Il convient d'examiner les achats enregistrés au cours
du début de l'exercice (N+1) pour déceler d'éventuels
achats relatifs à l'exercice audité (N-1) qui n'auraient pas
été enregistrés en comptabilité.
b) Charges externes : entretien du matériel
L'industrie meunière est très
mécanisée. Elle nécessite d'importants investissements.
Par ailleurs, en vue de se conformer aux normes de sécurité,
l'entreprise doit procéder, selon certaines normes, à des
investissements nouveaux ou à de grosses réparations.
Les dépenses d'entretien et de réparation
constituent des charges normales, sauf exceptions, car elles n'augmentent ni la
durée de vie du bien, ni sa valeur. Elles sont immobilisées
uniquement si elles augmentent la valeur du matériel ou, d'une
manière appréciable, ses rendements ou sa capacité
d'écrasement.
Page
133
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
L'entretien des matériels de meunerie semble donc
pouvoir constituer une charge immédiatement déductible si ces
dépenses ne sont engagées que pour respecter des obligations
réglementaires.
Cependant, il faut tenir compte de la position de
l'administration fiscale lors des contrôles fiscaux qui considère
généralement que les grandes dépenses d'entretien
constituent des immobilisations et non des charges déductibles.
L'administration fiscale base son raisonnement sur le fait que
l'engagement de la dépense est indispensable pour utiliser le bien et
permet donc de prolonger sa durée de vie.
Cette position est discutable ; chaque situation est
particulière.
Si l'option de comptabiliser les dépenses de cette
nature en charges est retenue, l'auditeur analyse l'opération. Il valide
l'enregistrement en charges ou s'il lui semble que la dépense doit
être immobilisée ou étalée, il le recommande
à la direction générale. En cas de refus, il en fait
mention dans son rapport.
Page
134
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
Section 2 : Cycle Ventes/clients.
1. Evaluation du contrôle interne
a) Remarques préalables
Il est proposé, ci-après, un questionnaire
adapté au secteur de la minoterie industrielle pour l'évaluation
des procédures de contrôle interne du cycle ventes /clients.
Cependant, avant d'exposer le guide d'évaluation des
procédures de contrôle interne des clients, il y lieu de noter les
remarques suivantes :
? La clientèle de la minoterie n'est pas de type
homogène, elle est constituée généralement des
entités suivantes : Grossistes, boulangerie industrielle et artisanale,
épiceries, grandes et moyennes surfaces, hôtels, restaurants et
clients du son.
? Le prix de la farine nationale du blé tendre est
fixé par voie règlementaire par contre le prix des autres farines
est libre. Comme exposé dans la première partie, les
distributeurs qoutataires de la FNBT sont attribués à chaque
minoterie industrielle.
? Même si les minoteries industrielles vendent un seul
produit (la farine libre), le prix varie d'une minoterie à l'autre en
fonction de l'emballage et du type de farine.
? Les farines vendues sont de plusieurs types, mais les plus
connues sont les suivants :
Farine luxe normale : farine utilisée dans la panification
ménagère
Farine de luxe pâtissière : farine utilisée
dans les pâtisseries.
Farine boulangère :
Farine fleur :
Farine complète :
Farine parisienne :
Farine viennoiserie :
? Les farines sont vendues dans plusieurs types d'emballage : 1,
5, 10, 25,50 Kg.
Page
135
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
b) Revue du circuit de vente de la farine et
questionnaires de contrôle interne.
Farine libre
Généralement, le circuit de vente d'une minoterie
industrielle se décompose des phases suivantes :
· Bon de commande des clients : la minoterie
industrielle établit un bon de commande clients standard. Ce bon de
commande spécifie le code de la farine, le type de la farine, la
quantité en quintal, le prix unitaire et le prix total.
· Chargement de la farine : sur la base du bon de
commande, le service commercial lance aux services magasin le chargement de la
farine par l'établissement d'un bon de chargement.
· Pesage de la farine sur les balances : avant la
livraison au client, le service magasin procède au pesage de la farine
à livrer et édite un bon de pesage.
· Livraison des palettes au client : le service magasin
procède à la livraison des palettes aux camions et établit
des bons de livraison.
· Facturation des ventes : les factures de vente sont
établies sur la base des bons de livraisons signés par les
clients en appliquant les tarifs de vente fixés par l'entreprise.
· Certains clients de la farine et de son sont des
personnes qui travaillent dans l'informel et ne demandent pas de factures. Ces
clients règlent généralement en espèces d'où
un risque de non comptabilisation du chiffre d'affaires correspondant à
ces ventes. Les omissions d'enregistrement des ventes peuvent cependant
être décelées par l'examen des mouvements matières
et les indicateurs d'écrasement.
Farine subventionnée
La vente de la farine subventionnée obéit
à une logique administrative et non commerciale. Cette vente est soumise
à une réglementation rigoureuse, résumée comme suit
:
Fixation des quotas : la commission technique
chargée de l'élaboration du plan de fabrication de la farine
subventionnée et de la répartition du contingent entre minoteries
élabore un plan de fabrication pour un semestre donné par centre
de fabrication. Un tableau annexé au PV de ladite commission fixe la
répartition des quotas des centres de fabrication entre les minoteries
du centre (Un centre de fabrication est constitué d'une ou de plusieurs
minoteries implantées dans une province ou dans les préfectures
d'une même wilaya).
Répartition du quota alloué à la
minoterie entre les communes de la province : l'ONICL envoie à la
minoterie un document fixant les dotations du quota de la minoterie.
Page
136
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
|
Livraison de la farine aux commerçants : tous les
dix jours, la minoterie procède à la livraison de la farine
nationale du blé tendre aux provinces désignées par
l'ONICL dans le document.
Transport de la farine nationale du blé tendre :
le transport de la FNBT hors la ville de résidence de la minoterie est
pris en charge par l'ONICL.
Questionnaire de contrôle interne de la vente
de la farine
Points de contrôle
|
Oui/Non
|
Observation
|
Réf FT
|
Les commandes des clients sont-elles reportées sur des
documents numérotés ?
|
|
|
|
un contrôle de concordance des quantités
entre les bons de commande et les bons de livraison est-il
effectué ?
|
|
|
|
Sous quelle forme est tenu le registre des mouvements :
informatique ou manuelle ?
|
|
|
|
Ce registre est-il servi à partir des bons de livraison
?
|
|
|
|
Qui établit les factures?
Les ventes de la FNBT sont-elles facturées au prix
fixé par l'ONICL ?
|
|
|
|
Y-a-t-il un contrôle opéré sur la
concordance entre les bons de livraison et les factures émises ?
|
|
|
|
Les factures sont-elles contrôlées avant leur
envoi ?
|
|
|
|
|
Page
137
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Suite du questionnaire : contrôle interne
de la vente de la farine
Points de contrôle
|
Oui/Non
|
Observation
|
Réf FT
|
Les avoirs sont-ils approuvés par une autre personne que
le préposé à la facturation?
|
|
|
|
Les avoirs liés à un retour de farine sont-ils
repris sur le registre de sortie ?
|
|
|
|
Comment sont enregistrées les ventes en
comptabilité ? (basculement informatique, saisie manuelle)
|
|
|
|
Qui réalise cet enregistrement ? A quelle période
?
|
|
|
|
Les enregistrements comptables des ventes font-ils l'objet
concordance avec ceux de la gestion commerciale ?
|
|
|
|
Comment fonctionne le système de classement des factures
?
|
|
|
|
Synthèse sur le questionnaire
|
|
|
|
|
Page
138
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Questionnaire contrôle interne :
correspondances vis-à-vis de l'O.N.I.C.L
Points de contrôle
|
Oui/Non
|
Observation
|
Réf FT
|
S'assurer de l'envoi de déclaration bimensuelle à
l'ONICL.
La déclaration bimensuelle recense les sorties Mensuelles
de la farine pour vente. Ces sorties
servent à les comparer avec les ventes figurant au CPC
?
|
|
|
|
S'assurer de l'envoi de déclaration de la quinzaine
à l'ONICL concernant les ventes de la farine nationale du blé
tendre.
Les données de cette déclaration sont à
comparer avec les ventes de FNBT figurant au CPC.
|
|
|
|
Les ventes de la FNBT font-elles l'objet d'enregistrement en
comptabilité d'une prime compensatrice de 143,375 dhs
par Ql à recevoir de l'ONICL (arrêté de
l'année 2012)
|
|
|
|
S'assurer que le registre des mouvements de produits est
à jour
Y a-t-il une distinction entre les différents types de
farine sur le registre ?
|
|
|
|
Synthèse sur le questionnaire
|
|
|
|
|
Page
139
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
|
2. Evaluation du contrôle des comptes
A) Ventes de farine
L'indépendance des exercices doit être bien
maîtrisée. Les méthodes classiques et appropriées
sont utilisées pour s'assurer de l'exhaustivité de la facturation
et de la règle d'indépendance des exercices.
L'auditeur doit s'assurer de la concordance des indications
reportées sur le registre des mouvements des produits avec les ventes
enregistrées en comptabilité. A cet effet, une colonne reprenant
le montant des ventes est ajoutée.
La cohérence du stock de farine est
étudiée selon la même méthode que celle
décrite pour les achats de blé destiné à la
production et pour les achats de céréales destinées au
négoce puisque le registre obligatoire indique à la fois les
quantités obtenues (de farine et d'issues) et les quantités
livrées.
B) Comptes clients
Le plan de mission souligne l'importance d'un contrôle
approfondi des comptes clients. En effet, la défaillance d'un client
peut avoir diverses incidences non négligeables.
? Vérification des comptes clients
Le seuil de signification devra donc être relativement
faible. Il est même envisageable un contrôle exhaustif des comptes
clients si la mission d'examen est exécutée dans une petite ou
moyenne entreprise.
La clientèle est très diversifiée
(grandes surfaces, grossistes, épicerie,.....). Il convient d'adopter
une méthode de vérification pour chaque catégorie.
Grandes surfaces : Pour ce type de
clientèle, on pourrait utiliser la confirmation directe des soldes.
Cette clientèle est structurée et dispose
généralement de services financiers performants capables de
répondre aux lettres de confirmation de l'auditeur.
Vu la valeur élevée du volume de vente à
cette clientèle, il est important pour l'auditeur de valider le solde de
cette clientèle.
Page
140
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
|
Grossistes : Ce type de
clientèle est généralement peu organisé. Il n'est
pas envisageable de procéder à une confirmation de soldes. La
seule vérification possible est de comparer les composantes des soldes
avec les factures non encore encaissées et les bons de livraison
correspondants.
? Constitution d'une provision pour créances douteuses
Chaque retard de paiement est noté. Une
révision des mouvements des comptes clients au début de
l'exercice suivant est souhaitable. Elle permet de détecter une
éventuelle défaillance des clients vérifiés pouvant
entraîner la constitution d'une provision pour dépréciation
clients.
Un entretien avec la direction est organisé à ce
stade de la révision afin de passer en revue les risques
éventuels. La discussion fera peut-être apparaître des
défaillances non visibles dans les grands livres car apparues
très récemment.
Une consultation des avocats est intéressante afin de
détecter d'éventuels litiges avec les clients et suivre
l'état de la procédure engagée.
Section 3 : Cycle Gestion des stocks.
Dans l'activité de minoterie, le stock constitue un
poste important de l'actif de la société, que ce soit les
matières premières « blé », les produits finis
« farines : farine complète, farine de luxe, farine nationale,
farine ronde courante, farine ronde spéciale » et les sous-produits
« son », ainsi que les emballages « sacherie » et les
matières consommables « améliorants ».
Ce poste appelle un suivi et une gestion rigoureuse à
tous les niveaux.
1. Evaluation du contrôle interne
a) Procédure d'inventaire physique et
permanent
L'inventaire du stock des minoteries industrielles est une
tâche quotidienne pour répondre aux exigences de l'ONICL. Cet
inventaire est réalisé à l'aide de logiciels de gestion de
stocks et rarement en physique.
Page
141
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
|
Vu l'impact de cette obligation réglementaire, les
services de gestion du stock sont rodés pour l'exécution
d'inventaires. Le risque d'anomalies lié à cette opération
se trouve minime, voire même inexistant.
L'exactitude des inventaires physiques de stock se trouve
confortée par la tenue en parallèle d'un inventaire comptable
permanent.
Les méthodes d'inventaires de stocks sont simples pour
deux raisons essentielles :
? La présence d'une seule matière première,
le blé, et d'un seul produit fini, la farine.
? Le stockage du blé et de la farine se fait
généralement dans des silos en béton ou en acier disposant
d'un système de mesure de quantités.
La mesure de quantité en stock se base sur une
méthode simple : Quantité de blé ou de farine par volume
(hectolitre).
La ou les personnes chargées de l'inventaire peuvent
réaliser les tâches suivantes pour le comptage de stock :
? Si les silos disposent d'unités de mesures, il suffit
de multiplier le niveau de remplissage relevé par le nombre de kg par
hectolitre et selon l'exemple ci-après :
Exemple :
Supposant que pour une catégorie de blé un
hectolitre donne 77 Kg de blé
Le silo à un diamètre de 10 mètres de
hauteur et 60 mètres. Les mesures indiquent un remplissage de 30
mètres.
Calculs :
Volume en M3 = ð Pi * (Rayon/2)2 *
hauteur
Volume en M3 = 3,14 * 52 * 30 = 2355
M2
1 hectolitre = 0,1 M3
Donc 2355 M3 = 23 550 HL
Poids en Kg = 23 550 HL * 77 Kg = 1 813 350 kg, soit 1 814
quintal
Page
142
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
|
· Si les silos ne disposent pas d'unités de mesures,
il est procédé par des métrés pour
déterminer les quantités stockées.
L'ensemble de quantités inventoriées est
récapitulé sur des feuilles de comptage structurées par
silos et par nature de matière et produits.
Généralement, dans les minoteries industrielles,
les stocks sont organisés de la manière suivante :
· Le blé est stocké par origine : local, USA,
Russie, Europe, .....
· La farine est stockée par qualité : luxe,
fleur, FNBT,
L'inventaire permanent est tenu dans les minoteries
industrielles sur des applications informatiques intégrées. Ce
système permet de gérer outre le stock, le commercial, les
achats, la paie et la comptabilité.
Le stock physique est comparé au stock permanent. En cas
d'écarts, il est procédé à la recherche de leurs
causes en vue d'apporter les corrections qui s'imposent.
b) Obligation de tenue des comptes matières
vis-à-vis de l'ONICL
Comme rapporté dans les paragraphes
précédents, la minoterie industrielle doit établir des
rapports à l'ONICL d'une manière journalière, bimensuelle
et mensuelle.
La farine est une denrée de première
nécessité, En vue d'éviter au pays une rupture de stock
aux conséquences désastreuses, l'ONICL assure par le biais de ces
déclarations un suivi permanent pour prévenir une
éventuelle insuffisance et mettre en place le cas échéant,
des actions correctives.
L'exploitation des données fournies par ces rapports peut
être mise à profit par les entités suivantes :
· Les agents de l'ONICL lors d'une inspection
· Les vérificateurs lors d'un contrôle
fiscal
· Les auditeurs internes.
· Les auditeurs externes lors d'un audit légal ou
contractuel.
Page
143
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
c) Méthodes d'évaluation des stocks
? Evaluation des stocks de matières premières
« blé »
L'auditeur procède lors de sa mission au contrôle
d'évaluation de stock de blé détenu à la date
d'inventaire. Il s'assure des procédures mises en place pour
l'évaluation des stocks et de leur bonne application.
Généralement, le contrôle
d'évaluation de stock de blé ne pose pas de problèmes
majeurs en raison des comptes rendus effectués quotidiennement par la
minoterie à l'ONICL et des contrôles inopinés qui peuvent
être réalisés par les agents de cet organisme.
Il suffit pour l'auditeur de réaliser un rapprochement
simple entre les quantités déclarées sur le registre du
mouvement du blé avec les fiches d'inventaire physique.
Les méthodes généralement admises pour
l'évaluation du stock sont celles préconisées par le
CGNC.
La méthode de coût moyen pondéré
(CMUP)
Si la société auditée pratique la
méthode CMUP, le contrôle de l'auditeur portera sur le
contrôle du calcul du CMUP et de la valeur finale du stock.
La méthode FIFO
Le contrôle d'évaluation par la méthode FIFO
est très simple, il suffit de se faire communiquer les derniers achats
de blé pour reconstituer le stock de fin d'exercice en quantités
et valeurs.
? Evaluation des stocks de produits finis « farine
»
Cette rubrique de stock pourrait présenter quelques
difficultés pour sa validation, notamment si l'entité
auditée ne dispose pas de comptabilité analytique.
Si l'entreprise tient une comptabilité analytique, le
contrôle portera sur les méthodes d'évaluation
utilisées.
Par mesure de simplification, certaines entreprises
évaluent le stock de la farine sur la base du prix de vente auquel il
est appliqué une décote correspondant à la marge brute.
Page
144
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
Cette méthode n'est pas conforme aux dispositions du CGNC.
Elle peut faire l'objet de critiques de l'administration fiscale lors d'un
contrôle fiscal.
Pour conforter son opinion, l'auditeur aura à mettre en
oeuvre, une méthode de comparaison : évaluation du coût de
production par le biais de la comptabilité générale, selon
le schéma ci-après :
Etat des mouvements de blé de l'exercice
(A)
|
Désignation
|
Quantité
|
Valeur
|
|
Stock initial du blé (libre et licencié)
|
|
|
|
(+) Achats du blé (libre et licencié)
|
|
|
|
Stock final du blé (libre et licencié)
|
|
|
|
(=) Quantité globale écrasée (libre
et licencié)
|
|
|
Page
145
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
Comptes de charges à inclure dans le
coût de production de la farine (B)
|
Intitulé
|
|
Améliorants
|
|
Achats de fournitures moulin
|
|
Achats d'emballages perdus (sacherie)
|
|
Fournitures moulin
|
|
Fournitures entretien moulin
|
|
Fournitures entretien laboratoire
|
|
Eau
|
|
Electricité
|
|
Gasoil
|
|
Petit outillage
|
|
Location matériel et outillage
|
|
Crédit-bail de matériel de production
|
|
Equipement minoterie
|
|
Filtre ventilateur
|
|
Entretien et réparation matériel de production et
laboratoire
|
|
Assurance multirisque (bâtiments industriels et
matériel de production).
|
|
Charge du personnel de production
|
|
Assurance AT et autres charges sociales liées à la
production
|
|
Habillement
|
|
Médecine de travail du personnel de production.
|
|
Dotations aux amortissements des bâtiments et
équipements
|
|
Total des charges de production
|
Ces charges constituent des charges consommées pour
l'opération de l'écrasement de l'exercice.
A ces charges, il convient d'ajouter les frais d'emballages
(sacs consommés), et déduire le coût de production du son.
Ce dernier est obtenu par application d'un taux déterminé par les
services techniques de la minoterie.
Page
146
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
Récapitulation du coût de production
farine
|
Désignation
|
Montants en dirhams
|
|
1
|
Coût d'achat du blé écrasé cf. (A)
|
|
|
2
|
(+) Charges de production cf. (B)
|
|
|
3
|
(+) Montant des sacs d'emballages perdus consommés
|
|
|
4
|
(=) Coût global de production incluant le son
|
|
|
5
|
% du son obtenu lors de la production
|
|
|
6
|
Coût de production du son (coût global de production)
(4 *5)
|
|
|
7
|
Coût de production de la farine (4-6)
|
|
|
8
|
Quantité de farine fabriquée durant l'exercice (en
quintal)
|
|
|
9
|
Coût de production par quintal de farine
|
|
2. Révision des comptes
a) Test de contrôle du stock de la farine par la
sacherie
L'emballage de la farine est réglementé par une
circulaire conjointe du 27 février 2007 entre l'ONICL et la Direction de
Protection des Végétaux, des contrôles techniques et de la
répression de fraudes.
Cette circulaire fixe les conditions d'emballage,
d'étiquetage et de la livraison de la farine par les minoteries
industrielles.
Les farines peuvent être livrées en sacs de 5, 10,
15, 20,25 et 50 kg ; les emballages doivent comporter l'étiquette
d'identification correspondante.
Les sacs d'emballages sortis du stock doivent se trouver
normalement parmi les ventes de l'exercice audité ou figurer dans le
stock de fin d'année.
Le contrôle de la sacherie est très
recommandé. Il pourrait révéler d'éventuelles
anomalies (ventes en noir de la farine, sous-estimation de stock).
Page
147
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
Cas pratique :
Informations communiquées à l'auditeur lors d'une
mission de révision des comptes :
? Etat des sorties de la sacherie pour la production.
? Etat des ventes de farine en kg. ? Etat de stock final de
farine.
? Etat de stock initial de la farine.
Etat des sorties de la sacherie pour la
production
|
Code Article
|
Volume de sac en Kg
|
Nombre de sacs sortis
|
Quantité théorique de
Farine
correspondante
|
|
1
|
50
|
14
|
811
|
|
740
|
550
|
|
2
|
10
|
24
|
281
|
|
242
|
810
|
|
3
|
25
|
866
|
608
|
21
|
665
|
200
|
|
4
|
50
|
16
|
325
|
|
816
|
250
|
|
5
|
25
|
|
305
|
|
7
|
625
|
|
6
|
5
|
53
|
199
|
|
265
|
995
|
|
7
|
5
|
1
|
513
|
|
7
|
565
|
|
8
|
10
|
195
|
521
|
1
|
955
|
210
|
|
9
|
10
|
2
|
310
|
|
23
|
100
|
|
10
|
25
|
326
|
452
|
8
|
161
|
300
|
|
Total
|
|
|
|
33
|
885
|
605
|
|
Stock final de farine:
|
719 900 Kg
|
|
Vente de farine en kg :
|
33 695 255 Kg
|
|
Stock initial de farine:
|
521 630 Kg
|
Page
148
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
Le principe du test consiste en la comparaison entre la
production théorique et la production réelle de la farine.
|
Elément
|
|
Nombre de Kg
|
|
Stock final de farine
|
A
|
719 900
|
|
Ventes farine de l'exercice B
|
33 695 255
|
|
Stock initial de la farine
|
C
|
- (521 630)
|
|
Production réelle (A+B-C)
|
D
|
33 893 525
|
|
sorties sacheries pour la consommation
|
E
|
33 885 605
|
|
Ecart (D-E)
|
|
7 920
|
L'écart de 7 920 Kg peut correspondre aux
cas suivants :
? Dissimulation de ventes de farine
? Erreurs dans les inventaires de stock en quantité ?
Erreurs dans l'inventaire de la sacherie
NB : L'auditeur doit procéder à
un inventaire physique en fin d'année de la sacherie restante afin de
ressortir les consommations de l'emballage.
A cet inventaire il faut ajouter la sacherie détruite
ou vendue. L'auditeur se doit communiquer le PV de destruction des sachets et
la facture de ventes des sachets à des tiers.
Ces éléments doivent être pris en compte
lors du calcul des sorties de la sacherie pour la production.
b) Test de contrôle du stock de la production de
farine par la consommation électrique
Pour s'assurer de la cohérence des quantités
vendues et stockées de farine, on peut recourir à une
méthode souvent utilisée lors de contrôles fiscaux.
Cette méthode repose sur les informations suivantes
faciles à mettre en oeuvre :
? Les comptes de charges et les factures relatifs à la
consommation d'électricité de l'exercice audité.
? L'indicateur relatif aux quintaux produits par KW, Cette
information peut être obtenue des services techniques.
Page
149
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
La quantité produite de farine durant l'exercice
auditée ressort de la formule suivante : Quantité
produite = nombre de KW consommés * nombre de quintaux par
KW.
La quantité produite ainsi déterminée est
comparée avec celle relevée sur les différentes
déclarations à l'ONICL ou calculée (stock final + ventes -
stock initial).
? Production calculée à partir de la force
motrice
? Production calculée à partir des stocks (initial
et final) et les ventes. ? Ecart
|
Elément
|
|
Quantités /Ql
|
|
Production calculée à partir de la force motrice
(A)
|
|
|
|
Production calculée à partir des stocks (initial et
final) et les ventes (B)
|
|
|
|
Ecart en quantités C = (A-B)
|
|
|
|
Prix de vente au quintal
|
(D)
|
|
|
Ecart en valeurs E = (C*D)
|
|
|
Si l'écart est positif : ce résultat peut
être interprété comme une minoration du chiffre d'affaires.
Si l'écart est négatif : ce résultat peut
révéler des erreurs de comptabilisation des ventes :
Factures comptabilisées plus d'une fois, avoirs non
comptabilisés ou comptabilisés comme s'il s'agissait de factures
et/ou enregistrement fictifs de ventes pour cacher la véritable
situation de la société (couverture de pertes plus ou moins
importantes).
Si l'écart est significatif, le réviseur des
comptes en signale le fait dans son rapport aux actionnaires.
En signalant l'impact de ces constatations sur les comptes et
le résultat de l'exercice, le réviseur mentionne dans son rapport
les réserves sur cette situation ou refuse la certification selon
l'importance des écarts. En revanche, si l'écart est peu
significatif, il est fait mention dans son rapport à la Direction
Générale avec une recommandation adéquate pour
éviter cette situation à l'avenir.
Page
150
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Chapitre 3- Audit des créances et des
dettes
vis-à-vis de l'Etat
Page
151
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
Section 1- Nature des créances parafiscales
Les créances parafiscales d'une minoterie industrielle
sont de deux types :
1. La prime forfaitaire sur l'achat du blé
tendre
Comme signalé dans la première partie, la prime
forfaitaire est une prime servie par l'ONICL à la minoterie industrielle
à l'occasion de l'achat du blé tendre auprès des
producteurs durant la période de récolte fixée par la
circulaire annuelle de commercialisation.
Cette prime constitue une créance parafiscale de la
minoterie vis-à-vis de l'ONICL. Elle est enregistrée au
débit d'une subdivision du poste 345 « Etat-débiteur »
par le crédit d'un compte de produits « subventions d'exploitation
»
2. La prime de compensation sur la farine nationale du
blé tendre (FNBT)
On se référant à la première
partie, la prime de compensation sur la farine nationale du blé tendre
est une prime perçue sur chaque quintal vendu par la minoterie dans le
cadre du quota annuel octroyé par l'ONICL aux minoteries
industrielles.
Le montant de cette prime est logé comme la prime
forfaitaire sur l'achat du blé dans une subdivision du poste 345 «
Etat débiteur » pour constater une créance vis-à-vis
de l'ONICL en attendant son encaissement.
Page
152
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
Section 2- Contrôle des comptes des
créances parafiscales
Prime relative à l'achat du blé local
(blé tendre)
|
Points de contrôle
|
Réf FT
|
|
Obtenir les états mensuels des bons de réception du
blé local de compagne et établir une récapitulation de ces
états par mois en quantité (Quintal)
|
|
|
Obtenir la liste des réceptions du blé local.
Comparer cette liste avec celle résultant des états
de réception.
|
|
|
Obtenir copie de la circulaire annuelle fixant le montant de la
prime forfaitaire relative à l'achat du blé local
|
|
|
Obtenir copies des lettres de virements des primes reçues
de l'ONICL.
|
|
|
Valoriser la quantité achetée par le montant de la
prime par quintal (30 dhs/quintal en 2012) et déduire les virements
reçus de l'ONICL. Le montant obtenu devrait correspondre au solde du
compte 3451 Compensation Blé local.
|
|
Prime de compensation de la farine nationale du
blé tendre (FNBT)
|
Points de contrôle
|
Réf FT
|
|
Obtenir les états de livraisons de la farine nationale du
blé tendre quantité (Quintal)
|
|
|
Obtenir la liste des livraisons (ventes) de la FNBT
|
|
|
Obtenir copie de l'arrêté fixant le montant de la
prime de la FNBT ; le montant était fixé à 143,375
dhs/quintal en 2012.
|
|
|
Obtenir copies des lettre de virements des primes reçues
de l'ONICL.
|
|
|
Valoriser la quantité livrée par le montant de la
prime par quintal (143,375 dhs/quintal) et déduire les virements
reçus de l'ONICL. Le montant obtenu devrait correspondre au solde du
compte 3451 Compensation FNBT.
|
|
Page
153
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
Section 3 - Nature des dettes parafiscales
Les dettes parafiscales sont les suivantes :
1. La taxe de commercialisation
Il est institué, au profit de l'ONICL, une taxe
parafiscale dénommée "taxe de commercialisation des
céréales et des légumineuses", perçue à la
transformation par les industries utilisatrices en ce qui concerne les
blés, les orges, le maïs et le riz, et à la
commercialisation en ce qui concerne les légumineuses alimentaires et
les autres céréales.
Cette taxe est prélevée sur les paiements des
minoteries industrielles aux agriculteurs lors de l'achat du blé local
durant la récolte.
2. Transport ONICL
Forfait de transport de place de 0,5 Dhs/QL, inclus dans le
prix de vente de la FNBT destinée aux commerçants grossistes. Son
montant est repris par l'ONICL auprès des minoteries.
Lors de la livraison de la FNBT, il est constaté une
dette vis-à-vis de l'ONICL inscrite au crédit du compte 4455
« Etat, taxe de commercialisation».
3. Les amendes pénales suite au contrôle de
l'hygiène Ces amendes sont établies suite au contrôle de la
qualité de la farine produite.
Ces amendes résultent de jugements des tribunaux. Elles
sont comptabilisées dans une subdivision du poste 4455 Etat
créditeur en attendant l'exécution des jugements.
Page
154
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
Section 4 - Contrôle des comptes des dettes
parafiscales
Taxe de commercialisation
|
Points de contrôle
|
Réf FT
|
|
Obtenir les états d'achats de l'exercice du blé
local auprès des agriculteurs
|
|
|
Multiplier la quantité achetée par le montant par
quintal de la taxe de commercialisation (1,90 dhs par quintal)
|
|
|
S'assurer que cette taxe est prélevée sur les
factures des producteurs
|
|
|
Demander les états de paiement de cette taxe à
l'ONICL.
Généralement, ces taxes sont
prélevées par l'ONICL lors de l'octroi des subventions de la FNBT
aux minoteries industrielles.
|
|
|
Valider le solde du compte taxe de commercialisation en
rapprochement son mouvement crédit au total des achats du blé
local multiplié par le montant unitaire de la taxe de commercialisation
et son montant débit à l'ensemble des retenues de la taxe de
commercialisations effectuées par l'ONICL au cours de l'exercice.
NB : La taxe de commercialisation retenue par l'ONICL est
imputée sur les remboursements des primes et subventions.
|
|
Transport ONICL
|
Points de contrôle
|
Réf FT
|
|
Obtenir les états de livraison de la FNBT de l'exercice
|
|
|
Multiplier la quantité de FNBT livrée par le
montant par quintal de 0,5 dhs
|
|
|
Demander les états de l'ONICL de paiement du transport
pour justifier les paiements.
|
|
|
Valider le solde du compte transport ONICL en rapprochement
son
mouvement crédit au total des livraisons de la FNBT (hors
région de la minoterie) multiplié par le montant unitaire du
transport par quintal et son montant crédit à l'ensemble des
retenues de la taxe de commercialisations effectuées par l'ONICL au
cours de l'exercice.
NB : l'auditeur se doit communiquer l'état des livraisons
FNBT hors région de la Minoterie.
|
|
Page
155
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
Amendes pénales
|
Points de contrôle
|
Réf FT
|
|
Obtenir le Grand livre du compte 445503 Amendes pénales
|
|
|
Obtenir détail des jugements non encore
exécutés et faire un rapprochement avec le Solde du compte
445503.
|
|
Page
156
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
Conclusion de la deuxième partie
La mission d'audit d'une minoterie industrielle,
exerçant à la fois des opérations d'écrasement de
blé aussi bien libre qu'au titre licencié pour la production et
la vente de la farine dont une partie est rigoureusement suivi par l'Etat passe
par la réalisation de plusieurs étapes de travail à
accomplir par l'auditeur.
En premier lieu, il convient de recueillir les informations
suffisantes sur le secteur d'activité des minoteries industrielles, la
conjoncture nationale et internationale, les spécificités
juridiques, comptables et fiscales de la profession et les risques
inhérents aux activités exercées par la minoterie
auditée.
Après cette prise de connaissance, l'auditeur
effectuera des contrôles approfondis sur les composants à risque
des états de synthèse de la minoterie industrielle à
savoir :
> Cycle : Achats fournisseurs
> Cycle : Vente clients
> Cycle : stocks de blé et de farine
> Cycle des créances et des dettes vis-à-vis de
l'Etat
A l'issus de ses travaux, l'auditeur doit être en mesure
de répondre à trois questions essentielles se rapportant à
ces cycles :
> Tous les achats de blé de l'exercice sont-ils
correctement enregistrés ?
> Y a-t-il une cohérence entre la production issus
de la comptabilité et celle dégagée à partir de la
consommation électrique ?
> Y a-t-il une cohérence entre la production issus
de la comptabilité et celle dégagée à partir du
test de la sacherie ?
Enfin, à partir de l'analyse des risques relatifs aux
minoteries industrielles, nous avons établi des programmes de travail
pour les composants à risque, qui certes ne sont pas exhaustifs, mais
veulent apporter aux auditeurs une méthode de travail pour effectuer une
mission d'audit.
Page
157
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
Conclusion générale
Fortement caractérisé par une législation
dense et mouvante, et un suivi étatique quotidien, le secteur de la
meunerie industrielle se distingue largement des autres secteurs aussi bien au
regard de son fonctionnement qu'au regard de son audit.
L'Expert-Comptable appelé à accompagner les
entreprises exerçant une activité de minoterie industrielle aussi
bien dans le cadre d'une assistance comptable et fiscale que dans le cadre
d'une mission d'audit légal ou contractuel, se doit de maîtriser
toutes les particularités et la réglementation de cette
activité.
Par ailleurs, l'activité des minoteries industrielles
se caractérise par la faiblesse des marges de vente de la farine qui
engendre une fragilité de la structure financière (faiblesse des
résultats annuels dégagés par rapport au volume
d'écrasement). Cette fragilité est d'autant plus accentuée
lorsque la minoterie procède à des investissements importants
et/ou des entretiens couteux avec financement par des crédits bancaires
importants.
En conséquence, la structure financière doit
être contrôlée afin de détecter une éventuelle
difficulté d'entreprise, voire lancer une procédure d'alerte.
L'auditeur devra donc maîtriser les principes issus de
la réglementation des minoteries industrielles afin de s'assurer de leur
respect. Il portera plus particulièrement son attention sur les
composants à risque des états financiers à savoir les
stocks de matières (blés) et produits finis (farine) , le chiffre
d'affaires, les achats de matières premières et les dotations aux
amortissements des immobilisations.
Pour mener à bien sa mission d'audit d'une minoterie
industrielle, l'Expert-comptable d'une minoterie industrielle doit
obligatoirement procéder à des diligences dont notamment :
? La revue de l'environnement externe fixant les enjeux et les
perspectives de la minoterie industrielle.
? Le diagnostic stratégique, de gestion et financier
aboutissant à un positionnement de l'entreprise dans le secteur de la
meunerie.
Page
158
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
? L'examen des procédures de contrôle interne
pour maîtriser les opérations réalisées et
définir les zones de risque et leur incidence éventuelle sur les
comptes.
? L'identification des risques propres à la minoterie sous
revue.
Ne prétendant pas répondre à toutes les
questions susceptibles de se présenter dans la pratique, le
présent mémoire se propose, d'une part, d'améliorer les
connaissances de ce métier et aider à trouver une réponse
aux principales interrogations, et d'autre part , constituer pour la profession
un guide dans ce domaine d'activité lui permettant de déceler
rapidement les zones de risques spécifiques à l'entreprise
auditée afin d'appréhender les situations rencontrées et y
apporter les réponses les plus appropriées.
Page
159
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
Bibliographie
Mémoires d'expertise comptables
1. L'industrie de la meunerie : analyse des
particularités et impacts sur la mission du réviseur, BOUREL EP.
DESORME STEPHANIE, Novembre 2002.
2. Aspects particuliers des risques de prix et de changes dans
les sociétés de négoce
international de
céréales, LIEBART CHRISTIAN, novembre-décembre 1992.
3. Mission d'examen des comptes annuels d'une minoterie, COGEN
ERIC, Novembre 2000.
4. La reprise d'une boulangerie pâtisserie artisanale :
outils d'aide à la détermination de
l'un prix juste du fonds
et rentabilité d'exploitation. MALOU, Karim, mai 2010.
5. L'analyse de l'exploitation préalable à la
gestion dans la meunerie. Etudes
1. Etude stratégique sur les perspectives
d'évolution du secteur meunier, étude réalisée par
la fédération nationale des minoteries en 2009 avec le concours
d'un cabinet d'étude.
2. Etude sur les produits subventionnés dans le cadre du
système de compensation. Etude réalisée par le conseil
national de la concurrence en juin 2012.
3. Fond de développement agricole : les aides
financières de l'Etat pour l'encouragement des investissements
agricoles.
4. Plan d'Action de la Transformation des
Céréales, étude réalisée par le FIAG.
5. Projet de cahier des charges de la minoterie industrielle
Textes de lois
? Loi n° 12-94 du 22 février 1995 relative
à l'office national interprofessionnel des céréales et des
légumineuses et à l'organisation du marché des
céréales et des légumineuses complétée par
la loi 17-96 du 2 août 1996.
Page
160
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
Décrets
· Décret n°2-96-298 du 30 juin 1996
instituant au profit de l'Office National Interprofessionnel des
Céréales et des Légumineuses une taxe de commercialisation
des céréales et légumineuses et fixant les
modalités de son recouvrement.
· Décret n°2-00-363 du 28 Juin 2000
modifiant le décret n°2-96-298 instituant au profit de l'Office
National Interprofessionnel des Céréales et des
Légumineuses une taxe parafiscale dénommée « Taxe de
commercialisation et de stockage des orges destinées à
l'alimentation animale ».
· Décret n° 2-96-16 du 30 Juin 1996
Modifiant et complétant le décret n° 2-84-839 du 5 rabii II
1405 (28 décembre 1984) instituant au profit de l'Office National
Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses une
taxe parafiscale dénommée « Taxe de commercialisation et de
stockage des orges ».
· Décret n° 2-97-512 du 28 Octobre 1997
Relatif à la caution de bonne exécution des opérations
d'importation des céréales et des légumineuses.
· Décret n°2-08-289 du 8 Décembre
2009 modifiant et complétant le décret n°2-97-5l2 du 25
joumada II 1418(28 octobre 1997), relatif à la caution de bonne
exécution des opérations d'importation des céréales
et des légumineuses.
· Décret n°2-02-327 du 17 Juillet 2002
modifiant le décret n° 2-97-512 du 25 joumada II1418 (28 octobre
1997) relatif à la caution de bonne exécution des
opérations d'importation des céréales et des
légumineuses.
· Décret n° 2-97-52 du 20 Mai 1997 fixant la
liste des laboratoires habilités à effectuer les analyses au
titre de la répression des fraudes.
Page
161
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
Mai 2013
TOUIL Hicham
Lexique en arabe
|
Mouture
|
|
äÍØ
|
|
Office national interprofessionnelle des céréales
et légumineuses
|
íä ÇØÞáÇ
|
æ ÈìÈÍáá
íäåãáÇ
íäØìáÇ
ÉÊßãáÇ
|
|
Organismes stockeurs
|
|
ÉäÒÎã
ÉÓÓÄã
|
|
Fédération nationale des minoteries
|
|
äÍÇØãáá
ÉíäØìáÇ
ÉíÚãÌáÇ
|
|
Coopérative
|
|
ÉíäæÇÚÊ
|
|
Ecrasement
|
|
äÍØ
|
|
Taux d'extraction
|
|
ÌÇÑÎÊÓáÇÇ
ÉÈÓä
|
|
Farine nationale du blé tendre
|
íÑØáÇ
ÍãÞáá
íäØìáÇ
ÞíÞÐáÇ
|
|
Minoterie industrielle
|
|
ÉíÚÇäÕ
ÉäÍØã
|
|
Minoterie artisanale
|
|
ÉíÐíáÞÊ
ÉäÍØã
|
|
Farine
|
|
ÞíÞÏ
|
|
Registre des entrées du blé
|
|
ÍãÞáÇ ÊáÇ
ìÎÐã áÌÓ
|
|
Registre de mouture
|
|
äÍØáÇ
áÌÓ
|
|
Registre de mouvement de produits
|
|
ÌìÊäãáÇ
ÉíßÑÍ áÌÓ
|
|
Contingent
|
|
ÉÕÍ
|
|
Droit de mouture
|
|
äÍØáÇ
ÞìÞÍ
|
Page
162
|
ISCAE- Cycle
d'Expertise Comptable
|
Minoteries industrielles : aspects juridiques,
comptables et
fiscaux et proposition d'une méthodologie
d'audit
|
Mai 2013
TOUIL Hicham
|
Annexes
Annexe 1
Loi n° 12-94 relative à l'Office National
Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses et
à l'organisation du marché des céréales et des
légumineuses.
Annexe 2
Loi n° 17-96 complétant la loi n° 12-94 relative
à l'Office National Interprofessionnel des Céréales et des
Légumineuses et à l'organisation du marché des
céréales et des légumineuses.
Annexe 3
Déclaration d'existence des minoteries industrielles et le
récépissé de dépôt
Annexe 4
Extrait du projet du guide des travaux à réaliser
sur le plan technique.
Annexe 5
Circulaire annuelle de la compagne de collecte du blé
tendre
Page
163
| 


