|
ULG (Université de Liège)
ULG-Arlon
(Université de Liège - Campus d'Arlon)
FUSAGx (Faculté
universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux)
FUCaM (Facultés
universitaires catholiques de Mons)
UCL (Université catholique de
Louvain)
DEA Interuniversitaire en Développement, Environnement
et Sociétés

Dynamique des représentations sociales
de
l'agriculture et de la ruralité dans un contexte territorial
du
vieillissement de la population :
Le cas du « Projet
Nô-Life » de la Ville de Toyota au Japon
Professeurs :
Promoteur : Marc MORMONT (ULG -
Arlon)
Lecteur : Jean-Philippe PEEMANS (UCL)
Lecteur : Andreas THELE
(ULG)
Kenjiro MURAMATSU
Mémoire du DEA
Première impression et dépôt officiel : le
20 août 2007
Deuxième impression (version
révisée) : le 28 septembre 2007
Année académique 2006-2007
Remerciements
Je tiens tout d'abord à remercier le Professeur Marc
MORMONT, promoteur de ce mémoire, pour ses engagement et
intérêt vifs portés à la présente
étude ainsi qu'au terrain étudié. Ses connaissances et
rigueur scientifiques ont donné un corps solide à ce travail de
réflexion. L'apport de ses sincères soutiens ne s'est pas
limité au cadre formel du travail, mais a été une grande
source de motivation et d'inspiration pour continuer et accomplir cette
recherche.
Je tiens à remercier le Professeur Jean-Philippe
PEEMANS, d'avoir accepté d'être lecteur de ce mémoire. Ses
fins et profonds conseils et connaissances ont donné une inspiration
décisive pour ce travail. Je remercie également le Professeur
Andreas THELE, d'avoir accepté d'être lecteur de ce mémoire
ainsi que pour ses encouragements.
C'est grâce à la Bourse pluriannuelle offerte par
la Fondation Rotary au cours des années 2005-2006 et 2006-2007, que
cette étude a pu être réalisée. Je tiens à
exprimer ma sincère gratitude envers le Rotary Club de Seraing et
à ses membres pour leur chaleureux accueil en Belgique. Je tiens
particulièrement à remercier Willy ZORZI, mon conseiller
hôte, pour ses incessants efforts de soutiens apportés à ma
vie pour mener à bien cette étude. Je tiens également
à remercier Okazaki Rotary Club et Shingo Kato, mon conseiller parrain,
pour m'avoir donné l'opportunité de réaliser ces deux ans
d'études en Belgique.
Je tiens à remercier le Professeur Yoshihito SHIMADA,
d'avoir accepté cette tentative d'études euro-japonaises ainsi
que pour ses soutiens et encouragements.
Je tiens à exprimer ma sincère gratitude
à toutes les institutions et les personnes pour avoir répondu
à mes questions et ainsi coopéré à cette recherche.
Je tiens particulièrement à remercier le Centre pour la
Création de Nô-Life de la Ville de Toyota (Toyota-shi
Nô-Life Sôsei Center) et ses employés pour avoir
accepté la réalisation de mes enquêtes sur leur terrain.
Je tiens à remercier la « Ful », à
savoir le Département des sciences et gestion de l'environnement de
l'ULG (ex-Fondation universitaire luxembourgeoise), ainsi que ses personnels
qui m'ont donné un environnement utile et précieux pour mener
à bien ce travail.
Enfin, je tiens à exprimer ma sincère gratitude
à Sarah PIQUETTE pour avoir sans cesse lu et commenté mon
travail. De nombreux ami(e)s ont apporté leurs soutiens d'une
façon ou d'une autre à la réalisation de ce travail, et je
tiens à les en remercier, plus particulièrement la famille
PIQUETTE ainsi que ma famille pour leur solidarité.
A la mémoire de mes deux regrettés
grands-pères décédés au cours de cette
recherche.
Sommaire
REMERCIEMENTS 3
INTRODUCTION : PROBLÉMATIQUE ET
MÉTHODOLOGIE 7
1. PROBLÉMATIQUE 7
Situation de crise permanente de l'agriculture et de la
ruralité au Japon : quelle solution possible ? 7
Contexte particulier : Vieillissement de la population
8
Tendance du « retour à la terre (kinô)
» 8
Implication de la question d'Ikigai 9
Représentations sociales de l'agriculture et de la
ruralité 10
Importance de l'histoire 10
2. MÉTHODOLOGIE 11
Méthode empirique : enquêtes de terrain
11
Méthode théorique : étude des
représentations sociales 13
RÉFÉRENCES 16
CHAPITRE I : EVOLUTION URBAINE ET RURALE DANS LA VILLE DE
TOYOTA APRÈS 1945 18
INTRODUCTION 18
Périodisation en trois décennies après
1945 19
1 INDUSTRIALISATION : NAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DE L'
« AUTOMOBILE TOYOTA » 20
1937 - 1955 : Implantation et développement de
l'Automobile Toyota 20
1955 - 1965 (et après) : Développement de
l'Automobile Toyota 22
2 URBANISATION : NAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DE LA «
VILLE DE TOYOTA » 23
Avant 1945 - 1955 : mutation du Bourg de Koromo et de ses
environs 23
1955 - 1965 : Agrandissement du territoire de la Ville
24
1965 - 1975 : Essor économique et démographique
27
3 EVOLUTION AGRICOLE ET RURALE DANS LA VILLE DE TOYOTA 31
1945-1955 : période de la réforme de
l'après-guerre 31
1955-1965 : Naissance et formation de la Ville de Toyota
35
1965-1975 : période de la Haute croissance
économique 40
4. RÉFLEXIONS 47
RÉFÉRENCES 50
CHAPITRE II : PROCESSUS DE LA CONSTRUCTION DU PROJET
NÔ-LIFE : ÉMERGENCE DE L'AGRICULTURE DE TYPE IKIGAI 52
1. REPRÉSENTATIONS, MODES D'ACTIONS ET PRISE DE POSITION
DES ACTEURS 52
Acteur 1 : Bureau de la Politique Agricole de la
Municipalité de la Ville de Toyota (BPA) 53
Acteur 2 : Section de la Création d'Ikigai dans le
Bureau Education permanente de la Municipalité de la Ville
de Toyota (SCI) 78
Acteur 3 : Direction des Activités agricoles de la
Coopérative agricole de Toyota (CAT) 95
Acteur 4 : Bureau Départemental de la Politique
Agricole (BDPA) 111
Acteur 5 : Section Amélioration - Vulgarisation du
Bureau départemental de l'agriculture, de la forêt et de la
pêche de Toyota-Kamo (Ex-Centre pour l'Orientation et la Vulgarisation
agricoles de Toyota-Kamo : ECV) 122
Acteur 6 : Conseil Local de Toyota de la
Fédération des Syndicats Ouvriers du Département d 'Aichi
(CLFS : Rengô Aichi Toyota Chikyô) 133
Acteur 7 : Groupement d'Arboriculteurs de Sanage pour l'Aide
aux Travaux Agricoles (GA SA TA) 140
2. RÉPONSES AUX QUESTIONS : ANALYSE DU PROCESSUS ENTRE
ACTEURS INSTITUTIONNELS 150
Elaboration de l'ensemble des actions concrètes pour
la construction du Projet Nô -L ife 151
Transformations des représentations de l'agriculture
et de la ruralité 169
L'origine de l'idée centrale du projet : «
`Nô '(l 'agriculture ou la ruralité) en tant qu 'Ikigai (sens de
la vie) » 175
Relation établie entre acteurs 183
RÉFÉRENCES 193
Ouvrages et articles 193
Documentation 194
CHAPITRE III : PROJET NÔ-LIFE À
L'ÉPREUVE DE LA VIE DES STAGIAIRES 198
1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS
DU CENTRE NÔ-LIFE 198
1 Formations Nô-Life : « porteur » et «
culture maraîchère de saison » 198
2 Entremise de terrains agricoles 201
3 Entremise d'emplois agricoles 201
4 Recherche et développement 201
2 STAGIAIRES DE LA FORMATION NÔ-LIFE : TYPOLOGIE ET
REPRÉSENTATIONS 201
Typologie et tendances générales des stagiaires
202
Diversité et dynamique des représentations
213
3 RÉPONSES AUX QUESTIONS 241
1 Quel lien entre les différents types de stagiaires
et les représentations ? 241
2 Positions des stagiaires vis-à-vis de l'idée
du Projet Nô -L ife sur l'agriculture de type Ikigai ? 245
3 Conséquences pour les stagiaires, du compromis entre
les agents gestionnaires 247
4 Compatibilité des éléments de
l'agriculture de type Ikigai aux yeux des acteurs 249
RÉFÉRENCES 256
Ouvrages et articles 256
Documentation 256
CONCLUSION 257
RAPPEL DES ANALYSES 257
Chapitre 1 257
Chapitre 2 259
Chapitre 3 260
PERSPECTIVES 263
Agriculture de type Ikigai dans le contexte
général : un indice de transformation 263
Importance de la dimension territoriale 264
Projet Nô -Life : possibilités et limites
264
Généralisation ou particularisation ?
265
BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 266
ANNEXES 269
Introduction : Problématique et
méthodologie
1. Problématique
Situation de crise permanente de l'agriculture et de la
ruralité au Japon : quelle solution possible ?
Situation de crise permanente de l'agriculture et de la
ruralité au Japon. Par quoi peut-on commencer ?
Du point de vue historique. Le capitalisme industriel
écrasant l'agriculture et absorbant la paysannerie ? L'exode ? La
montée en puissance de l'économie de marché
privilégiant les propriétaires terriens et renforçant
l'écart entre ceux-ci et les fermiers avant la Réforme agraire ?
Nous pouvons au moins remonter jusqu'en 1868, l'industrialisation et la
montée en puissance de l'économie de marché1 :
la Restauration de Meiji a ouvert le pays au système-monde après
260 ans de Fermeture du pays (Sakoku), face à la grande menace de
puissances occidentales. Certes, la paupérisation de la campagne et la
prolétarisation des paysans ont bien eu lieu dans une longue
durée de l'histoire moderne du pays.
En bref, ce phénomène a dû durer au moins
jusqu'à la réalisation de la Haute croissance économique
entre 1955 et 1975 où la disparité économique entre les
couches urbaines et rurales fut stabilisée via une transformation de la
main-d'oeuvre agricole en une population agricole en majorité
pluriactive et « stable » au sens des revenus des ménages.
Mais, le paradoxe est bien connu : la grande majorité des agriculteurs
japonais gagnent une grande partie de leur revenu en travaillant en tant que
salarié non agricole2. Cette situation de
pluriactivité généralisée depuis les années
60, rend la situation de l'agriculture japonaise ainsi que notre
problématique tout-à-fait ambigües.
Du point de vue géographique, la situation de crise de
l'agriculture est avant tout due à sa condition naturelle
défavorable, à la modernisation telle qu'elle est toujours
préconisée par la politique agricole par référence
à la logique de marché, à la productivité
équivalente de celle de l'industrie etc3.
1 Tout ceci en sachant que le progrès économique
était de 1639 à 1868 (époque d'Edo) assez constant et
considérable au Japon : ainsi F. Braudel met l'accent sur le fait que,
dans cette période, « (...) augmentation de la population,
évidente montée de la production du riz, mise en place de
nouvelles cultures... Les villes s'agrandissent. Au XVIIIème
siècle, Yédo compte au moins un million d'habitants. Cette
accélération générale de l'économie ne
serait pas possible sans un surplus de production agricole, notamment de riz,
à jeter sur le marché citadin, sans la facilité avec
laquelle le grain se conserve et se transporte, sans la possibilité de
mettre à la disposition des villes un combustible, le charbon de bois,
en quantité suffisante. » (Braudel, 1993 : 334) Enfin, il
conclut que « (...), avant 1868, un mouvement vif de la vie japonaise,
une relance économique qui a créé, dès le
XVIIIème siècle, un pré-capitalisme actif, prêt
à s'épanouir. Avec le XIXème siècle, le mouvement
se précipite encore : l'ère de Meiji serait
incompréhensible sans ces transferts et ces mises en place
antérieurs, sans cette préalable accumulation de moyens
économiques et de capitaux, sans les milles tensions sociales qui en
résultent. » (Ibid. : 335).
2 Selon la statistique officielle, en 2005, il y avait au Japon 2
840 000 « foyers agricoles (Nôka) » possédant plus de
0.1ha de terrains agricoles et dégageant un chiffre d'affaires annuel de
150 000 yens (près de 1000 euros) au Japon. Dont 1 950 000 « foyers
agricoles vendeurs » possédant plus de 0.3ha de terrains agricoles
et dégageant un chiffre d'affaires annuel de 500 000 yens (près
de 3333 euros). Et il y avait également 430 000 « foyers agricoles
dont l'agriculture est le métier principal », soit 15% du nombre
total des foyers agricoles, qui obtiennent leur revenu principal via leur
production agricole et dans lesquels plus d'un membre de moins de 65ans
travaille plus de 60j ours par an pour leur production agricole
(Nôrinsuisan-shô, 2005).
3 Citons encore la remarque générale de F. Braudel
sur l'agriculture japonaise qui fait « obstacle » à son
capitalisme : « (...) il ne faut pas oublier aussi que la
réforme agraire a créé une nuée de
micro-propriétaires, les plus petits asservis aux moins
défavorisés, et tous sont incapables de se grouper et surtout de
laisser la place libre à une agriculture moderne et scientifique
» ; « (...), le Japon qui vit avec une population à peu
près double de celle de la France sur un territoire, en gros,
moitié moins étendu (300 000 contre 550 000 km2) et
où la terre arable représente 15% de la surface contre 84% chez
nous, le Japon n 'a que de misérables
Du point de vue sociologique au sens classique, nous
semble-t-il, les communautés rurales basées sur les petites
productions familiales s'opposant au mode de production capitaliste ou à
la logique de l'urbanisation ne constituent plus un objet pertinent de
recherche. Ceci rien qu'en raison de la situation de pluriactivité
généralisée où les agriculteurs assimilent bien le
système industriel et urbain tout en restant responsables de leurs
petites productions familiales. Dans ce contexte, plutôt devrait-on
parler du dilemme de cette population : il doit être complexe avec les
aspects familiaux (transmission), fonciers (impôt) et de la production
agricole qui peuvent être à la fois des contraintes et des
opportunités, en fonction des façons individuelles d'articuler
toutes ces préoccupations de type différent pour gérer
leurs biens agricoles familiaux. Un exemple simple : la transmission des
terrains agricoles peut être une bonne chose du point de vue de la valeur
familiale, mais ceci risque d'imposer des contraintes économiques
lourdes aux générations futures avec l'obligation du paiement des
taxes foncières. Ainsi, la vente de ces terrains ou une mise en valeur
de manière non agricole (exemples fréquents : location
d'appartements ou de parkings) de ces terrains peuvent constituer un bon choix
pour la famille.
En tout cas, à partir du moment où la question
doit se poser au niveau de la vie individuelle, notre perspective doit
être renversée : au lieu de se poser la question sur la crise de
l'agriculture et de la ruralité de manière
générale, il faut repenser les apports spécifiques de
celles-ci pour chaque individu et les groupes sociaux diversifiés
auxquels cet individu appartient dans des contextes contemporains qui sont de
plus en plus complexes, multiples et particuliers. Ce qui nous oblige à
mettre entre parenthèse la question et le problème
généraux sur la situation de crise, et ensuite à aborder
des contextes particuliers où la signification de l'agriculture ou de la
ruralité peut avoir un certain poids au sein de divers acteurs et de
leurs objets.
Contexte particulier : Vieillissement de la
population
C'est pouquoi notre présente étude va
s'intéresser à un cas particulier du Japon contemporain, qui nous
semble intéressant à étudier en terme de nouvelles formes
d'articulation de l'agriculture et de la ruralité dans un cadre à
la fois individuel et collectif, mais également politique et
économique, qui s'inscrit dans un contexte nouveau et marquant la
société japonaise actuelle : celui du vieillissement de la
population.
Ne recommençons pas à parler des crises ou des
risques que ce phénomène peut impliquer dans la
société de manière générale4 - ce
qui nous amènera au même raisonnement que ce que nous venons de
faire plus haut -. Mais, ce contexte nous intéresse dans la mesure
où il impose aux individus et à la société
d'adopter de nouveaux modes de penser, d'agir et de communiquer dans la vie
réelle. Ceci touche, face à l'affaiblissement du corps humain qui
est le premier symptôme du vieillissement, les multiples niveaux de la
vie qui sont liés les uns aux autres de manière complexe - en
tout cas dans la société japonaise industrialisée et
post-industrielle -, soit individuel, soit collectif, soit politique, soit
économique, soit local, soit régional, soit national etc. Nous
aborderons donc dans les prochains chapitres les diverses
problématisations concrètes du vieillessement
opérées par les différents types d'acteurs
concernés par le cas étudié.
Tendance du « retour à la terre (kinô)
»
ressources naturelles. L'industrie ne travaille qu'avec la
laine, le coton, le charbon, le minerai de fer, le pétrole
importés. » (Braudel, 1993 : 341.)
4 Certes, intégrer le vieillissement pèse
aujourd'hui au Japon comme un grand défi à la vie des japonais
à tous les niveaux de la société : au niveau national,
perte de la main-d'oeuvre pour la croissance économique et augmentation
du coût de la redistribution : sécurités sociales et
services publics ; au niveau régional, gestion publique de la
redistribution de plus en plus
décentralisée, crise de transmission
d'activités économiques à faible rentabilité (PME,
petits commerçants et artisans, agriculteurs, forestiers, pêcheurs
etc.) ; niveau de la vie locale, santé, habitation, changements dans les
liens sociaux, communautaires, familiaux etc.) D'ailleurs, l'agriculture et la
ruralité ont déjà connu ce problème bien avant la
population urbaine.
Ici, nous évoquons juste un aspect
général dans lequel notre présente étude de cas
peut s'inscrire : celui d'une vague du « retour à la terre des
retraités salariés (teinen kinô) » qui s'est de plus
en plus accentuée au cours de ces dernières années au
Japon. Ce phénomène concerne à la fois le monde agricole
et le monde des citoyens en général.
Concernant le monde agricole, il est en rapport avec la
situation de pluriactivité généralisée. Il s'agit
de retraités salariés dont le nombre est grandissant surtout pour
ceux de la génération baby-boom, qui étaient soit
déjà en réalité des agriculteurs pluriactifs
(quelque soit le niveau de leur production), soit des fils d'agriculteurs,
partis travailler puis s'installer dans d'autres régions (autres que
leur région natale), tout en restant successeurs de leurs terrains
agricoles familiaux, soit les épouses de ces derniers qu'elles aient
auparavant été femmes au foyer ou non. Aujourd'hui, ce type de
population est de plus en plus considérée comme « porteur
» de l'agriculture potentiellement importants dans une situation de crise
agricole permanente où la diminution du nombre d''agriculteurs continue,
en s'accompagant d'un manque permanent d'installation de jeunes
agriculteurs5. Du moins, ceci est présent dans les discours
officiels de la politique agricole actuelle6. Ceci malgré
l'incertitude que cette population implique, car la motivation et la
compétence des individus peuvent varier chez les uns et les autres.
(Faut-il ici rappeler la question de la vie individuelle ?)
Du côté du monde des citoyens en
général, il s'agit également des retraités de la
génération baby-boom qui sont à la recherche de nouveaux
modes de vie différents de celui du type salarial et urbain. L'acte de
cultiver la terre peut, bien au-delà d'un simple loisir, avoir des
effets et des intérêts multiples pour la population
essentiellement non agricole et rurale, tels que : plaisir de récolter
et de consommer sa propre production ; vie au rythme de la nature ;
santé physique et mentale ; sociabilité ; possibilité
éventuelle d'avoir un revenu supplémentaire etc. C'est en fait
dans ce sens-là que la notion d' « Ikigai » (nous
l'expliquerons plus bas) est pleinement employée dans notre cas du
« Projet Nô-Life », une action publique organisée par la
Municipalité de la Ville de Toyota depuis 2004 en collaboration avec la
Coopérative agricole de Toyota, qui consiste à promouvoir une
nouvelle installation agricole des citoyens en majorité salariale et
urbaine et notamment les nouveaux retraités salariés de la
génération baby-boom. Là, la visée est de
développer un nouveau type d'activités agricoles s'inscrivant
dans ce contexte expliqué plus haut du vieillissement et de la tendance
de retour à la terre de nouveaux retraités, qui concerne à
la fois le vieillissement de la population générale et le
problème du monde agricole japonais, et ainsi de faire face à la
crise agricole locale représentée par le manque de producteurs et
l'augmentation de friches agricoles (délabrement).
Implication de la question d'Ikigai
Ikigai est un terme japonais spécifique
désignant littéralement le « sens de la vie » qui
imprègne fortement le sens commun des japonais. Ceci pouvant aller tant
au niveau de l'interrogation philosophique individuelle « Pourquoi vis-je
? » ou « A quoi sert ma vie ? », qu'au niveau politique et
économique « Pourquoi travaille-t-on ? » ou « A quoi sert
de l'argent si on n'a pas d'Ikigai ? »7.
5 De 2000 à 2005, la population agricole active a
diminué de 14.2% (de 3 890 000 à 3 338 000). (Source : Livre
Blanc de l'Agriculture de 2005)
6 L'Etat japonais prête attention aujourd'hui à
cette tendance en terme de main-d'oeurve agricole : « Ces dernières
années, la question est de plus en plus grandissante sur l'influence
socio-économique de la retraite massive de la génération
baby-boom qui constitue la plus grande partie dans la structure
démographique japonaise. Concernant les membres des foyers agricoles,
c'est la génération des 50-54 ans qui constitue la plus grande
partie de la population. (...) Désormais, nous nous attacherons au
mouvement de cette population ainsi qu'aux personnes originaires d'un foyer
agricole travaillant en s'installant ailleurs que leur foyer natal. »
7 Cependant, il est difficile de trouver de terme
équivalent dans les autres langues : Kôken SASAKI, sociologue
japonais et grand spécialiste de E. Durkheim, relève ainsi dans
un récent ouvrage collectif franco-japonais sur le vieillissement
(publié en français) « (...) il ne semble pas exister de
terme équivalent dans les langues occidentales ou les autres langues
asiatiques. Bien que les expressions françaises `joie de vivre' ou
`raison d'être' soient assez proches du point de vue du sens, elles
appartiennent à un registre philosophique et abstrait et sont ainsi
dénuées des connotations d' `ikigai', qui se réfère
directement à la vie
quotidienne. ». Selon lui, « ce terme est
utilisé dans des contextes où l'on souligne le lien entre
l'individu et la société » (Sasaki, 2004 : 119).
Le terme Ikigai apparaît dans notre étude du
processus du Projet Nô-Life comme un outil par excellence de penser,
d'agir et de communiquer tant pour les acteurs individuels que pour les acteurs
institutionnels gestionnaires du Projet. Par exemple, au niveau politique, ce
terme apparaît tantôt comme une thématique légitime
de la politique municipale pour les personnes âgées avec une
approche intégrant le thème du « vieillissement actif
», tantôt, pour la politique agricole locale, comme une
catégorie de producteurs/trices agricoles qui sont dynamiques mais ne
s'inscrivent pas dans la catégorie des agriculteurs professionnels,
comme par exemple des femmes ou des hommes âgés de foyers
agricoles pluriactifs « dynamiques » qui arrivent à
commercialiser leur production à court circuit en dehors du grand
marché. Concernant le niveau individuel, les approches deviennent
évidemment plus diverses, et le contenu du terme est beaucoup moins
clairement défini qu'au niveau politique.
L'intérêt de la présente étude est
d'étudier les représentations, les actions et les pratiques qui
sont mises en relation au travers de cette notion d'Ikigai ainsi
mobilisée dans le contexte du vieillissement, à l'égard de
l'agriculture et de la ruralité. Quelles nouvelles significations de
l'agriculture et de la ruralité peuvent naître dans un tel
contexte particulier ? Telle est donc notre question de recherche de
départ.
Représentations sociales de l'agriculture et de la
ruralité
Pour répondre à cette question, nous ne pouvons
pas dissocier les représentations, les actions et les pratiques des
acteurs individuels et institutionnels, de leur relation sociale dans laquelle
ils doivent ou veulent jouer. Autrement dit, nous ne pouvons pas les isoler en
les juxtaposant les uns aux autres, pour analyser la signification collective
et le processus d'émergence ou de construction de celle-ci.
C'est dans ce sens-là que nous introduisons d'abord
comme approche analytique de base la notion des « représentations
sociales » qui nous permettront d'étudier les
réprésentations dans la relation sociale que tisse les
différents types d'acteurs au travers de leurs propres actions et
pratiques. Nous présenterons plus bas cette approche en essayant
d'articuler ces quelques éléments théoriques pour la
rendre « opérationnelle » dans notre analyse.
Ensuite, dans les chapitres 3 et 4, nous mobiliserons quelques
points de vue anthropologiques et sociologiques tels que le « bricolage
», la « transaction sociale » et d'autres, dans notre analyse
des modes d'actions et la dynamique des relations sociales au sein de
différents types d'acteurs, à partir desquels nous essaierons
d'éclairer le processus des représentations, et inversement.
L'articulation possible de ces différents concepts sera
à l'épreuve de la réalité décrite dans notre
étude de cas. Ensuite, nous ne limitons pas la portée de notre
approche théorique au côté explicatif et
compréhensif qui nous permettrait d' « éclairer » la
réalité sociale et locale en réorganisant les
éléments de faits, mais également d'une approche
d'intervention qui nous permetterait de revenir à cette
réalité faisant l'objet de notre compréhension, au cours
de laquelle nous essaierons de relever de nouveaux problèmes et
solutions. C'est pourquoi, à la fin du chapitre 3, nous avons
essayé de formuler quelques propositions concrètes pour
améliorer la situation du Projet étudié.
Importance de l'histoire
Dans cette étude, nous accordons une grande importance
à l'histoire. A notre égard, le point de vue historique est
important dans deux sens. D'abord, dans le sens de la « longue
durée » telle qu'elle fut proposée par F. Braudel. Ceci
d'autant plus que notre recherche basée sur l'observation de terrain
ethnographique et sociologique risque toujours d'ignorer le temps long de la
réalité sociale et locale à force de s'intéresser
au
« papillottement » de faits vifs que nous pouvons
observer sur l'instant ou le court terme8. Notre objectif de
recherche n'est pas de relever la particularité historique et culturelle
de notre objet de recherche, mais un tel point de vue nous permettra
d'éviter de recourrir à la généralisation
immédiate de nos analyses et réflexions sur un cas particulier,
et ensuite d'avoir davantage de possibilités de mieux comprendre
l'objet, ainsi que de le comparer ultérieurement à d'autres cas
particuliers9. Ainsi, dans le chapitre 1, nous essaierons par
recontextualiser le cas étudié, en l'inscrivant dans une longue
durée de l'histoire locale de la Ville de Toyota. Il s'agit de
l'histoire du développement de la Ville de Toyota après 1945, qui
est marquée par un mode d'évolution spécifique et complexe
entre l'industrialisation, l'urbanisation et la mutation agricole et rurale.
Puis, l'histoire nous préoccupe également au
niveau des acteurs et de leur relation. Il s'agit de la « trajectoire
sociale » ou de l' « ancrage » des représentations qui
donne toujours un sens important à la dynamique actuelle. Ceci rien
qu'au niveau des connaissances et des expériences antérieures qui
déterminent toujours les éléments de moyens disponibles et
« présents » pour un acteur. De ce point de vue-là,
nous pourrons mieux comprendre les spécificités des
représentations, actions et relations sociales au sein de
différents types d'acteurs. Nous devrons ainsi comprendre pourquoi et
comment les acteurs essaient de produire ou reproduire leurs objets. Ainsi,
dans les chapitres 2 et 3, nous nous attacherons à décrire les
trajectoires de chacun des acteurs institutionnels (chapitre 2) et individuels
(chapitre 3).
2. Méthodologie
Nous présenterons ici notre méthodologie
à deux niveaux : empirique et théorique. Au niveau empirique,
nous expliquerons brièvement le déroulement des deux
enquêtes de terrain, dont le première a consisté en une
observation participante à long terme (six mois) effectuée sur
les formations agricoles données dans le Projet Nô-Life. La
deuxième a consisté en des entretiens intensifs et individuels
effectués auprès d'une trentaine d'acteurs institutionnels et
individuels concernés par le Projet Nô-Life.
Au niveau théorique, nous présenterons comment
nous appliquerons l'approche des représentations sociales comme
démarche d'analyse. Dans la présente étude, nous
essaierons d'articuler l'approche des représentations sociales avec
d'autres approches conceptuelles en anthropologie et en sociologie. Chacune de
ces approches sera présentée dans le chapitre 2 en sorte qu'elles
soient mieux adaptées à leurs contextes d'application.
Méthode empirique : enquêtes de
terrain
L'enquête de terrain a été effectuée
en deux phases. La première enquête, de mars à septembre
2005, a consisté en une observation participante de la formation offerte
par le Projet. Et la deuxième, durant un mois en
8 Braudel a ainsi préconisé : « les autres
sciences sociales sont assez mal informées et leur tendance est de
méconnaître, en même temps que les autres travaux des
historiens, un aspect de la réalité sociale dont l'histoire est
bonne servante, sinon toujours habile vendeuse : cette durée sociale,
ces temps multiples et contradictoires de la vie des hommes, qui n'osent pas
seulement la substance du passé, mais aussi l'étoffe de la vie
sociale actuelle. (...) ; rien n'étant plus important, d'après
nous, au centre de la réalité sociale, que cette opposition vive,
intime, répétée indéfiniment, entre l'instant et le
temps lent à s'écouler. Qu'il s'agisse du passé ou de
l'actualité, une conscience nette de cette pluralité du temps
social est indispenable à une méthodologie commune des sciences
de l'homme. » (Braudel, 1969 : 43)
9 Par exemple, les agricultures française et japonaise. Il
serait vain de les comparer uniquement sur la base d'une observation sur le
présent ou le court terme sans se référer au temp long
dans lequel s'inscrivant ces deux objets. Déjà, en Europe
occidentale, pouvons-nous trouver une situation de pluriactivité
généralisée telle qu'elle existe déjà au
Japon ? De plus, dans ce cas précis s'ajoute la notion d'Ikigai qui est
spécifiquement japonaise.
2006, a consisté en des entretiens intensifs et
individuels avec des acteurs institutionnels et individuels concernés
par le Projet.
Première enquête : observation participante
Dans la première enquête, l'enquêteur
(rédacteur du présent mémoire), a pleinement
participé aux formations offertes par le Projet en tant que stagiaire et
individu ayant le même statut que les autres stagiaires. Les principaux
enquêtés, objets directs de l'observation, étaient une
trentaine de stagiaires des années 2005-2007. Les stagiaires des
années 2004-2006, premiers stagiaires de la formation Nô-Life,
sont exclus de notre observation directe. La période de cette
enquête correspond au premier quart de la totalité de la formation
des stagiaires des années 2005-2007. L'enquêteur a suivi toutes
les formations divisées en trois filières : culture
maraîchère ; cultures maraîchère et rizicole ;
culture fruitirère. Une trentaine de stagiaires étaient
répartis dans ces trois filières. Les cours théoriques et
pratiques sont donnés par filière une fois par semaine de 9h
à 12h (sauf les cours exceptionnels donnés par exemple lors des
périodes des récoltes).
Cette participation avait préalablement
été autorisée par l'organisme gestionnaire du Projet, le
« Centre Nô-Life », dont le nom officiel est « Toyota-shi
Nô-Life Sôsei Center (Centre pour la Création de la Vie
rurale de la Ville de Toyota) », auquel l'enquêteur avait
présenté son objectif de recherche.
Par ailleurs, l'enquêteur a effectué une
enquête par questionnaire auprès des stagiaires des années
2004-2006 et 2005-2007. Le questionnaire a été distribué
au total à 69 stagiaires de manière anonyme. 50 réponses,
soit un taux de récupération de 72 %, ont été
récoltées. Ce questionnaire contenait 24 points visant à
saisir le profil, les motifs pour la participation à la formation, les
perspectives des stagiaires pendant et après la formation
etc10.
Apports de la première enquête
Cette première enquête nous a permis d'avoir un
certain degré d'interconnaissance, d'intimité et de confiance
avec les enquêtés(es) ainsi que les personnels du Centre
Nô-Life (trois permanents et deux temporaires, pour certains
employés de la Municipalité de Toyota et pour d'autres
employés de la Coopérative agricole de Toyota). Cette
enquête nous a également permis d'observer concrètement la
situation intérieure du Projet. Puis, le caractère
personnalisé de la relation enquêteur - enquêté(e)
mentionné nous a permis d'aborder certains aspects subjectifs et
personnels des acteurs.
Limites de la première enquête
Cependant, nous pouvons relever certaines limites de cette
enquête en deux points suivants : le premier est dû au
caractère « clos » du déroulement de l'enquête.
En effet, l'enquêteur se cantonnait aux activités de la formation
offertes par le projet, ce qui a limité la portée de notre
observation aux acteurs intérieurs du Projet : stagiaires et personnels
du Centre Nô-Life. Les acteurs extérieurs au projet, comme les
agents concernés au sein des autres institutions n'ont pas
été recensés ; le second point réside dans le
caractère collectif de l'enquête. En fait, la participation de
l'enquêteur au Projet et la distribution du questionnaire de
manière anonyme ne nous ont pas permis d'aborder de manière
approfondie les aspects individuels et personnels des acteurs. Notamment le cas
des stagiaires dont le profil et les motifs de participation au Projet se sont
avérés très divers suite au résultat de
l'enquête par questionnaire.
La deuxième enquête : entretiens intensifs et
individuels
Afin de pallier à ces deux défauts, la
deuxième enquête à court terme (pendant un mois) a
été effectuée en octobre 2006 auprès des divers
acteurs intérieurs et extérieurs concernés par le Projet.
Cette enquête a été menée sous forme d'entretiens
intensifs et individuels auprès d'une trentraine d'acteurs
institutionnels et individuels.
10 Pour le détail du questionnaire, voir l'annexe 1.
L'analyse du résultat de cette enquête sera
présentée dans le chapitre 3.
Ces entretiens ont été enregistrés et
dactylographiés en intégralité. Deux types de questions
ont été posées aux acteurs : questions communes à
tous les acteurs ; questions particulières à certains acteurs
spécifiques. Nous avons intégré dans les annexe 2 et 3, la
liste des questions posées lors des entretiens ainsi que la
synthèse du résultat de cette enquête par entretiens.
Méthode théorique : étude des
représentations sociales
L'intérêt de la présente étude est
d'étudier les représentations, les actions et les pratiques
à l'égard de l'agriculture et de la ruralité, dans un
contexte particulier qui est celui du vieillissement.
Notre approche globale est interdisciplinaire en articulant
notamment l'hitoire, l'anthropologie et la sociologie. Donc notre
éventail de concepts d'analyse ne relève ni d'une seule
discipline, ni d'une seule théorie, ni d'un seul courant. L'approche des
« représentations sociales », relevant de la phychologie
sociale francophone, se situe à notre égard « à la
croisée » de l'histoire, de l'anthropologie, de la sociologie et de
la phychologie. Nous l'appliquons dans cette étude comme démarche
d'analyse susceptible d'englober ces différentes approches
disciplinaires.
Représentations et dynamiques sociales dans un contexte
spécifique
Pour éclairer les caractéristiques de l'approche
des représentations sociales, nous pouvons nous référer
à quelques articles montrant des appplications concrètes sur des
contextes spécifiques de cette approche.
L'article de C. Garnier et L. Sauvé11 montre
un mode d'application de la théorie des représentations sociales
dans une recherche empirique sur un contexte spécifique qui est celui de
l'éducation de l'environnement. Par contre, celui de B.
Fraysse12 cherche des liens entre l'identité et les
représentations chez les élèves de la formation
professionnelle d'ingénieurs. Ces deux articles portent sur
l'application de cette approche sur des contextes spécifiques et
concrets. Si le premier porte un intérêt à la fois
compréhensif et pragmatique en essayant de montrer dans quelle mesure
l'approche des représentations sociales pent être pertinente pour
décrire, expliquer (ou comprendre) son objet de recherche et ensuite
élaborer une stratégie d'intervention, le second porte
plutôt un intérêt purement analytique sur son objet de
recherche et s'attache à montrer sa compéhension de cet objet.
Notre démarche rejoint surtout l'approche
présentée par le premier article, qui nous semble plus
adaptée et opérationnelle pour notre étude de cas du
Projet Nô-Life. Car dans notre recherche, en partant d'une description
historique et ethnographique des enjeux des acteurs, nous nous attacherons
également à donner une analyse compréhensive et à
en relever les problèmes et contradictions, et ensuite à proposer
des solutions possibles.
La théorie des représentations sociales a
été développée « en Europe francophone au
cours des trois dernières décennies13 » par de
nombreux phychologues sociaux dont notamment S. Moscovici, D. Jodelet, W. Doise
et J-Cl. Albric etc. Mais elle ne constitue pas pour autant « une
théorie unifiée », mais « un ensemble de perspectives
théoriques qui sont apparues à la croisée de la sociologie
et de la phychologie14 ».
Soulignons quelques caractéristiques de la notion des
représentations sociales. D'abord, une représentation peut
déjà comprendre des éléments de types
extrêmement divers et complexes. Ainsi, étant un «
phénomène mental », elle « correspond à un
ensemble plus ou moins conscient, organisé et cohérent,
d'éléments cognitifs, affectifs et du domaine des valeurs
concernant un objectif particulier appréhendé par un
sujet15 ». Et la notion
11 Garnier et Sauvé, 1998.
12 Fraysse, 2000.
13 Garnier et Sauvé, 1998 : 66.
14 Ibid.
15 Ibid. : 66. Et on peut même y trouver « des
éléments conceptuels, des attitudes, des valeurs, des images
mentales, des connotations, des associations, etc. C'est un univers symbolique,
culturellement déterminé, où se forgent les
théories spontanées, les opinions, les préjugés,
les décisions d'actions, etc. » (Ibid.)
des représentations sociales est non seulement de simples
représentations produites par un sujet à l'égard d'un
objet, mais également des éléments constitutifs de «
processus sociocognitifs16 ».
En fait, l'approche des représentations sociales est
d'étudier les représentations en relation avec les objets sociaux
et la dynamique des rapports sociaux dans lesquels les sujets agissent,
interagissent et se communiquent. Et la relation entre une
représentation, son objet, son sujet et ses rapports sociaux n'est pas
figée, mais interactive voire interdépendante. Ainsi, « une
représentation se construit, se déconstruit, se reconstruit, se
structure et évolue au coeur de l'interaction avec l'objet
appréhendé, alors même que l'interaction avec l'objet est
déterminée par la représentation que le sujet en
construit17». W. Doise souligne ainsi que « la dynamique
d'élaboration des représentations est intimement
entremêlée à la dynamique des rapports sociaux18
».
L'approche devient donc nécessairement systèmique
mais non causale, c'est-à-dire que les représentations sociales
sont indissociables du discours et de la pratique, et qu'ils forment un «
tout19 ».
S'agissant d'un contexte spécifique (comme
l'environnement et la santé chez C. Garnier et L. Sauvé), cette
approche éclaire le « caractère socialement construit des
représentations20 » dans ce contexte donné.
Autrement dit, selon la théorie des représentations sociales,
« toute représentation portée par un individu est
socialement construite21 ».
Représentations comme instruments cognitifs et
intellectuels
Selon B. Fraisse, qui s'attache surtout à la dimension
individuelle en recherchant la relation entre les représentations et le
processus d'apprentisage individuel et interindividuel ainsi que la
construction identitaire, les représentations sont définies comme
des « modes spécifiques de connaissances du réel qui
permettent aux individus d'agir et de communiquer22 ».
Les représentations sociales peuvent être de
véritables instruments congnitifs et intellectuels pour l'acteur.
Ensuite, celui-ci s'en sert pour communiquer à partir des
réalités « ayant le statut de représentations »,
et ainsi reconstruit le lien entre ses représentations et les
réalités23. Donc, dans la dimension individuelle, les
représentations peuvent se comprendre comme éléments du
processus particulier de construction - reconstruction des connaissances de la
réalité24.
Objectivation et ancrage : deux processus fondamentaux
L'approche des représentations sociales ne se contente
pas d'étudier les contenus représentationnels, mais consiste
à analyser la structure génératrice de ceux-ci à
travers l'action, la communication et la relation sociale des
sujets25.
Deux processus fondamentaux initialement définis par S.
Moscovici marquent l'approche des représentations sociales :
objectivation et ancrage26. Selon nous, ces deux processus
désignent la relation réciproque entre les représentations
et la réalité sociale et spatio-temporelle. D. Jodelet
caractérise ces deux processus ainsi :
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Doise et al. (1992), cité par Garnier et Sauvé,
1997 : 67
19 Ibid. : 67.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Fraysse, 2000 : 651.
23 Ibid.
24 Sur ce point, la notion du bricolage semble avoir une
proximité, dans le sens où le bricoleur construit son oeuvre
(représentation) à partir d'un objet existant
(réalité et en reconstruit une autre au moyen de sa construction
antérieure. Nous emploierons ce terme dans les chapitres 2 et 3 dans
notre analyse du mode d'action des acteurs.
25 « la théorie des représentations sociales a
été construite autour de la notion de système. Bien
au-delà de l'étude des contenus représentationnels, la
recherche sur les représentations sociales vise à mettre en
évidence les structures organisatrices de ces
contenus » (Garnier et Sauvé, 1997 : 68)
26 Moscovici, 1961 ; 1976, cité par Garnier et
Sauvé, 1997 : 69.
Schéma : mondes représentationnel et
réel
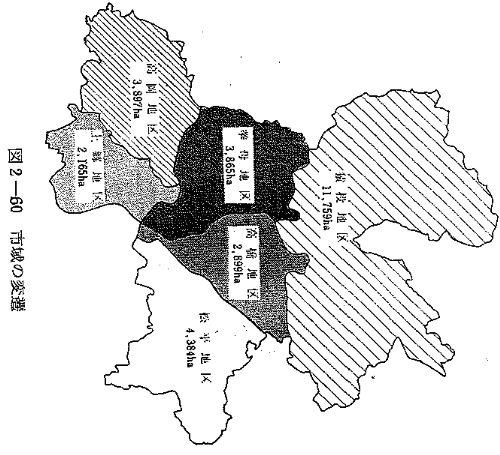
Monde réel
: Interaction
Monde représentationnel
Ancrage
Objectivation
Objet (réel)
Objet (réel)
Objet (réel)
Relation sociale
Représentation Représentation Représentation
Représentation
Sujet Sujet Sujet Sujet
- « l'objectivation correspond à une
sélection d'éléments d'un objet appréhendé
et à la construction d'un schéma organisationnel de ces
éléments (remodelage) en une image concrète,
préhensible, qui facilite la communication au sein du groupe à
propos de l'objet en question. »
- « l'ancrage enracine la représentation de
l'objet dans un réseau de savoirs antérieurs et de significations
au sein du groupe, et permet de le situer par rapport aux valeurs sociales ;
l'ancrage confère également une valeur fonctionnelle à la
représentation pour l'interprétation et la gestion de
l'environnement27 ».
Notre cadre d'analyse va donc se baser sur le schéma
ci-dessus. La relation (ou la frontière) entre le monde réel et
le monde représentationnel ne peut pas être figée ni
séparée, mais est indissociable et cyclique. Car nous avons dit
plus haut que la représentation n'est pas seulement un produit
figé, mais un processus. Avec ce schéma, nous avons essayé
de présupposer la relation dialectique entre les représentations,
les actions et la relation sociale.
Ce présent schéma n'est ni un modèle
théorique figé, ni définitif. Il n'est qu'un cadre
d'analyse de base que nous supposons comme point de départ, à
partir duquel nous devrons explorer et appréhender la complexité
et la diversité de la réalité sociale et locale.
Démarche : description, explication et stratégie
d'intervention
Ensuite, la perspective de recherche présentée
par C. Garnier et L. Sauvé va plus loin avec l'approche des
représentations sociales en inscrivant celle-ci dans une démarche
constituée par les trois étapes suivantes : description -
explication - stratégie d'intervention.
Si c'est l'environnement qui constitue un objet social et
politique dans la recherche de ces auteurs28, dans notre recherche,
il s'agit de l'agriculture et de la ruralité dans un contexte local et
japonais du vieillissement de la population, qui constituent également
un objet social et politique. Et l'intérêt fondamental de la
théorie des représentations sociales pour l'intervention, est que
les représentations « orientent la communication sociale et
27 Jodelet, 1989 cité par Garnier et Sauvé, 1997 :
69
28 Ibid. ; 69.
servent de guide pour l'action29 » comme «
processus de décodage et grille de lecture de la
réalité30 ».
Et l'étude des représentations sociales peut
contribuer à éclairer « la dynamique des rapports entre la
personne, le groupe social31 » et son objet. Et « elle
peut aider à saisir le caractère systèmique et complexe
des enjeux liés aux questions », et « à mieux
comprendre les dynamiques menant à la prise de position des
différents acteurs et celles qui régissent les conflits entre
groupes sociaux32 ». Les auteurs soulignent qu'« une telle
compréhension est indispensable pour planifier des interventions visant
à résoudre des problèmes ou pour concevoir des projets
socialement viables33 ».
En rejoignant cette position à la fois
compréhensive et pragmatique de ces auteurs, notre analyse
procèdera d'abord à une description basée sur une
enquête historique, ethnographique et sociologique de la
réalité complexe dans laquelle agissent, interagissent,
communiquent et se positionnent les acteurs qui se différencient tant au
niveau de l'échelle (institutionnel, groupe, individuel) qu'au niveau
des champs sociaux. Et ceci dans un contexte particulier au Projet
Nô-Life.
Ensuite, nous essaierons de dégager un ensemble
représentationnel dans lequel divers types de représentations se
situent autour d'un objet en question dans le contexte étudié. Il
s'agit d'étudier l' « ensemble que constitue le réseau
représentationnel dans lequel s'insère une représentation
particulière ». C. Garnier et L. Sauvé évoquent que
cette représentation particulière d'un objet (ex. environnement)
entretient des liens avec celles de différents types d'objets (ex.
santé et corps chez les jeunes enfants)34. Dans notre
recherche, nous le verrons dans le Chapitre 2, nous avons relevé trois
objets qui entrent dans l'ensemble représentationnel dans le processus
de la construction du Projet Nô-Life. Il s'agit de la qualité de
vie, du lien social et territorial et la production matérielle qui sont
mis en relation avec l'objet en question, qui est celui de l'agriculture de
type Ikigai.
Puis, nous avons essayé de repérer les prises de
position des acteurs concernés, lesquelles ancrent des
éléments constitutifs de cet ensemble représentationnel,
et ainsi de mettre en évidence la convergence et la divergence dans leur
relation sociale.
Enfin, à partir de ces analyses compréhensives
et explicatives, nous avons essayé de donner des réponses
à une série de questions que nous avons posées
préalablement au début des chapitres 2 et 3, sur les enjeux des
acteurs observés. Et par là, nous avons essayé de relever
des problèmes et des contradictions qui sont tantôt visibles
tantôt invisibles dans la réalité objective, mais qui nous
ont paru exister au niveau de la situation complexe de représentation,
de pratique et de pouvoir.
Et dans la réponse pour la dernière question du
Chapitre 3, nous avons essayé de formuler quelques propositions
destinées aux acteurs du Projet. Ceci en portant un double
intérêt d'un côté celui des acteurs pour une
meilleure régulation de cette situation, de l'autre celui de montrer sa
pertinence et sa perspective à l'épreuve de la
réalité faisant l'objet de cette étude.
Références
BRAUDEL, F. (1969), Ecrits sur l'histoire, Paris,
Flammarion.
BRAUDEL, F. (1993), Grammaire des civilisations, Paris,
Flammarion.
FRAYSSE, B. (2000), « La saisie des représentations
pour comprendre la construction des identités », Revue
29 Abric, 1994 cité par Garnier et Sauvé, 1997 :
69.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid. 70.
des sciences de l'éducation, Vol. XXVI, n°3,
2000, p.65 1-676.
GARNIER, C., SAUVE, L. (1998), « Apport de la
théorie des représentations sociales à l'éducation
relative à l'environnement : Conditions pour un design de recherche
», Education relative à l'environnement, Vol. 1,
1998-1999, p.65-77.
Nôrin-suisan-shô (Ministère de
l'agriculture, de la pêche et de la forêt) (2005), «
Heisei 17 nendo Shokuryô - nôgyô - nôson no
dôkô » ainsi que « Heisei 18 nendo Shokuryô -
nôgyô - nôson shisaku » (« Tendances de
l'alimentation - agriculture - ruralité de l'année 2005 » et
« Mesures pour l'alimentation - agriculture - ruralité de
l'année 2006 »),
http://www.maff.go.jp/hakusyo/nou/h17/html/index.htm
(site officiel)
SASAKI, K. (2004), « Suicide et `ikigai' chez les personnes
âgées », in Quand la vie s'allonge : France-Japon,
Paris, L'Harmattan : p.99-123.
Chapitre I : Evolution urbaine et rurale dans la Ville
de Toyota après 1945
Introduction
Quel est le facteur historique de temps long de la politique
municipale de la Ville de Toyota qui, pour construire le Projet Nô-Life,
a problématisé ensemble le vieillissement de la population en
majorité salariale, le manque de main-d'oeuvre agricole et le
délabrement des terrains agricoles ? Et quelle était la place de
la question d'Ikigai dans l'histoire de la Ville de Toyota après 1945 ?
Ce présent chapitre vise une recontextualisation historique de ces
questions croisées ayant engendré le Projet Nô-Life.
Comme notre présente étude porte principalement
sur les facteurs et le processus du développement du Projet
Nô-Life démarré en 2004, notre approche doit
inévitablement se baser sur l'observation directe ou indirecte de faits
sur l'instant ou la courte durée qui touchent ce projet. Mais ceci
risque d'ignorer une durée beaucoup plus longue dans laquelle s'inscrit
la dynamique du présent que nous pouvons observer directement.
C'est pourquoi Garnier et Sauvé avertissent, dans la
conclusion de leur article, que « le processus de transformation des
représentations et des pratiques est éminemment complexe et
demeure un vaste champs d'investigation35 » Selon eux, il n'y
aurait pas d' « influence directe » entre les pratiques et les
représentations « qui aboutissent à des transformations
»36. Et c'est le « contexte » qui « pourrait
intervenir » comme « élément intermédiaire
» entre ces deux éléments37.
Dans ce présent chapitre, notre tentative consistera
donc à une recontextualisation historique de notre objet de recherche,
visant à éclairer l'ancrage socio-historique des
représentations et des pratiques qui sont en question dans le processus
du Projet Nô-Life, sur un temps plus long que la portée de notre
« étude des acteurs du Projet » que nous présenterons
dans les deux chapitres suivants.
Nous délimitons l'unité spatio-temporelle de
notre examen au territoire de la ville de Toyota dans la période de 1945
à 1975. C'est-à-dire, l'évolution de cette ville pendant
une trentaine d'années après la deuxième guerre mondiale.
En effet, c'est après 1945 que les agents institutionnels principaux du
Projet Nô-Life tels que la municipalité, la coopérative
agricole, se sont entièrement décomposés et
recomposés, et que la vie de la population locale fut presque
entièrement réorganisée au travers du passage du
régime national de la guerre d'avant 1945 à celui de la
démocratie pacifique (après 1945) instaurée sous
l'occupation américaine (1945-195 1).
L'objectif de notre examen ici n'est pas de décrire
trente ans d'histoire urbaine et rurale de la Ville de Toyota après
1945, mais de resituer le contexte du Projet Nô-Life marqué par
les trois thématiques évoquées plus haut (vieillissement
de la population générale ; manque de main-d'oeuvre agricole ;
délabrement des terrains agricoles), dans une longue durée de la
réalité sociale et locale de la Ville de Toyota.
Ce chapitre sera composé des quatre parties suivantes : 1
Industrialisation : naissance et développement de
l' « Automobile Toyota » ; 2 Urbanisation : naissance
et développement de la « Ville de Toyota » ; 3 Evolution
agricole et rurale dans la Ville de Toyota ; 4 Réflexions.
Nous nous baserons sur la lecture des ouvrages collectifs
intitulés « Histoire de la Ville de Toyota (toyota
35 Garnier et Sauvé, 1998 : 73.
36 Ibid.
37 Ibid.
shishi) » publiées successivement de 1976 à
1987 par la Ville de Toyota, pour toutes les parties
descriptives38.
Périodisation en trois décennies après
1945
Dans le tome 4 de ces ouvrages collectifs publié en
1977 qui concerne la période contemporaine, la description de l'histoire
se base sur une périodisation en trois décennies suivantes :
1945-1954 (les années 20 de Shôwa) ; 1955-1964 (les années
30 de Shôwa) ; 1965-1974 (les années 40 de Shôwa).
Selon l'explication donnée par les membres du
comité de rédaction dans la postface de ce tome, les auteurs
essaient, par cette périodisation, de mettre l'accent sur les «
caractéristiques de l'époque de chaque
décennie39 ». De là, ils essaient de mettre en
évidence les caractéristiques « totales
(sôgô-teki) » de chacune de ces époques, en se
concentrant sur les « choses qui se mettent en parallèle avec
chaque époque »40. Et ceci, à la
différence de la manière dont sont souvent éditées
les histoires des collectivités territoriales japonaises
(shi-chô-son shi), lesquelles découpent verticalement l'histoire
moderne et contemporaine en différents domaines tels que
l'administration, l'agriculture, l'industrie, le commerce,
l'éducation41.
Citons un paragraphe de cette postface, qui exprime l'esprit de
la rédaction de ce tome portant sur « trente ans de
turbulence42 » de la Ville de Toyota :
« Nous ne nous satisfaisons pas d'une histoire de la
ville qui n'a que pour objectif d'enregistrer le changement et de le suivre de
manière statistique. Si on n'y trouve pas d'expressions de la vie et
Ikigai des citoyens, cette histoire sera insignifiante. Nous voulons aborder
l'action et la conscience des citoyens concernant le changement du nom de la
Ville, les fusions des villages et les mouvements ouvriers etc. Ceci
également sur le devenir des paysans ecrasés par l'urbanisation,
les instituteurs s'étant efforcés, avec des changements de
courants de pensée pour l'éducation, à s'occuper des
enfants et des élèves dont l'augmentation du nombre était
brutal. Autrement dit, nous avons voulu toucher les efforts et les sentiments
des citoyens qui ont subi chacun les distorsions depuis l'époque
d'après la défaite de la grande guerre, marquée par la
confusion, l'angoisse et la difficulté, jusqu'à nos jours de
prospérité sous la Haute croissance. Nous avons également
pensé à laisser comme archives de la Ville les états
réels de chaque époque. Cependant, nous ne pouvons pas effacer
les affaires, les résistances et les critiques en decrivant l'histoire
de la ville, comme si celle-ci s'était déroulée sans aucun
problème et inconvénient. Il serait également inacceptable
que l'on decrive les oppositions et les concurrences entre les fermes et les
usines, la terre agricole et l'habitat urbain, uniquement de manière
à raconter la gloire des gens qui l'ont emporté dans ces
confrontations. Le problème est dans quelle mesure celles-ci ont
été exprimées dans cette histoire. Sur ce point, nous
devrons attendre l'appréciation des lecteurs. »
Dans cette explication, nous pouvons aisément
apercevoir à quel point les préoccupations des auteurs ainsi que
l'histoire de la Ville de Toyota après 1945 sont marquées par les
turbulences suite à l'industrialisation automobile et les drames qui
l'ont suivie dans la « vie des citoyens ».
L'existence de la ville de Toyota est d'abord marquée -
à la fois réellement et symboliquement - par son nom
38 Cette série d'ouvrages collectifs est
éditée en dix tomes : le premier porte sur la nature, la
période primitive, l'antiquité, le moyen âge ; le second
sur la période pré-moderne (kinsei) ; le troisième sur la
période moderne (kindai : 1868-1945, de l'ère Meiji à la
fin de la grande guerre) ; le quatrième sur la période
contemporaine (gendai : 1945-aujourd'hui) ; le cinquième sur le folklore
; les tomes 6-10 constituent l'ensemble des annexes présentant
respectivement les données concernant chacun des cinq premiers tomes.
Ces ouvrages sont édités par la Commission de l'éducation
de la Ville de Toyota (Toyota-shi Kyôiku Iinkai) ainsi que le
Comité spécial de rédaction de l'histoire de la Ville de
Toyota (Toyota-shi-shi Hensan Senmon Iinkai). Chacun des cinq premiers tomes
est rédigé par une dizaine de rédacteurs couvrant
différentes disciplines (histoire, géographie, politique,
économie, sociologie, folklore, administration, éducation etc).
Chaque rédacteur est chargé d'un ou plusieurs chapitres. En
général, les auteurs mobilisés pour la rédation
sont, soit des instituteurs d'écoles primaires ou de collèges ou
de lycées situés dans la Ville de Toyota, soit des professeurs
d'université présents dans la région.
39 Matsui, Itô et Miyakawa, 1977 : 881
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Ibid. : 882.
emprunté depuis 1959 à celui d'une
célèbre société constructrice d'automobiles
japonaise qui s'est implantée dans les années 30 dans le
territoire de cette ville, et y a constitué une concentration
industrielle dominante. En fait, avant l'implantation et le
développement de l'industrie automobile à la fin des
années 30, cette ville était un petit bourg rural qui avant 1959
s'appelait « Koromo ». Au Japon, cette ville de taille moyenne
constitue un exemple typique des villes généralement
appelées, avec une connotation ironique, par sa forte dépendance
à une seule industrie, sous le nom de « bourg fortifié par
l'entreprise (kigyô jôka-machi) ».
Dans les deux premières parties, nous allons esquisser
des aspects généraux de l'histoire de l'industrialisation et de
l'urbanisation de cette ville d'avant 1945 à 1975. Ensuite, dans la
troisième partie, nous décrirons l'évolution du monde
agricole et rural dans la même période.
1 Industrialisation : naissance et développement
de
l' « Automobile Toyota »
1937 - 1955 : Implantation et développement de
l'Automobile Toyota
Démarrage de l'Automobile Toyota et changement territorial
avant 1945
La construction de la première usine de la
Société Anonyme de l'Industrie Automobile de Toyota (Toyota
Jidôsha Kôgyô Kabushiki Gaisha)43 en 1935 au Bourg
de Koromo fut l'occasion pour celui-ci de faire son premier pas vers sa grande
transformation en une « ville industrielle moderne »44.
L'origine de cette société remonte à
l'établissement de l'Industrie Textile Toyota (Toyota Bôseki) en
1922 (Taishô 11) à Kariya45 par Sakichi TOYODA
(1867-1930), inventeur de nombreux métiers à tisser automatiques
et père fondateur de la société46. Dès
qu'il a monté par la suite la Société de Métiers
à tisser automatiques Toyota (Toyota Jidôshokki) en 1926
(Taishô 15), il avait déjà l'intention de développer
ultérieurement une industrie automobile. Ensuite, c'est Kiichiro TOYODA,
son fils aîné, qui a repris la volonté de son père
après le décès de celui-ci en 1930, en déposant en
1933 une demande de rachat d'un terrain de près de 200ha situé au
Bourg de Koromo, auprès de la mairie de celui-ci, pour y construire sa
première usine automobile47.
Ce terrain était une vaste colline non cultivée,
mais bien située du point de vue des moyens de transport ferroviaire et
de l'alimentation en électricité48.
Le maire du Bourg de Koromo (Juichi Nakamura) a trouvé
que cette proposition était une très bonne opportunité de
sortir de la crise, amorcée depuis 1930, les industries et commerces
locaux amorcée depuis 1930 : cocons de vers à soie et produits
textiles49. Malgré des difficultés pour convaincre les
180 propriétaires
43 Nous l'appelons Automobile Toyota. Dans le langage courant de
la région de la Ville de Toyota, on l'appelle également de
manière plus courte soit « Industrie-auto Toyota
(Toyota jikô) », soit « Industrie - auto(jikô) ».
44 Takahashi, 1978 : 753.
45 Un bourg situé au sud-ouest de Koromo.
46 Sakichi TOYODA est né fils d'un pauvre
paysan-charpentier dans le département de Shizuoka situé au
sud-est d'Aichi. Il
inventa un célèbre métier à tisser
automatique en bois « Toyota-shiki Mokusei Jinriki Shokki (Machine
à tisser manuelle du style Toyota) » en 1897, pour lequel il a
utilisé le plus possible de bois qui étaient moins coûteux
que les métaux. L'efficacité, le bon rapport qualité-prix
et la qualité du tissu étaient les grands atouts de cette
invention.
47 Ibid. : 753.
48 Ibid. : 754.
49 Ibid. : 755. Le Bourg de Koromo constituait un centre
régional de distribution de soies brutes et de produits textiles
cotonniers ainsi qu'en soie.
terriens concernés par ce rachat, le maire y parvint.
L'usine fut construite en 1935 en plein champs à Koromo, et l'Automobile
Toyota fut ainsi établie en 193750.
Puis, l'Automobile Toyota s'est développée en
produisant essentiellement des camions pour l'armée japonaise dans le
régime de guerre, renforcé à partir de 1937, avec le
début de la Guerre sino-japonaise.
Métamorphose des industries locales
L'implantation de la première usine et du siège
de l'Automobile Toyota à Koromo a apporté quelques changements
brutaux à sa structure démographique et industrielle. Au niveau
démographique, l'effet de l'implantation était déjà
net : si, de 1920 à 1935, l'augmentation du nombre d'habitants restait
douce (de 11924 à 14256, soit 19.5%), celle de 1935 à 1940
était de 44.7% (de 14256 à 20629)51.
Puis, alors qu'entre 1933 et 1938, le poids du nombre des
foyers agricoles sur le nombre total des foyers dans le Bourg a diminué
de 52.1% à 42.5%, à l'année suivante, il diminua
rapidement jusqu'à 33.7%52. Tandis que le poids des foyers
dont des membres sont employés dans l'industrie est passé de 3.6%
à 20.5% de 1933 à 193953. Par ailleurs, l'implantation
de l'Automobile Toyota a stimulé le secteur commercial du Bourg : le
poids des foyers dont des membres travaillent dans ce secteur, a
augmenté entre 1937 et 1939 de 68.8% (de 916 à 1
546)54.
Au niveau du chiffre d'affaires de tous les secteurs,
l'évolution était encore plus nette autour de 1938 : de 1933
à 1937, l'augmentation totale chaque année était
inférieure à 11%, mais en 1938, l'augmentation fut quarante fois
supérieure à celle de l'année précédente (on
passa alors de moins de 400 000 yens à 15 400 000 yens)55. Il
en résulta que le poids du secteur industriel dans le chiffre d'affaires
de tous les secteurs est atteint plus de 80% en 1938, puis 94% en 1939, alors
qu'il était de 10.7% en 193756.
Par contre, à partir de 1936, le déclin du
secteur des vers à soie fut amorcé : diminution du chiffre
d'affaires de 50% entre1936 et 1939, alors que son poids sur le chiffre
d'affaires total de tous les secteurs dans le Bourg de Koromo passa de 53.3%
à 1.8% entre 1936 et 193957! Cette chute du secteur des vers
à soie est non seulement liée à la crise permanente depuis
1929, mais également au régime national de guerre qui
contrôlait l'économie en restreignant les « industries
pacifiques (heiwa sangyô) », à savoir celles non
militaires58.
Reconstruction de l'Automobile Toyota dans la décennie de
1945 à 1955
De 1937 à 1945, l'Automobile Toyota s'est d'abord
développée en tant qu'une industrie militaire dans le
régime national de guerre dans lequel la production des voitures non
militaires était contrôlée par l'Etat
impérial59. Ceci malgré le fait que l'Automobile
Toyota avait toujours l'intention de se spécialiser dans la production
de voitures normales depuis le début de ses activités de
recherche vers 193360. Puis, après la défaite du Japon
de la guerre, elle dut se reconvertir en une « industrie pacifique ».
A cet effet, elle s'est d'abord spécialisée dans le domaine de
l'automobile en se séparant notamment du secteur de la construction
aéronautique auquel elle participait également pendant la
guerre61. Mais, dans la bonne conjoncture économique
japonaise grâce à la Guerre de Corée (1950-1953), elle
continua à produire des camions pour les troupes des Nations Unies
essentiellement composées de l'armée
américaine62. En fait, après la fin de la guerre en
1945,
50 Ibid. : 756.
51 Ibid. : 757.
52 Ibid. : 758.
53 Ibid.
54 Ibid.
55 Ibid. Ceci a encore augmenté à 53 000 000 yens
l'année suivante.
56 Ibid. On ne compte pas le prix de production du secteur des
vers à soie dans le secteur industriel.
57 Ibid.
58 Ibid.
59 Miyakawa, 1977 : 109.
60 Ibid. : 109.
61 Ibid. : 108.
62 Ibid. Appelé « Chôsen tokuju (Demande
spéciale de la Guerre de Corée) », c'était cette
bonne conjoncture qui, du moins au
l'Automobile Toyota a toujours continué à produire
des camions pour la reconstruction du pays, grâce à l'autorisation
donnée par l'armée américaine
d'occupation63.
De 1945 à 1950, le déploiement de l'industrie
automobile était encore limité au territoire du Bourg de Koromo
qui était entouré de collectivités rurales avec lesquelles
il fusionna lors des décennies suivantes64. Dans des
collectivités rurales de moyenne montagne autour de Koromo, quelques
industries artisanales telles que la poterie, le tissage au moulin à eau
réalisèrent leur relèvement65.
Une des caractéristiques de l'Automobile Toyota est la
concentration industrielle régionale de ses unités de production
qui ont d'abord été centrées sur le Bourg de Koromo, et
ensuite étendues aux collectivités rurales environnantes. Ce
choix ne relève pas seulement de la stratégie de cette
entreprise, mais plutôt de la situation politico-économique au
niveau macro dans le contexte de la guerre et de l'impérialisme
japonais.
En effet, dès 1922, l'Industrie textile Toyota
s'était déjà implantée à Shanghai, en Chine.
Puis, des usines automobiles de Toyota s'implantèrent à Shanghai
et à Tianjin en 1938. Ceci à peu près dans la même
période que la construction de la première usine à Koromo
en 1937. Elle avait ainsi établi ses capitaux étrangers et son
système de production international en Asie de l'Est, dans les zones de
la « Sphère de co-prospérité de la grande Asie
orientale (Daitôa Kyôei-ken) » construite par le Japon
impérial pendant la guerre66. Mais elle perdit tous ses
capitaux étrangers suite à la défaite du Japon, et dut
accueillir la population rapatriée de l'étranger67.
Après la guerre, la politique économique de
rigueur édictée par l'occupation américaine68
imposa aux entreprises japonaises une rationalisation rigoureuse de leur
gestion. Une rationnalisation a ainsi été réalisée
dans l'Automobile Toyota suite à deux mois de conflits sociaux
brûlants en 1949, ce qui conduit au licenciement de 2146
employés69. Puis, le « GHQ70 » a abolit
le contrôle de la production automobile, l'année du
déclenchement de la Guerre de Corée71. Le Japon a
joué le rôle d'une base stratégique et militaire pour les
forces des Nations-Unies, et a créé entre-temps ses propres
troupes qui deviendront plus tard les « Forces d'auto-défense
(Jieitai) »72. Le soutien des forces des Nations-Unies ainsi
que des troupes japonaises ainsi réorganisées pendant la Guerre
de Corée ouvrirent de grands débouchés aux camions de
l'Automobile Toyota.
1955 - 1965 (et après) : Développement de
l'Automobile Toyota
De 1955 à 1965, la zone industrielle de la Ville de
Toyota s'est développée à l'initiative de l'Automobile
Toyota qui établit son système de production de masse de voitures
normales. La Ville de Toyota s'est ainsi constituée en une « ville
de l'entreprise unique (tanitsu kigyô toshi) » avec l'effondrement
d'industries artisanales locales.
Quelques chiffres nous permettent de constater un
développement brutal et considérable de la production automobile
de l'industrie automobile dans le territoire de la Ville de Toyota : de 1955
à 1964, le nombre d'entreprises a augmenté de 634 à 875
dans l'ensemble du territoire de la Ville de Toyota73 ; le nombre
des usines a augmenté de 208 à 313 dans le Bourg de Koromo ainsi
que deux villages voisins (Takahashi et Kamigô)74 ; le nombre
des employés dans l'ensemble du territoire de la Ville de Toyota : passa
de 9901 en 1956
départ, permit au Japon de réaliser sa Haute
croissance lors de la vingtaine d'années qui ont suivies.
63 Ibid. : 110 La production totale japonaise autorisée
était de 1500 camions par mois.
64 Ibid. : 116.
65 Ibid. : 117.
66 Ibid. : 120.
67 Ibid.
68 Ceci avec les fameurses mesures de « Dodge line »
appliquées en 1949.
69 Ibid. : 124. Le « Syndicat ouvrier de l'Automobile Toyota
de Koromo » était organisé dès 1946.
70 GHQ : General Headquarters/ Supreme Commander for the
Allied Powers. L'appellation du centre de décision de l'occupation
américaine au Japon.
71 Ibid. : 126.
72 Ibid.
73 Ce territoire compte également les collextivités
environnantes qui ont fusionnés avec la Ville de Toyota jusqu'en
1970.
74 Ibid. : 214.
à 38817 en 196475. Rien que dans le Bourg de
Koromo et le Village de Kamigô, le nombre d'employés passa de 7784
à 3203376 ; le chiffre d'affaires de la production
industrielle dans le Bourg de Koromo et le Village de Kamigô a
augmenté de près de 21 fois (11 600 000 000 yens à 249 400
000 000 yens) de 1956 à 196477.
Concentration industrielle autour du Bourg de Koromo
A partir de 1958, la concentration considérable
d'entreprises filiales et sous-traitantes de l'Automobile Toyota
commença. Les collectivités rurales voisines du Bourg de Koromo
établirent chacune leurs lois municipales pour l'installation
d'entreprises sur leur territoire78. Jusqu'en 1970, trois
collectivités (Takahashi, Kamigô, Takaoka) ont ainsi
fusionné avec la Ville de Toyota79.
L'essor de l'Automobile Toyota lors de cette période
est d'abord le fruit de la construction de sa deuxième usine en 1959
à Motomachi dans le Bourg de Koromo, et de la concentration
d'entreprises filiales et sous-traitantes dans la région environnante du
Bourg de Koromo80. Pendant cette décennie, la population du
territoire de la Ville de Toyota a triplé (de 33418 à
107037)81. Et ainsi le Bourg de Koromo se transforma d'un «
bourg rural (nôson-toshi) » en une « ville de l'entreprise
(kigyô-toshi) ».
2 Urbanisation : naissance et développement de
la « Ville de Toyota »
Avant 1945 - 1955 : mutation du Bourg de Koromo et de ses
environs
Evolution démographique avant 1945
La population du Bourg de Koromo a, nous l'avons vu,
augmenté de près de 50% entre 1935 et 1940. Ceci alors qu'entre
1920 et 1940, l'évolution démographique était encore douce
dans les collectivités rurales environnantes soit une augmentation de
10-20% dans les zones en plaine (Kamigô et Sanagé), soit la
stagnation ou une diminution dans les zones de moyenne montagne (Homi, Ishino,
Takahashi et Matsudaira)82
Naissance de la « Ville de Koromo » et évolution
des collectivités environnantes de 1945 à 1955
La bonne conjoncture économique suite à la Guerre
de Corée en 1950 fut l'occasion du développement de la Ville de
Toyota, en tant que ville industrielle83.
En 1951, le Bourg de Koromo est devenu la « Ville de Koromo
» au niveau administratif en atteignant le
75 Ibid. : 215.
76 Ibid.
77 Ibid. : 216.
78 Matsui, 1977 : 201.
79 Ibid.
80 Ibid.
81 Ibid.
82 Takahashi, 1978 : 773.
83 Itô, 1977 : 12.
nombre d'habitants nécessaire fixé par l'Etat :
30 000 habitants84. Cette transformation administrative lui permit
de réaliser un ensemble de nouvelles mesures pour développer ses
infrastructures urbaines (routes, trains, places, établissements
commerciaux et socio-culturels etc).
Cette transformation administrative était une grande
attente de la part de la population du Bourg de Koromo depuis
déjà 1937, l'année de la construction de la
première usine de l'Automobile Toyota, et cette naissance de la Ville de
Koromo fut grandement été célébrée par la
population.
Quelques discours représentatifs de l'administration
municipale ainsi que de la population prononcés à cette occasion,
montrent une représentation naissante et particulière qui
apparaît comme un leitmotiv commun sur le développement de cette
ville, au sein de la politique municipale et de la population. Il s'agit de la
coexistence entre la grande industrie automobile, les petits commerces locaux,
l'agriculture et la ruralité. En effet, à l'occasion de ce
changement du statut administratif du Bourg de Koromo, la mairie a
organisé un concours d'essais sur la « Perspective de la
construction de la grande Ville de Koromo (Dai-koromo-shi Kensetsu
Kôsô) » auprès des habitants du Bourg85.
Dans tous les essais choisis par la mairie, l'avenir de la ville était
identifié à celui d'une ville industrielle en espérant son
élargissement futur ainsi que le développement des
infrastructures urbaines intégrant les zones rurales
environnantes86. Le discours du maire du Bourg de Koromo lors du
vote final au sein du Conseil municipal en 1950 pour ce changement de nom,
mettait bien l'accent sur la coopération entre les trois zones de types
différents dans la nouvelle Ville de Koromo : zone industrielle ; zone
commerciale ; zone agricole87.
Certes, depuis le Moyen Âge, le Bourg de Koromo avait la
fonction d'un centre régional de distribution de produits agricoles,
ainsi que de cocons des vers à soie et de produits textiles dans les
années 20. Ainsi, le transport ferroviaire était-il
déjà plus ou moins développé avant l'implantation
de l'Automobile Toyota. Mais à partir de 1937, il devint presque
entièrement dépendant des activités de l'Automobile
Toyota.
Pendant cette première décennie, les
collectivités environnantes restaient encore à dominante rurale,
et la naissance de la Ville de Koromo ne les intéressait pas
directement88. Mais, après 1945, plusieurs fusions entre des
collectivités voisines parmi elles furent effectuées sous
l'implusion nationale de la fusion massive des collectivités rurales
dans le cadre la modernisation de l'administration locale sous l'occupation
américaine89.
1955 - 1965 : Agrandissement du territoire de la
Ville
La deuxième décennie de la Ville de Toyota
était marquée par l'évolution de la structure
démographique et industrielle, le changement du nom de la Ville de
Koromo à Toyota, des fusions successives avec les collectivités
environnantes et l'aménagement d'infrastructures urbaines.
Au Japon, la grande croissance économique a
commencé vers 1952 à partir de l'augmentation des investissements
dans le secteur des industries chimique et lourde. Suite à la bonne
conjoncture économique des années 56-5790, les
médias ont nommé cette époque avec des termes tels que la
« fin de l'après-guerre » ; « aube du nouveau Japon
» ; « décollage économique »91. Cette
croissance consistait en une série de changements de la
société industrielle indiqués par : la triomphe de
l'industrie lourde sur l'industrie légère ; la diminution rapide
du secteur primaire ; le développement des secteurs secondaire et
tertiaire etc92.
Dans la Ville de Toyota, l'augmentation démographique
s'accélèra dès 1960, le caractère rural du
territoire
84 Ibid. : 13.
85 Ibid. : 15.
86 Ibid.
87 Ibid. : 16.
88 Ibid. : 20.
89 Ibid. : 20. Cette politique nationale était
également dictée par la politique américaine d'occupation
: « Recommendation Shoup »
en 1949 concernant le système de la finance publique
japonaise.
90 Cette conjoncture est nommée « Jinmu keiki
(conjoncture de Jinmu) ».
91 Itô, 1977 : 289.
92 Ibid. : 290.
de la Ville cèda la place à celui d'une ville
industrielle et jeune. Et ce caractère se renforça avec des actes
symboliques de la politique municipale marquant cette transformation :
changement du nom de la Ville de Koromo à Toyota ; acte de jumelage
entre la Ville de Toyota et la Ville de Detroit93. Puis la
Municipalité de Toyota développa son aménagement urbain de
manière à coopérer avec l'Automobile Toyota en
construisant une canalisation pour l'industrie automobile, des
résidences publiques pour ses employés etc94.
Evolution de la structure démographique
Dans la Ville de Toyota, le taux d'augmentation
démographique entre 1950 et 1975 fut le plus élevé du
Japon : 777.5%, de 30 000 à 250 000 habitants. En 25ans, cette ville
s'est transformée d'un bourg rural inconnu à une ville
industrielle de taille moyenne95.
A partir de 1960, l'augmentation démographique de la
Ville de Toyota s'est considérablement accélérée.
Nous pouvons constater les conséquences caractéristiques de cet
essor démographique au niveau du sexe, de l'âge, des secteurs
industriels et des occupations professionnelles.
Au niveau du sexe, le nombre des hommes a dépassé
celui des femmes en 196096. Cette tendance a duré jusque vers
1 96597. La population jeune augmenta davantage.
Le nombre de personnes employées dans le secteur
secondaire (20 551) égala en 1960 celui du secteur primaire (20799). En
1965 Le poids de la population employée dans le secteur primaire devint
plus faible par rapport aux secteurs secondaire et tertiaire: 21.5% dans le
secteur primaire ; 53.5% dans le secteur secondaire98.
Au niveau des occupations professionnelles, la structure
démographique est marquée par le taux de plus en plus dominant de
la population de la couche ouvrière : en 1960, parmi la population
active et masculine, 45.5% étaient des ouvriers (qualifiés et non
qualifiés) et 26.7% des travailleurs agricoles. Tandis que, pour la
même année, parmi la population active et féminine, 56.4%
étaient encore des travailleuses agricoles et 19.2% était des
ouvrières99. En 1970, 61.7% de la population active et
masculine étaient des ouvriers, et 6.2% des travailleurs agricoles. Les
employés dans le domaine administratif (8.0%) et le domaine technique
spécialisé (7.0%) ont chacun devancé le nombre des
travailleurs agricoles100. Parmi la population active et
féminine, le nombre des ouvrières a égalé celui des
travailleuses agricoles. Le nombre des employées dans le domaine
administratif et le domaine technique spécialisé a
également augmenté101. Au total, en 1970, 51.3% de la
population active étaient des ouvriers.
Naissance de la Ville de Toyota
Le changement du nom de la Ville de Koromo à celui de
Toyota a eu lieu en 1959, suite à la demande officielle
déposée en 1958 par la Chambre du commerce et de l'industrie de
Koromo102. Malgré quelques mouvements de résistance de
la population locale, ce changement fut opéré sept mois
après le dépôt de cette demande103.
L'auteur qualifie cet évènement d'un « fait
symbolique et historique » qui est caractérisé par le
début de la période de la Haute croissance économique, et
qui s'inscrit dans l'histoire du Japon de l'ère de Shôwa (1926
à 1989)104. Cet acte de changement du nom de la ville
était important notamment dans le sens où il a redéfini
le
93 Dès lors, la mairie de la Ville de Toyota se
présente souvent dans ses communications publiques comme « Detroit
de
l'Orient (Tôyô no Detroit) ».
94 Ibid.
95 Ibid. : 294.
96 Ibid. : 291.
97 Ibid.
98 Ibid. : 298.
99 Ibid. : 299.
100 Ibid.
101 Ibid.
102 Ibid. : 343.
103 Ibid.
104 Ibid. : 344
principe de la politique municipale de cette ville :
développer la Ville en coopération avec l'Automobile Toyota. Ceci
a favorisé, en sacrifiant les 2000 ans d'histoire du nom de Koromo, le
développement de l'Automobile Toyota, ainsi que le processus de fusions
successives avec les collectivités environnantes avec la Ville de Toyota
grâce à sa politique industrielle davantage orientée par ce
changement de nom105.
Fusions des collectivités environnantes
Comme nous l'avons dit plus haut, le mouvement de fusion des
collectivités rurales au Japon était poussé par l'Etat au
nom de la rationalisation de la gestion financière des
collectivités locales, dictée par la « Recommendation de
Shoup », une des mesures imposées par la politique d'occupation
américaine, qui consistait à l'élargissement de
l'échelle des collectivités ainsi qu'à l'augmentation de
l'efficacité économique de l'administration
locale106.
Selon cette politique, l'Etat voulait réduire le nombre
des collectivités locales au Japon jusqu'au tiers du nombre total, en
fusionnant notamment la grande majorité des collectivités ayant
moins de 8000 habitants (7833 sur 8245 collectivités, soit
95%)107 . Ceci alors que la population moyenne par
collectivité était à cette époque de 5200
habitants108. Une série de lois pour avancer le processus des
fusions ont été adoptées (en 1953, 1956 et
1965)109.
Dans le territoire de la Ville de Toyota, la
répartition démographique par collectivité en 1948
était la suivante: 30564
hab. au Bourg de Koromo ; 7626
hab. au Village de Takahashi ; 10539
hab. au Village de Kamigô ; 15921
hab. au Village de Takaoka ; 20580
hab. au Village de Sanage (y compris Homi et
Ishino) ; 7306
hab. au Bourg de Matsudaira. 92538 habitants
au total dont la population du Bourg de Koromo occupait 33%110
Les fusions de ces collectivités ont donc eu lieu en
fonction de l'élargissement accéléré de l'industrie
automobile, ainsi que de la nécessité de l'aménagement
urbain suite à ce développement industriel111. Le
tableau ci-dessous montre le processus de l'avancement de ces
fusions112.
Suite à ces fusions, Un nouvau plan d'urbanisme fut
conçu en 1966, afin de rééquilibrer le rapport entre les
nouvelles zones industrielles et résidentielles et l'ancien centre du
Bourg de Koromo. Puis, les zones de moyenne montagne au Nord (Sanage) et
à l'Est (Matsudaira) ont été désignées comme
« zones résidentielles de pleine nature » et « zones de
recréation » dans lesquelles le tourisme et le loisir sont à
développer113.
105 Ibid. Dans la lettre officielle pour la demande de ce
changement, déposée par la Changre du Commerce et de l'Industrie
de Koromo, l'intérêt propre à l'Automobile Toyota par ce
changement était clairement explicité. Ceci à la fois pour
la promotion (le
nom de Koromo était quasiment inconnu dans le Japon) et le
principe de l'aménagement urbain favorable au développement de
l'Automobile Toyota. (Ibid.: 345)
106 Ibid. : 329.
107 Ibid.
108 Ibid.
109 Avant l'ère de Meiji, il y avait plus de 70 000
villes, bourgs et villages au Japon. Mais depuis l'instauration des
collectivités territoriales (shi-chô-son : ville - bourg -
village) comme unité administrative, le nombre de collectivités a
été réduit à environ 25% du début via la
fusion des collectivités en 1889 (71314 à 15859 dont 39 bourgs).
Puis, entre 1945 et 1961, le nombre de
collectivités a davantage été réduit
à un tiers : 10520 à 3472 (dont 556 villes, 1935 bourgs et 981
villages). (Source : Sômu-shô,
http://www.soumu.go.jp/gapei/)
110 Ibid.
111 Ibid. 328.
112 Ces fusions ont été accomplies jusqu'en 1974
malgré quelques conflits d'intérêts territoriaux complexes
(cas de Kamigô et de Takaoka) (Ibid. : 334-342)
113 Ibid. 339.
Schéma : Généalogie des fusions des
collectivités pour la formation de la Ville de Toyota

Bourg de
Sanage (1955)
Ville de
Toyota (1967)
Ville de
Koromo (1956)
Ville de
Toyota (1959)
Ville de
Toyota (1964)
Ville de
Toyota (1965)
Ville de
Toyota (1970)
Bourg de Sanage Village de Homi Village de Ishino Ville de Koromo
Village de Takahashi Bourg de Kamigô Bourg de Takaoka Bourg de
Matsudaira
(Ibid. : 328)

Takahashi (2899ha)
Takaoka (3897ha)
Sanage (11759ha)
Koromo
(3865ha)
Matsudaira (4384ha)
Kamigô (21 65ha)
Carte : Territoire de la Ville de Toyota après
1970
(Ibid. : 342.)
1965 - 1975 : Essor économique et
démographique
Au Japon, la décennie de 1965 à 1975 est
marquée par la Haute croissance économique et l'urbanisation
explosive114. Pendant cette période, le PNB a
été multiplié par 3.7115 . Et le revenu annuel
par personne a été multiplié par 3.3 (de 255 000 yens
à 834 000 yens)116 En dépassant les niveaux de
l'Angleterre et de l'Italie, le
114 Itô, 1977 : 630.
115 Ibid.
116 Ibid.
Japon est devenu le seul pays développé en
Asie117.
Une série de chiffres nous permet de réaliser
l'ampleur de l'essor économique de la Ville de Toyota entre 1965 et
1975: nombre des voitures produites par l'Automobile Toyota : 470 000 en 1965,
2 230 000 en 1975 (4.7 fois plus) ; chiffre d'affaires total des industries :
295 400 000 000 yens en 1965 ; 1 945 500 000 000 yens en 1974 (6.6 fois plus) ;
surface totale du territoire de la Ville : 28 969ha après la fusion avec
Matsudaira (deuxième ville après Nagoya dans le
Département) ; population : 107 445 hab. en 1965, 248 774 hab. en 1975
(2.3 fois plus) ; financement municipal (dépenses annuelles) : 2 600 000
000 yens en 1965, 21 800 000 000 (8.4 fois plus) ; financement municipal
(Impôts) :1 700 000 000 en 1965, 12 700 000 000 en 1975 (7.5 fois
plus)118 .
Suite à cette grande croissance économique, la
Ville de Toyota a lancé un nouveau slogan de l'aménagement urbain
dans le nouveau plan d'urbanisme conçu en 1966. Ce slogan est «
Ville industrielle et culturelle (Sangyô-bunka-toshi)119
», mettant l'accent sur le développement de : l'infrastructure
urbaine ; l'éducation ; la culture ; le cadre de vie ; l'économie
industrielle120. Puis, en 1971, un nouveau plan d'urbanisme a
redéfini la qualité de la Ville de Toyota comme « lieu de la
vie sociale et humaine » plutôt qu'un simple « lieu de
production » en prévoyant un élargissement futur de la
démographie de la Ville de 300 000 habitants pour 1985121.
Pendant cette troisième décennie, trois nouvelles
usines de l'Automobile Toyota ont été construites : Kamigô
(moteurs) en 1965 ; Takaoka (assemblage) en 1966 ; Tsutsumi (assemblage) en
1970.
A partir des 1970, quelques magasins de grande surface furent
ouverts dans le centre-ville situé au centre de l'ex-bourg de
Koromo122. Puis, une série d'établissements publics
furent construits grâce à la grande augmentation des recettes
publiques réalisées par l'essor de l'industrie automobile (routes
; résidences publiques ; écoles, centres sociaux et culturels ;
centres sportifs ; musées ; bibliothèque etc123.
Structure territoriale de la Ville de Toyota
Dans la réorganisation du territoire de la nouvelle
Ville de Toyota, chaque ancienne collectivité se transforme de plus en
plus en une zone dotée de fonctions spécifiques dans l'ensemble
du territoire de cette ville industrielle « moderne » telles que :
commerce et administration ; industrie ; agriculture ; résidence ;
tourisme et récréation etc124.
- L'ex-Bourg de Koromo devient le centre-ville où les
commerces, les entreprises et les fonctions administratives se
réunissent125 : - autour de l'ex-Bourg de Koromo, près
de 1000 usines se sont concentrées vers l'ouest et le sud. Puis, une
urbanisation résidentielle se développe autour de ces usines;
- dans le sud (ex-Village de Kamigô et ex-Village de
Takaoka), 70% de la surface totale est agricole, où de grandes usines et
de nouvelles zones résidentielles se construisent de manière
dispersée;
- dans le nord (ex-Bourg de Sanage) où la montagne et la
forêt occupent 65% de la surface totale, une urbanisation
résidentielle avance à côté de quelques zones de
production spécialisées dans l'arboriculture et la culture
maraîchère ;
- à l'est de l'ex-Bourg de Koromo, le quartier de
l'ex-Village de Takahashi constitue une zone industrielle et
résidentielle ;
- plus à l'est, l'ex-Bourg de Matsudaira, où une
grande partie du territoire est occupée par la montagne et la
forêt, constitue un atout pour le tourisme et le loisir.
Après la fusion avec le Bourg de Matsudaira en 1970, sur
28969ha du territoire de la Ville de Toyota, la
117 Ibid.
118 Matsui, 1977 : 491.
119 Ibid. : 492.
120 Ibid.
121 Ibid.
122 Ibid. : 493.
123 Ibid.
124 Ibid. : 495.
125 Ibid. Ceci y compris le siège de la Coopérative
agricole de Toyota ayant également annexé les coopératives
agricoles des collectivités environnantes (nous le verrons plus bas)
montagne et la forêt occupent 34%, les terrains
agricoles occupent 33% et la zone résidentielle occupe moins de 10%. Ce
qui constraste fortement avec la grandeur du chiffre d'affaires de l'industrie
de la Ville. D'où la coexistence entre les deux slogans publiquement
manifestés par la Ville : « Ville de voiture (kuruma no machi)
» et « Ville du vert et de l'eau (midori to mizu no machi) ».
Ensuite, nous pouvons relever quelques traits particuliers de
la vie locale de la population de la Ville de Toyota, qui sont fortement
liés à l'histoire de l'industrialisation de cette ville. En fait,
il y a très peu de contacts ou d'échanges parmi la population
locale dont la majorité habite dans des zones résidentielles
nouvellement construites, mais éloignées du centre-ville et des
centres des anciens bourgs. En plus, le développement
considérable de la Coopérative de consommation de Toyota
implantée dans chacune de ces nouvelles zones résidentielles (19
magasins) permet à cette population dispersée de s'approvisionner
pour ses besoins quotidiens sans devoir aller au centre-ville126.
Ces aspects défavorisent le développement et l'animation du
centre-ville127.
De ce fait, rééquilibrer le rapport entre les
anciens et les nouveaux habitants constitue un thème permanent de la
politique de la Municipalité de Toyota128. L'identité
de la Ville de Toyota est ainsi mise en question. D'où l'importance
accordée à l'organisation d'évènements d'animation
et de sports129.
Emigration rurale japonaise vers la Ville de Toyota
Enfin, nous aborderons quelques aspects généraux de
l'émigration de la population japonaise vers la Ville de Toyota, une des
plus grandes caractéristiques de l'évolution démograhique
de la Ville de Toyota.
Au fur et à mesure qu'augmente le nombre des personnes
s'installant dans la Ville de Toyota, la zone où se situe leur lieu de
naissance, s'est de plus en plus élargie, partant de l'intérieur
du département d'Aichi jusqu'aux départements environnants
d'abord, et allant ensuite jusqu'à tout le territoire
japonais130.
Le tableau suivant montre l'évolution des lieux d'origine
de la population installée dans la Ville de Toyota entre 1956 et 1960,
et entre 1966 à 1970131.
De 1956 à 1960, 35% de la population issue de
l'extérieur du département d'Aichi était originaires de
départements voisins132. De 1966 à 1970, le nombre de
personnes venant de tous les départements japonais, installées
dans la Ville de Toyota augmenta. Les personnes venaient notamment du centre
(Chûbu) (où se situe le département d'Aichi), de l'ouest
(Kinki), du sud (Kyûshû) et du nord (Hokkaidô). Du coup, les
personnes venant des départements voisins ne représentaient plus
que 16.1% des personnes venant de l'extérieur du département
d'Aichi.
126 Ibid. : 497.
127 Ibid.
128 Ibid.
129 Ibid.
130 Itô, 1977 : 647.
131 Ibid.
132 Ibid. Sinon, il y avait déjà ceux venant de
Tôkyô ; Niigata (un département rural au Nord) ; Fukuoka et
Saga (anciennes
régions charbonnières de Kyûshû).
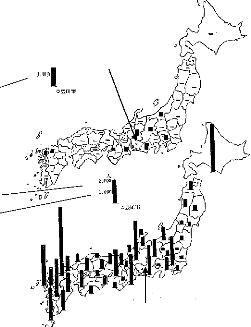
2000 pers.
Ville de Toyota
1000 pers.
2000 pers.
1000 pers.
Ville de Toyota
Carte : Répartition des lieux d'origine de la
population intallée
dans la Ville de Toyota (Haut : 1956-1960, Bas :
1965-1970)
(Ibid. : 648)
Evolution des lieux d'origine de la population
installée
dans la Ville de Toyota 1956-1 960 et 1966-1
970
|
1956-1960
|
1966-1970
|
|
Nbre. effectif
|
%
|
Nbre. Effectif.
|
%
|
|
Dép. Aichi
|
13457
|
70.7
|
36665
|
36.9
|
|
4 dép.
voisins
|
Dép. Nagano
|
401
|
2.1
|
1466
|
1.5
|
|
Dép. Shizuoka
|
565
|
3.0
|
2592
|
2.6
|
|
Dép. Gifu
|
555
|
2.9
|
3386
|
3.4
|
|
Dép. Mie
|
432
|
432
|
2685
|
2.7
|
|
Les autres dép.
|
3631
|
19.1
|
52503
|
52.9
|
|
Total
|
19041
|
100
|
99297
|
100
|
(Ibid. : 649.)
Par ailleurs, le nombre de départs de la population vers
l'intérieur de la Ville de Toyota augmenta de manière
considérable133.
Si la population installée venant de départements
moins avancés (économiquement) a tendance à plus
133 Ibid. : 649.
s'installer définitivement dans la Ville de Toyota,
celle venant de départements plus avancés a tendance à
équilibrer le rapport entre les nombres de départ et
d'installation. Ces aspects sont liés au fait qu'existent les deux types
suivants de motivation d'installation : installation définitive pour
l'emploi et le mariage ; installation à court terme pour des emplois
saisonniers134.
Problème du maintien de la main-d'oeuvre industrielle
Une des raisons pour lesquelles l'Automobile Toyota s'est
implantée dans le Bourg de Koromo était également la
facilité d'obtenir la main-d'oeuvre à partir de la population
rurale environnante135. Mais, la mobilisation de la population des
environs du Bourg de Koromo était peu suffisante face à l'essor
de l'ensemble de l'industrie automobile pendant la Haute
croissance136. En 1969, le nombre d'installation a atteint plus de
22 500 personnes en un an137. Mais, le maintien de la main-d'oeuvre
consitituait de plus en plus un grand problème pour les entreprises du
secteur de l'industrie automobile dans la Ville de Toyota138. Ceci a
ainsi constitué une thématique importante pour la politique
municipale de Toyota139.
En fait, le départ de la main-d'oeuvre industrielle
n'est pas seulement dû à l'emploi saisonnier, mais
également à la caractéristique du mode de travail à
la chaîne dans les usines : peu de valorisation des compétences
individuelles démotivant souvent les employés140.
Ainsi, si de 1973 à 1974, 21 000 personnes ont été
embauchées dans l'industrie automobile, 18 700 personnes ont
quitté leur travail141. Pour faire face à ce
problème, les entreprises et la Municipalité devaient
élaborer des mesures pour maintenir la main-d'oeuvre industrielle dans
la Ville de Toyota142.
3 Evolution agricole et rurale dans la Ville de
Toyota
1945-1955 : période de la réforme de
l'après-guerre
La première période de la « réforme
de l'après-guerre (sengo kaikaku) » est caractérisée
par les trois thèmes suivants : augmentation de la production
destinée au rationnement (lutte contre la faim) ; Réforme agraire
(décomposition du système proriétaire-fermier «
jinusi-kosaku seido ») ; politique de défrichement («
nôchi-kaitaku jigyô »)143.
Les procédures de la Réforme agraire
(nôchi-kaikaku) ont été amorcées en 1945 et ont
été accomplies vers 1950. D'un côté, les
propriétaires terriens ont perdu leur statut privilégié
suite au rachat coercitif et à la redistribution exercés par
l'Etat des terrains mis en fermage, ainsi qu'à la baisse du prix du
fermage et au paiement du fermage en argent. De l'autre côté, le
statut des cultivateurs s'est élevé en raison de l'agrandissement
de terrains en leur possession. Cette réforme a apporté un
changement révolutionnaire à l'ordre
134 Ibid. : 649.
135 Ibid. : 655.
136 Ibid.
137 Ibid.
138 Ibid. Ceci était surtout le cas pour les petites
entreprises sous-traitantes.
139 Ibid. : 655.
140 Ibid. : 656.
141 Ibid. : 656.
142 Ibid. Nous le verrons dans le chapitre suivant, mais nous
pouvons déjà comprendre pourquoi le terme d'Ikigai était
largement
employé à cette époque tant dans la politique
des entreprises que dans celle des syndicats ouvriers, en essayant de donner le
sens
au travail des salariés.
143 Matsui, 1977 : 76.
social déjà établi en milieu
rural144.
Ensuite, dans le prolongement de la Réforme agraire, la
politique de défrichement a été mise en oeuvre par la
vente et le rachat nationaux de terrains cultivables antérieurement
possédés par l'Etat impérial ou les propriétaires
terriens absentéistes145. Ces terrains ont été
défrichés par de nouveaux cultivateurs appelés «
nyûshôku-sha (littéralement parlant, `colons') ». Les
terrains ainsi défrichés ont atteint 22% de la surface agricole
totale utilisée auparavant146.
Ces nouveaux cultivateurs ont souffert du manque de
denrées alimentaires et de mauvaises conditions de leurs terrains jusque
vers 1952 - 1953147. Les anciens foyers agricoles n'ont pas connu
une situation de famine aussi grave que celle que subissait la population en
général. Au contraire, ils ont bénéficié de
l'« inflation rurale (nôson inhule) » en raison d'une hausse du
prix des denrées alimentaires de base telles que le riz, le blé
et la patate douce.
Cette décennie était une époque
marquée par l'augmentation de la production pour le rationnement et le
contraste entre la souffrance et la pauvreté des nouveaux cultivateurs,
habitants des nouveaux quartiers, et le bénéfice des anciens
foyers agricoles, habitants des anciens villages, grâce à leur
production pour le rationnement148.
Réforme agraire
La politique de la Réforme agraire fut mise en oeuvre
au niveau municipal par un système complexe de régulation avec
l'instauration d'une « commission agraire (nôchi iinkai) »
composée par des propriétaires, des fermiers élus par
suffrage communal, ainsi que des villageois et des fonctionnaires locaux etc.
Puis, l'Etat a racheté et redistribué aux cultivateurs les
terrains dont la disponibilité avait été
réglée par cette commission.
Dans le cas de la Ville de Toyota, cette réforme a eu
un très bon résultat. La surface totale des terrains
rachetés par l'Etat dans la réforme est de 1756.7ha, soit 32.7%
de la surface agricole totale de la Ville, et 6578 foyers agricoles ont
reçu ces terrains ainsi libérés149. En moyenne,
79.8% des terrains cultivés en fermage ont été
rachetés par l'Etat et revendus aux fermiers150. En 1950, le
taux des terrains en fermage est passé de 38% à 9%. (Au niveau
national, il est passé de 46.2% à 13.1%) Dans la Ville de Toyota,
malgré quelques résistances de la part de propriétaires,
l'objectif de la création des cultivateurs propriétaires a
été presque atteint par la coopération de la
majorité des fermiers et des propriétaires151.
Mais, l'auteur relève un point de paradoxe de cette
réforme à partir du cas de la Ville de Toyota. En
réalité, la plupart des propriétaires terriens qui ont
dû libérer leurs terrains, n'en avaient que de petite taille. Les
propriétaires ayant libéré moins de 0.5ha occupaient 64.4%
du nombre total des propriétaires ayant libéré des
144 Ibid.
145 Ibid.
146 Ibid.
147 Ibid. : 76-77.
148 Ibid. : 77.
149 Ibid. 84
150 Ibid. 88 Les fermiers cultivant à plus grande
échelle avaient tendance à recevoir plus de terrains.
151 Ibid. La « réussite »
générale de la Réforme agraire japonaise dans
l'immédiat après-guerre suscite diverses
interprétations
possibles et de nombreux débats intellectuels
chez les historiens, les politologues et les économistes etc. Certains
rejoignent la
position de la politique américaine dominante en
attribuant la cause de la réussite à l'initiative de MacArthur
ayant voulu abolir le système agraire basé sur la relation
propriétaire terrien - fermier en interprétant celle-ci comme
subsistance du système féodal, et
ainsi le « démocratiser ». D'autres les
contredisent en l'attribuant à la cause « culturelle » (ou
plutôt « civilisationnelle ») en
insistant sur le fait que l'idéal de la réforme
agraire existait déjà dans l'antiquité japonaise au
7ème siècle où fut réalisée,
selon le
modèle de la dynastie chinoise Tang, une politique
étatique de la distribution égalitaire des terrains agricoles au
peuple (Calvet,
2002 : 71). Sur ce point, R. Calvet propose récemment
divers points de vue historiques approfondis qui nous permettent de
relativiser ces deux points de vue extrèmistes. (Calvet,
2002) A notre égard, ces deux points de vue ne semblent ni basés
sur la
réalité sociale et locale de la mise en oeuvre de
cette politique au Japon, ni sur les besoins et l'initiative réels de la
population
locale de l'époque. Pour comprendre la «
réussite » de cette mise en oeuvre politique, nous devrions du
moins prendre en compte
les besoins, les comportements et les représentations
spécifiques et la relation sociale au sein des agents ayant
participé aux
procédures dans lesquelles le rôle la Commission
agraire était notamment important. Nous n'aborderons pas ici ce
débat, mais nous
interrogeons plutôt les conséquences de
cette mise en oeuvre politique sur la réalité sociale et locale,
tant sur le court terme que sur
le long terme.
terrains, et ceux ayant libéré moins d'un
hectare occupaient 86.7%. Puis, si les « propriétaires
absentéistes » occupaient 40.6% de tous les propriétaires
touchés par cette réforme, la plupart d'entre eux habitaient, en
réalité, dans un village ou un bourg voisin de celui où se
situaient leurs terrains, qui est aujourd'hui situé dans le même
territoire de la Ville de Toyota. C'est pouquoi cette réforme a
été mal reçue par ces petits propriétaires
terriens. Et l'auteur ajoute qu'une bonne partie de ces terrains ainsi
libérés ont dû être vendus lors du processus
d'urbanisation après 1955. C'est pourquoi l'Etat a décidé
en 1965 d'indémniser ces anciens propriétaires.
Après les procédures de la Réforme
agraire, la « Commision agraire » s'est reconstituée, en 1951,
en « Commision agricole (nôgyô iinkai) », chargée
jusqu'à nos jours des procédures de la mobilisation des terrains
agricoles telle que le remembrement, l'achat et le contrat de fermage. C'est
elle qui donne aux particuliers l'autorisation finale au sein de
l'administration municipale pour l'aquisition ou la location de terrains
agricoles152.
Politique de défrichement
La politique de défrichement était promue par
l'Etat dans le cadre de la Réforme agraire pour faire directement face
à la crise alimentaire ainsi qu'au chômage causé par la
défaite lors de la guerre153. En effet, les problèmes
pour le Japon de cette époque étaient en premier la crise
alimentaire, et en second le chômage causé par la défaite
de la guerre ainsi que les soldats et les habitants de l'étranger
rapatriés au Japon154. Ils ont été
encouragés à être de nouveaux cultivateurs en recevant des
terrains libérés par l'Etat qui appartenaient auparavant soit
à des propriétaires terriens, soit à l'Etat
impérial.
Dans la Ville de Toyota, en 1947, 434 nouveaux cultivateurs et
2588 anciens foyers agricoles au total ont participé au
défrichement pour cultiver nouvellement 151 5.4ha soit 22% de la surface
totale agricole du territoire de la Ville155. Ce fut donc un grand
défrichement.
Les conditions d'admission des nouveaux cultivateurs
étaient dans un premier temps, d'être chômeur, soldat ou
habitant rapatrié. Mais au fur et à mesure que la crise
alimentaire se stabilisa, la politique favorisa davantage les ex-agriculteurs
revenants de l'étranger, les cadets ou les troisièmes
garçons des fermes et les petits foyers agricoles etc156. Du
coup, la moitié des participants au défrichement était des
personnes originaires d'anciens foyers agricoles locaux, 41% étaient des
chômeurs urbains et 9% étaient des soldats et des habitants
rapatriés157. Les nouveaux cultivateurs étaient
généralement jeunes : les personnes d'une vingtaine
d'années occupaient 10.3% ; celles d'une vingtaine à une
quarantaine d'années 78%158. 44.9% des nouveaux cultivateurs
étaient originaires du territoire de la Ville de Toyota, et 22.8%
originaires de l'extérieur du département d'Aichi. Si cette
mesure avait tendance à être destinée aux cadets ou
troisièmes garçons des foyers agricoles locaux ou aux petits
exploitants, chaque quartier de cultivateurs appelé «
frontière (kaitaku-chi) » était composé de personnes
d'origines géographiques
hétérogènes159.
Les nouveaux cultivateurs ont tous défriché sans
recours aux machines agricoles. Leurs conditions de vie et celles des terrains
agricoles étaient souvent défavorables jusque vers 1952, 1953
où la vie a commencé à se stabiliser. Mais, jusqu'en 1969,
151 .8ha des terrains défrichés ont été reconvertis
pour la construction d'usines et d'habitats urbains, et 175 foyers de nouveaux
cultivateurs ont quitté leurs quartiers pour aller travailler en tant
que salarié non agricole160. Les terrains remis en friche
augmentèrent également161.
152 Ainsi, la Commission agricole joue également un
rôle important dans les procédures de l'entremise de terrains
agricoles
assurée par le Centre Nô-Life.
153 Ibid. : 89
154 Ibid.
155 Ibid. : 90.
156 Ibid. : 95.
157 Ibid.
158 Ibid.
159 Ibid.
160 Ibid. : 93.
161 Ibid. Enfin, de notre point de vue, il serait
intéressant de mettre en parallèle cette politique du «
retour à la terre » des citoyens,
avec le Projet Nô-Life. Ces deux politiques s'inscrivent
dans deux contextes sociaux extrêmement différents (famine et
chômage
de masse d'un côté, crise agricole et retraite de
masse de l'autre). Mais nous pouvons trouver une coïncidence entre ces
deux
Augmentation de la production alimentaire
Si, à la fin des années 40, les nouveaux
cultivateurs ont vécu la souffrance de la crise alimentaire pendant leur
défrichement, la population des anciens foyers agricoles s'est
efforcée à augmenter sa production pour le rationnement à
la demande urgente de l'Etat162. Ces foyers ont largement pu
bénéficier de l' « inflation rurale » suite à la
grande hausse des prix alimentaires ainsi qu'à la montée des
marchés noirs urbains163. Mais, dès que la crise
alimentaire s'est stabilisée dans les années 50, les agriculteurs
ont dû convertir leur production destinée rationnement en de
nouvelles denrées commerciales164. D'où l'appellation
de la période du début des années 50 « tournant de
l'agriculture (nôgyô no magarikado)».
En fait, dès 1948, un journal local de la région
de la Ville de Toyota annonça que le montant d'épargne des foyers
agricoles de la région avait cessé de
croître165. Et jusque vers 1953 - 1954, les foyers agricoles
se contentèrent d'augmenter la production des mêmes denrées
alimentaires de base pour le rationnement, dont le prix était
assuré par l'Etat, et ne cherchèrent ni à introduire de
nouveaux produits, ni à innover dans leur mode de
production166. Cependant, dès que la crise alimentaire s'est
stabilisée au début des années 50, et que l'Etat a
cessé de contrôler la production du blé en 1952, que le
prix des denrées alimentaires de base a cessé de monter, on
commença à parler du « tournant » dans le monde
agricole167. Des mouvements vers la spécialisation et la
diversification des productions agricoles ont ainsi été
amorcés avec la riziculture, les cultures maraîchère et
fruitière, les vers à soie, les élevages (aviculture,
porcs, vaches laitières etc).
Rapport important mais implicite entre ce « tournant »
et la stratégie américaine
Relevons ici un point que l'auteur ne mentionne pas, mais qui
nous semble important : il s'agit du rapport implicite, entre ce discours du
« tournant de l'agriculture » et la conjoncture internationale de
cette époque. En fait, le gouvernement japonais a commencé
à importer le blé américain à partir de 1954,
fameuse période de la surproduction mondiale de blé. C'est dans
le cadre de l'accord MSA (U.S. and Japan Mutual Defense Assistance
Agreement) que le Japon a accepté cette « aide alimentaire
» en échange de l'acceptation de l'aide militaire américaine
au Japon ainsi qu'au nom de la reconstruction économique du
Japon168.
Ce tournant n'était donc pas sans rapport avec la
stratégie mondiale de la politique américaine de cette
époque. Selon Cl. Servolin, économiste agricole français,
le blé et le maïs constituaient le plus important des
marchés internationaux de produits agricoles, « tant par son volume
que par son rôle stratégique169 ». Et l'origine de
ce marché se trouve dans « le système de régulation
agricole des Etats-Unis tel qu'il fut mis en place sous Roosvelt lors de la
crise des années 30 et renforcé après la guerre et surtout
après la Public law 480 de 1954170 ».
Dès les années 50, les excédents
américains de céréales ainsi que ceux de soja ont
été « impossibles à contrôler171
». Dès lors, « le gouvernement américain a
adopté une politique d'exportations massives à bas prix qui a
été employée délibérément à
des fins de stratégie politique générale en direction des
pays en voie de
politiques dans le sens de la combinaison de la politique sociale
urbaine et et de la politique agricole territoriale, en faisant appel
aux citoyens volontaires...
162 Ibid.
163 Ibid.
164 Ibid.
165 Ibid. : 107.
166 Ibid.
167 Ibid.
168 Suzuki, 2003 : 17.
169 Servolin, 1989 : 101.
170 Ibid. Servolin relève que le système
américain de la régulation agricole ne ressemble pas à
celui préconisé par le
« libéralisme », mais plutôt à
celui du protectionnisme européen : « Contrairement à un
préjugé tenace, l'agriculture américaine
n'obéit pas aux règles du « libéralisme
» et est gouvernée par un système de gestion étatique
très semblable à ce que nous
connaissons de ce côté de l'Atlantique
»(Ibid.)
171 Ibid.
développement »172.
Et le Japon a accepté en 1954, en renouvellant l'accord
MSA, les conditions fixées par le Public law 480
américain dont l'appellation officielle est « Agriculture Trade
Developpement and Assistance Act »173 Une de ces
conditions voulaient permettre au Japon d'utiliser une partie du
bénéfice de la vente des produits américains
effectuée à l'intérieur du pays, pour la reconstruction
économique. Mais d'autres conditions permettaient également aux
Etats-Unis d'utiliser une partie de ce bénéfice au profit de la
campagne des produits américains dans le pays
bénéficiaire, ainsi que d'offrir les produits américains
sans contrepartie aux cantines scolaires174. Les pays qui ont conclu
l'accord dans le cadre de cette loi avec les Etats-Unis, étaient
l'Italie, l'Ex-Yougoslavie, la Turquie, le Pakistan, le Japon, la Corée,
Taïwan etc175.
Selon cet accord, le gouvernement japonais a fait, avec l'aide
américaine, une campagne massive pour « moderniser » et «
améliorer » la vie alimentaire de la population japonaise en
promouvant le style de vie alimentaire occidental par l'introduction du pain et
du lait combinés avec les viandes, les oeufs cuisinés à
l'huile, ainsi que les produits laitiers. Ce qui va radicalement changer le
style de vie alimentaire des japonais de l'après-guerre. En effet, dans
cette décennie de la « réforme de l'après-guerre
», la vie alimentaire de la grande majorité de la population
japonaise était encore basée sur le riz, les
céréales, les produits végétaux et les
poissons176.
1955-1965 : Naissance et formation de la Ville de
Toyota
La deuxième décennie de l'évolution
agricole et rurale est marquée par le passage de la production pour le
rationnement dans le contexte de la crise alimentaire, à celle pour la
commercialisation après la sortie de cette crise. Ce « tournant
» du mode de production agricole a impliqué la diversification et
la spécialisation de production agricoles vers le domaine de la
riziculture, des légumes, des fruits et des élevages. Pour
promouvoir ce nouveau type de production, l'Etat a également
lancé une politique intitulée « mesures pour la nouvelle
construction rurale (shin nôson kensetsu jigyô) » qui
consistait à créer une série d'établissements
dotés d'équipements pour la production et la distribution
agricoles en commun au niveau des villages et des quartiers.
En même temps, la Ville de Toyota a commencé
à connaître une grande concentration industrielle dans cette
période. Ce qui a provoqué une absorption massive de la
main-d'oeuvre agricole dans le secteur non agricole, et a ensuite
généralisé la pluriactivité des foyers
agricoles.
Si les contenus des productions ont changé de
destination en s'orientant vers la commercialisation de manière de plus
en plus spécialisée, les foyers agricoles ont
parallèlement connu un affaiblissement important de leur main-d'oeuvre.
En effet, la situation de pluriactivité s'est
généralisée au sein des foyers agricoles quelle que soit
la taille de leur exploitation et leur ancienneté. Ainsi, ils ont
rapidement perdu leur main-d'oeuvre masculine et jeune, et les femmes et les
hommes âgés sont alors devenus majoritaires au sein de la
main-d'oeuvre agricole.
Et la modernisation agricole consistant en l'utilisation des
machines agricoles (tracteur, moissonneur, batteur, pulvérisateur de
pesticides etc) et des produits chimiques (engrais, pesticides), a
favorisé à la fois le développement de la production de
type marchand et l'avancement de la situation de pluriactivité
grâce à cette simplification des travaux agricoles.
172 « C'est ce qu'on a appelé `l'arme alimentaire'.
Ces bas prix sont rendus possibles par les faibles coûts de production,
mais aussi
par les subventions versées par l'Etat
fédéral aux producteurs » (Ibid.)
173 Suzuki, 2003 : 22.
174 Ibid. : 23.
175 Ibid. : 25.
176 Ibid. : 13-42.
Politique pour la production de type marchand : mesures pour la
« Nouvelle construction rurale »
Les mesures pour la « Nouvelle construction rurale » a
duré de 1956 à 1960 avant l'établissement de la Loi
fondamentale de l'agriculture (Nôgyô-kihon hô) adoptée
en 1961 177.
Les zones d'application ayant fait l'objet de cette politique,
étaient dispercées de manière exhaustive dans le
territoire de la Ville de Toyota178. Ceci à la
différence des mesures pour l'Amélioration de la structure
agricole qui visera, après 1963, des zones d'application de
manière plus intensive et sélective. Ainsi, dans le cadre de
cette politique, dans la Ville de Toyota, 65 projets ont été mis
en oeuvre sur 45 quartiers dans le cadre de cette politique179.
D'après l'auteur, cette politique avait non seulement pour objectif
d'augmenter la production, mais également d'améliorer le
système de la distribution, la gestion de production et les conditions
de vie de la population agricole tout en renforçant leurs
activités communes pour la production180. Parmi ces 65
projets, on peut noter la mise en place de centres de calibrage sur 29
quartiers, celle de centres de production en commun sur 27 quartiers et celle
de machines à l'utilisation commune sur 4 quartiers181.
Mais l'échelle de cette politique était
relativement basse au niveau financier182. Et cette politique
restait « incitative » pour changer la production agricole
destinée au rationnement. C'est pouquoi la réalisation de
l'objetif de cette politique était finalement
incomplet183.
Pluriactivité généralisée et
affaiblissement de la main-d'oeuvre agricole
La concentration industrielle qui a commencé dans la
Ville de Toyota à partir de 1955, a rapidement élargi son
marché d'emploi. La population agricole a de plus en plus
été absorbée dans les entreprises ou les travaux de
construction comme journalier ou « homme de peine (ninpu)
»184.
Evolution du nombre des foyers agricoles pluriactifs
entre 1960 et 1965
|
1960 (Shôwa 30)
|
1965 (Shôwa 35)
|
|
Foyers agricoles au total
|
10 629
|
10 092
|
|
Foyers agricoles professionnels
|
2 932
|
877
|
|
Foyers agricoles pluriactifs
de la première
catégorie
|
4 038
|
3 695
|
|
Foyers agricoles pluriactifs
de la deuxième
catégorie
|
3 659
|
5 520
|
|
Foyers agricoles pluriactifs au total
|
7 697
|
9 215
|
(Ibid. : 427)
L'avancement de la situation de pluriactivité
était considérable entre 1960 et 1965 : le nombre des foyers
agricoles professionnels ayant diminué de 70.1% (de 2932 à 877),
soit de 27.6% à 8.7% en pourcentage sur le nombre total des
exploitations185. Alors que le nombre des « foyers agricoles
pluriactifs de la première catégorie » a diminué de
8% (de 4038 à 3695), le nombre des « foyers agricoles pluriactifs
de la deuxième catégorie » a augmenté de 50.9%, et
passa de 34.4% à 54.7%186 . A savoir que les foyers agricoles
pluriactifs de
177 Matsui, 1977 : 429.
178 Ibid.
179 Ibid.
180 Ibid.
181 Ibid.
182 Ibid. : 430.
183 Ibid. : 431.
184 Ibid. : 433.
185 Ibid. : 427.
186 Ibid. Le « foyer agricole de la première
catégorie » et « [celui] de la deuxième
catégorie » sont des termes spécifiques de la
statistique
japonaise. Le premier désigne un foyer agricole où plus d'une
personne parmi ses membres travaille à l'extérieur du
la deuxième catégorie sont devenus majoritaires
à cette période. Et le pourcentage du nombre de tous les foyers
agricoles pluriactifs sur le nombre total des foyers agricoles est passé
de 72.4% à 91.3% (de 7697 à 9215)187.
Evolution des professions occupées par
les
foyers agricoles pluriactifs entre 1960 et 1965
|
|
1960 (Shôwa 30)
|
1965 (Shôwa 35)
|
|
Foyers agricoles
pluriactifs salariés
|
Total
|
6 072
|
8 003
|
|
Employés permanents
|
1 562
|
2 236
|
|
Ouvriers permanents
|
3 593
|
4 040
|
|
Dekasegi
|
6
|
155
|
|
Hommes de peine
et journaliers
|
911
|
1 572
|
|
Foyers agricoles
Pluriactifs non salariés
|
Total
|
1 625
|
1 212
|
(Ibid. : 427)
En 1965, parmi les professions occupées par ces foyers
pluriactifs, 86.8% sont des salariés188. La plupart de ces
salariés pluriactifs vont au travail en résidant dans leur foyer
agricole189. Pour le reste de la population agricole pluriactive, il
existait en moyenne montagne des petites activités artisanales (ex.
tissage aux moulins à eau) et forestières, ainsi que de petits
commerces à la périphérie du
centre-ville190.
Entre 1960 et 1965, le nombre total des foyers pluriactifs
salariés a augmenté de 31% (de 6072 à 8003). Dans cette
période, le nombre de foyers pluriactifs travaillant comme homme de
peine ou journaliers augmenta considérablement (de 911 à 1572)
ainsi que celui travaillant comme « employé permanent » (1562
à 2236), et celui tavaillant comme « ouvrier permanent » (3593
à 4040)191. Donc, parmi les foyers agricoles pluriactifs
salariés, ceux qui travaillaient comme « employé ou ouvrier
permanent » représentaient 68.1%. Ce qui montre un
élargissement important du marché de l'emploi par la
concentration industrielle192.
Par contre, le nombre des foyers dont des membres allaient
travailler dans d'autres régions en tant que saisonniers, connus sous
l'appellation fameuse de « dekasegi (travailleurs immigrants) »,
resta très bas dans la Ville de Toyota, même si nous constatons
une augmentation nette du nombre de ce type de foyers entre 1960 et 1965 (de 9
à 155)193
Si en 1950, le taux de pluriactivité atteignait
déjà 60% dans une zone de moyenne montagne, ce taux restait pour
le reste du territoire de la Ville de Toyota, ce taux restait en moyenne
d'environ 45%194. Mais en 1960, le taux moyen attint 70% sauf pour
la zone du sud propice à la grande riziculture195. En 1965,
l'avancement de la
foyer, et dont le revenu provenant des travaux à
l'extérieur est inférieur au revenu agricole du foyer. Le second
désigne donc les
foyers agricoles pluriactifs mais dont le revenu provenant des
travaux à l'extérieur est supérieur au revenu agricole du
foyer.
187 Ibid.
188 Ibid.
189 Ibid.
190 Ibid.
191 Ibid.
192 Ibid.
193 Ibid. A. Berque explique ainsi en 1973 le
phénomène de « dekasegi » au Japon : « En
chiffre absolus, ce sont les régions peu urbanisées qui faute
d'emplois sur place, dépêchent vers les villes la plus grosse
masse d'alternants ; c'est-à-dire qu'il s'agit pour beaucoup d'entre eux
(le cinquième dans le Tôhoku) d'une migration à longue
distance et d'une absence de six mois et plus. C'est
ce qu'on appelle le dékasegi, partir gagner sa
vie ». D'où la situation de l'époque, qualifiée
de la « prolétarisation du paysan
japonais » : « Si (...) on
considère que les conditions dans lesquelles sont employés les
alternants sont beaucoup plus mauvaises
que celles que l'action syndicale peut assurer aux ouvriers
ou employés à part entière, et que leur milieu de vie est
totalement
déficient (logement en hanba [bidonville en japonais],
baraques sans eau, sans chauffage...), la prolétarisation du
paysan
japonais apparaîtra incomparablement plus grave que
chez nous : sans parler d'éventuels actes de piraterie
(prélèvements d'intermédiaires marrons, etc.), il est
inévitable que les foules qui se présentent
régulièrement à l'embauche inévitable que
les
foules qui se présentent régulièrement
à l'embauche à la fin de la saison agricole soient
employées au rabais. » (Berque, 1973 :
336)
194 Ibid. : 428.
195 Ibid.
situation de pluriactivité s'est
généralisé : le taux moyen a atteint plus de 90% sans
exception géographique196.
Concernant cette généralisation du taux de
pluriactivité, nous le verrons plus bas, la mécanisation agricole
de la riziculture a joué un rôle important. Ainsi, le taux moyen
de pluriactivité de la Ville de Toyota (91.3%) a dépassé
celui du département d'Aichi (86.2%) en 1965197.
Modernisation agricole et réorganisation territoriale de
la production
Parallèlement à la politique nationale pour la
promotion de la production destinée à la commercialisation, les
trois types suivants de réaction des foyers agricoles sont apparus dans
la situation de pluriactivité avancée198.
1 Avancement de l'état de pluriactivité
\u8594æ diminution de la production agricole \u8594æ déprise
agricole (datsunô-ka)
2 Exploitations familiales qui se lancent dans une production de
type marchand comme une entreprise
3 Réorganisation territoriale de la production entre les
foyers professionnels et pluriactifs
Le premier type d'évolution est le plus
général. Le deuxième type d'évolution concerne des
foyers agricoles qui gèrent leurs activités de manière
autonome. Les foyers agricoles de ce type sont présents de
manière dispersée sur le territoire de la Ville de Toyota. Le
troisième type d'évolution s'inscrit dans la politique de la
modernisation agricole axée sur la mécanisation et la
simplification des travaux rizicoles.
Mécanisation agricole rapidement
généralisée
Entre 1960 et 1965, la mécanisation agricole s'est
rapidement diffusée dans le domaine de la riziculture. Pendant la
guerre, sous la forme de l'utilisation communale, la batteuse à moteur
(dakkoku-ki) et la machine à monder le riz à moteur (momizuri)
avaient déjà remplacé la batteuse à pédale
et l'urne pour monder le riz199. Ensuite, un herbicide
dénommé « 24D » s'est diffusé dès la fin
de la guerre200. Puis vers 1960-1963, un nouvel herbicide
appelé « PCP » a remplacé le précédent
vers 1960-1963201. Ce qui a libéré les paysans du
travail le plus pénible dans la riziculture : le désherbage
estival202.
Puis, la machine à sécher le riz s'est
diffusée vers 1960, ce qui a causé la disparition du travail de
séchage des grains de riz en hiver dans les cours de
fermes203.
Vers 1963, le pulvérisateur de pesticides pour la
prévention des maladies s'est
généralisé204. Ceci en même temps que le
remplacement du boeuf de labour par le tracteur, ainsi que celui du fumier par
les engrais chimiques205. Ce qui a presque complètement
libéré les paysans des travaux estivaux de la
rizière206. Puis, vers 1965, le désherbage des bords
des rizières a commencé à s'effectuer par la machine
à faucher207.
Le tableau ci-après montre l'état d'avancement
de la diffusion de la mécanisation agricole dans la Ville de Toyota. En
1960, si la possession individuelle du moteur et de la batteurse à
moteur s'est diffusée au sein de 40 à 45% des foyers agricoles,
l'utilisation du tracteur était encore minoritaire. Mais en 1965, la
diffusion du tracteur était massive et rapide : 46.8% des foyers
agricoles possèdaient soit un motoculteur, soit un tracteur.
La mécanisation agricole pour la riziculture
diffusée entre 1955 à 1965 a favorisé à la fois
l'avancement de la situation de pluriactivité, la production de type
marchand et la réorganisation territoriale de la production
196 Ibid.
197 Ibid.
198 Ibid. : 445.
199 Ibid. : 446.
200 Ibid.
201 Ibid.
202 Ibid.
203 Ibid. Ce qui a, en même temps, fait disparaître
le rôle de la cour de ferme.
204 Ibid.
205 Ibid.
206 Ibid.
207 Ibid.
agricole208
Situation de l'introduction des machines
agricoles
1960
|
|
|
1965
|
|
Motoculteur, tracteur
|
Possession individuelle
|
667
|
4 725
|
|
Possession collective
|
14
|
126
|
|
Pulvérisateur à moteur
(en liquide)
|
Possession individuelle
|
271
|
1 108
|
|
Possession collective
|
62
|
96
|
|
Pulvérisateur à moteur
(en poudre)
|
Possession individuelle
|
70
|
99
|
|
Possession collective
|
67
|
9
|
|
Camionnette,
voiture à troie roues
|
Possession individuelle
|
267
|
827
|
|
Possession collective
|
6
|
32
|
|
Nombre total des foyers agricoles
|
10 629
|
10 092
|
(Ibid. : 447)
Riziculture collective
En 1957, la « riziculture collective
(shûdan-suitô-saibai) » a été promue par un
ingénieur agricole de l'Institut départemental de la recherche
agronomique d'Aichi (Aichi Nôgyô Shiken Jô), dans le but
d'augmenter la production rizicole209. Il s'agissait d'unifier les
variétés de riz et les méthodes de culture, et ainsi
d'uniformiser le calendrier agricole et de collectiviser les activités
de production (fertilisation, traitements chimiques, irrigation
etc)210.
Dans la Ville de Toyota, la riziculture collective s'est
répandue dans la situation de pluriactivité
généralisée211. Ceci de sorte à confier
aux foyers professionnels la gestion de production et les travaux
pénibles (labours, pulvérisations etc), alors que les femmes au
sein de foyers agricoles pluriactifs ont uniquement fourni une aide pour la
plantation du riz qui n'était pas encore mécanisée
à cette époque212.
Mais au fur et à mesure que la situation de
pluriactivité se généralisa, même dans les foyers
agricoles professionels qui jouaient le rôle de « leader »
parmi les producteurs locaux participant à la riziculture collective, ce
type d'organisation de la production rizicole s'est rapidement
effondré213.
Production commerciale à l'initiative de femmes au
foyer agricole
A côté des rizicultures collectives, un type
d'organisation de production particulier est apparu vers 1955. Il s'agit de
femmes au sein de petits foyers agricoles pluriactifs qui se sont
organisées au sein de la Coopérative agricole de
Koromo,214 pour produire des légumes à la demande de
la Coopérative de consommation de Toyota (Toyota seikyô), qui
voulait les utiliser pour les cantines des ouvriers de l'Automobile
Toyota215. En 1963, 30 000 plats par jour étaient
préparés par la Coopérative de consommation de Toyota. Et
la même année, 15 groupes composés par 184 foyers agricoles
ont participé à cette production
légumière216. A partir de cette
année-là, alors que le nombre de foyers participants a
progressivement diminué (120 foyers en 1968 ; 54 personnes en 1975),
l'échelle de production par foyer a été agrandi.
208 Ibid. : 448.
209 Ibid.
210 Ibid.
211 Ibid.
212 Ibid.
213 Ibid. : 450-451.
214 L'ancien nom de la Coopérative agricole de Toyota.
215 Ibid. : 451.
216 Ibid. : 452.
Cette organisation de production montre une forme
d'agriculture spécifique née dans le processus de l'avancement de
la situation de pluriactivité dû au contexte de la concentration
industrielle dans la Ville de Toyota entre 1955 et 1965.
1965-1975 : période de la Haute croissance
économique
Pendant la troisième décennie,
l'élargissement de la production industrielle a continué à
absorber la main-d'oeuvre agricole217. Puis, l'urbanisation
explosive qui l'a suivie, a dégradé des terrains
agricoles218. Le nombre des foyers agricoles pluriactifs de la
deuxième catégorie a augmenté de manière
spectaculaire, et la production agricole a stagné219.
L'Etat a alors mis en place une série de nouvelles
mesures de la modernisation agricole dictées par la Loi fondamentale de
l'agriculture établie en 1961. Cette loi a déterminé
l'objectif de la politique agricole centré sur l'accroisement de la
productivité et du revenu agricole, afin que l'agriculture et les
agriculteurs s'adaptent à la Haute croissance
économique220, ainsi qu'au niveau de la productivité
et du revenu des autres secteurs industriels221. Ses applications
consistaient surtout à l' « agrandissement sélectif
(sentaku-teki kakudai) ». Il s'agissait de la spécialisation de la
production et de l'accroisement de la productivité, adaptés aux
demandes du marché.
La mécanisation de la production rizicole s'est de plus en
plus développée. Mais le domaine rizicole s'est rapidement
heurté à la surproduction, et à la politique du
contrôle de la production mise en place par la suite222.
Des productions agricoles à grande échelle
apparurent de plus en plus dans les domaines de la culture
maraîchère, de l'horticulture, des élevages et de
l'arboriculture. On les considère généralement comme des
« formes d'agriculture adaptées à la période de la
Haute croissance223 »
Urbanisation et dégradation de la situation agricole
Diminution des terrains agricoles
Les terrains agricoles de la Ville de Toyota fut
considérablement détruits et réduits par la concentration
industrielle entre 1960 et 1965 ainsi que par la construction des trois usines
de l'Automobile Toyota entre 1965 et 1970224, puis par
l'urbanisation résidentielle qui a suivi ce développement de
l'industrie automobile225.
Si, depuis l'époque de la réforme de
l'immédiat après-guerre jusqu'en 1960, la surface agricole a
augmenté de près de 700ha (de 8000ha à 8700ha) dans la
Ville de Toyota, elle a diminué de près de 3 100ha (soit 35.7% de
diminution) au cours des quinze années de l'urbanisation qui ont suivi
cette période226.
217 Ibid. : 551.
218 Ibid.
219 Ibid.
220 La période de la Haute croissance économique
japonaise (Kôdo keizai seichô jidai) couvre
généralement les vingt années
allant de 1955 à 1975.
221 Ibid. Voici l'article premier de cette loi: «
L'objectif de la politique nationale relative à l'agriculture est,
compte tenu de l'importance de la mission que l'agriculture et les agriculteurs
ont pour notre industrie, notre économie et notre société
: adapter immédiatement l'agriculture et les agriculteurs à la
croissance de l'économie nationale ainsi qu'au progrès de la vie
sociale de la nation ; ajuster ses désavantages dus à ses
contraintes naturelle, économique et sociale ; accroître la
productivité agricole afin de réguler son écart avec les
autres industries ; augmenter le revenu des agriculteurs afin de
l'équilibrer au niveau de celui des travailleurs dans les autres
secteurs industriels. Cette politique envisage ainsi le développement
agricole et l'élevation du statut
des travailleurs agricoles. » (traduit par le
rédacteur)
222 Cette politique du Contrôle de production (seisan
chôsei) est généralement appelée, avec une
connotation négative, « politique
de réduction de la surface rizicole (gentan seisaku)
».
223 Ibid.
224 Usine de Kamigô en 1965 ; celle de Takaoka en 1966 ;
celle de Tsutsumi en 1970.
225 Ibid. : 551.
226 Ibid.
Evolution de la surface agricole et du nombre des
foyers agricoles
dans la Ville de Toyota entre 1950 et 1975
|
Surface totale
agricole
|
Surface
rizicole
|
Foyers agricoles
au total
|
Foyers agricoles
professionnels
|
Foyers pluriactifs
de la
deuxième
catégorie
|
|
1950 (Shôwa 25)
|
7947
|
5153
|
10933
|
5696
|
2462
|
|
1960 (Shôwa 35)
|
8716
|
5682
|
10629
|
2932
|
3659
|
|
1965 (Shôwa 40)
|
8138
|
5584
|
10092
|
877
|
5520
|
|
1970 (Shôwa 45)
|
7191
|
5209
|
9529
|
648
|
6547
|
|
1975 (Shôwa 50)
|
5604
|
4227
|
8608
|
406
|
7565
|
(Matsui, 1977 : 552)
Aggravation de la situation de pluriactivité
Cette diminution de la surface agricole est non seulement due
à l'industrialisation et à l'urbanisation, mais également
liée à la diminution du nombre des foyers agricoles ainsi
qu'à l'aggravation de la situation de
pluriactivité227. Le nombre des foyers agricoles de la Ville
de Toyota a diminué de 2325 foyers, soit 21.3% du nombre total, au cours
de 25 années (entre 1950 et 1975), et de 1484 foyers au cours de dix
années (entre 1965 et 1975)228. En même temps, le
nombre des foyers agricoles professionnels ne comptait que 406 foyers, soit
4.7% du nombre total, alors que 87.9% des foyers étaient des pluriactifs
de la deuxième catégorie229.
Dans la Ville de Toyota, de 1965 à 1975, la diminution
du nombre des foyers agricoles et l'aggravation de la situation de
pluriactivité accompagnées par la mécanisation et la
simplification des travaux agricoles, sont allés de pair avec le
processus de l'urbanisation.
La main-d'oeuvre agricole a diminué et vieilli, et
s'est de plus en plus féminisée. Le nombre des « agriculeurs
principaux (kikanteki nôgyô jyûjisha)230 » a
diminué de près de 77.1% entre 1960 et 1975 (passant de
près de 20 000 à seulement 4572)231. Alors que le
nombre des agricultrices avait peu diminué entre 1960 et 1965, il a
considérablement diminué entre 1965 et 1975232. Ainsi,
si nous pouvions compter en 1960 un homme et une femme dans un foyer agricole
comme « agriculteurs principaux », nous n'avions en 1975 que 0.2
homme et 0.3 femme de cette catégorie dans un foyer233.
Il s'agit de la féminisation et du vieillissement de la
main d'oeuvre agricole. Près de 70% de la main-d'oeuvre agricole
était féminine, et 53.3% des hommes avait plus de
60ans234. En bref, la main-d'oeuvre agricole de plus de 60ans
occupait 35.4% du nombre total de la main-d'oeuvre agricole, et celle
féminine de moins de 59ans occupait 50.7%. En fin de compte, dans la
Ville de Toyota en 1975, 86.1% de la main-d'oeuvre agricole était
âgée de plus de 60ans ou féminine235.
227 Ibid. : 553.
228 Ibid. Voir le tableau ci-dessus.
229 Ibid. Voir le tableau ci-dessus.
230 Terme spécifique de la statistique japonaise. Il
désigne les membres des foyers agricoles qui travaillent constamment
pour la production agricole.
231 Ibid.
232 Ibid.
233 Ibid.
234 Ibid. : 554.
235 Ibid. Ce phènomène de la féminisation et
du vieillissement aigus de la population agricole a été
appelé au Japon « agriculture
de trois-chan (3 chan nôgyô) ». Les «
trois-chan » désignant : papie (oji-chan), mamie (oba-chan) et
maman (oka-chan). Et A.
Berque explique également ce phénomène en
1973 : « si le vieillissement est commun à bien de nos
compagnes [françaises], la féminisation est plus remarquablement
japonaise : c'est ce qu'amèrement désigne l'expression de
kâchan nôgyô « l'agriculture de maman ». Cette
féminisation est particulièrement prononcée pour les
couches d'âges de 30 à 60 ans, c'est-à-dire celles qui ont
la charge d'un foyer. » (Berque, 1973 : 339)
Diffusion de l'extensification-simplification
(shôryoku) des travaux rizicoles et du travail en entreprise
(ukeoi)
En fonction de l'aggravation de la situation de
pluriactivité, le mode de production rizicole a eu tendance à
davantage se simplifier et s'extensifier236.
En 1975, le taux de possession du motoculteur ou du tracteur
dans les foyers agricoles, était de 79.5% et le taux d'utilisation de
86.3%237. Cette diffusion du motoculteur et du tracteur a
complètement mis fin à l'utilisation de boeufs de labour. Dans la
même année, toutes les exploitations rizicoles de plus de 30ares
possédaient au moins un motoculteur ou un tracteur238.
Suite à cette diffusion du motoculteur et du tracteur,
les agriculteurs pluriactifs ont eu tendance à finir leurs travaux
agricoles en peu de temps pour pouvoir aller travailler constamment à
l'extérieur en tant que salarié permanent239. La
machine à planter le riz, la moisonneuse et la moisonneuse-batteuse se
sont diffusées quelques années plus tard. Ainsi, en 1975, il
était rare de voir les agriculteurs faucher et planter le riz à
la main.
Cette transformation du mode de production rizicole a
été rendue possible par le développement de l'industrie
mécanique réalisé pendant la Haute croissance, alors que
l'extensification du désherbage et des traitements au cours de la
décennie de 1955-1965, a été rendue possible par le
développement de l'industrie chimique240.
La politique agricole nationale après 1970 a
renforcé cette tendance de mécanisation en promouvant
l'agrandissement d'échelle de production et l'introduction de grandes
machines agricoles. Ainsi, nous le verrons plus bas, sont apparues des
entreprises gérées par les coopératives agricoles, qui se
chargent des travaux agricoles confiés par les foyers agricoles
pluriactifs241. Et les silos et les grandes machines à monder
et sécher le riz au sein des coopératives ont commencé
leurs activités242.
Par ailleurs, dans les zones de moyenne montagne de la
région de Mikawa243, les paysans menaient
généralement une riziculture avec l'élevage de quelques
boeufs pour le labour et la viande, en la combinant à l'élevage
de vers à soies244. Puis, ils effectuaient leurs travaux
forestiers et la production du charbon de bois pendant la période creuse
d'hiver245. Mais face à la grande disparité apparue
pendant la période de la Haute croissance entre l'agriculture et
l'industrie, le déclin de l'élevage de boeufs et de vers à
soie fut amorcé en raison de leur faible
productivité246. L'agriculture traditionnelle en moyenne
montagne de la région s'est ainsi effondrée247.
Transformation de la production agricole
Dans la troisième décennie, au niveau du prix de
production, les élevages occupaient de plus en plus de place dans
l'agriculture par rapport aux cultures végétales :
élevages 34% ; cultures végétales 63.7%248.
Parmi les cultures végétales, le poids du riz augmenta alors que
celui de la production légumière baissa249. Le poids
des cultures fruitières (kaki, pêche, poire, raisin) et de la
culture spéciale (thé vert) n'était pas
important250. Le
236 Ibid. Ici, l'extensification désigne celle du travail
dite « rôdô no sohôka », mais non du capital (moyen
de production).
237 Ibid. : 555.
238 Ibid.
239 Ibid. : 556.
240 Ibid.
241 Ibid.
242 Ibid.
243 Le nom de l'ancienne province qui couvre la Ville de Toyota
et ses environs.
244 Ibid. : 558.
245 Ibid.
246 Ibid.
247 Ibid.
248 Ibid. : 564.
249 Ibid. Voici le poids du prix de production par domaine de
production en 1975 dans la Ville de Toyota : riz 41.5% ; élevages
34.0% dont l'aviculture 20.2% ; légumes 13.2%.
250 Ibid.
poids des élevages de vaches laitières et de porcs
était beaucoup moins important que celui de
l'aviculture251.
En bref, mise à part les productions
spécialisées et limitées à certains foyers
professionnels (élevages, arboriculture, horticulture, légumes),
l'agriculture de la Ville de Toyota était caractérisée par
le fait que le poids de la riziculture était important grâce
à la simplification du mode de production252.
Sinon, les productions qui connurent un important
déclin ou la disparition sont : millets ; colza ; tabac ; racines
comestibles (patates douces, taro etc) ; blé ; pois (soja, haricot
etc)253. Puis, les cultures alternées avec le riz ont
disparu254. De 1950 à 1975, si le taux de diminution des
terrains agricoles était de 29.5%, celui de la surface
récoltée était de 58.6%255.
Quant à la répartition géographique des
productions, la zone du sud (Kamigô et Takaoka) était à
dominante rizicole. D'autant plus que le nombre de foyers agricoles pluriactifs
était important dans cette zone, se développèrent des
entreprises agricoles qui se chargeaient des travaux agricoles confiés
par ces foyers256. Il existait de manière dispersée
des éleveurs, producteurs de thé, de fruits et de
légumes257.
Dans une zone du Nord (Sanage), l'arboriculture
spécialisée dans la pêche, le Kaki et la poire s'est
développée258. Il existait également des zones
d'élevages dans des quartiers défrichés pendant la
période de l'immédiat après-guerre259.
Contrairement à ces deux zones, aux alentours de
l'usine - siège de l'Automobile de Toyota à Koromo (construction
en 1938) et de celle de Motomachi (construction en 1959), l'agriculture s'est
effondrée suite à l'industrialisation et à l'urbanisation.
Ceci malgré le fait que ces zones ont été
défrichées par de nouveaux cultivateurs au cours de la
période de l'immédiat après-guerre260.
Mais, entre les zones du Nord et du Sud, il y a des zones de
caractère intermédiaire où des cultures rizicoles et
légumières pour la commercialisation se sont
développées de manière dispersée et
individuelle261.
En moyenne montagne, comme nous l'avons dit plus haut, la
situation des foyers agricoles a été rapidement envahie par la
pluriactivité en raison de la faible productivité de leurs
activités traditionnelles (petite riziculture, vers à soie,
charbon de bois et bois)262 C'est pourquoi l'agriculture de type
marchand ne s'est pas développée dans ces zones, et qu'une bonne
partie de terrains agricoles de moyenne montagne se sont délabrés
avec l'aggravation de la situation de pluriactivité263.
Ainsi, dans la Ville de Toyota, alors que
généralement, l'agriculture a été
dérangée par l'industrialisation et l'urbanisation, il y a une
coexistence entre, d'un côté, des zones où se sont
développées des productions de type marchand ou celles
organisées de façon à s'adapter à la situation de
pluriactivité, et de l'autre côté, des zones où
l'agriculture s'est délabrée comme c'est
généralement le cas dans des zones rurales
dépeuplées264.
Politiques de la modernisation agricole
Dans la troisième décennie, l'agriculture de la
Ville de Toyota a connu des dérangements et des transformations
considérables. Face à cette situation, loin de les ignorer,
l'administration a positivement accepté la politique
nationale265. Il s'agissait de former des exploitations agricoles
autonomes aptes à s'adapter à la
251 Ibid.
252 Ibid.
253 Ibid. : 565. Pour ce qui concerne le blé et le soja,
ils ont évidemment été remplacés par le blé
et le soja américains importés, auxquels s'ajoute
également le maïs...
254 Ibid.
255 Ibid.
256 Ibid. : 568.
257 Ibid.
258 Ibid.
259 Ibid.
260 Ibid.
261 Ibid.
262 Ibid.
263 Ibid.
264 Ibid.
265 Ibid. : 589.
disparité entre l'agriculture et l'industrie, ainsi que
d'aménager l'infrastructure de la production agricole266.
Mesures de l'amélioration de la structure agricole
Comme nous l'avons vu, la Loi fondamentale de l'agriculture
adoptée en 1961, visait l'accroisement de la productivité et
l'augmentation du revenu agricole via la rationalisation de l'agriculture
prétendant l'agrandissement d'échelle et à la
spécialisation de la production agricole. Les Mesures pour
l'Amélioration de la structure agricole (Nôgyô
Kôzô Kaizen Jigyô) sont celles qui incarnent le plus l'esprit
de cette loi. Elles consistaient à aménager l'infrastructure qui
permettrait l'aggrandissement d'échelle et la spécialisation de
la production agricole, ainsi qu'à construire des établissements
modernes ayant pour objectif de collectiviser et d'organiser la production
auprès de la coopérative agricole267.
Dans la Ville de Toyota, après 1963, ces mesures ont
été réalisées dans six quartiers, en y construisant
des établissements disposant de grandes machines et équipements
agricoles (tracteurs, moisonneuse-batteuses, pulvérisateurs, centres de
machines à sécher et monder le riz appelés « Rice
center », silos appelés « contry elevator »
etc.)268 La riziculture a fait l'objet principal de ces mesures.
L'aménagement des terrains agricoles appelé «
aménagement de l'infrastructure (kiban seibi) » consistant à
remembrer les terrains agricoles auparavant morcelés, en sorte qu'une
parcelle compte uniformément 0.3 ares. 325.6ha de rizières (soit
6.3% de la surface rizicole totale) ont ainsi été
aménagés269.
A partir du moment où la coopérative a
commencé à produire les plants de riz avec de nouveaux
équipements, la machine à planter le riz s'est rapidement
diffusée parmi les foyers agricoles. C'est-à-dire que, les
agriculteurs désormais achetaient les plants de riz à la
coopérative, plants préadaptés au dispositif de la
machine, et ainsi ne produisaient plus leurs propres plants. Et le
système des travaux rizicoles à forfait a encore plus
libéré les foyers agricoles des travaux agricoles, ce qui les a
davantage poussé à être pluriactifs.
Quelques critiques ont été émises sur ces
mesures à propos de leur effet d'accélération de la
situation de pluriactivité, ainsi que de l'aménagement de
terrains rizicoles uniformisés au détriment des conditions
naturelles du sol. Mais malgré toutes ces critiques, dans une situation
de pluriactivité déjà généralisée et
approfondie, cette politique de modernisation a eu sa légitimité
au nom de la « conservation des terrains agricoles (nôchi hozen)
» qui sont menacés de délabrement dans
l'avenir270.
Suite à l'application de ces mesures, une nouvelle
forme de gestion de production rizicole est apparue : système où
les foyers agricoles confiaient leurs travaux rizicoles à des groupes d'
« opérateurs » formés par la coopérative
agricole disposant d'un ensemble d'équipements modernes pour la
production, introduits dans le cadre des mesures de l'amélioration de la
structure agricole271.
Dans la Ville de Toyota, onze opérateurs ont
été formés au sein de la coopérative agricole de
Toyota en 1963272. Mais l'organisation du groupe de ces
opérateurs a eu des difficultés pour continuer ses
activités. En effet, en 1975, neufs opérateurs ont quitté
l'agriculture pour devenir salariés non agricole273. Du coup,
la coopérative a dû recourrir à l'emploi temporaire de
travailleurs agricoles pour organiser les activités de ce groupe.
Par ailleurs, en 1972, deux groupes d'opérateurs,
composés par des agriculteurs professionnels locaux, sont apparus dans
la zone rizicole du sud274. En collaboration avec la
coopérative agricole de ce quartier ainsi que le Centre pour la
vulgarisation agricole, ces deux groupes ont géré de
manière autonome leurs travaux pour la production, en confiant la
gestion financière à la coopérative275. En
1974, l'un des groupes composé de cinq
266 Ibid.
267 Ibid. : 590.
268 Ibid. : 591.
269 Ibid.
270 Ibid.
271 Ibid. : 592.
272 Ibid.
273 Ibid. : 593.
274 Ibid. : 594.
275 Ibid.
agriculteurs possédant individuellement 9.3ha de
rizières au total, s'est chargé de la gestion de production
entière de 39ha de rizières appartenant à d'autres foyers
agricoles locaux276. Il s'est également chargé de
travaux agricoles de manière partielle tels que le labour, le
traitement, la récolte, la préparation de plantes
etc277. Et l'autre groupe composé de sept agriculteurs
possédant individuellement au total 11 ha de rizières, s'est
chargé de la gestion entière de 33ha de rizières d'autres
foyers agricoles, en effectuant des travaux partiels comme le groupe
précédent278. L'échelle des activités de
ces deux groupes a doublé en deux ans de 1972 à
1974279. Et leur slogan de départ pour lancer ces entreprises
agricoles vers 1965, était « mouvement pour conserver la terre
agricole (nôchi wo mamoru undô) » face à la situation
aggravée de pluriactivité280.
Ces entreprises continuent leurs activités jusqu'à
aujourd'hui (en 2006), et sont toujours considérées comme un
célèbre modèle historique de la modernisation agricole
dans la Ville de Toyota.
Mesures pour la formation des « ensembles » pour la
modernisation agricole
Depuis 1970, le département d'Aichi a élargi la
politique de la réorganisation territoriale de la production agricole
dans d'autres domaines de production que la riziculture, tels que
l'élevage, l'arboriculture, les cultures spéciales
etc281. Il s'agissait de cibler des zones de production
spécialisée comme des « ensembles (danchi) »
voués à la modernisation agricole, et concentrer dans ces zones
les infrastructures de production, de transformation et de distribution. Ceci
consistait donc à construire des établissements dotés
d'équipements modernes pour la production, la transformation et la
distribution dans des zones où une production spécilalisée
est particulièrement développée, telle que la pêche
et la poire dans la zone du nord282. Cette direction du
développement agricole appelée « structuration et
systèmatisation de l'agriculture (nôgyô no sôchi-ka to
shisutemu-ka) », est basée sur la considération suivante :
la capacité d'adaptation des foyers agricoles individuels à la
demande du marché, est limitée face au renforcement de la
concurrence entre différentes régions à l'intérieur
du Japon283.
De 1970 à 1972, dans la Ville de Toyota, sept zones de
production ont ainsi été désignées comme «
ensembles » pour la modernisation agricole284. Ces zones de
production se spécialiseront chacune dans un type de production tel que
: poulet ; vers à soie ; légumes (pastèque et chou
chinois) ; oeuf ; poire ; pêche ; lait etc285.
Contrôle de la production du riz
Après 1965, la politique de la modernisation agricole
« adaptée à la Haute croissance », et notamment
destinée au domaine de la riziculture, s'est rapidement heurtée
au problème de la surprodution du riz286. Ceci à la
fois en raison de la baisse de la consommation du riz parmi la population
japonaise, liée au changement de style de vie alimentaire, et du
maintien du prix du riz assuré par l'Etat qui accepta la revendication
agricole pour ce maintien du prix287. L'Etat a donc
décidé de contrôler la production de riz dès 1970
par l'imposition de quotas de production288.
Dans la Ville de Toyota, 1 123.9ha de rizières au total
(soit 22.5%) ont été mis en jachère par l'application
de
276 Ibid.
277 Ibid.
278 Ibid.
279 Ibid. : 595.
280 Ibid. : 594.
281 Ibid. : 596.
282 Ibid. : 597.
283 Ibid.
284 Ibid.
285 Ibid.
286 Ibid. : 608.
287 Ibid.
288 Ibid.
cette politique en 1975289.
Cette politique a certainement accéléré
la tendance de l'abandon de l'agriculture au sein des foyers agricoles, ainsi
que celle de l'aggravation de la situation de pluriactivité. Elle a
particulièrement eu pour effet de diminuer le sentiment de
réticence vis-à-vis de l'abandon de la terre agricole au sein de
la population agricole qui était liée au respect de l'acte de
transmission du patrimoine familial assuré par leurs
ancêtres290. A cette époque, il était
déjà estimé que près de 850 ha de terrains
rizicoles mis en jachère avaient peu de possibilités d'être
recultivés plus tard291.
Désignation des zones réservées pour le
développement agricole
En contraste avec l'ambition de la politique de la
modernisation agricole lancée par la Loi fondamentale de l'agricultutre,
comme nous l'avons vu, la surface agricole diminue de plus en plus dans le
processus acceléré de l'urbanisation292.
La Nouvelle Loi de l'Urbanisme (Shin toshi keikaku hô),
entrée en vigueur en 1969, a introduit la désignation de la
« zone à urbaniser (shigaika kuiki) » et de la « zone
d'urbanisation contrôlée (shigaika chôsei kuiki)
»293 . Un nouveau plan d'urbanisme de la Ville de Toyota fut
établi selon cette loi en 1973. De 1961 à 1974, 1225.8ha de
terrains agricoles ont été convertis soit pour
l'industrialisation, soit pour l'urbanisation. Cette tendance de conversion
urbaine de terrains agricoles eut tendance à
s'accélerer294.
Simultanèment à cette institutionalisation de
l'urbanisation, l'Etat adopta en 1969 la « Loi pour les Zones
réservées pour le développement agricole
(Nôgyô chiiki seibi hô) ». Avec cette loi, chaque
collectivité territoriale désigna, dans la zone d'urbanisation
contrôlée, des « zones réservées pour le
développement agricole (nôgyô shinkô chiiki) »
afin d'y préserver les terrains agricoles et d'y développer
l'agriculture. Et à l'intérieur de ces zones, la
collectivité délimita des « zones vouées à
l'utilisation agricole (nôyôchi kuiki) » dans lesquelles le
type d'utilisation était limité à la production agricole
au cours des dix années à venir295.
En 1975, la Ville de Toyota a ainsi désigné
5991ha de terrains agricoles comme « zones réservées pour le
développement agricole » sur la surface totale des terrains
agricoles de 7190 ha, et délimité 372 1ha (soit 51.8% de la
surface totale) comme « zones vouées à l'utilisation
agricole »296
Cette politique de zonage est effectivement articulée
avec la politique de la modernisation agricole. En effet, les zones ainsi
désignées par la collectivité correspondent à
celles où s'appliquent les Mesures pour l'Amélioration de la
structure agricole et la formation des ensembles pour la modernisation
agricole.
Diverses formes d'agriculture : exemple de femmes de foyers
agricoles pluriactifs, archétype de l'agriculture de type Ikigai ?
En dehors de la politique de la modernisation agricole
axée sur la réorganisation territoriale et collective de la
production, il existe divers types de foyers agricoles qui s'efforcèrent
à développer des productions agricoles de type marchand en
résistant à l'urbanisation brutale au cours de cette
troisième décennie. L'auteur présente en
289 Les quotas étaient d'abord imposés par l'Etat
à chaque département, et ensuite ils ont été
imposés au niveau des collectivités territoriales (Ibid. : 611).
L'Etat a attribué des subsides aux foyers agricoles pour l'application
de cette mesure, afin d'indemniser la diminution de production (Ibid.). Le
montant des subsides était de 25000 yens pour 0.1ares de jachère,
30000 yens pour 0.1ares de conversion de culture ordinaire et individuelle,
35000 yens pour 0.1 ares de conversion de culture spécialisée et
collective (Ibid.). Cependant, les subsides pour la jachère furent
supprimés en 1973(Ibid.).
290 Ibid. : 612.
291 Ibid. Ce chiffre correspond à la surface agricole en
friche et en jachère d'aujourd'hui annoncée par la
Municipalité de Toyota.
292 Ibid. : 618.
293 La désignation de terrains comme « zone à
urbaniser » permet aux propriétaires de ces terrains de les
convertir ou de les vendre via une demande auprès de l'administration
municipale.
294 Pendant la période de la concentration industrielle
(vers 1958 - 1961) le but des conversions de terrains agricoles était
principalement industriel. Mais à partir de 1964, ceci a commencé
à être de plus en plus résidentiel. Et après 1968,
d'autres buts de conversions sont apparus de manière diverse tels que
parking, chantier (Ibid. : 618).
295 Ibid.
296 Ibid. : 621.
détails huit exemples de tentatives agricoles
individuelles. Il s'agit de diverses organisations de production agricole dont
la plupart sont familiales et professionnelles (non pluriactives), plus ou
moins spécialisées dans un certain domaine de production
(légumes, fruits, thé vert, vaches laitières, poulets et
porcs etc).
Sans tous les présenter, nous allons montrer un exemple
particulier parmi ces huit exemples, qui nous semble lié à
l'émergence d'une forme d'agriculture ni professionnelle, ni
personnelle, mais dynamique. En fait, cet exemple nous renvoie à une
forme d'agriculture « de type Ikigai » que nous mettrons en question
dans notre étude de cas du Projet Nô-Life.
Nous l'avons vu plus haut, cet exemple est, en fait, le
prolongement de la production légumière développée
à l'initiative de femmes de petits foyers agricoles pluriactifs depuis
1955. Cette production légumière était organisée au
sein de la coopérative agricole de Toyota avec 15 groupes
composés par 184 foyers agricoles pluriactifs, à la demande de la
Coopérative de consommation de Toyota qui géraient les cantines
des ouvriers de l'Automobile Toyota. En 1975, 54 personnes continuaient
à organiser cette production.
Dans le cas du quartier U, six femmes au foyer dont les maris
étaient tous des salariés non agricoles, cultivaient chacune des
légumes avec en moyenne 0.76ares de terrains de manière à
alterner plusieurs cultures dans une année297. Les produits
principaux étaient les radis blancs, les poireaux, les choux et les
carottes, mais elles cultivaient également les pommes de terre, les
choux chinois, les laitues, le persil, les courges etc298. Ces
cultures étaient organisées en rotation complexe afin de pouvoir
distribuer régulièrement des récoltes variées
à la coopérative de consommation299. Les prix des
produits étaient stablement fixés par la coordination entre la
Coopérative de consommation de Toyota et la Coopérative agricole
de Toyota300.
Les semences et les engrais étaient achetés en
commun à la coopérative301. Et dans certains foyers,
les paiements étaient prélevés sur le compte
d'épargne des maris, alors que le revenu était versé
à leurs femmes302. Ce qui fait que ces femmes pouvaient
pleinement profiter du bénéfice de leur propre production !
Grâce à ce bénéfice, les femmes au foyer de ce
groupe partaient en voyage une fois par an, ce qui renforçait leur lien
de solidarité303. Elles pouvaient ainsi obtenir un revenu
supplémentaire plus élevé que celui que l'on pouvait
obtenir par un emploi à temps partiel non agricole. C'est ainsi que l'on
a qualifié cette tentative agricole d'« agriculture de maman
complètement gagnante (kâchan nôgyô marumouke)
»304. Selon l'auteur, une « agriculture pour le plaisir
(tanoshimi nôgyô) » a ainsi été
organisée305.
Si cet exemple s'inscrit dans la situation
généralisée de féminisation de la main-d'oeuvre
agricole japonaise, il nous montre également une forme de production
née de la situation spécifique à la Ville de Toyota. A
savoir, une situation socio-économiquement hybride avec
l'industrialialisation massive et rapide d'un côté et l'avancement
de la situation de pluriactivité des foyers agricoles de l'autre. Et
cette forme de production n'est ni traditionnelle, ni modernisée en
fonction de la seule logique du marché, mais articulée avec un
certain lien social et territorial ainsi qu'avec une cetraine qualité de
vie des producteurs. Nous pourrions la considérer soit comme un «
archétype » de l'agriculture de type Ikigai dont nous allons
étudier l'émergence dans le processus de la construction du
Projet Nô-Life dans le chapitre suivant, soit comme un « indice
» de cette émergence.
4. Réflexions
297 Ibid. : 600.
298 Ibid.
299 Ibid.
300 Ibid.
301 Ibid. : 601.
302 Ibid.
303 Ibid.
304 Ibid.
305 Ibid.
Essayons de répondre aux questions posées au
début du présent chapitre : Quel est le facteur historique de
temps long de la politique municipale de la Ville de Toyota qui, pour
construire le Projet Nô-Life, a problématisé ensemble le
vieillissement de la population en majorité salariale, le manque de
main-d'oeuvre agricole et le délabrement des terrains agricoles ?
Questions du vieillissement de la population et de la crise
agricole
Concernant le vieillissement, il s'agit de la masse de
population ainsi installée dans la Ville de Toyota pendant la Haute
croissance qui atteint aujourd'hui l'âge de la retraite. Et la population
de cette génération est particulièrement importante dans
cette ville. Le vieillissement étant une thématique
généralement mise en avant au Japon, elle prend un sens encore
plus fort dans la Ville de Toyota. Mais ceci n'est pas sans rapport avec la
question proprement posée à cette ville : celle de
l'identité de la Ville. Nous reprendrons plus bas ce point en abordant
la place de la question d'Ikigai.
Concernant la crise agricole, la préoccupation de la
conservation des terrains agricoles face à la situation de
délabrement, était également présente. Et nous
avons constaté que cette préoccupation imprégnée de
la situation de crise était même présente au coeur de la
mise en oeuvre de la politique de la modernisation agricole après la Loi
fondamentale de l'agriculture de 1961. Il s'agissait notamment des entreprises
agricoles chargées de la gestion de terrains rizicoles confiés
par les foyers agricoles pluriactifs dans la zone du sud de la Ville de Toyota.
Le slogan que les agriculteurs de ces entreprises lancèrent à
cette époque était déjà le « mouvement pour
conserver la terre agricole (nôchi wo mamoru undô) ».
Cette situation est tout-à-fait compréhensible
par rapport à la situation de pluriactivité profondément
généralisée au sein des foyers agricoles dans la Ville de
Toyota, à cette époque. Comme nous l'avons vu, de 1965 à
1975, le nombre des foyers agricoles pluriactifs de la deuxième
catégorie, qui se cantonnaient beaucoup moins aux activités
agricoles qu'à leur travail salarial, a atteint plus de 80% du nombre
total des foyers agricoles. En plus, à cette même époque,
le phénomène du vieillissement et de la féminisation fut
dépassé : les jeunes femmes également commencèrent
à aller travailler en dehors de l'exploitation familiale. D'où,
à partir de cette période, le vieillissement total de la
main-d'oeuvre agricole qui était déjà affaiblie
auparavant. Le manque de porteurs de l'agriculture constitue également
une préoccupation permanente de la politique agricole.
Mais, pour aller plus loin que ce constat de lien entre les
faits, nous devons peut- être nous demander si les solutions
apportées par la politique de la modernisation agricole étaient
appropriées. Il s'agit des conséquences de cette politique
productiviste instaurée depuis les années 60. Nous avons
déjà vu que cette politique a eu pour effet d'aggraver la
situation agricole derrière certains « succès »
apparents comme la tentative des entreprises rizicoles à grand
échelle et la spécialisation - agrandissement de l'arboriculture
dans la zone du nord. Il s'agit de l'accélération de la situation
de pluriactivité au profit de certaines productions agricoles «
adaptées à la Haute croissance » et, d'ailleurs, de la Haute
croissance économique elle-même. Conformément à ce
que la Loi de 1961 dictait : l'adaptation impérative de l'agriculture et
des agriculteurs à la Haute croissance économique japonaise.
En fait, à force de relégitimer son principe
productiviste par référence à la Haute croissance
économique, la politique agricole japonaise après les
années 65-75 a eu pour effet de marginaliser les producteurs agricoles
à faible productivité et rentabilité. Et cette
marginalisation est au niveau « représentatif » au sens
politique et théatral du terme. Autrement dit, la situation agricole a
été représentée par cette politique de façon
dualiste entre les producteurs forts et faibles (ou bons et mauvais) au cours
de sa mise en oeuvre306.
Et cette politique, n'a-t-elle pas dénigré les
fruits et les efforts apportés par la population agricole et locale dans
l'immédiat après-guerre, pour la Réforme agraire et la
politique de défrichement, au profit de la grande force de la Haute
croissance donnnant la priorité aux industries fortes, à la
grande urbanisation ainsi qu'à l'économie de marché ?
Notre tâche n'étant pas d'évaluer l'effet de cette
politique agricole, nous nous garderons
306 D'où, nous le verrons dans le chapitre suivant, le
caractère très élitiste et sélectif de la politique
préconisée par l'Ex-Centre pour la Vulgarisation agricole (acteur
5), tout en restant dans la vision productiviste instaurée par la Loi de
1961.
de répondre à cette question. Mais nous pouvons
tenir compte de l'héritage de cette politique de la modernisation
agricole pour nos analyses ultérieures dans les chapitres suivants.
Place de la question d'Ikigai
Par ailleurs, concernant la question d'Ikigai, autrement dit
la mise en question du « sens de la vie » ou du lien entre l'individu
et la société, même si elle n'était pas explicite
dans notre illustration historique de 1945 à 1975, nous pouvons trouver
certains « germes » dans l'histoire de la politique de la Ville de
Toyota fortement ancrée dans la réalité de sa population.
Il s'agissait toujours du rapport entre l'industrie automobile et la vie de la
population ».
Déjà depuis 1950, lors du changement de statut
du Bourg de Koromo en Ville de Koromo, le maire, dans son discours officiel,
avait mis l'accent sur la « coopération » entre la zone
industrielle, la zone commerciale et la zone agricole qui se trouvaient dans le
territoire de la Ville de Koromo. Et en 1966, à l'époque
où l'essor de l'industrie automobile et l'agransissement de la Ville
étaient à leur apogée, la municipalité a choisi
comme slogan « ville industrielle et culturelle » axée sur une
politique locale de redistribution. Et en 1971, après toutes les fusions
avec les collectivités environnantes amorcées depuis les
années 50, son nouveau plan d'urbanisme a redéfini la
qualité de la Ville de Toyota comme un « lieu de vie social et
humain » plutôt qu'un « lieu de production .
Ne rejetons pas ces discours en les considérant comme
simple rhétorique de la part des agents de la politique dominante se
montrant favorable à leur population en majorité ouvrière
- même si ceci est vrai -, l'imporant à notre égard est de
trouver dans ces représentations de la Ville un « ancrage » ou
une « signification » particulière à la
réalité sociale et locale de cette ville.
Par là, nous pouvons évoquer les
caractéristiques de la population de la Ville de Toyota qui ont
émergé notamment dans les années 65-75 : habitations
dispercées de la population nouvelle dans des résidences
publiques construites autour des zones industrielles, mais
éloignées des zones des anciennes villes et bourgs ; peu de lien
territorial parmi cette nouvelle population et entre celle-ci et l'ancienne
population ; diversité d'origines géographiques qui implique,
dans une certaine mesure, un déracinement identitaire et une
instabilité de vie. Nous l'avons vu, le nombre des départs de
population était aussi important que celui des installations, notamment
en raison de l'arrêt du travail dans le secteur automobile, en partie
à cause du travail à la chaîne dévalorisant la
qualité individuelle des employés.
Là nous comprenons la tentative incessante de la
politique municipale de donner un sens ou une identité entre la vie de
la population et la ville elle-même. Et cet acte visait toujours à
combler le fossé entre l'intérêt de l'industrie automobile
avec laquelle la Municipalité coopérait, et celui de la
population. Nous pouvons dire que telle est la spécificité de la
politique redistributive de la Ville de Toyota. Et la question d'Ikigai n'en
est pas loin même explicitement, car, nous le verrons dans le chapitre
suivant, ce terme était largement employé dans la revendication
menée par le syndicat ouvrier de Toyota depuis le début des
années 70.
La question d'Ikigai a donc une signification
particulière entre la réalité et la représentation
propres à la Ville de Toyota, qui implique nécessairement une
dimension identitaire. Et par là, nous comprenons également que
la question d'Ikigai qui est mise en avant aujourd'hui au Japon dans le
contexte du vieillissement de la population, sera si aisément
réappropriée et appliquée dans la politique municipale de
Toyota. Ce qui aboutira, en fait, à la mise en oeuvre du Projet
Nô-Life.
Et nous ne pouvons pas exclure de notre réflexion sur
la question d'Ikigai, l'évolution du monde agricole et rural dans le
territoire de la Ville de Toyota. Nous avons bien constaté que, parmi la
population agricole pluriactive et affaiblie par le vieillissement et la
féminisation, il y avait une nouvelle dynamique émergeante et
constante : dans les années 50, plus d'une cinquantaine de femmes de
foyers agricoles pluriactifs, s'organisèrent pour cultiver plusieurs
sortes de légumes par rotation, et ensuite les distribuer aux cantines
des ouvriers de l'Automobile Toyota, par l'intermédiaire de la
Coopérative agricole de Toyota et de la Coopérative de
consommation de Toyota. Elles réussirent à réaliser le
lien entre leur solidarité menacée par la déprise
agricole, le plaisir et une production agricole de type marchand. Nous verrons
également dans le chapitre suivant que ce
type de production « dynamique » menée par la
couche de population des foyers agricoles pluriactifs, essentiellement vieillie
et féminine, sera progressivement prise en compte, dès les
années 80, par la politique agricole locale comme « agriculture de
type Ikigai » à valoriser dans une certaine mesure. Et dans le
processus de la construction du Projet Nô-Life, nous verrons que cette
« agriculture de type Ikigai » ainsi pratiquée et
représentée, rejoindra la politique municipale d'Ikigai sur le
vieillissement de la population. Par là, nous trouvons
déjà que ce Projet n'est pas un simple produit de combinaison
entre la politique du vieillissement et la politique agricole, mais
également ancré dans une signification particulière qui
est construite dans l'histoire de la Ville de Toyota après 1945, qui
renvoie à l'identité de cette ville elle-même mise en
question sans cesse au sein de sa population et sa politique.
Références
BERQUE, A. (1973), « Les campagnes japonaises et l'emprise
urbaine », Etudes rurales, n°49-50 : p.32 1-352. CALVET, R.
(2002), « La Réforme agraire japonaise de 1946 : Les fondements
historiques d'un succès », Histoire et Sociétés
Rurales, n°18, 2e semestre : p.65-89.
ITO, T. (1977), « Dai 2 setsu : Koromo-shi no tanjô
to toshi-seibi (Sous-chapitre 2 : Naissance de la Ville de Koromo et
aménagement urbain) », Dai 1 shô : Sengo kaikakuki no Toyota
(Chapitre 1 : Toyota en période de la réforme de
l'après-guerre), Toyota-shi-shi (Histoire de la Ville de
Toyota), Tome 4 : p. 13-27.
ITO, T. (1977), « Dai 3setsu : Toyota-shi no tanjô
to hatten (Sous-chapitre 3 : Naissance et développement de la Ville de
Toyota) », Dai 2shô : Toyota-shi no tanjô to keisei (Chapitre
2 : Naissance et formation de la Ville de Toyota), Toyota-shi-shi (Histoire
de la Ville de Toyota), Tome 4 : 289-350.
ITO, T. (1977), « Dai 4setsu : Toshika no shinten to
toshi-keisei (Sous-chapitre 4 : Avancement de l'urbanisation et formation de la
Ville) », Dai 3shô : Kôdo-keizai-seichô-ki no Toyota
(Chapitre 3 : Toyota en période de la Haute croissance),
Toyota-shi-shi (Histoire de la Ville de Toyota), Tome 4 :
p.630-656.
MATSUI, S. (1977), « Dai 3 setsu : Nôchikaikaku to
shokuryô-zôsan (Sous-chapitre 3 : Réforme agraire et
augmentation de la production alimentaire) », Dai 1 shô :
Sengo-kaikaku-ki no Toyota (Chapitre 1 : Toyota en période de la
réforme de l'après-guerre) in Toyota-shi-shi (Histoire de la
Ville de Toyota), tome 4 : p.76-108.
MATSUI, S. (1977), « Dai 1setsu : Kigyô-toshi
Toyota no keisei (Sous-chapitre 1 : Formation de la Ville d'entreprise Toyota)
», Dai 2shô : Toyota-shi no tanjô to keisei (Chapitre 2 :
Naissance et formation de la Ville de Toyota), Toyota-shi-shi (Histoire de
la Ville de Toyota), Tome 4 : 20 1-203.
MATSUI, S. (1977), « Dai 5 setsu : Nôgyô no
henyô to kindaika (Transformation et modernisation de l'agriculture)
», Dai 2 shô : Toyota-shi no tanjô to keisei (Chapitre 2 :
Naissance et formation de la Ville de Toyota); in Toyota-shi-shi (Histoire
de la Ville de Toyota), tome 4 : p.425-458.
MATSUI, S. (1977), « Dai 1setsu : Yakushin-ki no
Toyota-shi (Sous-chapitre 1 : Ville de Toyota en période d'essor »,
Dai 3shô : Kôdo-keizai-seichô-ki no Toyota (Chapitre 3 :
Toyota en période de la Haute croissance), Toyota-shi-shi (Histoire
de la Ville de Toyota), Tome 4 : p.49 1-497.
MATSUI, S. (1977), « Dai 3 setsu : Nôgyô no
konran to nôgyô-kôzô-kaizen (Sous-chapitre 3 :
désordre de l'agriculture et politique de l'amélioration de la
structure agricole) », Dai 3 shô : Kôdo keizai-seichô-ki
no Toyota (Chapitre 3 : Toyota en période de la Haute croissance), in
Toyota-shi-shi (Histoire de la Ville de Toyota), tome 4 :
p.551-629.
MIYAKAWA, Y. (1977), « Dai 4setsu : Kôgyô no
seisan no konran to hukkô (Sous-chapire 4 : Dérangement dans la
production industrielle et reconstruction) », Dai 1 shô : Sengo
kaikakuki no Toyota (Chapitre 1 : Toyota en période de la réforme
de l'après-guerre), Toyota-shi-shi (Histoire de la Ville de
Toyota), Tome
4 : p.108-134.
MIYAKAWA, Y. (1977), « Dai 2setsu :
Jidôsha-kôgyô no hatten to Toyota no Kôgyô-ka
(Sous-chapitre 2 : Développement de l'industrie automobile et
industrialisation de la Ville de Toyota) », Dai 2shô : Toyota-shi no
tanjô to keisei (Chapitre 2 : Naissance et formation de la Ville de
Toyota), Toyota-shi-shi (Histoire de la Ville de Toyota), Tome 4 :
213-240.
SERVOLIN, Cl. (1989), Agriculture moderne, Paris,
Seuil.
SUZUKI, T. (2003), « America-komugi-senryaku » to
nihonjin no shokuseikatsu (« Stratégie céréaliaire
américaine » et la vie alimentaire des japonais),
Fujiwara-shoten : p. 13-42.
TAKAHASHI, J. (1978), « Dai 2setsu : Jidôsha
kôgyô no tenkai to suii (Sous-chapitre 2 : Développement et
évolution de l'industrie automobile) », Dai 5 shô : Toyota-
Jidôsha-Kôgyô no sôgyô to senjika no seikatsu
(Chapitre 5 : Démarrage de l'Automobile Toyota et vie pendant la
guerre), Toyota-shishi (Histoire de la Ville de Toyota), tome 3 :
p.753-769.
TAKAHASHI, J. (1978), « Dai 3setsu : Jinkô no
ugoki to Koromo-chô no toshi keikaku (Sous-chapitre 3 : Mouvement
démographique et plan d'urbanisme du Bourg de Koromo) », Dai
5shô : Toyota-Jidôsha-Kôgyô no sôgyô to
senjika no seikatsu (Chapitre 5 : Démarrage de l'Automobile Toyota et
vie pendant la guerre), Toyota-shishi (Histoire de la Ville de
Toyota), tome 3 : p.770-785.
Chapitre II : Processus de la construction du Projet
Nô-Life : émergence de l'agriculture de type Ikigai
Dans ce chapitre, nous allons analyser le processus de la
construction du Projet Nô-Life aux niveaux des représentations et
actions des acteurs concernés. C'est pourquoi nous posons les quatre
questions suivantes.
1 Comment l'ensemble des actions concrètes pour la
construction du projet a-t-il été élaboré par
différents types d'acteurs locaux ?
2 Y-a-t-il eu, ces dix dernières années, des
transformations des représentations de l'agriculture et de la
ruralité dans le contexte de la construction du projet, dont notamment
le vieillissement de la population urbaine et rurale ?
3 L'origine de l'idée centrale du projet, celle de
« `Nô'(l'agriculture ou la ruralité) en tant qu'Ikigai (sens
de la vie) » qui relie le problème du vieillissement à celui
de l'agriculture et de la ruralité, est-elle plutôt descendante ou
ascendante par rapport à la position des acteurs impliqués dans
le processus concret de la construction du projet ?
4 Quelle relation fut établie entre acteurs à
travers ce processus de la construction du Projet ?
Pour répondre à ces questions, nous allons analyser
les comportements des différents types d'acteurs locaux impliqués
dans le processus de la construction du Projet.
A cet effet, il faut tenir compte de plusieurs niveaux
d'échelle comme l'Etat, le département, la municipalité
etc. dans lesquels les différents acteurs peuvent s'influencer et
interagir en jouant leur rôle dans ce processus. En se basant sur
l'examen des discours et énoncés de ces acteurs recueillis lors
de notre enquête de terrain, nous allons étudier leurs
représentations, leurs modes d'actions d'implication et leur prise de
position par rapport au Projet Nô-Life. La relation sociale entre ces
acteurs, construite et mise en jeu à travers ce processus de la
construction du Projet Nô-Life, va être mise en évidence
à partir de cet examen, celle qui déterminera également la
situation préstructurée du jeu d'acteurs à analyser dans
le chapitre suivant.
1. Représentations, modes d'actions et prise de
position des acteurs
Ici, nous allons retenir les 7 acteurs suivants qui
étaient directement impliqués dans le processus de la
construction du Projet Nô-Life :
1. Bureau de la Politique Agricole de la Municipalité de
la Ville de Toyota (BPA)
2. Section de la Création d'Ikigai dans le Bureau
Education permanente de la Municipalité de la Ville de Toyota (SCI)
3. Direction des Activités agricoles de la
Coopérative Agricole de Toyota (CAT)
4. Bureau Départemental de la Politique Agricole
(BDPA)
5. Section Amélioration - Vulgarisation du Bureau
Départemental de l'Agriculture, de la Forêt et de la Pêche
de Toyota-Kamo (Ex-Centre pour l'Orientation et la Vulgarisation agricoles de
Toyota-Kamo : ECV)
6. Conseil Local de Toyota de la Fédération des
Syndicats Ouvriers du Département d'Aichi (CLFS : Rengô Aichi
Toyota Chikyô)
7. Groupement d'Arboriculteurs de Sanage pour l'Aide des Travaux
Agricoles (GASATA)
Ensuite, pour chacun de ces acteurs, nous allons mettre en
évidence le caractère général de l'acteur, celui
des données examinées, les représentations de
l'agriculture et de la ruralité dans le contexte du vieillissement au
travers de leur propre mission, leur mode d'implication (actions) et leur prise
de position vis-à-vis du Projet Nô-Life.
Acteur 1 : Bureau de la Politique Agricole de la
Municipalité de la Ville de Toyota (BPA)
Caractère général de l'acteur
Le Bureau de la Politique agricole « Nô-Sei ka
» en japonais, nous l'appellerons le BPA, attaché à la
Direction de l'Industrie (Sangyô bu) au sein de la Municipalité de
Toyota, est acteur principal du Projet Nô-Life en tant que
co-gestionnaire officiel du Centre Nô-Life avec la Coopérative
Agricole de Toyota (CAT). Si la Municipalité est initiatrice et
titulaire de ce projet, le BPA est gestionnaire direct de ce projet.
Domaines de compétences
Le BPA est chargé de divers types de services
administratifs locaux concernant l'agriculture dans le territoire de la Ville
de Toyota.
Au sein la Municipalité de Toyota, il se divise en
trois domaines de compétences internes en 2006 : Terrains agricoles
(Nô-chi) ; Politique agricole (Nô-Sei) ; Administration agricole
(Nô-mu). D'après de brèves explications données par
Monsieur N, employé et responsable du Plan fondamental de l'Agriculture
(Nô-gyô Kihon Keikaku, on l'abordera plus loin), les tâches
concernant ces trois domaines sont comme les suivantes :
- Terrains agricoles : tâches relatives à la «
Commission agricole (Nôgyô iinkai)307 »; Plan
d'aménagement des « Zones réservées pour le
développement agricole (Nôgyô Shinkô Chiiki) » ;
Pensions agricoles (nôgyôsha nenkin) etc.
- Politique agricole : « Plan fondamental de
l'Agriculture (Nôgyô Kihon Keikaku) » ; « Animaux
nuisibles (Yûgai Chôjû) » aux activités agricoles
; « Système des Aides directes pour les Zones de montagnes
(Chûsankan chiiki Chokusetsu Shiharai Seido) » ; « Echanges
Urbain - Rural (Toshi sanson kôryû) » etc.
- Administration agricole : Soutien d'organisations agricoles ;
régulation de la production (Seisan chôsei) etc308.
307 La Comission agricole (nôgyô iinkai) est un
organe qui a pour fonction de donner une authorisation pour l'acquisition ou la
location des terrains agricoles aux demanders de ces droits. Elle est
principalement constituée par des agriculteurs représentants de
la Ville et des administrateurs du BPA.
308 Puis, à ces trois domaines de compétences
constituant le BPA, s'ajoute un autre bureau s'appellant le « Bureau de
l'Aménagement des terrains agricoles (nôchi-seibi ka) »
chargé de : chemins et canaux agricoles ; remembrement (men-seibi) ;
enquête cadastrale (chiseki chôsa).
Sans entrer dans le détail de toutes ces fonctions,
retenons que la caractéristique plus essentielle du BPA est que celui-ci
est gestionnaire administratif et public des biens et des services agricoles.
Il est notamment chargé de la gestion de tout ce qui concerne
l'économie publique dans les domaines agricole et rural du territoire de
la Ville (impôts, subsides, aménagements des biens fonciers
etc)309.
Le BPA a, notamment en rapport avec les tâches relatives
aux subsides, des rapports de collaboration avec une série d'agents
administratifs et publics de plusieurs niveaux : Ministère de
l'Agriculture, de la Fôrêt et de la Pêche
(Nô-rin-Suisan Shô : niveau national) ; Bureau départemental
de l'Agriculture, de la Fôrêt et de la Pêche se divisant en
deux domaines de compétences : Politique agricole (BDPA : Bureau
Départemental de la Politique Agricole) et Soutiens techniques (ECV :
Ex-Centre départemental pour la Vulgarisation et l'Amélioration
de l'agriculture). Puis, dans le secteur privé, le BPA est en
collaboration avec la CAT et les agriculteurs qui constituent de nombreux
« Groupements de producteurs (seisan bukai) » au sein de la
Coopérative, spécialisés souvent à un produit
agricole, et « Syndicats des affaires agricoles (nô-ji kumiai)
» au sein des villages310.
Le Centre Nô-Life étant attaché au BPA, il
y constitue un nouveau domaine de compétences indépendant depuis
son inauguration en 2004. En effet, lors de l'établissement du Centre
Nô-Life, le BPA l'a doté d'une nouvelle compétence
nidépendante des trois domaines de compétences du BPA
expliqués plus haut. Dans le Centre Nô-Life, les trois personnels
suivants travaillent comme employés permanents et responsables des
activités : Président, Monsieur K, employé du BPA qui
était chargé de l'élaboration du Projet Nô-Life
depuis le début en 2001 ; Vice-président, Monsieur KH,
également employé du BPA sous la direction de Monsieur K ;
Vice-président, Monsieur KM, employé de la CAT, sous la direction
de Monsieur S, directeur de la Direction des Activités
agricoles311.
Bref historique de l'établissement du Centre Nô
-Life
Le Centre Nô-Life s'est constitué en plusieurs
étapes successives depuis cette dernière décennie. La
vision d'origine de son projet remonte au 1996, l'établissement d'un
premier plan décennal de la politique agricole municipale de Toyota :
« Premier Plan fondamental de l'Agriculture de Toyota (Daiichiji
Toyota-shi Nôgyô Kihon Keikaku) » (nous l'appelons ici le
`Plan de 96'). Ce plan décennal est susceptible d'être en vigueur
jusqu'à l'année 2005-2006312. L'idée qui a
fondé la conception du Projet Nô-Life, provient d'une nouvelle
catégorie d'agriculture qui a été établie par ce
Plan de 96 : celle de l'« Agriculture de type Ikigai (Ikigai-gata
Nôgyô) » contrastant avec l'autre catégorie de l'«
Agriculture de type industriel (Sangyô-gata Nôgyô) ».
L'introduction de cette nouvelle catégorie d'agriculture a fait que la
politique agricole de la Municipalité de Toyota se focalise sur une
série de types de producteurs considérés, jusqu'alors,
comme marginaux et surtout à faible productivité. Il s'agissait
surtout des personnes âgées, femmes et salariés des foyers
agricoles pluriactifs constituant une grande majorité de la population
agricole de la région. Puis, le Plan de 96 propose, comme une mesure
pour un développement de ce type d'agriculture, la « Conception de
l'Ecole rurale (Nôson-juku Kôsô) »313. Nous
examinerons plus loin pourquoi et comment ce Plan a formulé un tel
nouveau projet.
309 Ces fonctions ont toutes un caractère historique
qui dépasse largement le cadre administratif de l'époque moderne.
En effet, il suffit de suggérer qu'au Japon, le système sur
l'impôt immobilier sur les terrains agricoles existe depuis le Moyen
âge, et surtout, qu'il a été réunifié et
réorganisé au niveau national par le premier plan cadastral
japonais instauré à la fin du 16ème siècleIl s'agit
de la célèbre politique de l'« enquête foncière
(kenchi) » de Hideyoshi TOYOTOMI, seigneur qui unifia le territoire
japonais à l'époque féodale, appliquée pour que
l'Etat réorganise et unifie le système de redevances annuelles
basé sur le riz. Ce système s'est élaboré et
perfectionné au cours de l'ère du Gouvernement d'Edo (Edo bakuhu)
qui a duré de 1603 à 1867. Puis, l'administration « moderne
» du Gouvernement de Meiji a rendu monétaire ce système de
redevances. Aujourd'hui, ce sont les municipalités qui s'en chargent
sous forme d'impôts immobiliers.
310 En milieu rural, un village, souvent appelé comme
« Buraku (hameau) », constitue l'unité minimum de
l'organisation territoriale. Il organise des mesures à appliquer
collectivement aux foyers agricoles d'un même village par exemple celles
pour le contrôle de la production rizicole.
311 Il s'agit de l'acteur 3. Nous avons interrogé Monsieur
S.
312 Actuellement, le BPA et d'autres acteurs concernés
sont en train d'évaluer l'évolution de l'agriculture de la
région de la décennie déroulée après ce Plan
et la situation d'aujoud'hui par rapport aux perspectives de ce plan, afin
d'élaborer le deuxième plan fondamental qui remplacera ce premier
plan dès l'année 2007.
313 Direction de l'Agriculture et de la Forêt, 1996 :
17.
Puis, de 1998 à 2003, plusieurs nouvelles mesures ont
été réalisées à l'initiative du BPA et
d'autres acteurs partenaires dans le cadre de cette politique pour l'agricuture
de de type Ikigai. D'abord, en se référant au modèle
européan des « jardins familiaux » connu au Japon sous le nom
allemand « Klein garten », se sont développées une
série de mesures de « Jardins familiaux (Katei saien) » et
« Jardins citoyens (Shimin Nôen) » à l'initiative de la
Municipalité et de la CAT. En 2003, le nombre total de ces jardins
était 24, et celui de parcelles 985 (dont 968
utilisées)314, dans la Ville de Toyota aussi bien dans les
zones à urbaniser que dans les zones d'urbanisation
contrôlée315. Puis, en 2000, en se basant sur les
idées formulées dans la « Conception de l'Ecole rurale
(Nôson-juku Kôsô) » formulée dans le Plan de 96,
la Municipalité a commencé l'« Ecole de l'agriculture
vivante de Toyota (Toyota Iki-iki Nôgyô-juku) » (on
l'analysera dans la partie de l'acteur 3) en collaboration avec la CAT. Ce
projet de la formation agricole était non seulement destinée aux
producteurs agricoles de la nouvelle catégorie formulée par le
Plan de 96, mais aussi aux personnes des foyers non agricoles,
c'est-à-dire le public en général, dont notamment les
retraités salariés du secteur automobile dans la Ville de
Toyota.
Parallèlement, depuis 2000, un autre type d'initiative
« non agricole » a rejoint ce nouveau mouvement de la politique
agricole : l'initiative de mesures relatives aux problèmes dûs au
vieillissement de la population. Cela notamment dans le cadre de mesures pour
développer les activités d'Ikigai des personnes
âgées parmi lesquelles comptent des activités de type
agricole comme « Ferme-école pour les personnes agées
(Kônensha Taiken Nôjô) » (Nous la verrons dans la partie
de l'Acteur 2). Monsieur K, le président du Centre Nô-Life, a
également participé dans l'élaboration de ce projet. Cette
approche, à caractère urbain et engendrée par la
thématique du vieillissement de la population, a poussé le
processus de l'élaboration du Projet Nô-Life à partir de
2001316.
En s'appuyant sur ces initiatives antérieures, en 2001,
le processus du démarrage du projet a officiellement été
amorcé à l'initiative du BPA dans le cadre d'une politique
agricole municipale pour la « Recherche et formation de nouveaux porteurs
(aratana ninaite hakkutsu-ikusei) »317. Ensuite, à
partir de la fin 2002, un plan pour la réalisation concrète du
Projet Nô-Life a été ébauché, en concertation
avec divers acteurs institutionnels agricoles et non agricoles au sein de la
Ville de Toyota, sous un nom provisoire comme ceci : « Centre pour le
soutien aux activités agricoles (Einô Shien Center) ».
Par la suite, en 2003, le BPA a effectué une
enquête auprès de la population de la Ville sur la «
Conscience sur l'agriculture de Toyota », afin de recencer le degré
d'attentes au sein de la population de la Ville aussi bien agricoles que non
agricoles, vis-à-vis des mesures de la politique agricole municipale.
Cette enquête donna un résultat positif, ce qui apporta ainsi un
élément de justification au Projet Nô-Life.
Enfin, comme dernière étape importante de
démarrage du Projet Nô-Life, la Municipalité de Toyota a
lancé plusieurs propositions de déréglementations
juridiques au niveau foncier dans le cadre de la politique des « Zones
spéciales pour la Réforme structurelle (Kôzô Kaikaku
Tokku Seisaku) que nous appellerons ici la `Politique des Zones
spéciales', politique nationale de déréglementation
commencée depuis 2003 par le Gouvernement de M. Koizumi afin de relancer
l'économie japonaise318.
Les propositions de la Municipalité consistaient
notamment à la réduction de la « Surface minimum
d'installation agricole (Shûnô Kagen Menseki) » de 0.4ha
à 0. 1ha, une norme qui était imposée au Japon par la Loi
agraire (Nôchi Hô) depuis son entrée en vigueur en
1952319. Cette déréglementation avait pour but de
permettre aux personnes non agriculteurs / agricultrices d'utiliser (louant ou
en achetant) plus facilement des terrains agricoles à partir de 0. 1ha
dont leur surface dépasse largement le niveau de surface ordinaire de
jardins familiaux ou citoyens où une parcelle ne compte
généralement que 0.00 1ha à 0.01ha (0. 1a à 1a)
314 Ville de Toyota, 2003b.
315 Deux catégories foncières principales dans
l'urbanisme japonais depuis les années 70.
316 Dans la partie de l'Acteur 2 de ce chapitre, on analysera
comment ont été mises en relation l'idée d'Ikigai et des
éléments de l'agriculture et de la ruralité dans
l'évolution de la politique du viellissement mise en oeuvre à
Toyota.
317 Bureau de la Politique Agricole de la Ville de Toyota,
2006.
318 Une nouvelle politique nationale de
déréglementation de l'économie japonaise lancée par
le gouvernement japonais depuis 2003. La méthode est originale : ce sont
diverses organisations locales (collectivités, associations,
entreprises, hôpitaux et même individus) qui peuvent librement
proposer à l'Etat leur programme contenant des mesures de
déréglementations. Les domaines d'application sont
également divers : industries ; commerces ; services ; agriculture ;
éducation ; médecine etc. Après avoir approuvé
chaque programme, l'Etat effectue des déréglementations possibles
selon ceux que propose le programme. Mais l'Etat ne donne pas de subside
à l'organisme chargé d'exécuter le programme.
319 Ceci est juste après l'accomplissement de la
Réforme agraire.
Caractère général des données
Afin d'étudier les représentations portées
par le BPA pour démarrer le Projet Nô-Life, nous allons examiner
quatre documents qui ont constitué les étapes préalables
du démarrage du Projet Nô-Life320.
Premièrement, nous allons analyser le texte
intégral du « Premier Plan fondamental de l'Agriculture de
Toyota », le Plan de 96321.
Deuxièmement, on passera à l'analyse du texte
intégral de l' « enquête sur la conscience sur
l'agriculture de Toyota » que le BPA a réalisé
auprès de 2500 propriétaires des foyers agricoles
localisés dans la Ville de Toyota ainsi que de 2050 personnes
employées dans la Ville de Toyota. C'est un rapport public et complet
rédigé par le BPA sur le résultat de cette enquête.
Cette enquête fut réalisée en collaboration avec le Conseil
Local de Toyota de la Fédération des Syndicats Ouvriers du
Département d'Aichi (CLFS), acteur 6 que nous analyserons plus loin, qui
s'est chargée de la distribution du questionnaire auprès des 2050
salariés dans la Ville de Toyota.
Troisièmement, nous verrons le texte
élaboré par la Municipalité de Toyota pour postuler
à la Politique des Zones spéciales. Ce texte a principalement
été préparé par le BPA en collaboration avec un
agent du niveau départemental : Bureau Départementale de la
Politique Agricole (BDPA), acteur 4 que nous analyseront également plus
loin.
Par ailleurs, les brochures officielles du Centre
Nô-Life distribuées chaque année au public, nous montreront
la façon dont le Projet se présente au public322.
Puis, nous nous servirons d'appui quelques explications données sur ces
documents par Monsieur K, Président du Centre Nô-Life, Monsieur
KH, vice-président du Centre-Nô-Life, ainsi que Monsieur N,
employé du BPA, avec lesquels nous avons effectué nos entretiens
individuels.
Représentations
« 2005 Toyota Agri-bility Plan »
Contextes d'apparition : imbrication de niveaux global et local,
et bricolage d'idées et d'actions
D'après Monsieur N, avant l'apparition du Plan de 96,
n'existait pas au sein de la Municipalité de Toyota, un tel plan qui
présente une vision globale sur l'ensemble des mesures appliquées
par la politique agricole municipale de Toyota. Selon l'explication ci-dessous
donnée par ce plan, les contextes de son établissement sont
marqués par une série de changements politiques nationaux suite
aux « Accords relatif à l'agriculture » de l'Uruguay Round du
GATT323 d'un côté, et de l'autre par l'aggravation de
la situation locale de l'agriculture tels que le vieillissement de la
main-d'oeuvre agricole, l'avancement de la situation de pluriactivité,
la pression foncière urbaine de plus en plus accrue
etc324.
320 Direction de l'Agriculture et de la Forêt (1996) ;
Bureau de l'Agriculture et de la Forêt (2003) ; Ville de Toyota (2003a) ;
Ville de Toyota (2003b).
321 Ce texte est produit par le BPA dont le nom était
à cette époque « Direction de l'Agriculture et de la
Forêt (Nô-rin bu) » de la Municipalité de Toyota.
322 Brochures officielles du Centre Nô-Life : Centre pour
la Création de Nô-Life de Toyota, 2004 ; 2005 ; 2006a ; 2006b.
323 La négociation du GATT s'est déroulée
entre 1986 et 1994.
324 Direction de l'Agriculture et de la Forêt, 1996 : 1.
« L'objectif du Plan : Le Plan fondamental de l'Agriculture de Toyota
détermine les orientations de base du développement agricole et
de la conservation des terrains agricoles de la futur Ville de Toyota, et ainsi
systématise ces orientations comme mesures à développer
d'ici pendant dix ans. On définit ces orientations comme principe des
mesures de notre politique agricole. Ceci en tenant compte des changements
interne et externe de l'environnement de l'agriculture comme l'opération
de l'accès minimal du riz imposé par l'Uruguay Round du GATT et
l'entrée en vigueur de la Nouvelle loi alimentaire, puis des
problèmes comme le vieillissement de la population agricole, la
situation où les foyers agricoles
Ensuite, le Plan indique deux changements politiques nationaux
qui, suite à ces accords internationaux, étaient en cours au
Japon à cette époque, en matière d'agriculture et de
distribution alimentaire à l'intérieur du Japon. Il s'agit des
deux éléments suivants : « Nouvelle direction des Politiques
de l'Alimentation, l'Agriculture et de la Ruralité »
présentée par le Ministère de l'Agriculture, de la
Forêt et de la Pêche en 1992 ; « Lois sur l'Offre et la
Demande des Alimentations principales et sur la Stabilité des prix :
Nouvelle loi alimentaire » entrée en vigueur en 1994325.
Le premier élément est une direction qui marqua un des premiers
pas politiques visant la réalisation d'une réforme globale de la
politique agricole japonaise qui va aboutir, en 1999, à
l'étabilissement d'une nouvelle loi de la politique agricole : «
Loi fondamentale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Ruralité
(Shokuryô - Nôgyô - Nôson Kihonhô) ». Le
deuxième élément est une loi adoptée en 1994 visant
la libéralisation progressive du marché du riz à
l'intérieur du Japon326.
Cependant, comme Monsieur N nous l'a suggéré
comme ci-dessous, malgré les influences apportées par ces
politiques, le Plan de 96 avait un caractère « anticipatif »
de ce changement de la politique agricole nationale dans le sens où il
mettait déjà l'accent sur des aspects se rapportant à la
« multifonctionalité » et au « développement rural
» qui ne sont pas uniquement préoccupés par le
côté productif de l'agriculture. Monsieur N explique ainsi :
« A cette époque, petit à petit, il y
avait des jardins citoyens et des jardins familiaux [dans le territoire de la
Ville de Toyota]. Puis, émergeait une partie qui ne pouvait pas
être déterminée uniquement par le côté
productif de l'agriculture. Puis, c'était encore avant
l'établissement de la nouvelle loi agricole : l'époque où
l'approche du « développement rural » n'existait pas encore. A
Toyota, dans un sens, on l'avait anticipé un peu... »
D'ailleurs, d'après Monsieur N, l'établissement
d'un tel plan de la politique agricole au sein d'une municipalité n'est
pas obligatoire. L'établissement du Plan de 96 nous semble être
d'un côté une action encadrée par des cadres politiques
supérieurs (international et national), mais d'un autre
côté, une réaction spontanée à l'initiative
de la Municipalité de Toyota et d'autres agents locaux en colloboration
avec elle. Cet aspect d'anticipation nous évoque déjà la
présence d'un certain contexte territorial où la
Municipalité de Toyota avait besoin d'élaborer sa propre
politique agricole à son initiative.
Eléments imposés par les Accords de l'Uruguay Round
du GATT
Avant d'entrer dans le contenu du Plan de 96, parcourrons
quelques éléments essentiels apportés par les politiques
internationales et nationales citées plus haut, qui marquèrent
une influence importante à la politique agricole de l'Etat japonais et
celle des collectivités territoriales.
Les accords de l'Uruguay Round du GATT ont trois principes sur
lesquels les accords entre pays membres portent : Accès aux
marchés ; Soutien interne ; Subventions à
l'exportation327. Et l'objectif principal consiste à orienter
davantage le commerce des produits agricoles vers le marché. C'est ce
qui nous semble renforcer davantage, au niveau mondial, la
légitimité politique du principe de la recherche de la
productivité dans le domaine agricole. Et cette recherche vise toujours
à demander à l'agriculture d'être concurrentielle sur le
marché.
Les accords sur l'Accès aux marchés ont d'abord
imposé au Japon l'« accès minimal » au marché du
riz. Ce qui poussa la politique japonaise à avancer la
libéralisation (déréglementation) progressive du
marché du riz à
sont de plus en plus pluriactifs, et l'augmentation de
demandes foncières de type urbain suite au développement de
l'urbanisation. Ce Plan tient également compte du Plan supérieur
de la Ville de Toyota « Plan de la future Ville de Toyota du 21ème
siècle (Toyota-shi 21seiki Mirai Keikaku) » et des autres plans
concernés ».
325 Ibid. Il s'agit de « Atarashii Shokuryô -
Nôgyô - Nôson Seisaku no Hôkô » et «
Shuyô Shokuryô no Jukyû oyobi Kakaku no Antei ni kansuru
Hôritsu : Shin Shokuryô Hô ».
326 Par cette libéralisation, les producteurs rizicoles
ont eu le droit de distribuer leur riz par eux-même sans devoir les
apporter à la coopérative agricole. En même temps, l'Etat
est en train d'abolir sa politique du contrôle de la production rizicole
ainsi que son soutien du prix de riz. Mais actuellement, au lieu d'inciter la
réduction de production rizicole et la conversion de cultures avec des
primes, les quotas de production sont imposés aux producteurs par l'Etat
et la coopérative agricole.
327 OMC :
http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/ursum_f.htm
(site officiel)
l'intérieur du pays.
Tout en renforçant le principe de l'orientation du
commerce des produits agricoles vers le marché international, les
accords sur le Soutien interne ont également engendré certains
types de mesures agricoles ayant le moins d'impacts possibles au commerce
international dites mesures de la « Catégorie verte ». Cette
partie des accords, exclue des objets de la « réduction » des
mesures protectrices des Etats membres, laissa une place légitime aux
mesures apportées par les « services publics de caractère
général » dans les domaines concernant la recherche, la
lutte contre les maladies, l'infrastructure et la sécurité
alimentaire328.
A la différence des pays occidentaux, concernant le Japon,
le domaine des subventions à l'exportation ne semble pas avoir beaucoup
d'importance, car le Japon n'exporte guère ses produits agricoles.
Enfin, en prenant en considération le cadre des accords
de l'Uruguay Round du GATT, nous pouvons considérer que le Plan de 1996
s'inscrit également dans le contexte de restructuration de «
services publics » dans le domaine agricole comme mesures du «
soutien interne relatif à l'agriculture ».
Eléments imposés par les réformes de la
politique agricole nationale
La nouvelle loi agricole adoptée en 1999 au Japon mit
en avant comme piliers les quatre éléments suivants :
développement durable de l'agriculture ; développement rural ;
distribution stable de l'alimentation ; multifonctionalité de
l'agriculture et de la ruralité.
Elle est d'un côté axée sur l'aspect
productif de l'agriculture, c'est-à-dire le renforcement de la
compétitivité des producteurs japonais face aux
internationalisation et libéralisation progressives du marché,
d'un autre, axée sur les aspects non productifs de l'agriculture,
encadrés par les termes comme « le développement rural
» et la « multifonctionalité ».
D'autant plus que le Plan de 1996 a été
conçu plus tôt que cette nouvelle loi de l'Etat, ce sont, nous
semble-t-il, les reflets de la situation locale et spécifique à
la Ville de Toyota sur ce Plan qui ont plus d'importance que les influences
directes des contextes globaux. Nous relèverons plus bas les
éléments de représentation spécifiques dans le
contenu du Plan de 96.
Puis, on abordera notamment la question de l'origine du Projet
Nô-Life : comme on l'a déjà évoqué plus haut,
il s'agit de l'étabilissement d'une nouvelle catégorie
d'agriculture par ce Plan de 96 : celle de l'« Agriculture de type Ikigai
(Ikigai-gata Nôgyô) » contrastant avec l'autre
catégorie de l'« Agriculture de type industriel (Sangyô-gata
Nôgyô) » et celui de la « Conception de l'Ecole rurale
(Nôson-juku Kôsô) » qui donnèrent des
idées de base au Projet Nô-Life. Quels éléments de
représentations de l'agriculture et de la ruralité peut-on
trouver dans ces nouvelles catégories d'agriculture ainsi que cette
conception d'un nouveau projet pour développer ce type d'agriculture ?
Sont-elles liées aux idées relevant de la politique agricole
globale (compétitivité ou multifonctionalité), ou à
d'autres idées spécifiques à la politique agricole
municipale de Toyota ?
Constat de la situation locale de l'agriculture
Le Plan de 96 présente d'abord un constat de la
situation locale de l'agriculture de Toyota en terme de ses
spécificités et problèmes. Puis, à partir de ce
constat, il développe un ensemble de thématiques de l'agriculture
de Toyota. Les spécificités de la situation locale sont
présentées en quatre points suivants :
1 Développement d'une agriculture extensive
basée sur la riziculture
2 Présence de diverses cultures spéciales
(légumes, fruits, fleurs)
3 Composition des foyers agricoles dont la grande
majorité pluriactive de la deuxième catégorie
4 Présence d'un grand bassin de consommation dans la
ville et ses alentours329
328 Il nous restera à demander la position du Japon qui
est à la fois un « pays développé » et «
importateur net de produits alimentaires » à la différence
des pays occidentaux, dans la négociation relative à
l'agriculture au sein de l'OMC.
329 Direction de l'Agriculture et de la Forêt, 1996 : 2.
Le premier et deuxième points montrent les types
représentatifs de production agricole dans le territoire de la Ville de
Toyota. Le premier point designe, en réalité, la riziculture
à grande échelle gérée par des entreprises
agricoles situées dans le sud de la Ville de Toyota330. Cette
production rizicole est citée comme un rare exemple de la production
agricole « compétitive » existant dans le territoire de la
Ville de Toyota. Le deuxième point concerne également la
présence de cultures spéciales qui sont compétitives sur
le marché dont notamment la pêche et la poire produites dans une
zone du Nord de la Ville de Toyota. Ce sont des produits « phares »
de Toyota dont la spécialisation des cultures est très
avancée, par rapport aux autres zones où la petite production
rizicole reste souvent dominante. Ces productions fruitières ont
développé et maintenu leur compétitivité sur le
marché régional depuis les années 70331.
Contrairement à ces deux rares et « bons »
exemples de l'agriculture modernisée de Toyota, le troisième
point designe un aspect négatif mais dominant de la situation locale de
l'agriculture de Toyota332. Ici, il faut remarquer que le Plan de 96
essaie d'accorder une valeur positive aux « femmes et personnes
âgées » qui composent la plupart de la population de ces
foyers agricoles pluriactifs en soulignant qu' « ils jouent un grand
rôle en tant que porteurs de notre agriculture »333.
Cette affirmation montre déjà une représentation
particulière que la Municipalité porte de l'agriculture de son
territoire. En effet, comme on le verra dans la partie de l'acteur
5 : ECV qui est un agent technique et agricole du
département, les foyers agricoles pluriactifs, dont la majorité
des personnes qui les composent sont des femmes et des personnes
âgées, n'avaient pas grande importance dans le cadre de la
politique agricole de « porteurs » généralement
appliquée dans le secteur agricole au Japon. En fait, ils y sont
ignorés et presque exclus des catégories cibles de cette
politique334.
Puis, dans le quatrième point, le Plan repère la
population urbaine de la Ville de Toyota et de ses alentours comme un bassin de
consommation « potentiel » et important pour l'agriculture de Toyota.
En évoquant la montée d'intérêts de consommateurs
sur les produits agricoles et sur l'agriculture, il suggère que la Ville
de Toyota a « des possibilités de développer une nouvelle
agriculture qui sera directement liée aux consommateurs
»335. Ce point montre également une tendance
particulière de préoccupations portées par la
Municipalité, qui visent, comme de nouveaux débouchés de
produits agricoles de Toyota, des marchés à court circuit avec
des produits diversifiés, plutôt que des marchés à
longue distance avec des produits dont la spécialisation est très
avancée comme le cas de la pêche et de la poire dans le nord de la
Ville de Toyota. Cela marque également une différence par rapport
à la politique agricole des agents de l'Etat ou du département,
appliquée de manière sectorielle et
généralisée.
Ensuite, les problèmes sont présentés en
quatre points suivants :
1 Manque de successeurs et de nouveaux porteurs
2 Dispersion de terrains agricoles mis en location et
augmentation de friches
3 Dimunition de la surface agricole due à l'avancement
de l'urbanisation
4 Retard de la mobilisation des terrains agricoles,
concentration de droits d'usage336
330 Nous avons vu dans le chapitre 1 l'historique de ces deux
entreprises agricoles montées à l'aide de la coopérative
agricole de Toyota les années 70. Aujourd'hui, elles gèrent au
total plus de 200 ha de rizières.
331 Sur la couverture du Plan, on peut ainsi trouver des images
de ces produits. Nous aborderons l'implication d'arboriculteurs professionnels
de cette zone de production fruitière dans le Projet Nô-Life dans
la partie de l'acteur 7.
332 Nous avons vu dans le chapitre 2 la situation
généralisée de pluriactivité des foyers agricoles
de la Ville de Toyota entre 1955 et 1975.
333 Direction de l'Agriculture et de la Forêt, 1996 : 2.
334 Pourtant, si les femmes et les personnes âgées
sont ignorées dans les catégories cibles d'agriculteurs à
développer dans le cadre de la politique agricole sectorielle, on
accorde de plus en plus d'importance, au cours de cette décennie,
à ce type de personnes surtout dans le cadre des activités
symboliques mais efficaces comme la vente directe de produits du terroir,
animation locale etc. Et plus récemment, comme on le voit dans le Projet
Nô-Life, les agents du secteur agricole comme la Coopérative
agricole et l'Ex-centre pour la vulgarisation essaient de former les personnes
d'origine non agricole comme les jeunes retraités du secteur automobile
de la région. Sur cette évolution, voir la partie de l'Acteur 3,
5.
335 Direction de l'Agriculture et de la Forêt, 1996 : 2.
336 Ibid. : 3
Le premier élément constitue un des
thèmes majeurs du Projet Nô-Life (formation de nouveaux porteurs).
Le Plan de 96 attribue la cause du manque de successeurs au fait que «
diverses opportunités de travail existent pour les jeunes des foyers
agricoles » et à « l'instabilité des revenus des
agriculteurs due à la fluctuation de prix agricoles
»337.
Le deuxième élément montre
également que le Plan met en cause la dispersion de petits terrains mis
en location sous forme de l'ancien fermage et l'augmentation de friches qui
« empèchent la rationalisation de la gestion (agricole) », ce
qui constitue également l'autre thème majeur du Projet
Nô-Life (prévention et mise en valeur des friches agricoles). Il
va de soi que ce problème d'abandon de terrains agricoles est lié
au premier point : baisse de motivation des agriculteurs pour leur production
agricole338.
Puis, dans le troisième point, le Plan met en cause non
seulement la diminution de terrains agricoles dû à l'avancement de
l'urbanisation, mais aussi le mode d'urbanisation qui est souvent du type
« sprawl (en anglais) »339. Nous pouvons également
y trouver une spécificité du Plan de 96 ainsi que celle de la
politique agricole de la Ville de Toyota : il s'agit de place la politique
agricole dans le cadre de la politique globale de la « Ville » -
c'est-à-dire son urbanisme au sens large du terme - dont la
majorité de la population non agricole. D'où la nouveauté
de ce plan, et la spécificité de l'approche de la
Municipalité qui réside à être un agent des services
publics locaux.
Le quatrième point montre un aspect
général de stagnation de la modernisation de l'agriculture qui
consiste à tenter toujours de « rationaliser » les terrains
agricoles via concentration de terrains par les producteurs à haute
productivité340.
En tenant compte du constat précédent des
spécificités et des problèmes, le Plan de 96
présente les thématiques en huit points suivants :
1 Soutiens aux porteurs (producteurs) à haute
motivation
2 Développement d'une nouvelle agriculture
péri-urbaine
3 Un développement agricole répondant aux
demandes de consommateurs et exploration de nouveaux
débouchés
4 Mesures sur les taxes successorales sur les terrains
agricoles et les terrains destinés aux établissements
agricoles
5 Avancement de la mobilisation de terrains agricoles et du
droit d'usage, et du remembrement
6 Examen des mesures de la conservation de terrains agricoles
mettant en avant leur multifonctionalité
7 Régulation efficace entre la conservation de
terrains agricoles et l'usage urbain de terrains
8 Examen des mesures de la conservation de terrains agricoles
face à la recomposition des foyers agricoles pluriactifs
Nous pouvons remarquer que ces huit points impliquent une
série de nouvelles thématiques de la politique agricole de la
Municipalité de Toyota :
- une nouvelle agriculture « péri-urbaine »
liée aux demandes de consommateurs, et ses nouveaux
débouchés (liées aux deuxième et troisième
points)
- multifonctionalité (liée au sixième
point)
- régulation entre la conservation des terrains agricoles
et le mode d'urbanisme (liée au septième point) - mesures
alternatives face à la recomposition des foyers agricoles pluriactifs
(lié au huitième point)
Chacune de ces thématiques semble chercher d'autres types
de solutions que les solutions de type productiviste et technique, face
à l'aggravation de la crise agricole341.
337 Ibid. : 2
338 L'objectif principal du Projet Nô-Life est de lutter
contre la friche via le contrat de fermage déréglementé.
En effet, cela implique une mise en cause indirecte du système agraire
japonais d'après la deuxième guerre mondiale : le système
imposé par la Loi agraire (Nôchi hô) établie selon
l'esprit de « jisaku nô shugi » que l'occupation
américaine avait instauré. A expliquer dans le chapitre de
l'histoire.
339 Direction de l'Agriculture et de la Forêt, 1996 : 2.
340 Nous pouvons constater, dans la partie de l'acteur 5, cet
aspect modernisateur de la politique agricole sectorielle.
341 Nous avons vu dans le chapitre 1 l'esprit productiviste de la
modernisation agricole dans la Loi fondamentale de l'Agriculture
(nôgyô kihon hô).
Enfin, le Plan de 96 résume en six points suivants les
valeurs que l'on peut accorder aux deux thèmes majeurs : «
développement agricole (Nôgyô Shinkô) » et
à la « conservation des terrains agricoles (Nôchi Hozen)
».
1 Alimentation (Shoku) : lieux de l'offre de l'alimentation
de bonne qualité dont la fraîcheur et la sécurité
sont assurées pour les citoyens
2 Travail (Gyô) : importance en tant qu'une «
industrie » en terme de l'emploi et de l'économie
régionale
3 Environnement naturel (Shizen-kankyô) : espaces pour
le maintien et la conservation de l'é co-système ; fonction de la
conservationn de l'eau pour la prévention des désastres naturels,
et pour atténuer le dégât des inondations
4 Environnement urbain (Toshi-kankyô) : lieux de
l'offre d'un environnement agréable pour la ville ; espace ouvert(open
space) en cas de désastres ; lieux de l'offre alimentaire en cas
d'urgence
5 Ikigai - loisir (Ikigai - Yoka) : lieux de
l'éducation sociale ; lieux dikigai et de la maintien de la santé
des personnes âgées ; offrir des lieux d'activités de
loisirs des citoyens pour un développement urbain
équilibré
6 Sol (Tochi) : fonction d'un bassin pour une orientation
organisée de futures demandes urbaines de biens fonciers
Là, on voit très clairement l'intention de la
Municipalité de rejustifier sa politique agricole dans le cadre des
services publics tout en essayant de redéfinir les valeurs de sa
politique du développement agricole. Ainsi, y sont explicitées
une série de nouvelles dimensions de la politique agricole comme
indiquent les termes suivants, : « citoyen », « environnement
», « urbain », « sociale », « santé et
Ikgai des personnes âgées » et « loisir » etc. Et
ces nouvelles dimensions s'inscrivent dans l'idée de la
multifonctionalité.
« Grande ville rurale, Toyota » : thème
fondamental. Une mise en relation entre la multifonctionalité et la
ville.
Après le constat de la situation, le Plan
présente son thème fondamental comme une nouvelle proclamation.
Quelque peu ambitieux et idéaliste, il prononce audacieusement ses
nouvelles idées. Citons ci-dessous le texte entier dont le titre est
« Une grande ville rurale de Toyota soutenue par les agriculteurs de
divers types à haute motivation, ainsi que les citoyens (Iyokuaru
Tayô na Nôgyôsha to Shimin ni Sasaerareta Ooinaru
Inakamachi-Toyota ) ».
« En se basant sur le point de vue de `Penser
globalement, agir localement`, nous avons pour but de développer une
agriculture contribuant au maintien et à l'amélioration de
l'autosuffisance alimentaire, puis, une agriculture respectant les
multifonctions d'intérêt public de l'agriculture et des terrains
agricoles, qui s'ajoutent à la fonction de la production et de l'offre
alimentaire stables, tels que l'environnement, le paysage, l'éducation,
la culture, le bien-être et la santé-repos. A cet effet, nous
allons rechercher et former les divers types d'agriculteurs à haute
motivation comme les « agriculteurs de type industriel » et les
« agriculteurs de type Ikigai » tels que les personnes
âgées, les femmes des foyers agricoles, les retraités des
salariés originaires des foyers pluriactifs. Puis, via diverses
occasions d'échanges avec les citoyens qui sont susceptibles
d'être supporteurs de l'agriculture, nous allons créer une
perception commune sur le fait que l'agriculture et les terrains agricoles sont
des biens communs qui fondent la vie prospère de l'ensemble des citoyens
de Toyota y compris les agriculteurs. En s'appuyant sur la compréhension
et la coopération mutuelles entre les agriculteurs et les citoyens, nous
allons aider à faire développer, le plus possible, les diverses
'ability (compétences potentielles)' de notre agriculture et de nos
terrains agricoles. Par ce plan, nous proposons la forme souhaitable de
l'agriculture de Toyota pour 2005, c'est-à-dire la vision de notre
future agriculture. »342
Relevons ici les trois dimensions suivantes marquant cette
proclamation du thème fondamental du Plan de
96 :
342 Direction de l'Agriculture et de la Forêt, 1996 : 4.
- idées provenant des niveaux internationaux et nationaux
: autosuffisance alimentaire (sécurité alimentaire) et
multifonctionalité
- nouvelles catégories d'agriculteurs / agricultrices :
industriel et ikigai
- participation des citoyens aux activités agricoles :
approche « bien commun »
Nous pouvons également, dans le « Schéma
conceptuel » du Plan de 96 (voir l'annexe 4) présenté
avec ce thème fondamental, que le Plan redéfinit sa politique
agricole en interprétant les thèmes de la sécurité
alimentaire et de la multifonctionalité d'un point de vue qui implique
manifestement les dimensions locales des services publics, l'urbanisme et de la
participation citoyenne. Et cette interprétation est exercée par
une mobilisation d'idées émanantes de la situation locale et
spécifique à la Municipalité de Toyota. Nous
considérons ainsi ce type de réflexion qui intègre des
idées imposées de niveaux supérieurs (globaux) et des
idées émanantes de la situation locale et spécifique
à l'agent concerné, comme une sorte de « bricolage »
d'idées.
D'ailleurs, le fait d'intégrer les multifonctions de
l'agriculture et de la ruralité, y compris la fonction de l'offre
alimentaire, dans les dimensions de l'intérêt public (services
publics), de l'urbanité et de tous les citoyens, semble y constituer une
nouvelle identité de la politique agricole menée par la
Municipalité de Toyota.
Agriculture de type industriel et celle de type Ikigai
Le Plan définit ainsi les deux catégories
d'agriculture à développer comme piliers de sa politique.
- Agriculture de type industriel (sangyô-gata
nôgyô) : agriculture de type entrepreneurial visant l'offre
alimentaire
- Agriculture de type Ikigai (Ikigai-gata nôgyô)
: (1) agriculture de type Ikigai visant l'offre alimentaire ; (2) agriculture
de type Ikigai visant la protection de l'environnement plutôt que l'offre
alimentaire.
Puis, sur base de la réalisation de ces piliers, il
présente en cinq points suivants ses visions concrètes sur le
développement agricole et de la conservation de terrains agricoles.
1 Un développement agricole mettant en valeur les
fonctions d'intérêt public de l'agriculture et des terrains
agricoles
2 Un développement agricole basé sur les
diverses localités
3 Un développement agricole soutenu par les porteurs
de divers types
4 Un développement agricole mettant en valeur les
possibilités apportées par l'urbanisation
5 Aménagement de l'environnement des beaux villages
ruraux et revalorisation et diffusion de styles de vie (Life style) enrichis
par le « rural (nô) »
Le premier point réaffirme d'abord
l'intérêt public que le développement agricole porte en se
référant à l'idée de la multifonctionalité.
Il s'agit là surtout de conserver les terrains rizicoles qui occupent
80% de la surface agricole totale du territoire de Toyota. Nous y trouvons une
image montrant un paysage rizicole à grande échelle où une
grande moisonneuse-batteuse effectue la récolte. Et le deuxième
point affirme l'intention de développer une agriculture basée sur
sa diversité régionale en montrant une image de paysage rizicole
mais montagnard, qui fait contraste avec l'image précédente de la
riziculture extensive. Le troisième point réaffirme l'idée
de « divers types de porteurs (tayô na ninaite) » qui
s'impliquent dans les activités agricoles. Il s'agit du principe que
« non seulement des exploitations de type entrepreneurial et des
foyers agricoles professionnels, tous les types de populations
concernées par la production agricole s'impliquent dans l'agriculture
avec Ikigai et plaisir »343 . Le quatrième point
suggère la nécessité de s'adapter à la future
urbanisation visant le développement d'une grande
agglomération344. Le cinquième point affirme une
intention de développer un aménagement rural mettant en valeur
les « charmes et rêves (miryoku ya akogare) » que le
public ressent de
343 L'image qui accompagne cette partie est une scène
où des jeunes font leur stage chez une éléveuse de vaches
laitières.
344 L'image montre un grand nouveau pont qui fut construit autour
d'un champs maraicher.
plus en plus vis-à-vis de la ruralité tels que
« beaux paysages ruraux, environnement non artificiel, une vie
basée sur l'auto-production et l'auto-consommation, un style de vie
accompagné par la nature ».
De ces points de vue là, le Plan développe
davantage un autre schéma conceptuel du développement agricole
dans le cadre de l' « aménagement de la ville
(machi-zukuri) » pour une concrétisation de l' «
harmonie entre les fonctions d'intérêt public et
l'aménagement de la ville »345. Ainsi, un «
sous-thème (sub theme) » est formulée comme suit avec le
titre « Tranquilité et aménité dans
l'aménagement de la Ville !! (Machi-zukuri ni Nodokasa to Kokochiyosa wo
!!)
« Pour le futur aménagement de la Ville, est
indispensable la création d'un environnement plein de tranquilité
et d'aménité avec l'« eau » et le « vert ».
Le fait de conserver les terrains agricoles de manière appropriée
et de développer une agriculture saine selon ce Plan fondamental, va
créer également un environnement valable pour les citadins avec
l' « eau » et le « vert ». Il est attendu que cela va
largement offrir une quiètude à nos citoyens. Ainsi, du point de
vue du « rural (nô) », nous constituons ce sous-thème du
Plan afin de contribuer à créer un bon environnement ainsi
qu'à l'aménagement de la Ville de Toyota. »
Mesures concrètes de l'agriculture de type Ikigai et de
l'« école rurale (nôson juku) »
Jusqu'ici, on a parcouru les idées que le Plan de 96
développe pour organiser les mesures pour le développement
agricole. Ensuite, le Plan présente les mesures concrètes sur
cinq points suivants qui reprennent les deux nouvelles catégories
d'agriculture et les visions sur le développement agricole :
1 Développement de l'« agriculture de type
industriel » adaptée à la nouvelle ère
2 Formation de porteurs à haute motivation pour le
développement de l' « agriculture de type industriel »
3 Développement de l' « agriculture de type
Ikigai » pour l'offre alimentaire
4 Développement de l' « agriculture de type
Ikigai » pour la protection de l'environnement
5 Aménagement de l'environnement de la vie
rurale
Sans entrer dans le détail de tous ces points, nous allons
se centrer sur les mesures pour l' « agriculture de type ikigai », et
notamment les mesures qui vont aboutir plus tard à la réalisation
du Projet Nô-Life.
En fait, à cette époque-là, l'idée
du Projet Nô-Life n'existait pas en tant que tel. Mais des idées
ou des intentions se trouvent déjà concrètement dans les
deuxième et troisième points. Il s'agit de l'établissement
d'un système de formations de nouveaux agriculteurs aussi bien de type
industriel que de type Ikigai. C'est là que se situe la «
Conception de l'Ecole rurale (Nôson-juku Kôsô) » que le
Plan de 96 présente dans la partie suivante. En fait, dans ce plan,
l'ensemble du système de formation était envisagé
plutôt dans le cadre de la formation de porteurs de l'agriculture de type
industriel, avec une série de services pour les nouveaux agriculteurs
tel que la consultation, l'information, l'aide aux investissements, l'entremise
de terrains, l'apprentisage technique etc. Par contre, dans le cadre de
l'agriculture de type Ikigai, on envisageait seulement d'établir un
système d'apprentisage agricole destinés aux foyers agricoles
pluriactifs y compris les retraités salariés de ces foyers. C'est
pourquoi le Plan de 96 envisage d'« aménager les conditions et
l'environnement qui permetteront aux agriculteurs âgés et
retraités des foyers agricoles pluriactif de se mettre aux
activités agricoles en pleine motivation »346. En
effet, à cette époque, on ne ciblait pratiquement que la
population des foyers agricoles (pluriactifs ) comme porteurs de l'agriculture
de type Ikigai mais non les personnes des foyers non agricoles. Parce que, en
raison de la réglementation de la surface minimum d'installation
agricole, il était encore difficile de considérer comme porteurs
de l'agriculture les personnes des foyers non agricoles qui ne possèdent
pas de terrains agricoles. C'est pourquoi le Projet Nô-Life envisagera
plus tard de mettre en place un nouveau système de formation agricole
pour la population non agricole non seulement avec l'apprentisage technique
mais également l'entremise de terrains, l'entremise d'emplois agricoles,
la consultation etc.
345 Voir l'annexe.5.
346 Direction de l'Agriculture et de la Forêt, 1996 :
12.
Puis, la différence entre l'agriculture de type
industriel et l'agriculture de type Ikigai résidait, dans leur
définition, aux filières qu'elles visaient. L'agriculture de type
industriel désigne les productions spécialisées
destinées au grand marché, tels que le riz, la pastèque,
le chou chinois, certains fruits (poire et pèche), cetrtaines fleurs, le
thé vert, les élevages et le bois. Tandis que l'agriculture de
type ikigai vise essentiellement des productions polyculture dont les
débouchés sont des marchés locaux, ce qui correspond
à la « nouvelle agriculture péri-urbaine » que le Plan
de 96 envisageait au début. C'est pourquoi le Plan de 96 envisage
également un nouveau système de filière locale
adaptée aux divers produits locaux, en collaboration avec diverses
organisations locales telles que la coopérative agricole ; organisation
de nouveaux groupements de producteurs de type Ikigai ; points de vente directe
; création d'un réseau de coopération avec les commerces
de détail ; les consommateurs etc.
Cependant, pour que puisse se réaliser un
système de formation de l'agriculture de type Ikigai destiné au
public, cela devait prendre encore huit ans, c'est-à-dire jusqu'en 2004
où le Centre Nô-Life fut inauguré. Comme on l'a
évoqué plus haut, pour arriver à cette inauguration, il
fallait connaître plusieurs expériences tentées en
colloboration avec la Coopérative agricole (« jardins citoyens
» depuis 1998, « école vivante de l'agriculture » depuis
2000) et avec la Section de la Création d'Ikigai (« Ferme
école des Personnes âgées » depuis 2002). Puis, une
réforme de la Loi agraire qui réglementait, depuis son
entrée en vigueur en 1952, l'usage des terrains agricoles avec la
surface minimum d'installation de 0.4 ha347, ce qui constituait,
surtout pour la population des foyers non agricoles, un grand obstacle pour
envisager une utilisation formelle de terrains agricoles.
Quelques projets concrets
Par ailleurs, le Plan a prévu quatre projets
concrèts suivants dont l'Ecole rurale faisait partie.
1. Aménagement d'un Parc rural (Nôson
Kôen) par la méthode de Zonage (Zoning hôshiki ni yoru
Nôson Kôen no Seibi)
2. Etablissement de l' Ecole rurale (Nôson
Juku)
3. Développement d'un système de
filière localisée pour la production polyculture
(Jiba-ryûtsu-gata Tahinmoku-seisan-nôgyô no Tenkai)
4. Développement d'un système local et
complexe de la gestion agricole respectueuse de l'environnement (Kankyô
ni Yasashii Junkan-gata-chiiki-hukugô-keiei-nôgyô no
Tenkai)348
En s'inscrivant au sous-thème du Plan de 96 consistant
à un développement de l'aménité rurale, le premier
projet envisageait d'établir un « Parc rural (Nôson
Kôen) » censé intégrer les trois
éléments suivants : jardins citoyens ;
aménagement de l'environnement de la vie rurale ;
Aménagement de l'environnement des beaux paysages
ruraux349.
Monsieur K, président du Centre Nô-Life,
était impliqué dans l'élaboration de ce projet jusqu'en
1999. Cependant, ce projet n'a finalement pas vu le jour pour des raisons que
l'on n'a pas pu clairement vérifier au cours de nos
enquêtes350. Pourtant, on a obtenu des informations dans nos
entretiens, concernant une période creuse qu'ont connu des projets du
Plan de 96 pendant quelques années après l'établissement
du Plan en 1996.
En effet, d'après Monsieur KH, employé du BPA et
vice-président du Centre Nô-Life travaillant avec Monsieur K dans
le Centre Nô-Life, le Plan de 96 a dû se modifier, notamment par
rapport à son premier slogan « Grande ville rurale, Toyota (Ooinaru
Inakamachi-Toyota) » suite à une réclamation
provenant du secteur
347 La surface minimu d'installation est fixé à 0.4
ha dans le cas de Toyota. En général, dans le territoire
japonais, cette surface est fixée à 0.5ha sauf Hokkaidô
où la surface est fixée à 2ha.
348 Direction de l'Agriculture et de la Forêt, 1996 :
16-18.
349 Voir l'annexe 6.
350 Monsieur K et d'autres acteurs qui étaient
impliqués dans le projet, n'avaient pas voulu nous expliquer les causes
de la suspension de ce projet. Autrement, à cette époque,
Monsieur K pensait à réaliser ce projet par une méthode de
coopération entre secteurs public et privé appellée «
PFI (Private\u-243£Finance \u-243£Initiative) ».
automobile portant sur ce slogan. Des représentants du
secteur de l'industrie automobile a réclamé que ce slogan
proclamé par le Plan risquait d'aller à l'encontre du slogan
permanent de la Ville de Toyota : celui de la « Ville de la voiture
(kuruma no machi) ». Nous n'avons pas obtenu plus d'informations pour
vérifier si la suspension du projet du Parc rural est liée
à ce retrait du slogan du Plan fondamental 96. Sinon, il paraît
que le maire de Toyota de cette époque n'était pas, en
réalité, forcément favorable à l'égard de
nouvelles mesures en matière de l'agriculture et de la ruralité,
à la différence du maire actuel de Toyota, élu en 2004. Il
s'exprime souvent son intérêt vif à l'égard de
l'agriculture et de la ruralité dans ses discours, et encouragea ainsi
le BPA à réaliser une série de mesures concernées.
Bon nombre de personnes dont les employés du BPA et Monsieur K, ont
reconnu que l'initiative de ce nouveau maire était importante pour
pouvoir démarrer le Projet Nô-Life.
Puis, c'est après la suspension du Projet Parc rural que
Monsieur K a commencé à s'impliquer dans d'autres projets qui
seront liés au Projet Nô-Life notamment avec la CAT et la Section
de la Création d'Ikigai (SCI).
Cependant, d'après Monsieur K, il prévoyait
déjà, dans le cadre du Projet Parc rural, d'éventuelles
possibilités de réaliser un système de formation agricole
pour les citoyens. L'idée que les citoyens s'intègrent à
la ruralité en se mettent réellement à des
activités agricoles, était déjà présente
chez lui à cette époque-là. Dans le Plan de 96, une grande
image du Parc rural est présentée (voir l'annexe 7). Nous
pouvons trouver dans cette image dessinée en double page, un ensemble
d'éléments représentant l'agriculture et la
ruralité de Toyota que la Municipalité de Toyota imaginait dans
le cadre du projet du Parc rural. Cette image semble fortement marquée
par l'idée de la multifonctionalité où la nature, les
cultures diverses, les agriculteurs et le public s'intègrent dans un
espace rural351.
Puis, le deuxième projet est l'Etablissement d'une
Ecole rurale. En fait, ce projet avait été conçu par
Monsieur S, directeur actuel de la Direction des Activités agricoles de
la CAT, que l'on a également intérrogé. Il l'avait
proposé, au début, sous le nom de « Second Life Academy Plan
». Nous allons aborder le contenu de ce plan dans la partie de l'Acteur 2
(Section de la Création d'Ikigai de la Municipalité) et l'acteur
3 (Direction des Activités agricoles de la Coopérative agricole).
Son intention initiale était de créer de petites écoles
où les femmes et retraités des foyers agricoles pluriactifs
pourraient apprendre des méthodes culturales, afin de faire face au
problème de manque de successeurs d'exploitations agricoles du
territoire de Toyota. Monsieur S envisageait ce projet de formation uniquement
pour les personnes originaires des foyers agricoles, à la
différence de la Municipalité qui voulait orienter le Projet vers
le « public » en général, c'est-à-dire tous les
« citoyens (shimin) » de Toyota, quelque soit son origine (agricole
ou non). C'est pourquoi dans le cadre de ce Plan, la Municipalité met
l'accent non seulement sur la formation agricole, mais également sur
d'autres thématiques susceptibles d'intéresser le public telles
que l'échange entre citoyens et agriculteurs, et la sensibilisation aux
thématiques de la politique agricole de la Municipalité
(développement agricole et conservation des terrains agricoles). Un
shéma conceptuel de l'Ecole rurale est ainsi établi par le Plan
(voir l'annexe 8)
En se basant sur cette conception, plusieurs initiatives ont
collaboré avec le BPA, comme on avait déjà
évoqué plus haut : la CAT pour réaliser l'Ecole de
l'agriculture vivante en 2000 et la Section de la Création d'Ikigai de
la Municipalité pour réaliser la Ferme-école des Personnes
âgées en 2002. Et Monsieur K, président du Centre
Nô-Life, étaient impliqué dans la réalisation de ces
deux projets.
Le troisième point concernant le projet pour le
développement d'une filière locale de divers produits du terroir,
envisageait de créer un réseau de coopération entre de
nouveaux groupements de producteurs de type Ikigai, la coopérative
agricole et ses points de vente directe, la Municipalité, les
consommateurs et les
351 Nous trouvons dans cette image : riziculture en plaine
où travaillent un couple et plusieurs personnes travaillent pour la
moisson avec une petite moisonneuse-batteuse (gauche en haut) ; foyer rural et
traditionnel où habite une grande famille (centre en haut) ;
rizières en étage de moyenne montagne (droite en haut) ; vergers
où le public vient en famille pour récolter les fruits (gauche en
bas) ; ruisseau à la campagne où des enfants jouent à
attraper les poissons (centre en bas) ; champs de thé vert où le
public vient en famille aider la récolte (gauche en bas) ; grand
panorama d'un paysage rural où sont intégrés tous les
éléments des autres images, avec les montagnes, les forêts,
les petites rizières, les habitations dispersées etc. (au
centre).
commerçants de détail352. Le
quatrième point concerne la création d'un système de
« filière » de fumier via recyclage, réalisé
dans un nouveau Centre de compostage, des déchets ménagers,
vannure de riz provenant de la Coopérative agricole et déjections
animales provenant des élevages353.
Principe de partenariat
Par ailleurs, le Plan établit comme ci-dessous, en vue de
sa réalisation, un principe de partenariat public et privé
notamment avec la Coopérative agricole, le Centre pour la Vulgaristaion,
les agriculteurs et les citoyens.
Distribution des rôles dans l'application des
mesures
Municipalité
: Saisir les contextes larges des niveaux national et
international et présentation des visions du développement
agricole de Toyota ; Saisir les projets départementaux et nationaux et
examin des mesures propres comme compléments de ces projets ; Offre des
informations sur les menus des mesures et des projets aux agriculteurs ;
Sensibilisation du public à l'agriculture
|
|
|
CAT
|
: Jouer le rôle de coodinateur et producteur qui
promeuvent les mesures et projets, en collaboration avec les agriculteurs et
l'administration ; Soutiens directes aux agriculteurs du côté
technique et économique
; Jouer le rôle de leader dans le
développement agricole ; Jouer le rôle de coordinateur dans la
mobilisation et la concentration de terrains agricoles ; Construction d'un
système de distribution de l'alimentation, à la demande des
consommateurs, dans lequel sont assurés la sécurité, la
traçabilité et le bon prix.
|
|
|
ECV
|
: Saisir les projets départementaux et nationaux ;
Divers soutiens concernant les domaines : technique, gestion, formation de
porteurs, amélioration des conditions de vie et développement
agricole
|
|
|
|
|
Niveau
territorial
: Agriculteurs (groupes liés par le lien au sol,
dont les exploitations - porteurs sont principales). En tenant compte du fait
que les acteurs du développement agricole et de la conservation de
terrains agricoles sont toujours les agriculteurs, ils s'efforcent,
positivement et spontanément, à stabiliser leur gestion agricole
et améliorer leur productivité agricole.
Citoyens
: Compréhension de la nécessité de
l'agriculture et de ses fonctions d'intérêt public ; Jouer le
rôle de supporteurs de l'agriculture de Toyota en tant qu'aidants de
travaux agricoles, ou consommateurs ; Jouer le rôle d'acteurs de la
gestion de l'environnement territorial, de l'aménagement du territoire
et de la ville
(Direction de l'Agriculture et de la Forêt, 1996 : 20)
Il est caractéristique que le schéma accorde la
plus grande importance à la Coopérative agricole, en explicitant
qu'elle est susceptible de jouer à la fois les rôles de «
coordinateur », « producteur » et « leader » dans le
développement agricole. Le rôle explicite de la
Municipalité reste complémentaire dans ce schéma par
rapport à la Coopérative agricole ainsi qu'aux agriculteurs,
c'est-à-dire les acteurs du secteur agricole.
De ce fait, on peut remarquer un fort ancrage de la politique
agricole de la Municipalité dans le secteur agricole, d'où son
caractère à la fois public et sectoriel (économique,
spécialisé et privé).
Quelques analyses du Plan de 96
L'établissement du Plan de 96 a joué un
rôle primordial dans le processus de la construction du Projet
Nô-Life. Il a d'abord établi un bilan de situation locale et
historique de l'agriculture de Toyota, et à partir de ce bilan,
formulé de nouvelles idées qui permettent au BPA
(Municipalité) d'apporter des changements à leur politique
agricole de façon à s'adapter, stratégiquement, à
des facteurs externes et internes. Notamment, en anticipant même
l'initiative de l'Etat, il a réussi à constituer, de façon
légitime, deux grands cadres de la
352 Egalement, ce projet est progressivement
réalisé par plusieurs initiatives avec un slogan qui est conjoint
à la thématique de l'autosuffisance alimentaire. Ce slogan est :
« produire et consommer localement (chisan-chishô) ». Depuis
ces dernières années, ce terme est à l'air du temps au
Japon. Ainsi, depuis lors, une série de projets ont été
réalisé à Toyota. (ex. ouverture d'un magasin
géré par la Coopérative agricole, qui est
spécialisé aux produits du terroir de Toyota ; un nouveau
groupement de producteurs d'Ikigai organisé par des anciens stagiaires
de « l'Ecole de l'agriculture vivante » ; lancement du thé
vert de marque Toyota en cannette etc.).
353 Cependant, la réalisation de ce projet n'a pas
été non plus finalisée en tant que tel. (ex. Le centre de
compostage n'a pas été construit.) Cependant, la
Municipalité a établi une liste d'adresses d'éleveurs
localisés dans la Ville de Toyota, qui produisent leur fumier à
base de déjections animales de leurs bétails, qui est disponible
au public depuis 2002.
politique agricole, qui sont propres à la
Municipalité de Toyota :
- Intégration des thématiques globales dans les
contextes locaux : autosuffisance alimentaire et multifonctionalité par
l'introduction des nouvelles catégories d'agriculture : industriel /
ikigai. Ces catégories sont susceptible d'intégrer non seulement
toutes les couches de la population agricole, mais également la
population non agricole.
- Paticipation citoyenne aux activités agricoles et
rurales
Puis, on pouvait trouver, dans les représentations
manifestées par le Plan de 96, un principe qui marque sa
conhérence, et qui est inhérent au BPA (Municipalité) en
tant qu'un agent du secteur public : logique des services publics qui poursuit
toujours l'intérêt public (d'où l'autosuffisance
alimentaire et la multifonctionalité), et qui est toujours « au
service de tous » (d'où le recours à la participation
citoyenne).
Ainsi, vers 2001, le BPA a amorcé le processus de
démarrage du Projet Nô-Life selon le principe de partenariat,
également établi par le Plan de 96, reliant la
Municipalité à d'autres agents publics et privés.
L'enquête réalisée par le BPA en 2003, auprès de la
population de la Ville de Toyota, agricole et non agricole, va ainsi
rejustifier ce processus de démarrage en tant qu'une politique
publique.
Enquête sur la conscience sur l'agriculture de Toyota
(Toyota-shi Nôgyô ni kansuru Ishiki Chôsa)
Contextes de la réalisation de l'Enquête
En 2001, la thématique de la construction d'un
système de « Recherche et formation de nouveaux porteurs (aratana
ninaite hakkutsu-ikusei) » fut mise en discussion. Et les trois
années qui l'ont suivi, constituèrent la plus importante
période dans les étapes pour la réalisation du Projet
Nô-Life. Dans ce cadre de discussion, fut entamé l'examen des
mesures relatives aux friches agricoles (Yûkyû nôchi) et
à l'installation des agriculteurs de type Ikigai354. En 2002,
plusieurs réunions officielles ont eu lieu sur cette thématique
entre le BPA et des agents attachés au Ministère de
l'Agriculture, de la Pêche et de la Forêt tant au niveau
départemental qu'au niveau national355. Ces discussions
portaient notamment sur l'application de la nouvelle politique nationale de
déréglementation, la Politique des Zones spéciales,
lancée en 2002 par le Gouvernement de M. Koizumi. Pour y
procéder, le BPA devait surtout collaborer avec la Préfecture
d'Aichi (dont le Bureau départemental de la Politique Agricole) qui est
en charge des dossiers pour l'application de ce programme à toutes les
collectivités territoriales du département. C'est en janvier 2003
que fut remise au Secrétariat du Gouvernement la première
proposition de déréglementation de la Ville de Toyota pour le
Projet Nô-Life à titre consultatif. Puis, c'est un an après
la remise de cette demande (janvier 2004) que la « Zone spéciale
pour la Création de Nô-Life (Nô-Life Sôsei Tokku)
» fut approuvé avec les programmes complets du Projet
Nô-Life.
Ensuite, en juin 2003 et janvier 2004, la réunion
officielle pour l'établissement du Centre Nô-Life356
coordonnée par la Municipalité (BPA) et la CAT, et
également avec la participation de divers agents locaux concernés
tels que : entreprises locales ; syndicat ouvrier ; agriculteurs ;
organisations agricoles ; chambre du commerce et de l'industrie ; associaion
des chefs des quartiers ; Agence publique de l'Emploi ; Bureau régional
du Ministère de l'Agriculture de Tôkai ; Département ; CAT
; Municipalité etc357.
Puis, l'« Enquête sur la conscience sur
l'agriculture de Toyota » a été réalisée
par le BPA, en collaboration avec un organisme local représentant des
syndicats ouvriers du Département (Conseil local de la région de
Toyota attaché à la Fédération des Syndicats
ouvriers du Département d'Aichi). Cette enquête a
été effectuée de juin à août 2003, en plein
lancement du processus concret du démarrage du Projet Nô-Life. De
ce fait, on peut d'ailleurs clairement voir, dans les explications de
l'objectif de cette enquête, une série d'idées qui
sous-tendent
354 Bureau de la Politique Agricole de la Ville de Toyota, 2006 :
2.
355 Ibid.
356 Sous le nom provisoire de ce Centre « Centre pour le
soutien aux activités agricoles (Einô Shien Center) ».
357 Bureau de la Politique Agricole de la Ville de Toyota, 2006 :
2.
le Projet Nô-Life.
Objectifs de l'Enquête : idées
héritées du Plan de 96. Vers une approche du « bien commun
»...
Comme on l'a déjà expliqué plus haut,
l'enquête a été effectuée auprès de deux
types de population : 2500 chefs de foyers agricoles (Nôka no setai
nushi) et 2050 travailleurs résidants dans la Ville de Toyota. Deux
questionnaires différents ont été distribués
à chacun de ces deux types de population358.
Le contexte et l'objectif sont expliqués de la
manière suivante pour ces deux types de population :
« Objectif de l'Enquête : L'agriculture et les
terrains agricoles ont un rôle important pour l'offre alimentaire. Et ces
dernières années, il est reconnu qu'ils remplissent des fonctions
multiples dans l'éducation, la santé, les échanges
(communication), le paysage et l'aménagement de la Ville. Cependant,
dans notre ville, la population agricole et les friches agricoles augmentent en
raison du vieillissement de cette population et du manque de successeurs. Pour
freiner l'aggravation d'une telle situation, il est nécessaire d'avoir
un mécanisme de formation de nouveaux porteurs, et de mise en valeur des
friches agricoles. Cette enquête a pour but d'étudier le
mécanisme, les systèmes, les établissements
nécessaires pour les personnes non agriculteurs qui se mettent
réellement à des activités agricoles. Par ailleurs, sont
mentionnés dans les questionnaires les éléments suivants :
la forme de distribution des produits agricoles ; la conscience des
consommateurs sur la traçabilité et la sécurité
alimentaire ; l'idée de `produire et consommer localement' susceptible
de augmenter le taux de l'autosuffisance alimentaire. Nous avons pour but de
faire du résultat de cette enquête une donnée de base pour
examiner le mode de développement agricole d'une nouvelle
ère359. »
Puis, pour les chefs des foyers agricoles, l'objectif
spécifique du questionnaire est « de saisir ce que pensent et
souhaitent les foyers agricoles possédant les terrains agricoles et de
se servir de ces données pour élaborer des mesures efficaces
à la prévention des friches agricoles360».
Et concernant les travailleurs : l'objectif est de « rechercher des
possibilités où les salariés d'entreprises n'ayant pas
actuellement de rapport avec l'agriculture, deviennent de nouveaux porteurs de
l'agriculture après leur retraite361 ».
Là, on voit clairement que cette enquête
s'inspire de l'essence des idées qui ont été
développées dans le Plan de 96 : lier les thématiques
globales de l'agriculture et de la ruralité (autosuffisance et
multifonctionalité) aux mesures concrètes de prévention
des crises locales de l'agriculture (friche et manque de successeurs -
porteurs), par l'introduction de deux nouvelles catégories d'agriculture
: industrielle et ikigai. Et cette enquête recherche également les
degrés d'attentes vis-à-vis de ces mesures de prévention,
des deux côtés des populations agricole et urbaine (dont les
foyers agricoles pluriactifs peuvent faire partie de ces deux catégories
de population, en même temps).
Enfin, il est intéressant d'ajouter que, dans la
couverture utilisée pour le questionnaire destiné aux
travailleurs, on explicite l'idée de considérer l'agriculture et
les terrains agricoles comme bien commun. Ainsi, après l'explication sur
la multifonctionnalité de l'agriculture et l'aggravation de la situation
agricole, il est noté comme suit : « ... pour freiner une telle
aggravation de la situation, et développer l'agriculture de notre ville
pour les générations futures, il est nécessaire d'avoir la
coopération et un haut degré d'intérêt de chacun de
vous les citoyens, basés sur une perception que l'agriculture et les
terrains agricoles constituent un bien précieux pour l'ensemble des
citoyens »362.
Analyses du résultat et conclusions faites par le BPA
358 Pour les chefs des foyers agricoles, 1432 réponses ont
été récupérées (soit 57.3% de taux de
récupération) et pour les
travailleurs 1470 réponses récupérées
soit 71.7% de taux de récupération). (Bureau de l'Agriculture et
de la Forêt, 2003 : 2 ; 39)
359 Ibid. : 2.
360 Ibid.
361 Ibid. : 39.
362 Ibid. : 70.
Du côté des foyers agricoles, 21 questions ont
été posées363. Les analyses du résultat
faites dans le rapport portent sur les cinq points suivants : état de
gestion d'exploitation agricole ; continuation des activités agricoles ;
état des friches ; possibilités de location de terrains ;
attentes sur les mesures de soutien.
L'état de gestion des exploitations agricoles est
d'abord marqué par l'avancement du vieillissement de la population
agricole : les personnes de plus de 65 ans représentent 53.7% du nombre
total des enquêtés, et celles de plus de 75 ans soit
20.8%364 . Ensuite, le taux de foyers agricoles pluriactifs est de
59 % du nombre total et les foyers agricoles pluriactifs de la deuxième
catégorie de 42.7% 365. Puis, 57.2% des foyers cultivent
principalement du riz366. Ceci « est en contraste avec l'image
généralement diffusée de l'agriculture de Toyota, qui est
marquée par des cultures spéciales comme la pêche, la
poire, le thé, les fleurs etc367 »
Les réponses concernant la continuation des
activités agricoles reflètent un « résultat
très grave » : 44.3% des enquêtés ne sont « pas
sûrs de continuer après un certains temps » et 26.6% ne sont
« pas dans un état où il est possible de continuer »
pour cause de : « surcharges d'investissement dans les machines » (3
8.8%) ; « manque de successeurs - porteurs »
(34.5%)368.
Sur l'état des friches agricoles, 25.1% « ont des
friches » et 21.6% « ont des champs mis en
jachère369 ». Et ceci pour cause de : «
productivité insuffisante en raison de mauvaises conditions
géographique et topographique » (26.6%) ; « manque de porteurs
» (20.2%)370. Le rapport explique qu'il y a là un
problème sur le rapport déséquilibré entre efforts
humains et retours économiques371.
A côté de ces aspects négatifs de la
situation des foyers agricoles, les réponses sur les possibilités
de location de terrains agricoles montrent, malgré 3 0.7% qui « ne
pensent pas louer aux particuliers », des intentions potentiellement
positives : 5.2% « en louent déjà pour des jardins familiaux
et citoyens » ; 19.8% « veulent en louer sous conditions » ;
22.8% sont « prêts à en louer s'il n'y a pas de
problèmes juridiques » ; 19.6% « peuvent louer les terrains
non cultivés » ; 12.4% « peuvent louer si les locataires se
mettent à l'agriculture sérieusement et non pour leur loisir
». C'est-à-dire que 79.6% des foyers agricoles sont prêts
à louer leurs terrains en fonction de conditions de location (profil de
locataires, durée, frais, entremise etc) !.
Concernant les mesures de soutien, 35 % attendent des «
soutiens à la prévention des friches ». Le rapport ajoute
les risques que les friches peuvent provoquer, à savoir des
éléments d'aggravation de l'environnement agricole comme la
« prolifération de mauvaises herbes et d'insectes nuisibles »
et les « dépôts illégaux de déchets
»372. Puis, les travaux d'entretien dont surtout le
désherbage constituent des charges lourdes pour les personnes
âgées373.
Dans la conclusion sur les foyers agricoles, le rapport
constate qu'il y a une aggravation du problème du vieillissement de la
population agricole et du manque de porteurs, et que, surtout dans les zones de
moyenne montagne, la situation devient de plus en plus critique avec une
augmentation nette des friches. Puis, il est également constaté
qu'il y a un dilemme pour la continuation des activités agricoles : d'un
côté, il est nécessaire de rationaliser la production
agricole via mécanisation, remembrement etc, mais de l'autre
côté, le coût d'investissement pour les machines agricoles
pèse trop lourd pour la plupart des exploitations qui sont
363 Ibid. : 5. Les points abordés par chacune de ces
questions sont : 1 Sexe ; 2 Age ; 3 Localisation des foyers (adresse du
domicile) ; 4 Situation de l'exploitation agricole
(professionnelle ou pluriactive ;, 5 Types de cultures ; 6 Présence de
successeurs ;
7 Continuation des activités agricoles ; 8 Types de
problèmes pour la continuation ; 9 Orientation ultérieure de
gestion
d'exploitation ; 10 Surface des terrains agricoles
possédés ; 11 Modes d'utilisation et de gestion
ultérieurs; 12 Présence de friches ;
13 Raisons de ces friches (ne pas cultiver) ; 14 Locations de
terrains agricoles aux particuliers (envisagées ou pas) ; 15 Conditions
possibles de location ; 16 Types de personnes auxquelles louer des terrains
agricoles ; 17 Surface possible de terrains agricoles à
mettre en location ; 18 Frais possible de location ; 19
Durée possible de location ; 20 Types de besoins d'aides agricoles
apportées
par les particuliers ; 21 Types de mesures de soutien.
364 Ibid. : 6.
365 Ibid.
366 Ibid.
367 Ibid.
368 Ibid.
369 Ibid.
370 Ibid.
371 Ibid.
372 Ibid.
373 Ibid. Le désherbage constitue un travail important
dans l'agriculture japonaise.
pluriactives.
Par ailleurs, la présence d'une attente potentielle
à l'égard de la location de terrains agricoles aux particuliers a
été constatée chez la grande majorité des foyers
agricoles. C'est ce qui pousse le BPA à réaliser des projets qui
établissent des conditions nécessaires pour que ces foyers
puissent procéder à ces locations. Le Projet Nô-Life a pour
but de répondre à cette attente réelle des foyers
agricoles.
Du côté des travailleurs, 17 questions ont
été posées concernant les points suivants par
l'intermédiare du Conseil local de la région de Toyota
attaché à la Fédération des Syndicats ouvriers du
Département d'Aichi374. Les analyses du
résultat faites dans le rapport portent sur les quatre points suivants :
profils, motifs et modes de participation dans le domaine agricole ;
importances mises sur les produits agricoles ; possibilités de location
de terrains ; attentes sur les mesures agricoles ultérieures.
D'abord, 45.9% des enquêtés ayant répondu
à cette enquête, dont 89% sont des hommes, avaient moins de 39
ans. Ce sont donc des hommes « dans la force de l'âge (hataraki
zakari) »375. Puis, 62.7% des enquêtés ont
exprimé une envie de mener des activités agricoles d'une
manière quelconque : 3 5.5% veuleut faire « un jardin potager comme
un loisir », 24.5% « pour l'auto-consommation » et 2.7% «
pour vendre des produits et en tirer un revenu »376. En effet,
41.6% des enquêtés « veuleut manger ou faire manger des
produits cultivés par eux-même »377. Le rapport
ajoute qu'il y a un effet d' « images et de rêves sur la terre
» qui amènent le public à penser comme
ceci378.
Ensuite, le rapport trouve remarquable que la grande
majorité des enquêtés accordent plus d'importance à
la qualité des produits qu'à leur apparence : 61.4% accorde plus
d'importance au « goût » ; 56.3% à la «
sécurité » plutôt qu'à l'apparence (5.0%
seulement)379.
Concernant la location de terrains agricoles, seulement 24%
des enquêtés « veuleut louer »380. Le rapport
explique que, du fait qu'ils sont pleinement actifs, l'idée de louer un
terrain peut être irréaliste pour eux381. Cependant, en
tenant compte du fait que 22.7% des enquêtés veuleut mener des
activités agricoles « pour bien profiter du temps libre
après la retraite », le rapport ajoute que l'attente pour la
location est potentiellement grande382. Ainsi, il est
confirmé que les retraités peuvent être
considérés comme de « nouveaux porteurs de l'agriculture
»383.
Concernant les attentes sur les mesures agricoles
ultérieures, les enquêtés se sont exprimés sur les
domaines suivants : « Offre de l'alimentation dont la
sécurité est assurée » (57.1%) ; «
Système de production et de distribution directement lié aux
consommateurs » (33.5%) ; « Occasions où les enfants peuvent
connaître l'agriculture » (3 0.8%) ; « Promotion de
l'agriculture biologique ou sans traitement chimique »
(24.4%)384.
Enfin, dans la conclusion sur les travailleurs, le rapport
remet d'abord l'accent sur le fait que 62.7% des enquêtés veulent
mener des activités agricoles d'une manière quelconque. Il est
également confirmé que les attentes sur la sécurité
alimentaire et un nouveau système de filière alimentaire sont
élevées. Concernant des possibilités de considérer
le public comme nouveau porteur de l'agriculture, le rapport conclut que,
même s'il est impossible d'attendre des personnes actuellement actives ce
rôle, il sera possible de les orienter dans le
374 Bureau de l'Agriculture et de la Forêt, 2003 : 42. Les
points abordés par chacune de ces questions sont : 1 Sexe ; 2 Age ; 3
Localisation des foyers (adresse du domicile) ; 4 Possession de terrains
agricoles ; 5 Expériences agricoles ; 6 Usages de jardin
familial ; 7 Types d'établissements agricoles
souhaités dans l'aménagement ; 8 Types de participation
souhaités dans le domaine agricole ; 9 Motifs pour cette participation ;
10 Eléments importants dans le domaine agricole ; 11 Formes possibles
de
participation ; 12 Location de terrains agricoles ; 13 Conditions
possibles de location (surface, frais, durée, localisation) ; 14
Soutiens souhaités pour commencer des activités
agricoles ; 15 Raisons de ne pas vouloir faire des activités agricoles ;
16 Types d'échanges souhaités avec les gens des fermes ; 17
Mesures agricoles ultérieures souhaitées
375 Ibid. : 43
376 Ibid.
377 Ibid.
378 Ibid.
379 Ibid.
380 Ibid.
381 Ibid.
382 Ibid.
383 Ibid.
384 Ibid.
domaine agricole après leur retraite, à condition
d'établir des conditions nécessaires pour la location de terrains
et un système de formation suffisant.
La réalisation de cette enquête a pour
conséquence de réaffirmer, de manière neutre,
légitime voire publique, l'importance de fonctions que remplissent
l'agriculture et de la ruralité dans la société, surtout
au niveau local. Les analyses du résultat et les conclusion faites par
le BPA vont préciser l'orientation des mesures de la Municipalité
dans de nouveaux cadres émergents de la politique agricole
(multifonctionalité, participation citoyenne, agriculture de type Ikigai
etc). Ce qui permet à la Municipalité de mener sa politique
destinée au public dans une convergence d'intérêts entre sa
politique et le public, à savoir l'intérêt public.
Puis, cette procédure nous semble avoir
été efficace pour atténuer des éléments
d'incertitudes qu'un nouveau type de projet comme le Projet Nô-Life
implique dans sa dimension locale. C'est-à-dire, les incertitudes au
niveau des attentes vis-à-vis du Projet, et des valeurs que le public
loal accorde au Projet, malgré la légitimité des
idées générales qui sous-tendent le Projet.
Zone spéciale de la Création du Nô-Life
(Nô-Life Sôsei Tokku)
Comme on l'a déjà évoqué plus
haut, c'est à partir de la fin 2002 et au cours de l'année 2003
qu'une série de procédures se sont effectuées au sein de
divers acteurs vers la réalisation du Projet Nô-Life, sous le nom
provisiore du Centre Nô-Life « Centre pour le soutien aux
activités agricoles (Einô Shien Center) ». Et parmi ces
procédures, le fait de poser la candidature pour la Politqiue des Zones
spéciales au nom de la Municipalité, et d'appliquer ses
propositions de déréglementations concernant la Loi agraire
(Nô-chi hô), ont constitué une étape finale et
déterminante de la concrétisation du Projet Nô-Life.
Procédures des « Zones spéciales »
Dans le cadre de la politique des Zones spéciales, en
janvier 2003, la Municipalité de Toyota remit au Gouvernement, à
titre consultatif, quatre propositions de déréglementations
concernant la Loi agraire lors de la « Deuxième appel à
candidature de propositions (dainiji teian boshû) » lancé par
le Gouvernement. Ensuite, le Gouvernement a donné ses réponses
à la Municipalité de Toyota, sur la faisabilité de chacune
de ces propositions. C'est un an après cela que la Municipalité
effectua une « demande commune (kyôdô teian) » avec le
Département d'Aichi pour faire qualifier la Ville de Toyota par l'Etat
comme « Zone spéciale pour la Création du Nô-Life
(Nô-Life Sôsei Tokku) » où des
déréglementations sont authorisées en deux points suivants
:
1 Elargissement du droit d'ouverture de jardins citoyens
(shimin nôen no kaisetsusha no hani kakudai)
2 Baisse de la surface minimum d'installation (nôchi
shutoku go no nôchi no kagen-menseki yôken
kanwa)385
Le premier point consiste à élargir le droit
d'ouverture de jardins citoyens aux personnes morales privées louant des
terrains agricoles ainsi qu'aux propriétaires de terrains agricoles en
friche ou en jachère. En effet, auparavant, ce droit était
limité à la collectivité territoriale et à la
coopérative agricole. Celles-ci géraient déjà dans
le territoire de la Ville de Toyota, en 2002, 24 jardins familiaux et citoyens
composés par 985 parcelles, dont 968 sont utilisées. Et il
était constaté que la demande de jardins était de plus en
plus importante. Cette mesure de déréglementation était
ainsi appliquée afin de répondre davantage à cette
demande.
Le deuxième point consiste à baisser la «
surface minimum d'installation (shûnô kagen menseki) » de
0.4ha à 0. 1ha. En effet, cette surface minimum était
fixée par la Loi agraire pour l'obtention du droit d'utilisation ou
d'achat de terrains agricoles destinés aux activités
agricoles.
L'établissement du Centre Nô-Life est
défini dans le cadre du programme de la « Zone spéciale
» de la Ville de Toyota comme un « projet qui peut être
considéré comme nécessaire pour promouvoir l'application
de son
385 Bureau de la Politique Agricole de la Ville de Toyota, 2006 :
2.
pragramme de la Zone spécilale par la
collectivité territoriale concernée »386.
Ainsi, dans cette étape de la qualification de la Ville de
Toyota, pour la première fois, le mot « Nô-Life » est
officiellement apparu387. Et le contenu des acivités
principales du Centre Nô-Life est également
déterminé.
Les quatre activités principales du Centre Nô-Life
ainsi déterminées sont :
1 Formation (Stages de techniques culturales)
2 Entremise de terrains agricoles
3 Entremise de possibilités d'emplois agricoles chez
des exploitations agricoles
4 Recherche de nouvelles variétés de produits
agricoles, de nouveaux produits transoformés etc388.
Premièrement, les formations Nô-Life sont
composées de deux types de formation dont l'un s'appellant «
Formation Porteur (Ninaite-zukuri Co-su) », est destineé aux
« citoyens ayant pour objetcif d'avoir un revenu via leur agriculture
», et l'autre s'appellant « Formation Culture des
Légumes de saison (Shun no Yasai-zukuri co-su) » aux «
citoyens souhaitant cultiver des légumes dans un jardin citoyen
quelconque comme loisir ou pour la santé »389.
Deuxièmement, le service de l'entremise est directement
lié aux éléments de déréglementation
expliqués plus haut (Elargissement du droit d'ouverture de jardins
citoyens, Baisse de la surface minimum d'installation). Le Centre Nô-Life
est notamment chargé d'entremettre des terrains agricoles disponibles
à chacun/chacune des personnes ayant terminé la « Formation
Porteur », qui souhaite en louer dans le territoire de la Ville de Toyota.
Puis, le Centre assume également le service d'aides aux
propriétaires de terrains agricoles souhaitant ouvrir des jardins
citoyens dans leurs terrains.
Troisièmement, le Centre Nô-Life assume un
rôle comme s'il était un « agence d'emplois agricoles ».
En fait, ce domaine d'activités concerne également un des objets
de déréglementation dans le cadre de la Zone spéciale de
Nô-Life. Il concerne la Loi de la Stabilité de l'Emploi
(Shokugyô antei hô). Cette déréglementation permet au
Centre Nô-Life de proposer gratuitement aux particuliers un emploi
agricole consistant à aider des travaux agricoles d'une exploitation
agricole.
Quatrièmement, dans le cadre de la Formation Porteur,
le Centre Nô-Life effectue, avec la CAT, des recherches de nouvelles
variétés de produits agricoles ou de nouveaux types de produits
transformés. Ce domaine d'activités semble surtout être
lié à l'intérêt économique de la CAT.
Ainsi, le Centre Nô-Life prend un caractère
multiforme, à la fois en tant qu'une école (formation agricole),
un agence immobilier (entremise de terrains agricoles ), un agence d'emplois
(entremise de possibilités d'emplois agricoles) et enfin un laboratoire
(recherche nouveaux produits agricoles).
386 Ville de Toyota, 2003b : 5.
387 Le mot « Nô-Life » est un terme
inventé par la Municipalité. Nous anlyserons sa terminologie plus
bas. C'est une combinaison originale du terme « Nô =
\u-28750ÒÜ en kanji (caractère chinois) » qui signifie
le « rural » ou l' « agricole » , avec le « Life (en
anglais) = \u12521«é« \u12501«Õ (laihu) » En
employant ainsi un tel nouveau mot dont on peut facilement percevoir le sens
comme « une vie de type agricole ou rural », mais qui n'a jamais
existé ailleurs au Japon, au lieu d'utiliser simplement des termes
japonais courants comme « vie agricole (Nôgyô seikatsu) »
ou « vie rurale (Nôson seikatsu) », le nom de «
Nô-Life » évoque une sensation nouvelle pour le public. Et ce
terme évoque non seulement une sensation nouvelle et moderne voire
urbaine avec le terme « Life » en anglais (plutôt que «
Seikatsu » en japonais), mais également une connotation d'«
activités agricoles » avec le terme « Nô ». Ce qui
distingue notamment ce terme de la simple image de « vivre à la
campagne » dans la tranquilité et l'aménité...
388 Ville de Toyota, 2003b : 5. Nous présenterons les
activités du Centre Nô-Life dans la première partie du
chapitre 3.
389 Voici, les explications générales
données sur ces deux filières dans ce « Plan pour les Zones
spéciales de la Réforme structurelle » : Formation Porteur :
La durée de formation est deux ans (les cours sont donnés une
fois par semaine). Les quatres matières suivantes sont organisées
: « champs sec (hata-ka) : légumes (yasai) »; «
rizière - champs sec (tahata-kaà : légumes, riz (yasai,
suitô)» ; « rizière (tanbo-ka) : riz, blé, soja
(suitô, mugi, daizu) » ; « fruitière (kaju-ka) ».
Le nombre de stagiaires est environ 10 par matière. Les personnes ayant
terminé cette formation ont le droit de bénéficier du
service d'entremise de terrains agricoles et d'emplois agricoles proposé
par le Centre Nô-Life (activités 2 et 3).
- Flière Culture des Légumes de saison : La
durée de formation est six mois (les cours sont donnés une fois
par mois). Les matières sont : celle de Légumes du printemps -
été et celle de Légumes de l'automne - hiver. Le nombre de
stagiaires est environ 50 par matière.
Un processus stratégique...
Ce processus nous montre, du point de vue de rapports entre
représentations que le BPA mobilisent pour le Projet Nô-Life et
ses actions de ce projet, non seulement un processus politique et pragmatique
vers la réalisation concrète du Projet, mais également un
processus complexe de mobilisation de différents types de moyens
déterminants des actions du Projet Nô-Life. En effet, ont
été mobilisé de différents types de moyens qui
impliquent à la fois des éléments culturels (dans le sens
de valeurs, par exemple « Ikigai » ; « agriculture comme bien
commun » etc), juridiques (opérations juridiques via
déréglementation), économiques (financement public) et
sociaux (mobilisation de divers acteurs et du public). Et tous ces moyens sont
orientés vers la réalisation de l'objectif du Projet.
Ce processus de la Ville de Toyota pour la qualification comme
« Zone spéciale », fut amorcé suite au constat d'un
problème juridique qui faisait obstacle à la réalisation
de l'objectif de la politique agricole du BPA (installation agricole à
petite échelle : plus de 0. 1ha mais moins que 0.4ha). Et c'était
une action de type spontané de la part du BPA et de la
Municipalité, puisque cette déréglementation lui
paraîssait logique et évidente par rapport à la
démarche historique de sa politique de la dernière
décennie (étapes progressives pour la promotion de l'agriculture
de type ikigai), plutôt que par rapport à la stratégie de
l'Etat dans sa politique des « Zones spéciales de la Réforme
structurelle » amorcée depuis 2002. C'était par
nécessité et pour saisir l'opportunité offerte par l'Etat
que la Municipalité a « réagit » à l'action de
l'Etat.
Puis, cette action de la Municipalité était une
adaptation par rapport à un nouveau contexte socio-économique qui
est le vieillissement de la population non seulement rurale mais
également urbaine : arrivée massive de nouveaux retraités
du secteur industriel, et notamment ceux de la génération
baby-boom nés entre 1947-1952390. Au cours des années
90, cette thématique n'attirait pas autant d'attention qu'au
début des années 2000 ni au sein de la municipalité ni
parmi la population.
Quels éléments de représentations ont-ils
alors été mobilisés dans ces procédures pour la
« Zone spéciale » ? Dans une présentation officielle de
la « Zone spéciale pour la Création de Nô-Life
»391, on voit d'abord deux éléments en
situation de crise être mis en avant : l'aggravation de la situation
agricole et le vieillissement massif de la population urbaine. Ensuite,
l'idée d'Ikigai des personnes âgées est ajoutée aux
deux mesures de la politique agricole (prévention des friches et
conservation de terrains).
Plan de la Zone spéciale
Ensuite, en se centrant sur ces deux éléments de
situation de crise d'un côté rural et de l'autre urbain, le Plan
de la Zone spéciale est expliqué en trois points suivants :
Spécificité spatio-historique de la Ville ; Valeurs du Plan de la
Zone spéciale ; Effets socio-économique du Plan de la Zone
spéciale sur la zone concernée. Ces explications nous montrent un
travail de contextualisation, effectué du point de la
Municipalité de Toyota, des éléments préparatoires
du Projet Nô-Life.
Dans la partie sur la spécificité
spatio-historique de la Ville de Toyota, en montrant d'abord l'importance de la
superficie naturelle et agricole dans le territoire de la Ville de Toyota
(forêt-montagne soit 3 6.8%, champs agricoles soit 21.9% sur 29 012ha de
la superficie totale de la Ville), le Plan met l'accent sur la richesse de la
nature et de l'agriculture, ce qui est en contraste avec la richesse de
l'industrie très dévelpppée de la Ville.
390 Le nombre de population de cette génération est
30721 soit 8.6% par rapport à la population totale de la Ville en 2003
(Ville de Toyota, 2003b : 7.).
391 Ville de Toyota, 2003a : 1. « Dans la Ville de
Toyota, nous commençons le `Projet du Centre pour le soutien aux
activités agricoles (Einô Shien Center Jigyô) ' (nom
provisoire) qui a pour but d'effectuer des stages de techniques culturales,
l'entremise des terrains que d'emplois agricoles dans des exploitations
agricoles aux citoyens de tendance agricole. Ceci en tant qu'un système
qui a l'intention de fusionner les `ressources foncières' qui sont les
terrains agricoles dont constitue un souci une augmentation de terrains en
friche ou en jachère, avec les `ressources humaines' qui sont les
citoyens de tendance agricole parmi lesquels le nombre de retraités va
rapidement augmenter dans les prochaines années à venir. A cet
effet, suite aux deux
applications de déréglementation, à
savoir la baisse de la surface minimum d'installation et le droit d'ouverture
de jardins citoyens, nous metterons en place des systèmes d'entremise de
terrains agricoles adaptés aux compétences physiques de
retraités, et également d'entremise d'aidants d'exploitations
agricoles. Ceci afin de les contribuer à la prévention des
friches, à la conservation de terrains agricoles et aux mesures pour
Ikigai des personnes âgées »
Ensuite, le Plan retrace brièvement l'évolution
du développement industriel de la Ville de Toyota depuis l'ère de
Meiji (1868-1912) : développement de l'industrie textile et du commerce
des cocons des vers à soie produits par les foyers ruraux depuis
l'ère de Meiji dans le Bourg de Koromo ; déclin de cette
industrie à partir de l'ère de Shôwa (1926-1989) suite
à une stagnation du marché de cocons des vers à soie ;
arrivée de l'industrie automobile des années 30... Comme nous
l'avons vu dans le chapitre précédent, ce plan fait un rappel
historique de la Ville de Toyota : changement du statut du « Bourg (machi)
» à celui de la « Ville (shi) » en 1951 ; changement du
nom de Koromo à celui de Toyota en 1959, un des plus grands
évènements historiques de la Ville de Toyota392.
D'où le slogan de la Ville de Toyota qui est permanent jusqu'à
aujourd'hui : « Ville de la Voiture (Kuruma no Machi) ». Puis, le
Plan de la Zone spéciale explique l'évolution de la Ville de
Toyota suite à l'essor de l'industrie automobile entre 1955 et 1975 qui
a abouti à une série de fusions avec les collectivités
environnantes. La Ville de Toyota est ainsi devenu 7.5 fois plus grande que la
superficie initiale du Bourg de Koromo. Le Plan de la Zone spéciale met
l'accent sur le fait que la prochaine fusion aura lieu en 2005 avec six
communes rurales et montagnardes. Ce qui va, cette fois-ci, agrandir la
superficie de la Ville trois fois grande393.
Et le Plan de la Zone spéciale explique
également que la population de la Ville de Toyota augmenta non seulement
avec la fusion des collectivités rurales mais plutôt avec
l'arrivée massive d'émigrants ruraux de partout dans le Japon
à partir des années 60394. Puis, à partir des
années 90, le rythme de l'augmentation démographique de la Ville
de Toyota s'est adouci. Aujourd'hui, elle est ainsi confrontée au
vieillissement de la population dû à l'arrivée massive de
retraités du secteur industriel dont beaucoup d'entre eux
étaient, justement, les émigrants ruraux des années
65-75.
Enfin, le Plan de la Zone spéciale aborde la situation
agricole de Toyota, notamment son évolution de la dernière
décennie marquée par une série d'aspects de crise qui ont
déjà été mis en cause depuis le Plan de 96. En
donnant des chiffres de la statistique agricole, le Plan réexplique
cette situation de crise en quatre points suivants : diminution progressive de
la surface agricole utilisée dû à l'urbanisation,
l'industrialisation et l'abondon de terrains agricoles (friches et
jachère) ; diminution de la population agricole ; fragilisation de la
structure d'exploitations agricoles ; manque de porteurs de l'agriculture.
Concernant la diminution progressive de la surface agricole
utilisée, de 1995 à 2000, la surface a diminué de 548ha
soit 14.3% de la surface totale de 1995 (3845ha à 3297ha). Et cette
tendance est commune à tous les quartiers de la Ville. La surface en
friche (kôsaku hôkichi) augmente, de 1995 à 2000, pour 32ha
soit 9.9% de la surface totale en friche en 1995 (322ha à 354ha), puis
la surface en jachère (husakutsuke chi) augmente davantage, 1995
à 2000, pour 1 03ha soit 43.2% de la surface totale en jachère
(238ha à 34 1ha)395.
Puis, la diminution de la population agricole se traduit par la
diminution du nombre des foyers agricoles pour 10.2% de 1995 à 2000
(5474 à 4918). Et la population agricole active 9.9% (5822 à
5246).
Cependant, la pluriactivité des foyers agricoles
s'accentue de plus en plus : les foyers de la catégorie de la «
ferme auto-productive (jikyû teki nôka) » et des foyers
agricoles pluriactifs de la deuxième catégorie sont 90.7% du
nombre total des foyers agricoles396. En plus, le nombre des foyers
qui n'ont moins de 0.3ha de la surface agricole utilisée augmente, 1995
à 2000, pour 96 foyers soit 6% (1611 à 1707). Et la population
agricole vieillit : le taux de vieillissement est de 25.1% parmi
elle397.
Concernant le manque de porteurs, l'explication du Plan montre
l'aspect extrèmement stagnant de la
392 Voir le détail dans le chapitre 1.
393 La superficie totale de la Ville est ainsi 91 847ha
aujourd'hui.
394 Voir le détail dans le chapitre 1.
395 Selon les définitions données par la
statistique nationale, les Friches (kôsaku hôki-chi)
désignent les terrains non cultivé depuis plus d'un an, et dont
leurs cultivateurs (husakutsuke-chi) n'ont pas l'intention de les cultiver dans
quelques années. Les jachères désignent également
les terrains non cultivés depuis plus d'un an, mais dont leurs
cultivateurs ont l'intention de les cultiver dans quelques années
(Nôrinsuisan-shô, 2005)
396 Selon la statistique nationale, « foyers agricoles
auto-productifs (jikyû teki nôka) » désignent les
foyers agricoles possédant
moins de 0.3ha de terrains agricoles et dégageant un
chiffre d'affaires annuel de moins de 500 000 yens (près de 3333 euros)
(Nôrinsuisan-shô, 2005)
397 Ce taux de vieillissement est celui de la population de plus
de 65ans sur la population totale concernée. Nous ajoutons que le
taux de vieillissement parmi la population totale de la Ville de
Toyota est encore de 11.1% en 2000, ce qui est relativement bas en comparaison
avec les chiffres national et départemental : 17.3% et 14.5%
politique de la modernisation agricole : en 2003, le nombre d'
« agriculteurs qualifiés (nintei nôgyô sha)
»398 est 66, et le nombre d'entreprises agricoles est 18.
Cependant, le nombre de ces deux types d'exploitations agricoles n'augmentait
guère depuis 2000. D'ailleurs, il n'y a eu que 4 nouveaux agriculteurs
en 2002 dont l'un a déjà quitté son exploitation
l'année suivante.
Ensuite, dans la partie sur les valeurs du Plan de la Zone
spéciale, le Plan reprend des éléments historiques sur
d'autres projets liés au Projet Nô-Life pour montrer qu'existent
déjà des actions et des pratiques liées à la
construction du Projet Nô-Life, à savoir l'Ecole de l'agriculture
vivante (Ikiiki nôgyô juku) amorcée en 2000 ; la Ferme
école des Personnes âgées (kônen daigaku taiken
nôjô) amorcée en 2002.
L'Ecole de l'agriculture vivante étant
co-gérée par la Municipalité et la Coopérative
agricole, elle a 41 stagiaires en 2004. Il y a déjà 23 personnes
sur 112 anciens stagiaires qui se sont organisées comme un groupement de
producteurs dans la Ville de Toyota. Puis, il y a 30 élèves dans
la Ferme-école des Personnes âgées en 2004.
Puis, le Plan explique quelques éléments du
résultat de L' « Enquête de la Conscience sur l'Agriculture
de Toyota » montrant des attentes élevées sur des
possibilités de location de terrains agricoles, aussi bien au sein des
foyers agricoles qu'au sein des travailleurs. La réussite de jardins
familiaux et citoyens y est également citée.
Tous ces éléments permettent au Plan de montrer
une nécessité de créer un nouveau système pour une
mise en valeur des friches et une formation de porteurs de l'agriculture d'un
nouveau type en tenant compte du contexte du vieillissement de la population
rurale comme urbaine.
Dans la partie sur les « Effets socio-économique
du Plan de la Zone spéciale sur la zone concernée », le Plan
tente surtout de mettre l'accent sur des aspects quantitatifs et
économiques du Projet Nô-Life. Cette partie se divise en deux
points suivants : formation de nouveaux agriculteurs ; réalisation de la
création d'Ikigai.
D'abord, dans le premier point, le Plan compte, le nombre de
nouveaux agriculteur susceptibles d'être formés par le Projet
Nô-Life ainsi que la surface agricole susceptible d'être
cultivée suite au lancement du Projet Nô-Life, dans les cinq
années à venir à partir de l'année 2004 dont
l'inauguration du Centre Nô-Life.
Plusieurs types de nouveaux agriculteurs sont attendus :
stagiaires du Centre Nô-Life (environ 90 sur 200 stagiaires en cinq ans),
anciens stagiaires de l'Ecole de l'agriculture vivante et usagers de jardins
citoyens (environ 5 personnes par an). Finalement, l'arrivée d'environ
100 nouveaux agriculteurs est escomptée jusqu'en 2009. Puis, la surface
agricole susceptible d'être cultivée par ces nouveaux agriculteurs
pour 0. 1ha par personne, soit 1 0ha au total jusqu'en 2009.
Ensuite, il est à noter que, par la suite, un nouvel
élément économique du Projet Nô-Life apparaît
dans cette partie : il s'agit de l'objectif d'avoir un revenu agricole d'un
million de yens399 par an au moyen de la vente de produits agricoles
avec 0. 1ha de terrains. A cet effet, le Plan envisage d'introduire de nouveaux
produits aptes à dégager ce chiffre-là. Ainsi, est
escomptée une augmentation de 225 000 000 yens400 pour le
revenu total des nouveaux agriculteurs jusqu'en 2009. En plus, s'y ajoute une
prévision de 102 500 000 yens401 de côuts
d'investissement (achat de machines agricoles, plantes etc) comme effet
économique direct.
Ce dernier élément n'ayant pas été
prévu jusqu'alors402, semble être quelque peu
opportuniste. D'ailleurs, Monsieur K a dit à l'enquêteur
(rédacteur) qu'il était, lors de l'élaboration du projet,
contre cette idée d'établir un tel critère
économique. En effet, il pensait que l'objectif final du Projet
Nô-Life est après tout la satisfaction individuelle de chaque
participant via ses propres pratiques agricoles. D'après lui, fixer une
telle norme économique aux stagiaires ne correspondrait pas à ce
besoin de satifaction individuelle.
398 La politique d' « agriculteurs qualifiés »
est la politique nationale pour les « poeteurs ». Dans la partie de
l'Acteur 5, l'ex-centre départemental pour la vulgarisation agricole, on
verra le travail de cet acteur pour cette politique de la modernisation.
399 Un million de yens soit environ de 6666.6 euros (150 yens
fait environ de 150-160 euros aujourd'hui) Le revenu agricole
(nôgyô shotoku) est le montant dont on enlève le montant du
coût pour la gestion agricole du revenu agricole total.
400 Près de 1 500 000 euros.
401 Près de 683 333 euros
402 En tous cas, il n'est pas explicité dans les documents
officiels et disponibles au public.
Cependant, cet élément semble paradoxalement
constituer un élément convergent non seulement avec
l'intérêt économique du secteur agricole dont la
Coopérative agricole fait partie, mais également avec l'objectif
de la Politique des Zones spéciales de la Réforme structurelle de
l'Etat : relance économique du pays via
déréglementation.
Le deuxième point sur la réalisation de la
création d'Ikigai ne concerne, en fait, que la promotion d'ouverture de
jardins citoyens via déréglementation du droit d'ouverture. Le
Plan prévoit 6.5ha de jardins citoyens ouverts par des
propriétaires de terrains agricoles jusqu'en 2009. Le nombre d'usagers
est également escompté pour 1950 personnes jusqu'en 2009 en
créant 30 parcelles par 0. 1ha.
Le plan escompte pour l'utilisation de ces jardins citoyens
non seulement des éléments non productifs comme la santé
et Ikigai, mais également la possibilité d'avoir de futurs
producteurs susceptibles de rejoindre les nouveaux agriculteurs,
engendré par le premier point, qui pourront utiliser ainsi plus de 0.
1ha par personne.
Certains effets économiques sont également
escomptés comme les frais d'utilisation des jardins versés aux
propriétaires constituant 3000yens de revenu par parcelle en un an, cela
fait donc 90 000 yens pour 0. 1ha403, et la consommation de
matériels agricoles par les usagers des jardins, ce qui profitera
également la coopérative agricole qui vend ces
matériels.
Autrement, en terme d'Ikigai, est également
escompté l'effet de l'ouverture de jardins citoyens suscitant des
échanges entre les usagers urbains et les propriétaires
ruraux.
Vision du Projet Nô-Life
Enfin, le Plan de la Zone spéciale nous montre une
vision définitive du Projet Nô-Life qui a préparé
son inauguration en 2004. En parcourant ce plan, on a repéré,
comme ci-dessous, la détermination des objectifs et des moyens par cette
vision pour la réalisation du Projet Nô-Life :
Objectifs : prévention des crises agricole (vieillissement
de la population agricole et manque de porteurs) et urbaine (vieillissement de
la population, manque d'Ikigai)
Moyens : juridique (déréglementation) ;
économique (nouveau financement public pour le Centre Nô-Life) ;
social (mobilisation de divers agents institutionnels et citoyens) ; culturel
(valeurs de l'agriculture pour tous les citoyens ; Ikigai des personnes
âgées)
Suite à cette détermination du contenu du Projet,
une valeur officielle et publique est accordée au Projet : une
nécessité répondant aux attentes historiques et
grandissantes au sein de l'ensemble des citoyens.
Puis, on a pu entrevoir que ce projet implique non seulement
des thématiques croisées de la crise agricole et de celle
urbaine, mais également une imbrication de différents types
d'intérêts au sein d'agents concernés. C'est-à-dire,
les intérêts des secteurs public (Municipalité dont le BPA)
et privé (Coopérative agricole). D'autant plus que ce sont la
Municipalité et la Coopérative agricole qui gèrent en
commun le Projet selon un consensus minimum sur le contenu du Projet
Nô-Life, cette imbrication d'intérêts différents
constituera un espace flou dans le jeu d'acteurs autour du Projet
Nô-Life. Concrètement parlant, cette divergence
d'intérêts sera particulièrement visible sur la question
d'argent : il se sera avéré que, pour la plupart de participants
de la Formation Porteur du Centre Nô-Life, il serait quasiment impossible
de dégager un revenu agricole d'un million de yens par an après
deux ans de la formation Nô-Life tel qu'il est défini dans la
vision officiel du Projet Nô-Life404.
D'ailleurs, dans le Plan de la Zone spéciale, les
aspects non productifs de la multifonctionalité sur lesquels le Plan de
96 ainsi que l'Enquête de la Conscience dans le cadre du mode
d'aménagement de la Ville de Toyota mettaient le plus d'accent,
apparaissent beaucoup moins. Le terme de la Multifonctionalité y est
carrément absent alors que le Plan de la Zone spéciale s'incline
plutôt sur la recherche de la productivité, marqué
403 3000 yens soit d'environ 20 euros, 90000 yens soit d'environ
600 euros.
404 Ce qui va causer un certain nombre de soucis parmi ces
stagiaires. Sur ce point, nous verrons en détail dans le chapitre 3.
notamment par son objectif de « gagner un million de yens
après la retraite ».
Mode d'actions
Le mode d'actions du BPA, en tant qu'un agent local des
services publics, est marqué par son côté basé sur
la situation locale et spécifique (celle de la Ville de Toyota). Puis,
on a constaté qu'il pouvait bien être « bricoleur »
d'idées à la fois descendantes de la situation globale mais
égalament ascendantes de la situation locale405. Quels
facteurs déterminent alors cette caractéristique apparement
indéfinissable ? Il nous semble que l'on peut attribuer un de ces
facteurs à la neutralité qui est spécifique au BPA, celle
d'un agent local des services publics. Sa manière d'être est
d'abord déterminée par le principe des services publics qui est
d'« être au service de tous ». Puis, cette neutralité
n'est pas celle qui se présente comme transcendante et universelle comme
celle de l'Etat mais plus spécifique et limitée par sa situation
locale. Et on peut ajouter que cette neutralité est beaucoup plus
fragile et incertaine.
Puis, on a trouvé dans les actes de
représentation du BPA comme caractéristique de son mode
d'actions, d'un côté une grande flexibilité en tant que
coordinateur local de différents agents (réseaux de
coopération), mais de l'autre quelque peu incohérente et
coincé entre de différents principes d'actions : notamment les
deux principes sectoriels suivants : celui du secteur agricole qui est
privée et économiquement spécialisé (gestion et
technique) et celui du secteur public qui se base sur l'intérêt
public et qui est administratif.
Prise de position vis-à-vis du Projet
Nô-Life
Nous pouvons également parler de sa dynamique qui est
stratégique dans le sens où il a commencé à
chercher à acquérir de nouveaux rôles dans le domaine
agricole comme on l'a vu dans le Plan de 96 face au grand changement
extérieur de la situation agricole (comme les Accords du GATT). Ainsi,
le Plan de 96 mettait fortement l'accent sur la multifonctionalité et
l'intérêt public inhérents à l'agriculture et la
ruralité, d'où l'importance de la participation citoyenne dans ce
domaine. Le BPA a ainsi trouvé une nouvelle place où il pourra
jouer un rôle important en tant qu'un agent public dans le domaine
agricole.
Sur ce point, Monsieur K nous a expliqué en
répondant à la question de l'enquêteur concernant une
série de projets en rapport avec le public comme l' « Ecole de
l'agriculture vivante » et la « Feme-école des Personnes
âgées » dans lesquels Monsieur K était impliqué
depuis vers 2000406. Après le Plan de 96, c'est notamment
à partir de l'année 2000-2001 que le BPA s'est progressivement
adressé au public en le considérant comme un des objets
principaux de sa politique agricole. Ainsi, en 2000, les jardins citoyens
gérés par la Coopérative agricole ont été
ouverts hors la zone à urbaniser c'est-à-dire la zone
d'urbanisation contrôlée. Et également l'inauguration de l'
« Ecole de l'agriculture vivante » en 2000 et celle de la «
Ferme-école des Personnes âgées » en 2002. Puis, c'est
à partir de l'apparition du problème de l'utilisation de terrains
agricoles à petite échelle en raison de la Loi agraire que le
BPA, qui est chargé de l'administration foncière, a
commencé à envisager de créer un système qui
permettra aux citoyens de continuer leur activité agricole en utilisant
des terrains agricoles de manière légale : d'où la
conception du Projet Nô-Life.
Par contre, on peut remarquer, malgré ses démarches
stratégiques, le côté toujours mitigé et ambïgu
dans les
405 Nous examinerons plus bas la conception du « bricolage
» de Cl. Lévi-Strauss.
406 Voici la réponse de Monsieur K : «
[Enquêteur : (...) Depuis quand êtes-vous impliqué dans
des projets de type `Ikigai ' comme l'Ecole de l'agriculture vivante ou les
jardins citoyens etc ?] C'est à partir de l'année 2001 que je
suis directement concerné. [Enquêteur : Ce type de mesures
d'Ikigai existaient déjà avant le Projet Nô -Life. Le
début était-il alors l'Ecole de l'agriculture vivante ?] C'est
ça. J'y suis entré un an après que ceci avait
commencé. [Enquêteur : Avant cela, pour vous, le domaine agricole
appartenait quasiment aux agriculteurs ?] Donc, on ne regardait que les
agriculteurs. Le public, c'était les gens qui faisaient seulement les
jardins familiaux, en fait. [Enquêteur : Et maintenant, on va vers les
citoyens ?] Oui. »
actes de représentations du BPA.
Nous pouvons déjà évoquer la suspension
du Projet du « Parc rural » qui était envisagé en
priorité dans le Plan de 96, et également le retrait de l'audace
slogan « Grande ville rurale : Toyota » au profit de
l'intérêt du slogan permanent de la Ville « Ville de la
Voiture ». Certes, entre 1996 à 2000, on n'a pas constaté,
dans le cadre de notre enquête, un évènement remarquable
par rapport à l'établissement du Projet Nô-Life.
D'ailleurs, on peut également rappeller que les représentations
manifestées dans le Plan de 96 avaient un caractère quelque peu
idéaliste avec un éventail extrèmement large de ses
visions. Le caractère quelque peu flou et opportuniste de la vision du
Projet Nô-Life semble également être lié à
cette ambïguité de la position du BPA.
Acteur 2 : Section de la Création d'Ikigai dans le
Bureau Education permanente de la Municipalité de la Ville de Toyota
(SCI)
Nous allons ici étudier l'implication, dans la
construction du Projet Nô-Life, de la SCI (Section de la Création
d'Ikigai (Ikigai zukuri tantô) du Bureau Education Permanente
(Shougai-kyôiku ka) de la Municipalité de Toyota). Etant un acteur
non-agricole, cette section a joué un rôle important dans le
processus du démarrage du Projet Nô-Life. Cette section a une
originalité du fait de son contexte d'apparition récent et
lié au phénomène irreversible du vieillissement de la
population marquant aujourd'hui la société japonaise aussi bien
globalement que localement.
D'abord, un examen de quelques documents de la politique du
vieillissement de la Municipalité de Toyota nous permettra d'analyser
les caractères généraux de cette section. Puis, nous
allons nous baser sur nos entretiens effectués avec deux responsables de
la section : Monsieur A, président du 'Toyota Young Old Support Center
(Centre pour les Jeunes Vieux de Toyota)' créé en 2002, et
géré par la SCI, ainsi que Madame S, chargé de projet de
la même section et « disciple de Monsieur A » d'après
elle-même. Ils nous montreront comment ils ont effectué leurs
travaux de coordination des mesures de la création d'Ikigai en tant
qu'un agent de la politique publique de la Municipalité de Toyota dans
ce nouveau contexte du vieillissement.
Caractère général de l'acteur
Contexte d'apparition récent : réformes suite
à la Loi sur l'Assurance des Aides aux Personnes âgées en
2000.
Son contexte d'apparition est marqué, d'un
côté par l'émergence d'une nouvelle situation globale du
vieillissement caractérisé par l'aspect de « aged society
(kôrei-shakai) »407 et de l'autre côté par
des traits spécifiques de la situation locale.
L'origine de cette section remonte à 2000
l'année de l'établissement du « Comité pour la
promotion de la Création d'Ikigai (Ikigai-zukuri Suishin Kaigi : CPCI)
» dans la Direction du Bien-être - Santé (Hoken-fukushi bu).
Ce comité fut créé dans le cadre d'une restructuration
administrative exigée par l'entrée en vigueur en 2000 de la
« Loi sur l'Assurance des Aides aux Personnes âgées
dépendantes (Kaigo-Hoken Hô) » au niveau national. Cette
restructuration devait s'effectuer au niveau de diverses dispositions locales
dans le cadre des mesures des aides aux personnes âgées
dépendantes. Nous allons voir ci-dessous la portée politique et
sociale de cette loi.
407 D'après la définition des Nations Unies, une
société où le taux de la population agée de plus de
65 ans est de plus de 14% sur la population totale est « aged society
(société vieillie : kôrei shakai) » alors que «
aging society (société en vieillissement : kôreika-shakai)
» est de plus de 7% sur la population totale. Le taux de la population
âgée au Japon a dépassé 20% en 2005.
L'objectif principal de l'établissement de ce
comité était d'étudier les possibilités de mesures
pour la « prévention de la dépendance (kaigo yobô)
», une des thématiques prévues dans la Loi sur l'Assurance
des Aides aux Personnes âgées. Puis, cette thématique
impliquait l'introduction d'une nouvelle manière de la
catégorisation des personnes âgées dans le cadre des
mesures pour la santé des personnes âgées : personnes
âges dites « en bonne santé (genki na) » et
potentiellement actives malgré leur âge de la retraite et celles
« non en forme » c'est-à-dire celles qui sont malades ou qui
ont besoin d'aides pour leur autonomie ou qui sont dépendantes. Et
l'objectif de la prévention est principalement et nécessairement
destiné aux personnes âgées qui ne sont pas encore
dépendantes. Nous le verrons plus bas, l'idée d'Ikigai s'inscrit
dans ce cadre de la prévention de la dépendance.
Le CPCI, ayant cette nouvelle catégorie « cible
» pour ces mesures, introduisit également une nouvelle forme
d'organisation : participation des citoyens. En 2000, la municipalité a
effectué un concours général auprès des habitants
et a sélectionné 12 citoyens qui participeront pleinement aux
activités de ce comité en tant que ses membres principaux. Ainsi,
la composition du CPCI sera ces 12 citoyens et 7 administrateurs dont Monsieur
A, responsable général de ce comité, ainsi que Monsieur K,
président du Centre Nô-Life et employé du Bureau de la
Politique agricole (BPA) de cette époque. Ensuite, ils ont
effectué, pendant un an, 14 réunions générales et
25 réunions thématiques qui ont abouti au « rapport de
propositions » rendu au maire en 2001. Nous verrons en détail plus
bas, ce rapport a proposé trois idées finales dont l'une d'entre
elles a donné l'idée de base pour le Projet Nô-Life.
Enfin, suite à la réception de ce rapport par le
maire, la SCI fut mise en place en 2001. Mais la SCI a d'abord
été créée sous un autre nom et dans une autre
direction que celle de la Santé - Bien-être : la « Section du
Vieillissement - Diminution de la Jeunesse (Shôshi-Kôrei ka) »
dans le bureau de l' « Echange intergénérationel (jisedai
kôryû-ka) » attachée à la « Direction
sociale (shakai-bu) ». En effet, cette restructuration était
liée à la fois à la nouvelle division de la
catégorie des personnes âgées expliquée plus haut :
celles actives et non-actives, et à une série de réformes
de la structure administrative liée au nouveau contexte du
vieilissement. Du coup, une série de sections chargées des
services aux personnes âgées « en bonne santé »
et actives sont séparées de la Direction de la Santé -
Bien-être qui est principalement chargée des soins aux personnes
âgées. Ainsi, d'après Monsieur A qui était à
la fois responsable du CPCI, lors de la mise en place de la SCI dans la
Direction sociale, elle a « amené » avec elle dans cette
direction un ensemble de Sections liées aux activités des
personnes âgées : « Clubs des Personnes âgées
(rôjin club) »408 ; « Centre des Ressources humaines
âgées (Silver Jinzai Haken Center) »409. Ceux-ci
étaient auparavent attachés à la Direction Santé -
Bien-être. Ainsi, de 2001, la SCI a pris ses fonctions410.
Puis, en 2005, suite à une autre réforme, le
Bureau de l' « Echange intergénérationnel » a
été dissout en séparant la Section de la Jeunesse et celle
des Personnes âgées (actives) en tenant compte des charges de plus
en plus importantes du domaine de la Jeunesse. D'après Madame S, le
Bureau de l'Echange intergénérationnel travaillait pour les trois
thématiques suivants : vieillissement - diminution de la jeunesse
(shôshi kôrei ka) ; participation sociale des femmes (danjo
kyôdô sankaku shakai) ; éducation morale de la jeunesse
(seishônen no kenzen ikusei). Ainsi, la SCI, accompagnée par les
domaines des Clubs des Personnes âgées, Centre des Ressources
humaines âgées et Participation sociale des femmes, s'est
installée dans sa place actuelle (en 2006) :
408 Le Club des Personnes âgées (Rôjin Club) a
été créé sous forme d'une association de personnes
âgées vers 1950 dans une circonstance de crise sociale et
économique de cette époque. Ensuite, il a été
généralisé au niveau des collectivités
territoriales. Il a été reconnu en 1963 par la Loi sur le
Bien-être des Personnes âgées. Puis, depuis 1994, il est
considéré comme une organisation ayant pour but de promouvoir la
politique de la participation sociale et Ikigai des personnes
âgées dans le cadre d'une nouvelle stratégie nationale pour
la politique des personnes âgées. Source :
Fédération nationale des Club des Personnes âgées
(Zenkoku Rôjin Club Rengôkai) :
http://www4.ocn.ne.jp/~zenrou/
(site officiel)
409 Le Centre des Ressources humaines âgées (Silver
Jinzai Haken Center) a été créé en 1975 à
Tôkyô sous forme d'une association indépendante ayant pour
objectif de mettre en valeur les compétences et expériences des
personnes âgées dont le nombre était grandissant. L'esprit
de l'association est : « autonomie, indépedance, coopération
et entraide (jishu - jiritsu - kyôdô - kyôjo) ».
Ensuite, en 1980, l'association a été
généralisé à l'aide de l'Etat dans tout le Japon au
sein des collectivités territoriales. C'est en 1986 que l'association
est devenue une affaire nationale par l'adoption de la « Loi sur la
Stabilité de l'emploi des personnes âgées (kôreisha
nado no koyô no antei nado ni kansuru hôritsu) ». Source :
Association nationale des Centres des ressources humaines âgées
(Zenkoku Silver Jinzai Center Jigyô Kyôkai) :
http://www.zsjc.or.jp/rhx/index.jsp
(site officiel)
410 Ceci était sous le nom de la « Section
Vieillissement - Diminution de la Jeunesse (Shôshi kôrei
tantô-ka) ».
le Bureau de l'Education Permanente.
Enfin, nous pouvons remarquer que, malgré un changement
extérieur et supérieur déterminant le contexte
d'apparition de la SCI (Entrée en vigueur de la Loi sur l'Assurance des
Aides aux Personnes âgées), l'établissement de cette
Section est marqué, dans son intérieur, par une sorte de «
bricolage » qui n'est pas forcément défini par le haut et
qui invente ses propres idées en combinant de différents
éléments accessibles. Et ceci tant au niveau de ses
compétences qu'au niveau de sa forme d'organisation. Ses
compétences sont marquées par une intersectorialité
complexe (santé mentale et physique, éducation permanente,
travail, participation sociale, agriculture et ruralité). Et sa forme
d'organisation est également marquée par ses aspects
localisé et hétérogène (participation citoyenne,
déplacements successif d'un bureau à l'autre, présence
d'administrateurs de différents domaines etc).
Caractère général des données
Notre examen de l'implication de la SCI dans le Projet
Nô-Life se base, sur trois plans de la politique du vieillissement de la
Ville411. Ces trois documents sont publiés et successivement
révisés depuis 2000 (l'année de l'entrée en vigueur
de la Loi sur l'Assurance des Aides aux Personnes âgées
dépendantes).
Au niveau de l'intérieur de la SCI, nous avons le
rapport produit et rendu au maire de Toyota en 2001 (expliqué plus haut)
par le CPCI (Ikigai-zukuri Suishin kaigi)412. Il montre non
seulement des travaux de réflexion portant sur l'élaboration de
nouvelles mesures sur le vieillissement, mais également ceux ayant
élaboré, en terme de la création d'Ikigai, de nouveaux
représentations et mode d'actions liés à la
thématique du vieillissement.
Représentations : mise en relation de Ikigai et la
ruralité (Nô)
Pourquoi et comment la place de l'idée d'Ikigai a
été accordée et légitimée par la politique
de la municipalité de Toyota ? Pour répondre à cette
question, nous allons d'abord constater une portée politique et sociale
de l'entrée en vigueur en 2000 de la Loi sur l'Assurance des Personnes
âgées dépendantes, qui marque, au niveau politique, un
grand changement des représentations du vieillissement au Japon. Ensuite
nous allons examiner l'évolution récente des
représentations portées par la politique municipale de Toyota sur
le vieillissement. Il s'agit d'une approche généalogique sur
l'émergence de l'idée d'Ikigai en tant qu'un projet politique
légitime aussi bien qu'au niveau national qu'au niveau local.
Loi sur l'Assurance des Aides aux Personnes
âgées dépendantes (Kaigo-hoken hô)
La Loi sur l'Assurance des Aides aux Personnes
âgées dépendantes adoptée en 1997 semble marquer un
grand tournant politique et sociétal au Japon. C'est un tournant pour le
Japon en tant qu'Etat-providence. L'objectif de notre analyse ici n'est pas
d'étudier l'évolution de la politique sociale du vieillissement
au Japon dans son détail. Cependant, il nous serait utile de survoler
cette évolution pour comprendre le changement qui s'est
opéré sur les représentations objectives du vieillissement
au Japon de ces dernières décennies, ainsi que les contextes
d'apparition de l'établissement de la SCI de la Ville de Toyota, et
ensuite le processus de la construction du Projet Nô-Life. C'est pourquoi
nous allons nous baser sur des explications générales
données
411 Direction Santé et Bien-être, 2000 ; Section
Bien-être et Vieillissement de la Direction Santé et
Bien-être, 2003 ; Section Bien-être et Vieillissement de la
Direction Santé et Bien-être de la Ville de Toyota, 2006.
412 Comité pour la promotion de la création
d'Ikigai, 2001.
dans un ouvrage japonais publié en 2001, intitulé
« Introduction à la Sécurité sociale (Shakai
Hoshô Nyûmon) » et ecrit par Zenji TAKEMOTO, expert de la
sécurité sociale japonaise413.
L'apparition de la Loi sur l'Assurance des Aides aux Personnes
âgées dépendantes est liée, d'une part, au
vieillissement de la population accéléré414 par
rapport aux autres pays développés, d'autre part, au changement
du style de vie de la population japonaise lié à l'urbanisation
et à la rapide industrialisation réalisée à
l'époque de la Haute croissance japonaise (Kôdo keizai
seichô jidai)415.
Quant au vieillissement, d'après une estimation
nationale, le taux de la population âgée de plus de 65 ans va
dépasser 25% en 2015 au Japon. Cette phase du vieillissement est
appelé « société hyper âgée
(chô-kôrei shakai) ». En général, l'augmentation
du taux de population âgée dans une société fait
augmenter celui de la population malade ou handicapée, parmi laquelle le
risque de dépendance s'impose à long terme. Ce risque de
dépendance à long terme est présent, surtout chez les
personnes âgées de plus de 75 ans, dû aux affections
chroniques comme le diabète, les rhumatismes, les troubles des organes
de la digestion plutôt qu'aux affections aiguës416. Et
ceci constitue la plus grande cause de l'augmentation du coût
médical417. Ce risque de dépendance nécessite
non seulement des services médicaux mais surtout des aides aux personnes
âgées dépendantes (kaigo) et de divers services pour le
"bien-être (hukushi)" à long terme418.
Le nombre des personnes qui ont besoin d'aides aux personnes
âgées dépendantes au Japon était de 2 627 675 en
2001419. Le Ministère du Travail et du Bien-être
(Kôsei Rôdô shô) estime qu'en 2010, il y aura, parmi la
population âgée de plus de 65 ans, 1 900 000 personnes affaiblies
(kyo-jaku), 300 000 personnes démentielles (chihô) et 1 700 000
personnes grabataires (netakiri), soit 3 900 000 personnes au total. Puis, pour
l'an 2025, on estime 2 600 000 personnes affaiblies, 400000 personnes
démentielles et 2300000 personnes grabataires, soit 5200000 personnes au
total420.
Par alilleurs, le principal changement du style de vie de la
population japonaise est au niveau famillial. En effet, la rapide
industrialisation de l'époque de la Haute croissance et l'urbanisation
qui s'est développé parallèlement, ont fait augmenter le
nombre des familles nucléaires ainsi que les foyers constitués
uniquement par des personnes âgées421. Ce qui fait
diminuer considérablement la capacité de la prise en charge des
personnes âgées dépendantes au sein des
familles422.
Le phénomène appelé l' «
hospitalisation sociale (shakai-teki nyûin) » explique bien une des
conséquences de ces derniers constats de la société
japonaise. Il s'agit de bon nombre de gens ayant des maladies
inguérrisables par des traitements médicaux, qui restent
hospitalisés pour des raisons "sociales" dues notamment à la
situation familliale et ensuite au manque de systèmes de aides aux
personnes âgées dépendantes et du bien-être dans leur
territoire. Ce phénomène est vu de manière négative
dans la société japonaise. De plus, au niveau familial, la
surcharge que constitue la prise en charge des personnes âgées
dépendantes imposée aux autres membres de la famille, souvent des
femmes au foyer, peut même conduire, de manière critique, à
la détérioration des relations familiales.
Tous ces contextes sociaux ont fait apparaitre l'idée
de la « socialisation des aides aux personnes âgées
dépendantes (kaigo no shakai-ka) » qui consiste d'abord à
séparer le travail des aides aux personnes âgées
dépendantes de celui des services médicaux, puis, à
financer ces services par l'introduction d'une nouvelle assurance sociale et
ensuite à les assurer avec divers acteurs publics et privés.
En fait, cette introduction de la nouvelle assurance sociale
en matière des aides aux personnes âgées dépendantes
implique un important changement au niveau des représentations
politiques du vieillissement au Japon : il s'agit du rôle de l'Etat
centralisé et de celui de la famille. En effet, auparavant, les aides
aux personnes
413 Takemoto, 2001 : 145-166.
414 Naikaku-hu, 2006 : 9.
415 Takemoto, 2001: 146-147.
416 Takemoto : 148.
417 Ibid.
418 Ibid.
419 Ibid. : 160.
420 Ibid. : 147.
421 Ibid. ; Naikaku-hu, 2006 : 9.
422 Ibid. : 147.
âgées et les services de bien-être des
personnes âgées étaient financés par l'impôt
centralisé et assurés par certains organismes limités
(collectivités territoriales et « personnes morales pour le
bien-être public (shakai-hukushi hôjin) »)423 .
Puis, les familles et les hôpitaux complétaient le manque de
services généré par ces organismes limités.
Toutefois, la situation du vieillissement accéléré a rendu
insuffisante la capacité des prises en charge assurées par ce
système centralisé de l'Etat et complétée par les
familles.
L'application du système de l'Assurance des Aides aux
Personnes âgées dépendantes introduit une série de
nouveaux principes : choix des individus-usagers vis-à-vis des aides aux
personnes âgées dépendantes ; nouveaux rôles des
collectivités territoriales en tant qu' « assureur (hokensha)
» ; rôle complémentaire de l'Etat ; services centrés
sur ceux à domicile ; divers services offerts par les organismes publics
et privés.
Le paiement de cotisations est obligatoire à partir de
l'âge de 40 ans424. Les cotisants ont le droit de demander une
aide aux personnes âgées dépendantes à partir de
l'âge de 65 ans. L'Etat (c'est-à-dire l'impôt) finance les
collectivités territorriales pour la moitié du coût de ces
services pour compléter le financement assuré par cette
assurance425.
Changement des représentations du vieillissement
dans la politique japonaise
Sans entrer dans le détail du fonctionnement de ce
système, retenons les aspects essetiels du changement : il s'agit d'une
hausse de responsablités de la part des organismes locaux (dont
notamment les collectivités territoriales) et de celle des individus.
Pour les organismes locaux, leurs responsabilités sont
grandissantes et considérables aussi bien quantitativement que
qualitativent. La quantité absolue de la demande en la matière et
sa hausse prévue à long terme sont importantes. Puis, le contenu
et la qualité des offres des services doivent être
différenciés et surtout individualisés en fonction des
degrés de risque de dépendance de chaque usager de ces services.
A cet effet, les degrés de dépendance (yô-kaigo do) sont
fixés à six niveaux. Puis, le montant de l'assurance dont les
usagers peuvent bénéficier est très différent selon
ces degrés. L'inégalité éventuelle de la
quantité et de la qualité de services offerts paraît
d'autant plus accentuée que deviennent sensibles et difficiles les
travaux pour l'évaluation de ces degrés effectués par les
collectivités territoriales.
Pour les individus, le poids financier pèse davantage
lourd pour les cotisants de moins de 65 ans, du fait qu'ils n'ont pas le droit
de bénéficier de cette assurance à la différence de
l'Assurance Nationale Santé (Kenkô hoken) où chaque
cotisant, quelque soit son âge, peut en bénéficier. De
plus, l'augmentation du montant de cotisation est fort probable dans le
futur.
Par ailleurs, cette série d'augmentation de
responsablités locales et individuelles face aux risques dus au
vieillisement induit la nécessité de renforcer la capacité
d'autonomie des personnes âgées au sein de la
société. « Développer des systèmes sociaux
où les personnes âgées peuvent exercer leurs
compétences » est de plus en plus exigé426. Puis,
« agir en sorte que les personnes âgées puissent retrouver
leur Ikigai dans la société va contribuer à augmenter le
nombre des pesonnes âgées en bonne santé
»427. Enfin, « cela va produire de bons effets secondaires
comme une rationalisation de la sécurité sociale grâce au
freinage des coûts des aides aux personnes âgées
dépendantes et de ceux médicaux »428.
La Ville de Toyota ne fait pas exception à ce type de
raisonnement général sur l'autonomie des personnes
âgées. D'ailleurs, c'est ce raisonnement qui a fait
apparaître la SCI dans la Municipalité de Toyota. Les mesures pour
la « Création d'Ikigai (Ikigai zukuri) » destinées aux
« personnes âgées en bonne santé (genki na
kôrei-sha) » sont ici considérées comme efficaces pour
la « prévention de la dépendance (Kaigo-yobô) ».
D'ailleurs, en 2005, une réforme nationale de la Loi sur l'Assurance des
Aides aux Personnes âgées dépendantes
423 Ibid. D'où le phénomène de l'
«hospitalisation sociale» et l'augmentation d'attentes pour
l'entrée dans les organismes d'aide-soignante dont le nombre
était limité.
424 La moyenne nationale du montant de cette cotisation par
personne est de 2500 yens soit environ 17 euros par mois (Ibid. :
158).
425 Ibid. : 150.
426 Ibid. : 146.
427 Ibid.
428 Ibid.
a accordé davantage d'importance à cette
prévention429. Nous examinerons d'abord la situation locale
de la Ville de Toyota à l'égard du vieillissement de la
population, et ensuite les travaux de la SCI.
Situation du vieillissement de la population dans la Ville de
Toyota
Dans la Ville de Toyota, le taux de
vieillissement430 est de 11.1% en 2000. C'est relativement bas en
comparaison avec les chiffres national et départemental (17.3% et
14.5%). C'est pourquoi on qualifie cette ville d'une « ville jeune
»431. Toutefois, ce taux va augmenter de manière
accélérée d'ici 10-15 ans du fait de l'importance
démographique de la génération baby-boom432. En
effet, dans la Ville de Toyota, le nombre de la population de cette tranche
d'âge est particulièrement important en raison de l'histoire de
son développement réalisé grâce à l'essor de
l'industrie automobile depuis les années soixante433. Selon
l'estimation faite par la Ville, le taux de vieillissement sera de 13.4% en
2005, de 16.7% en 2010, de 19.8% en 2014434. Et la
Municipalité estime que, dans la Ville de Toyota, l'augmentation du taux
de vieillissement continura à s'accélérer jusqu'en
2020.
Le nombre des personnes âgées de la
première catégorie (zenki kôrei-sha : personnes de 65 ans
à 74 ans) est de 26 745 et celle de la deuxième catégorie
(Kôki Kôreisha : personnes de plus de 75 ans) est de 17 204, soit
au total 43 949 sur une population totale de 394 467 en 2000. Cependant, la
Ville estime qu'en 2018, le nombre des personnes âgées de la
deuxième catégorie va dépasser le nombre de celles de la
première catégorie.
Rapport implicite avec la décentralisation en
cours
Ajoutons que cette dynamique politique du vieillissement n'est
pas sans rapport avec le processus de la décentralisation actuellement
en cours au Japon. Takemoto relève ce point : « Les assureurs
de l'Assurance des Aides aux personnes âgées sont les
municipalités (shi-chô-son). Le système est ainsi construit
de manière décentralisée pour que les services propres
à leur localité puissent être offerts
»435. Mais cette diversité de services est «
à double tranchant » : « certaines collectivités
motivées font de grands efforts, mais d'autres pas, en réduisent
les tarifs des cotisations. D'où une inévitable disparité
régionale. »436. D'ailleurs, l'offre de ces
services peut dépendre de la demande locale : « Soit les
services à domicile, soit les services en institution, sans avoir plus
de certaine quantité de demandes, il est impossible d'offrir les
services efficaces. »437 D'où un inévitable
lien avec le mouvement massif de la fusion des collectivités au Japon :
« La mise en vigueur de la Loi sur l'Assurance des Aides aux personnes
âgées dépendantes constitue une des causes de la fusion des
collectivités actuellement en discussion »438.
Dans le mouvement massif de la fusion des collectivités
appelée « grande fusion de l'ère de Heisei (Heisei no
daigappei) »439, qui s'est amorcée à la fin des
années 90, les collectivités à faible capacité
financière dont les collectivités rurales
dépeuplées (kaso jichitai)440 notamment, risquent de
perdre leur entité administrative en
429 Section Bien-être et Vieillissement de la Direction
Santé et Bien-être de la Ville de Toyota, 2006 : 1-2.
430 Le taux du nombre des personnes âgées de plus de
65 ans sur la population totale.
431 Section Bien-être et Vieillissement de la Direction
Santé et Bien-être de la Ville de Toyota, 2006 : 13.
432 La génération baby-boom designe la population
née entre 1946-1949. Cette génération est appellée
au Japon « dankai no sedai (génération de cohorte) ».
Ce terme provient d'un romain du même titre publié en 1976
traitant ce sujet, dont l'auteur est Taichi SAKAIYA, ecrivain et
économiste japonais. Ce terme implique que cette
génération a toute une particularité commune au niveau des
expériences et des caractères et par rapport aux autres
générations antérieures et ultérieures (Sakaiya,
2005 : 11-16)
433 Section Bien-être et Vieillissement de la Direction
Santé et Bien-être de la Ville de Toyota, 2006 : 12.
434 Ibid. : 17.
435 Takemoto, 2001 : p. 162.
436 Ibid. : 162 - 163.
437 Ibid. : 163.
438 Ibid.
439 Sur l'historique des fusions des collectivités locales
au Japon, voir le Chapitre 1.
440 En 1970, l'Etat a adopté une loi visant à
établir un ensemble de mesures visant à relever les
collectivités dépeuplées. A cette époque, il y
avait près de 1000 collectivités dépeuplées. Et en
2000, il y en a près de 1200 collectivités concernées par
ces mesures. Aujourd'hui, si ces collectivités occupent la moitié
de tout le Japon au niveau de la surface, le nombre total d'habitants dans ces
collectivités occupent que près de 6% sur la population totale
japonaise. Aujourd'hui, si ces collectivités occupent la moitié
de tout le Japon au niveau de la surface, le nombre total d'habitants dans ces
collectivités occupent que près de 6% sur la population totale
fusionnant avec d'autres collectivités voisinantes.
La Ville de Toyota s'inscrit pleinement dans ce contexte. Elle
a fusionné, en 2005, avec six collectivités rurales dont cinq
étaient désignées jusqu'alors comme «
collectivités dépeuplées (kasoka) » et situées
dans des zones de moyenne montagne. La nouvelle Ville de Toyota a ainsi
adopté un nouvel réglement municipale (jôrei) sur
l'aménagement du territoire intitulé « Règlement
fondamental de l'aménagement de la Ville (machizukuri kihon
jôrei) » dont le préambule ci-dessous est marqué
par la nécessité de faire face aux problèmes liés
à la relation urbain - rural émergente et inévitable ainsi
qu'au vieillissement de la population. Tous les projets exercés au sein
de la municipalité doivent respecter le contenu de ce
Règlement.
« Tout en mettant en valeur nos diverses
localités irremplaçables que nous avions
développées, notre ville de Toyota travaille pour créer
une ville où vivent ensemble la ville et les campagnes rurales et
montagnardes. Orienté par la Charte communale de Toyota, nous souhaitons
apprendre, travailler et vivre riche et en toute sécurité. Ici,
nous établissons le Règlement fondamental de l'aménagement
de la Ville de Toyota, avec l'idée de base que, pour notre futur, tout
le monde, les enfants et les personnes âgées inclus, s'efforce
à l'aménagement de la ville via la coopération en tant que
porteurs de cet aménagement, et a pour objectif de réaliser une
société locale et autonome. »441
Représentations du vieillissement dans la politique
municipale : une généalogie de l'idée d'Ikigai
Une idée centrale de la politique de la ville à
l'égard du vieillissement fut formulée comme ci-dessous dans un
plan intitulé « Perspective pour une société
longévitale de la Ville de Toyota (Toyota-shi Chôju Shakai Kihon
Kôsô) » créée en 1989 :
« Viser une société de coexistence
où chaque citoyen joue son rôle et, sur la base des principes de
jijo (aide par soi-même ou self help) et de gojo (entraide ou mutual
help), tout le monde devient autonome et peut partager le plaisir de vivre
»442
Ensuite, les trois idées de base furent formulées
comme ci-dessous en 1993 dans le « Plan municipal de la Santé et du
Bien-être des personnes âgées (Toyota-shi Kôrei-sha
Hoken Hukushi Keikaku) »443 :
1 Une société de coexistence qui nous permet de
maintenir une vie sociale et d'avoir Ikigai même si l'on devient
grabataire.
2 Une société longé vitale et saine
où tout le monde peut se soutenir et peut être soutenu.
3 Soutiens à l'autonomie en tant qu'objectif
fondamental du bien-être social
Le Plan municipal de la Santé et du Bien-être des
personnes âgées pour les années 2000-2004, résume
ainsi ces idées : « l'idée que l'ensemble des citoyens
se soutiennent pour que l'on puisse passer une vie autonome avec Ikigai
même si on devient grabataire »444. Puis, «
cette idée est conjointe avec les idées fondamentales des
mesures de la Santé et du Bien-être (Hoken-hukushi) de la Ville de
Toyota, c'est-à-dire, le jijo (efforts personnels et familiaux), le gojo
(entraide entre habitants locaux) et le kôjo (aides publiques : larges
soutiens institutionnels réalisés par l'administration et des
organismes privés etc.) »445. C'est pour cela que
ces idées ont été reprises par ce plan pour les
années 2000-2004.
Le Plan pour les années 2000-2004 formule son objectif
fondamental comme ceci : « Une ville de longévité et de
santé où l'on passe une vie vivante et en toute
sécurité (anshin shite ikiiki to kuraseru kenkô chôju
no
japonaise. (Source : Site officiel de la Préfecture
d'Aichi. :
http://www.pref.aichi.jp/chiiki/kaso1/index-frmpg.htm)
441 Selon « Toyota-shi Machizukuri Kihon Jôrei
(Règlement fondamental sur la Production de la Ville de Toyota)
».
442 Direction Santé et Bien-être, 2000 : 80.
443 Ibid.
444 Ibid.
445 Ibid.
machi) »446. En fait, cette formule
est fruit d'un changement apporté, dans le contexte de l'introduction du
Système de l'Assurance des Aides aux personnes âgées
dépendantes, à la formule faite en 1991 dans un plan global de
l'aménagement de la Ville de Toyota qui était comme celui-ci :
« une ville du bien-être où l'on peut passer toute la vie
en toute sécurité (anshin shite shôgai wo sugoseru hukushi
no machi) »447. En remplaçant le mot «
bien-être » par les mots « longévité et
santé », le Plan pour les années 2000-2004 met l'accent sur
l'élément de la « vie vivante (Ikiiki to kurasu) » qui
implique le sens d'Ikigai. Pour expliquer ce changement de formule, le Plan
pour les années 2000-2004 fait une mise en relation avec l'introduction
de la Loi sur l'Assurance des Aides aux Personnes âgées
dépendantes :
« La Loi sur l'Assurance des Aides aux Personnes
âgées dépendantes est un système `où l'on
soutient les aides aux personnes âgées dépendantes par
l'ensemble de la société en se basant sur l'idée de la
solidarité' et également un système `où les usagers
décident leurs services de santé (hoken), de médecine
(iryô) et de bien-être (hukushi)' et en bénéficient
de manière englobante et cohérente.'. C'est un nouveau
système de la sécurité sociale ayant pour objectif de
soutenir les aides aux personnes âgées dépendantes sans
polariser les charges de ces aides qu'à certaines personnes
particulières. De ce fait, il est nécessaire d'inclure une
orientation où chacun continue sa propre vie de manière autonome
en bénéficiant des services. Une vie autonome et
indépendante se réalise dans un cadre de vie où la bonne
santé et Ikigai sont présents, et qui permet de pouvoir vivre en
toute sécurité »448.
Suite à cet objectif fondamental, les deux piliers
suivants sont formulés pour l'application des mesures concrètes :
« production de la santé vivante par chacun de nos citoyens
(shimin hitori-hitori no ikiiki kenkô-zukuri) » ; «
établissement d'un système local de soins chaleureux
(omoiyari ahureru chiiki `care-system' no kakuritsu) »449.
Ensuite, le Plan se donne trois thématiques des points de vue suivants :
« santé - ikigai » ; « soutien à
autonomie » ; « environnement sécurisant
»450.
En fait, c'est à ce niveau-là que l'idée
d'Ikigai a vu le jour dans le cadre de la politique du vieillissement de la
Ville de Toyota. C'est dans la première thématique qu'elle est
clairement définie et située. Dans la première
thématique, l'idée d'Ikigai est clairement liée à
la longévité et à la santé. Et la santé
étant un élément universel comme « ce que tout le
monde souhaite »451. Et l'idée de la «
prévention de la dépendance (kaigo-yobô) » est
clairement formulée comme suit « nous allons susciter une prise
de conscience au sein du public sur la gestion de santé, via une mise en
valeur de diverses affaires de santé, pour son maintien de la bonne
santé et sa prévention des risques de dépendance
»452.
Donc, l'idée d'Ikigai est non seulement située
dans le cadre de la sensibilisation à la santé, mais
précisément dans le cadre de la prévention de la
dépendance. Elle est destinée aux personnes qui ne sont pas
encore dans la phase de dépendance. D'où l'apparition de la
nouvelle catégorie de la population cible de la politique du
vieillissement : personnes âgées en bonne santé (genki na
kôreisha).
La première thématique va encore plus loin en
terme de définition de l'idée d'Ikigai. Elle la met en relation
avec une série de nouveaux éléments : « santé
mentale (kokoro no kenkô) » liée à la «
participation sociale » et l'« apprentisage à vie ou
l'éducation permanente (shôgai gakushû) » et ensuite
« travail d'Ikigai (ikigai shûrô) ». Elle explique ainsi
ces mises en relation :
- « Concernant la santé, il est
nécessaire de tenir compte non seulement de la santé physique
mais aussi de la santé
mentale. Il sera ainsi nécessaire de
mettre en place des soutiens pour construire une vie pleine d'Ikigai par le
biais de la
446 Ibid : 81.
447 Ibid.
448 Ibid.
449 Ibid.
450 Ibid. « 1 Soutien pour la réalisation d'une vie
avec la bonne santé et Ikigai (santé - ikigai) ; 2 Soutien pour
la réalisation d'une
vie autonome des personnes âgées (soutien à
l'autonomie) ; 3 Aménagement d'un environnement où l'on peut
vivre
indépendamment en toute sécurité
(environnement sécurisant). » (Ibid.)
451 Ibid. : 82.
452 Ibid.
participation sociale et de la promotion de l'apprentisage
à vie »453
- « Près de 90% des personnes
âgées sont en bonne santé et ils ont une haute motivation
pour le travail. Le travail des personnes âgées peut être
lié à Ikigai et constituer une grande puissance qui soutient
l'ensemble de la société dans le contexte du vieillissement -
diminution accélérée de la population jeune
(shôshi-kôreika). De ce fait, le soutien au travail des personnes
âgées sera davantage nécessaire. »
L'idée d'Ikigai est ainsi située et plus
structurée dans une des trois thématiques de la politique du
vieilissement, en relation avec la promotion de la santé mentale qui est
suceptible d'avoir un effet positif sur celle physique. Puis, ceci est
destiné aux personnes âgées en bonne santé
plutôt que celles qui ont besoin d'aide, et cette promotion est
encouragée, par le biais des : participation sociale ; éducation
permanente; travail454.
En même temps, l'idée d'Ikigai se sépare,
de fait, des deux autres thématiques concernant la mise en place et le
développement d'une série de nouvelles infrastructures pour les
aides aux personnes âgées dépendantes comme les services
à domicile, services en institution, informations sur l'Assurance des
Aides aux Personnes âgées dépendantes, main-d'oeuvre dans
les aides aux personnes âgées dépendantes etc.
Mise en place du Comité pour la Création
d'Ikigai (Ikigai-zukuri Suishin Kaigi) dans la Direction Santé et
Bien-être
Dans le Plan pour les années 2000-2004,
l'établissement du CPCI est prévu dans le cadre de la
première thématique « Soutien pour la réalisation
d'une vie avec la bonne santé et Ikigai (santé -
ikigai) » qui se divise en trois domaines suivants : 1 Promotion
Santé (Kenkô-zukuri no Suishin) ; 2 Soutien aux Participation
sociale et Création d 'Ikigai (Shakai-sanka ya Ikigai-zukuri heno Shien)
; 3 Soutien au travail (Shûrô heno Shien) 455.
L'étabilissement du CPCI est explicité dans le deuxième
domaine indiqué ci-dessus avec un ensemble de projets concréts
à réaliser dont l'agriculture est abordée pour la
première fois. Les projets principaux prévus dans ce domaine sont
ainsi les suivants :
- Enrichissement des cours dans les centres cummunaux
(université des personnes âgées, cours sur les hobbies etc)
- Enrichissement des opportunités de présentations des fruits de
l'éducation (exposition, compétition etc)
- Etablissement de centres pour un usage
multigénérationel
- Examen de l'étabisssement d'un centre complexe de
l'Education permanente « maison pour l'échange
intergénérationel »
- Etablissement du Comité pour la Promotion de la
Création d'Ikigai
- Réunion pour la formation des leaders des personnes
âgées
- Promotion des Activités pour la communication et
l'échange avec l'agriculture456
(souligné par le rédacteur)
Comme il l'a été expliqué plus haut, en
2000, le CPCI a été organisé par la participation de 12
citoyens sélectionnés par un concours général et 7
administrateurs de la Municipalité dont Monsieur A, responsable du CPCI
et Monsieur K, président actuel du Centre Nô-Life et
employé du BPA de l'époque. Ensuite, en aôut 2001, ce
comité a abouti à rendre au maire de Toyota un rapport de
propositions sur les mesures pour la création d'Ikigai. Il formula les
trois propositions suivantes qui vont déterminer les piliers des mesures
de la création d'Ikigai au sein de la municipalité de Toyota et
dont la première sera l'idée qui va précéder le
Projet Nô-Life457.
- « Travail d'Ikigai valorisant le `Nô'
(ruralité) (`Nô' wo ikashita Ikigai shûrô) » :
projet d'une Ferme école des personnes âgées
(Kônenreisha Taiken Nôjo Jigyô)
453 Ibid.
454 Ici, le contexte est clairement lié à la
thématique internationale du « vieillissement actif ».
455 Direction Santé et Bien-être, 2000 : 85.
456 Ibid. : 89.
457 Comité pour la promotion de la création
d'Ikigai, 2001 : 1.
- « Enrichissement d'un lieu de création
d'Ikigai par le biais d'apprentisage de techniques et de connaissances (gijutsu
- chishiki wo shûtoku shi Ikigai zukuri no ba no jûjitsu) » :
Inauguration de l'Université du Trosième âge (Kônen
daigaku no kaikô)
- « Mise en place d'une fonction de coordination des
demandes diverses d'Ikigai (Tayô na Ikigai needs no Coodinate Kinô
no Secchi » : Ouverture du « Young Old Support Center (Centre du
soutien des jeunes vieux) » (souligné par le
rédacteur)
Le lien entre l'idée d'Ikigai et la ruralité
(Nô) a ainsi été établi par ces propositions du
CPCI. La mise en relation de ces deux éléments a
été réalisée par des réflexions faites au
sein du CPCI et de travaux de coordination effectués par la SCI. Pour
éclairer les éléments de représentations
mobilisés dans cette mise en relation, nous examinerons le contenu de ce
rapport de propositions et des explications données par Monsieur A,
Madame S et Monsieur K, président du Nô-Life.
Relation entre Ikigai et Nô (ruralité) avec la
dimension sociale et territoriale
Dans le Plan pour les années 2003-2007, version
révisée du Plan précédent, la SCI présente
un schéma mettant en relation les idées de la participation
sociale (shakai sanka) et de la Création d'Ikigai et les
différents types d'acteurs locaux concernés dont les acteurs
ruraux (foyers et organisations agricoles) sont mentionnés (Voir
l'annexe 9)458.
Dans ce schéma, autour d'une série
d'institutions coordonnées par le CPCI (Young Old Support Center,
Université du Troisième âge, Ferme école des
Personnes âgées, Centre des Ressources humaines
âgées, Clubs des Personnes âgées etc), les
thématiques de la Participation sociale et de la Création
d'Ikigai met en relation en réseau sous la forme d'un cercle quatres
types d'acteurs territoriaux : les « communautés locales » ;
les « foyers et organisations agricoles » ; les «
bénévolats et NPOs (Non Profit Organisation) » ; les «
entreprises ».
Ici, nous pouvons remarquer une intention, de la part de la
SCI, de lier les acteurs territoriaux de différents niveaux et secteurs
par l'intermédiaire des thématiques de la participation sociale
et d'Ikigai autour des activités coordonnées par le CPCI.
Monsieur A nous a expliqué comme ci-dessous son intention pour cette
coordination intersectorielle en répondant à une question de
l'enquêteur :
« [L'enquêteur : Quelles sont les autres
structures extérieures avec lesquelles vous êtes en collaboration
depuis l'établissement du Comité ?] Euh, dès le
départ, la thématique que l'on a choisie pour démarrer le
Comité était la `Création d'Ikigai par le biais du travail
(Shûrô ni yoru Ikigai zukuri)'. C'est le CPCI. C'était de ce
point de vue-là que l'on a intégré des employés de
Hellowork459 chargés des personnes âgées qui
étaient dans la Direction de la Politique de l'Industrie et du Travail
(sangyô- rôsei ka) (de la Municipalité), et le Centre pour
les Ressources humaines âgées. On a intégré ces deux
organismes dans notre comité du point de vue d'Ikigai des personnes
âgées en tant qu'un centre doté de la fonction du centre
dans son ensemble. »
Et le Projet Nô-Life, qui s'organise en collaboration
entre la Municipalité de Toyota et la CAT, se situe, d'après
Madame S, dans la partie indiquant le rapport avec « les foyers et
organisations agricoles » et les mesures de la Création d'Ikigai.
Puis, l'explication donnée dans le Plan sur ce schéma, en
redéfinissant les contextes et les objectifs de l'application des
mesures, met l'accent sur les liens sociaux au niveau territorial.
« Vu la tendance d'affaiblissement des
communautés locales liée à la mobilité
démographique, le changement de la structure des foyers, la
diversification de Life Style, il devient important d'avoir des objectifs de la
vie et Ikigai pour que chacun puisse passer sa vie comme il le souhaite en
maintenant une relation avec la société. A cet effet, nous
commençons la promotion de l'éducation permanente tout en
intégrant les niveaux locaux, et nos soutiens au travail dans lequel les
personnes âgées peuvent mettre en valeur leurs techniques et
compétences qu'ils avaient acquis au
458 Section Bien-être et Vieillissement de la Direction
Santé et Bien-être, 2003 : 61.
459 Le Hellowork est le nom d'un agence public pour
l'emploi au Japon comme l'ANPE en France.
cours de leur carrière (professionnelle). Puis,
nous nous efforçons à assurer les diverses occasions et lieux qui
permetteront aux personnes âgées de valoriser leurs
énergies comme les activités bénévoles,
récréatives et l'échange
intergénérationnel460. »
Là, on peut voir une intention manifeste de la SCI de
mettre en relation des liens sociaux et leurs thématiques de la
participation sociale et d'Ikigai tout en mettant l'accent sur le
problème d'un affaiblissement de liens sociaux de type «
communautaire » et « locaux », du à l'individualisation
et l'urbanisation des modes de vie de la population locale comme indiquent les
termes suivants « mobilié démographique », le «
changement de la structure des foyers » et la « diversification de
Life Style ».
Pourquoi une telle mise en relation ? : Réponses de Madame
S
Pourquoi alors un tel raisonnement autour de l'idée
d'Ikigai ? Madame S explique le principe de sa mission comme ci-dessous en
définissant d'abord l'idée d'Ikigai comme étant avant tout
« subjective » et pouvant différer chez les uns ches les
autres :
« ..., en fait, Ikigai n'a pas de limite
d'âges, dès la naissance jusqu'à la mort, chacun peut
l'avoir en fonction de sa période de vie. Il peut y en avoir 10 chez 10
personnes, 100 chez 100 personnes. C'est une histoire très subjective,
je pense. La question est : comment l'administration peut s'y impliquer ? De
notre part, on se spécialise aux personnes qui vont être
âgées et qui sont âgées d'à peu près 55
ans jusqu'à leur fin de la vie, ce qui peut durer à peu
près 40 ans. (...) On leur propose un menu et après, c'est
à chacun de trouver un Ikigai ou pas. On présente une telle
chose, et le choix de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser, c'est à la
liberté de chaque citoyen. Puis, ce dont l'on s'occupe, ce n'est pas des
loisirs personnels - c'est à chacun d'en chercher - mais, ce que l'on
appelle la `contribution territoriale ou sociale', ou la `participation
sociale', de faire trouver Ikigai [à chacun], en ayant un lien avec la
société ou le territoire où il habite. C'est par là
que l'administration pourrait apporter une aide, je pense. »
Puis, elle a expliqué des traits spécifiques de
la population de la Ville de Toyota et son vieillissement en abordant le
problème de la retraite massive de la génération du
baby-boom (dankai no sedai) et l'histoire urbaine de Toyota marquée par
l'essor industriel avec l'Automobile Toyota depuis les années 65-75 :
« (...) Quant au problème de 2007 où la
génération du baby-boom née après 1947 va
massivement prendre leur retraite, c'est sois disant `happy retire'. Cependant,
avec la prolongation d'emploi lié au problème de la
pension461, cela ne serait pas si massif et brutal que l'on le
croyait. Mais vers 2012 où ils auront 65 ans, il y aura des
problèmes quelques part. Le changement sera un peu plus doux
plutôt que brutal. De toute façon, c'est la même chose, je
pense. (...) Il s'agit du système urbain de la Ville de Toyota, l'impact
de l'Automobile Toyota vers les années 65 - 75 est grand. La ville a
grandi, physiquement et démographiquement. Bien entendu, il y a des
fusions des collectivités, non celle de Heisei mais... (...). Vers le
début des années 65 - 75, l'époque où l'Automobile
Toyota s'est développée, il y a eu de plus en plus d'arrivants de
l'extérieur de la ville ou plutôt du département. Et
à cette époque, la génération du baby-boom choisit,
pour leur travail après l'école, l'Automobile Toyota ou ses
filiales. Ces gens-là, qui ne sont pas originaires de Toyota au niveau
ancestral, disons que ce sont des `immigrants de la première
génération'. Il se marient et créent leur famille et leur
maison ici. C'est ces gens-là qui vont être à la retraite.
Bien sûr, avec le problème de 2007, le babyboom est important au
niveau national, mais à Toyota, c'est particulièrement
significatif. Puis, comment puis-je dire, pour ces gens-là qui ont leur
maison, mais n'ont pas de rizière ni de champs chez eux dont ils
pourront s'occuper après leur retraite, qu'est-ce qu'ils vont faire
après avoir quitté leur entreprise ? De le départ, ils
n'ont pas de lien d'enfance entre eux, et sont devenus citoyens de Toyota
après être adultes. Leur lien territorial est donc très
faible. On dit, plus on est « homme d'entreprise (kaisha ningen) »,
plus cela a tendance à être le cas. C'est par rapport à ces
gens
460 Ibid.
461 Il s'agit de la réforme politique actuelle de la
sécurité sociale au Japon. Le début du paiement des
pensions sera progressivement repoussé de 60 ans à 65 ans.
L'accomplissement de cette réforme est prévue pour 2025.
là qu'il y a le rapport avec les mesures d'Ikigai,
c'est pareil dans le cas de Nô-Life. Le président K disait que, il
y en a beaucoup qui sont originaires de Kyûshû qui sont
deuxième ou troisième fils de fermes. En fait, ce sont des gens
qui ne sont pas totalement urbains. »
De ces explications, nous pouvons comprendre le poids de la
dimension historique et spécifique à la Ville de Toyota,
concernant la relation entre l'idée d'Ikigai et la ruralité dans
ces représentations que Madame S nous a exprimé ci-dessus par
rapport au problème du vieillissement. Il s'agit d'un «
déracinement », oserait-on dire, de la population toyotaienne de la
génération baby-boom à majorité ouvrière et
non-originaire de cette région462. Pourtant, ce
déracinement, il ne faudrait pas le confondre avec la
prolétarisation des paysans des années 60-70, à savoir la
fameuse émigration saisonnière des paysans japonais qui
subissaient des conditions de vie extrèmement défavorables dans
les grandes villes, appellée comme « dekasegi ». En effet,
dans le cas de Toyota que nous étudions ici, il s'agit, en
général, de problèmes de la « retraite heureuse
». Cela comme Madame S nous l'a évoqué avec le mot `happy
retire', de manière quelque peu ironique, au début de ces
explications citées ci-dessus. Ainsi, la question d'Ikigai de la
population de la Ville de Toyota n'est pas direcrement liée à
celle du déracinement des paysans prolétarisés, mais
plutôt à la faiblesse du lien social et territorial au sein d'une
population locale qui a pu bénéficier d'un grand essor
économique réalisé dans la période de la Haute
croissance.
Rapport de propositions de 2001
Le rapport de propositions qui a été rendu au
maire en 2001 par le CPCI, a développé un ensemble d'idées
pour démarrer l'ensemble des mesures de la Ville de Toyota pour la
création d'Ikigai. Comme on l'a déjà souligné plus
haut, sa forme d'organisation était marquée à la fois par
sa méthode participative et l'intersectorialité au niveau de son
domaine de compétences, ce que l'on pourrait appeller une sorte de
« bricolage » plutôt que des travaux effectués de
manière spécialisée et purement administrative. Sur ce
point, Monsieur A nous a répondu comme ci-dessous en expliquant que le
CPCI était organisé, lors de la discussion entre 2000 - 2001, de
manière spontanée et même anticipante de la situation
englobante comme celle de la tendance à la décentralisation.
« [Enquêteur : (...), là, il y a des
organismes qui sont de différents domaines de compétences qui
s'impliquent...] Ici, c'était avec le Bureau de l'Education permanente
qui était attachée à la Commission de l'Education à
l'époque. On faisait déjà des discussions où on se
disait `tiens, nous, on faisait ceci et cela à l'université
populaire ou aux centres communaux...'. Ensuite, c'était avec le
Musée de l'art populaire, le Musée du pays, le Bureau de
l'Industrie et du Travail, le Bureau de l'Echange
intergénérationel etc. On développait par là nos
communications vis-à-vis de diverses propositions. Là [concernant
la ruralité], c'était beaucoup avec le Bureau de la Politique
agricole, sur la culture légumière, le jardinage etc. On
examinait, thématique par thématique, la faisabilité et la
responsabilité pour divers projets. Il était également
possible de dire `ça, c'est aux habitants à le faire par
eux-même'. Désormais, peut-être on fera davantage de cette
manière... On l'a fait comme une tentative qui a
précédé la décentralisation de nos jours.
[Enquêteur : c'est intéressant. Mais cette tentative
n'était-elle pas commandée par le haut comme l'Etat ? Ou bien,
était-ce un fruit d'interactions entre divers acteurs locaux ? Ben, sans
doute était-ce l'initiative locale qui a dû anticiper, je
suppose.] Oui. En fait, du côté de l'administration, on a une
limite d'intervention malgré nos diverses tentatives de soutiens pour
répondre aux demandes locales. Si on saisit bien la demande, le projet
va se développer, sinon, il va décliner. Si on essaie d'avancer
un projet uniquement par la motivation de la part de responsables
administratifs, on aura des inconvénients. Dans un tel cas, on pourrait
immédiatement arrêter le projet. Mais, tant qu'à faire,
avant de commencer un projet si difficile et compliqué, pourquoi pas
demander les avis des citoyens ! C'est plus rapide. C'était une telle
idée si simple. »
462 Nous avons vu dans le chapire 1 le phénomène de
l'émigration rurale massive vers la Ville de Toyota
accélérée entre 1965 et 1975 depuis toute l'archipel du
Japon.
Donc, l'idée d'appliquer la concertation au public avec
une telle coordination intersectorielle au sein du Comité pour
développer ses projets, était pour avoir une meilleure
efficacité de l'intervention publique afin de mieux répondre aux
demandes locales. Et Monsieur A tient toujours son intérêt sur les
idées qui ont été développées dans ce
rapport établi en 2001 :
« Donc, on a diverses propositions politiques (dans
le rapport) pour les activités possibiles des personnes
âgées, que l'on a pas encore entreprises. Mais si on
réétudie là-dedans, il serait possible de
développer de nouveaux projets. Il peut y avoir une concentration
d'idées là-dedans qui sont encore possibles à
réaliser. »
Ce rapport a développé au total 13 propositions
particulières qui ont convergé aux trois propositions finales
suivantes :
1 « Travail d'Ikigai valorisant le `Nô'
(ruralité) (`Nô' wo ikashita Ikigai shûrô) » :
projet d'une Ferme école des personnes âgées
(Kônenreisha Taiken Nôjo Jigyô)
2 « Enrichissement d'un lieu de création
d'Ikigai par le biais d'apprentisage de techniques et de connaissances (gijutsu
- chishiki wo shûtoku shi Ikigai zukuri no ba no jûjitsu) » :
Inauguration de l'Université du Trosième âge (Kônen
daigaku no kaikô)
3 « Mise en place d'une fonction de coordination des
demandes diverses d'Ikigai (Tayô na Ikigai needs no Coodinate Kinô
no Secchi » : Ouverture du « Young Old Support Center (Centre du
soutien des Jeunes vieux) »463
Sans détailler le contenu de toutes les 13 propositions
particulières, voyons ci-dessous les titres de ces propositions
liés chacun à une des trois propositions finales indiqués
ci-dessus. Les thématiques abordées par ces 13 propositions sont
très diversifiées :
- Plan de Second Life Academy : 1
- Mise en valeur de friches agricoles (jardin horticole ;
location de jardins potagers ; ferme école ; culture de légumes
biologiques ; fertilisation du sol pour le jardinage) : 1
- Plan de Second Life Academy (recité) : 2
- Etablissement de l'Université du Troisième
âge : 2
- Penser le `Travail d'Ikigai pour la production
matérielle (mono-zukuri ikigai shûrô wo kangaeru)'
(restauration du tissu artisanal de coton de Mikawa464) : 2
- Mise en place d'un système éducatif pour la
réinsertion et les activités bénévoles des
personnes âgées : 2
- Projet de soutiens aux travaux ménagers (services
à domicile par les personnes âgées, services de soins
à domicile aux foyers composés de personnes âgées ou
de personnes handicapées) : 2
- Projet de recyclage, réparation des matériels
non utilisés (réparation et vente de matériels non
utilisés par un atelier ; service de réparation à domicile
de jouets) : 2
- Projet de soutiens à la garde et à
l'éducation d'enfants (ouverture de crèches et de classes
d'enfants ; projet de vente de matériels recyclés pour les
enfants) : 2
- Construction d'un réseau dont le centre est la Ville
de Toyota : 3
- Mise en place d'un système d'enregistrement de
ressources humaines âgées : 3
- Création d'un système d'épargne -
points pour les activités bénévoles des personnes
âgées : 3
- Mesures pour le bien-être des personnes
âgées : école des adultes ; établissement d'une
piscine pour la réhabilitation ; construction d'un logement public pour
les personnes âgées : autre465
Parmi ces propositions, ici, nous allons s'intéresser au
contenu des deux premières propositions liées à la
463 Comité pour la promotion de la création
d'Ikigai, 2001 : 1.
464 Le Mikawa est le nom ancien de la région de Toyota
et ses alentours. L'industrie textile du coton étaient fleurissantes
dans cette région jusque vers les années 20. C'était
justement après la crise économique que cette industrie
était au déclin continu et c'est l'industrie automobile qui a
remplacé l'industrie principale de la région après la
deuxième guerre mondiale.
465 Ibid.
première proposition finale du « projet d'une
Ferme école des personnes âgées » qui va donner
l'idée de base au Projet Nô-Life. Le BPA est pleinement
concerté pour élaborer ces propositions et il y a donné
des opinions, de son point de vue, pour la réalisation de chaque projet
proposé.
Proposition 1: « Second Life Accademy Plan ».
Son origine agricole et rurale.
D'abord, concernant la première proposition
intitulée de manière quelque peu originale « Second Life
Academy Plan », il s'agit d'une proposition de créer un
système de formation destiné aux pensionnés pour qu'ils
puissent passer leur vie après la retraite avec Ikigai par le biais
« des contribution productive, sociale et culturelle
(Sangyô-kôken, shakai-kôken, bunka-kôken
»466 . Cette idée correspond largement à
l'idée fondatrice de la SCI, à savoir la contribution sociale et
Ikigai des personnes âgées. En consultant des documents
détaillés de cette proposition qui étaient utilisés
sur la table de discussion du CPCI en 2001 et 2002, citons ci-dessous les
formulations de l'idée de base, la définition donnée au
terme « Second Life Academy ».
Conception du Second Life Academy (Second Life Academy
Kôsô)
1. L'idée de base : Au 21ème
siècle, dans la Ville de Toyota, il est estimé qu'une
augmentation du nombre de citoyens qui passent leur vie dans un sentiment
d'inquiétude et de désolation en raison de l'accroissement du
nombre de familles nucléaires et du vieillissement des gens qui ont
contribué au développement de la Ville. S'il y a un moyen de les
apaiser, cela serait le rôle en tant qu'une personne active pendant toute
sa vie et un sentimenet d'être sûr de son existence. Nous
définissons les mesures visant à leur offrir de tels
éléments, ainsi que les soutiens à la vieillesse riche
comme une des plus importantes thématiques de la Ville.
2. Qu'est-ce que `Second Life Academy' ?
Pour vivre une deuxième vie (= vie à la
retraite) avec Ikigai, il est indispensable de monter une conscience de la
participation de soi-même aux contributions productive, sociale et
culturelle. Nous inaugurons ainsi ce Second Life Academy en tant qu'un
organisme d'éducation afin de former des ressources humaines qui
seraient susceptibles de jouer le rôle de leader dans leur
territoire467.
Tout en se focalisant sur un risque que la vieillesse pourrait
provoquer dans la vie comme « vie dans un sentiment
d'inquiétude et de désolation », il cite
également le développement de familles nucléaires comme
une des causes de ce risque. Cette problématique semble
particulièrement marquer la Ville de Toyota, en rapport avec son
histoire urbaine qui est « jeune », c'est-à-dire, une ville
développée par une seule industrie nouvelle après la
guerre et peuplée par des arrivants de l'extérieur. Cette
représentation rejoint la préoccupation de la SCI qui mettait
l'accent sur l'affaiblissement de liens sociaux et territoriaux dans son
plan.
Par ailleurs, cette « conception » est
marquée par une importance accordée à une série
d'activités agricoles dans sa filière « productive ».
Pourquoi alors un tel attachement aux activités agricoles ? En effet, on
peut remonter la source du contenu de cette première proposition
jusqu'au Plan de 96. Le CPCI a donc repris cette idée, en concertant des
employés du BPA de l'époque dont notamment Monsieur K,
président du Projet Nô-Life, pour élaborer ses propres
discussions.
En plus, concernant cette « conception du Second Life
Academy », c'était Monsieur S, le directeur actuel de la Direction
des Activités agricoles de la CAT (acteur 3 que nous aborderons plus
bas) qui avait proposé cette conception à la Municipalité
de Toyota lors de l'élaboration du Plan de 96. Au début, cette
conception était formulée pour la CAT. Avec le nom de «
conception de l'école rurale (nôson-juku kôsô) »,
elle avait été
466 Ibid. : 2.
467 Comité pour la promotion de la création
d'Ikigai, 2002 : 1. Après la présentation des idées de
base, le programme est proposé ainsi : i. Condition d'admission : les
habitants pensionnés de la Ville de Toyota qui sont capable de venir
à l'école sans aide de quelqu'un ; ii. Programmes :
Filière obigatoire (cours sur les problèmes de la
société contemporaine) ; Filière agricole (production
légumière et fruitière ; élaboration et fabrication
de produits dérivés dans un atelier de transformation ; vente des
produits transformés dans un point de vente ; distribution de
légumes à la cantine scolaire ; un restaurant de déjeuner
mettant en valeur les produits récoltés et transformés) ;
Filière artisanale (expositions des oeuvres ; vente des oeuvres) ;
Filière Service (tour des foyers des personnes âgées
glabataires et isolées ; aides comme nettoyage, consultation etc ;
autres activités répondant aux demandes sociales) (Ibid.)
proposée afin de répondre au problème du
manque de successeurs d'exploitations agricoles de la région de Toyota
dans le contexte du vieillissement démographique. Ainsi, d'après
Monsieur S, le CPCI a carrément remplacé le terme de la «
Coopérative agricole de Toyota » par celui de la « Ville de
Toyota » dans la formulation de l'idée de base de ce plan !
Puis, cette conception avait déjà
été mise en pratique en 2000, au sein de la Coopérative
agricole, sous la forme d'une formation agricole destinée uniquement aux
personnes des foyers agricoles et pluriactifs dont l'importance est notamment
accordée aux femmes et pensionnés. Cette école,
s'appellant l'« Ecole de l'agriculture vivante de Toyota (Toyota Iki-iki
Nôgyô-juku) », continue encore ses activités
aujourd'hui. Et la Municipalité a également pris leurs
expériences comme exemple pour démarrer le Projet Nô-Life.
Dans la partie de l'acteur 3, nous verrons les explications données par
Monsieur S sur ces projets.
Enfin, le BPA donne ses avis favorables vis-à-vis de
cette proposition du « point de vue agricole » en tenant compte de l'
« aggravation d'abandon de terrains agricoles due au manque de porteurs
»468. Puis, en évoquant des problèmes juridiques
concernant l'utilisation de terrains agricoles par les personnes des foyers
non-agricoles, et des problèmes du coût d'investissement aux
équipements), il suggère déjà la
nécessité de la mise en place d'un nouvel établissement
susceptible d'accueillir les personnes, surtout celles des foyers non
agricoles, qui ont l'intention de suivre une formation agricole plus
élaborée. Ainsi, sera envisagé plus tard le Projet
Nô-Life donnant deux ans de formation agricole à ses stagiaires et
ainsi de suite les qualifie d'être agriculteur susceptible de louer un
terrain agricole à partir de 10 ares.
Proposition 2 : « Mise en valeur de friches agricoles
». Un objectif commun entre les mesures d'Ikigai et celle agricoles -
rurales.
En comparaison avec la proposition 1 qui avait un
côté conceptuel pour établir une nouvelle vision globale de
la vie à la retraite, la proposition 2 apporte des idées plus
concrètes sur des projets proposant diverses activités agricoles
et rurales. Voici le motif de cette proposition et les aperçus de quatre
projets proposés :
|
Motif
|
« Il est regrettable de laisser les jachères rendues
en friche que l'on trouve beaucoup dans la ville. C'est pourquoi nous allons
les louer afin d'en créer des projets concernant le `vert (midori)'
»
|
|
|
|
|
Projet 1 : Jardin
horticole
- Réaliser comme une entreprise, une production horticole
(du semi à la vente) semblable à celle de `Maison des
Fleurs'469
Projet 2 : Location de
jardins potagers -
ferme
école470
- Afin d'offrir des lieux d'échange avec les habitants
locaux et des occasions pour communiquer avec la nature, créer des
jardins potagers de petite taille utilisables pour les amateurs et en
développer les projets d'une location de jardins potagers et d'une ferme
école.
- Réaliser comme une entreprise, des cultures
légumières par la méthode biologique jusqu'à la
vente des produits récoltés.
Projet 3 : Culture de
légumes
biologiques471
Projet 4 : Fertilisation
du sol pour
le
jardinage472
- Réaliser comme une entreprise, la fertilisation du
sol pour le jardinage et la vente de ce sol : utiliser des arbres dans les rues
et les feuilles mortes dans les parcs ; utilisation de déchets
végétaux, en collaboration avec le Centre des Ressources humaines
âgées, comme branches d'arbres coupées et morceaux d'arbres
; acheter les pailles auprès des fermes et les utiliser pour la
fertilisation du sol ; rammasser les déchets ménagers biologiques
et les utiliser pour la fabrication du fumier. - Effet : réduction des
déchets
(Comité pour la promotion de la création d'Ikigai,
2001 : 10 - 12.)
468 Ibid., 2001 : 2.
469 La « Maison des Fleurs (yamamuro hana house) » est
un établissement horticole créé dans la Ville de Toyota en
1997 par le Centre des Ressources humaines âgées. Ayant pour
l'objectif d'être un établissement du travail d'Ikigai, il emploie
des personnes âgées pour sa production horticole (Section
Bien-être et Vieillissement de la Direction Santé et
Bien-être, 2003 : 72). Pour cet établissement, le CFLS (acteur 6)
a pris l'initiative (nous verrons plus bas).
470 Kashi nôen - nôen gakkô jigyô.
471 Yûki saibai no yasai zukuri jigyô.
472 Gardening yô `tsuchi' zukuri jigyô.
Pour cette proposition, le BPA donne, projet par projet, ses
avis portant sur la faisabilité, les problèmes de moyen de
réalisation, des propositions alternatives etc. L'idée
formulée dans le motif, de remettre en valeur les friches agricoles en
s'appuyant sur divers moyens possibles, semble devenir un objectif commun entre
le CPCI et le BPA autour de la double thématique de valorisation,
à savoir : valorisation du travail d'Ikigai des personnes
âgées et celle de l'agriculture et de la ruralité en
crise.
Mode d'actions
Après la remise du rapport de propositions du CPCI au
maire en 2001, les trois propositions finales du rapport ont été
mises en oeuvre en 2002 : à savoir : Ferme école pour les
personnes âgées (kônensha taiken nôjô) ;
Université du Troisième âge (kônen daigaku) ;
Young Old Support Center.
La Ferme école a été
intégrée, lors de son inauguration, dans une des filières
de l'Université du Troisième âge sous le nom du
`Département de l'Agronomie environnementale (Kankyô nôgaku
ka)'. En 2005, elle loue deux terrains agricoles dans la Ville de Toyota (dont
la suface est 1.1 ares et 1are) et le nombre de ses étudiants est 32
personnes473. En 2005, l'Université du Troisième
âge a quatre « départements » : vie vivante (Iki-iki
seikatsu gakka) ; culture-artisanat (bunka-kôgei gakka) ; agronomie -
environnement ; échange sympathique (waku-waku kôryû
gakka). Et le nombre d'étudiants est 117 personnes (y compris celui
de la Ferme école)474. Le Young Old Support Center,
centre d'accueil pour le public, il fonctionne comme un centre d'informations
et de coordination. Le nombre de visiteurs de cet établissement
était, en 2005, 18100 personnes475.
Et le CPCI continue ses activités de réunions de
réflexion depuis 2000. Les membres du CPCI se renouvellent tous les deux
ans par un concours citoyen ouvert aux personnes âgées de plus de
18 ans (donc, elles ne sont pas limitées aux personnes
âgées.) Lors de l'entretien avec Madame S et Monsieur A,
c'était donc la fin de la troisième période du CPCI (les
années 2005-2006 et 2006-2007). Il joue toujours un rôle important
comme lieu privilégié de réflexion sur l'ensemble des
mesures pour la Participation sociale et Ikigai des personnes
âgées, en interaction entre des participants citoyens et des
administrateurs municipaux.
Son mode d'actions est, dès le début du CPCI en
2000, toujours marqué par une insectorialité, une
flexibilité, une reflexibilité et enfin une multiplicité
de rôles (coordination des acteurs en réseaux, gestion des mesures
d'Ikigai, point d'accueil au public etc). Cela nous laisse entrevoir sa grande
capacité, en tant qu'un agent public, d'invention d'idées, de
modes d'actions et de mesures concrètes. Etant structurée dans le
secteur administratif et public, la SCI et la relation de réseau
coordonnée par elle, montrent un nouveau mode d'action publique et
territoriale émergent. Et cette émergence est marquée
à la fois par la nouvelle situation globale et locale du vieillissement
de la population au Japon, et par la dimension historique et spécifique
de son territoire.
Cependant, on peut mentionner quelques faiblesses qui
résident dans son mode d'actions. D'abord, un manque de
spécialisation dans ses actions, car il n'y a pas d' « experts
» d'Ikigai. Comme Madame S nous l'a expliqué, « le
bien-être et le soin doivent être chargés par
l'administration, mais l'idée d 'Ikigai des individus impliquant une
telle subjectivité individuelle, n'existaient pas auparavant dans les
domaines de l'administration ». C'est sans doute pour cela que
l'administration doit faire le recours à une approche participative. De
plus, il y a une ambiguîté dans sa fonction concernant Ikigai des
individus : elle est d'abord liée à la subjectivité des
individus ayant chacun ses interprétations d'Ikigai. D'où la
difficulté d'évaluation de ses activités. Comment
quantifier la valeur d'Ikigai qui est tout d'abord définie comme
élément de la santé mentale ? Dans la politique du
vieillissement, son ambiguîté est marquante par rapport
l'importance plus évidente de la fonction des soins aux personnes
âgées dépendantes.
473 Section Bien-être et Vieillissement de la Direction
Santé et Bien-être de la Ville de Toyota, 2006 : 60 ; Young Old
Support Center de la Ville de Toyota, 2006 : 13.
474 Section Bien-être et Vieillissement de la Direction
Santé et Bien-être de la Ville de Toyota 2006 : 58.
475 Ibid. : 57.
Prise de position vis-à-vis du Projet Nô-Life
: un rapport d'entente, mais un décalage d'intérêts
sectoriaux.
Quant à la position de la SCI vis-à-vis du Projet
Nô-Life, un rapport d'entente ou de coopération semble être
établi surtout en se basant sur l'idée de la combinaison Ikigai -
ruralité.
Un rapport d'entente et de coopération
A travers le processus de l'élaboration du projet de la
Ferme école au sein du CPCI, un consensus de base avait
été établi entre la SCI et le BPA. Et ce consensus, tant
au niveau des représentations sur la relation entre l'idée
d'Ikigai, l'agriculture et la ruralité, qu'au niveau de modes d'actions
au niveau de la mise en oeuvre politique.
En effet, le rapport de coopération entre la SCI et le
BPA était étroit pour démarrer la Ferme école.
C'est Monsieur K, responsable du côté du BPA pour le CPCI depuis
2001 et président actuel du Centre de Nô-Life, qui a donné
un avis favorable au projet de la Ferme école et entamé la
discussion entre le CPCI et le BPA vers la mise en oeuvre du
projet476. Il explique ainsi : « Lorsque Monsieur A et
d'autres collègues ont démarré l'Université du
Troisième âge et commencé la Ferme école, ils nous
ont demandé à louer des terrains agricoles. C'est à ce
moment-là qu'il fallait que le BPA obtienne une authorisation et
régler des choses pour cela. C'était encore le moment où
le plan de notre projet (Nô-Life) n'était pas clarifié,
puis, j'ai négocié avec le BPA pour réaliser ce projet de
la Ferme école et élaborer les programmes par la suite etc. Ces
expériences-là nous ont servi à commencer ici
(Nô-Life) 477»
Depuis, un rapport de bonne entente continue entre la SCI et
le BPA au travers la relation entre la Ferme école et le Projet
Nô-Life. En effet, la Ferme école fonctionne comme une «
porte d'entrée » pour des stagiaires qui veulent commencer des
activités agricoles à partir d'un niveau de petit jardins
potagers. Puis, la Ferme école donne à ses stagiaires des
renseignements sur le Centre Nô-Life pour qu'ils puissent aller plus loin
dans leur pratique agricole, s'ils veulent : il s'agit de continuer et
progresser dans leur activité agricole après un an de formation
de la Ferme école, et finalement de pouvoir louer des terrains agricoles
après avoir terminé la formation Nô-Life. Monsieur A
explique ainsi cette liaison entre la Ferme école et le Centre
Nô-Life : « L'important, c'est de pouvoir saisir l'occasion ou
pas. Essayer d'abord ici (Ferme école) est une chose. Et c'est un an de
période d'essai comme une étape avant d'aller au Centre
Nô-Life. Et si on a le sentiment de pouvoir continuer là, on ira
au Centre Nô-Life. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça, en
fait. Donc, le Centre Nô-Life et la Ferme école sont liés.
» Donc, la liaison entre la Ferme école et le Nô-Life
fonctionne comme un réseau, un réseau de formations de
l'agriculture de type Ikigai à différentes échelles, qui
sont destinées aux citoyens.
Une distance d'intérêts sectoriaux
Cependant, il y a une distance nette entre la SCI et le Projet
Nô-Life malgré leur relation de coopération. Cette distance
n'est pas celle entre la SCI et le BPA, mais celle entre la SCI et la CAT
(coopérative agricole) qui est co-gestionnaire du Projet Nô-Life
avec le BPA depuis le démarrage du Projet Nô-Life. Ces deux
agents, la SCI et la CAT, relèvent des deux secteurs différents :
l'un du secteur des services du vieillissement, et l'autre du
476 Une des plus grandes préoccupation du
côté du BPA était un problème foncier et jufidique
dans le cadre de la Loi agraire sur l'utilisation de terrains agricoles par une
personne non agriculteur.
477 Puis, c'était une membre citoyenne du Comité
qui voulait faire un programme d'activités agricoles dans le cadre de
mesures d'Ikigai, ce qui a fait entrer un employé du Bureau de la
Politique agricole dans les discussions du Comité. Mais, mais la
personne qui était responsable du côté du Bureau pour le
Comité en 2000 avant Monsieur K, avait refusé la
réalisation de la proposition de cette Ferme école en raison
d'obstacles imposés par le droit rural. En effet, il n'avait pas la
même idée que Monsieur K qui avait l'esprit de « essayer
d'abord, et régler des problèmes après »...
secteur agricole qui est privé et économique. Donc
il y a déjà une divergence d'intérêts de nature
entre ces deux agents : d'un côté le service pour le
bien-être de tous, et de l'autre le développement agricole.
Et dans les procédures de la mise en oeuvre du Projet
Nô-Life, la SCI était absente. Les procédures de la
réalisation du Projet Nô-Life ont été
assurées par le BPA et une série d'agents du secteur agricole qui
étaient concertés et coordonnés par le BPA478.
D'ailleurs, la préoccupation propre aux agents de ce secteur est bien
représentée dans une des thématiques principales du Projet
Nô-Life : celle de la « formation de porteurs de l'agriculture
(Nôgyô no ninaite no ikusei) », relevant de la politique
agricole nationale du moment actuel. Et le terme d'Ikigai est également
employé par la politique agricole locale depuis un moment pour designer
une catégorie de producteurs agricoles qui sont à faible
productivité479. Mais l'emploi de ce terme dans la politique
agricole est plutôt marquée par le sens économique que
celui socio-culturel que vise la SCI au travers de la thématique de la
« participation sociale et travail d'Ikigai des personnes
âgées ».
Sur ce point, Monsieur A, responsable de la SCI, nous a
expliqué en parlant du rapport entre le Projet Nô-Life et le
développement local. Même si la SCI n'est pas directement
impliqué dans le Projet Nô-Life, sa vison sur celui-ci semble
être celle du développement local de la Ville de Toyota dans le
sens de l'idée de la « ville rurale480 » qui met en
lien l'agriculture et la ruralité au cadre de vie et au lien social et
territorial des habitants, plutôt qu'un simple développement
agricole dans le sens économique. Selon lui, « L'idée
d'introduire le `Nô (agriculture et rural)' dans un cadre de vie est
synonyme d'un aménagement de la ville intégrant l'agriculture et
la ruralité»481 .
A la différence de la coopérative agricole qui a
tendance de viser une « agriculture intensive », la vision que
Monsieur A a du Projet Nô-Life est orientée vers l'image d'une
« ville rurale » intégrant des éléments de
ruralité, dans le cadre d'un aménagement urbain-rural, dans le
cadre de vie des habitants qui n'en disposent pas forcément. Même
s'il ne suggère pas une situation de conflit entre la SCI et les agents
du secteur agricole dont notamment la CAT, un écart de
représentations sur le Projet Nô-Life et l'agriculture de type
Ikigai entre ces deux agents nous semble assez net.
Acteur 3 : Direction des Activités agricoles de
la Coopérative agricole de Toyota (CAT)
Caractère général de l'acteur
478 Il s'agit des : la coopérative agricole (CAT, acteur
3), l'administration agricole départementale (BDPA, acteur 4),
l'organisme de vulgarisation (ECV, acteur 5), la Commission agricole etc. Les
connaissances mutuelles entre ces agents du secteur agricole sont
historiquement constituées dans le cadre des activités pour le
« développement agricole » ayant une connotation
économique et sectorielle.
479 Voir la partie de l'acteur 5.
480 `Inaka toshi' en japonais.
481 Voici la question - réponse entre l'enquêteur et
Monsieur A : « [ L'enquêteur : La caractéristique du Projet
Nô-Life me semble être liée à l'originalité de
la Ville de Toyota : caractère non mégalopole comme Tokyo
où la hausse de prix fonciers est extrème avec la speculation,
mais une ville moyenne et rurale, qui est riche grâce à ses
industries... Y-a-t-il des rapports possibles avec le Projet Nô-Life et
l'aménagement urbain ?] C'est bien ça, c'est une 'ville
rurale'. Sans avoir un cadre de vie comme base, on ne peut rien faire.
L'idée d'introduire la 'ruralité (nô)' dans un cadre de vie
est égale à un aménagement de la ville intégrant
cette ruralité. Toutefois, - si ça peut être une
contradiction politique - pour faire une agriculture intensive, et pour un
développement agricole, il est nécessaire de baisser le
coût et développer une agriculture à grande échelle,
je pense. (...) Mais après tout, sans base de vie, pas de tentatives
d'activités agricoles. Pour les habitants de grands ensembles (=
'danchi' en japonais), il n'y en a nulle part (moyens pour faire des
activités agricoles). En bref, leur environnement ne leur permet pas de
le faire. Alors, par où on doit ouvrir des portes pour eux ? Les jardins
potagers et familiaux sont là, mais ce n'est pas encore suffisant.
L'idée de les élargir seulement au niveau administratif est
perverse. Il serait plus important que les gens de foyers agricoles
créent un environnement favorable, puisqu'ils ont des moyens de le faire
au niveau institutionnel. Donc, l'important est de donner des méthodes
à ces gens-là, par exemple des subsides, comme par exemple 'on
aide 20% pour aménager vos terrains agricoles et pouvez-vous en faire
des jardins familiaux ?' etc. Ca serait une idée, même si l'on ne
l'a pas encore étudiée... ».
Présentation générale des
Coopératives agricoles japonaises (JA) : un peu d'histoire
L'établissement des « Coopératives
agricoles japonaises (Nôgyô kyôdô kumiai :
Nôkyô ; Japan Agriculural Cooperatives : JA » remonte en 1948.
L'origine de cette organisation remonte à l' « Union agricole
(Nôgyô kai) » établie en 1943 par le régime
totalitaire pendant la guerre pacifique dans le but de centraliser, sous
l'égide de l'Etat, la distribution des denrées alimentaires.
Une coopérative, mais également une grande
firme...
Le JA est un organisme représentant l'immense
majorité des foyers agricoles japonais, en 2004, le nombre
d'adhérents était environ 5 050 000 membres officiels (foyers
agricoles) et 4 090 000 membres associés (foyers non agricoles) au
Japon482. Et le nombre total de coopératives agricoles
était de 813 en 2004 alors qu'en 1993, il était de 3012. Ce qui
correspondait à peu près au nombre de collectivités au
Japon à cette époque. Depuis lors, accompagné par le
changement de son appellation générale de «
Nôkyô » à « JA », le mouvement massif de
fusions intercommunales de coopératives fut très rapidement
procédé jusqu'à aujourd'hui. Ce qui reflète le
déclin de la population agricole japonaise, notamment accentué
dans les petites collectivités rurales dépeuplées. Le
nombre de membres officiels, c'est-à-dire les agriculteurs, a
également diminué de 720 000 depuis 1975 (5 770 000 en 1975
à 5 050 000 en 2004) en raison de la diminution du nombre des foyers
agricoles483.
Etant une coopérative agricole, elle est également
un grand organisme financier : la Banque de JA (Nôrin chûo kinko :
The Norinchukin Bank) est une grande banque à l'échelle
mondiale484.
Les fonctions des JA sont diverses. Quatre fonctions
générales sont : achat commun des matériels agricoles
(engrais, pesticides, machines etc) ; vente commune des produits agricoles ;
crédits (épargne, prêt etc) ; mutualité (assurances
de vie, de logement, auto etc). Puis s'y ajoutent l'offre de divers services
pour la vie quotidienne des membres (supermarchés, santé, aides
aux personnes âgées, tourisme, organisation de
cérémonies funéraires etc.)
Coopérative agricole de Toyota (CAT)
La CAT avait, en 2005, 15352 membres agriculteurs composant
15132 foyers agricoles485. D'après la brève
explication de Monsieur S, directeur de la Direction des Activités
Agricoles (Einôbu) de la CAT, cette direction a quatre domaines
d'activités : achat commun des matériels agricoles (kôbai),
vente commune des produits agricoles (hanbai), utilisation
d'établissements (riyô : silo, locaux pour le calibrage etc.) ;
orientation agricole (shidô : stages agricoles, conseils techniques
etc).
Pour la CAT, le Projet Nô-Life relève du domaine
de l'Orientation agricole. Si le domaine de la vente constitue une des
prémières préoccupations de la Direction des
activités, les activités de l'orientation agricole ne produisent
pas directement de profits économiques pour les membres. Le domaine de
la vente constitue ainsi le « visage de la Coopérative
(nôkyô no kao) », « C'est, dit Monsieur S,
de là que l'argent vient pour les membres ». C'est pourquoi
Monsieur S souhaite également faire le lien entre l'investissement au
Projet Nô-Life et un développement de la vente de produits
agricoles. Ces dernières années, le chiffre d'affaires de la CAT
a tendance à baisser en raison de la baisse des prix agricoles comme
celui du riz notamment dans le contexte de la libéralisation du
marché.
Partenaires institutionnels
482 Zenkoku Nôgyô kyôdô kumiai
chûou kai : Zen-chû (Fédération centrale des
Coopératives agricoles japonaises) :
http://www.zenchu-ja.or.jp/profile/b.html
(site officiel).
483 Ibid.
484 En 1995, elle était dans les dix premiers rangs des
plus grandes banques dans le monde.
485 Aichi Toyota Nôgyô Kyôdô Kumiai
(2005) : 25.
Les partenaires avec lesquels la CAT collabore
régulièrement sont : les municipalités situées au
territoire concerné (dont notamment celle de Toyota) ; le
département (BDPA : Bureau Départemental de la Politique
Agricole) ; l'organisme de vulgarisation (ECV : Ex-Centre pour la
Vulgarisation, attaché au département). Les municipalités
et le département concernent notamment le domaine administratif : la
gestion des subsides, et celle des biens fonciers avec la Commission
agricole486 etc. Puis, l'ECV est chargé du domaine
d'orientation agricole au niveau technique et économique.
Bref historique de l'implication de la CAT dans
l'élaboration du Projet Nô -Life
L'évènement marquant la première
implication de la CAT dans le processus de l'élaboration du Projet
Nô-Life fut la proposition de « la Conception de l'Ecole rurale
(nôson juku kôsô) » par Monsieur S, dans le cadre du
Plan de 96 de la Municipalité de Toyota
En fait, cette conception contenait les idées qui
influençèrent le plus une série d'actions
concernées qui ont précédé le Projet Nô-Life
depuis la fin des années 90 jusqu'en 2004 : Jardins citoyens ; Ecole de
l'agriculture vivante ; Ferme-école des Personnes âgées
etc. Et comme on l'a vu dans la partie précédente sur la SCI, la
proposition était initialement faite par Monsieur S sous un titre
différent : « Conception du Second Life Academy ». Monsieur S,
qui était soucieux de la situation du manque de successeurs des
activités agricoles au sein des foyers agricoles, du au vieillissement
de la population agricole, a eu l'idée d'ouvrir une école afin de
donner un enseignement agricole pour les retraités salariés des
foyers agricoles n'ayant très peu d'expériences agricoles.
Ensuite, la Municipalité de Toyota voulut prendre cette idée
comme un projet pour le public en général en majorité
salariale pour lequel le problème du vieillissement démographique
était de plus en plus considéré comme important. C'est
ainsi que, nous l'avons vu, le CPCI coordonné par la SCI, a repris cette
conception comme idée de base pour élaborer leur proposition
remise au maire en 2001.
Suite au lancement du Plan de 96, et à la suspension du
projet du Parc rural en 1999, la CAT commença à mener ses
actions, en collaboration avec le BPA et l'ECV, pour réaliser une
série de projets qui étaient prévus dans le cadre de la
Conception de l'Ecole rurale. Les Jardins citoyens (1998-) et l'Ecole de
l'agriculture vivante (2000-2003) furent ainsi mis en oeuvre, afin d'encourager
le public à mener des activités agricoles dans le territoire de
la Ville de Toyota.
Jardins citoyens (1998-)
L'ouverture des « Jardins citoyens (shimin nôen)
» consistait à aménager plusieurs ensembles de terrains
agricoles comme des jardins potagers disponibles au public dont chaque parcelle
fait 70-100 \u13217§(0.7-1 are). Ces jardins sont situés en milieu
rural (zone d'urbanisation contrôlée) à la
différence des jardins appelés « jardins familiaux (katei
saien) » qui étaient déjà aménagé
à l'intérieur de la zone urbaine (zone à urbaniser), dont
chaque parcelle compte 20-30 \u13217§(0.2-0.3 are). En aménageant
ces nouveaux jardins potagers à une échelle plus grande, la CAT
et la Municipalité de Toyota escomptaient que les usagers puissent
développer leur pratique de jardinage au delà d'un simple loisir,
et ainsi mettre en valeur plus de terrains agricoles qui étaient
laissés en jachère ou en friche.
Ecole de l'agriculture vivante (2000-2003)
Puis, l' « Ecole de l'agriculture vivante (Ikiiki
nôgyô juku) » a été lancée en 2000 par
une coopération entre la Municipalité de Toyota (BPA), la CAT et
l'ECV. Elle est considérée comme une forme de mise en oeuvre de
l' Ecole rurale telle qu'elle était conçue dans le Plan de 96.
Ce projet consistait à donner une formation agricole
à une quarantaine de stagiaires pendant un an. D'après
486 La Commission agricole dont l'origine remonte, nous
l'avons vu dans le chapitre 1, à la Commission agraire organisée
pour la Réforme agraire, est attachée à la
Municipalité, qui donne l'autorisation à l'acquision des droits
(location ou achat) d'utilisation de terrains agricoles.
Monsieur S, seulement deux jours après le lancement de
l'appel à candidature pour ce stage, le nombre de personnes ayant
posé leur candidature avait déjà dépassé le
nombre de stagiares prévu. En utilisant des terrains agricoles
gérés par la CAT, six agriculteurs de la région ont
enseigné leur méthode culturale à ces stagiaires. Le
projet a duré quatre ans avec succés. En plus, après la
formation, un bon nombre de stagiaires (23 sur 112 anciens stagiaires en 2004)
se sont organisés en un nouveau groupement de producteurs de
l'agriculture biologique au sein de la CAT pour continuer leurs production et
distribution de leurs produits en circuits courts.
Ce projet était destiné au public, dont les
femmes et les retraités salariés des foyers agricoles pluriactifs
ainsi que les retraités des foyers non agricoles. Il constitua ainsi une
référence importante dans l'élaboration du Projet
Nô-Life.
Puis, c'est à partir du moment où les stagiaires
ont voulu continuer leur activité agricole dans leur propre terrain, que
fut mis en question le problème de la Loi agraire qui
réglementait le droit d'utilisation de terrains agricoles avec la
surface minimum d'installation de 0.4ha. Cette régle constituait une
barrière pour les stagiaires qui voulaient utiliser formellement des
terrains agricoles. D'où l'élaboration du Projet Nô-Life
visant à créer un système d'entremise des terrains
agricoles au public, en appliquant une déréglementation de la
surface minimum d'installation dans le cadre de la Politique des Zones
spéciales.
Projet Nô-Life (2004-)
Enfin, le Projet Nô-Life a vu le jour en 2004, en
succédant pratiquement aux activités de formation de l'Ecole de
l'agriculture vivante487. Le Centre Nô-Life a
été construit par la Municipalité de Toyota avec un budget
municipal dont le montant est de près de 30 millions de
yens488, à côté d'un centre local de la CAT en
louant environ 2.3 ha de terrains agricoles destinés aux
activités des formations agricoles du Projet Nô-Life. La CAT,
étant co-gestionnaire du Projet Nô-Life, s'investit
également en envoyant trois employés permanents dont notamment
Monsieur KM, vice-président du Centre Nô-Life, chargé des
activités des formations avec Monsieur KH, vice-président du
côté du BPA. Puis, la CAT loue des locaux et des
équipements pour les activités de formation (salles de cours,
machines etc) à la Municipalité de Toyota.
Caractère général des données
Dans cette partie, l'analyse est basée sur l'entretien
effectué avec Monsieur S, directeur de la Direction des Activités
agricoles de la CAT. Il a accueilli l'enquêteur (rédacteur) dans
son bureau de la CAT pour répondre à nos questions, pendant
près d'une heure et demi489.
Représentations
Consensus de base avec la Municipalité sur le
développement de l'agriculture de type Ikigai Problèmatique
de base : manque de producteurs et mise en valeur de retraités
salariés
Le manque de producteurs dû au vieillissement de la
population agricole, et à la baisse des prix agricoles,
487 Pourtant, l'Ecole de l'agriculture vivante continue encore
ses activités de formation dans certains centres locaux de la CAT.
488 Soit environ 200 000 euros.
489 Des renseignements utiles peuvent être
récoltés dans les sites internet des organisations des
Coopératives agricoles japonaises (JA) comme Zenkoku Nôgyô
kyôdô kumiai chûou kai : Zen-chû
(Fédération centrale des Coopératives agricoles
japonaises) :
http://www.zenchu-ja.or.jp/profile/b.html,
ainsi que Nôrin chûo kinko : The Norinchukin Bank :
http://www.nochubank.or.jp/outline/index.shtml
et la CAT
http://www.ja-aichitoyota.com/.
constitue une préoccupation prioritaire pour la CAT.
D'où le motif principal de la CAT pour s'impliquer dans le Projet
Nô-Life afin de « former des agriculteurs (nôka wo
tsukuru) 490 ». D'après l'explication de Monsieur
S, le manque de porteurs dû au vieillissement est surtout aggravé
chez les producteurs maraîchers dont la structure est familiale et non
sous forme d'entreprises, et qui subissent le plus la fluctuation des prix
agricoles.
Ensuite, pour faire face à cette situation de crise, un
point de consensus se constitua entre la CAT et la Municipalité de
Toyota : une nécessité de mettre en valeur les retraités
salariés des foyers agricoles et non agricoles. Voici l'explication de
Monsieur S :
« ... Cependant, on ne peut pas demander aux jeunes
de faire le paysan. Mais si ce sont des retraités, comme ils ont leur
pension, ça pourrait être possible. C'est pour cela que l'on a
demandé au maire de faire quelque chose. On leur dit donc `faites le
paysan !' 491»
Idées de Monsieur S pour la Conception de l'Ecole rurale :
« Ils ont un milieu pour jouer, un lieu d'existence »
Puis, Monsieur S nous a expliqué comme ci-dessous les
idées qu'il avait lorsqu'il a proposé la « Conception de
l'Ecole rurale » à la Municipalité de Toyota lors de
l'élaboration du Plan de 96 :
« En fait, les gens autour de la
génération baby-boom se sont souvent passés de faire le
paysan. Par exemple, quand ils rentrent à la maison, leur
grand-mère travaille aux champs. Mais eux, ils ne savent pas comment
entretenir les champs et la ferme. Puis, est-ce qu'ils peuvent demander
à leur mère comment le faire ? La réponse est non. Quant
à l'épouse également, on fait rarement de conversation
pour demander à sa belle mère comment cultiver les légumes
etc. Dans ce cas, les savoir-faires de ces grand-mères n'ont qu'à
disparaître. Si c'est comme cela, ça serait bien d'organiser des
formations et de faire apprendre... D'où l'idée de l'Ecole
rurale. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'agriculture alors qu'ils
sont nés à la ferme. Eux, après leur retraite, ils ont des
terrains agricoles chez eux. Puis, il y en a qui n'en ont même pas. Ils
n'ont rien, en plus, s'ils doivent aller à l'hôpital tous les
jours ? [Il est possible quj ils vont tous les jours à l'hôpital,
sinon à Pachinko. Il y en a qui font comme ça. Mais quant aux
foyers agricoles, la montagne est là, les champs sont là. Ils ont
un milieu pour jouer, ce qui constitue également un lieu d'existence
pour eux. Ensuite, y être tout simplement ne suffit pas, il faut faire
quelque chose. Alors, il faut apprendre un petit peu l'agriculture. Mais ils ne
la connaissent pas, donc on la leur apprend. Pour la coopérative
agricole, s'ils peuvent ainsi devenir successeurs, c'est suffisant pour nous de
s'adresser uniquement aux foyers agricoles. Mais si on travaille avec la
Municipalité, elle veut s'adresser également au public,
c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas de terrains agricoles. C'est
ainsi que l'on a fait appel aux personnes non agricoles pour lancer l'Ecole de
l'agriculture vivante, il y a déjà 6-7 ans. »
Dans cette explication, il decrit la réalité du
vieillissement des populations tant rurale qu'urbaine (ceux qui ont des
terrains et ceux qui n'en ont pas). Quant aux foyers agricoles, c'est la
grand-mère (ou le grand-père) qui entretient tout seul les
champs, et alors que leur fils et son épouse ne s'en occupent pas.
La situation des foyers agricoles pluriactifs telle qu'elle a
été decrite par Monsieur S, semble s'éloigner encore plus
de l'image stéréotypée sur la pluriactivité des
foyers agricoles au Japon, qui a été largement diffusée
depuis l'époque de la Haute croissance : nous l'avons vu dans le
chapitre 1, celle de « san chan nôgyô (agriculture de 3 chan)
», il s'agit de l'agriculture de papie, de mamie et de maman. Cette
désignation suppose que ces trois personnes s'occupent des champs, alors
que le père (fils) va travailler tout seul à l'extérieur
de la ferme. Dans la description de Monsieur S, on peut sentir que le temps a
passé et que la situation des foyers agricoles pluriactifs a encore
évolué aujourd'hui : les femmes vont davantage travailler en
dehors de leur foyer et les grands parents n'arrivent plus à travailler
aux champs en raison de leur vieilliesse, et enfin le père va
490 Le terme Nôka a un double sens : d'abord la «
ferme », c'est-à-dire le foyer agricole, ensuite il designe
également quelqu'un est spécialisé dans le métier
agricole, donc l'agriculteur. Ceci est le même usage de « ka »
que « judô ka » ou « karate ka ».
491 « Faire le paysan (hyakushô yaru) » est une
exprésssion couramment utilisée parmi la population japonaise
pour signifier
« travailler aux champs » ou « se mettre à
des activités agricoles ». Le mot Hyakushô est un terme qui
signifiait, depuis le Moyen âge, le statut général du
peuple appartenant à la paysannerie japonaise.
bientôt prendre sa retraite...
Pour mieux comprendre cette explication de la situation des
foyers agricoles pluriactifs, prenons la trajectoire personnelle de Monsieur S
ayant un lien fort avec cette situation. En fait, Monsieur S est lui-même
issu d'un foyer agricole dans une zone de moyenne montagne situé dans le
territoire de Toyota. Son pays natal, s'appellant Matsudaira, avait
fusionné avec la Ville de Toyota en 1970492. Puis,
étant fils ainé, il n'a pas repris les activités agricoles
de ses parents. Ceci afin d'aller travailler, après avoir fini ses
études universitaires à Tôkyô, en tant
qu'employé de la Coopérative agricole de Matsudaira qui fusionna
également avec la CAT plus tard. Une telle trajectoire semble influencer
la façon dont il perçoit la situation des foyers agricoles
pluriactifs, puisque qu'il vit lui-même cette situation.
Dans son explictaion, les champs et la montagne constituent
les plus importants capitaux pour les foyers agricoles. Ils représentent
« un milieu pour jouer » et « un lieu d'existence » pour
ces retraités qui n'ont pas travaillé la terre pendant qu'ils
étaient salariés. Cette explication montre un
élément essentiel des idées de Monsieur S qui
établit clairement le lien entre le vieillissement de la population et
la ruralité pour concevoir sa « Conception de l'Ecole rurale
».
Par ailleurs, il met l'accent sur le fait que c'était
la Municipalité (et non la CAT) qui voulait s'adresser à la
population non agricole pour lancer le projet de l'Ecole de l'agriculture
vivante, et qu'il suffisait, pour la coopérative, d'avoir plus de
successeurs d'activités agricoles au sein des foyers agricoles par ce
projet. De cette explication, on peut remarquer qu'il y a un
intérêt particulier que la CAT porte pour son implication dans le
Projet Nô-Life en tant qu'un organisme représentant des
agriculteurs mais non le public en général.
Vision de l'Agriculture de type Ikigai chez Monsieur
S
Nous avons constaté un point de consensus entre la CAT
et la Municipalité sur le problème et l'objectif
généraux pour mener une coopération pour le Projet
Nô-Life. Cependant, la vision que la CAT porte pour mettre en oeuvre le
Projet Nô-Life, notamment celle de l'agriculture de type Ikigai,
n'a-t-elle pas un trait spécifique en raison de son propre
intérêt ? D'autant plus que la place de cette idée de
l'agriculture de type Ikigai est centrale dans le Plan de 96 ainsi que dans le
Projet Nô-Life, et que c'était Monsieur S qui a apporté,
avec ses propres idées (fortement liées à sa trajectoire),
une contribution importante pour l'élaboration du Plan de 96, il nous
serait plus éclairant de mettre en évidence les
éléments de représentations sous-tendant la vision de
Monsieur S sur l'agriculture de type Ikigai.
Expériences antérieures de Monsieur S : une
généalogie de ses idées sur l'agriculture de type
Ikigai...
« Marché du mardi soir » à la
Coopérative de Matsudaira vers 1984 : l'idée de « pouvoir
gagner de l'argent avec un plaisir » dans une situation
ambivalente
Plusieurs expériences que Monsieur S a
antérieurement vécues dans son travail au sein de la
Coopérative agricole de Matsudaira (son pays natale) et la CAT, et qu'il
nous a racontées, nous apportent certains éléments
importants pour comprendre sa propre vision de l'agriculture de type Ikigai.
Ces expériences nous montrent qu'il y a une continuité historique
dans son approche, voire une généaologie de ses idées sur
l'agriculture de type Ikigai.
Vers 1984, il a eu l'expérience d'avoir réussi
à organiser un marché de la vente directe à la
Coopérative
agricole de Matsudaira dans laquelle il était
employé à cette époque. Ce marché s'appellant le
« Marché du
Mardi soir (kayô yû-ichi) », fut
organisé par des femmes de 40-50 ans, et des personnes
âgées des foyers
agricoles pluriactifs de Matsudaira. S'ouvrant
chaque mardi vers 16h à 18h, devant la porte du supermarché
de
la Coopérative de Matsudaira avec une gamme de produits du
terroir, ce marché fonctionne jusqu'à aujourd'hui.
En mettant
l'accent sur les femmes et les personnes âgées des foyers
agricoles pluriactifs, l'action anticipait
492 Le pays de Matsudaira était la seule commune
situé en zone de montagne et la dernière commune parmi les cinq
communes qui ont fusionné avec la Ville de Toyota à entre 1956 -
1970.
bien la mode de la « vente directe des produits agricoles
», une idée largement diffusée et reconnue au Japon
aujourd'hui sous le terme de « Sanchoku », notamment avec le slogan
de « produire et consommer localement (chisan chishô)
»493. Puis, cette anticipation était liée
à la situation spécifique et locale de son pays : à
Matsudaira situé dans une zone de moyenne montagne, la situation de
pluriactivité, du vieillissement et de la stagnation agricole
étaient fortement accentué par rapport aux autres zones
situées en plaine dans le territoire de la Ville de Toyota où les
conditions pour la modernisation étaient relativement favorables
(facilité pour effectuer le remembrement, proximité à la
zone urbaine, possibilité plus grande pour la spécialisation de
la production tel que l'arboriculture etc).
D'ailleurs, à cette époque, il n'y avait pas
encore de points de vente directe gérés par la CAT dans chaque
quartier de la Ville de Toyota comme aujourd'hui. Ainsi Monsieur S explique
comme ci-dessous ses idées qu'il avait à cette époque pour
mener cette action :
« Quand j'ai créé le Marché du
Mardi soir, en fait, j'avais vu beaucoup de choux chinois laissés aux
champs. Et je me suis dit, `Sans doute, il y aurait des gens qui voudront tout
ça...' Puis, j'ai fait le tour des mères des fermes et
discuté avec elles pour commencer un marché. A cette
époque, la vente directe n'exsistait quasiment pas. Le mot de `Vente
directe (Sanchoku)' n'existait même pas. Les points de la vente directe
comme 'Green center' de la Coopérative n'existaient pas encore non plus.
(...) Il fallait le faire de manière 'face-à-face' en sorte que
les gens fassent leur achat en parlant avec ces mères. On a
commencé ce marché une fois par semaine. Ensuite, dans un certain
temps, on a même commencé une livraison de panier avec une
coopérative de consommation de Nagoya. (...) Aujourd'hui, il y en a
beaucoup qui font comme ça avec e-mail... Mais cela n'existait pas
à cette époque. Mais on l'a fait. Et ça continue
encore. »
Comme il l'a expliqué ci-dessus, il a conçu
l'idée de lancer ce marché en tenant compte de légumes qui
restaient aux fermes sans être distribués au marché («
j'avais vu beaucoup de choux chinois laissés aux champs
»). Puis, il a mis en oeuvre ce marché de façon
à se baser sur sa localité en faisant « le tour des
mères des fermes » pour organiser les gens des foyers
agricoles pluriactifs de son pays. Quelle était alors la
préoccupation de Monsieur S pour cette action ? Il l'explique ainsi :
« [Enquêteur : Est-ce que vous pensiez
déjà au problème du manque de successeurs à cette
époque ?] Non, c'était plutôt pour la vente. Je me
demandais comment pouvoir faire gagner de l'argent, et comment pouvoir faire
gagner de l'argent avec un plaisir. Cela en me disant comme ceci : s'il y a des
légumes là, ça arrangera ceux qui en veulent'. Quelque
chose comme ça. »
Donc, la préoccupation n'était même pas le
problème du manque de successeurs, mais la question de «
comment pouvoir gagner de l'argent avec un plaisir (tanoshimi nagara kasegu
niha dôshitara yoi ka) ». Il nous faut éclaicir les
nuances de cette explication. « Gagner de l'argent », il s'agit de la
vente de produits agricoles, que la plupart des gens des foyers agricoles
pluriactifs ne pouvaient pas effectuer au travers le grand marché (comme
chez les grossistes). Puis, l'expression d' « avec un plaisir »
semble impliquer une nuance plus particulière. Pour comprendre cette
nuance, il faut tenir compte des diffucultés et des contraintes
auxquelles les foyers agricoles étaient confrontés pour pouvoir
rendre viable leur exploitation face à l'exigence du grand marché
qui était établi pendant la Haute croissance économique
entre 1955 et 1975. Et la plupart des foyers agricoles sont devenus pluriactifs
en raison de l'impossibilité d'adapter à cette logique
économique avec la structure défavorable de leur production
familiale face à l'exigence du marché. Le mot de « plaisir
» doit être interprété dans un tel contexte
socio-économique.
493 Au Japon, depuis la période de la Haute croissance, le
mouvement de « Teikei-sanchoku (vente directe contractuelle) »
était déjà né entre des groupes de consommateurs de
grandes villes et des groupes de producteurs agricoles. D'ailleurs, un
mouvement récemment paru en France s'y réfère. Voir l'AMAP
(Association pour le Maintien d'une Agriculture paysanne) :
http://alliancepec.free.fr/Webamap/index1.php
(site officiel)
Situation spécifique des foyers agricoles
pluriactifs japonais
En fait, cela suppose également une situation
socio-économique ambivalente des femmes et des personnes
âgées des foyers agricoles pluriactifs. En effet, leur situation
ne peut pas être interprêtée ni en terme de la misère
de la paysannerie japonaise, ni en terme de l'aisance économique
réalisée grâce à la Haute croissance. D'abord, les
foyers agricoles japonais sont tous devenus propriétaires privés
de terrains agricoles après la Réforme agraire494. Ce
qui apporta à la majorité de foyers agricoles une richesse
économique de base à laquelle les citadins (salariat urbain)
n'avaient pas d'accès facile495. Puis, d'un
côté, l'avancement de la situation de pluriactivité a
fragilisé la structure d'exploitation agricole au sein de la
majorité des foyers, de l'autre côté, cette situation
pouvait permettre aux foyers agricoles pluriactifs d'avoir un revenu
équivalent de celui des salariés du secteur industriel. Ceci
pouvait surtout être le cas dans les régions industrielles dont la
Ville de Toyota constitue un bon exemple, tandis que les régions plus
reculées et éloignées des zones commerciales et
industrielles ont subi un exode rural massif et critique496.
En tenant compte d'une telle situation ambivalente
après la Haute croissance économique, qu'est-ce que
représentait l'idée de « gagner de l'argent avec un plaisir
» aux femmes des foyers agricoles pluriactifs ? C'était sans doute
ni pour gagner de l'argent pour sa subsistance dans une situation de
pauvreté critique, ni simplement pour un loisir dans une situation
économiquement aisée. Sans pouvoir répondre ici de
manière complète à cette question, nous pouvons
évoquer, quoique hypothétique, trois éléments
suivants : besoin d'autonomie socio-économique ; motivation pour
continuer la production agricole ; maintien de l'identité relevant de la
profession agricole en tant que « nô-ka (foyer agricole ou
agriculteur / trice) ».
Le fait qu'un foyer agricole devient pluriactif dans une
situation où son chef (père) travaille à
l'extérieur en tant que salarié pour gagner la majeure partie des
revenus de son foyer, est de commencer à perdre plus ou moins son
autonomie socio-économique en tant qu'une exploitation agricole. Et ceci
malgré la richesse économique apportée par son salaire.
Dans ce contexte, la place des activités agricoles devenait
économiquement secondaire au sein d'un foyer agricole, par rapport au
travail salarial du père. Mais, les épouses de ces pères,
qui restaient aux foyers, devaient, de leur côté, jouer un
rôle plus important pour maintenir les activités agricoles dans
leur foyer pour combler l'absence de leur mari. Mais ceci alors que ces
activités agricoles n'avaient plus de performance économique pour
rendre viable leur exploitation. D'où un déséquilibre de
leur position socio-économique. L'idée de se lancer dans une
activité de vente directe avec des femmes des autres foyers de son pays
ne pouvait-elle pas rééquilibrer leur position en tant que femmes
des foyers agricoles et renforcer leur autonomie ? Puis, cela pouvait leur
redonner une motivation pour leur production agricole familiale à petite
échelle ? Ensuite, leur identité relevant de la profession
agricole devaient être assurée par ces activités ?
Si on n'employait peut-être pas encore le mot Ikigai
pour designer leurs activités de vente directe, la notion d'Ikigai
semble bien pouvoir correspondre à un tel contexte ambivalent. Car la
notion d'Ikigai qui signifie littéralement « le sens de la vie
», implique une connotation à la fois productiviste et
anti-utilitariste qui favorise le sens du travail (économique), de la
morale (social) et du moral (mental). Ceci alors que cette notion refuse la
connotation purement lucrative.
« Mouvement de deux ou trois produits » : l'argent
nécessaire pour avoir Ikigai
Monsieur S met l'accent sur l'importance d'avoir un but lucatif
pour l'agriculture de type Ikigai en donnant l'exemple de l'application d'une
mesure d'animation de zones de montagne lancée par la CAT, qui est
494 Voir le chapitre 1.
495 Nous avons vu dans le chapitre 1, dans l'immédiat
après-guerre, il y a eu une « inflation rurale » grâce
à la crise alimentaire. Puis, après la crise alimentaire, les
foyers agricoles sont des possédant d'importants biens fonciers qui
peuvent faire l'objet d'investissements urbains. En plus, l'impôt foncier
est fixé extrèmement bas pour les montagnes et les terrains
agricoles.
496 Il ne faut tout de même pas ignorer la
présence de zones montagnardes fortement reculées et
dépeuplées, qui sont situées dans le même
département que la Ville de Toyota, dans une fourchette de 20-40 km
depuis la zone industrielle de Toyota. Au Japon, la montagne occupe un immence
espace à l'intérieur des îles par rapport aux plaines
situées dans les zones côtières.
actuellement en cours dans le territoire de Toyota (il s'appelle
« mouvement de deux ou trois produits (ni san hinmoku undô) »)
:
« Dans les zones de montagne, il n'y a rien comme
produit. Mais pour animer la montagne et la campagne, les gens de montagne
n'ont que leur montagne et leur terrain agricole comme ressource. Il n'ont
qu'à les mettre en valeur. C'est cette mise en valeur que la
Coopérative doit organiser. Et maintenant, dans le Mouvement de deux ou
trois produits, on dit `faisons de tel ou tel produits dans notre
localité...' par exemple, l'igname japonaise (jinen jo) au quartier A.
D'ailleurs des mouvements comme ça existent depuis longtemps. Ainsi, on
fait produire quelque chose. Et si on le fait une fois, et gagne 100 yens
(équivalent près de 0.66 euros) grâce à ça,
on commence à s'y mettre. Et de l'argent y vient. Au début, les
gens sont réticents en disant `Mais, ça n'ira pas...' Mais
dès que de l'argent vient, ils commencent à bouger »
D'après cette explication, de l'argent est
considéré comme indispensable pour faire « bouger » la
population locale. Telle est la conviction de Monsieur S sur le rapport entre
la Coopérative et ses membres ? Il continue son explication comme
ci-dessous en établissant un lien entre l'argent et Ikigai :
« Si on arrive à faire produire jusqu'à
ce niveau-là, ça serait vraiment d'avoir Ikigai (rire). Ikigai
doit s'accompagner de l'argent. Je pense que c'est comme cela que l'on peut
bouger. Cela donne également une fierté à la
localité. Et s'y impliquer par soi-même est très important
pour ces gens. Cela créé un lieu d'existance précieux.
Bientôt, nous, les retraités - moi aussi - la question de `quoi
faire ?' et de `où faire ?' est très importante. Si on reste
toute la journée à la maison, on gènera tout le monde de
la famille (rire). Alors, qu'est-ce que l'on fait en allant à
l'extérieur ? D'où les choix variés... Ainsi, faire le
paysan est un de ces choix »
D'après cette explication, d'avoir un but lucratif ne
se réduit pas seulement à la recherche de profit, mais il est en
rapport avec une série de conditions pour avoir Ikigai tels que :
l'identité locale (« fierté à la localité
(chiiki no hokori) »), le lien social (« s'y impliquer par
soi-même (jibunra ga sore ni kakawaru to iukoto) ») et
l'existance sociale (« lieu d'existance précieux (arigatai
ibasho ga dekiru) »).
De là, nous pouvons comprendre le rapport entre la
question d'Ikigai des retraités salariés et leurs petites
activités agricoles : « faire le paysan » donne aux
retraités ces conditions socio-économiques nécessaires
pour avoir Ikigai.
Agriculture de type Ikigai pour les retraités : valeur
ambivalente
Ensuite, Monsieur S réexplique le rapport ambivalent entre
la situation économique des retraités et leur activité
agricole de type Ikigai.
« Eux [retraités salariés], ils ont des
pensions. Donc, même s'ils ne gagnent pas d'argent en faisant le paysan,
ils n'ont pas de problèmes pour leur vie. D'un côté, s'ils
arrivent à gagner des sous pour payer leur saké pour une
année, mettons un ou deux millions de yens, il n'y a pas trop de
problèmes plus tard. Mais de l'autre côté, comme ils ont
des pensions, ils n'ont pas besoin de s'y mettre sérieusement.
D'ailleurs, pour ceux qui reçoivent beaucoup de pensions, ce n'est
même la peine de faire le paysan. »
Il constate que, après tout, l'ambivalence subsiste
chez les retraités qui « font le paysan » entre les valeurs
sociale et économique : « faire le paysan » pour les
retraités ne vaut que les faire gagner de l'argent de poche pour «
payer leur saké pendant une année ».
Importance de l'organisation économique : un
intérêt sectoriel
Puis, au delà de la recherche d'Ikigai, un autre
élément plus objectif s'ajoute dans la vision de l'agriculture de
type Ikigai chez Monsieur S : le principe de l'organisation économique
qui dépasse le niveau individuel et
subjectif. Pour faire face à la diminution du nombre
d'agriculteurs, pour Monsieur S, il faut que la production agricole s'organise
sous une forme collective et formelle tel que l'entreprise agricole ou le
groupement de producteurs etc. Voici son explication :
« (...) Puis, l'important, c'est la forme
entrepreneuriale de production agricole (hôjin-ka). Quant aux individus,
s'ils décèdent, c'est fini. Si leur fils refuse de reprendre les
activités, c'est fini. C'est ça, le paysan. En bref, si on
créé une organisation, même si le représentant de
cette organisation décède, quelqu'un d'autres peut le remplacer,
ou bien on peut accueillir de nouveaux membres. On peut faire comme ça.
Créer une 'organisation est donc important. Plus tard, une
société anonyme serait également possible. Même si
on ne le commence pas facilement. Si c'est rentable, cela peut
commencer... »
Cette explication montre que la CAT veut accorder, en
principe, plus d'importance à l'organisation collective et formelle de
la production agricole comme une entreprise, plutôt qu'à la
production qui reste au niveau individuel et purement familial. Et ceci afin de
rendre la production plus permanente dans un cadre du secteur économique
et formel. C'est ce qui semble différencier l'approche de la CAT de
celle de la Municipalité qui veut d'abord mettre l'accent sur la
satification individuelle pour répondre aux diverses demandes de la
population en tant qu'un agent des services publics.
Passage des Jardins citoyens et de l'Ecole de l'agriculture
vivante au Projet Nô -Life
Quand la CAT s'est mise en action pour les lancements des
Jardins citoyens en 1998 et de l'Ecole de l'agriculture vivante en 2000,
Monsieur S a mené certain nombre de réflexions face aux
réussites et problèmes rencontrés au cours du processus de
la mise en oeuvre de ces projets.
Avant de créer les Jardins citoyens, Monsieur S et
d'autres personnels concernés (y compris des députés
locaux) ont effectué une visite des Jardins familiaux en Europe afin
d'étudier la mise en oeuvre de ces jardins. Cette visite leur a plu.
Mais après le retour au Japon, ils ont rencontré tout de suite un
problème juridique par rapport à la Loi agraire sur
l'interdiction de construction de batîments à l'usage non agricole
dans les terrains agricoles. Ce qui les empêcha de construire des cabanes
dans les jardins de la manière européenne. Donc, ils ont dû
lancer les jardins sans y construire de batîments dont chaque parcelle
fait 100 \u13217§, ce qui est plus grand que les parcelles des jardins
familiaux auparavant mis en place dans la Ville de Toyota. Monsieur S
escomptait alors, qu' « il y aura [it] plus de personnes qui voudr
[aient] se mettre vraiment dans l'agriculture plus tard ».
Mais il rencontra un autre problème dans la gestion de
ces jardins citoyens : beaucoup de citoyens qui n'arrivaient pas à
continuer leur activité de jardinage sur leur parcelle attribuée
en raison de sa trop grande surface. Monsieur S attribue la cause de ce
problème à l' « effet de mode » sur l'agriculture parmi
les usagers urbains.
Puis, dans le projet de l'Ecole de l'agriculture vivante,
Monsieur S a expliqué la réussite de ce projet notamment au
niveau de l'organisation d'anciens stagiaires. En effet, nous l'avons
expliqué plus haut, bon nombre d'anciens stagiaires de ce projet se sont
organisés en un groupement de producteurs de l'agriculture biologique au
sein de la CAT. Ce type d'organisation de nouveaux producteurs est un des
éléments auxquels Monsieur S accordait de l'importance dans sa
vision de l'agriculture de type Ikigai.
Ensuite, Monsieur S avait tenté d'essayer une autre
idée pour aller plus loin avec ces anciens stagiaires. Il aurait
souhaité que ces stagiaires gèrent collectivement leur terrain
(il est loué par la CAT) et ensuite le faire utiliser par des
écoles. Il s'agissait d'accueillir des élèves d'une
école primaire et de les faire expérimenter l'agriculture sur ce
terrain agricole, et faire utiliser dans leur cantine scolaire les produits que
ces élèves auraient récoltés. Cependant, cette
tentative n'a pas connu le succès escompté, en raison de
l'exigence du centre municipal de la distribution alimentaire pour les cantines
scolaires (kyûshoku center). En fait, ce centre, gestionnaire de la
distribution alimentaire des repas scolaires, refusa catégoriquement
d'utiliser les produits crus (surtout non surgelés) et non
standardisés (ex. concombres courbées, pommes de terre de taille
hétérogène etc). Ceci en raison du maintien de
l'efficacité de leur travail (découpe, stockage etc).
Puis, après quatre ans d'expériences, l'Ecole de
l'agriculture vivante s'est retrouvée, lorsque les anciens stagiaires
ont voulu davantage développer leur production agricole, avec le
problème de la surface minimum d'installation imposée par la Loi
agraire. Ce qui conduisit la CAT et la Municipalité de Toyota à
élaborer le Projet Nô-Life plus tard.
Idées de base du Projet Nô -Life
Nous allons analyser les idées de Monsieur S sur
l'élaboration du Projet Nô-Life, en tant que responsable du Projet
Nô-Life du côté de la CAT. Le consensus est d'abord
établi avec la Municipalité et les autres agents
concernés, sur le problème du manque de producteurs ainsi que
l'objectif de formation de nouveaux producteurs de type Ikigai en s'appuyant
sur les retraités salariés dont on estimait que le nombre allait
augmenter dans la Ville de Toyota. Mais en plus de ces deux
éléments fondant le contexte du Projet Nô-Life, Monsieur S
met davantage l'accent sur le fait que les stagiaires sont encouragé
à dégager un revenu agricole après leur
formation497. Ensuite, Monsieur S réaffirme le principe des
activités de l'Orientation agricole de la CAT en parlant de la situation
du Projet Nô-Life où les stagiaires risquent de quitter leur
activité agricole quand ils ne pourront plus la continuer...
« (...) On pensait au début 's'il y aura une
ou deux personnes qui se mettront à l'installation agricole, ça
serait bien'. Mais il y en a plus que prévu pour l'instant... Mais,
faire le paysan ne fait pas gagner de l'argent ! Donc on peut se demander
jusqu'à quand ils pourront continuer.(...) Après tout, c'est une
des missions de la Coopérative. Créer les agriculteurs, former
les successeurs, c'est le rôle de la Coopérative. »
Nous voyons ainsi que le rôle officiel de la
Coopérative est identifié au souhait affirmé par Monsieur
S pour la continuation permanente des activités agricoles par les
stagiaires du Projet Nô-Life, ainsi que le fait que ces stagiaires
puissent dégager un revenu agricole.
Puis, le consensus entre la CAT et la Municipalité de
Toyota est renforcé quant au vieillissement de la population dont le
souci augmentait de plus en plus face à la retraite massive de la
génération baby-boom notamment prévue à partir de
2007498. Ainsi, Monsieur S reconnaît également le
problème du vieillissement comme ci-dessous, mais ceci surtout en
rapport avec la ruralité... :
« Et pour la Municipalité, si le nombre des
retraités de la génération baby-boom augmente de plus en
plus, et ils font que fréquenter Pachinko et l'hôpital, ça
coûte trop cher. Peut-être vous le savez, le département de
Nagano499 est le dépatement où il y a le moins de
papis et mamies qui fréquentent l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'ils
travaillent aux champs. Ça, c'est aussi notre but. Dans les villages de
Nagano, on peut trouver des papis et mamies qui sont même prêts
à mourrir sur leurs champs ! En plus, ils tombent rarement malades, et
sont toujours en forme. On espère avoir une telle situation.
»
Monsieur S a également soulevé le problème
du dépeuplement des zones de moyenne montagne situées dans le
territoire de la Ville de Toyota comme ci-dessous :
« Il y a encore une chose, notre Matsudaira et
d'autres zones comme Fujioka et Asahi dans la Ville de Toyota, la population
diminue. Car les jeunes sont partis. C'est pour cela que la localité
décline, sans avoir assez de gens. Surtout le travail comme le
désherbage, il faut le faire trois ou quatre fois par an. Et s'il n'y a
pas assez de gens, on n'y peut rien. On espère que les gens viennent
s'installer dans la montagne. Mais ça serait difficile... »
497 « Ce que nous voulons, dit Monsieur S, en bref,
c'est que, parmi ces stagiaires, il y en ait qui deviennent agriculteurs /
agricultrices. Ikigai, c'est bien, mais on espère que les gens auront
Ikigai en dégageant un revenu agricole ».
498 Ce problème est souvent traité dans les
médias au Japon avec une appellation spéciale comme «
Problème de 2007 (2007nen mondai) ». (Voir la partie de l'acteur
2)
499 Le département de Nagono est une grande région
montagnarde à dominante rurale, située au nord du
Département d'Aichi.
Dans cette explication, on voit que, derrière le
rôle officiel de la CAT affimé plus haut (formation agricole),
d'autres problèmes plus fondamentaux et ancrés dans la situation
territoriale préoccupent Monsieur S : déclin des zones rurales
dû au vieillissement de la population agricole et au dépeuplement.
Et son intention exprimée ici est de lier, via le Projet Nô-Life,
les solutions des problèmes du vieillissement de la population urbaine
et de celui de la population rurale dont le dépeuplement constitue un
facteur décisif d'aggravation.
Vision concrète sur les porteurs de
l'agriculture
La formation des producteurs censés être porteurs
de l'agriculture de type Ikigai est l'objectif principal du Projet
Nô-Life, et également une des missions de la Coopérative
agricole. Mais en réalité, quel type de producteurs la CAT
veut-elle former ? A-t-elle une vision concrète de ceux-ci ?
Plus haut, on a soulevé, dans les
représentations que Monsieur S a de l'agriculture de type Ikigai, les
dimensions suivantes : économique (objectif d'avoir un revenu agricole
d'un million de yens par an); institutionnel (maintien d'une relation avec
l'organisation de la coopérative) ; social (implication) et moral
(mental).
Cependant, la valeur de l'agriculture de type Ikigai pour
Monsieur S impliquait une ambivalence qui était non seulement
liée à la situation objective des retraités (pas
nécessaire de vendre les produits, car leur pension leur assure une vie
stable), mais également au sens de la notion d'Ikigai elle-même
(productiviste mais anti-utilitariste) Face à cette ambivalence, comment
la CAT envisage-t-elle la réalisation de la formation dans le Projet
Nô-Life ? Quelles conditions concrètes la CAT veut-elle proposer
aux stagiaires via la formation ? Et quelle place accorde-t-elle à ces
producteurs par rapport au modèle productiviste des agriculteurs tel
qu'il est promu dans la politique agricole japonaise ? Il s'agit de la question
de la finalité à laquelle elle veut faire aboutir le Projet
Nô-Life...
Intérêt de l'organisation
D'abord, pour Monsieur S, la distance est nette entre la
visée de la formation du Projet Nô-Life et le modèle
productiviste de la politique agricole, promu aujourd'hui avec le
système de l' « agriculteur qualifié (nintei
nôgyô-sha) »500. Il considère qu'il sera
« difficile » pour les stagiaires du Projet Nô-Life de suivre
ce modèle. Il souhaiterait pouvoir accorder aux stagiaires du Projet
Nô-Life au minimum une intégration (ou une participation) de
manière quelconque dans une organisation à l'intérieur de
la Coopérative agricole. Voici l'explication de Monsieur S :
« D'abord, il nous faut saisir qui fait quoi dans tel
ou tel endroit. Notre organisation - la coopérative - et la
Municipalité sont en train de s'efforcer à former des gens. Et si
on ne peut pas identifier leur activité et leur relation, on ne saura
plus où ils vont ! S'ils vont partir seuls et se contenter de vendre
leurs produits par eux-même sans acheter nos matériels, sans
vendre avec nous, on se demandera pourquoi on leur a fait apprendre. Ca n'ira
pas pour nous, si ça se passe comme ça. On voudrait qu'ils
adhèrent à la Coopérative, et qu'ils participent à
telle ou telle organisation en bénéficiant ou gérant nos
affaires. Sur ce point-là, ce n'est pas encore clair dans ce
projet. »
L'importance de l'organisation est le point que l'on a
déjà soulevé plus haut sur la vision de l'agriculture de
type Ikigai de Monsieur S. La CAT souhaite que les stagiaires du Projet
Nô-Life mènent leur activité agricole de manière
à s'intégrer à l'organisation de la coopérative
agricole. Et ceci sans pour autant exiger des stagiaires de suivre le
modèle productiviste d'agriculture. Cela confirme de nouveau l'exigence
de la CAT, basée sur son intérêt particulier qui se
distingue de l'intérêt public de la Municipalité, dans leur
implication dans le Projet Nô-Life.
Et dans l'explication ci-dessous, Monsieur S met surtout l'accent
sur l'importance de l'aspect collectif dans
500 C'est un modèle de producteurs agricoles promu par la
politique agricole japonaise. Par cette politique, il est recommendé aux
agriculteurs de suivre ce modèle via la qualification. Voir la partie de
l'acteur 5.
les organisations de la coopérative agricole. Il n'est
surtout pas souhaité par la CAT, que les stagiaires ne mènent
leur activité qu'individuellement en dehors d'une organisation formelle.
La participation dans un groupement de producteurs (seisan bukai) est ainsi
recommandée aux stagiaires du Projet Nô-Life501.
Jeu d'intérêts réciproques : source de
l'ambiguïté de la finalité du Projet
D'ailleurs, Monsieur S suggère comme ci-dessous que le
fait que les stagiaires s'organisent au sein de la CAT intéressera
également la Municipalité de Toyota.
« L'administration sera aussi contente s'il y aura un
tel mouvement. En effet, l'administration, elle veut aussi avoir un
mérite (jisseki). Si on ne dit que `tout le monde est content dans notre
projet', ça n'ira pas trop... »
Le fait que le mot de « mérite (jisseki)
» a été énoncé par Monsieur S nous
paraît significatif dans la mesure où ce fait suggère
l'existence d'un intérêt particulier de la part de la
Municipalité de Toyota. En effet, cela implique que la position
officiellement déintéressée de la Municipalité de
Toyota, tout en respectant l'intérêt public, veut et doit
également être reconnue comme un mérite (comme par exemple
celui du maire). Et la CAT tient compte, quoique implicitement, de cet
intérêt de la Municipalité de Toyota, pour mener ses
actions.
Puis, l'intérêt que porte la Municipalité
de Toyota vu par la CAT prend nécessairement un caractère
plutôt « symbolique » que matériel, comme Monsieur S
l'explique ci-dessous, de manière quelque peu ironique, sur les valeurs
que l'administation peut accorder aux activités des stagiaires du Projet
Nô-Life :
« Si des nouvelles comme 'd'anciens stagiaires de
Nô-Life font leur contribution locale en faisant telles ou telles
activités' paraissaient, ça serait une très bonne chose.
C'est ce qui ferait le plus plaisir à l'administration. Mais il faut
constituer un enchaînement avec quelques résultats, même si
c'est une histoire pas facile à réaliser. Par exemple, 'tel ou
tel nombre de personnes sont entrés dans un groupement de producteurs',
'la capacité de la vente a augmenté à tel ou tel
degré'. C'est ce qui va créer les fruits du Projet. (...) Donc,
s'il y aura des nouvelles comme 'des élèves d'une école
primaire font quelque chose', ça serait très bien. »
L'expression de Monsieur S « cela fera le plus
plaisir à l'administration » révèle bien
l'existence de la relation d'intérêts réciproques entre la
CAT et la Municipalité de Toyota dans leur coopération pour le
Projet Nô-Life. C'est dans le cadre d'une telle relation
d'intérêts réciproques, que le caractère symbolique
de leur jeu prend son sens et influence la vision « concrète »
de leur projet. Du coup, la finalité du Projet Nô-Life
apparaît nécessairement floue en étant coincé entre
l'intérêt privé et concret de la CAT et
l'intérêt public et symbolique de la Municipalité de
Toyota, qui sont situés dans leur propre jeu réciproque. De ce
fait, on pourrait rendre compte de l'ambivalence de l'idée d'Ikigai qui
a été mise dans ce jeu.
Place résiduelle du Projet Nô -Life au sein de
la CAT : fragilité du Projet Nô -Life
Dans quelle mesure la CAT peut-elle s'intéresser au
Projet Nô-Life face à une telle ambiguïté complexe qui
entoure ce projet (situation des retraités, valeur d'Ikigai,
finalité du Projet) ? Et pourquoi la CAT s'intéresse à ce
projet ? Quelle est l'attente de la CAT vis-à-vis du Projet
Nô-Life ? La réponse de Monsieur S pour cette question montre bien
la réalité paradoxale de la relation entre la structure interne
de la CAT et l'intérêt qu'il porte pour s'impliquer dans le Projet
Nô-Life. Comment la CAT, étant représentant des
intérêts des agriculteurs membres, reconnaît-elle l'apport
du Projet Nô-Life de ses membres ? Monsieur S exprime comme
ci-dessous,
501 « Ce qui sera bien pour nous, dit Monsieur S, c'est
que les stagiaires participent à un groupement de producteurs. Ainsi on
pourrait les organiser. (...) Avant tout, la Coopérative est
elle-même une organisation. Et il y a des organisations à
l'intérieur de cette organisation. On fonctionne comme ça. Donc,
si on se focalise sur les individus, ça sera trop difficile de s'en
charger. Le plus important, c'est la participation dans notre organisation.
L'objectif est donc d'organiser les stagiaires. Mais ce n'est pas
forcément dans une organisation déjà existante, ils
peuvent bien en créer une nouvelle. Organiser c'est une des tâches
de la Coopérative. Tout seul, ça ne marchera pas. Même s
'il en a qui font comme ça... »
un regard généralement peu enthousiaste des
agriculteurs sur le Projet Nô-Life...
« Pour les gens des foyers agricoles, ils n'attendent
pas grand chose du Centre Nô-Life. [Enquêteur : l'apport du Projet
n'est pas encore reconnu...?] Ce qui leur plairait le plus, ça serait de
créer des organisations pour les aider le travail. Par exemple, des
organisations qui viennent aider leur travail quand l'agriculteur tombe malade.
Une telle nouvelle sera très bien appréciée. Mais dans ce
cas, cette aide sera payante... »
D'après cette explication, le simple fait que les
citadins mènent des activités agricoles n'intéresse pas
trop les agriculteurs, sauf s'ils arriveront à jouer un rôle utile
pour eux, comme une organisation d'aides de travaux agricoles en cas
d'urgence502, que Monsieur S a expliqué.
Sinon, pour la CAT elle-même, la reconnaissance interne de
l'importance de son investissement dans le Projet Nô-Life est encore
faible. Voici les explications de Monsieur S :
« Si je n'allais pas voir ce qui se passe
là-dedans (dans le Projet Nô-Life), il n'y aurait personne qui s'y
intéresserait. Il n'y a pas de membre qui s'intéresse à ce
qui se passe à l'intérieur du Projet. [Enquêteur : Il
s'agit de la reconnaissance de l'importance du Projet Nô-Life dans
l'ensemble de la Coopérative...] Il n'y a pas trop de reconnaissance
à ce niveau-là. Donc, s'il y aura de nouveaux agriculteurs parmi
les stagiaires, on leur dira à peine `vous avez bien réussi'.
Mais le processus du Projet lui-même ne les intéresse
guère. »
Le fait que « le processus du projet lui-même
n'intéresse guère » les agriculteurs, comme Monsieur S
l'a évoqué, montre bien la façon des agents du monde
agricole de percevoir ce qui se passe dans le Projet Nô-Life. C'est le
point de vue sectoriel de la part de la CAT qui n'apprécie pas la valeur
du Projet tant qu'il n'y a pas de résultat visible pour le secteur
agricole. Mais, si, au sein de la CAT, il n'y a peu de reconnaissance pour son
investissement dans le Projet Nô-Life, qu'est-ce que ce projet pourrait
représenter pour elle ?
« On n'ignore pas le Projet, on le connaît
quand même. Mais les effets concrets du Projet vis-à-vis de la
Coopérative n'existent pas pour l'instant. (...) On se dit plutôt
'pourquoi on y envoie nos trois employés ?' Alors, je leur dis, 'nous
coopérons avec la Ville.' Mais s'il n'y a pas de retour pour nous par
rapport au temps que nous y consacrons, on devra dire 'on a été
obligé de leur envoyer nos employés [par la Municipalité]
!' »
En plus, le domaine de l'Orientation agricole dans la
coopérative agricole est considéré comme un domaine «
non productif » à la différence des autres domaines
d'activités (achat, vente, utilisation etc). De ce fait, la CAT
n'accorde, déjà, pas beaucoup d'importance à ce domaine.
Et d'après l'explication suivante, le « mérite » de la
Municipalité de Toyota pour le Projet Nô-Life a l'air de
déranger l'intérêt de la CAT.
« Dans le domaine de l'orientation agricole, chez
nous, on ne veut pas trop mettre les gens là-dedans. Nous sommes quand
même une entreprise, même si nous nous appelons coopérative,
nous devons gérer nos affaires. De ce point de vue là,
l'orientation ou la formation des agriculteurs ne sont pas trop rentables. Du
coup, on ne s'y investit pas trop. Et pour la création du Centre de
Nô-Life, d'abord on a envoyé nos deux employés. Et le
travail de ces deux employés devra être reconnu par le haut de la
Coopérative. Maintenant, tout le mérite appartient au maire,
alors... »
Pour la CAT, il faut quelques retours concrets et
matériels par rapport à son investissement dans le Projet
Nô-Life. Et cela est d'autant plus vrai que la Municipalité de
Toyota semble attachée à son « mérite » qui
implique un profit symbolique, comme celui donné au
maire503.
502 Un stagiaire du Projet Nô-Life envisage d'organiser
avec d'autres stagiaires pour aider les agriculteurs. Cette tentative vise
à apporter à la fois à la Municipalité, à la
Coopérative, aux agriculteurs et aux stagiaires, des possibilités
de mise en valeur de la formation du Projet Nô-Life. Nous l'aborderons
dans le Chapitre 3.
503 Cependant, ce profit n'exclut pas les aspects
matériels et concrets, comme une série de chiffres
économiques donnés que nous avons vu dans leur formulation du
Projet dans le cadre de la politique de la Zone spéciale.
Ecart de points de vue entre la CAT et la Municipalité
de Toyota Organisation ou individus ?
Enfin, Monsieur S affirme son souci comme ci-dessous sur
l'intention de la Municipalité de Toyota d'accorder de l'importance plus
à la satisfaction individuelle de chaque stagiaire qu'à leur
organisation collective. Du coup, le Centre Nô-Life paraît à
la CAT accueillir trop de stagiaires.
« Comme c'est une organisation, il faut saisir les
personnes. L'essentiel est de connaître chacun des stagiaires et savoir
comment les organiser. (...) Il faut donner la réponse à chacun
pour son débouché. C'est pour cela, qu'il est impossible de
s'occuper de beaucoup de gens. Chaque année, il y a de nombreux
stagiaires qui finissent leur formation504. Ca sera alors
impossible. (...)Sinon, le résultat sera mitigé. Au pire, il n'y
aura plus de mérite, et la Municipalité voudra nous
déléguer le Projet. Alors, on lui dira que l'on ne saura pas le
faire... »
Ikigai pour le bien-être public ou pour le
développement du secteur agricole ? : Question sur la finalité du
Projet : une ambiguïté qui dérange la CAT
Pour Monsieur S, la question cruciale est donc la
finalité du Projet Nô-Life. La position ambigüe de la
Municipalité de Toyota dérange la CAT qui vise après tout
le « développement agricole » comme expliqué
ci-dessous :
« Donc, il s'agit de la question de la
finalité. Si on continue le Projet comme maintenant de manière
à satisfaire tout le monde, ça ne changera pas. Pourtant,
l'administration a également l'intention de former les agriculteurs et
faire le développement agricole. Mais le Projet tel qu'il est maintenant
n'est pas destiné au développement agricole. Si on tombe au
niveau du simple loisir, des jardins familiaux, ça n'ira pas... Du point
de vue du développement agricole, il faut former les agriculteurs. Et si
on accueille trop de personnes, je pense que la finalité risque
d'être floue. A fortiori, nous sommes la coopérative, et si on
travaille ensemble, nous, on veut former les agriculteurs ! »
En plus, pour Monsieur S, cet écart de position entre la
CAT et la Municipalité de Toyota se posait déjà comme
problème depuis le lancement de l'Ecole de l'agriculture vivante...
« Quant à l'Ecole de l'agriculture vivante,
nous voulions que l'on vise uniquement les personnes des foyers agricoles. Mais
la Municipalité nous a dit 'Ne dites-pas comme ça, c'est mieux de
faire avec le public'. Pourtant, ce n'est pas la peine d'avoir quarante
personnes, mais seulement dix suffiront. Et on fera la formation
face-à-face avec chacun. Mais on ne peut pas s'occuper de vingt
personnes en même temps. (...) C'est finalement pour continuer la
formation à long terme, que je pense comme ça (...) Il faut
continuer le Projet, mais la finalité doit être claire.
»
Mode d'actions
D'abord, le mode d'actions de la CAT est, comme les deux
agents précédents analysés plus haut, marqué par
son côté « bricoleur », c'est-à-dire son mode
d'actions flexible et spontané qui mobilise les éléments
humains, matériels et même symboliques dans sa dimension
territoriale. Comme nous l'avons constaté dans les expériences de
Monsieur S, pour le « Marché du mardi soir » au sein de la
Coopérative de Matsudaira, ainsi que dans sa proposition de «
Second Life Academy » qui a anticipé et inspiré le fondement
des idées non seulement du Plan de 96 (dirigé par le BPA), mais
également celui du rapport de propositions remis au maire en 2001 par le
CPCI. Et ce mode d'action que l'on peut qualifier de celui de bricoleur est
basé sur son ancrage territorial et
504 Jusqu'à l'année 2006-2007, il y a environ 150
anciens et nouveaux stagiaires, au total.
social qui est lié à l'organisation de la CAT. En
plus, comme nous l'avons constaté dans le cas de Monsieur S, cet ancrage
territorial est également lié au niveau de sa propre
trajectoire505.
Toutfois, cette caractéristique de l'agent en tant que
bricoleur de la CAT ne doit pas, comme c'était le cas chez les agents
publics que l'on a analysés précédemment, être
considérée comme étant séparée de la logique
institutionnelle de la coopérative agricole. Au contraire, les actions
de la CAT obéissent plutôt au principe du secteur agricole
intégré dans l'économie marchande. Cette logique se
distingue de celle du secteur des services publics qui suit, en principe, la
logique de la politique de redistribution.
L'explication suivante de Monsieur S « le domaine de
la vente constitue le visage de la Coopérative. (...) C'est de là
que l'argent vient pour les membres », met bien en évidence le
principe marchand des activités de la coopérative agricole. De ce
fait, le domaine de l'orientation agricole où est placé la
coopération de la CAT dans le Projet Nô-Life, est
considéré comme un domaine « non productif » et
secondaire par rapport au domaine de la vente. D'où une réticence
pour s'engager et s'investir davantage dans le Projet Nô-Life.
En raison de ce caractère marchand, la CAT
s'intéresse moins au « mérite » dans le sens symbolique
que la Municipalité cherche souvent à obtenir, mais plus au
profit concret et matériel reconnaissable du point de vue
économique. D'ailleurs, pour elle, c'est ce côté concret et
matériel qui « mérite » d'être reconnu. De ce
fait, la CAT a tendance à chercher en priorité à obtenir
son propre profit concret et matériel506. D'où un
décalage par rapport à l'intérêt « altruiste
» de la Municipalité de Toyota qui travaille d'abord « au
service de tous » et qui doit chercher la reconnaissance pour le fait
qu'elle travaille effectivement pour cette finalité. Et ce principe, en
fait, n'exclut ou ne doit pas exclure pour autant le fait de travailler «
avec » et même « pour » le profit des autres agents
privés507 à la différence de la
coopérative agricole qui a tendance à poursuivre uniquement son
propre profit. Cependant, il ne faut pas non plus qu'elle serve exclusivement
le seul profit de la coopérative agricole, ce qui risque d'aller
à l'encontre de l'intérêt public. Ceci constitue un dilemme
pour la Municipalité de Toyota dans la conduite du Projet Nô-Life,
tant que la CAT reste dans son propre principe sectoriel, même dans le
cadre de sa coopération avec la Municipalité de Toyota. Et la
CAT, de son côté, en poursuivant toujours exclusivement sa propre
logique d'actions, a moins de dilemme de ce type, auquel l'autre est
confrontée. D'où une relation d'intérêts
décalés...
Monsieur K, président du Centre Nô-Life, nous a
bien suggéré, de manière quelque peu ironique, ce
caractère exclusiviste de la CAT en expliquant à
l'enquêteur le caractère général du comportement de
la coopérative agricole comme ci-dessous :
« Quand on fait un appel quelconque à la
Coopérative, s'ils disent 'non' à notre demande, l'histoire est
finie pour nous. D'ailleurs, c'est plus facile de dire 'non' que dire 'oui'
pour eux, n'est-ce pas ? »
Cette exclusivité qui fait une des
caractéristiques du mode d'actions de la coopérative agricole,
constitue une cause du manque d'intersectorialité dans ses actes de
coopération avec la Municipalité de Toyota. Monsieur A,
président du « Toyota Young Old Support Center », nous a
expliqué cet aspect en relevant comme ci-dessous l'insuffisance de la
prise de consciense de la part de la coopérative agricole pour la
thématique de l'aménagement de la ville.
« Si la Coopérative avait un point de vue de
l'aménagement de la ville dans ses actions... (...) Maintenant, ce n'est
que le côté des producteurs et du développement agricole.
Mais si on partage ce point de vue de l'aménagement de la ville, on
pourrait développer plus de choses... »
505 Sans doute c'est le cas chez beaucoup d'employés dans
les unités locales des Coopératives agricoles au Japon. En effet,
des fils d'agriculeteurs sont souvent employé dans la Coopérative
de la même localité. Ce qui sembe être une des
caractéristiques des branches locales des Coopératives
agricoles.
506 Le profit pour la CAT est d'ailleurs censé, au nom du
principe de la coopérative, représenter le profit de tous ses
membres.
507 Le Projet Nô-Life s'inscrit dans la logique du «
Partenariat » entres les acteurs pubics et privés.
Prise de position vis-à-vis du Projet Nô-Life
Le caractère exclusiviste et sectoriel des actions de
la CAT rend partielle et même réticente sa coopération avec
la Municipalité pour le Projet Nô-Life. Cette position de la CAT
implique et conserve inévitablement la divergence
d'intérêts entre les secteurs privé et public entre la
Municipalité, l'écart de points de vue et enfin
l'ambiguïté de la vision centrale du Projet Nô-Life.
Ce désaccord implicite derrière la relation
officielle de coopération entre la CAT et la Municipalité,
constitue une source d'incertitude et de fragilisation du Projet Nô-Life
avec une série de problèmes concrets auxquels le Centre
Nô-Life est confronté508. Ce qui risque de
déranger non seulement les agents gestionnaires du Projet Nô-Life,
mais encore plus les stagiaires du Projet Nô-Life. Nous aborderons ce
problème touchant les stagiaires dans le chapitre suivant.
Acteur 4 : Bureau Départemental de la Politique
Agricole (BDPA)
Caractère général de l'acteur
Le Bureau Départemental de la Politique Agricole (BDPA)
est le bureau administratif délégué du Bureau
Départemental de l'Agriculture, de la Forêt et de la Pêche
de Toyota-Kamo509.
Il a notamment coopéré avec la
Municipalité de Toyota pour le Projet Nô-Life depuis la fin 2002
où la procédure de la réalisation concrète du
Projet Nô-Life fut amorcée en concertation avec divers acteurs
institutionnels sous le nom provisoire du Centre Nô-Life : « Centre
pour le soutien aux activités agricoles (Einô Shien Center)
». Dans cette procédure, il contribua notamment à la
préparation du Plan de la Zone spéciale au cours de
l'année 2003-2004, la dernière étape avant l'inauguration
du Centre Nô-Life au printemps 2004.
Domaines de compétences
D'après la brève explication de Monsieur M,
responsable actuel du Projet Nô-Life, les domaines de compétences
du BDPA sont les suivants :
- Tâches administratives relatives à la Loi agraire
(Nôchi-hô) ainsi qu'à la Loi relative à
l'Aménagement des Zones réservées pour le
développement agricole (Nôgyô Shinkô Chiiki no Seibi
ni Kansuru Hôritsu)
- Travaux publics agricoles dirigés par les
municipalités et par la coopérative agricole
- Aides directes pour les Zones de montagne
- Développement des cultures spéciales (thé,
fleurs, fruits, pêche, élevages etc)
- Orientation de l'information des produits alimentaires
(étiquetage, traçabilité etc)
Le BDPA partage les domaines de compétences relatifs
à l'agriculture et à la ruralité avec l'ECV (acteur 5)
508 Nous pouvons évoquer trois problèmes
suivants : non intention de la Coopérative d'envoyer plus
d'employés pour le Centre Nô-Life, malgré le
problème d'un manque d'employés posé au Centre
Nô-Life notamment suite à la construction de deux centres
Nô-Life supplémentaires dans le territoire de la Ville de Toyota
en 2006 ; peu de faisabilité de l'objectif d'un million de yens du
revenu agricole pour la plupart de stagiaires ; Opposition de la
Coopérative à l'élargissement du Centre Nô-Life de
2006. Nous les aborderons dans le Chapitre 3.
509 Son territoire de compétence s'étend au
territoire de la Ville de Toyota (y compris les collectivités
fuisionnées en 2005) ainsi qu'à celui de la Ville de Miyoshi,
ville vosine de Toyota située à l'ouest de celle-ci.
au sein du Bureau Départemental de l'Agriculture, de la
Forêt et de la Pêche de Toyota-Kamo. Le BDPA est chargé de
l'administration tandis que l'ECV est chargé de l'orientation technique
et économique des producteurs agricoles.
Si l'ECV travaille souvent de manière
face-à-face avec les producteurs sur le terrain, le BDPA n'a pas ce
rapport direct et individuel avec les producteurs et travaille « toujours
à l'intérieur du bureau » (d'après Monsieur M).
Thématiques récentes
La thématique qui était la plus importante pour
le BDPA était justement, jusqu'en 2005, la préparation du dossier
de candidature pour l'application de la politique nationale de la Zone
spéciale à la Ville de Toyota510. Cette candidature
fut posée suite à la coopération entre la
Municipalité de Toyota et la Préfecture d'Aichi. Monsier M a
coopéré avec le BPA pour l'élaboration de ce dossier de
candidature (nous avons analysé le contenu de ce dossier dans la partie
de l'acteur 1) en jouant le rôle de l'intermédiaire entre la
Municipalité de Toyota et le gouvernement japonais.
La thématique actuellement la plus importante pour le
BDPA est la politique des « porteurs » de l'agriculture de la
région Toyota-Kamo, notamment avec le système de l' «
agriculteur qualifié (nintei nôgyôsha)511 »
Cette politique pour la modernisation agricole constitue actuellement une des
thématiques « plus urgentes » pour le BDPA.
Partenaires principaux
Les partenaires institutionnels du BDPA sont les suivants : la
Municipalité de Toyota (le bureau du BDPA se trouve à
côté du bâtiment de la Municipalité) ; la CAT (CAT).
Et comme expliqué plus haut, le BDPA et l'ECV se partagent
respectivement les tâches administratives et
technico-économiques.
Le BDPA intervient dans l'élaboration des Plans
fondamentaux de l'Agriculture de la Ville de Toyota512. Le BDPA
donne ses avis à la Municipalité de Toyota en sorte que les plans
de celle-ci soient convergents avec les plans départementaux
concernés. Puis, il effectue également l'évaluation de
l'état d'avancement des projets municipaux.
La position du BDPA est marquée par un lien fort avec
les structures administratives supérieures dont notamment le
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de la Forêt. Sa
mission principale consiste donc à exercer les tâches
administratives attribuées par l'Etat, vis-à-vis des organismes
locaux concernés tels que les municipalités et les
coopératives agricoles.
C'est pourquoi le BDPA a très peu de relations directes
avec la population locale dans sa mission. Ce qui le différencie de la
municipalité ainsi que de la coopérative agricole qui travaillent
plutôt au service de la population locale (les « membres » pour
la coopérative agricole). C'est pourquoi le travail de Monsieur M se
déroule toujours à l'intérieur de son bureau, comme
évoqué plus haut.
Relation avec le Projet Nô -Life
Après 2005, le BDPA n'a plus d'implication
régulière dans le Projet Nô-Life, à la
différence de l'ECV qui participe aux activités de la formation
Nô-Life dans le cadre de l'orientation technique et économique des
producteurs.
Il assume une tutelle administrative a posteriori de la
Municipalité qui « peut venir en aide en cas de problème
», d'après Monsieur M. Il n'intervient donc pas dans
l'élaboration des activités du Centre Nô-Life.
510 En effet, en 2005, les déréglementations
appliquées par le programme de la Zone spéciale de Toyota furent
généralisées dans toutes les collectivités
territoriales au Japon. Dès lors, la qualification de la Ville de Toyota
pour la Zone spéciale fut annulée.
511 Pour l'analyse du contenu de cette politique, voir la partie
de l'Acteur 5.
512 L'élaboration du deuxième plan
décénal pour les années 2006-2015 est actuellement en
cours (en 2006).
Par ailleurs, le BDPA examine la synthèse annuelle des
activités du Centre Nô-Life notamment en terme financier afin de
la présenter au sein du Conseil général
(départemental).
Caractère général des données
Notre analyse du BDPA se base sur l'entretien effectué
par l'enquêteur (rédacteur) avec Monsieur M, vice-chef du Bureau
Départemental de la Politique Agricole et responsable actuel (en 2006)
des affaires administratives concernant le Projet Nô-Life. Il nous a
accueilli dans son bureau pour répondre à nos questions pendant
près de deux heures.
Représentations
Le BDPA est un agent administratif qui exerce ses fonctions
juridiquement déterminées, et dont les actions sont fortement
régies par les structures supérieures comme la préfecture
et le Ministère de l'agriculture, de la Pêche et de la
Forêt. C'est pourquoi il ne doit pas normalement avoir un point de vue
particulier ni une position particulière.
Cependant, lorsque le BDPA s'implique dans le Projet
Nô-Life, qui est un nouveau type de politique publique locale
inspirée par de nouvelles idées, de quelle façon saisit-il
la situation et le problème de l'agriculture de la région de
Toyota et le Projet Nô-Life ? A-t-il un point de vue particulier sur le
Projet, basé sur son propre intérêt et sa propre position
?
Son point de vue particulier : calcul économique et
foncier
Telles étaient nos interrogations de base pour mener
notre entretien avec Monsier M. Pour répondre à nos questions,
Monsieur M, lui-même surpris de la visite de l'enquêteur
(rédacteur) qui lui était quelque chose d'inhabituelle, s'est
interrogé sur la pertinence du fait que ce soit lui qui soit choisi pour
répondre aux questions de l'enquêteur. Ce qui fait
déjà un grand contraste avec les employés de la
municipalité qui ont l'habitude de prendre contact et de recevoir le
public513.
En évoquant la complexité pour mesurer
l'efficacité des mesures de la politique agricole en disant «
l'agriculture est un domaine tellement grand » (une phrase que
Monsieur M a répété plusieurs fois lors de l'entretien),
il nous confirme qu'il ne peut nous parler que de « calculs
économiques ». Ceci suggère déjà un
caractère délibérément objectiviste de son point de
vue. Il pense le problème agricole et rural et le Projet Nô-Life
notamment en relation avec les conditions générées par le
montant de la taxe sur les biens fonciers (kotei-shisan zei) sur les terrains
agricoles concernés.
Il nous a d'abord expliqué les points qui
l'intéressaient lorsqu'il a participé, en septembre 2006, au
« contrôle du stage individuel (jisshû hantei) » des
stagiaires des années 2005-2007 de la filière rizicole, en tant
que l'un des contrôleurs514.
513 Monsieur M : « Donc, le point clé, ce que
vous voulez savoir le plus, vous vous focalisez sur le travail de
l'administration départementale dans le domaine de la politique agricole
pour cette nouvelle activité sociale de personnes âgées...
(Projet Nô -Life) L'essentiel pour les domaines administratifs comme la
politique agricole, est de mener une politique ayant un effet net ou pas...
Euh, il s'agirait du détail, je risque de me tromper... En fait,
l'agriculture est un domaine tellement grand que je risque de ne pas pouvoir
vous répondre exactement. (...) Ce que je peux vous répondre, ce
n'est que des calculs économiques, en fait. Par exemple, 'combien
coûte le coût de production agricole avec tel ou tel bien foncier
loué, avec tels ou tels membres de la famille ?' etc... »
514 Le contrôle du stage individuel s'effectue à
la fin du programme de la formation Nô-Life. Il s'agissait
d'évaluer les pratiques agricoles que chaque stagiaire mène sur
son terrain. Le stage individuel s'effectue, soit dans leur propre terrain
agricole (dans le cas des stagiaires déjà possédants ou
locataires de terrains agricoles), soit dans une parcelle attribuée par
le Centre Nô-Life (dans le cas des stagiaires qui n'ont pas de terrains
à leur disposition ou qui ont voulu utiliser une parcelle du Centre
Nô-Life). Voir la
En nous montrant le rapport officiel sur les trois stagiaires
qu'il avait contrôlé, il nous a expliqué les
éléments qu'il avait essayé de repérer chez les
stagiaires lors du contrôle : profils (sexe, âge, parcours
professionnel etc) ; objectif de chaque stagiaire pour leurs activités
agricoles ; évaluation des valeurs et taxes foncières des
terrains agricoles concernés ; rapport entre le coût et le profit
pour la production concernée ; rapport avec le coût de la vie
etc.
Il a d'abord établi un constat commun sur ces trois
personnes : il leur est impossible de gagner leur vie avec leur seule
activité agricole, tandis que cette activité leur permet de
« bien vivre (ikiiki) » en leur donnant un «
deuxième emploi (daini no shûshoku) » et que leur
motivation pour la production agricole est très haute.
Par contre, il relève une difficulté pour
évaluer chacun des stagiaires, car chacun a son propre objectif
différent de celui des autres. Voici un bilan résumé de la
situation de ces trois stagiaires.
1 Salarié retraité ayant 0.3 ha de terrains
agricoles. Il souhaite plus tard élargir l'échelle de sa
production jusqu'à 1 ha
2 Salarié de l'âge mur, d'un foyer agricole
pluriactif. Il cultive 0.2ha de terrains rizicoles qui lui appartiennent.
3 Salarié retraité ayant plus de 0.5 hectares de
terrains agricoles dont une partie est mise en location sous forme
d'appartements. Il mène sa production agricole sur ses terrains pour
gérer ses biens immobiliers en tenant compte du montant de la taxe
foncière qui s'impose sur ces biens.
Ces trois stagiaires avaient d'abord un point commun : ils
sont tous chefs d'un foyer agricole pluriactif. Et le premier stagiaire
retraité souhaite agrandir sa production en louant davantage de terrains
; le deuxième, actuellement salarié, cultive son terrain, dont il
a hérité, pour lui-même et sa famille ; le troisième
cultive son terrain pour la gestion économique de ses biens fonciers.
Dans le cas du troisième stagiaire, en raison de la localisation d'une
grande partie de ses terrains agricoles 0.25ha au bord de la « zone
à urbaniser », il est confronté au problème de
l'élevation de la taxe foncière. Si à l'avenir ses
terrains seront intégrés dans la zone à urbaniser, la taxe
foncière appliquée à ces terrains va radicalement
s'élever. C'est pour cela qu'il choisit de maintenir des
activités agricoles sur ces terrains (au lieu de les laisser en friche)
pour garder le statut agricole de ces terrains.
Monsieur M constate que la succession familiale des terrains
agricoles préoccupe beaucoup les producteurs agricoles en terme de
gestion des biens immobiliers. Ce à quoi il accorde le plus d'importance
en tant qu'enjeu de la conservation des terrains agricoles.
Rapport avec le thème majeur de la Ville de Toyota :
la relation urbain - rural
L'aspect foncier marque fortement la vision exprimée
par Monsieur M, en tant qu'agent de l'administration agricole du
département. L'enquêteur lui a posé une question sur la
relation du BDPA avec la politique de la Municipalité de Toyota
marquée par son nouveau « Règlement fondamental sur
l'Aménagement de la Ville (machizukuri kihon jôrei) » (voir
la partie de l'acteur 2) adopté suite à la grande fusion avec six
collectivités rurales en 2005, qui prône l'idée de la
« ville où vivent ensemble la ville et les campagnes rurales et
montagnardes (toshi to nôsanson no kyôsei) ». Monsieur M a
alors relevé un problème fondamental de la structure
foncière de l'agriculture dans le territoire de la Ville de Toyota. Cela
tout en affirmant que le BDPA s'implique dans ce thème majeur de la
Municipalité de Toyota dans le cadre de sa mission
départementale, et que le Projet Nô-Life constitue
également une thématique importante dans ce thème.
Problème fondamental 1 : structure foncière
urbain-rural de Toyota « visible d'un seul coup d'oeil (hitome de wakaru)
»
En nous montrant une carte de la Ville de Toyota, il nous a
expliqué un problème fondamental qui est « visible d'un
seul coup d'oeil (hitome de wakaru) » selon lui du point de vue
foncier, sur l'agriculture dans le
présentation générale des activités
de formation Nô-Life dans le chapitre suivant.
territoire de la Ville de Toyota.
Inégalité de la valeur foncière des terrains
agricoles
D'après lui, la structure foncière du territoire
de la Ville de Toyota après la fusion de 2005, se divise en trois zones
géographiques : plaine de la rive droite du fleuve Yahagi (zone 1) ;
plaine de la rive gauche du fleuve Yahagi jusqu'au bord de la zone de moyenne
montagne (zone 2) ; zone de moyenne montagne (zone 3).
Puis, il nous a fait remarquer une inégalité
nette de la valeur foncière des terrains agricoles entre ces trois
zones. Dans la zone 1, la valeur foncière des terrains agricoles est
environ de 3000 yens à 4000 yens par \u13217§ soit environ 3 - 4
millions de yens pour 10 ares. Dans la zone 2, elle est environ 900 à
1000 yens par \u13217§, soit environ 1 millions de yens pour 10 ares, et
dans la zone 3, environ 200 yens par \u13217§, soit environ 200 000 yens
pour 10 ares. Et le montant de la taxe foncière sur ces terrains
agricoles est de 0.014% de leur valeur foncière.
Tableau : chiffres approximatifs sur les valeur et taxe
fonciers des terrains agricoles
|
VF (par \u13217§)
|
VF (pour 10ares)
|
Taxe (\u13217§)
|
Taxe (pour 10ares)
|
|
Zone 1
|
3000 - 4000
|
3 - 4 millions
|
42 - 56
|
42 000 - 56 000
|
|
Zone 2
|
900 - 1000
|
90 0000 - 1 million
|
12.6 - 14
|
12 600 - 14 000
|
|
Zone 3
|
200
|
200 000
|
2.8
|
2800
|
Unité monétaire : yen (150-160 yens soit 1euro) Ces
chiffres sont calculés par l'enquêteur.
En moyenne montagne, dépeuplement et vieillissement
Puis, s'ajoute à une telle inégalité des
valeurs foncières, un mécanisme du dépeuplement et du
vieillissement de la population rurale, comme Monsieur M l'explique ci-dessous
:
« Voici les trois différentes zones. Et dans
la zone de moyenne montagne, imaginez que vous avez une famille où les
parents ont un enfant qui est susceptible de reprendre leur métier de
l'agriculture. Et si cet enfant est employé dans le secteur automobile
et peut gagner plus que le revenu de ses parents qui habitent dans la montagne,
il s'installera en ville. Car il pourra ainsi avoir un niveau de vie plus
élevé. Et dans la montagne, il n'y a plus de porteurs. D
'où l'avancement du vieillissement et du dépeuplement.
»
En plus du mécanisme de l'émigration rurale tel
qu'il est expliqué ci-dessus, on peut ajouter qu'en plaine, sur le prix
de vente du riz pour 10 ares (environ 10 5000 - 12 0000 yens515), le
montant de la taxe équivaut à la moitié de ce prix ! Dans
la zone de moyenne montagne, malgré le faible taux de la taxe
foncière imposée, la quantité des récoltes et la
surface de terrains sont réduites par rapport à la plaine. Et si,
en plus, on tient compte du coût de production, on constate qu'il est
effectivement « impossible de gagner sa vie » avec la seule
production rizicole.
En plaine, pression foncière urbaine
Puis, Monsieur M explique que le problème se pose
également dans les foyers agricoles situés en plaine
confrontés à une forte pression foncière urbaine.
« (...) Et par cette zone intermédiaire
située entre la ville et les zones rurales, dont la valeur
foncière peut s'élèver jusqu'à 10 millions de yens
pour 10 ares, si les frères ou soeurs veulent partager les biens de la
famille pour les vendre, le repreneur n'a qu'à l'accepter...
»
515 Le prix de vente du riz est environ 15000 yens pour 60 kg
(1pyô) au Japon. Nous pouvons récolter environ 420 kg - 480kg (7-8
pyô) de riz pour 10 ares.
Cette explication indique le dilemme des foyers agricoles face
à l'antinomie des logiques de l'économie patrimoniale et de celle
du marché. Et ceci implique le risque du morcellement parcellaire et
ainsi la fragilisation de la structure d'exploitation agricole. Puis, on peut
ajouter que c'est en plaine que les conditions géographiques sont
généralement favorables pour la modernisation agricole
(mécanisation et remembrement), alors que les agriculteurs y sont
confrontés à la pression foncière de l'urbanisation plus
forte que dans la zone de moyenne montagne. Par contre, dans la zone de moyenne
montagne, même si la pression de la taxe foncière est beaucoup
moins importante qu'en plaine, cette zone est marquée par des conditions
géographiques défaborables à la modernisation et la main
d'oeuvre agricole affablie par le vieillissement et le dépeuplement.
Système de l'exonération de l'impôt foncier :
seul moyen pour la conservation agricole
En tenant compte de ces problèmes liés à
la structure foncière, Monsieur M met l'accent sur l'importance de
l'utilisation du système de l'exonération de l'impôt sur
les terrains agricoles pour la conservation des terrains agricoles. En effet,
en observant les stagiaires de Nô-Life, il avait constaté que ce
problème de la gestion foncière constitue pour eux l'une des plus
importantes préoccupations. Ce système de l'exonération de
l'impôt foncier permet aux agriculteurs, qui continuent leur
activité agricole en héritant les terrains de leur famille via
donation entre vifs, d'être dispensés de payer les droits de
succession. Cela constitue ainsi le seul moyen pour permettre la conservation
des terrains agricoles par les agriculteurs. Sinon, d'après Monsieur M,
« la taxe va tout prendre » chez les agriculteurs. Mais
l'utilisation de ce système devient de plus en plus rare au sein des
foyers agricoles, face au dilemme au sein du foyer agricole entre les logiques
patrimoniale et marchandes. D'ailleurs, quand on applique ce système, le
contrôle administratif de l'utilisation des terrains agricoles devient
beaucoup plus strict pour le successeur afin qu'il continue effectivement de
mener par lui-même une activité agricole sur ses terrains.
Contradiction entre la politique agricole nationale et la vie
« réelle » des foyers agricoles
Ensuite, Monsieur M a continué à nous expliquer
la grande contradiction entre ce dilemme imposé aux foyers agricoles
pluriactifs et la politique agricole de l'Etat sur les « porteurs »
qui recherche toujours l'agrandissement d'échelle de production.
Monsieur M l'explique comme ci-dessous :
« Pourtant, la politique nationale d'aujourd'hui qui
essaie de concentrer les terrains par les porteurs, entre en contradiction avec
ce mécanisme foncier. Il y a un grand problème entre la vie
réelle des agriculteurs et la politique agricole de l'Etat qui veut
toujours former des exploitations de grande échelle. C'est ça, le
point pénible de la politique agricole. Dans la zone de moyenne
montagne, même si on reçoit des aides directes, comment un porteur
peut-il gérer un hectare de terrain avec une main d'oeuvre affaiblie par
le vieillissement ? Franchement parlant, il n 'y a pas de solutions C'est
pourquoi dans la mesure où la base de l'agriculture reste avant tout
quelque chose de social. Même si les agriculteurs font des efforts, cette
base est limitée. C'est pourquoi même si la ville souhaite
développer l'agriculture, il n'est même pas possible de concevoir
une perspective, dans une telle réalité... »
Cela souligne la contradiction fondamentale entre la situation
des foyers agricoles pluriactifs et et l'orientation de la politique agricole
nationale visant la concentration des terrains entre les mains d'un petit
nombre de « porteurs » sélectionnés (souvent sous forme
d'entreprises agricoles soutenues par la coopérative agricole) avec des
« opérateurs » qui disposent des grandes machines
agricoles516.
En faisant ce constat de la réalité objective de
l'économie agraire, Monsieur M explique les éléments
objectifs de la crise agricole et rurale qui fondent les thématiques du
Projet Nô-Life, sous un regard objectiviste
516 Sur l'orientation de la politique agricole nationale, voir la
partie de l'acteur 5. Nous avons également vu dans le chapitre 1
l'évolution de cette politique dans les années 65-75 avec les
entreprises agricoles à grande échelle chargées des
travaux rizicoles des autres foyers agricoles pluriactifs dans la zone du
sud.
et plus distancié que les autres vis-à-vis de la
situation (« il n'est même pas possible de concevoir une
perspective, dans une telle réalité »).
Place du Projet Nô -L ife
Face à un tel constat de la crise fondamentale de
l'agriculture et de la ruralité, quelle est la place du Projet
Nô-Life dans la politique agricole, du point de vue du BDPA ? Quelles
valeurs sont accordées au Projet ? Les réponses de Monsieur M
restent bien objectivistes et justificatrices du Projet du point de vue «
administratif (gyôsei-teki) » et « social (shakai-teki) »,
ce qui reflète sa position toujours basée sur le principe de
l'intérêt public (ou bien-être public : kokyô no
hukushi)
Valeurs du Projet Nô-Life
Le thème majeur du Projet Nô-Life est «
la réduction et la prévention des friches agricoles
(yûkyû-nôchi no kaishô) ». Il y a environ
700ha de friches agricoles dans le territoire de la Ville de Toyota sur
10120.3ha de la zone réservée pour le développement
agricole qui occupe un tiers de la surface totale de la Ville de Toyota
(29012ha)517. Et Monsieur M confirme que « le plus grand
fruit » du Projet Nô-Life serait le fait que les stagiaires du
Projet Nô-Life mènent leur activité agricole sur ces
friches, et que « les retraités prennent plaisir à leur
activité agricole et rurale ». Cela veut dire que ces deux
demandes de pair, constituent un consensus public sur le Projet
Nô-Life.
Place accordée à l'Agriculture de type Ikigai :
terrains échappant à la politique de la modernisation agricole
Quelle relation est-elle établie entre l'agriculture de
type Ikigai et la politique agricole de porteurs ? Monsieur M nous a
expliqué que ces terrains faisant environ 700ha constituent les terrains
qu'il est impossible de concentrer par les grandes exploitations agricoles ou
les opérateurs de la coopérative agricole,
considérés comme « porteurs » de l'agriculture de type
industriel, qui cultivent le riz, le soja et les céréales en
rotation à grande échelle. Ces 700ha de terrains sont «
ceux qui échappent » à la politique agricole de
porteurs à grande échelle et également « ceux qui
sont abondonnés par leurs propriétaires ». Et le maire
de Toyota promeut le Projet Nô-Life, parce que « laisser
abondonner ces friches peut constituer un problème social
».
L'importance de cet enjeu de la conservation des terrains
agricoles par les petits producteurs est « une mission du Bureau de la
Politique Agricole et une tâche de la Loi agraire ». Ici, il
faut noter que l'urbanisation, d'après Monsieur M, n'est pas non plus
exclue de la future utilisation de ces terrains, bien au contraire, elle
constitue l' « objectif ultime » dans la vision normative de
l'administration... Toutefois, dans la mesure où l'agriculture de Toyota
est constituée d'« un secteur industriel » avec un
chiffre d'affaires important (près d'un milliard de yens soit environ 6
666 666.6 euros, d'après Monsieur M), « la prévention
des friches agricoles constitue un thème de la
société ».
Quels sont les problèmes rencontrés dans le
Projet Nô-Life ?
Monsieur M confirme d'abord qu' « il n'y a pas de
problème » dans le Projet. Ce qui veut dire que le Projet se
déroule comme « un projet avec un budget (yosan
jigyô) » et qu'il fonctionne comme « le maire le
pensait »
517 Ce chiffre est celui d'avant la fusion de 2005. Après
la fusion de 2005, la surface total de la Villle de Toyota a triplé : 91
847ha. Mais nous n'avons pas pu obtenir les données sur le territoire
élargi, concernant la zone réservée pour le
développement agricole ni celles concernant les friches. En 2000, dans
le terriotoire de la Ville de Toyota, il y a 354ha des terrains en friche,
341ha des terrains mis en jachère. Si on se base sur la « surface
agricole utilisée (nôyôchi) » dans la « zone
réservée pour le développement agricole (nôgyô
shinkô chiiki) », la surface totale des terrains agricoles sont
5113.4 ha en 2003. Cependant, il faudrait estimer un peu plus pour compter plus
réellement la surface agricole, car ce chiffre ne contient pas la
surface agricole située hors cette zone, à savoir : la zone
à l'urbanisation contrôlée qui n'appartient pas à la
zone réservée pour le développement agrciole, et la zone
à urbaniser. Ainsi, il n'est pas facile de repérer la surface
agricole réelle dans les statistiques officielles...
en répondant à « une demande stable de la
part des stagiaires ». Donc, c'est administrativement qu' «
il n'y a pas de problème » dans le Projet.
Par contre, Monsieur M a évoqué la
difficulté d' « analyser les facteurs de la
réussite » de ce projet. Les facteurs de la réussite du
Projet Nô-Life sont d'abord « le cycle où les stagiaires
apprennnent bien (l'agriculture) et obtiennent leur terrain agricole pour
prévenir les friches, et deviennent ainsi porteurs de l'agriculture en y
prennant plaisir ». Et ce thème prôné par le
maire « a bien réussi à avoir le droit de cité
(shimin ken) ». Cependant, il est « difficile d'expliquer
ses résultats et effets (seika) », compte tenu du
problème de la structure foncière « visible d'un coup
d'oeil » que l'on a constaté plus haut.
Les facteurs d'Ikigai ? : « Ce qu'ils n'ont pas socialement,
c'est Ikigai »
Quels sont les facteurs d'Ikigai pour Monsieur M ? Un des
objectifs du Projet Nô-Life d'avoir un million de yens de revenu agricole
constitue-t-il un de ces facteurs déterminant ? Ou y en a-t-il d'autres
? D'abord, le fait d'aboir un revenu avec des activités agricoles
constitue « un point de départ qu'il ne faut pas oublier
», et que « le revenu constitue la base de vie ».
Toutefois, ce n'est pas défini comme un « objectif de
l'administration ».
En fait, la question de revenu est « vraiement
difficile à cerner » pour Monsieur M, et il « ne voit
pas la direction » quand il analyse, dans le cadre de son travail,
les différents types des revenus agricoles tels que le salaire agricole,
la vente des produits, le chiffre d'affaires etc., qui sont différemment
définis en fonction des types d'organisation agricole tels que
coopératives, entreprises, exploitations familiales, individus etc.
Malgré tout, chez Monsieur M, la thématique
d'Ikigai est indispensable dans le Projet, étant avant tout une «
motivation de la part du maire, qu'il ne faut pas ignorer ».
Voici son explication :
« Non, non. Une des motivations du maire pour le
Projet Nô-Life est le 'Nô-Life pour Ikigai'. Comme le montre
l'enquête que le Syndicat ouvrier de Toyota avait effectuée, il y
aura 2000-3000 retraités chaque année. Ils pourront mener leur
vie avec leur pension. Donc ce qu'ils n'ont pas socialement, c'est Ikigai.
Mener une production agricole dans la société, établit une
relation avec la société, et ainsi permet d'avoir un Ikigai.
»
Donc, l'idée d'Ikigai dans le Projet Nô-Life est
avant tout d'avoir « une relation avec la société
» via des activités agricoles. Puis, le Projet Nô-Life tente
de lier l'idée d'Ikigai à la réalité sociale locale
où « les propriétaires ruraux sont
embarrassés » par le problème de leur friche agricole.
Car l'absence d'activité agricole sur ces terrains définis comme
« agricoles » fera disparaître l'exonération de
l'impôt foncier (taxe de succession) dont bénéficient les
propriétaires qui en ont hérités. Donc, si ces
propriétaires peuvent louer leurs terrains aux particuliers qui
mènent une production agricole sur ces terrains, cela «
constituera réellement une prévention positive »
selon Monsieur M. Cela constitue non seulement un « mérite pour
l'administration » mais également un « mérite
social » dans le sens où cela donne Ikigai pour les
retraités, « cela enrichit leur vie ».
Donc, l'essentiel de la vision officielle du Projet
Nô-Life n'est pas économique. Et vu la réponse que Monsieur
M nous a donnée sur la question de l'objectif de dégager un
million de yens de revenu agricole, la pertinence de cet objectif
dépendra, finalement, des réponses de chacun des stagiaires.
Problème fondamental 2 : difficulté de la
production agricole « c'est comme si on traitait un malade qui est dans un
stade irrémédiable »
Monsieur M a de nouveau relevé un problème
fondamental de l'agriculture lorsque l'enquêteur lui a posé la
question sur les conséquences escomptées du Projet Nô-Life
vis-à-vis des localités (ou sociétés locales :
chiiki shakai) de la Ville de Toyota. Cette fois-ci, il a exprimé son
point de vue économique en commençant par l'interrogation
suivante : « Pourquoi, aujourd'hui, la production agricole
connaît-elle une telle difficulté, alors qu'elle était
autrefois une activité communautaire au sein de la population ?
»
Monsieur M attribue la cause des difficultés pour la
production agricole au système étatique du contrôle
alimentaire, où l'Etat soutenait le marché du
riz, un système où l'Etat « payait cher et vendait pas
cher »518. Et la nouvelle loi alimentaire entrée en
vigueur en 1994 est venue bouleverser ce système du soutien national au
marché du riz qui fonctionnait par l'intermédiaire de la
coopérative agricole. Citons l'explication de Monsieur M :
« On gérait le prix en amont avec le
financement de l'Etat. Et si on bouleverse le taux de prix entre l'amont et
l'aval, ce qui fait que le prix versé aux producteurs est moins
élevé que le prix à la distribution, du coup, les
agriculteurs produisent moins. Et ils commencent à vouloir vendre leurs
produits par eux-même. La distribution devient ainsi moins
réglée. Donc, le point de départ était que le
marché du riz était soutenu par l'Etat, ce qui venait
compléter le revenu des agriculteurs. Et maintenant, on essaie de les
faire produire et vendre librement. Du coup, c'est la Coopérative
agricole qui est obligée de gérer la distribution par
elle-même. Mais cela ne peut pas marcher... L'Etat n'a plus de
financement maintenant. C'est pour cela que l'agriculture est tragique. Puis,
dans un tel contexte, l'administration vient en aide pour combler cette absence
des aides du gouvernement qui étaient mises en place auparavant. C'est
l'état actuel de l'administration qui est douloureux. Franchement dit,
c'est comme si on traitait un malade qui est dans un stade
irrémédiable... »
Il s'agit du contexte de la libéralisation du
marché du riz au Japon via la déréglementation de la
distribution, l'abolition du principe de l'intervention étatique avant
l'entrée des produits dans le marché, et la priorité
donnée au principe du marché. Monsieur M continue son explication
en abordant le problème de la surproduction que cette politique a
provoqué.
« (...) La conséquence du soutien national au
marché du riz ne concerne pas seulement les agriculteurs individuels,
mais la surprodution du riz que tous les agriculteurs avaient produit. Cette
surprodution coûte extrèment cher à l'Etat pour la
gérer. Aujourd'hui, l'Etat est obligé de modifier cette
politique. C'est la position actuelle de la politique agricole nationale. Et du
côté des agriculteurs, aujourd'hui, c'est eux qui sont
responsables d'eux-même. Il faut produire du riz ou d'autres produits, de
manière concurrentielle. La situation est ainsi défavorable pour
les agriculteurs aujourd'hui. Leur revenu est réduit de moitié
par rapport à l'époque où le marché était
soutenu. Donc ils n'ont plus de travail et quittent l'agriculture. Les
opérateurs de la Coopérative s'occupent de plus en plus de la
production, mais ils sont obligés de tenter d'élargir leur
échelle de production en fonction du coût de production qui
augmente de plus en plus. Ainsi, ils ne deviennent pas riches pour autant. Du
côté des propriétaires ruraux, leurs terrains sont
conservés grâce à ces opérateurs et à la
Coopérative, sinon, ils les laisseraient en friche. Et finalement, si on
ne conserve pas les terrains agricoles, l'agriculture n'a plus besoin
d'exister! Ce n'est pas bien de dire comme ça, mais la base de la
politique agricole est avant tout la base économique et le sol...
»
Dans cette explication, Monsieur M nous montre que le
mécanisme économique de l'agriculture japonaise qui est
bloqué. Et là, l'enquêteur lui a posé la question
suivante « Dans un tel contexte, qu'est-ce qu'apporteraient au niveau
local l'idée de `produire et consommer localement' et de la `vente
directe' ? » Pour Monsieur M, ce type d'approches « d'en
bas » ne viennent pas pour autant relever l'agriculture japonaise.
« C'est le contraire. Il est impossible de relever
l'agriculture japonaise par ce type d'approches d'en bas. 'Produire et
consommer localement' ou la `renaissance de la communauté (community no
saisei)' etc., c'est impossible. La base, c'est le calcul économique. On
vous ordonne de récolter et vendre par vous-même alors que l'on
vous avait empêché de les gérer par vous-même. Telle
est la réalité. Donc, on n'a qu'à s'en aller...
»
D'après Monsieur M, la structure
politico-économique s'impose irréversiblement à
l'agriculture avec une nouvelle politique de la libéralisation du
marché... Et le Projet Nô-Life ne semble pas pouvoir apporter une
solution décisive face à ce problème
déterminé par la structure du haut. Quelle pourrait alors
être la clé de la future réussite du Projet ? La
réponse finale de Monsieur M est bien basée sur le principe du
« bien-être public »,
518 Au Japon, on appelle ce système du soutien national au
marché avec l'expression « gyaku-zaya (marge à l'inverse)
».
mais la finalité reste toujours « insaisissable
» pour l'administration publique... Consensus de base sur le Projet
Nô -L ife : lien social
Monsieur M reconfirme que le consensus de base sur le Projet
Nô-Life est de permettre aux retraités d'avoir des «
camarades (nakama) » via leur activité agricole, donc
d'avoir des liens sociaux. Mais pour pouvoir continuer le Projet plus tard,
quels seront les « résultats et effets » davantage
requis ? Actuellement (en 2006), cette question est de plus en plus
posée au sein du Centre Nô-Life, car à mesure que le nombre
de stagiaires augmente depuis 2004, un financement plus important et un plus
grand nombre d'employés sont requis. Il s'agit d'un besoin de justifier
le Projet Nô-Life, au sein de la Municipalité de Toyota, avec plus
d'éléments susceptibles de fonder le consensus sur la
finalité du Projet.
Valeurs publiques de l'agriculture et de la ruralité :
avec le « sens de l'intérêt public », mais le fruit est
« insaisissable »...
« L'idée d'Ikigai peut-elle faire partie de
celle de la multifonctionalité de l'agriculture et de la ruralité
qui était présente dans la politique agricole de la Ville de
Toyota depuis une dizaine d'années ? » Monsieur M a
répondu à cette question en mettant l'accent sur la
finalité de l'administration publique, qui n'est pas celle d'une
entreprise qui suit le principe de la recherche du profit, mais celle du «
sens de l'intérêt public (kôkyô no hukushi to iu
kankaku) ». Cependant, il nous explique comme ci-dessous que c'est
une mission extrèmement difficile à réaliser face à
l'ambiguïté des « effets » que la politique
agricole apporte à son public.
« Du point de vue fondamental de l'administration, la
raison d'être de la politique agricole est trop difficile à
prononcer. C'est insaisissable ! Il y a énormément de gens qui
entourent les foyers agricoles, même si on essaie de leur donner une
orientation nécéssaire, et qu'on s'efforce de les orienter, on ne
voit pas les effets concrets ! Un travail aussi difficile n'existe pas
ailleurs... »
L'administration est actuellement confrontée à
la situation où elle doit de nouveau rendre compte du «
Profit » du Projet Nô-Life par rapport à son
coût financier. Ceci devrait s'effectuer par la réflexion des
gestionnaires du Centre Nô-Life (BPA et CAT) et le maire de la Ville de
Toyota qui justifiera la finalité du Projet.
Mode d'actions
Le mode d'actions du BDPA semble rester strictement
administratif en tant qu'un agent administratif du département :
certains cadres juridiques précèdent toujours les cadres de ses
actions. Son exercice est ainsi dicté par les lois concernées
(Loi agraire, Loi pour l'aménagement de la zone reservée pour le
développement agricole) et les structures administratives
supérieures (préfecture, le ministère de l'agriculture, de
la pêche et de la forêt).
Position de l'adminisation basée sur le principe de
l'intérêt public
Le BDPA partage plus son intérêt avec le BPA de
la Municipalité de Toyota qu'avec la CAT. Ceci d'autant plus que la
division des domaines de compétences est nette entre le BDPA et l'ECV
qui, étant régulièrement en coopération avec la
CAT, travaille directement avec les agriculteurs pour améliorer leur
gestion d'exploitation. Ainsi, il n'est pas forcément attaché au
principe productiviste de la modernisation agricole, à la
différence de l'ECV.
Puis, dans le cadre du processus de la construction du Projet
Nô-Life, il semble qu'il est le moins marqué par la divergence
d'intérêts entre agents concernés en raison de sa position
neutre et distanciée.
Regard neutre et distancié
Cette position rend également son propre regard neutre et
distancié, à la fois sur la situation locale et la structure
externe et globale.
La difficulté de définir clairement une
direction dans le domaine de la politique agricole face à la
compléxité des données réelles (« le
domaine agricole est tellement grand... », « on ne voit la
direction », « [la finalité du Projet est]
insaissisable »), souvent soulignée par Monsieur M, montre
bien sa position située au milieu entre la situation locale complexe et
les structures externes qui l'entourent (juridique, institutionnelle,
foncière, économique et politique). Et en même temps, il
essaie de suivre strictement le principe administratif (exercice des missions
par rapport aux lois concernées) en définissant prioritairement
son rôle par rapport à ces lois, et non par rapport à la
situation locale.
Et c'est ce regard neutre et distancié du BDPA qui a
permis à Monsieur M de nous montrer la situation objective de
l'agriculture de Toyota de son point de vue économique et foncier, en
allant jusqu'à relever les grandes contradictions entre la situation
réelle de l'agriculture japonaise et l'orientation de la politique
agricole. Nous pourrions même considérer que, malgré le
caractère personnel de ses avis, c'est sa position sociale
particulière qui lui permet d'avouer une défaillance du
système agricole au Japon (« cela ne peut pas marcher
» ; « c'est pour cela que l'agriculture est tragique »
; « l'agriculture japonaise est dans un stade
irrémédiable »)
Peu d'interaction dans sa position
Il ne se mêle pas de la relation d'interaction entre agents
locaux tandis que c'était souvent le cas entre le BPA, la SCI et la CAT
dans le processus de l'élaboration du Projet Nô-Life.
Il est intéressant d'ajouter, à titre
anecdotique, que Monsieur M était même étonné et un
peu gêné de la visite de l'enquêteur519. En
effet, il ne savait pas bien comment répondre à nos questions,
parce que, dans son travail, il n'a pas l'habitude de recevoir le public de
manière plus ou moins imprévue et informelle, comme lorsque nous
avons effectué notre entretien. Monsieur K, président du Centre
Nô-Life, m'a également confirmé que cela lui est
déjà souvent arrivé : « Les gens de la
préfecture sont toujours comme ça. Quand on leur rend visite
directement dans leur bureau, ils ont toujours l'air d'être
embêté en se demandant pourquoi on vient chez eux (rire)
»
Prise de position vis-à-vis du Projet Nô-Life
Pour comprendre sa position vis-à-vis du Projet
Nô-Life, il faut d'abord tenir compte de la différence de son mode
d'actions par rapport à la municipalité ou à la
coopérative. Le BDPA a peu d'interaction, peu d'acceptation de ce qui
est imprévu et ainsi peu de « bricolage » dans ses
idées et actions. C'est pourquoi il n'a pas été
concerné par l'histoire de la construction du Projet Nô-Life qui
était marquée par une série de bricolages d'idées
et d'échanges intersectoriels entre différents agents locaux
concernés. En fait, il n'est impliqué dans le Projet que dans la
mesure où le Projet touche ses fonctions administratives (lois, relais
avec le département et l'Etat etc).
Après la fin de la procédure pour le programme
de la Zone spéciale, dans la conduite du Projet Nô-Life, il n'a
que des rôles minimums à jouer sans implication directe et
régulière. Ainsi Monsieur M a défini sa position
vis-à-vis du Centre Nô-Life comme « soutien en
arrière » qui peut venir en aide en cas de
problèmes.
519 C'est Monsieur K, président du Centre Nô-Life,
qui nous l'a dit certain temps après que l'on avait effectué
notre entretien avec Monsieur M.
Autrement, la relation de coopération entre le BDPA et
le BPA de la Municipalité de Toyota nous paraît favorable, vu
qu'ils partagent le même principe de représentations et d'actions
qui obéit à celui de l'intérêt public.
Egalement, sa vision de l'agriculture de type Ikigai ou de la
finalité du Projet Nô-Life était d'abord orientée
vers la dimension sociale plutôt qu'économique, ce qui rejoint la
position du BPA de la Municipalité de Toyota. (Sur ce sujet, il ne nous
a pas parlé non plus de la coopérative agricole.)
Acteur 5 : Section Amélioration - Vulgarisation
du Bureau départemental de l'agriculture, de la forêt et de la
pêche de Toyota-Kamo (Ex-Centre pour l'Orientation et la Vulgarisation
agricoles de Toyota-Kamo : ECV)
Nous allons ici examiner l'implication, dans la construction
du Projet Nô-Life, de la Section Amélioration - Vulgarisation du
Bureau Départemental de l'Agriculture, de la Forêt et de la
Pêche de Toyota-Kamo que nous appellerons par la suite l'« ECV :
Ex-Centre pour la Vulgarisation ». En effet, jusqu'aux années 90,
son nom était l'Ex-Centre pour l'Orientation et la Vulgarisation
agricoles de Toyota-Kamo (Toyota Kamo Nôgyô Fukyû Sidô
Center).
L'examen sera principalement basé sur les documents
officiels intitulés « Plan fondamental pour la Vulgarisation et
l'Orientation (Fukyû Shidô Kihon Keikaku) » ainsi que
l'entretien effectué avec Monsieur N, un conseiller agricole
(nôgyô kairyô fukyû-in) chargé de
l'accompagnement de « Porteurs (notamment les jeunes agriculteurs) et
Gestion d'exploitation agricole ». Il est également responsable de
la coopération avec le Centre Nô-Life au sein de
l'ECV520.
Caractère général de l'acteur
Un agent technique et local du département et de
l'Etat dans le secteur de l'agriculture et de la ruralité
Le territoire dont s'occupe l'ECV est celui de la Ville de
Toyota et du Bourg de Miyoshi521 dont la surface totale est de 9505
8ha occupant 18.4% de la surface du territoire du département (en 2003).
La surface agricole dans ce territoire est de 8035ha, soit 8.4% de la surface
totale, dont les rizières occupent 5904ha (73% de la surface agricole),
les cultures maraîchères 1343ha (16%) et l'arboriculture 788ha
(9%)522 . Le nombre total des foyers agricoles est de 9481 dont 562
foyers sont des « exploitations professionelles (Sengyô Nôka)
», 341 sont des « exploitations pluriactives de la première
catégorie » et 4922 sont des « exploitations pluriactives de
la deuxième catégorie »(Idem.)523.
Concernant le reste du territoire, la forêt de montagne
occupe 6323 3ha soit 66.5% de la surface totale et la surface de l'habitat est
de 6797ha soit 7.1% de la surface totale en 2003524.
520 Cependant, Monsieur N n'était pas dans son poste
actuel lors de l'élaboration du Projet Nô-Life.
521 Le bourg (chô) de Miyoshi est une ville voisine dont le
nombre d'habitants est 55570 en 2007.
522 Section Amélioration - Vulgarisation du Bureau
départemental de l'agriculture, de la forêt et de la pêche
de Toyota-Kamo (Centre pour la Vulgarisation et l'Orientation de Toyota-Kamo),
2005 : 3.
523 Ces catégories d'exploitations agricoles sont
basées sur celles définies par la statistique agricole nationale
(Nôgyô Census). La catégorie des foyers agricoles dont le
nombre n'est pas cité dans ce plan (celui de 2005-20 10) peuvent
inclure, en majeure partie, les « exploitations auto-productives
(jikyû nôka) ». Pour les définitions de ces
catégories, voir le chapitre I.
524 Bureau départemental de l'Agriculture, de la
Forêt et de la Pêche de Toyota-Kamo, 2005 : 2. Ce taux de
répartition spatiale des zones agricole, forêstière et de
l'habitation correspond à peu près à celui du Japon
même si, au niveau national, la surface agricole
L'établissement de l'ECV dans chaque département
remonte à 1948, année de l'adoption de la Loi pour l'Incitation
à l'Amélioration de l'Agriculture (Nôgyô Kairyô
Jochô Hô). Cette loi obligea l'établissement de l'ECV dans
chaque département525. D'après Monsieur N, cette loi
incarnait « l'initiative de l'Etat de prendre la direction pour la
protection et le développement de l'agriculture japonaise ».
Et sa visée est notamment l'orientation des agriculteurs en terme
technique et économique. A cet effet, les 11 ECVs présents dans
le Département d'Aichi entretienent une relation étroite et
verticale avec l'Institut Départemental de la Recherche Agronomique
(Nôgyô Sôgô Shikenjô). Les conseillers dans les
ECVs sont ainsi dirigés « d'en haut » par les
ingénieurs de cet Institut dont chacun a une qualification de
l'Etat526. Cette institution est un « agent » de ces
institutions supérieures comme le département et l'Etat qui
prennent leur direction de manière centralisée dans le cadre de
la politique agricole nationale.
Les fonctions de Monsieur N sont d'accompagner les
agriculteurs cibles designés comme « porteurs (ninaite) » dans
les Plans pour l'Orientation et la Vulgarisation (expliqués plus bas).
Parmi ces agriculteurs cibles, il accompagne notamment les jeunes agriculteurs
pour améliorer leurs techniques agricoles et gestion d'exploitation tout
en essayant de leur appliquer les nouvelles techniques provenant de l'Institut
du Département de la Recherche Agronomique, et de les diffuser au sein
de tous les producteurs agricoles de la région.
Ses partenaires : coopérative agricole et
municipalité
L'ECV a une forte relation de partenariat avec les
coopératives agricoles situées dans le territoire dont il se
charge. Il s'agit ici de la CAT et du BPA de la Municipalité de la Ville
de Toyota. Les plans fondamentaux de l'ECV sont ainsi élaborés en
sorte qu'ils soient cohérents avec les plans globaux que la CAT et le
BPA établissent respectivement.
Conseil et soutien techniques aux formations du Projet
Nô -Life
Dans le cadre du Projet Nô-Life, d'après Monsieur
N, l'ECV a participé à l'élaboration des programmes des
formations Nô-Life notamment dans le domaine de la technique agricole.
L'ECV participa à la discussion qui commença en 2003 pour la
préparation de l'établissement du Centre Nô-Life. Depuis
l'année 2004, l'année de l'inauguration du Centre Nô-Life,
il envoie certains de ses employés en tant qu'enseignants pour les
formations de Nô-Life.
Caractère général des données
Notre analyse se base principalement sur les deux plans
quinquenaux les plus récents, publiés par l'ECV intitulé
« Plan Fondamental pour la Vulgarisation et l'Orientation (Fukyû
Shidô Kihon Keikaku) », dont l'un porte sur les années 200
1-2005 et l'autre sur les années 2006-20 10. Nous les appellerons par la
suite le « Plan fondamental 2001-2005 » et le « Plan fondamental
2006-2010 ».
Ces plans déterminent la ligne directrice de l'ensemble
des activités de l'ECV en montrant la « Direction de guidance
(Yûdô hôkô) » de l'agriculture et de la
ruralité du territoire concerné527. Et ils sont
orientés par les
occupe un peu plus et la zone d'habitation un peu moins : 12.7%
(agricole), 66.4% (forêt) et 4.4% (habitations) en 2003. Source :
Statistics Bureau & Statistical Research and Training Institute,
http://www.stat.go.jp/data/nenkan/01.htm
525 L'établissement de ce type d'institution par
département n'est plus obligatoire suite à des modification de
cette loi en 2004. Cependant, d'après Monsieur N, aucun organisme
créé par cette loi n'est disparu dans tous les
départements japonais aujourd'hui.
526 Nous avons également intérrogé Monsieur
O qui était justement ingénieur de cet Institut, et qui est
actuellement à la retraite et invité comme enseignant pour la
formation Nô-Life. Pour devenir ingénieur dans un Institut
Départemental de la Recherche Agronomique, il faut passer un concours
national dans un domaine spécialisé (ex. riziculture, culture
légumière etc.) après avoir eu des expériences en
tant que conseiller agricole dans des Centres pour la Vulgarisation. Il en
était ainsi pour le parcours de Monsieur O.
527 Section Amélioration - Vulgarisation du Bureau
départemental de l'agriculture, de la forêt et de la pêche
de Toyota-Kamo
plans officiels émanants de la politique agricole de
l'Etat (Ministère de l'Agriculture, de la forêt et de la
Pêche) et ensuite de celle du département528. Ils
orientent l'ensemble des activités de l'ECV, et servent de
critères pour les auto-évaluations de ces activités
effectuées chaque année529 par l'ECV
lui-même.
Nous pouvons examiner dans ces plans une série de
discours de l'ECV qui représentent l'agriculture et la ruralité
de son territoire, du point de vue de sa propre mission pour le
développement technico-économique de l'agriculture.
Représentations
Sa politique générale d'orientation
Dans l'introduction et le premier chapitre intitulé
« Idées de base (Kihonteki na kangaekata) » du Plan
fondamental 200 1-2005, nous pouvons trouver le constat fait par l'ECV sur la
situation globale précisant une série d'atouts et de menaces de
l'agriculture et de la ruralité de du territoire concerné, et la
direction fondamentale pour l'orientation.
Constat de la situation : atouts et menaces
Nous pouvons déjà entrevoir les principales
idées de la politique d'orientation de l'ECV dans son constat de la
situation qui présente les atouts et les menaces pour l'agriculture du
territoire concerné. Concernant les atouts, le Plan fondamental
2001-2005 indique que :
« L'agriculture dans notre territoire est celle du
type de l'utilisation extensive des sols (Tochi-Riyô-gata) comme la
riziculture à grande échelle dans le Sud de la Ville de Toyota,
l'arboriculture principalement développée sur le Nord, les
cultures maraîchères dans le Bourg de Miyoshi. Egalement,
l'agriculture du type hors sol (Shisetsu-gata) comme l'horticulture et
l'élevage dans la Ville de Toyota, le Bourg de Miyoshi et le Village de
Shimoyama. Ensuite, dans les zones de moyenne montage, la production de
produits du terroir comme l'igname japonaise (Jinen-jo), le Wasabi, le
chrysanthème sur sol ainsi que des activités de vente directe
sont développées par des personnes âgées et des
femmes »530
Tout en mettant l'accent sur une série de types de
productions à haute productivité présents dans certaines
zones limitées (riziculture à grande échelle,
l'arboriculture, l'horticulture et l'élevage intensif), les
activités locales animées par des producteurs à faible
productivité comme « des personnes âgées et des
femmes » dans les zones de moyenne montagne sont
présentées de manière contrastée. En même
temps, les autres types de productions à productivité
relativement faibles existants partout dans la région, dont notamment la
riziculture située en plaine ainsi qu'en zone de moyenne montagne, n'y
sont pas citées.
Concernant les menaces, à la suite des phrases
citées plus haut, le Plan fondamental 2001-2005 précise que :
« Cependant, l'agriculture de cette région est
submergée de problèmes : diminution du nombre de jeunes
agriculteurs, vieillissement des porteurs, baisse du taux d'utilisation des
terrains agricoles, urbanisation - avancement de la cohabitation des urbains et
des ruraux (konjû-ka), montée de la concurrence
interrégionale accompagnée par l'internationalisation, baisse des
prix agricoles, problèmes envionnementaux etc. »531
(Centre pour la Vulgarisation et l'Orientation de Toyota-Kamo),
2005 : 2.
528 Ibid. : 25.
529 Ibid.
530 Centre pour la Vulgarisation et l'Orientation de Toyota-Kamo,
200 1a : 3.
531 Ibid.
Et c'est « pour résoudre ces
problèmes » et pour « y faire face de manière
cohérente avec des plans à long terme comme à court
terme » que le Plan fondamental 200 1-2005 fut
établi532.
Parmi les problèmes cités plus haut, le manque de
main-d'oeuvre dû au vieillissement de la population agricole est
accentué avec un constat particulier formulé comme ceci dans le
début du premier chapitre :
« En 2000, le nombre total des foyers agricoles est
de 9922, dont 495 foyers sont des exploitations professionnelles. Le taux de
présence d'exploitations professionnelles est de 5-6% en plaine, tandis
qu'il est de 7% dans les zones de moyenne montagne. Ce dernier dépasse
le chiffre de la plaine. Cela est dû à l'installation agricole de
personnes retraitées d'autres secteurs industriels, et ce sont des
familles nucléaires principalement constituées par des personnes
âgées qui provoquent ce phénomène.
C'est-à-dire que ce sont des exploitations professionnelles temporaires
héritées par des personnes âgées et des femmes sans
successeurs »533
Dans cette explication, le Plan fondamental 200 1-2005
constate que le vieillissement et l'exode des jeunes des foyers ruraux sont
irreversibles alors que, quoique marginalement, de nouvelles personnes
s'installent et reprennent les activités agricoles de leurs foyers. Il
s'agit de nouveaux retraités de secteurs industriels de la
région. Le Plan résume ainsi la caractéristique de
l'agriculture de sa région :
« L'agriculture de notre territoire est
développée de diverses manières allant du type
entrepreunarial mettant en valeur une main d'oeuvre salariale, au type d'Ikigai
principalement menée par des personnes âgées et des femmes
»534
Curieusement, le Plan emploie ici le terme « Ikigai
» pour designer le type d'activités agricoles diverses qui sont
menées par des personnes âgées et des femmes des foyers
agricoles, et se distinguent du type de l'agriculture «
entrepreneuriale». Ensuite, dans le Plan fondamental 2006-20 10, on mettra
davantage l'accent sur des apports potentiels pour la main-d'oeuvre agricole
grâce au vieillissement de la population d'autres secteurs : urbains et
industriels.
Après ce constat de la situation, le Plan fondamental
2001-2005 affirme délibérément sa cible comme ci-dessous.
Ce qui va déterminer la direction de sa politique de « porteurs
(ninaite) » :
« L'objet auquel l'ECV accorde de l'importance est :
les exploitations familiales visant un revenu annuel de 10 millions de yens et
les exploitations de type entrepreneurial visant un revenu annuel de 18
millions de yens, soit 420 foyers au total. »535
Politique sélective d'orientation
Nous pouvons constater avec le discours de l'ECV cité
plus haut, une caractéristique modernisatrice et sélective
très prononcée : sa politique d'orientation vise prioritairement
une ultra minorité de producteurs à haute productivité qui
représentent à peine 2% du nombre total des foyers agricoles.
Ainsi, dans le Plan fondamental 2001-2005, l'objectif à atteindre vers
2010 en terme du nombre des exploitations des foyers agricoles est : « de
115 exploitations familiales ayant un revenu annuel de 10 millions de yens
et 150 exploitations de type entrepreneurial ayant un revenu annuel de 18
millions de yens »536.
Puis, le Plan fondamental 2006-20 10 mettra en avant
l'idée de la gestion rationnelle d'exploitation agricole en
définissant « les meilleures exploitations » qui
« développent rationnellement leur gestion agricole selon le
`management cycle' tout en analysant l'environnement socio-économique de
leur gestion et leurs propres
532 Ibid.
533 Ibid.
534 Ibid.
535 Ibid. 10 millions yens soit équivalent à
environ 66666 euros.
536 Ibid : 4. Ce chiffre à atteindre donné ici
émane directement du plan départemental supérieur «
Vision 2010 pour l'Agriculture,
la Forêt et la Pêche d'Aichi (Aichi Nôrin
Suisan Vision 2010) » (Ibid : 46)
ressources disponibles pour la gestion
»537. Il modifie ainsi son objectif à atteindre avec
plus de précision : « 149 exploitations familiales ayant un
revenu de 8 millions de yens pour 2.5 membres par famille » et
« 87 exploitations entrepreneuriales ayant un revenu de 14 millions de
yens dont 8 millions pour le gestionnaire et 6 millions pour 1.5 membres par
famille »538.
« La direction de guidance » pour les années
2001-2005
Afin d'atteindre l'objectif cité plus haut pour la
formation des exploitations, le Plan fondamental 200 1-2005 fixe «
deux piliers pour la direction de guidance » :
- Formation des porteurs de divers types (tayô na
ninaite no ikusei)
- Développement de l'agriculture locale à
l'initiative des agriculteurs eux-même (Nôgyô-sha mizukara no
torikumi ni yoru chiiki-nôgyô no kasseika)539
Dans le cadre du premier pilier sur « la formation
des porteurs de divers types », les mesures sont
résumées en trois points : « formation des exploitations
dotées d'un meilleur sens de gestion (keiei kankaku ni sugureta keieitai
no ikusei) » ; « formation des agriculteurs porteurs de la
génération future (jidai wo ninau nôgyô-sha no
ikusei) » ; « aménagement de localités
attrayantes avec un déploiement des compétences des personnes
âgées et des femmes (josei - kôreisha no nôryoku hakki
ni yoru miryoku aru chiiki zukuri) »540.
Le premier point sur la « formation des exploitations
dotées d'un meilleur sens de gestion » mentionne des
problématiques pratiques à aborder en priorité sur les 420
exploitations professionnelles cible : « pratique de
comptabilité » ; « détection des
problèmes et amélioration » ; « pratique de
consultation et de `counseling ' pour chaque exploitation, et participation des
femmes à la gestion »541.
Le second point concerne les activités pour
améliorer les compétences de gestion des jeunes agriculteurs qui
font partie de l'association des jeunes agriculteurs « 4H
Club542». L'importance est également accordée au
rôle des femmes en tant que « partenaires des gestionnaires
»543.
Le troisième point indique que « les femmes
occupent 51.2% de la population agricole active, et les personnes
âgées 22.8%. Ils sont d'importants porteurs de l'agriculture de
notre région »544. « Les lieux où
ils animent leurs activités » sont « des points de
vente directe, groupes pour la mise en valeur des ressources agricoles (comme
le groupe de la production de Shimenawa, conseillers de la vie rurale, groupe
pour l'amélioration de la vie) »545. Le Plan
indique qu'il est important de mettre en valeur dans les localités
« les compétences individuelles des conseillers de la vie
rurale et des personnes âgées pour créer des
localités attrayantes »546.
Dans le cadre du deuxième pilier de l'orientation
« développement de l'agriculture locale à l'initiative
des agriculteurs eux-même », les quatres points suivants
résument les mesures d'orientation : « formation des
zones
537 Section Amélioration - Vulgarisation du Bureau
départemental de l'agriculture, de la forêt et de la pêche
de Toyota-Kamo
(Centre pour la Vulgarisation et l'Orientation de Toyota-Kamo),
2005), p.6.
538 Ibid.
539 Centre pour la Vulgarisation et l'Orientation de Toyota-Kamo,
200 1a : 4.
540 Ibid .
541 Ibid. La pratique de comtabilité n'est
effectuée que par un peu plus de 20% d'exploitations professionnelles.
(Ibid.)
542 26 jeunes agriculteurs de moins de 28 ans font partie de
cette association et font l'objet de l'orientation de l'ECV. L'âge
maximum des jeunes agriculteurs cible de cette orientation est de
39ans. « 4H Club » est une association nationale des jeunes
agriculteurs japonais crééé en 1948 selon le modèle
américain de l'association des jeunes agriculteurs. Le nom officiel
de
l'association est « Nôgyô Seinen Club ».
Mais ce nom de l'association a changé plusieurs fois jusqu'à nos
jours. « 4H » signifient «Head to clearer thinking ; Heart to
greater loyalty; Hands to larger service; Health to better living». Le
nombre de clubs et de members ne cessent de diminuer depuis la deuxième
moitié des années 50 jusqu'à aujourd'hui.
Référence : le site officiel de l'association :
http://www.zenkyo4h.org/2004/main.htm
543 Centre pour la Vulgarisation et l'Orientation de Toyota-Kamo,
200 1a : 4.
544 Ibid.
545 Ibid. Shimenawa est le produit d'une fablication
traditionnelle fait d'une corde pour la décoration pour le Nouvel an au
Japon.
« Conseillers de la vie rurale (Nôson-seikatsu
adviser) », « Groupe pour l'amélioration de la vie
(Seikatsu-kaizen group) » sont les noms d'associations d'agricultrices
locales.
546 Ibid.
de production spécialisée (sanchi) à
haute productivité avec innovation technique » ; «
établissement d'une gestion rizicole mettant en valeur les
spécificités locales » ; « promotion d'une
agriculture locale respectueuse de la protection de l'environnement »
; « animation des zones de moyenne montagne» 547
.
Le premier point sur la « formation des zones de
production spécialisée (sanchi) à haute
productivité avec innovation technique » met l'accent sur le
développement des zones de production spécialisée avec des
innovations techniques pour « faire face à l'import de produits
agricoles ainsi qu'à la concurrence interrégionale de
l'intérieur du pays »548. Puis, des innovations
concrètes à apporter sont précisées dans chaque
production spécialisée à haute productivité visant
« l'aggrandissement d'échelle (Kibo kakudai) »,
« la réduction du travail humain (Shô-ryoku) »
et l'introduction de « techniques pour l'extensification des travaux
(sagyô bunsan gijutsu)»549.
En poursuivant la ligne productiviste du premier point, le
deuxième point sur l'« établissement d'une gestion
rizicole mettant en valeur les spécificités locales »
encourage la « mobilisation (ryûdô-ka) » et la
« concentration (shûseki) » des terrains rizicoles par
les « porteurs (entreprises agricoles de la riziculture)
»550.
Concernant les zones de moyenne montagne, le Plan fondamental
2001-2005 affirme que « il est difficile de conserver les porteurs et
d'utiliser efficacement des rizières via la concentration » en
raison de « conditions défavorables aux niveaux naturel,
économique et social, accompagnées par le vieillissement des
gestionnaires »551. A cet effet, apparaît une
volonté de soutenir l'application du « système d'aides
directes aux zones de la moyenne montagne » via des «
conventions villageoises »552.
Le troisième point sur la « promotion d'une
agriculture locale respectueuse de la protection de l'environnement »
affirme une volonté d'établir « une agriculture
basée sur le recyclage, des techniques pour la réduction
d'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides »553.
Et ceci « afin de se diriger vers la réalisation d'une
agriculture susceptible de coexister avec sa localité (chiiki to
kyôzon dekiru nôgyô wo mezasu tame)
»554. Pourtant, les domaines d'application des mesures
concrètes se limitent à certains types de productions
spécialisées : « utilisation cyclique par les
producteurs des cultures végétales du fumier issu des
déjéctions du bétail » ; «
réduction de l'utilisation des pesticides via l'emploi d'un produit
empêchant la reproduction des insectes » ; « technique
de réduction des engrais via l'emploi d'engrais à effet
faible »555.
Le quatrième point sur l'« animation des zones
de moyenne montagne » met l'accent sur la valorisation de produits du
terroir destinés à la transformation et à la vente directe
comme l'igname japonaise (jinenjo) et le wasabi etc556.
Enfin, quelles représentations pouvons-nous retenir
dans l'ensemble du Plan fondamental 2001-2005 ? En fait, l'agriculture et la
ruralité de la région de Toyota sont représentées
de manière contrastée voire « dualiste ». Et cette
approche fait suite au constat d'une série de crises agricoles
(vieillissement de la main d'oeuvre agricole, baisse des prix agricoles). Son
approche dualiste divise en deux, que ce soit de manière explicite ou
547 Ibid : 4-5.
548 Ibid : 4.
549 Ibid.
550 Ibid : 5. Ici, il nous faut évoquer que cette mesure
semble tenir compte du fait qu'une grande partie des terrains rizicoles est
détenue par une majorité de foyers agricoles pluriactifs, et que
ces terrains sont pour la plupart de petite taille (20 a - 1ha),
morcelés et de plus en plus laissés en
jachère ou en friche. Et nous pouvons également constater que,
dans le domaine rizicole, ces foyers pluriactifs sont clairement exclus de la
catégorie des producteurs-porteurs.
551 Ibid.
552 Ibid. « Système d'aides directes aux zones de la
moyenne montagne (chûsankan-chiiki nado chokusetsu shiharai seido) »
et
« conventions villageoises (shûraku kyôtei)
» sont des systèmes nationaux de subvention lancés depuis
2000 pour les activités agricoles dans les zones de moyenne montagne.
553 Ibid.
554 Ibid.
555 Ibid. L'échange du fumier entre éleveurs et
producteurs des cultures végétales est limité à
certaines zones. L'utilisation du
produit empêchant la communication des insectes est
pratiquée par le membre d'un groupement d'arboriculteurs
spécialisés de la
poire et de la péche qualifiés de « ecofarmers
», un label nationale récent créé pour qualifier les
producteurs respectueux de l'environnement. 104 producteurs sont
qualifiés de ce label en 2004, mais ceux dont 99 producteurs dans le
domaine fruitier. Tous
les membres des groupements de producteurs de la Pêche
et de la Poire ont été qualifiés. (Section
Amélioration - Vulgarisation du Bureau départemental de
l'agriculture, de la forêt et de la pêche de Toyota-Kamo (Centre
pour la Vulgarisation et l'Orientation de Toyota-Kamo), 2005 : 20.
556 Centre pour la Vulgarisation et l'Orientation de Toyota-Kamo,
200 1a : 5.
implicite, les cibles d'orientation par le seul critère
de la productivité (fort ou faible par rapport au marché) aux
niveaux des producteurs, types des produits et zones de production (foyers
professionnels cible ou non professionels ; jeunes agriculteurs ou personnes
âgées et femmes ; quelques entreprises rizicoles dans la zone du
sud ou nombreux riziculteurs pluriactifs non cités ; groupements de
producteurs de la Poire et de la Pêche dans la zone du nord ou
groupements de personnes âgées ou de femmes pour des produits
artisanaux destinés à la vente directe ; plaine - moyenne
montagne etc.)
Selon ces catégories dualistes multipliées, on
constate que, d'une part, la politique d'orientation de l'ECV est
d'emblée productiviste, sélective et orientée vers le
marché. Et cette direction est justifiée pour « faire
face à la concurrence interrégionale renforcée suite
à l'internationalisation 557». D'autre part, l'ECV
encourage une série d'activités productives ou animées des
personnes âgées, des femmes des foyers pluriactifs, même
s'ils sont rarement appellés « agriculteurs » ou «
agricultrices ». Là, l'ECV a tendance à utiliser une
série de termes « symboliques » plutôt
qu'économiques dont il est difficile de critiquer les valeurs pour le
public tels que : « agriculture d'Ikigai » ; « créer des
localités attrayantes » ; « déploiement des
compténces individuelles » etc.
« La direction de guidance » pour les années
2006-2010
Dans le Plan fondamental 2006-2010, le contenu de la «
direction de guidance » ne change pas la nature de ses
représentations dualistes de l'agriculture et de la ruralité du
teritoire concerné, que nous avons constatée, sauf s'il y ajoute
quelques éléments de nouveauté. Le Plan fondamental
2006-20 10 établit trois piliers suivants de l'orientation en y
intégrant le contenu des deux piliers du plan précédent
:
- Formation des exploitations et des zones à forte
compétitivité via des innovations techniques - Assurer
une production durable de l'alimentation de sécurité et de bonne
qualité
- Aide des activités locales mettant en valeur les
ressources de l'agriculture et de la ruralité »558
Rappelons que ce nouveau Plan fondamental 2006-2010 introduit
une définition des « meilleures exploitations »
basée sur l'idée de la gestion rationnelle, et modifie ainsi
l'objectif à atteindre pour la formation des exploitations
professionnelles : « 149 exploitations familiales ayant leur revenu de
8 millions yens pour 2.5 membres de la famille » et « 87
exploitations entrepreneuriales ayant leur revenu de 14 millions yens dont 8
millions pour le géstionnaire et 6 millions pour 1.5 membres de la
famille » (recitée).
Le premier pilier sur la « formation des
exploitations et des zones à forte compétitivité via des
innovations techniques » est orienté vers les activités
productives et entrepreneuriales. Le rôle des femmes accordé par
ce pilier est le rôle d'entrepreneuses tandis que, dans le plan
précédent, c'était le rôle de partenaires de
gestionnaires qui était attendu par l'ECV. Ce changement semble se baser
sur la présence de plus en plus importante de femmes exerçant la
transformation artisanale et la vente directe de produits locaux559.
10 foyers individuels et 22 groupes développent leurs activités
aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural de moyenne
montagne560. L'attente de l'ECV vis-à-vis de ces femmes est
affirmée du point de vue de la « valorisation des produits du
terroir et de l'idée de `produire et consommer localement'
(chisan-chishô) »561.
Ensuite, le Plan affirme son soutien aux nouveaux producteurs
de légumes (fraise, igname, aubergine) et de fleurs
(chrysanthème). En effet, pour la plupart ces produits sont
destinés au marché local, dont le vieillissement des producteurs
est relativement avancé562. Et dans le domaine des
légumes, le Plan fondamental 2006-20 10 met l'accent notamment sur une
nouvelle catégorie de producteurs qui s'installent de plus en plus :
« retraités
557 Ibid. : 2.
558 Ibid. : 4.
559 Ibid. : 7.
560 Ibid.
561 Ibid. L'idée de « produire et consommer
localement » est un slogan qui est à « l'ère du temps
» au Japon aujourd'hui. Ce fait
est notamment lié au contexte de la préoccupation
grandissante sur l'auto-suffisance alimentaire aussi bien au niveau pubic qu'au
niveau politique. Cette idée est également promue dans la
troisième pilier du Plan fondamental 2006-20 10.
562 Ibid : 12-15.
revenants à la terre (teinen kinô cha)
». Le Plan fondamental 2006-2010 constate que :
« Pour les légumes de notre territoire, de la
plaine à la moyenne montagne, nous avons beaucoup de zones de
productions spécifiques de petite taille sous diverses conditions
environnementales : le chou chinois, l'aubergine pour les cultures sur sol en
plaine ; la fraise, l'aubergine pour les cultures hors sol ; une série
de légumes du terroir comme l'igname japonaise, l'asperge, l'aubergine
en moyenne montagne etc. On peut constater un mouvement de nouvelles
installations comme celui de retraités revenants à la terre.
»563
Pour les légumes, le Plan fondamental 2006-20 10
envisage une série de soutiens à apporter vis-à-vis de ces
nouveaux producteurs émergents (formation technique, introduction de
nouvelles techniques et de nouvelles variétés des produits).
Concernant les aubergines de l'été et de l'automne, il explicite
même son intention de coopérer avec le Centre Nô-Life
(inauguré en 2004) pour « recruter (boshû) et orienter
(shidô) » de nouveaux producteurs au niveau de «
l'ensemble des zones de productions spécialisées (sanchi
zentai to shite) »564. Et ceci afin d'«
élargir l'échelle des zones de productions
spécialisées et les rendre plus compétitives
»565
Cette attente est affirmée par l'ECV pour l'installation
de nouveaux retraités alors que leur orientation de nature productiviste
reste la même (« élargir et rendre compétitives
les zones de productions spécilisées
»)566.
Dans le deuxième pilier consistant à «
assurer une production durable de l'alimentation de sécurité
et de bonne qualité », le Plan fondamental 2006-20 10
intègre une préoccupation pour l'agriculture respectueuse de la
protection de l'environnement. Le Plan fondamental 2006-20 10 y reprend et
développe le contenu du troisième point du deuxième pilier
du plan précédent qui était : « promotion d'une
agriculture locale respectueuse de la protection de l'environnement
». Le Plan fondamental 2006-20 10 y ajoute des préoccupations en
matière des sécurité et traçabilité
alimentaires, de plus en plus grandissantes aujourd'hui au Japon 567.
La troisième pilier sur l'« aide aux
activités locales mettant en valeur les ressources de l'agriculture et
de la ruralité » est orienté vers les activités
pour le développement local et rural. En y intégrant le
quatrième point du deuxième pilier du plan
précédent qui concernait l'« animation des zones de la
moyenne montagne », le Plan fondamental 2006-2010 développe
dans ce pilier ses mesures, plus diversifiées, orientées de
manière générale vers le développement
rural568. Les trois points de ce pilier sont : « formation
des organisations agricoles mettant en valeur des spécificités
locales (chiiki no tokuchô wo ikashita einô-soshiki no ikusei)
» ; « soutien des diverses activités des agriculteurs pour
la sensibilisation sur l'alimentation et la ruralité (shoku to nô
heno rikai no zôshin ni muketa nôgyô-sha no tayô na
torikumi shien) » ; « création des produits du
terroir dans les zones de moyenne montagne (chûsankan chiiki no
tokusan-hin zukuri) ».
Dans le premier point, le Plan fondamental 2006-20 10 exprime
d'abord son constat de « la baisse de motivation (Iyoku ga teika
shiteiru) » des producteurs vis-à-vis de l' «
amélioration de la base de la production agricole et de
l'environnement pour la gestion agricole » au sein des producteurs du
territoire concerné569. Et ceci est dû à la
« faible efficacité économique et au vieillissement
»570. A cet effet, le Plan fondamental 2006-2010 accorde de
l'importance à la « mise en valeur des terrains agricoles
», la « formation de groupements agricoles susceptibles d'exercer
avantageusement la vente et la distribution », le «
développement de l'agriculture locale et du développement
rural » et « aménagement de l'environnement
confortable pour les travaux agricoles et de l'environnement rural
»571. Et ceci « pour que les agriculteurs puissent
travailler leur
563 Ibid : 12
564 Ibid.
565 Ibid.
566 Cependant, les réactions des stagiaires du Projet
Nô-Life ne sont pas toujours conjointes ni homogènes par rapport
à cette
attente de l'ECV. Nous allons les examiner dans le Chapitre
IV.
567 Ibid : 20-2 1
568 Ibid : 22-23.
569 Ibid : 22.
570 Ibid.
571 Ibid.
agriculture en pleine motivation
»572.
Dans le deuxième point, le Plan fondamental 2006-2010
affirme son soutien global aux diverses activités des agriculteurs non
seulement du point de vue de la production agricole, mais aussi de celui de la
multifoncionalité de l'agriculture (ce qui n'était pas
mentionné dans le plan précédent)573. En se
focalisant sur les zones de moyenne montagne, le Plan fondamental 2006-2010
affirme son soutien aux diverses activités des agriculteurs pour la
« sensibilisation sur l'alimentation et la ruralité »
représentée par les idées de «produire et
consommer localement » et de l'« éducation
alimentaire et rurale » etc574. Et ceci est dans le but de
« développements agricole et local hamonieux valorisant les
spécificités locales dans notre territoire où la ville et
la campagne montagnarde voisinent »575.
Dans les mesures du troisième pilier, nous pouvons
constater, d'une part, une volonté de l'ECV, qui semble être plus
affirmée pour apporter ses soutiens aux acteurs qui étaient,
considérés comme marginaux dans le plan précédent
en raison de leur faible productivité. Et ces soutiens sont mis en
relation avec une série de thématiques émergentes :
multifonctionalité ; développement rural ; échage entre
ville et campagne ; `produire et consommer localement' ; éducation
alimentaire ; Ikigai pour les personnes âgées etc. Ces termes
semblent contenir des définitions plus élaborées et
complexes que les termes symboliques qui étaient employés dans le
plan précédent, rappelons-en quelques-uns : « agriculture
d'Ikigai », « créer des localités attrayantes »,
« déploiement des compténces individuelles » etc.
Complexification et ambiguïté de la politique
d'orientation
Suite à notre examen des deux « direction[s] de
guidance » de la politique d'orientation de l'ECV, nous pouvons constater
une complexification des représentations de cette politique.
A travers des changements entre ces deux directions, nous
pouvons remarquer que, dans le Plan fondamental 2006-2010,
émergèrent une série de nouvelles thématiques dont
les origines et les poids ne sont pas toujours les mêmes, et qui
influencent les représentations de la politique d'orientation de l'ECV :
renforcement de la force concurrentielle ; gestion rationnelle d'exploitation
(management) ; agriculture respectueuse de l'environnement ; qualité et
sécurité alimentaires ; renforcement de l'autosuffisance
alimentaire ; multifonctionalité ; développement rural ;
échange entre ville et campagne ; produire et consommer localement ;
éducation alimentaire ; Ikigai pour les personnes âgées
etc.
Ces nouvelles thématiques impliquent souvent des
éléments dont la nature est différente de celle de la
propre mission de l'ECV : le développement technico-écnomique de
l'agriculture via la recherche de la productivité. Puis, ses intentions
affirmées pour soutenir les divers producteurs étaient toujours
accompagnées par un constat de la situation locale de plus en plus
aggravée de l'agriculture et de la ruralité (vieillissement des
producteurs porteurs même, aggravation de l'abondan de terrains etc).
Les représentations politiques de l'agriculture et de
la ruralité de la région de Toyota qu'exprime l'ECV
étaient, dans un premier temps, dualistes (fort ou faible par le seul
critère de la productivité) et commandées par le haut (le
département et l'Etat). Cependant, elles sont influencées, d'un
côté, par une série de thématiques émergentes
de plus en plus structurées émanantes de l'extérieur, de
l'autre côté, par l'évolution de la situation locale
où le vieillissement et l'exode marque décisivement un effet
négatif. Ainsi, elles se complexifient et deviennent de plus en plus
ambiguës.
Une forte attente vis-à-vis du Projet Nô-Life
dans le cadre de la politique de « nouveaux porteurs »
Rappelons que l'ECV affirmait, dans le Plan fondamental 2006-20
10, son soutien pour les activités du
572 Ibid.
573 Ibid.
574 Ibid : 23 L'éducation alimentaire (Shokuiku) est une
nouvelle thématique nationale. La Loi Fondamentale sur l'Education
Alimentaire (Shokuiku Kihonhô) fut adoptée en 2005.
575 Ibid : 22.
Centre Nô-Life dans le cadre du « soutien de
l'installation agricole des nouveaux participants » en vue de la «
formation des porteurs de la génération future
»576.
« Nouveaux participants » comme nouveaux porteurs
?
Le terme « nouveaux participants (shinki sannyû
sha) » designe ici les personnes non originaires des exploitations
professionnelles toujours considérées comme cibles de la
politique sélective d'orientation depuis le Plan fondamental 2001-2005.
Ce sont de nouveaux producteurs ou candidats producteurs dont le nombre est
croissant et qui : « n'ont pas de base pour la gestion agricole
(Nôgyô keieikiban wo motanai) » ; « ne font pas
partie de l'association des jeunes agriculteurs (4H Club) » ; «
sont âgés de plus de 30 ans » ; « n'ont pas
de connaissances agricoles ni d'expériences »577.
Quelle place est alors accordée par l'ECV à ces nouveaux venus
dans le domaine agricole ?
Rappelons que le premier objectif de la politique
d'orientation de l'ECV était formulé, dans le Plan fondamental
2006-2010, par un nombre d'exploitations professionnelles à former qui
correspondait à seulement 2% du nombre total des foyers agricoles du
territoire concerné (236 sur 9481). Et le type d'exploitations agricoles
cibles de cette politique sélective était uniquement celui des
exploitations professionnelles dont le nombre est de 426. Dans le Plan
fondamental 2006-2010, la catégorie des « nouveaux participants
» en tant que « porteurs » est clairement distinguée de
celle des « successeurs des exploitations cibles (jûten shigô
taishô keiei-tai nô sitei) »578. Donc, la place des
nouveaux participants d'origine « non agricole », cités plus
haut, reste secondaire du point de vue de la politique sélective de
l'ECV. Et comme nous avons pu le constater dans l'examen du Plan fondamental
2006-2010, l'attente affirmée par l'ECV pour l'installation de nouveaux
retraités est attaché au fait qu'ils suivent leur orientation de
nature productiviste dans le domaine de légumes. Autrement dit, ce
nouveau type de « participants » a simplement été
ajouté dans la cartégorie des porteurs de l'agriculture selon le
même critère de jugement de la production agricole. Monsieur N
nous a répondu à ce propos lors de notre entretien en
répondant à la question formulée ainsi « Que
pensez-vous de l'objectif principal579 du Projet Nô-Life ?
» :
« Euh, je pense qu'il est quand même important
de former de nouveaux porteurs. Jusqu'à maintenant, on essayait
d'assurer les porteurs en faisant que les successeurs reprennent les fermes
(les activités agricoles). Mais il est inévitable de trouver des
porteurs à partir d'autres personnes. `Non originaire des foyers
agricoles (hi-nôka)', puis-je dire ? Mon idée est qu'il faut
mettre en valeur de tels porteurs. »
Et il trouve qu'il y a un avantage particulier chez ces
nouveaux porteurs grâce aux « bonnes images » de
l'agriculture qu'ils ont, par rapport aux « mauvaises images
» présentes chez les « gens originaires des fermes
» :
« Par exemple, en discutant avec différentes
personnes, je me suis rendu compte que, comme les personnes originaires des
fermes connaissent trop l'amertume de l'agriculture et les grandes
difficultés que leurs parents ont, certains en ont marre de
l'agriculture. Puis, il y a pas mal de gens originaires des fermes qui
étaient salariés et qui ont pris leur retraite. Eux, ils n' ont
pas envie de faire de l'agriculture, je pense. Mais, au contraire, les gens qui
ne se sont jamais occupés de l'agriculture jusqu'à maintenant,
n'ont pas de telles mauvaises images. Ils pensent plutôt même que
l'on peut travailler agréablement dans la montagne, quoique un peu
naïvement, infuencés par la télé etc. (rire).
Pourtant, ce n'est pas souvent la réalité...»
576 Ibid : 8.
577 Ibid : 9.
578 Ibid : 8.
579 Les objectifs principaux : inciter les habitants de se mettre
à l'agriculture compte tenu des problèmes liés au
vieillissement de population à venir (deuxième vie, Ikigai,
santé etc) ainsi que des problèmes agricole et rural
aggravés (augmentation de friches agricoles, diminution du nombre
d'agriculteurs). Et ainsi contribuer à la diminution de friches puis au
maintien de porteurs.
[Enquêteur : La `liberté' etc...]
« Une bonne image où il n'y plus de
contraintes (shigarami) comme à l'intérieur d'une entreprise
(kaisha), je crois. C'est pourquoi mon idée personelle est de bien
mettre en valeur de telles personnes. Je pense que c'est également un
travail dont il faut bien se charger en tant que conseiller. »
[Enquêteur : Pensez-vous uniquement aux personnes
âgées ?]
« Non. Si je parlais des retraités,en fait, il y
a aussi quelques jeunes dans Nô-Life, »
[Enquêteur : Ce qui est caractéristique dans
Nô-Life, c'est qu'il y a divers types de personnes. En
réalité, pas mal de personnes qui ne pensent pas forcément
à la `deuxième vie' etc.]
«Oui, il y en a qui essaient de gagner leur
croûte avec l'agriculture. Mais, surtout pour les jeunes personnes, on ne
leur apporte que de bonnes images, lorsque ils essaient de s'installer et nous
allons les orienter (rire jaune). Pour ceux qui vont gagner leur croûte,
on les oriente en disant que ce n'est pas si heureux que ça. S'ils
viennent uniquement avec de bonnes images comme ` il sera facile de gagner de
l'argent 'ou ` on me prêtera facilement de l'argent et je pourrai
facilement trouver des terrains' (rire jaune). Puis, s'ils n'ont que l'image
où l'on peut travailler en liberté et que c'est bien, cela mettra
en question notre responsablilié. Cela nous dérange s'ils
viennent avec une telle facilité. Donc, on les oriente comme il faut. On
les prévient même avant qu'ils y entrent. »
Là, on entrevoit qu'existe un décalage
réel entre des perceptions générales de l'agriculture chez
les nouveaux participants, qui sont « bonnes » mais souvent
opportunistes d'après Monsieur N, et celles qui sont normatives et
productivistes de l'ECV. Si Monsieur N s'exprime en faveur des nouveaux
participants, il affirme clairement que les principes d'orientation de l'ECV ne
vont pas changer vis-à-vis de ce type de personnes.
Mode d'actions
D'abord, le mode d'actions de L'ECV est fortement régi
« par le haut » aux niveaux juridique et institutionnel. En effet, la
Loi pour l'Incitation de l'Amélioration de l'Agriculture
(Nôgyô Kairyô Jochô Hô) définit la place
de l'ECV de façon à centraliser le pouvoir de décision au
niveau départemental, et définit également l'objectif de
l'établissement de l'ECV comme centré sur la diffusion des «
techniques et connaissances scientifiques sur la gestion agricole et la vie
rurale580 ».
En plus, Monsieur N nous a affirmé que l'ECV «
n'effectue que les travaux liés au Plan fondamental quinquenal
» dans lequel la coopération au Projet Nô-Life est
prévue dans le Plan fondamental 2006-2010. De ce fait, le mode d'actions
de l'ECV est, à la différence de la Municipalité ou de la
Coopérative agricole, moins marqué par la manière du
bricolage d'idées ou d'actions, ainsi que par la relation d'interaction
avec les autres agents concernés. En fait, le principe des idées
et du modes d'actions de l'ECV garde une forte autonomie assurée
à la fois par son rôle privilégié en tant qu' «
expert » technique, économique et scientifique, et par son statut
institutionnel régi par le département et l'Etat. D'où sa
politique à caractère productiviste et selectif qui persiste et
même a tendance à se renforcer malgré son constat de la
situation locale aggravée dû à la baisse de prix, au
vieillissement de la population agricole etc.
580 L'article 1 défini l'objectif principal de de cette
loi comme suit : « Cette loi incite les recherches et les
activités de vulgarisation relatives à l'agriculture afin que les
agriculteurs obtiennent les connaissances effectives et pratiques sur la
gestion agricole et la vie rurale, et puissent les diffuser et les
échanger. A cet effet, cette loi a pour l'objectif de développer
: la méthode agricole optimale et harmonieuse avec l'environnement; la
gestion agricole efficace et stable ; l'agriculture adaptée à la
spécificité locale, et ainsi de contribuer à
l'amélioration de la vie rurale. » Et l'Article 12
défini les trois tâches suivantes de l'ECV : «
synthèse des découvertes obtenues par les
activités » des Conseillers pour la Vulgarisation (Fukyû
shidôin) au sein des instituts de la recherche ; « mener des
activités visant à intégrer la vulgarisation et
l'orientation des techniques et connaissances scientifiques relatives à
la gestion agricole et à l'amélioration de la vie rurale
» ; « donner aux agriculteurs les renseignements relatifs
à l'amélioration de la gestion agricole et de la vie rurale
» ; « afin de promouvoir la nouvelle installation agricole, mener
les activités du renseignement et de la consulation etc. »
Prise de position vis-à-vis du Projet Nô-Life
L'ECV affirme son soutien au Projet Nô-Life en raison de
son attente vis-à-vis de ce projet dans sa capacité de former les
porteurs « non originaires des foyers agricoles (hinôka) » que
le Plan fondamental 2006-2010 appelle « nouveaux participants (shinki
sannyû sha) ».
Cependant, comme nous l'avons constaté dans l'examen du
Plan fondamental 2006-2010 ainsi que lors de l'entretien avec Monsieur N, son
implication dans le Projet s'effectue de manière à continuer le
principe productiviste et sélectif. (« Cela nous
dérange, s'ils viennent avec une telle facilité. Donc, on les
oriente comme il faut. On les prévient même avant qu'ils y
entrent. »)
D'ailleurs, dans un cours de la formation Nô-Life
donné par un conseiller de l'ECV à tous les stagiaires des
années 2005-2007 (l'enquêteur l'a observé en 2006), qui
porte sur la nouvelle installation agricole, ce conseiller n'a expliqué
le système de la nouvelle installation agricole qu'en terme de
système d'aides à l'investissement agricole qui est disponible
pour les « agriculteurs qualifiés (nintei nôgyô sha)
». Dans la définition de ce type d'agriculteurs, le revenu agricole
annuel doit s'élever au minimum à 2 500 000 yens, ce qui
dépasse largement l'objectif du Projet Nô-Life de « 1 000 000
yens de revenu agricole annuel ». Ce qui paraît à la grande
majorité des stagiaires difficile à réaliser, et peu
disponible pour eux.
Enfin, cette tendance « professionaliste » de la part
de l'ECV ne semble pas forcément correspondre aux attentes des
stagiaires de Nô-Life et également à l'objectif d'Ikigai
des personnes âgées.
Acteur 6 : Conseil Local de Toyota de la
Fédération des Syndicats Ouvriers du Département d'Aichi
(CLFS : Rengô Aichi Toyota Chikyô)
Caractère général de l'acteur
La Fédération des Syndicats Ouvriers
(Rengô) est aujoud'hui l'organisation majoritaire dans le monde syndical
japonais581. Le CLFS est une branche locale chargée du
territoire de la Ville de Toyota, qui regroupe une grande majorité des
syndicats présents dans ce territoire appartenant au Rengô
d'Aichi. Il fédère ainsi une grande majorité des syndicats
ouvriers présents dans la Ville de Toyota en formant la plus grande
organisation dans la Ville de Toyota ayant près de 70 000
adhérents. (Cf. Le nombre d'adhérents de la CAT est de 25623
personnes en 2005)
Missions du CLFS : niveaux global et local
Le CLFS a deux types de missions : l'une est globale et l'autre
locale. Sa mission globale est principalement l'implication politique via
notamment les activités électorales. Il a pour but d'augmenter
aux niveaux municipal,
581 C'est en 1989, que quatre grandes
fédérations syndicales dont Sôhyô qui
représentait principalement les syndicats du secteur public, et
Dômei, Shinsanbetsu et Chûritsu qui représentaient
également les syndicats du secteur privé dans les
différents secteurs industriels, se fédérènt pour
former Rengô. Aujourd'hui, elle soutient manifestement leParti
démocrate japonais (Minshu-tô). Le nombre d'adhérents est 6
726 000 en 2004, ce qui fait 19.2 % des employés au Japon en 2004 (selon
le Ministère de la Santé
publique et du Travail (Kôsei rôdôshô) :
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/weekly/no669/print.html).
Par ailleurs, les syndicats plus radicaux n'ayant pas rejoint le mouvement de
la fédération de Rengô en 1989, ont formé deux
fédérations minoritaires des syndicats ouvriers
(zen-rôkyô; zen-rôren) liées respectivement au parti
communiste japonais (Kyôsan-tô) et au partis socio-démocrate
japonais (Shamin-tô : l'ex-parti socialiste japonais). Leur nombre
d'adhérents est environ 300 000 (zen-rôkyô) et 1 000 000
(zen-rôren).
départemental et national, le nombre des
députés représentant l'intérêt du
Rengo582, afin de renforcer l'influence de leurs opinions dans le
monde politique. Et c'est via ces activités électorales que le
CLFS est intégré aux structures supérieures du Rengô
(départemental et national) tant au niveau institutionnel qu'au niveau
de ses représentations et de ses actions.
Sa mission locale concerne la coopération avec les
collectivités territoriales dont notamment la Municipalité de
Toyota, dans divers domaines y compris la politique agricole. Dans le cadre de
cette coopération, Monsieur Y, vice-directeur (jichô) du
secrétariat du CLFS, participe, en tant que représentant du monde
syndical de la Ville de Toyota, au comité pour l'élaboration du
Plan fondamental de l'agriculture depuis 2006583. Il s'implique
également dans le domaine de l'Aménagement de la Ville
(machizukuri) telle que l'organisation du Festival estival de la Ville de
Toyota.
Au travers de toutes ces activités locales, le CLFS
essaie ainsi de renforcer ses rapports avec les petite localités de la
Ville de Toyota et la population locale. Monsieur Y nous a expliqué
comme ci-dessous cette intention du CLFS :
« [Enquêteur : Essayez-vous ainsi de renforcer
notamment votre rapport avec les localités ?] Oui. Même si cela
n'a pas encore atteint le niveau suffisant, on exerce toujours nos
activités avec ce sentiment-là. J'imagine la scène
où nos camarades mènent leurs activités non seulement au
niveau global de la `Ville de Toyota Ç mais aussi au niveau des plus
petites localités comme les quartiers ou les villages. Il s'agit de ne
pas enfermer la vie de nos salariés dans leur entreprise, mais d'essayer
de pouvoir mieux communiquer avec la population locale via diverses occasions
possibles ».
Cette intention de renforcer le rapport entre les
adhérents (salariés de la Ville de Toyota) et les petites
localités ainsi que la population locale, est liée à la
thématique d'Ikigai aussi bien pour les salariés que pour les
retraités salariés. Ainsi, une des grandes thématiques
actuelles du CFLS est d' « élargir la variété
d'activités d'Ikigai pour les retraités salariés
». C'est également cette thématique qui a conduit le CLFS
à collaborer avec la Municipalité pour le Projet Nô-Life.
Nous l'aborderons plus bas en détail.
Changement de l'orientation des missions du CLFS : du
national au local
En fait, dans le CLFS, ce type d'activités
impliquées dans divers domaines de la politique publique locale,
n'existait pas auparavant. D'après Monsieur Y, les activités du
CLFS consistaient notamment à la revendication pour l'augmentation des
salaires en réunissant les syndicats de différents secteurs et
« en hissant les drapeaux rouges ». Mais aujourd'hui, face
à une diminution radicale du nombre d'adhérents du Rengô
dans la dernière décennie584 et à
l'augmentation du nombre de salariés non organisés585.
Ce qui risque de réduire inévitablement l'influence des syndicats
vis-à-vis des entreprises. Actuellement, le CLFS se préoccupe de
plus en plus d'intégrer ces couches de salariés non
organisées dans le Rengô.
D'un côté, le CLFS continue à mener,
vis-à-vis des entreprises, la revendication pour l'augmentation de
salaire et l'amélioration des conditions de vie des salariés,
mais de l'autre côté, le CLFS a progressivement diversifié
son mode d'implication directe dans la politique publique locale en
coopérant avec les collectivités territoriales dans divers
domaines. Ceci afin de transmettre plus largement ses opinions dans la
société. L'influence du CLFS est considérable dans la
politique publique de la Ville de Toyota, vu qu'il constitue le plus grand
organisme dans cette dernière avec plus de 70 000 adhérents.
Bref historique de la relation entre le CLFS et le Projet
Nô-Life : démarche réciproque pour
582 Ces députés appartiennent aujourd'hui au Parti
Démocrate Japonais : Minshu-tô.
583 La première réunion générale a eu
lieu le 1er août 2006, et la deuxième réunion
générale le 29 novembre 2006 où l'enquêteur
(rédacteur) a été présent en tant que public.
584 Depuis 1994, le nombre des adhérents du Rengô ne
cessa de diminuer. Rengô a perdu près d'un million
d'adhérents pendant la dernière décennie. (
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/weekly/no669/print.html)
585 Par exemple, ceux qui travaillent à temps partiel ou
avec un contrat à durée détermnée.
la promotion d'Ikigai des personnes âgées
L'établissement du premier rapport de
coopération entre le BPA (de la Municipalité de Toyota) et le
CLFS remonte à une date récente : nous l'avons vu dans la partie
de l'acteur 1, en 2003, lorsque la Municipalité effectua en
collaboration avec le CLFS, l' « Enquête sur la conscience sur
l'agriculture de Toyota (Toyota-shi Nôgyô ni kansuru Ishiki
Chôsa) » afin de recenser les attentes des salariés de la
Ville de Toyota vis-à-vis de l'agriculture et de la ruralité de
leur région. Cette enquête fut effectuée en pleine
période de l'élaboration concrète du Projet Nô-Life
et juste avant la remise, au gouvernement japonais en 2004, du dossier de
candidature pour l'application de la Politique de la Zone spéciale (voir
la partie de l'acteur 1). Donc, c'est à travers le Projet Nô-Life
que ce lien entre le BPA et le CLFS est né.
Par ailleurs, le CLFS avait déjà, bien avant le
Projet Nô-Life, une expérience antérieure dans le cadre
d'un projet pour la promotion d'Ikigai des personnes âgées. Il
s'agit de l'établissement de la « Maison des fleurs (Hana house)
» en 1997 : La Maison des fleurs est un ensemble de serres
dédiées à la culture horticole dont la gestion est
actuellement confiée au Centre des Ressources humaines
âgées (Silver Jinzai Haken Center). Elle a été
créée par la Municipalité de Toyota « pour
promouvoir la participation sociale des personnes âgées via leur
travail de la production horticole et en développer leur Ikigai et
améliorer leur santé 586». Monsieur Y, de
son côté, ajoute que :
« (...) C'était aussi dans le cadre de la
créaction dikigai. Les retraités produisent des fleurs, non pour
gagner leur vie, mais dans le prolongement du loisir. En produisant les fleurs,
ils décorent la Ville avec ces fleurs. Avant l'étape du Centre
Nô-Life, il y avait donc cela. »
En fait, c'était le CLFS qui avait pris l'intiative
pour pousser la Municipalité à créer La Maison des fleurs.
Il avait conçu l'idée de construire celle-ci dans le
résultat d'une enquête par questionnaire qu'il avait
effectuée auprès de ses adhérents. Puis, il a mené
son action auprès de la Municipalité de Toyota pour
l'établir au moyen de l'influence de députés appartenant
à Rengô.
Cet établissement devint ainsi un modèle
précurseur qui inspira plus tard le CPCI qui développa un
ensemble de mesures pour Ikigai depuis 2000 (voir l'acteur 2). Ainsi, dit
Monsieur Y, l'implication du CLFS dans l'élaboration du Projet
Nô-Life était « naturellement née, de
manière réciproque ».
Caractère général des données
Notre analyse du CLFS se base sur l'entretien effectué
par l'enquêteur (rédacteur) avec Monsieur Y, vice-chef du
secrétariat du CLFS (en 2006). Il est également adhérent
du Syndicat ouvrier de l'automobile Toyota (Toyota Rôso).
Il n'occupait pas son poste actuel lors de la distribution de
l' « Enquête sur la conscience sur l'agriculture de Toyota
(Toyota-shi Nôgyô ni kansuru Ishiki Chôsa) » en 2003
(car le personnel de ce poste change chaque année). Depuis 2006, il est
membre du Comité pour l'élaboration du Deuxième Plan
fondamental de l'agriculture de Toyota au sein de la Municipalité. Il
nous a accueilli dans le Bureau du CLFS pour répondre à nos
questions pendant près d'une heure.
Représentations
586 Section Bien-être et Vieillissement de la Direction
Santé et Bien-être, 2003 : 72. En 2004, 2684 personnes
âgées ont été usagers de cet établissement.
Pour le mois d'avril 2005, il y a près de 35 adhérents dont 6
travaillent par jours en alternance. (Section Bien-être et Vieillissement
de la Direction Santé et Bien-être de la Ville de Toyota, 2006 :
66.)
Les représentations de l'agriculture et de la
ruralité chez Monsieur Y porte sur des préoccupations dont les
deux niveaux s'imposent : global et local, ce qui correspond à la
caractéristique des missions du CLFS que l'on a constaté plus
haut.
Au niveau global, deux thématiques sur l'agriculture
sont énoncées en les mettant en relation avec les
thématiques du Projet Nô-Life : l'une sur l'auto-suffisance
alimentaire au Japon ; l'autre sur le manque de main-d'oeuvre agricole.
Préoccupations globales sur l'agriculture
Concernant l'auto-suffisance alimentaire, quoique personnelle,
Monsieur Y « a une forte prise en conscience » de ce
problème. Il s'agit de la forte dépendance alimentaire du
Japon587, qu'il la considère en rapport avec la
thématique du Projet Nô-Life : la prévention des friches
agricoles. Puis, il a évoqué la conjoncture internationale
actuelle où la grande croissance économique de nouveaux pays
émergents désignés sous l'acronyme « BRICs »
(Brésil, Russie, Inde, Chine) risque de rendre de plus en plus difficile
la condition du Japon pour assurer (importer) son alimentation. Monsieur Y
ajoute « déjà en réalité, la Chine a
commencé à manger le thon. Notre alimentation sera de plus en
plus menacée »588.
Puis, Monsieur Y établit le lien entre sa
préoccupation à propos de l'auto-suffisance alimentaire et du
manque de la main-d'oeuvre agricole au Japon, c'est-à-dire du manque de
« porteurs » de l'agriculture qui est également une des
thématiques du Projet Nô-Life. Cependant, Monsieur Y
considère ce problème de manière plus globale que dans le
cadre limité du Projet Nô-Life. Ceci notamment en suggérant
la nécessité d'introduire de la main-d'oeuvre
étrangère non seulement dans le secteur industriel mais
également dans le secteur agricole au Japon. En fait, il avait
suggéré ce point lors de la deuxième réunion
officielle du Comité pour l'élaboration du Deuxième Plan
fondamental de l'agriculture de Toyota qui eut lieu en novembre 2006. Ainsi,
sur ce point, il explique comme ci-dessous :
« (...) On est dans une situation où il est
difficile de compter sur les jeunes comme porteurs. Ce que j'avais un peu dit
lors de la dernière réunion, c'est qu'il faudrait que plus
d'immigrants étrangers installent pour nous aider. C'est d'ailleurs, ce
qui se passe déjà dans le secteur industriel. Dans la
région de Toyota, à peu près 5% des employés sont
déjà des étrangers, je crois. (...) Pour l'agriculture ou
la forêt, les jeunes ne se forment plus comme agriculteur, et on n'habite
plus dans la zone de moyenne montagne. Pour soutenir l'agriculture et la
forêt, la politique nationale doit réagir également, mais
l'essentiel, c'est de s'assurer d'abord, de quelque part, de la main-d'oeuvre.
(...) »
Et Monsieur Y en attribue la cause au fait que les jeunes ne
reprennent plus les activités agricoles, au fait que le
développement industriel est bien supérieur à celui de
l'agriculture dans la région de Toyota, comme une condition «
indéniable ».
Quel rapport établit-il entre ces préoccupations
globales et le Projet Nô-Life ? Pour lui, ce rapport est plutôt
problématique que positif, car les thématiques de
l'auto-suffisance et de la formation de porteurs de l'agriculture et celle
d'Ikigai sont presque incompatibles : « Les retraités
salariés ne pourront continuer à mener leur activité
agricole qu'au maximum dix ans. Après tout, il est impossible de les
considérer comme porteurs, à mon avis »
Cependant, les mesures pour l'infrastructure d'Ikigai sont
considérées comme nécessaire par le CLFS, mais elles ne
peuvent correspondre ni aux mesures pour les porteurs, et ni à celles
pour l'auto-suffisance alimentaire.
Puis, en rapport avec la thématique de la Politique de
la Municipalité de Toyota : « ville où vivent ensemble la
ville et les campagnes rurales et montagnardes », ainsi que la grande
thématique du Projet Nô-Life : Conservation des terrains
agricoles, Monsieur Y porte un regard plus global. En terme de
multifonctionalité -
587 Le taux d'autosuffisance alimentaire au Japon est
actuellement 40% en terme des calories, 70% en terme de chiffre d'affaires.
(Nôrinsuisan-shô, 2005).
588 Dans les médias également, ces dernières
années, on parle beaucoup de ce sujet au Japon. D'ailleurs, un bon
nombre de stagiaires du Projet Nô-Life ont également
évoqué ce problème en parlant du futur risque de la «
crise alimenaire au Japon »...
quoique implicitement -, il pense non seulement à la
conservation des terrains agricoles, mais également à celle des
forêts de montagne. Et il considère que c'est un «
très grand problème ». Mais il ajoute
également qu' « il faudrait le traiter avec une politique de
portée nationale ».
Préoccupations locales
Comme nous l'avons expliqué plus haut, la
thématique d'Ikigai (« élargir la variété
d'activités d'Ikigai pour les retraités salariés
») pour les retraités constitue actuellement une des
thématiques les plus importantes pour le CLFS dans le cadre de ses
activités pour renforcer le rapport entre ses adhérents et leur
localité. Et le CLFS diversifie les domaines de ses activités au
niveau local, au delà de ses activités traditionnelles comme la
revendication de l'augmentation des salaires, mais en s'impliquant, à
diverses occasions, dans la politique publique locale tels que
l'aménagement de la ville, la santé des personnes
âgées, la politique agricole de la Municipalité etc.
Et cette forme d'implication locale du CLFS ne peut pas
être considérée sans tenir compte de son propre
intérêt global en tant qu'un organisme appartenant à la
plus grande fédération syndicale au Japon : Rengô.
Notamment, la diminution radicale du nombre d'adhérents du Rengô
au cours de cette dernière décennie, reflète une
série de mutations du monde salarial contemporain (vieillissement,
tertialisation, précarisation, diversification de mode de vie etc.), ce
qui constitue un facteur déterminant du changement de comportement des
organisations syndicales au Japon. Aujourd'hui, comme le disait Monsieur Y plus
haut, le mouvement du CLFS ne consiste plus seulement à «
hisser les drapeaux rouges » pour revendiquer l'augmentation des
salaires, mais également à s'impliquer dans les divers domaines
de la vie de la population locale dont pour une grande partie sont des
adhérents. Et ceci en renforçant notamment le rapport avec la
politique municipale. C'est de cette manière-là qu'aujourd'hui,
le CLFS essaie de valoriser son existence dans la société.
Pour la thématique d'Ikigai des personnes
âgées, comme nous l'avons expliqué plus haut, le CLFS avait
déjà pris l'initiative de créer la Maison des fleurs en
1997. Et d'après Monsieur Y, la coopération entre le CLFS et la
Municipalité en matière du vieillissement, peut remonter encore
plus avant, si on parle d'une série d'actions menées par le CLFS
en collaboration avec la Municipalité telles que la quête (bokin),
la visite de maisons de retraite etc.
Cependant, l'idée de lier la thématique d'Ikigai
ou de la santé des personnes âgées à l'agriculture
ou à la ruralité, reste encore une nouveauté pour le CLFS.
En effet, la relation concrète entre le CLFS et un agent public du
secteur agricole de la Ville de Toyota, existe à peine depuis 2003
où il a collaboré avec le BPA de la Municipalité de
Toyota, pour effectuer l' « Enquête sur la conscience sur
l'agriculture de Toyota ». La motivation du CLFS pour son implication dans
les domaines agricole et rural semble rester encore partielle et
limitée. Malgré les attentes potentielles exprimées par la
couche salariale de la Ville de Toyota au travers de l'enquête de 2003,
l'intérêt réel de la part des salariés
vis-à-vis de l'agriculture et de la ruralité ainsi que du Projet
Nô-Life, n'est pas si enthousiaste parmi la majorité de cette
population. Ainsi, la motivation de type Ikigai pour les activités
agricoles ne peut pas correspondre facilement à l'objectif du Projet
Nô-Life tel qu'il est conçu par le BPA et la CAT à savoir :
la conservation des terrains agricoles et la formation de porteurs de
l'agriculture, via les activités agricoles de type Ikigai par les
retraités salariés.
Intérêt du côté des travailleurs :
jardinage, loisir, auto-consommation. Ecart avec l'objectif du Projet
Nô-Life
Il avait été constaté dans le
résultat de l'enquête de 2003, que 62.7% des enquêtés
ont exprimé une envie de mener des activités agricoles d'une
manière quelconque, et que 3 5.5% veuleut faire « un jardin potager
pour le loisir », 24.5% « pour l'auto-consommation » et 2.7%
« pour vendre des produits et en tirer un revenu ». Comme on le voit
dans ce résultat, si un bon nombre de salariés étaient
intéréssés par l'activité du jardinage à
titre de loisir ou d'auto-consommation, il y avait encore très peu de
gens qui imaginaient vendre leurs propres produits agricoles.
Nous pouvons rappeler ici un trait spécifique de la
population de Toyota : elle est constituée pour une grande partie, par
les « émigrants ruraux » venant d'autres régions
rurales pour travailler à Toyota dans le secteur automobile au cours des
années 65-75. D'un côté, ces émigrants gardent
souvent un certain attachement à la vie rurale qu'ils ont connu dans
leur enfance, et de l'autre ils ont peu de rapports sociaux dans leur
localité de la Ville de Toyota589.
En fait, Monsieur Y est lui-même ce type
d'émigrant rural : né dans une ferme d'une autre région,
il s'est installé à Toyota pour travailler dans l'usine
automobile Toyota, en raison de l'absence de travail dans son pays. Et il loue
actuellement une parcelle et cultive son jardin avec son épouse dans la
Ville de Toyota. Il affirme également qu'il connaît beaucoup de
gens autour de lui qui louent une parcelle et jardinent, et qu'ils ont une
haute motivation pour leur auto-consommation alimentaire. Pourtant, il affirme
également que lui-même « n'est pas si passionné
par la ruralité (nô) » et que sa motivation est dans le
prolongement du loisir. Ce qui ne le conduit pas à avoir une prise de
conscience concernant la conservation des terrains agricoles de la Ville.
Il trouve également « non réaliste
» l'objectif prôné par le Projet Nô-Life de gagner un
million de yens de revenu agricole. « Il faut, dit Monsieur
Y, le considérer séparémment. Ce qu'il faut faire pour
la conservation des terrains agricoles et la promotion d'Ikigai. »
Puis, il trouve qu'il est difficile pour les personnes âgées de
s'investir autant dans les activités agricoles : « En
investissant dix millions de yens et achetant des machines, combien
d'années faut-il pour que tout cela paie ? Il n'est même pas
sûr que cela paie en dix ans. »
Rapport avec la ruralité
Le CFLS a également une approche réaliste et
modeste vis-à-vis du principe de la politique municipale de Toyota :
« ville où vivent ensemble la ville et les campagnes rurales et
montagnardes ». En fait, Le CFLS mène des activités de
promotion vis-à-vis de ses adhérents pour leur participation
à des évènements d'animation rurale telle que la
randonnée dans une région montagnarde. Mais la participation des
adhérents n'est pas encore massive. D'après Monsieur Y, «
il n'y a pas de potion magique » pour promouvoir l'échange
entre la ville et la campagne. Mais il faut le faire « pas à
pas »...
Attentes vis-à-vis du Projet Nô-Life
Monsieur Y est pour l'idée d'élargir les zones
d'activités du Centre Nô-Life590 afin de faciliter la
participation de la population au Projet Nô-Life. Et pour Monsieur Y, le
Projet Nô-Life n'est pas encore suffisamment connu par la population.
Puis, lors de la réunion du Comité pour
l'élaboration du Deuxième Plan de l'agriculture de Toyota, il
avait proposé à la Municipalité de s'intéresser non
seulement aux retraités salariés mais également à
la jeunesse, notamment aux jeunes qui sont dans une situation précaire,
catégorisés aujourd'hui soit comme « NIET » soit comme
« Freeter »591. Par cette proposition, Monsieur Y pense
à la possibilité d' « éveiller ces jeunes
à la ruralité (nô) » avec le Projet
Nô-Life, quoique cela soit difficile à réaliser,
ajoute-t-il...
Limite de l'implication locale de la part du Syndicat
vis-à-vis des grands problèmes agricole et ruraux : pas au
delà de la promotion d'Ikigai
Tout en accordant de l'importance à la promotion des
activités d'Ikigai, et en affirmant l'initiative du syndicat ouvrier
dans ce domaine, Monsieur Y relève la limite des approches de type local
pour pouvoir faire
589 Monsieur K, président du Centre Nô-Life, et
Madame S de la Section de la Création d'Ikigai ont évoqué
cette caractéristique de la population de Toyota.
590 Comme cet élargissement a été
effectué en 2006 avec deux établissements supplémentaires
dont l'un dans une zone de moyenne montagne et l'autre dans une zone agricole
de plaine.
591 `NIET' est une catégorie anglaise signifiant
`Not in Education, Employment or Training' pour désigner une
couche de population qui n'est ni dans le travail ni dans l'éducation.
Elle est largement employée auj oud'hui au Japon tant par les
médias que par la politique.
face aux crises agricole et rurale via notamment la
conservation des forêts de montagne et des terrains agricoles. Car
celles-ci nécessitent une approche portant plus sur le long terme que la
promotion d'Ikigai pour les personnes âgées. Elles impliquent
également une problèmatique plus complexe entre les domaines
public et privé compte tenu que les propriétaires des
forêts de montagne et des terrains agricoles sont, pour la plupart, des
individus592. Ce qui exige, d'après lui, une approche plus
globale de la politique publique, à savoir la politique nationale.
Mode d'actions
Comme nous l'avons constaté plus haut dans la
caractéristique des missions du CLFS, ainsi que celle de ses
représentations, les deux niveaux d'approche coexistent dans son mode
d'actions : global et local. Son approche du niveau global est directement
liée à la politique nationale via les activités
électorales et l'élaboration de ses programmes politiques etc.
Au niveau local, même si le CLFS veut renforcer son
rapport avec la population locale, son approche n'a pas encore
réellement d'ancrage local sur les petites localités. Ceci
à la différence de la Municipalité de Toyota qui a des
centres locaux dans chaque quartier, car ce dernier, ayant été
une commune indépendante avant sa fusion avec la Ville de Toyota,
reutilisa son ancienne mairie après la fusion593. Et
également il se différencie, au niveau de son mode
d'organisation, de la coopérative agricole dont les organisations sont
historiquement ancrées dans les petites unités locales qui
peuvent aller jusqu'au niveau des petits hameaux ruraux dits « buraku
». De ce fait, l'approche de type local du CLFS est limitée
à la coopération qu'il mène de manière formelle et
institutionnelle notamment avec la Municipalité.
Rapport avec la politique de la Municipalité de
Toyota
Son implication dans le domaine de la politique agricole de la
Municipalité de Toyota n'a marqué qu'au début de sa
coopération avec cellc-ci. Et sa participation du CLFS dans
l'élaboration du Deuxième Plan de l'agriculture de Toyota, reste
encore individuelle594. De ce fait, il n'y a pas encore de
discussion dans l'ensemble du CLFS sur la thématique de la politique
agricole.
Approche événementielle
Par rapport à la relation avec la ruralité,
l'approche du CLFS reste après tout évènementielle dans le
cadre de l'aménagement du territoire de la Ville de Toyota (comme la
journée de la randonnée). Si Monsieur Y met l'accent sur
l'importance de mener ce type d'actions « pas-à-pas » pour
intéresser réellement les adhérents à la
ruralité, le CLFS n'a pas d'autres types d'approches à mener de
manière plus permanente et basée sur les localités.
Tendance de l'action politique vers l'Etat plutôt que
vers la municipalité : peu de possibilité de bricolage et
d'interaction
Le CLFS a toujours tendance à recourrir à
s'adresser au niveau national plutôt qu'au niveau local, pour les grandes
thématiques comme la crise agricole. Monsieur Y affirme ainsi la
difficulté de s'impliquer de manière plus approfondie dans le
Projet Nô-Life, « car il faut faire face à des
thématiques plus grandes que la
592 Monsieur Y participe également à un projet
municipal de Toyota pour la conservation des forêts de montagne.
593 Chaque centre dont le nom est "community center", dispose
non seulement un ensemble de fonctions administratives, mais également
des locaux pour les activités culturelles. Une grande partie des
activités dans le domaine de l'éducation permanente se passe dans
ces centres locaux de la Municipalité.
594 Elle dépend de la volonté de la personne qui en
est responsable. C'était ainsi le tour de Monsieur Y en
été 2006.
promotion d'Ikigai ». Du coup, on peut remarquer
que le CLFS a peu de possibilité de s'impliquer de manière
à interagir avec les autres agents ou à mener des actions
flexibles en « bricolant » des idées globales et locales...
Prise de position vis-à-vis du Projet Nô-Life
Vu toutes les tendances du mode d'actions du CLFS, son
implication dans le Projet Nô-Life reste distanciée. Si Monsieur Y
affirme son « soutien » au Projet, cela reste uniquement dans le sens
de la promotion d'Ikigai, mais ceci sans essayer d'aller plus loin...
Acteur 7 : Groupement d'Arboriculteurs de Sanage pour
l'Aide aux Travaux Agricoles (GASATA)
Le processus de la construction du Projet Nô-Life n'a
pas été mené seulement par des grands agents
institutionnels, mais également par des agriculteurs locaux
concernés. Le Groupement d'Arboriculteurs de Sanage pour l'Aide aux
Travaux Agricoles (GASATA : Sanage Nô-sagyô Jutaku Kumiai) a ainsi
joué un rôle décisif pour concrétiser le Projet
Nô-Life en tant que collaborateur du BPA de la Municipalité de
Toyota.
Caractère général de l'acteur
Historique de l'organisation
Le GASATA est une association d'arboriculteurs du pays de
Sanage qui a pour but d'aider les arboriculteurs du même pays dans leurs
travaux agricoles. Constituée de 17 arboriculteurs professionnels, elle
fut créée au printemps 2003 à l'initiative de trois
arboriculteurs professionnels du pays de Sanage, dont le chef est Monsieur N
que nous avons intérrogé, et qui étaient soucieux de
l'aggravation de la situation de leur zone de production
spécialisée de pêches et de poires, en raison du
vieillissement des producteurs, du manque de successeurs, de l'augmentation
progressive des friches etc.
En effet, dans le territoire de la Ville de Toyota, certains
quartiers du Pays de Sanage constituent une « zone de production (sanchi)
» par excellence qui s'est développée depuis les
années 70 en se spécialisant dans la production de la pêche
et de la poire. Une centaine de producteurs constitue la grande majorité
des membres des deux groupements de producteurs au sein de la CAT dont l'un est
spécialisé dans la pêche et l'autre dans la poire. Et la
CAT dispose, à l'usage de ces groupements, d'un centre de calibrage des
fruits doté d'une série d'équipements modernes
récemment introduits (transporteur à rouleaux pour le calibrage,
machine à mesurer le degré de sucre par laser,
réfrigérateur et congélateur pour le stockage des fruits
etc).
Puis, face à la situation aggravée de cette zone
de production, Monsieur N a eu l'idée de créer une association de
producteurs ayant pour but d'aider les travaux agricoles des arboriculteurs qui
sont en difficulté pour continuer leur activité. A cet effet, il
avait d'abord commencé à discuter de cette idée avec deux
jeunes arboriculteurs et un jeune conseiller agricole de l'ECV avec lesquels il
« était de plain-pied » pour lancer officiellement
cette association.
Ensuite, c'est dans le cadre de la discussion pour
l'établissement du GASATA en 2002 que fut établi le lien entre le
GASATA et le BPA. En effet, à un certain moment après le
début des réunions pour le lancement du
projet de cette association, le BPA ainsi que la CAT,
intéressés par ce projet, ont pris contact avec les trois
arboriculteurs qui étaient les principaux organisateurs de
l'association, pour se renseigner sur le projet. Et six mois après le
début des réunions pour l'établissement du GASATA, le
président du Centre Nô-Life (Monsieur K) qui, à cette
époque, travaillait pour l'élaboration du Projet Nô-Life, a
rejoint ces réunions. Ceci en vue de coopérer avec cette
association pour leur objectif commun : faire face au vieillissement de la
population rurale et prévenir les friches agricoles.
Fonctionnement du GA SA TA
Le GASATA fournit des aides aux travaux agricoles en
répondant à la commande de chaque arboriculteur. Le contenu de
ces aides est varié : désinsectisation, fumage, taille des
arbres, désherbage, plantation etc. Une liste précisant le frais
de chaque travail est établie en prenant compte de la surface
concernée, du coût de travail et du coût de l'utilisation
des machines etc. Pour la première année, le GASATA a
effectué des travaux pour 28 arboriculteurs soit 0.1 8ha au total.
Historique du rapport avec Nô -Life
Après le lancement officiel du GASATA au printemps
2003, la collaboration entre le Centre Nô-Life qui préparait son
inauguration pour l'année suivante, et le GASATA, a commencé pour
élaborer le programme de la filière de l'arboriculture de la
formation du Centre Nô-Life.
Le GASATA participe ainsi au Projet Nô-Life depuis son
inauguration au printemps 2004. Les 17 arboriculteurs professionnels membres
accompagnant les stagiaires, en tant qu'enseignants de la filière de
l'arboriculture, pour les exercices pratiques de terrain. Monsieur N, a
également proposé quelques parcelles de ses vergers de poirier
à l'usage des exercices pratiques de cette filière.
Caractère général des données
Notre analyse du GASATA se base sur l'entretien effectué
par l'enquêteur (rédacteur) avec Monsieur N, chef du GASATA. Il
nous a accueilli dans sa maison pour répondre à nos questions
pendant près d'une heure et demi.
Depuis près de 35 ans, dès la fin du
lycée, Monsieur N a repris l'exploitation de ses parents qui, à
cette époque, produisaient du riz, des tomates et des concombres, mais
pas encore des fruits. Depuis son installation au début des
années 70, il a progressivement converti les rizières et les
champs en vergers de pêchers et de poiriers. Il gère actuellement
2.3ha de vergers dont 1 .7ha de pêchers et 0.6ha de poiriers.
Il travaille principalement avec son épouse sur son
exploitation, et son père de 80 ans leur vient de temps en temps en aide
pour les travaux. Ayant quatre enfants dont trois travaillent
déjà à l'extérieur de l'exploitation, Monsieur N
travaille aujourd'hui comme arboriculteur professionnel.
Représentations
Monsieur N est l'un des arboriculteurs les plus dynamiques du
pays de Sanage tant au niveau économique que social. Et ses engagements
pour le GASATA et pour la coopération au Projet Nô-Life semblent
manifestes tout en dépassant la dimension personnelle de son
intérêt pour la gestion de sa propre exploitation. Pour quelles
motivations s'implique-t-il dans le Projet Nô-Life ? Et quelles sont ses
attentes vis-à-vis du Projet Nô-Life ? Quelles idées
sous-tendent ses actions ?
Préoccupations primordiales : risque du
délabrement de la zone de production
La préoccupation qui marquait le plus l'action de
Monsieur N pour le lancement du GASATA était d'éviter que sa
« zone de production se délabre (sanchi ga areru) ».
Et l'accord entre Monsieur N et Monsieur K, président du Centre No-Life,
pour mener leur coopération, se base sur l'objectif de réagir
contre ce risque du délabrement de la zone de production.
Cette préoccupation reflète la conscience à
la fois collective et historique que Monsier N a de sa zone de production
fruitière dont il a vécu le développement depuis plus de
trente ans.
Puis, Monsieur N insiste fortement sur l'importance
d'établir le rapport entre sa zone de production et le public. Et ceci
constitue, d'après lui, un élément crucial dans la
préoccupation de tous les producteurs du pays : « En fait,
dit Monsieur N, y compris mes enfants, pour l'agriculture de demain,
il faut qu'un maximum de gens s'y impliquent, sinon cela ne marchera absolument
pas. Tout le monde pense comme ça. Donc, on ne pense pas du tout
à faire reprendre son exploitation par ses enfants. Quiconque s'y
intéresse sera le bienvenu. C'est comme ça, chez tout le
monde. »
Monsieur N avait ce sentiment depuis bien avant le lancement
du Projet Nô-Life. C'est ainsi qu'il a lancé vers 1992 - 1993 la
« Journée de la peinture des fleurs de pêcher (momo no hana
shasei taikai) » qui est un évènement pour l'animation
locale consistant à ouvrir certains vergers de pêcher au public
pendant une journée vers le début avril où les
pêchers fleurissent (on l'abordera plus bas).
Enfin, il met également l'accent sur le fait que
l'établissement du GASATA et l'organisation de la journée de la
peinture ont renforcé la relation d'entraide entre arboriculteurs qui
avaient auparavant l'habitude de travailler individuellement.
Hisorique de la formation de la zone de production
Pourquoi et comment est-il parvenu à avoir une telle
prise de conscience pour réagir contre l'urgence du délabrement
de sa zone de production non de manière à mener à bien
seulement sa propre production individuelle, mais de manière à
renforcer l'entraide entre arboriculteur et même à
intéresser le public ?
Pour répondre à cette question, rappelons ici
l'historique de la « réussite » collective du Pays de Sanage
qui s'est constitué en une zone de production de la pêche et de la
poire, en suivant l'explication de Monsieur N.
Situé dans une zone ensoleillée au piéd
du Mont de Sanage595, le pays de Sanage était au début
un pays où étaient plantés beaucoup d'arbres de Kaki. Mais
ils furent dévastés par le Typhon du Golf d'Ise (Isewan
Taihû) de 1959596. Puis, depuis vers 1965, les agriculteurs
commençaient petit à petit à planter, à titre
expérimental, les pêchers dans la montagne. Et depuis 1970, la
conversion aux autres cultures (légumes ou fruits) était
suscitée par la « politique de la réduction de la surface
rizicole (gentan seisaku) » de l'Etat, avec des subsides. C'est dans ce
contexte que les « pêchers sont descendus de la montagne
». Au début, plusieurs petits groupes de producteurs dont chacun
était constitués par 4-5 personnes, réunissaient par
eux-même leurs fruits pour les distribuer au marché. Vers 1975,
lorsque les arbres plantés sur le terrain des rizières avaient
bien grandi, les groupes de producteurs professionnels (non des foyers
pluriactifs) ont mis en place un système de calibrage collectif dans un
local commun. Ensuite, les gens (« papis et mamies ») des
foyers agricoles pluriactifs ont commencé à y participer. Enfin,
en 1997, à l'initiative de la CAT, un grand centre de calibrage fut
construit avec une série d'équipements modernes pour
rationnaliser la distribution des produits de ces arboriculteurs. Aujourd'hui,
le Pays de Sanage constitue la plus grande zone de production de pêches
et de poires dans le Département d'Aichi, avec leur propre marque comme
« Pêche de Toyota (Toyota no Momo) » et « Poire de Toyota
(Toyota no Nashi) ».
La pêche et la poire constituent ainsi les atouts
décisifs dans le développement historique de l'agriculture de
l'après-guerre au Pays de Sanage. D'un côté, celles-ci
constituent, aujourd'hui, plus ou moins des symboles de l'identité
collective et historique des arboriculteurs de ce pays. Ceci est non seulement
dû à leur réussite
595 Sanage-san situé au nord du Pays de Sanage, dont le
point culminant est 628.9m.
596 Un des trois grands typhons historiques au Japon de
l'ère de Shôwa.
économique, mais également dû à
l'organisation collective des arboriculteurs autour de ces produits depuis une
quarantaine d'années. Mais de l'autre côté, cette
identité collective et historique a un caractère
éphémère : elle ne peut pas être confondue avec
l'identité traditionnelle ou communautaire, car l'introduction de ces
produits était liée à la politique nationale des
années 70, et on ne peut pas ignorer le fait que sa réussite
était clairement due à la haute croissance économique
japonaise.
D'ailleurs, la pêche et la poire ne sont pas
considérées, chez Monsieur N, comme des produits à
être transmis de génération en génération.
Tout d'abord, les parents de Monsieur N ne faisaient pas de pêches ni de
poires avant que Monsieur N ait commencé à les planter. Puis,
d'après Monsieur N, « tous » les arboriculteurs du
Pays de Sanage, ne pensent pas forcément à faire reprendre leurs
vergers par leur fils: « Cela m'est égal, dit Monsieur N,
si mes enfants reprennent mes vergers ou pas. Pour moi, je l'ai fait
jusqu'à aujourd'hui, parce que il n'y avait que ça à
faire. Mais s'il y a d'autres façons de vivre pour mes enfants, ce
serait bien aussi, je pense. » Et ses enfants n'ont jamais
participé au travail de Monsieur N lorsqu'ils étaient petits :
« Aide ? dit Monsieur N, Ils n'ont jamais fait. Mon fils
ainé et le troisième ont fait un lycée agricole, mais ils
ne m'ont jamais aidé. D'ailleurs, je ne leur ai même pas
demandé. Ils ne pensent peut-être même pas que je me donne
beaucoup de peines pour mes vergers. D'ailleurs je ne travaillais pas non plus
de manière extrèmement dure. Au contraire, ils se demandaient
peut-être 'pourquoi notre père reste tout le temps à la
maison ?'(rire) »
Par contre, le sentiment du refus du délabrement des
vergers de Monsieur N peut s'expliquer par le fait que le délabrement
risque de dévaloriser la relation sociale historiquement
constituée entre arboriculteurs dont l'oeuvre est la zone de production
elle-même. Mais l'intention de ne pas perpétuer forcément
ses vergers via une succession familiale, mais de recourir au public pour
valoriser ses vergers, semble être liée à un raisonnement
plus particulier de la part de Monsieur N et des autres arboriculteurs
professionnels. Nous pouvons supposer que Monsieur N et les autres
arboriculteurs professionnels reconnaissent bien que leur réussite de la
production de la pêche et de la poire n'est pas seulement l'oeuvre de
leur propre travail à eux, mais également celle de la situation
historique impliquant une dimension plus globale (politique de la
réduction de la surface rizicole, haute croissance économique
etc). C'est sans doute pour cela qu'il ne considère pas forcément
ses vergers (en tout cas, sa production de la pêche et de la poire) comme
des biens à transmettre absolument à ses fils.
Puis, l'idée de rendre public la gestion de ses vergers
et sa zone de production lui permet de concilier son intérêt de
maintenir la zone de production comme étant l'oeuvre de sa relation
sociale et historique, et son renoncement à la perpétuation de
ses vergers comme biens de sa famille (ceci contrairement à ce que les
chercheurs imaginent souvent concernant la gestion de patrimoine familial chez
les agriculteurs).
C'est ce qui pourra expliquer pourquoi - on abordera plus bas
- Monsieur N accorde davantage de l'importance à la continuation des
activités agricoles des foyers agricoles pluriactifs dont ce sont
souvent des personnes âgées qui entretiennent les vergers en
l'absence de leurs enfants qui travaillent à l'extérieur. En
effet, le GASATA est créé notamment afin d'aider ce type
d'arboriculteurs et de rendre possible la continuation de leur production. Il
s'agit des arboriculteurs du pays de Sanage de la « première
génération » qui précède la
génération de Monsieur N. Le problème que Monsieur N a
relevé est qu'il n'arrive pas à proposer à ces gens de la
première génération, de nouvelles démarches
associatives comme le GASATA ou la Journée de la peinture ou le Projet
Nô-Life. Car ils ont tendance à « suivre les autres
» qui sont plus jeunes et plus dynamiques et ne considèrent les
groupements de producteurs ou la coopérative agricole que comme un moyen
pour la vente de leurs propres produits. Du coup, ce fut toujours avec des
arboriculteurs plus jeunes de la « troisième
génération » (30 - 40 ans) que Monsieur N a mené ses
démarches associatives. Mais l'incertitude de la continuation des
activités agricoles pèse le plus sur ces foyers de la
première génération597.
597 D'après Monsieur N, environ 20 arboriculteurs
professionnels et « un quart » des foyers agricoles de son
village sont pluriactifs et gérés par les grands parents. Et
environ 60 membres au total font partie des groupements de producteurs de la
pêche et de la poire. Par ailleurs, d'après la statistique de la
Ville de Toyota pour l'an 2000, dans le village de Monsieur N, il y a 56.22ha
de vergers sur 66.33ha de la surface totale. Et 42 foyers dont 12
professionnels, 13 pluriactifs de la première catégorie (qui
gagnent plus que la moitié des revenus de leur foyer avec leurs
activités agricoles) et 17 pluriactifs de la deuxième
catégorie (qui gagnent moins que la moitié des revenus de leur
foyer avec des activités agricoles.) Au pays de Sanage, grâce
à sa production fruitière, le pourcentage du nombre des foyers
professionnels sur le nombre total des foyers agricoles est le plus
élevé : 15% (62 sur 412) par
Journée de la peinture de 1993-2003 : première
action pour établir un rapport entre la zone de production et le
public
Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, la «
Journée de la peinture des fleurs de pêcher (momo no hana shasei
taikai) » fut la première action menée à l'initiative
de Monsieur N qui était alors le président du Groupement de
producteurs de la pêche de Toyota (JA Toyota- shi momo bukai). Ceci
consistait à ouvrir les vergers au public et en faire une «
contribution sociale (shakai kôken) ». Monsieur N
l'explique ainsi avec enthousiasme :
« [ Enquêteur : Depuis quand vouliez-vous
établir un rapport avec le public qui n'a pas de lien avec l'agriculture
?] Depuis toujours. Vers 1993, 1994, lorsqu'il n'y avait pas encore le grand
centre de calibrage là-bas, on se disait 'on ne peut pas rester comme
ça. Il faut faire une contribution sociale !' et ainsi on a fait la
journée de la peinture. (...) C'est ce que l'on a fait d'abord. Ensuite,
on a fait appel à tout le monde, le président de la
coopérative et compagnie. En parlant avec des jeunes arboriculteurs, on
se disait 'nous le commençons enfin...!'. Puis, cela a duré 11
ans. Quelques milliers personnes sont venues. Et du coup, si on parle de cet
évènement, tout le monde en est au courant. C'est important. Si
on compte que sur nous, cela ne marchera vraiment pas. »
Dans cette explication, on voit ce qui était essentiel
pour Monsieur N pour lancer la journée de la peinture : faire
connaître au public la zone de production de la pêche et de la
poire du Pays de Sanage (« si on parle de cet évènement,
tout le monde en est au courant. C'est important ») Puis, à
travers cette action, il pensait amener la gestion de la zone de production de
manière à intégrer le « public » (« Si
on compte que sur nous, cela ne marchera vraiment pas
»)598.
L'établissement du GASATA en 2003 : besoins internes
des arboriculteurs
Ensuite, Monsieur N a mené son action pour monter le
GASATA en 2002. L'initiative fut prise par Monsieur N et d'autres jeunes
arboriculteurs de manière spontanée et indépendante des
grands organismes comme la municipalité et la coopérative
agricole. Ceci en tenant compte des deux aspects suivants : la
nécessité de renforcer l'entraide entre arboriculteurs de
manière formelle ; vieillissement des arboriculteurs (y compris
lui-même). Sur le premier point, Monsieur N s'explique ainsi :
« En fait, quand on est paysan, on est `almighty' en
faisant tout, quelques soit les échelles, grande ou petite. Puis, on n'a
pas de limite au niveau du temps. Et si on répond à une demande
d'aide de quelqu'un, on finirait par dire que l'on est seulement gentil. Mais
pour pouvoir passer à une époque suivante, je me disais, il
faudrait valoriser en monnaie nos compétences, quoiqu'une idée
réaliste »
Dans cette explication, on voit bien que l'intention de
Monsieur N était de conserver les vergers pour le futur (« pour
pouvoir passer à une époque suivante »), et ensuite
d'organiser formellement l'entraide entre arboriculteurs via une
monnaitarisation des aides aux travaux agricoles. En appliquant cette
méthode, il avait l'intention de résoudre à la fois les
problèmes existants chez les arboriculteurs professionnels membre du
GASATA, et chez les demandeurs d'aides aux travaux agricoles : Du
côté des membres du GASATA, il y avait une difficulté pour
répondre « sans être prévenu »aux
demandes d'aides aux travaux agricoles, et de manière à devoir
« tout faire », alors qu'ils avaient leur travail à
faire dans leur exploitation. Du côté des demandeurs d'aides, ils
ne pouvaient s'adresser qu'aux gens qu'ils connaissaient bien, et ils
étaient gênés de demander des aides aux autres
arboriculteurs pour de grands travaux. Le fait d'établir une liste des
contenus des aides aux travaux agricoles avec les frais précis, allait
donc régler ces problèmes qui existaient implicitement entre
rapport à 8% pour l'ensemble de la Ville de Toyota (269
sur 3238) (Toyota-shi, 2004 : 150-154)
598 Et cela n'exclut pas, bien évidemment, que Monsieur N
escomptait un effet de la promotion de leurs produits sur le marché.
arboriculteurs.
Puis, deuxièmement, la préoccupation de Monsieur N
concernait le problème de son propre vieillissement. Il l'explique ainsi
:
« Puis, lorsque j'ai commencé à avoir
plus de 50ans, je me suis dit, si je ne peux plus continuer à
travailler, la vie de ma famille ne marchera plus. Et si, dans une telle
situation, quelques collègues à moi étaient là pour
prendre le relais pour un ou deux mois pendant lesquels j'ai une fracture ou
d'autres problèmes, je pourrais reprendre mon travail après,
n'est-ce pas ? Et je me suis dit que les personnes âgées devaient
penser la même chose, encore plus fort que moi, d'ailleurs. Je pensais
comme cela depuis longtemps à travers mes activités de la gestion
de mon exploitation. »
D'après cette explication, il a eu l'idée de monter
le GASATA, par sa propre réflexion, de manière à
répondre à la fois à son propre besoin ressenti par
lui-même et à celui des autres producteurs âgés.
Actuellement, trois ans après le lancement du GASATA,
les avantages du projet sont nets : « Il y a, dit Monsieur N,
des gens qui nous disent ' Brusquement, le papi a eu une fracture et il ne peut
pas travailler pendant deux mois. Vous pouvez faire tel ou tel travail ?' Et
après, ils sont très contents ! Car, ces papis ne veulent pas
arrêter leur travail, mais ils veulent continuer. C'est seulement pendant
un moment qu'ils ne peuvent pas travailler ».
Puis, les activités du GASATA ont également permis
aux arboriculteurs de mieux communiquer (échanger des opinions,
apprendre des techniques des uns et des autres etc)
Préoccupation actuelle : une stratégie pour
subsister...
Quelles sont les préoccupations actuelles de Monsieur N
? C'est bien son propre avenir à lui-même, ainsi que celui des
autres arboriculteurs du Pays de Sanage. Ce qui est primordial dans ses
préoccupations, c'est de « garder l'attention du public sur
[sa] zone de production » avec l'implication du public, à
savoir : les « gens des autres secteurs industriels » ; la
municipalité ; la coopérative agricole. C'est pour cela que le
GASATA s'est fortement impliqué dans le Projet Nô-Life.
Il s'agit également d'une stratégie pour
subsister. C'est pourquoi Monsieur N met l'accent sur l'importance de la
continuation des activités du GASATA afin de maintenir une
cohésion plus solide entre arboriculteurs. Pour lui, il est plus
difficile de prendre des décisions collectives au niveau des groupements
de producteurs, dans lesquels chaque arboriculteur ne se préoccupe que
de vendre ses produits. Et d'après Monsieur N, c'est via le GASATA que
les arboriculteurs pourraint se soutenir, même avec les producteurs
âgés, et c'est avec lui qu'il faut maintenir la relation avec la
municipalité et la coopérative agricole.
Rapport avec les producteurs âgés des foyers
pluriactifs
Comme nous l'avons suggéré plus haut, l'objectif
réel du GASATA consistait à aider notamment les arboricultuers
âgés de la couche des foyers agricoles pluriactifs afin de leur
faire continuer leurs activités de la production pour éviter le
délabrement de la zone de production. Et le problème pour
Monsieur N était l'absence d'« occasion » de discuter
de ses idées pour mener de nouvelles actions avec ces producteurs
âgés, car il était difficile pour lui d'en discuter dans le
seul cadre des groupements de producteurs pour la vente. Ces groupements ont
uniquement pour objectif la vente commune, et Monsieur N les trouvent «
trop grands » pour mener de nouvelles actions599 C'est
pour cela que Monsieur N a entrepris le GASATA avec des jeunes arboriculteurs
pour d'abord « montrer » aux producteurs âgés,
telles ou telles idées et actions concrètes. Ceci pour que ces
producteurs âgés puissent ainsi les « suivre
»...
599 D'après Monsieur N, il y a « à peu
près soixantaine » de producteurs dans ces groupements de
producteurs. Par ailleurs, d'après une statistique de l'Ex-Centre pour
la Vulgarisation, 53 membres dans le groupement de producteurs de la
pêche et 85 membres sont dans le groupement de producteurs de la poire.
Centre pour la Vulgarisation et l'Orientation de Toyota-Kamo, 2001b : 9.
Arboriculteurs du Pays de Sanage vus par
génération
D'après Monsieur N, les arboriculteurs du Pays de
Sanage sont composés de trois générations. La
première génération est celle correspondant au père
de Monsieur N, c'est-à-dire les arboriculteurs de la
génération nés dans les années 20 et 30 qui ont
commencé leur production de pêches et de poires dès les
années 70. Selon ce schéma, Monsieur N est
considéré comme l'aîné des arboriculteurs de la
deuxième génération600. Parmi les
arboriculteurs de la troisième génération, ceux qui ont la
quarantaine sont les plus nombreux. Ceux qui ont la trentaine ne
représentent qu'un petit nombre. Et il n'y a personne de la vingtaine
(sauf un qui aide son père en tant que futur successeur)
Et parmi ces trois générations, Monsieur N
prête particulièrement attention à la
génération « de son père ou de sa tante
», il s'agit de la première génération. « Il
faut, dit Monsieur N, bien prêter attention à la
génération de mon père ou de ma tante. C'est parce que si
ces gens-là continuent à bien mener leur production malgré
la petite échelle de production, leur fils qui travaille à
l'extérieur voudra la reprendre plus tard. Comme ça, il n'y aura
pas de délabrement, n'est-ce pas ? ». Et quel regard a-t-il
sur les producteurs professionnels ? : « Pour nous, dit Monsieur
N, c'est pas la peine. De toute façon, les professionnels
n'ont qu'à produire ». Pour Monsieur N, c'est chez les
producteurs âgés des foyers pluriactifs que réside le
facteur déterminant du délabrement de la zone de production et
qu'il faut y faire face en tenant compte des conditions dans lesquelles leurs
fils, actuellement salariés, peuvent reprendre la production de leurs
parents après leur retraite.
Et Monsieur N constate déjà qu'il y a
actuellement quelques salariés originaires des foyers agricoles
pluriactifs qui ont l'intention de reprendre la production de leurs parents, et
qu'ils s'intéressent au Projet Nô-Life. Nous pouvons
également rappeler qu'il y a déjà une femme d'un âge
moyen qui a commencé à produire la poire et la pêche chez
elle dès la fin de sa formation Nô-Life en 2005 !
Rapport avec le Projet Nô -Life
Le GASATA s'implique directement dans l'exercice du Projet
Nô-Life dans le cadre de la « filière fruitière
(kaju-ka) » de la formation Nô-Life.
Nous avons constaté que l'intérêt propre
du GASATA pour participer au Projet Nô-Life est manifeste :
développer son rapport avec le public en collaboration avec la
Municipalité de Toyota dans le but de conserver sa zone de production
fruitière en évitant ainsi le risque du délabrement de
cette zone de production dont les facteurs sont l'abandon et la mise en friche
de vergers par les producteurs en difficulté (âge, maladie,
pluriactivité, manque de successeurs etc). Quelles idées le
GASATA applique-t-il alors pour travailler dans le Projet Nô-Life ? Quels
avis a-t-il sur ce projet à travers son implication ?
Problèmes rencontrés dans le stage pratique au
verger : « vraies techniques » difficiles à transmettre...
Depuis le printemps 2004, l'année de l'inauguration du
Centre Nô-Life, le GASATA participe aux activités de la
filière fruitière de la formation Nô-Life. 17
arboriculteurs professionnels du GASATA jouent le rôle d'accompagnateur
des stagiaires en tant qu'enseignants pour leur stage pratique au verger. Le
nombre de stagiaires de la filière fruitière est de : 14 pour les
années 2004-2006 ; 12 pour les années 2005-2007 ; 9 pour les
années 2006-2008. Dans leur programme, la deuxième année
de la formation est principalement consacrée au stage pratique au verger
dans lequel les stagiaires gèrent par eux-même pendant toute
l'année un verger de pêchers et un verger de poiriers dont
l'échelle est environ de 10-20a pour chacun de ces vergers. Dans ce
stage pratique, les stagiaires sont censés appliquer les connaissances
qu'ils ont acquises dans les cours théoriques et pratiques qu'ils ont
suivis la première année601.
600 Ceci alors que, dans son cas, c'est lui-même qui s'est
lancé à la pêche et à la poire en reprenant
l'exploitation de son père.
601 Sur la présentation générale des
activités de formation Nô-Life, voir le chapitre 3.
En fait, la filière fruitière, par rapport aux
autres filières (culture maraîchère ; cultures
maraîchère et rizicole'), a connu plus de problèmes dans le
déroulement de son programme de formation. Il s'agit d'une discordance
entre le comportement des stagiaires et la condition de stage donnée par
le Centre Nô-Life et le GASATA. Nous pouvons donner ici un exemple de
l'échec du stage pratique au verger des stagiaires des années
2004-2006 qui s'est déroulé en 2005.
Le stage pratique des stagiaires des années 2004-2006 a
été effectué sur 1 5ares de vergers de pêchers
appartenant à Monsieur N. Un certain nombre d'arbres ont
été attribués à chaque stagiaire, chacun
étant chargé de l'entretien de ces arbres pendant toute une
année. Cependant, les stagiaires ont mal entretenu les arbres, et cela a
eu pour conséquence l'apparition de maladies et la prolifération
d'insectes nuisibles qui se sont répandus jusqu'aux vergers
environnants. Puis, Monsieur N a finalement dû abattre les arbres
entretenus par ces stagiaires en raison de la dégradation de la
viabilité de ces arbres. De ce fait, les stagiaires des années
2005-2007 n'ont plus eu l'opportunité d'avoir des arbres individuels
pour leur stage pratique.
De cette expérience, Monsieur N relève la
difficulté de transmettre aux stagiaires les « vraies
techniques (hontô no gijutsu)» pour entretenir les vergers,
qu'il ne peut pas oralement expliquer. D'après lui, les stagiaires
avaient tendance à ne pas prêter attention au devenir des arbres
qu'ils ont entretenus pour l'année suivante602. Et ils n'ont
pas effectué tous les traitements nécessaires pour la
prévention des maladies et des insectes.
Par ailleurs, un autre problème s'est posé au
niveau des débouchés des stagiaires : il y a très peu de
stagiaires qui peuvent se mettre à la production de pêches ou de
poires après leur stage, en raison du manque de connaissances
techniques, du coût d'investissment élevé, de la
difficulté de trouver un terrain disponible pour eux etc. Du coup, la
plupart de stagiaires souhaitent continuer leurs activités en tant qu'
« aide agricole (ennô) » chez des arboriculteurs.
Cependant, ce type de demande de la part des stagiaires est peu acceptable pour
les arboriculteurs. Monsieur N relève notamment la difficulté
d'employer les gens qui ne veulent effectuer que des travaux simples n'exigeant
pas de réflexion (ex. réduire le nombre de boutons, et de fleurs
; mettre des sachets sur les fruits pour les protéger avant la
récolte etc.). Pour lui, au lieu d'accepter des aides temporaires
quoique bénévole, il est préférable d'accepter un
ou deux stagiaires qui suivent à long terme un même verger et
apprennent les « vraie techniques » sur tout le processus de
l'entretien d'un verger.
Actuellement, face à ces difficultés
rencontrées avec les stagiaires des années 2004-2006, le Centre
Nô-Life et le GASATA sont en train de réviser le programme du
stage pratique pour la deuxième année des stagiaires de la
filière fruitière.
Et les membres du GASATA sont également en train de
discuter pour proposer une nouvelle solution. Par exemple, ils discutent de
l'idée d'organiser un grand verger faisant plusieurs hectares, qui est
actuellement en friche, de manière à le gérer en commun
entre arboriculteurs sous forme d'une personne morale. Il s'agit de
créer un grand verger qui servirait aux usages multiples du public : la
location de parcelles aux ex-stagiaires de Nô-Life ; agri-tourisme etc.
Monsieur N a suggéré qu'il serait possible de faire une sorte de
« parc rural (Nôson kôen) » dans ce verger. Pour
lui, quel ques soit les usages, si on arrive à éviter le
délabrement, un tel projet peut « mériter »
d'être réalisé. Il dit également que la future
coopération avec la Municipalité pour réaliser cette
idée est également souhaitable...
Attentes vis-à-vis du Projet Nô-Life : renforcement
du rapport avec le public pour la main-d'oeuvre et la reconnaisance de la zone
de production
Malgré ces problèmes rencontrés au cours du
stage pratique, Monsieur N insiste sur la valeur du Projet Nô-Life du
point de vue de la « main-d'oeuvre (hitode) » agricole que
ce projet peut générer sur le long terme :
« [Enquêteur : Attendez-vous quelque chose du
Projet Nô-Life ?] Oui, absolument. Il s'agit de la main-d'oeuvre.
C'est
très important. C'est déjà super qu'autant de
gens soient venus se rassembler, n'est-ce pas ? Puis, chacun des
stagiaires
dit à son épouse et l'épouse dira à quelqu'un
d'autre. Et ainsi ça va se diffuser. Désormais, pour
l'agriculture,
602 Par exemple, ils ont trop taillé les arbres sans
penser à la future conséquence de leur opération.
il faut que le plus de gens possibles provenant des autres
secteurs s'y impliquent. Il suffit même de venir voir, aussi. Donc, il y
a vraiment une très bonne chose dans Nô-Life. Il y a
déjà 36-37 stagiaires au total et ils parleront de leur
activité à leur épouse et l'épouse en parlera
quelque part et ainsi de suite... De ce point de vue là, c'est super. Il
y a un grand mérite. Ainsi, les gens vont davantage s'intéresser
à la pêche ou à la poire et essayer d'en manger une. En
fait, la pêche et la poire, c'est quelque chose dont on peut se passer
pendant toute l'année ! Ce n'est pas la peine de les manger, n'est-ce
pas ? Mais avec Nô-Life, par exemple, les enfants s'intéresseront
à la pêche que leur père a produite, et également,
cela peut aller jusque chez les petits enfants... Ca, c'est vraiment
important. »
Cette attente confirmée par Monsieur N vis-à-vis
du Projet Nô-Life reflète fortement son souci sur le
problème du manque de ressources humaines pour sa zone de production
à venir, notamment en raison du vieillissement et du manque de
successeurs des activités agricoles. Et il ne souhaite pas seulement
s'assurer la main-d'oeuvre agricole, mais également faire
reconnaître sa zone de production par le public.
Par ailleurs, il constate également que, «
grâce au Nô-Life et aux activités du GASATA »
qu'il y a des retraités salariés qui ont l'intention de reprendre
l'arboriculture fruitière de leurs parents dans son village, et que l'on
peut trouver cette tendance même en dehors du Projet Nô-Life.
Exemple de Monsieur YM, un stagiaire : cas idéal
pour la main d'oeuvre et la sociabilité...
Parmi les stagiaires des années 2004-2006, Monsieur YM
est le seul à avoir commencé la production fruitière, dans
un verger de poiriers de 1 5ares appartenant à Monsieur N603.
Pour Monsieur N, le cas de Monsieur YM est idéal en terme de
débouchés pour les stagiaires.
Monsieur YM, que nous avons également
intérrogé, étant troisième enfant d'une ferme de
Shikoku produisant la clémentine (mikan), s'est installé dans la
Ville de Toyota pour travailler dans une usine de l'Automobile Toyota. Et il
est actuellement salarié retraité après avoir
travaillé pendant 40 ans dans le secteur automobile. Ayant fini les deux
ans de la formation Nô-Life dans la filière frutière en
2005, il a commencé à mener la production de poires sur 1 5ares
de vergers qu'il loue actuellement à Monsieur N. Il travaille tous les
week-ends au verger. Il insiste qu'il ne mène pas ses activités
agricoles dans le but de gagner de l'argent, mais dans le but de «
s'assurer son lieu d'existence (jibun no ibasho wo kakuho shitakatta)
». Il distribue la moitié de sa récolte à ses voisins
et vend le reste au marché de grossiste. Ses activités agricoles
lui coûtent 300 000 yens (soit environ 2000 euros) par an. Et il trouve
« décevant » la performance économique de ses
activités agricoles par rapport à ses anciens collègues
qui continuent à être employés dans leur entreprise en
gagnant près de 600 000 yens (environ 4000 euros) par an604.
Cependant, il met l'accent sur la relation qu'il a pu créer, grâce
à la distribution de sa récolte, avec ses voisins avec lesquels
il n'avait pas de contacts auparavant. Et il se réjouit de «
pouvoir vivre dans la nature » et de « sentir toutes les
saisons » à la différence de la vie de salarié
qu'il était, dans laquelle on ne peut pas sentir le changement de saison
et où « il n'y a que le chaud ou le froid là-bas
».
Monsieur N espère également qu'il y aura
davantage de stagiaires comme Monsieur YM. Ceci dans le sens où la
présence de stagiaires dans les vergers réanime la
sociabilité parmi les habitants des foyers agricoles dont notamment les
femmes et les personnes âgées. Il y a effectivement des habitants
des foyers agricoles qui ont rencontré Monsieur YM sur leurs vergers et
ils se sont communiqués : « Ces papis, leurs épouses et
belles filles, dit Monsieur N, ne sont que des papis et leurs
épouses et belles filles du quartier. Mais pour les stagiaires de
Nô-Life, ce sont des 'enseignants' comme nous ! » Ainsi, ils
apprennent souvent à Monsieur YM leur méthode de l'arboriculture
au travers de leur communication. Telle est un des souhaits de Monsieur N pour
le Projet Nô-Life. Et il met également l'accent sur le fait que
cela peut influencer la relation entre habitants des foyers agricoles qui ont
tendance à se considérer les uns les autres comme des «
concurrents »605. Le fait que Monsieur YM communique
avec des habitants du quartier, créé « une bonne
ambiance » pour Monsieur N. Monsieur N
603 A part ceux qui ont commencé les figues (ichidiku).
604 Suite à la réforme des pensions où
l'âge de réception des pensions sera progressivement
repoussé de 60ans à 65 ans, les entreprises japonaises sont
actuellement encouragées à continuer à employer les
personnes âgées de plus de 60 ans. Il s'agit de la politique du
« Prolongement de la période d'emploi (Koyô-enchô)
».
605 Monsieur N : « Quant aux voisins, mamies, en fait,
les paysans ont tendance à se considèrer comme des
concurrents ».
souhaite également que les stagiaires de Nô-Life
mènent leur activité non de manière « trop
professionnelle » mais familiale avec leurs épouses ou leurs
enfants.
Quelle agriculture de type Ikigai ? : Objectif lucratif
« difficile » mais nécessaire.
Concernant l'objectif de Nô-Life de gagner un million de
yens de revenu agricole par an, Monsieur N le trouve difficile à
réaliser et même « impossible ». Cela tout en
connaissant la difficulté de rentabliser une production agricole dans
ses expériences agricoles. Puis, tout en constatant qu'il y a un
décalage entre la réalité du côté des
stagiaires et cet objectif lucratif du Projet Nô-Life, il insiste sur la
nécessite d'avoir un « matériel (tane) » avec
lequel on peut se motiver, et que l'on peut viser comme objectif. Pour Monsieur
N, si on n'a pas un but commecial pour mener les activités agricoles, et
si on n'a seulement l'intention de distribuer le surplus, « le
commerce ne se constitue pas ». Il accorde ainsi de l'importance
à l'aspect lucratif des activités agricoles des stagiaires de
Nô-Life, dans la mesure où cela donne un objectif et rend les gens
plus « sérieux » dans leur activité.
Cela concerne également le souci de Monsieur N que l'on
a constaté plus haut, sur la demande de la part de beaucoup de
stagiaires de la filière fruitière qui veulent exercer une aide
agricole chez les arboriculteurs. Ce qui était peu acceptable pour lui
en raison du manque de techniques des stagiaires. C'est pour cela que, le cas
de Monsieur YM paraît idéal à Monsieur N, et qu'il souhaite
qu'il y ait plus de stagiaires comme Monsieur YM « qui peut être
responsable » de sa production, même si l'échelle de
production est petite. Le fait que les stagiaires procurent une aide agricole
ne leur donnera pas la « responsabilité » et cela
risque de devenir un « passe-temps » pour ces stagiaires,
d'après Monsieur N.
Idée pour une meilleure continuation du stage :
proposition d'un « compagnonnage »
Enfin, Monsieur N souhaite que les stagiaires continuent leur
apprentisage plus à long terme au delà de la durée de deux
ans, alors que le Centre Nô-Life leur fait automatiquement terminer leur
stage en deux ans.
De ce fait, Monsieur N propose au Centre Nô-Life de
prolonger le stage pour ceux qui souhaitent continuer, à la
manière d'un « compagnonnage (decchi bôkô)
» : le stage sera individuellement effectué à long terme
chez un arboriculteur en sorte que le stagiaire se spécialise dans la
production d'un produit spécifique.
Sur ce point-là, il y a une différence du point
de vue entre le GASATA et le Centre Nô-Life sur la durée
d'apprentisage. Actuellement, le Centre Nô-Life considère que la
première année de la formation est le tronc commun, et que la
deuxième année est la spécialisation. Tandis que pour
Monsieur N, deux ans de formation Nô-Life peuvent servir aux stagiaires
pour avoir les connaisances générales et pour «
s'habituer à la vie des paysans (hyakushô no seikatsu)
», et la spécialisation pourra s'effectuer après la
formation via un stage individualisé chez un arboriculteur, donc
à manière d'une « compagnonnage ».
Mode d'actions
Le mode d'actions du GASATA est d'abord marqué par une
grande flexibilité que ses membres peuvent accorder à cette
organisation malgré leur occupation professionnelle et individuelle
(« quand on est paysan, on est `almighty' en faisant tout, quelques
soit les échelles, grande ou petite. Puis, on n'a pas de limite au
niveau du temps »)606.
Le GASATA est considéré par Monsieur N comme un
lieu privilégié de réflexion et d'actions pour les
arboriculteurs du Pays de Sanage. En effet, ceci est lié à
l'intention de Monsieur N d'établir cette association non de
manière à englober sectoriellement tous les arboriculteurs de la
région de Toyota, mais de manière à
606 C'est Monsieur N qui est chargé de la distribution du
temps de travail à chaque membre en concertation avec celui-ci pour les
activités du GASATA.
pouvoir se réunir régulièrement et
discuter des problèmes entre arboriculteurs disponibles et
motivés à y participer. En effet, comme nous l'avons
constaté plus haut, Monsieur N trouvait « trop grands » les
groupements de producteurs de pêches et de poires, pour y avoir une
occasion de discuter entre arboriculteurs. Il a ainsi eu l'idée de
« montrer » d'abord des actions concrètes pour que les autres
producteurs, dont notamment ceux qui sont âgés au sein des foyers
agricoles pluriactifs, puissent « suivre » les actions du GASATA.
Ensuite, les actions du GASATA sont basées sur leur
propre intérêt professionnel constitué par le souci sur
l'avenir de leur exploitation individuelle et celui de leur zone de production.
Cependant, cet intérêt ne peut pas être confondu avec les
intérêts institutionnels tels que celui de caractère
sectoriel de la part de la coopérative agricole et l'autre de
caractère public de la part de la municipalité. En effet,
Monsieur N prend l'initiative de ses actions collectives pour l'arboriculture
de son pays en tentant de chercher un autre appui que l'économie
sectorielle (le marché, les groupements de producteurs pour la vente)
pour maintenir leur production.
Prise de position vis-à-vis du Projet Nô-Life
La volonté du GASATA de s'investir dans le Projet
Nô-Life est basée sur une prise de conscience de la
nécessité d'ouverture de leur zone de production au public. Cette
volonté est manifeste et conjointe à leur propre
intérêt de conserver cette zone de production. Puis, il prend
conscience d'ouvrir la zone de production au public tout en reconnaissant que
le renforcement de l'intérêt public vis-à-vis de celle-ci,
pourra également servir à maintenir sa durabilité. Ceci en
suscitant l'introduction de la nouvelle main-d'oeuvre dans la zone de
production, la communication entre habitants et la motivation de ces habitants
pour leur production etc. Et la conservation de leur zone de production est
liée non seulement à la base de leur économie mais
à celle de leur relation sociale historiquement constituée avec
le développement de cette zone.
Toutefois, l'intérêt du GASATA ne correspond pas
tout à fait à celui du Centre Nô-Life qui cherche à
répondre le plus largement possible à l'intérêt de
tout le public. Sur ce point, la position du GASATA rejoint celle de la CAT
exprimée plus haut par Monsieur S, directeur de la direction des
activités agricoles de la CAT, qui mettait l'accent sur l'importance
d'intégrer les stagiaires de Nô-Life dans leur organisation, au
lieu de satisfaire simplement le public via la formation Nô-Life. Ainsi,
Monsieur N n'est pas d'accord avec la politique de l'élargissement du
Centre Nô-Life de 2006. Pour lui, c'était « trop
tôt » pour le moment actuel où la méthode de la
filière fruitière de la formation Nô-Life n'est même
pas encore établie. D'ailleurs, il pensait « depuis le
début » qu'il faudrait 5-6 ans pour établir le
système de la formation Nô-Life dans cette
filière607.
2. Réponses aux questions : analyse du processus
entre acteurs institutionnels
Le processus de la construction du Projet Nô-Life ne
peut pas être considéré comme un procédé
résultant de simples opérations administratives, juridiques,
techniques ou politiques, mais comme un processus émergent et complexe
qui implique les dimensions historique, sociale et culturelle des acteurs
impliqués dans ce processus, que nous avons étudiés plus
haut.
Rappelons-nous ici les trois éléments
déterminants de l'objecif du Projet Nô-Life tels qu'ils ont
officiellement été définis par la Municipalité de
Toyota.
607 En plus, Monsieur N n'a pas été prévenu
par le Centre Nô-Life de cette politique de l'élargissement...
1 Conservation des terrains agricoles (prévention de
friches)
2 Conservation de la main-d'oeuvre agricole (formation
agricole)
3 Proposition de nouvelles activités aux personnes
âgées pour assurer leur Ikigai
Ces trois éléments déterminent l'objectif du
Projet Nô-Life à savoir : le développement de l'agriculture
de type Ikigai.
Cependant, ces éléments officiellement
présentés par le Projet ne nous permettent pas
immédiatement de répondre à une série de questions
générales que nous pouvons supposer telles que : quel est
l'objectif initial du projet ? (développement agricole ou mesure sur le
vieillissement de la population ?) ; de quel domaine ou secteur le Projet
relève-t-il ? (politique agricole ou Ikigai des personnes
âgées, mais quelle définition opérationnelle du
terme d'Ikigai ?) ; dans quel contexte le Projet a-t-il été
établi ? (il semble être multiple...) ; quel est le contenu des
actions du projet ? (formation agricole ni professionnelle ni amatrice, mais de
quel type ? Et location de terrains agricoles, mais cela relève du
domaine privé...) ; quelle finalité le Projet se donne-t-il ? (y
a-t-il une fin à ce projet ?)
Vu la complexité et le flou que l'objectif officiel du
projet implique, il nous paraît quasiment impossible de répondre
à ces questions d'un point de vue objectif ou général, ce
qui nécessite de recourrir à d'autres types d'explications
capables d'appréhender les dimensions plus concrètes et
substantielles des choses. C'est pourquoi nous avons pris un «
détour » qui, afin de comprendre plus sociologiquement le Projet
comme une action, va mettre en évidence les éléments
déterminants les représentations et actions de chaque acteur dans
son enjeu, et nous permettera finalement d'analyser la relation sociale entre
ces acteurs qui est à la fois construite autour du projet et mis en jeu
par le Projet.
En sa basant sur les éléménts de l'analyse
des acteurs effectuée plus haut, nous allons répondre aux quatre
questions posées au début de ce chapitre.
Elaboration de l'ensemble des actions concrètes pour
la construction du Projet Nô-Life
Comment l'ensemble des actions concrètes pour la
construction du projet a-t-il été élaboré par
différents types d'acteurs locaux ? Le Projet Nô-Life n'a pas
été construit de manière isolée des autres projets
précédemment menés soit par le BPA lui-même, soit
par d'autres acteurs du territoire de la Ville de Toyota, dont les
thématiques ont des points communs avec celles du Projet Nô-Life.
Mais il se situe dans la continuité d'idées et d'actions qui
l'ont précédée au sein des 7 acteurs étudiés
plus haut. Chacun de ces acteurs avait construit ses propres actions,
anticipant d'une manière ou d'une autre, les thématiques du
Projet Nô-Life. Nous avons établi ci-dessous un tableau
chronologique les situant à la fois par période (année) et
par acteur afin de mettre en évidence la relation entre ces actions
historiques liées au Projet Nô-Life.
Ce tableau chronologique nous permet de réorganiser les
actions constitutives du processus de la construction du Projet Nô-Life.
C'est pourquoi il est intéressant de retracer l'itinéraire que le
BPA, notamment Monsieur K président du Centre Nô-Life, a pris pour
arriver à la réalisation de son but : réalisation du
Projet Nô-Life. En fait, cet itinéraire nous montre tout un
emsemble d'actions du type du bricolage qui combine plusieurs types de
ressources disponibles aux yeux de l'acteur (BPA et Monsieur K) Puis, cette
démarche, dont l'oeuvre est la réalisation du Projet
Nô-Life, n'a pas exclu la réalisation d'un certain nombre de
transactions sociales entre les agents concernés de champs sociaux
différents à base territoriale.
|
Tableau chronologique des actions dans le processus de
l'élaboration du Projet Nô-Life
|
|
Act. 1
BPA
|
Act. 2
SCI
|
Act. 3
CAT
|
Act. 4
BDPA
|
Act. 5
ECV
|
Act. 6
CLFS
|
Act. 7
GASATA
|
|
Avant
1996
|
Jardins Familiaux
(- aujourd'hui)
|
|
Marché du Marrdi Soir
(vers 1984-
aujourd'hui)
|
|
|
|
Journée de la Peinture
des Fleurs de
pêcher
(1 993-2003)
|
|
1996
|
Plan fondamental de
l'Agriculture
(-2005)
|
|
|
|
|
|
|
|
1997
|
|
|
|
|
Maison des fleurs
(-aujourd'hui)
|
|
|
1998
|
Jardins Citoyens
(- aujourd'hui)
|
|
Jardins Citoyens
(- aujourd'hui)
|
|
|
|
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Plan fondamental
2001-2005
Projet Nô-Life
(- aujourd'hui)
Ecole Vivante de
l'Agriculture
(-2003)
Discussion pour la
« Recherche et
formation
de
nouveaux porteurs
»
(-2002)
Ferme-Ecole pour les
Personnes
agées
(-aujourd'hui)
Comité pour le
« Centre pour le
soutien aux
activités
agricoles »
(-2004)
Enquête sur la
Conscience sur
l'agriculture de
Toyota
Zone spéciale pour la
Création de
Nô-Life
Projet Nô-Life
(- aujourd'hui)
Comité pour la
Promotion de la
Création d'
Ikigai :
CPCI
(- aujourd'hui)
Dépôt du "Rapport de
propositions"
au Maire
de la Ville de
Toyota
Ferme-Ecole pour les
Personnes
agées
(-aujourd'hui)
Ecole Vivante de
l'Agriculture
(-2003)
Discussion pour la
« Recherche et
formation
de
nouveaux porteurs
»
(-2002)
|
Comité pour le
« Centre pour le
soutien aux
activités
agricoles »
(-2004)
|
Projet Nô-Life
(- aujourd'hui)
Comité pour le
« Centre pour le
soutien aux
activités
agricoles »
(-2004)
Zone spéciale pour la
Création de
Nô-Life
Projet Nô-Life
(- aujourd'hui)
|
Comité pour le
« Centre pour le
soutien aux
activités
agricoles »
(-2004)
|
Projet Nô-Life
(- aujourd'hui)
Plan fondamental
2006-2010
Comité pour le
« Centre pour le
soutien aux
activités
agricoles »
(-2004)
Enquête sur la
Conscience sur
l'agriculture de
Toyota
Discussion pour
l'établissement du
GASATA
|
Etablissement du
GASATA
(-aujourd'hui)
|
Itinéraire des actions du BPA pour la construction du
Projet Nô-Life
Nous illustrons ici les manières dont ont
été mises en place les six actions suivantes, dont les trois
premières se sont déroulées avant que le Projet
Nô-Life ait été mis en discussion en 2001, et les trois
autres se sont déroulées après 2001.
Avant la mise en discussion du Projet Nô-Life :
1 Mise en place des Jardins citoyens avec la CAT(acteur 3) en
1998
2 Etablissement de l'Ecole de l'agriculture vivante avec la CAT
en 2000
3 Etablissement de la Ferme école des Personnes
âgées avec la SCI(acteur 2) en 2001 (inauguration en 2002)
Après la mise en discussion du Projet Nô-Life :
4 Etablissement du GASATA(acteur 7) avec des arboriculteurs de
Sanage en 2003
5 Réalisation de l'Enquête sur la Conscience sur
l'agriculture de Toyota avec le CFLS(acteur 6 ) en 2003
6 Application de la politique de la Zone spéciale pour la
Création de Nô-Life avec le BDPA(acteur 4) et l'ECV(acteur 5) en
2003
1 Mise en place des Jardins citoyens avec la CAT(acteur 3) en
1998
Les Jardins citoyens ont été
réalisés à l'initiative de la CAT mais à la demande
plus ou moins informelle du BPA qui voulait les réaliser dans le
prolongement de la conception du « Parc rural »
présentée dans le Plan de 96 (voir la partie de l'acteur 1).
L'idée des Jardins citoyens est importée de
l'idée des « Jardins familiaux » en Europe, connue au Japon
sous le nom du « Klein garten », alors que la construction des
cabanes était interdite par la Loi agraire au Japon, ce qui a contraint
la CAT à aménager les jardins sans cabane. Et pour la
création des Jardins citoyens, il y avaient deux intérêts
différents croisés : faire du bien au public (pour la
Municipalité), mais également profiter des usagers de ces jardins
pour s'assurer de futurs producteurs agricoles (pour la CAT).
L'intérêt de la CAT était de conserver les
terrains agricoles et de s'assurer de futurs producteurs au sein des usagers de
ces jardins pour un développement durable du secteur agricole. C'est
pour cela que la taille d'une parcelle est plus grande (100 \u13217§) que
celle des « Jardins familiaux » (20 - 30 \u13217§). Et si les
Jardins citoyens sont aménagés à l'extérieur de la
zone à urbaniser, les Jardins familiaux sont aménagés
à l'intérieur de cette zone.
Puis, l'intérêt du BPA était de
réaliser l'idée de la multifonctionalité qui était
pronée par le Plan de 96 en incitant les citoyens à se mettre aux
activités agricoles. Ce qui est considéré par le Plan
comme une approche « bien commun » vis-à-vis de l'agriculture
et de la ruralité. Cette idée est conforme à la position
de la Municipalité orientée vers le bien-être public.
Malgré quelques insatisfactions de la part de la CAT(voir
la partie de l'acteur 3), le fait qu'il y ait constamment des usagers constitue
un élément de succès des Jardins citoyens.
2 Etablissement de l'Ecole de l'agriculture vivante avec la
CAT en 2000
Ensuite, l'Ecole de l'agriculture vivante fut
réalisée à l'initiative de la CAT en coopération
avec le BPA comme un projet qui était également prévu dans
la conception de l' « Ecole rurale » conçue dans le Plan de
96.
L'intérêt de la CAT portait toujours sur la
conservation des terrains agricoles et les porteurs de l'agriculture face
à la situation de crise (pluriactivité démotivant les
producteurs pour leur production agricole ; vieillissement de la population
rurale etc). D'ailleurs, c'était Monsieur S qui avait conçu cette
idée afin d'animer les activités agricoles de la population des
foyers agricoles pluriactifs, dont notamment les femmes et les retraités
salariés. C'est pourquoi il voulait destiner ce projet uniquement
à cette population.
Mais l'intérêt du BPA était de destiner le
projet au public y compris la population non agricole. Finalement, un compromis
entre ces deux agents aboutit à la réalisation d'une formation
agricole destinée au public. (« Pour la Coopérative,
dit Monsieur S de la CAT, s'ils deviennent ainsi successeurs, c'est
suffisant pour nous de s'adresser uniquement aux foyers agricoles. Mais si on
travaille avec la Municipalité, elle veut s'adresser également au
public, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas de terrains agricoles.
C'est ainsi que l'on a fait appel aux personnes non agricoles pour lancer
l'Ecole de l'agriculture vivante »)
A travers les tentatives des Jardins citoyens et de l'Ecole de
l'agriculture vivante, le BPA a réellement commencé à
mener sa politique de manière à s'orienter vers le public,
c'est-à-dire la population générale à
majorité urbaine.
Un facteur de la réussite de ce projet réside
dans le grand nombre de stagiaires qui ont participé à la
formation du projet, et l'établissement d'un groupement de producteurs
de l'agriculture biologique au sein de la CAT.
Enfin, l'expérience de ce projet a relevé la
nécessité d'établir un nouveau système de location
de terrains agricoles pour que les stagiaires puissent continuer et
développer leur activité agricole après leur formation.
C'est ainsi que, par la suite, le Projet Nô-Life fut envisagé par
le BPA et la CAT.
3 Etablissement de la Ferme école des Personnes
âgées avec la SCI(acteur 2) en 2001 (inauguration en 2002)
La Ferme école des Personnes âgées fut
réalisée à l'initiative de la SCI à l'aide du BPA
dans le cadre des mesures pour la création d'Ikigai des personnes
âgées dans le contexte du vieillissement de la population
générale (urbaine comme rurale). Ce fut la première
approche dans la Ville de Toyota combinant la thématique d'Ikigai des
personnes âgées et l'agriculture.
Si l'idée de ce projet a été
énoncée par une citoyenne participant au Comité pour la
Promotion de la Création d'Ikigai (CPCI), lequel a rendu le «
Rapport de propositions » au maire de Toyota en 2001, le CPCI a
également « recyclé » l'idée du « Second
Life Academy » qui avait été proposée par Monsieur S
de la CAT pour le Plan de 96, pour formuler son idée dans ce rapport
remis au maire en 2001.
Monsieur K, en tant que délégué du BPA,
avait participé au CPCI et coopéré pour
l'élaboration et la réalisation de ce projet. En effet, Monsieur
K s'est impliqué dans ce projet à la fois afin de « servir
» à sa réalisation avec les compétences qu'il a en
tant qu'agent de la politique agricole, et également « s'en servir
» pour chercher à valoriser autrement les biens agricoles et
ruraux.
Les intérêts étaient donc conjoints entre ces
deux agents de la Municipalité pour valoriser des éléments
de « nô (l'agricole et le rural) » pour le bien-être
public.
Pour le BPA (Monsieur K), les procédures pratiques pour
monter ce projet de formation agricole destinée au public
(élaboration des programmes, location de terrains par la
Municipalité etc) furent un bon apprentisage. («
C'était, dit Monsieur K, encore le moment où le plan
de notre projet (Nô-Life) n'était pas clair, puis, j'ai
négocié avec le [BPA] pour réaliser cette Ferme
école et ainsi de suite, faire les programmes etc. Ces
expériences-là nous ont servi à commencer ici
(Nô-Life) »)
Après 2001 où le Projet Nô-Life était
mis en discussion, le BPA dont le responsable était Monsieur K, mena les
trois actions suivantes vers la réalisation du Projet Nô-Life.
4 Etablissement du GASATA avec des arboriculteurs de Sanage
(acteur 7) en 2003
L'établissement du GASATA en 2003 était un acte
réalisé à l'initiative d'arboriculteurs de Sanage.
Monsieur K a participé à des réunions pour cet
établissement en vue de mener une coopération avec eux dans le
Projet Nô-Life. La filière frutière est ainsi
réalisée avec la coopération avec les membres du
GASATA.
L'intérêt des arboriculteurs membres du GASATA
pour l'établissement de ce groupement portait sur le maintien de leur
zone de production via un renforcement de : l'entraide entre arboriculteurs ;
la reconnaissance publique de cette zone de production et de ses produits
fruitiers ; l'augmentation de la motivation des autres arboriculteurs
âgés des foyers pluriactifs pour leur production.
En fait, la coopération avec le GASATA fut tout
à fait occasionnelle aussi bien pour le BPA que pour le GASATA. Le BPA
est intervenu dans son établissement pour réaliser son propre
objectif à lui : Projet Nô-Life. Mais cette intervention du BPA
fut effectuée de manière à intéresser son objet
d'intervention (GASATA) au Projet Nô-Life.
5 Réalisation de l'Enquête sur la Conscience sur
l'agriculture de Toyota avec le CFLS(acteur
6 )en 2003
Puis, l'Enquête sur la Conscience sur l'agriculture de
Toyota fut réalisée à l'initiative du BPA en
coopération avec le CFLS. Cette enquête avait, avant le lancement
du Projet Nô-Life, pour but de confirmer les types et les degrés
des attentes de la population locale (urbaine et rurale) de la Ville de Toyota,
vis-à-vis de l'agriculture et de la ruralité. Puis, cet acte a
permis au BPA d'avoir, pour la première fois, un rapport de
coopération avec le CFLS qui représente la grande majorité
des syndicats ouvriers présents dans la Ville de Toyota, et constitue
ainsi la plus grande organisation sociale dans cette Ville.
L'intérêt du CFLS pour la coopération dans le
Projet Nô-Life était également lié à sa
propre position
sociale : contribuer à la politique municipale lui permet
de renforcer l'ancrage local de son organisation. Ainsi, la promotion d'Ikigai
des personnes âgées constitue, aujourd'hui, un pilier de sa
politique locale.
Le rapport établi entre le BPA et le CFLS se situe
spécifiquement dans le contexte de la construction du Projet
Nô-Life. Ces deux agents appartenant à deux champs sociaux
habituellement opposés (secteurs agricole et industriel), ont ouvert un
espace de discussion sur le thème du Projet Nô-Life, celui
croisé vieillissement / agriculture et ruralité. Et ce rapport
est construit de manière à ne pas se baser sur les effets du
Projet à court terme. En effet, en réalité, le rapport
entre l'idée d'Ikigai et l'idée de la conservation des terrains
agricoles ou de s'assurer de futurs producteurs agricoles paraît peu
compatible pour le CFLS.
6 Application de la politique de la Zone spéciale pour
la Création de Nô-Life avec le BDPA (acteur 4) et l'ECV(acteur 5)
en 2003
Enfin, en 2003, la procédure pour l'application de la
politique de la « Zone spéciale pour la Création de
Nô-Life » fut réalisée en coopération avec les
agents agricoles du département d'Aichi : le BDPA et l'ECV.
Cet acte avait pour la Municipalité, d'un
côté, pour but pragmatique de la dérèglementation de
la Loi agraire, et de l'autre pour but politique et stratégique :
renforcement de la valeur officielle du Projet Nô-Life au delà du
niveau local via une reconnaisance dans le cadre de cette politique
gouvernementale qui était bien « en vogue ».
En fait, l'objectif officiel de la politique nationale de la
Zone spéciale de la Réforme structurelle est la relance
économique de l'Etat. Mais en réalité, la
Municipalité de Toyota « s'en est servi » afin d'avancer le
processus qui était déjà en marche dans son territoire,
à savoir le processus de la participation citoyenne aux activités
agricoles avec une série de projets antérieurs expliqués
plus haut. Et ceci malgré le fait que le Projet Nô-Life ne
servirait pas forcément - objectivement parlant - à contribuer
à l'objectif de la relance économique de l'Etat...
Bricolage et transaction
En survolant l'itinéraire des actions et les oeuvres du
BPA dont Monsieur K était responsable, nous permet de voir une forme de
l'action publique locale qui s'est effectuée sous forme de «
bricolage » agencé par une série de transactions sociales
qui sont des compromis entre agents de champs sociaux différents
à base territoriale. Nous utilisons le concept du « bricolage
», célébre notion anthropologique employée par Cl.
Lévi-Strauss, et le concept sociologique de la « transaction
sociale » et du « compromis » pour analyser le processus de la
construction du Projet Nô-Life. Ceci dans la mesure où le BPA agit
comme un « donneur de sens » vis-à-vis des ressources
disponibles à ses yeux afin de « s'en servir » pour la
réalisation de son projet, tout en effectuant des communications entre
ses propres projet et la structure de ces ressources humaines (personnelles,
institutionnelles et représentationnelles) et non-humaines (juridiques
et économiques : matérielles, foncières et
financières).
Concept du « bricolage » chez Lévi-strauss : ses
caractéristiques et possibilité
Nous relevons ici les caractéristiques du concept du
« bricolage » proposé par Lévi-Strauss dans une partie
de son ouvrage « la pensée sauvage » publié en 1962,
dans laquelle il essaie d'expliquer la nature de la pensée mythique et
établit le lien entre celle-ci et la pensée
scientifique608.
D'abord la caractéristique du bricoleur réside
dans ses rapports avec les moyens qu'il utilise pour son acte créateur.
A la différence de l'ingénieur, le bricoleur effectue son acte
créateur non pas à partir de ses projets déterminés
par des concepts, mais à partir de moyens disponibles qui lui sont des
occasions de réaliser « un ensemble » qui est son oeuvre.
Ensuite, il donne des sens à ces moyens pour que ceux-ci puissent
effectivement jouer le rôle d' « opérateur » pour la
réalisation de son oeuvre.
Or, de ce fait, le bricoleur et l'ensemble ainsi
réalisé (oeuvre) sont forcément dépendants de la
nature des
608 Lévi-Strauss, 1962 : 30-36.
moyens utilisés, c'est-à-dire, leurs fins
antérieures. Les moyens du bricoleur ne sont donc pas
définissables par les fins proprements conçues par le bricoleur,
autrement dit, la structure de son projet.
A partir de cette explication de Lévi-strauss que nous
avons résumée, nous pouvons relever la qualité, le
défaut et la possibilité de l'action et de l'oeuvre de type
bricolage.
D'abord, la qualité de l'action et de l'oeuvre de type
bricolage est son approche ascendante (d'en bas). Il s'agit, comme dit
Lévi-strauss, de celle « première »609 qui
est originale et non standardisée par des critères descendants
(d'en haut) donnés par des « savants ». Et ceci surtout dans
la mesure où l'action et l'oeuvre de type bricolage sont «
libéralisatrices » des objets quelconques mobilisés par
cette action, car le bricoleur leur donne une nouvelle signification.
Ensuite, son défaut réside dans l'incertitude du
résultat de son action, car cette action est limitée par la
nature de ses ressources. Il s'agit, comme nous l'avons dit plus haut, de sa
dépendance à la structure des moyens qui impliquent toujours des
fins antérieures.
Lévi-strauss relève ainsi la capacité
limitée du « signe » donné par le bricoleur par
opposition à la capacité illimitée du « concept
» qui donne une « ouverture » vers la
généralisation610. D'après lui, si
l'ingénieur peut toujours aller « au-delà » de ses
moyens pour créer un « autre message » par le biais de son
projet, de ses concepts et de ses fins, le bricoleur reste « en
deçà » de ses moyens611.
Mais, en complément à la proposition de
Lévi-strauss, nous pouvons relever que la possibilité du
développement « réel » et non théorique de
l'action et de l'oeuvre de type bricolage est illimitée : puisque le
processus de l'acte créateur du bricoleur est un processus de «
reconstruction incessante à l'aide des même matériaux
»612 dont le cycle de la fin et du moyen des objets
mobilisés est le moteur.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que les matériaux et
les savoirs sur ceux-ci doivent toujours être « limités
» ou « mêmes » en réalité, comme
Lévi-strauss entend le dire ? La réponse peut clairement
être non. D'ailleurs Lévi-strauss reconnaît lui-même
que la différence entre l'ingénieur et le bricoleur n'est jamais
absolue en réalité, en disant que le pouvoir créteur de
l'ingénieur est également limité par ses ressources qui
sont ses « interlocuteur[s] » avec lesquels il doit toujours
dialoguer et transiger. Et il doit souvent recourrir à des moyens dont
les fins sont antérieurement déterminées613.
En plus, vu que la circulation des savoirs est aujourd'hui
explosive au niveau mondial, on peut souvent avoir accès à des
oeuvres données par des « savants » et des savoirs
généraux diffusés sur celles-ci. Ainsi, tout en
étant bricoleur, on pourrait bien « détourner » la fin
de ces oeuvres scientiques en les « inventoriant » et les
transformant en des moyens pour réaliser une nouvelle oeuvre. Et le
résultat de cet acte créateur du bricoleur implique toujours,
comme dit Lévi-strauss, « un compromis entre la structure de
l'ensemble instrumental et celle du projet » du bricoleur.
Du bricolage à la transaction sociale...
Ici, les types des ressources mobilisées dans ce
processus sont divers et complexes tels que les types humains et sociaux
(personnel, organisation, relation sociale et représentations),
économiques (matériel, foncier, financier) et politiques
(décision politique, législations).
Et l'ensemble des actions s'est effectué en relation
avec des agents de champs sociaux différents à base territoriale,
aux niveaux des contextes, des secteurs et même des échelles
institutionnelles. D'où la nécessité de la
réalisation d'une série de transactions sociales entre agents
intersectoriaux.
D'ailleurs, comme nous l'avons vu avec en nous
référant à Lévi-Strauss, le bricolage s'effectue
par le biais d'un « compromis entre les structures de l'ensemble
instrumental et du projet ». La transaction sociale nous semble ainsi
constituer, avec le bricolage, le moteur de l'ensemble des actions temporelles
(processus) de la
609 Ibid. : 35.
610 Ibid. : 34.
611 Ibid. : 33.
612 Ibid. : 35.
613 Ibid : 33. « lui aussi devra commencer par inventorier
un ensemble prédéterminé de connaissances
théoriques et pratiques, de moyens techniques, qui restreignent les
solutions possibles »
construction du Projet Nô-Life614. Paradigme de
transaction sociale
La transaction sociale n'est pas un concept bien
défini, mais celui qui est suscetible d'être un « paradigme
» qui permet d'appréhender la vie sociale comme « une forme de
séquence d'ajustements successifs »615. En se
référant à quelques recherches récentes
s'inscrivant dans ce cadre616, sans toutefois être exhaustif,
nous pouvons relever un certains nombre de traits caractéristiques de ce
cadre d'analyse. Ensuite, nous allons montrer, selon l'approche proposée
par Mormont (1994), dans quelle mesure ce cadre pourrait être pertinent
comme grille d'analyse pour comprendre le processus du Projet Nô-Life.
Caractéristiques du paradigme de la transaction
sociale Vers un dépassement de la dichotomie holisme - individualisme
?
Le cadre de la transaction sociale semble vouloir
dépasser une série de concepts dichotomiques régissant la
pensée sociologique tels que : individuel / collectif ; liberté /
contrainte ; stratégie / norme ; rationnel / irrationnel ; formel /
informel, négociation / imposition etc.
Et l'approche nous semble marquer une attitude scientifique
« non réductionniste » qui s'attache à articuler la
complexité et la diversité des situations et comportements des
acteurs.
Notons que cette notion est d'origine belge et qu'on trouve sa
source dans l'ouvrage « Produire ou reproduire ? » de Jean REMY et
Lilianne VOYE paru en 1978617. Selon l'explication donnée par
M. Blanc618, ces auteurs ont nettement pris leurs distances avec les
principaux courants dominants de la sociologie « française »
contemporaine, c'est-à-dire à l'égard de la position
structuraliste de P. Bourdieu, de celle des mouvements sociaux de A. Touraine
et de celle de l'individualisme méthodologique de R.
Boudon619. Notons brièvement les différences
marquées par le paradigme de la transaction sociale par rapport à
ces trois courants.
Par rapport à la position structuraliste qui s'attache
à démontrer le mécanisme de la reproduction des structures
dominantes ainsi que des relations de type dominant-dominé entre les
agents, le paradigme de la
614 D'ailleurs si la notion du bricolage peut nous servir comme
point de vue de « base » pour analyser l'acte créateur des
agents, elle a une certaine limite pour appéhender le processus entre
les êtres humains ayant des natures sociales différentes. Ceci
nous semble dû au fait que la notion du bricolage est conçue par
Lévi-strauss par sa réflexion sur la relation entre la culture et
la nature, et que Lévi-strauss présuppose toujours dans son
approche structuraliste l' « esprit humain » qui est la structure
inconsciente et universelle de l'homme : dans son ouvrage « Anthropologie
structurale » (1958), l'universalité de l' « esprit humain
» est ainsi présupposée : « l'activité
inconsciente de l'esprit consiste à imposer des formes à un
contenu, et si ces formes sont fondamentalement les mêmes pour tous les
esprits, anciens et modernes, primitifs et civilisés - (...) - il faut
et il suffit d'atteindre la structure inconsciente, sous-jacente à
chaque institution ou chaque coutume, pour obtenir un principe
d'interprétation valide pour d'autres institutions et d'autres
coutumes » (Lévi-strauss, 1958 : 28) D'où notre
distance à l'égard d'un tel présupposé
spécifique à l'anthropologie structurale, et la nécessite
de prendre un passage, dans nos points de vue de recherche, de l'anthropologie
(telle qu'elle est construite par Lévi-strauss) à une approche
sociologique.
615 « La transaction sociale n'est pas un concept rigoureux
», « mais elle est un paradigme » (Blanc, 1994 : 10). La
définition du paradigme donnée J. Rémy et L Voyé
est ainsi (citée par M. Blanc) : « plus qu'une somme de
concepts, le paradigme est l'image de base à partir de laquelle
s'imagine une interprétation de la réalité. Le paradigme
est ainsi le principe organisateur et inducteur de la construction
d'hypothèses et d'interprétations théoriques »
(Rémy et Voyé, 1978, cité par Blanc, 1994 : 10)
616 L'ensemble des ouvrages collectifs suivants nous fournissent
divers points de vue fondamentaux pour construire cette approche : Blanc, 1992
; Blanc et al., 1994.
617 Nous pouvons évoquer que la recherche menée par
ces auteurs porte sur le contexte particulier à la société
belge marquée par le fameux conflit complexe entre les flamands et les
wallons. Cette origine belge du concept de transaction sociale n'est pas «
un hasard », comme le commente M. Blanc : «
Déchirée par des conflits linguistiques, religieux,
politiques et économiques qui se superposent sans coïncider, la
Belgique devrait être une société bloquée et
pourtant elle ne fonctionne pas trop mal ! Il fallait donc inventer le concept
de transatcion pour `lire' ces compromis pratiques entre acteurs qui sont
contraints à cohabiter alors qu'ils restent en conflit. »
(Blanc, 1992 : 13.)
618 Blanc, 1992 : 7-9.
619 Curieusement, ces trois courants théoriques
constituent chacun un des quatre cadres principaux de la sociologie
française contemporaine après la Seconde Guerre mondiale,
expliqués par P. Ansart : structuralisme génétique
(Bourdieu) ; sociologie dynamique (Balandier et Touraine) ; approche
fonctionnaliste et stratégique (Crozier) ; individualisme
méthodologique (Boudon) (Ansart, 1990).
transaction sociale postule que les acteurs dominés
produisent également des structures sociales, et qu'ils sont capables
d'élaborer des projets620.
Par rapport à la position des mouvements sociaux,
« la logique d'opposition frontale entre les mouvements sociaux et l'Etat
est très simplificatrice621 ». Et elle ne permet pas de
comprendre les situations qui se situent entre les deux comme celle de la
coopération conflictuelle.
Par rapport à la position de l'individualisme
méthodologique, il s'agit d'une prise de distance par rapport à
son approche utilitariste consistant au souci individuel de compatibiliser les
bénéfices et les coûts. A côté de celle-ci,
l'approche de la transaction sociale admet également l'action des
individus de se contraindre, car la contrainte peut servir de cadre
stabilisateur.
Place de la transaction sociale à proximité de la
sociologie de l'organisation
Puis, l'approche de la transaction se situe à
proximité de la sociologie de l'organisation. Selon J. Rémy,
« la transaction sociale présuppose que l'on se mette dans la
perspective d'un système d'action concret » de Crozier et
Friedberg, qui implique « une mise à distance de la perspective
fonctionnaliste pour qui l'organisation est considérée comme une
solution objective aux problèmes posés par un contexte aux
caractéristiques objectivement donnés622 ». Et la
sociologie de l'organisation adopte « une perspective plus politique
où l'organisation apparaît comme un construit social
résultat de stratégies et de jeux d'acteurs623
».
Mais la transaction sociale marque également une
distance vis-à-vis de la sociologie de l'organisation. Ceci dans la
mesure où « la transaction sociale met au centre le jeu des acteurs
», et « il découle des enjeux multiples et liés
à la vie quotidienne » qui sont « transposables à
diverses échelles, qui vont de la vie domestique au pouvoir local et aux
institutions »624.
Et la différence entre les deux approches réside
dans la place de la « règle explicite ». Selon J. Rémy,
dans le cadre de la transaction, la formalisation ou règle explicite
n'est pas au centre de l'analyse, mais « une des composantes de la
régulation d'un échange »625.
Si la sociologie de l'organisation s'attache
généralement au processus de la négociation autour d'une
réglè explicite entre des acteurs stratégiques ayant leurs
propres intérêts, l'approche de la transaction sociale essaie
d'aller au-delà d'un simple cadre d'échange
d'intérêts, en abordant la « coopération ».
La distanction entre la négociation et la
coopération : si la négociation s'effectue lorsque « le
contrat repose sur l'équilibre des intérêts », la
coopération « associe au contrat par intérêt une
dimension plus directement culturelle et plus existentielle
»626.
Selon M. Blanc, la coopération « fait intervenir
des normes et des valeurs qui renvoient peut être à un
intérêt général et à long terme », mais
dans la négociation, « seuls les intérêts
immédiats peuvent étre approximativement mesurés et
équilibrés627 ».
Donc, si le « système d'action concret » tel
qu'il est supposé par la sociologie de l'organisation, « est apte
à rendre compte de la négociation mais pas la coopération
ainsi définie628 ». Mais « il y a une combinaison
des deux », « la transaction sociale s'applique à la fois aux
situations de négociation et de coopération629.
»
La position de la transaction est ainsi nette par rapport au
problème de la « régulation », selon Rémy,
« au lieu de faire de la régulation le noeud à
démêler, la transaction sociale est centrée sur la
genène de la relation ou sur les effets du compromis, sur les
étapes de l'évolution du rapport social, sur la transformation
des termes
620 Blanc, 1992 : 8.
621 Ibid.
622 Rémy, 1994 : 293.
623 Ibid. Il est intéressant d'évoquer que
l'approche stratégique de M. Crozier constitue le quatrième
courant de la sociologie contemporaine selon P. Ansart !
624 Ibid. : 294.
625 Ibid.
626 Bourdin, 1992, cité par Blanc, 1994 : 37.
627 Blanc, 1994 : 37 « Et la coopéation ne supprime
pas tout calcul d'intérêts mais elle l'inclut dans une logique
plus complexe et
elle déborde le paradigme utilitariste. »
628 Ibid.
629 Ibid.
d'échange et sur la modification des priorités. La
transaction s'intéresse surtout au processus de métissage
résultant de l'interférence entre pouvoir et
contre-pouvoir630 ».
Revenons ici à notre cas du Projet Nô-Life.
L'analyse du processus de la construction du Projet Nô-Life, ainsi que
celle du processus du jeu des acteurs institutionnels (gestionnaires du Projet
et leurs partenaires) et individuels (stagiaires) (dans le chapitre 3),
concerne non seulement certaines règles explicites de l'organisation
officielle du Projet, mais implique largement la vie quotidienne (y compris la
routine du travail) propre aux différents acteurs. Autrement dit, le jeu
des acteurs ne se déroule pas seulement « dans » le Projet,
mais également « autour » ou « avec » le Projet.
C'est pourquoi nous rejoignons l'approche de la transaction sociale apte
à intégrer la négociation définie par rapport
à une règle explicite ou officielle, dans le cadre plus large de
la coopération.
Et l'approche de la transaction sociale nous paraît tout
à fait appropriée pour analyser le processus du Projet
Nô-Life où la transaction sociale se prolonge à partir du
compromis institutionnel (entre la BPA et la CAT) à d'autres
échanges entre ses usagers (stagiaires) et les institutions partenaires,
en terme de « métissage » de représentations et
d'actions dans une interférence entre les acteurs ainsi dotés de
pouvoirs de différents niveaux et types.
Transaction sociale et processus de la construction du Projet
Nô -Life
Ensuite, nous allons essayer de réorganiser le
processus de la construction du Projet Nô-Life selon le cadre de
transaction proposé par Mormont631 développé
selon le contexte de sa recherche en matière de gestion de
l'environnement. Nous allons voir les quatre points de vue qu'il propose dans
sa conclusion pour penser le paradigme de transaction : 1
Interdépendances et incertitudes entre objet d'intervention (nature ou
environnement) et dispositifs politiques et sociaux ; 2 Redéfinition des
règles du jeu ; 3 Modèles transactionnels : cadres
institutionnalisés d'engagement et d'anticipation ; 4 Transaction :
grille d'analyse des interdépendances.
Puis, nous verrons entre le point 2 et le point 3, la notion
du transcodage que nous considererons comme outil pertinent pour comprendre la
mise en relation de divers acteurs d'une action publique. Situer cette notion
dans le paradigme de transaction sociale nous paraît également
pertinent pour éclairer celui-ci dans son processus concret.
1 Interdépendances et incertitudes entre objet
d'intervention (nature ou environnement) et dispositifs politiques et
sociaux
D'abord, selon Mormont, le problème de l'environnement
suppose deux niveaux d'incertitudes naturelle et sociale
enchevêtrées dues aux interdépendances contextuelle et
sociale. C'est-à-dire que, la validité des connaissances
scientifiques concernant l'environnement dépend fortement des contextes
variés en termes naturel et social auxquels elles
s'appliquent632. En l'occurence, on doit recourrir à une mise
en place de systèmes incitatifs : codes de bonne pratique agricole,
diffusion et vulgarisation technique, incitants économiques à
utiliser des matériels plus sûrs etc633. Puis,
l'efficacité de toutes ces mesures dépend largement de
dispositifs sociaux qui acceptent ces mesures634.
Notre contexte ne concerne pas directement le problème de
l'environnement, mais celui du vieillissement de
630 REMY, 1992, cité par Blanc, 1994 : 37.
631 MORMONT, M. (1994), Incertitude et engagement. Les
agriculteurs et l'environnement : une situation de transaction (Chapitre
10), in Vie quodienne et démocratie : Pour une
sociologie de la transaction sociale (suite), L'Harmattan : p.209-234.
632 Ex 1 : Mesures des pesticides en agriculture dans la
toxicologie. Les mesures sont difficiles à réaliser exactement en
raison d'incertitudes résidant dans l'environnement réel.
D'où une situation où le risque est supposé comme
potentiel (Mormont, 1994 :
219) Ex 2 : Rejets de pesticides dans les milieux auquatiques.
Des normes juridiques sont très difficiles à imposer en raison de
la diversité des modes d'usages de ces pesticides selon les cultures,
les sols, et les conditions climatiques (Ibid. : 220)
633 Ibid.
634 Ibid.
la population. Autrement dit, c'est le problème du monde
« humain » mais au niveau « bio-physique », car la
population vieillit naturellement.
En fait, l'interdépendance et l'incertitude aux niveaux
contextuel et social sont également grandissantes dans ce domaine.
Du côté de la population vieillie ou en
vieillissement, la catégorie « bio-physique » des personnes
âgées de moins en moins homogènes est difficile à
identifier face à l'augmentation du nombre des personnes
âgées en bonne santé. Mais le risque existe toujours ou au
moins potentiellement (surtout les affections chroniques comme le
diabète, les rhumatismes, les troubles des organes de la digestion). En
plus, les frontières entre les personnes âgées en bonne
santé, celles qui sont dépendantes, et celles qui sont malades
sont de plus en plus floues. Ce qui pose un grand problème pour la
« gestion » du vieillissement635.
Du côté de la politique sociale, les coûts
économiques sont grandissants et menaçants pour les
régimes de retraite et la sécurité sociale. Un trait
significatif : il y a de plus en plus de jeunes qui ne côtisent plus pour
le régime national de pension, ce qui menace la viabilité du
système du régime. Ce phénomène semble lié
à la méfiance à l'égard du système national
et à l'instabilité potentielle ou présente dans leur
situation économique636.
Puis, l'interdépendance sociale est effectivement
grande. La politique du vieillissement doit de plus en plus compter sur
l'autonomie individuelle et le lien social et territorial pour assurer son
efficacité. Surtout depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur
l'Assurance des aides aux personnes âgées dépendantes en
2000, la gestion des affaires relatives à cette loi est confiée
aux agents locaux concernés dont les collectivités territoriales
combinées avec les acteurs publics et privés concernés.
D'où la thématique du vieillissement actif au niveau
international, ainsi que la thématique d'Ikigai légitimée
comme une politique locale du vieillissement au Japon.
Donc, sur le contexte contemporain du vieillissement au Japon,
nous pouvons également dire que, comme le mentionne Mormont sur la mise
en place de systèmes incitatifs agri-environnementaux, «
l'efficacité [des mesures] dépend largement de dispositifs
sociaux qui acceptent ces mesures637 ».
D'ailleurs, nous devons ajouter que le contexte du Projet
Nô-Life ne s'inscrit pas seulement dans le contexte du vieillissement de
la population générale, mais également dans celui de la
crise de la politique agricole. Elle se traduit par la diminution et le
vieillissement de la population agricole et le délabrement des terrains
agricoles, dont la politique de la modernisation agricole amorcée dans
les années 60 n'a pas pu régler la situation, face à la
logique de plus en plus puissante du marché et du monde industriel dans
le contexte de la Haute croissance économique. Loin d'améliorer
la situation, cette politique a très vite causé un effet
suicidaire tant pour l'appareil politique que pour la population agricole :
surproduction du riz et réglementation de la production rizicole
(réduction de la surface rizicole) depuis 1970638.
635 Comme nous l'avons vu dans la partie 2, l'évaluation
des degrés de dépendance (yô-kaigo do) d'une personne
âgée est sensible, d'autant plus qu'elle déterminera la
qualité et la quantité des services dont cette personne
dépandante pourra bénéficier.
636 En ce moment, le régime de pensions est un des sujets
politiques les plus sensibles au Japon.
637 Mormont, 1994 : 220.
638 De ces constats, nous pouvons également
évoquer des éléments explicatifs pour la question suivante
: pourquoi au Japon (du moins au niveau local de manière
dispercée), met-on en relation la crise agricole avec le vieillissement
de la population générale, alors que l'environnement n'est pas
pris en compte, nous semble-t-il en tout cas, avec autant d'importance et de
sensibilité qu'en Europe ?
- L'agriculture japonaise, telle qu'elle est historiquement
constituée dans la civilisation japonaise, dérange moins
l'environnement naturel que celle occidentale qui est beaucoup plus extensive
et historiquement basée sur un défrichement massif de la
forêt (grandes cultures, élevage extensif, raisins...). Au Japon,
il est impossible de défricher de la même manière qu'en
Europe, car la forêt est essentiellement montagnarde et très
dense. Et cette forêt a toujours géré, directement et
effectivement, la ressource en eau et les désatres naturels (pluies,
érosion, typhons, innondation etc). Et ceci tout en coexistant avec les
rizières montagnardes à petite échelle qui constituent
elle-mêmes également des réservoirs d'eau : ce qui n'est
pas le cas pour les cultures céréalières en Europe ! - En
matière de la ressource en eau, au Japon, la qualité et la
quantité en ressource en eau sont considérables. Au Japon, la
riziculture extensive et « chimique » ne pollue pas l'eau souterraine
autant qu'en Europe occidentale. Car les engrais et les pesticides sont
filtrés par l'eau des rizières. S'y ajoute l'abondance du flux de
l'eau et de la pluie (pluviométrie japonaise trois fois plus importante
qu'en Europe !) De plus, au Japon, l'eau potable provient essentiellement de
l'amont des rivières, et pas des nappes phréatiques comme en
Europe occidentale. Du coup, la pollution de l'eau souterainne par
l'agriculture est moins mise en cause. Si l'élevage intensif a
été très fortement contesté par la population
urbaine au Japon depuis les années 60, c'était à cause de
dérangements humain et urbain (odeurs) plutôt que du
dérangement écologique.
- Enfin, nous pouvons évoquer
l'accéssibilité importante de la population urbaine à la
production agricole au Japon. Car la petitesse naturelle et historique de
l'agriculture japonaise et la situation de pluriactivité
développée par l'industrialisaton, ont
2 Redéfinition des règles du jeu
Revenons au cadre de transaction proposé par Mormont.
Deuxièmement, pour faire face aux incertitutdes complexes aux niveaux
contextuel et social, la gestion de l'environnement doit effectuer dans son
application une mise en relation de différents domaines
socio-économiques. Il s'agit de la nécessité d'une «
articulation concrète de données physiques et
socio-économiques »639. En se référant
à la sociologie de l'innovation (Latour, Callon), cette démarche
de l'articulation concrète « `invente' une mise en relation
nouvelle, et modifie l'un ou l'autre domaine afin de les rendre
compatibles640 ».
Cette démarche est techniquement « un arragnement
local entre des données biophysiques et sociales (contraintes
juridiques, rapports économiques, demandes sociales), de manière
à former un dispositif qui les harmonise provisoirement au moins, mais
avec assez de stabilité pour que la technique puisse fonctionner et
répondre à des `besoins`641 ».
Puis, les effets causés par l'ensemble de ces processus
sont en question. En effet, ils sont imprévus et non
maîtrisés, et surtout difficiles à analyser en terme des
causalités car « elles sont à la fois écologiques,
techniques, économiques, culturelles et juridiques642 ».
Ce qui spécifie le problème de l'environnement, et «
à tel point qu'il devient nécessaire, d'intégrer dans
l'analyse sociologique l'ensemble de ces processus643 ».
Enfin, Mormont relève, comme problème dans la
redéfinition des règles du jeu pour la gestion de
l'environnement, le « conflit de légitimité
»644. Il s'agit non seulemnt des demandes de différents
types d'acteurs, mais de « questions de fait ou d'évaluation de la
réalité et de l'avenir645 ».
Essayons de transposer dans notre contexte de la gestion du
vieillissement, les enjeux relevés par Mormont sur la
redéfinition des régles du jeu en matière de gestion de
l'environnement. D'abord, nous savons que la gestion du veillissement
nécessite également une mise en relation de différents
domaines socio-économiques, comme dans la gestion de l'environnement.
Nous avons ensuite vu dans la partie de l'acteur 2,
l'évolution du rapport entre acteurs du vieillissement : du rapport
auparavant limité par celui de l'Etat (établissements publics
gérés par l'Etat centralisé) et la famille, aux rapports
multipliés de manière décentralisée concernant
plusieurs domaines diversifiés : économique, santé
physique (dépendance et maladie), santé mentale, diverses
activités de personnes âgées. Et à plusieurs
échelles institutionnelles : Etat, entreprises, syndicats,
collectivités territoriales, hôpitaux, établissements
publics et privés pour les aides aux personnes âgées
dépendantes, diverses organisations pour les activités des
personnes
fortement hybridé la population agricole avec la
population et le système urbains. Berque explique ainsi la
configuration
urbaine-rurale en comparaison avec celle française, ainsi
en 1973 « (...) une imbrication des franges urbaines et de la
campagne,
dont la banlieue parisienne ne donne pas idée ;
là, antinomie entre la grande culture et le résidentiel,
opposition accusée par le
relief ; ici, que ce soit autour d'Osaka, de Nagoya ou de
Tôkyô, rien d'abord qui rappelle les espaces découverts des
plateaux de grande culture de la région parisienne ; puis, la
rizière comme l'habitat ont la même prédilection pour les
mêmes espaces plans ;
enfin, l'habitat ne diffère pas sensiblement de la
ville à sa couronne et à la grande banlieue, à ceci
près qu'il se desserre
relativement : c'est mutatis mutandis comme si l'on trouvait
le même habitat pavillonnaire du plateau de Saclay à la plaine
d'Issy-les-Moulineaux et à Montparnasse. » (Berque, 1973 :
324)
- Toutefois, nous pouvons également évoquer
l'impact que peut avoir le vieillisement de la population
générale dans la campagne française par rapport à
la mobilité des personnes âgées. « Les
mobilités de retraites vers les espaces ruraux ont un peu
contribué à
leur regain démographique au cours des
dernières décennies (...). L'accroissement de cette population
dans les vingt prochaines années est une donnée (en 2020, un
Français sur trois aura plus de 60 ans) ». Mais ce facteur
implique beaucoup d'incertitudes
sur les comportements et modes de vie futurs des personnes
âgées. « Mais il y a beaucoup d'incertitutdes sur les
facteurs ou
variables explicatifs des comportements et modes de vie
futurs des personnes âgées : les ressources et contraintes
budgétaires des retraités, la répartition territoriale de
l'offre d'équipements et de services d'accompagnement en matière
de soins et de santé, les
types d'activités que les seniors pratiqueront dans
l'avenir sont par exemple objet d'incertitudes, et pour certains aspects de
controverses. »(Perrier-Cornet, 2000, 39-40) N'est-il pas aisé
d'y ajouter comme facteur explicatif, soit le contexte du
« vieillissement actif », soit, pourquoi pas, celui
d'Ikigai à la française ?
639 Ibid. : 213.
640 Ibid.
641 Ibid.
642 Ibid. : 214
643 Ibid. : 214
644 Ibid.
645 Ibid.
âgées (Centre des ressources humaines
âgées, Clubs des Personnes âgées, éducation
permanente) et enfin familles etc.
S'agissant du contexte du Projet Nô-Life, nous pouvons
dire que le rapport établi entre les acteurs concernés, est une
des variables locales de la forme multiple et complexe des rapports entre
acteurs du vieillissement mentionnée ci-dessus. Dans le cas du Projet
Nô-Life, nous avons donc : collectivités territoriales
(administration agricole : BPA, BDPA, services pour les activités des
personnes âgées : SCI) ; organismes du secteur agricole
(coopérative agricole : CAT, vulgarisatition agricole : ECV) ; syndicat
ouvrier : CLFS ; agriculteurs professionnels : GASATA, et individus
variés : stagiaires de la formation Nô-Life.
Transcodage : un outil pertinent pour le processus bricolage -
transaction
Dans ce contexte, nous pourrions parler d'une « technique
» de mise en relation des acteurs de politique publique,
opérée dans le processus de la construction du Projet
Nô-Life : celle du « transcodage ».
Cette notion est proposée par P. Lascoumes pour
comprendre les choses qui se traduisent au sein d'acteurs en réseaux
d'action publique646. Pour élaborer cette notion, Lascoumes a
adapté la notion de « traduction » de la sociologie des
sciences (B. Latour, M. Callon), qui implique l'idée de donner aux
autres une interprétation de leurs idées et intérêts
par le langage de ce qui interpréte (traducteur), dans le but de mieux
réaliser la stratégie du traducteur647.
Nous allons repérer ici les caractéristiques de la
notion du transcodage sur les quatre points suivants : 1 Equilibrage ; 2
Situation de pouvoir ; 3 Inégalité de pouvoirs ; 4 Concurrence et
luttes.
1 Equilibrage. Premièrement, le transcodage,
à la différence de la traduction qui essaie d'intégrer
à la stratégie du traducteur, les stratégies des autres
acteurs de types différents, essaie d'équilibrer les
différentes traductions en présence dans l'élaboration des
politiques publiques648.
Dans ce sens, l'approche du transcodage nous semble plus
relativiste que la traduction, et plus éclairant pour comprendre une
relation de compromis qui met en relation des acteurs en conservant leurs
intérêts divergeants.
Ensuite, Lascoumes met l'accent sur le "recyclage" d'idées
et de pratiques déjà établies au sein des acteurs
concernés649.
A partir de là, nous pouvons considérer que le
transcodage est une technique spécifique d'arrangement ou de
coordination qui permet au « transcodeur » de respecter le processus
de bricolages effectués en interaction avec différents types
d'acteurs.
Cela pourrait entrer dans le paradigme de transaction que nous
allons évoquer plus bas, à savoir un cadre pour le
développement d'une politique publique, dans lequel l'anticipation et
l'engagement des acteurs sont primordiaux. Car le transcodage permet aux
acteurs de conserver leur propre manière d'agir et de communiquer sous
forme de réseaux dans le cadre d'une action publique.
2 Situation de pouvoir. Selon Lascoumes,
l'opération de transcodage ne fait pas qu'équilibrer les
positions des
uns et des autres, mais elle implique aussi un rapport de
pouvoir : « être en situation de pouvoir ». Donc, cela
646 LASCOUMES, P.(1996),"Rendre gouvernable : de la "traduction"
au "transcodage" L'analyse des processus de changement dans les réseaux
d'action publique", p.325-338 in La Gouvernabilité, PUF.
647 « J'appellerai traduction l'interprétation
donnée, par ceux qui construisent les faits, de leurs
intérêts et de ceux des gens qu'ils recrutent » LATOUR, Br.
(1989), Science en action : p.172.
648 « La signification que nous donnons à la notion
de `transcodage' s'inspire de celle de 'traduction' utilisée par Michel
Callon, dans la mesure où ce processus concerne une activité de
production de sens par mise en relation d'acteurs autonomes et transaction
entre des perspectives hétérogènes. La traduction est
ainsi une activité spécifique aux réseaux socio-techniques
et technico-économiques étudiés par la sociologie des
sciences ; mais des activités de même type s'observent dans les
réseaux d'action publique, 'polity' ou 'community network'. »
(Lascoumes, 1998 : 336) ; « Les oprérations de transcodage sont
celles de l'agrégation de positions diffuses, le recyclage de pratiques
établies, la diffusion élargie des constructions
effectuées, le tracé d'un cadre d'évaluation des actions
entreprises » (Ibid.)
649 « Tous les discours portants sur la 'nouveauté'
des problèmes et des politiques sont d'abord là pour occulter
l'essntiel, à savoir qu'il s'agit en grande partie d'entreprises de
recyclage. C'est-à-dire de conversion-adaptation du
'déjà-là' de l'action publique, de ses données
préexistantes, de ses catégories d'analyse, de ses
découpages institutionnels, de ses pratiques routinisées »
(Ibid. : 335)
implique le fait de s'imposer aux autres, et de les rendre
dépendants650.
3 Inégalité de pouvoirs. Le transcodage
suppose ensuite l'inégalité des capacités d'agir des
acteurs concernés dans leur situation objective qui
précontraignent leurs espaces d'interactions651.
4 Concurrence et luttes. En tenant compte de cette
inégalité de pouvoirs des acteurs prélimités, le
transcodage ne peut pas s'effectuer dans une condition égale pour tous
les acteurs. Du coup, le jeu des acteurs concernés doit se
dérouler dans un « univers conccurentiel » dans lequel «
tous les acteurs et actants ne disposent pas des mêmes pouvoirs
performatifs652 ».
Dans un tel contexte, selon Lascoumes, le transcodage devient une
sorte de « lutte » pour maîtriser les réseaux
eux-mêmes d'action publique653.
Enfin, étant une manière d'arrangement local dans
une action publique, le transcodage implique l'équilibre et la tension
de pouvoirs d'agir entre différents types d'acteurs impliqués.
Il nous permet d'envisager de mettre en relation
différents types d'acteurs concernés dans une relation
d'équilibre qui leur permettra d'anticiper et d'engager dans le
processus de construction d'une politique publique.
Puis, il nous permet également d'envisager un rapport
de forces inégal donné, de façon à ne pas
l'interpréter ou le réduire à celui
dominant-dominé, mais de l'accepter comme une structure possible
à restructurer via des actions constructives.
Transcodage dans le processus du Projet Nô-Life
Le transcodage a joué un rôle important au cours
du processus de coopération entre les agents du secteur agricole et ceux
du secteur des services publics qui ont abouti à créer le Projet
Nô-Life autour de l'idée de promouvoir l'agriculture de type
Ikigai en s'appuyant sur la population locale âgée mais
potentiellement active (baby-boomers), et ainsi de mettre en valeur les
terrains agricoles menacés de délabrement.
Le transcodage s'est opéré entre les deux
thématiques suivantes relevant chacune d'un domaine politique : la
politique agricole de la conservation (ou développement) agricole ; la
politique sociale du vieillissement du la promotion (ou développement)
d'Ikigai des personnes âgées contribuant à la
prévention de la dépendance.
Ces deux politiques se sont retrouvées autour d'un
référentiel commun pour construire le Projet Nô-Life :
Ikigai. Mais comment ?
Le BPA (Bureau de La politique agricole) de la
Municipalité de Toyota plutôt ancrée dans le secteur
agricole, essayait de trouver des moyens de résoudre le problème
du développement agricole (crise) via une approche du « bien commun
» sous l'implusion de l'idée de la multifonctionalité de
l'agriculture et de la ruralité depuis l'établissement de son
premier plan agricole décennal nommé « Toyota agri-bility
plan 2005 » en 1996. Depuis lors, elle a tenté de trouver non
uniquement dans le secteur agricole, mais davantage dans le public
général, de nouveaux appuis (partenaire) et une nouvelle
destination (client) de sa politique agricole.
Nous l'avons vu dans la partie de l'acteur 1 (BPA : Bureau de
la politique agricole), ce plan s'inscrivait explicitement dans le contexte de
la restructuration de la politique agricole nationale suite au contexte de la
libéralisation du marché extérieur et intérieur
(mondialisation économique) marqué par les accords du GATT
650 « Transcoder, c'est rendre gouvernable. (...) Etre en
situation de pouvoir dans un réseau d'action publique, c'est avoir une
forte capacité d'intégration de
l'hétérogène, de recyclage des pratiques discursives et
matérielles routinisées, de développement d'alliances
stabilisantes et de production de principes de jugement des actions
entreprises. Etre en situation de dépendance, c'est au contraire se voir
imposer des qualifications, des mises en relations, des reconversions, c'est
subir des alliances forcées et des principes de jugement » (Ibid.:
338)
651 « rappeler que les capacités performatives des
actants (humains et objets) varient selon un ensemble de déterminants
économiques et sociaux qui structurent les espaces dans lesquels
s'accomplissent les interactions ». (Ibid. :328)
652 Ibid. : 338.
653 « Face aux changements sociaux, le transcodage est en
quelque sorte la lutte pour la maîtrise des réseaux d'action
publique, de leurs frontières, de leur acteurs, de leurs
intermédiaires, de leurs productions et des significations communes
données aux interactions qui en assurent la cohésion »
(Ibid.)
relatifs à l'agriculture en 1994.
Puis, le BPA a progressivement dirigé sa politique
agricole vers le public dans ce contexte en établissant le lien entre
celui-ci et l'agriculture dans l'optique de la multifonctionalité. Mais
dans un premier temps, son approche penchait plutôt vers le loisir, le
repos et la santé (Parc rural qui a échoué, Jardins
familiaux et citoyens).
Puis, la CAT (Coopérative agricole de Toyota), agent
principal du secteur agricole privé et partenaire traditionnel du BPA, a
rejoint, quoique partiellement, l'approche basée sur l'«
intérêt général » du BPA en lançant en
2000 l'Ecole de l'agriculture vivante destinée au public. Mais en
réalité, cette école était plutôt
destinée aux personnes âgées des foyers agricoles
pluriactifs. Et l'idée de promouvoir une production agricole à
petite échelle avec les femmes (épouses et grand-mères) et
les hommes âgés des foyers agricoles pluriactifs, était
déjà présente tant dans les pratiques de ce type de
population agricole que dans la politique agricole de la modernisation depuis
les années 60 (nous l'avons vu en partie dans le chapitre 1, et le
constaterons également plus bas dans la généalogie de
l'agriculture de type Ikigai).
Et parallèlement à cela, le BPA a
coopéré avec le SCI (Service pour la Création d'Ikigai) de
la Municipalité, relevant du domaine de l'éducation permanente
mais à l'origine du domaine du bien-être - vieillissement, pour
lancer en 2002 la Ferme-école des personnes âgées
destinée au public dont essentiellement la population non agricole
âgée.
Le cadre de coopération s'est ainsi établi entre
les agents du secteur agricole et les services publics en matière de
vieillissement, en se basant sur leurs activités
préétablies, savoirs et intérêts réciproques.
Ceci par l'intermédiaire de l'intervention du BPA et du
référentiel commun d'Ikigai des personnes âgées.
Le Projet Nô-Life fut ainsi construit par la
coordination du BPA tout en effectuant un transcodage par ce
référentiel commun d'Ikigai, entre une série d'acteurs
relevant de secteurs différents, dont notamment le secteur agricole (CAT
: co-gestionnaire ; BDPA : administration agricole ; ECV : vulgarisation
agricole ; GASATA : groupement d'arboriculteurs professionnels), le secteur des
services publics en matière de vieillissement (SCI) et le secteur
industriel et « salarial » (CFLS : syndicat ouvrier). En plus, nous
avons vu qu'une déréglementation de la Loi agraire relative
à la surface minimum d'installation fut effectuée en profitant du
cadre national des « Zones spéciales pour la réforme
structurelle ».
Nous pouvons éclairer cette opération de
transcodage, en schématisant ci-dessus la structure de l'échange
effectué entre ces acteurs dans lequel le cyclique fin - moyen constitue
un procédé crucial654.
654 Rappelons - nous ici la définition du bricolage de
Lévi-Strauss : le bricolage défini par l'univers instrumental
(structure des moyens) en reconstruction incessante par le cyclique de sens
donnés aux objets mobilisés, entre la fin et le moyen. Et son
résultat est toujours « un compromis entre la structure de
l'ensemble instrumental et celle du projet. » (cité plus haut)
Schéma : structure de l'échange fin -
moyen

Secteur services publiques
vieillissement
Secteur agricole
Fin
Fin
et développement agricoles
Conservation
Promotion d'Ikigai
des personnes âgées
Moyen
BPA
Agriculture
de type Ikigai
Moyen
Dispofitifs
socio-économiques
Dispositifs
socio-économiques
Pour le secteur agricole, Ikigai des personnes
âgées (de la population générale) est
interprété comme moyen susceptible de servir à la
conservation et au développement agricoles. Et inversement pour le
secteur des services publics du vieillissement : conservation et
développement agricoles comme moyen de servir à la promotion
d'Ikigai des personnes âgées.
Puis, pour le secteur agricole, les personnes
âgées actives dont la majorité salariale et les dispositifs
socio-économiques des services publics ayant un certain niveau de
capacité de financer le Projet et de mobiliser cette population, sont
également interprétés comme utiles pour la
réalisation de la conservation et du développement agricoles. Et
inversement pour le secteur des services publics du vieillissement : la
population agricole et les dispositifs socio-économiques, comme utiles
pour la réalisation de la promotion d'Ikigai des personnes
âgées.
Autrement dit, dans ce transcodage, elles se sont
réciproquement « instrumentalisées » en
opérérant un transcodage entre leurs fins respectives
(conservation et développement agricole - promotion d'Ikigai des
personnes âgées).
D'un côté, depuis les années 70, la
politique agricole donnait, à la notion d'Ikigai le statut de «
moyen » de réaliser sa fin qui est la conservation et le
développement agricoles, dans un sens incitatif vis-à-vis des
producteurs cibles et marginalisés (femmes au foyer et hommes
âgés des foyers agricoles pluriactifs) dans un contexte de crise
permanente depuis les années 60-70.
De l'autre côté, pour la politique sociale du
vieillissement, l'agriculture a été retrouvée comme un bon
moyen de réaliser sa fin de la promotion d'Ikigai liée à
la prévention de la dépendance (qui est un élément
émergeant dans la structure de son projet en pleine «
restructuration »). Mais dans ce contexte, l'agriculture était
interprétée, au moins au début du processus, plutôt
dans le prolongement du loisir et du moyen de prévenir la
santé.
Cependant, il nous reste à poser une autre question :
cet échange effectué par un transcodage, est-il
équilibré en terme de pouvoirs ? Comme nous l'avons vu plus haut,
P. Lascoumes relevait que transcoder implique d'« être en situation
de pouvoir ». Ce transcodage alimentant un compromis entre les agents
gestionnaires en coopération (BPA et CAT : coopérative agricole
de Toyota), il nous semble nécessairement impliquer un rapport de
pouvoirs inégal tant au niveau matériel et technique qu'au niveau
symbolique. Nous aborderons cette question dans la réponse à la
quatrième question de ce chapitre sur la relation établie entre
acteurs.
3 Modèles de transaction - cadres
institutionnalisés d'anticipation et d'engagement
Reprenons de nouveau le cadre proposé par Mormont.
Troisièmement, les cadres d'anticipation et d'engagement des acteurs et
leur institutionalisation sont supposés comme être constitutifs
des modèles de transaction.
Concernant la notion d'anticipation, Mormont insiste sur le
fait qu'elle est « cruciale pour saisir la complexité des
problèmes d'environnement », pour que ceux-ci puissent
apparaître « comme une situation dans laquelle différents
scénarios d'anticipation sont possibles, se référant
chacun à la fois à des prévisions ou des extrapolations
scientifiques et à des revendications en termes de valeurs ou
d'identité655 ».
En se basant sur sa réflexion sur les comportements
anticipatifs des agriculteurs vis-à-vis de mesures préventives
pour l'environnement, ils conclut que « les rationalités
immédiates de l'agriculteur n'obéissent pas nécessairement
aux représentations que les théories expertes s'en font et ceci
constitue un problème essentiel pour la mise en oeuvre de politiques
préventives656 ». Puis, le comportement anticipatif est
également imposé du côté des acteurs politiques
comme les experts : ils sont en fait « obligés de mobiliser des
modèles par lesquels ils anticipent à la fois sur des processus
naturels et sur des comportements sociaux, ainsi que sur leur
relation657 ». Ce qui fait que « les experts mobilisent
nécessairement une sociologie spontanée à propos des
acteurs, qu'ils soient auteurs ou victimes du risque, sociologie qui leur
permet de formuler leurs propres anticipations658 »).
Suite à cette réflexion portant sur les
comportements des agents institutionnels (experts) et individuels
(agriculteurs), il postule l'hypothèse que l'efficacité de la
mise en oeuvre de ces politiques environnementales dépend de la
correspondance entre les modèles d'anticipation des agents de ces deux
niveaux (« l'efficacité des mesures de prévention est
fortement soumise à une contrainte de correspondance entre les
modèles d'anticipation des experts (auteurs de normes et des conseils)
et les modèles d'anticipation des agents eux-mêmes659
»).
De ce fait, l' « appréhension des problèmes
de pollution par les agriculteurs ne se fait pas [toujours] de manière
technique, et l'ouverture même d'un espace de discussion avec eux
(agriculteurs) sur la question suppose que soient mis en place des cadres plus
larges d'anticipation qui concernent l'avenir de la profession ou au moins le
devenir de tels ou tels systèmes de production, qui concernent aussi le
statut des objets naturels, comme l'eau ou la faune sauvage660
».
Il s'agit donc d'ouvrir un « espace de discussion » qui
permet aux agents concernés de mettre en place les conditions plus
larges de leur anticipation.
Mormont conclut que cette mise en place d'un « espace de
discussion » est finalement « de la capacité de la politique
agricole à proposer des cadres d'expérimentation cohérents
et crédibles pour une redéfinition du métier agricole que
peuvent émerger ces cadres d'anticipation qui assurent des perspectives
à long terme à des catégories d'agriculteurs661
».
Pour aborder la notion d'engagement, Mormont s'interroge d'abord
sur la « manière dont le long terme peut se stabiliser dans un jeu
d'anticipation662 ».
Il s'agit de penser les modèles d'anticipation des acteurs
non seulement à partir de leur intérêt sur le court terme,
mais également à partir de celui sur le long terme qui peut
même relever de leur identité.
Et pour que ces intérêts puissent se mettre en place
(se stabiliser) dans la politique environnementale, quels dispositifs
institutionnels faut-t-il appeller ?
Pour répondre à cette question, Mormont nous
rappelle d'abord qu'il existe un « immense appareil de règles
» qui forme, en fait, un ensemble d'agents dominants dans le monde
agricole (politique agricole, encadrement agricole, vulgarisateurs,
organisations professionnelles etc), et porte « une définition
légitime de
655 Ibid. : 225.
656 Ibid. : 227.
657 Ibid.
658 Ibid. : 228.
659 Ibid.
660 Ibid.
661 Ibid.
662 Ibid. : 229.
l'agriculteur et de son métier663 ». Il
considère ensuite cet ensemble « non seulement comme appareil de
domination, mais comme un cadre stabilisateur permettant des anticipations
», et que cet ensemble a « un rôle dans la diminution des
incertitudes », en plus qu'il est « soumis, au moins en partie,
à des épreuves de vérification de leur validité
pour les agents664 ».
Suite à cette considération, Mormont propose que
« la possibilité de développer des mesures
préventives pour réguler les pollutions agricoles suppose de
déveloper d'autres dispositifs institutionnels dans lesquels puissent
être élaborés et testés d'autres modèles
d'anticipation, ces dispositifs ayant à inclure aussi bien des
éléments identitaires que des éléments techniques
et des connaissances quant à la nature665 ».
C'est dans le cadre de la construction de ces dispositifs
institutionnels alternatifs que Mormont situe la notion d'engagements qui
« peut être mobilisée pour comprendre comment les individus
peuvent entrer dans des processus de transformation qui concernent, dans des
contextes d'incertitudes, aussi bien les outils techniques qu'ils utilisent que
les représentations qu'ils se font de la réalité, des
objets naturels comme des réalités sociales666.
»
Schéma : modèle de transaction de
Mormont
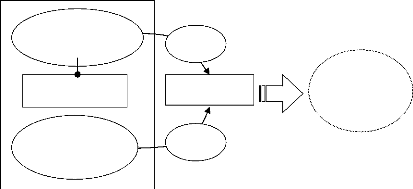
Construction
Dispositifs
institutionnels
alternatifs
Appareil de règles
(agents agricoles dominants)
Définition légitime du métier
(agriculteur)
Individus (agriculteurs)
Anticipation Engagement
Anticipation Engagement
Politique
environnement
Enfin, Mormont considère qu'il faut reconstruire ces
dispositifs institutionnels alternatifs pour que les agriculteurs ayant perdu
confiance à l'égard de la politique agricole dominante en raison
de la situation de crise, puissent à nouveau s'y engager « en
accordant suffisamment de crédibilité à de nouveaux
experts et assez de confiance à leur devenir professionnel667
». Et « ces dispositifs institutionnels doivent être vus comme
des dispositifs d'échange, consititués de transactions
c'est-à-dire de combinaison de règles, dans lesquelles sont
reconnus à la fois des intérêts sectoriels et dans des
intérêts généraux, des identités
professionnelles et des légitimités
sociétales668 ».
Cet appel à la reconstruction de nouveaux dispositifs
de la politique agricole tient compte du fait que la politique agricole (de
l'Europe occidentale) reposait bien sur un type de dispositif depuis les
années 50 basé sur un compromis entre le productivisme agricole
orienté vers le marché et l'indépendance des
exploitations
663 Ibid. : 230.
664 Ibid.
665 Ibid.
666 Ibid.
667 Ibid : 231.
668 Ibid. : 231-232. Sur ce point, Mormont se
réfère à Jobert et Muller. Ouvrage cité : JOBERT,
B., MULLER, P. (1990), L'Etat en action, Paris, PUF.
familiales, ce qui fonctionnait également comme un cadre
transactionnel669 entre les agriculteurs et l'appareil de
régles du monde agricole.
Dans le contexte d'incertitudes, le paradigme de la
transaction devient ainsi « éclairant pour essayer d'identifier les
modes d'élaboration possibles de nouveaux dispositifs institutionnels
susceptibles d'intégrer progressivement la protection de
l'environnement670 ».
Enfin, nos analyses du processus de la construction du Projet
Nô-Life portent également sur à la fois des agents
politiques et individuels, à savoir :
- agents institutionnels du secteur agricole (administration
agricole, coopérative agricole, vulgarisation agricole) - agents
institutionnels de la politique sociale du vieillissement
- agents individuels ou collectifs du secteurs agricole
(groupement de producteurs, producteurs professionnels) - divers individus
usagers (stagiaires ayant diverses trajectoires)
Et c'est une politique relevant à la fois de la crise
agricole et d'une nouvelle politique du vieillissement, nous pouvons
également supposer comme le schéma ci-dessous une construction de
nouveaux dispositifs alternatifs de la politique agricole dans le paradigme de
transaction selon le schéma de modèles de transaction que nous
avons établi ci-dessus :
Schéma : modèle hypothétique de
transaction pour le Projet Nô-Life

Appareil de règles
(agents agricoles dominants)
Définition légitime du métier
(agriculteur)
Individus
(agriculteurs)
Individus (stagiaires)
Anticipation Engagement
Projet Nô-Life
Anticipation Engagement
Anticipation Engagement
Agents institutionnels
non agricoles
Public
Construction Dispositifs institutionnels alternatifs ?
4 Transaction : grille d'analyse des interdépendances
Nous tentons d'analyser dans notre lecture du processus de la
construction du Projet Nô-Life la dynamique des représentations
sociales de l'agriculture et de la ruralité an sein de divers acteurs
concernés, d'une part, au niveau des rapports institutionnels apparement
stabilisés mais impliquant des désaccords sous-jacents, et
d'autre part, au niveau des rapports entre ces agents institutionnels et ceux
individuels portant différents types de représentations et
pratiques.
Sur ce point, comme Mormont l'indique en quatrième
point, le paradigme de la transaction sociale nous apparaît
également utile « comme une grille d'analyse des
interdépendances soit sous la forme de rapports stabiliés (qui
impliquent de lire dans les institutions les rapports sous-jacents qu'elles
entretiennent entre elles), soit sous la forme de situations d'invention
sociale de nouvelles régulations de ces
interdépendances671 ».
669 Ibid. : 232
670 Ibid.
671 Ibid. : 234.
Et nous le verrons dans le Chapitre 3, les
intérêts des stagiaires du Projet Nô-Life portent non
seulement sur le court terme mais également sur le long terme qui peut
relever de leur identité et de valeurs à respecter dans leur vie
individuelle et sociale. Nous pouvons donc rejoindre le paradigme de la
transaction sociale dans le sens de Mormont qui la différencie de la
négociation par le fait que la transaction sociale « porte sur les
principes de base des identités sociales et sur les
représentations des objets qui ne peuvent donner lieu à
négociation qu'à partir du moment où ils sont suffisamment
stabilisés pour constitutuer des cadres d'anticipation où des
intérêts peuvent être identifiés et
calculés672 ».
Transformations des représentations de
l'agriculture et de la ruralité
Y-a-t-il eu, ces dix dernières années, des
transformations des représentations de l'agriculture et de la
ruralité dans le contexte de la construction du Projet Nô-Life,
dont notamment le vieillissement de la population urbaine et rurale ?
Pour répondre à cette question, nous allons
tenter de simplifier dans un tableau de synthèse les
représentations des sept acteurs que nous venons d'étudier (ce
tableau se trouve à la page suivante). Pour établir ce tableau
nous avons retenu quatre éléments constitutifs des
représentations : contextualisation (constat de la situation) ;
problématisation (problèmes et solutions) ; intention
(motivation) ; intérêt.
Ensuite, nous pouvons distinguer les trois groupes suivants
catégorisant les sept acteurs étudiés : 1 Service public
agricole (BPA, BDPA) ; 2 Secteur agricole (CAT, ECV, GASATA) ; 3 Public en
général (SCI, CLFS) Ces trois groupes montrent trois types
distincts d'évolution des représentations de l'agriculture et de
la ruralité.
1 Service public agricole Contexte de la
restructuration
D'abord, concernant les acteurs du service public agricole,
les accords du GATT eurent une influence décisive de manière
à imposer d'en haut les décisions de la politique internationale
sur le commerce des produits agricoles aux politiques nationale et locale.
Parmi ces accords, la « catégorie verte » dans le cadre du
Soutien interne semble importante dans la mesure où elle a
encadré la restructuration des services publics agricoles. Comme nous
l'avons constaté dans la partie de l'analyse de l'acteur 1, cette
catégorie laissa une place légitime aux services publics «
de caractère général » dans les domaines concernant
la recherche, la lutte contre les maladies, de l'infrastructure et de la
sécurité alimentaire, tout en les excluant des objets de la
« réduction » des mesures protectrices des Etats membres.
C'est dans ce contexte politico-historique que fut conçu par la
Municipalité de Toyota le Plan de 96 qui apporta une nouvelle direction
de la politique agricole dans le territoire de la Ville de Toyota.
672 Ibid.
Tableau des représentations de l'agriculture et
de la ruralité
Contextualisation Problématisation Intention
Intérêt
|
Act. 1 BPA
|
Situation globale : Concurrences
internationale et nationale renforcée et restructuation services publics
(Accords GATT)
Situation locale : Types d'agriculture
locale (compétitif / non compétitif) ; Aspect dominant
(pluriactivité et vieillissement de la population agricole)
|
Problèmes : Manque de
producteurs et de valorisation des terrains agricoles ;
Pression urbaine ; Retard rationalisation de la structure des
terrains agricoles Solutions : Une nouvelle
agriculture de type « péri-urbain » (demandes consommateurs,
nouveaux débouchés) ; D éveloppement
multifonctionalité ; Ré gulation entre urbanisme et agriculture ;
Mesure face à la recomposition des foyers pluriactifs
|
Redéfinition valeurs de la Politique agricole :
Interprétation des idées globales : autosuffisance
alimentaire (sécurité alimentaire) et multifonctionalité,
par l'introduction des nouvelles catégories d'agriculture locales :
industriele et ikigai Participation citoyenne : approche « bien commun
»
|
Nouveau type de service public local de l'agriculture et de la
ruralité mis en relation avec l'urbanisme et le public (participation
citoyenne)
|
|
Act. 2
SCI
|
Situation globale : Restructuration des
services publics locaux face au vieillissement de la population ;
Nécessité de nouvelles mesures pour la prévention de la
dépendance
Situation locale : Retraite massive
de la génération baby-boom à majorité salariale du
secteur automobile
|
Problèmes : Manque de lien
social et territorial parmi la population locale, lié à
l'histoire du développement de la Ville de Toyota `immigrants de la
première géné ration'
Solutions : Aider la population
à trouver Ikigai via participation sociale ; éducation
permanente; travail. D'où l'idée « Travail d' Ikigai
valorisant le `Nô' »...
|
Amélioration environnement de vie, lien social et
territorial entre habitants
Mise en valeur du 'Nô' du point de vue de la "Ville
rurale" pour un développement local de la Ville de Toyota
|
Service public local dans le domaine du vieillissement
Eléments de 'nô' donnent nouvelles
possibilités pour développer les mesures pour Ikigai des
personnes âgées
|
|
Act. 3
CAT
|
Situation globale : Baisse prix
agricoles ; Affaiblissement secteur agricole
Situation locale : Manque de
producteurs dû au vieillissement de la population agricole
; Situation aggravée de la pluriactivité : Retraite
génération baby- boom au sein des foyers agricoles pluriactifs,
mais sans expérience agricole
|
Problèmes : Connaissances des
personnes âgées menacées de disparition ; Risque de
désolation des salariés retraités après la retraite
; Déclin zones rurales dû aux vieillissement et
dépeuplement Solutions : Mettre en valeur
salariés retraités des foyers agricoles et non- agricole ; Vie
agricole et rurale comme rem ède au vieillissement ; Combinaison
solutions aux problèmes du vieillissement de la population
urbaine / rurale
|
Formation agriculteurs : augmentation de successeurs des
activités agricoles au sein des foyers agricoles
Développement agriculture de type Ikigai, mais avec un but
lucatif en rapport avec : identité locale ; lien social ; existence
sociale
|
Organisation collective et formelle (sectorielle) de la
production agricole Mais importance du domaine de
l'Orientation agricole (formation, Nô-Life) est
économiquement faible dans l'ensemble de la Coopérative.
D'où limitation de la capacité d'investissement et de la
motivation à la coopération au Projet
NôLife...
|
|
Act. 4
BDPA
|
Situation globale : Contradiction entre
politique agricole nationale / vie « réelle » des foyers
agricoles ; Difficulté structurelle de la production agricole : "stade
irrémé diable" (conetxte du passage du contrôle é
tatique à la libéralisation du marché)
Situation locale : Inégalité valeur
fonciè re des terrains agricoles : urbain/rural ; plaine - montagne ;
Enjeu conservation des terrains agricoles : gestion biens
immobiliers au
sein des foyers agricoles ; 700ha de friches agricoles
|
Problèmes : 700ha de terrains
échappant à la politique agricole de porteurs à
grande échelle et "abondonnés par [les] proprié
taires". La prévention des friches constituant "thème de la
société" Solutions :
Impossibilité d'avoir la solution face à la réalité
objective ; Des approches politiques d'"en bas"ne relèveront pas
l'agriculture japonaise. Mais l'objectif du Projet Nô-Life (Ikigai des
personnes âgées et prévention des friches) est
légitime.
|
Tentative du Projet Nô-Life : Lier Ikigai à la
réalité sociale locale où « les propriétaires
ruraux sont embarrassés » par le problème de leur friche
agricole en terme de gestion des biens fonciers.
Mais "résultats et effets" restent difficiles à
définir compte tenu du problème globale de l'agriculture.
|
Intérêt public. Mais la finalité reste
difficile à définir face à la complexité de la
réalité de l'agriculture.
Importance de l'agriculture de type Ikigai ou de la
finalité du Projet Nô-Life est plutôt sociale
qu'économique.
|
|
Act. 5
ECV
|
Situation globale : Concurrence
internationale et nationale renforcée ; Baisse prix agricoles
Situation locale : Situation de plus en
plus aggravée ; Types d'agriculture à productivité
forte/faible c-à-d : type entrepreunarial / type Ikigai menée par
les personnes âgées et les femmes (des foyers pluriactifs)
|
Problèmes : Manque de
producteurs ; Baisse de motivation des producteurs dû à
la « faible efficacité économique et vieillissement
»
Solutions : Formation divers types de
porteurs ; Développement des activités locales ; Soutien nouveaux
producteurs de produits locaux (légumes, fleurs) dont notamment les
salariés retraités revenants à la terre via
coopération avec le Centre N ô-Life.
|
Orienter nouveaux producteurs au niveau des zones de production
spécialisée afin de les élargir et de les rendre plus
compé titives. Mais la place des nouveaux participants d'origine «
non agricole » reste secondaire du point de vue de la productivité
par rapport aux porteurs de type industriel et entrepreneurial.
|
Continuation et réussite de sa politique productiviste,
sélective, en se basant sur son rôle de modernisateur et son
statut privilégié d'expert technique, économique et
scientifique
|
|
Act. 6
CFLS
|
Situation globale : Crise
autosuffisance alimentaire au Japon (forte dépendance alimentaire) ;
Manque main-d'oeuvre agricole
Situation locale :
Supériorité de l'industrie par rapport à l'agriculture est
une condition "indéniable" ; Thématique d'Ikigai pour les
retraités est importante pour les activités locales du CLFS. Ceci
pour renforcer le rapport entre syndicat et localités.
|
Problèmes : Conservation
terrains agricoles et forêts de montagne
Solutions : Introduction de nouveaux
types de main-d'oeuvre : immigrants ou jeunes. Mais la thématique
d'Ikigai est incompatible avec celles de l'agriculture et de la ruralité
: autosuffisance et main- d'oeuvre. Il faut "une politique de portée
nationale"
|
Implication dans la politique municipale et dans les divers
domaines de la vie de la population locale
« élargir la variété d'activités
d'Ikigai pour salariés retraités »
Domaine d'implication limitée à la promotion
d'Ikigai Mais non dans les thématiques de l'agriculture et de la
ruralité.
|
Intérêt de l'organisme : renforcer l'ancrage local
en coopérant avec la politique municipale et la population locale.
Motivation encore partielle et limitée pour l'implication
dans le Projet Nô-Life, malgré les attentes potentielles des
salariés vis-àvis de l'agriculture et de la ruralité :
Intérêt limité des travailleurs : jardinage, loisir,
auto-consommation. Mais non la conservation des terrains agricoles et de la
formation de porteurs de l'agriculture.
|
|
Act. 7
GASATA
|
Situation locale : Crise
délabrement de la zone de production face au vieillissement
|
Problèmes : Délabrement
zone de production ; Difficulté de discuter des probl èmes avec
les gens des foyers agricoles pluriactifs ("papis et mamies")
Solutions : Prévention des
friches. Renforcement du rapport d'entraide entre arboriculteurs et du rapport
avec le public.
|
Conservation vergers pour le futur ; aider et encourager la
"première génération" à continuer sa production
agricole Renforcement intérêt public vis-à-vis de la
zone de production afin de maintenir sa durabilité
Conservetion de la relation sociale des arboriculteurs
Avoir plus de main-d'oeuvre et de reconnaissance publique avec le
Projet Nô -Life
Un but lucratif nécessaire pour développer
l'agriculture de type Ikigai
|
Propre intérêt professionnel : souci sur l'avenir
des exploitations individuelles et leur zone de production
Recherche d'un autre appui que l'économie sectorielle
(marché, coopérative) pour le maintien de leur production.
|
Toutefois, aux yeux des acteurs concernés, cette
restructuration n'est pas seulement le reflet du contexte dicté par la
politque internationale de la libéralisation du marché : Monsieur
M du BDPA a bien souligné l'état «
irrémédiable » de l'agriculture japonaise suite au passage
historique de la politique : de la protection du marché du riz à
la libéralisation de celui-ci. Pour lui, la position de l'administration
est de « [venir] en aide pour combler cette absence des aides du
gouvernement qui étaient mises en place auparavant », et cet
état actuel de l'administration est qualifié de «
douloureux ». Cette remarque témoigne du point de vue de
Monsieur M, qui est
un acteur de l'intérieur de l'administration locale
subissant le contexte de cette restructuration. En fait, selon lui, la
situation de l'administration locale vis-à-vis de l'agriculture est
aujourd'hui comme si elle « traitait un malade qui est dans un stade
irrémédiable », c'est-à-dire, l'administration
(service public) locale doit payer les pots cassés de la politique
agricole nationale qui était mise en place auparavant. Mais quels pots
cassés ? Nous pouvons rappeller deux défaillances historiques de
la politique agricole japonaise : Selon Monsieur N, la politique agricole
japonaise impliquait une contradiction dans sa tentative permanente de la
modernisation agricole consistant à favoriser l'aggrandissement
d'échelle et la spécialisation au detriment des conditions de la
réalité locale faisant obstacle à ce type de modernisation
(petite structure des exploitations familiales, zones en plaine subissant la
forte pression urbaine, zones en moyenne montagne condamnée à
subir l'exode et le vieillissement de la population rurale critique etc). Puis,
s'y ajoute la politique du soutien au marché du riz qui a
provoqué la surproduction dès les années 70.
Nous devons resituer la nouvelle politique menée par la
Municipalité de Toyota dans ce contexte paradoxal dans le sens où
cette politique paraît ambitieuse du point de vue du marché, mais
désespérante du point de vue « objectif » de Monsieur
M, un acteur de terrain qui vit et opère par lui-même les mesures
de cette politique au niveau local.
Redéfinition de l'agriculture locale
C'est ainsi que le Plan de 96 vint redéfinir la place
de l'agriculture et de la ruralité en pronant les valeurs de celles-ci
du point de vue de l'autosuffisance alimentaire et de la
multifonctionalité, et les définissant comme "bien commun" des
citoyens de la Ville.
Par ailleurs, les démarches de la politique de la
Municipalité de Toyota se sont déroulées de manière
à se baser sur la situation locale, où le côté non
productif de l'agriculture était de plus en plus apprécié
parmi les habitants comme le montre le succès des jardins familiaux qui
connaissaient déjà à cette époque un
développement remarquable en utilisant des parcelles appartenant aux
foyers agricoles pluriactifs, situées en zone à urbaniser. De
plus, dans notre analyse, nous avons bien constaté que le Plan de 96
avait un caractère anticipatif de la politique de la
multifonctionalité ou du développement rural qui n'était
pas encore mise en place par l'Etat à cette époque. Selon notre
analyse, l'établissement du Plan de 96 était d'un
côté encadré par la politique globale, mais d'un autre
côté, une réaction spontanée à la propre
initiative de la Municipalité de Toyota et d'autres agents locaux en
collaboration avec elle, tout en effectuant un travail de « bricolage
» d'idées d'origines hétérogènes.
Enfin, la politique pour le développement de
l'agriculture de type Ikigai a vu une convergence d'intérêts avec
la nouvelle politique du vieillissement qui émergea depuis 2001 par
l'établissement du CPCI (Comité pour la Promotiona de la
Création d'Ikigai) suite à l'entrée en vigueur de la Loi
de l'Assurance des Aides pour les personnes âgées
dépendantes en 2000. Le CPCI s'est intéressé aux
éléments de 'nô (agricole et rural)' en vue de les
intégrer dans l'élaboration des nouvelles mesures pour
développer les activités d'Ikigai des personnes
âgées du point de vue de la prévention de la
dépendance. C'est ainsi que l'idée de l'agriculture de type
Ikigai a véritablement eu son « droit de cité » dans la
Ville de Toyota, et que le Projet Nô-Life a vu le jour en 2004 en mettant
en avant cette idée dans le cadre de la politique agricole de la Ville
de Toyota.
2 Secteur agricole
Au sein des acteurs du secteur agricole, le constat de la
situation de crise s'est renforcé au cours de cette décennie,
d'un côté en rapport avec la situation historique et interne comme
le dépeuplement, la pluriactivité, le manque de producteurs et le
vieillissement de la population agricole, de l'autre côté en
rapport avec la conjoncture globale comme la baisse des prix agricoles due au
renforcement de la concurrence internationale.
En même temps, l'approche politique de l'ECV reste
toujours dualiste entre celle modernisatrice favorisant la plus haute
productivité qui met l'accent sur une ultra minorité des
producteurs compétitifs sur le marché, et celle mettant l'accent
sur les producteurs marginaux dont notamment les femmes et les personnes
âgées des
foyers agricoles pluriactifs qui constituent la majorité
de la population agricole.
Puis, l'approche menée par la CAT avec des femmes et
des personnes âgées promouvant la vente directe, de petites
productions de produits du terroir est bien présente depuis les
années 80, et ce type d'approche se renforce de plus en plus. Ceci est
lié à la situation ambivalente des foyers pluriactifs qui ont
d'un côté subi l'essor du développement industriel, mais de
l'autre côté, en ont bénéficié en en retirant
un revenu stable. Puis, cette couche des producteurs agricoles a
également subi la politique du contrôle de la surproduction qui,
depuis 1970, lui a imposé une réduction de la surface rizicole. A
l'exception de quelques zones de production qui ont réussi à se
spécialiser collectivement dans un type de produits (comme dans le cas
de la poire et la pêche de Sanage), la plupart des foyers agricoles n'ont
pas pu s'adapter à cette politique de manière positive.
D'où la pluriactivité et la petite structure de la plupart des
foyers agricoles faisant le trait dominant de la situation agricole au Japon
jusqu'à aujourd'hui.
Enfin, nous pouvons remarquer que la conception de «
Second Life Academy » de Monsieur S de la CAT reflétait la
situation urbanisée des foyers agricoles pluriactifs, en se
préoccupant du risque de « désolation » (ennui,
inertie, isolation etc) des retraités salariés des foyers
agricoles pluriactifs. Puis, cette idée a rejoint la politique agricole
de la Municipalité de Toyota lors de l'établissement du Plan de
96, et déterminé le projet de l'Ecole rurale. Ce qui a fait le
compromis entre l'approche destinée au public de la Municipalité
et l'approche sectorielle de la CAT afin de mener leur coopération.
Par ailleurs, les jeunes arboriculteurs de Sanage dont
Monsieur N était leader, ont également montré une nouvelle
approche destinée au public dès le début des années
90 en commençant la « Journée de la peinture des fleurs de
pêcher ». Cette tentative était liée au souci de
Monsieur N sur le futur délabrement de la zone de production. Ce qui
montre que même ces arboriculteurs professionnels de Sanage qui ont
réussi la modernisation agricole, ont également commencé
à s'intéresser à une autre approche que la politique
sectorielle de la modernisation en se dirigeant vers le public. La
coopération entre le GASATA et le Projet Nô-Life est un mouvement
recherchant à la fois un développement de l'agriculture de type
Ikigai intégrant la participation citoyenne, et le mode futur de
développement de la zone de production de la poire et de la pêche
de Sanage.
3 Public en général (citoyens)
Au côté du public en général, nous
avons pu constater qu'il y a de plus en plus de prise de conscience des
éléments de la qualité de vie comme nous pouvons le
constater dans la tendance des jardins familiaux et citoyens.
Monsieur Y, vice-chef du secrétariat du CLFS,
lui-même loue également un petit jardin potager pour son
autoconsommation. Et selon lui, il y a beaucoup de salariés autour de
lui qui pratiquent le jardinage.
L'idée d'Ikigai n'est pas sans rapport avec cette
tendance. Monsieur Y nous a expliqué que la valeur d'Ikigai peut changer
en fonction des périodes de vie : périodes active et
retraitée. La différence des valeurs d'Ikigai entre ces deux
générations est que la génération active a tendance
à rechercher la richesse économique tandis que la
génération retraitée veut retrouver le sens de la richesse
dans l' « usage du temps ».
Le Projet de la Maison des Fleurs réalisé en
1997 par la coopération entre le CLFS et la Municipalité de
Toyota montre une interprétation originale de l'idée d'Ikigai en
combinant la production horticole et la contribution sociale des personnes
âgées. Une tentative d'aller plus loin que le niveau d'un simple
loisir.
Et cette approche a rejoint l'approche de la SCI qui, à
l'initiative citoyenne du CPCI, a développé les nouvelles mesures
d'Ikigai en se centrant sur l'éducation permanente (apprentisage), la
contribution sociale (participation, lien social) et le travail d'Ikigai
(production).
Puis, le Projet Nô-Life s'est inspiré de cette
idée pour démarrer. Monsieur YM qui, après la formation
Nô-Life, continue à produire la poire chez Monsieur N à
Sanage, releva ainsi comme éléments de sa motivation pour ses
activités agricoles, les éléments introuvables dans la vie
des salariés urbains tel que le lien de sociabilité et le contact
avec la nature.
D'ailleurs, dans le cas des stagiaires du Projet
Nô-Life, nous l'aborderons dans le chapitre 3, la racine rurale dans leur
trajectoire semble fortement jouer. Il s'agit notamment d'émigrants
ruraux originaires d'autres régions
et de fils des foyers agricoles pluriactifs locaux. En fait,
c'est déjà le cas chez Monsieur YM qui est le troisième
enfant d'une ferme de Shikoku, et qui a émigré à Toyota
afin de travailler pendant quarante ans dans une usine automobile...
Eléments de représentation de l'agriculture de type
Ikigai
Enfin, en survolant ces trois types d'évolution, quels
éléments de représentations pouvons-nous retenir ?
D'abord, ces représentations n'appartiennent ni uniquement à la
profession agricole (productivisme), ni au monde rural représenté
par les communautés villageoises telles qu'elles ont longtemps
été l'objet de la sociologie rurale japonaise avec le concept de
« Ie - Mura (famille - village) »673. Puis, elles ne se
définissent pas non plus par opposition à la ville. Elles ne sont
pas non plus le simple reflet du point de vue urbain détaché des
traits agricole et rural que nous venons d'évoquer, à savoir le
cadre de vie, le paysage et la nature...674
Il faut tenir compte des trois contextes suivants marquant les
représentations émergentes dans le processus de la construction
du Projet Nô-Life. Premièrement, la situation historique de crise
de l'agriculture et de la ruralité s'aggrave de plus en plus
malgré les efforts politiques de la modernisation agricole.
Deuxièmement, l'évolution de la société salariale
(ou post-industrialisation) vient de changer le comportement de la population
urbaine675. Troisièmement, le changement de la conjoncture
économique globale (ou mondialisation) vient restructurer la politique
nationale et locale ainsi que le rapport entre acteurs.
Ces trois contextes font émerger, dans le contexte de
la Ville de Toyota, une hybridation de la relation urbain-rural. Cette
hybridation résulte à la fois de l'émigration rurale
massive dans les années 60-70 et du développement de la
pluriactivité des foyers agricoles locaux. Ces deux
phénomènes, historiquement engendrés par
l'industrialisation et l'urbanisation, ont radicalement bouleversé la
population agricole et rurale au Japon depuis ce dernier demi-siècle.
En plus de cette hybridation au niveau de la situation, une
autre hybridation a eu lieu au niveau des représentations autour de
celle de l'agriculture de type Ikigai. Pour identifier cette hybridation de
représentations, nous pouvons retenir les trois éléments
suivants : qualité de vie (priorité à la satisfaction
individuelle, consommation, style de vie etc.) ; lien social et territorial
(contribution sociale, sociabilité) ; production matérielle
(travail, lucrativité).
L'idée de la qualité de vie relève de la
vie urbaine et individualisée. Et les éléments de
'nô' (agricole et rural) servent de référence pour la
recherche de cette qualité, en terme de santé physique et
mentale, de l'alimentation, du cadre de vie (aménité, paysage),
du contact avec la nature et éventuellement de l'identité
culturelle (racine rurale) etc.
673 Dans un récent ouvrage d'un grand sociologue rural
japonais, qui traite le devenir de l'agriculture et de la ruralité au
Japon, ce concept tient toujours le coeur de l'analyse. Dans cet ouvrage, le
combinaison « famille - village » est défini en relation avec
la production agricole à petite échelle ancrée dans
l'ensemble de la production matérielle et la reproduction du travail qui
se distingue de la production de type capitaliste basée sur la seule
recherche du profit. (Hosoya, 1998 : 9-17)
674 D'après un récent ouvrage collectif sous la
direction de Ph. Perrier-Cornet, en France, trois éléments
suivants « ressource », « cadre de vie », « nature
» font les figures de la campagne. Ce point de vue est
précédé par les contextes historiques de la
désertification (avant 90) et de la rennaissance des campagnes
(après 90). Puis, pour les années 2000, de nouveau enjeux sont
suscités par l'évolution des espaces ruraux tel que la prise en
compte de la nature dans les différents usages de l'espace rural, le
développement durable dans l'aménagament du territoire, la
multifonctionalité dans l'action publique etc. « Les tensions et
agencements entre ces trois figures sont à notre sens une clé de
lecture pour comprendre la physionomie actuelle et les perspectives des espaces
ruraux en France dans les années 2000. » (Perrier-cornet, Hervieu,
2002 : 9-31).
675 En citant Daniel BELL, H. Mendras explique des traits
caractéristiques de la transformation dans la société
post-industrielle avec trois logiques suivantes qui entrent en tension «
L'économique obéit à la rationalité comptable,
à la logique weberienne, elle est mue par la demande des consommateurs
et par l'innovation technique. Elle crée les inégalités ;
La politique organise la participation de tous les citoyens, elle est
fondée sur l'inégalité et obéit à la loi
tocquevillienne : plus l'égalité progresse, plus les
inégalités deviennent insupportables ; Le culturel donne un sens
à la vie des individus qui cherchent à construire leur
identité en s'exprimant : c'est un domaine de liberté
discrétionnaire qui pousse à la diversité. »
(Mendras, 2002 : 158) Les trois logiques économique - social - culturel
doivent donc s'articuler. La question que Ikigai (sens de la vie) pose dans le
sens commun, aborde également ces trois logiques complexes. Car tenir
compte d'Ikigai dans la vie contemporaine, implique de mettre en question le
« sens de la richesse » (Hamaguchi, 1994 : 236), ce qui
implique le sens soit économique, soit social, soit culturel.
Schéma représentationnel de l'agriculture
de type Ikigai

Lien social et territorial
Agriculture de type Ikigai
Qualité de vie
Production matérielle
Puis, l'idée de rechercher le lien social et
territorial relève à la fois de l'absence de ce lien entre
habitants de la Ville de Toyota dû à l'histoire jeune de
l'urbanisation et de l'industrialisation, et de la présence du lien des
communautés rurales subsistantes dans cette ville entre anciens
habitants. Et les éléments de 'nô' (agricole et rural)
viennent également servir de référence pour cette
recherche notamment en terme de sociabilité676.
Enfin, l'idée de la production matérielle
constitue également une condition pour réaliser Ikigai. Et ceci
n'exclut pas d'avoir un but lucratif. Nous pouvons considérer qu'une
sorte d'esprit productiviste marque également l'idée de
l'agriculture de type Ikigai dans un prolongement du professionalisme agricole
ou industriel677.
Ces trois éléments regroupent diverses
représentations de l'agriculture de type Ikigai qui ont
émergé cette dernière décennie dans le processus de
la construction du Projet Nô-Life.
Toutefois, il ne faut pas considérer ce schéma
comme un modèle figé de l'agriculture de type Ikigai, ni
l'objectif formel du Projet Nô-Life. En effet, la définition de
l'agriculture de type Ikigai est fluctuante, car ces éléments de
représentation sont entre les mains des acteurs qui les portent dans
leurs actions et ensuite les mettent en jeu. Autrement dit, l'agriculture de
type Ikigai peut avoir des significations différentes pour chaque
acteur. Pour appréhender l'articulation de ces différentes
significations, il faut notamment tenir compte de la divergence
d'intérêts et des prises de position au sein de ces acteurs. Ce
qui nous renvoie à la quatrième question sur la relation sociale
établie dans le processus entre acteurs.
Nous pouvons supposer que, pour les acteurs des services
publics agricoles (BPA et BDPA), l'idéal serait que, du point de vue de
l'intérêt général, tous les trois
éléments de représentation se combinent de manière
compatible dans la réalisation de leur politique publique de
l'agriculture de type Ikigai. Par contre, pour les acteurs du secteur agricole
(CAT, ECV et GASATA), c'est à la production matérielle et sa
rentabilité que l'on accorde le plus d'importance. Le lien social et
territorial peut également compter pour ces acteurs, mais ceci dans la
mesure où il sert à mieux organiser la production agricole,
notamment dans le cadre d'une organisation quelconque au sein de la CAT. Et la
recherche de la qualité de vie des individus n'est pas la
priorité pour ces acteurs.
Puis, pour les acteurs concernant le public en
général (SCI et CLFS), les éléments prioritaires
pour réaliser l'agriculture de type Ikigai sont notamment
l'amélioration de la qualité de vie des individus, et le
développement du lien social et territorial de ces individus. La
production avec but lucratif n'est pas exclue des conditions prévues par
ces acteurs, mais l'absence éventuelle de cet élément ne
les dérangerait pas.
A partir de cette analyse, nous pouvons établir dans le
tableau suivant les quatre variantes possibles de la composition de
l'agriculture de type Ikigai en relation avec les représentations de
chaque acteur concerné.
676 Cette mixité entre habitants nouveaux et anciens
constitue depuis longtemps une des thématiques les plus importantes de
la politique municipale de la Ville de Toyota qui s'est
développée en fusionnant successivement avec les villages des
alentours, et brassant ainsi les émigrants et les anciens habitants.
677 Nous aborderons ce point plus bas la réflexion
critique apportée par Umesao. Il relève le lien entre la mode de
la notion d'Ikigai au Japon vers la fin des années 60 et
l'intérêt des entreprises qui voulaient monter la motivation des
salariés pour le travail via cette idée... (Umesao, 1985 :
p.82)
Tableau : Variantes de la composition des
éléments de l'agriculture de type Ikigai
|
Qualité de vie
|
Lien social et territorial
|
Production matériele
|
Acteurs intéressés
|
|
Variante 1
|
o
|
o
|
o
|
BPA, BDPA
(tous les autres)
|
|
Variante 2
|
o
|
o
|
×
|
SCI et CLFS
(BPA, BDPA)
|
|
Variante 3
|
o
|
×
|
o
|
(tous)
|
|
Variante 4
|
×
|
o
|
o
|
CAT, ECV
Et GASATA
(BPA, BDPA)
|
Ajoutons quelques explications sur ce tableau. D'abord, ce
tableau est une construction théorique. En effet, en
réalité, les trois éléments sont
interdépendants en fonction des significations que donnent les acteurs
qui réalisent l'agriculture de type Ikigai. Cela est notamment le cas en
ce qui concerne les critères de la qualité de vie.
Toutefois, ce modèle peut nous eclaircir la
frontière entre l'agriculture de type Ikigai, l'agriculture de type
loisir (jardinage) et l'agriculture de type professionnel (industriel). C'est
pourquoi un seul élément ne semble pas pouvoir constituer
l'agriculture de type Ikigai telle qu'elle est conçue par le Projet
Nô-Life : car cela deviendrait soit un simple loisir (pour la
qualité de vie), soit une production agricole de type industriel. Puis,
il est supposable de réaliser l'agriculture de type Ikigai uniquement
dans le but d'avoir le lien social et territorial. Par exemple, dans le cas des
personnes qui cultivent leurs terrains par obligation en terme de gestions
foncière (nous l'avons vu dans la partie de l'acteur 4 : BDPA), ou de
celles qui essaie de s'impliquer dans le monde agricole ou d'avoir une
activité relevant de l'agriculture ou de la ruralité dans le but
d'une contribution sociale. Nous verrons divers types de représentations
portées par les stagiaires dans le Chapitre 3.
Quant à la variante 3, elle n'est réalisable que si
le critère de la qualité de vie (satififaction individuelle) et
la production matérielle vont parfaitement de pair.
Si ce tableau n'est pas construit pour établir une
définition objective et figée de l'agriculture de type Ikigai, il
pourra nous servir comme outil analytique des représentations
sous-tendant sa construction au sein des acteurs « porteurs » de ces
représentations.
L'origine de l'idée centrale du projet : «
`Nô'(l'agriculture ou la ruralité) en tant qu'Ikigai (sens de la
vie) »
L'origine de l'idée centrale du projet, celle de «
`Nô'(l'agriculture ou la ruralité) en tant qu'Ikigai (sens de la
vie) » qui relie le problème du vieillissement à celui de la
ruralité, est-elle plutôt descendante ou ascendante par rapport
à la position des acteurs impliqués dans le processus concret de
la construction du projet ?
Terminologie : « Nô » et « Ikigai »
Avant de répondre à cette question, nous essayons
d'examiner la définition des notions en question : « Nô
» et « Ikigai », dont chacun a des traits spécifiques au
niveau de l'origine, des idées et de l'usage.
« Nô : \u-28750ÒÜ »
L'usage du terme « nô » est relativement
récent et peu habituel dans le langage courant en japonais. En effet,
comme nous l'avons déjà évoqué, le « nô
» ne constitue pas un mot à lui seul, il ne constitue un mot qu'en
combinaison avec « gyô (métier ; affaire) » : «
nôgyô (agriculture) » ; avec « son (village) » :
« nôson (ruralité ; villages ruraux) » ; avec « ka
(personne exerçant un métier ; professionnel » «
nôka (ferme ; agriculteur) » et avec « min (peuple) » :
« nômin (paysan) ».
Donc, le terme « nô » est souvent
utilisé entre parenthèse tel que « `nô' teki na mono
(quelque chose de `nô') » signifiant « quelque chose d'agricole
ou de rural ». Ainsi, Hamaguchi et Sagaza, sociologues japonais, tentent
de définir ce terme en abordant le phénomène du «
teinen kinô (retour à la terre après la retraite) »
qui est un sujet d'actualité très animé par les
médias au Japon ces dernières années678.
D'après Hamaguchi et Sagaza, la signification du «
kinô (retour à la terre) » tel qu'il peut s'observer
aujourd'hui au Japon, ne se limite pas à mener des activités
agricoles comme profession. Ils relèvent que, selon un résultat
d'enquête, la majorité des personnes qui veulent mener une vie
rurale après la retraite ne souhaitent que mener des activités
comme un prolongement du jardinage (tout comme nous l'avons constaté
dans le résultat de l'enquête effectuée par le BPA et le
CLFS auprès des salariés de la Ville de Toyota en
2003)679. Ils donnent comme exemple : la location de terrains de
près de 10 ares chacun pour les cultiver ; la location d'une parcelle de
jardin citoyen. Puis, ils donnent d'autres exemples en dehors du milieu des
retraités : élèves de l'école primaire apprennant
à planter le riz ; établissements pour les soins aux personnes
âgées dépendantes appliquant le jardinage comme
méthode de soin aux personnes âgées ; développement
du tourisme vert etc. Hamaguchi et Sagaza entendent par l'expression de «
s'impliquer dans `nô' (nô to kakawaru) » cette
diversité des manières d'aborder l'agriculture680.
Par ailleurs, d'après la définition de Katsuo
OTSUKA qui a publié en 1997 un ouvrage intitulé «
L'ère de vivre de manière `nô' (nô-teki ni ikiru
jidai) », la « vie de `nô' (nô-teki seikatsu)
», ne signifiant pas la vie agricole ni la vie en milieu rural, cela
siginife « une manière de vivre respectueuse de la nature,
protectrice de l'éco-système, respectueuse de la vie même,
et non artificialisée681 ». Et ceci est «
un style de vie qui, en reconsidérant la destruction de la nature,
la dégradation de l'environnement, l'anthropo-centrisme, le
technocrato-opportunisme et le matérialisme dépendant des valeurs
matérielle et monétaire, accorde de l'importance à la
cohabitation entre la nature et l'homme, la conservation de l'alimentation et
de l'environnement et à la vrai richesse, puis, tente d'introduire le
plus possible les éléments de `nô ' dans la vie
quotidienne682. »
Enfin, Hamaguchi est Sagaza établissent le lien entre
le « nô » et l'idée de la multifonctionalité. La
montée d'une prise de conscience de l'idée de « nô
» parmi la population japonaise relève du fait que « non
seulement les habitants locaux concernés, mais toute la population ont
commencé davantage à comprendre l'impact de la
multifonctionalité de l'agriculture sur elle-même
»683. Selon eux, « nô » est une condition
nécessaire afin que la population puisse bénéficier de la
multifonctionalité. (« c'est à travers nos diverses
implications à `nô ' que nous pouvons bénéficier de
cette multifonctionalité684 ».)
En bref, après ce survol de la réflexion
menée par Hamaguchi et Sagaza, nous pouvons retenir que le `nô'
est un terme récemment employé au Japon afin de redéfinir
l'agriculture et la ruralité, dans une dimension de la relation entre la
multifonctionalité de celles-ci et toute la population.
678 D'ailleurs, le « teinen kinô » est un terme
inventé par un journaliste dans la revue « gendai nôgyô
(agriculture
contemporaine) » en 1998. Depuis lors, ce terme fut
rapidement diffusé dans les médias japonais et reconnu comme
terme courant
pour désignier le fait que les retraités
salariés commencent à mener des activités agricoles ou
à s'installer en milieu rural pour
passer leur vie à la retraite (Hamaguchi, Sagaza , 1994 :
p.95)
679 Ibid.: p.95.
680 Ibid. : p.95-96
681 Otsuka (1997) cité par Hamaguchi et Sagaza, Ibid. :
p.109
682 Ibid.
683 Ibid : p.108.
684 Ibid.
« Ikigai : \u29983ßæ#172; »
Le terme d'Ikigai signifie litéralement le « sens
de la vie » ou la « valeur de la vie ». Etant un terme courant
dans la langue japonaise, ce terme implique diverses interprétations en
sciences sociales, et peut éventuellement provoquer des débats
épistémologique pour sa définition. Sans entrer dans les
détails dans ces débats, nous allons essayer de clarifier les
contours de sa définition en se référant à deux
auteurs japonais qui ont mené des réflexions sur cette notion
d'Ikigai.
Ikigai en sociologie
D'abord, le sociologue Hamaguchi (le même auteur que
celui que nous avons vu plus haut) relève les trois conditions pour la
réalisation d'Ikigai dans la société contemporaine et
quatre variantes de cette réalisation, dans son ouvrage intitulé
« Ikigai sagashi : taishû chôju shakai no jilenma
(Recherche d'Ikigai : dilemme de l'ère de la longévité de
masse) ».
Les trois conditions pour la rélisation d'Ikigai sont
déterminées par les facteurs objectifs et subjectifs (voir le
tableau ci-dessous)
Tableau : conditions
d'Ikigai685
Conditions objectives Conditions subjectives
|
Première
condition
|
Manque : maladie, pauvreté
ignorance, contrainte
|
Insatisfaction : solitude, souci,
futilité,
inertie
|
|
Deuxième
condition
|
Suffisance
|
Satisfaction
|
|
Troisième
condition
|
Abondance : santé, richesse,
culture,
liberté
|
Volonté : création,
service,
réalisation de soi,
accomplissement,
spotanéité, plénitude
|
La première condition d'Ikigai est la « sortie
du malheur » consistant notamment à surmonter le manque ou
l'insatifaction686. En réalité, il s'agit d'une
réalisation appropriée de l'élevation de la
productivité et de l'établissement du système de la
sécurité sociale.
La deuxième condition est le « maintien de la
stabilité » consistant à la tentative incessante du
développement sans se satisfaire de l'état
présent687.
La troisième condition est la « réalisation de
la possibilité plus grande » comme l'innovation dans les styles de
vie et des modes de pensée688. Il s'agit de
l'amélioration de la qualité de vie.
Puis, ce qui caractèrise Ikigai dans la
société contemporaine est la variabilité selon les couches
sociales, l'âge, la composition familiale, la profession et le sexe
etc689. Hamaguchi distingue la forme d'Ikigai dans la
société contemporaine, de celle dans la société
traditionelle. Dans la société traditionnelle, Ikigai ne peut pas
être choisi, et il est déterminé par le statut
(féodal) de la personne dès la naissance tels que paysan et fils
de samourai etc690. Dans une telle société où
les gens n'envient pas les autres, Ikigai est invariant et
prédéterminé selon les statuts sociaux.
Dans la société contemporaine, Ikigai est
marqué par le choix de style de vie et par la mobilité, ce qui
fait sa variabilité691. Et l'écart entre individus
s'agrandit en fonction des compétences et des chances, et les gens
685 AOI, K. (1970), Seikatsu kôzô no riron
(Théorie de la structure de la vie), Yûikaku : p.69,
cité par Hamaguchi, 1999 : p 235.
686 Hamaguchi, 1999 : p.235
687 Ibid.
688 Ibid.
689 Ibid. : p.236.
690 Ibid.
691 Ibid.
s'envient de plus en plus les uns les autres. Dans une telle
société, il y a plus de risques, car les gens peuvent mettre en
question le sens de la richesse, et ainsi la perdre. La réponse que
l'individu donne à cette question détermine son style de vie, ce
qui déterminera finalement son Ikigai.
Ensuite, Hamaguchi présente quatre variantes de la
réalisation d'Ikigai dans la société contemporaine.
Concernant ces variantes, il donne les quatre facteurs suivants : direction de
l'action orientée vers l'intérieur (valeur de la satisfaction) ;
direction de l'action orientée vers l'extéiruer (valeur de la
contribution) ; sentiment (kibun) ; foi (shinen)692. Voici les
quatres types de la réalisation d'Ikigai dans le tableau ci-dessous.
Tableau : quatre types de l'expérience
d'Ikigai693
Direction
|
|
Valeur de la satisfaction
|
Valeur de la contribution
|
|
Psychologie
|
Sentiment
|
Type I
|
Type II
|
|
Foi
|
Type II
|
Type IV
|
Le type I consiste à la satisfaction dans la vie
privée694. Un grand nombre de personnes correspondent
à ce type. Le type II consiste à déployer la
compétence individuelle dans le travail (ou le ménage) afin de se
mettre en valeur pour soi-même695. Le type III correspond aux
personnes qui mènent leur vie de manière indépendante des
appréciations faites par les autres (comme une vie purement
spéculative ou conservatrice)696. Le type IV consiste
à s'orienter vers l'avenir ou le progrès avec des objecifs
ambitieux de vie. Et les gens combinent ainsi quelques unes de ces quatres
variantes pour leurs expériences d'Ikigai697.
Enfin, Hamaguchi relève que l'argumentation sur Ikigai
grandissante dans la société japonaise est le reflet du dilemme
de la population entre le bonheur et le malheur qu'elle a vécus dans la
société contemporaine. Et la recherche d'Ikigai consiste à
se poser la question sur le sens de la vie.
Cette conceptualisation sociologique d'Ikigai apportée
par Hamaguchi montre bien l'idée qu'implique la notion d'Ikigai dans la
société moderne et contemporaine. Dans son approche, le terme
d'Ikigai est d'abord marqué par le stade post-industriel où la
société contemporaine (japonaise) est centrée sur le choix
du style de vie et l'amélioration de la qualité de vie, à
condition de passer les deux stades antérieurs (sortie du malheur,
maintien de la stabilité).
Nous pouvons mettre en parallèle l'approche de
Hamaguchi et l'approche de la SCI qui, tout en reconnaissant l'importance de la
subjectivité jouant sur les critères d'Ikigai, définissait
les types des mesures pour la création d'Ikigai des personnes
âgées par l'éducation permanente (apprentisage), la
contribution sociale (participation) et le travail (production). Les quatres
variantes de l'expérience d'Ikigai montrées par Hamaguchi
semblent avoir notamment des points communs avec les types II et IV dont le
facteur est la « direction de l'action orientée vers
l'extérieur ».
Ikigai en anthropologie
Ensuite, nous allons voir brièvement une
réflexion critique sur la notion d'Ikigai menée par le
célèbre anthropologue japonais Tadao UMESAO. Tout en
reconnaissant avoir contribué à « produire la mode du
débat sur Ikigai » vers la fin des années 60 dans les
médias japonais, il mena une réflexion critique sur le fondement
épistémologique des débats sur la notion d'Ikigai tel
qu'ils étaient menés à cette époque au Japon, dans
une conférence qu'il a donnée en 1970698.
692 Ibid. : p.238
693 Ibid. : p.239.
694 Ibid. : p.238.
695 Ibid.
696 Ibid. : p.239
697 Ibid.
698 Umesao, 1985 : p.87
En fait, il relève deux approches extrèmes pour
l'argumentation sur Ikigai, lesquelles sont dangereuses, car porteuses de l'
« irresponsabilité » vis-à-vis de l'accumulation future
des résulats de la recherche d'Ikigai699.
D'une part, il y a la tendance ultra-subjectiviste et
relativiste qui prétend accorder la valeur absolue à l'aspect
mental d'Ikigai. Selon lui, cette approche est inconvéniente pour
aborder Ikigai comme problème de l'être-humain constituant une
existence totale dotée du corps et de l'esprit ou, comme problème
du mode de vie des individus dans la société
réelle700. Si on refoule tous les facteurs
déterminants d'Ikigai à la satisfaction mentale ou à la
subjectivité, cela peut être tout et n'importe quoi au
détriment de la situation objective.
D'autre part, il y a la tendance ultra-structuraliste qui accorde
la valeur absolue à l'utilité de la vie (utilitarisme) ou
à la production matérielle (productivisme industriel ou
agricole).
Pour expliquer ceci, Umesao évoque, par exemple,
qu'à l'époque féodale au Japon, les samouraï avaient
tous « shini gai (sens de la mort) » pour mener leurs batailles, ce
qui constitue l'inverse d' « Ikigai (sens de la vie) »701.
Ils se battaient pour ensuite avoir une récompense (fief) de la part de
leur seigneur après. Et la mort d'un samouraï sur un champ de
bataille avait une grande valeur, et permettait à ses fils de recevoir
la plus grande récompense comme l'accession à un statut plus
supérieur. Dans le monde contemporain, il évoque le contexte
où les entreprises japonaises veulent augmenter la motivation de leurs
salariés par le biais de l'idée d'Ikigai702. Le fait
de se motiver pour le travail et le fait de trouver Ikigai dans ce travail sont
très proches selon Umesao. Cette logique où une organisation
organise les individus en leur distribuant une série d'objectifs
différents, risque de mener la société jusqu'à une
sorte de système totalitaire de fait703.
Et le productivisme relève non seulement de
l'industrialisme japonais, mais également de l'agriculture comme dans
l'idéologie agrarienne (Nôhon shugi) apparue lors du régime
totalitaire qui revendiqua que le fondement de l'Etat résidait dans
l'agriculture704. Il avertit notamment du danger écologique
que ce type de pensées risque de provoquer en donnant de nombreux
exemples.
Umesao qualifie ces deux types d'approches constitutives des
débats sur Ikigai de « hiérarchisation des objectifs de la
vie (jinsei no mokuteki taikeika) ». Pour Umesao, ces approches viennent
donner un objectif à ce qui n'a pas d'objectif en soi, par exemple la
famille705.
Enfin, en défendant la nécessité de
sortir de ce type de pensée, il nous propose de passer à la
pensée de Lao-Tseu (taoisme) qui dépasse totalement de ce type
d'approches, en rejetant l'idée de devoir être utile dans la
société ou de devoir achever un objectif dans la vie...
Sans entrer dans les débats profonds sur la
définition d'Ikigai, il est intéressant de retenir la critique
d'Umesao sur la dichotomie constituant une sorte de continuum («
hierarchisation des objectifs »), qu'implique la pensée d'Ikigai.
Car, dans le contexte du Projet Nô-Life, nous pouvons mettre en
parallèle les deux extrémités de l'approche d'Ikigai
relevées par Umesao, le subjectivisme (mental) et le structuralisme
(utilitarisme ou productivisme), appraissent d'un côté sous la
forme d'une recherche de l'intérêt général mettant
l'accent sur la satifsaction individuelle (ou la santé mentale), d'un
autre côté sous la forme de la recherche de l'intérêt
des acteurs du secteur agricole. Ce qui constitue l'ambivalence ou la
contradiction interne de la définition de l'agriculture de type Ikigai
dans le Projet Nô-Life.
« Nô -Life »
699 Ibid. : .p.84-88
700 Ibid. : p.74-78.
701 Ibid. : p.66-74
702 Ibid. : p.81-84.
703 Ibid. Là, nous pouvons évoquer le régime
totalitaire japonais qui permettait aux soldats de faire Kamikaze lors de la
guerre pacifique...
704 Ibid. : p. 128-13 3 Pour Umesao, l'industrialisme japonais
qui donne la plus grande valeur à la production matérielle est
également une pensée « réactionnaire
(handô) » due à la situation de la société
post-industrielle où la valeur centrale est de plus en
plus accordée à l'information, plutôt qu'aux
produits industriels.
705 Cela renvoie à la notion de la sociologie allemande
« Gemeinschaft » comme les organisations humaines qui existent
naturellement dans la société, par opposition
à la « Geselleschaft » déterminé par les
objectifs artificiels (Ibid. : p.301-302)
Quant au terme « Nô-Life » qui est
inventé par la Municipalité de Toyota pour monter le Projet
Nô-Life, nous pouvons supposer que la partie de `nô' a
été reprise dans le sens du terme que nous avons
étudié plus haut, c'est-à-dire les éléments
de l'agriculture et la ruralité impliquant les diverses manières
d'établir des rapports entre la population et ces
éléments. Puis, la définition de Otsuka qui établit
le rapport entre la réalisation de la multifonctionalité et le
`nô' a également un trait commun avec le contexte du Projet
Nô-Life : le Plan de 96 était avant tout marqué par
l'idée de la multifonctionalité. Et l'agriculture de type
d'Ikigai était considérée comme un moyen de la
réalisation de la multifonctionalité.
Puis, la partie de « Life » semble être
liée au terme de « Life style » qui évoque la
caractéristique donnée par Hamaguchi sur Ikigai dans la
société contemporaine. Ce terme implique également
l'importance du choix individuel comme déterminant de ce Life
style (style de vie)
Enfin, à partir de ces analyses, nous pouvons supposer
la nuance que le terme « Nô-Life » implique dans l'idée
: les individus s'impliquent de diverses manières dans l'agriculture et
la ruralité tout en choissisant leur style de vie individuel.
Généalogie de l'idée de l'agriculture de
type Ikigai
Revenons sur le contexte de la construction du Projet
Nô-Life. Nous allons maintenant tenter de rechercher l'origine de
l'idée de l'agriculture de type Ikigai au sein des acteurs
concernés.
Racine agricole et rurale
Dans le milieu agricole et rural, nous pouvons trouver des formes
initiales de l'agriculture de type Ikigai en remontant à la
période bien antérieure à l'établissement du Plan
de 96.
Sur ce point, nous avons interrogé Monsieur O qui est
ingénieur retraité de l'Institut Départemental de la
Recherche Agronomique (IDRA), et actuellement invité comme enseignant
dans la formation Nô-Life. Il a commencé sa carrière en
tant que conseiller agricole pendant trois ans dans la coopérative
agricole d'Inabu706. Il a ensuite été conseiller
agricole dans un Centre pour l'Amélioration et la Vulgarisation agricole
(ECV) dans le département d'Aichi. Puis, après avoir passé
un coucours national pour devenir ingénieur spécialisé
dans la production du riz, il est devenu ingénieur agricole dans l'IDRA
qui dirige les conseillers agricoles au sein des Centres pour
l'Amélioration et la Vulgarisation situés dans le
département d'Aichi. Il a pris sa retraite à l'âge de 60
ans en 1997. Ainsi, il a travaillé au total pendant 40 ans comme
conseiller et ingénieur agricole dans le département d'Aichi.
Il nous a expliqué que dans un projet qu'il a
dirigé dans le cadre d'un projet qu'il a dirigé dans le cadre
d'un projet d'un ECV de la Ville d'Anjô707 à la fin des
années 80, les deux types d'agriculture : industriel et ikigai
étaient déjà définis. La thématique
principale de ce projet était de créer une « agriculture
qui peut payer le salaire (hôshû no shiharaeru
nôgyô) ». A cet effet, dans un Plan fondamental de l'ECV,
il a divisé les zones agricoles situées dans le territoire
concerné, en ces deux type d'agriculture, par le critère de la
rentabilité potentielle.
Concernant l'agriculture de type industriel, la
thématique était notamment de payer suffisamment de salaire au
partenaire du gestionnaire de l'exploitation, c'est-à-dire
l'épouse. Le montant du salaire visé pour un partenaire que
Monsieur O nous a donné, était de 150 000 - 200 000 yens (environ
1000 - 1333 euros) par mois. Par contre, la catégorie de la population
agricole ciblée pour l'agriculture de type d'Ikigai était bien
les femmes et les personnes âgées au sein des foyers agricoles
pluriactifs. Le montant de revenu varie selon les cas, mais il était au
minimum de 800 000 - 1 000 000 yens (environ 5333 - 6666 euros) par an. Ceci,
d'après l'expression de Monsieur O, en sorte que les personnes
âgées « puissent offrir de l'argent de poche à
leurs petits enfants ». Derrière ce projet, il y avait
également un contexte où la revendication de la participation
sociale des femmes était grandissante. Ce projet a connu un grand
succès si bien que plus tard le « modèle
d'Anjô » fut diffusé dans
706 Inabu est un village situé dans la zone de moyenne
montagne ayant fusionné avec la Ville de Toyota en 2005.
707 La ville d'Anjô est une région agricole en
plaine située au Sud-est de Toyota.
tout le Japon plus tard. « Pour cette
époque-là, dit Monsieur O, ça a vraiment fait
date ».
Nous pouvons situer cette histoire de Monsieur O dans la
continuité avec le contexte du Projet Nô-Life. D'abord, nous
pouvons la mettre en parallèle avec l'expérience du «
Marché du mardi soir » que Monsieur S a connu depuis le
début des années 80 dans la Coopérative agricole de
Matsudaira située dans une zone de moyenne montagne. L'objectif
était également de permettre aux femmes et aux personnes
âgées des foyers agricoles pluriactifs de gagner un revenu
agricole708.
Donc, dans les années 80, l'idée de
l'agriculture de type Ikigai était déjà bien
présente dans les actions menées par les agents du secteur
agricole afin de développer la production agricole par les femmes et les
personnes âgées des foyers agricoles qui étaient marginaux
par rapport aux exploitations professionnelles. Puis, il faut remarquer que,
dans ces deux tentatives, l'importance était bien accordée au but
lucratif de la production agricole. Et la valeur d'Ikigai était
présente dans le sens où elle sert à motiver cette
population à bien mener leur production agricole.
Le concept de « Second Life Academy » que Monsieur S
a proposé plus tard pour le Plan de 96, était également
adressé aux personnes des foyers agricoles pluriactifs (dans
l'idée de Monsieur S), mais cette fois-ci, les retraités
salariés, à savoir les hommes.
Nous pouvons ensuite remarquer que l'objectif du montant de
revenu agricole annuel fixé par le Projet Nô-Life pour les
stagiaires est le même montant que celui qui était fixé
dans le projet que Monsieur O avait dirigé à Anjô : environ
100 000 yens (6666 euros). Est-ce une coincidence ? Nous n'avons pas
posé cette question aux acteurs, mais nous pouvons constater un trait
commun entre le Projet Nô-Life et ces approches historiquement
menées par les agents du secteur agricole. De ce point de vue, nous
pouvons considérer que l'agriculture de type Ikigai telle qu'elle est
conçue par le Projet Nô-Life se situe dans la même ligne que
la politique de la modernisation agricole, dans le sens où le seul
critère de la productivité (rentablilité) détermine
le type de production agricole.
Il faut admettre que, si nous pouvons entendre la « crise
» agricole par la stagnation de la production agricole due au
problème de la surproduction (réduction de la surface rizicole),
et à l'avancement du phénomène de la pluriactivité
dans les territoires de la Ville de Toyota ou de la Ville d'Anjô, les
tentatives du développement de l'agriculture de type Ikigai venaient
compléter la politique de la modernisation productiviste qui
s'avérait en partie défaillante, plutôt que pour la mettre
en cause ou la changer. Et le terme d'Ikigai semble avoir bien
été efficace pour engendrer cette politique aussi bien du
côté des agents (une valeur morale et productiviste) que du
côté des producteurs cibles (motivation).
Cependant, il ne faut pas oublier que, du côté
des producteurs cibles (foyers agricoles pluriactis à faible
productivité), nous avons supposé trois éléments
qui pouvaient également être facteurs de leurs actions : besoin
d'autonomie socio-économique ; motivation pour continuer la production
agricole ; maintien de l'identité professionnelle en tant que Nôka
(agriculteurs / agricultrice ou foyer agricole). (voir la partie de l'acteur
3)
Enfin, la politique de l'agriculture de type Ikigai s'est
ainsi effectuée donc par l'interaction entre les agents du secteur
agricole (ECV, CAT) et les producteurs cibles. Et l'idée de
l'agriculture d'Ikigai a pu se constituer dans ce jeu d'interaction, un outil
symbolique très subtil et efficace pour gérer une situation
d'incertitude du secteur agricole ou une crise agricole. Ceci tout en
permettant à la politique de la modernisation agricole antérieure
de réparer sa « panne » constituant la cause de l'incertitude
ou la crise, et de se rejustifier ainsi pour pouvoir poursuivre une politique
de même nature qu'avant.
Racine urbaine
Du côté du milieu urbain, comme nous l'avons vu,
le terme d'Ikigai était déjà en vogue dans les
médias japonais dès la fin des années 60 : époque
de la haute croissance économique où commençait à
grandir l'interrogation sur l'amélioration de la qualité de vie
des salariés ou sur la motivation pour le travail.
708 Dans le cas du Marché du mardi soir, l'activité
suscitée était la vente directe des produits du terroir.
Ikigai dans le milieu syndical japonais des années 70
Pour mieux appréhender le contexte social où le
terme Ikigai prenait un sens particulier dans son usage, nous pouvons
évoquer que ce terme était massivement employé dans le
milieu syndical japonais dès les années 70. Citons le
célèbre reportage de Satoshi KAMATA qui nous le confirme. Ce
reportage, intitulé « Jidôsha zetsubôkôjô
(Usine automobile du désespoir) » a decrit, en se basant sur sa
propre expérience d'ouvrier saisonnier de 1972 à 1973 dans une
usine de l'Automobile Toyota dans la ville de Toyota, la réalité
des conditions du travail et la vie des ouvriers des usines de l'Automobile
Toyota709.
Dans ce reportage, Kamata cite une annonce publiée dans
« Shûkan toyota (Toyota hebdomadaire) » qu'il a trouvé
par lui-même le 9 octobre 1972 dans l'usine où il était
employé710. Cette annonce montre, dans le contexte du
mouvement de la réunification des syndicats ouvriers du secteur
automobile dans la « Fédération générale
automobile (Jidôsha sôren) » en 1972, le slogan de cette
Fédération, qui était le suivant « Par
l'établissement d'une organisation sectorielle, réalisons une
société de providence où sont présents Ikigai et le
Sens du travail (hataraki gai) (sangyô betu soshiki wo kakuritsu si,
hatarakigai ikigai no aru fukushi shakai no jitsugen wo hakarô)
»71 1 . Puis, quatre « bases de mouvement (undô no
kichô) » et deux « principes des activités
concrètes (gutaiteki katsudô hôshin) » sont
présentés de la manière suivante :
« Bases de mouvement » : a. Réalisation
de la société de providence ; b. Recherche du Sens du travail
(hatarakigai) et Ikigai ; c. Etablissement d'une organisation sectorielle
puissante ; d. Démocratisation de l'industrie.
« Principes des activités concrètes »
: a. Elevation du niveau de vie ; b. Renforcement des activités pour la
politique industrielle712
La politique des syndicats ouvriers de Toyota et de la
Fédération générale automobile était
marquée par sa position de « Coopération
(kyôchô) » et non par la lutte de classe. Pour eux, la
relation employeur-employé était officiellement
considérée comme « une relation humaine
»713. Ainsi, la grève n'a été
effectuée qu'une seule fois (en 1949) jusqu'à nos jours par les
syndicats de l'Automobile Toyota. Plus tard, la Fédération
générale automobile jouera un rôle central pour
créer Rengô en 1989.
Selon la description de Kamata, à l'époque
où il était employé, le syndicat ouvrier de Toyota mettait
de plus en plus l'accent dans sa revendication sur la « restauration
d'Ikigai » par le biais de l'augmentation du loisir des employés,
au lieu de mettre en cause le problème du travail même, comme le
mode de production et les conditions de travail714.
A partir de cette illustration, nous avons pu constater un
mode d'emploi du terme Ikigai qui sert d'outil symbolique bien efficace pour
une meilleure intégration du salariat dans l'entreprise japonaise. Et
ceci sans remettre en cause le productivisme capitaliste. De là, nous
pouvons également comprendre le contexte sur lequel Umesao basait sa
critique de la notion d'Ikigai.
Ikigai et politique du vieillissement
Puis, dans la politique à l'égard du
vieillissement de la population, la Municipalité de Toyota a
formulé en 1989 comme ci-après dans son plan intitulé
« Perspective pour une société longévitale de la
Ville de Toyota (Toyota-shi Chôju Shakai Kihon Kôsô) » :
« Viser une société de coexistence où (...), tout
le monde devient autonome et peut partager le plaisir de vivre
».(voir la partie de l'acteur 2) Et en 1993, elle a employé le
terme
709 Kamata, 1983. Cet ouvrage a été traduit en
français par Jean-Louis FOLGOET comme Toyota : l'Unine du
désespoire. Journal
d'un ouvrier saisonnier (1976), Les éditions
ouvrières.
710 Kamata, 1983 : p.77-78.
711 Ibid.
712 Ibid.
713 Ibid. : p.253
714 Ibid. : p.171; 223.
Ikigai ainsi : « Une société de
coexistence qui nous permet de maintenir une vie sociale et d'avoir Ikigai
même si l'on devient grabataire. » (idem)
L'idée pour cette formulation est basée sur le
renforcement de l'autonomie et le maintien du lien social face aux risques du
vieillissement comme la dépendance et l'isolement.
La mise en relation de cette idée avec les
éléments de `nô' était progressivement apparue par
des pratiques fragmentaires comme le succès des jardins familiaux. Et la
proposition de Monsieur S de « Second Life Academy » pour le Plan de
96 a fait date dans le sens où il a établit le lien entre la
thématique du vieillissement de la population et celle de la crise
agricole (foyers agricoles pluriactifs de plus en plus âgés).
Ainsi, le Plan de 96 accorda une nouvelle valeur aux thématiques de la
politique agricole (développement agricole et conservation des terrains
agricoles) : « Ikigai - loisir (Ikigai - Yoka) : lieux de
l'éducation sociale ; lieux d'Ikigai et de maintien de la santé
des personnes âgées ; offrir des lieux d'activités de
loisirs des citoyens pour un développement urbain
équilibré ».
La politique d'Ikigai pour les personnes âgées et la
politique agricole se sont ainsi croisées sous la forme de l'idée
de l'agriculture de type Ikigai.
Nous pouvons d'abord considérer, comme il a
déjà été dit plus haut, cette hybridation
d'idées comme l'oeuvre d'un brilolage effectué par des agents de
la politique publique locale basée sur sa situation locale et
concrète (voir plus haut la partie de « Elaboration de l'ensemble
des actions concrètes pour la construction du Projet Nô-Life
»). Dans ce sens-là, nous ne pouvons pas parler de cette politique
en terme de l'imposition directe d'une politique quelconque d'en haut.
Cependant, cette oeuvre politique est également le
fruit d'une série de transactions effectuées entre agents de
différents champs sociaux à base territoriale. Nous n'allons pas
répéter ici tous les agents qui étaient impliqués
dans le processus de la construction du Projet Nô-Life. (voir
également plus haut la même partie)
Concernant le Projet Nô-Life, nous avons constaté
qu'une idée constitutive du Projet Nô-Life (production avec but
lucatif à l'aide d'une motivation d'Ikigai) s'enracine dans la politique
historique des agents du secteur agricole. Dans ce sens, le Projet
Nô-Life assume indirectement un poids de l'idée productiviste
provenant de la politique de la modernisation agricole.
De ce fait, nous pouvons comprendre pourquoi, dans le document
final définissant la forme et le contenu du Projet Nô-Life dans le
cadre des politiques des Zones spéciales (nous l'avons
étudié dans la partie de l'acteur 1), le mot de la
multifonctionalité était carrément disparu en mettant
fortement l'accent sur l' « effet économique » 715 du Projet
Nô-Life indicant l'objectif donné aux stagiaires de dégager
un million de revenu agricole annuel.
En tenant compte de ce poids, les trois éléments
constitutifs de l'agriculture de type Ikigai que nous avons illustré
dans un schéma plus haut (Qualité de vie ; Lien social et
territorial ; Production matérielle) pourront-elles être
compatibles non seulement aux yeux des agents gestionnaires du Projet ou
concernés, mais également à l'épreuve des divers
intérêts des stagiaires de la formation Nô-Life ? Telle sera
notre question centrale du Chapitre 3...
Relation établie entre acteurs
Quelle relation fut établie entre les acteurs à
travers ce processus de la construction du Projet ? Pour répondre
à cette question, nous allons d'abord constater les positions des sept
acteurs institutionnels telles qu'elles ont été établies
au niveau représentationnel dans le processus de la construction de
l'agriculture de type Ikigai.
Plus haut, nous avons déjà
spécifié les variantes correspondantes à chacun des septs
acteurs institutionnels dans le schéma représentationnel de
l'agriculture de type Ikigai que nous avons établi. Ce schéma
ci-dessous montre leurs prises de position dans le processus de la construction
du Projet Nô-Life.
715 Ville de Toyota (2003) « Plan pour les Zones
spéciales de la Réforme structurelle » : P.4.
Dans ce schéma, nous repérons donc les trois
positions suivantes parmi ces sept acteurs institutionnels :
1. Intérêt général et agricole
cherchant à rendre compatible les trois éléments (BPA et
BDPA)
2. Intérêt du secteur agricole cherchant
à utiliser le lien social et territorial au profit de la production
agricole (CAT, GASATA et ECV). Parmi eux, l'ECV (vulgarisateur agricole) penche
plus du côté de la production matérielle. Tandis que le
GASATA (groupement d'arboriculteurs professionnels) cherche plus à
développer et diversifier le lien social et territorial pour maintenir
leur zone de production frutière dans une situation de crise.
3. Intérêt général mais avec peu
de lien avec l'agriculture, cherchant à améliorer la
qualité de vie de la population locale âgée via le
développement du lien social et territorial. L'agriculture de type
Ikigai peut
Schéma : positions des acteurs institutionnels
dans le
schéma représentationnel de l'agriculture de type
Ikigai

Lien social et
V. 4 Production matérielle
territorial
SCI
CLFS
V. 2
Qualité de vie
BPA* BDPA
CAT* ECV GASATA
V. 1
V. 3
*BPA et CAT sont les co-gestionnaires du Projet Nô-Life.
partiellement servir à cet intérêt. (SCI et
CFLS)
Cette divergence d'intérêts des acteurs
institutionnels n'est évidemment pas sans rapport avec la
différence ou la division objective de leurs rôles institutionnels
respectifs. Mais cela n'est ni figé ni mécanique, quand nous les
situons dans un processus socio-local d'une politique spécifique. Cela
est vrai d'autant plus que la situation de l'agriculture de type Ikigai est
émergente ces dix dernières années et qu'elle est encore
en train de se transformer dans le contexte du vieillissement
acceléré de la population. Autrement dit, nous sommes
amenés à voir ce processus comme un systéme dans un
contexte spatio-temporellement limitée, dans lequel chaque acteur peut
agir et communiquer en interaction avec les éléments
extérieurs et intérieurs y compris ces acteurs eux-mêmes et
les objets concernés716.
Nous reprérons là une relation de «
coopération » mais basée sur une telle divergence de
positions représentationnelles. Nous essaierons d'abord d'eclairer cette
relation en terme de « compromis », dont la définition est
élaborée notamment par Boltanski et Thévenot de
manière à le traiter comme un concept sociologique par exellence
tout en dépassant le sens habituel du terme comme un simple acte
d'arrangement basé sur des concessions mutuelles.
716 Dans ce sens, l'introduction suivante de P. Bourdieu pour
parler du « champ des pouvoirs locaux » est eclairante : « De
même que la `politique du logement' est au niveau central, le produit
d'une longue suite d'interactions accomplies sous contraintes structurales, de
même, les mesures réglementaires qui sont constitutives de cette
politique seront elles-mêmes réinterprétées et
redéfinies au travers d'une nouvelle série d'interactions entre
des agents qui, en fonction de leur position dans des structures objectives de
pouvoir définies à l'échelle d'une unité
territoriale, région ou département, poursuivent des
stratégies différentes ou antagonistes. » (Bourdieu, 2000 :
155)
Relation de compromis
Pour comprendre la relation établie entre les acteurs
institutionnels du Projet Nô-Life, la notion de compromis nous
paraît pertinente. Sur cette notion, L. Boltanski et L. Thévenot
donnent une définition claire à cette notion. Pour notre examen,
nous suivrons l'explication donnée dans un ouvrage récent de M.
Nachi qui nous apporte un bon éclaicissement sur la sociologie de
Boltanski717. D'après M. Nachi, ce sont Boltanski et
Thévenot qui donnèrent à la notion du compromis une place
centrale dans la sociologie718.
Approche du Bien commun : construction d'accords
contraignants
Le compromis constitue une des trois figures de l'accord avec
l'arrangement et la relativisation. Le point commun de ces trois figures est
qu' « ils se présentent comme une alternative lorsque la sortie de
crise devient impossible719 ».
L'arrangement est défini comme un « accord
contingent » qui n'a pas de justification en commun entre les personnes
qui procèdent à cet arrangement. Il s'arrange uniquement sur la
base de leurs intérêts respectifs. Il est donc
relativiste720.
Puis, dans la relativisation, on suspend l'accord afin
d'éviter le désaccord et de détendre la
situation721.
A la différence de ces deux formes de l'accord, le
compromis ne se base pas uniquement sur les intérêts particuliers
des personnes qui entrent en compromis, mais il se base sur un « bien
commun » qui ne relève ni de l'une ni de l'autre partie, mais
comprend les deux722.
Donc, le compromis implique nécessairement une
pluralité de grandeurs ayant chacune une part de justification
dotée d'une généralité spécifique. La
définition du compromis est ainsi donnée par Thévenot :
« une action soumise à des contraintes plus fortes, cherchant
à être justifiable - ou raisonnable - et à s'inscrire dans
un équilibre global723 ». Puis, en visant un bien
commun, le compromis a pour objectif de résoudre le conflit, la tension,
le désaccord entre des personnes appartenant à différentes
grandeurs. Donc, dans une situation de compromis, des contraintes et des
conflits entre les parties sont indissociables724.
Puis, la situation du compromis est complexe et hybride, car
elle est marquée par la présence d'objets
hétérogènes725. Et ce bien commun suppose des
motifs visant une construction et une manifestation d'accords plus ou moins
durables726.
Ambiguïté : contraintes et question de
compatibilité
Une des caractéristiques du compromis réside dans
l'ambiguïté de son principe. Celle-ci du fait que les
717 NACHI, M. (2006), « D'une pragmatique du compromis
à une phéoménologie de l'arrangement » (Chapitre IV),
Introduction à la sociologie pragmatique : vers un nouveau «
style » sociologique ?, Paris, Armand Colin : p.173-185. Dans cette
partie sur le compromis, il se base principalement sur l'ouvrage suivant :
BOLTANSKI, L., THEVENOT, L. (1991), De la justification. Les Economies de
la grandeur, Paris, Gallimard.
718 Chez Boltanski et Thévenot, « il est même
érigé au rang d'un concept central et bénéficie
d'une réflexion de la plus grande importance » (Nachi, 2006 : 174).
Ils sont « parmi les rares auteurs qui sont allés le plus loin dans
la problématisation du compromis » (Ibid.).
719 Ibid.: 173.
720 Ibid. : 180-181.
721 Ibid. : 181-183.
722 Ibid. : 175.
723 Thévenot, 1989 : p177, cité par Nachi, 2006 :
174.
724 « C'est cette pluralité cosubstantielle au monde
de la vie sociale qui véhicule en son sein les marques du compromis.
Car, dans un tel monde, le bien commun ne peut être atteint par le
recours à une grandeur unique. Il faut le concours de plusieurs
principes d'équivalence, de plusieurs formes de
généralités. Le compromis a pour objectif de
résoudre des conflits et de régler des différends en
mobilisant des principes et des objets relevant de mondes différents
». Nachi, 2006 : 174)
725 « la multiplication des objets composites qui se
corroborent et leur identification à une forme commune contribuent ainsi
à stabiliser, à frayer le compromis. Lorsqu'un compromis est
frayé, les êtres qu'il rapproche deviennent difficilement
détachables. » (BOLTANSKI, L., THEVENOT, L., 1991 : 340,
cité par Nachi, 2006 : 175)
726 « Une telle figure sous-entend des relations
interindividuelles animées par des motifs visant `à construire,
à manifester et à sceller des accords plus ou moins durables'
»( BOLTANSKI, L., THEVENOT, L., 1991 : 39, cité par Nachi, 2006 :
175)
personnes entrant en compromis renoncent à clarifier les
principes sur lesquels se base leur compromis, sans pour autant exclure
l'impératif de justification727.
Cette ambiguïté est en partie due aux contraintes
du compromis, parce que celui-ci doit impliquer des « principes
d'équivalence satisfaisant différents ordres de grandeur »
ainsi que le « rapprochement de grandeurs a priori incompatibles
»728. Dans le compromis, il suppose donc la question de
compatibilité des objets relevant de mondes
différents729.
Fragilité
L'ambiguïté des principes et les contraintes du
compromis constituent également des sources de fragilité. Cette
fragilité est inévitable car dans le compromis, l'identité
des parties ne peut pas être mise en cause afin de maintenir le
compromis730. C'est pourquoi le compromis nécessite que le
bien commun (ou l'intérêt général) visé
dépasse un simple arrangement basé uniquement sur les
intérêts particuliers. Il s'agit de la constitution d'une «
cité » par ce bien commun731. Dans cette optique, la
dispute entre les parties n'est pas forcément réglée par
une logique légitime d'un seul monde, mais suspendue en vue de
constituer un compromis. Donc, un compromis risque toujours d'être
déstabilisé ou mis en question par la critique ou la
dénonciation732.
Possibilité de transformation ou de
consolidation
Pour surmonter cette fragilité, il faut que le
compromis fasse l'objet d'une transformation ou d'une consolidation « en
faisant référence à des êtres et à des objets
appartenant à divers mondes mais disposant d'une identité
autonome733. Mais comment ? Selon Boltanski et Thévenot, il
faut doter les éléments constitutifs du compromis d' « une
identité propre » en mettant ces éléments « au
service du bien commun734 ».
Mise en parallèle du concept de compromis avec les
autres éléments théoriques
Après ce survol des caractéristiques du
compromis tel qu'il est conceptualisé par Boltanski et Thévenot,
essayons de mettre en parallèle ce concept avec les autres
éléments théoriques mobilisés dans notre analyse :
représentation sociale ; bricolage ; transaction sociale ;
transcodage.
Représentation sociale
L'approche des représentations sociales que nous avons
présenté dans le chapitre 1, consiste à comprendre comme
un processus la relation dialectique entre les représentations
portées par les acteurs concernés, leurs rapports sociaux et
leurs actions. Surtout via la notion de l'objectivation et celle de l'ancrage,
cette approche vise à articuler les éléments
représentationnels et réels dans leur complexité.
Dans ce sens, cette approche, nous semble-t-il, peut
être un outil pertinent pour éclairer la situation complexe de
compromis. D'autant plus que celle-ci est marquée par la présence
d'objets hétérogènes relevant de différents mondes
qui, à notre égard, impliquent nécessairement des produits
de représentations sociales. La
727 Nachi, 2006 : 175.
728 Ibid. : 175.
729 « (...) il [compromis] présume le
dépassement des intérêts purement individuels ainsi que
l'existence d'un bien supérieur
commun : `le compromis suggère l'éventualité
d'un principe capable de rendre compatibles des jugements s'appuyant sur des
objets relevant de mondes différents.(...)' » (Ibid. : 176)
730 Ibid. : 176.
731 Ibid.
732 Ibid.
733 Ibid. : 177.
734 « une façon de durcir le compromis est de mettre
au service du bien commun des objets composés d'éléments
relevant de
différents mondes et de les doter d'une identité
propre en sorte que leur forme ne soit pas reconnaissable si on leur soustrait
l'un ou l'autre des éléments d'origine disparate dont ils sont
constitués » (BOLTANSKI, L., THEVENOT, L., 1991 : 339, cité
par Nachi,
2006 : 177)
question de mode d'articulation de ces objets
hétérogènes pour constituer un compromis nous renvoie
directement à interroger celui des représentations sociales.
Bricolage
Nous appliquons le concept du bricolage tel qu'il a
été défini par Lévi-Strauss, pour comprendre les
manières dont les acteurs réalisent leurs projets, pas dans le
sens d'une application mécanique de concepts selon des objectifs
préétablis, mais celui d'inventions par appropriation et
réappropriation des objets existants.
Nous pouvons situer le compromis dans le processus de
bricolage, d'autant plus que, nous l'avons vu plus haut, celui-ci implique
toujours « un compromis entre la structure de l'ensemble instrumental et
celle du projet ». Autrement dit, quand on considère le processus
de bricolage comme un processus social, on doit toujours tenir compte du
compromis mis en place entre les acteurs concernés.
Autrement dit, l'oeuvre d'un bricolage collectif est celle
d'un compromis effectué dans son processus. Dans ce sens, ce n'est pas,
nous semble-t-il, un hasard que le caractère précaire et ambigu
du compromis qui implique une possibilité ou une nécessité
de s'appuyer sur un bien commun généralisable (constitution d'une
cité), rejoint également une des caractéristiques de
l'oeuvre du bricolage donnée par Lévi-strauss. Et comme nous
l'avons vu plus haut, l'oeuvre du bricolage dépasse un résultat
contingent d'une action humaine, mais celui apportant un « sens » qui
n'exclut pas la possibilité de se généraliser et ainsi de
généraliser.
Transaction sociale
Le compromis implique certainement un point commun fort avec
le modèle de transaction de Mormont, d'autant plus que Mormont
envisageait la transaction sociale, nous l'avons vu, comme cadre stabilisateur
permettant l'anticipation et l'engagement des acteurs, qui ne se base pas
uniquement sur leurs intérêts sur le court terme, mais qui permet
d'engager leur identité.
La création de nouveaux dispositifs alternatifs
proposée par Mormont du point de vue de la transaction sociale, et la
constitution du bien commun dépassant les intérêts
particuliers des parties, qui suppose de renforcer le compromis et de lui
donner « une identité propre », peuvent, nous semble-il,
être deux approches complémentaires. Le lien théorique
entre le paradigme de la transaction sociale et la sociologie de Boltanski et
de Thévenot nous reste à explorer735.
Transcodage
Enfin, la technique du transcodage pourrait également
être un outil pertinent pour éclairer les conditions du compromis.
Ceci d'autant plus que le transcodage vise à équilibrer les
pratiques et les positions de différents types d'acteurs.
Cependant, il nous semble y avoir une distance de nuances
entre les « visées » du compromis et du transcodage : En
effet, le transcodage suppose que, dans une « situation d'être en
pouvoir » que celui-ci implique, les acteurs peuvent se trouver soit dans
une situation d'autonomie, soit dans une situation de dépendance. Ce qui
amènent les acteurs à lutter pour la « maîtrise des
réseaux d'action publique ». Le transcodage a donc pour objectif
d'équilibrer cette situation. Sur ce point, nous avons une distance
entre le transcodage et le compromis supposant de constituer un « bien
commun » plus ou moins transcendant entre les les parties, relevant de
différents mondes. Le lien théorique entre ces deux concepts nous
reste également à explorer.
Compromis dans le processsus de la construction du Projet
Nô -Life
Le concept du compromis peut, nous semble-t-il, éclairer
la situation de la relation telle qu'elle a été établie
735
entre les agents dans le processus de la construction du Projet
Nô-Life, en terme de l'approche du bien commun, l'ambiguïté
du principe du compromis et la fragilité de celui-ci.
D'abord, le processus de la construction du Projet
Nô-Life s'inscrit, au moins initialement, dans une approche du «
bien commun » de manière explicite : il s'agit de valoriser
l'agriculture et la ruralité non de manière sectorielle, mais via
une « participation citoyenne » (surtout depuis le Plan de 96) en les
considérant comme un bien commun appartenant aux citoyens mais non
uniquement aux agriculteurs.
Cependant, nous l'avons relevé dans l'examen de la
position respective des gestionnaires du Projet Nô-Life (BPA et CAT),
l'ambiguïté du principe du Projet Nô-Life est en question en
raison d'une divergence de leurs propres visions sectorielles tant sur le court
terme que sur le long terme.
En principe, du côté du BPA, il est coincé
entre l'intérêt général qu'il porte, et
l'intérêt du secteur agricole porté par la CAT. Du
côté de la CAT, en réalité, son intérêt
porte exclusivement sur le profit du secteur agricole, malgré la
complexité de son raisonnement.
Intéréts sur le court terme
Sur le court terme, le BPA, en tant qu'agent municipal, doit
d'abord satisfaire le public en répondant le plus possible aux demandes
immédiates des usagers (stagiaires) du Projet. Du coup, le
critère de sélection des stagiaires doit être souple .
C'est pourquoi le Centre Nô-Life accueille divers types de stagiaires qui
ne correspondent pas souvent à l'objectif productiviste du Projet
Nô-Life, (ce qui est d'ailleurs compréhensible en
réalité, nous le verrons dans le Chapitre 3). Puis, quand il doit
présenter le résultat ou la vertu concret du Projet auprès
de la municipalité, il doit nécessairement recourrir aux
éléments quantifiables et immédiats avec des chiffres
concrets (surtout le nombre de stagiaires et la surface agricole mise en
location avec les stagiaires ayant terminé la formation Nô-Life)
plutôt qu'aux éléments non quantifiables qui
dépendent beaucoup du long terme ou de la subjectivité
(qualité de vie, lien social et territorial).
Face à cette exigence du BPA, l'engagement de la CAT
reste mitigé à cause de la faible importance économique
que le Projet Nô-Life pourrait apporter au secteur agricole : la CAT
elle-même est en réalité un grand organisme financier et
commercial dans lequel le domaine des activités agricoles est en
permanence déficitaire736. Si bien que quelques points de
désaccord étaient déjà apparents pour la conduite
actuelle du Projet, sur l'élargissement du Centre Nô-Life
effectué en 2006, à deux autres quartiers : l'un en plaine dans
une zone fortement agricole, l'autre en moyenne montagne, dans une commune
venant de fusionner avec la Ville de Toyota. Ce choix était pour
favoriser la demande de la population locale et l'égalité de
l'offre des services publics en terme géographique. D'après
Monsieur K, président du Centre Nô-Life, la demande pour
l'installation du Centre Nô-Life est surtout forte de la part des
communes de moyenne montagne dépeuplées qui viennent de fusionner
avec la Ville de Toyota, comme un « cadeau d'échange » de
cette fusion. Mais la CAT n'était pas d'accord avec cette
décision. Car ce qui compte pour la CAT, nous l'avons vu, est de «
former les agriculteurs » au lieu de « satisfaire le plus possible le
public ». A cet effet, le nombre des stagiaires accueillis par le Centre
Nô-Life doit être minimum pour la CAT afin de pouvoir
réaliser son objectif de la formation agricole, et
l'élargissement de la taille du Projet Nô-Life n'est pas
prioritaire pour elle.
Intérêts sur le long terme : question de
l'identité agricole
La divergence d'intérêts sectoriaux porte
également sur le long terme qui concerne directement la
définition légitime du métier agricole. La seule
référence légitime de la profession agricole renvoie, en
fait, au montant de
736 Nous avons vu la structure interne de la coopérative :
l'importance économique occupée par les activités
agricoles à l'intérieur de la CAT (achat commun des
matériels agricoles, vente commune des produits agricoles) est
déjà extrèmement faible par rapport aux autres domaines
d'activités. En tant que coopérative agricole, les
coopératives agricoles japonaises effectuent surtout un ensemble de
services financiers (crédits, mutualité, immobiliers, commerce de
détail etc) et également ceux non agricoles (services
immobiliers, divers services dans le domaine de la « vie » comme les
supermarchés, les cérémonies funéraires et services
de l'aide aux personnes âgées dépendantes). Surtout les
services pour les personnes âgées ou leur décès sont
aujourd'hui un marché à conquérir à l'ère du
vieillissement...
revenu agricole annuel des « agriculteurs
qualifiés » considérés comme « porteurs »
de l'agriculture, dont la définition relève de la politique
agricole nationale. Et ce sont ceux qui peuvent bénéficier du
prêt agricole départemental contrôlé par l'ECV
(vulgarisateur agricole). Pour en bénéficier, il faut
déposer un plan planifiant une production agricole susceptible de
dégager plus de 2 500 000 yens de revenu agricole annuel.
L'objectif du Projet Nô-Life semble être
fixé par référence à ce critère
économique. De plus, nous l'avons vu, le montant de revenu agricole
annuel donné par le Projet Nô-Life (un million de yens) s'enracine
également dans l'histoire de la modernisation agricole japonaise des
années 70 comme un slogan national, ensuite dans les années 80
comme un objectif économique donné à l' « agriculture
de type Ikigai » promue par la politique de la vulgarisation agricole dans
la région proche de Toyota, pour les femmes et hommes âgés
des foyers agricoles pluriactifs. Cet objectif est donc lui-même un
référentiel historique de la modernisation agricole.
Donc, la définition légitime du métier
agricole reste quasi-exclusivement dans le monde agricole, et elle se
reflète même dans l'objectif du Projet Nô-Life qui a permis
le compromis entre la CAT et le BPA.
Ainsi, nous pouvons comprendre plus ce que veut
substantiellement dire l'intérêt de « former les agriculteurs
» de la part de la CAT. Et du côté du BPA, il n'a qu'à
se référer à la définition telle qu'elle est
donnée dans le monde agricole, tant qu'il n'a pas d'autres
définitions alternatives du métier agricole, à part la
représentation ordinaire comme les « jardiniers pour le loisir
». Si bien que cet objectif lucratif du Projet Nô-Life a
été décidé par une concession de la part du BPA qui
n'était pas forcément favorable à cet objectif : il
souhaitait donner plus de liberté aux stagiaires pour choisir un type
d'activités agricoles quelconque.
Inégalité de l'effet symbolique du Projet
En plus, selon notre enquête, c'était apparement
l'initiative du maire de la Ville de Toyota (élu en 2004) qui a le plus
fortement poussé le Projet Nô-Life jusqu'à son
démarrage en 2004 (la même année que son
élection...). Ce qui amène Monsieur S, directeur de la Direction
des activités agricoles de la CAT, à se plaindre de l'absence du
« mérite » de la part de la CAT pour la réalisation du
Projet Nô-Life. L'effet « symbolique » de la réussite du
Projet compte ainsi dans leur relation de compromis.
Fragilité du compromis Nô-Life
Comme dit Boltanski, la fragilité du compromis est due
au fait que le compromis ne peut pas mettre en cause des identités des
parties et que la dispute entre elles reste non réglée. Ceci
semble bien être le cas dans le Projet Nô-Life entre les parties
appartenant au monde agricole et au monde des services publics locaux.
Selon notre observation, le compromis entre les agents
co-gestionnaires du Projet Nô-Life, où un
référentiel historique de la modernisation agricole productiviste
se reflète fortement, contraindra, du moins dans l'immédiat, plus
ces stagiaires de la formation Nô-Life que les agents institutionnels
concernés, qui n'ont certainement pas fait partie de ce compromis
initial. Dans le Chapitre 3, nous aborderons les conséquences de ce
compromis en examinant les réactions de ces stagiaires. Il s'agira alors
du compromis du Projet Nô-Life qui sera « à l'épreuve
» de la vie des stagiaires. Là, la question de renforcer ce
compromis en le dotant d'une « identité propre » sera
envisageable par référence aux représentations relevants
des acteurs appartenant à différents mondes autour de l'objet de
l'agriculture de type Ikigai...
Rapport de pouvoirs entre les sept agents
Enfin, le compromis tel qu'il est constitué pour la
construction du Projet Nô-Life, est-il équilibré ou
déséquilibré ? Pour répondre à cette
question, nous allons examiner le rapport de pouvoirs établi entre les
sept acteurs institutionnels à partir du schéma ci-dessous.
Dans ce schéma, nous pouvons facilement repérer
la forte emprise qu'ont des agents appartenant au monde agricole professionnel
(BPA, CAT, BDPA, ECV, GASATA), sur la réalisation du Projet
Nô-Life, par rapport aux deux autres agents (SCI, CFLS) qui n'y sont
qu'indirectement impliqués.
Parmi les cinq agents appartenant au monde agricole
professionnel, quatre agents (BPA ; CAT ; l'ECV : vulgarisateur agricole ;
GASATA : groupement d'arboriculteurs professionnels) s'impliquent directement
dans les activités de la formation Nô-Life. Le BDPA
(administration agricole départementale) conserve un rôle de
tutelle. Lors du contrôle final du stage individuel sur l'état
d'entretien des cultures, quelques responsables de ces cinq agents sont
présents pour donner leurs commentaires.
Puis, traditionnellement, ces cinq agents constituent entre
eux des liens de partenariat. Si bien qu'ils sont constamment en contact dans
leurs activités routinières liées au monde agricole
professionnel. Ce qui renforce leur lien social.
En fait, les deux autres agents ne sont qu'indirectement
impliqués dans les activités du Projet Nô-Life. Le SCI
(agent des services publics locaux pour Ikigai des personnes
âgées), maintient juste son rapport avec le Centre Nô-Life
via son propre projet « Ferme-école des personnes
âgées » qui joue le rôle médiateur entre les
personnes âgées en général et le Centre
Nô-Life. En effet, cette école peut être une première
étape pour apprendre pendant un an les pratiques agricoles en tant que
débutant, et ensuite s'inscrire éventuellement au Centre
Nô-Life pour passer à l'étape suivante. Mais, nous l'avons
vu, l'écart est net entre la position du SCI et le monde agricole
professionnel. Pour le SCI, les activités agricoles pour les personnes
âgées ne peuvent avoir de siginification qu'en relation avec
l'amélioration de la qualité de vie ou de le lien social et
territorial des personnes âgées. Et par là, l'agriculture
peut avoir un lien avec l'aménagement de la Ville dans le sens du
paysage ou de l'aménité, mais le développement agricole au
sens sectoriel et productiviste n'entre pas dans l'approche du SCI.
Schéma : Rapport institutionnel dans le Projet
Nô-Life
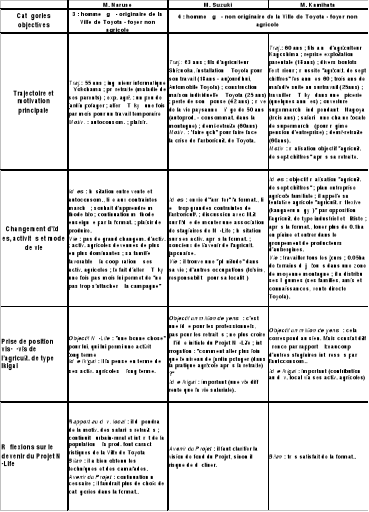
Monde syndical
et salarial
Monde services
publics locaux
(Municipalité)
Monde agricole
professionnel
BDPA
CFLS
SCI
BPA
CAT
ECV
GASATA
: Lien de partenariat direct pour le Projet
: Lien de partenariat indirect pour le Projet Nô-Life
: Lien de partenariat traditionnel
Si le CFLS joue le rôle de médiateur entre les
retraités salariés résidant dans la Ville de Toyota et le
Projet Nô-Life via une offre d'informations auprès de ses
adhérents, il ne s'implique pas dans les activités de la
formation Nô-Life. De même, ces dix dernières années,
il a établi un lien de partenariat avec la Municipalité via
diverses thématiques concernant la vie locale (aménagement
urbain, animation etc) dans lesquelles la thématique de la promotion
d'Ikigai des personnes âgées est abordée en terme de la
qualité de vie et du lien social et territorial. La thématique de
l'agriculture l'intéresse également, mais elle est traitée
dans le cadre de sa politique syndicale à l'échelle nationale,
soit pour l'autosuffisance alimentaire, soit pour la préservation de
l'environnement naturel et rural.
Selon son point de vue (informellement énoncé
lors de notre entretien), le Projet Nô-Life ne pourrait pas contribuer au
développement agricole dans le sens sectoriel et productiviste. A cet
effet, la mobilisation des personnes âgées actives sera incertaine
et insuffisante. Ainsi, il n'a pas l'intention de plus s'impliquer dans le
Projet Nô-Life.
« Ambiguïté structurale » ?
Enfin, à partir de ce schéma, nous pouvons
également repérer la position ambigüe du BPA marquée
par sa double appartenance d'un côté au monde des services
publics, de l'autre au monde agricole professionnel. Cette double appartenance
traduit bien l'ambiguïté du principe du Projet Nô-Life.
Sur cette ambiguïté de la position du BPA, nous
pouvons évoquer la notion de l' « ambiguïté structurale
» que P. Bourdieu emploie dans un de ses derniers ouvrages737.
Ceci pour analyser le comportement d'un agent public (ingénieurs du DDE
: Direction départementale de l'équipement) occupant une position
dominante dans l'application locale de la politique du logement dans le Val
d'Oise. Selon Bourdieu, cette ambiguïté est due à la «
double dépendance » de cet agent basé sur la situation de
« champ local738 » où s'impose la double relation
structurée, d'un côté verticale (hiérarchie
bureaucratique et ministère de tutelle) et de l'autre horizontale
(préfet et collectivités locales). Et cette ambiguïté
de la position, déterminée non seulement par des champs
structurés et complexes, lui permet de jouer stratégiquement pour
« s'assurer une forme d'indépendance autorisant les compromis, les
exceptions et les transactions et, par là, d'importants avantages
matériels et symboliques »739. Ainsi, selon Bourdieu,
malgré la possibilité de l'opération d'une transaction
singulière dans un champ territorial, la position dominante des agents
bureaucratiques et de leurs « protégés (notables) »
sera assurée via une violence symbolique vis-à-vis des agents
faibles (« les assujettis » et « les administrés
»)740. Ce point de vue relève que des contraintes
structurales peuvent même exister dans une situation de champ local
où les agents peuvent s'arranger de manière flexible comme dans
le cas du Projet Nô-Life. Cependant, nous nous gardons d'appliquer
directement à notre cas l'analyse structuraliste de Bourdieu, car le
Projet Nô-Life ne s'inscrit pas dans une politique générale
comme la politique du logement. C'est d'abord un projet portant une
thématique locale et nouvelle, spécifiquement
élaboré entre des agents relevant de différents champs
(bureaucratique, agricole). Si des contraintes structurales peuvent peser
généralement sur ce processus tant sur les agents bureaucratiques
que sur les agents du secteur agricole, elles ont été «
mises en parenthèses » par un compromis initialement établi
entre ces agents. Autrement dit, l'ambiguïté structurale de la
position du BPA a « cédé » sa place pour que celui-ci
entre en compromis institutionnel pour lancer le Projet Nô-Life, sans
pour autant effacer son influence latente sur ce compromis.
Compromis et représentations
737 Bourdieu, 2000 : 166.
738 Le « champ » est un des concepts centraux
élaborés par Bourdieu. Pour la définition
générale, nous pouvons se référer à son
ouvrage « Questions de sociologie » (1984) (« Quelques
propriétés des champs »(p. 113-120). Il est d'abord un
« état du rapport de force entre les agents ou les institutions
engagées dans la lutte » (Bourdieu, 1984 : p.114). Et ils
luttent dans l'enjeu du monopole de ces capitaux spécifiques. Ils sont
ainsi dans une relation de concurrence en ayant chacun ses propres
intérêts, stratégie et position. Nous pouvons
généralement considérer le champ comme «
structure de la distribution du capital spécifique
»(Ibid.) dont l'accumulation s'effectue « au cours des luttes
antérieures », et qui « oriente les stratégies
ultérieures » des agents constitutifs du champ. Puis, ce
rapport de forces entre les agents peut se traduire comme un rapport dominant -
dominé déterminé par l'inégalité de la
distribution du capital spécifique. A travers les luttes entre les
agents y compris les nouveaux entrants qui essaient de « faire sauter
les verrous du droit d'entrée » (Ibid. p.11 3) et entre
souvent en opposition face aux dominants qui essaient « de
défendre le monopole et d'exclure la concurrence » (Ibid.). La
structure du champ est ainsi « au principe des stratégies
destinées à la transformer, est elle-même toujours en
jeu » (Ibid. : p.1 14).
739 Ibid.
740 Ibid. : 171-172.
Schéma : Rapport institutionnel dans le Projet
Nô-Life
et représentations de l'agriculture de type
Ikigai

Contribution sociale et locale ;
socioabilité locale ;
vie
familiale ; éducation alimentaire
Lien social et
territorial Qualité de vie Production
matérielle
CFLS
Santé ; loisir ; plaisir ; éducation permanente
; activités culturelles etc.
SCI
BPA CAT
BDPA
GASATA
Travail (de production) ; vente ; lucrativité ;
développement agricole
ECV
Représentations :
CFLS (santé, loisir, plaisir, contribution sociale et
territoriale etc)
SCI (santé physique et mentale, éducation
permanente, contribution sociale et territoriale, activités culturelles
etc)
BPA (santé, loisir, plaisir, contribution sociale et
territoriale, éducation alimentaire, conservation et
développement agricole)
BDPA (idem.)
CAT (contribution sociale et territoriale, conservation et
développement agricole)
ECV (conservation et développement agricole)
GASATA (contribution sociale et territoriale, conservation et
développement agricole)
Enfin, ce rapport de forces entre les sept agents et la position
ambiguë du BPA pèsent inévitablement sur la relation entre
les différentes représentations constitutives de l'agriculture de
type Ikigai.
Dans ce schéma, nous pouvons percevoir une situation de
déséquilibre entre les représentations de l'agriculture de
type Ikigai basées sur les prises de position des agents
concernés. Là, nous comprenons que, face à l'emprise des
représentations liées au productivisme agricole, relevant de
l'ensemble des institutions locales appartenant au monde agricole
professionnel, les représentations relevant des autres agents, portant
sur la qualité de vie et le lien social et territorial , sont beaucoup
moins « représentées » (au sens politique du terme)
dans la relation établie pour le Projet Nô-Life.
Références
Ouvrages et articles
ANSART, P. (1990), Les sociologies contemporaines,
Paris, Seuil.
BERQUE, A (1973), « Les campagnes japonaises et l'emprise
urbaine », Etudes rurales, n°49-50 : p.32 1-352. BLANC, M.
(Textes réunis et présentés par) (1992), Pour une
sociologie de la transaction sociale, Paris, L'Harmattan.
BLANC, M., MORMONT, M., REMY, J., STORRIE, T. (Textes
réunis et présentés par) (1994), Vie
quotidienne
et démocratie : Pour une sociologie de la transaction
sociale (suite), Paris, L'Harmattan.
BLANC, M. (1992), « Introduction », in Pour une
sociologie de la transaction sociale, Paris, L'Harmattan :
p.7-15.
BLANC, M., MORMONT, M., REMY, J., STORRIE, T. (1994), «
Présentation », in Vie quotidienne et démocratie : Pour
une sociologie de la transaction sociale (suite), Paris, L'Harmattan :
p.9-17.
BLANC, M. (1994), « La transaction dans les sciences
sociales : vers un paradigme élargi (Chapitre 1) » in Vie
quotidienne et démocratie : Pour une sociologie de la transaction
sociale (suite), Paris, L'Harmattan : p.21-47.
BOURDIEU, P. (1984), Questions de Sociologie, Paris, Les
Editions de Minuit.
BOURDIEU, P. (2000), Les structures sociales de
l'économie, Paris, Seuil.
HAMAGUCHI, H., SAGAZA, H. (1994), Teinen no Life Style (Style
de vie des retraités), Tôkyô, Korona-sha. HAMAGUCHI, H
(1999), Ikigai sagashi : taishû chôju shakai no jilenma
(Recherche d'Ikigai : dillemme de l'ère de la longévité de
masse) , Kyôto, Mineruva Shobô.
HOSOYA, T. (1998), Gendai to Nihon Nôson Shakai-gaku
(Monde contemporain et sociologie rurale japonaise), Sendai, Tôhoku
Daigaku Shuppai kai.
KAMATA, S. (1983), Jidôsha zetsubô
kôjô : aru kisetsu-kô no nikki (Usine automobile du
désespoir : journal d'un ouvrier saisonier) , Tôkyô,
Kôdansha bunko.
LASCOUMES, P.(1996), « Rendre gouvernable : de la
`traduction' au `transcodage' L'analyse des processus de changement dans les
réseaux d'action publique », in La Gouvernabilité,
Paris, PUF : p.325-338 LÉVI-STRAUSS, Cl. (1958), Anthropologie
structurale, Paris, Librairie Plon.
LÉVI-STRAUSS, Cl. (1962), La pensée
sauvage, Paris, Librairie Plon.
MENDRAS, H. (2002), Éléments de
sociologie, Paris, Armand Colin.
MORMONT, M. (1994), « Incertitudes et engagaments les
agriculteurs et l'environnement une situation de transaction » in Vie
quotidienne et démocratie : Pour une sociologie de la transaction
sociale (suite), Paris, L'Harmattan : p.209-234.
NACHI, M. (2006), Introduction à la sociologie
pragmatique : vers un nouveau « style » sociologique ?, Paris,
Armand Colin.
Naikaku-hu (Office du Gouvernement) (2006), Heisei 18nendo :
Kôrei-shakai Hakusho (Livre blanc du
Vieillissement),
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2006/gaiyou/18indexg.html
(site officiel)
Nôrin-suisan-shô (Ministère de
l'agriculture, de la pêche et de la forêt) (2005), «
Heisei 17 nendo Shokuryô - nôgyô - nôson no
dôkô » ainsi que « Heisei 18 nendo Shokuryô -
nôgyô - nôson shisaku » (« Tendances de
l'alimentation - agriculture - ruralité de l'année 2005 » et
« Mesures pour l'alimentation - agriculture - ruralité de
l'année 2006 »),
http://www.maff.go.jp/hakusyo/nou/h17/html/index.htm
(site officiel)
PERRIER-CORNET, Ph., HERVIEU, B. (2002), « Les
transformations des campagnes françaises : une vue d'ensemble », in
Repenser les campagnes, Géménos, éditions de
l'aube : p.9-31.
PERRIER-CORNET, Ph. (2003), « La dynamique des espaces
ruraux dans la société française »,
Agriculteurs,
ruraux et citadins. Les mutations des campagnes
françaises, Dijon, CRDP de Bourgogne : p.35-51.
REMY, J. (1994),
« La transaction : de la notion heuristique au paradigme
méthodologique (Conclusion) » in
Vie quotidienne et démocratie : Pour une sociologie de
la transaction sociale (suite), Paris, L'Harmattan :
p.293-3 19.
SAKAIYA, T. (2005), Dankai no Sedai : shinpan
(Génération de dankai : nouvelle édition),
Tôkyô, Bungei-shunjû.
TAKEMOTO, Z. (2001), Shakai Hoshô Nyûmon : Naniga
kawattaka, korekara dônaruka (Introduction à la
Sécurité sociale : quel changement, quel avenir ?),
Tôkyô, Kôdansha.
TOYOTA-SHI (Ville de Toyota) (2004), Toyota-shi Tôkei
sho : Heisei 15nendo-ban (Statistique de la Ville de Toyota : année
2003), Toyota, Toyota-shi.
UMESAO, T. (1985), Watashi no Ikigai-ron (Mon argumentation
sur Ikigai) , Tôkyô, Kôdansha bunko.
Documentation
Bureau de la Politique agricole de la Municipalité de la
Ville de Toyota (BPA)
- Documents publiés -
Direction de l'Agriculture et de la Forêt (1996), 2005
Toyota Agri-bility Plan : Premier plan fondamental de l'agriculture de Toyota
(Daiichiji Toyota-shi Nôgyô Kihon Keikaku) , Ville de Toyota,
21p.
Bureau de l'Agriculture et de la Forêt (2003),
Enquête sur la conscience sur l'agriculture de Toyota, l'Année
2003-2004 : Rapport d'enquête(Heisei 15nendo Toyota-shi Nôgyô
ni kansuru Ishiki-chôsa : Chôsa hôkoku-sho), Ville de
Toyota, 74p.
Ville de Toyota (2003a), Zone spéciale
Création Nô-Life (Nô-Life Sôsei Tokku), Bureau
gouvernemental pour la promotion de la Zone spéciale de la
Réforme structurelle (Naikaku-Kanbô Kôzô-kaikaku
Tokubetsu Suishin Honbu), 1p :
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/
Ville de Toyota (2003b), Plan pour les Zones
spéciales de la Réforme structurelle (Kôzo-kaikaku
Tokubetsu-kuiki Keikaku), Bureau gouvernemental pour la promotion de la
Zone spéciale de la Réforme structurelle (Naikaku-Kanbô
Kôzô-kaikaku Tokubetsu Suishin Honbu), 10p \u-230£°
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/
- Brochures officielles du Centre Nô-Life -
Centre pour la Création de Nô-Life de Toyota (2004),
« Centre pour la Création de Nô-Life de Toyota »
(Brochure pour la candidature des stagiaires des années 2004-2006),
Ville de Toyota.
Centre pour la Création de Nô-Life de Toyota
(2005), Stage de la techinique agricole : Filière
Formation
« Porteur », Ville de Toyota. (Brochure pour la
candidature des stagiaires des années 2005-2007)
Centre pour la Création de Nô-Life de Toyota
(2006a), Stage de la techinique agricole : Filière
Formation
« Porteur », Ville de Toyota. (Brochure pour la
candidature des stagiaires des années 2006-2008)
Centre pour la Création de Nô-Life de Toyota
(2006b), Stage de la techinique agricole : Activités agricoles
montagnardes (Centre de Shimoyama); Production - Consommation localisées
(Centre de Takaoka), Ville de Toyota. (Brochure pour la candidature des
stagiaires des années 2006-2008)
- Documents non publiés-
Bureau de la Politique Agricole de la Ville de Toyota (2006),
« Aperçu du Centre pour la Création de Nô-Life
de
la Ville de Toyota (Toyota shi Nô-Life Sôsei Center no
Gaiyô) », document interne non publié.
- Sites internet -
http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/ursum_f.htm
: site officiel de l'OMC
Section de la Création d'Ikigai dans le Bureau Education
permanente de la Municipalité de la Ville de Toyota)
- Documents publiés -
Direction Santé et Bien-être (2000), Plan
Santé et bien-être des personnes âgées de la Ville de
Toyota - Affaires sur l'Assurance des aides aux personnes âgées
dépendantes (résumé) : 2000-2004, (Toyotashi
Kôreisha Hoken Hukushi Keikaku - Kaigo Hoken Jigyô Keikaku : Heisei
12 nendo - Heisei 16 nendo (gaiyô-ban)), Ville de Toyota.
Direction Santé et Bien-être (2000), Plan
Santé et bien-être des personnes âgées de la Ville de
Toyota - Affaires sur l'Assurance des aides aux personnes âgées
dépendantes : 2000-2004 (Toyotashi Kôreisha Hoken Hukushi Keikaku
- Kaigo Hoken Jigyô Keikaku : Heisei 12 nendo - Heisei 16 nendo) ,
Ville de Toyota.
Section Bien-être et Vieillissement de la Direction
Santé et Bien-être (2003), Plan Santé et
bien-être des personnes âgées de la Ville de Toyota
(résumé) : 2003-200 7 (Toyotashi Kôreisha Hoken Hukushi
Keikaku - Kaigo Hoken Jigyô Keikaku : Heisei 15 nendo - Heisei 19
nendo(gaiyô-ban)), Ville de Toyota.
Section Bien-être et Vieillissement de la Direction
Santé et Bien-être (2003), Plan santé et
bien-être des personnes âgées de la Ville de Toyota :
2003-200 7 (Toyotashi Kôreisha Hoken Hukushi Keikaku - Kaigo Hoken
Jigyô Keikaku : Heisei 15 nendo - Heisei 19 nendo), Ville de
Toyota.
Section Bien-être et Vieillissement de la Direction
Santé et Bien-être de la Ville de Toyota (2006),
Troisième
plan Santé et sien-être des personnes
âgées de la Ville de Toyota (résumé): 2006-2008 (Dai
3ki
Toyotashi Kôreisha Hoken Hukushi Keikaku - Kaigo Hoken
Jigyô Keikaku : Heisei 18 nendo - Heisei
20 nendo(gaiyô-ban)), Ville de Toyota.
Section Bien-être et Vieillissement de la Direction
Santé et Bien-être de la Ville de Toyota (2006),
Troisième plan Santé et bien-être des personnes
âgées de la Ville de Toyota : 2006-2008 (Dai 3ki Toyotashi
Kôreisha Hoken Hukushi Keikaku - Kaigo Hoken Jigyô Keikaku : Heisei
18 nendo - Heisei 20 nendo), Ville de Toyota.
Young Old Support Center de la Ville de Toyota (2006),
Aperçu des affaires de Toyota Young Old Support Center (Heisei
18nendo Toyota Young Old Support Center Jigyô-gaiyô), Ville de
Toyota.
- Document non publié -
Comité pour la promotion de la création d'Ikigai
(2001), Synthèse des propositions respectives et processus
de
ces propositions avec les petites commissions (Kobetsu-teian
no taikei to shô-iinkai no teian-katei) , 29p. Comité pour la
promotion de la création d'Ikigai (2002), Conception de Second Life
Academy (Second Life
Academy Kôsô), document interne non publié ,
3p.
- Sites internet -
http://www4.ocn.ne.jp/~zenrou/
: site officiel de la Fédération nationale des Club des Personnes
âgées (Zenkoku Rôjin Club Rengôkai)
http://www.zsjc.or.jp/rhx/index.jsp
: site offciel de l'Association nationale des Centres des ressources humaines
âgées (Zenkoku Silver Jinzai Center Jigyô Kyôkai)
Direction des Activités agricoles de la Coopérative
agricole de Toyota (CAT)
- Document publié -
Aichi Toyota Nôgyô Kyôdô Kumiai
(2005), Données pour la 13ème réunion
générale : Rapport d'activités pour l'année
2004-2005, plan d'activités pour l'année 2005-2006 (Dai 13 kai
Tsûjô sôdai kai shiryô : heisei 16 nendo gyômu
hôkoku-sho, heisei 1 7nendo jigyô keikaku-sho), p.73.
- Sites internet -
http://www.zenchu-ja.or.jp/profile/b.html
: site officiel du Zenchû
http://www.nochubank.or.jp/outline/index.shtml
: site officiel du Nôchûkin http://www.ja-aichitoyota.com/ : site
officiel de la CAT
Ex-Centre départemental pour la Vulgarisation et
l'Amélioration de l'agriculture de Toyota-Kamo
- Document publiés -
Centre pour la Vulgarisation et l'Orientation de Toyota-Kamo
(200 1a), Plan fondamental pour la Vulgarisation et l'Orientation :
2001-2005 (Hukyû-shidô kihon-keikaku : Heisei 13nendo kara 1
7nendo), Département d'Aichi, 72p.
Bureau départemental de l'Agriculture, de la
Forêt et de la Pêche de Toyota-Kamo (2005), Plan fondamental de
l'alimentation et du Vert : Plan pour la Promotion régionale Toyota-kamo
: 2005-2010 (Shoku to Midori no kihon-keikaku : Toyota-kamo chiiki suishin
plan), Département d'Aichi, 42p.
Section Amélioration - Vulgarisation du Bureau
départemental de l'agriculture, de la forêt et de la pêche
de Toyota-Kamo (Centre pour la Vulgarisation et l'Orientation de Toyota-Kamo),
(2005), Plan fondamental pour la Vulgarisation et l'Orientation :brillante
agriculture de Toyota-Kamo vers la génération future
(Hukyû-shidô kihon keikaku - Jidai ni mukatte kagayaku Toyota-Kamo
nôgyô : Mokuhyô-nenji 2010, Département d'Aichi,
48p.
Centre pour la Vulgarisation et l'Orientation de Toyota-Kamo
(2001b), Données pour le Plan fondamental pour la Vulgarisation et
l'Orientation : 2001-2005 (Hukyû-shidô Kihon-keikaku
Shiryô-hen), Département d'Aichi, 17p.
- Brochure-
Groupe de l'Education et de la Vulgarisation dans la Section
Gestion agricole du Bureau de l'Agriculture et de la Pêche (2004), «
Affaires de vulgarisation pour la réalisation d'une agricuture avec
charme et yarigai : principes de la mise en plase des affaires de vulgarisation
de l'agriculture coopérative : thématiques des activités
de vulgarisation 2001-2005 », Département d'Aichi.
- Sites internet -
http://www.stat.go.jp/data/nenkan/01.htm
: Statistics Bureau & Statistical Research and Training Institute
http://www.zenkyo4h.org/2004/main.htm
: Site officiel du Nôgyô Seinen Club
Conseil Local de Toyota de la Fédération des
Syndicats Ouvriers du Département d'Aichi (CLFS : Rengô Aichi
Toyota Chikyô)
- Sites internet -
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/weekly/no669/print.html
: Site officiel de « Rengô » (la Fédération des
sydicats ouvriers japonais)
Groupement d'Arboriculteurs de Sanage pour l'Aide des Travaux
Agricoles (GASATA)
- Documents publiés -
Ville de Toyota (2004), Statistique de la Ville de Toyota :
année 15 Heisei (Toyota-shi Tôkei sho : Heisei 15 nendo
ban).
Centre pour l'amélioration et la vulgarisation de
l'agriculture de Toyota-kamo du Département d'Aichi
(2001),
Données pour le Plan fondamental pour la Vulgarisation et
l'Orientation : 2001-2005 (Hukyû-shidô
Kihon-keikaku Shiryô-hen), Département
d'Aichi.
Chapitre III : Projet Nô-Life à
l'épreuve de la vie des stagiaires
Les stagiaires des formations Nô-Life sont non seulement
des acteurs individuels du Projet Nô-Life mais également
susceptibles d'être protagonistes du Projet. Dans ce présent
chapitre, nous allons analyser leurs représentations, actions et
pratiques de leur participation dans le Projet elle-même, et à
travers celà, celles de l' « agriculture de type Ikigai ».
En première partie, nous présenterons
brièvement les activités générale du Centre
Nô-Life. Ensuite, en nous basant sur le résultat de nos
enquêtes effectuées auprès de ces stagiaires des
années 2005-2007, nous présenterons la typologie de ces
stagiaires et leurs représentations de l'agriculture et de la
ruralité dans le contexte du Projet Nô-Life. Ensuite, nous
essaierons de répondre aux quatre questions suivantes.
1 Quel lien pouvons-nous établir entre les
différents types de stagiaires et leurs représentations de
l'agriculture et de la ruralité ?
2 Quelles positions les stagiaires constituent-ils
vis-à-vis de l'idée du Projet Nô-Life (agriculture de type
Ikigai) ? Divergence ou convergence des positions ?
3 Le compromis basé sur la divergence
d'intérêts entre les agents gestionnaires produisant
l'ambiguïté ou la contradiction de la finalité du Projet
Nô-Life. Quelle conséquence aura-t-elle sur les stagiaires ?
4 En tenant compte de l'héritage de la modernisation
agricole productiviste, les trois éléments constitutifs de
l'agriculture de type Ikigai que nous avons établit dans le
schéma représentationnel de celle-ci (Qualité de vie ;
Lien social et territorial ; Production matérielle), pourront-elles
être compatibles non seulement aux yeux des agents gestionnaires et
partenaires du Projet, mais également à l'épreuve des
divers intérêts des stagiaires de la formation Nô-Life ?
1 Présentation générale des
activités du Centre Nô-Life
Nous allons présenter les quatre activités
principales du Centre Nô-Life : 1 Formations Nô-Life (kenshû
jigyô) ; 2 Entremise de terrains agricoles (nôchi chûkai) ; 3
Entremise d'emplois agricoles (nôka chûkai) ; 4 Recherche et
développement (kenkyû kaihatsu)
1 Formations Nô-Life : « porteur » et
« culture maraîchère de saison »
Les formations Nô-Life s'étendent à deux
types de programmes : 1 Formation « porteur » ; 2 Formation «
culture maraîchère de saison ».
Le premier constituant le pilier principal des activités
du Centre Nô-Life, consiste à donner un programme de formation
agricole de deux ans, afin de former les agriculteurs susceptibles de
dégager un certain niveau de
revenu agricole dont le repère est un million de yens
(environ 6666 euros) par an. Ce programme vise à l'acquisition d'une
qualification professionnelle dans le domaine agricole qui permet aux
stagiaires de bénéficier du service de l'entremise de terrains
agricoles à partir de 0. 1ha, offert par le Centre Nô-Life.
Le second consiste à offrir une occasion d'avoir une
expérience de la pratique d'une culture maraîchère de
saison dans un jardin familial ou citoyen pour le plaisir. Le programme se
déroulera une fois par mois pendant une moitié d'année.
Deux sessions sont organisées l'une pour le printemps -
été (avril - juillet) et l'autre pour l'automne - hiver
(septembre - décembre). Ce programme est largement ouvert aux
débutants.
Nous présenterons ici le programme de la formation
« porteur » en se référant à une brochure
officielle préparé pour l'appel à candidature des
stagiaires des années 2005-2006 sur lesquels notre analyse porte
principalement741. Puis, notre observation participante
effectuée sur ce programme de mars à septembre 2005
complètera l'explication.
Objectif de la Formation « porteur »
Ce programme vise à l'acquisition d'une qualification
professionnelle dans le domaine agricole qui permet aux stagiaires de
bénéficier du service de l'entremise de terrains agricoles
à partir de 0. 1ha, offert par le Centre Nô-Life.
Il a pour objectif le stage agricole de deux ans portant tant
sur les techniques culturales que sur les connaissances de la gestion agricole.
Il est destiné aux personnes de moins de 65 ans souhaitant
dégager un certain niveau de revenu agricole dont le repère est
un million de yens (environ 6666 euros) par an.
Structure du programme
Ce programme est constitué de cours théoriques
(tronc commun et filière spécilisée), cours pratiques par
filière spécialisée et d'un stage individuel final. Les
cours auront lieu une ou deux fois par semaine, ce qui est environ de l'ordre
de 40 jours par an (soit environ 120 heures).
Les enseignements s'étendent aux trois filières
suivantes (culture maraîchère ; cultures marâichère
et rizicole ; culture fruitirère) qui sont organisées au Centre
Nô-Life en collaboration avec des agents agricoles impliqués (CAT
: Coopérative agricole de Toyota ; ECV : Ex-Centre pour la Vulgarisation
; GASATA : Groupement d'arboriculteurs de Sanage pour l'Aide aux Travaux
Agricoles). La formation se déroulera sur deux années.
Il comprend un tronc commun théorique à tous les
stagiaires, et un ensemble de cours théoriques et pratiques à
suivre dans l'une des trois filières. Un stage individuel, suivi d'un
contrôle final, est prévu à la fin de la deuxième
partie du programme. Le contrôle du résultat du stage est
assuré par certain nombre de responsables des agents du secteur
agricole, dont ceux du Centre Nô-Life font partie.
Le stage individuel se réalise soit dans une parcelle
attribuée par le Centre Nô-Life (près de 170m), soit dans
une parcelle privée, (sauf pour les stagiaires de la filière
fruitière qui n'ont plus à effectuer un stage individuel depuis
les stagiaires des années 2005-2007).
L'évaluation finale sera effectuée sur la base du
taux de présence aux cours (plus de 80%) et du résultat du
contrôle du stage individuel.
Activités du programme Trois filières au
choix
Tous les stagiaires dans cette formation doivent choisir l'une
des trois filières suivantes lors de leur candidature. Ensuite, lors de
l'admisssion, le Centre Nô-Life désigne la filière
où chaque stagiaire va s'inscrire.
741 Centre pour la Création de Nô-Life de Toyota,
2005.
Filière Contenu Produits
|
Culture maraîchère
|
Culture maraîchère en plein air et en serre
|
Légumes divers
|
|
Cultures maraîchère et rizicole
|
Riziculture et culture maraîchère en plein air
|
Riz et légumes divers
|
|
Culture fruitière
|
Productions de fruits du terroir
|
Pêche, poire, figue
|
Source : Centre pour la Création de Nô-Life de
Toyota (2005).
Contenu des enseignements
Les cours du tronc commun portent sur l'agronomie
générale, la biologie végétale, les techniques
agricoles, la gestion agricole et la conjoncture agricole etc. Les cours
spécialisés par filière consistent en l'apprentisage
pratique des techniques culturales.
Dans la filière « culture maraîchère
», les stagiaires suivent des enseignements et des cours pratiques sur la
culture maraîchère en plein air et en serre et de son entretien en
cultivant sur le terrain du Centre Nô-Life divers types de légumes
tels que tomates, pommes de terre, radis blanc, poivrons, choux, carotes,
fraises, maïs, soja etc.
Dans la filière « cultures maraîchère
et rizicole », les stagiaires suivent des enseignements et des cours
pratiques sur riziculture et culture maraîchère en plein air et de
son entretien en cultivant sur le terrain du Centre Nô-Life du riz et
divers types de légumes tels que pastèques, satoimo (taro),
aubergines, oignons etc.
Dans la filière « Culture fruitière »,
les stagiaires suivent des enseignements et des cours pratiques sur la
production de fruits du terroir à savoir la pêche, la poire, la
figue. Les cours de terrain pour la pêche et la poire ont lieu dans la
zone de production fruitière de Sanage. Les stagiaires suivent les
enseignements organisés par des arboriculteurs membres du GASATA sur des
terrains de leurs exploitations familiales. Une parcelle louée par le
Centre Nô-Life dans cette zone est également utilisée pour
l'apprentisage collectif de l'entretien d'un verger de pêches.
|
Tronc
commun
|
- Sol et engrais ; diagnostic des maladies et insectes nuisibles
; biologie des plantes ; utilisation des outils et des machines agricoles ;
analyse du sol et planification de la fertilisation ; planification de
l'installation agricole ; gestion agricole ; actualités de la politique
agricole etc.
|
|
Cours
spécialisés
(par
filière)
|
- Culture et entretien (préparation du sol ; fertilisation
; semis et plantation ; prévention des maladies et insectes nuisibles ;
enlever les mauvaises herbes ; récoltes)
- Visite d'exploitations et d'établissements agricoles
- Les cours sont principalement basés sur les exercices
pratiques. Le contenu est varié selon les filières.
|
Source : Centre pour la Création de Nô-Life de
Toyota (2005).
Les enseignants
Les cours du tronc commun et des cours théoriques sont
assurés par des conseillers ou ingénieurs retraités de
l'ECV ou de l'Institut départemental de la recherche agronomique d'Aichi
(institution supérieure des ECV) Les cours pratiques sur le terrain du
Centre Nô-Life sont assurés par les deux vice-présidents du
Centre Nô-Life (Monsieur KH, employé du BPA ; Monsieur KM,
employé de la CAT). Les cours pratiques de la filière
fruitière sur le terrain de la zone de production seront
accompagnés par les vice-présidents du Centre Nô-Life et
les arboriculteurs membres du GASATA.
Autrement, les stagiaires suivent occasionnellement des
enseignements assurés par des agriculteurs professionnels
retraités de la Ville de Toyota sur le terrain du Centre
Nô-Life.
Stage individuel
Le stage individuel consiste à cultiver du riz (pour la
filière "riziculture") ou plusieurs sortes de légumes pendant
toute l'année de la deuxième année du programme, soit sur
une parcelle individuelle attribuée par le
Centre Nô-Life (près de 1 70m2), soit sur
une parcelle privée.
Les stagiaires de la filière fruitière
n'effectuent plus de stage individuel depuis le programme 2005-2007. Cela est
dû au fait que, comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, un verger
collectif loué à un arboriculteur professionnel (Monsiuer N) a
été gravement dégradé suite au mauvais entretien
effectué par les stagiaires des années 2004-2006 (premiers
stagiaires de la formation Nô-Life) lors de leur stage individuel.
Un certain nombre de stagiaires ont choisi de faire leur stage
individuel sur une parcelle attribuée par le Centre Nô-Life comme
pour ceux des deux autres filières, d'autres ont continué
à entretenir collectivement le verger de pêches loué par le
Centre Nô-Life.
Sinon, une possibilité de stage dans une exploitation
professionnelle est offerte par l'entremise du Centre Nô-Life
(activité 3). Un jeune stagiaire de 28ans souhaitant devenir agriculteur
professionnel a effectué son stage dans une exploitation professionnelle
de l'agriculture biologique, en bénéficiant de l'entremise du
Centre Nô-Life.
2 Entremise de terrains agricoles
Les stagiaires ayant acquis la qualification de la formation
"porteur" ont le droit de bénéficier du service de l'entremise de
terrains agricoles assuré par le Centre Nô-Life à partir de
0. 1ha.
Les terrains agricoles faisant l'objet de cette entremise sont
limités à ceux situés dans la zone réservée
au développement agricole (environ 5000 ha). Sur l'estimation
générale annoncée par la Municipalité, environ
700ha de terrains agricoles sont soit mis en jachère, soit
laissés en friche.
Les données complètes relatives à ces
terrains agricoles (état des cultures, situation de
propriété etc) sont à disposition du Centre Nô-Life,
grâce à son statut institutionnel branche du BPA chargé de
la gestion cadastrale.
Les stagiaires bénéficiaires de l'entremise
concluent ensuite un contrat de fermage avec le propriétaire en se
mettant d'accord avec celui-ci sur les conditions de location.
3 Entremise d'emplois agricoles
Le Centre Nô-Life effectue également l'entremise
d'un emploi agricole, pour les stagiaires du Centre Nô-Life, dans une
exploitation agricole . Ceci a principalement pour objectif d'assurer une aide
aux travaux agricoles auprès des exploitations familiales qui manquent
de main-d'oeuvre en raison du vieillissement de leurs membres.
4 Recherche et développement
Des expérimentations de nouvelles variétés
de produits agricoles ou de nouveaux produits transformés seront
effectuées via les cours pratiques au profit de l'agriculture de la
Ville de Toyota.
2 Stagiaires de la formation Nô-Life : typologie
et représentations
Typologie et tendances générales des
stagiaires
Résultat de l'enquête par questionnaire
Cette enquête par questionnaire a été
effectuée de mai à juin 2005 auprès des stagiaires des
années 2004-2006 et 2005-2007 dont le nombre total était de 69
personnes. Le questionnaire a été distribués à tous
ces stagiaires de manière anonyme, et nous avons pu
récupérer 50 réponses (soit un taux de
récupération de 72 %). Ce questionnaire contenait 24 points
visant à saisir le profil(sexe, âge, expériences
passées etc), les motifs pour la participation à la formation,
les perspectives des stagiaires pendant et après la formation
etc742.
L'analyse de son résultat nous servira à
établir les catégories objectives (âge ; sexe ; lieu
d'origine ; expériences professionnelles), et à analyser les
tendances générales des représentations que les stagiaires
ont de leur participation à la formation, du Projet Nô-Life, de
l'agriculture et de la ruralité.
Approche objectiviste de cette enquête
Ici, nous devons avertir que nous n'avons pas recherché
les liens entre chaque catégorie objective et certaines
représentations spécifiques exprimées dans les
réponses pour cette enquête. Cela est finalement notre choix de
l'analyse : en effet, à un moment donné de notre examen du
résultat de cette enquête par questionnaire, il nous a paru plus
pertinent et approprié d'en analyser les catégories objectives
des stagiaires et les tendances générales des
représentations plutôt que les particularités de chaque
enquêté individuel.
D'une part, ceci est dû à la
caractéristique de cette enquête par questionnaire qui, avec
certain nombre de ces questions de type dites « fermé »,
c'est-à-dire celles proposant aux enquêtés certain nombre
de choix préalables de leurs réponses, risque d'aller
réduire les réponses personnellement données par les
enquêtés, à la déduction préalablement et
« objectivement » établie par l'enquêteur.
D'autre part, c'est l'enquête par entretien dont nous
allons analyser le résultat plus bas, qui va mettre en avant les liens
entre les traits particuliers individuels des enquêtés et leurs
représentations. Le lien entre nos deux enquêtes est donc
complémentaire : l'une (par questionnaire) plus objectiviste et l'autre
(par entretien) plus subjectiviste (pour cette dernière, voir plus bas
la partie du « Caractérisgiques des données :
représentations sociales en jeu »).
Catégories objectives des stagiaires
Sexe, âge et lieu d'origine
Plus de 80% des enquêtés sont des hommes (42 sur
50), dont les personnes de 50 ans à 60 ans occupent 40% du nombre total
(20 personnes dont 17 hommes et 3 femmes) et les personnes de 60 ans à
65 ans occupent 30% du nombre total (15 personnes dont 13 hommes et 2 femmes).
Ce qui fait que 70% des enquêtés ont plus de 50 ans. Ensuite, les
personnes de 40 à 50 ans occupent 16% du nombre total (8 personnes dont
6 hommes et 2 femmes).
Si la grande majorité des enquêtés sont
des résidents de la Ville de Toyota (42 personnes soit 84%) ou ceux de
villes environnantes (5 personnes soit 10%), les lieux d'origine des
enquêtés sont, par contre, extrèmement diversifiés.
Les plus nombreux sont originaires de la Ville de Toyota (19 personnes soit 38%
du nombre total),
742 Pour le questionnaire de cette enquête traduit en
français, voir l'annexe 1.
mais si on regroupe toutes les personnes originaires de
l'extérieur de la Ville de Toyota, c'est-à-dire celles venant
d'une ville du département d'Aichi hors la Ville de Toyota (12 personnes
soit 24%) et celles venant de l'extérieur du département d'Aichi
(14 personnes soit 28%), ces personnes constituent la majorité des
enquêtés (26 personnes soit 52%) Les lieux d'origine des personnes
venant de l'extérieur du département d'Aichi couvrent toutes les
régions de l'archipel japonais : Kyshû (Kagoshima ; Kumamoto) ;
Shikoku (Kôchi) ; Kinki (Osaka ; Hyôgo) ; Hokuriku (Toyama) ;
Tôkai (Gifu ; Mie ; Shizuoka) ; Hokkaidô et même
Tôkyô743. Ce qui reflète une des
spécificités historiques de la population de la Ville de Toyota
que nous avons constaté dans le chapitre 1 : rapide développement
de l'industrie automobile qui a absorbé la main-d'oeuvre de tout le
Japon, dont notamment les régions rurales, pendant la haute croissance
économique (1955-1975). C'est pourquoi nous pouvons constater que
presque toutes ces personnes se sont installées dans la Ville de Toyota
entre 1961 et 1980 (14 personnes).
Expériences professionnelles
Grâce aux réponses aux questions concernant le
parcours scolaire (questions 4 et 5), les expériences professionnelles
(6, 7 et 8) et les expériences agricoles (9, 10 et 11), nous pouvons
saisir les éléments socio-professionnels des stagiaires. Ceux qui
n'ont pas suivi un enseignement universitaire constituent à peu
près la moitié du nombre total (23 personnes soit 46%), alors que
30% (15 personnes) ont suivi des cursus universitaires (11 licenciés et
4 master).
Quant à la situation professionnelle actuelle, 62% des
enquêtés (31 personnes) sont inactives, dont 17 personnes (soit
34% du nombre total) se sont présentées comme retraitées
et 5 personnes sont femmes au foyer. Cependant, si nous tenons compte des
personnes s'étant présentées comme « sans emploi
» (9 personnes) ou « agriculteurs » (4 personnes) ou «
[employés] à temps partiel » (2 personnes), une immense
majorité des enquêtés (46 personnes, si on les additionne
toutes) pourront être considérés comme déjà
en retraite ou qui le seront potentiellement, ou inactifs.
Puis, le nombre des enquêtés ayant répondu
à la question 7 sur la profession antérieure est au total de 25
personnes (50% du nombre total), ce que nous pouvons considérer comme le
nombre des retraités le plus proche de la réalité.
Parmi ces retraités, presque tous ont occupé une
profession parmi les catégories des ouvriers (8 personnes) ou des
employés (1 personne) ou des professions intermédiaires (14
personnes). Et au moins la moitié de ces professions sont dans le
secteur automobile744.
Dans la question 9, 19 enquêtés ont
présenté plusieurs professions qu'ils ont
expérimentées au cours de leur période active. Sur 32
professions présentées, 30 sont parmi les catégories des
ouvriers ou des employés ou des professions intermédiaires. La
majorité de ces professions appartient au secteur industriel.
743 Le département d'Aichi se trouve dans la région
Tôkai située au centre du Japon.
744 Pour les catégories professionnells, nous avons
utilisé les PCS(Professions et Catégories Socioprofessionnelles)
dont la nomenclature a été renouvellée en 1982 par
l'INSEE. Source :
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/prof_cat_soc/pages/pcs.htm.
Il faut préciser quelques défauts résidant dans le
résultat sur les parties concernant les expériences
professionnelles (Question 6, 7, 8) D'abord, vu l'ambiguïté de la
situation des retraités ou de celle des personnes des foyers agricoles
pluriactifs, la description de chaque profession devient approximative. Par
exemple, un bon nombre de personnes de 60 ans à 65 ans travaillent
à temp partiel comme « conseiller à temps partiel dans une
usine » ou « employé à temps partiel » dans le
cadre des mesures du « prolongement de l'emploi (koyô enchô)
» appliquées par leurs entreprises. Il s'agit de permettre aux
salariés de continuer à travailler après l'âge de 60
ans jusqu'à l'âge de 65 ans (ou 63 ans) où les
salariés pourront toucher leur pension. Il y a également des
retraités qui peuvent se trouver dans une situation de chômage
temporaire sans pouvoir toucher leur pension avant d'avoir l'âge de 63
ans ou 65 ans. Puis, la réponse comme « agriculteur » ne
designe pas forcément un statut professionnel, car on peut être
à la fois salarié retraité et agriculteur non
professionnel. Ensuite, un autre défaut de cette partie de
l'enquête réside dans la manière dont les questions ont
été posées. En effet, nous avons demandé aux
stagiaires de présenter la profession par « métier ou
secteur », ce qui entraîne un manque de précision dans la
façon dont les enquêtés ont présenté leur
profession. Cetrains ont mis un métier, mais d'autres un secteur dans
lequel ils travaillent, comme par exemple « commerce » dont on ne
voit pas le statut exact du travail. C'est pourquoi l'enquêteur a
dû réorganiser ce type de réponses de manière plus
ou moins arbitraire.
Expériences agricoles
Quant aux expériences agricoles, il n'est pas facile de
distinguer les populations agricoles ou non agricole vu la situation
marquée par la pluriactivité des foyers agricoles. Mais nous
pouvons effectuer des estimations plus ou moins justes à partir des
réponses aux questions sur la durée et le contenu des
expériences agricoles.
D'abord, 72% des enquêtés (36 personnes) ont une
expérience agricole quelconque. Parmi eux, deux tiers (24 personnes,
soit 48% du nombre total) ont plus de cinq ans d'expériences agricoles.
Parmi les expérimentés, 20 personnes (40% du nombre total) ont
cultivé un jardin potager, et 16 personnes tirent leurs
expériences du travail sur les terrains de leur ferme natale. Nous
pouvons considérer ces dernières comme venant d'un foyer agricole
situé dans la Ville de Toyota. Puis, 5 personnes se sont
présentées comme étant déjà agriculteur. A
partir de ce constat, au moins 30% des enquêtés viennent d'un
foyer agricole de la région, alors que 38% des enquêtés
étaient les habitants de la Ville de Toyota. Là, nous pouvons
constater une autre spécificité des habitants de la Ville de
Toyota : la pluriactivité des foyers agricoles.
Puis, nous pouvons également estimer que, parmi la
population « non agricole » (environ 70% des enquêtés),
la grande majorité est originaire de régions rurales de
l'extérieur de la région de Toyota. D'ailleurs, la plupart de ces
personnes peuvent déjà avoir cultivé un jardin potager ou
un jardin citoyen dans la Ville de Toyota.
A partir de ce résultat sur les expériences
agricoles des enquêtés, nous pouvons constater une tendance
fortement agricole et rurale chez les stagiaires tant au niveau de
l'expérience qu'au niveau de la trajectoire, malgré le fait que
le Projet Nô-Life est destiné au public en grande majorité
non agricole et urbain,
Types de production souhaités : production de type
polyculture à petite échelle Echelle de la surface agricole
déjà utilisée
Parmi 15 personnes ayant répondu à la question
11 sur la surface agricole utilisée et le temps du travail agricole par
semaine745, la moitié (7 personnes) utilise moins de 0.3ha et
l'autre moitié utilise de 0.3ha à 1ha. Quant à
l'échelle des activités agricoles envisagées (question
19), la plupart des enquêtés ont répondu en terme de
surface . En effet, la moitié des personnes ayant répondu
à cette question (19 sur 39 personnes) envisage de cultiver moins de
0.3ha (dont 7 personnes moins de 0. 1ha) après leur formation
Nô-Life. Puis, 10 personnes veulent cultiver plus de 0.3ha jusqu'à
1ha. Seulement 4 personnes ont répondu en terme de revenu.
Les perspectives sur la surface agricole qu'ont les stagiaires
pour leurs activités agricoles peuvent se catégoriser selon les
trois niveaux approximatifs suivants : moins de 0.1ha ; de 0.1 à 0.3ha ;
de 0.3ha à 1ha. En tenant compte du fait que le nombre des personnes
envisageant de cultiver plus de 0.3ha de terrains correspond au nombre des
agriculteurs pluriactifs qui utilisaient déjà plus de 0.3ha de
terrains (nous venons de le constater plus haut), nous pouvons estimer que la
surface que la grande majorité des stagiaires (plus de 80%) souhaitent
cultiver après la formation Nô-Life est moins de 0.3ha.
Types de production envisagée après la formation
Sur les personnes ayant répondu à la question 17
sur les produits envisagés après la formation (42 personnes au
total), sauf 9 personnes voulant cultiver les fruits (figues, poire,
pêche et kaki etc), presque tous les stagiaires veulent cultiver plus de
5 sortes de produits allant jusqu'à 30 sortes de produits dont les
légumes sont majoritaires.
De ce fait, nous pouvons esquisser le type de production que
la grande majorité des stagiaires souhaitent mener comme la suivante :
production à petite échelle (moins de 0.3ha) de type polyculture
(à dominante maraîchère, plus des céréales
(riz, soja, maïs) et des pommes de terre).
745 Ce chiffre correspond presque à notre constat sur les
réponses obtenues pour la question 10 : 16 personnes tirent leurs
expériences du travail sur les terrains de leur ferme natale parmi les
stagiaires.
Tendances générales des représentations
A partir des réponses obtenues aux 7 questions (13 ; 15
; 20-24), nous pouvons saisir les tendances générales des
représentations qu'ont les stagiaires de leur participation à la
formation, du Projet Nô-Life, de l'agriculture et de la ruralité.
Ces 7 questions portent sur les catégories suivantes : motivations pour
la participation (Q. 13) ; intérêts sur les domaines
d'apprentisage (Q.1 5) ; intention de la réalisation concrète
à moyen terme après la formation (Q.20) ; intention de la
réalisation concrète à long terme après la
formation (Q.21) ; place de l'agriculture dans la vie future (Q.22) ; vision
idéale de la réalisation du « Nô-Life » (Q.23) ;
problèmes agricole et alimentaire au Japon (Q.24).
Les enquêtés ont répondu à toutes
ces questions par ecrit. Ce qui a permis à chaque enquêté
de s'exprimer de manière personnelle. C'est aussi pourquoi la
quantité et la qualité des réponses sont variables selon
les enquêtés.
Ici, nous avons tenté de saisir les tendances
générales de leurs représentations en analysant les
différents éléments que les réponses
contiennent.
Motivations pour la participation (Q. 13)
Pour la question 13 sur la motivation pour la participation
à la formation du Centre Nô-Life, nous avons obtenu 28
réponses.
La plupart des réponses ont reflété des
intérêts plutôt immédiats et concrets des stagiaires
pour la participation à la formation Nô-Life. Ainsi, la
majorité des réponses (16 personnes) ont mentionné
l'apprentissage des techniques et des connaissances agricoles. Puis, ont suivi
une série d'éléments concernant la production : la
conservation ou la succession de la production agricole familiale (9
personnes), le développement de la production agricole individuelle (6
personnes) et la location ou l'achat des terrains agricoles (5 personnes).
Q.13 : Motivation pour la participation à la
formation Nô-Life
|
Eléments
|
Nombre des réponses
|
|
Apprentissage techniques (connaissance)
|
16
|
|
Conservation (succession)
production agricole
familiale
|
9
|
|
Développement production agricole
individuelle
|
6
|
|
Location (ou achat) terrains agricoles
|
5
|
|
Ikigai après la retraite
|
3
|
|
Revenu (rentabilité)
|
3
|
|
Santé
|
3
|
|
Auto-consommation
|
3
|
|
Relation familiale
|
3 (parent-enfant 1; conjugale 2)
|
|
Qualification agricole
|
2
|
|
Installation agricole(professionnelle)
|
2
|
|
Plaisir, loisir
|
2
|
|
Installation (vie) à la campagne
|
2
|
|
Devenir agriculteur
|
1
|
|
Porteur de l'agriculture
|
1
|
|
Nature (sol, terre)
|
1
|
|
Auto-suffisance alimentaire japonaise
|
1
|
|
Sécurité alimentaire
|
1
|
|
Consommation
|
1
|
|
Contribution sociale et territoriale
|
1
|
|
Paysage
|
1
|
|
Vieillissement de la population
|
1
|
|
Futur mode de vie
|
1
|
|
Prévention de la friche
|
1
|
|
Une autre vie que la vie salariale
|
1
|
|
Autres
|
2 (nostalgie de l'agriculture 1; nouveau type de service
publics
|
|
Total (Nombre des réponses)
|
28
|
Intérêts sur les domaines d'apprentisage (Q.
15)
Pour la question 15 « Que vous voulez le plus apprendre
dans la formation Nô-Life ? », nous avons obtenu 33 réponses.
La grande majorité des réponses (26 personnes) ont exprimé
l'intérêt focalisé sur les divers aspects techniques de la
production agricole tantôt sur les produits spécifiques
(légumes, riz, fruits etc), tantôt sur les modes de production
(utilisation réduite des pesticides, rotation, amendement etc). Et
beaucoup d'entre elles (9 personnes) ont insisté sur les connaissances
de « base ».
Q. 15 : Intérêts sur les domaines
d'apprentisage
|
Eléments
|
Nombre des réponses
|
|
Apprentisage technique
|
26
|
|
Gestion d'exploitation
|
2
|
|
Distribution des produits agricoles
|
1
|
|
Rentabilité
|
1
|
|
Caractéristiques des plantes
|
1
|
|
Légumes sans traitements chimiques
|
1
|
|
Communication avec les gens
|
1
|
|
Possibilité du business agricole
|
1
|
|
Procédures administratives
|
1
|
|
Total (Nombre des réponses)
|
28
|
Intention de la réalisation concrète
après la formation à moyen terme (Q.20)
Pour la question 20 « Quelle réalisation
concrète envisagez-vous à travers vos activités agricoles
à moyen terme (d'un à cinq ans) ? », nous avons obtenu 46
réponses.
En comparant les éléments de ces réponses
aux trois catégories constitutives de l'agriculture de type Ikigai que
nous avons analysé dans le chapitre 2, nous pouvons faire un
schéma comme ci-dessous. Si le nombre des réponses exprimant le
souci sur le revenu agricole était le plus nombreux (12 personnes), les
aspects non productifs ont été mis en avant tels que le lien
social et territorial (11 personnes), le style de vie (7 personnes), la
santé (6 personnes), l'auto-consommation (6 personnes), la relation
familiale (6 personnes), la consommation (5 personnes) etc. Ceci à la
différence des réponses pour la question sur la motivation pour
la participation, et à celle sur l'intérêt sur les domaines
d'apprentisage, qui ont presque exclusivement porté sur l'aspect
productif et technique.
Le nombre des réponses exprimant le souci sur le revenu
agricole était le plus nombreux, mais les contenus des intentions sur le
revenu agricole sont
variés. il y a tantôt des
personnes qui souhaitent avoir un revenu
agricole minimum « pour pouvoir vivre » ou « si
possible », tantôt celles qui souhaitent avoir un revenu agricole
annuel de 300 000 à 1 000 000 yens ou plus.
Nous pouvons remarquer que l'importance accordée aux
objectifs officiels du Projet Nô-Life est relativement basse : porteur de
l'agriculture (1 personne) ; prévention de la friche (1 personne) ;
Ikigai après la retraite (2 personnes) ; vieillissement (1 personne).
Q.20 : Réalisation concrète
envisagée à moyen terme (de 1 à 5 ans)
|
Qualité de vie
|
Nbre
|
Lien social et territorial
|
Nbre
|
Production matérielle
|
Nbre
|
|
Style de vie
|
|
Sociabilité ;
|
|
|
|
|
(cadre de vie ;
vie individuelle)
|
7
|
vie de la localité ;
relation
humaine
|
11
|
Revenu (rentabilité)
|
12
|
|
Santé
|
6
|
Relation familiale
|
6
|
Vente
|
5
|
|
|
Contribution sociale et
|
|
|
|
|
Auto-consommation
|
6
|
territoriale
|
1
|
Techniques
|
2
|
|
Consommation
|
|
|
|
|
|
|
(vie alimentaire)
|
5
|
Education alimentaire
|
1
|
Porteur de l'agriculture
|
1
|
|
|
|
|
Agriculture
|
|
|
Plaisir, loisir
|
3
|
Vieillissement
|
1
|
respectueuse
de l'environnement
|
1
|
|
Ikigai après la retraite
|
|
|
Prévention de la friche (mise en valeur des
|
|
|
(life work)
|
2
|
|
terrains agricoles)
|
1
|
|
Nature (sol, terre)
|
2
|
|
Business
|
1
|
|
Habitat
|
1
|
|
|
|
Liberté
|
1
|
|
|
|
Sécurité alimentaire
(moins de
produits
chimiques)
|
1
|
|
|
Nbre total
46
des réponse
Intention de la réalisation concrète
après la formation à long terme (Q.21)
Pour la question 21 « Quelle réalisation
concrète envisagez-vous à travers vos activités agricoles
à long terme (de cinq à dix ans) ? », nous avons obtenu 36
réponses. Nous avons également établi un schéma
comparant les éléments de ces réponses aux trois
catégories constitutives de l'agriculture de type Ikigai.
D'abord, à la différence des réponses
à la question précédente, plus d'intentions ont
été exprimées sur le lien social et territorial (7
personnes) avant le revenu (6 personnes). Et l'autoproduction -
autoconsommation (5 personnes) et le développement de la production
agricole individuelle (5 personnes) les ont suivis.
Puis, dans les intentions sur le style de vie, des termes
évoquant certains types de vie rurale comme «
Seikô-udoku » ou « Slow life » sont
apparus. Le terme de « Seikô-Udoku », étant une
expression japonaise signifiant « cultiver la terre quand il fait beau,
lire quant il pleut », designe un type de vie rural, calme et libre.
Dans la production matérielle, le nombre d'intentions
exprimées sur l'agriculture respectueuse de l'environnement (4
personnes) a dépassé celui sur la vente (3 personnes).
Il est intéressant de voir qu'un même type de
réflexion a été exprimé par deux stagiaires
concernant l'autosuffisance alimentaire japonaise en rapport avec
l'évolution de la conjoncture internationale, dont notamment la
montée en puissance des pays émergents comme la Chine et l'Inde.
La logique expliquée est la suivante : si ces pays, qui étaient
auparavant exportateurs de l'alimentation, se développent
économiquement, ils deviendront de plus en plus consommateurs et
importateurs de l'alimentation. A ce moment-là, une crise alimentaire
touchera le Japon en l'empêchant de plus en plus d'importer
l'alimentation à bas prix. Tout comme le
cas du pétrole. Puis, c'est à cette
occasion-là que l'agriculture japonaise prendra plus d'importance
à l'intérieur du Japon...
Q.21 : Réalisation concrète
envisagée à long terme (de 5 à 10 ans)
|
Qualité de vie
|
Nbre
|
Lien social et
territorial
|
Nbre
|
Production matérielle
|
Nbre
|
|
Autoproduction-
autoconsommation
|
5
|
Sociabilité ;
vie de la localité
;
relation humaine
|
7
|
Revenu (rentabilité)
|
6
|
|
Style de vie (cadre de vie ;
vie
individuelle)
|
3
|
Relation familiale
|
2
|
Développement
production agricole
individuelle
|
5
|
|
Habitat
|
2
|
Vieillissement
|
1
|
Agriculture
respectueuse
de
l'environnement
|
4
|
|
Consommation (vie alimentaire)
|
2
|
|
Vente
|
2
|
|
Santé
|
1
|
Auto-suffisance alimentaire
japonaise
|
2
|
|
Nature (sol, terre)
|
1
|
Techniques
|
1
|
|
Installation (vie) à la campagne
|
1
|
Conservation
(succession) production
agricole
familiale
|
1
|
|
Entreprise, business
|
1
|
Nbre total des réponses 36
Place de l'agriculture dans la vie future (Q. 22)
Pour la question 22 « Quelle place accorderez-vous
à l'agriculture dans votre vie future ? », les
enquêtés ont choisi une ou plusieurs réponses parmi les dix
choix suivants que l'enquêteur leur a proposés : a. Profession
principale ; b. Moyen d'obtenir un revenu supplémentaire ; c. Loisir ;
d. Moyen de se maintenir en bonne santé ; e. Nouveau métier de la
famille à transmettre de génération en
génération ; f. Moyen de vivre avec la famille ; g. Moyen de
s'enraciner dans la localité ; h. Moyen de se suffire à
soi-même ; i. Moyen de créer des camarades ; j. Ikigai)
Le nombre de réponses était le plus important
dans les trois éléments suivants : « h. moyen de se suffire
à soi-même » (21 personnes), « d. Moyen de se maintenir
en bonne santé » (20 personnes) et « Ikigai » (20
personnes). Puis, les trois réponses suivantes les ont suivies « a.
profession principale » (14 personnes), « i. Moyen de créer
des camarades » (14 personnes), « Moyen d'obtenir un revenu
supplémentaire » (13 personnes). Ensuite, « c. Loisir »
(10 personnes), « f. Moyen de vivre avec la famille » (9 personnes)
et « g. Moyen de s'enraciner dans la localité » (8
personnes).
Ce résultat montre fortement quels types d'importances
sont accordées à l'agriculture dans la vie des stagiaires. Il est
remarquable que les trois éléments choisis avec le plus
d'importance sont tous liés à la qualité de vie.
Q.22 : Place de l'agriculture dans la vie
future
|
Eléments
|
Nombre des réponses
|
|
|
|
h. Moyen de se suffire à
soi-même
|
21
|
|
d. Moyen de se maintenir en bonne
santé
|
20
|
|
j. Ikigai
|
20
|
|
|
14
a.Profession principale
|
i. Moyen de créer des camarades
|
14
|
|
b. Moyen d'obtenir un revenu
supplémentaire
|
13
|
|
c. Loisir
|
10
|
|
f. Moyen de vivre avec la famille
|
9
|
|
g. Moyen de s'enraciner dans la localité
|
8
|
|
e. Nouveau métier de la famille
|
5
|
|
k. Autres
|
2
|
Vision idéale de la réalisation du «
Nô-Life » (Q. 23)
Pour la question 23 « Decrivez librement votre vision
idéale de `Nô-Life' », nous avons obtenu 41 réponses.
Nous avons également établi ci-dessous un schéma comparant
les éléments de ces réponses aux trois catégories
constitutives de l'agriculture de type Ikigai.
Cette question a eu comme caractéristique de faire
s'exprimer les stagiaires sur leur désir ou intérêt
fondamental sur l'agriculture et la ruralité.
Une importance plus ou moins égale été
accordée aux éléments de la qualité de vie
(autoproduction - autoconsommation, plaisir, loisir, style de vie, nature,
liberté etc), du lien social et territorial (sociabilité, vie de
la localité, relation humaine, camarades, relation familiale etc) et de
la production matérielle (revenu agricole, autres professions non
agricoles, agriculture respectueuse de l'environnement, vente etc).
Parmi ces éléments-là, ceux de la
qualité de vie ont pris le plus d'importance. Surtout l'autoproduction -
autoconsommation semble avoir une place privilégiée.
Nous pouvons également remarquer que les
enquêtés sont davantage attachés aux éléments
liés à la nature ou à l'environnement. En terme de la
qualité de vie, quatre réponses ont mentionné le
Seikô-udoku, et cinq réponses ont évoqué la nature
comme élément de vie (sol, terre, rythme de vie) soit à
intégrer, soit à protéger. Puis, en terme de la
production, cinq réponses ont mentionné l'agriculture
respectueuse de l'environnement tels que « culture biologique »,
« sans traitement chimique ».
Par ailleurs, curieusement, cette question a fait exprimer des
idées conciliatrices avec la réalité en évoquant la
nécessité d'avoir d'autres professions non agricoles (5
personnes) pour pouvoir continuer le style de vie de « nô »
(avoir un rapport avec la ruralité de diverses manières).
Enfin, nous constatons également que les
éléments liés aux objectifs officiels du Projet
Nô-Life (porteur de l'agriculture, prévention des friches, Ikigai
et vieillissement) ont relativement moins d'importance dans les expressions des
enquêtés.
Q.23 : Vision idéale de « Nô-Life
»
|
Qualité de vie
|
Nbre
|
Lien social et territorial
|
Nbre
|
Production matérielle
|
Nbre
|
|
Autoproduction -
autoconsommation
|
10
|
Sociabilité ;
vie de la localité
;
relation humaine ;
camarades
|
7
|
Revenu agricole (rentabilité)
|
6
|
|
Plaisir, loisir
|
8
|
Relation (vie) familiale
|
5
|
Avoir d'autres professions
(non
agricoles)
|
5
|
|
Style de vie
(cadre de vie ;
vie
individuelle)
|
6
|
Contribution sociale et
territoriale
|
2
|
Agriculture respectueuse
de
l'environnement
|
5
|
|
Nature (sol, terre)
|
5
|
Vieillissement
|
1
|
Vente
|
4
|
|
Liberté
|
4
|
|
Prévention de la friche
(mise en valeur des
terrains
agricoles)
|
3
|
|
Santé
|
2
|
Techniques (apprentisage)
|
3
|
|
Installation (vie) à la campagne
|
2
|
|
Entreprise, Business
|
2
|
|
Ikigai après la retraite (life work)
|
1
|
Développement production
agricole individuelle
|
1
|
|
Paysage
|
1
|
Revenus non agricoles
|
1
|
|
Maintien de la vie
|
1
|
Durabilité
|
1
|
|
Nbre total des réponses
|
41
|
Problèmes agricole et alimentaire au Japon
(Q.24)
Pour laquestion 24 « Mettez vos opinions ou avis sur la
situation contemporaine de l'agriculture et des produits agricoles au Japon
», nous avons obtenu 30 réponses.
Cette question a comme caractéristique d'inviter les
enquêtés à s'exprimer sur leurs prise de conscience et
réflexions tantôt sur les problèmes de l'agriculture et de
l'alimentation, tantôt sur les possibilités d'avoir des
solutions.
Bon nombre de réponses sont marquées par une
forte prise de conscience sur les crises agricole et alimentaire de
manière à aborder des thématiques très larges. Ceci
soit sur la main-d'oeuvre, soit sur les terrains agricoles, soit sur la
production à petite échelle en difficulté, soit sur la
contradiction de la politique agricole japonaise, soit l'autosuffisance
alimentaire basse, soit la sécurité alimentaire
inquiétante, soit la libéralisation... Surtout nous constatons
qu'il n'y a aucune opinion optimiste parmi les réponses.
A partir des réponses proposant des possibilités
d'avoir des solutions de la situation de crise, nous pouvons synthétiser
les éléments exprimées par les enquêtés en
trois idées communes comme ci-dessous :
- Afin d'améliorer l'autosuffisance et la
sécurité alimentaire, il faut développer au niveau local
la production et la consommation.
- Ceci sera également efficace pour d'autres
thématiques de la société globale comme
l'amélioration du cadre de vie, la lutte contre le réchauffement
climatique et l'éducation des enfants etc.
- Pour réaliser cela, il faut plus ouvrir l'accès
à l'agriculture pour les citoyens.
Finalement, ces trois idées semblent bien rejoindre
l'idée principale de la politique de la Municipalité de Toyota.
Rappellons - nous le fil rouge du Plan fondamental de 96 : intégration
des thématiques globales de l'autosuffisance alimentaire et de la
multifonctionalité ; développement des deux type d'agriculture
industriel et ikigai ; participation citoyenne aux activités agricoles
et rurales.
Nous constatons là que les stagiaires sont loins
d'être privés des problématiques globales de l'agriculture
et de la ruralité dans leurs représentations, mais au contraire,
ils peuvent bien les penser activement, les réflechir et les mettre en
cause.
D'ailleurs, ces idées peuvent se retrouver au niveau
pratique des stagiaires : nous l'avons constaté plus haut, ils
souhaitent généralement mener la production de type polyculture
à petite échelle, ainsi que la distribution à court
circuit (agriculture périurbaine).
Q.24 : Opinions sur l'agriculture et les produits
agricoles au Japon
|
Thèmes abordés
|
Nombre des réponses
|
|
Auto-suffisance alimentaire au Japon
|
6
|
|
Mise en valeur des friches
|
5
|
|
Sécurité alimentaire
|
4
|
|
Ouverture de l'agriculture au public
|
3
|
|
Difficulté de l'agriculture à petite
échelle
(grande agriculture industrielle / petite agriculture
individuelle)
|
3
|
|
Echec de la politique agricole japonaise
|
3
|
|
"Agriculture réjouissante"
|
2
|
|
Semences hybrides et indigènes
|
2
|
|
Réglementations agricoles
|
2
|
|
Conjoncture internationale et agriculture japonase
|
2
|
|
Manque de porteurs
|
1
|
|
Revenu agricole instable
|
1
|
|
Libéralisation du marché agricole
|
1
|
|
OGM
|
1
|
|
Agriculture adaptée
à la
spécificité régionale
|
1
|
|
Agriculture respectueuse
de l'environnement
|
1
|
|
Agriculture périurbaine
|
1
|
|
Total (Nombre des réponses)
|
30
|
Analyse : trois niveaux des représentations
A partir des réponses obtenues pour les septs questions
dont nous venons d'exposer le résultat, nous pouvons distinguer trois
différents niveaux de représentations qui sont indissociablement
liées à la dimension de l'action des stagiaires : niveau
stratégique ; niveau idéal ; niveau réflexif. Pour les
expliquer, nous synthétisons ce que nous avons constaté dans les
réponses obtenus pour les septs questions.
Niveau stratégique des représentations :
demandes instrumentales
D'abord, pour la question 13 sur la motivation pour la
participation à la formation Nô-Life, ainsi que la question 15 sur
l'intérêt sur les domaines d'apprentisage, les
enquêtés ont surtout mis l'accent sur les demandes instrumentales
tant théoriques que techniques qu'ils veulent obtenir lors de cette
formation dans l'immédiat. Cependant ils souhaitent également
aborder, via la formation, l'aspect productif et matériel tels que la
conservation de la production agricole familiale, le développement de la
production agricole individuelle et la location ou l'achat de terrains
agricoles qu'ils veulent envisager via la formation. Et ceci alors que peu de
réponses ont évoqué les objectifs officiels du Projet
Nô-Life comme la formation de porteurs de l'agriculture, la
prévention des friches agricoles, Ikigai pour les personnes
âgées et la prévention de la dépendance dûe au
vieillissement.
C'est par là que nous entendons le niveau
stratégique des représentations au sein des stagiaires : la
formation Nô-Life est intrumentalisée par les stagiaires afin de
réaliser leurs propres intérêts. Du moins les
activités de l'apprentisage technique (ou théorique) dans le
Centre Nô-Life ne constituent pas un obejctif en soi. Ce qui
distinguerait d'emblée la caractéristique du Projet Nô-Life
de l'optique du point de vue stardard d'Ikigai, tel qu'il est adopté par
le SCI (Section pour la Création d'Ikigai) de la Municipalité :
elle défini d'abord Ikigai par l'éducation permanente, bien
qu'elle essaie, de sa part, de développer leur vision en y ajoutant
l'idée de la contribution sociale et du travail. (Voir la partie de
l'acteur 2 du Chapitre 2).
Entre le stratégique et l'idéal :
intérêt fondamental...
Ensuite, pour la question 20 sur l'intention de la
réalisation concrète à moyen terme (1-5 ans), ainsi que la
question 21 sur la même chose mais qui porte sur le long terme (5-10
ans), les enquêtés ont exprimé leurs objectifs à
atteindre (ou à réaliser) mais de manière quelque peu
différente selon les deux dimensions temporelles que ces questions ont
introduites.
Nous avons vu que, dans ces réponses, les
enquêtés avaient mis l'accent sur les éléments
liés à tous les trois
éléments constitutifs de l'agriculture d'Ikigai,
c'est-à-dire, la qualité de vie (style de vie, santé,
autoconsommation etc), le lien social et territorial (sociabilité, vie
de la localité, relation familiale etc) et la production
matérielle (revenu, vente, techniques etc). Mais nous avons
également constaté une différence relative des tendances
entre les réponses pour les deux questions : pour la question 20, le
revenu avait le plus d'importance en devançant les
éléments des deux autres catégories, tandis que pour la
question 21, l'importance accordée au revenu a un peu baissé et
le lien social et territorial l'a devancé. Puis, s'y sont ajouté
de nouveaux éléments qui étaient marginaux dans les
réponses pour la question précédente : autoconsommation,
Seikô-udoku (et slow life également) et l'agriculture
respectueuse de l'environnement. Le point commun qu'impliquent ces
éléments-ci est - évidemment - le côté
non-productif de l'agriculture et de la ruralité (ou vie rurale).
Pourquoi cette différence ? Ceci peut s'expliquer par
la différence de la dimension temporelle : moyen terme (1-5 ans) et long
terme (5-10ans). Ces deux dimensions temporelles introduites dans les questions
ont fait que les enquêtés ont distingué leurs
intérêts à court terme et à long terme, ce qui nous
permet d'établir la distinction des intérêts selon ces deux
niveaux temporels. Et c'est également par là que nous entendons
le niveau idéal ou plus statique des représentations au sein des
stagiaires. Mais ce niveau dite idéale ou statique n'exclut
évidemment pas la dimension temporelle et stratégique. Là,
nous pouvons parler de l'intérêt qui est fondamental et
recherché à long terme par les stagiaires qui sont toujours
ancrés dans la dimension réelle, à savoir
spatio-temporelle et sociale.
Niveau idéal de représentations : projets de
vie ou intérêts sur le long terme
Et la question 22 sur la place de l'agriculture dans la vie
future, ainsi que la question 23 ont cette fois-ci , directement abordé
cette dimension exclusivement idéale et plus statique des
représentations par l'utilisation des terme « place de
l'agriculture » et « vision idéale du 'Nô-Life' ».
Le résultat a curieusement montré un prolongement (ou
renforcement) de la distinction représentative que nous venons de
constater entre les intérêts sur le court terme et sur le long
terme.
En effet, dans les réponses obtenues pour la question
22, les éléments de la qualité de vie ont largement
devancé les éléments des deux autres catégories :
selon ces réponses, l'agriculture était d'abord
considérée comme un moyen pour l'autoconsommation (« se
suffire à soi-même ») et pour la santé (« se
maintenir en bonne santé »). Puis, s'y ajoute la définition
objective de l'agriculture comme « Ikigai ». Et après ces
trois éléments, les définitions en rapport avec le lien
social (« moyen de créer des camarades ») et la production
matérielle (« moyen d'obtenir un revenu supplémentaire
») ont été choisies, accompagnées par la
définition objective telle que la « profession principale ».
Ensuite, dans les réponses obtenues pour la question 23, ce prolongement
a été plus accentué : les éléments de la
qualité de vie et du lien social et territorial ont largement
devancé les éléments de la production matérielle.
Surtout l'autoconsommation-autoproduction (jikyû-jisoku) a eu le plus
d'importances. Puis, les éléments liés à la nature
ont également eu plus d'importances tant en terme de qualité de
vie qu'en terme de production matérielle (agriculture respectueuse de
l'environnement).
Ce résultat implique les deux manières de
définir l'agriculture, ainsi que des actions dans le Projet
Nô-Life, qui vont de pair dans les représentations des stagiaires
: d'un côté subjectif, car le prolongement de la stratégie
sur le long terme dans l'action des stagiaires, de l'autre objectif car c'est
la valeur statique et la vision idéale qu'ils ont tenté
d'exprimer.
Niveau réflexif de représentations :
pensée sur la politique collective
Enfin, les réponses obtenues pour la question 24
confirment le troisième niveau des représentations :
réflexive. Nous avons constaté qu'en somme, les
enquêtés ont des connaissances remarquables du mécanisme de
la réalité objective qui les entoure, et sont capables d'y
réfléchir. Et ils peuvent également mettre ces
connaissances en rapport avec des solutions à la situation de crise
agricole et alimentaire qui ne sont pas contradictoires avec leurs actions dans
la participation au Projet Nô-Life.
Nous avons vu la correspondance entre la vision commune des
stagiaires que nous avons induite à partir de
leurs idées exprimées en réponse à
la question 24, et la vision de base de la politique agricole de la
Municipalité de Toyota formulée dans le Plan fondamental de 96.
Il s'agit de renforcer l'autosuffisance alimentaire, la sécurité
alimentaire et la multifonctionalité ; développer au niveau local
la production et la consommation des produits de bonne qualité ; faire
participer les citoyens dans les activités agricoles. Nous entendons par
là, une convergence entre les raisonnements des agents institutionnels
du Projet Nô-Life et des stagiaires qui sont des acteurs individuels.
Puis, curieusement, cette vision pouvait bien se retrouver au niveau pratique
des stagiaires : souhait de mener une production à petite
échelle, et de réaliser une distribution à court circuit
(agriculture périurbaine).
Coexistance de représentations à plusieurs
niveaux
En induisant les trois niveaux des représentations
à partir du résultat de l'enquête par questionnaire, nous
trouvons une coexistance de représentations à plusieurs niveaux.
D'un côté, les stagiaires veulent réaliser d'autres choses
(autoproduction - consommation ; vie avec la nature ; agriculture non
productiviste ; c'est-à-dire respectueuse de l'environnement) que ce que
le Projet souhaite réaliser officiellement746, tout en
profitant des capitaux offerts par le Projet. Cette stratégie des
stagiaires est non seulement pensée sur le court terme, mais
distinguée sur le long terme, en se renforçant même au
niveau de leur vision idéale des choses.
Cependant, de l'autre côté, nous avons vu
apparaître, au niveau de la réflexion des stagiaires, une
convergence entre l'idée générale sous-tendant le Projet
Nô-Life et la politique agricole de la Ville de Toyota et l'idée
des stagiaires, qui peut finalement se retrouver dans les pratiques des
stagiaires eux-même.
Diversité et dynamique des
représentations
Résultat de l'enquête par entretien
Notre enquête par entretien individuels a
été effectuée auprès de 16 stagiaires des
années 2005-2007. Chaque entretien fut effectué de manière
intensive durant 30minutes à 1heure et demi par personne. Cette
enquête a été accomplie pendant tout le mois d'octobre
2006, période où les stagiaires des années 2005-2007
avaient accompli les trois quarts des activités de leur formation.
Les questions ont été posées sur les sept
points suivants à travers un an et demi d'expérience de la
formation Nô-Life747 : a. changements d'idées qui se
sont opérés au travers de la participation au Projet
Nô-Life ; b. différences entre leurs activités (mode de
vie) antérieures et actuelles, et leurs activités
ultérieures ; c. changement de vision sur l'agriculture, le type de
production envisagé après la formation et le problème
auquel ils sont confrontés concernant leurs activités agricoles ;
d. points de vue sur la vision de l'« agriculture de type Ikigai »
telle qu'elle est promue par le Centre Nô-Life ; e. points de vue sur le
rapport entre le Projet Nô-Life et le développement local (ou la
vie de la localité) ; f. bilan des activités de la formation
Nô-Life ; g. avis sur l'avenir (ou la continuation) du Projet
Nô-Life.
Cette enquête a été effectuée dans
le but de rechercher les enjeux des stagiaires à travers leur
participation à la formation Nô-Life non seulement au niveau de
l'action, mais également de la représentation des
éléments relevant de l'idée de l'agriculture de type
Ikigai promue dans le Projet Nô-Life.
Pour organiser nos entretiens, nous avons d'abord
établi 9 catégories comme ci-dessous pour repérer les
différents types de stagiaires selon les catégories objectives de
profils (sexe, âge, lieu d'origine et expérience agricole :
agriculteur ou non), ceci afin de rendre compte de la diversité des
enjeux au sein des stagiaires.
746 Nous mettons de côté maintenant la divergence
d'intérêts entre le BPA et la CAT : général
(bien-être de tous) et particulier - sectoriel (production agricole avec
but lucratif).
747 Liste des questions posées dans les entretiens se
trouve dans l'annexe 2.
Les 9 catégories objectives de profils des
stagiaires
Suite au constat du résultat de l'enquête par
questionnaire sur les catégories objectives de profils des stagiaires,
nous avons établi neuf catégories des stagiaires des
années 2005-2007 indiquées dans le tableau ci-dessous, selon les
quatre critères suivants : sexe (homme, femme) ; âge (jeune : 20 -
40 ans, âge moyen : 40 - 55 ans, âgé 55 - 65 ans) ; lieu
d'origine (Ville de Toyota ou non) ; foyer agricole ou non748.
Ainsi, nous avons intérrogé les 16 stagiaires dont chacun
correspond à une de ces catégories.
Tableau : 9 catégories des stagiaires
(années 2005-2007)
|
Sexe
( H/F)
|
Age
|
Lieu d'origine
|
Foyer agricole
ou non
|
Nbre de pers
intérrogées
|
|
1
|
H
|
Age moyen
|
Toyota
|
non agricole
|
3
|
|
2
|
H
|
Agé
|
Toyota
|
agricole
|
5
|
|
3
|
H
|
Agé
|
Toyota
|
non agricole
|
1
|
|
4
|
H
|
Agé
|
Non Toyota
|
non agricole
|
2
|
|
5
|
F
|
Jeune
|
Toyota
|
agricole
|
1
|
|
6
|
F
|
Age moyen
|
Toyota
|
non agricole
|
1
|
|
7
|
F
|
Age moyen
|
Non Toyota
|
non agricole
|
1
|
|
8
|
F
|
Agée
|
Toyota
|
agricole
|
1
|
|
9
|
F
|
Agée
|
Non Toyota
|
non agricole
|
1
|
Caractéristiques des données :
représentations sociales en jeu
Approche subjectiviste
Le résultat de l'enquête par entretien nous
permettra surtout de comprendre les représentations portées par
les stagiaires, qui peuvent souvent échapper aux tendances
générales. Et ceci non dans le sens du détail des faits,
mais dans celui de la diversité des enjeux.
Si l'enquête par questionnaire nous a montré les
attentes potentielles et plutôt initiales des stagiaires vis-à-vis
du Projet Nô-Life, l'enquête par entretien va nous montrer les
changements de ces attentes « en action » à travers leur
vécu du Projet, c'est-à-dire leur expérience de la
formation Nô-Life. Et ces changements nous permettront d'analyser les
représenations en jeu portées par les stagiaires dans le
déroulement du Projet Nô-Life.
Relevons ici une série de caractéristiques dont il
faut tenir compte dans notre analyse des données recueillies par cette
enquête par entretien.
D'abord, la description du passé des stagiaires que
nous effectuerons plus bas, peut prendre la forme d'un récit de vie (ou
histoire de vie) rendu intelligible par ordre chronologique, mais l'objectif de
notre analyse n'est pas d'appréhender la vie des enquêtés
comme fin (ou aboutissement, accomplissement) de leur histoire de vie
construite de manière uniquement linéaire. Comme P. Bourdieu a
établi la notion de « trajectoire », nous pouvons concevoir
cette approche comme une « série de positions successivement
occupées par un même agent
748 En raison de l'absence ou de la présence faible de
stagiaires correspondants, les types suivants ont été exclus de
nos catégories : homme jeune ; homme d'âge moyen originaire de la
Ville de Toyota venant d'un foyer agricole ; Homme d'âge moyen non
originaire de la Ville de Toyota ; femme jeune originaire de la Ville de Toyota
venant d'un foyer agricole ; femme jeune non originaire de la Ville de Toyota ;
femme d'âge moyen non originaire de la Ville de Toyota venant d'un foyer
agricole ; femme âgée
originaire de la Ville de Toyota venant d'un foyer non agricole ;
femme âgée non originaire de la Ville de Toyota venant d'un foyer
agricole.
(ou un même groupe) dans un espace lui-même en
devenir et soumis à d'incessantes transformations749
».
A partir de ce point de vue-là, notre analyse vise
à atteindre l' « ancrage » social des individus, ce qui nous
permettra d'appréhender les représentations sociales au sein des
stagiaires enquêtés sur leur participation au Projet
Nô-Life, le Projet Nô-Life, et l'agriculture et la
ruralité.
Puis, en contraste avec l'analyse précédente du
résultat de l'enquête par questionaires, l'analyse du
résultat de l'enquête par entretien mettra davantage en avant la
subjectivité des enquêtés qui peut être à la
fois inscrite dans l'interactivité par rapport à la situation
locale du Projet Nô-Life, et influencée par la contingence comme
des évènements extérieurs ou imprévus pour les
enquêtés.
Compte tenu de ces aspects que nous venons de relever comme
caractéristiques du résultat de l'enquête par entretien
(trajectoire, subjectivité, interactivité, situation locale,
contingence), il faudra donc analyser les représentations ni à
partir des catégories objectives ni à partir de leurs tendances
générales, mais à partir de leurs catégories
subjectives et des tendances spécifiques. Et ceci nous demandera ensuite
d'appréhender ces représentations sans les dissocier de leurs
propres contextes socio-spatio-temporels.
Statut des catégories objectives : non
représentatif, mais descriptif
Nous devons alors expliquer pourquoi nous avons ici
intégré les neufs catégories objectives des stagiaires
dans cet examen du résultat de l'enquête par entretien. Ceci
d'abord non pas en les considérant comme facteurs déterminants
des représentations des stagiaires, mais pour une raison pratique dans
le cadre de la réalisation de cette enquête par entretien : il
s'agissait de repérer et d'interroger le plus possible les
différents types de stagiaires parmi ceux des années
2005-2007.
Autrement dit, nous avons utilisé ces catégories
préétablies à partir de notre constat de la situation en
place avec le résultat de l'enquête par questionnaire et
l'observation-participante effectuée par l'enquêteur, comme
prétexte pour intégrer le plus possible la diversité des
traits des stagiaires dans notre description.
Ce qui nous amène à dire que nous ne
présupposons pas nos 16 enquêtés comme
représentatifs de tous les stagiaires correspondants chacun à
leurs catégories objectives. Par exemple, une personne de la
catégorie 5 ne représente pas forcément toutes les autres
personnes correspondantes à cette catégorie.
En plus, nous devons relever une limite de notre enquête
par entretien : les neufs catégories dont nous nous sommes servis pour
mener nos entretiens, n'ont pas pu être tout-à-fait
exhaustives.
Par exemple, nous savons qu'il y avait un homme de 28ans parmi
les stagiaires des années 2005-2007, qui avait pour objectif de devenir
agriculteur professionnel après la formation Nô-Life. Ce qui
échappe déjà à nos neuf catégories
objectives. Même s'il est le seul stagiaire de moins de 30 ans parmi ceux
des années 2005-2007, cela nous aurait intéressé de
l'interroger. Cependant, nous n'avons malheureusement pas eu la chance de le
joindre, en raison de sa disponibilité qui était relativement
moins importante que les autres. Pourquoi ? Parce que, dès sa
première année dans la formation Nô-Life, par
l'intermédiaire du Centre Nô-Life, il a trouvé une
exploitation en agriculture biologique dans la Ville de Toyota qui l'a
accepté comme employé - stagiaire à temps plein. Du coup,
il n'a pas eu besoin d'effectuer son stage individuel dans une parcelle
attribuée par le Centre Nô-Life, ce qui fait qu'il
fréquentait moins souvent le Centre. De plus, il était habitant
de la Ville de Nagoya (30 - 40 km de la Ville de Toyota)750.
Quatre grilles de lecture des entretiens
L'examen des réponses pour les questions a., b., et c.
nous permettra de voir les trajectoires et les choix
749 Selon P. Bourdieu, « les évènements
biographiques se définissent, comme autant de placements et de
déplacements dans l'espace social, c'est-à-dire, plus
précisément, dans les différents états successifs
de la structure de la distribution des différentes espèces de
capital qui sont en jeu dans le champ considéré. Le sens des
mouvements conduisant d'une position à une autre (...) se
définit, de toute évidence, dans la relation objective entre le
sens au moment considéré de ces positions au sein d'un espace
orienté ». (Bourdieu, 1994 : 88-89)
750 D'ailleurs, en théorie, les profils des stagiaires
peuvent différer d'une année sur l'autre : un jour,
peut-être, un jeune étudiant d'une faculté d'agronomie
viendra-t-il participer à la formation Nô-Life ? Ou bien, un
immigré japono-brésilien travaillant dans une usine de
sous-traitance de l'Automobile Toyota ? Ou encore, un médecin, un
avocat, un cadre retraité de l'Automobile Toyota ?
d'activités opérés par les stagiaires.
Puis, l'examen des réponses pour la question d. nous permettra de voir
la prise de position des stagiaires vis-à-vis de la vision de
l'agriculture de type Ikigai proposée par le Projet Nô-Life.
Enfin, l'examen des réponse les questions e. f. g. va montrer les
réflexions des stagiaires sur le devenir du Projet Nô-Life
lui-même en terme de : sa place dans le développement local (e);
le bilan des activités de la formation Nô-Life (f); l'avenir du
Projet Nô-Life751. Nous présenterons ci-dessous en
quatre tableaux suivants la synthèse du résultat des
entretiens.
Tableaux de la synthèse des entretiens
Tableau de la synthèse 1 : catégorie
1
M. Nichizawa M. Katô M. Itô
|
Catégories
objectives
|
1 : homme d'âge moyen, originaire de la Ville de
Toyota - foyer non agricole
|
|
Trajectoire et
motivation
principale
|
Traj. : 43 ans ; situation précaire ; exp. agri.
: culture légumes en pot, pr ès de 10 ans.
Motiv.: passion ; objectif professionnel
|
Traj. : 40 ans ; situation précaire ; exp. agri.
: un peu de jardin potager ; problème mental
Motiv.: passion (riziculture) ; auto- consommation
|
Traj. : 43 ans ; carrières diverses
(salarié, petit entrepreneur)
Motiv.: s'impliquer dans le monde agricole et rural ;
prod. figues ; contribution au dév. rural.
|
|
Changement didé
es, activités et
mode
de vie
|
Idées : pas de grand changem. ; motiv.
identitaire (toute sa vie) ; choix prod. fraises pour revenu ; contraintes
économ. pour invest..
Vie : santé améliorée.
|
Idées : pas de changem. ; plaisir d'autoconsom. ;
chaleur humaine ; liberté ; souhait achat terrains ; souhait culture
sans traitement chimique ; contrainte économ. (chert é de
terrain)
Vie : pas de changem. ; problème de
dépression (été 2006)
|
Idées : pas de prod. figues ; constat crise
agricole (vieillissem., durabilité) ; volonté monter une
association de stagiaires Nô-Life ; passion ; intérêt
à long terme
|
|
Prise de position vis-à-vis de
l'agricult. de type Ikigai
|
Objectif d'un million de yens :
accord.
Idée Ikigai : accord (passion,
intérêt à long terme)
|
Objectif d'un million de yens : relativiste ("chacun son
objectif").
|
Vieillissem. : Projet est lié à son
problème de 10-15 ans après.
Idée Ikigai : accord (motiv. identitaire et
sociale, intérêt à long terme)
|
|
Réflexions sur le devenir du Projet Nô
-Life
|
Bilan : cela dépend des résultats (devenir
professionnel ou pas) ; insuffisance de la format. (quantité de
cours).
|
Rapport au dév. local : souhaitable ; Projet
pas assez connu par le public. Avenir du Projet : continuation
né
cessaire.
|
Rapport au dév. local : Projet doit constituer un
réseau ; insuffisance format. (connaissance approfondies).
Avenir du Projet : continuation né cessaire ;
pour cela, il faut créer un r éseau de coopération.
|
751 Dans l'annexe 3, nous avons présenté la
synthèse des entretiens effectués avec les stagiaires des dix
catégories selon quatre grilles de lecture suivantes : 1 Trajectoire et
motivation initiale ; 2 Changement d'idées, activités et mode de
vie (questions a. ; b. ; c.) ; 3 Prise de position vis-à-vis de
l'agriculture de type Ikigai (question d.) ; 4 Réflexions sur le devenir
du Projet Nô-Life (question e. ; f ; g.).
Tableau de la synthèse 2 : catégorie
2
|
M. Shimizu
|
M. Kobayashi
|
M. Imai
|
M. Shioya
|
M. Isomura
|
2 : homme âgé - originaire de la Ville de
Toyota - foyer agricole
Changement
d'idées, activité
s et
mode de
vie
Idées : pas de grand
changem. ; constat difficulté de vente ; plaisir de
produire. Vie : pas de grand changem. ; santé
améliorée.
Catégories
objectives
|
Trajectoire et
motivation
principale
|
Traj. : 66 ans ; fils aîné d'agriculteur ;
exp. agri. : très peu dans la jeunesse ; culture Kaki commencée
à l'âge de 58ans) ; salariés (18-60ans) ; retraite ;
succession obligée Motiv.: recherche de successeurs de ses
activ. agricoles ; maintien de biens familiaux.
Traj.: 54 ans ; fils aîné d'agriculteur ;
salarié (-53ans) ; exp. agri. : aide des parents ; perte de
l'épouse ; incendie (perte des parents) ; pré retraite et
succession obligée. Motiv.: maintien et transmission des biens
agricoles familiaux.
Idées : pas de changem. de vision ; étre
plus sûr de sa compétence ; forme de
prod. ne changera pas : autoconsom. sans
vendre les produits (sauf du riz) ; problè me : liberté
limitée par la politique agricole (ex. réduction de la surface
rizicole)
Vie : activ. agricoles devenues principales ; nouveaux
loisirs li és aux activ. agricoles (ex. soba)
Traj. : 57 ans ; fils aîné d'agriculteur
pluriactif ; exp. agri. : aide des parents ; salari é (poste) ;
préretraite obligée (maladie de son père) ; succession
obligée (décès de son beau frère)
Motiv.: maintien de biens agricoles familiaux.
|
Idées : être plus sûr de sa
compétence ; encouragé par d'autres stagiaires "de même
type" que lui ; pas de grand changem. de vision ; autoconsom. sans vendre les
produits (sauf du riz) ; intention réduction - simplification de
traitements chimiques.
Vie : activ. agricoles devenues principales.
|
|
Traj.: 61ans ; fils cadet d'agriculteur ;
héritage partiel de biens agricoles familiaux ; arrêt de prod.
depuis une trentaine d'années ; salarié
(1 8-60ans, Automobile Toyota) ; exp. agri. : un peu ; retraite.
Motiv.: maintien de biens familiaux ; pour loisir.
|
Idées : agricult. comme loisir, non prioritaire
par rapport à d'autres loisirs ; plaisir de cultiver ; style de vie ;
pas de grand changem. de vision ; multifonctionalité de l'espace
agricole ; forme de
prod. ne changera pas ; contrainte é
conom. (pression foncière). Vie : pas de grand changem..
Plaisir de cultiver et autoconsommer avec son é pouse.
|
Traj.: 56 ans ; originaire d'un village moyenne
montagne ; gendre dans un foyer agricole ; salarié (caserne de pompiers)
; exp. agri. : un peu d'aide de son beau père ; préretraite
(54ans)
Motiv.: maintien de biens agricoles familiaux.
|
Idées : étre plus sûr de sa
compétence ; intérêt à l'é ducation
alimentaire ; constat importance des connaissances scientifiques ; forme de
prod. adaptée aux terroirs ; remarque critique sur le système
l'entremise de terrains (il faut tenir compte de l'attitude égoïste
de proprié taires ruraux qui risque de faire obstacle au
système)
Vie : activ. agricoles devenues principales ; distrib.
de lé gumes à la vente directe ; un autre rythme de vie que la
vie salariale.
|
Prise de
position vis-à-
vis
de
l'agriculture de
type Ikigai
|
|
Réflexions sur
le devenir du
Projet
Nô-Life
|
|
Vieillissem. : problème succession de ses
activ. s'imposera.
Objectif un million de yens : impossible et
inacceptable Idée Ikigai : accord (qch indé finissable,
ni pour loisir ni pour santé)
|
|
Rapport au dév. local : bons effets sûrs
(identité agricole de la Ville).
Bilan : il a bien appris les techniques ; il
était bien
assidu.
Avenir du Projet : continuation nécessaire avec
un é largissement du Centre NôLife.
|
|
Vieillissem. : problème de succession de ses
activ. s'imposera.
Objectif un million de yens : accord (former les
porteurs) Idée Ikigai : accord. (pour la transmission des
biens
agricoles familiaux, l'agricult. ne constitue pas Ikigai en lui-m
ême)
|
|
Rapport au dév. local : décisif. Car
l'agricult. est basée sur sa localité, bon impact sur
l'urbanisation
Bilan : il a bien appris les techniques ; trop de
traitements chimiques coûteux dans la format. ;
intérrogation sur la recherche de rentabilité ; douteux que
beaucoup de stagiaires deviennent porteurs.
|
|
Objectif Nô-Life : il ne correspond pas au type
"porteur" de l'agricult. Objectif un million de yens : trop
contraignant.
Idée Ikigai : agricult. n'est pas Ikigai, mais
plutôt une obligation par rapport aux biens familiaux.
|
Rapport au dév. local : Autour de lui,
très peu de personnes continuent leurs activ. agricoles. Les gens de
foyers non agricoles sont plus motivé es que ceux de foyers agricoles.
Projet doit se focaliser sur les personnes ayant les marges
économ. et temporelle pour
développer l'agricult. de type Ikigai.
Avenir du Projet : continuation nécessaire ; il
serait bien d'ajouter des enseignements sur l'agricult. biologique.
Objectif Nô-Life : c'est bien pour animer les
personnes âg ées ; lui-même ne correspond pas au type de
producteurs d'Ikigai ayant pour but de dé gager un revenu agricole
Idée Ikigai : faire ce que l'on aime ; loisirs
variés selon les â ges.
|
Rapport au dév. local : Pas de
réputation sérieuse du Projet au sein de la population locale
Bilan : manque
d'enseignements sur l'entretien des cultures
Avenir du Projet : il risque d'ê tre
éphémère, cela dépend des attentes des citoyens.
|
Objectif un million de yens : trop contraignant ;
difficulté de faire appel aux salariés retraité s,
lié à leur tendance d'être dé pendant de
l'entreprise et de la vie salariale.
Idée Ikigai : une préoccupation importante
pour sa vie. ("pourquoi vivre ?")
|
Rapport au dév. local : il faudrait créer
une zone réserv ée aux paysans.
Bilan : manque d'enseignements sur l'entretien des
cultures.
Avenir du Projet : continuation nécessaire. Il
faudrait créer un rapport de confiance avec les propriétaires
ruraux.
|
Tableau de la synthèse 3 : catégorie 3 -
4
|
M. Naruse
|
M. Suzuki M. Kamihata
|
|
Catégories
objectives
|
3 : homme âgé - originaire de la
Ville
de Toyota - foyer non
agricole
|
4 : homme âgé - non originaire de la Ville
de Toyota - foyer non
agricole
|
|
Trajectoire et
motivation
principale
|
Traj.: 55 ans ; ingénieur informatique
à Yokohama ; préretraite (maladie de ses parents) ; exp. agri. :
un peu de jardin potager ; aller à Tôkyô une fois par mois
pour un travail temporaire Motiv. : autoconsom. ; plaisir.
|
Traj.: 63 ans ; fils d'agriculteur à Shizuoka,
installation à Toyota pour son travail (18ans - aujourd'hui, Automobile
Toyota) ; construction maison individuelle à Toyota (25 ans) ; perte de
son épouse (42 ans) ; rêve de la vie paysanne à l'âge
de 50 ans (autoprod. - consommat. dans la montagne) ; demi-retraite (60ans)
Motiv. : "faire qch" pour faire face à la crise de
l'arboricult. de Toyota.
|
Traj.: 60 ans ; fils aîné d'agriculteur
à Kagoshima ; reprise exploitation parentale (18ans) ; divers boulots
à l'extérieur ; réussite "agricult. de sept chiffres" les
années 60 ; trois ans de maladie suite au surtravail (25ans) ;
travailler à Tôkyô dans une épicerie (quelques
années) ; ouverture supermarché indépendant à
Nagoya (trois ans) ; salarié une chaîne locale de
supermarché (pour régime pension d'entreprise) ; demi-retraite
(60ans).
Motiv : réalisation objectif "agricult. de sept
chiffres" après sa retraite.
|
|
Changement d'idé
es, activités et
mode
de vie
|
Idées : hésitation entre vente et
autoconsom., liée aux contraintes marché ; souhait d'apprendre
mé thode bio ; continuation méthode enseignée par la
format. ; plaisir de produire.
Vie : pas de grand changem. d'activ. ; activ. agricoles
devenues de plus en plus dominantes ; sa famille favorable à la
coopération à ses activ. agricoles ; le fait d'aller à
Tôkyô une fois pas mois lui permet de "ne pas trop s'attacher
à la campagne"
|
Idées : envie d'"arrêter" la format.,
lié e à trop grandes contraintes de l'arboricult. ; discussion
avec M.Itô sur l'idée de monter une association de stagiaires de
Nô-Life ; hésitation sur ses activ. après la format. ;
soucieux de l'avenir de l'agricult. japonaise.
Vie : il trouve une "plénitude" dans sa vie ;
d'autres occupations (loisirs, responsabilité pour sa
localité)
|
Idées : objectif réalisation "agricult. de
sept chiffres" ; plan entreprise agricole familiale ; il appelle sa tentative
agricole "agricult. réflexive (kangaeru nôgyô)" par
opposition à l'agricult. de type industriel et élitiste ;
après la format., louer plus de 0.1ha en plaine et entrer dans le
groupement de producteurs d'aubergines.
Vie : travailler tous les jours ; 0.05ha de terrains
déjà loués dans une zone de moyenne montagne ; il a
distribué ses légumes (ses familles, amis et connaissances, vente
directe à Toyota).
|
|
Prise de position vis-à-vis de
l'agricult. de type Ikigai
|
Objectif Nô-Life : "une bonne chose" pour lui, qui
lui permi une activité à long terme
Idée Ikigai : Il la pense en terme de ses activ.
agricoles à long terme.
|
Objectif un million de yens : c'est une idée pour
les professionnels, pas pour les retraités ; ne plus croire à
l'idée initiale du Projet Nô-Life ; inté rrogation :
"comment aller plus loin que le niveau de jardin potager (dans la pratique
agricole après la retraite) ?"
Idée Ikigai : important (une vie diffé
rente que la vie salariale).
|
Objectif un million de yens : cela correspond au sien.
Mais constat diff érence par rapport à beaucoup d'autres
stagiaires intéressés par l'autoconsom..
Idée Ikigai : important (contribution au
dév. local via ses activ. agricoles)
|
|
Réflexions sur le devenir du Projet Nô
-Life
|
Rapport au dév. local : il dépendra de la
motiv. des salariés retraités ; continuité urbain-rural et
intérêt de la population à la prod. font caracté
ristiques de la Ville de Toyota
Bilan : il a bien obtenu les
techniques et des camalades.
Avenir du Projet : continuation né cessaire ; il
faudrait plus de choix de catégories dans la format..
|
Avenir du Projet : il faut clarifier la vision de fond
du Projet, sinon il risque de décliner.
|
Bilan : très satisfait de la format..
|
Tableau de la synthèse 4 : catégorie 5 -
9
Mme. Konno Mme. Tsuzuki Mme. Kawamura Mme. Katô
Mme. Mizutani
|
Catégories
objectives
|
5 : femme jeune - originaire
de la Ville de Toyota -
foyer
non agricole
|
6 : femme d'âge moyen -
originaire de la Ville
de
Toyota - foyer agricole
|
7 : femme d'âge moyen, non
originaire de la
Ville de
Toyota, foyer non agricole
|
8 : femme agée, originaire
de la Ville de
Toyota, foyer
agricole
|
9 : femme agée, non
originaire de la Ville
de
Toyota, foyer non agricole
|
|
Trajectoire et
motivation
principale
|
Traj.: 35 ans ; travail (après lycée) ;
mariage ; accouchement enfants ; refus de devenir "bonne femme à temps
partiel, afin d'"avoir un territoire de soi-même"; réfé
rence aux "mères des années 55-65"
Motiv.: volonté de faire l'agricult. son
"métier pour toute la vie".
|
Traj.: 48 ans ; mariage avec un agriculteur
pluriactif (27ans) ; femme au foyer ; exp. agri. : un peu d'aide de sa belle
mère ; chargé du ménage et de ses trois enfants (dont l'un
est parti pour aller à l'univ.)
Motiv .: pas de raison particuliè re ;
circonstanciel : "comme il y a des rizières et des champs (chez
elle)"
|
Traj.: 55 ans ; originaire d'une famille grossiste de
bois jardinage à Inazawa ; travail chez un fleuriste,
installation à Toyota ; mariage avec un
salarié de l'Automobile Toyota (28, 9ans) ; ouverture d'un magasin
de fleurs indépendant (pendant 25ans) ; divorce et fermeture magasin (il
y a
5ans) ; exp. agri. : jardins potagers (depuis une dizaine
d'années) ; employée à temps partiel (usine de mayonnaise)
; arrêt de travail (maladie de sa mère) ; chômage ;
chargée par sa fille ; "prête à commencer" ses activ.
agricoles.
Motiv .: passion (culture maraî chère) ;
obtention de revenu supplémentaire ("argent de poche de tous les jours")
; prod. de figues.
|
Traj.: 60 ans ; fille aînée d'une
famille agricole pluriactive ; exp. agri. : un peu d'aide des parents ;
salarié (éducation permanente) ; mariage avec un fils d'une
famille non agricole à proximité de chez elle ; son mari
était fonctionnaire (préfecture) ; retraite (60ans). Son petit
frère a hérité les biens agricoles familiaux. prod.
confiée à une entreprise agricole.
Motiv .: occupations après la retraite ; soit
une grande prod. de fraises en serre avec son fils en chômage, soit une
prod. maraîchère avec son mari pour le plaisir.
|
Traj. : 63 ans ; fille d'une
famille de pêcheur à Mie ; rêve d'une vie
rurale et montagnarde ; installation dans la Ville de Toyota après son
mariage avec un technicien du secteur automobile ; travail en tant qu'aide
familiale ; problème de la relation humaine ; exp. agri. : jardin
potager depuis la retraite du mari ; problème du chômage de son
fils cadet Motiv. : souhait de retrourner au pays natal pour mener des
activ. agricoles avec sa
famille.
|
|
Changement
d'idées, activité
s et
mode de
vie
|
Idées : de la prod. de pêches à
celle de légumes ; pas sûr de conditions de terrains agricoles
à louer.
Vie : grand changem. (vie bas ée sur "cycle de la
nature") ; beaucoup plus de temps libre qu'avant (quand elle travaillait) ; son
mari et ses enfants peuvent l'aider ; grand changem. de vision : "tout a
changé", auparavant, l'agricult. n'avait aucun sens pour elle.
|
Idées : pas de grand changem. ; motiv.
relativement faible pour les activ. agricoles, liée à d'autres
occupations ; non intention de s'investir plus dans le domaine agricole,
liée au manque de temps ; pas de changem. de vision ; autoconsom. sans
vendre les produits (sauf du riz) ; forme de
prod. ne changera pas.
Vie : pas de changem..
|
Idées : intention de cultiver les aubergines
au lieu de figues, li ée à la difficulté du
traitement maladie de figues ; distinguer la méthode enseignée
dans le Centre Nô-Life, et la méthode de type écologique ;
condition de la suface minimum de la
location (0.1 ha) est contraignante ; souci sur la
main-d'oeuvre.
Vie : pas de grand changem. : activ. agricoles
étaient déjà principales quand elle travaillait à
l'usine ; apprentisage et tentative de pratiques
agricoles de type écologique.
|
Idées : utilisation prévue de terrains de
sa famille natale, pour la prod. de fraises en serre ; constat
difficulté d'obtenir un revenu agricole ; utilisation du prêt
agricole dé partemental paraît très risquée :
d'où son hésitation (prod. commeciale ou prod. pour
autoconsom.).
Vie : sa relation conjugale am éliorée via
ses activ. de la format. (activ. communes)
|
Idées : épargne pour son invest. futur
dans l'agricult. ; location de terrains envisagée à Toyota ;
changem. de vision : rapport avec le temps qu'il fait ; difficulté de
cultiver du riz sans traitement chimique ; forme de prodution : prod.
diversifiée (riz et légumes), transformat. variée et vente
; problème de financement ; son fils n'est pas motivé par les
activ. agricoles.
Vie : amélioration santé physique
(ménopause) et mentale (relation humaine) ; animation de la relation du
voisinage.
|
|
Prise de position vis-à- vis de l'agricult. de
type Ikigai
|
Objectif Nô-Life : "trop tard" de s'y investir
après 60ans, car contraintes
économ. et physique ; succession
des activités en question ; place privilégiée pour les
jeunes mè res.
Idée Ikigai : important (trouver le plaisir et
l'occupation à long terme pour les mères)
|
Objectif Nô-Life : son objectif n'est pas la
vente
Idée Ikigai : sa participation à la
format. n'est pas pour Ikigai, mais "par hasard".
|
Objectif d'un million de yens : impossible à
réaliser.
Idée Ikigai : Accord (agricult. est un des choix
pour cela).
|
Objectif un milion de yens :
impossible à réaliser. Le prêt agricole
départemental est une grande contrainte.
Idée Ikigai : accord (occupations après la
retraite)
|
Objectif Nô-Life : vieillissem. (population) et
délabrement (agricult.) sont très présents dans sa vie
Objectif un milion de yens : impossible
à réaliser.
|
|
Réflexions sur le devenir du Projet
Nô-Life
|
Rapport au dév. local : il n'est pas facile
à penser : car en ré alité, les femmes au foyer sont pas
assez sensibles à ce
sujet (crise agricole, consommation de produits de terroir
etc)
|
Rapport au dév. local : Projet est
objectivement "une bonne chose" pour la Ville de Toyota (vieillissem. de la
population et délabrement de l'agricult.) ; sa participation au
Projet
n'influencera pas les autres foyers agricoles, car l'atitude de
la population des ces
foyers est relativiste.
Bilan : elle a bien appris dans la format., et elle
veut encore la continuer.
Avenir du Projet : continuation nécessaire ; s'il
se dé veloppera petit à petit, c'est bien.
|
Rapport au dév. local : bon effet. Toyota est
un
"magnifique lieu" comme campagne.
Bilan : très satisfait de la format. ; elle lui a
permi des "r êves" pour réaliser de
nouvelles choses basées sur la réalité du
monde agricole. Avenir du Projet : continuation nécessaire ; il
manque dans le Projet le dialogue entre les amateurs et les experts de
l'agricult. ; il faut concerter plus les stagiaires.
|
Rapport au dév. local : amé lioration
de la communication entre habitants locaux.
Bilan : sa relation conjugale améliorée ;
insuffisante de la format. pour s'investir dans une grande prod. ; d'où
l'ambiguïté de la format. entre le professionalisme et le
amateurisme
Avenir du Projet ; il faut clarifier la cible du Projet
en ré pondant aux diverses demandes des stagiaires ; il faut que les
stagiaires donnent plus d'avis au Centre Nô-Life.
|
Rapport au dév. local : le nbre de personnes
intéressées par ce Projet est insuffisante par rapport à
la taille de la Ville. Bilan : très satisfaite de la
format..
Avenir du Projet : continuation nécessaire ; il
faut intensifier plus la format. ; il faut que les salariés
retraités se mettent le plus tôt possible à cultiver la
terre pour la durabilité. Il faut contribuer à renforcer
l'autosuffisance alimentaire au niveau local.
|
(La liste d'abréviations. activ. :
activités. ; agricult. : agriculture ; arboricult. : arboriculture ;
autoconsom. : autoconsommation ;
changem. : changement ; dév. :
développement ; distrib. : distribution ; économ. :
économique ; exp. agri. expériences agricoles ;
format.:
formation ; invest. : investissement ; motiv. : motivation ; traj. :
trajectoire ; prod. production ; vieillissem. :
vieillissement)
Analyse des entretiens
Dans notre anlalyse du résultat de l'enquête par
entretien, nous allons tenter, à partir de la synthèse des
entretiens présentée plus haut, de mettre en évidence les
ressemblances et les dissemblances entre les réponses obtenues. Et cette
analyse se répartira sur les cinq niveaux suivants qui reprennent, en
fait, les quatre grilles de lecture utilisées dans la synthèse
des entretiens : trajectoire ; motivation initiale ; changement d'idées,
d'activités et de mode de vie ; prise de position vis-à-vis de
l'agriculture de type Ikigai ; réflexion sur le devenir du Projet
Nô-Life.
Ces cinq niveaux impliquent également les moments
diachroniques de la vie des stagiaires dans le Projet Nô-Life, à
savoir : 1 trajectoire désigne les expériences
passées qui précèdent la participation à la
formation Nô-Life ; 2 motivation initiale se traduit par
l'intention ou l'objectif initial pour la participation ; 3 changement
d'idées montre comment les stagiaires ont vécu le Projet
Nô-Life ; 4 prise de position de chaque stagiaire est le reflet
de leurs points de vue plus ou moins déterminé de
l'intérieur sur les principes du Projet ; enfin, 5
réflexion sur le devenir du Projet Nô-Life montre le
point de vue distancié et final sur l'ensemble du Projet.
Cinq moments de la vie des stagiaires dans le Projet
Nô-Life
|
Avant la
formation
|
Avant et pendant
la formation
|
Pendant la formation
|
Pendant et Après
la formation
|
|
Trajectoire
|
Motivation initiale
|
Changement
d'idées
|
Prise de position
|
Réflexion
|
|
Expériences
passées
|
Objectif initial
|
Vécu du Projet
|
Point de vue
déterminé
de
l'intérieur
|
Point de vue
distancié et final
|
Quels liens pouvons-nous établir entre les
répartitions des éléments des réponses se trouvant
sur ces cinq niveaux ? Y a-t-il des groupes porteurs de représentations
spécifiques ? Pouvons-nous trouver dans ces représentations une
convergence ou une divergence ?
1 Trajectoires : au delà des catégories
socio-professionnelles objectives... Complexité derrière une
ressemblance générale
Concernant les trajectoires des enquêtés, nous
pouvons trouver une ressemblance au niveau socio-professionnel. Sans pouvoir
clarifier en détails les couches socio-professionnelles des
enquêtés, faute d'avoir les données précises sur
certains aspects déterminants (revenus, statuts etc), nous pouvons dire
qu'il n'y a pas de grands écarts entre les enquêtés au
niveau des couches socio-économiques. D'ailleurs, nous avons
constaté cette caractéristique dans l'analyse du résultat
de l'enquête par entretien sur les expériences professionnelles de
tous les stagiaires de Nô-Life.
En effet, sauf M. Naruse qui était ingénieur
informatique dans une grande entreprise électronique (Mitsubishi)
à Yokohama, la plupart des personnes ont occupé des professions
du niveau moyen comme salariés moyens, fonctionnaires et petits
indépendants. Cependant, deux hommes d'âge moyen font exception :
M. Nichizawa et M. Katô étaient des ouvriers, et ces
dernières années ils sont dans une situation précaire
(quatre ans pour M. Nichizawa, un an pour M. Katô). A part ces trois
enquêtés, personne n'a occupé de manière permanente
des professions, tels que : agriculteur professionnel, ouvrier, cadre,
profession intellectuelle supérieure et profession libérale
etc.
Toutefois, les aspects ont tendances à être plus
complexes en terme de la pluriactivité présente parmi les
enquêtés des deux types suivants : (ex-) agriculteurs pluriactifs
; femmes.
Quant aux cinq hommes originaires d'un foyer agricole de la
Ville de Toyota, c'est-à-dire ceux qui étaient des «
agriculteurs pluriactifs », deux étaient fonctionnaires locaux (M.
Shimizu, M. Isomura), deux autres postiers (M. Kobayashi et M. Imai) et l'un
salarié de l'Automobile Toyota (M. Shioya). Ces cinq hommes ont
mené une vie salariale, sans devoir se consacrer pour la majeure partie
de leur vie aux travaux agricoles.
Quant aux cinq femmes, leurs maris étaient (ou sont
encore) des salariés du niveau moyen. Parmi elles, une femme au foyer
(Mme. Tsuzuki), une salariée retraitée (Mme. Katô), deux
qui ont travaillé à temps partiel tout en étant femme au
foyer (Mme. Konno, Mme. Mizutani), et l'une a connu le divorce et perdu son
métier de fleuriste il y a cinq ans à l'âge de 50 ans, et
s'est ensuite retrouvée dans une situation précaire (Mme.
Kawamura).
Puis, nous devons également tenir compte de l'impact de
la prise de retraite sur la vie des enquêtés retraités (ou
en semi-retraite). Bien entendu, le contexte du Projet Nô-Life s'inscrit
dans celui du vieillissement actif752 où la retraite ne
signifie plus immédiatement la vieillesse ou le retrait de la
société ou le « repos », mais, comme le propose
récemment M. Legrand, sociologue française du vieillissement, la
« question de l'identité individuelle et collective »
posée par un « vide » dans un contexte de «
dévaluation de l'âge »753. Ce qui nous conduit
à accorder une place importante au « mode de recomposition
identitaire » qui passe par « un long cheminement fait
d'essais et erreurs, de tâtonnements, qui renvoie à la question du
sens du vieillir »754. Nous pouvons partager ce point de
vue européen pour notre analyse du processus du Projet Nô-Life
dans lequel, les « jeunes retraités » sont censés jouer
un rôle important, et puis, comme nous l'avons vu dans le Chapitre 2 avec
l'acteur 2 : SCI (Section de la Création d'Ikigai), la thématique
d'Ikigai fut introduite comme un domaine légitime de la politique du
vieillissement dans les collectivités territoriales japonaises avec
l'entrée en vigueur de la « Loi sur l'Assurance des Aides aux
Personnes âgées dépendantes (Kaigo-Hoken Hô) »
en 2000 au niveau national.
En bref, chaque enquêté a ses traits particuliers
dans sa trajectoire dont on ne peut nier les liens avec les quatre
catégories objectives que nous avons établies (homme/femme ;
âge ; lieu d'origine ; foyer agricole ou non). Ce qui nous oblige
à prendre en compte la complexité de l'histoire et la
circonstance de la vie de chacun.
Pour nous éclaircir sur ce point, nous pouvons ici
rappeler l'histoire turbulente de la vie de M. Kamihata dans ces quarante
dernières années : vie en tant qu'exploitant agricole pluriactif
à Kagoshima (1962-1969) ; réussite de son exploitation familiale
; trois ans de maladie ; installation à Tôkyô pour
travailler dans une épicerie (1972-) ; ouverture d'un supermarché
indépendant à Nagoya ; fermeture volontaire de son
supermarché trois ans après l'ouverture ; employé dans une
chaîne locale de supermarché ; semi-retraite (2005-) ;
participation à la formation Nô-Life...
Tout d'abord, la trajectoire de M. Kamihata échappe
à nos catégories stéréotypées : points de
vue, soit misérabilistes sur la paysannerie (misère,
émigration, prolétarisation etc.), soit généraux
sur la modernisation agricole (entrepreneur agricole) qui sont marqués
par de simples visions économiques réductrices à
l'idée de la « réussite » ou de l' « échec
».
Pour dépasser ce type de compréhension
stéréotypée, il nous faut tenir compte de l'aspect de la
construction sociale de la personne. Dans le cas de M. Kamihata, il s'agit de
la construction de sa propre famille en milieu urbain. Après son
départ à Tôkyô au début des années 70,
il s'est marié avec une femme originaire de Shikoku qui n'avait jamais
connu le monde agricole. Il a ensuite constitué avec elle sa vie et sa
famille. Et sa décision de redevenir salarié dans une
chaîne locale de supermarché en fermant son supermarché
indépendant, a été prise afin d'établir une vie
plus stable, car le régime de la pension d'entreprise lui a paru plus
avantageux à long terme ! A Nagoya, il a mené sa vie dans un
environnement tout-à-fait urbain avec son épouse et ses enfants
sans avoir un jardin potager. Et après leurs études
universitaires, ses enfants travaillent tous dans le domaine financier. Puis,
en participant au Projet Nô-Life, M. Kamihata se réfère
à toutes ses expériences antérieures
752 Voir la note de bas de page 145 dans le Chapitre 2 sur le
contexte international du vieillissement actif.
753 LEGRAND, M. (2001), La retraite : une révolution
silencieuse, Ramonville, Erès : p.12.
754 Ibid.
(agriculture, distribution alimentaire, réussite,
échec etc) et à l'évolution de la société
japonaise qu'il a vécue (pauvreté, haute croissance, basse
croissance, incertitude après la bulle économique...). Il essaie
ainsi de redevenir paysan dans la Ville de Toyota, une ville dans laquelle, il
n'a pas encore vécu !
Enfin, l'exemple de M. Kamihata nous permet de constater que,
pour saisir l'évolution de la vie d'une personne, nous devons avoir
à la fois les deux points de vue : point de vue constructiviste qui
prend en considération la stratégie et le jeu d'interaction de
circonstance en vue d'intégrer dans l'action des éléments
circonstanciels tout-à-fait divers et hybrides. Mais le point de vue de
type stracturaliste (reproduction sociale) qui prend en considération
l'ancrage d'un acteur dans ses expériences et positions sociales
antérieures. Ces deux types d'aspects peuvent bien faire partie
intégrante de cette évolution.
Sans pour autant reprendre ici les histoires de vie de tous
les enquêtés, nous retenons que leurs trajectoires peuvent avoir
une influence sur l'action des enquêtés de participer à la
formation et de se mettre chacun à leurs activités
ultérieures. Et cette influence va prendre forme, soit de façon
à donner aux acteurs un facteur qui les conduit à construire un
nouveau type de vie pour eux dans une nouvelle circonstance
socio-spatio-temporelle, soit de façon à donner aux acteurs un
facteur qui les oriente à reproduire un type de vie qu'ils ont
déjà connu dans le passé, mais ceci en renouvelant leurs
expériences antérieures dans un nouveau type de circonstance
donnée.
A partir de ce constat, nous construisons un modèle
pour comprendre cette influence complexe de la trajectoire sur l'action des
enquêtés comme dans le schéma ci-dessous, en terme de la
« crise » et de la « stabilité » de la vie du
passé proche au niveau de différentes espèces de capitaux.
Ici, nous prenons deux types de capitaux : capital économique ; capital
socio-culturel755.
Modèle des trajectoires
capital économique
stabilité (suffisance) / crise (insuffisance)
capital socio-culturel
stabilité (suffisance) / crise (insuffisance)
A partir de ce schéma, nous pouvons concevoir quatre types
suivants de variantes :
Variation du modèle des trajectoires
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
cap. éco
|
sta.
|
sta.
|
crise.
|
crise.
|
|
cap. socio-cult.
|
sta.
|
crise.
|
sta.
|
crise.
|
Puis, nous pouvons supposer, comme ci-dessous, une sorte
spécifique d'influence qu'ont ces quatre types de trajectoire sur
l'action :
- Type 1 : capitaux économique et socio-culturel
suffisants : reconstruction vers le maintien, ou
l'accumulation des deux types de capitaux existants. Ou bien,
la création libre ou la contribution
sociale basées sur la stabilité de ces deux types de capitaux
sont possibles à supposer.
- Type 2 : capital économique suffisant et capital
socio-culturel insuffisant : en maintenant ou accumulant le capital
économique existant, on essaie de construire un nouveau capital
socio-culturel ;
- Type 3 : capital économique insuffisant et capital
socio-culturel suffisant : on essaie d'abord de construire un nouveau
capital économique, en maintenant ou accumulant le capital
socio-culturel existant ;
- Type 4 : capital économique et socio-économique
insuffisant : on essaie de construire de nouveaux capitaux
économiques et socio-culturels
Essayons ensuite d'analyser la trajectoire de chaque
enquêté par ces quatre modèles dans le tableau suivant :
755 Nous entendons par le terme du capital socio-culturel, les
éléments susceptibles de couvrir le lien social et territorial et
la qualité de vie.
Typologie des trajectoires
|
M.
Nichi
|
M. Katô
|
M. Itô
|
M.
Shimizu
|
M.
Kobayashi
|
M. Imai
|
M.
Shioya
|
M.
Isomura
|
|
Cap.éco
|
Crise
|
Stab./crise
|
Stab. ?
|
Stab.
|
Stab.
|
Stab. ?
|
Stab.
|
Stab.
|
|
Indic. détermin.
|
Chôm. et
célib.
|
Revenu épouse /
chôm.
|
Revenu
épouse /
préc. ?
|
Pension
|
Pension et
revenu immo.
|
Pension (en
attente)
|
Pension
|
Pension
|
|
Cap.
socio-cult.
|
Crise ?
|
Crise ?
|
Stab.
|
Stab.
|
Crise
|
Crise ?
|
Stab.
|
Stab.
|
|
Indic.
détermin.
|
Célib.
|
Dépression.
|
Bonne relat.
fam.
|
Bonne relat.
fam.
|
Perte famille
(incendie)
|
Perte famille
(maladie,
âge)
|
Richesse
loisirs
|
Bonne relat.
fam.
|
|
Type traj.
|
4
|
2 / 4
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
|
M.
Naruse
|
M. Suzuki
|
M.
Kamihata
|
Mme.
Konno
|
Mme.
Tsuzuki
|
Mme.
Kawamura
|
Mme. Katô
|
Mme.
Mizutani
|
|
Cap.éco
|
Stab.
|
Stab.
|
Stab.
|
Stab.
|
Stab.
|
Crise
|
Stab.
|
Stab. ?
|
|
Indic.
détermin.
|
Pension
|
Pension et trav.
temp.
|
Pension et trav.
temp.
|
Revenu
mari
|
Revenu
mari
|
Divorce,
chômage
|
Pension
|
Pension
mari
|
|
Cap.
socio-cult.
|
Stab. ?
|
Stab./crise
|
Stab. / crise
|
Crise
|
Stab.
|
Crise
|
Crise
|
Crise
|
|
Indic.
détermin.
|
Maladie
parents
|
Veuf / loisirs,
richesse relat.
hum.
|
Bonne relat.
fam. / identité
agricole
|
Perte
occup.
Indiv.
|
Bonne
relat. fam.
|
Divorce,
chômage
|
Mauvaise
relat. conjug. ;
Chôm. e Fils
|
Chôm. Fils
|
|
Type traj.
|
1
|
1 / 2
|
1 / 2
|
2
|
1
|
4
|
2
|
2
|
(Liste d'abréviation : Cap. éco. :
Capital économique ; Indic. détermin : Indicateurs
déterminants ; Cap. socio-cult : Capital socio-culturel ; Type traj. :
Type des trajectoires ; Stab. : Stabilité. : Préc. :
Précarité ; Chôm. : Chômage ; Célib. :
Célibataire ; Relat. fam. : Relation familiale ; Immo. : Immobilier ;
Trav. temp. : Travail temporaire ; Relat. Hum. : Relation humaine ; Occup.
Indiv. : occupation individuelle ; Relat. conjug. : Relation conjugale)
Pour établir ce schéma, il faut d'abord
considérer qu'il n'y a pas de coupure totale entre ces critères
Stabilité/Crise, et qu'ils sont plutôt relatifs. Puis, nous sommes
toujours confrontés à l'ambiguïté et la
complexité de la situation de chacun, sans oublier notamment celles des
retraités, femmes, (ex-)agriculteurs pluriactifs, que nous avons
relevées plus haut. C'est pour cela que nous avons mis dans les parties
les éléments des indicateurs déterminants dont nous avons
pris en compte pour cette analyse. Nous pourrons prendre en
considération le résultat de cette analyse dans les analyses
suivantes756.
Reprise du Schéma de l'agriculture de type Ikigai :
qualité de vie ; lien social et territorial ; production
matérielle
Pour l'analyse des réponses correspondant aux quatre
niveaux suivants (motivation initiale ; changement d'idées,
d'activités et de mode de vie ; prise de position vis-à-vis de
l'agriculture de type Ikigai), certains
756 Nous pouvons nous rappeller ici les trois conditions pour la
réalisation d'Ikigai citées par Hamaguchi que nous avons vues
dans le Chapitre 2 : première condition « sortie du malheur »
surmonter le manque ou l'insatifaction ; deuxième condition «
maintien de la stabilité » tentative incessante du
développement sans se satisfaire de l'état présent ;
troisième condition « réalisation de la possibilité
plus grande » comme l'innovation dans les styles de vie et des modes de
pensée (Hamaguchi, 1999). Nous pouvons mettre en parallèle le
type de trajectoire 1 à la deuxième ou la troisième
condition, le type de trajectoire 2, 3, 4 à la première ou
deuxième condition.
nombres d'éléments communs composent le
schéma des représentations tels que : autoconsommation, plaisir,
loisir, style de vie, santé, relation familiale, obligation familiale,
contribution sociale, revenu supplémentaire, revenu principal etc.
Là, nous pouvons situer ces éléments dans
le schéma des trois éléments d'idées constitutives
de l'agriculture de type Ikigai, que nous avons relevé à partir
de l'analyse du processus de l'émergence du Projet Nô-Life :
qualité de vie (priorité à la satisfaction individuelle,
consommation, style de vie etc.) ; lien social et territorial (contribution
sociale, sociabilité) ; production matérielle (travail, profits).
A partir de cette analyse, nous pouvons mettre en relation les positions de 16
stagiaires enquêtés avec les trois pôles d'idées de
l'agriculture d'Ikigai.
Nous considérons ici que ces trois pôles
constituent un nouveau monde émergeant dans le processus du Projet
Nô-Life. Cette approche va d'ailleurs nous permettre de faire confronter
directement les positions de ces enquêtés à celles des
agents institutionnels dans le Projet Nô-Life que nous avons
analysé à la fin du Chapitre 2, et ainsi de répondre
à nos questions finales de ce chapitre.
2 Motivation initiale
Le schéma montre la place de la motivation initiale de
chaque enquêté par rapport aux trois éléments du
processus de l'agriculture de type Ikigai. Nous avons repéré six
groupes qui se situent chacun à une place commune.
Dans le groupe 1, le plus proche du pôle Lien social et
territorial, nous avons M. Shimizu, M. Kobayashi, M. Imai, M. Shioya et Mme.
Tsuzuki. Ils ont comme motivation commune le maintien de biens agricoles
familiaux, dont le degré est varié de l'un à l'autre.
Puis, ils attachent peu d'importance en rapport avec leurs activités
agricoles à l'exigence individuelle de la qualité de vie, et la
production matérielle avec but lucratif. Ils ont un trait commun
marquant : être originaire d'un foyer agricole local et salariés
retraités (c'est-à-dire la catégorie objective 2, sauf
Mme. Tsuzuki qui est femme au foyer).
Et leurs types de trajectoire sont tous 1 (stable au niveau
des capitaux économique et socio-culturel) sauf M. Kobayashi qui a perdu
son épouse et ses parents dans la même année en 2003 (nous
lui avons mis le type 2, stable au niveau du capital économique, mais
crise au niveau du capital socio-culturel). Dans ce sens, le maintien de biens
agricoles familiaux peut à la fois correspondre à celui des
capitaux économique (immobilier) et socio-culturel (familial et
ancestral). Chez M. Kobayashi, comme il nous l'a affirmé, sa motivation
pour le maintien de biens a plus de sens constructif en raison de sa situation
de crise au niveau du capital socio-culturel : le maintien et la transmission
des biens familiaux sont son Ikigai.
Schéma : Motivation initiale

Qualité de vie
(individuelle)
G.2
M. Katô : 2 / 4
M. Naruse : 1
G.5
G.3
Mme. Kawamura : 4
Mme. Konno : 2
Mme. Katô : 2
G.1
M. Nichizawa : 4
Mme. Mizutani : 2
G.6
Lien social et
territorial
M. Shimizu : 1 M. Kobayashi : 2
M. Imai : 2 M. Suzuki : 1 / 2
M. Shioya : 1
M. Itô : 1
M.Isomura : 1
M. Kamihata : 1 /2
Production
matérielle
(lucrative)
Mme. Tsuzuki : 1
G.4
Les numéros 1- 4 sont les types des trajectoires.
Dans le groupe 2, le plus proche du pôle Qualité
de vie (individuelle), nous avons M. Katô, M. Naruse. Ils ont comme
motivation commune l'autoconsommation et le plaisir. Ils attachent peu
d'importance en rapport avec leurs activités agricoles à
l'exigence sur le lien social et territorial, et la production
matérielle avec but lucratif. S'ils ont des traits différents en
terme de trajectoire (M. Katô, 40ans, ouvrier - situation précaire
; M. Naruse, 55ans, ingénieur informatique - préretraité),
ils sont tous les deux mariés et originaire d'un foyer non agricole de
la Ville de Toyota.
Le type de trajectoire de M. Katô peut être 2 ou 4
(crise au niveau du capital économique en raison de sa situation
précaire, stabilité ou crise au niveau du capital socio-culturel
liée à son problème de dépression). Mais chez lui,
il faut relativiser sa situation individuelle, car sa situation
économique peut être stable grâce au travail de son
épouse et au fait qu'il habite toujours avec ses parents. Puis, il n'a
pas l'intention de répondre à son besoin économique par
ses activités agricoles (il cherche un travail ailleurs). Le type de
trajectoire de M. Naruse peut être 1, et l'autoconsommation et le plaisir
peuvent être considérés comme l'accumulation ou la
jouissance du bien-être assuré par sa situation stable au niveau
des capitaux économique et socio-culturel.
Dans le groupe 3 situé au coeur du triangle du
schéma, nous avons Mme. Konno, Mme. Katô et Mme. Mizutani. Elle
ont comme motivation commune de combiner, de manière
équilibrée, leurs exigences sur la qualité de vie
individuelle, le lien familial et la production matérielle avec un but
lucratif. Si Mme. Konno est la seule jeune (35ans) parmi ces trois femmes et
leurs trajectoires sont différentes, elles ont toutes les trois mis
l'accent sur l'importance de leurs rôles familiaux : mère et
épouse. Si Mme. Konno insiste sur la compatibilité de ces deux
rôles et son propre « territoire » individuel, les deux autres
se préoccupent fortement d'un problème commun: les
difficultés d'insertion de leurs fils qui ont la trentaine, et n'ont pas
d'activités publiques.
Nous avons considéré leurs types de trajectoire
comme 2 en raison de leur situation stable au niveau du capital
économique mais en crise au niveau du capital socio-culturel (territoire
individuel dans la sphère
familiale chez Mme. Konno, précarité des fils de
Mme Katô et Mme. Mizutani). C'est pourquoi leurs activités
agricoles peuvent avoir un sens constructif au niveau du capital
socio-culturel.
Dans le groupe 4 situé entre les deux pôles Lien
social et territorial, et Production matérielle (lucrative), nous avons
M. Itô, M. Suzuki et M. Isomura. Ils ont comme motivation commune la
combinaison des aspects sociaux et économiques. La motivation est
commune entre M. Itô et M. Suzuki : contribution sociale au travers
d'activités de la production fruitière, au monde agricole
notamment celui de l'arboriculture. Et M. Isomura, salarié
retraité et gendre d'une famille agricole locale, s'attache, comme les
enquêtés du groupe 1, au maintien de biens agricoles familiaux. Il
a pour but la vente de ses produits et s'intéresse à divers
domaines concernés comme l'éducation alimentaire, la
préservation de l'environnement etc. Leurs trajectoires sont toutes
différentes : M. Itô : originaire de la Ville voisine de Toyota -
salarié Automobile Toyota - petit entrepreneur - chômeur (?) ; M.
Suzuki : originaire d'un foyer agricole du département Shizuoka -
salarié Automobile Toyota - semi-retraite ; M. Isomura : originaire d'un
village moyenne montagne ayant fusionné avec la Ville de Toyota -
fonctionnaire de la Ville - préretraite.
Nous avons considéré les types de trajectoire de
ces trois hommes comme 1 (sauf celui de M. Suzuki peut-être 1 ou 2 en
raison du fait qu'il est veuf et habite seul avec sa belle-mère
âgée). Les motivations de M. Suzuki et M. Itô sont
orientées vers la contribution sociale basée sur leur situation
stable au niveau des capitaux économique et socio-culturel. Mais nous ne
pouvons jamais ignorer que le côté constructif peut toujours avoir
une importance dans leur action, vu que l'incertitude est présente dans
leurs situations (passage de la semi-retraite à la retraite chez M.
Suzuki, travail et revenu apparemment instables chez M. Itô)
Dans le groupe 5 situé entre les deux pôles
Qualité de vie (individuelle) et Production matérielle
(lucrative), nous avons Mme. Kawamura. Elle a comme motivation à la fois
la passion pour la culture maraîchère et le but de gagner «
de l'argent de poche de tous les jours ». En effet, elle était
fleuriste et a un fort attachement pour les plantes. Puis, elle est dans une
situation précaire depuis l'âge de 50 ans où elle a
dû fermé son propre magasin de fleurs suite à son divorce.
Elle a maintenant 55 ans, et est à la charge de sa fille. Les
activités agricoles constituent une de ses occupations personnelles
importantes, qui peuvent lui permettre de répondre à sa situation
de crise au niveau des capitaux économique et socio-culturel (son type
de trajectoire : 4).
Dans le groupe 6, le plus proche du pôle de la
Production matérielle (lucrative), nous avons M. Kamihata et M.
Nichizawa. Ils ont comme motivation commune l'obtention d'un revenu agricole de
plus d'un million de yens. Mais leurs situations et trajectoires sont
tout-à-fait différentes. M. Kamihata, 60ans, bientôt
retraité et pensionné ; M. Nichizawa, 43ans, célibataire
et chômeur depuis quatre ans. Si M. Kamihata essaie de réaliser
une entreprise agricole familiale avec son épouse et son fils, tout en
remobilisant ses expériences professsionnelles passées
(agriculteur professionnel à Kagoshima, employé de
supermarché), M. Nichizawa veut devenir agriculteur prodessionnel
individuel. C'est pourquoi il doit, en fait, dégager un revenu agricole
dont le montant est beaucoup plus important qu'un million de yens : au moins
deux millions et demi de yens757), ce qui constitue une grande
contrainte en terme de l'investissement et du travail.
Le type de trajectoire de M. Kamihata peut-être 1 ou 2,
car, alors qu'il a une condition socio-économique qui est stable, il est
toujours en quête de son identité agricole et paysanne dans sa
trajectoire turbulente. Par contre, nous avons considéré celui de
M. Nichizawa comme 4 en raison de sa précarité économique
et de sa situation du célibat prolongé (il a 43ans).
3 Changement d'idées, d'activités et de mode de
vie
Groupe 1 : M. Shioya ; M. Shimizu ; M. Kobayashi ; M. Imai ; Mme.
Tsuzuki
Le schéma (voir la page suivante) montre les mode de
changements que les enquêtés ont connu pendant leur formation
Nô-Life. Nous avons mis quatre types de flèches pour designer ces
changements : changement ; intention ; hésitation ; contrainte,
difficulté.
Bien que quatre personnes sur cinq (sauf M. Shioya)
situées dans le groupe 1, n'aient pas radicalement
757 Environ 16 666 euros.
Schéma : Changement d'idée,
d'activités et de mode de vie

: changement
: intention
: hésitation
: contrainte, difficulté
Les numéros 1- 4 sont les types des trajectoires.
Qualité de vie
(individuelle)
G.2
M. Shioya : 1
M. Katô : 2 / 4
M. Naruse : 1
Mme. Kawamura : 4
G.5
Mme. Konno : 2
M. Itô : 1
G.3
M. Suzuki : 1 / 2
Mme. Katô : 2
M. Nichizawa : 4
Mme. Mizutani : 2
Lien social et
territorial
M. Shimizu : 1
M. Kobayashi : 2 M. Imai : 2
M. Kamihata : 1 / 2
G.6
Production
matérielle
(lucrative)
Gi
M.Isomura : 1
G.4
Mme. Tsuzuki : 1
changé d'idées, nous constatons que chacun a connu
des réactions de types différents.
M. Shimizu a toujours l'intention de vendre ses produits (kaki),
mais constate fortement la difficulté pour cela en raison de la
rentabilité extrèmement faible.
M. Kobayashi hésite d'un côté à
développer sa vente face à la contrainte pour mener la production
de type lucratif (normes de quantité, qualité,
régularité pour la distribution), de l'autre, il trouve sa
passion dans un nouveau loisir lié à sa production : soba
(nouilles de sarrasin)
M. Imai et Mme. Tsuzuki ne constatent pas de changement dans
leur vie depuis le début de la formation. Mais M. Imai, lui aussi,
constate une contrainte vis-à-vis du pôle de la production
matérielle dans le sens où la formation Nô-Life n'a pas
satisfait sa demande de vouloir réduire l'utilisation de produits
chimiques dans sa production.
M. Shioya a connu un changement radical d'idées : il a
pris conscience que ses activités agricoles ne constituent qu'un de ses
loisirs, mais pas plus. En effet, il a beaucoup d'autres loisirs qui ont la
priorité sur l'agriculture.Il n'a pas l'intention de développer
sa culture maraîchère par manque de temps.
Groupe 2 : M. Katô ; M. Naruse
Si les deux hommes situé dans le groupe 2 ne partagent pas
un même type de trajectoire ni un même type de
changement d'idées au cours de la formation Nô-Life,
tous les deux constatent des contraintes économiques pour mener une
production lucrative.
M. Katô n'a pas connu un grand changement
d'idées. S'il découvre davantage de valeur sentimentale dans
l'agriculture (chaleur humaine, plaisir d'autoconsommation), ceci est
lié au problème de dépression qu'il a connu en
été 2006, qui l'a forcé à arrêter son travail
dans une usine de mayonnaise.
M. Naruse hésite à décider quoi et
comment vendre ses produits. Son souhait initial était de faire du riz
avec 0.1 ha de rizière, mais à présent il hésite
compte tenu de la faible rentabilité de la production rizicole et de la
contrainte en terme de l'investissement notamment pour les machines. Du coup,
il s'intéresse à produire et vendre des figues pour sa
rentabilité. Mais il n'a pas pour autant l'intention d'entrer dans un
groupement de producteurs à cause de la contrainte du marché qui
s'impose à la production.
Groupe 3 : Mme. Konno ; Mme Katô ; Mme. Mizutani
Les trois femmes situées du groupe 3, constatent des
contraintes pour la production de type lucratif. Mais leur intention de lier la
vente à l'aspect social (familial) en tant que mère reste
toujours un point commun parmi elles.
Si le souhait initial de Mme. Konno était de faire des
pêches ou des figues pour les vendre, elle a décidé de
développer d'abord sa culture maraîchère pour
l'autoconsommation et ensuite la vente. Car la production de pêches ou de
figues demande un investissement plus important. Si elle n'a pas changé
d'idées en principe, elle a connu un « grand impact » en terme
de son rythme de vie et de sa vie alimentaire basés sur le « cycle
de la nature ». Elle garde sa grande motivation pour continuer ses
activités agricoles avec sa famille.
Mme. Katô a du mal à décider si elle va
suivre son objectif initial de produire des fraises en serre face à la
grande contrainte économique en terme d'investissement (prêt
agricole départemental, construction de serres, travail etc). Cette
hésitation est également liée à son âge
(60ans) et sa préoccupation concernant son fils qui est au
chômage. En effet, elle n'est pas sûre que son fils voudra la
rejoindre pour la production de fraises. Par contre, elle met l'accent sur le
fait que ses activités agricoles ont amélioré sa relation
avec son mari.
Puis, Mme. Mizutani constate également la contrainte
pour la production rizicole en terme de l'utilisation de produits chimiques.
Mais elle a l'intention de s'investir tant au niveau du travail, qu'au niveau
financier pour développer une production agricole familiale et
diversifiée,. Mais tout comme le cas de Mme Katô, son fils qui est
au chômage n'a pas l'air d'être intéressé par ses
activités agricoles.
Groupe 4 : M. Itô ; M. Suzuki ; M. Isomura
Les trois hommes situés dans le groupe 4 cherchent
chacun à sa manière leur implication dans le monde agricole.
Notamment M. Itô et M. Suzuki ont radicalement changé
d'idées. Si ces deux enquêtés s'inscrivent dans la
filière fruitière, chacun a son propre raisonnement.
M. Itô s'intéressait au début à
produire des figues, tout en ayant l'intention de chercher des
possibilités de s'impliquer dans le monde agricole afin de contribuer
à un nouveau type de développement agricole et rural. Puis, dans
la formation Nô-Life de la filière fruitière qui s'est
déroulée dans la zone de production de la poire et de la
pêche de Sanage, il a trouvé qu'il y a de sérieux
problèmes dans ce monde, liés au vieillissement de la population
agricole, au manque de porteurs etc. Par ailleurs, il trouvait également
la difficulté d'apprendre les techniques agricoles dans ce domaine par
la seule formation Nô-Life, car la production de la pêche et de la
poire nécessite un investissement important et une expérience
professionnelle plus longue. C'est ainsi qu'il a eu l'idée de monter une
association de stagiaires de Nô-Life dans le but de non seulement
organiser une aide pour les travaux agricoles, mais également de
s'entraider entre stagiaires de Nô-Life, y compris les stagiaires des
autres filières. Ceci en considérant qu'il est bien placé
pour jouer le rôle d'organisateur en raison de son âge plus jeune
que les autres (43ans).
M. Suzuki voulait au début « faire quelque chose
» pour faire face au risque du délabrement de la zone de production
de la poire et de la pêche de Sanage. Mais après un an et demi
d'expérience de la formation de la
filière fruitière, il est fortement
déçu de cette formation. C'est pourquoi il met en cause un manque
de perspectives de la part du Centre Nô-Life pour l'organisation de cette
filière. En effet, comme nous l'avons vu dans la partie de l'acteur 7
(Monsieur N du GASATA) du Chapitre 2, la plupart des stagiaires (y compris ceux
des années 2004-2006) de cette filière ont du mal à se
lancer dans la production de la pêche ou de la poire après leur
formation, en raison des contraintes économiques très
élevées (investissement, travail, technique) par rapport à
leur âge. M. Suzuki est ainsi confronté au dilemme de ne pas
pouvoir se lancer dans ce domaine, ni en tant que producteur, ni en tant
qu'aide aux travaux agricoles. Ceci alors qu'il était l'un des
stagiaires qui s'engageait le plus fortement dans les activités de la
formation. C'est pourquoi il rejoint M. Itô pour élaborer
l'idée de monter une association de stagiaires pour chercher d'autres
moyens alternatifs de développer ses activités ultérieures
et celles des stagiaires de Nô-Life. Et ceci avec une remise en cause du
fondement du Projet Nô-Life qui relève de la combinaison d'Ikigai
des personnes âgées et de la prévention des friches
agricoles. Il trouve que l'approche actuelle du Centre Nô-Life est
insuffisante pour réaliser cet objectif. A cet effet, il a
déjà donné son avis au Centre Nô-Life en disant que,
si la Ville a vraiment l'intention de préserver les terrains agricoles
en s'appuyant sur la main-d'oeuvre de nouveaux salariés
retraités, il vaudrait mieux qu'elle loue directement ces terrains
agricoles à son initiative, et y embaucher les retraités...
M. Isomura ne change pas radicalement d'idées à
l'inverse de ces deux derniers, en s'inscrivant à la filière
maraîchère. A la différence des autres stagiaires
originaires d'un foyer agricole local, il s'intéresse à la fois
à la vente de ses produits, à l'aspect social de la production
agricole comme l'éducation alimentaire et au changement de son rythme de
vie qui implique un changement radical par rapport à la vie salariale.
Et il pense que le système du Projet Nô-Life ne se diffusera pas
facilement par l'entremise du Centre Nô-Life, face à l'attitude
égoïste de propriétaires fonciers. C'est pourquoi il rejoint
en partie l'idée de M. Suzuki que la Ville doit prendre plus
d'initiative pour préserver les terrains agricoles.
Groupe 5 : Mme. Kawamura
Quant au groupe 5, Mme. Kawamura voulait, au début,
produire des figues pour les vendre, mais elle est en train de changer son
idée, face à la contrainte technique pour l'entretien des figues
(maladie, traitement). C'est pourquoi elle envisage de cultiver les aubergines
pour gagner « de l'argent de poche de tous les jours ». Sinon,
étant une des rares pratiquant la méthode de l'agriculture
biologique dans le stage individuel de la formation Nô-Life, elle
distingue fortement la méthode enseignée dans la formation
Nô-Life qui est conventionnelle et la sienne qui est de type
écologique.
Groupe 6 : M. Nichizawa ; M. Kamihata
Même si les deux hommes situés dans le groupe 6
ne changent pas leur objectif initial de mener une production lucrative pour un
revenu agricole de plus d'un million de yens, ils présentent chacun une
approche contrastant avec l'autre, en ayant deux trajectoires totalement
différentes.
D'un côté, l'approche de M. Nichizawa (43 ans)
est individuelle. Etant originaire d'un foyer non agricole de la Ville de
Toyota, célibataire et actuellement au chômage, il a pour but de
devenir agriculteur professionnel après la formation Nô-Life. Il
envisage une production de fraises en serre en raison de sa haute
rentabilité. Cependant, la contrainte économique (investissement
avec le prêt agricole départemental, travail) constitue
déjà un souci pour lui. Malgré cela, il s'appuie sur sa
passion pour l'agriculture et mener les activités agricoles pour toute
sa vie.
De l'autre côté, l'approche de M. Kamihata est
familiale et entrepreneuriale. Etant ex-agriculteur professionnel de Kagoshima
et salarié en semi-retraite, essaie de créer une entreprise
agricole familiale après la formation Nô-Life. Il envisage une
« agriculture réflexive (kangaeru nôgyô) »
(d'après son expression) qui consiste à trouver des
créneaux avec des produits qui ne se trouvent pas ailleurs (saisons
décalées, mais de bonne qualité), afin de ne pas subir la
baisse des prix due à la surproduction. C'est pourquoi il n'envisage pas
la monoculture de fraises comme M. Nichizawa, même si elle est fortement
recommandée par le Centre Nô-Life et
la CAT (Coopérative agricole de Toyota). Constat commun :
contraintes économiques
D'un côté, nous constatons que chacun a sa
manière de réagir dans la situation de leur formation
Nô-Life en relation avec les trois pôles du processus de
l'agriculture de type Ikigai, de l'autre côté, nous trouvons un
point commun fort parmi les stagiaires : contrainte fortement ressentie
vis-à-vis du pôle de la production matérielle.
Ce point implique diverses formes d'attitudes négatives
: hésitation entre le maintien de bien familiaux, l'autoconsommation et
la vente ; attitude distanciée ou indifférente ; souci sur la
faisabilité ; dilemme entre l'engagement et la déception
vis-à-vis de la réalité ; critiques sur le fondement du
Projet ; tentative de démarches alternatives avec une initiative
associative etc.
D'autant que cette tendance est commune à la plupart
des stagiaires, nous pouvons supposer qu'elle n'est pas seulement liée
aux trajectoires et motivations initiales de chaque stagiaire qui sont
très différentes de l'un à l'autre. Quel facteur constitue
cette situation ? Nous pouvons attribuer cette tendance à des facteurs
extérieurs à la vie des stagiaires en rapport avec le pôle
de la production matérielle. Dans ce cas, nous devrons prendre en
considération l'interaction entre les comportements des stagiaires et le
principe de la formation Nô-Life elle-même derrière lequel
les agents concernés qui s'imposent dans ce pôle, ou d'autres
circonstances extérieures.
Nous verrons plus bas que cette tendance s'exprimera plus
clairement par les points de vue plus ou moins manifestes de la majorité
des stagiaires, qui détermineront leurs prises de position
vis-à-vis de la vision officielle de l'agriculture de type Ikigai
notamment avec l'objectif d'un million de yens de revenu agricole annuel.
4 Prise de position vis-à-vis de l'agriculture de type
Ikigai
Pour ce schéma, nous avons essayé de
déterminer la position des enquêtés en rapport avec leurs
positions occupées dans les deux derniers schémas, ainsi que les
réponses obtenues pour la question d. sur la vision de l'«
agriculture de type Ikigai » telle qu'elle est proposée par le
Centre Nô-Life : combinaison d'Ikigai des personnes âgées et
l'agriculture avec l'objectif d'un million de yens de revenu agricole.
Le résultat, c'est que la plupart des
enquêtés (sauf M. Nichizawa et M. Kamihata qui poursuivent cet
objectif) ont finalement pris leurs distances avec le pôle de la
production matérielle à but lucratif en répondant «
impossible » ou « trop contraignant » sur l'objectif d'un
million de yens de revenu agricole.
Sinon, sur l'idée de considérer l'agriculture
comme Ikigai, la plupart des enquêtés ont donné chacun une
réponse positive à leur manière. Puis, nous avons
réuni dans le « Groupe distancié » quatre personnes qui
ne considèrent pas forcément l'agriculture comme leur Ikigai, ou
mettant fortement en doute cette idée. Il s'agit de M. Shioya, M.
Suzuki, Mme. Tsuzuki et M. Imai.
Groupe distancié
Pourquoi ces quatre personnes se sont retrouvées en
dehors du cercle de l'agriculture de type Ikigai au travers de la formation
Nô-Life ? Sont-ils totalement désintéressés par le
Projet Nô-Life ? Quels sont finalement les facteurs de ce décalage
entre la vision officielle de l'agriculture de type Ikigai et leurs visions
personnelles ? Ces facteurs sont-ils extérieurs et
généraux liés au Projet Nô-Life ou intérieurs
et particuliers aux contextes individuels de ces enquêtés ?
Parmi ces quatre enquêtés, à part M.
Suzuki, trois enquêtés sont originaires d'un foyer agricole local
qui avaient, au départ, comme motivation le maintien de leurs biens
agricoles familiaux. Mais leurs raisonnements sont variés en rapport
avec leur trajectoire, leur ancrage social et leur construction de la vie.
Schéma : prises de position visà-vis de
l'agriculture de type Ikigai
: Position claire
Les numéros 1- 4 sont les types des trajectoires.
: Indifférent, relativiste, interrogation


Mme. Tsuzuki : 1
Groupe distancié
M. Imai : 2
Lien social et
territorial
M. Suzuki : 1 / 2
M. Shioya : 1
M. Shimizu : 1
M. Itô : 1
M. Kobayashi : 2
M.Isomura : 1
Mme. Katô : 2
Mme. Mizutani : 2
Qualité de vie
(individuelle)
M. Katô : 2 / 4
Mme. Konno : 2
M. Kamihata : 1 / 2
M. Naruse : 1
Mme. Kawamura : 4
Groupe neutre
M. Nichizawa : 4
Groupe productiviste
Production
matérielle
(lucrative)
M. Shioya reconnaît « ne pas faire partie des gens
de ce type » (agriculteurs de type Ikigai) promu par le Centre
Nô-Life, dans le sens où il n'a pas l'intention de mener ses
activités agricoles dans le but de dégager un million de yens de
revenu agricole. Il considère ses activités agricoles comme un
« loisir » tout en mettant l'accent sur le fait qu'il prend plaisir
à aller tous les jours aux champs s'occuper de légumes, ce qui
constitue son nouveau « rythme de vie » après la retraite.
Puis, il met en doute notamment l'idée du Projet Nô-Life de faire
s'investir les salariés retraités dans les activités
agricoles avec un but lucratif. Pour lui, ce n'est pas une idée
raisonnable tant que « cela ne paiera pas ».
D'une part, sa réflexion vis-à-vis de
l'investissement économique dans les activités agricoles est
liée à sa trajectoire : il a déjà
arrêté sa production rizicole il y a 20 ans en raison de la
politique de la réduction de la surface agricole ayant donné des
subsides pour la mise en jachère des rizières. Il a ainsi mis en
jachère ses 0.3ha de rizières. Depuis cela, il n'a plus jamais
cultivé du riz. Il souligne que la production rizicole à petite
échelle n'est pas rentable par rapport à l'investissement
nécessaire pour les plantes, les machines, les engrais etc. Maintenant,
il a seulement un tracteur datant de plus de trente ans pour labourer seulement
les terrains pour les « gérer ».
D'autre part, son raisonnement se base sur le fait qu'il a
construit un style de vie qui est très riche en terme de loisirs :
voyage à l'étranger dans des milieux de type « non
exploré » (ex. le profond de montagnes en Chine, la Patagonie en
Argentine, voir l'aurore etc. ; nombreuses activités d'apprentissage :
Shamisen, Minyô (chant populaire japonais), Kîkô et la
conversation en anglais etc. Devant ces loisirs, l'agriculture n'a pas la
priorité. Et
il « n'[a] pas de temps » de se consacrer à
cela. D'ailleurs, ce qui constitue Ikigai pour lui est « faire ce que l'on
aime ».
Mme. Tsuzuki montre une attitude indifférente
vis-à-vis de l'idée de considérer l'agriculture comme
Ikigai. Elle n'est pas venue suivre la formation Nô-Life pour cela, mais
c'était parce que « par hasard », « il y avait des
rizières et des champs » chez elle.
Pourtant, cela ne veut pas dire qu'elle est
indifférente à l'égard du Projet Nô-Life par sa
propre volonté. Cette attitude est d'abord liée à son
ancrage familial. Chez elle, il y a 0.65ha de rizières, 0.2ha de champs
secs. Et c'est sa belle-mère qui s'occupe encore de la plupart des
cultures principales. Donc, Mme. Tsuzuki, qui est d'abord femme au foyer dans
sa famille, n'a pas encore la responsabilité de s'occuper des cultures.
Si bien qu'elle vient aider sa belle-mère avec son mari qui est
salarié, uniquement pour les périodes chargées comme la
plantation et la récolte du riz. C'est pourquoi elle n'avait jamais
cultivé des légumes avant la formation Nô-Life.
Puis, comme elle habite à six avec ses beaux-parents,
son mari, ses deux enfants lycéens, elle doit remplir beaucoup de
tâches en tant que mère (repas scolaires des enfants) et femme au
foyer (repas de la famille, ménage etc). En plus de cela, elle a
beaucoup d'autres occupations personnelles et sociales qui dépassent
largement le niveau domestique : tennis comme loisir et plusieurs
activités bénévoles : membre de l'association des parents
des élèves ; membre d'une commission de la santé des
parents-enfants au lycée ; chargée de la communication dans une
coopérative de consommation etc.
Cependant, elle suggère que, plus sa belle-mère
sera âgée, plus elle aura de « choses à faire ».
De ce fait, nous pouvons dire que, comme elle n'a que 48ans, il est encore trop
tôt pour qu'elle puisse consacrer beaucoup de temps aux activités
agricoles familiales. De ce point de vue-là, son acte de participer
à la formation Nô-Life peut être considéré
plutôt comme positif car c'est une anticipation de sa future occupation
familiale.
Pour M. Imai, l'agriculture n'est pas Ikigai, mais une obligation
familiale à l'égard de biens agricoles familiaux.
Ceci est lié à la circonstance
défavorable de son foyer agricole. D'abord, il a été
obligé de reprendre les travaux agricoles de sa famille suite à
la perte de son père (il y a cinq ans) et son beau-frère (il y a
un an). Et ceci alors qu'il a pris sa préretraite à la poste il y
a trois ans (à l'âge de 54ans). En plus, l'échelle des
terrains agricoles de sa famille est petite depuis la génération
de son père qui était pour cela déjà pluriactif
dans sa jeunesse. Maintenant, il cultive du riz sur 0.2ha de terrains et des
légumes seulement sur 0.03-0.04ha. M. Imai n'arrive pas encore à
cultiver tous ses terrains et laisse 0.05ha en jachère, ou en friches
qui sont « pleines de mauvaises herbes (kusa bôbô) ».
C'était dans une telle circonstance qu'au début,
il avait trouvé une sympathie pour le slogan de « former les
porteurs de l'agriculture » du Projet Nô-Life. Mais, au cours de la
formation Nô-Life, il s'est vite rendu compte qu'il n'était pas le
type d'agriculteurs que le Projet voulait former. Pourquoi finalement est-il
arrivé à cette réflexion ?
En effet, il n'a pas vraiment l'intention de vendre ses
produits (sauf du riz), parce que cela nécessite plus de temps et de
techniques. Pour lui, dégager plus d'un million de yens de revenu
agricole imposera trop de contraintes.
Pourtant, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de motivation
pour produire : la preuve est que cela fait plus de dix ans qu'il est
abonné à une revue agricole intitulée l' «
agriculture contemporaine (gendai nôgyô)758 », et
qu'il les « lisai[t] toutes » auparavant, lorsqu'il ne consacrait pas
beaucoup de temps à s'occuper des terrains de la famille comme ces
dernières années. Ceci était afin de connaître les
moyens les plus économes d'entretenir ses cultures à petite
échelle.
Mais la méthode que la formation Nô-Life lui a
enseignée est celle de l'agriculture conventionnelle qui demande une
utilisation standardisée de produits chimiques. Et c'est à ce
niveau-là que M. Imai ressent un décalage avec le Projet
Nô-Life.
Autrement, s'il n'arrive pas à développer plus
ses activités agricoles, c'est parce qu'il travaille tout seul en ce
moment, alors que sa femme continue à travailler de son
côté. Ce qui peut physiquement et psychologiquement constituer un
poids pour M. Imai. C'est pourquoi il suggère que, quand elle prendra sa
retraite, ils pourront
758 Revue mensuelle japonaise publiée par
Nôbunkyô depuis les années 1940 (après la fin de la
deuxième guerre mondiale).
peut-être travailler la terre ensemble et s'y investir
plus... D'ailleurs, il a souligné qu'il était encouragé
par le fait que le même type de personnes que lui se réunissent
dans le Projet Nô-Life. Cela montre qu'il a une motivation
potentiellement importante pour développer ses activités
agricoles plus tard.
M. Suzuki est, comme nous l'avons vu dans le schéma du
changement d'idées, fortement déçu par la formation
Nô-Life dans la filière de l'arboriculture. Il n'arrive plus
à « croire à l'idée du maire » qui a
lancé le Projet Nô-Life. Il est confronté au dilemme entre
la contrainte économique trop grande pour s'investir dans
l'arboriculture et son engagement fort pour le monde agricole. Ce dilemme est
pour lui douloureux, d'autant plus qu'il était un des stagiaires les
plus engagés dans les activités de la filière de
l'arboriculture, alors que beaucoup de stagiaires de cette filière se
sont désintéressés de leur stage dans les vergers, en
s'intéressant à d'autres cultures comme les figues ou cultiver
des légumes. (cas de Mme. Konno et Mme Kawamura)
Sinon, il considère Ikigai dans le sens de la
construction d'un autre type de vie que la vie salariale. D'ailleurs, il
rêvait de mener une vie basée sur l'autoproduction et
l'autoconsommation dans la montagne depuis l'âge de 50ans (il est
originaire d'un foyer agricole de Shizuoka).
Sa volonté de monter une association de stagiaires avec
M. Itô est révélatrice de son engagement pour le monde
agricole. Et cet acte montre également qu'il trouve des problèmes
dans le Projet Nô-Life et essaie de chercher des solutions à sa
propre initiative.
Pour M. Shioya, M. Imai et M. Suzuki, leur éloignement
du monde de l'agriculture de type Ikigai semble être lié à
l'orientation de la formation Nô-Life formulée par l'objectif d'un
million de yens de revenu agricole. Certes, chacun perçoit toujours les
choses à sa manière dans son ancrage particulier. Mais la
contradiction, semble moins se trouver dans l'histoire ou la convenance
personnelles de chacun, que dans le fait même que ces trois hommes
correspondants le plus au type de personnes visé par le Projet
Nô-Life (jeunes salariés retraités), n'ont pas
été convaincus par l'orientation de la formation
Nô-Life.
Ceci nous semble vrai d'autant plus qu'ils continuent chacun
à leur manière à s'intéresser aux activités
agricoles. Et M. Imai et Mme. Tsuzuki, eux aussi, pourront être plus
dynamiques en terme des activités agricoles en fonction de changements
ultérieurs de leur situation familiale (retraite de l'épouse pour
M. Imai, vieillissement de la belle-mère pour Mme. Tsuzuki).
Groupe neutre
Ensuite, parmi les enquêtés situés dans le
cercle de l'agriculture de type Ikigai, nous avons encerclé dans le
« Groupe neutre » dix personnes considérant l'agriculture
comme Ikigai, mais conservant une distance avec l'orientation productiviste du
Projet Nô-Life traduite par l'objectif d'un million de yens de revenu
agricole.
Un bon nombre parmi eux ont exprimé un doute manifeste
sur l'objectif d'un million de yens de revenu agricole (M. Shimizu, M. Isomura,
Mme. Katô, Mme. Konno, Mme Mizutani, Mme Kawamura) ou sur la
méthode enseignée par la formation qui est trop productiviste et
pas très économe (M. Itô, M. Kobayashi, M. Naruse et M.
Katô). Parmi eux, Mme Kawamura, M. Naruse et M. Katô ont surtout
l'intention de mener une production de type plus écologique.
Ce qui caractérise ce groupe est qu'ils ont l'intention
de garder un rapport économique dans leur prise de position (sauf M.
Itô qui n'a plus l'intention de mener une production quelconque et M.
Katô qui reconnaît devoir chercher un travail en dehors de ses
activités agricoles pour vivre)
Parmi ces enquêtés nous pouvons remarquer que les
personnes du type de trajectoire 2 (ou 2/4 ou 4) impliquant une situation de
crise (insuffisance) au niveau du capital socio-culturel, ont tendance à
prendre position plus proche du pôle de la production matérielle
(Mme. Kawamura, Mme Katô, Mme Konno, Mme Mizutani, M. Kobayashi). C'est
qu'ils ont l'intention d'établir le lien entre leur construction de
capitaux socio-culturels et un certain niveau d'activités
économiques. Nous allons voir les raisonnements de chacun au cas par
cas.
Mme Kawamura, suite à son divorce et sa situation
précaire depuis cinq ans, a besoin de construire à la fois de
nouveaux capitaux économiques et socio-culturels. Mais son exigence
économique n'est pas pour autant de gagner sa vie, mais de maintenir son
autonomie relative à sa situation familiale (être chargée
par sa fille). C'est
ainsi qu'elle a l'intention de gagner « de l'argent de poche
de tous les jours ».
Puis, Mme. Katô qui a un capital économique
suffisant pour elle-même, essaie de construire un capital
économique pour répondre à une situation de crise de sa
famille : fils au chômage et mauvaise relation conjugale. Mais elle est
confrontée au risque trop élevé qu'implique un
investissement économique à faire dans la production de fraises
en serre. En fait, le prêt agricole départemental que le Centre
Nô-Life propose aux stagiaires, est un système plutôt
destiné aux agriculteurs professionnels qu'aux salariés
retraités qui n'ont ni assez d'expériences pour cela, ni un
objectif purement professionnel ou économique.
Mme. Konno est en quête d'un certain niveau de capital
économique pour faire face à la crise au niveau du capital
socio-culturel dans le sens où elle risquait de perdre
l'équilibre entre les trois aspects personnels en tant qu'individu
(« territoire de soi-même »), épouse et mère de
trois enfants. C'est pour répondre à cette crise qu'elle a choisi
de mener à son initiative une production agricole avec sa famille
à long terme, pour s'assurer à la fois une économie
domestique plus stable, une meilleure relation familiale (épouse et
mère) et une occupation personnelle pour son autonomie individuelle. Et
elle trouve qu'elle est bien placée pour mener cette activité en
raison de son âge encore jeune (35ans).
Sa prise de position nous apparaît, en fait,
bouleversante par rapport à la position officielle du Centre
Nô-Life qui vise d'abord les salariés retraités
majoritairement à dominante masculine dans son approche de l'agriculture
de type Ikigai. En effet, elle s'affirme comme une seule personne placée
dans une position idéale par rapport aux trois pôles de
l'agriculture de type Ikigai, alorsqu'elle constitue un type de stagiaire de
Nô-Life tout-à-fait imprévu par les agents gestionnaires du
Projet Nô-Life ! (jeune femme, originaire d'un foyer non agricole, sans
aucune expérience agricole)
Mme. Mizutani, confrontée à une situation
précaire de son fils comme Mme. Katô, essaie de construire un
capital économique avec de nouvelles activités agricoles avec sa
famille. Mais elle se retrouve dans sa situation personnelle avec une
série de conditions incertaines (motivation incertaine de son fils,
financement, difficulté pour réaliser la rentabilité
etc)
M. Kobayashi a connu deux pertes successives de membres de sa
famille en 2003 (décès de l'épouse suite au cancer du
poumon, celui des parents suite à un incendie). C'est pourquoi il a pris
sa préretraite à la même année, et a
hérité des biens agricoles de sa famille. Dans le but de
maintenir et transmettre les biens agricoles familiaux qui étaient
auparavant entretenus par ses parents, il participa à la formation
Nô-Life depuis 2005. Et il affirme finalement que cet objectif du
maintien et de la transmission est son Ikigai.
Il est potentiellement motivé pour développer
ses cultures sur 1 .2ha de rizières et de champs secs qu'il a
hérité de ses parents, même s'il n'arrive pas encore
à tous les cultiver tous en raison de sa compétence encore
insuffisante. S'il hésite encore à exercer la vente de ses
produits en raison de contraintes du marché qui seront imposées
à la production, il a quand même l'intention d'entrer dans un
groupement de producteurs dans deux ou trois ans, quand sa compétence
sera plus grande.
En même temps, il trouve la méthode
enseignée par la formation Nô-Life trop coûteuse en terme de
l'utilisation de machines et de produits chimiques, et surtout non
adaptée aux besoins réels des stagiaires. Il pense qu'il vaut
mieux que le Centre Nô-Life enseigne également des méthodes
sans traitement chimique.
Sinon, pour le reste de personnes du Groupe neutre ayant le
type de trajectoire 1(sauf M. Katô), chacun a son engagement à sa
manière dans la vision de l'agriculture de type Ikigai, même si
dans une situation relativement stable au niveau des capitaux économique
et socio-culturel.
M. Katô reste relativiste vis-à-vis de l'objectif
d'un million de yens de revenu agricole. Cette attitude n'est pas simplement
due au fait qu'il s'intéresse uniquement à l'autoconsommation.
Mais elle est liée au fait qu'il est dans une situation de crise au
niveau des capitaux économique et socio-économique
(chômeur, dépression) : Comme il sait qu'il faut maintenant avoir
un autre travail en dehors des activités agricoles pour pouvoir vivre
économiquement, il n'a pas l'intention de se consacrer davantage
à ses activités agricoles. Puis, comme il a encore un fils allant
au collège avec lequel il faut passer du temps dans sa famille, il
envisage de s'investir davantage dans ses activités agricoles
après que son fils aura grandi.
M. Naruse porte un intérêt à long terme
concernant ses activités agricoles comme une occupation principale
après sa retraite. Sinon, il hésite entre
l'autoconsommation et la vente en raison de contraintes liées au
marché.
M. Itô, 43 ans, porte également un
intérêt à long terme pour l'agriculture en pensant au
problème qu'il rencontrera dans 10-1 5ans : celui d'Ikigai. Il montre
une motivation identitaire et sociale pour son implication dans le monde
agricole à travers l'idée de monter une association de stagiaires
dont il discute avec M. Suzuki. Son acte est comme le cas de M. Suzuki,
révélateur de son engagement qui pourrait être porteur de
perspectives à l'initiative de stagiaires eux-mêmes,
c'est-à-dire non à l'initiative d' « en haut »
émanant d'agents institutionnels, pour l'avenir du Projet
Nô-Life.
M. Shimizu est très critique vis-à-vis de
l'objectif d'un million de yens de revenu agricole. Pour lui, c'est un objectif
qu'il ne faut pas annoncer aux stagiaires, car il est absolument impossible
à réaliser. Ce sentiment contestataire se base sur ses
expériences de la vente de Kaki ainsi que celles du passé
liées à son foyer agricole qui n'a pas pu continuer sa production
agricole depuis une quarantaine d'années.
Son intérêt pour la participation à la
formation Nô-Life porte aussi sur le long terme : il pense à son
futur successeur auquel il pourra confier la gestion de ses terrains agricoles.
Il considère ses activités agricoles comme quelque chose de
différent d'un simple loisir mais indéfinissable.
Pour M. Isomura, la question d'Ikigai est également une
préoccupation importante. Il a rapidement opéré un
changement radical de son mode de vie : celui de type salarial à celui
de type « paysan » qui implique un mode d'utilisation du temps
complètement différent. D'après lui, c'est ce que beaucoup
de salariés retraités n'arrivent pas à réaliser en
général, à cause de leur tendance d'être
dépendant de l'entreprise, dite l' « homme de l'entreprise (kaisha
ningen) ».
S'il a une position plutôt équilibrée
vis-à-vis des trois pôles de l'agriculture de type Ikigai, mais il
pense néanmoins que trop de contraintes imposées à la
production par le marché risquent d'empêcher beaucoup de
stagiaires de Nô-Life de continuer leurs activités agricoles.
Groupe productiviste
Concernant deux hommes de ce groupe, loin de se mettre
à la simple recherche de la rentabilité, l'un essaie de
construire sa vie économique et sociale dans une situation de crise,
l'autre essaie de construire après sa retraite une vie fortement
liée à son identité agricole et paysanne du passé,
qui n'a jamais été oubliée dans sa trajectoire, tout en
mobilisant ses expériences passées et sa relation sociale.
M. Nichizawa poursuit toujours son objectif professionnel dans
la formation Nô-Life, tout en s'appuyant sur sa passion, son
intérêt à long terme (« jusqu'à la mort
»). C'est également une urgence par rapport à ses crises au
niveau des capitaux économique et socio-culturel : il est
célibataire et chômeur à l'âge de 43 ans.
Pourtant, les contraintes lourdes pour l'investissement dans la
production de fraises en serre, constituent un grand souci pour lui.
M. Kamihata poursuit, de manière persistante, son
objectif économique (plus d'un million de yens de revenu agricole). Ceci
malgré sa situation relativement stable en terme économique et
socio-culturel. Sa tentative d'une nouvelle installation agricole avec la
formation Nô-Life semble être, en quelque sorte, une quête
identitaire liée à ses expériences passées en tant
qu'agriculteur.
Au travers de sa nouvelle installation agricole, il a
l'intention de contribuer au développement local et rural notamment dans
une zone de moyenne montagne. Il veut notamment avoir le lien avec la
population locale surtout des rapports de coopération avec les gens de
sa génération : baby-boomers qui avaient quitté leur terre
pour travailler dans le secteur automobile, et qui vont prendre leur retraite
comme M. Kamihata.
Par ailleurs, la mobilisation et la compréhention de sa
famille sont indispensables pour lui. Il travaille par ses activités
agricoles avec son épouse, son fils et d'autres personnes de sa famille
(ex. famille de sa soeur). Avec ses activités agricoles, il a
également l'intention d'éviter d'être dépendant de
ses enfants lorsqu'il sera âgé. Au contraire, avec sa tentative
d'une entreprise agricole familiale, il souhaite pouvoir laisser à ses
enfants un « chemin » pour leur avenir. Donc, son engagement
s'inscrit également dans le contexte social du vieillissement.
Poids lourd de l'orientation productiviste du Projet
Nô-Life
Dans notre analyse des prises de position des stagiaires
enquêtés vis-à-vis de la vision de l'agriculture de type
Ikigai proposée par le Centre Nô-Life, nous avons constaté
une influence lourde de l'orientation productiviste de la formation
Nô-Life imposée sur les raisonnements des
enquêtés.
En effet, l'objectif d'un million de yens de revenu agricole
et la formation Nô-Life orientée par cet objectif constituant les
facteurs généraux et extérieurs aux contextes individuels
des enquêtés, font obstacle à leur accès au
pôle de la production matérielle à but lucratif dans leur
prise de position. Car cet objectif paraît trop productiviste,
contraignant voire irréaliste pour beaucoup de stagiaires. Ce qui
provoqua comme résultat leur éloignement général du
pôle de la production matérielle à but lucratif.
En plus, cette situation n'est pas seulement due au fait que
le niveau économique de l'objectif du Projet Nô-Life est trop
haut, mais plutôt au fait que cette orientation productiviste ne donne
pas la place aux autres espèces des capitaux dont les stagiaires ont
besoin, liées à leurs propres contextes économique et
socio-culturel. Et ces contextes, impliquant soit une situation de crise, soit
celle de stabilité à la suite de la trajectoire de chacun,
donnent aux stagiaires leurs propres motivations qui font ainsi la
diversité de leurs enjeux et représentations.
Dans notre analyse, on constate que l'agriculture de type
Ikigai donne souvent un sens aux stagiaires, dans la mesure où elle est
mise en relation avec leurs besoins du niveau socio-culturel. Et le pôle
de la production matérielle à but lucratif peut également
avoir un sens pour les stagiaires, mais à condition qu'il soit mis en
relation avec ce type de besoins. Sinon, l'agriculture de type Ikigai risque de
perdre sa propre valeur légitime au sein des représentations des
stagiaires.
En fait, ce constat-là nous permet de dépasser
l'interprétation générale que l'on donne souvent à
l'agriculture de type Ikigai d'un seul point de vue économique, comme
étant une activité économique qui dépasse le niveau
de loisir, mais moins important que le niveau professionnel (ex. «
agriculture qui permet de gagner de l'argent de poche »)
Il faut dire que notre constat peut être dans le cas
rare chez des deux stagiaires du groupe productiviste. Leurs raisonnements
particuliers ancrés dans leurs contextes économique et
socio-culturel jouent fortement dans la détermination de leurs actions
économiques.
Dans le cas de M. Nichizawa, il paraît logique qu'il
poursuive du moins formellement un objectif purement économique,
à la différence des autres stagiaires plus âgés, car
il essaie de devenir agriculteur professionnel « pour gagner [sa]
croûte » dans une situation de crise assez urgente qui
nécessite une construction importante tant en terme de capital
économique qu'en terme de capital socio-culturel. D'ailleurs, dans son
cas, il lui faudrait dégager un revenu beaucoup plus élevé
que le niveau donné par l'objectif du Projet Nô-Life pour
réaliser son objectif professionnel. Dans ce cas, la formation
Nô-Life sera même inadaptée à ce besoin, car sa
production devra être celle de type plus industriel orienté vers
le marché. C'est pour cela qu'il s'intéresse à la
production de fraises en serre recommendé par le Centre Nô-Life et
la CAT (Coopérative agricole de Toyota).
Dans le cas de M. Kamihata, il essaie de réaliser
l'objectif donné par le Projet Nô-Life, par une approche familiale
et quasi professionnelle. En effet, il n'a pas comme motivation dans sa
tentative, à la différence des autres stagiaires,
l'autoconsommation de ses produits, mais plutôt la reconstruction de son
identité après sa retraite en tant qu'un agriculteur
professionnel qui a connu à la fois une réussite et un
échec dans les années 60 à Kagoshima. Et cette
identité se distingue nettement de celle d'un agriculteur pluriactif
ordinaire. C'est pour cela que sa prise de position est finalement
éloignée des autres stagiaires originaires d'un foyer agricole
local de la Ville de Toyota.
Ensuite, nous allons voir les réflexions données
par les points de vue des stagiaires sur l'ensemble du Projet Nô-Life.
Elles vont constituer une sorte de réponses finales au Projet
Nô-Life qu'ils ont vécu.
5 Réflexion sur le devenir du Projet Nô
-Life
D'abord, il faut relever une limite imposée pour l'analyse
de cette partie. Les données analysées ici sont
beaucoup moins complètes que les données
analysées dans les parties précédentes. Ceci est dû
au fait qu'avec cette enquête par entretien, la possibilité
laissée aux enquêtés de développer leurs
réflexions était beaucoup plus limitée que dans
l'enquête par questionnaire, notamment en raison du manque de temps et
d'un rapport d'interaction enquêteur - enquêté qui s'impose
dans les entretiens.
Pour dégager les éléments des
réflexions menées par les enquêtés, nous avons
repris les trois groupes identifiés dans notre analyse de la prise de
position : groupe distancié ; groupe neutre ; groupe productiviste. Nous
présenterons notre analyse en groupant les avis positifs et
négatifs des enquêtés sur les trois thématiques
abordées : Rapport du Projet au développement local ; Bilan des
activités de la formation Nô-Life ; Avenir du Projet
Nô-Life. Bien que nous ne trouvions pas toujours de relation forte entre
ce groupement et les réflexions des enquêtés sur l'ensemble
du Projet Nô-Life, la division des enquêtés en ces trois
groupes nous permet de repérer certaines tendances de leurs
réflexions.
La thématique sur le Rapport du Projet Nô-Life au
développement local a recherché les avis des
enquêtés sur l'impact extérieur des activités du
Projet Nô-Life. Puis, la thématique sur le bilan des
activités de la formation Nô-Life a recherché l'
appréciation interne des activités du Projet Nô-Life par
les enquêtés. Enfin, la thématique sur l'avenir du Projet
Nô-Life, en demandant aux enquêtés s'il faut continuer le
Projet à l'avenir, a recherché la légitimité et la
valeur générale du Projet et les propres avis des
enquêtés sur les problèmes qui résident dans
l'orientation du Projet pour sa continuation future.
Rapport du Projet au développement local
Tableau : Avis des enquêtés sur le Rapport
du Projet Nô-Life au développement local
|
Avis positif
|
Avis négatifs
|
Avis pragmatiques
|
|
Groupe
distancié
|
- Motiv. souvent plus forte chez la pop.
non agri. que chez la pop. agri.. Il
faudrait que le Projet
se focalise + sur
les salariés retraités aisés (M.
Imai)
|
- Attente faible de la pop.
loc. ou agri. (M.
Shioya;
Mme. Tsuzuki; M. Imai)
|
|
|
Groupe
neutre
|
- Positif du pdv de l'identité
agri. et rur.
de la Ville de Toyota
(Mme. Kawamura,
M.Naruse, M. Shimizu)
- Positif du pdv de la communic.
entre
hab. loc. (Mme. Katô)
- Positif du pdv de l'agricult.
basée sur
la localité. Influence possib. sur
l'urbanisation
(M. Kobayashi)
- Positif, j'espère (M. Katô)
|
- Sceptique du pdv
fem. au
foyer encore insensibles
à
ce sujet (Mme. Konno)
- Pourquoi le nbre. de
stagiaires n'est
pas très
élevé par rap. taille de la
Ville ?(Mme
Mizutani)
- Négatif car motiv. des
salariés
retraités restera
incertaine (M. Naruse ; M.
Isomura)
|
- Cela pourra être positif avec
un réseau Nô-Life (M. Itô)
- Pour que
cela puisse être
positif, il faudrait créer un
zonage spécial pour les
activités
Nô-Life (M. Isomura)
|
|
Groupe
productiviste
|
- Pas d'avis
|
- Pas d'avis
|
|
(Liste d'abréviation. Motiv. : motivation
; pop. : population ; agri. agricole ; loc. : local ; pdv : point de vue ; rur.
: rural ; communic. : communication ; hab. : habitant ; agricult. : agriculture
; possib. : possibilité ; fem. : femmes ; nbre. : nombre)
Dans le groupe distancié, les trois
enquêtés originaires d'un foyer agricole local (M. Shioya, Mme.
Tsuzuki, M. Imai) ont souligné que le Projet Nô-Life a peu de
répercutions sur la population agricole, et qu'en réalité,
il est plutôt rare de trouver des personnes qui continuent leurs
activités agricoles parmi cette population dont la majorité est
pluriactive. D'ailleurs, M. Imai trouve qu'aujourd'hui, la population non
agricole est souvent plus motivée que la population agricole.
Dans le groupe neutre, les avis positifs et négatifs
coexistent avec des points de vue variés.
Concernant les avis positifs, les trois points de vue suivants
sont relevés par plusieurs personnes.
- Identité agricole et rurale de la Ville de Toyota (Mme.
Kawamura, M. Naruse, M. Shimizu) - Communication entre habitants locaux (Mme.
Katô)
- Rapport entre l'agriculture et la localité (M.
Kobayashi)
Mme. Kawamura, M. Naruse et M. Shimizu ont parlé,
chacun à sa manière, l'identité agricole et rurale de la
Ville de Toyota comme caractéristique du Projet Nô-Life et quelque
chose que le Projet Nô-Life essaie de mettre en avant. Pour Mme.
Kawamura, la Ville de Toyota est un cadre idéal de la campagne où
il y a la montagne, la moyenne montagne, la plaine et la Ville. Puis, M. Naruse
considère la Ville de Toyota comme une ville rurale qui se distingue
fortement des grandes villes comme Tôkyô où il a fait sa
carrière professionnelle. Et pour M. Shimizu, les produits agricoles
font, à côté des voitures de l'Automobile Toyota,
également partie de l'identité de la Ville de Toyota.
Mme. Katô qui a connu une amélioration de sa
relation conjugale via ses activités agricoles, souligne que le Projet
Nô-Life pourra animer la communication entre habitants locaux de la
Ville.
Pour M. Kobayashi, ayant hérité 1 .2ha de terrains
agricoles de ses parents, l'agriculture est un moyen par excellence
d'établir le lien social et territorial et de contribuer à sa
localité.
Concernant les avis négatifs, l'incertitude des
attentes vis-à-vis du Projet Nô-Life ainsi que de l'agriculture et
de la ruralité, du côté des femmes au foyer et du
côté des salariés a été relevée par
Mme. Konno, M. Naruse et M. Isomura.
Pour Mme. Konno, envisager le rapport du Projet Nô-Life
au développement local est difficile face au grand décalage
existant entre le mode de vie réel de la population locale et les
discours de plus en plus fréquents au niveaux politique et
médiatique sur l'alimentation comme la consommation de produits de
terroir ou la vente directe. Elle souligne, en se basant sur ce qu'elle
constate au quotidien, les femmes au foyer ne sont pas assez sensibles, en
réalité, à ce type de thématiques. Car elles vont
plutôt au supermarché acheter des plats préparés
pour économiser leur temps et leur travail de ménage. Et surtout
dans les foyers où le père travaille comme ouvrier en deux fois
huit dans le secteur automobile, il est rare que les pères se mettent
à table avec leur familles en raison de leurs emplois du temps
décalés. Cela ne permet pas à leurs épouses de
préparer des repas de famille de manière
élaborée.
M. Isomura, qui était fonctionnaire local dans la Ville
de Toyota, souligne, que les salariés retraités n'arrivent pas
changer facilement de mode de vie après leur retraite à cause de
leur tendance à être dépendants de leur travail à
l'entreprise. M. Naruse met en doute également l'attente réelle
du côté des salariés retraités.
Puis, M.Itô et M. Isomura pensent chacun à une
solution alternative. M. Itô pense qu'il faudrait créer un
réseau d'acteurs pour que le Projet puisse se développer à
long terme. C'est pourquoi il pense à organiser une association de
stagiaires. M. Isomura pense que l'entremise assurée par le Centre
Nô-Life ne sera pas suffisante pour réduire les friches agricoles.
Il pense qu'il faut que la Ville loue directement les friches agricoles, et les
gère en faisant appel au public pour leur participation à cette
gestion. Sinon, le Centre Nô-Life sera confronté à des
difficultés face à l'attitude égoïste des
propriétaires.
Bilan des activités de la formation Nô-Life
Concernant les avis positifs sur le bilan des activités de
la formation Nô-Life, la satisfaction sur l'apprentissage technique a
été exprimée dans chacun des trois groupes.
Concernant les avis négatifs, les trois points suivants
sont relevés par plusieurs enquêtés dans le groupe
distancié et le groupe neutre.
- Manque d'enseignement sur l'entretien des cultures (M. Shioya,
M. Isomura) - Méthode trop coûteuse (M. Imai, M. Kobayashi)
- Ambiguïté entre l'amateurisme et le
professionnalisme (Mme. Katô, M. Nichizawa)
En effet, dans les cours pratiques de la formation
Nô-Life, ce sont souvent les employés qui se chargent de
l'entretien quotidien des cultures, alors que les stagiaires, au moment des
cours se déroulant une fois par semaine, n'assistent que partiellement
au déroulement des procédés agricoles (labour, semis,
fumage, récolte etc.). C'est pourquoi les stagiaires ne peuvent pas
connaître des techniques importantes pour l'entretien quotidien des
cultures. Un bon nombre de stagiaires semblent partager cet avis.
Dans la formation Nô-Life, on n'enseigne principalement
que les méthodes culturales conventionnelles avec l'utilisation, de
manière spécialisée et standardisée, de machines
agricoles, d'engrais chimiques, de pesticides et d'herbicides.
Mais cette méthode est adaptée plutôt
à la production à grande échelle destinée à
la distribution au marché, plutôt qu'à la production
à petite échelle que les stagiaires Nô-Life sont
censés exercer après la formation. Là, il y a donc un
rapport certain à l'objectif d'un million de yens de revenu agricole. Et
l'intérêt économique de la part de la Coopérative
agricole est également présent sur ce point (vente de
matériels agricoles)759.
Tableau : Avis des enquêtés sur le Bilan des
activités de la formation Nô-Life
|
Avis positif
|
Avis négatifs
|
Autres
|
|
Groupe
distancié
|
- Bon apprent. tech.(Mme
Tsuzuki)
|
- Manque d'enseig. sur l'entretien
cultures(M. Shioya)
- Méthode trop conventionnelle,
compliquée et coûteuse (M. Imai)
|
|
|
Groupe
neutre
|
- Projet m'a donné des rêves à
réaliser (Mme. Kawamura)
- Très satisfait de la format. Bon accueil et
enseignement (Mme. Mizutani)
- Bon apprent. tech. (M.
Kobayashi, M. Naruse, M.
Shimizu)
- Camarades (M. Naruse)
- Apprent.connais. gén. (M. Itô)
|
- Enseignement inadapté à la
prod.profes., d'où l'ambiguïté entre
l'amateurisme et le professionnalisme (Mme. Katô)
- Méthode trop coûteuse (M.
Kobayashi)
- Manque d'enseig. sur l'entretien
cultures (M. Isomura)
|
|
|
Groupe
productiviste
|
- Très satisfait de la format., avec bons accueil et
personnels, j'en ai très bien profité (M. Kamihata)
|
- Quantité cours insuffisante (M.
Nichizawa)
|
Cela dépendra du résultat (si je vais devenir
professionnel ou pas) (M. Nichizawa)
|
(Liste d'abréviation. Apprent. :
apprentisage ; tech. : technique ; enseig. : enseignement ; format. : formation
: connais. : connaissances : gén. : général ; prod. :
production ; profes. : professionnels)
M. Imai, M. Kobayashi le soulignent parce qu'ils savent dans
leurs expériences qu'une telle méthode est trop coûteuse et
irréaliste pour beaucoup de foyers agricoles pluriactifs.
Mme. Katô se persuade que la formation Nô-Life
n'est adaptée ni aux amateurs de l'agriculture, ni aux professionnels de
l'agriculture. Elle avait l'intention de mener une production de fraises en
serre après la formation, mais elle s'est rendue compte qu'il faudrait
pour cela beaucoup plus d'investissements écoomiques qu'elle ne
l'imaginait. D'après elle, deux ans de formation Nô-Life ne
suffisent pas pour gérer une production à grande
échelle.
C'est ainsi que M. Nichizawa trouve, lui aussi, que le nombre de
cours de la formation est insuffisant pour devenir agriculteur
professionnel.
759 Comme nous l'avons vu dans le Chaitre 3, ce point est
même explicité dans le plan politique de la « Zone
spéciale de la Création de Nô-Life » en terme des
effets économiques de la politique de la Zone spéciale de la
Création Nô-Life.
Avenir du Projet Nô-Life
Si la grande majorité des enquêtés
justifient la nécessité de la continuation et la valeur
générale du Projet, ils forment souvent un certain nombre de
demandes pour sa continuation ultérieure. Ce qui montre qu'un grand
nombre des stagiaires prennent conscience que le Projet est encore dans un
stade de tâtonnement, et qu'ils ne sont pas totalement satisfaits de
l'état actuel du Projet.
Tableau : Avis des enquêtés sur l'Avenir du
Projet Nô-Life
Avis positif Avis négatifs
|
- Je justifie le Proj. avec optimisme (Mme Tsuzuki)
- Je justifie le Proj., mais demande d'ajouter un enseig. sur
la
méth. de l'agricult. bio (M. Imai)
|
|
- Je justifie le Proj., mais demande d'avoir + de concertation
entre les amateurs et les professionnels de l'agricult. (Mme. Kawamura)
- Je justifie le Proj., mais demande d'intensifier + la
format. avec + de stagiaires. Retraités doivent commencer (activ. agri.)
le plus tôt possible, car ils n'auront pas beaucoup de temps (au max 10
ans) (M. Mizutani)
- Je justifie le Proj., mais demande d'avoir + de choix de type
de formation (M. Naruse)
- Je justifie le Projet (M. Katô)
- Je justifie le Proj., mais demande d'avoir un réseau de
coopération (M. Itô)
- Je justifie le Proj., mais demande d'un élargissement du
Centre Nô-Life à d'autres quartiers (M. Shimizu)
- Je justifie le Proj., mais demande de créer un rap. de
confiance entre le Proj. Nô-Life et les propriétaires ruraux (M.
Isomura)
|
Groupe
distancié
Groupe neutre
- Pessimiste sur la continuat. Proj. en raison de
l'incertitude attentes citoyens(M. Shioya)
- Critique sur la vision du fond du Proj. Si on ne la change
pas, il risque de décliner(M. Suzuki)
- Critique sur l'ambiguïté de la vision du Projet.
Il faut la clarifier en concertant + les stagiaires (Mme. Katô)
Groupe - Pas d'avis - Pas d'avis
productiviste
(Liste d'abréviation. Proj. : projet ;
méth. : méthode ; continuat. : continuation ; rap. : rapport)
Concernant les avis positifs, les demandes sont variées
dans le groupe distancié et le groupe neutre.
M. Imai, à la recherche d'une méthode
économe pour maintenir ses terrains agricoles familiaux, il demende un
enseignement de l'agriculture biologique. Mme. Kawamura, elle aussi,
pratiquante d'une méthode de la culture de type écologique,
demande à avoir plus de communication entre les amateurs et les
professionnels dans la formation Nô-Life, car elle trouve
déséquilibrée la situation actuelle de la formation sur ce
point. Mme. Mizutani, désireuse d'augmenter sa compétence pour
développer à son initiative une production familiale, demande
à intensifier plus le contenu de la formation Nô-Life. M. Naruse,
également intéressé par la méthode de type
écologique, demande à avoir plus de choix dans la formation. M.
Shimizu, le plus âgé parmi les stagiaires de Nô-Life, fils
d'agriculteur et salarié retraité, souhaite que le Projet
Nô-Life se développe davantage en élargissant ses aires
géographiques dans la Ville de Toyota. Il veut chercher parmi les
stagiaires de Nô-Life le futur successeur à la gestion de ses
terains agricoles. M. Isomura, lui-même propriétaire de terrains
agricoles et loueur d'une partie de ses terrains à des particuliers
comme jardin potager, relève la nécessité de créer
un rapport de confiance entre le Projet Nô-Life et les
propriétaires ruraux pour que le système de l'entremise de
terrains agricoles puisse fonctionner.
Concernant les avis négatifs, dans le groupe
distancié, M. Shioya reste pessimiste sur la continuation du Projet, car
l'attente des citoyens vis-à-vis de ce Projet lui paraît
incertaine. Et M. Suzuki, comme nous l'avons vu plus haut, met en doute le
fondement du Projet Nô-Life : combinaison entre Ikigai des personnes
âgées et la préservation des terrains agricoles.
Dans le groupe neutre, Mme. Katô considère
l'ambiguïté de la vision du Projet comme un danger : par exemple,
pour les jeunes voulant devenir agriculteur professionnel avec la formation
Nô-Life. Pour elle, si la vision reste ambiguë entre l'amateurisme
et le professionalisme, il ne faut pas accueillir les jeunes gens qui ont
encore un avenir à construire sur le long terme. Sinon, il faudrait
clarifier la vision du Projet en concertant plus les stagiaires.
3 Réponses aux questions
1 Quel lien entre les différents types de stagiaires
et les représentations ?
Catégories objectives et subjectives, et
représentations
Quel lien entre les différents types de stagiaires et
les représentations ? Pour répondre à cette question, nous
allons d'abord mettre à plat la terminologie de notre recherche. La
typologie des stagiaires relève des deux types de catégories
suivantes : catégories objectives ; catégories subjectives.
Les catégories objectives sont les éléments
possibles à déterminer de l'extérieur du sujet
concerné comme : âge, sexe, lieu d'origine, expériences
professionnelles etc. Mais que désignent les catégories
subjectives ?
Nous entendons par ces catégories les sens
donnés et raisonnés par le sujet vis-à-vis d'un objet
donné. Pour l'expliquer, prenons un exemple : quelqu'un qui aime le vin
: nous pouvons objectivement le considérer comme « amateur de vin
». Mais suite à cette catégorie objective, nous pouvons nous
poser la question suivante pour en savoir plus : « amateur de vin,
d'accord, mais dans quel sens ? Et pourquoi ? »
Cette question peut conduire le sujet concerné à
mener des raisonnement particuliers sur le fait qu'il est amateur du vin dans
divers sens, soit politique, soit économique, soit philosophique, soit
religieux, soit gastronomique, soit par tradition familiale ou locale, soit
personnel etc.
C'est ce type de raisonnements ou de sens donnés par le
sujet concerné que nous entendons par les catégories subjectives.
Autrement dit, ceux qui peuvent relever de la question de « pourquoi
» donnant une raison ou un sens à une catégorie objective
attribuée à la personne. Et c'est dans cette dimension-là
que nous mettons en question les représentations : nous entendons par
celles-ci les éléments subjectivement mis en relation avec une
catégorie objective ou un objet donné. Autrement dit, les
représentations sont des éléments d'idées donnant
des liens significatifs entre un sujet et un objet.
Dans ce sens-là, nous pouvons rejoindre la
définition suivante des représentations sociales données
par B. Fraysse : « modes spécifiques de connaissances du
réel qui permettent aux individus d'agir et de communiquer760
»
Prenons le cas du Projet Nô-Life. Pour Mme. Konno,
l'agriculture n'avait pas de sens pour elle avant de participer à la
formation Nô-Life, même si elle la connaissait certainement de
manière générale. A partir du moment où ses trois
petits enfants sont tous entrés à l'école maternelle, elle
est arrivée à faire le lien entre sa vie et l'agriculture dans le
sens où celle-ci s'est avérée utile pour rendre compatible
le maintien de son « territoire
760 Fraysse, 2000 : 651.
d'(elle)-même » et ses rôles d'épouse et
de mère de trois enfants.
Sans reprende toute son histoire de suite, nous pouvons
soulever au moins les éléments suivants comme
éléments de représentation de l'agriculture chez Mme.
Konno : territoire individuel (« territoire de soi-même ») ;
rôles domestiques en tant que femme (épouse et mère). Et
ces représentations relèvent de son choix opéré
entre un travail à temps partiel quelconque et la production agricole
à petite échelle susceptible de dégager un revenu
supplémentaire (figues ou pêche dans sa motivation initiale) Puis,
c'est son intention plus stratégique et idéale pour construire sa
vie qui détermine le sens de ces représentations.
Schéma : Représentations de l'agriculture
dans la vie de Mme. Konno

Rôle épouse
Mme. Konno
Agriculture
Territoire individuel
Rôle mère de trois enfants
Représentations en action
Ensuite, suite à l'exemple de Mme. Konno, nous pouvons
considérer que les représentations peuvent fortement
dépendre des actions concrètes du sujet. Autrement dit, nous
présupposons ici que nous ne pourrons pas parler de ses
représentations sans parler de son acte de participation à la
formation Nô-Life suivi d'une série de pratiques, activités
et mises en oeuvre concernées.
Il s'agit là de poser la question de « comment »
: comment les sujets (acteurs) mettent en action, pratiquent ou mettent en
oeuvre leurs représentations ? Nous parlons ici des
représentations vécues par les sujets.
Et nous devons prendre en considération les
possibilités de changements des représentations au cours de cette
expérience chez le sujet concerné, il s'agit des
représentations mises en relation avec la réalité
objective et d'autres représentations extérieures au sujet.
Par rapport à la réalité objective, les
représentations peuvent inévitablement être
confrontées aux catégories objectives attribuées au
sujet.
Schéma : Représentations en action dans
une situation réelle

Catégorie objective A
Rep.A
Sujet A
Rep.B
Objet
Catégorie objective B
Rep.C
Rep.D
Rep.E
Sujet B
Chez Mme. Konno, malgré ses représentations
spécifiques quelconques, d'un côté, elle devra rester
femme, avoir un certain âge et un certain niveau de vie
économique, et tenir compte de tous ces éléments qui
entrent dans la situation réelle de son action de la participation
à la formation Nô-Life.
Puis, de l'autre côté, il est inévitable pour
les représentations d'être confrontées à d'autres
représentations données de l'extérieur qui touchent le
même objet dans la dimension de l'action du sujet.
Les représentations de Mme. Konno peuvent être
confrontées aux représentations préalablement
données au Projet Nô-Life par les agents gestionnaires, comme par
exemple l'agriculture de type Ikigai avec un certain nombre
d'éléments de définition attribués par ces agents
(nous les avons étudié dans le chapitre 2).
Les réalités objectives et les
représentations extérieures peuvent ainsi constituer des facteurs
de dynamiques de représentations.
Représentations dans la temporalité de l'action
Etudier les représentations qui sont en action dans une
situation réelle nous amène également à les situer
dans la temporalité. Via cette introduction de la temporalité
dans notre analyse, nous pouvons appréhender les catégories
objectives et subjectives des sujets en terme de leur trajectoire.
D'où les cinq moments de la vie des stagiaires dans le
Projet Nô-Life que nous avons établi, à partir desquels
nous avons essayé de saisir les représentations en action au sein
des stagiaires de la formation Nô-Life : trajectoire (antérieure)
; motivation initiale ; changement d'idées, d'activités et de
mode de vie ; prise de position vis-à-vis de l'agriculture de type
Ikigai ; réflexions sur le devenir du Projet Nô-Life.
Et les représentations situées dans ces cinq
moments peuvent interagir, se construire ou se reconstruire, ce qui peut
finalement permettre aux sujets de changer (conserver ou transformer) la
trajectoire ultérieure. Ce qui nous permet de voir la construction
possible d'une nouvelle typologie du sujet dans le temps ultérieur.
Etude des dynamiques de représentations de l'agriculture
et de la ruralité dans le « jeu » du Projet Nô-Life
Suite à notre réflexion théorique
menée plus haut, reformulons notre recherche du Projet Nô-Life
avec l'exemple de Mme. Konno.
Quant à sa participation à la formation
Nô-Life, nous avons d'abord essayé de saisir les
éléments de représentations qui entrent dans l'esprit de
cette participation, que nous traitons comme parties des catégories
subjectives de Mme. Konno. Pour désigner ces parties, nous avons
employé le terme de la « motivation initiale » de sa
participation.
Ici, notre question se porte sur les dynamiques des
représentations de l'agriculture et de la ruralité à
travers le Projet Nô-Life. Et comme nous l'avons analysé, le
Projet Nô-Life lui-même porte certaines représentations de
l'agriculture et de la ruralité en tant qu'une politique publique, qui
constituent également la motivation initiale et « officielle »
du projet Nô-Life de la part des agents gestionnaires du Projet (BPA et
CAT761) et d'autres agents institutionnels concernés.
Du côté des stagiaires, les
éléments de représentations constitutifs de la motivation
initiale de la participation à la formation Nô-Life, entrent en
relation à la fois avec le devenir de cette action-même et les
représentations du Projet Nô-Life données par les sujets
extérieurs dont principalement les agents gestionnaires, qui impliquent
celles de l'agriculture et de la ruralité.
Nous entendons par cette relation un « jeu » des
représentations de l'agriculture et de la ruralité à
travers le processus du Projet Nô-Life au sein de différents types
d'acteurs concernés. Ensuite, nous avons analysé les aspects de
confrontation entre les représentations portées par les
stagiaires (usagers du Projet), et les agents institutionnels (gestionnaires du
Projet) dans les différents moments de ce jeu : changements
d'idées, d'activités et de mode de vie ; prise de position
vis-à-vis de l'agriculture de type Ikigai ; réflexions sur le
devenir du Projet Nô-Life.
Processus du Projet Nô-Life : un nouveau monde
émergeant de l'agriculture de type Ikigai
Ce jeu du Projet Nô-Life se situe dans les
temporalités des différents types d'acteurs. Ces
temporalités constituent un monde particulier et émergeant de ce
Projet constitué par les trois pôles de l'agriculture de type
Ikigai que nous avons établi dans l'analyse du processus de
l'émergence du Projet Nô-Life au Chapitre 2 : qualité de
vie ; lien social et territorial ; production matérielle. Ici, nous ne
confondons donc pas ces trois pôles avec les représentations
officiellement données par les gestionnaires du Projet. Car les porteurs
des représentations de l'agriculture de type Ikigai ne sont ni seulement
ces gestionnaires, ni le Projet Nô-Life (nous avons vu dans le processus
d'autres projets qui sont en relation avec le Projet Nô-Life). Donc, les
agents gestionnaires du Projet Nô-Life ne sont que quelques-uns parmi
d'autres porteurs des représentations, mais avec leur
spécificité en tant qu'agent singulier, leur mode d'action (ou
mode de vie du Projet), et leur prise de position dans ce jeu.
Typologie et représentations
Dans ce monde émergeant, la typologie des acteurs peut
être à la fois comme déterminant et déterminé
par rapport à leurs représentations suite aux conséquences
du jeu. Autrement dit, les catégories objectives ou subjectives des
acteurs deviennent elles-mêmes des objets de changement (transformation
ou conservation) en entrant dans les trajectoires spécifiques des
acteurs qui sont « en cours ».
La relation entre la typologie des stagiaires et leurs
représentations est donc cyclique et évolutive, par
l'intermédiaire du jeu de ces représentations, dans la
temporalité du monde émergeant avec le processus du Projet
Nô-Life762.
761 BPA : Bureau de la Politique Agricole de la
Municipalité de Toyota ; CAT : Coopérative agricole de Toyota.
762 Nous pouvons mettre en parallèle cette relation avec
la fameuse question de la relation dialectique et évolutive entre la
poule et l'oeuf : « qu'est-ce qui est apparu en premier, l'oeuf ou la
poule ? »
Schéma : Relation entre la typologie et les
représentations

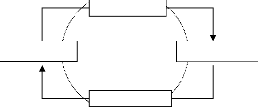
Catégorie objective
Jeu dans la temporalité
Typologie
Catégorie subjective
Représentations
2 Positions des stagiaires vis-à-vis de
l'idée du Projet Nô-Life sur l'agriculture de type Ikigai ?
Quelles positions les stagiaires établissent-ils
vis-à-vis de l'idée du Projet Nô-Life (agriculture de type
Ikigai) ? Divergence ou convergence des positions ?
Nous pouvons répondre à cette question en nous
basant sur nos analyses des changements d'idées, d'activités et
de mode de vie, ainsi que des prises de position vis-à-vis de
l'agriculture de type Ikigai, effectuées plus haut.
Dans l'analyse des changements d'idées, et
d'activités et de mode de vie au cours de leur formation Nô-Life,
les six groupes d'enquêtés que nous avons établi à
partir de leurs motivations initiales ont montré leurs diverses
manières d'agir (ou réagir) dans la situation de la formation
Nô-Life, en relation avec leurs circonstances et trajectoires
individuelles que nous considérons comme facteurs intérieurs de
leurs actions.
Puis, comme facteur extérieur et général
aux stagiaires, nous pouvons soulever des contraintes économiques que
les activités agricoles peuvent entraîner en terme
d'investissement (équipements, travail, exigences du marché).
Elles sont ressenties de manière négative, mais
différemment chez les uns chez les autres, ce qui provoque tantôt
des changements d'idées qui éloignent les positions des
stagiaires du pôle de la production matérielle, tantôt une
hésitation entre ce pôle et les deux autres pôles,
tantôt un dilemme entre l'engagement fort aux activités du Projet
Nô-Life et les contraintes ressenties pour mener ces activités.
Ceci constitue un point commun parmi la plupart des
enquêtés763.
Puis, dans l'analyse des prises de position des stagiaires
vis-à-vis de l'agriculture de type Ikigai, nous avons
repérés trois groupes parmi les stagiaires enquêtés
: groupe distancié, groupe neutre et groupe productiviste.
Si d'un côté, il y a une divergence des positions
entre les enquêtés, elle est liée aux circonstances
individuelles du présent ou à court terme, qui s'inscrivent dans
leurs trajectoires impliquant, comme nous l'avons analysé, quatre
variantes de situation (crise ou stabilité au niveau des capitaux
économique et socio-culturel). Ces facteurs intérieurs
constituent finalement la diversité des enjeux et des
représentations au sein de nos enquêtés. Et par là,
cette diversité sous-tend la divergence de positions.
Mais de l'autre côté, nous trouvons une convergence
forte ou un point commun susceptible de constituer une source de convergence :
ceci peut s'expliquer par les deux points suivants négatif et
positif.
Le point négatif est, comme nous l'avons
constaté dans la partie des Changements d'idées, que la plupart
des enquêtés se retrouvent confrontés à la
difficulté liée aux contraintes économiques que risquent
d'entraîner une production agricole à but lucatif. D'où une
série de critiques et de doutes chez les enquêtés
vis-à-vis de l'objectif productiviste de la formation Nô-Life
représenté par celui d'un million de yens de revenu agricole
763 Cette tendance est commune sauf pour Mme. Tsuzuki et M.
Kamihata. Car Mme Tsuzuki n'a en ce moment l'intention ni de développer
sa production agricole dans ses terrains familiaux, ni de s'occuper de la
production à son initiative car sa belle-mère est encore active.
Puis, M.Kamihata poursuit de manière persistante son objectif
économique pour une raison identitaire et particulièrement forte
par rapport aux autres stagiaires.
annuel.
Trois enquêtés du groupe distancié (sauf
Mme. Tsuzuki dont la raison est expliquée plus haut) et tous les
enquêtés du groupe neutre critiquent ou mettent en doute soit cet
objectif productiviste, soit le contenu de la formation Nô-Life trop
orienté par ce dernier imposant une méthode d'agriculture
conventionnelle trop coûteuse et non rentable. Et ce point éloigne
comme résultat les positions de ces enquêtés du pôle
de la production matérielle.
Ensuite, nous pouvons soulever un point positif qui pourrait
constituer une source de convergence : ils considèrent tous (sauf trois
personnes du groupe distancié, M. Shioya, Mme. Tsuzuki, M. Imai)
l'agriculture comme Ikigai. Et ceci pour divers besoins socio-culturels qui
portent souvent sur un intérêt sur le long terme, plutôt que
pour des besoins économiques sur le court terme. En plus, ces besoins
socio-culturels ne sont pas dissociés du pôle de la production
matérielle.
Nous avons pu trouver plus clairement ces aspects dans le
groupe neutre dont cinq enquêtés du type de trajectoire 2,
marqués par une situation de crise au niveau du capital socio-culturel
(cas de Mme. Kawamura, Mme. Katô, Mme. Konno, Mme Mizutani et M.
Kobayashi). Puis, cela va de même chez les autres enquêtés
de ce groupe, mais de manière plus individuelle dans une situation
stable (type de trajectoire 1), et ensuite chez les deux hommes du groupe
productiviste de manière différente de l'un à l'autre, en
raison de deux trajectoires totalement différentes (M. Nichizawa et M.
Kamihata). Et même chez les quatre enquêtés du groupe
distancié, nous avons constaté que leurs motivations ou
engagement restent potentiellement forts, malgré leur éloignement
des trois pôles de l'agriculture de type Ikigai pour diverses
circonstances individuelles (cas de M. Imai et Mme. Tsuzuki) et obstacles
ressentis par rapport à l'orientation actuelle du Projet Nô-Life
(cas de M. Suzuki). Ils sont donc en réalité loin d'être
totalement désintéressés du monde de l'agriculture de type
Ikigai, mais potentiellement motivés ou engagés par celle-ci.
Suite à notre constat de ces points négatifs
(obstacle posé par l'orientation productiste du Projet Nô-Life) et
positifs (motivation pour Ikigai dans le sens socio-culturel), nous pouvons
dire qu'un point de convergence entre les enquêtés est qu'ils sont
confrontés au même dilemme : la difficulté de rendre
compatible ces deux exigences économique et socio-culturel.
D'ailleurs, un certain nombre d'avis positifs et
négatifs exprimés dans les réflexions sur le devenir du
Projet Nô-Life nous ont confirmé ce dilemme auquel les
enquêtés sont confronté, et auquel le Projet lui-même
n'arrive pas encore encore à faire face.
Nous pouvons nous référer notamment à ceux
portant sur le Bilan des activités de la formation Nô-Life et
l'Avenir du Projet Nô-Life.
Sur le Bilan, si nous avons constaté la satisfaction
généralement exprimée par un bon nombre
d'enquêtés dans les trois groupes (dix personnes), cela se
limitait au niveau de l'apprentissage de la technique de base qui est, en fait
une demande instrumentale générale et un intérêt sur
le court terme présente chez tous les enquêtés (ce point a
été confirmé par le résultat de l'enquête par
questionnaire)
Puis, les trois points relevant des avis négatifs sur
le Bilan sont révélateurs de l'ambiguïté
résidant dans le principe et le contenu de la formation Nô-Life :
ambiguïté de l'objectif entre l'amateurisme et le professionnalisme
qui implique d'un côté, un manque d'enseignement sur l'entretien
des cultures (amateurisme), de l'autre une méthode agricole trop
coûteuse relevant de l'agriculture conventionnelle
(professionnalisme).
Sur l'Avenir, si un grand nombre d'enquêtés
justifient la légitimité et la valeur générale du
Projet Nô-Life, ils ont toujours exprimé différents points
d'insatisfactions sur le Projet Nô-Life, soit sur la concertation entre
stagiaires et gestionnaires, soit sur le contenu de la formation (plus de
quantité et de qualité), soit sur la forme de l'organisation du
Projet sur le long terme (élargissement institutionnel ou transformation
à un réseau de coopération). Puis, n'oublions pas des
réflexions critiques sévères portant sur le fond du Projet
(ambiguïté du principe du Projet d'un côté,
incertitude des attentes du public de l'autre).
3 Conséquences pour les stagiaires, du compromis
entre les agents gestionnaires
Le compromis basé sur la divergence
d'intérêts entre les agents gestionnaires produisant
l'ambiguïté ou la contradiction de la finalité du Projet
Nô-Life. Quelles conséquences aura-t-il pour les stagiaires ?
Pour répondre à cette question, rappelons-nous
d'abord l'analyse que nous avons effectuée dans la chapitre
précédent sur la relation de compromis établie entre les
acteurs institutionnels au travers du processus de la construction du Projet
Nô-Life.
Compromis précontraint
Ce compromis institutionnel est d'abord le produit d'un
processus historique marqué par une série de bricolages
intersectoriaux qui se sont successivement opérés ces dix
dernières années. Par là, nous pouvons relever une des
caractéristiques de ce processus : la dépendance de celui-ci
vis-à-vis des instruments existants. Le principe du compromis ainsi
établi pour le Projet Nô-Life implique donc nécessairement
une certaine incertitude ou imprévisibilité de son
résultat, de sa finalité voire de sa vertu.
Concrètement parlant, le Projet Nô-Life, ses
gestionnaires et agents partenaires dépendent de ceux qu'ils
intrumentalisent pour la mise en oeuvre du Projet. D'un côté, il
s'agit notamment des réactions de ces agents eux-mêmes qui
s'instrumentalisent, ainsi que de leurs instruments non-humains qui sont
disponibles, de l'autre, des réactions des stagiaires ainsi que de leurs
instruments humains et non-humains qui sont disponibles.
Comme le relève Lévi-Strauss, un tel processus
est caractéristique du bricolage comme étant un processus de
« reconstruction incessante à l'aide des même
matériaux ». Cette remarque est intéressante pour voir
plusieurs actions constructives comme un processus, mais non comme une
série de simples contingences. Ceci, bien que nous nous gardions de
rejoindre totalement le point de vue de Lévi-strauss : comme nous
l'avons déjà dit, aujourd'hui rien qu'en tenant compte de la
mobilité physique, sociale et informative764, il est
très difficile de déterminer réellement (non
théoriquement) la structure invariante des instruments tel que
Lévi-Strauss entend la conceptualiser. Ces éléments
interagissants765qui sont à la fois instrumentalisés
et instrumentalisant, se constituent réciproquement comme «
interlocuteurs » et « bricoleurs »766.
Puis, comme relève encore Lévi-Strauss, chaque
instrument (actant) a sa structure déterminée par ses fins (ou
raison d'existence) antérieures767, et le processus et le
résultat du bricolage sont ainsi précontraints par une telle
structure instrumentale.
Concrètement parlant, le processus de la construction
du Projet Nô-Life et son résultat (sa finalité et sa
vertu), sont précontraints par les structures des acteurs
mobilisés, à savoir leurs identités antérieures
ou
764 D'ailleurs, cette conception semble fortement se baser sur
un présuposé théorique particulier que nous ne rejoignons
pas forcément : celui de l'universalité de l'esprit humain. Une
telle vision ne produit-elle pas la dichotomie absolue entre « la culture
et la nature » sur laquelle se base, en fait, la réflexion de
Lévi-strauss ? Ainsi, dit-il : « Sur l'axe de l'opposition
entre nature et culture, les ensembles dont ils [l'ingénieur et le
bricoleur] se servent sont perceptiblement décalés. En effet, une
des façons au moins dont le signe s'oppose au concept tient à ce
que le second [bricoleur] se veut intégralement transparent à la
réalité, tandis que le premier [ingénieur] accepte, et
même exige, qu'une épaisseur d'humanité soit
incorporée à cette réalité. »
(Lévi-Strauss, 1962 : 34) S'il faut dépasser cette dichotomie
dans notre épistémologie, il suffit de se référer
à la pensée de « Fûdo » de T. Watsuji
(1889-1960), philosophe japonais. Pour lui, la nature telle qu'elle est
conceptualisée de façon à l'opposer à l'être
humain, n'est qu'un produit d' « objectivation » humaine qui est, en
fait, elle-même déjà déterminée par
Fûdo dont la définition possible du terme est une condition
écologique de l'existence humaine (Watsuji, 1979 : 3).
765 Ceci renvoit à la notion d' « actant »,
terme désignant les êtres humains et leurs objets interagissants
dans la société. Depuis que B. Latour a employé ce terme,
certains sociologues francophones préfèrent l'employer comme
terme au lieu d'utiliser les termes habituels comme acteur, agent, individuel.
Cela va ainsi chez Boltanski et Thévenot : « Boltanski et
Thévenot se montrent critique à l'égard de l'usage des
catégories sociologiques habituelles : individus, groupe, classe,
culture, société, etc. L'enjeu essentiel est, pour eux, de se
débarasser de toutes les formes de catégorisation a priori afin
de pouvoir élucider les processus, dynamiques sociales et
opérations cognitives qui sont à l'oeuvre chez les personnes
ordinaires. Pour ce faire, ils se servent notamment du concept d'actant,
d'être, d'état... » (Nachi, 2006 : 49).
766 Pour Lévi-Strauss, la structure instrumentale est
également considérée comme limitant le pouvoir de
l'ingénieur, une fois que celui-ci est obligé d'entrer dans un
rapport de « dialogue » avec son objet (Ibid. 33)
767 Lévi-Strauss, 1962 : 35.
trajectoires, ainsi que leurs ressources disponibles, relations
préétablies voire les circonstances intégrées
à leurs actions.
Ambiguïté du compromis Nô-Life : situation
déséquilibrée
Puis, nous avons mis en évidence les dispositifs
construits pour lancer le Projet Nô-Life au travers d'une série
d'actions et de communications, que nous avons tenté
d'interpréter en terme de la transaction sociale pour désigner le
type de dynamique de la relation sociale entre acteurs dans le processus de la
construction du Projet Nô-Life, ainsi que du transcodage pour
repérer la technique opérée pour la mise en relation des
acteurs institutionnels dans ce processus ; et ensuite du compromis pour
spécifier l'état de la relation sociale ainsi établie
entre ces acteurs.
Et nous avons constaté la présence de
l'idée du bien commun dans ce compromis. Bien commun dont la
signification donnée par les acteurs institutionnels est : agriculture
et ruralité ; les objets du Projet. Cette idée constitua la base
du compromis en supposant d'abord, selon Boltanski, l'impossibilité de
la sortie de crise à laquelle les parties sont confrontées :
crise agricole d'un côté, vieillisement
accéléré de la population de l'autre. Cette relation
implique qu'elle ne se base pas uniquement sur les intérêts
particuliers de chacune des parties, mais sur une idée qui les comprend.
Et cette idée, formulée comme « promotion de l'agriculture
de type Ikigai », implique inévitablement des contraintes relevant
de « grandeurs » de mondes dans lesquels appartient chacun des
parties, à savoir : monde agricole professionnel d'un côté,
monde des services publics locaux du vieillissement.
Puis, comme le définit Thévenot, ce compromis
« cherche à être justifiable » dans son principe en tant
qu'une politique publique dans son application réelle face à
l'épreuve de la vie de ses usagers (stagiaires), et essaie d'atteindre
un « équilibre global ».
Par là, nous pouvons rejoindre l'approche de la
transaction sociale de M. Mormont, qui consiste également à
créer de nouveaux dispositifs alternatifs comme « cadre
stabilisateur » des anticipations des agents concernés, sur
lesquelles se basent leurs identités et intérêts sur le
long terme. Et ceci tout en dépassant les conflits dus aux
intérêts particuliers sur le court terme. Puis, il en est de
même du transcodage de P. Lascoumes, qui consiste à «
équilibrer » les dispositions divergentes des agents.
Ce compromis implique nécessairement une
ambiguïté de son principe dans la mesure où il ne peut pas
mettre en cause les identités des parties. D'où la
présence de : contraintes liées à des grandeurs
incompatibles a priopri, objets hétérognènes relevant de
différents mondes, situation de de représentation et de pouvoir
déséquilibrée. Nous avons ainsi constaté une
situation de pouvoir déséquilibrée entre deux mondes
divergents (monde agricole professionnel et services publics locaux du
vieillissement), marquée par l'emprise réelle de l'ensemble des
agents du monde agricole professionnel, ainsi que par la position ambiguë
du gestionnaire principal du Projet (BPA) coincé entre ces deux mondes
divergents.
Et cette situation de pouvoir se reflète dans les
représentations sociales ancrées dans les positions de ces
acteurs. Du coup, les représentations portant sur la qualité de
vie et le lien social et territorial sont très faiblement
représentées (au sens politique du terme) par rapport à la
forte présence des représentations portant sur la production
matérielle relevant du productivisme agricole hérité de
l'histoire de la modernisation agricole japonaise. Ainsi, les pratiques
établies dans la formation Nô-Life sont également
orientées par cette vision.
Sources de fragilité : effet de marginalisation
Là, nous pouvons nous poser la question de la
fragilité du compromis établi dans le Projet Nô-Life :
cette situation de pouvoir, de représentation et de pratique
déséquilibrée, constitue-t-elle des sources de
fragilité du Projet Nô-Life ?
Nous pouvons répondre à cette question en nous
référant à la réponse que nous avons donné
à la question précédente concernant les positions des
stagiaires vis-à-vis de l'idée de l'agriculture de type Ikigai
telle qu'elle est présentée par le Projet Nô-Life. Ce sont
les stagiaires qui mettent réellement à l'épreuve la
légitimité du
Projet Nô-Life. Autrement dit, le résultat du Projet
(ou la finalité ou la vertu), voire la justification du compromis entre
les agents gestionnaires et partenaires du Projet, dépendent de cette
épreuve.
Reprenons brièvement les constats faits dans notre
réponse précédente. D'abord, la divergence des positions
des enquêtés dépend de la diversité de leurs enjeux
individuels qui sont en grande partie déterminés par leurs
trajectoires tant sur le court terme que sur le long terme. Ensuite, la
convergence des positions des enquêtés se trouve d'abord dans
leurs représentations de l'agriculture de type Ikigai signifiant les
divers besoins socio-culturels portant souvent sur leurs intérêts
sur le long terme ou leurs identités. Et ces besoins exigent souvent
d'être compatibles avec des éléments économiques
relevant de la production matérielle. Ceci pour que les personnes
puissent mieux répondre à ces besoins. Puis, la difficulté
de compatibiliser dans la réalité ces besoins socio-culturels et
économiques, constitue également un point de convergence parmi
ces enquêtés. Ceci notamment face aux contraintes liées
à la production matérielle.
Pourquoi alors la difficulté ? Nous pouvons relever que
celle-ci n'est pas due à la diversité des comportements des
enquêtés, d'autant qu'ils ont en commun une motivation ou un
engagement stable basé sur leurs propres besoins, pour l'agriculture de
type Ikigai qui est l'objet central du Projet Nô-Life. Cette
difficulté est plutôt due à l'orientation productiviste du
Projet ainsi que de sa formation, qui est le reflet du
déséquilibre des représentations sociales ancrées
dans la relation de compromis entre les agents gestionnaires et partenaires.
Finalement, cette orientation constitue elle-même une source de
fragilité, en provoquant souvent des réticences dans l'engagement
des stagiaires ou parfois même démotivant ceux-ci.
Autrement dit, ce compromis déséquilibré
marginalise les stagiaires au niveau des dispositifs de la mise en oeuvre du
Projet Nô-Life. Ce que nous pouvons considérer comme un effet
pervers provoqué par le Projet, car ce sont ces stagiaires, du moins
officiellement, qui sont censés être protagonistes du Projet
Nô-Life.
Cet effet de marginalisation est d'abord relationnel entre les
agents institutionnels (gestionnaires et partenaires) et les usagers
individuels (stagiaires). Mais cette relation sociale ancre à la fois
les dispositifs pratiques et représentationnels du Projet Nô-Life.
Ce qui joue toujours pour reproduire cet effet.
Enfin, ne nous trompons pas, ces stagiaires ne sons pas pour
autant « dominés » dans l'esprit. Au contraire, ne sont-ils
pas de vrais connaisseurs de la cause de cette situation contradictoire ? Nous
l'avons vu, ils relèvent déjà par leur réflexion
certains points faibles du principe du Projet qui touche directement
l'ambiguïté du compromis institutionnel en question. (orientation
mitigée entre l'amateurisme et le professionnalisme, insuffisance
d'enseignements pour l'entretien, méthode trop coûteuse de
l'agriculture conventionnelle qui ne correspond pas à la
réalité, absence d'enseignements pour l'agriculture respectueuse
de l'environnement etc) Et ceci tout en reconnaissant la valeur
générale de l'existence du Projet sur le long terme. Ce qui donne
d'ailleurs une garantie de légitimité au Projet. Autrement dit,
l'agriculture de type Ikigai est, au moins de manière
générale, approuvée comme bien commun de façon
à ne pas mettre en cause les identités des parties au compromis.
Mais ceci à condition de mettre entre paranthèses
l'ambiguïté, le dilemme et la contradiction présents dans la
réalité.
4 Compatibilité des éléments de
l'agriculture de type Ikigai aux yeux des acteurs
En tenant compte de l'héritage de la modernisation
agricole productiviste, les trois éléments constitutifs de
l'agriculture de type Ikigai que nous avons établi dans le schéma
représentationnel de celle-ci (Qualité de vie ; Lien social et
territorial ; Production matérielle), pourront-elles être
compatibles non seulement aux yeux des agents gestionnaires et partenaires du
Projet, mais également à l'épreuve des divers
intérêts des stagiaires de la formation Nô-Life ?
Question de rééquilibrage global et
d'identité du bien commun
D'abord, cette question de compatibilité des
éléments représentationnels de l'agriculture de type
Ikigai nous amène directement à reprendre la direction
proposée par Boltanski pour surmonter la fragilité du compromis :
il s'agit justement de la nécessité d'envisager la
compatibilité des « êtres et objets »
hétérogènes relevant de mondes différents afin de
consolider le compromis. A cet effet, il faut doter le compromis d' « une
identité propre » tout en mettant au service du bien commun ces
élements hétérogènes a priori incompatibles. Et
ceci de sorte que la forme de ces éléments
hétérogènes ne soit pas reconnaissables, sous une nouvelle
identité.
Concernant le contexte du Projet Nô-Life, il s'agit de
doter l'agriculture (bien commun) d'une nouvelle identité, à
savoir Ikigai, afin de renforcer l'agriculture comme un bien commun. Et afin de
consolider ce bien commun face à la fragilité du compromis
basé sur celui-ci, nous devrons envisager un rééquilibrage
(ou ajustement) global de la relation déséquilibrée de
représentation, de pratique et de pouvoir qui constitue la source de
cette fragilité. Et ceci au travers d'une revalorisation des
éléments dévalués dans cette situation.
Pour des propositions concrètes...
Mais comment s'y prendre ? Revenons ici à notre dernier
constat de la réalité pour repérer les
éléments en question : du côté des agents
gestionnaires et partenaires, c'est l'orientation productiviste du Projet
Nô-Life qui reflétait leur rapport de forces
déséquilibré dans le dispositif de la mise en oeuvre du
Projet, à savoir l'emprise de l'ensemble des agents du monde agricole
professionnel. Et derrière cette orientation, nous avons constaté
une certaine divergence de points de vue entre les agents appartenant au
secteur agricole (CAT, ECV), l'agent gestionnaire principal (BPA) ayant une
double appartenance au monde agricole professionnel et à celui des
services publics locaux, et les agents appartenant au monde plus public (ou
civil), l'un au monde des services publics locaux du vieillissement (SCI) et
l'autre au monde syndical et salarial (CFLS).
Du côté des stagiaires, non seulement cette
orientation s'avérait techniquement et économiquement
inadaptée à la capacité productive des stagiaires, mais
surtout elle ne tenait pas compte de leurs divers besoins complexes aux niveaux
socio-culturel et économique représentés dans leurs
motivation et engagement. D'où l'effet de marginalisation de cette
orientation à l'égard des stagiaires sur les plans
représentationnel (idées qui n'ont pas pris sens), pratique
(activités de la formation inadaptées) et relationnel (perte
éventuelle de confiance dans les gestionnaires).
En suivant la direction de Boltanski sur le bien commun, il
serait intéressant d'envisager ici quelques propositions
concrètes destinées aux acteurs du Projet Nô-Life vers une
redéfinition de l'agriculture de type Ikigai qui serait possible et
pertinente aux yeux de ces acteurs. Et ces propositions visent à
modifier l'orientation du Projet Nô-Life qui sera susceptible de
régler la situation de marginalisation, et ainsi de rendre
réellement compatible les éléments
représentationnels de l'agriculture de type Ikigai.
Rappel d'apports théoriques
Transaction sociale : pour une création de nouveaux
dispositifs alternatifs...
Avant de formuler ces propositions, il serait utile de tenir
compte des apports de l'approche de la transaction sociale proposée par
M. Mormont, et celle du transcodage de P. Lascoumes.
Dans l'optique de la transaction sociale, M. Mormont insiste
sur la nécessité de créer de nouveaux dispositifs
alternatifs permettant aux agents d'anticiper et de s'engager pour mettre en
oeuvre une politique publique tout en maintenant leurs perspectives
identitaires respectives. Et ceci s'accompagnant d'une complète
reconsidération de « l'appareil de règles » du monde
professionnel portés par un ensemble d'agents dominants, comme porteur
de cadre stabilisateur des anticipations de tous les agents
concernés.
La création de tels nouveaux dispositifs apparaît
nécessaire, d'autant plus que cette proposition de M. Mormont se base
sur le contexte d'une politique agricole européenne en matière
d'environnement, qui risque toujours de mettre en cause l'identité de la
profession agricole basée sur le productivisme historiquement
constitué depuis les années 50, dont la définition
légitime est portée par le monde agricole professionnel.
Concernant le cas du Projet Nô-Life, bien que le
contexte soit fort différent de la politique européenne, nous
pouvons rejointre la direction de M. Mormont dans la mesure où la
définition de la profession agricole et de l'agriculture est mise en
question, tout en tenant compte également de la présence de
« l'appreil de règles » porté par les agents principaux
du monde agricole professionnel.
Il faudrait donc envisager, dans nos propositions, de nouveaux
dispositifs alternatifs dans lesquels les agents gestionnaires et partenaires
du Projet Nô-Life mettent en place un cadre stabilisateur des
anticipations de tous les acteurs concernés pour que les stagiaires
marginalisés et les agents institutionnels faiblement
représentés puissent s'y engager pleinement.
Redéfinition de l'agriculture par rapport à sa
définition historiquement légitimée
Puis, concernant la redéfinition de la profession
agricole et de l'agriculture, pour en trouver une alternative, il faudrait
d'abord dépasser la définition officielle de l'agriculture de
type Ikigai, telle qu'elle est présentée par la
Municipalité de Toyota et le Projet Nô-Life, qui est basée
sur la dichotomie entre l'agriculture de type industriel et celle de type
Ikigai (nous l'avons examiné dans le chapitre 2 avec le Plan de 96).
En effet, comme nous l'avons vu, dans le Projet Nô-Life,
l'agriculture de type Ikigai est officiellement promue par un ancien slogan (un
million de yens de revenu agricole annuel) repris de l'histoire de la
modernisation agricole japonaise datant de l'époque de la Haute
croissance économique des années 60-70 au cours de laquelle le
problème de la disparité économique entre les couches
agricole et salariale était important, et où le rattrapage du
retard économique constituait un thème global de la politique
agricole au Japon (Comme M. Kamihata, un stagiaire et ex-agriculteur de
Kagoshima, se le remémorait lors de notre entretien ). On a alors
réduit le critère de la définition de l'agriculture au
seul critère économique. Ce qui risque d'ignorer les autres types
d'éléments représentationnels de l'agriculture : la
qualité de vie et le lien social et territorial. Ceux dans lesquels
l'aspect environnemental peut également être pris en
considération tant au niveau de la production qu'au niveau de la
consommation et du style de vie.
Pourquoi cette reproduction de la définition dominante
et historique de la profession agricole dans la définition de
l'agriculture de type Ikigai est-elle promue par le Projet Nô-Life ? Cela
est non seulement dû à l'emprise de l'ensemble des agents
institutionnels du monde agricole professionnel, mais également à
l'absence de critère alternatif pour définir l'agriculture d'un
nouveau type qui porterait une identité propre. Dans le sens de
Boltanski, cette identité devrait se référer aux
représentations présentes au sein des acteurs concernés,
et être justifiable dans le cadre de la politique du Projet
Nô-Life.
D'ailleurs, le Centre Nô-Life est déjà
doté de nouveaux dispositifs pour pouvoir développer les
agriculteurs et l'agriculture d'un nouveau type. Les quatres activités
principales du Projet déjà établies (formation, entremise
de terrains, entremise d'emplois agricoles, recherche de nouveaux produits)
seront peut-être à réarticuler avec des idées
alternatives pour régler la situation
déséquilibrée. A cet effet, il peut toujours s'appuyer sur
les dispositifs de l'administration agricole, ainsi que ceux du secteur
agricole qui est en coopération avec lui. Mais ceci tout en cherchant
à les valoriser autrement que dans l'orientation actuelle...
Transcodage à opérer
Et pour pouvoir maintenir une nouvelle identité
agricole, la technique du transcodage pourrait être pertinente : il
s'agit de « rendre gouvernable » l'agriculture de type Ikigai
émergeante au travers d'incessants efforts de concertations et de
traductions réciproques des représentations et pratiques des
acteurs concernés, afin de les « rééquilibrer
».
Cette approche nous semble importante d'autant plus que,
depuis l'inauguration du Centre Nô-Life en 2004, les activités du
Centre Nô-Life sont exclusivement gérées par celui-ci sans
concertation, ni des autres agents partenaires et extérieurs, ni des
stagiaires. Monsieur S, directeur des activités agricoles de la CAT,
nous a confirmé que ceci est encore actuellement le cas avec la CAT qui
est co-gestionnaire du Projet Nô-Life. Ceci alors que, comme nous l'avons
vu, la communication et la coopération intersectorielle étaient
très riches dans le
processus de la construction du Projet Nô-Life avant
2004.
Cette situation est liée au fait que le Projet est
encore dans un stade de tatônnement, et qu'il est débordé
par ses tâches quotidiennes ou la gestion de ses activités
à court terme. Mais nous avons constaté lors de notre entretien
que, Monsieur K, président du Centre Nô-Life, était
déjà conscient de ce problème de manque de communication.
Il regrettait d'ailleurs un peu l'engagement faible de la part de la CAT. Voici
sur ce point un décalage d'engagement entre les cogestionnaires.
En plus, au fur et à mesure que le nombre des
stagiaires et ex-stagiaires augmente, il manquera de plus en plus
d'employés, soit venant de la Municipalité de Toyota, soit venant
de la CAT, pour gérer les activités du Centre Nô-Life.
Pour régler cette situation, pour les gestionnaires, il
faudrait avoir plus d'éléments justificateurs du Projet dans les
prochaines années à venir, surtout auprès de la
Municipalité et de la CAT en tant qu'une politique légitime pour
ces deux organismes. Mais, nous l'avons vu avec le propos de Monsieur S,
directeur des activités agricoles de la CAT, il est difficile pour la
CAT de s'investir plus dans le Projet Nô-Life en raison de sa faible
importance économique pour la structure interne de la CAT, de
l'ambiguïté de la finalité du Projet et de l'effet
symbolique (mérite) du Projet résidant plutôt du
côté de la Municipalité (maire).
Nous devrons donc envisager dans nos propositions, de «
traduire » ces préoccupations internes de la CAT en sorte qu'elles
soient « transcodables » pour celle-ci et compatibles avec les autres
éléments susceptibles de constituer un nouveau compromis
consolidé du Projet Nô-Life...
En tenant compte de ces apports théoriques et
réflexions préalables, nous essaierons de formuler quatre
propositions destinées non seulement aux agents gestionnaires, mais
à tous les acteurs concernés en vue d'améliorer la
situation du Projet Nô-Life sur le court terme, et de consolider le
compromis entre tous les acteurs du Projet Nô-Life, et ainsi de rendre
plus durable, gouvernable et rejustifiable la politique de l'agriculture de
type Ikigai dans la Ville de Toyota sur le long terme.
Quatre propositions pour une restructuration des activités
Nô-Life : vers une redéfinition de l'agriculture de type Ikigai
Nos quatre propositions portent sur : 1 Etablissement de
nouveaux cadres de concertation sur la gestion des activités du Centre
Nô-Life ; 2 Modification de l'orientation globale du Projet Nô-Life
; 3 Ajustement du programme de la formation Nô-Life ; 4 Etablissement
d'une association de stagiaires Nô-Life
1 Etablissement de nouveaux cadres de concertation sur la
gestion des activités du Centre Nô -Life
Premièrement, nous proposerons de créer de
nouveaux cadres de concertation sur la gestion des activités du Centre
Nô-Life. Sur ce point, le Centre Nô-Life organise
déjà des occasions de concertation des avis des stagiaires pour
améliorer les activités du Centre Nô-Life dont notamment le
programme de la formation, via des réunions irrégulières
(deux ou trois fois par an) intitulées « réunion
d'échange d'avis (Iken kôkan kai) » ou des enquêtes par
questionnaire etc. Nous pouvons rejoindre cette pratique déjà
mise en place avec notre première proposition. Cependant, ce cadre de
concertation tel qu'il est actuellement mis en place par le Centre
Nô-Life, reste seulement consultatif au service des gestionnaires du
Centre Nô-Life, avec pour objectif de prendre en compte les avis des
stagiaires pour améliorer leurs activités. Mais dans ce cadre, on
ne remet pas en question les cadres principaux de ces activités, et les
avis énoncés par les stagiaires risquent d'être
dispercés et limités à ceux, plutôt rares, qui osent
exprimer clairement leurs opinions.
Donc, nous proposerons de continuer cette réunion
d'échange d'avis mais de façon à la développer de
manière plus réflexive et interactive. Cette proposition entend
mettre en place des cadres de discussion que la simple consultation des
stagiaires, en mettant en question (pas forcément « en cause
») les cadres principaux du Projet qui ne semblent pas bien fonctionner ou
ceux qui semblent inadaptés aux conditions réelles des
stagiaires
etc. Autrement dit, il s'agit de discuter ensemble d'un
problème quelconque tant du côté des gestionnaires que du
côté des stagiaires.
Puis, nous proposerons, en ajoutant à ce cadre de
concertation « interne » du Centre Nô-Life, un autre cadre
externe sur la gestion du Projet qui prendra la forme d'un « comité
(iinkai) » intersectoriel. Cette proposition se référe aux
expériences du CPCI (Comité pour la Promotion de la
Création d'Ikigai) organisé par le SCI (Section pour la
Création d'Ikigai : Acteur 2) depuis 2000, dans lequel des membres
citoyens volontaires ont joué un rôle important pour
élaborer un rapport de propositions remis au maire concernant les
nouveaux services et activités dans le domaine d'Ikigai des personnes
âgées au sein de la Municipalité de Toyota. Monsieur K,
président du Centre Nô-Life, y a lui-même participé
dans la première période (2000-2002) pour élaborer le
projet de la « Ferme-école des personnes âgées »
(voir la partie de l'Acteur 2 du chapitre 2).
Nous envisageons ce comité intersectoriel, en faisant
appel à tous les agents locaux partenaires et intéressés
(appartenant à différents « mondes ») afin de discuter
librement de possibilités de développer les activités
nouvelles ou déjà existantes au sein du Centre Nô-Life. Une
participation volontaire de stagiaires de la formation Nô-Life y sera
également bienvenue. Nous prévoyons le lien entre ce
comité et l'association de stagiaires Nô-Life dont nous proposons
l'établissement dans la proposition 4.
Cette première proposition de la création de
cadres de concertation vise à renforcer mutuellement la
compréhension et la réflexion entre les acteurs concernés
afin de rééquilibrer leurs représentations, pratiques et
positions.
2 Modification de l'orientation globale du Projet Nô
-Life
Deuxièmement, nous proposerons une modification de
l'orientation globale du Projet Nô-Life via une baisse du montant du
revenu agricole annuel visé dans l'objectif de la formation
Nô-Life. Ce montant sera précisément baissé d'un
million de yens à trois cent milles yens (environ deux milles euros).
En effet, nous avons choisi ce chiffre par
référence à un exemple dont nous avons pu vérifier
la pertinence lors de notre enquête de terrain. En fait, ce chiffre
provient du monde dit « vieillissement actif » dans la Ville de
Toyota : nous avons découvert ce chiffre avec Madame S, responsable du
SCI lors de notre entretien, pour connaître le montant moyen annuel de
rémunération par personne versé aux personnes
âgées inscrites dans le Centre des Ressources humaines
âgées (Silver Jinzai Center) de la Ville de Toyota : un agence
pour l'emploi semi-publique pour les personnes âgées (plus de 60
ans) mise en place dans les collectivités territoriales au Japon depuis
les années 70768 . Les personnes âgées peuvent
s'inscrire dans ce centre pour répondre aux diverses demandes de la vie
quotidienne de la population locale comme par exemple arrachage des mauvaises
herbes dans le jardin, surveillance de parkings à vélos conte le
vol, réparation de la maison etc.
Nous trouvons ce montant mieux adapté à la
réalité ainsi qu'à la motivation des personnes
âgées inscrites dans la formation Nô-Life, que le montant
actuellement présenté provenant exclusivement de l'histoire du
monde agricole (nous l'avons vu). Avec Madame S, nous avons également
vérifié que, dans une enquête officielle
réalisée auprès des personnes inscrites dans le Centre des
ressources humaines âgées de la Ville de Toyota, la
majorité de ces personnes âgées s'engagent dans les
activités de ce centre pour une raison socio-culturelle (santé,
maintien du lien social après la retraite, contribution sociale et
territoriale etc) plutôt qu'économique. Cet aspect correspond
largement aux représentations au sein des stagiaires de la formation
Nô-Life.
Le montant de revenu agricole annuel que nous proposons ici
pour les stagiaires de Nô-Life, pourrait même être un
repère dit « objectif à atteindre » au niveau
quantitatif de la production agricole, qui sera accessible à la grande
majorité d'entre eux y compris ceux qui sont jeunes. Pour ceux qui
veulent aller plus loin en visant un chiffre plus élevé dans leur
production agricole, ce montant leur donnera, dans ce cas, une première
étape à
768 Le montant total des rémunérations
verséers aux membres est de 7 000 000 000 yens (environ 46 666 666euros)
et nous avons divisé ce montant par 2016 (nombre total des membres du
Centre des ressources humaines âgées de la Ville de Toyota). Le
chiffre ainsi calculé est de 350 000 yens (environ 2333 euros). Nous
pouvons en déduire que les membres de ce centre gagnent en moyenne
à peu près 30 000 yens par mois (200 euros) en travaillant deux
ou trois fois par semaine.
franchir.
Cette deuxième proposition d'une modification du
montant de l'objectif économique du Projet Nô-Life, vise d'un
côté à constituer un « incitatif »
économique plus adapté aux conditions objectives et subjectives
des stagiaires, qui est même susceptible de correspondre à
l'intérêt productiviste du secteur agricole (car plus faisable
pour plus de personnes), de l'autre côté, à
rééquilibrer les représentations de l'agriculture de type
Ikigai au sein de tous les acteurs du Projet Nô-Life entre les trois
pôles : qualité de vie ; lien social et territorial ; production
matérielle. Ce rééquilibrage afin de ne pas sacrifier
certains éléments représentationnels pour d'autres, mais
de les compatibiliser dans un objectif réalisable.
Nous pourrons même escompter un effet de
solidarité entre les personnes âgées inscrites dans le
Centre Nô-Life et celles dans le Centre des ressources humaines
âgées en leur faisant partager un même objectif dans leurs
différentes activités d'Ikigai. Ce qui serait idéal pour
la politique publique d'Ikigai des personnes âgées de la Ville de
Toyota.
3 Ajustement du programme de la formation Nô
-Life
Troisièment, suite à la modification de
l'orientation globale du Projet Nô-Life proposée
précédemment, nous proposerons de réorienter le programme
de la formation Nô-Life. Il s'agirait de proposer un mode de production
propre à l'agriculture de type Ikigai à promouvoir dans le cadre
du Projet Nô-Life.
L'objectif de revenu annuel dont le montant sera baissé
à trois cent milles yens permettra aux agriculteurs de type Ikigai de se
distinguer plus substantiellement, d'un côté du modèle de
l'agriculture de type Industriel destiné au grand marché
organisé, de l'autre côté, de celle de type «
jardinage » destinée exclusivement à l'autoconsommation ou
au loisir.
Pour ce faire, se distinguer des modèles dominants de
l'agriculture de manière exclusivement quantitative sera insuffisant -
car leur vision est fondamentalement économique - mais il faut
introduire d'autres types de repères plus qualititatifs. A cet effet,
nous proposerons d'introduire une référence environnementale dans
la méthode agricole enseignée dans la formation Nô-Life.
Parce qu'actuellement c'est de ce type de référence que le
programme de la formation manque dans le Projet, alors que la politique
agricole de la Municipalité de Toyota l'abordait fortement en terme de
la multifonctionnalité de l'agriculture dans le Plan 96. Et,
jusqu'à aujourd'hui, nous ne constatons pas de réalisations
remarquables dans les mises en oeuvre de la politique agricole de la
Municipalité769. De plus, un bon nombre de stagiaires ont
montré leurs intérêts potentiels sur un style de vie ou un
mode de production agricole respectueux de l'environnement.
A cet effet, nous avons déjà un exemple de
« réussite » des anciens élèves de l' «
Ecole de l'agriculture vivante » (lancée en 2000 par la CAT
à la demande du BPA) qui se sont constitués en groupement de
producteurs de l'agriculture biologique au sein de la CAT. Les membres de ce
groupement n'ont pas seulement pour objectif d'exercer la vente commune de
leurs produits mais également d'organiser un apprentisage collectif de
la méthode de l'agriculture biologique via des réunions
régulières. Ce groupement est essentiellement composé de
personnes âgées féminines comme masculines originaires de
foyers agricoles pluriactifs.
Il serait intéressant pour les stagiaires de la
formation Nô-Life, de prendre contact et avoir un rapport
d'échange et de coopération avec ce groupement dans le cadre du
programme de la formation Nô-Life. Ce qui pourrait davantage inspirer les
stagiaires. Et ceci sera même efficace pour rétablir le
décalage entre le Centre Nô-Life et la CAT, d'autant plus que
c'était Monsieur S, directeur des activités agricoles de la CAT,
qui était responsable de l'Ecole de l'agriculture vivante et de sa
« réussite » !
Nous savons même qu'il y a quelques agriculteurs
biologiques célèbres dans le territoire de la Ville de Toyota
qui, nous semble-t-il, pourraient apporter des contributions à la
formation Nô-Life. Par exemple, organiser une visite collective de leurs
exploitations serait intéressant.
Puis, le recours réduit aux traitements chimiques
hautement spécialisés permettrait d'intensifier et d'enrichir
769 Ce point est expliqué dans l'évaluation
finale faite en 2006 par les responsables du BPA sur les projets
réalisés dans le cadre du Plan 96. L'agriculture de type Ikigai
telle qu'elle était prévue dans ce plan prévoyait deux
types de production : production destinée au marché local ;
production susceptible de contribuer à la préservation de
l'environnement.
les activités des stagiaires dans le programme. Car
avec moins de traitements chimiques, ils devront effectuer par eux-mêmes
plus de soins alternatifs pour les cultures, et ainsi avoir plus de
connaissances en la matière. L'intensification des activités dans
le programme est l'une des demandes des stagiaires les plus fréquentes
que nous avons constaté dans le résultat de l'enquête par
entretien. Ceci nous semble important d'autant plus qu'actuellement, ce sont
souvent les personnels du Centre Nô-Life, lorsque les stagiaires sont
absents, qui effectuent les traitements chimiques préventifs sur les
cultures gérées pour les cours pratiques. Mais nous pouvons
évoquer qu'il y a déjà quelques stagiaires qui s'engagent
pleinement à une pratique culturale de type écologique en
employant des produits naturels pour la fertilisation, la prévention des
maladies et des insectes nuisibles (comme Mme. Kawamura)
Cette proposition d'ajustement de la formation Nô-Life vise
à envisager l'agriculture de type Ikigai dotée d'une
identité propre dépassant les catégories dichotomiques de
l'amateurisme et du professionnalisme.
4 Etablissement d'une association de stagiaires Nô
-Life
Enfin, quatrièmement, nous proposerons
l'établissement d'une association constituée par les stagiaires
et ex-stagiaires de la formation Nô-Life. Ceci d'abord en nous
référant à l'idée de M. Itô et M. Suzuki de
monter une association de stagiaires ayant pour objectif d'organiser une aide
aux travaux agricoles des exploitaions fruitières en difficulté
pour cause de maladies, vieillissement des exploitants, manque de main-d'oeuvre
etc. Selon eux, cette association vise également à organiser des
entraides entre les stagiaires ainsi que les ex-stagiaires qui auront besoin
d'échange d'infos, d'aides aux travaux (ex. installation d'une serre,
labour).
Cette proposition implique des intérêts sur
plusieurs niveaux. D'abord, sur le plan pratique, l'association permettrait aux
stagiaires d'avoir plus de sociabilité entre eux. Ce qui est
également l'une des attentes les plus fréquentes des stagiaires
constatées dans le résultat de l'enquête par entretien :
garder le lien avec les camarades de la formation Nô-Life. Puis, cela va
de même pour l'apprentissage collectif, l'entraide et l'organisation
éventuelle d'une vente commune comme un groupement de producteurs «
Nô-Life ». Puis, sur le plan représentationel, l'association
susciterait une prise de conscience des points communs entre les stagiaires, et
par là, le renforcement de leur identité collective. Et sur le
plan de la politique collective, l'association permettrait aux stagiaires de
regrouper leurs avis inviduels sur la gestion des activités du Centre
Nô-Life et de les proposer aux gestionnaires. A cet effet, ils pourront
participer au Comité que nous avons proposé dans la proposition
1.
Cependant, il reste certaines difficultés à
surmonter pour organiser cette association avec succès. Il s'agit de la
nécessité de tenir compte de la diversité des trajectoires
et des enjeux de chacun des stagiaires. En effet, l'association risque
d'être confrontée à une attitude de type « chacun pour
soi » de ses membres. Ainsi, nous ne pourrons pas l'envisager de
manière traditionnelle comme par exemple de petits groupements de
producteurs locaux qui sont souvent basés soit sur le lien de type
« communautaire », à savoir celui d'interconnaissance
lié au sol (ex. habitants du même village), soit sur une condition
sociale partagée (ex. femmes âgées de foyers agricoles
pluriactifs)
Les circonstances et les enjeux individuels des membres de
l'association devront être hétérogènes et «
urbains » à la différence des exemples mentionnés
ci-dessus. C'est pouquoi nous proposerons de doter cette association d'un
caractère « multifonctionnel » ou « multiforme », et
dont les visées possibles seraient les suivantes:
- économique : production (apprentissage de
méthodes agricoles alternatives ; aide aux travaux agricoles des
exploitations agricoles en difficulté ; entraides ; échange de
semances etc.) ; distribution (vente commune à court circuit)
- social : sociabilité (échange d'infos,
fêtes etc) ; constitution d'un réseau de stagiaires
Nô-Life
- politique collective : communication -
coopération avec le Centre Nô-Life, la CAT et les agriculteurs
locaux etc.
Par ailleurs, nous avons constaté que
l'établissement d'une association de stagiaires de ce type est
fortement
attendu par les agents institutionnels : du côté
du monde agricole, dans la mesure où une organisation formelle de
nouveaux producteurs dans le cadre du Projet Nô-Life aura un bon effet
d'incitation pour le secteur, tant au niveau socio-économique, qu'au
niveau symbolique ; du côté du monde des services publics locaux
(BPA, SCI, CFLS), dans la mesure où l'association renforcera l'autonomie
et le lien social et territorial parmi la population locale âgée.
Puis, cela va de même pour divers domaines de la politique publique
locale comme le développement local, l'aménagement du territoire,
car la Municipalité essaie actuellement de promouvoir l'initiative de
type associatif (comme NPO : Non profit organisation) dans le contexte de la
décentralisation. En tous cas, la réalisation d'une telle
association serait une « bonne nouvelle » pour la ville.
Ainsi, cette idée nous semble tout-à-fait
envisageable sur le terrain. D'ailleurs, Monsieur K, président du Centre
Nô-Life, a déjà informellement donné un avis
favorable à M. Itô qui lui a parlé de cette idée
lors de la « fête de la récolte », qui a eu lieu en
octobre 2006 dans le Centre Nô-Life et qui a réuni une grande
partie des acteurs concernés.
Références
Ouvrages et articles
BOURDIEU, P. (1994), Raisons pratiques, Paris, Seuil.
FRAYSSE, B. (2000), « La saisie des représentations
pour comprendre la construction des identités », Revue des
sciences de l'éducation, Vol. XXVI, nP 3, 2000, p.651-676.
HAMAGUCHI, H (1999), Ikigai sagashi : taishû
chôju shakai no jilenma (Recherche d'Ikigai : dillemme de l'ère de
la longévité de masse), Kyôtô, Mineruva
Shobô.
LEGRAND, M. (2001), La retraite : une révolution
silencieuse, Ramonville, Erès.
LÉVI-STRAUSS, Cl. (1962), La pensée
sauvage, Paris, Librairie Plon.
Documentation
Centre pour la Création de Nô-Life de Toyota
(2005), Stage techinique de la culture des produits agricoles : Champs;
Champs - Rizière; Vergers, Ville de Toyota. (Brochure pour la
candidature des stagiaires des années 2005-2007).
Conclusion
Pour conclure la présente étude, reprenons nos
questions de départ : à travers le Projet Nô-Life, quelle
dynamique des représentations, des actions et des pratiques sur
l'agriculture et la ruralité constatons-nous ? ; le Projet Nô-Life
peut-il être une solution ou un remède vis-à-vis de la
situation de crise permanente de l'agriculture et de la ruralité au
Japon ? Est-il généralisable ou reste-il un cas local et
particulier ? Afin de répondre à ces questions, rappelons d'abord
les apports de chacun des trois chapitres précédents.
Rappel des analyses
Chapitre 1
Interdépendance socio-politique, rapport de forces, jeu de
représentations dans la Ville de Toyota
Industrialisation dans le territoire de la Ville de Toyota :
crise du marché des cocons des vers à soie, implantation de
l'Automobile Toyota avant la guerre, défaite de l'Empire japonais,
reconstruction sous l'occupation américaine, bonne conjoncture
grâce à la Guerre de Corée, concentration industrielle,
changement du nom de la Ville de Koromo à celle de Toyota, et l'essor
pendant la Haute croissance...
En parcourant une quarantaine d'années
d'évolution de l'industrie automobile dans la Ville de Toyota, nous
constatons que son développement fait partie intégrante de
l'histoire politique et sociale du monde, du Japon et de sa région.
Ainsi, sans l'accumulation antérieure des capitaux par les petits
commerces du Bourg de Koromo et la production paysanne des vers à soie,
puis sans la crise économique ayant fait chuter la distribution des
cocons, cette industrie n'aurait pas pu s'implanter dans le territoire de la
Ville de Toyota dans les années 30. De même, sans
l'impérialisme japonais, la montée en puissance de sa force
militaire, sa défaite, la réforme par l'occupation
américaine et la Guerre de Corée, cette industrie n'aurait pas pu
se relever en s'enracinant dans le territoire de la Ville de Toyota. Ensuite,
la réalisation de son essor économique n'aurait pas non plus
été possible sans pleinement profiter de la Haute croissance
nationale garantie par la paix qui fut le produit de la Guerre froide, ainsi
que par la politique locale de redistribution assurée par la Ville de
Toyota que cette industrie s'est appropriée en accord avec les pouvoirs
locaux.
Finalement, l'histoire du développement de cette
industrie automobile est marquée par une interdépendance complexe
avec plusieurs systèmes et circonstances socio-politiques dans lesquels
elle a toujours stratégiquement joué. Et cette
interdépendance est également synonyme d'un certain rapport de
forces. L'emprise politique de cette industrie tant au niveau de la Ville de
Toyota qu'au niveau du Japon reste toujours incontestable.
Par contre, il a toujours existé un fossé
qu'elle a laissé dans la réalité sociale et locale de la
population et de sa ville. Sur ce point, un responsable de la politique
agricole de la Ville de Toyota a bien insisté sur le fait que, les
problèmes mis en discussion dans la politique municipale de Toyota sont
toujours d'autres domaines que l'industrie, soit les services, soit
l'urbanisme, soit les petits commerces locaux, soit l'agriculture, soit le
bien-être.
Si cet aspect est un des privilèges de cette ville de
ne pas avoir de souci économique grâce à cette industrie,
ce privilège pose toujours d'autres problèmes renvoyant à
l'identité de la Ville. C'est pourquoi, à chaque époque,
les représentations de la Ville constituent implicitement un enjeu
important pour sa politique. « Ville de la voiture » fut le premier
slogan, mais à côté de ce slogan, il y eut mille tentatives
de donner d'autres sens à l'existence de la Ville : «
coopération entre les zones industrielle, commerciale et agricole
», « ville industrielle et culturelle », « lieu de vie
sociale plutôt qu'un simple lieu de production », « ville de
l'eau et du vert » etc. Enfin, évoquons un fait marquant : dans le
contexte de la politique agricole municipale des années 90, le nouveau
slogan formulé par le Plan de 96 « Grande ville rurale (ooinaru
inaka-machi) » a été rejeté suite à une
plainte déposée par des représentants du secteur
industriel, car jugé incohérent par rapport au premier slogan
favorable à l'industrie. Cet épisode montre bien l'existence de
jeux implicites de représentations, impliquant toujours une
interdépendance sociale et un rapport de forces présents dans la
politique de cette Ville. Puis, ces jeux renvoient toujours directement aux
problèmes socio-culturels de sa population. D'où la place
centrale de la question d'Ikigai dans ce jeu identitaire de la Ville.
Monde agricole et rural déchiré, mais avec une
nouvelle dynamique émergeante...
Du côté du monde agricole et rural, depuis la
Réforme agraire, l'agriculture et la ruralité ont beaucoup
évolué afin de se relever de la paupérisation et la
défaite de la guerre. Mais, malgré un « succès »
de la Réforme agraire et de grands efforts fournis par les nouveaux
cultivateurs et les anciens foyers agricoles pour le défrichement,
dès les années 50, face au contexte dominant du « tournant
de l'agriculture » à la sortie de la crise alimentaire et
l'avènement de la Haute croissance économique de 1955 à
1975, la tendance d'évolution a dû céder sa place à
la déprise agricole et ainsi à la situation de
pluriactivité. Depuis lors, l'écart de productivité entre
l'agriculture et les industries n'a pas cessé de croître. Le style
de vie alimentaire des japonais a rapidement changé avec l'import des
excédents agricoles américains ainsi que la campagne nationale
massive pour la « modernisation » de la vie alimentaire japonaise
populaire vers le style occidental, à l'aide de la politique
américaine. Puis, promu par la politique agricole nationale et tout en
s'alimentant largement de ces excédents agricoles américains, le
développement des élevages intensifs et spécialisés
(oeufs, poulets de chair, porcs, lait, boeufs) accompagna ce changement.
Toutefois, comme la possibilité de se lancer dans ce type
d'élevages « modernes » ou d'autres types de
spécialisation (légumes et fruits) était
extrèmement limitée en terme d'investissement et par les
contraintes du marché, la majorité des foyers agricoles ont
recourru à la pluriactivité et à la simplification de
leurs travaux agricoles par la mécanisation et l'utilisation des
intrants chimiques dont la diffusion massive et rapide fut assurée par
les industries mécanique et chimique qui étaient alors en plein
essor.
Puis, dans les années 60, la politique agricole
nationale a prétendu adapter l'agriculture et les agriculteurs à
la réalité des autres industries en pleine croissance. Cette
politique a renforcé d'un côté la tendance vers
l'agrandissement et la spécialisation de la production agricole, de
façon à limiter ses applications à un petit nombre
d'exploitations ou d'entreprises agricoles ou à certaines zones de
productions, de l'autre côté la tendance à la
simplification et la mécanisation des travaux rizicoles via
l'instauration de quelques entreprises agricoles locales à grande
échelle et des remembrements. Cette politique a eu pour effet
d'accélérer la situation de pluriactivité et
l'affaiblissement de la main-d'oeuvre agricole, et surtout de dualiser la
structure agricole entre une minorité de producteurs individuels et
organisés à forte rentabilité et la majorité,
à faible rentabilité, pluriactive dépendante des revenus
non agricoles.
Toutefois, nous avons souligné qu'un type d'agriculture
a eu une place pour se développer tout en résistant à
cette dualité imposée au cours des années 50-70 : comme
par exemple, une cinquantaine de femmes de foyers agricoles pluriactifs qui ont
produit et distribué leurs légumes dans des cantines des ouvriers
de l'Automobile Toyota, en collaboration avec la coopérative agricole et
la coopérative de consommation. Ceci est un indice d'une autre forme
possible de développement agricole et rural, basée sur la
réalité territoriale contenant à la fois les circonstances
urbaine et rurale. Ce type de dynamiques agricoles menées avec la
population rurale, féminine et âgée, sera bientôt
nommé dans le monde agricole « agriculture de type Ikigai » au
cours des années 80. Elle va ensuite faire l'objet d'une promotion dans
la politique agricole locale afin de pallier le fossé de la
modernisation agricole dualiste.
Dans cette évolution, nous trouvons une «
étoffe » de la dynamique actuelle du Projet Nô-Life, qui se
situe en continuité du temps long de l'histoire de la Ville de Toyota.
Autrement dit, dans cette analyse historique de la Ville de Toyota après
1945, nous avons trouvé une « raison » historique,
territoriale et identitaire, pour laquelle la politique locale de
redistribution de la Ville de Toyota a fait le lien entre l'agriculture de type
Ikigai et la question d'Ikigai pour sa population urbaine en vieillissement.
Chapitre 2
Emergence de l'agriculture de type Ikigai
Dans le chapitre 2, nous avons mis en évidence le
processus de la construction du Projet Nô-Life entre les acteurs
institutionnels ou organisés. Et à travers cela, nous avons
analysé pourquoi et comment ont émergé dans ce processus,
les éléments représentationnels de l'agriculture de type
Ikigai. Ces éléments s'organisent autour des trois pôles
suivants : qualité de vie ; lien social et territorial ; production
matérielle. Nous avons considéré ces trois pôles
représentationnels de l'agriculture et de la ruralité en tant que
produit de l'hybridation de la relation urbain-rural dans le territoire de la
Ville de Toyota. Cette hybridation résulte à la fois de
l'émigration rurale massive pendant la Haute croissance
économique (1955-1975) et de la généralisation de la
situation de pluriactivité des foyers agricoles locaux. Ces deux
phénomènes, historiquement engendrés par
l'industrialisation et l'urbanisation, ont radicalement bouleversé la
population agricole et rurale depuis ce dernier demi-siècle au Japon.
Puis, le terme « Nô-Life », inventé par
la Municipalité de Toyota, a une connotation nouvelle : concernant la
partie « Nô » designant « agri- » ou « rural
», l'apparition de l'utilisation de cette seule partie est relativement
récente (dans les années 90). « Nô » implique
diverses manières d'aborder l'agriculture et la ruralité en terme
de style de vie tout en tenant compte des aspects non productifs de
l'agriculture et de la ruralité, dits multifonctionnels. Puis, la partie
« Life », provenant du terme anglais, a notamment la connotation
urbaine et post-industrielle du « life style », style de vie comme
étant choisi par les individus.
Construction du Projet
Dans ce processus, nous avons d'abord repéré une
série d'opérations réalisées comme des «
bricolages collectifs » entre des agents locaux appartenant à
différents champs sociaux. Il s'agit d'un ensemble d'opérations
de transcodage entre les principaux agents du monde agricole
(coopérative agricole : CAT ; vulgarisateur : ECV ; groupement de
producteurs professionnels : GASATA ; administrateur départemental
agricole : BDPA ; administrateur municipal agricole : BPA) et des agents du
monde public et civil (agent municipal de la politique du vieillissement : SCI
; représentant local des syndicats ouvriers : CLFS). C'est-à-dire
qu'ils se sont réciproquement instrumentalisés tout en
échangeant leurs propres objectifs et moyens afin d'élaborer
leurs propres actions. Et ces oprérations, par l'intermédiaire du
Bureau de la Politique agricole de la Municipalité de Toyota, ont abouti
à un compromis qui constitue la clef de voûte du Projet
Nô-Life : accord entre la politique agricole locale et celle du
vieillissement autour de la question commune d'Ikigai. L'idée de base de
ce compromis était de relier les mesures pour l'agriculture de type
Ikigai, qui existait déjà dans le monde agricole sous diverses
formes, et celles pour les activités et services pour Ikigai des
personnes âgées, et ainsi de former de nouveaux agriculteurs et
faire face au délabrement de l'agriculture.
Contradiction du Projet
Mais ce compromis impliquait une ambiguïté de
principe basée sur une divergence d'intérêts entre les
agents
de ces deux secteurs, dont notamment les gestionnaires du
Projet : adminisrateur municipal agricole (BPA) et coopérative agricole
(CAT). D'un côté, le BPA essaie de valoriser l'agriculture en
sorte qu'elle soit vouée à l'intérêt public en
s'inscrivant dans l'approche de la multifonctionalité apparue au cours
des années 90 dans le contexte de restructuration après les
Accords du GATT. De l'autre côté, la CAT essaie d'imposer une
norme productiviste pour la réalisation du Projet, qui se reflète
dans le slogan de « gagner un million de yens de revenu agricole annuel
» donné à la formation agricole organisée par le
Centre Nô-Life. Mais en même temps, l'engagement de la part de la
CAT dans le Projet s'avère faible par rapport au BPA en raison de
l'apport économiquement faible de ce projet : la coopérative
agricole japonaise est en réalité un grand organisme financier et
commercial, plutôt qu'une organisation agricole et sociale. Ce qui est
largement du à la situation de pluriactivité
généralisée pendant la Haute croissance.
Selon L. Boltanski, un compromis est un accord impliquant
l'approche du bien commun entre plusieurs mondes différents ayant chacun
sa nécessité de justification. Si le compromis a pour objectif de
résoudre des conflits et de régler des différends en
mobilisant des principes et des objets relevant de ces différents
mondes, toutefois, le compromis doit sa fragilité à cette
divergence d'identités entre les parties en présence, ainsi
qu'à l'impossibilité de mettre en cause ces identités.
Sur la base d'un tel compromis, dans le cas du Projet
Nô-Life, nous avons constaté un rapport de pouvoir
désquilibré dans le dispositif de la mise en oeuvre du Projet,
lié à l'emprise des agents du secteur agricole. Et ce rapport de
pouvoir désquilibré ancre fortement les éléments de
représentation donnés à l'agriculture de type d'Ikigai que
le Projet Nô-Life doit promouvoir : priorité donnée
à la production matérielle avec la reprise du slogan
présenté plus haut. Or ce slogan provient implicitement (que ce
soit inconsciemment ou consciemment) de l'histoire de la modernisation agricole
des années 60 au Japon, dont le référentiel était
le rattrapage de la Haute croissance économique du pays.
Chapitre 3
Typologie des stagiaires et tendances générales de
représentation
Dans le chapitre 3, nous avons analysé les
représentations de l'agriculture et l'« agriculture de type Ikigai
» chez les stagiaires de la formation Nô-Life, à travers leur
participation dans le Projet.
A partir de l'analyse du résultat de l'enquête
par questionnaire, nous avons relevé que la typologie objective des
stagiaires correspond à la fois au contexte contemporain du
vieillissement (70% ont plus de 50ans, sont déjà en retraite ou
proches de la retraite), mais également à la
spécificité historique de la Ville de Toyota : parcours
professionnel en majorité salariale (ouvriers et employés) dans
le secteur industriel ; diverses origines géographiques (moitié
des stagiaires originaires de l'extérieur de la Ville de Toyota) ;
situation généralisée de pluriactivité des foyers
agricoles (un tiers des stagiaires sont des agriculteurs pluriactifs locaux).
Puis, l'expérience agricole prend une importance considérable
parmi ces stagiaires : un tiers étant déjà cultivateurs
d'un terrain agricole de leur foyer natal, ce qui correspond au nombre des
agriculteurs pluriactifs parmi eux ; un tiers ayant cultivé un jardin
potager depuis plus de cinq ans.
Ensuite, nous avons repéré les tendances
générales de représentations de l'agriculture en rapport
avec leur participation dans la formation Nô-Life. Nous avons
relevé les trois niveaux suivants de représentations qui sont
indissociables de la dimension actionnelle des stagiaires : stratégique
; idéal ; réflexif. Le premier, le niveau stratégique, en
se basant sur les divers intérêts à court terme, montre la
dimension de demande instrumentale de la part des stagiaires vis-à-vis
du Projet. A ce niveau-là, nous avons trouvé plus
d'éléments de représentation relevant de la dimension
économique (ex. acquisition de techniques ; obtention de revenus), et
moins des dimensions socio-culturelles. Mais le second, le niveau idéal,
en se basant sur les intérêts à long terme, montre la
dimension du projet de vie des stagiaires. A ce niveau-là, nous avons
trouvé plus d'éléments relevant des dimensions
socio-culturelles (autoconsommation, plaisir, style de vie, sociabilité
etc) et moins de la dimension
économique. Puis, le troisième, le niveau
réflexif, en se basant sur des préoccupations sur la crise
agricole et alimentaire en général, montre la dimension politique
et collective. A ce niveau-là, nous avons trouvé un certain
nombre d'idées articulées telles que : développement de la
production et de la consommation des produits locaux, afin d'améliorer
l'autosuffisance et la sécurité alimentaire ; lien entre la
production agricole avec d'autres thématiques de la vie des citoyens
(cadre de vie, environnement, éducation etc) ; participation citoyenne
dans le domaine agricole. En fait, nous avons trouvé une large
correspondance entre ces visions exprimées par les stagiaires et la
problématique formulée par la politique agricole de la
Municipalité de Toyota depuis les années 90 notamment par leur
Plan décennal de 1996 : intégration des thématiques
globales de l'autosuffisance alimentaire et de la multifonctionalité ;
développement des deux types d'agriculture industriel et ikigai ;
participation citoyenne aux activités agricoles et rurales. Et cette
correspondance se trouve même au niveau des visions pratiques des
stagiaires : souhait de mener une agriculture périurbaine avec une
production de type polyculture à petite échelle et la
distribution des produits à court circuit. Ces trois niveaux de
représentations nous semblent possibles à articuler entre eux,
puis à renforcer au niveau de la mise en pratique.
Dynamique des représentations dans les moments du
Projet
Puis, à partir de l'analyse du résultat de
l'enquête par entretien, nous avons essayé de repérer les
catégories subjectives et les tendances spécifiques des
représentations des stagiaires en rapport avec leurs divers enjeux
personnels. Notre démarche d'analyse était la suivante :
- d'abord, nous avons distingué les cinq niveaux
suivants de représentations correspondant aux moments diachroniques de
la vie des stagiaires dans le Projet Nô-Life, à savoir : 1
trajectoire qui désigne les expériences passées qui
précèdent la participation à la formation Nô-Life ;
2 motivation initiale qui se traduit par l'intention ou l'objectif initial pour
la participation ; 3 changement d'idées montrant comment les stagiaires
ont vécu le Projet ; 4 prise de position de chaque stagiaire, qui est le
reflet de leurs points de vue plus ou moins déterminé de
l'intérieur sur les principes du Projet ; 5 réflexion sur le
devenir du Projet, montrant le point de vue distancié et final sur
l'ensemble du Projet.
- ensuite, sur chacun de ces cinq niveaux, nous avons
tenté de trouver les ressemblances et les dissemblances entre les
éléments de représentation portés par chaque
stagiaire. A partir de là, nous avons repéré les groupes
porteurs de représentations spécifiques, afin d'y voir finalement
les relations de divergence et de convergence au sein des
représentations portées par les stagiaires.
Au niveau de la trajectoire, nous avons pris en compte la
complexité de l'histoire et de la circonstance de la vie de chacun, qui
se base sur une articulation complexe des catégories objectives
(homme/femme ; âge ; lieu d'origine ; foyer agricole ou non) Il s'agit de
comprendre le processus de construction socio-historique de la personne tout en
dépassant nos stéréotypes objectivistes et
réductionnistes.
Nous avons supposé que les influences de la trajectoire
sur l'action des enquêtés sont complexes, mais saisissables dans
les deux sens suivants : soit à construire un nouveau type de vie pour
chacun dans une nouvelle circonstance socio-spatio-temporelle ; soit à
reproduire un type de vie antérieurement connu, mais tout en renouvelant
les expériences passées dans un nouveau type de circonstance
donnée. Ensuite, nous avons construit un modèle de
compréhension de ces influences complexes de trajectoire sur l'action
des enquêtés en terme de « crise (insuffisance) » et de
« stabilité (suffisance) » de leur vie du passé proche
au niveau de deux espèces de capitaux : économique et
socio-culturel. Nous avons ainsi établi les quatre types d'influences de
trajectoire (1 capitaux économique et socio-culturel suffisants ; 2
capital économique suffisant et capital socio-culturel insuffisant ; 3
capital économique insuffisant et capital socio-culturel suffisant ; 4
capital économique et socio-économique insuffisants) supposant
certain nombre d'explications possibles sur la dynamique actuelle des
individus770.
Puis, pour analyser les réponses correspondant à
ces quatres niveaux, nous avons repris le schéma
770 Tout en sachant que ces critères « crise
(insuffisance) » et de « stabilité (suffisance) » n'ont
pas de coupure totale entre eux, mais sont relatifs, et également que la
situation de la vie individuelle est souvent marquée par
l'ambiguïté et la complexité, cette typologie et les
explications ainsi supposées ont constitué un outil de
compréhension de la situation individuelle des enquêtés.
représentationnel de l'agriculture de type Ikigai
établi dans le chapitre précédent. Les trois pôles
constitutifs de ce schéma (qualité de vie, lien social et
territorial, production matérielle) pouvant correspondre aux
éléments de représentation portés par nos
enquêtés, nous permettent ainsi d'éclairer leurs positions.
Et nous avons également comparé ces positions avec celles des
acteurs institutionnels analysées dans le chapitre
précédent, en les confrontant dans dans ce même
schéma.
A partir de l'examen des représentations des
enquêtés sur quatre niveaux (motivation initiale ; changement
d'idées ; prise de position ; réflexion sur le devenir du Projet
Nô-Life), nous avons analysé les positions des
enquêtés en terme de divergence et de convergence.
D'abord, la divergence des positions entre les
enquêtés, est liée aux circonstances individuelles du
présent ou à court terme, qui s'inscrivent dans leurs
trajectoires impliquant les quatres types d'influences expliqués plus
haut. Ces facteurs intérieurs constituent finalement la diversité
des enjeux et des représentations au sein de nos
enquêtés.
Puis, en terme de convergence des positions des
enquêtés, nous avons relevé les points positif et
négatif. Le point positif de convergence réside dans le fait que
la plupart des enquêtés considèrent l'agriculture comme
Ikigai en ayant chez eux divers besoins socio-culturels portant sur le long
terme qui sont associables à la production matérielle.
Le point négatif de convergence réside dans le
fait que la plupart des enquêtés ressentent des contraintes
économiques pour mener une production agricole à but lucratif.
D'où une série de critiques et de mise en doute par les
enquêtés à l'égard de l'orientation productiviste
donnée par le Projet Nô-Life, représentée par
l'objectif de gagner un million de yens de revenu agricole annuel, ainsi que
des activités de formation Nô-Life orientées par cet
objectif. C'est pourquoi les prises de position des enquêtés ont
eu tendance à s'éloigner du pôle de la production
matérielle. Ces deux points de convergence montrent que les
enquêtés sont confrontés au même dilemme : la
difficulté de rendre compatibles leurs besoins économique et
socio-culturels.
D'ailleurs, un certain nombre de réflexions sur le devenir
du Projet Nô-Life nous ont confirmé l'existence de ce dilemme
commun aux enquêtés, et que le Projet Nô-Life lui-même
n'arrive pas encore à résoudre.
Conséquence du compromis institutionnel du Projet
Nô-Life : effet de marginalisation
Puis, nous avons considéré cette situation de
dilemme à laquelle les enquêtés sont confrontés,
comme un effet de marginalisation par le compromis réalisé entre
les agents gestionnaires du Projet Nô-Life. Autrement dit, une
marginalisation des demandes de la part des stagiaires par rapport à
l'offre proposé par le Projet. En effet, ce compromis, comme nous
l'avons relevé dans le chapitre précédent, reflète
fortement une vision productiviste héritée de l'histoire de la
modernisation agricole japonaise. Cette orientation est le reflet du
déséquilibre de situation de représentations, de pratiques
et de pouvoirs dans les relations sociales constitutives de ce compromis entre
les agents gestionnaires et partenaires. Finalement, cet effet de
marginalisation aggrave la fragilité du compromis en risquant de
désangager ou de démotiver ces stagiaires. Cette situation peut
être considérée comme un effet pervers du Projet
Nô-Life, car les protagonistes du Projet ne sont pas les gestionnaires
mais ces stagiaires qui mettront à l'épreuve la
légitimité du Projet.
Propositions critiques et pragmatiques
Suite à ce constat, en guise de réflexion finale
de ce chapitre, nous avons formulé quatre propositions destinées
aux acteurs du Projet Nô-Life en vue de consolider le compromis non
seulement entre les acteurs institutionnels mais entre tous les acteurs du
Projet, en dotant le bien commun constituant ce compromis, qui est
l'agriculture elle-même, d'une nouvelle identite dans le sens de
l'idée de la « cité » de L. Boltanski. Il s'agit d'une
définition alternative de la profession agricole, en l'occurence une
tentative de redéfinition de l'agriculture de type Ikigai dans le
contexte du Projet Nô-Life.
Pour procéder à ces propositions, nous avons repris
des éléments théoriques de la transaction sociale
proposés par M. Mormont ainsi que du transcodage de P. Lascoumes.
L'approche de la transaction sociale proposée par M.
Mormont consiste à supposer une création de nouveaux dispositifs
alternatifs pour la mise en oeuvre politique qui permet aux agents
concernés d'anticiper et de s'engager tout en maintenant leurs
identités et intérêts sur le court terme et le long terme.
Et ceci implique une complète reconsidération de «
l'appareil de règles » du monde professionnel portés par un
ensemble d'agents, non seulement comme structure dominante, mais comme porteur
de cadre stabilisateur de ces anticipations et engagements des agents
concernés en vue de mettre en oeuvre une nouvelle politique publique. Ce
point de vue implique dans notre contexte une redéfinition alternative
de la profession agricole qui est susceptible de dépasser la
définition de l'agriculture de type Ikigai, telle qu'elle a
été faite dans le Projet Nô-Life sur la base du seul
critère économique et réductionniste qui ne tient pas
compte des autres espèces de représentations, à savoir
celles relevant des critères de la qualité de vie et du lien
social et territorial.
L'approche du transcodage de P. Lascoumes consiste à
« rendre gouvernable » une nouvelle identité de l'agriculture
de type Ikigai qui constitue un monde émergeant dans le contexte du
Projet Nô-Life. Ceci au travers d'incessants efforts de concertations et
de traductions réciproques des dispositions des acteurs
concernés, et ainsi de « rééquilibrer »
celles-ci pour un meilleur maintien de ce monde fluctuant et conflictuel.
Sans reprendre les contenus de ces quatre propositions (1
Etablissement de nouveaux cadres de concertation sur la gestion des
activités du Centre Nô-Life ; 2 Modification de l'orientation
globale du Projet Nô-Life ; 3 Ajustement du programme de la formation
Nô-Life ; 4 Etablissement d'une association de stagiaires Nô-Life),
notons que nous avons voulu montrer qu'à travers ces propositions, tout
en remettant en question les défauts du Projet selon notre observation,
il y a des possibilités pour développer durablement une
agriculture alternative dans ce contexte du Projet Nô-Life, avec les
acteurs en place et leurs moyens disponibles, malgré le
déséquilibre de leur situation de représentations, de
pratiques et de pouvoirs.
Perspectives
Agriculture de type Ikigai dans le contexte
général : un indice de transformation
Pour répondre à notre question
générale sur la crise permanente de l'agriculture et de la
ruralité au Japon, nous devons d'abord réinterroger la vision
productiviste de la politique de la modernisation agricole japonaise. Nous
avons vu que le référentiel de cette modernisation était
la Haute croissance économique de 1955 à 1975. Ce
référentiel a permis à cette politique d'avoir une
légitimité, malgré ses défaillances
avérées dans ses conséquences : accélération
de la situation de pluriactivité, surproduction du riz etc. Mais, de nos
jours, est-ce que cette légitimité continue à se baser sur
ce même référentiel ?
Sur ce point, le cas de l'émergence de l'agriculture de
type Ikigai dans la Ville de Toyota montre effectivement un indice de
transformation des représentations sociales de l'agriculture et de la
ruralité. Comme nous l'avons relevé, cette agriculture
était composée des trois pôles des représentations
socio-culturelles et économique (qualité de vie ; lien social et
territorial ; production matérielle). Mais tout comme la notion des
représentations sociales, cette agriculture est elle-même en
devenir, à savoir un processus. Il doit toujours être mis en jeu
ou à l'épreuve dans son contexte d'émergence, qui est
territorial et socio-politique.
Dans le contexte général de l'agriculture
japonaise, ce qui caractérise l'agriculture de type Ikigai dans la Ville
de Toyota, c'est que la problématique du vieillissement de la population
a été ajoutée, quoique partiellement et localement, dans
les référentiels de la politique agricole. Ceci grâce
à la légitimité générale de l'idée
d'Ikigai mise en relation avec la prévention de la dépendance des
personnes âgées dans la politique du vieillissement au Japon. Et
ceci était également possible dans le contexte prolongé de
restructuration après les
accords du GATT qui a accordé de l'importance à
la multifonctionalité de l'agriculture et de la ruralité, ainsi
qu'au rôle de la politique publique pour la sécurité
alimentaire. Mais, bien entendu, la vision productiviste y reste dominante et
plutôt renforcée avec le référentiel de
marché et de concurrence. Dans ce sens-là, le cas de
l'agriculture de type Ikigai ne montre pas un vrai changement, mais
plutôt une situation de contradiction accrue. La contradiction parce que,
vu que le contexte général du vieillissement de la population
japonaise où la population a même commencé à
diminuer depuis 2005, et en plus, dans le contexte économique actuel du
pays, le revenu moyen des ménages n'augmente plus depuis ces
dernières années771, il nous paraît même
inadapté d'adopter la vision productiviste aujourd'hui avec le
référentiel de l'époque de la Haute croissance.
Importance de la dimension territoriale
Néanmoins, le cas du Projet Nô-Life nous tient
à coeur, rien que par son utilisation d'une approche originale et
réaliste de mise en oeuvre de la multifonctionalité. Mais
au-delà de cela, le plus remarquable dans ce projet est que son
processus de construction dépendait fortement de son contexte
territorial : un des facteurs importants du développement de ce projet
est l'importance de la question d'Ikigai qui est fortement liée à
la question territoriale propre à l'histoire de la Ville de Toyota. Il
s'agit de l'identité territoriale de la Ville de Toyota, qui a dû
fortement jouer dans le processus de construction du Projet ainsi que dans
celui de l'émergence de l'agriculture de type Ikigai. En effet, la
qualité de vie et le lien social et territorial constituent une demande
permanente de la population de cette ville, et ainsi une sorte de leitmotiv de
la politique locale de redistribution de la Ville de Toyota depuis les
années 50 dans sa situation d'emprise par l'industrie automobile. Dans
ce sens-là, la question d'Ikigai est presque synonyme de celle de
l'identité de la Ville. Autrement dit, ces deux thèmes
constituent une dialectique territoriale propre à cette ville.
Et l'identité de la ville n'est pas un produit
figé, mais un processus tout comme une représentation. Elle est
donc, en permanence, et parallèlement à l'émergence de
l'agriculture de type Ikigai et la construction du Projet Nô-Life, en
devenir et en jeu. Elle a ses propres besoins, problèmes et conflits en
elle-même. C'est ainsi qu'elle compose ses objets et s'en recompose. La
réappropriation croisée de la question agricole et de celle du
vieillissement effectuée par les agents locaux de cette ville pour
construire le Projet Nô-Life, peut donc se comprendre dans le cadre de
cette dynamique identitaire inhérente au territoire de la Ville de
Toyota. Que sont alors les possibilités et limites du cas du Projet
Nô-Life ?
Projet Nô-Life : possibilités et
limites
Nous avons voulu montrer les possibilités et limites du
Projet Nô-Life de manière concrète, avec nos quatre
propositions à la fois critiques et pragmatiques portant sur : le mode
de communication (manque de concertation) ; la représentation (slogan
productiviste inadapté à la situation) ; la pratique
(méthode trop conventionnelle) ; la relation sociale (manque de lien
plus autonome parmi les stagiaires).
Malgré toutes les critiques et propositions possibles,
le développement ultérieur du Projet Nô-Life et de
l'agriculture de type Ikigai dépendra de la dynamique identitaire propre
au territoire de la Ville de Toyota. Cette dynamique constitue la
première condition pour ce développement, à laquelle on
devrait toujours se référer, et dans laquelle on devrait jouer.
Les possibilités et limites se trouveront également dans cette
dynamique territoriale où se trouvera également le processus de
transaction sociale avec des compromis, des tensions et la domination qui
ancrent les représentations sociales.
771 Ainsi les problèmes de la sécurité
sociale et de la disparité économique parmi la population et
entre les régions constituent actuellement deux des thèmes
politiques les plus importants au Japon.
Généralisation ou particularisation
?
Pour la question de la possibilité de
généralisation de la leçon de cette étude de cas,
nous insistons d'abord sur l'importance de replacer dans une dimension
territoriale la question qu'elle soit générale, comme celle de la
crise agricole et rurale, ou locale, comme celle du dilemme individuel. C'est
là qu'elles pourront être réellement posées et mises
en jeu et à l'épreuve. Et c'est là où la
priorité des choses peut se renverser et se recomposer autour d'une
problématique identitaire et inhérente au territoire. Ainsi nous
devrions articuler une redéfinition et une solution alternative, avec
les acteurs et les objets territoriaux, tout en prenant conscience que le
conflit entre ceux-ci fera également partie intégrante du
processus en question.
Enfin, c'est à partir de cette dimension territoriale
que nous pourrons procéder à la comparaison avec d'autres cas
pour améliorer nos connaissances sur une question donnée.
Ensuite, nous pourrons mieux examiner la pertinence des questions
générales ou locales en les mettant à l'épreuve de
plusieurs dynamiques territoriales différentes. Puis, les
possibilités et limites des réponses devront être
relevées à partir des enjeux propres dans ces dynamiques.
Bibliographie générale
ANSART, P. (1990), Les sociologies contemporaines,
Paris, Seuil.
BERQUE, A. (1973), « Les campagnes japonaises et l'emprise
urbaine », Etudes rurales, n°49-50 : p.32 1-352. BLANC, M.
(1992), « Introduction », in Pour une sociologie de la
transaction sociale, Paris, L'Harmattan : p.7-15.
BLANC, M. (1994), « La transaction dans les sciences
sociales : vers un paradigme élargi (Chapitre 1) » in Vie
quotidienne et démocratie : Pour une sociologie de la transaction
sociale (suite), Paris, L'Harmattan : p.21-47.
BLANC, M. (Textes réunis et présentés par)
(1992), Pour une sociologie de la transaction sociale, Paris,
L'Harmattan.
BLANC, M., MORMONT, M., REMY, J., STORRIE, T. (1994), «
Présentation », in Vie quotidienne et
démocratie : Pour une sociologie de la transaction
sociale (suite), Paris, L'Harmattan : p.9-17.
BLANC, M., MORMONT, M., REMY, J., STORRIE, T. (Textes
réunis et présentés par) (1994), Vie
quotidienne
et démocratie : Pour une sociologie de la transaction
sociale (suite), Paris, L'Harmattan. BOURDIEU, P. (1984), Questions de
Sociologie, Paris, Les Editions de Minuit.
BOURDIEU, P. (1994), Raisons pratiques, Paris, Seuil.
BOURDIEU, P. (2000), Les structures sociales de
l'économie, Paris, Seuil.
BRAUDEL, F. (1969), Ecrits sur l'histoire, Paris,
Flammarion.
BRAUDEL, F. (1993), Grammaire des civilisations, Paris,
Flammarion.
CALVET, R. (2002), « La Réforme agraire japonaise de
1946 : Les fondements historiques d'un succès », Histoire et
Sociétés Rurales, n°18, 2e semestre :
p.65-89.
FRAYSSE, B. (2000), « La saisie des représentations
pour comprendre la construction des identités », Revue des
sciences de l'éducation, Vol. XXVI, n°3, 2000 : p.65 1-676.
GARNIER, C., SAUVE, L. (1998), « Apport de la
théorie des représentations sociales à l'éducation
relative à l'environnement : Conditions pour un design de recherche
», Education relative à l'environnement, Vol. 1, 1998-1999
: p.65-77.
HAMAGUCHI, H (1999), Ikigai sagashi : taishû
chôju shakai no jilenma (Recherche d'Ikigai : dillemme de l'ère de
la longévité de masse), Kyôtô, Mineruva
Shobô.
HAMAGUCHI, H., SAGAZA, H. (1994), Teinen no Life Style (Style
de vie des retraités), Tôkyô, Korona-sha. HOSOYA, T.
(1998), Gendai to Nihon Nôson Shakai-gaku (Monde contemporain et
sociologie rurale japonaise), Sendai, Tôhoku Daigaku Shuppai kai.
ITO, T. (1977), « Dai 2 setsu : Koromo-shi no tanjô
to toshi-seibi (Sous-chapitre 2 : Naissance de la Ville de Koromo et
aménagement urbain) », Dai 1 shô : Sengo kaikakuki no Toyota
(Chapitre 1 : Toyota en période de la réforme de
l'après-guerre), Toyota-shi-shi (Histoire de la Ville de
Toyota), Tome 4 : p. 13-27.
ITO, T. (1977), « Dai 3setsu : Toyota-shi no tanjô
to hatten (Sous-chapitre 3 : Naissance et développement de la Ville de
Toyota) », Dai 2shô : Toyota-shi no tanjô to keisei (Chapitre
2 : Naissance et formation de la Ville de Toyota), Toyota-shi-shi (Histoire
de la Ville de Toyota), Tome 4 : 289-350.
ITO, T. (1977), « Dai 4setsu : Toshika no shinten to
toshi-keisei (Sous-chapitre 4 : Avancement de l'urbanisation et formation de la
Ville) », Dai 3shô : Kôdo-keizai-seichô-ki no Toyota
(Chapitre 3 : Toyota en période de la Haute croissance),
Toyota-shi-shi (Histoire de la Ville de Toyota), Tome 4 :
p.630-656.
KAMATA, S. (1983), Jidôsha zetsubô
kôjô : aru kisetsu-kô no nikki (Usine automobile du
désespoir : journal d'un ouvrier saisonier) , Tôkyô,
Kôdansha bunko.
LASCOUMES, P. (1996), « Rendre gouvernable : de la
`traduction' au `transcodage' L'analyse des processus de changement dans les
réseaux d'action publique », in La Gouvernabilité,
Paris, PUF : p.325-338
LEGRAND, M. (2001), La retraite : une révolution
silencieuse, Ramonville, Erès.
LÉVI-STRAUSS, Cl. (1958), Anthropologie
structurale, Paris, Librairie Plon.
LÉVI-STRAUSS, Cl. (1962), La pensée
sauvage, Paris, Librairie Plon.
MATSUI, S. (1977), « Dai 1setsu : Kigyô-toshi
Toyota no keisei (Sous-chapitre 1 : Formation de la Ville d'entreprise Toyota)
», Dai 2shô : Toyota-shi no tanjô to keisei (Chapitre 2 :
Naissance et formation de la Ville de Toyota), Toyota-shi-shi (Histoire de
la Ville de Toyota), Tome 4 : 201-203.
MATSUI, S. (1977), « Dai 1setsu : Yakushin-ki no
Toyota-shi (Sous-chapitre 1 : Ville de Toyota en période d'essor »,
Dai 3shô : Kôdo-keizai-seichô-ki no Toyota (Chapitre 3 :
Toyota en période de la Haute croissance), Toyota-shi-shi (Histoire
de la Ville de Toyota), Tome 4 : p.491-497.
MATSUI, S. (1977), « Dai 3 setsu : Nôchikaikaku to
shokuryô-zôsan (Sous-chapitre 3 : Réforme agraire et
augmentation de la production alimentaire) », Dai 1 shô :
Sengo-kaikaku-ki no Toyota (Chapitre 1 : Toyota en période de la
réforme de l'après-guerre) in Toyota-shi-shi (Histoire de la
Ville de Toyota), tome 4 : p.76-108.
MATSUI, S. (1977), « Dai 3 setsu : Nôgyô no
konran to nôgyô-kôzô-kaizen (Sous-chapitre 3 :
désordre de l'agriculture et politique de l'amélioration de la
structure agricole) », Dai 3 shô : Kôdo keizai-seichô-ki
no Toyota (Chapitre 3 : Toyota en période de la Haute croissance), in
Toyota-shi-shi (Histoire de la Ville de Toyota), tome 4 :
p.551-629.
MATSUI, S. (1977), « Dai 5 setsu : Nôgyô no
henyô to kindaika (Transformation et modernisation de l'agriculture)
», Dai 2 shô : Toyota-shi no tanjô to keisei (Chapitre 2 :
Naissance et formation de la Ville de Toyota); in Toyota-shi-shi (Histoire
de la Ville de Toyota), tome 4 : p.425-458.
MENDRAS, H. (2002), Éléments de
sociologie, Paris, Armand Colin.
MIYAKAWA, Y. (1977), « Dai 2setsu :
Jidôsha-kôgyô no hatten to Toyota no Kôgyô-ka
(Sous-chapitre 2 : Développement de l'industrie automobile et
industrialisation de la Ville de Toyota) », Dai 2shô : Toyota-shi no
tanjô to keisei (Chapitre 2 : Naissance et formation de la Ville de
Toyota), Toyota-shi-shi (Histoire de la Ville de Toyota), Tome 4 :
213-240.
MIYAKAWA, Y. (1977), « Dai 4setsu : Kôgyô no
seisan no konran to hukkô (Sous-chapire 4 : Dérangement dans la
production industrielle et reconstruction) », Dai 1shô : Sengo
kaikakuki no Toyota (Chapitre 1 : Toyota en période de la réforme
de l'après-guerre), Toyota-shi-shi (Histoire de la Ville de
Toyota), Tome 4 : p.108-134.
MORMONT, M. (1994), « Incertitudes et engagaments : les
agriculteurs et l'environnement une situation de transaction » in Vie
quotidienne et démocratie : Pour une sociologie de la transaction
sociale (suite), Paris, L'Harmattan : p.209-234.
NACHI, M. (2006), Introduction à la sociologie
pragmatique : vers un nouveau « style » sociologique ?, Paris,
Armand Colin.
Naikaku-hu (Office du Gouvernement) (2006), Heisei 18nendo :
Kôrei-shakai Hakusho (Livre blanc du
Vieillissement),
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2006/gaiyou/18indexg.html
(site officiel)
Nôrin-suisan-shô (Ministère de
l'agriculture, de la pêche et de la forêt) (2005), «
Heisei 17 nendo Shokuryô - nôgyô - nôson no
dôkô » ainsi que « Heisei 18 nendo Shokuryô -
nôgyô - nôson shisaku » (« Tendances de
l'alimentation - agriculture - ruralité de l'année 2005 » et
« Mesures pour l'alimentation - agriculture - ruralité de
l'année 2006 »),
http://www.maff.go.jp/hakusyo/nou/h17/html/index.htm
(site officiel)
PERRIER-CORNET, Ph. (2003), « La dynamique des espaces
ruraux dans la société française » in
Agriculteurs,
ruraux et citadins. Les mutations des campagnes
françaises, Dijon, CRDP de Bourgogne : p.35-51.
PERRIER-CORNET,
Ph., HERVIEU, B. (2002), « Les transformations des campagnes
françaises : une vue
d'ensemble » in Repenser les campagnes,
Géménos, éditions de l'aube : p.9-31.
REMY, J. (1994), « La transaction : de la notion
heuristique au paradigme méthodologique (Conclusion) » in Vie
quotidienne et démocratie : Pour une sociologie de la transaction
sociale (suite), Paris, L'Harmattan : p.293-3 19.
SAKAIYA, T. (2005), Dankai no Sedai : shinpan
(Génération de dankai : nouvelle édition),
Tôkyô,
Bungei-shunjû.
SASAKI, K. (2004), « Suicide et `ikigai' chez les personnes
âgées », in Quand la vie s'allonge : France-Japon,
Paris, L'Harmattan : p.99-123.
SERVOLIN, Cl. (1989), Agriculture moderne, Seuil.
SUZUKI, T. (2003), « America-komugi-senryaku » to
nihonjin no shokuseikatsu (« Stratégie céréaliaire
américaine » et la vie alimentaire des japonais),
Fujiwara-shoten : p. 13-42.
TAKAHASHI, J. (1978), « Dai 2setsu : Jidôsha
kôgyô no tenkai to suii (Sous-chapitre 2 : Développement et
évolution de l'industrie automobile) », Dai 5 shô : Toyota-
Jidôsha-Kôgyô no sôgyô to senjika no seikatsu
(Chapitre 5 : Démarrage de l'Automobile Toyota et vie pendant la
guerre), Toyota-shishi (Histoire de la Ville de Toyota), tome 3 :
p.753-769.
TAKAHASHI, J. (1978), « Dai 3setsu : Jinkô no
ugoki to Koromo-chô no toshi keikaku (Sous-chapitre 3 :
Mouvement démographique et plan d'urbanisme du Bourg
de Koromo) », Dai 5shô :
Toyota-Jidôsha-Kôgyô no sôgyô to
senjika no seikatsu (Chapitre 5 : Démarrage de l'Automobile Toyota
et vie pendant la guerre), Toyota-shishi (Histoire de la
Ville de Toyota), tome 3 : p.770-785.
TAKEMOTO, Z. (2001), Shakai Hoshô Nyûmon : Naniga
kawattaka, korekara dônaruka (Introduction à la
Sécurité sociale : quel changement, quel avenir
?), Tôkyô, Kôdansha.
TOYOTA-SHI (Ville de Toyota) (2004), Toyota-shi Tôkei
sho : Heisei 15nendo-ban (Statistique de la Ville de Toyota : année
2003), Toyota, Toyota-shi.
UMESAO, T. (1985), Watashi no Ikigai-ron (Mon argumentation
sur Ikigai) , Tôkyô, Kôdansha bunko.
Annexes
1 Questionnaire
2 Liste des questions posées dans les entretiens
3 Synthèse du résultat de l'enquête par
entretien
4 Schéma global du Plan de 96
5 Schéma global sur la nouvelle place de
l'agriculture
dans l'aménagement urbain dans le Plan de 96
6 Schéma des fonctions du Parc rural dans le Plan de 96
7 Image du Parc rural dans le Plan de 96
8 Schéma des fonctions de l'Ecole rurale dans le Plan de
96
9 Schéma conceptuel du réseau sur
la
participation sociale et la création d'Ikigai
10 Localisation de la Ville de Toyota dans le Japon
| 


