|
Aux membres de ma famille, particulièrement :
- Suzanne Ngah Onana, ma grand-mère ; - Justine Nathalie
Ebéné, ma mère ;
- Justine Corine Ebéné, ma petite soeur.

SOMMAIRE
ii
REMERCIEMENTS iii
SIGLES, ACRONYMES, ABREVIATIONS iv
LISTE DES ILLUSTRATIONS vi
RESUME viii
ABSTRACT ix
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE 1
CHAPITRE I
:PRESENTATION DE LA FEMME EN AFRIQUE CENTRALE ZONE
CEMAC 28
A. RAPPEL HISTORIQUE 29
B. LA CREATION DE L'UDEAC ET LA PLACE RESERVEE AUX
FEMMES 38
C. L'AVENEMENT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE SOUS
REGIONALE LA
CEMAC 46
CHAPITRE II : LE ROLE DE LA
FEMME AU SEIN DE L'ORGANISATION
INTERNATIONALE SOUS REGIONALE LA CEMAC 54
A. LES LEGISLATIONS EN FAVEUR DES FEMMES DANS LA CEMAC
54
B. DE LA CONTRIBUTION DIPLOMATIQUE DE LA
FEMME 66
M
C. LES MOYENS D'ACTION DE LA FEMME DANS LA
CEMAC 92
CHAPITRE III : LES LIMITES A L'ACTION DIPLOMATIQUE
DE LA FEMME AU SEIN
DE LA CEMAC 101
A. LA CONJONCTURE COMMUNAITAIRE ET LES LOIS
DEFAVORABLES AUX SOMMAIRE
FEMMES 101
B. LES PROBLEMES GENERAUX A LA LIBRE
CIRCULATION 113
C. AUTRES FORMES DE DIFFICULTES
117
CHAPITRE IV : BILAN DE LA CONTRIBUTION DIPLOMATIQUE DE LA FEMME
AU SOMMAIRE
SEIN DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE SOUS REGIONALE LA
CEMAC 120
A. DES REALISATIONS DIPLOMATIQUES DE LA FEMME DANS LA
CEMAC, ENJEU
DE SA PRESENCE DANS LES POSTES DE RESPONSABILITE
120
B. L'IMPACT DES REALISATIONS DIPLOTIQUES DE LA FEMME
DANS LA
SOMMAIRECEMAC ..134
C. DES PERSPECTIVES POUR UNE MEILLEURE PROMOTION DE LA
FEMME DANS
LA CEMAC 137
CONCLUSION GENERALE 147
SOMMAIREANNEXES 152
SOURCES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 174
TABLE DES MATIERES 187

iii
REMERCIEMENTS
Arrivée au bout de cette recherche qui n'a pas
été un long fleuve tranquille, c'est l'occasion de manifester la
gratitude à tous ceux qui ont, de près ou de loin, permis la
réalisation de ce mémoire.
Nos profonds remerciements s'adressent tout d'abord au
directeur de mémoire, le Pr. Robert Kpwang Kpwang dont
l'expérience et le dévouement ont permis de mener ce travail
à terme.
Notre gratitude va également à l'endroit de tous
les enseignants du Département d'Histoire de la Facultés des
Arts, Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Yaoundé I
qui, par leur disponibilité, ont contribué à notre
formation actuelle.
Cette même gratitude est exprimée aux
responsables des différents centres de SOMMAIRE
documentation, aux Diplomates des ambassades, notamment
Julie-Diane Djambo Benita, Conseiller Economique et Commercial à
l'Ambassade du Gabon au Cameroun dont la collaboration a permis de mieux
comprendre la situation de la femme au Gabon. Aux SOMMAIRE
fonctionnaires de la Représentation de la CEMAC au
Cameroun notamment Julien Ticky, Expert Principal aux questions
institutionnelles qui a été attentionné à nos
préoccupations et a mis à notre disposition, des documents
adéquats sur ce thème. A Nicolas Marie Gaspar Messi, Assistant de
la Représentante de la CEMAC au Cameroun qui nous a permis de
bénéficier de l'accès à la Bibliothèque de
la Représentation de la CEMAC. Aux cadres du Ministère des
relations extérieures, notamment Mebounou Marcelline, chef de service
à la Sous-direction des affaires d'Afrique qui a manifesté
beaucoup d'intérêt à ce travail, à travers la
réponse à notre
SOMMAIRE
questionnaire.
Nos reconnaissances vont aussi à l'endroit du Pr.
Essomba Leka du Département de Sociologie, pour ses corrections
apportées à ce SOMMAIRE travail et le Dr. Edith
Valéry Ndjah Etolo pour sa documentation. Au Dr. Jean Léonard
Thierry Mbassi Ondigui pour sa documentation et ses multiples corrections dans
ce travail. Ainsi, qu'au Dr. Cyrille Aymard Bekono donc la contribution
à ce travail a été importante.
SO
Nous portons aussi nos remerciements à nos oncles
Charles Essomba et François Ekani, qui part leur apport matériel,
ont contribué à la réalisation de ce travail.
Ils sont encore nombreux ceux dont les noms ne figurent pas
ici, et à qui nous disons SOMMAIRE
merci pour leur apport de près ou de loin dans ce
travail.

SIGLES, ACRONYMES, ABREVIATIONS
iv
AEF : Afrique Equatoriale Française
BAD : Banque Africaine de
Développement
SOM
CCPAC : Comité des Chefs de Polices
d'Afrique Centrale
CEDEF : Convention sur l'Elimination de toutes
les formes de Discrimination à
l'Egard des Femmes
CEEAC : Communauté Economique des Etats
de l'Afrique Centrale
CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
CER : Communauté Economique
Régionale
SOM
CPAC : Comité des Pesticides d'Afrique
Centrale
CRUROR/AC : Conférence des Recteurs des
Universités et des Responsables
des Organisations de Recherche en Afrique Centrale.
O
EIED : Ecole Inter-Etat des Douanes
ENAM : Ecole Nationale d'Administration et de
Magistrature
ESIJY : Ecole Supérieure Internationale
de Journalisme de Yaoundé
ESSTI : Ecole Supérieure des Sciences et
Technique de l'Information
ESSTIC : Ecole Supérieure des Sciences et
Technique de l'Information et de la
Communication
S
FERDI : Fondation pour les Etudes et Recherches
sur le Développement
International
ISSEA : Institut Sous Régionale de
Statistique et d'Economie Appliquée
LIEAP : Laboratoire Inter-Etats d'Analyse des
Pesticides et de Contrôle de
SOMMAIRE
Qualité des Aliments en Afrique Centrale
MINREX : Ministère des Relations
Extérieures
MINUSCA : Mission multidimensionnelle
Intégrée des Nations Unies pour la
Stabilisation en Centrafrique
OCEAC : Organisation de Coordination de lutte
contre les Endémies en Afrique
Centrale
ONU : Organisation des Nations Unies
OUA : Organisation de l'Unité
Africaine
PER : Programme Economique Régional
v
PIDESC : Pacte International Relatif aux Droits
Economiques, Sociaux et Culturels
PPCA/CEMAC : Promotion de la Pêche
Continentale et de l'Aquaculture de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
RCA : République Centrafricaine
RDC : République Démocratique du
Congo
REFAC : Réseau des Femmes Actives de la
CEMAC
SADC : Communauté de Développement
des Etats de l'Afrique du Sud
SDN : Société des Nations
SJ-CEMAC : Synergie Jeune de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
TSS1 : Technicien Supérieur de la
Statistique niveau 1
UDE : Union Douanière Equatoriale
UDEAC : Union Douanière Economique de
l'Afrique Centrale
UEAC : Union Economique d'Afrique Centrale
UMAC : Union Monétaire d'Afrique
Centrale
VIH-SIDA : Virus Immunodéficience
Humaine- Syndrome Immunodéficience Acquise

LISTE DES ILLUSTRATIONS
vi
1. Liste des figures
Carte 1 : Représentation
géographique des pays de la CEMAC 6
Carte 2 :
Représentation géographique de la CEMAC et limites
frontalières des Etats
membresSOMMAIRE 47
Graphique 1
: Taux de croissance du PIB réel dans les pays de l'Afrique
centrale de
2010 à 2012 ..104
2. Liste des tableaux
Tableau 1 : Les responsables de l'UDEAC en 1977
43
Tableau 2 : Le personnel féminin de la
comptabilité agréé par le Secrétariat de l'UDEAC
1977
SOMMAIRE
et 1988 .45
Tableau 3 : Ratification de la CEDEF par les
pays de la CEMAC .55
Tableau 4 : Ratification du PIDESC par les pays
de la CEMAC ...56
SOMMAIRE
Tableau 5 : Ratification de la charte africaine
des droits de l'homme et des peuples par
les Etats de la CEMAC 57
Tableau 6 : Personnel féminin au
PPCA/CEMAC en 2012 ..78
Tableau 7 : Liste des étudiants filles
inscrits dans la filière TSS1 pour l'année académique
2007
2008 à l'ISSEA 85
Tableau 8 : Le Personnel enseignant
féminin de l'ISSEA de toutes les filières confondues en
2017 86
Tableau 9 : Quelques professionnels
libéraux agréés de la Fiscalités (CF/SCF) par la
Sous-Commission des Affaires Fiscales de la CEMAC à Ndjamena le jeudi 26
octobre
2017 ..125
SOMMAIRE
Tableaux 10 : Le personnel féminin dans
la direction de l'EHT- CEMAC de 2008
à 2011 .127
Tableau 11 : Quelques fonctionnaires
féminins du CPAC de 2014 à 2017 .....128
Tableau 12 : Le Personnel enseignant
féminin de l'ISSEA de toutes les filières confondues en
2017 ..129
Tableau 13 : Quelques femmes de 2010 à
2013 au sein de l'EIED 130
vii
Tableau 14 : Responsables féminins du
REFAC de cinq pays de la CEMAC .133
3. Liste des photos
Photo 1 : Les premiers dirigeants du Secretariat
de l'UDEAC à la Commission de la
CEMAC 44
Photo 2 : La représentante du
Tchad Mahadie Outhman Issa, Secrétaire d'Etats aux infrastructures et
aux transports à la 20ème réunion du
Collège de la Surveillance
multilatérale de la CEMAC, Douala les 16-17
décembre 2010 ..70
Photo 3 : Conférence
débat sur la fluidification des échanges en zone CEMAC lors de
la
FOTRAC 2016 ..71
Photo 4 : Les produits de l'agriculture
vivrière dans la CEMAC à Kyé-Ossi .75
Photo 5 : Surcharge d'un pick-up pour faire face
à l'augmentation des coûts de
douanes 76
Photo 6 : Etang de Mitone à la Lambarene,
Antenne du PPCA/CEMAC au Gabon .....79
Photo 7 : Le poisson dans un Stand lors de la
Foire Transfrontalière de juin 2016 79
Photo 8 : Les produits agricoles de la
Guinée Equatoriale exposés à la FOTRAC 2016... 81
Photo 9 : Equipe de football féminine
tchadienne de la coupe CEMAC 90
Photo 10 : Les produits artisanaux
féminins à la FOTRAC 2016 91
Photo 11 : L'entrepreneuriat cosmétique
féminin équatoguinéen à l'honneur à la
foire
de 2014 ..91
Photo 12 : Les miss
présentées au stade d'Ebébiyin lors de la foire
transfrontalière
de 2016 ..92
Photo 13 : Les jeunes dans le processus
d'intégration sous régionale ..94
Photo 14 : Le discours de la Représente
de la CEMAC au Cameroun lors de la 4ème édition de
la journée CEMAC 95
Photo 15 : Rosario
Mbasogo Kung Nguidang, ancienne et première femme Vice-présidente
de
la Commission de la CEMAC de 2012 à 2017
.123
Photo 16 : Fatima Haram Acyl, actuelle
Vice-président de la Commission de la CEMAC depuis
2017 .124

RESUME
viii
Le présent travail sur "Le rôle de la femme dans
la diplomatie de la CEMAC 19642017", est une étude qui a pour objectif
de montrer la contribution de la femme dans la SOMMAIRE
dynamique diplomatique des Etats pour la construction de la
CEMAC. Présenter les circuits et logiques d'ascension des femmes au sein
de cette institution, ressortir le niveau de visibilité et la teneur du
travail effectué par les femmes dans cette
homogénéité spatiale, tout en relevant
SOMMAIRE
les difficultés auxquelles elles font face et ressortir
les pistes pour améliorer la représentativité de la femme
au sein de cette communauté économique et monétaire de
l'Afrique centrale.
Pour mener à bien cette recherche, l'on a adopté
une méthode à la fois qualitative à travers l'analyse
minutieuse des sources écrites, des témoignages oraux et
quantitative à travers l'utilisation des tableaux statistiques, de
diagramme. C'est ainsi qu'ont été combinées des
méthodes diachronique et analytique, sans oublier la
pluridisciplinarité dont met en exergue ce travail. De ces multiples
investigations il ressort que la femme a commencé à jouer un
rôle en
SOMMAIRE
Afrique centrale, depuis la période précoloniale
même si ce rôle était moins considérable que celui de
l'homme. Cependant, avec l'arrivée du colonisateur, la femme est
reléguée au second rang car c'est l'homme qui est au-devant de la
scène à travers des multiples tâches difficiles
SOMMAIRE
qu'il accomplies auprès des colonisateurs. C'est ainsi
que lors de la période de décolonisation des territoires, les
femmes vont s'insurger contre cet ostracisme, et porteront une main forte pour
la libération de leurs territoires. Accéder à
l'indépendance, les pays de cet espace SMMR
géographique manifestent la volonté de s'unir,
c'est dans ce sens que naît l'UDEAC.
A partir de là, les femmes ne sont pas en reste
même si elles sont minoritaires dans les postes de responsabilité.
Toutefois, avec la décennie de la femme lancée à partir de
1975 lors de la conférence féministe de San Francisco, nombreux
Etats africains introduisent ce SOMMAIRE
programme dans leur agenda. En 1994, la CEMAC remplace l'UDEAC
par le Traité de Ndjamena du16 mars, cela permet à cette
Institution de dépasser le cadre simple de la douane, en introduisant le
volet économique et monétaire, sans oublier les volets politique
et social. SOMMAIRE
Cependant, c'est dans les années 2000 que la femme est
réellement déployée au sein de cette Institution en
occupant de nombreux postes tant au sein des Organes, des Institutions
spécialisée que des groupes d'association, ceci grâce
à son dynamisme avéré. Cependant, il est noté une
insuffisance des textes juridiques dans cette institution qui promeuvent la
femme. Pour pallier
SOMMAIRE
à cela, la CEMAC à travers le Programme
Economique Régional lancé en 2011, a introduit la question genre
dans ses objectifs à atteindre d'ici 2025.
ix

ABSTRACT
This work on "The role of women in the diplomacy of CEMAC
1964-2017", is a study which aims at showing the contribution of
SOMMAIREwomen in the diplomatic dynamics of States for the
construction of CEMAC. It also portrays the circuits and logic of the ascent of
women within this institution, highlights the level of visibility and the
content of the work done by women in this spatial homogeneity, while noting the
difficulties they face and suggests ways
SOMMAIRE
to improve the representativeness of women within this
economic and monetary community of Central Africa.
To carry out this research, we have used qualitative method
through careful analysis SOMMAIRE
of written sources, oral testimonies and quantitative method
through the use of statistical tables and diagrams. This is how diachronic and
analytical methods were combined, without forgetting the multidisciplinarity
which this work highlights. From these multiple investigations, it appears that
women have started playing a role in Central Africa since the pre- colonial
period even if this role was less considerable than that of men. However, with
the arrival of the colonizer, women were relegated to second role because men
were at the forefront through the multiple difficult tasks that they
accomplished with the colonizers. This
SOMMAIRE
is how, during the period of decolonization, women rebelled
against this ostracism, and took part in the liberation of their territories.
Once their independence has been achieved, countries of this geographic area
showed their desire to unite, it is in this sense that UDEAC was born.
SOMMAIRE
From that moment, women have not been outdone even if they are
not many occupying positions of responsibility. However, with the decade of
women launched in 1975 at the feminist conference in San Francisco, many
African states have been putting this program SOMMAIRE
on their agenda. In 1994, CEMAC replaced UDEAC with the Treaty
of Ndjamena of March 16, this allowed this Institution to go beyond the simple
customs framework, by introducing the economic and monetary component, without
forgetting the political and social components too. However, it was in the
2000s that women were really represented in this Institution, occupying
numerous positions both within the Organs, Specialized Institutions and
association groups, thanks to their proven dynamism. Nevertheless, there is an
insufficiency of the legal texts in this institution which promote the
empowerment of women.
SOMMAIRE
To sort it out, CEMAC through the Regional Economic Program
launched in 2011, has introduced the gender issue into its goals to be achieved
by 2025.

INTRODUCTION GENERALE
1
1. Contexte et justification du sujet
Cette recherche porte sur "Le rôle de la femme dans la
diplomatie de la CEMAC 19641999". L'Afrique a connu des épreuves
douloureuses de domination, de l'esclavage à la colonisation. Des
épreuves auxquelles vont s'ajouter la Première et la
Deuxième guerre mondiale. C'est ainsi que, longtemps qualifiée de
continent ténébreux, l'Afrique est restée
SOMMAIRE
ignorer dans les relations internationales,
considérée comme un objet. L'on ne saurait faire exempt du
syndrome de Berlin qui a amplifié la dislocation anarchique des
territoires africains1. Cependant, après la Première
Guerre mondiale, est créée la Société des Nations
(SDN) le 20 SOMMAIRE
janvier 1920 pour maintenir la paix et la
sécurité internationale. Promesse à laquelle elle ne
tiendra pas. Ayant ainsi échoué à sa mission avec
l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, la SDN n'a plus eu
lieu d'être. Ce qui avait conduit à la création de
l'Organisation des Nations Unies (ONU) à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, pour poursuivre et innover les objectifs de l'organisation
précédente. Par ailleurs, durant la Deuxième Guerre
mondiale, les problèmes des colonies se posent avec acuité,
surtout la volonté des peuples africains de s'affranchir. C'est ainsi
qu'au lendemain de ce deuxième conflit international, les Africains
SOMMAIRE
manifestent massivement de s'autodéterminer afin de
contribuer eux-mêmes à l'amélioration de leurs conditions
de vie.
Dans cette initiative, plusieurs territoires africains
accédèrent à la souveraineté
SOMMAIRE
internationale dans les années 19602. Cette
accession au nouveau statut d'Etats souverains donne aux populations africaines
et à leurs dirigeants, outre la liberté et le droit à
l'autodétermination, de nouvelles obligations qui étaient celles
de prendre eux-mêmes leur SOMMAIRE
avenir en main3. C'est ainsi qu'au lendemain de
leur accession à l'indépendance, les Etats africains se dessinent
un projet de vivre ensemble. Cependant, la création de l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA) en 1963 pour le processus d'intégration
de l'Afrique a laissé paraître
M
deux thèses, par rapport à l'unité
africaine : celle de la supranationalité relative au bloc de Casablanca
et celle d'une union progressive du bloc Monrovia. C'est ainsi que la
thèse prônant
1 A. Bathili, "La conférence de Berlin 1985
: causes et conséquences", in Aujourd'hui l'Afrique,
n°31-32, Centenaire de la Conférence de Berlin (1884-1885).
2 M. Cornevin, Histoire de l'Afrique
Contemporaine : de la deuxième guerre mondiale à nos jours,
Paris, Payot, 1979, pp.210-263.
3 V. Faka, "La BAD et le développement
socioéconomique du Cameroun entre 1972 et 2010", Mémoire de
master
en histoire, Université de Yaoundé I, 2017, p.1.
SO
4 M.T. Zézé Kalonji, Dictionnaire
des organisations interafricaines, lexique et textes, Paris, Edition
Girof, 1997, p.104.
2
une intégration progressive va rayonner. Cela conduira
à la création des homogénéités spatiales
sous régionales à l'instar de la CEMAC.
Les pays de l'Afrique centrale ont très tôt pris
conscience de l'intérêt que représente l'intégration
régionale comme facteur de renforcement de leurs relations. Avant les
indépendances, la République Centrafricaine, la République
du Congo, le Gabon et le Tchad constituaient une géoéconomique
intégrée, sous l'appellation de l'Afrique Equatoriale
Française (AEF). Le 29 juin 1959, ces pays créent l'Union
Douanière Equatoriale (UDE). Devenus autonomes puis indépendants
en 1960, ils optent pour le renforcement de leur union douanière. En
1962, le Cameroun s'associe à l'UDE et le 8 décembre 1964, les
chefs d'Etats de ces cinq pays signent à Brazzaville le traité
instituant l'Union Douanière Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC),
confirmant ainsi un processus de regroupement entamé sous la
période coloniale. Dans le but de redynamiser leurs relations, ces pays
créent la CEMAC dont le but est de parachever le processus
d'intégration économique et monétaire dans les Etats
membres de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique
centrale4. Toutefois, la coopération entre ces Etats au sein
de cette institution résulte des négociations et de la signature
des accords diplomatiques, que ce soit dans le domaine politique,
économique ou socioculturel.
Depuis des décennies, les questions de genre et
d'égalité s'opposent avec acuité dans le monde en
générale et en Afrique centrale en particulier. Cela se justifie
par l'introduction de la décennie de la femme par l'Organisation des
Nations Unies (ONU) à partir des années 70. Question prise en
compte par les Etats, ce qui justifie la forte présence des femmes au
sein des différents postes administratifs, tant dans les structures
nationales qu'internationales. D'où ce thème sur la femme dans la
CEMAC.
2. Raisons de choix du sujet
Notre préoccupation dans le cadre de cette étude
est de soutenir un mémoire sur le thème "le rôle de la
femme dans la diplomatie de la CEMAC 1964-2017". Le choix d'un sujet de
recherche participe de la complexité de la discipline historique.
Toutefois, ce choix relève une certaine subjectivité
légitime puisque dans la logique des fondateurs de l'école des
Annales, l'historien doit lui-même fabriqué ses faits sans plus
attendre qu'on les lui serve. Toutefois, nous notons que ces raisons peuvent
être de plusieurs ordres. Dans cette étude, sont relevées
des raisons d'ordre scientifique.
5 F. Virgili, "L'Histoire des femmes et l'histoire
des genres aujourd'hui", in Revue d'histoire vingtième
siècle, n° 20, Paris, 2002, p.6.
3
L'invisibilité comme sujet historique est ancienne et
l'existence de quelques travaux de femmes ou sur les femmes ne contredisent
point ce silence. C'est ainsi que les premières recherches sur les
femmes, verront le jour, même si elles sont l'oeuvre des auteurs
engagés dans le mouvement féministe (Jeanne Bouvier, Léon
Abensour, Édith Thomas, etc.), qui sont tous restés
marginalisés5. Raison pour laquelle l'histoire des femmes ou
sur les femmes sera plus tard assimilée au féminisme.
L'histoire des femmes est aussi une histoire sociale, celle de
l'arrivée des femmes diplômées, candidates à des
postes jusque-là détenus par les hommes. Les femmes ont beaucoup
milité, bousculant ainsi les habitudes et les pratiques. Ainsi il y a eu
la nécessité de donner la parole aux femmes. Elles ont
bravé les échelons, d'autres au gré de leur vie pour
atteindre un seuil dans la société d'où leur
présence dans la relation entre Etats au-delà des
frontières nationales de nos jours. Ce qui ressort du rôle de ces
dernières au sein de la CEMAC.
Après plusieurs lectures sur le rôle des femmes
dans des regroupements régionaux, sous régionaux (en Afrique), il
s'est avéré un vide scientifique sur les femmes dans la CEMAC. Ce
qui a suscité une interrogation, celle de savoir si cela est issu des
stéréotypes et conjectures qui ont longtemps miné la
femme, l'astreignant à travailler dans un seul cadre qui est celui
national alors que le travail au-delà des frontières nationales a
toujours connu la suprématie masculine. Ainsi, il est devenu fascinant
d'écrire sur les femmes dans la CEMAC afin d'apporter cette modeste
contribution sur le travail scientifique qui existait déjà sur
elles dans cet espace géographique. Afin de démontrer que les
femmes sont de nos jours innombrables dans le monde scientifique et il est
scientifiquement ingrat de denier leur activisme pour l'évolution du
monde dans tous ses aspects.
En sus, l'on a été motivé du travail sur
la femme à partir de l'observation faite sur plusieurs travaux
scientifiques en histoire et en sociologie. Il y a eu un constat selon lequel,
la multitude de travaux scientifiques en histoire traite spécifiquement
soit des faits, des événements ou ils sont basés sur les
hommes et difficilement sur la femme. En parallèle avec la sociologie,
c'est dans cette discipline que beaucoup de travaux portent sur la femme, si
non sur le genre. Il est donc novateur que l'on porte une étude sur la
femme en histoire et surtout dans le cadre de la diplomatie
multilatérale, pour sortir du conformisme scientifique, de la
masculinité disciplinaire car l'évolution globale de la science
n'a point besoin de différence entre les sexes.
4
3. Cadre géographique et chronologique
Tout travail scientifique se situe dans le temps et dans
l'espace. Chaque fait, chaque événement ou chaque Homme est
retraçable en fonction du temps et de l'espace.
Délimitation chronologique
Selon Fernand Braudel, tout travail historique
décompose le temps révolu, choisit entre ses
réalités chronologiques selon les préférences plus
ou moins conscientes6. Tout travail historique doit s'articuler sur
un acrotère chronologique bien établit. Il ressort que le
déterminant chronologique est indispensable dans l'historiographie. Cela
se laisse voir avec cette pensée de Claude Lévi-Strauss "il n'y a
pas d'histoire sans date (...) si les dates ne sont pas toute l'histoire, ni le
plus intéressant dans l'histoire, elles sont ce à défaut
de quoi elle-même s'évanouirait, puis que toute son
originalité et sa spécificité sont dans
l'appréhension de l'avant et de l'après..."7 Ce qui
permet à Joseph Ki-Zerbo de réitérer que, "l'historien qui
veut remonter le temps sans repère chronologique ressemble au voyageur
qui parcourt dans une voiture sans compteur, une piste sans bornes
kilométriques"8. C'est donc une interpellation, de toujours
prendre en compte les zones, les faits et les dates qui représentent une
réalité dont la nécessité n'est plus à
démontrer en science historique9. Allant de ce postulat,
cette étude couvre la période de 1964 à 2017.
La première date 1964 correspond à la
création de l'UDEAC. Dès 1959, les pays de l'Afrique centrale
manifestent une volonté de mettre sur pied une entité
géoéconomique intégrée car les indépendances
sont proches. C'est ainsi que le 8 décembre 1964, les chefs d'Etat de
ces pays signent le traité instituant l'UDEAC. Le choix de la borne
inférieure 1964 n'est pas synonyme d'une étude comparative entre
l'UDEAC et la CEMAC, étant donné qu'il s'agit d'une même
organisation dont les enjeux ont juste été innovés et qui
a changé de dénomination. Il s'agit plutôt de remonter le
temps pour mieux comprendre l'évolution de ladite Communauté.
La date intermédiaire qui n'est pas moins importante
dans notre travail est 1994. Elle correspond à la date de la signature
du traité instituant la CEMAC qui vient relever les défis de
l'UDEAC et innover dans les objectifs.
6 F. Braudel, Ecrits sur l'histoire,
Paris, Edition Flammarion, 1969, p.44.
7 A. Prost, Les douze leçons sur
l'histoire, Paris, Le Seuil, 1996, p.101.
8 J. Ki-Zerbo, Histoire de l'Afrique Noire d'hier
à demain, Paris, Hatier, 1972, p.16.
9 H. Bahoken Bekona, "Les élections
parlementaires dans la région du Mbam au Cameroun : Essai d'analyse
historique de 1946 à 1992", Mémoire de master en histoire,
Université de Yaoundé I, 2010, p.11.
5
La dernière borne chronologique est 2017. Elle renvoie
à l'année de nomination de la deuxième femme au poste de
Vice-présidente à la Commission de la CEMAC, la Tchadienne Fatima
Acyl Haram, poste qu'elle occupera jusqu'en 2021. Alors que la première
femme de nationalité équatoguinéene, Rosario Kung Mbasogo
l'avait déjà occupé de 2012 à 2017. Par ailleurs,
cette date représente une sorte de bilan à mi-parcours des femmes
de cette sous-région voilà pourquoi le choix a été
porté d'étendre l'étude jusqu'à cette date.
Délimitation géographique
Le cadre géographique de l'étude est la
sous-région d'Afrique centrale politique, avec une superficie de plus de
3020144 km2. Elle est composée de six Etats membres dont le
Cameroun, le Congo Brazzaville, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la
République Centrafricaine et le Tchad. Parmi ces pays, seuls le Tchad et
la République Centrafricaine sont des pays continentaux10. Le
Cameroun est le seul pays qui dispose des frontières avec tous les
autres pays membres de la CEMAC. Il joue également le rôle
d'interface avec l'espace ouest-africain. Historiquement, le Cameroun est
considéré comme la locomotive économique et politique de
la sous-région, même si ce leadership est parfois contesté.
De manière générale, les situations se présentent
différemment dans ces pays de la CEMAC. On peut donc, en fonction de la
délimitation spatiale, ressortir le contexte politique et
socioéconomique de ces pays.
D'une façon générale, le climat politique
en zone CEMAC se caractérise par des coups d'Etats ou des tentatives,
des conflits internes et transfrontaliers, des mutineries à
répétition, des élections sources de violences et de
contestations, la situation des droits de l'homme sujette à controverse.
Certains Etats de cette Organisation sous régionale n'accordent
suffisamment d'importance à leurs relations politiques au sein de la
communauté. Ce qui explique l'absence avérée à
plusieurs rencontres organisées, des chefs d'Etats de ces pays
d'où l'expression de "diplomatie de la chaise vide"11.
De même, les économies des Etats de la CEMAC
présentent une ambigüité. D'une part, une très forte
disponibilité des ressources et d'autre part, un rythme de croissance
apathique. Cela est parfois dû à la précarité des
infrastructures mais également à une politique d'attraction
10 Les pays continentaux sont des pays qui n'ont pas
accès à la façade maritime.
11 A. Sommo Pende, "l'intégration sous
régionale en zone CEMAC à l'épreuve de la liberté
de circulation des biens et des personnes", Mémoire de master en
Gouvernance et politique publique, Université catholique d'Afrique
centrale, 2010, p.30.
6
des investissements peu efficaces. Le principe de libre
circulation des personnes et des biens, l'un des piliers de la
communauté, est loin d'être vécu dans les
faits12.
Carte 1 : Représentation
géographique des pays de la CEMAC.

Légende
Frontières nationales
Espace CEMAC
Les Cours d'eaux
Et les îles
Source : Livre Blanc de la CEEAC et de la
CEMAC, 2014, p.21.
12 Sommo Pende, "l'intégration sous
régionale en zone CEMAC ...", p.7.
7
4. Définition des concepts
L'étude des concepts est une étape cruciale dans
l'analyse profonde d'un sujet. Cette étape permet d'élucider
certains mots clés du sujet. Elle permet de lever l'amphibologie sur la
complexité et l'ambiguïté de certains mots en fonction de
l'étude, afin de rendre clair les tours et contours du travail et
éviter tout amalgame relative aux concepts. Ce qui incombe l'affirmation
de Grawitz selon laquelle "le concept est un élément
indispensable de toute recherche" 13.
De fait, une démarche scientifique doit s'appuyer sur
un cadre conceptuel solide qui constitue la fondation de l'analyse. C'est ici
le lieu d'éviter toutes confusions au sujet, de la polysémie des
termes et leurs divers champs d'application qui pourraient constituer un
obstacle pour le chercheur. Celui-ci doit absolument circonscrire sa recherche
en définissant clairement les termes clés de son étude.
Durkheim insistait ainsi sur le fait que "la première démarche du
chercheur doit donc être de définir les choses dont il traite afin
que l'on sache et qu'il sache bien de quoi il est question". Car "c'est en
raffinant les concepts que l'on améliore le caractère
opérationnel de la méthode".
Tout au long de ce travail, un certain nombre de concepts qui
peuvent susciter une incompréhension seront utilisés. Il est donc
approprié de définir le sens qui leur sied dans le cadre de cette
étude. Ainsi, quatre concepts majeurs sont recensés dans ce
thème : le rôle, la femme, diplomatie, CEMAC.
La femme
Le substantif féminin "femme" est issu du latin
classique Femina dont l'étymologie a été discutée.
Les grammairiens latins rapprochent Femina de fémur
(cuisse)14, une étymologie qui serait erronée.
Cependant, les linguistes considèrent aujourd'hui que Femina est
participe présent passif car il a d'abord signifié "femelle" puis
"femme, épouse" et a concurrencé mulier "femme" et uxor
"épouse" 15. En français, l'expression femme est
attestée dès la fin du Xe siècle.
13 M. Grawitz, Méthode des sciences
sociales, Paris, Dalloz, 2001, 11ème édition,
p.385.
14
http://.www.lexilogos.com/latin(gaffiotphp?q=femme, consulté le 11
février 2019 à 11h30min.
15 P. Flobert, "sur la validité des
catégories de voix et de diathèses en latin", in C. Moussy et S.
Mellet, La validité des catégories attachées au verbe,
Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, coll. "lingua Latina",
recherches linguistiques du Centre Alfred, n°1, 1ere ed., vol. 1, 1992,
p.74.
8
Une femme est un être qui dans l'espèce humaine
appartient au sexe féminin. La femme est le stade supérieur de la
fille, car la fille désigne la femme à ses stades infantiles et
pubères. Autrement dit, la femme serait un être humain de sexe ou
de genre féminin adulte. Avant la puberté, elle porte le nom de
petite fille16. La femme présente toutes les
caractéristiques biologiques communes à l'homme, même si
l'on relève un dimorphisme sexuel entre l'homme et la femme à
travers l'analyse des caractères dont la vitalité est liée
à la génétique et aux chromosomes humains. Le terme femme
est parfois utilisé pour désigner un individu de sexe masculin ou
inter-sexe s'identifiant comme de genre féminin17.
Par contre, dans cette étude, il s'agit de la femme au
sens biologique. La CEMAC étant une organisation internationale sous
régionale, un système qui regroupe six Etats au sein desquels se
trouve une population masculine et féminine. Cependant, l'on s'appesanti
sur les femmes fonctionnaires de la CEMAC, agents des Etats ou femmes autonomes
qui contribuent activement à la construction de la CEMAC et non à
toutes les couches féminines. Il s'agit de travailler sur les femmes qui
contribuent à l'évolution de la CEMAC comme institution
communautaire, pour l'amélioration du processus d'intégration.
Le terme rôle
Le mot rôle vient du latin rotulus qui signifie
"parchemin". Il désignait autre fois, le Rouleau de papier, de parchemin
sur lequel on écrivait des actes, des titres. En Angleterre, l'histoire
révèle que le terme renvoi aux registres de manuscrits des actes
du parlement de l'Angleterre. Dans le théâtre, le rôle
renvoi à ce que doit réciter un acteur. D'Après Octave
Mirbeau, c'est la manière dont on agit dans les affaires du monde, dans
certaines occasions, du personnage qu'on y fait, du caractère qu'on y
montre18. En sociologie, le terme rôle représente la
manière dont un individu doit se comporter et ainsi pouvoir être
intégré au sein de la société
actuelle19. Ce rôle est généralement lié
au statut social, qui fait référence à la position sociale
qu'un individu occupe au sein d'une organisation sociale donnée. Le
rôle renvoi également à la contribution. La femme fait
partir des acteurs de la CEMAC. Il est observé qu'elle occupe une place
au sein de cette institution communautaire, tant au sommet qu'à la base.
Par cette position,
16 "Femme : définition femme", sur
dico-définitions.com,
consulté le 11 février 2019 à 11h30min.
17 "Part Three : Gender indentity-sexuality and
gender", sur The New Atlantis, consulté le 11 février 2019
à 11h30min.
18 O. Mirbeau, La mort de Balzac, Paris,
Bibliothèque Charpentier - Fasquelle, 1907, pp.422-439.
19 P. Fougeyrollas, K. Roy, " Regard sur la notion
de rôles sociaux. Réflexion conceptuelle sur les rôles en
lien avec la problématique du processus de production du handicap", in
Service social, Vol. 45, n° 3, 1996, pp.31-54.
9
elle joue un rôle dans la CEMAC qui contribue à
la dynamisation de cette institution sous régionale.
Pour ce qui du terme diplomatie
Le mot diplomatie implique la communication et souvent la
négociation entre les entités politiques distinctes
(cités, empires, Etats, etc.). Ce mot est dérivé du grec
"diplôma", qui désigne le document comportant les instructions
données aux émissaires des cités sous
l'antiquité20. Selon Jean Serre, la diplomatie est
l'exécution et la concrétisation du programme qu'un gouvernement
s'est assigné dans son organisation hors de ses frontières et
d'assurer également son application quotidienne21.
D'après Dario Battistela, la diplomatie se doit comme une pratique parmi
tant d'autres de la politique étrangère. Elle est née avec
le besoin des sociétés humaines de communiquer et de traiter les
unes avec les autres22. Ce qui fait dire à Martin Belinga que
la diplomatie est souvent synonyme de la politique
extérieure23. Les relations diplomatiques renvoient aux
rapports existants entre Etats par l'intermédiaire des liens
diplomatiques souvent au niveau des ambassades, des consulats. Elles sont
nouées à la suite des négociations entre parties
intéressées par un pacte, un traité ou par consentement
mutuel. La diplomatie est la science et l'art de la représentation des
Etats et des négociations. Il s'agit parfois d'un mécanisme de
coopération dans tous les domaines entre Etats, créant des
relations amicales tout en évitant le recours à la force.
La diplomatie sert aux Etats à entretenir des relations
qui peuvent être bilatérales ou multilatérales. La
sauvegarde des intérêts nationaux, les liens politiques,
économiques, culturels ou scientifiques tout comme les efforts
collectifs de défense des droits de l'homme ou de règlement
pacifique des différends constituent certaines de ses grandes
missions24. Ces accords diplomatiques sont également
signés entre les Etats et les organisations internationales.
L'expression "diplomatie" a évolué au cours des
époques. Ayant un sens restreint d'antan, sera élargie avec
l'évolution du temps. Le premier système diplomatique connu est
celui de la Grèce antique qui effectuait par des représentants
qui obéissaient à un protocole, notamment les envoyés sans
titre permanant. C'est à la mesure de l'évolution du monde que
la
nécessité s'est imposée à l'extension
des liens diplomatiques. La diplomatie s'est
20 D. Battistela, al., Dictionnaire des Relations
internationales, Paris, 3e Edition, Edition Dalloz, 2012,
p.125.
21 Luntadila K. Mbanzulu, "La coopération
diplomatique Zaïre-Cameroun (1960-1988)", rapport de stage diplomatique,
Yaoundé, IRIC, 1989, p.5.
22 Battistela, al., Dictionnaires des
Relations..., p.125.
23 Luntadila K. Mbanzulu, "La coopération
diplomatique...", p.3.
24 ABC de la diplomatie, Département
fédéral des affaires étrangères, Berne, 2008,
p.3.
10
institutionnalisée à partir du XXe
siècle avec la création des ministères des affaires
étrangères et des ambassades25. Par ailleurs, c'est le
congrès de vienne de 1815 qui fixe pour la première fois le
régime international des législations. Ces règles sont
reconnues dans les relations diplomatiques et figurent dans les conventions de
Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et 196326.
Ce terme de diplomatie est parfois polysémique, car il
désigne à la fois la carrière diplomatique et la fonction
d'une personne à représenter son pays dans un autre ou
auprès d'une organisation internationale. Ici, c'est la
représentation des Etats par des femmes au sein de la CEMAC qui nous
préoccupe. Aussi, en fonction du nombre d'Etats qui entretiennent des
relations diplomatiques, l'on distingue deux formes de diplomatie : la
diplomatie bilatérale et la diplomatie multilatérale.
La diplomatie bilatérale met en exergue deux Etats
alors que la diplomatie multilatérale lie plus de deux Etats, et c'est
cette dernière qui concerne cette analyse. Cependant, il ne s'agit pas
de parler exclusivement de la signature des accords, la négociation, des
relations au sommet des Etats, il s'agit de ressortir le rôle même
que les femmes jouent pour l'avancement de la CEMAC, tant sur le plan
politique, économique que socioculturel que ce soit à la base
comme au sommet.
La CEMAC
La CEMAC renvoie à la communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale, créée par le
traité du 16 mars 1994 à Ndjamena et qui entre en vigueur en juin
1999. Elle regroupe six Etats dont le Cameroun, le Congo Brazzaville, le Gabon,
la Guinée Equatoriale, la RCA et le Tchad. La CEMAC prend en effet la
relève de l'UDEAC pour redynamiser le processus engagé entre les
six Etats en 1964 à travers l'UDEAC. La CEMAC couvre un espace
géographique de près de 3020144 km2 et une population
estimative de plus de 51 millions d'habitants27.
5. Cadre théorique
Le mot théorie vient du grec "Theorein" qui signifie
"contempler", "observer" ou "examiner". C'est ainsi que Raymond Aron
relève que c'est "la connaissance contemplative,
25 Battistela, al., Dictionnaires des
Relations..., p.125.
26 R. Delcorde, Les mots de la diplomatie,
Paris, L'Harmattan, 2005, p.47.
27 www.cemac.intel/Histoire, consulté le
01/02/2019 à 13h10min.
11
saisie des idées ou de l'ordre essentiel du
monde"28. La théorie apporte une grille de lecture dans le
champ d'étude du chercheur, lui permettant de mieux analyser son sujet.
Elle permet de jeter sur la réalité un regard éclairant et
ordonné29. La définition de cette notion de
théorie n'est toujours pas chose facile. Pour d'aucun, c'est "un
ensemble cohérent de généralisation permettant d'expliquer
une réalité donnée"30. Pour d'autres, la
théorie permet de mieux organiser nos visions des questions
internationales car "tous les théoriciens en relations internationales
interprètent des événements ou des sujets particuliers
comme des exemples d'une tendance d'un phénomène ou d'une
position et expression théorique plus large"31. Ce qui
résulte que la théorie est l'ensemble des outils qui permettent
d'analyser les affaires internationales. Il existe plusieurs théories
utilisables dans le cadre de la recherche en histoire, en fonction du champ de
l'étude. Dans le cadre de cette étude, l'on a fait recours aux
théories critiques des relations internationales. C'est ainsi que deux
grilles théoriques ont été mobilisées notamment la
théorie féministe et la théorie constructiviste. Ce
travail étant basé sur les femmes, notamment sur
l'égalité d'employabilité entre l'homme et la femme dans
la CEMAC, ces deux théories permettront de mieux analyser ledit
sujet.
La théorie féministe
La théorie féministe est une théorie
critique des relations internationales qui revendique l'égalité
entre les genres, voire la présence des femmes dans le monde
professionnel. Cette théorie s'amplifie dans les années 1970 avec
les multiples plateformes des conférences féministes
organisées dans le monde. Elle est l'objet de nombreuses
polémiques et divisent des penseurs. En effet, la question genre avait
divisé les Hommes en deux à savoir d'un côté la
femme et de l'autre côté l'homme. Selon les biologistes, le sexe
est une spécialisation biologique d'organismes vivants. Ici, le sexe est
perçu comme une différence purement biologique. D'après
Christine Delphy,
Dans les années quatre-vingt et maintenant encore, le
sexe est conceptualisé comme une division naturelle de
l'humanité, la division mâle/femelle, la division dans laquelle la
société met de sel. C'était déjà une
avancée considérable que de penser qu'il y'avait dans les
différences de sexe, quelque chose qui n'était
pas attribuable à la nature. 32
28 S. Saurrugger, Théories et concepts de
l'intégration européenne, Paris, Science po, 2009,
pp.18-19.
29 R. Quivy et L. Van Campenhoudt, Manuel de
recherche en sciences sociales, 4e édition, Paris,
Dunod, 2006, p.83.
30 P. Braillard, Théories des
systèmes et relations internationales, Bruxelles, Bruyant, 1977,
p.77.
31 A. Macleod, "Théorie des relations
internationales", in T. Balzac et F. Ramel (dir)., Traité de
relations internationales, Paris, Sciences Po, 2013, p.990.
32 C. Delphy, l'Ennemi principal, Paris,
Syllepse, 1998, p.25.
12
Certains auteurs dits "anti-essentialistes", réfutent,
s'inspirant notamment des travaux de Michel Foucault sur la sexualité,
l'idée du sexe comme donnée biologique et insistent sur le fait
que le sexe n'est rien d'autre qu'une naturalisation visant à
bi-polariser et à répartir les liens sociaux.
Quant aux essentialistes, ils voient en la "distinction des
sexes ", une simple différence homme/femme basée
sur les caractéristiques d'ordre naturel. L'anthropologue Irène
Théry, dans son ouvrage Dictionnaire de sexe, fait une
différence entre "différenciation de sexe" et "distinction de
sexe". Pour elle, la "différenciation de sexe" renvoie uniquement
à cette différence physionomique du sexe, sexe ici comme
donnée naturelle. Par contre, la "distinction des sexes" est une
expression qu'elle choisit pour désigner le genre ainsi entendu, " ne
peut jamais être rebattue sur la différence entre "le masculin" et
"le féminin" comme attributs substantiels des individus, qu'on les
considère comme naturels ou culturels, infus ou acquis"33.
Cette analyse précédente relève que l'on ne peut parler de
féminisme sans aborder la question de genre, car c'est la question sur
la distinction des sexes au sein de la société, négligeant
la question des femmes qui donne lieu à l'activisme féminin.
Dans son ouvrage intitulé Le Deuxième
sexe, Simone de Beauvoir affirmait déjà "on ne nait pas
femme, on le devient". Elle faisait déjà cette distinction entre
la notion de sexe qui s'apparente à une donnée biologique et la
condition future du sexe en société (homme/femme),
qualifiée de "sexe social", de genre. Cette dénaturalisation du
sexe biologique deviendra un enjeu politique. Dans l'évolution des
pensées, la "différence des sexes" est peu à peu
substituée à celle de "construction sociale des sexes", de
"genre", traduction approximative du "gender" anglais et plus tard à
celle de féminisme. En effet, le paradigme "féminisme" inspire
non seulement les pratiques revendicatrices d'ordre politique et
économique, mais contraint également à revisiter les
différents savoirs et les systèmes de représentation des
femmes. Ce concept fait son apparition avec l'avènement de la
IIIe République, or la notion d'individu citoyen implique
l'identité voire l'égalité de l'homme et de la femme.
Déjà, pendant la révolution
française, les femmes exprimaient çà et là une
volonté collective où la prise de conscience de leurs
problèmes spécifiques va de pair avec leur désir
d'appartenir, comme les hommes à la nouvelle société
politique. Des cahiers de doléances, des pétitions, des clubs
politiques et la célèbre déclaration des droits de l'homme
d'olympe de Georges sont les premiers éléments de cette pratique
militante. Cependant, c'est à partir des
33 I. Théry, La Distinction de sexe : Une
nouvelle approche de l'égalité, 2007, p.218.
13
années 1830 avec l'émergence des mouvements
utopistes, en particulier Saint-simoniens et fouriéristes que des femmes
se présentent comme constituant un groupe de sujets politiques, en
dénonçant leur "asservissement séculaire" et en
réclamant un "affranchissement" et une "émancipation" propres
à leurs donner une place égale à l'homme dans la
société. Le concept de féminisme a longtemps
été utilisé dans le vocabulaire médical pour
caractériser des hommes d'apparence féminine. Toutefois,
l'histoire a donné de préférence un sens politique
à ce mot. Le vocabulaire politique s'empare du "féminisme" pour
caractériser les femmes qui revendiquent l'égalité avec
les hommes34.
L'Afrique a longtemps été sujet des relations
internationales car celles-ci dominées par les théories
classiques telles le réalisme et le libéralisme, cela a
limité la présence de l'Afrique dans la scène
internationale et de surcroît l'implication tardive des femmes africaines
dans les relations internationales. Cependant, l'émergence des
théories critiques permet de reconsidérer l'Afrique dans la
science des relations. D'où l'implication massive des femmes africaines
de la CEMAC à des mouvements féministes. Les multiples
conférences féministes organisées vont ainsi permettre une
représentation accrue des femmes au sein des institutions
étatiques. La plateforme de Beijing est un exemple palpable qui
interpelle les Etats à une forte représentativité des
femmes dans les institutions étatiques et il en est pareil pour les
organisations internationales.
Il existe plusieurs tendances dans la théorie
féministe parmi lesquelles le féminisme de tradition marxiste et
socialiste, le féminisme radical, le féminisme de positionnement
et le féminisme libéral égalitaire. C'est cette
dernière tendance qui conjugue avec cette étude. Encore
appelée "réformiste" ou féminisme des droits égaux,
qui est en filiation directe avec l'esprit de la révolution
française de 1789. Sa philosophie le libéralisme, son incarnation
le capitalisme font de la liberté (individuelle) et de
l'égalité ses deux principaux axes de lutte.
Selon cette approche, les causes de l'oppression des femmes
sont liées au système capitaliste à l'intérieur
duquel les femmes sont discriminées dans tous les domaines de la
société. Et les lieux où s'exprime cette discrimination
sont : l'éducation, le monde du travail, les partis politiques, le
gouvernement, etc. Les moyens les plus efficaces pour enrayer ces
34Théry, La Distinction de sexe...,
p.218.
14
discriminations sont une socialisation non sexiste et des
pressions pour faire changer les lois discriminatoires35.
Cette théorie va faciliter la compréhension de
l'introduction tardive d'un grand nombre de femmes dans le milieu professionnel
(économique, politique, social), en évoquant les causes et les
effets de la disparité quantitative entre l'homme et la femme au sein de
la CEMAC, ainsi que la disparité au sein de la répartition des
postes de responsabilité dans cette institution, tout en émettant
des solutions d'un équilibre des tâches entre l'homme et la femme
au sein de la CEMAC. Cette théorie féministe explique
également notre travail dans la mesure où la CEMAC, dans les
années antérieures avait un personnel largement constitué
d'hommes.De nos jours, l'on retrouve une présence féminine au
sein de cette organisation à forte représentation, à des
postes stratégiques. Ce qui relève une évolution de la
considération de la femme dans les sociétés africaines et
précisément des Etats de la CEMAC.
La théorie constructiviste
Dans son prologue sur le constructivisme, Thierry
Braspenning36 affirme :
L'approche constructiviste repose sur la dimension
intersubjective des relations politiques en générale. Les Etats
sont des "existants" culturels ayant la capacité et la volonté
d'adopter des attitudes délibérées à l'égard
du monde et de lui donner un sens. C'est cette capacité qui permet de
donner naissance aux faits sociaux, à des faits qui dépendent de
l'accord des partenaires rationnels, d'instructions humaines pour exister.
L'identité et l'intérêt des acteurs sont socialement
construits37.
Le terme "constructivisme" qui se repend dans la
littérature théorique des relations internationales,
dénote une contestation des postulats strictement matérialistes
ou individualistes supposée permettre de mieux comprendre les
changements observés dans la politique mondiale. Fréquemment
utilisé pour désigner une nouvelle façon de faire des
sciences qui s'opposeraient au modèle "Positiviste", le constructivisme
est le signe le plus visible aujourd'hui, d'un débat sur la nature
même des procédures de construction des connaissances sur l'Homme
et la société.
Le constructivisme met en exergue la production des pratiques
sociales avec leur caractère situé dans des contextes
historiques, politiques, économiques ou géographiques et
35 R. H. Ekotto Menye Ella, "Disparité de
genre et accès des salarié(e)s) à la formation
professionnelle continue au Cameroun : une approche comparée du secteur
public et du secteur privé à Yaoundé", Mémoire de
master en sociologie, Université de Yaoundé I, 2014, p9.
36 Chercheur au Centre d'Etudes des Crises et
Conflits Internationaux (CECRI) de l'Université Catholique de Louvain et
au Centre d'Etudes Internationales (Centre Of International Studies) de
l'Université de Cambridge.
37 Klotz, C. Lynch, le constructivisme dans la
théorie des relations internationales, Critique internationale 2,
1999, pp.51-54.
15
souligne aussi la nécessité de contextualiser
historiquement les valeurs, les croyances et les modes
d'investigation.38 Selon Guy Mvelle, le constructivisme est la
théorie élaborée dans le cadre des études faites
dans les relations sociales internes et internationales à partir de
l'année 1980. Nicolas Onuf et Alexander Wendt sont
considérés comme les précurseurs du projet
constructiviste39. Les questions de genre, notamment
l'inégalité et les discriminations basées sur le genre en
Afrique ce sont construites non seulement de l'idéologie des cultures
africaines, mais bien plus, les revendications qui en font l'objet ne subissent
pour la plupart que l'influence du jeu international dans lequel l'Afrique
n'est qu'un spectateur qui subit les relations internationales.
Cette théorie est convoquée pour
déconstruire l'ordre social inégalitaire construit d'antan au
sein de la CEMAC où la femme est moins représentée. Mieux
encore, elle est utilisée pour promouvoir la reconstruction de la CEMAC
sur l'égalité du genre.
6. Intérêt de l'étude
Ce travail de recherche regorge des intérêts
multiples, notamment scientifique, politique et social.
L'intérêt scientifique
L'histoire est cette discipline des sciences humaines qui se
distingue par sa scientificité. Elle est fondée sur un processus,
une démarche rationnelle qui permet d'examiner des
phénomènes, des problèmes à résoudre et
obtenir des réponses précises à partir
d'investigations40. Si l'histoire permet de comprendre le
présent par le passé41, il y a à
côté de cela un futur opaque qu'il faut déceler les
brèches. L'histoire devient alors cette discipline qui étudie le
passé pour comprendre le présent et projeter le futur. Raison
pour laquelle l'historien sénégalais Cheikh Anta Diop
écrivait : "les intellectuels doivent étudier le passé,
non par pour s'y complaire, mais pour puiser des leçons ou s'en
écarter en connaissance de cause si cela est
nécessaire"42.
38 Ibid., pp.51-54.
39 N. Onuf, World of our making : Rules in social
theory and international relations, Colombia University of Sourth Carolina,
Press, 1989.
40P. Nda, Méthodologie de la recherche,
de la problématique à la discussion des résultats. Comment
réaliser une thèse, un mémoire d'un bout à
l'autre. Collection Pédagogie, Abidjan, Edition universitaire de
Côte-d'Ivoire/ Université de Cocody, 2006, p.15.
41 M. Bloch, Apologie pour l'histoire ou
métier d'historien, Paris, Armand Colin, 1952, pp.7-9.
42 C-A. Diop, L'unité culturelle de
l'Afrique noire, Paris, Présence africaine, 1982, p.43.
16
L'essentiel des oeuvres scientifiques qui abordent la question
de la CEMAC, s'inscrivent dans le cadre de l'intégration sous
régionale en Afrique centrale et sous l'angle de la
nécessité de la transition entre les deux institutions. Peu
d'ouvrages réalisent une évaluation de la politique de genre dans
cette institution, ce qui constitue un vide scientifique dans ce domaine. A cet
effet, l'aboutissement de notre étude sera d'une innovation pour rendre
un champ d'étude moins exploré ouvert à la
communauté scientifique.
L'intérêt politique
En plus de l'intérêt scientifique, ce travail est
doublé d'un intérêt politique. La diplomatie est une
sphère de la politique qui met en exergue la négociation, la
signature des accords, que ce soit sur le plan politique, économique et
social. La femme au sein de cette sphère porte à insistance la
place de choix que le domaine politique de chaque Etat lui accorde pour
implémenter l'aspect politique de son pays. Ceci montre que la femme est
présente dans tous les corps de métier de la
société, elle contribue au même titre que l'homme à
l'avancée politique de la sous-région. Cela répond au
débat sur la question de genre que la communauté internationale a
initié depuis plusieurs décennies déjà, pour une
société équitable dans l'employabilité et bien
évidemment à la présence des femmes dans tous les corps de
métier.
L'intérêt social
L'insertion de la femme dans la diplomatie met en exergue
l'introduction d'un construit social dans le monde professionnel. La diplomatie
relève du secteur formel d'une société. Ceci résout
également le problème de chômage au sein des Etats. En
plus, cela vient balayer en brèche les stéréotypes et
préjugés sur l'incapacité des femmes ou sur le recrutement
des femmes sur des critères autres que ceux de la compétence, des
aptitudes à exercer une fonction professionnelle dont elles ont
longtemps été victimes. De même, la sous-région
bénéficie d'une double expérience dans la formation des
apprenants : une expérience à la fois masculine et
féminine. Il est aussi important de mentionner que
l'intérêt social ressort également du fait que la femme a
bravé de nombreux échelons, ce qui lui permet de nos jours
d'être hissée au rang des hauts fonctionnaires des Etats.
Aussi, cette étude est une sorte d'appel à la
mobilisation des femmes en vue de leur prise de conscience de tous leurs atouts
de compétences professionnelles afin de s'autodéterminer dans le
monde de l'emploi et de contribuer au même titre que les hommes à
la construction de nos sociétés dans le cadre local, national et
même international.
17
7. Revue critique de la littérature
La revue critique de littérature consiste à
faire la recension des écrits, faire le bilan critique de ce qui a
été produit dans le domaine de recherche
concerné43. Ce qui fait dire à Yves Alexandre Chouala
que "toute construction scientifiques est une reformulation et une
création nouvelle à partir du déjà
là"44. La revue critique de littérature est donc une
émanation du déjà paru, dont le chercheur utilise dans le
cadre de sa recherche, mais tout en ayant un regard critique. C'est ainsi que
Jean Pierre Frangnière relève qu' "on est rarement le premier
à aborder une question plus exactement, le champ thématique que
l'on entreprend a déjà été balisé par les
études voisines ou cousines, ou bien il se réfère à
des études fondamentales sur lesquelles les bibliothèques
entières ont été écrites"45. Ce qui
revient au chercheur de relever l'équivoque entre ce qui a
déjà été fait et ce qui ne l'a pas encore
été. Encore appelée "analyse des données
accessibles", "études des écrits pertinents", "analyse des
sources" ou "histoire du problème", la recension des écrits donne
le loisir de faire l'état des connaissances sur le problème
à l'étude46. A cet effet, une plume de production en
rapport avec notre thème a été recensée. Que ce
soit sur le plan politique, économique que socioculturel.
L'ouvrage Les femmes américaines en
politique47, parle d'une avancée américaine en
matière de représentativité féminine en politique,
une possible cassure du plafond de verre. Il relève que la situation de
la femme dans la politique aux Etats-Unis a longtemps été
précaire à cause de la masculine imposante et subversive à
l'égard des femmes. Cet ouvrage énonce le fait que les
difficultés que rencontrent les femmes sont universelles. Elles ne sont
pas inhérentes à un coin du monde même si les variances
s'observent. Cependant, cet auteur est plus critique que réaliste. Par
ailleurs, depuis l'obtention du droit de vote par les femmes aux Etats-Unis en
1920 jusqu'en 2008, la représentativité des femmes dans la
politique américaine a connu des avancées notoires et qui
seraient louables par rapport à d'autres Etats dans le monde. Alors que
cette dernière fustige toujours cela et pense que ce n'est pas assez.
L'on pourrait se demander si cette critique ne serait pas l'oeuvre de sa nature
de femme. Ce qui met en cause l'objectivité dans ses écrits.
43 P. Nda, Méthodologie de la recherche...,
p.59.
44 Y. A. Chouala, "Désordre et Ordre dans
l'Afrique centrale actuelle : démocratisation, conflictualisation et
transitions géostratégiques régionales", Thèse de
doctorat troisième cycle en Relations Internationales, IRIC, 1999,
p.32.
45 J. P. Frangnière, Comment
réussir un mémoire, comment présenter une thèse,
comment rédiger un rapport,
Paris, Dunod, 1986, p.75.
46 P. Nda, Méthodologie de la recherche...,
pp.60-62.
47 C. Durieux, Les femmes américaines en
politique, Paris, Ellipses, 2008.
18
L'article "Femmes, Etat et mondialisation en
Afrique"48 ressort que l'introduction des questions relatives aux
femmes en politique a permis d'élargir l'espace familial dans lequel
sont confinés leur statut et leur pouvoir dans des conditions et des
règles socialement définies par la communauté et
juridiquement par l'État. Ce qui a donné lieu à
l'institutionnalisation politique et Administrative progressive des programmes
en direction des femmes : Protection maternelle et infantile et animation
féminine des années d'indépendance ; Femme et
développement et Genre et développement des années
1970-1990, avec les deux décennies des Nations Unies en direction des
femmes. Dans le souci de promotion des femmes en vue du développement.
D'où la représentation des femmes à plusieurs postes de
responsabilité avec le système de quota. L'auteur relève
par ailleurs que les femmes doivent également participer à la
transformation de l'Etat, pas seulement en y occupant des sièges
à travers le système de quota, mais en y contribuant au
développement de tous. Cet article permet de comprendre que les Etats
africains ont introduit la question des femmes ou du genre dans leurs
législations. Cet article donne une vision politique des questions
relatives aux femmes en Afrique. Toutefois, son étude table sur toute
l'Afrique, ce qui ne laisse pas observer cette vision politique sur la femme
dans le cadre de la CEMAC en particulier.
Le Bulletin n°006 du CPAC Info Pesticide49
présente la Réunion de Planification du Projet de Laboratoire
Inter-Etats d'Analyse des Pesticides et de Contrôle de Qualité des
Aliments en Afrique Centrale (LIEAP), tenue du 27 au 30 Mai 2009 à
l'Hôtel Sawa de Douala. Au cours de cette réunion, ont pris part
Nsa Allogho Suzanne de nationalité gabonaise, qui a été
nommée par les Experts du Bureau des Travaux du LIEAP ; Okala née
Neloumta de nationalité tchadienne. Elles ont effectué une
présentation de l'état des lieux des laboratoires des pays de la
CEMAC. Ceci montre la place que la femme occupe au sein des conférences
sous régionales de la CEMAC. Cependant, le CPAC Info Pesticide ne
ressort pas toutes les femmes présentes à cette
conférence, soit occupant des postes de responsabilité ou simple
employées au CPAC ou au LIEAP. Ce qui ne permet pas d'avoir un
inventaire réel de toutes les femmes travaillant dans ces deux
structures de la sous-région.
Le Rapport de la Réunion de lancement du Comité
régional50 relève que Marie Thérèse
Chantal Mfoula, Secrétaire général adjoint en charge du
Département de l'Intégration Physique, Economique et
Monétaire (DIPEM) a, au nom de l'Ambassadeur Ahmed Allam,
Secrétaire
48 F. Sow, "Femmes, Etat et mondialisation en
Afrique", Paris, L'Harmattan, 2005.
49 CPAC Info, Bulletin n°006, Avril-Juin
2009.
50 Rapport de la Réunion de lancement du
Comité Régional de Facilitation des Echanges en Afrique Centrale
(CRFE-AC), Pointe-Noire, République du Congo, du 30 avril au
1er mai 2018, Relevé des conclusions
19
général de la Communauté Economique des
Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) , remercié les hautes
Autorités congolaises, notamment Denis Sassou Nguesso, Président
de la République du Congo pour avoir autorisé la tenue à
Pointe-Noire des présentes assises et pour leur engament constant en
faveur de l'intégration sous régionale. Ce rapport mentionne
qu'elle a assuré aux côtés de Michel Niama, Commissaire en
charge du Marché Commun de la CEMAC, le Secrétariat des travaux
à Pointe-Noire. L'on constate à cet effet la confiance qui est
accordée à la femme au sein des institutions communautaires,
à la mesure où elle préside les travaux devant une
multitude de hautes personnalités masculines. Par ailleurs, ce rapport
ne ressort pas spécifiquement le rôle joué par toutes les
femmes présentes dans cette réunion communautaire en dehors de
Marie Thérèse Mfoula. Ce qui laisse un vide
d'éléments indispensables51 à l'action de
toutes ces femmes pour le compte de la CEMAC ce jour-là.
Les relevés des décisions d'agréments de
2015 à 2017 ressortent également la présence des femmes
dans la diplomatie de la CEMAC. En tant que Commissaire des Douanes, Expert des
Douanes, Conseil Fiscal ou personnel des douanes, 29 femmes ont
été nommées à ces postes de 2015 à 2017.
Cette archive de l'Union Economique et Monétaire, une institution de la
CEMAC relève qu'en 2015, une femme était Commissaire des Douanes,
en 2016, 16 femmes ont été nommées aux postes de
Commissaire des Douanes, Expert des Douanes, Expert-Comptable, Conseil fiscal
ou personnel des douanes alors qu'en 2017, 12 sont dénombrées
à ces postes. Ce qui laisse voir une avancée considérable
de la situation de la femme au sein de la CEMAC52. Par ailleurs, ce
document ne permet pas d'observer la présence des femmes dans d'autres
secteurs d'activité.
Dans le Mémoire intitulé "Disparité de
genre et accès des salarié(e)s) à la formation continue au
Cameroun"53, l'auteure dévoile les inégalités
de genre dans l'accès à la formation professionnelle continue au
Cameroun. Prenant pour échantillon la ville de Yaoundé elle fait
comprendre que la figure globale des inégalités d'accès
à la formation professionnelle continue se compose d'une configuration
réglementaire et d'une configuration institutionnelle dans laquelle se
trouve la sous-configuration de l'action formation. L'auteure relève que
c'est dans cette sous configuration que l'on trouve des
inégalités d'accès à la formation selon le
genre,
51 Le rôle joué par ces femmes lors de
cette rencontre.
52 Décision d'Agrément in
http://www.cemac.int/sites/default/files/ineditor/.pdf
, consulté le dimanche 03 juin 2018 à 19h20min.
53, R. H. Ekotto Menye Ella, "Disparité de
genre et accès des salarié(e)s) à la formation
professionnelle continue au Cameroun : une approche comparée du secteur
public et du secteur privé à Yaoundé", Mémoire de
master en sociologie, Université de Yaoundé I, 2014.
20
l'entreprise voire l'âge. Aussi, ajoute-t-elle, les
inégalités sont discriminatoires tantôt pour les femmes,
tantôt pour les hommes. Ce qui nécessite une évaluation
systématique des actions de formation pour améliorer les
processus. Elle propose aux entreprises publiques et privées les mesures
pour réduire les disparités de genre dans l'accès à
la formation. Ce travail permet d'observer les disparités existantes
aussi bien dans les entreprises publiques que privées, mais aussi
d'avoir un aperçu sur la question genre en milieu professionnel au
Cameroun. Alors que notre étude s'étend dans toute la CEMAC, il
est clair que ce document couvre juste une infime partie de notre travail car,
basée uniquement dans un pays et précisément dans la ville
de Yaoundé. Lorsqu'il est aussi vrai que les disparités dans les
entreprises diffèrent parfois en fonction des régions, voire des
pays.
Dans le Mémoire de master intitulé "Le
rôle des associations féminines dans la promotion de la femme de
la région de l'Adamaoua : cas du RAFVI"54, l'auteur
relève dans son travail scientifique que la femme de la région de
l'Adamaoua est reléguée au second plan notamment dans la prise
des décisions. Ce qui endigue son émancipation sur le plan
social, professionnel, économique et politique. Par ailleurs, il ressort
le fait que malgré toutes les difficultés qui compromettent toute
possibilité de promotion de la femme dans cette région du
Cameroun, il est observé l'existence de certaines opportunités de
promotion de la femme. C'est l'exemple du RAFVI, association qui a permis aux
femmes de la région de l'Adamaoua de s'émanciper et de pouvoir
répondre normalement à leurs pratiques. Cette étude est
importante dans la mesure où elle s'inscrit dans l'approche
féministe qui revendique la représentation de la femme au sein de
la société. Cela permet à cet effet de voir la place moins
régalienne que la femme occupait autrefois dans la société
de l'Adamaoua. Cependant, l'auteur se limite dans la région de
l'Adamaoua. Ce qui ne permet pas d'avoir une vue panoramique sur la place des
femmes dans toutes les régions du Cameroun et encore moins dans la
CEMAC. Aussi, il ne laisse pas voir les femmes qui s'affirment également
dans cette partie du pays par d'autres moyens.
Le Mémoire intitulé "La Conférence de
Beijing: impact sur l'intégration politique, économique et
socioprofessionnelle de la femme au Cameroun"55, relève que
les questions inhérentes à l'amélioration de la condition
de la femme furent inscrites dans l'agenda de
54 D. Attadjoudé, "Le rôle des
associations féminines dans la promotion de la femme de la région
de l'Adamaoua : le cas du (RAFVI)", Mémoire de master en sociologie,
Université de Yaoundé I, 2013.
55F. E. Njingang, "La Conférence de Beijing
: impact sur l'intégration politique, économique et
socioprofessionnelle de la femme au Cameroun", Mémoire de master en
histoire, Université de Yaoundé I.
56 F. Virgili, "Histoire des femmes et histoire des
genres aujourd'hui", in Revue d'Histoire Vingtième
siècle, n°20, Paris, 2002.
21
plusieurs Gouvernements africains depuis la première
conférence de l'ONU sur la femme à Mexico en 1975. La plateforme
d'action de Beijing de 1995 constitue par ailleurs un catalyseur dans la marche
vers l'équilibre entre les genres dans le cas du Cameroun. C'est ainsi
que les progrès encourageants et perceptibles interviennent dans le
paysage politique camerounais. Une dynamique permanente et une diversion du
rôle de la femme sont nécessaires au sein de la
société camerounaise, malgré certaines lois
discriminatoires, des fortes pesanteurs des cultures, des religions, des
traditions dont la plupart pensent que la vocation première de la femme
est d'assurer la pérennité de la société. Ce
mémoire est d'une importance capitale dans cette étude, car il
permet de ressortir les périodes dynamiques de revendications des droits
professionnels des femmes. Cependant, il contribue partiellement à cette
étude dans la mesure où, son travail est focalisé sur un
seul pays de l'organisation qui est le Cameroun et ne parle pas des autres pays
de la CEMAC.
Dans l'article intitulé "Histoire des femmes et
histoire des genres aujourd'hui"56, l'auteur présente
l'intégration des femmes et singulièrement des françaises
dans le monde professionnel comme un combat de longue-allène. Il
relève que de nombreuses recherches préliminaires sur les femmes
sont l'oeuvre d'auteurs engagés dans le mouvement féministe. Les
femmes se sont mobilisées pour sortir du "demi-universel" (universel
masculin) dont le monde s'est toujours constitué. Il poursuit son
analyse en prenant le cas du monde de la science historique qui a connu
très peu de figures et qui parfois quand elles étaient
présentes n'étaient pas connues au monde extérieur. Il
prend le cas de Simone Vidal Bloch, femme de Marc Bloch dont le travail de
préparation des notes de recherche ou de lecture des manuscrits ne fut
jamais signalé par son mari. Le cas de Suzanne Dognon Febvre, la femme
de Lucien Febvre dont la contribution aux travaux de son mari n'a pas
été exempte. Ce qui entrainera la reconnaissance tardive de la
place de la femme dans l'historiographie. Cet article permet d'observer que les
femmes ont toujours joué un rôle dans la société
partout dans le monde et qui parfois a souvent été
désavoué. Par ailleurs, situant son analyse dans le cas singulier
de la France, il ne permet pas d'observer l'évolution féministe
dans les autres pays du monde. Lorsqu'il est clair que cette étude se
fait sur la CEMAC. Il donne juste un aperçu général et
limité de l'évolution de la situation de la femme dans le
monde.
Albert Pascal Temgoua dans "Femme et intégration en
Afrique centrale" relève que le rôle de la femme a longtemps
été sous-estimée dans le processus d'intégration en
Afrique, à
22
cause de ses tâches et de ses préoccupations. Car
elle est le plus souvent concentrée dans les secteurs où
l'enregistrement n'est pas de règle, et donc presque ignoré par
les pratiques nationales57. Toutefois, en Afrique centrale comme
partout ailleurs, les ressources humaines féminines sont les plus
importantes en quantité que les ressources masculines. A cet effet, il
est nécessaire de mettre sur pied des stratégies nationales
telles que le recommande l'ONU, si on veut arriver à former un capital
humain féminin capable de remplir efficacement les rôles que la
société attend de lui. Par ailleurs, il relève que ces
stratégies doivent viser l'amélioration de l'éducation et
la formation des filles et des femmes. Ce qui permettra d'améliorer la
qualité de la vie de la communauté. Cet article est important
dans ce travail, dans la mesure où, il parle de la place de la femme
dans le processus d'intégration régionale en Afrique en
générale et en Afrique centrale en particulier. Il
présente la situation de la femme dans les questions
d'intégration, et préconise quelques mesures pour une meilleure
implication de la femme dans le processus d'intégration en Afrique
centrale. Cependant, le caractère laconique de cet article montre
l'insuffisance des sources sur la question des femmes, si non l'action de la
femme sur cette question d'intégration et de surcroît limite notre
champs d'exploration sur le rôle de la femme dans la CEMAC. D'autant plus
qu'il ne parle pas précisément du rôle de la femme dans la
CEMAC.
L'article intitulé "Statuts et rôles
féminins au Cameroun"58, relève que les femmes
africaines disposent et ont toujours disposé d'un pouvoir réel
dans leur ménage et au sein de la parentèle, malgré la
hiérarchie formelle des rôles sexués qui leur
confère une position d'infériorité. En étudiant
quelques exemples dans les ethnies du Cameroun, l'auteur relève que les
traditions pèsent encore considérablement sur le rôle de la
femme dans cette société, même si l'on note que certains
espaces de pouvoir sont détenus par les femmes. Ce qui explique que les
stratégies actuelles des femmes africaines pour valoriser leur statut
sont enracinées dans la culture et les traditions des différentes
ethnies. Toutefois, il n'est pas indéniable que le statut de la femme
dans la société en Afrique a évolué. Cet article
est important dans cette étude, dans mesure où il est
observé une nette amélioration du rôle de la femme dans la
société en Afrique et au Cameroun en particulier. Cependant, il
présente juste l'aspect social de la femme et ne ressort pas le domaine
économique et politique, ce qui ne donne pas une vue d'ensemble de la
femme dans tous les domaines de la vie.
57 A.P. Temgoua, "Femme et intégration en
Afrique centrale", in A. Daniel, J-M. Essomba, Als., Dynamiques
d'intégration régionale en Afrique centrale, Tome 2,
Yaoundé, PUY, 2001.
58 Yana, S.D., ". Statuts et
rôles féminins au Cameroun : Réalités d'hier, images
d'aujourd'hui", in Politique Africaine n° 65, 1997.
23
8. Problématique
La problématique est l'ensemble construit autour d'une
question principale, des hypothèses de recherches et des lignes
d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisis59. C'est une
composante essentielle dans le travail. Elle est l'aboutissement du double
travail antérieur notamment le choix du sujet et le
débroussaillage60. D'après Paul Nda, la
problématique est l'approche ou la perspective théorique qu'on
décide d'adopter pour traiter le problème posé par la
question de départ61. Elle est cruciale et centrale, donc
essentielle pour le sujet à étudier. C'est elle qui permettra de
construire le raisonnement qui soutiendra le plan de rédaction et devra
être partie intégrante de l'introduction générale.
Ce qui implique qu'il ne s'agit pas de plaquer de manière artificielle
et dogmatique sur le phénomène étudié, une
théorie toute faite, appuyée dans un enseignement
théorique de sociologie, d'anthropologie ou de quelque autre discipline
que ce soit62. Ce qui permet à Kurt Lewin de mentionner qu'
"il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie"63. Car
elle nous permet de jeter sur la réalité un regard
éclairant et ordonné.
Les femmes ont été confrontées à
la restriction de leur présence dans le monde professionnel.
Réduites au ménage, à la vie conjugale et d'autres aux
travaux comme champêtres, renforcé par des
stéréotypes d'antan, les femmes n'avaient qu'un seul rôle
dans la société, la vie au foyer. Cependant, avec
l'évolution des sociétés et l'instruction des filles, leur
présence se manifestent de plus en plus dans le monde professionnel.
Elles se retrouvent dans les hautes fonctions étatiques et peuvent
à cet effet jouer un rôle considérable en matière de
représentation de leurs nations au-delà de leurs
frontières, comme c'est le cas dans la CEMAC.
Au regard de tout ceci, l'on se pose une question fondamentale
qui est celle de savoir : quel est le rôle de la femme dans la dynamique
diplomatique entreprise par les Etats pour la construction de la CEMAC ?
Autour de cette problématique centrale se
décline des interrogations subsidiaires à savoir : Comment se
présente la femme en Afrique centrale avant la création de la
CEMAC ? Quelle est la place réservée à la femme au sein de
la CEMAC ? Par ailleurs, quelles sont les
59 M. Beaud, L'art de la thèse : Comment
préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse
de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du
net, Paris, La Découverte, 2006, p.55.
60 M. Beaud, L'art de la thèse...,
p.57.
61 Van Campenhoudt, Quivy, Manuel de
recherche..., p.81.
62 Ibid.
63 Ibid., p.82.
24
difficultés auxquelles elles font face dans cette
organisation internationale sous régionale ? Enfin quelle est la
portée de la présence féminine au sein de la CEMAC ?
9. Méthodologie
La méthodologie est l'ensemble des méthodes
appliquées à un domaine particulier de la science de la
recherche64. Quant à la méthode de recherche, elle est
une démarche intellectuelle qui vise à établir ou mener un
raisonnement rigoureux portant sur un objet d'étude65. C'est
aussi une démarche rationnelle de l'esprit pour arriver à la
connaissance, à la démonstration de la vérité ou
tout simplement à un ensemble de procédés et de moyens
pour arriver à un résultat66.
Il est question de préciser la procédure de
collecte des données, la démarche d'analyse et de consignation
des données et des informations susceptibles de réaliser le
document final. Dans ce travail, l'on a conjugué les approches
qualitative et quantitative, de même que les méthodes diachronique
et analytique.
Concernant l'approche qualitative, elle a suscité
l'exploitation des sources primaires et secondaires, afin d'avoir des
informations fiables.
Les sources primaires exploitées ici sont les sources
d'archives et les témoignages oraux. Les archives mises à profit
dans ce travail sont publiques et privées. Les archives publiques
exploitées proviennent du siège de la Représentation de la
CEMAC au Cameroun sis au quartier Bastos, du Centre des Nations Unies au
Cameroun et du Ministère des relations extérieures du Cameroun.
Quant aux archives privées, elles proviennent de certains fonctionnaires
de la Représentation de la CEMAC au Cameroun. Ces rapports publics et
privés ont permis de mieux étayer et approfondir cette
recherche.
Les témoignages oraux quant à eux, sont l'oeuvre
des entretiens menés auprès des personnes ressources lors des
descentes sur le terrain, muni d'un questionnaire. Certains entretiens ont
été effectués auprès du personnel du
Ministère des relations extérieures (MINREX) du Cameroun, dans la
localité de Kyé-Ossi. D'autres auprès de la
représentation de la CEMAC au Cameroun, du personnel des Ambassade du
Congo, du Gabon et du Tchad au Cameroun, également auprès des
étudiants de certaines écoles sous régionales comme
l'ISSEA, et certains ressortissants de la sous-régions
fréquentant les écoles camerounaises. Cette étape a
64 M. Pastoureau, Dictionnaire des couleurs de
notre temps, Paris, Hachette, 1991, p.119.
65 Grawitz, Méthodes des sciences...,
p.912.
66 Ibid.
25
permis d'avoir une idée sur la conception de la femme
dans les différents pays de la CEMAC, mais également d'avoir une
vue d'ensemble sur l'éventuel effectif des fonctionnaires
féminins au sein de la CEMAC.
Les sources secondaires utilisées sont centrées
notamment sur les ouvrages, les thèses, les mémoires, les
articles, les revues. Certains journaux, magazines, protocoles, constitutions,
chartes, statuts, règlements sont classés comme archives. Cette
étape a permis d'avoir un aperçu sur l'état actuel des
débats scientifiques sur la question de la femme non seulement dans le
monde, mais dans la CEMAC en particulier. Ces documents ont été
d'une importance capitale dans la mesure où ils appuient certaines
informations tirées des enquêtes sur le terrain. Pour ce faire,
plusieurs centres de documentation tels que les bibliothèques de la
Représentation de la CEMAC au Cameroun, de la Faculté des arts,
lettres et sciences humaines et du département d'Histoire de
l'Université de Yaoundé I, de l'Université de
Yaoundé II, du CREPS, de l'Université de Douala, de l'Institut
Français du Cameroun, de Louis Paul Ango Ella et du Centre des Nations
Unies au Cameroun ont permis la réalisation de ce travail.
Après la collecte, a suivi l'étape de l'analyse
des données collectées. L'on a fait montre des méthodes de
l'écriture de l'histoire67 en examinant les différents
témoignages. Aussi, la critique interne et externe des sources et des
témoignages a permis de retenir ceux qui sont dûment
établis.
Par ailleurs, l'approche quantitative fait
référence notamment aux données chiffrées, aux
tableaux statiques, aux graphiques, aux courbes. Aussi, l'on a
constitué, avec les données disponibles, les tableaux des
fonctionnaires de l'UDEAC, les tableaux statistiques sur l'effectif des
enseignants et des étudiants de l'Institut Sous Régionale de
statistiques et d'Economie appliquée, des tableaux présentant des
éventuels effectifs des femmes dans certaines Instituions
rattachées et Institutions Spécialisées de la CEMAC. Tout
ceci nous a permis d'observer les différentes femmes qui ont
occupé depuis la création de la CEMAC en 1994 jusqu'en 2017, sans
omettre quelques postes occupés à l'UDEAC68. Il a
prévalu également dans ce travail la méthode diachronique
et analytique. La méthode diachronique a permis de remonter la femme
notamment dans les trois périodes de l'histoire africaines, la
période précoloniale coloniale et postcoloniale et d'observer
l'évolution du statut de la femme sur le plan politique,
économique et socioculturel en Afrique centrale. Pour ce qui est de la
méthode analytique, elle a donné lieu
67 Prost, Les douze leçons...,
p.101.
68
http://www.issea-cemac.org/index.php.
Consulté le 25/04/2019 à 15h30 min.
26
à une suite logique d'analyse de données sur la
femme dans la CEMAC, ce qui a abouti à l'idée du rôle
capital donc joue cette dernière au sein de cette institution.
Aussi, ce travail se situe dans la logique de la
pluridisciplinarité, car plusieurs autres disciplines interviennent dans
cette recherche. C'est le cas de la sociologie, de la Science politique et
juridique, de l'Anthropologie et des Relations Internationales dont les
documents issus de ces disciplines ont été d'une grande
utilité.
10. Difficultés rencontrées
La recherche scientifique est avant tout un processus, une
démarche rationnelle qui permet d'examiner des phénomènes,
des problèmes à résoudre et obtenir des réponses
à partir d'investigations69. L'investigation du chercheur met
en exergue la recherche documentaire et des entretiens ou interview sur le
terrain, une tâche qui n'est pas toujours aisée pour ce dernier.
C'est ainsi l'on a été confronté à des
difficultés inhérentes à la recherche, malgré
lesquelles ce travail a pu être réalisé.
La première difficulté a été celle
liée à l'insuffisance d'une plume scientifique sur la question de
la femme et spécifiquement sur le rôle de la femme dans les
institutions communautaires comme la CEMAC.
Une autre difficulté rencontrée a
été celle liée à la réticence des
autorités de certaines institutions et représentation
diplomatiques des pays de la CEMAC au Cameroun. C'est le cas de l'Ambassade de
Guinée Equatoriale au Cameroun, qui s'est montrée
réticente à nous fournir les informations, alors qu'elle est la
structure la mieux placée pour nous fournir certaines informations en
matière de promotion de la femme dans ce pays.
Par ailleurs, bien que certaines structures se sont
montrées favorables à cette recherche, les informations mises
à notre disposition ont parfois été insuffisantes, si non
contraire à notre champs d'analyse. L'on ne saurait omettre les dossiers
déposés dans d'autres structures et qui n'ont jamais connu une
suite favorable comme la BEAC nationale.
Il faut aussi noter l'inaccessibilité à certains
centres de documentation, le plus souvent pour des raisons
d'aménagement. C'est le cas des Archives du MINREX qui n'ont pas pu
être
69 Nda, Méthodologie de la
recherche..., p.15.
27
consultées pour des raisons d'aménagement du
bâtiment abritant ces archives. Ce qui nous a parfois valu de faire
preuve d'opiniâtreté pour accéder à certaines
informations.
11. Plan du travail
Il s'agit ici de ressortir l'ossature de ce travail, la ligne
de conduite dont notre analyse devra suivre, afin d'éviter une
divagation à vue70. Il doit respecter la
problématique.
Ce thème de recherche est construit au tour de quatre
chapitres.
Le Chapitre I est intitulé : "Présentation de la
femme africaine en Afrique Centrale zone CEMAC". Il s'agit de ressortir la
conception de la femme et de donner l'évolution du statut de la femme
dans cette communauté71, dans le domaine politique,
économique et social de la période précoloniale à
la période coloniale. Ensuite montrer la place réservée
à la femme au sein de l'UDEAC. Et donner les circonstances de
création de la CEMAC.
Le Chapitre II intitulé : "Le rôle de la femme au
sein de l'organisation internationale sous régionale la CEMAC", fait
ressortir les différentes législations qui promeuvent la femme
dans la CEMAC, la contribution de la femme sur les plans politique,
économique et socioculturel et les différents moyens qu'elle
utilise au sein de la CEMAC pour mieux s'investir dans la
sous-région.
Au Chapitre III dont le titre est "Les limites à
l'action diplomatique de la femme au sein de cette organisation
internationale", relève les différentes difficultés
auxquelles les femmes font face à la CEMAC72, ce qui limite
leur travail dans cette Communauté.
Le chapitre IV, intitulé "Bilan de la contribution
diplomatique de la femme au sein de l'organisation internationale sous
régionale la CEMAC", montre comment la présence des femmes au
sein de la CEMAC permet qu'elles jouent un rôle considérable dans
cette institution internationale sous régionale. Aussi, quelques aspects
sont marqués pour mieux assurer leur représentation au sein de
l'institution73.
70 Van Campenhoudt, Quivy, Manuel de
recherche..., p.81.
71 G. Trepanier, "La paysanne camerounaise entre
l'émancipation et l'aliénation", in Revue camerounaise des
études africaines, 1970, pp.321-332.
72 Henry Lucien Ticky, 47 ans, Expert Principal CEMAC en
circulation, entretien réalisé à la Représentation
CEMAC au Cameroun à Yaoundé, le 15/10/2018.
73 J. L. T. Mbassi Ondigui, "Les relations culturelles entre
Etats de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de
l'Afrique Centrale", Thèse de doctorat / Ph.D en histoire,
Université de Yaoundé I, 2014, p.113.
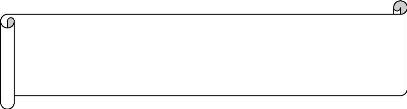
CHAPITRE I :
PRESENTATION DE LA FEMME EN AFRIQUE CENTRALE
ZONE
CEMAC
28
Le continent africain est un espace géographique
constitué de cinquante-quatre Etats regroupés en cinq
sous-régions dont la Communauté Economique et Douanière
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union du Maghreb Arabe (UMA), la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), la
Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est (EAC) et la Communauté
de Développement des Etats de l'Afrique du Sud (SADC). Au sein de chaque
grande sous-région, il existe des regroupements sous régionaux
qui constituent également des communautés économiques
régionales. C'est le cas de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) qui fait l'objet de cette
étude1.
La présentation des femmes en Afrique centrale ne nous
renvoie pas ici à la présentation des femmes en Afrique des
Grands Lacs2, mais plutôt en Afrique centrale zone CEMAC qui
regroupe six Etats dont le Cameroun, la République du Congo, le Gabon,
la Guinée Equatoriale, la RCA et le Tchad3. Aussi,
présenter les femmes ne vient pas à denier l'existence des hommes
au sein de cette Communauté sous régionale, mais plutôt de
relever une autre existence que celle des hommes, qui a toujours parue aux yeux
de tous comme la plus dominée4.
Il s'agit ici de faire un rappel historique en
présentant la situation de la femme en période
précoloniale et coloniale, de situer la femme dans L'UDEAC et de
présenter la CEMAC.
1 A. L. Aboa, al., Démocratie et
développement en Afrique : perspectives des jeunes chercheurs en
Afrique, Dynamique nationales et régionales du
développement, Tome I, Paris, L'Harmattan, 2013, pp.115-127.
2 L'Afrique des Grands lacs est l'Afrique centrale
géographique qui regroupe onze Etats qui constituent la CEEAC au sein de
laquelle se retrouve aussi la CEMAC, considérée Afrique centrale
politique qui regroupe à son tour six Etats. Cf. D. Abwa, et Als.,
Dynamique d'intégration en Afrique centrale, Actes du Colloque de
Yaoundé, Tome 1, Yaoundé, PUY, 2001, p.30.
3 Aboa, al., Démocratie et
développement en Afrique..., p.121.
4 Cynthia Obiang, 40 ans, Administrateur civil en
Guinée Equatoriale, entretien réalisé à Kyo-Ossi,
le 25/06/2017.
29
A. RAPPEL HISTORIQUE
La situation de la femme a évolué durant des
années. De la période précoloniale à la
période coloniale, le statut de la femme a connu des mutations. Ce qui
explique la présentation de la femme en zone CEMAC avant et pendant la
colonisation.
1. Situation de la femme à l'ère
précoloniale
La littérature occidentale a présenté la
femme africaine comme une esclave résolue aux plus durs travaux,
passive, résignée et objet de mépris pour les
hommes.5 Alors que d'un autre côté, certains auteurs
relèvent que la femme africaine n'était pas
opprimée6. Raison pour laquelle il est important de situer la
femme à l'ère précoloniale dans les domaines politique,
économique et socioculturel en Afrique centrale.
a. Le statut politico-juridique
En Afrique en général et en Afrique centrale en
particulier, on ne peut véritablement pas parler d'un statut politique
de la femme dans les sociétés traditionnelles. Certaines sources
révèlent que "la participation de la femme africaine à la
vie politique en Afrique précoloniale a toujours été
interprétée comme insignifiante, voire nulle. Les femmes
étaient étrangères à la partie la plus
organisée et la plus active de la société". Si cela semble
vrai de manière globale, l'on ne peut nier le fait que certaines femmes
ont souvent été impliquées dans la prise des
décisions du village7. Les réunions des "vieux" des
villages ne comprenaient uniquement que des hommes. Les femmes qui ont atteint
un certain âge y participaient également et non pas en tant que
spectatrices ou suppléantes, mais au même titre et avec les
mêmes prérogatives que les hommes. Les conseils, les
décisions des femmes "mûres" sont d'égale valeur que ceux
de leurs partenaires masculins. Aucune discrimination, aucune
ségrégation ne sont tolérées par les femmes.
S'ajoute à cela les confréries féminines autrement
appelées "sociétés secrètes féminines"
prolifiques dans les sociétés traditionnelles d'Afrique centrale,
qui ont joué un rôle non négligeable. Ces organisations
composées entièrement de femmes constituaient "des
5 G. Trepanier, "La paysanne camerounaise entre
l'émancipation et l'aliénation", in Revue camerounaise des
études africaines, 1970, pp.321-332.
6 H. Ngoa, Non, La femme africaine n'était
pas opprimée, Yaoundé, Clé, 1975.
7 E. V. Ndjah Etolo, "Dynamiques de genre et
rapport de pouvoir au sein des couples salariés à hypogamie
féminine : contribution à une sociologie de la vie conjugale en
contexte urbain camerounais", Thèse de doctorat/ Ph.D en sociologie,
Université de Yaoundé I, 2017, pp.37-40.
30
groupes de pression capables d'influer sur les affaires
publiques de la collectivité villageoise". À ce propos, Ignace
Koumba Pambolt écrit dans le cas du Gabon :
Au mois de février 1971 elles (les femmes du
N'djembè) sont intervenues aux côtés des hommes du Bwiti
(Société secrète masculine) pour s'opposer
énergiquement à la destruction de leurs cases dans la capitale
gabonaise, Libreville. Le régime de m. Albert Bernard Bongo avait
dû déchanter face à une telle opposition.8
Cela relève non seulement l'influence des
sociétés secrètes féminines, mais aussi le pouvoir
que les femmes pouvaient incarner dans la vie sociale traditionnelle. Aussi en
Afrique centrale, il y a eu des femmes de renom qui ont aussi pris part
à la vie politique. Pour la plupart, elles ont été surtout
des "cheffesses"9 ayant exercé l'autorité politique
à la tête d'un clan ou d'un lignage : Makove du clan
Mouva, Kumba-Pungueka du clan Mussanda, la vieille Kengue du
clan Bassamba, M'Buru-Akosso du clan Mandi." Mais aussi
reines à l'instar de "Ilassa de la pointe Owendo et de
l'île Koniquet, Evindo et Mbumba chez les Enenga".
Cependant, si l'homme reste le chef incontesté dans la vie politique
traditionnelle, il n'en demeure pas moins que la femme avait un rôle tout
aussi important et qu'elle n'a pas été au cours de l'histoire que
cette femme décrite comme soumise, simple victime. Par ailleurs, cette
attribution change radicalement, notamment avec l'arrivée de "l'homme
blanc"10.
Les femmes jouissaient aussi d'un certain nombre de
privilèges dans les domaines politiques et juridiques. Sur le plan
politique, elles jouaient le rôle de conseillères et de
confidentes11. Celles-ci disposaient de pouvoirs substantiels,
c'est-à-dire discrètes mais efficaces dans les questions d'ordre
social12. Elles participaient à la vie politique et pouvaient
assister à certaines assemblées. Nonobstant tout ceci, les femmes
étaient exclues des fonctions de commandement général. Les
sources traditionnelles sur l'époque précoloniale
révèlent que le rôle actif a généralement
été inhérent à l'homme. C'est lui qui prend les
décisions, il est l'auteur économique et politique. Par ailleurs,
les femmes sont reçues comme médiatrices dans le mécanisme
de la filiation mais d'une façon passive13.
8 P. I. Koumba, "L'intégration de la femme
gabonaise dans le processus de développement", Mémoire de
maîtrise de sociologie, 1979, p.114.
9 Ibid., pp.130-131.
10 O. P. Itoumba, "Les femmes et la politique au
Gabon (1956-2009) : une affaire d'État ou d'activisme féminin ?",
in Revue gabonaise d'histoire et archéologie, Editions
Lumières, N°2, 2017, pp.32-33.
11 J. Ntahohari, B. Ndayiziga, "Le rôle de la
femme burundaise dans la résolution pacifique des conflits", in UNESCO,
Les femmes et la paix en Afrique : Etudes de cas sur les pratiques
traditionnelles de résolution des conflits, Paris, Pointed in
France, 2003, p.21.
12 J. J. Chendjou, "Les bamilékés de
l'ouest-Cameroun : pouvoir économique et société
(1880-1916)", Thèse de doctorat 3e cycle en Histoire,
Université de Paris, 1986, p.83.
13 Ntahohari, Ndayiziga, "Le rôle de la femme
burundaise...", p.21.
31
Dans le cadre juridique, la femme en Afrique Centrale avait
des droits en tant que procréatrices, moyen d'échange et
productrice. Cependant, la colonisation est venue mettre un emprunt sur ces
droits. L'ordre colonial imposa des réformes coutumières ne
correspondant pas à la réalité du pouvoir en Afrique.
Il en ressort de tout ce qui précède que, dans
l'Afrique précoloniale, les construits sociaux hommes-femmes
répondaient à une hiérarchisation bien définie. Les
femmes avaient un pouvoir décisionnel moins considérable que
celui de l'homme. Elles étaient certes au centre de toutes les
compétitions de survie et de croissance, mais demeuraient en fin de
compte l'élément le plus dominé de la
société car elles étaient celles à qui il
était le plus demandé14.
b. La situation socio-économique
Avant la colonisation, la place de la femme se ressent
également dans la vie sociale et économique.
Sur le plan social, la femme en Afrique centrale assurait la
totalité des tâches domestiques en plus de ses travaux
champêtres, généralement répartis entre les femmes
et les filles de la maisonnée qui s'occupaient entre autres du
ménage, du ravitaillement en eau, du ramassage de bois, de la confection
des repas. Les femmes ou les mères étaient exclusivement
chargées des soins et de l'éducation des enfants. Ces
attributions qui renvoyaient aux rôles de mère, d'épouse et
de ménagère comme essentiels à la femme dans la
société traditionnelle, lui conféraient le statut de
gardienne des valeurs et des traditions, car responsable de la bonne marche de
son foyer15. C'est ainsi qu'une division sociale du travail
apparaît. Pendant que la femme exerçait son pouvoir de
procréation à travers son corps qui enfante et ses mains qui
travaillent la terre, l'homme affirmait son pouvoir d'organisation de la
société. En tant que source de vie, la première perception
qu'on avait de la femme était de la mère nourricière
dévouée aux siens. Malgré le respect qui lui était
ainsi accordé dans ces sociétés précoloniales, cela
n'empêchait sa subordination vis-à-vis de l'homme. La femme
était parfois moins considérée que l'homme, du fait
qu'elle dépendait, devait respect et était destinée
à son service. Considérée comme cadette sociale, elle
n'avait parfois pas droit à la parole dans une société
14 G. Balandier, Sociologie actuelle de
l'Afrique noire, dynamique sociale en Afrique centrale, Paris, PUF, 1963,
p.64.
15 Les britanniques ont qualifié le travail
du foyer de "Working mother" : travail effectué par des femmes en
attendant de trouver "l'amour" et de se retrancher dans la vie domestique
après le mariage. Ce mode de travail a connu une valorisation par la
culture américaine. Parallèlement, l'idée d'une
véritable carrière féminine se trouve dévaloriser :
le pourcentage dans les Universités diminue. La femme idéale
devient ainsi la jeune et jolie secrétaire qui travail en attendant de
se marier. Cf. A. M. F. Elanga Mbamgono, "Les politiques sociales au
bénéfice des femmes en zone CEMAC", Mémoire de master en
Relations Internationales, IRIC, 2012, p.109.
32
masculine16. Raison pour laquelle, bien qu'il
existe des sociétés matrilinéaires17 en Afrique
centrale ancienne, les femmes n'exerçaient pas véritablement
l'autorité car s'était de manière très
limitée. Par ailleurs, elles bénéficiaient d'un pouvoir
religieux qui supposait celui du chef, présidaient toutes les
sociétés secrètes des femmes et assistaient à
celles des hommes lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère
militaire18.
Les femmes dans certaines circonstances étaient les
plus nombreuses, assimilées aux esclaves et aux objets d'usage
courant"19. Présentant ses entretiens avec les femmes
béti du sud Cameroun, Jeanne Françoise Vincent relève que
lorsqu'il s'agissait d'apprécier le statut réservé aux
femmes, un mot commun revenait chez son informatrice, celui d'"esclave". Ce qui
traduit un statut d'infériorité sur le plan social qui
interdisait aux femmes de s'exprimer20. Le fort patriarcat des
sociétés traditionnelles a fait en sorte que la femme ne soit pas
suffisamment considérée. Son rôle se résume à
celui d'accompagner l'homme dans sa mission21. Raison pour laquelle,
même après vingt ans de promotion de la femme, les cultures se
battent pour promouvoir l'inégalité homme-femme qui selon elles,
est à la base de la fondation du monde. L'homme est ainsi le chef de la
famille et celui de la femme, la femme est mère et épouse. Son
destin est lié à celui de l'homme. Ainsi, une femme non
mariée est victime de marginalisation, elle n'est pas assez
respectée et n'a pas droit à la parole même dans sa propre
famille.
Par ailleurs, une femme qui n'enfantait pas était
considérée comme maudite et elle subissait le rejet social. C'est
pourquoi chez le peuple bamiléké de l'Ouest-Cameroun, de telles
femmes étaient parfois enterrées avec une pierre à la
main22, et dans d'autres cas, son corps était enterré
loin de son village23.
Dès la naissance, la fille et le garçon
n'avaient pas le même nombre d'années pour rester auprès de
leur maman. Car après avoir atteint un certain âge, il y avait une
séparation entre le garçon qui lui se voyait faire route avec son
père alors que la jeune fille restait attachée à sa
16 J-P. Tsala Tsala, La femme béti entre
tradition et modernité. Une demande en souffrance, Paris,
Université de Louis Pasteur, 1988, p.583.
17 Société matrilinéaire :
c'est un système de filiation dans lequel chacun relève du
lignage de sa mère. Cela signifie que la transmission de
l'héritage de la propriété des noms de famille passe par
le lignage féminin.
18 A. P. Temgoua, "Statut et rôle de la femme
dans la société précoloniale", in J. Fame-Ndongo, La
femme camerounaise et la promotion du patrimoine culturelle,
Yaoundé, CLE, 2002, pp.66-68.
19 B. Bilongo, La femme noire africaine en
situation, ou si la femme africaine était opprimée ?
Yaoundé, CNE, 1993, p.19.
20 J.F. Vincent, Tradition et transition.
Entretiens avec les femmes du Sud Cameroun, Paris, Berger Levrault, 1976,
p.6.
21 S. D. Yana, " Statuts et rôles
féminins au Cameroun : Réalités d'hier, images
d'aujourd'hui", in Politique Africaine N° 65, 1997, p.35.
22 Inès Fotsing, 70 ans,
ménagère, entretien réalisé à Yaoundé
le 22/09/2018.
23 Nadège Makemba, 60 ans environ, Chef de
service retraité au Ministère de la promotion de la femme et de
la famille, entretien réalisé à Yaoundé, le
25/01/2018.
33
mère. Laquelle lui enseignait les rouages des
ménages, tâche principale assimilée à la jeune
fille. C'est ainsi que sa mère était chargée de :
- développer ses aptitudes physiques à travers
notamment la recherche de l'eau, la recherche du bois de chauffage, le balayage
de la maison et de la cour, la préparation des mets.
- la formation du caractère dont les principales
qualités étaient notamment l'obéissance, la modestie, le
respect, la réserve, la honte24.
- la formation culturelle plutôt qu'intellectuelle,
puisque la méthode, les instruments et même la finalité de
l'éducation de la jeune fille relevaient du domaine de la culture dont
elle devait aider à perpétuer le contenu.
A l'analyse, l'éducation de la jeune fille ne vise pas
seulement à éveiller et à développer les
potentialités latentes dans le sens de son épanouissement ou la
meilleure intégration dans la vie. Il s'agit plutôt de la
canaliser et l'orienter dans le sens de la formation d'une âme
naturellement obéissante et soumise25. La femme ou
l'"épouse" est donc celle qui accomplit, à titre principal, les
tâches éducatives des enfants, indépendamment de leur sexe.
Son droit de regard sur ces enfants diminue par rapport au garçon au fur
et à mesure que ce dernier prend de l'âge26. La vie
conjugale est l'incontournable point de chute du destin de toute femme à
l'époque précoloniale. Une femme n'est pleinement accomplie que
si elle se marie et si elle procrée. C'est pourquoi, le rôle
conjugal de la femme est l'un de ceux qui déterminent le mieux sa
condition.
Hors de son ménage, la femme en générale
n'avait pas droit à la parole. En visite chez ses parents, comme
d'ailleurs au temps où elle était encore jeune fille, la femme
pouvait à tout moment se voir réduite au silence ou, parfois
s'entendre traitée de "fille"27 par un frère
même plus jeune qu'elle. Le système de descendance dans beaucoup
de sociétés africaines étant patrilinéaire, seuls
les hommes sont considérés comme héritiers. Cependant, ce
n'est que par la "dot", voir le "veuvage", un rituel qu'elle devait
exécuter après la mort de son mari, qu'elle pouvait
perpétuer l'héritage ou la descendance de son mari, en se mariant
avec un frère du lignage de son mari.
24 Ines Fotsing, entretien.
25 D. Attadjoude, "Le rôle des associations
féminines dans la promotion de la femme de la région de
l'Adamaoua : le cas du Réseau des Associations des Femmes de la Vina
(RAFVI)", Mémoire de master en Sociologie, Université de
Yaoundé I, Juin, 2013, pp.21-22.
26 Grégoire Djoulaye, 25 ans,
étudiant Tchadien à l'Université de Yaoundé II,
entretien réalisé à l'Université de Yaoundé
II, le 23/10/2018.
27 Attadjoude, "Le rôle des associations
féminines...", p.22.
34
Le volet économique de la femme clarifie que la
répartition sexuée des tâches faisait d'elle l'unique
responsable des travaux ménagers. A ce titre, il lui incombait de
s'occuper du petit bétail (pour des zones d'élevage), de prendre
soins des enfants, de chercher du bois, de puiser de l'eau. Ce qui ressort que
le rôle économique de la femme en Afrique précoloniale
était très limité. Le rôle économique ici
étant les activités génératrices de revenus. Les
coutumes et les normes régissant l'organisation sociale avaient
réduit les femmes à l'exercice des tâches pour lesquelles
aucun déplacement n'était requis28. En cette
période en Afrique, la plupart des femmes ne devaient pas se retrouver
loin de leurs ménages afin de s'assurer de la bonne conduite des enfants
et assurer la préparation des repas et prendre soins des enfants dont
leur éducation lui était assignée aussi comme tâche.
Une éducation qui était pour un certain temps en ce qui concerne
le jeune garçon car, il allait se retrouver du jour au-lendemain en
compagnie de son père qui de son côté allait lui inculquer
les rouages du vécu quotidien d'un homme29.
Le statut politique, économique et socioculturel de la
femme pendant la période précoloniale relève un
déséquilibre statutaire de la femme vis-à-vis de l'homme.
Elle était plus attachée aux activités domestiques
qu'économiques, son rôle était secondé à
celui de l'homme. Même si l'on ne peut dénier le rôle
important qu'elle jouait au sein de la société. Cependant,
l'avènement de la colonisation en Afrique viendra modifier certains
rapports de la femme dans la société.
2. La femme à l'époque
coloniale
La colonisation, avec tous ces chambardements qu'elle a
introduits en Afrique, a modifié d'une certaine manière le statut
de la femme dans la société, tel qu'il était à
l'époque précoloniale. C'est dans cette logique que l'on examine
la situation politique, économique et sociale de la femme à la
période coloniale.
a. Dans le domaine politico-juridique
L'implantation des puissances coloniales en Afrique centrale
au cours du XIXème siècle, a engendré un
bouleversement des structures traditionnelles mais aussi des
valeurs30. La femme en Afrique centrale qui jouissait d'un certain
rôle à l'époque précoloniale, voit celui-ci
décliné. Les principes philosophiques et politiques nouveaux
importés par les Européens mettent la femme dans une situation de
dépendance accrue vis-à-vis de l'homme. Dans cette
société
28 Attadjoude, "Le rôle des associations
féminines... ", pp.23-25.
29 Ndjah Etolo, "Dynamiques de genre et rapport de
pouvoir au sein des couples salariés...", pp.34-40.
30 N. N'nah Métégue, Histoire du
Gabon. Des origines à l'aube du XXIe siècle, Paris,
L'Harmattan, 2006, p.121.
35
coloniale "le mari était seul autorisé à
participer de plein droit à la vie politique et c'est lui qui
décidait du sort de sa femme".
Pendant la colonisation, les femmes étaient quasiment
écartées de la sphère politique. Alors que pendant la
période traditionnelle, la femme africaine détenait une certaine
place dans la gestion de la politique, dans la gestion matérielle. Des
femmes agissaient à un haut niveau d'organisation sociale et politique :
c'est le cas des reines mères et des épouses des grands
chefs31. Mais au moment où le missionnaire et le colon
arrivent, on constate une évacuation de la femme de cette sphère.
C'est l'homme qui s'occupe des grands emplois d'offices publics. Les
auxiliaires coloniaux sont essentiellement masculins. La femme est rarement
consultée. Le colon a retiré la femme dans plusieurs domaines
notamment économique et politique car même les hommes qui s'y
trouvaient déjà étaient moins considérables par
leur nombre. Aussi, la femme était mise à l'écart de la
société et sa place se retrouvait beaucoup plus dans les
ménages.
L'administration coloniale avec l'introduction du droit
écrit a juridiquement codifié la dépendance de la femme.
Pour travailler ou accomplir tout acte juridique, elle avait besoin de l'aval
de son mari. Aussi, l'accès aux centres urbains lui était plus
difficile. Le pouvoir de la femme fut donc amoindri. Elle se retrouvait ainsi
avec un double combat à savoir la patriarchie africaine et la
patriarchie européenne32. De même, elle se trouvait en
minorité. Les droits des femmes étaient très
limités pendant cette période. Sa condition devient de plus en
plus liée à celle de son mari. Ce qui pourrait laisser voir
qu'elle existe parce que son mari existe. Autrement dit, tout ce qu'elle devait
faire, elle devait avoir l'aval de son mari dont sa condition à lui
dépendait aussi du colonisateur. Le système devient donc une
chaine de dépendance de l'un à l'autre. Raison pour laquelle, la
femme ne pouvait se retrouver dans toutes les sphères de la
société car, son mari ne pouvait pas lui autoriser de faire ce
qui allait le compromettre notamment aller à l'encontre des lois
édictées par l'administration coloniale. Face à cela, le
rôle de la femme dans le cadre social et économique était
puéril.
b. Dans le domaine socio-économique
La politique coloniale portait également les traces de
discrimination envers les femmes. Cette pratique sera perpétuée
et perdurera au fil du temps, empiétant le processus d'instruction
féminine et son intégration professionnelle. Aussi,
l'enseignement dispensé aux femmes en
31 Ndjah Etolo, "Dynamiques de genre et rapport de
pouvoir au sein des couples salariés...", p.38.
32 E. Sutherland-Addy, A. Diaw, Des femmes
écrivent l'Afrique : L'Afrique de l'Ouest et du Sahel, Paris,
Karthala, 2007, pp.8-104.
36
cette période avait pour ambition d'une part d'en faire
des femmes capables de tenir un foyer, c'est ce qui ressort des femmes
éduquées dans les sexas33, d'autre part, de participer
à la vie publique pour celles-qui avaient été instruites
bien qu'en très petit nombre. Par ailleurs, certaines femmes pouvaient
être aides-soignantes, religieuses ou monitrices. Cependant, la
colonisation n'a fait que transformer la forme traditionnelle de
l'infériorité de la femme qui existait en Afrique
précoloniale en altérant le principe. Il est à noter qu'en
Afrique précoloniale, la division sexuée du travail
n'était pas d'envergure car, chaque "construit social" effectuait une
tâche en fonction de sa capacité à y assumer cette
responsabilité. Mais avec l'avènement du colonialisme, cette
division a été accentuée. Cette division du travail n'a
pas laissé l'Afrique centrale indifférente. La production
réservait aux hommes l'accomplissement de gros travaux, et aux femmes
des travaux relativement légers mais multiples et se faisait dans le
ménage ou à proximité34. L'homme est dans la
conception coloniale l'agent principal du travail indigène. Mais le gros
du travail était en réalité effectué par les
femmes. Ce qui explique le fait que dans les années 1930, très
peu de femmes se retrouvaient dans des villes. Cependant, un certain nombre y
étaient installées plus ou moins clandestinement.35
Sur le plan social, le système d'imposition a eu pour conséquence
l'introduction du salariat dont la femme était presque
exclue36.
Sur le plan économique, les privilèges que la
femme pouvait avoir tombèrent en désuète avec la
création des comptoirs et la pénétration à
l'intérieur du continent des commerçants européens.
Même s'il faut relever que le troc était le principal moyen de
commerce en "Afrique noire". L'introduction imposée de la monnaie, puis
du système d'imposition sur la place du marché, furent ensuite de
nouveaux éléments perturbateurs37. Dans l'agriculture
avant cette époque elle assurait la production dans les champs car, elle
occupait également une place très importante aussi bien que son
mari dans les travaux champêtres. Le système colonial, en refusant
le travail salarié aux femmes, les a marginalisées alors que
l'accès aux ressources monétaires constituait un moyen
d'épanouissement essentiel.
Allant des zones côtières à
l'intérieur, l'entreprise coloniale d'exploitation systématique
des richesses38 du sol et du sous-sol de l'Afrique en
générale et de l'Afrique centrale en
33 Zerabi, "Femmes au Maroc entre hier et
aujourd'hui : quels changements T", in Recherches, vol 3, n° 77,
pp.65-80.
34 Ibid., p.46.
35 Rafael Nguema, 65 ans, Enseignant gabonais
retraité, entretien réalisé à Kyo-Ossi, le
25/06/2017.
36 Idem.
37 Idem.
38 A. Boddy-Evans, What caused scramble for
Africa? Retrieved, 2012, p.25.
37
particulier nécessitait une main d'oeuvre
abondante39. C'est dans cette optique que les peuples locaux
étaient mis à contribution dans l'extraction minière, la
collecte de caoutchouc, la construction des chemins de fer et les
corvées de tout genre. Les hommes étaient donc le plus
sollicités pour l'accomplissement des corvées. Quant aux femmes,
elles s'occupaient du ramassage et du portage de pierres, ainsi que de la
collecte de l'huile de palme qu'elles acheminaient vers les centres
administratifs. Elles se chargeaient également de la cuisine dans les
chantiers40. L'homme et la femme sont voués à des
tâches différentes. Les hommes travaillaient dans les plantations
agricoles coloniales. Ce qui laisse voir dans les plantations d'exploitation
une main d'oeuvre essentiellement masculine41. Les hommes
étaient ainsi les seuls à être
rémunérés bien que certains travaillaient avec leurs
femmes42.
Les femmes étaient presque ignorées dans tout ce
qui avait trait à l'économie et à l'administration, ce qui
les mettait en marge de la société. Cela était
considéré comme "l'exclusion bénigne des
femmes"43. Cette vision de l'organisation de la
société relève de l'idéologie dominante des milieux
de l'élite européenne des XVIIIe et XIXe
siècles selon laquelle, l'homme était le pourvoyeur de fonds
utilisés dans tous les aspects alors que la femme avait la charge du
ménage. Ceci vient dont mettre en revers le rôle de la femme qui
était essentiel et primordial dans la société
traditionnelle. La femme joue ainsi un rôle de subalterne
vis-à-vis de l'homme et cela établit une relation sociale
déséquilibrée puisqu'il n'existe qu'un seul maillon dans
la chaine de production. Ceci perpétue la relation de dominant à
dominer et explique les difficultés à longue portée de la
femme à s'intégrer dans la vie professionnelle. C'est ce
dénie de représentation sociale que vient balayer la
théorie féministe qui réclame la représentation
équitable de l'homme et de la femme dans les postes de
responsabilité.
Cette théorie organisationnelle de la
société a été promue par l'administration,
l'industrie et l'église qui formaient les trois piliers de l'entreprise
coloniale. Chacune de ces instances à son niveau dans le cadre de ses
fonctions, a propagé l'idée d'un mari allant au travail pour
chercher de quoi subvenir aux besoins de sa famille, et d'une épouse
restant au foyer pour l'y entretenir.
Ces femmes peu nombreuses par rapports aux hommes constituent
l'embryon d'une "classe de petites commerçantes, qu'on pourrait
aujourd'hui intégrer au secteur "informel". Elles s'adonnaient à
la fabrication de boissons alcoolisées locales et à la revente de
la nourriture
39 R. Roberts, "Peculiarities of Africa labor and
working class history", in Labor/travail, 1982, pp.317-333.
40 Ndjah Etolo, "Dynamiques de genre et rapport de
pouvoir au sein des couples salariés...", p.43.
41 Roberts, "Peculiarities of Africa labor...",
p.320.
42 G. Mianda, Femmes africaines et pouvoir. Les
maraîchères de Kinshasa, Paris, L'Harmattan, 1996,
pp.30-25.
43 G. Mikelle, African feminism in subsaharan
Africa, Philadelphia University of Pennsylvania, 1997, p.16.
38
qu'elles ont elles-mêmes préparée. Les
investigations multiples relèvent qu'il y'avait pas de femmes
salariées jusqu'à dans les années 1950. Ce n'est qu'au
moment où les familles européennes s'étaient
installées qu'on avait eu besoin des femmes comme
ménagères pour garder les enfants. Encore que cette façon
d'employer les femmes était limitée.
Il est clair que la colonisation a perpétué les
inégalités entre l'homme et la femme. L'homme devient le seul
pourvoyeur de la société alors que la femme est résolue
à la gestion du foyer.44 C'est ainsi que cette situation va
révolutionner la femme et va l'amener à chercher comment faire
pour être représentée dans la société au
même titre que l'homme. Ce qui plus tard justifiera sa présence
dans les organisations interétatiques comme l'Union Douanière
Equatoriale de l'Afrique Centrale (UDEAC), devenue la CEMAC plus tard.
B. LA CREATION DE L'UDEAC ET LA PLACE RESERVEE AUX
FEMMES
Après leur accession à l'indépendance,
les pays africains à travers leurs dirigeants, ont manifesté le
désir de combattre le sous-développement par la création
de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), selon l'adage "l'union
fait la force". Mais, le chemin pour arriver aux résultats était
déjà mal tracé car, la création de l'OUA en 1963
était précédée par la division des leaders
africains en deux blocs : le groupe de Monrovia qui prônait une union
progressive à travers la constitution des regroupements sous
régionaux et celui de Casablanca qui était pour la
création des Etats-Unis d'Afrique. C'est ainsi que la première
tendance l'emporte d'où la création des
homogénéités spatiales comme la CEDEAO, la SADC et bien
d'autres. Ensuite, le plan d'action de Lagos de 1980 viendra jeter le
pavé dans la marre en préconisant l'intégration
régionale de l'Afrique à partir de la création des
pôles fédérateurs selon les régions. D'où la
formation des Communautés Economiques Régionales qui
prolifèrent de nos jours en suscitant les adhésions multiples des
Etats. C'est dans cette logique que l'UDEAC voit le jour en
196445.
1. Présentation de l'UDEAC
Le Président Barthélemy Boganda avait
émis, dès 1956, le projet de construction d'une
"République Centrafricaine", première étape d'une Union
d'Afrique Centrale qui soit visible sur le plan économique. Ce projet a
connu un échec. Néanmoins avant l'adoption de la loi cadre, la
France organise ses colonies d'Afrique noire en deux fédérations
: Afrique Occidentale
44 Ndjah Etolo, "Dynamiques de genre et rapport de
pouvoir au sein des couples salariés...", p.43.
45R. Kayembe Mungedi, "L'intégration
régionale en Afrique : regard critique sur la prolifération des
regroupements régionaux", in A. L. Aboa et Als, Démocratie et
développement en Afrique : perspectives des jeunes chercheurs africains,
Tome I, Paris, L'Harmattan, 2013, pp.115-132.
39
Française (AOF) et Afrique Equatoriale Française
(AEF)46. A la suite d'une volte-face, elle opte pour la
préservation des marchés tropicaux des sociétés
commerciales françaises implantées en Afrique noire. Toutefois,
la République Centrafricaine, le Congo, le Gabon et le Tchad
constituèrent dès lors une entité
géoéconomique intégrée, sous l'appellation de l'
AEF47. Suite à la signature de deux protocoles à Paris
en 1959, ces pays créent le 29 juin 1959, l'Union Douanière
Equatoriale (UDE)48, qui connait l'adhésion du Cameroun
en1962. Le 8 décembre 1964, les Chefs d'Etat de ces cinq pays signent
à Brazzaville le traité instituant l'UDEAC qui entre en vigueur
le 1er janvier 1966. Confirmant ainsi un processus de regroupement
entamé sous la période coloniale. Le 24 août 1983, l'union
connaît l'adhésion de la Guinée Equatoriale.
Les pays de l'Afrique centrale on très tôt pris
conscience de l'intérêt que représentent la
coopération économique et l'intégration régionale
en tant que facteurs susceptibles de contribuer à
l'accélération de leur croissance et de leur
développement. Ce qui justifie qu'ils vont assigner à l'UDEAC des
objectifs précis pour la bonne marche de la communauté. Ces
objectifs seront suivis et appliqués par des organes et des Institutions
spécialisées de l'UDEAC.
a. Les objectifs de l'UDEAC
Pour veiller au bon fonctionnement de l'Union, l'UDEAC
s'assigne de nombreux objectifs :
- établir une union de plus en plus étroite
entre les peuples des Etats membres en vue de raffermir leur solidarité
géographique et humaine ;
- promouvoir les marchés nationaux actuels grâce
à l'élimination des entraves du commerce intercommunautaire,
à la coordination des programmes de développement des
différents secteurs de production et à la répartition
à la l'harmonisation des projets industriels ;
- renforcer l'union de leurs économies et d'en assurer
le développement harmonieux par l'adoption des dispositions tenant
compte des intérêts de tous et de chacun, compensant de
manière adéquate par des mesures appropriées la situation
spéciale des pays de moindre développement économique ;
46 Kayembe Mungedi, "L'intégration
régionale en Afrique...", pp.115-132
47 S. Loungou, "La libre circulation des personnes
au sein de l'espace de la CEMAC : entre mythes et réalités", in
Revue belge de géographie, n° 3, Open Edition Journals,
2010, p.1.
48 A. Z. Tamekamta, Le Cameroun à l'UDEAC : Bilan
et perspectives d'une gestion administrative contestée à
l'ère du Renouveau, Paris, L'Harmattan, 2011, pp.13-14.
40
- participer à la création d'un véritable
marché commun africain et consolider l'unité
africaine49.
Ces objectifs exprimaient clairement la volonté des
Chefs d'Etat concernés d'unir leurs efforts, afin de bâtir un
espace économique optimal, susceptible d'impulser un
développement économique solidaire et de créer des
pôles de développement tout en facilitant l'intégration de
leurs économies nationales. A côté de ces objectifs
fixés, des organes et des institutions spécialisées sont
identifiés à l'UDEAC.
b. Organes et institutions spécialisées de
l'UDEAC
L'Union est structurée de la manière suivante :
- des services administratifs
- des divisions, départements et services techniques
- des organismes rattachés
- des organismes communautaires50
a- Les services administratifs
Les services administratifs comprennent :
- le Secrétariat particulier
- la Direction des services du Secrétariat
général
- la Direction administrative51
b- Les divisions Techniques
Elles comprennent :
- la Première division
- la Deuxième division
La première division comprend :
- le Département des douanes
- le Département de la fiscalité
- le Département des statistiques
- le Département de formation et de la Recherche
scientifique.
Alors que la deuxième division comprend :
- le Département de 1'hamonisation industrielle
49 Tamekamta, Le Cameroun à
l'UDEAC..., p.13.
50 J. Touscoz, J. Lormand, Coopération
scientifique et technique entre les Etats membres de l'UDEAC, Paris, Unesco,
1977, pp.96-99.
51 Ibid.
41
- le Département des transports, postes,
télécommunications et tourisme - le Département de
l'économie rurale
- le Département de la main d'oeuvre, du travail et de la
sécurité52
c- Les organismes rattachés
Les organismes rattachés sont :
- la Direction de 1'Agence comptable inter-états
- la Direction du contrôle financier
- la Direction de l'école inter-état des douanes
- le Centre régional d'études de population
- la Direction de l'Ecole supérieure de
commerce53
d- Les Organismes communautaires
Les Organismes communautaires sont.
- la Banque des Etats de l'Afrique Centrale
- la Banque de développement des Etats de l'Afrique
Centrale
- la Commission d ' Arbitrage54.
A côté de ces institutions susmentionnées, on
retrouve également les institutions ci-dessous :
- l'Institut Sous Régional d'Analyse Multisectorielle et
de Technologie Appliquée
(ISTA) ;
- l'Institut Supérieur des Statistiques et d'Economie
Appliquée (ISSEA) ;
- l'Ecole Inter-Etats des Douanes à Bangui
- la Communauté Economique du Bétail, de la Viande
et des Ressources Halieutiques
(CEBEVIRHA) ;
- la Banque de Développement des Etats de l'Afrique
Centrale (BDEAC)55.
Tous ces organes et institutions jouaient un rôle important
pour le bon fonctionnement de l'UDEAC, une homogénéité
constituée des hommes et des femmes qui voudraient voir leurs
52 B. Vinay, Coopération intra-africaine et
intégration l'expérience de l'UDEAC, Penant,1971,
pp.25-28.
53 Touscoz, Lormand, Coopération
scientifique et technique..., pp.98-99.
54 Cf. Organigramme de l'UDEAC en annexe N°
IV.
55 R. Pourtier, Atlas de l'UDEAC, Paris,
Ministère de la Coopération, 1993, pp.28-27.
42
pays réussir dans leur union. Ce qui nous amène
à nous interroger sur la place que cette union a accordée
à la femme.
2. La place réservée aux femmes à
l'UDEAC
Les pays d'Afrique centrale, après les
indépendances, ont fait le plus de progrès pour donner une
meilleure éducation à leurs populations, notamment aux femmes.
Cette initiative s'est accompagnée par la dotation des Etats des textes
permettant de régir cela et d'éliminer les considérations
d'ordre discriminatoire sur le sexe. C'est ce qui se décline dans les
différentes constitutions de ces Etats africains et
singulièrement de la CEMAC. Les Etats renoncent à toute forme de
discrimination sur le sexe, l'origine, la religion ou la classe sociale. Et
donnent à tous les citoyens les mêmes chances d'accès
à l'éducation, au travail56.
Par ailleurs, avant les indépendances, les pays de
l'Afrique centrale avaient l'idée d'une coopération
intra-africaine par l'intégration régionale liée aux
solidarités socioculturelles et des réseaux marchands
transfrontaliers. C'est dans cette trajectoire qu'après les
indépendances, naît le 08 décembre 1964 à
Brazzaville, l'Union douanière et économique de l'Afrique
centrale, dont l'objectif était de parvenir à une
intégration de la sous-région57.
C'est ainsi que l'homme comme la femme étaient
appelés à contribuer à l'évolution de cette
communauté douanière. Cependant, aucun texte pour promouvoir la
femme n'avait été adopté par l'UDEAC. Alors que le
rôle de la femme dans le processus de décolonisation n'avait pas
été moindre. Elles se sont montrées capables de
défendre leurs territoires contre le colonialisme
européen58. Or cette étape passée, il
était observé un vide juridique en matière de promotion de
la femme dans l'UDEAC.
L'Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale s'est
dotée de nombreux organes et institutions qui permettaient son bon
fonctionnement. Toutefois, la femme a occupé une place moins
considérable que celle de l'homme. Car la plupart des postes
étaient occupés par les hommes, (cf. tableau 1).
56 Groupe de la BAD, Autonomiser les femmes :
plan d'action, Indice de l'égalité du genre en Afrique 2015,
Abidjan, 2015, p.20.
57 Tamekamta, Le Cameroun à
l'UDEAC..., p.13.
58 M-I. Ngapeth Biyong, Cameroun : Combats pour
l'Indépendance, Paris, L'Harmattan, 2010, pp.250-260.
43
Tableau 1 : Les responsables de l'UDEAC en
1977.
|
Vincent Efon
|
Secrétaire général
|
|
Nyama
|
Secrétaire général adjoint
|
|
Comas
|
Directeur de la division fiscalité et douanes
|
|
Tanwo
|
Directeur des services du secrétaire
général
|
|
N'Kiet
|
Chef du département de 1 harmonisation industrielle (2e.
Division)
|
|
Nguema Nze
|
Chef du département de 1 économie rurale
(2ème division)
|
|
Nguema Allogo
|
Chef du département transports , postes et
télécommunications (2ème division)
|
|
Bayonne
|
Chef du protocole
|
|
Planes
|
Conseiller du secrétaire général
|
|
Joseph
|
Directeur du Centre régional d t études
de population
|
|
Plumelle
|
Conseiller du chef du département de 1 t
économie rurale
|
|
Conings
|
Conseiller au CREP (PNU)
|
Source : J. Touscoz, J. Lormand,
Coopération scientifique et technique entre les Etats membres de
l'UDEAC, Paris, Unesco, 1977, p.82.
Ce tableau est la liste non exhaustive des responsables de
l'UDEAC en 1977. Dans ce tableau, aucune femme ne figure. Est-ce le manque de
femmes compétentes ou c'est le fait que la structure n'a pas très
tôt pris en compte la femme ?
Par contre, de nombreuses femmes ont joué un rôle
important pour la décolonisation des territoires en Afrique centrale. De
plus, leur rôle s'est avéré après l'accession de ces
territoires à l'indépendance. C'est le cas de : Rose-Francine
Rogombé de nationalité gabonaise, elle avait âprement
milité pour l'indépendance de son territoire, plus tard a
été promue magistrate dans son pays59. Elisabeth
Damtien quant à elle fut dans les années 1960 Premier ministre du
gouvernement en RCA, première femme à occuper cette fonction dans
ce pays.60 Il va de soi avec Anastasie Nze Ada qui a fait montre de
son dynamisme dans la lutte pour la promotion des femmes en Guinée
Equatoriale, de surcroît la promotion de l'égalité genre
dans ce pays61. Au Cameroun, Marie-Irène Ngapeth Biyong a
lutté contre le colonialisme, elle était également
59 O. P. Itoumba, "Les femmes et la politique au Gabon
(1956-2009)", n °2, 2017, pp.35-40.
60 Rondo Lemercier, 24 ans, Etudiant centrafricain
à l'ISSEA en 4eme année IAS, entretien
réalisé à l'ISSEA, le 14/02/2018.
61M. D. Malu-Malu, "Guinée Equatoriale : le
projet de "femme idéale", pour l'égalité des droits entre
les deux sexes", 31 mai 2017, in
www.jeuneafrique.com/mag/440431/societe/guinee-equatoriale-projet-femme-ideale-legalite-droits-entre-deux-sexes/,
consulté le 24/04/2019 à 15h30min.
62E. Le-Yotho Ngartebaye, " La participation de la
femme à la vie politique au Tchad : 1933-2003", Mémoire de
maîtrise en sciences sociales, option sciences juridiques et politiques,
UCAC, 2003, p.15.
44
choisie par ses camarades de parti pour défendre le
dossier de la Réunification du Cameroun devant la quatrième
Commission de Tutelle en 1961. Au Tchad, Yeyou Lisette fut nommée par
François Tombalbaye présidente de l'Organisation des femmes de
Union Nationale pour l'Indépendance et la Révolution
(l'UNIR)62.
Si après l'accession à l'indépendance des
Etats de l'Afrique centrale, il existait des femmes capables de participer aux
affaires administratives, il pourrait donc être clair que la femme
n'avait pas vite été prise en compte par l'administration de
l'UDEAC.
Malgré cette preuve du dynamisme féminin dans
les différents territoires, les différents postes
stratégiques de l'UDEAC n'ont point connu la présence des femmes,
(cf. photo1).
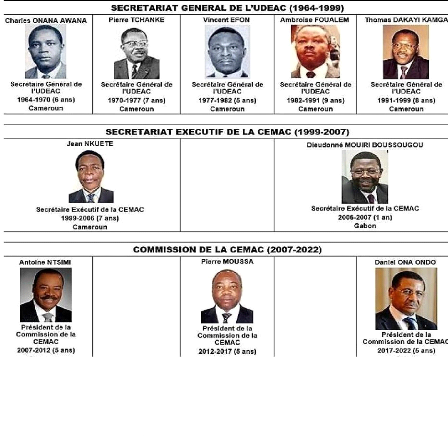
Source :
www.izf.net/upload/institutions/integration/african/cemac,
consulté le 12/05/2019 à 12h30min.
Photo 1 : Les premiers dirigeants, du
Secretariat de l'UDEAC jusqu'à la Commission de la CEMAC
45
Comme le démontre ce répertoire des anciens
dirigeants du Secrétariat de l'UDEAC à la Commission de la CEMAC,
la femme n'a pas été aux commandes de l'UDEAC. Cependant, il n'en
demeure pas moins que certaines femmes ont joué un rôle important
en occupant d'autres postes dans cette union douanière.
3. Quelques femmes et les postes occupés au sein
de l'UDEAC
Signé le 8 décembre 1964, le traité
instituant l'UDEAC entre en vigueur le 1er janvier 1966. Ce n'est
qu'en 1994 que l'UDEAC prend fin avec l'établissement de la
CEMAC63. De 1966 à 1994, de femmes et des hommes ont
travaillé en synergie au sein de l'UDEAC afin de promouvoir
l'idéal de la limitation des barrières douanières
recherché par les différents Etats membres. Même s'il faut
noter que les postes occupés par les femmes n'étaient pas des
postes clés, néanmoins, ils étaient déterminants
pour faire parler de l'expertise féminine dans l'UDEAC, (cf. tableau
2).
Tableau 2 : Le personnel féminin de la
comptabilité agréé par le Secrétariat de l'UDEAC
entre 1977 et 1988.
|
Noms et Prénoms
|
Grade
|
Pays
|
Année
|
|
A. Lapague-Boudet
|
Comptable
|
R. Congo
|
1977
|
|
Ambella Foumena
|
Comptable
|
Cameroun
|
1988
|
|
Elie Maya
|
Comptable
|
Cameroun
|
1988
|
|
Fokoua née Gertrude
|
Comptable
|
Cameroun
|
1988
|
|
Fomen née Ngo Débora
|
Comptable
|
Cameroun
|
1988
|
|
Foumena née Biabi Georgette
|
Expert-comptable
|
Cameroun
|
1988
|
|
Jacqueline Mono Ossou
|
Expert-Comptable
|
Gabon
|
1980 et 1988
|
|
Marguerite Dogmo
|
Comptable
|
Cameroun
|
1988
|
|
Marie-Thérèse Gandou
|
Comptable
|
R. Congo
|
1988
|
|
Michelle Radier-Collin
|
Comptable
|
Centrafrique
|
1978
|
|
Sarah Zinga
|
Comptable
|
Cameroun
|
1988
|
|
Yvonne Tchakounte
|
Comptable
|
Cameroun
|
1988
|
Source : Tableau des professionnels
libéraux agréés de la comptabilité par le
Comité de Direction de l'UDEAC, 31 juillet 1998, pp.5-17.
63 Loungou, "La libre circulation des personnes...",
p.1.
46
Dans la catégorisation des fonctionnaires depuis
l'UDEAC jusqu'à la CEMAC, les fonctionnaires sont classés sous
deux catégories à savoir : les fonctionnaires du régime
international et les fonctionnaires du régime local64. Dans
chaque catégorie, il existe des profils spécifiques. C'est ainsi
que les profils de comptable et d'expert-comptable font partie de la
catégorie des fonctionnaires du régime international, classe
exceptionnelle65. Comme le montre ainsi le tableau ci-dessus, les
femmes ont occupé de nombreux postes importants dans la catégorie
des fonctionnaires du régime international au sein de l'UDEAC. En effet,
avec des difficultés rencontrées au sein de la
Représentation de la CEMAC au Cameroun, le manque de sources sur
l'UDEAC, il a été difficile pour nous de ressortir toutes les
femmes ayant travaillé à l'UDEAC de 1964 à 1994.
Même si les femmes étaient très minoritaires par rapport
aux hommes66. Toutefois, cette présence féminine sera
accrue avec la création de la CEMAC. Etant donné que l'UDEAC
manifestait des limites, car elle était limitée à l'union
douanière67, la nécessité de dynamiser
l'organisation va s'imposer. L'avènement de la CEMAC constitue donc le
moment idoine pour prendre en compte toutes les autres pans de
coopération dans la sous-région.
C. L'AVENEMENT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE SOUS
REGIONALE LA CEMAC
Après une longue période de maturation, un
traité instituant la CEMAC est signé entre les Etats membres le
16 mars 1994 à Ndjamena. La CEMAC prend définitivement son envol
le 05 février 1998 lorsqu'à la fin de leur
33ème sommet, les Chefs d'Etat proclament la fin de l'UDEAC
et la naissance de la CEMAC. C'est ainsi que le traité
précédemment signé instituant la CEMAC entre en vigueur le
25 juin 1999 à Malabo. Cette réalisation répond à
l'attente des Etats et des peuples, préoccupés par les
insuffisances de la stratégie et des méthodes appliquées
jusqu'alors, et désireux de voir s'opérer un grand bon
qualificatif dans une coopération économique et monétaire
authentique, en vue d'un développement harmonieux et solidaire des pays
membres, dans un espace économique intégré. Cette
homogénéité géographique composée de six
Etats dont le Cameroun, la Guinée Equatoriale, la République du
Congo, la République
64 Règlement No
03/09-UEAC-007-CM-20 portant statut des fonctionnaires de la Communauté
Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale, 11
décembre 2009, p.1., Cf. annexe 8.
65
www.eied-cemac.org/-notes/statut_fonctionnaire8%20eied.html,
consulté le 13/04/2019 à 8h25min.
66 Lucien Henry Ticky, 47 ans, Expert Principal CEMAC
en circulation, entretien réalisé à la
Représentation de la CEMAC au Cameroun à Yaoundé, le
15/10/2018.
67 Tamekamta, Le Cameroun à
l'UDEAC..., p.19.
47
Centrafricaine et le Tchad prend en effet la relève de
l'UDEAC pour approfondir et dynamiser le processus engagé entre ces six
Etats.
La CEMAC couvre un espace géographique de près
de 3020144 km2 pour une population de plus de 51 millions
d'habitants aujourd'hui68. Elle est constituée des Organes
principaux et des Institutions Spécialisées qui jouent dans
chaque catégorie, un rôle important notamment pour l'avancement de
la communauté et pour le bien-être des
populations69.
Carte 2 : Représentation
géographique de la CEMAC et limites frontalières des Etats
membres
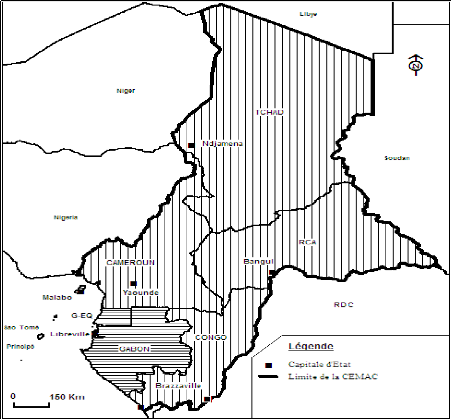
Source : S. Loungou, "La libre circulation
des personnes au sein de l'espace de la C.E.M.A.C : entre mythes et
réalités", in Revue belge de géographie, No 3,
Open Edition Journals, 2010, p.9.
68www.cemac.intel/Histoire, consulté le 1
février 2019 à 6h30min.
69Cf. Traité instituant la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, in CEMAC, Textes
organiques, Première Edition, Saagraph, Mai 1998, en annexe 1.
48
1. Objectifs, missions et principes de la
CEMAC
A l'issu de la mise sur pied de la CEMAC, ces Etats ce sont
fixés de nombreux objectifs pour atteindre l'intégration
escomptée de la sous-région, auxquels ils ont associé de
nombreuses missions et des principes.
a. Les Objectifs
En remplaçant l'UDEAC, la CEMAC s'est fixée des
objectifs. Ces objectifs sont plus étoffés par rapport à
la période de l'UDEAC, afin d'établir en commun les conditions
d'un développement harmonieux dans le cadre d'un marché ouvert et
dans un environnement juridique approprié.
Bien que l'objectif primordial soit de promouvoir le
développement des Etats dans le cadre de l'UEAC et l'UMAC70,
elle a aussi pour objectifs selon les articles 2, 4 et 5 :
Article 2 - Aux fins énoncées
à l'article premier et dans les conditions prévues par la
Convention, l'Union Economique entend réaliser les objectifs suivants
:
a) Renforcer la compétitivité des
activités économiques et financières en harmonisant les
règles qui régissent leur fonctionnement ;
b) Assurer la convergence vers des performances soutenables
par la coordination des politiques économiques et la mise en
cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique
monétaire commune ;
c) Créer un marché commun fondé sur la
libre circulation des biens, des services et des personnes ;
d) Instituer une coordination des politiques sectorielles
nationales, mettre en oeuvre des actions communes et adopter des politiques
communes, notamment dans les domaines suivants : l'agriculture,
l'élevage, la pêche, l'industrie, le commerce, le tourisme, les
transports, les télécommunications, l'énergie,
l'environnement, la recherche, l'enseignement et la formation
professionnelle.
Article 4 - Au cours de la première
étape, d'une durée de cinq ans à compter de
l'entrée en vigueur de la présente Convention et dans les
conditions prévues par celle-ci, l'Union Economique :
70 CEMAC, Textes organiques, Yaoundé,
Ed. Première Edition, Saagraph, Mai 1998, pp.14-20.
49
a) Harmonise, dans la mesure nécessaire au
fonctionnement du marché commun, les règles qui régissent
les activités économiques et financières et élabore
à cet effet des règlementations communes ;
b) Engage un processus de coordination des politiques
nationales, dans les secteurs suivants : l'agriculture, l'élevage, la
pêche, l'industrie, le commerce, le tourisme, les transports et les
télécommunications ;
c) Initie le processus de mise en place des instruments de
libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes,
notamment par une harmonisation de la fiscalité des activités
productives et de la fiscalité de l'épargne ;
d) Développe la coordination des politiques
commerciales et des relations économiques avec les autres régions
;
e) Prépare des actions communes dans les domaines de
l'enseignement, de la formation professionnelle et de la recherche.
Article 5 - Au cours de la deuxième
étape, d'une durée de cinq ans à compter de la fin de la
première étape, et dans les conditions prévues par la
présente Convention, l'Union Economique :
a) Etablit, entre ses Etats membres, la libre circulation des
biens, des services, des capitaux et des personnes ;
b) Met en oeuvre des actions communes dans les domaines
cités à l'article 4 alinéas b de la présente
Convention.
c) Engage un processus de coordination des politiques
sectorielles nationales en matière d'environnement et d'énergie
;
d) Renforce et améliore, en vue de leur
interconnexion, les infrastructures de transport et de
télécommunications des Etats membres71.
b. Les principes
Les principes de la CEMAC ont été
institués selon les articles 8, 9 et 10 suivant, de l'Additif au
traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique
de la communauté.
Article 8 - L'Union économique agit
dans la limite des objectifs que le Traité de la CEMAC et la
présente Convention lui assignent. Elle respecte l'identité
nationale de ses Etats membres.
71Traité instituant la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, pp.32-34.
50
Les organes de l'Union Economique et les Institutions
Spécialisées de celle-ci édictent, dans l'exercice des
pouvoir normatifs que la présente Convention leur attribue, des
prescriptions minimales et de réglementations cadres, qu'il appartient
aux Etats membres de compléter en tant que de besoin,
conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
Article 9 - Les actes juridiques pris par les
organes de l'Union Economique et les Institutions Spécialisées de
celle-ci pour la réalisation des objectifs de la présente
Convention, conformément aux règles et procédures
instituées par cette même Convention, sont appliqués dans
chaque Etat membre.
Article 10 - Les Etats membres apportent leur
concours à la réalisation des objectifs de l'Union Economique en
adoptant toutes mesures internes propres à assurer l'exécution
des obligations découlant de la présente Convention. Ils
s'abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à
l'application de la présente Convention et des actes juridiques pris
pour sa mise en oeuvre72.
c. Les missions
A côté des objectifs et des multiples principes
institués par la CEMAC, elle s'est dotée de nombreuses missions
dont l'une est régie dans l'Art. 1 du traité instituant la
CEMAC.
Article 1er - La mission essentielle de la
Communauté est de promouvoir un développement harmonieux des
Etats membres dans le cadre de l'institution de deux Unions : une Union
Economique et une Union Monétaire. Dans chacun de ces deux domaines, les
Etats membres entendent passer d'une situation de coopération, qui
existe déjà entre eux, à une situation, susceptible de
parachever le processus d'intégration économique et
monétaire73.
A côté de celle-ci, elle s'est assignée
plusieurs autres missions en vue de la réalisation d'un idéal
commun. Ces missions sont pléthoriques, parmi lesquelles :
- développer un espace intégré et d'y
promouvoir un développement harmonieux ; - harmoniser les
réglementations en vigueur au sein des Etats membres afin de
dynamiser les échanges commerciaux et faciliter la
convergence des politiques
économiques au sein de la sous-région ;
- la recherche de la convergence des politiques
macroéconomiques des Etats membres ;
72 CEMAC, Textes organiques..., p.35.
73 Cf. Traité instituant la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale en
annexe N° III.
51
- la Stabilité de la monnaie commune par une gestion
rigoureuse et cohérente des économies des Etats membres ;
- la sécurisation et l'amélioration de
l'environnement des activités économiques et des investissements
dans l'ensemble de la Communauté, par un cadre réglementaire
adapté et des procédures crédibles de règlement des
différends ;
- la promotion de la libre circulation des biens et des
services, des capitaux pour une meilleure affectation des ressources ;
- l'élargissement progressif de la liberté de
circulation, de résidence et d'établissement des populations,
gage de l'adhésion à un grand dessein
communautaire74.
L'évolution de la CEMAC est inhérente à
ses objectifs, principes et missions fixés. Toutefois, les femmes ne
sont pas exemptes de cela, raison pour laquelle, l'amélioration de leurs
conditions sociales se confirme par les diverses législations
adoptées à leur faveur.
2. Les organes et les institutions
spécialisées de la CEMAC
Pour l'avancement de la communauté, la CEMAC a des
Organes principaux et des Institutions Spécialisées qui jouent
dans chaque catégorie, un rôle important.75.
a. Les organes
Art.10.- La Communauté est
constituée de cinq Institutions rattachées :
l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;
l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) ;
le Parlement Communautaire ;
la Cour de Justice ;
la Cour des Comptes.
les Organes de la Communauté sont :
la Conférence des Chefs d'Etat ;
le Conseil des Ministres ;
le Comité Ministériel ;
la Commission de la CEMAC ;
la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) ;
la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale
(BDEAC) ;
74 Cf. Traité instituant la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale en
annexe N° III.
75 Ibid.
52
la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
(COBAC)76.
Ces organes et Institutions permettent le bon fonctionnement
de la Communauté. A côté de ceux-ci, l'on retrouve aussi
des Institutions Spécialisées.
b. Les Institutions
Spécialisées
Elles répondent en principe aux demandes des
populations de la sous-région en conformité avec les
règles de fonctionnement établies par la communauté en
matière d'Institution Spécialisée. Elles sont
pléthoriques et jouent chacune un rôle capital pour le bon
fonctionnement de la CEMAC. Elles sont :
- l'Ecole d'Hôtellerie et de Tourisme ;
- l'Ecole Inter-Etats des Douanes ;
- l'Institut d'Economie et de Statistiques Appliquées ;
- l'Institut Sous Régional Multisectoriel de Technologie
Appliquée, de Planification
et d'Evaluation de Projets ;
- l'Institut de l'Economie et des Finances-Pôle
Régional ;
- le Groupe d'Action contre le Blanchissement d'Argent en Afrique
Centrale ;
- l'Agence pour la Supervision de la Sécurité
Aérienne en Afrique Centrale ;
- le Pôle Régional de recherches Appliquées
au développement des systèmes
agricoles d'Afrique Centrale ;
- le Comité des Pesticides d'Afrique Centrale ;
- la Commission Internationale des Bassin du Congo-Oubangui
-Sangha ;
- l'Organisation de Coordination de lutte Contre les
Endémies en Afrique Centrale ;
- le Comité des Chefs de Police d'Afrique
Centrale-Interpol ;
- la Commission Economique du Bétail, de la Viande et des
Ressources Halieutiques ;
- la Carte Rose CEMAC.
La CEMAC dès sa création a mis sur pied des organes
et des institutions pour favoriser
la bonne locomotion de l'organisation et pourvoir répondre
aux attentes de ses populations. De
surcroît, elle s'est fixée des objectifs auxquels
elle ajouté des missions et principes77.
L'homme et la femme ont connu une vie harmonieuse pendant la
période précoloniale en Afrique centrale. La
société était structurée et les tâches
étaient assignée à chaque personne
76 CEMAC, Traité révisé de
la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC)du 16 mars 1994, révisé le 25 juin 2008, p13.
77 Cf. Traité instituant la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale en
annexe N° III.
53
en fonction de sa capacité à y assumer. La
division sexuée du travail était moins observable dans la
société78. Car la femme participait aussi bien
à des activités politiques qu'économiques au même
titre que l'homme même si le pouvoir décisionnel revenait à
l'homme. Cependant, avec l'arrivée des européens en Afrique, la
situation a tournée en défaveur des femmes. Les femmes sont pour
la plupart dévouées aux tâches
ménagères79. Les activités
génératrices de revenus sont l'apanage des hommes. Face à
cette situation, les femmes vont prendre conscience et vont se
démarquées dans la société en luttant contre le
colonialisme européen. Plus encore, après les
indépendances, elles vont se mobiliser pour réclamer leur
présence dans des postes de responsabilité dans les
différents Etats membres. Ce qui plus tard leur permettra d'être
représenté dans des organisations internationales sous
régionales comme l'UDEAC80. Même si leur nombre ne sera
pas pléthorique, elles vont néanmoins jouer un rôle dans
l'avancement de l'idéal de l'union douanière qui devient en 1994
la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique
Centrale, lorsqu'il est observé qu'elles sont plus importantes en
quantité81 . Dès lors, leur présence au sein
des cette nouvelle organisation sera observée par leur effectif dans de
nombreux postes de responsabilité et leur travail82.
78 Ndjah Etolo, "Dynamiques de genre et rapport de
pouvoir au sein des couples salariés...", pp.37-40.
79 N'nah Métégue, Histoire du
Gabon..., p.121.
80 Lucien Henry Ticky, entretien.
81 A. P. Temgoua, " Femme et intégration en
Afrique centrale", in Dynamiques d'intégration régionales en
Afrique centrale, Tome 2, Yaoundé, Presses Universitaires de
Yaoundé, 2001, pp.609-616.
82 Lucien Henry Ticky, entretien.
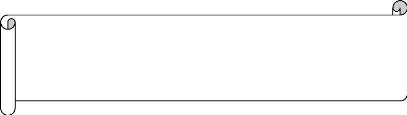
LE ROLE DE LA FEMME AU SEIN DE L'ORGANISATION
INTERNATIONALE SOUS REGIONALE LA CEMAC
CHAPITRE II :
54
L'avènement de la CEMAC a donné
l'opportunité aux femmes d'occuper de nombreux postes et jouer de
surcroît un rôle important pour l'avancement de la
communauté. Toutefois, cela est la résultante de la promotion de
la femme par les législations nationales, internationales et
communautaires. C'est ce que s'attèle à montrer ce chapitre
divisé en trois sous parties.
A. LES LEGISLATIONS EN FAVEUR DES FEMMES DANS LA CEMAC
Les Etats, les organisations internationales et
régionales ont été invités au cours des
dernières décennies à institutionnaliser les
échanges, à créer des inter-organisations d'informations
et de coopération dans le domaine de la promotion des femmes. A cet
effet, plusieurs législations ont été
élaborées pour promouvoir la femme, que ce soit dans le cadre
national, sous régional, régional ou international. Ces textes de
divers ordres contribuent considérablement à promouvoir la femme
dans tous les domaines de la vie. Mais le but premier est de promouvoir
l'être humain en général et d'accroître la
considération de la femme en particulier dans la société
pour une égalité entre l'homme et la femme dans tous les secteurs
d'activité1.
Pour une bonne appréhension de l'impact de ces
législations sur la considération de la femme, vu
également le caractère pléthorique de ces textes, il
convient de les étudier sur trois cadres notamment international,
national et sous régional2.
1. Les législations internationales
ratifiées par les Etats de la CEMAC
D'après l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), le souci de promouvoir la femme
dans le monde a été l'une des préoccupations de l'ONU
dès sa création3. Raison pour laquelle cette
organisation a créé dès 1946, une Commission de la
Condition de la Femme dont le but est de promouvoir et de valoriser la femme
dans le monde. Cette initiative de la Communauté Internationale trouve
l'une de ses
1 A. Moneyang Yana, "La promotion et la protection des droits
sociaux de la femme en Afrique centrale : cas du Cameroun", Rapport de Stage,
IRIC, 2015-2016, p23.
2 Jean Leonard Thierry Mbassi Ondigui, 47 ans,
Historien, entretien réalisé au département d'Histoire, le
20/03/2019.
3 CINU, Manuel de vulgarisation de l'approche
genre, Yaoundé, p.15.
55
justifications dans le rôle socioéconomique
joué par cette couche sociale précisément pendant la
Deuxième Guerre mondiale4.
Il s'agit ici de l'ensemble des législations
internationales et des plateformes ratifiées par la CEMAC ou les Etats
de la CEMAC. Sont étudiés ici : la Convention sur l'Elimination
de toutes les formes de Discrimination à l'Egard des Femmes (CEDEF)
adoptée en 1979, le Pacte International Relatif aux Droits Economiques,
Sociaux et Culturels (PIDESC), la Charte africaine des droits de l'hommes et
des peuples, la conférence de Maputo et la Conférence
féministe de Beijing de 1995.
Parlant tout d'abord de la CEDEF, elle a été
adoptée à New-York le 18 décembre 1979 et est
entrée en vigueur en 1981 après la signature par vingt pays.
Cette convention a établi les droits des femmes dans tous les secteurs
d'activité. Elle accorde une grande priorité aux droits des
femmes rurales, considérées comme les plus victimes de
discriminations même en dépit des textes relatifs. En son article
11, cette convention souligne l'élimination des discriminations à
l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer 1°)
Le droit du travail en tant que droit inaliénable de tous les droits
humains ; 2°) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi y
compris l'application des mêmes critères de sélection en
matière d'emploi. Cette convention a été adoptée et
ratifiée respectivement par les pays de la CEMAC comme l'indique le
tableau suivant5.
Tableau 3 : Ratification de la CEDEF par les
pays de la CEMAC.
|
Pays
|
Cameroun
|
Gabon
|
Guinée Equatoriale
|
R.C.A
|
République du Congo
|
Tchad
|
|
Année de ratification de la convention
|
23 Août
1994
|
21
Janvier
1983
|
23 Octobre 1984
|
21 Juillet
1991
|
26 Juillet
1982
|
9 Juillet
1995
|
Source : A. Moneyang Yana, "La promotion et
la protection des droits sociaux de la femme en Afrique centrale : cas du
Cameroun", Rapport de Stage, IRIC, 2015-2016, p23.
Le PIDESC a été adopté en 1966,
entré en vigueur en 19756. Il est divisé en quatre
parties et comporte 31 articles. Les principaux articles qui traitent de la
femme sont notamment les articles 2 à 5 et l'article 10 dans lesquels
les Etats s'engagent à garantir les droits sans
4 CINU, Manuel de vulgarisation de l'approche
genre, 9.15.
5 CINU, Communauté Economique pour
l'Afrique, Genre et éducation pour la culture de la paix en
Afrique, Septembre 2013, p.3.
6 J. A. Moneyang Yana, "La promotion et la protection
des droits sociaux de la femme...", pp.23-38.
56
discrimination aucune, tout en prônant
l'égalité homme/femme. Par ailleurs, il stipule en son article 7
alinéa a que les Etats reconnaissent le droit que toute personne a de
jouir des conditions de travail justes et favorables qui assurent à tous
les travailleurs un salaire équitable et une rémunération
égale sans discrimination aucune. Les femmes doivent avoir la garantie
que les conditions de travail qui leurs sont accordées ne sont pas
inférieures à celles dont bénéficient les
hommes7. Le PIDESC a été adopté par les pays de
la CEMAC comme suit :
Tableau 4 : Ratification du PIDESC par les pays
de la CEMAC
|
Pays
|
Cameroun
|
Gabon
|
Guinée Equatoriale
|
R.C.A
|
République du Congo
|
Tchad
|
|
Année de ratification de la convention
|
27 Juin
1984
|
21 Janvier 1983
|
25
Septembre 1981
|
08 Mais
1981
|
05 Octobre 1983
|
09 Juin
1986
|
Source : Tableau de ratification du PIDESC, in
www.google.research.com.
Consulté le 03/10/2019.
Aussi, la Charte Africaine des droits de l'homme
adoptée à Nairobi au Kenya en 1981, entrée en vigueur en
1986, présente l'égalité homme/femme comme gage d'une
société plus juste et encourage les décideurs à
valoriser la femme. Dans son entièreté, le document traite des
droits fondamentaux comme son titre l'indique. Cependant, le préambule,
les articles 2 et 18 précisent la clause de non-discrimination
basée sur un quelconque critère notamment le sexe. Autrement dit,
tout comme l'homme, la femme bénéficie également de tous
les droits qui y sont traités8. Il n'en reste pas moins de
l'acte constitutif de l'Union Africaine étant le premier instrument
juridique de l'Union africaine, il prônent l'équilibre entre
l'homme et la femme au sein de la société ; du Nouveau
Partenariat Economique pour le Développement de l'Afrique (NEPAD), de la
Convention contre la traite des femmes et des enfants qui prônent
également une représentation équitable entre l'homme et la
femme. La charte africaine des droits de l'homme et des peuples a
été ratifiée par les pays de la CEMAC selon le tableau
suivant :
7 Moneyang Yana, "La promotion et la protection des
droits sociaux de la femme...", p.23.
8 Cf. La Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples de 1981.
57
Tableau 5 : Ratification de la charte africaine
des droits de l'homme et des peuples par les Etats de la CEMAC
|
Pays
|
Cameroun
|
Gabon
|
Guinée Equatoriale
|
R.C.A
|
République du Congo
|
Tchad
|
|
Année de ratification de la convention
|
20 Juin
1989
|
20 Février 1986
|
07 Avril
1986
|
26 Avril
1986
|
09
Décembre 1982
|
09
Octobre
1986
|
Source : Tableau de ratification de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, in
www.google.research.com.
Consulté le 03/10/2019 à 16h22min.
En outre, une plateforme d'action est adoptée suite
à la quatrième conférence à Beijing en 1995 :
Beijing + 5. Au cours de l'an 2000, se tient à New-York une rencontre
internationale (Beijing +5) pour l'évaluation de cette plateforme. A cet
effet, Hillary Clinton, alors première dame des Etats-Unis, fit un
discours dans lequel elle relève que "les droits des femmes sont les
droits des hommes", comme pour dire qu'il n'y a pas de droits
réservés aux femmes et d'autres aux hommes9. C'est
dans cette perspective que les Etats ont élaborés des lois qui
promeuvent l'égalité entre les deux sexes.
Le Protocole de Maputo ou Protocole à la Charte
africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en
Afrique, considéré comme le dictionnaire africain des droits de
la femme a été adopté le 11 juillet, lors du second sommet
de l'Union Africaine à Maputo au Mozambique. Il exprime une vision
lucide de la situation de la femme ainsi que le statut qui devrait être
le sien. Il est le défenseur de celle-là qui très souvent
à cause du poids des traditions, de la configuration de nos
sociétés et du rôle assigné à la femme, de
l'ignorance des lois est sans cesse victime de discriminations et
d'injustices10. Il s'agit d'un pas important dans le cadre des
efforts effectués pour promouvoir et assurer le respect des droits des
femmes africaines. Le Protocole exige des gouvernements africains
l'élimination de toutes les formes de discrimination et de violence
à l'égard des femmes en Afrique et la mise en oeuvre d'une
politique d'égalité entre hommes et femmes11. Le
protocole engage également les gouvernements africains qui ne l'ont pas
encore fait, à inclure dans leurs constitutions nationales et autres
instruments, législations, ces principes fondamentaux et veiller
à leur application effective. En outre, il contraint les gouvernements
à intégrer à leurs décisions
9 C. Durieux, Les femmes américaines en
politiques, Paris, Ellipses, 2008, p.12.
10 Rapport périodique du Cameroun sur la
CEDEF, Février 2009, Septembre 2011, p.2.
11 Cf. Protocole à la charte africaine des
droits l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes.
58
politiques, leurs législations, leurs plans de
développement, la notion de discrimination fondée sur le sexe et
la promotion du bien-être général des femmes.
A côté de ces lois internationales, les Etats se
sont dotés des instruments juridiques pour promouvoir la femme dans le
cadre national.
2. Les législations nationales sur la
femme
Les textes nationaux étudiés ici sont ceux qui
promeuvent la femme dans la société, prônent
l'égalité homme/femme dans la représentation sociale. Ils
sont constitués principalement des constitutions des six Etats de la
CEMAC, des programmes nationaux notamment les ordonnances.
Au Cameroun, de nombreux textes
régissent la condition et la promotion de la femme. C'est le cas de la
Constitution camerounaise. En tant que loi fondamentale qui organise la nation,
la constitution camerounaise révisée par la loi n° 96-06 du
18 janvier 1996, portant révision de la Constitution du 02 juin 1972,
présente en son préambule la vision et la philosophie
générale de la nation. Elle engage l'Etat à promouvoir
l'égalité de sexe et à éradiquer les
discriminations, comme stipule le préambule : "le peuple camerounais
proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de
sexe, de croyance possède des droits inaliénables et
sacrés [...] la nation protège la femme". L'Etat camerounais
affirme aussi son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans
les instruments internationaux. Cette constitution affirme : 1°) le
principe de l'égalité de tous devant la loi, la liberté et
la sécurité, le droit de se déplacer et de se placer en
tout lieu ; 2°) le droit à la santé ; 3°) le droit au
travail. Dans ce même préambule, il est écrit que "l'Etat
garantit à tous les citoyens de l'un et l'autre sexe, les droits et les
libertés énumérés au préambule de la
Constitution"12. A côté de cette constitution,
l'ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 sur l'état civil, pose le
principe de la liberté pour la femme mariée d'exercer une
profession de son choix sans l'autorisation de son mari. Aussi, l'article 61
alinéa 2 du Code du travail de 1992 stipule que le salaire est
égal pour tous les travailleurs à conditions égales du
travail, d'aptitudes professionnelles, quel que soit l'origine, le sexe,
l'âge, le statut et la confession religieuse13.
Plusieurs lois et programmes sont élaborés pour
promouvoir la femme dans l'éducation, la santé, l'économie
et même dans la politique. Cette même Constitution camerounaise
prévoit dans ce préambule que tout enfant a droit à
l'éducation et que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuite.
L'article 7 relève formellement que "l'Etat garantit à tous
l'égalité de
12 Cf. Constitution camerounaise du 18
Janvier 1996.
13 Cf. Code du travail camerounais issu de la
loi n°92/007 du 14 août 1992.
59
chances d'accès à l'éducation sans
discrimination de sexe, d'opinion publique, philosophique et religieuse,
d'opinion sociale, culturelle, linguistique ou
géographique"14. Par ailleurs, la loi n°98/004 du 14
avril 1998 portant orientation de l'éducation au Cameroun prévoit
non seulement une éducation de qualité pour tous les enfants,
mais aussi des réformes tendant à corriger les problèmes
pédagogiques.
Plusieurs programmes de promotion d'envergure ont
également été élaborés, notamment le
Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricoles (PNVRA) dont
l'objectif est d'accroître la productivité des femmes par le
renforcement de leurs compétences techniques. Ce même Code du
Travail protège la femme pendant les périodes de
procréation en ses articles 84 (alinéas 1à 5) et 85
(alinéas 1 à 3)15.
Aussi la promotion de la femme au Gabon par les lois
gabonaises amène à penser au Code de travail gabonais, qui
consacre l'égalité aux travailleurs devant la loi et interdit
toute discrimination en matière d'emploi et de condition de travail
fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion
politique et l'origine sociale. Ce qui permet à la femme d'occuper des
postes de responsabilité tant dans le secteur public que privé.
Dans la même perspective, plusieurs programmes ont été
initiés par l'Etat gabonais pour promouvoir l'égalité
entre l'homme et la femme dans la société, à l'instar de
:
- promo Gabon ;
- le Fonds d'Aide et de Garantie (FAGA) ;
- le Fonds d'Expansion économique (FODEX) ;
- l'octroi aux femmes des microcrédits par l'Etat pour
inciter les femmes à pratiquer
l'agriculture16.
Le Gabon est également engagé dans le respect de
l'ensemble des droits fondamentaux de chaque être humain. C'est dans cet
optique qu'il promeut l'éducation sans distinction de sexe. Ce qui
stipule l'élaboration de la loi n°25/59 du 22 juin 1959 qui rend
obligatoire la scolarisation dans la République gabonaise. Ladite loi a
été complétée par la loi n°16/66 du 09
août 1966 portant organisation générale de l'enseignement
en République du Gabon. En outre, plusieurs programmes en matière
de santé ont été élaborés pour
protéger les femmes enceintes :
14 Cf. Loi constitutionnelle n° 1/1995
du 17 janvier 1995.
15 Cf. Code du travail camerounais
16 A. M. F Elanga Mbangono, "Les politiques
sociales au bénéfice des femmes en zone CEMAC", Mémoire de
master en relations internationales, IRIC, 2012, pp.100-101.
60
- fourniture au plus grand nombre de femmes enceintes et
d'enfants de moins de 5 ans atteints de paludisme, un traitement correct dans
les premières 24 heures après l'apparition des premiers signes
;
- fourniture aux femmes enceintes du Traitement
Préventif Intermittent (TPI).
De même, la constitution adoptée le 23
décembre 1990 en Guinée Equatoriale et révisée en
2001, proclame dans son préambule, "l'égalité et la
solidarité de tous les nationaux sans distinction de race, d'ethnie, de
sexe, d'origine, de religion et d'opinion". Dans son article 1, elle
réaffirme ce principe d'égalité de tous, sans distinction
devant la loi. L'article 2 formule : "dans les conditions
déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens
guinéens majeurs de l'un et de l'autre sexe, jouissant de leurs droits
civils et politiques". De même, l'article 8 évoque que "tous les
êtres humains sont égaux devant la loi". En outre, cette loi
fondamentale guinéenne prévoit en son article 23 que
"l'éducation est un devoir primordial de l'Etat, tout citoyen a droit
à l'éducation primaire, gratuite et garantie"17. Par
ailleurs depuis 2006, la Guinée Equatoriale s'est dotée de
nouvelles méthodologies d'enseignement aux niveaux primaire et
secondaire, l'élève devenant acteur et promoteur de son propre
apprentissage et l'enseignement ayant un rôle d'appui et d'orientation.
Ce même article 23 garanti que "nul ne peut être contrarié
dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie ou de ses
opinions". En plus, la loi guinéenne consacre le caractère
obligatoire de l'enseignement primaire et l'égalité de tous sans
aucune discrimination devant les services de l'éducation.
En outre, un prix de l'excellence pour les filles admises aux
examens nationaux et un prix d'encouragement aux familles ayant
scolarisé davantage de filles sont octroyés ; l'octroi de bourses
aux filles méritantes, des dons de fournitures et de manuels scolaires
pour les filles de faible niveau y sont également octroyés. Aussi
l'on observe la volonté de l'Etat guinéen à construire
l'égalité homme/femme par ricochet la promotion de la femme dans
tous les domaines de la
vie. il est aussi noter la mise en place
d'un Fonds National de Soutien à l'Education des Filles (FONSEF), la
répartition équitable de balayage des salles de classes et de la
cour des établissements scolaires est observée18.
Dans la même initiative, plusieurs politiques nationales
ont été élaborées pour la protection et la
promotion de la femme, entre autres :
- la distribution gratuite des médicaments
antipaludéens aux femmes enceintes ;
17 Cf. La constitution
équato-guinéenne adoptée le 23 décembre 1990
et révisée en 2001.
18 Elanga Mbangono, "Les politiques sociales au
bénéfice des femmes en zone CEMAC...", p.8.
61
- l'approvisionnement du plus grand nombre de femmes enceintes
et d'enfants de moins de 5 ans en moustiquaires imprégnées
d'insecticides19.
- l'octroi des crédits aux femmes présentant des
garanties bancaires exigées par les banques commerciales ;
- le projet PRAMUR, cofinancé par l'Agence canadienne
de Développement international.
Le Ministère des affaires sociales et la condition de
la femme apporte aussi un appui à travers des microcrédits et par
là, une formation des femmes à la planification et à la
vérification des produits horticoles. Aussi, le Décret
présidentiel N°127/1993 en date du 15 septembre 1993 accorde la
création du Comité national pour l'intégration de la femme
au développement20.
Tout comme les autres pays de la CEMAC, la RCA à
travers plusieurs textes promeut la femme dans tous les secteurs
d'activité. Sa Constitution a consacré de nombreux articles pour
l'expansion de la femme. L'égalité entre l'homme et la femme en
RCA est avérée dans les articles 1, 2 et 5 qui relèvent la
nécessité de protection de la personne humaine notamment l'homme
et la femme. L'article 1 ressort que la personne humaine est
sacrée et inviolable. Tous les agents de la puissance publique, toute
organisation ont l'obligation absolue de la respecter et de la
protéger.
La République reconnaît l'existence des Droits de
l'Homme comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la
justice dans le monde. L'article 2 quant à lui agrémente que la
République proclame le respect et la garantie intangible au
développement de la personnalité. Chacun a droit au libre
épanouissement de sa personnalité pourvu qu'il ne viole pas le
droit d'autrui, ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel. En son article 5,
souligne de l'égalité qu'ont tous les êtres humains devant
la loi sans distinction de race, d'origine ethnique, de région, de sexe,
de religion, d'appartenance politique et de position sociale. La loi garantit
à l'homme et à la femme des droits égaux dans tous les
domaines. Il n'y a en République Centrafricaine ni sujet, ni
privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille21.
C'est également ce que mentionne l'article 19 que tous les
Centrafricains des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis,
jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les
conditions déterminées par la loi22.
19 Elanga Mbangono, "Les politiques sociales au
bénéfice des femmes en zone CEMAC...", p.97.
20 Ibid., pp.101-102.
21 Cf. Constitution de la République
Centrafricaine, pp.3-4.
22 Ibid. p.8.
62
En outre, l'article 5 en son alinéa 3 consacre la
protection de la femme et de l'enfant contre la violence et
l'insécurité, l'exploitation et l'abandon moral, intellectuel et
physique qui sont une obligation de garantie pour l'Etat et les autres
collectivités publiques. A côté de tous ces droits, le
droit au travail est en droite ligne protégé par les
autorités centrafricaines, pour les deux sexes à travers la
constitution, d'autres textes nationaux et des institutions liées
à la question. De même, l'article 9 de la constitution de la
République garantit à chaque citoyen le droit au travail,
à un environnement sain, au repos et aux loisirs dans le respect des
exigences du développement national. Elle lui assure les conditions
favorables à son épanouissement par une politique efficiente de
l'emploi. Par ailleurs, tous les citoyens sont égaux devant l'emploi.
Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en
raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances. Le
droit à l'association qui permet de se regrouper en syndicat ou en parti
politique est également promu dans cette constitution, comme le
relève l'article 12, "tous les citoyens ont le droit de constituer
librement des associations, groupements, sociétés et
établissements d'utilité publique, sous réserve de se
conformer aux lois et règlements"23.
Pour matérialiser cela, l'article 74 relatif au Conseil
Constitutionnel relève les quotas qu'il faille respecter pour promouvoir
la femme dans cette institution étatique. La Cour Constitutionnelle
comprend neuf (9) membres dont au moins trois (3) femmes, qui portent le titre
de Conseiller. La durée du mandat des Conseillers est de sept (7) ans,
non renouvelable. Toutefois, les membres de la Cour Constitutionnelle sont
désignés comme suit :
- deux (2) Magistrats dont une (1) femme, élus par leurs
pairs ;
- un (1) Avocat élu par ses pairs ;
- deux (2) Professeurs de Droit élus par leurs pairs ;
- deux (2) membres dont une (1) femme, nommés par le
Président de la République ;
- deux (2) membres dont une (1) femme, nommés par le
Président de l'Assemblée Nationale24.
Aussi le projet de constitution de la République du
Congo de janvier 2002, tient compte de la promotion de la femme dans la
société congolaise. L'article 15 de la partie consacrée
aux droits, libertés et devoirs des citoyens met en exergue
l'égalité de tous les congolais devant la loi, et tous sont
protégés par cette loi, sans aucun favoritisme ou
désavantage à quiconque du fait de son origine familiale,
ethnique, de sa considération sociale, de ses convictions politiques,
23 Cf. Constitution de la République
Centrafricaine, p.6.
24 Ibid., p.25.
63
religieuses philosophiques et autres25. L'article
17 relève l'égalité entre l'homme et la femme ainsi que la
représentation de la femme à toutes les fonctions politiques,
électives et administratives. Aussi, l'assurance est faite pas l'Etat
sur l'épanouissement de la jeunesse et le droit à
l'éducation et égal accès à l'enseignement et
à la formation à tous à l'article 29. Alors qu'à
l'article 30, l'Etat reconnaît le droit de travail à tous les
citoyens et crée les conditions qui en rendent effective la
jouissance26.
En sus, l'Etat congolais dans sa constitution issue de la
réforme constitutionnelle du 25 Octobre 2015 en ses articles 232 et 233
met en relief, l'institutionnalisation du Conseil consultatif des femmes qui
sera chargé d'émettre des avis sur la condition de la femme et de
faire des suggestions au gouvernement, visant à promouvoir
l'intégration de la femme au développement, ainsi que
l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif des
femmes27. Selon l'Enquête Congolaise sur les Ménages
(ECOM 2005) et au regard du poids numérique des femmes dans la
population congolaise (51,1% de femmes contre 48,9% d'hommes), l'opinion
publique s'accorde à reconnaître qu'au-delà d'une simple
question de droits, l'égalité de genre est un enjeu du
développement humain harmonieux et durable28. Il en ressort
que la condition de la femme au Congo est considérée comme enjeu
majeur pour un développement harmonieux et réussi du pays. Raison
pour laquelle la parité homme/femme est un objectif affirmé dans
la constitution.
En outre pour promouvoir l'activité de la femme, l'Etat
tchadien a mis sur pied des mécanismes voire des structures de promotion
de la femme. C'est le cas du Ministère de l'Action Sociale, de la
Solidarité Nationale et de la Famille (MASSNF) qui regorge une
pléthore de structures chargées de rehausser le statut de la
femme dans tous les domaines de la vie.
La constitution tchadienne consacre au système
éducatif le droit à l'instruction pour tout tchadien mais accorde
une place de choix à la laïcité et la gratuité de
l'enseignement public. Aussi, la loi n°16/PR/06 du 13 mars 2006 portant
orientation du système éducatif tchadien dispose en son article 4
"le droit à l'éducation et à la formation, reconnu
à tous sans distinction d'âge, de sexe, d'origine
régionale, sociale, ethnique ou confessionnelle". Il a également
été élaboré un programme de traitement
préventif intermittent du sida chez la femme enceinte29.
Le statut de la Fonction publique a été
reformé par la loi n°17/PR/01 du 31 décembre 2001. Cette loi
vient remplacer l'ancien statut de 1996 promulgué par ordonnance
n°15/PR/86/
25Projet de la constitution de la
République du Congo de 2002, p6.
26 Ibid.
27 Projet de modification de la constitution
du Congo, Octobre 2015, p.16.
28 Ibid., p.101.
29 Elanga Mbangono, "Les politiques sociales au
bénéfice des femmes en zone CEMAC", pp.93-94.
64
du 20 septembre 1986. Ce nouveau statut général
dispose en son article 5 que " l'accès aux emplois publics est ouvert
à égalités des droits, sans distinction de genre, de
religion, d'origine, de race, d'opinion politique, de position sociale". Le
secteur privé cependant est régi par la loi n° 038/PR/96 du
11décembre 1996, portant Code de travail. Il relève qu'est
considéré comme travailleur ou salarié, selon l'article 3
de cette loi, toute personne physique, quel que soit son sexe et sa
nationalité "qui s'est engagé à mettre son activité
professionnelle moyennant rémunération sous la direction et
l'autorité d'une personne physique appelée employeur". Alors que
l'article 6 ajoute qu'aucun employeur ne peut prendre en considération
le sexe, l'âge ou la nationalité des travailleurs pour
arrêter ses décisions concernant le recrutement, la
répartition de travail, la formation professionnelle, l'avancement, la
promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la
discipline ou la rupture de contact de travail. Et concernant la
rémunération pour un travail de valeur égale, le salaire
est le même sans distinction de sexe. C'est ainsi que pour assurer
l'accès à tous les tchadiens dans la fonction publique sans
distinction de sexe, il est institué un concours de
recrutement30. En plus de ces lois nationales, il existe des
législations propres à la CEMAC en tant qu'institution
communautaire.
3. Les législations de l'Organisation
Internationale sous régionale la CEMAC
La législation sous régionale
évoquée ici est le Programme Economique Régional (PER),
élaboré par la CEMAC pour promouvoir la femme. Bien que cette
question soit abordée pendant des grandes assises de la
communauté, le PER est le seul instrument qui soit élaboré
jusqu'aujourd'hui en matière de promotion de la femme.
La communauté sous régionale n'a point
établi un véritable instrument juridique de promotion du genre,
qui permet de promouvoir la femme depuis l'UDEAC. Il n'en demeure pas moins que
de l'UDEAC à la CEMAC, les femmes ont toujours été
représentées, malgré leur petit nombre. Pour pallier
à cette insuffisance ou manque de législation dans le domaine, la
CEMAC s'est donnée pour initiative dans le PER élaboré en
2011, d'intégrer la question genre.
Le PER répond à une vision de l'avenir de la
Communauté à l'horizon 2025, consistant à "faire de la
CEMAC un espace économique intégré émergent ou
règnent la sécurité, la solidarité et la bonne
gouvernance, au service du développement humain"31. C'est un
programme élaboré pour trois périodes quinquennales. La
première phase allait de 2011 à 2015,
30 Elanga Mbangono, "Les politiques sociales au
bénéfice des femmes en zone CEMAC...", pp.97-98.
31 Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale, Programme Economique Régional, Plan
opérationnel, 2011, p.9.
65
la deuxième de 2016 à 2020, et la
dernière va de 2021 à 2025. Le premier plan opératoire
20112015 se traduit par les atouts principaux dont : un cadre institutionnel
clair et logique caractérisé par la déclinaison des axes
en objectifs stratégiques, en programmes puis en projets et un plan
cohérent dans lequel les projets des différents axes se
renforcent les uns les autres et convergent vers un même objectif,
excluant une compilation de projets sans cohérence entre les actions.
Aussi une approche programme permettant l'élaboration d'un budget
programme pluriannuel qui facilite la recherche, la mobilisation et
l'affectation opportune des ressources à ces projets déjà
identifiés de manière claire, logique et cohérente.
Par ailleurs, ce plan est appelé à servir de
guide d'action permanent pour les Institutions, les Organes et les Institutions
spécialisées de la Communauté en commençant par la
Commission de la CEMAC. Chaque Etat membre de la CEMAC y retrouve l'agenda
régional de son plan national de développement économique
et social (devant être mis en forme à travers le volet pays du
PER). Ce qui lui permet d'assurer une bonne articulation entre le niveau
régional et le niveau national, les acteurs du secteur privé,
partenaires essentiels et indispensables dans la création des richesses
dans la Communauté et les bailleurs de fonds, qui y trouveront une
meilleure visibilité lors des missions d'élaboration de leurs
cadres d'intervention dans les pays et d'appui à la communauté.
Autrement dit, le PER permet d'une part, d'assurer une bonne articulation entre
l'agenda de la CEMAC, de ses Etats membres et le secteur privé, et celui
des partenaires au développement de la Communauté et, d'autre
part, fournit des possibilités de complémentarité entre
les interventions des différents bailleurs de fonds au niveau de la
Communauté32.
Contrairement aux instruments juridiques
précédents de la CEMAC, ce dernier a élaboré un
programme de développement sur le genre. Avec une population de plus de
50 millions d'habitants aujourd'hui, sur un territoire communautaire de plus de
3002144millions de km2, une densité démographique de
13habitants/km2, bien que faible, et 7 personnes/13 sont du genre
féminin. Continuer à exclure par quel motif que ce soit, cette
population féminine, pénalise grandement la réalisation de
l'émergence économique de la Communauté. Motivation
incontestée de la mise sur pied d'un texte consensuel de promotion du
genre dans cette communauté. Le Programme de développement genre
vise ici à insérer davantage, voire réinsérer les
ressources humaines féminines de manière pragmatique et efficace
dans les activités économiques et sociales de la
Communauté, à travers la mise en oeuvre de trois projets. Aussi,
la mise en oeuvre d'une politique de promotion genre vise à assurer la
promotion genre
32Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale, plan opérationnel..., pp.9-10.
66
dans toutes les actions et activités du PER, par une
forte implication des ressources humaines féminines de la CEMAC. Pour ce
faire, il a été procédé à la formulation de
manière consensuelle dès l'année 2011, d'une politique de
promotion genre, dont la mise en oeuvre est entamée dans le courant de
l'année 201233.
Pour réaliser cet exploit, il est
préconisé de mettre sur pied ou de renforcer les réseaux
d'actrices économiques, mais aussi d'insérer les femmes dans la
promotion de la paix et de la sécurité. Les organisations de
groupements féminins existants dans chacun des Etats membres de la
CEMAC, développent séparément leurs programmes
d'activités, souvent sans une coordination à l'échelle de
la Communauté. Il s'agit par-là, de mettre en oeuvre ce projet,
de bâtir ce maillon manquant destiné à assurer la
convergence des programmes nationaux afférents aux femmes, en
particulier, à celles membres de réseaux nationaux
évoluant les divers secteurs économiques. La pleine implication
des femmes actrices économiques à travers un Réseau
communautaire fonctionnel pourrait ainsi contribuer amplement à
l'accélération de la mise en place effective du marché
commun. Car aucune action de développement ne peut être viable si
la Communauté n'évolue pas dans un environnement de paix et de
sécurité34. Il est plus qu'impératif que soient
pacifiées toutes les zones et poches de conflits et que les Etats
membres de la CEMAC cultivent et entretiennent précieusement entre eux
une diplomatie de bon voisinage, de manière durable. Sous ce rapport, la
population féminine de la Communauté dispose d'atouts
considérables à faire prévaloir, afin de contribuer
à la pacification et sécurisation de toutes les zones et poches
de conflits, à travers des stratégies se référant
au patrimoine culturel des civilisations de l'Afrique centrale35.
Face à toutes ces législations, le rôle de
la femme dans la CEMAC est examiné afin de comprendre l'importance
accordée à la femme dans cette sous-région.
B. DE LA CONTRIBUTION DIPLOMATIQUE DE LA
FEMME
Plusieurs femmes occupent de nos jours de nombreux postes au
sein de la CEMAC, que ce soit dans la classe des fonctionnaires du
régime international que celle des fonctionnaires du régime
local. Ces femmes jouent un rôle considérable pour l'avancement de
l'intégration politique et économique de la sous-région,
sans oublié l'harmonie sociale. C'est ce que s'attèle à
examiner cette partie.
33 Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale, plan opérationnel, pp.102-103.
34 D'après Mbassi Ondigui, entretien.
35Lucien Henry Ticky, 47 ans, Expert Principal
CEMAC en circulation, entretien réalisé à la
Représentation de la CEMAC au Cameroun à Yaoundé, le
15/10/2018.
36 Commission économique pour l'Afrique,
le Genre et l'Education à la culture de la paix en Afrique
Centrale, septembre 2013, p.4.
67
Autrefois, la différence de genre soumettait la femme
à une discrimination sociale et à la privation des
privilèges liés à sa contribution au développement.
De nos jours, les femmes de la sous-région sont davantage conscientes de
leur force sociale, économique et politique. D'où elles
s'affirment comme "sujet" de leur histoire et actrices incontournables de la
CEMAC sur les plans politique, économique et social.
1. La femme sur le plan politique
Parler du cadre politique dans la CEMAC renvoie à
aborder plusieurs domaines notamment la sécurité, la paix, la
prévention des conflits, l'élaboration des grandes politiques de
l'organisation, la prise des décisions importantes, les grands
débats sous régionaux (conférences, colloques,
séminaires), les accords de coopération entre Etats de la
sous-région et entre la CEMAC et d'autres structures partenaires.
a. Dans les domaines de la paix, la
sécurité et la prévention des conflits en zone
CEMAC
Dans ces domaines de la sécurité, du maintien de
la paix et de la prévention des conflits dans la sous-région, les
femmes contribuent massivement à la stabilité de la
sous-région à travers leur activisme. Ceci en accord avec les
législations nationales, sous régionales et internationales. La
résolution 1325 sur les femmes, sur la Paix et la Sécurité
du Conseil de Sécurité des Nations Unies affirme l'importance de
la femme dans la consolidation de la paix et invite les Etats membres à
assurer une représentation accrue des femmes à tous les niveaux
du processus décisionnel dans les institutions nationales,
régionales et internationales et dans les mécanismes de
prévention, de gestion et de résolution des
conflits36. C'est le cas de la participation des femmes dans les
opérations de maintien de la paix, initiées par le Conseil de
Sécurité des Nations Unies pour le maintien de la paix et la
sécurité dans le monde et de la résolution des conflits
par des moyens pacifiques. C'est ce qui ressort de la participation des femmes
dans les opérations de maintien de la paix initiées par le
Conseil de Sécurité en Centrafrique en 2014 et même bien
avant, et dans d'autres pays.
Aussi, les femmes de la CEMAC participent à la
sécurité de la sous-région dans le cadre de la Force
Multinationale de la CEMAC (FOMUC) qui est la force multinationale qui regroupe
les Etats de la CEMAC. C'est ce qui explique l'intervention de la FOMUC dans le
conflit centrafricain en 2002. Les femmes ne sont pas en reste dans cette
épreuve d'aide au pays en
68
conflit dans la sous-région. Même si elles ne
sont pas aux fronts, elles sont employées comme médecins, et dans
d'autres commissions du cadre du maintien de la paix dans le
monde37.
La présence d'Interpol-CEMAC connaît
également la participation des femmes dans les forces de maintien de
l'ordre et de la paix. D'où la présence du Comité des
Chefs de Polices d'Afrique Centrale (CCPAC). Les femmes ont toujours
été très actives dans les campagnes, des zones urbaines et
les mobilisations publiques pour la paix dans leurs Etats. Pour mieux jouer ce
rôle, Armelle Pana membre de l'unité de la protection de l'enfant
de la Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour
la Stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) en 2014 relève que : "afin de
rendre plus efficace leur participation aussi bien à la vulgarisation
qu'au processus de paix, les besoins les plus profonds des femmes doivent
être pris en compte". C'est dans ce sens que Gladys Atinga,
Conseillère principale en genre pour la MINUSCA en 2014 souligne que
:
La participation des femmes dans le processus de paix est
indispensable à l'établissement et au maintien de la paix.
L'exclusion des femmes lors de ces processus a des conséquences
importantes sur la façon dont les questions qui les concernent sont
abordées, tels que les problèmes de violence envers les femmes.
Il est alors nécessaire de revoir le rôle des femmes et surtout de
les préparer.38
Donc les femmes peuvent contribuer au même titre que les
hommes à la promotion de la paix dans le monde et sphériquement
dans la CEMAC39. Dans cette initiative, le Club CEMAC est une
plateforme de cohésion, de concertation, de dialogue et de promotion des
valeurs d'humilité et de partage entre les jeunes, au service de
l'intégration. Mais aussi et surtout au service du développement
durable de la Communauté, dans un environnement de fraternité, de
tolérance, de solidarité et de paix40. D'autant plus
qu'elles occupent des postes importants : Lemi Clarisse Penga,
Présidente du club CEMAC, Emmanuelle Ngo Bayina
Trésorière, Jeannette Ngo Mbemoun,
Conseillère.41
En outre, des conférences sont organisées
toujours dans le but de la préservation de la paix en Afrique centrale
zone CEMAC, c'est le cas du séminaire tenu du 18 au 19 Décembre
2017 qui avait pour thème "prendre en compte les besoins
spécifiques des femmes dans le processus de paix et de
sécurité en RCA". Il en ressort que la femme participe activement
au processus de maintien de la paix, et de la prévention des conflits en
Afrique centrale. Cependant,
37 J. Nna, "Sécurité et
défense en Afrique centrale 1960-2009", Mémoire de master en
Histoire, Université de Yaoundé I, 2009, pp.33-35.
38 D. Thiénot, "Les femmes entre les fronts en
République centrafricaine", in Rapport sur l'Afrique centrale 10,
Institut d'Etudes de Sécurités, Septembre 2017, pp.2-4.
39
https://minusca.unmission.org/prendre-en-compte-les-besoins-sp%C3%A9cifiques-es-femmes-dans-le-processus-de-paix-et-de-s%C3%A9curit%C3%A9-en-rca.
Consulté le 15/03/2018.
40 Plan d'action du Club CEMAC pour
l'année académique 2013-2014, une présentation du
bureau entrant, 20132014, 9p.
41 Ibid.
42 Réunion du groupe de travail
chargé de l'élaboration du plan d'action et du chronogramme
d'activités, Rapport des Experts, Yaoundé, 14-15 Septembre
2010, pp.2-3.
69
sa contribution devrait être redynamiser pour qu'elle
contribue plus efficacement, afin de participer à la stabilité de
la sous-région. Un rôle qui est promu par la Résolution
2387 du Conseil de sécurité qui met en exergue le rôle
crucial de la société civile dans le processus de paix et de
réconciliation, encourageant par ailleurs la participation
entière et effective des femmes. Elles sont aussi présentes dans
l'élaboration et l'adoption des grandes politiques de la
Communauté.
b. Les femmes dans les grands débats et
l'élaboration des directives politiques de la
Communauté
Les femmes sont également présentes dans
l'adoption des directives politiques de la sous-région et à la
tenue des conférences pour une gestion efficace de la
sous-région. Elles ne sont pas en marge de l'adoption des
législations nécessaires par la CEMAC pour l'avancement de cet
espace communautaire. L'on peut citer Chantal Elombart Mbedey, Directeur de
l'Intégration régionale au Ministère de l'économie,
de la planification et de l'aménagement du territoire de la
République du Cameroun. Elle a présidé du 14 au 15
Septembre 2010, la cérémonie d'ouverture de la réunion du
groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'action et du
chronogramme d'activités. Cette réunion était
convoquée conformément aux instructions du comité de
pilotage de la Communauté Economique Régionale (CER). Elle avait
mis sur pied un groupe de travail dont la mission était
d'élaborer un plan d'action pertinent qui servira de tableau de bord au
processus de rationalisation. Cette dernière a montré
l'importance de cette réunion et a exhorté les participants
à procéder à une analyse approfondie de la
problématique posée et identifier les voies et moyens qui
permettront d'élaborer un plan d'action réaliste,
répondant aux attentes exprimées par les Chefs d'Etats et les
Ministres de la Communauté42.
Il en va de même pour Dorothée Aimée
Calenzana, ministre centrafricaine de la Coopération, de
l'Intégration Régionale et de la Francophonie, qui est
également Coordonnatrice du Réseau de Soutien au Leadership
Politique des Femme Centrafricaines (RESOLEP-FC) et cumulativement
Présidente nationale du Collectif des Femmes de la société
civile centrafricaine (COFEM) et Yvonne Adélaïde Mougany, ministre
congolais des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, Madjima
Kalzeube Neldikingar, Ambassadeur extraordinaire du Tchad auprès de la
République du Congo, qui ont toutes pris part à la
22ème
70
session ordinaire du Conseil des Ministres de l'UEAC tenue
à Brazzaville le 19 Décembre 2011, qui tablait sur la
nécessité de dynamiser la sous-région.43.
Toujours dans la même initiative, Mahadie Outhman Issa,
Secrétaire d'Etat aux infrastructures et au transports du Tchad a pris
part à la 20ème réunion du Collège de la
surveillance multilatérale de la CEMAC, tenue à Douala les 16 et
17 Décembre 2010 dans les locaux de la Banque de Développement
des Etas de l'Afrique Centrale (BDEAC). Réunion au cours de laquelle,
des objectifs ont été préconisés pour le
Collège de surveillance multilatérale notamment d'assurer un
pilotage efficace et une appropriation du PER au niveau de chaque Etat membre
et une large diffusion de la Vision CEMAC 2025, du PER, mais aussi de
consolider la bonne gouvernance. Elle a fait un discours constitué de
remerciements à l'encontre du Président Congolais Denis Sassou
N'Guesso, devant une pléthore d'hommes et de femmes. C'est
également l'intelligentsia féminine qui était
prouvée ce jour-là, (cf. photo 2)44.
Photo 2 : La représentante du Tchad
Mahadie Outhman Issa, Secrétaire d'Etats aux infrastructures et aux
transports à la 20ème réunion du Collège
de la Surveillance multilatérale de la CEMAC, Douala les 16-17
Décembre 2010.
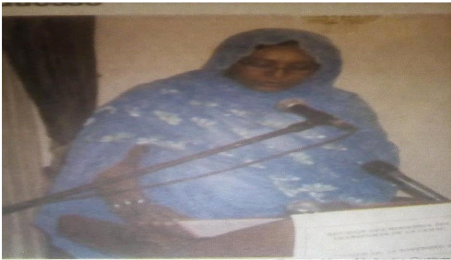
Source : Vision CEMAC, n°01, 29
décembre 2010, p.8.
Cette photo présente la ministre tchadienne des
transports en plein discours, lors de la 20ème réunion
du Collège de la Surveillance multilatérale de la CEMAC à
Douala les 16 et 17 Décembre 2010. Une réunion au cours de
laquelle des hommes et des femmes de la haute classe
43 Procès-verbal de la
22ème session ordinaire du Conseil des Ministres de
l'UEAC, Brazzaville (R. Congo), 19 décembre 2011, p.3.
44 Ibid., p.2.
45 Réunion du groupe de travail
chargé de l'élaboration du plan d'action et du chronogramme
d'activités, Rapport des Experts, 2016, p.2.
71
des fonctionnaires de la CEMAC étaient présents.
Elle représentait son pays au cours de cette conférence. Un
exemple de plus de la confiance mise sur la gente féminine dans la
sous-région. Car que ce soit au plan national comme international, les
femmes tiennent des conférences45.
En plus, d'autres conférences d'envergure sont
généralement organisées par les femmes en ce qui concerne
les activités économiques dans la sous-région. C'est le
cas de la Conférence débat sur la fluidification des
échanges en zone CEMAC, tenue lors de la Foire Transfrontalière
de l'Afrique Centrale (FOTRAC) 2016, dont Danielle Nlaté a ressorti la
nécessité pour les "sexes" et particulièrement les femmes,
de s'investir sur la question des échanges afin de booster cet espace
communautaire, (cf. photo 3).
Photo 3 : Conférence débat sur la
fluidification des échanges en zone CEMAC lors de la FOTRAC 2016.
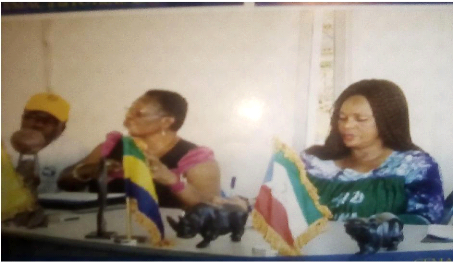
Source : FOTRAC, 7ème
édition, Kyé-Ossi, du 25 juin au 09 juillet 2016, p.9.
Cette photo présente les femmes en pleine
conférence sur la libre circulation lors de la Fotrac de 2016, aux rangs
desquels, la présidente fondatrice du REFAC, de la droite vers la
gauche, qui expose les biens fondés de ladite foire pour la
sous-région. Une autre Conférence sur la libre circulation s'est
tenue au cours de cette foire. Car la libre circulation devenue l'un des
principaux obstacles de la CEMAC, il est fondamental de s'atteler dessus pour
sensibiliser
72
tous les ressortissants de la sous-région de prendre en
considération ce pan qui incombe toutes les populations46.
c. L'expertise féminine dans le cadre
bilatéral pour un renforcement des relations communautaires
Pour une coopération plus fluide et prometteuse, de
nombreuses Commissions mixtes sont établies entre les pays de la CEMAC.
Des commissions au cours desquelles les femmes participent au même titre
que les hommes. C'est le cas de la grande Commission Mixte
Cameroun-Guinée Equatoriale. Au cours de la 8eme session de
ladite Commission ténue du 27 au 30 mai 2012 à Yaoundé, de
nombreux ministres camerounais et équato-guinéens ont pris part,
au rang desquels des femmes ministres du côté de chaque pays. Le
Cameroun comptait 14 émissaires dont Messina née Beyene
Clémentine Antoinette, ministre délégué
auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural,
chargé du développement rural. Elle a participé à
cette Commission mixte au côté de 13 autres ministres camerounais
de sexe masculin. Du côté équato-guinéens, Victoria
Nchama Nsue Ocomo, vice-ministre des Affaires étrangères
guinéennes. Il a par ailleurs été examiné des
questions d'ordre juridique et politique, de la coopération
économique et de la coopération scientifique, culturelle et
technique47.
A l'issu des travaux, huit accords ont été
signés. Il y'a eu l'accord relatif à l'exemption
réciproque de visas pour les titulaires des passeports diplomatiques, de
service ou officiels, celui portant création de la Commission mixte
permanente de sécurité. De même l'accord sur le
Règlement Intérieur du comité de suivi des questions
consulaires et de sécurité transfrontalières, celui de
coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture.
Aussi, le Protocole d'accord en matière d'agriculture, celui du domaine
de la promotion de la femme et du genre et l'accord de partenariat entre le
Ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative
du Cameroun et le Ministère de la Fonction publique et de la
réforme administrative de la Guinée Equatoriale. Sans omettre la
Convention de partenariat entre le Ministère des relations
extérieures du Cameroun et le Ministère
équato-guinéens des affaires étrangère et de la
coopération pour la formation et le perfectionnement du personnel de la
diplomatie de la Guinée Equatoriale.
La question genre qui a fait l'objet d'un débat au
cours de cette rencontre bilatérale, relève de la place que les
pays de la sous-région accordent à la question genre et mieux
encore
46 FOTRAC, 7ème
édition, Kyé-Ossi, du 25 juin au 09 juillet 2016, p.9.
47 Rapport 8eme Commission Mixte
Cameroun-Guinée Equatoriale, Yaoundé, 30 août 2012,
p.3.
73
à la femme48, même s'il faut relever
un déséquilibre d'effectif de représentation des femmes
par rapport aux hommes. Ceci peut être expliqué par la
sous-représentation des femmes au sein des pays respectifs de la CEMAC.
Aussi, le fait que des femmes occupent très peu de postes de
responsabilité au sein des Administrations nationales entraine leur
faible représentation au-delà des frontières
nationales.
Pour ce qui est du cadre national, au Gabon par exemple Rose
Francine Rogombé, ex-Président du Sénat et
ex-Président par intérim démontre que les femmes en
Afrique central et au-delà, peuvent bien diriger leurs pays et
même les organisations internationales. A la mort du Chef d'Etat Omar
Bongo, elle a assumé la transition de son pays et a organisé avec
succès les élections présidentielles remportées par
Ali Bongo, fils du défunt49. Il en va de même de
Catherine Samba Panza, qui a assuré la transition en RCA avant que
soient organisées les élections remportées par Archange
Touadera, l'actuel président de ce pays.
Il en ressort que la femme est présente dans les
domaines de la sécurité, de la paix, de la prévention des
conflits, de l'élaboration des grandes lignes de conduite de
l'organisation, de la prise des décisions importantes, dans les grands
débats sous régionaux (conférences, colloques,
séminaires), les accords de coopération entre les Etats de la
sous-région, et entre la CEMAC et d'autres organisations ou Etats dans
le monde. L'on ne saurait denier à quel point la diplomatie
féminine pour le dynamisme politique de la sous-région est
présente et efficace. Même s'il faille relayer leur petit nombre
par rapport aux hommes. Il nécessite toutefois de diagnostiquer sa place
dans le volet économique qui sous-tend même cette espace
communautaire.
2. Le rôle de la femme dans le volet
économique
En plus de son rôle joué dans la politique de la
sous-région, la femme joue également un rôle
déterminant dans le volet économique de la CEMAC. Aussi depuis,
les pays de l'Afrique centrale avaient manifesté une volonté de
mettre sur pied une entité géoéconomique
intégrée car les indépendances sont proches. Ce qui
explique le processus de création de la CEMAC qui couvre non seulement
l'économie, mais aussi la monnaie avec des déclinaisons
culturelles et politiques. Il incombe donc aux hommes et aux femmes de la
Communauté de dynamiser l'économie de la sous-région par
leur savoir-faire et de surcroit permettre le décollage
économique de cet espace géographique. Il est question dans cette
partie de ressortir
48 Rapport 8eme Commission Mixte...,
p.9.
49 Commission Economique pour l'Afrique..., p.19.
74
le dynamisme de la femme dans plusieurs domaines de
l'économie de la sous-région. Notamment dans l'agriculture, la
pêche, l'élevage, le commerce et les transports.
a. Dans l'agriculture
La CEMAC est un espace de six pays avec une superficie de plus
de 3 millions de km2 et une population de plus de 51 millions
d'habitants, disproportionnelle aux pays. Cette situation géographique
particulière offre à la zone CEMAC, une diversité de zones
agro-écologiques. Cette diversité fait en sorte que l'agriculture
occupe une place cruciale dans cette sous-région50.
L'agriculture est l'un des principaux secteurs de
l'économie des pays de la CEMAC. Elle emploie environ 64% de la force
vive de la zone et contribue pour 25% au Produit Intérieur Brut (PIB) de
la sous-région, bien que ce soit de manière variable d'un Etat
à un autre. Cependant, elle ne procure qu'environ 15% des recettes
d'exportation en raison du poids relativement important des exportations du
pétrole produit dans quatre pays sur six de la CEMAC51. Cette
contribution est tout aussi variable d'un pays à l'autre. La part des
importations des produits agricoles, dans le total des importations, est de
l'ordre de 16%52. Les produits les plus importants de cette
agriculture sont entre autres le cacao, le café, la banane, le
caoutchouc, l'huile de palme qui sont des produits fortement exportés
par des pays étrangers et permettent de propulser le PIB de la
sous-région.
Conformément aux constats de la littérature sur
l'agriculture en Afrique subsaharienne53, les observations sur le
terrain démontrent que les femmes ont moins d'accès à la
terre, cultivent généralement des parcelles de moindre taille et
ont un moindre accès aux services de conseil. De plus, la contribution
des femmes au travail agricole est de manière disproportionnée
plus grande, bien que les hommes assument les gros travaux (défrichage
et labour)54. Ce qui explique le fait que, peu d'organisations de
producteurs sont dirigées par des femmes, l'une des exceptions notables
étant le Conseil Régionale des Organisations Paysannes de la
Partie Septentrionale du Cameroun (CROPSEC), une association agropastorale
active dans les régions du Nord et de l'Extrême Nord comptant plus
de 3 000 femmes (soit 59% des
50 V. Achancho "Revue et analyse des
stratégies nationales d'investissements et des politiques agricoles en
Afrique du Centre : cas du Cameroun", in Reconstruire le potentiel
alimentaire de l'Afrique de l'Ouest, A. Elbehri (ed.), FAO/FIDA.,
p.127.
51 Discours de Poul Nieson à propos de l'accord
de Cotonou en 1999.
52 Stratégie agricole commune des pays
membres de la CEMAC, Version provisoire, mai 2004,
pp.6-7. 53A. N. Mukasa, and A. O. Salami, (2016). Gender
equality in agriculture : What are really the benefits for Sub-Saharan Africa
? Africa Economic Brief Chief Economist Complex | AEB, 7(3), 2016,
pp.1-12. 54 Anne Mindang, 35 ans, cultivatrice centrafricaine,
entretien réalisé à Yaoundé le, 15/06/2019.
75
membres)55. Cependant, ces difficultés
d'accès aux terres n'empêchent point ces femmes de la CEMAC de
pratiquer l'agriculture qui nourrit des populations à l'intérieur
comme à l'extérieur de ces pays à travers la
commercialisation, (cf. photo 4).
Photo 4 : Les produits de l'agriculture
vivrière dans la CEMAC à Kyo-Ossi.

Source : International Bank for
Reconstruction and Development / The World Bank, Briser les Obstacles au
Commerce Agricole Régional en Afrique Centrale, Août 2018,
p.71.
Cette image représente certains produits
cultivés par les femmes dans la CEMAC, ce qui contribue massivement
à l'alimentation d'une grande partie de la population dans les zones
frontalières de la sous-région, à travers la
commercialisation de ces produits, (cf. photo 5).
55 Aba Minlo, 35 ans, Agent CROPSEC, entretien
réalisé à Yaoundé, le 25/05/2018.
76
Photo 5 : Surcharge d'un pick-up face à
l'augmentation des coûts de douane

Source : International Bank for
Reconstruction and Development / The World Bank, Briser les Obstacles au
Commerce Agricole Régional en Afrique Centrale, Août 2018,
p.71.
Cette image présente la surcharge d'une voiture afin de
pallier aux coût tarifaires d'impôts, pour éviter
l'inadéquation entre les prix colossaux de la douane et la
vente56. Il faut relever que la plupart des femmes pratiquent ces
activités d'une façon informelle à cause d'énormes
entraves liées à la libre circulation, mais qui ne sont pas de
moindre importance. En plus de l'agriculture, la pêche et
l'élevage ne sont pas en reste dans ces
activités.57
b. La pêche et l'élevage
A côté de l'agriculture, l'on relève
l'élevage et la pêche qui sont des principales sources de
protéines d'origines animale dans l'alimentation des populations de la
CEMAC. Ces deux secteurs d'activité font partir des secteurs promus par
la sous-région et dont le cadre a été harmonisé par
la création de la Commission Economique du Bétail, de la Viande
et des Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA). Même s'il faut relever que
d'autres femmes pratiquent ces activités à usage personnel et de
façon informel. Cependant, l'importance est également
avérée par la fluidité du commerce dans les
différentes zones frontalières de ces Etats de la
sous-région.58
56 International Bank for Reconstruction and
Development / The World Bank, Briser les Obstacles au Commerce Agricole
Régional en Afrique Centrale, Août 2018, p.71.
57 Ibid..
58 S. Hekebereya, "La coopération
sectorielle en Afrique Centrale : le cas de la CEBEVIRHA (Commission Economique
du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques)", Mémoire
de master en relations internationales, IRIC, 2009, p.7.
77
Les activités pastorales menées dans trois des
six Etats couvrent une superficie d'environ 1,1 millions de km2.
Plus de 35% des populations au Cameroun et 40% au Tchad se consacrent aux
activités d'élevage. L'effectif global du cheptel bovin de la
zone était de 13 millions de têtes en 1995, et l'effectif
disponible à l'exportation sur pied et vivant représente 12% de
ce total. Mais de nos jours, on dénombre plus de 37.014 151 têtes
reparties entre les Etats membres, soit une augmentation de 25.014 151
têtes. Le Tchad et la RCA sont des exportateurs nets du bétail. Le
Cameroun est à la fois importateur et exportateur. L'Afrique centrale
n'a cependant pas pu bénéficier du Protocole viande prévu
par la Convention de Lomé IV. Au contraire, elle est envahie par les
produits carnés européens subventionnés.
La promotion et la valorisation des produits de
l'élevage restent insuffisantes et non pas permis d'exploiter à
fond des ressources de la zone. Les importations du lait dans l'ensemble des
pays en constituent une illustration. La zone CEMAC dispose pourtant d'atouts
importants pour le développement de l'élevage, notamment
l'abondance de pâturage et un climat très favorable. Les
échanges en bétail se multiplient de plus en plus dans cette
zone. Le commerce est dominé par l'exportation des animaux sur pied du
Tchad vers le Nigéria en passant par Kousseri au Cameroun. Aux circuits
intrarégionaux que sont Tchad-RCA, Bangui-Brazzaville,
Adamaoua-Yaoundé, RCA-Cameroun, Yaoundé-Douala,
Yaoundé-Libreville et Yaoundé-Malabo, s'ajoutent des circuits
extrarégionaux dont Tchad-Nigéria et
Cameroun-Nigéria59.
Face à ce vaste terrain qu'offre le domaine de
l'élevage en Afrique centrale, les femmes ne sont pas en reste et
contribuent au développement du secteur tant d'une façon formelle
qu'informelle. De nombreuses femmes pratiquent l'élevage dans
différents pays de l'Afrique centrale et permettent à travers
cette activité d'alimenter une grande partie de la population de la
sous-région. Cependant, les échanges sont malheureusement
entravés dans leur développement par de nombreuses contraintes
notamment l'inorganisation des marchés à bétail,
l'insuffisance des statistiques, les maladies animales émergentes, les
coûts élevés de production, le manque d'une
législation adaptée, les mesures de l'Organisation Mondiale sur
le commerce des animaux et de leurs produits et la faible structuration des
acteurs, qui sont autant de défis qui font à ce que la zone ne
soit pas compétitive. Même s'il faut aussi noter l'inégale
répartition des activités dans ce secteur entre l'homme et la
femme.
Pour ce qui est de la pêche, l'idée de promouvoir
la pêche continentale et l'aquaculture en zone CEMAC est née en
1999 à Bangui (RCA). C'est le Secrétaire Général de
la CEMAC de l'époque, Thomas Dakayi Kamga qui avait
révélé aux participants l'importance que
59 Hekebereya, "La coopération sectorielle en
Afrique Centrale...", pp.7-10.
78
représenterait la mise en place d'un projet
régional de la pêche continentale et d'aquaculture. C'est ce qui
justifie la tenue d'un atelier de lancement du projet "Promotion de la
pêche continentale et de l'aquaculture en zone CEMAC", du 18 au 20 Mai
2011 à Bangui, au siège de la CEMAC60. Plusieurs
femmes ont saisi cette opportunité pour contribuer à la
dynamisation de ce secteur en zone CEMAC. C'est ce qui explique la
présence de nombreuses femmes dans le personnel de la PPCA/CEMAC, tel
l'illustre ce tableau 6.
Tableau 6 : Personnel féminin au
PPCA/CEMAC en 2012
|
Noms et Prénoms
|
Fonctions
|
Pays
|
Année
|
|
Belcady Landou
|
Agent d'entretien
|
R. Congo
|
2012
|
|
Erna M. Ndengue Ikobo
|
Secrétaire/Comptable
|
R. Congo
|
2012
|
|
Espéranza Alono Akaba
|
Secrétaire/Comptable
|
Guinée Equatoriale
|
2012
|
|
Henriette O. Mbadinga
|
Chef d'Antenne
|
Gabon
|
2012
|
|
Hermine
Nzoïmbengene
|
Secrétaire/Comptable
|
RCA
|
2012
|
|
Huguette Biloho Essono
|
Assistant Technique Local (ALT)
|
Gabon
|
2012
|
|
Kouesse R. Karifene
|
Assistant Technique Local (ALT)
|
Tchad
|
2012
|
|
Margaret J. Rengouwa
|
Secrétaire/Comptable
|
Gabon
|
2012
|
|
Marie G. Etomo B.
|
Secrétaire/Comptable
|
Cameroun
|
2012
|
|
Nadège Mbonzi
|
Agent d'entretien
|
Gabon
|
2012
|
|
Sandrine N. Gossadina
|
Secrétaire de Direction
|
//////
|
2012
|
Source : CEBEVIRHA Info, N°003,
Juin 2012, pp.10-11.
Ce tableau est une liste exhaustive du personnel
féminin dirigeant de la PPCA/CEMAC en 2012.61 Ces femmes
représentent des Antennes de la PPCA/CEMAC dans les différents
pays de la Communauté. Il s'agit uniquement du personnel
féminin.
De nombreuses femmes pratiquent la pêche dans le cadre
de la sous-région. Elles sont regroupées pour certaines dans le
cadre du REFAC, ce qui leurs permet d'exposer ces produits aquacoles lors de la
foire transfrontalière qui a lieu tous les ans entre le mois de Juin et
celui de Juillet, (cf. photo 6). Mais aussi de vendre dans les marchés
frontaliers ou dans les Etats de la communauté.
60 CEBEVIRHA Info, n° 003, Juin 2012,
pp.1-2.
61 Ibid., p.10.
79
Photo 6 : Etang de Mitone à la Lambarene,
Antenne du PPCA/CEMAC au Gabon

Source : CEBEVIRHA, N° 003 Juin
2012, p.8.
Cette photo présente les différents étangs
de poissons de l'Antenne du PPCA/CEMAC au Gabon. Ceci est l'oeuvre conjointe
des hommes et des femmes dynamiques pour le projet sous régional
d'aquaculture62.
Photo 7 : Le poisson dans un Stand lors de la
Foire Transfrontalière de juin 2016.

Source :
https://journalintegration.com/fotrac-2018-place-a-linterregionalisme-bas/,
consulté le 19/04/2019 à 16h30min.
62 CEBEVIRHA Info, n° 003..., p.2.
80
En plus de ce type de poisson, bien d'autres sont
exposés pendant la foire communautaire, venant des différents
pays de la sous-région. Le commerce connait également un fort
déploiement des femmes. Par ailleurs, les pêches africaines d'une
façon générale emploient au total 19,2 millions de
personnes, dont 34 % de femmes63. 96% des emplois occupés par
les femmes concernent les activités post-récoltes, 3,1 % de
femmes sont employées comme pêcheurs et 0,7 % dans l'aquaculture.
La contribution totale de la pêche et de l'aquaculture au PIB agricole
est estimée à 9,2 % (26,6 milliards de dollars), une part
importante étant créée par les femmes.64
c. Le secteur commercial : une étude à
travers la foire transfrontalière
Le secteur commercial est également très
prisé par les femmes de la sous-région. Elles contribuent
énormément dans l'harmonisation du commerce de la CEMAC, non
seulement à travers la foire transfrontalière qui a lieu tous les
ans, mais aussi à travers des marchés frontaliers et
l'import-export.
Parlant des activités commerciales à travers la
foire, la 9ème édition de la foire
transfrontalière de la CEMAC s'est ouverte le 29 juin 2018 à
Kyé-Ossi. Elle avait fait cohabiter des exposants venus de 10 pays
appartenant aux communautés économiques régionales
d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Une interconnexion
socioéconomique qui a pour objectif de prôner le vivre ensemble
régional et interrégional. Venus nombreux, les participants ont
bravé le soleil pour commercialiser leurs produits de divers sorte,
comme le démontre cette image65, (cf. photo 8).
63 E. Kaunda, "Étude sur le potentiel de
l'aquaculture en Afrique", Mai 2015, p.42.
64 Ibid., p.42.
65
https://journalintegration.com/fotrac-2018-place-a-linterregionalisme-bas/
consulté le 19/04/2019 à 16h30min.
66 Z. R. Mbarga, "Intégration
Régionale, Fotrac 2018 : Place à l'interrégionalisme par
le bas", publié le 11/07/2018, in
https://journalintegration.com/fotrac-2018-place-a-linterregionalisme-bas/.Consulté
le 19/04/2019 à 16h30min.
81
Photo 8 : Les produits agricoles de la
Guinée Equatoriale exposés à la FOTRAC 2016.
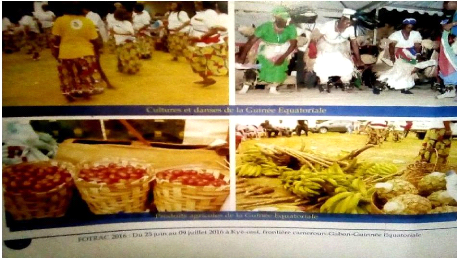
Source : FOTRAC, 7ème
édition, Kyé-Ossi, du 25 juin au 09 juillet 2016, p18.
Cette image présente les produits agricoles (tomates,
banane plantain, ananas, cannes à sucre, manioc, poisson, macabo,
igname, etc.), du thé des produits artisanaux des femmes
équato-guinéennes qui sont exposés lors de cette foire et
ont été exposés lors de la foire en 2016.
Il est clair que les femmes jouent un rôle important
dans la dynamique commerciale de la CEMAC, à travers cette foire qui
regroupe des femmes et des hommes des horizons divers. Cela permet
également de lever des voiles sur la libre circulation. Ce qui fait dire
à Benjamin Ambela, jeune entrepreneur présent à cette
foire "qu'il est difficile pour nous, jeunes leaders et entrepreneurs, de
tourner le dos à cette dynamique. Elle nous permet de comprendre les
subtilités de l'intégration. Simplement, on a l'impression de
lever les barrières et les obstacles à la libre
circulation"66. Tandis que la présidente fondatrice du REFAC
relève que : "avec le processus de rationalisation des
communautés économiques régionales de l'Afrique centrale,
nous avons bon espoir que la foire pourra déjà investir l'Afrique
centrale géographique". En effet, la Fotrac se veut être un
regroupement pour tous les peuples d'Afrique afin de contribuer à
l'échange continental. D'où Nlaté Danielle justifie :
82
Avec la zone de libre-échange continental (ZLEC), nous
pensons pouvoir accueillir d'autres frères et soeurs des régions
voisines, Pour ce faire, nous savons que nous pouvons toujours compter sur
votre mobilisation et votre soutien. La tâche est difficile. Nous trimons
au quotidien. Mais réussissons toujours à joindre les bouts les
plus essentiels.67
Les activités économiques ne sont pas seulement
l'apanage des hommes dans la sous-région. Car les analyses
précédentes expriment une contribution majeure de la femme dans
ce secteur. Cependant, qu'en est-il du domaine socioculturel ?
3. La femme dans le domaine socioculturel
Parlant du secteur socioculturel, il s'agit de mettre en
relief les domaines de l'éducation, de la santé, de
l'enseignement, de la recherche, de l'art artistique, du sport. Les femmes de
la CEMAC contribuent à plusieurs niveaux dans le domaine socioculturel,
à travers des événements culturels, à travers des
associations, au sein des institutions spécialisées et même
des organes centraux afin de dynamiser cette institution communautaire.
Le traité instituant la Communauté est le
premier texte juridique en matière sociale et culturelle. C'est une
véritable loi fondamentale applicable en vue de la réalisation
des politiques communes des six Etats membres notamment sur l'éducation,
l'enseignement, la formation professionnelle, le sport, la recherche, la
santé. Mais avant d'intégrer l'ordre juridique interne des Etats
membres de la CEMAC, ce droit est soumis aux actes conventionnels du droit
international, et doit suivre la procédure de ratification et de
réception dans ces Etats. Il est aussi composé d'articles aux
dispositions culturelles.
Par ailleurs, quatre institutions que sont l'Union Economique
de l'Afrique Centrale (UEAC), l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale
(UMAC), la Cour de Justice Communautaire (CJC), le Parlement Communautaire
(PC), font l'objet de conventions séparées 68 qui ont
été signées préalablement pour des actions
économiques conformément à l'orientation faite par les
objectifs et les missions stipulés par le traité de la CEMAC.
Cependant, la société est faite des lois et la culture est une
composante essentielle du développement, des politiques sectorielles
sociales et culturelles.69 Et le Parlement de la CEMAC a pour
rôle de légiférer par voie de directives même dans le
domaine social et culturel.
67 P. Ibrahim, in Afrique centrale,
Intégration, N°109, Interview réalisée
à Danielle Nlate, présidente fondatrice du REFAC.
68 68 CEMAC, Textes organiques..., p.29.
69 Ndong Owono Abang, entretien, in J.L. T. Mbassi
Ondigui, "Les relations culturelles entre Etats de la Communauté
Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale", Thèse
de doctorat/Ph.D en histoire, Université de Yaoundé I,
Décembre 2014, p.113.
83
Avant sa création, une commission interparlementaire
composée de cinq membres par Etat désignée par l'organe
législatif de chaque Etat membre était instituée. Son but
était de contribuer par le dialogue et le débat, aux efforts
d'intégration de ladite Communauté dans les domaines couverts par
le traité et les textes en vigueur, surtout ceux sportifs,
éducatifs et de formation70.
Dans le même ordre, la Cour de Justice Communautaire
(CJC) est une institution communautaire en charge du contrôle
juridictionnel des activités économiques et culturelles, mais
également de l'exécution budgétaire des institutions de la
CEMAC. Il en est de même pour l'UMAC dont le siège est à
Yaoundé. Elle est en charge de la politique monétaire, dont la
Banque des Etats de l'Afrique centrale constitue la pierre angulaire. Cette
institution rattachée de la CEMAC a également un volet social et
culturel. Aussi, l'UMAC participe avec l'Union économique à
l'exercice de la surveillance multilatérale par la coordination des
politiques économiques et la mise en cohérence des politiques
budgétaires nationales avec la politique monétaire commune,
bénéfique pour tous les secteurs d'activités même
ceux culturels71.
a. Dans la santé
Sur le plan sanitaire, la CEMAC a harmonisé la
politique sanitaire de la sous-région à travers la
création de l'OCEAC. Créée en 1963 à Yaoundé
par la volonté des Ministres de la Santé du Cameroun, du Congo,
du Gabon, de la RCA et du Tchad, l'institution portait le nom de l'Organisation
de Coordination et de Coopération pour la lutte contre les Grande
Endémies en Afrique Centrale (OCCCGEAC. Les buts de l'organisation
devenue OCEAC en 1965 sont entre autres : la coordination des politiques et
actions de santé, la formation du personnel de santé des Etats
membres, la recherche dans les domaines des sciences de la santé, la
contribution à la promotion de la santé et l'appui dans les
interventions d'urgences sanitaires. Ce qui explique la mise sur pied du Centre
Inter-Etats d'Enseignement Supérieur en Santé Publique d'Afrique
Centrale (CIESPAC)72.
Erigée depuis 2003 en une Institution
spécialisée de la CEMAC, l'OCEAC est devenue en 2006 un
véritable organe d'exécution de la Communauté pour les
questions de santé publique. Chaque Etat a mis à la disposition
de ses citoyens, des écoles de formation dans le domaine sanitaire. Ce
qui permet aux hommes et aux femmes de profiter de ces formations. Par
ailleurs, de nombreux étudiants de la sous-région profitent
réciproquement des formations
70 Ndong Owono Abang, entretien, p.15.
71 Mbassi Ondigui, "Les relations culturelles entre
Etats...", p.16.
72 Le Magazine, n° 003, Juillet 2013,
p.3.
84
sanitaires dans les différents Etats membres de la
CEMAC, ce qui leurs permet d'avoir les aptitudes nécessaires pour
répondre à des impératifs sanitaires dans la
sous-région. Elles contribuent à la stabilité sanitaire de
la sous-région par leur déploiement tant à partir de
l'OCEAC que dans le cadre des centres médicaux nationaux.
Pour ce qui est du cadre communautaire, de nombreuses femmes
sont recrutées pour contribuer à la santé humaine, animale
et végétale de la sous-région. Marlyse Peyou Ndi de
nationalité camerounaise, fait partir des experts du Réseau de
surveillance et de suivi de la résistance du VIH aux ARV en Afrique
Centrale73. Elle contribue aussi bien que des hommes dans de
nombreuses recherches concernant la prévalence ou l'atténuation
de la contamination du VIH-SIDA en Afrique centrale zone CEMAC.
Dans le cadre de l'harmonisation des politiques
pharmaceutiques dans la sous-région, de nombreuses femmes font parties
de l'équipe dirigeante. C'est le cas d'Emilienne Yissibi Pola, Expert
consultant de l'OCEAC. Elle a été primée par la
Communauté pour ses actions menées dans la bonne Coordination du
processus d'harmonisation des politiques pharmaceutiques nationales des pays de
la CEMAC. Nommée en 2007 à la coordination du programme
d'harmonisation des politiques pharmaceutiques nationales des pays de la CEMAC
mise en place à l'OCEAC, elle a conduit avec l'équipe du
Département des Programmes et Recherches, le processus d'harmonisation
avec les experts des pays membres, en collaboration avec les partenaires
concernés par les questions de la pharmacie et du médicament dans
la sous-région Afrique centrale. Ce processus a abouti au
développement d'une politique pharmaceutique commune et des documents
connexes, qui ont été validés par les Ministres de la
santé de la CEMAC. Ce sont tous ces efforts déployés pour
le succès de ce travail qui lui ont permis d'acquérir le prix de
la pharmacie francophone, remis à Genève en Suisse le 20 mai 2013
lors de la rencontre Leem/pays francophones74. Dans le cadre de ces
politiques pharmaceutiques harmonisées, de nombreuses conférences
sont ténues, auxquelles des femmes font preuves de leur
rhétorique en matière de dialogue communautaire pour des
meilleures modalités dans le domaine. Par ailleurs, les femmes ne sont
pas en reste dans le Projet de Prévention du VIH/SIDA en Afrique
centrale lancé par la sous-région CEMAC. Il en est de même
du domaine de l'éducation.
73 Le Magazine de l'OCEAC, n° 001,
Novembre 2007, p.29.
74 Le Magazine, n° 003..., p.29.
75 CEMAC, Répertoire des
établissements d'enseignement supérieur des pays membres de la
CEMAC, des centres et unités de recherche
rattachés, Yaoundé, Ed. Saagraph, Janvier 2006, p.3.
85
b. La femme dans l'éducation, l'enseignement et
la formation
Concernant l'enseignement, la recherche, et la formation
professionnelle, plusieurs écoles ont été ouvertes pour
permettre aux étudiants de la sous-région de
bénéficier de l'enseignement, de l'éducation, de la
recherche et des formations professionnelles désirées pour mieux
répondre aux défis de la sous-région en matière de
développement et d'intégration. A cet effet, des filles et des
hommes de la CEMAC sont inscrits dans ces écoles et reçoivent les
mêmes enseignements sans distinction. Et ces enseignements sont
dispensés aussi par des hommes que des femmes compétentes, dont
le recrutement ne tient compte des critères autres que ceux des
qualités et aptitudes professionnelles. C'est le cas de l'Ecole
d'Hôtellerie et de Tourisme, de l'Institut de l'Economie et des
Finances-Pôle Régional, de l'Institut d'Economie et de
Statistiques Appliquées, de l'Institut Sous Régional
Multisectoriel de Technologie Appliquée, ou de l'Ecole Inter-Etats des
Douanes, du Pôle Régional de Recherche Appliquée au
développement des Savanes d'Afrique Centrale, etc. Ce sont des
écoles sous régionales qui sont mises sur pied par un consensus
des Etats de la CEMAC pour former des ingénieurs, des cadres
administratifs et bien d'autres75, (cf. tableau 7).
Tableau 7 : Liste des étudiants filles
inscrits dans la filière TSS1 pour l'année académique
2007-2008 à l'ISSEA.
|
Noms et Prénoms
|
Pays
|
|
Carine Sandra Sita Banzouzi
|
R. Congo
|
|
Léontine Bernadette Kameni Poungom
|
Cameroun
|
|
Letycia Roku Gaetjens
|
Guinée Equatoriale
|
|
Prudence Mabou Mbongtot
|
Cameroun
|
|
Syntyche Grâce Olgis Zialot-Yagouelet
|
Centrafrique
|
Source : www.issea-cemac.orgindex.php,
consulté le 25/04/2019 à 15h30min.
Ce tableau représente l'effectif des filles ayant
obtenues le concours de l'ISSEA dans la filière des Techniciens
Supérieurs de la Statistique (TSS) niveau 1, pour le compte de
l'année académique 2007-2008. Il s'agit d'un effectif de 5 filles
sur 42 garçons ayant obtenus ce concours. Bien que l'effectif entre les
filles et les garçons soit inégal, les filles ne sont pas en
reste pour l'admission dans cette prestigieuse école sous
régionale qui offre de nombreuses
86
formations dans plusieurs filières. Il faut
également noter qu'il existe d'autres filières dans lesquelles
elles sont intégrées76.
Cette école regroupe aussi parfois des étudiants
ressortissants des autres pays ou sous-régions. C'est ce qui explique
qu'en 2019 en 3e année JAS, dans une classe de 34
étudiants, il y a des togolais77, des ressortissants de la
RDC qui suivent les cours dans cette école pour les uns dans le but de
maîtriser les études sur les statistiques et relever l'appareil
statistique de leur pays qui n'a pas été actualisé il y'a
pratiquement 30 ans78. Et pour d'autres, il s'agit de
bénéficier des hautes études en matière de
statistiques79. Ce qui montre que de plus en plus, les filles
s'intéressent aux affaires de la sous-région. Leur scolarisation
connait des avancées notoires dans les différents pays de la
CEMAC. Même si le Staff Administratif en lui, n'est composé que
des femmes secrétaires dans cette école80.
Cette école regroupe également le personnel
féminin enseignant tant régulier que vacataire, même s'il
est minoritaire, (cf. tableau 8).
Tableau 8 : Le Personnel enseignant
féminin de l'ISSEA de toutes les filières confondues en 2017.
|
Noms et Prénoms
|
Matière dispensée
|
Vacataire/Permanente
|
Pays
|
|
Christine Djockoua
|
Anglais
|
Vacataire
|
|
|
Colette Florence Mebada
|
Marketing
|
Vacataire
|
//////
|
|
Djiadeu née Njionwo
|
Anglais
|
Vacataire
|
//////
|
|
Edith Strafort Pedie
|
Analyse des données multidimensionnelles
|
Vacataire
|
//////
|
|
Elise Ndjiogoua
|
Anglais
|
Vacataire
|
//////
|
|
Emerentia Kongla Nkong
|
Anglais
|
Vacataire
|
//////
|
|
Suzanne Biwole
|
Français
|
Vacataire
|
//////
|
|
Yvonne Nane
|
Education physique
|
Permanente
|
Cameroun
|
|
Zang née Manjia M.
|
Mathématiques (Algèbre)
|
Vacataire
|
Cameroun
|
Source :
www.issea-cemac.org/index.php,
consulté le 25/04/2019 à 15h30min.
76
www.issea-cemac.org/index.php,
consulté le 25/04/2019.
77 Alexise Sabrina Mebe Asoui, 24 ans,
étudiante camerounaise à l'ISSEA, entretien réalisé
le 10/05/2018. 78Berry Swana, 24 ans, étudiant ressortissant
de la RDC en 3eme année IAS à l'ISSEA, entretien
réalisé le Mercredi 14/02/2018.
79 Emile Simpa, 22 ans, étudiant togolais en
3eme année TSS à l'ISSEA, entretien
réalisé le Mercredi 14/02/2018.
80 Rondo Lemercier, 24 ans, Etudiant centrafricain
à l'ISSEA en 4eme année JAS, entretien
réalisé à l'JSSEA, le 14/02/2018.
87
Les femmes jouent un rôle déterminant dans
l'éducation dans cette sous-région, à travers des
disciplines multiples qu'elles dispensent aux différents
étudiants. En ce qui concerne les enseignants vacataires, ils sont au
nombre de quatre-vingt-trois (83) dont soixante-quinze (75) hommes au
détriment de 8 femmes dont l'expérience avérée les
a conduits dans cette haute structure d'enseignement sous régionale.
Alors que le corps des enseignants permanents renferme treize (13) hommes et
une (1) femme qui contribuent à la formation physique et intellectuelle
des étudiants de la CEMAC et de d'autres pays de l'Afrique.
En outre, l'EIED contribue également à la
formation des contrôleurs et les préposés de douanes des
Etats membres. De même, cette école reçoit à chacun
de ses cycles de formation, des stagiaires recrutés compte tenu des
besoins exprimés par chaque Etat et des capacités d'accueil de
l'établissement81. Cependant, l'admission à cette
école est subordonnée à un concours organisé et
corrigé par sa direction. Cela permet de choisir les meilleurs. Pour
permettre de programmer ses enseignements, chaque Etat fait connaître ses
besoins en formation pour l'année à venir au cours du Conseil
d'administration au mois de Décembre. Même si tous les besoins en
formation des Etats ne sont pas toujours palliés82.
Aussi, l'Institut Sous Régional Multisectoriel de
Technologie Appliquée, de Planification et d'Evaluation de Projets
(ISTA) dont le siège est à Brazzaville, a été
créé du fait que les pays africains notamment ceux de la
sous-région CEMAC, souffraient de l'insuffisance des cadres
possédant des compétences nécessaires à
l'identification, la conception, l'exécution et l'évaluation des
projets de développement. Cette école est chargée entre
autres de la formation universitaire sanctionnée par un diplôme de
haut niveau, le Master en analyse et évaluation de projets, ainsi que du
perfectionnement des cadres à des outils et techniques de conception,
à la réalisation et le suivi-évaluation des projets de
développement. Sans oublier la réalisation des études de
projets de développement et la promotion des opérations
industrielles, par des actions diverses portant sur l'identification des
partenaires techniques et financiers. Pour ce faire, cet Institut est
doté d'un Centre de formation et d'un bureau d'études. De
nombreuses femmes suivent également des formations à son sein,
pour mieux répondre aux défis de leurs pays et de la
sous-région83. Il en est de même pour les autres
écoles qui jouent un rôle important en matière
d'enseignement, d'éducation et de formation dans la sous-région
et en Afrique en générale.
81CEMAC, Répertoire des
établissements d'enseignement supérieur des pays membres de la
CEMAC, p.3.
82 Bulletin officiel CEMAC n°1,
République du Cameroun, République Centrafricaine,
République du Congo, République du Gabon, République de
Guinée équatoriale, République du Tchad, 2004, p.3.
83 J. L. T. Mbassi Ondigui, "Les relations culturelles
entre Etats ..." pp.129-130.
88
Dans le but de faciliter la coopération universitaire,
il a été initié la Conférence des Recteurs des
Universités et des Responsables des Organisations de Recherche en
Afrique Centrale (CRUROR/AC). Cette instance permet d'harmoniser la recherche
dans cet espace géographique, en étroite collaboration avec les
politiques nationales en matière d'enseignement universitaire. C'est ce
qui explique la tenue du 20 au 23 Novembre 2007 de la 3emeSession
ordinaire du CRUROR/AC à Ndjamena. Rencontre au cours de laquelle, de
nombreuses femmes de différentes universités d'Afrique centrale
ont pris part, parmi lesquelles Balla Marthe Solange le Chef Service Accueil
Protocole et Relations Publiques à l'Université de Yaoundé
II au Cameroun, Ntone Kouo Hélène le Chef de Division de
l'Enseignement et des personnels enseignants à l'Université de
Douala, Sapou née Lady Bawa le Directeur du Centre des OEuvres
Universitaire de l'Université de Ngaoundéré. Par ailleurs,
la tchadienne Sylvie Lewickidhinaut, Directrice Régional pour l'Afrique
du Centre International de Recherche en Agriculture et pour le
Développement a participé aux côté de ses homologues
camerounaises à cette rencontre84. Jacqueline Moto-Ossou,
Conseiller auprès du Recteur de l'Université Omar Bongo, membre
de la cellule Technique Licence Master de la CEMAC, par ailleurs
Secrétaire de l'Association CEMAC des OEuvres Universitaires y
était présente.
En outre, la même conférence fut organisée
du 20 au 21 Décembre 2006. Albertoul Zakaria, Ministre
Délégué chargée de l'Alphabétisation
auprès du Ministre Tchadien de l'Education Nationale avait
présidé ladite conférence. Cette dernière
représentait le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle dudit pays. Il est
d'acte que les femmes ne sont pas en reste dans l'enseignement supérieur
car elles exercent les mêmes tâches que les hommes85. Le
domaine du sport n'est point exempt.
c. Dans le cadre du sport
Concernant le domaine sportif, la législation de la
CEMAC en matière de pratique du sport est en adéquation avec les
politiques nationales. La coupe de football CEMAC est une compétition de
football qui se joue depuis l'UDEAC en 1984 pour les hommes. Elle regroupe les
pays de l'Afrique centrale (le Cameroun, le Gabon, la Guinée
Equatoriale, la RCA, la R. Congo et le Tchad). La CEMAC remplace l'UDEAC en
1999, c'est ainsi que le règlement n° 08/99/UEAC-007-CM-02 du 18
août 1999 institutionnalise la coupe de football
CEMAC86.
84 Liste des Participants à la
3eme Session ordinaire de la CRUROR/AC, Ndjamena (CEBEVIRHA),
du 19 au 21 décembre 2007, pp.1-7.
85 Compte-Rendu des travaux de la 3eme Session
ordinaire de la CRUROR/AC, Yaoundé le 20 novembre, 2007, 1p.
86Bulletin officiel CEMAC n° 1...,
p.36.
89
Les articles 8 et 9 du règlement intérieur
avaient trait à la nomination des représentants du
secrétaire exécutif de la CEMAC, au comité d'organisation
et à la commission technique de celle-ci.87 Il était
aussi nécessaire de compléter ce règlement par la
décision n° 046/SE/DECAS. D'où l'article 2 disposait que les
représentants constituaient le groupe de travail interne du
Secrétariat exécutif de la CEMAC sur la coupe qui sera
élargie en cas de besoin. Cela traduisait la présence de ces
représentants lors de ladite coupe, au moment des rencontres des
équipes nationales des Etats membres de la CEMAC. Mais aussi, la
présence au sein du Secrétariat exécutif de la CEMAC,
d'une structure chargée de la promotion du sport car, la culture est le
catalyseur du développement politique et socio-économique. Cette
coupe de football CEMAC88 étant déjà une
réalité, se situe dans le cadre de la redynamisation des
relations culturelles entre Etats et répond du souci de
fraternité, de distraction et d'éducation à la paix entre
les peuples et les Etats.
Cependant, plusieurs coupes masculines de la CEMAC ont
déjà eu lieu à l'instar de celles de 2002 et de
décembre 2003 du Stade Massemba-Débat de
Brazzaville89. Mais la 5ème édition de 2008 se jouait
sous une grande ambiance. Le Cameroun, le Congo et la Centrafrique, les trois
premières équipes du classement, étaient acclamées
par les Chefs d'Etats.90 On assista donc ici au respect total par
les Etats des stipulations des règlements et la décision en
favorisant la tenue de cette coupe de football, qui engendra aussi le brassage
des populations, défiant les égoïsmes nationaux. Ceci
relève de la volonté des Etats membres de faire du sport un
véritable levier de développement et principalement
d'intégration dans la CEMAC car, le sport est un événement
qui rassemble davantage les peuples. C'est pour cette raison que les femmes de
cette Communauté ont aussi choisi le sport comme moyen d'action pour
sensibiliser un maximum des habitants de la sous-région sur la
nécessité du savoir vivre, pour un développement
harmonieux et pour l'intégration dans cette sous-région.
A côté de l'équipe masculine de football,
l'on note une section féminine de la coupe de football CEMAC. La
première édition de la Coupe de football CEMAC dames a eu lieu
à Ndjamena fin mars 2014, (cf. photo 9).
87 Bulletin officiel CEMAC n° 1...,
p.36..
88Cameroon Tribune, quotidien bilingue
n° 9126/5325, 34 e année, mercredi 25 Juin 2008, p.9.
89Echos d'Aujourd'hui n°15, p.14.
90 On comptait au total cinq chefs d'Etats, deux
premiers ministres. Cf. Cameroon Tribune, n° 9126/5325, p.9.
90
Photo 9 : Equipe de football féminine
tchadienne de la coupe CEMAC

Source :
https://www.google.com/amp/s/amp.rfi.fr/afrique/foot/20141215-le-tchad-rempor,
consulté le
24/04/2019 à 15h30min
En poste en maillots de la Coupe CEMAC, ces filles
représentent l'équipe tchadienne convoquée par leur
sélectionneur Zam Gagsou Barkos, en plein entrainement au stade de
Paris-Congo. Mais il faut noter que la Coupe de football féminin de la
CEMAC est récente, raison pour laquelle, un grand nombre d'informations
n'est pas disponible. Toutefois, il existe des coupes nationales jouées
par des femmes. Cependant, notre étude est basée sur
l'institution CEMAC et non sur la zone CEMAC.
d. Le domaine de l'art
Le domaine artistique n'est pas en reste, il est
également très envahi par la gente féminine. La conception
des bijoux fait partie de nombreux objets artisanaux fabriqués par les
femmes de la sous-région et vendus dans le cadre des marchés
nationaux ou communautaires. Ces bijoux viennent renforcer le commerce des
femmes avec d'autres produits relevant des activités agricoles,
pastorales et aquacoles. C'est ce qu'illustre l'image suivante91,
(cf. photo 10).
91 Cameroon Tribune, quotidien bilingue
n° 9126/5325, 34 e année, Mercredi 25 Juin 2008, p.9.
92 Rapport FOTRAC,
5ème édition, du 10 au 23 Juin 2014, p.12
91
Photo 10 : Les produits artisanaux
féminins à la FOTRAC 2016.

Source : Rapport FOTRAC,
5ème édition, du 10 au 23 Juin 2014, p.12.
On remarque la représentation des produits artisanaux
de la sous-région dans cette photo, relevant de l'expertise
féminine et masculine. Ces produits sont originaires de la
République du Congo. En plus de ceci, les produits cométiques
originaires de la Guinée Equatoriale sont également
présentés au cours de cette foire de 2014, (cf. photo 11).
Photo 11 : L'entrepreneuriat cosmétique
équatoguinéen féminin à l'honneur à la foire
de 2014.
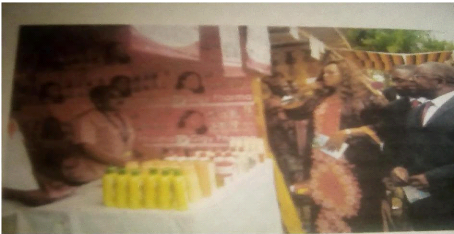
Source : Rapport FOTRAC,
5ème édition, du 10 au 23 Juin 2014, p.12.
92
Cette image ressort les produits cométiques
équatoguinéens. Placé au-devant du stand, la
présidente fondatrice du REFAC, promotrice de la FOTRAC et de la gauche
vers la droite, le Ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga
Atangana dont les produits font l'objet de la
présentation93.
Il a en est de même dans le domaine de la mode où
les femmes émerveillent le monde de la beauté sous
régionale à travers les miss qui font l'objet d'un
défilé de mode à chaque foire, (cf. photo 12).
Photo 12 : Les miss présentées au
stade d'Ebébiyin lors de la foire transfrontalière de 2016.

Source : FOTRAC, 7ème
édition, du 25 juin au 09 juillet 2016, p.23.
Cette photo présente la Miss et les deux Dauphines de
la FOTRAC 2016. A l'extrême droite se trouve la présidente du
REFAC, promotrice de la foire94. Tout ceci montre que les femmes
jouent un rôle important dans la CEMAC. Toutefois, les femmes de la CEMAC
utilisent de nombreux moyens pour agir dans cette institution.
C. LES MOYENS D'ACTION DE LA FEMME DANS LA
CEMAC
En dehors des postes occupés par les femmes au sein des
organes de la CEMAC, ou des Institutions auxquelles les femmes font preuve de
leur grande expérience, elles utilisent aussi de nombreux autres moyens
pour atteindre leurs objectifs au sein de la CEMAC.
93 Rapport FOTRAC, 5ème
édition..., p.12.
94 FOTRAC, 7ème édition, du 25
juin au 09 juillet 2016, p.23.
93
1. Les groupes d'association : le REFAC et la Synergie
Jeune-CEMAC
Les groupes d'association sont les premiers moyens par
lesquels les femmes de la sous-région agissent. C'est l'ensemble des
organes associatifs créés par les femmes de la sous-région
pour agir dans le cadre de la dynamique diplomatique consentie par les Etats
membres de la CEMAC, afin de contribuer à la dynamisation de cette
organisation, que ce soit dans le cadre d'une intégration par le bas que
par le haut. Sont étudiées ici, les associations telles le REFAC,
la SJ-CEMAC.95
a. Le REFAC comme moyen d'action des femmes de la
CEMAC
Le Réseau des Femmes Actives de la CEMAC (REFAC) est
fondé en 2007 à Douala au Cameroun par Danielle Nlaté et
légalisé en Janvier 2008. Cette association regroupe des
individus, des groupes d'initiatives communes (GIC), des associations et
d'autres groupes d'Afrique centrale, sans distinction d'âge, de race, de
sexe ou de religion. C'est une Organisation non-gouvernementale à but
non lucratif et apolitique. Son but premier est de fraterniser par des
échanges économiques et socioculturels. C'est dans l'atteinte de
l'idéal de la sous-région et pour pallier dans un domaine que les
hommes n'ont pu faire montre de leur intelligence que les femmes de cette
sous-région ont mis sur pied cette association et dont l'atteinte des
objets susmentionnés du REFAC sont d'un avantage pour tous notamment
dans la CEMAC. Cette Association connait un fort déploiement des femmes
de la sous-région. Le REFAC organise aussi de nombreuses rencontres,
surtout culturelles dans cet espace communautaire, aux fins d'unir les
populations de la sous-région en particulier, mais de l'Afrique en
générale et participer à la promotion de la paix. C'est ce
qui ressort de la FOTRAC organisée en 2018 qui a connu la participation
du Sénégal, du Burkina Faso96.
b. La SJ/CEMAC
En plus du REFAC, la Synergie Jeune de la CEMAC (SJ/CEMAC) qui
est une initiative conjointe est également un moyen par lequel les
femmes de la CEMAC s'expriment. La direction de l'organe est sous la tutelle
féminine avec Ruth Kamga comme "Représentante et Ambassadrice" de
la structure des jeunes femmes de la CEMAC97 et Nina Baho comme
Déléguée générale à
l'Intégration/SJ-CEMAC, nommée le 04 février
201298. Créée suite à la conférence des
Chefs d'Etats de la CEMAC tenue à Yaoundé le 24 et 25 Juin 2008
sous la
95 Le Relais de l'négation, n°
0006, Juin 2012, p.4.
96 FOTRAC, 9ème
édition, du 25 juin au 09 juillet 2018, p.23.
97 Ibid.
98 Ibid., p.7.
94
Présidence de Paul Biya président en exercice,
la SJ-CEMAC voit officiellement le jour le 18 Septembre 2008 en tant que
structure sous régionale favorisant le brassage des cultures entre les
jeunes de la Communauté. Son but principal étant notamment de
commémorer la journée du 16 Mars 1994 avec la CEMAC.
La Synergie Jeune constitue un moyen d'expression des femmes,
comme en témoigne la photo ci-dessous, (cf. photo 13).
Photo 13 : Les jeunes dans le processus
d'intégration sous régionale.

Source : Relais Intégration,
n° 0006, Juin 2012, p.8.
Cette image présente les jeunes participants à
la 4ème édition de la "Journée CEMAC"
ténue le 16 Mars 2012, à la Représentation de la CEMAC au
Cameroun. Cette image relève une forte dominance de la gente
féminine lors de cette journée commémorative du 16 Mars
1994, gage d'une forte implication des femmes dans la dynamique diplomatique
communautaire. C'est une Institution de la CEMAC en charge des questions
relatives à la jeunesse sous régionale99. Lors de
cette quatrième édition, elle a connu la participation de la
Représentante de la CEMAC au Cameroun, Malaïka Ndoumbe Ngollo. Elle
y a fait un discours en présence du Commissaire de la CEMAC Hassan Adoum
Bakhit, (cf. photo 14).
99Le Relais Intégration,
n° 0006..., p.5.
95
Photo 14 : Le discours de la Représente
de la CEMAC au Cameroun lors de la 4ème édition de la
journée CEMAC.
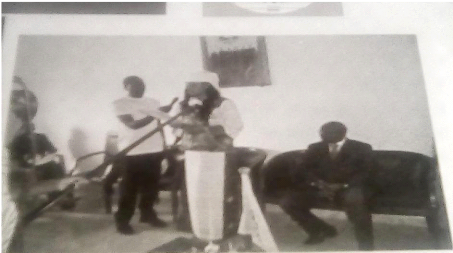
Source : Relais Intégration,
n° 0006, Juin 2012, p.6.
En plus de ces deux Associations reconnues par la CEMAC, les
femmes de la sous-région agissent aussi à travers le
Réseau des femmes Parlementaires d'Afrique Centrale. C'est une
association qui regroupe des femmes députés et sénateurs
de la zone CEMAC qui travaillent en synergie dans le but de dynamiser la femme
parlementaire de cet espace géographique. Ce qui explique la
ténue du 05 au 06 Mars 2015 à Libreville, de la
18ème Conférence annuelle des femmes parlementaires de
l'Afrique Centrale portant sur le thème : "les femmes parlementaires
face au défi des mariages et grossesses précoces". Les
différentes conférences ténues dans ce cadre
résultent dans l'intérêt de la nécessité
d'une action parlementaire globale100.
Outre ces associations à travers lesquelles les femmes
militent activement, leur rôle est perceptible à travers
également des événements culturels et sportifs.
2. Des événements culturels et sportifs
: la coupe de football CEMAC, la Coupe d'Afrique des Nations de football et les
foires communautaires
Dans cette partie, il s'agit de présenter les
événements sportifs et les foires communautaires comme les moyens
utilisés par les femmes dans la CEMAC pour s'exprimer car ce sont des
grands moments d'attraction.
100Régionale la Découverte,
Juillet/Août, 2015, p.26.
96
a. La coupe de football CEMAC et la Coupe des Nations
de Football
Les événements sportifs font partir des moyens
d'action des femmes de la CEMAC pour toucher une grande partie de la population
sur les questions qui concernent la sous-région. Etant donné que
ce sont des moments de grands rassemblements, il s'agit des opportunités
pour sensibiliser au maximum la population sur la nécessité de
participer et contribuer activement au processus d'intégration non
seulement économique, politique et sociale de la CEMAC.
Parlant de la Coupe de football CEMAC101, elle se
situe dans le cadre des relations culturelles entre six Etats de la CEMAC et
répond du souci de fraternité, de distraction, mais surtout de
l'éducation à la paix entre les peuples et les Etats de cette
sous-région. Ce qui se traduit par l'élaboration du
règlement n°08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999, portant
institutionnalisation d'une "Coupe de football CEMAC" et la décision
n° 046/SE/DECAS portant nomination des représentants du
Secrétaire exécutif de la CEMAC au comité d'organisation
et à la commission technique de cette coupe. On note plusieurs
éditions, comme celles masculines de 2002 et de décembre 2003 qui
avaient eu lieu au stade Massemba-Débat de
Brazzaville102. Aussi, la 5ème édition de
2008 se disputait sous une ambiance de fête. Les trois premières
équipes (le Cameroun, le Congo et la Centrafrique) étaient
chaleureusement félicitées par les Chefs d'Etats103.
Cela montre le travail du personnel en service à la CEMAC, pour
atteindre les objectifs assignés.
En plus de la coupe de football masculine de la CEMAC, la
coupe CEMAC des femmes connait généralement un fort
déploiement de la gente féminine, qui veut maximiser les chances
de sensibiliser les ressortissants de tous les pays d'Afrique centrale sans
distinction de sexe ni d'origine. C'est ce qui ressort de ce fort
déploiement des femmes du REFAC qui sont des habituées de tels
événements, pour espérer de toucher le public cible, lors
de la première coupe CEMAC tenue en décembre 2014 au Tchad. Ces
femmes de la CEMAC se déploient également dans les
compétitions continentales.
A côté des coupes CEMAC qui connaissent une
attention particulière des femmes, les femmes de la sous-région
agissent également à travers les coupes d'Afrique des Nations de
football. C'est ce qui ressort de plusieurs coupes auxquelles elles ont
assisté. Notamment : la Coupe d'Afrique des Nations de football de 2017
qui s'est déroulée au Gabon. Les femmes ont pris part à
cet événement dans le cadre du REFAC. Elles ont pris part
à cette coupe malgré quelques désagréments qui ont
empêché certaines femmes de ne pas y prendre part. Ces
101 Cameroon Tribune, quotidien bilingue n°
9126/5325..., p.9.
102 Echos d'Aujourd'hui n°15, CEMAC, Trimestriel,
Edition CEMAC, Juillet 2005, p.14.
103 On comptait au total cinq chefs d'Etats, deux premiers
ministres. Cf. Cameroon Tribune, n° 9126/5325, p.9.
97
désagréments étaient dus aux lenteurs
administratives, ce qui a valu à la présidente fondatrice de
"batailler", d'effectuer toutes les manoeuvres possibles pour permettre au
REFAC d'y assister à cette rencontre continentale qui se tient tous les
deux ans104.
Au cours de cette CAN, le REFAC a eu un agenda chargé.
Les objectifs étaient kyrielles et la quintessence renvoyait à
:
- La mobilisation et la sensibilisation au plus haut point et
au plus haut niveau, des autorités administratives et des populations
gabonaises et autres, sur le bienfondé de s'ouvrir définitivement
aux autres pays de la communauté pour faire face à la
mondialisation précédente et surtout une invite à
l'adhésion au projet FOTRAC, plateforme d'échanges et de
promotion socioéconomique et culturelle.
- la nécessité de promouvoir les valeurs
d'intégration sous régionales, la lutte contre la
pauvreté, la sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux
hommes, les droits et le développement humain à travers
l'agriculture, l'échange, l'éducation, la santé.
- affronter les réalités sur le terrain et
sensibiliser les citoyens de la communauté sur les idéaux des
pairs fondateurs et la nécessité des pays de briser les
barrières et d'être solidaires pour un développement
harmonieux et rendre aussi concrète l'Unité
africaine105.
A l'issue de cette sensibilisation, de nombreuses femmes et
hommes ont adhéré à ladite association, car ils ont
trouvé son bien-fondé pour la sous-région. Il en est de
mêmes des activités artistiques et culturelles.
b. Les activités culturelles, artistiques et le
dynamisme des femmes dans la CEMAC
Les activités culturelles font aussi partir des moyens
d'action des femmes de la CEMAC. Étant des situations de grands
accolements, ce sont des circonstances pour relayer aux hommes et aux femmes
l'importance d'une intégration réussie dans la
sous-région. Les activités culturelles sont notamment
étudiées ici dans le cadre de la Foire transfrontalière
annuelle de la CEMAC qui est créée en 2010 par Jeanne Danielle
Nlate et sur la Foire Touristique, Artisanale, Culturelle de la CEMAC
(FOTAC). La Fotrac est une Foire
104 Hebdo Intégration, La tribune des
communautés n° 260, 30 janvier 2017, p.9.
105 Ibid., p.7.
98
multisectorielle qui regroupe les acteurs de
développement de tous les pays d'Afrique centrale et d'ailleurs, les
administrations, les Chambres consulaires, les Organisations internationales,
les Chancelleries, les Instituts de Recherches, les Opérateurs
économiques. Aussi, un espace d'échanges, de partage
d'expériences surtout dirigé en faveur des femmes dans le cadre
de l'amélioration de leurs conditions de vie en milieu urbain et rural,
pour une meilleure implication de celles-ci dans le développement de la
sous-région.
La première foire CEMAC était à
Libreville en 2010. Elle avait été inaugurée par le
Ministre d'Etat gabonais à l'économie et aux finances,
avec certains responsables du Secrétariat Exécutif de la CEMAC.
Pendant quelques jours, une soixantaine de structures exposaient leurs
potentialités dans les secteurs aussi variés que l'artisanat, le
commerce, l'industrie, les services, l'agriculture. Cette foire CEMAC
répond du souci de promouvoir les affaires entre Etats membres de la
CEMAC, du voeu d'intégration sous régionale notamment
économique, tout en reflétant les idéaux
Communautaires106. Moment de rencontre, la foire est aussi une
occasion de soutenir les opérateurs privés notamment ceux du
domaine culturel, qui en tant que locomotive de toute économie,
contribue pour les Etats membres de la CEMAC à la lutte contre la
pauvreté par la création des richesses et les emplois. Bien que
cette première édition a connu quelques difficultés, elle
sera suivie par d'autres mieux planifiées, avec la participation
effective et importante des opérateurs économiques comme ceux du
secteur culturel. Aussi, cette foire CEMAC de Libreville avait malgré
quelques problèmes, eu le mérite d'être organisée
pour matérialiser l'initiative107.
En outre, une autre foire CEMAC avait eu lieu à
Mvangane le 26 mars 2011, à l'initiative du
réseau des femmes de la CEMAC, appuyée par la Commission de la
CEMAC. Les femmes du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon, de la
Guinée Equatoriale et du Tchad, faisaient valoir leur savoir-faire
pratique, en exposant aussi bien au public de la sous-région que
d'ailleurs, les produits de l'artisanat. C'était leur niveau
d'inventivité et de créativité qui était mis en
relief à des fins utilitaires. Les enjeux sont multiples mais, cela
participe également à des échanges culturels
partagés par les textes de la CEMAC. Ceci montre que la
sous-région constitue une diversité culturelle. Cette foire
permet également de se faire entendre, malgré la communication
limitée des décideurs de la CEMAC. Même comme un certain
éclectisme institutionnel a souvent mis la culture à une portion
congrue.
106 Echos d'Aujourd'hui n°16, CEMAC, trimestriel,
Edition CEMAC, Août 2006, p.19.
107 Ibid., p.7.
99
Cet événement culturel, avec des tendances
économiques et politiques se tient chaque mois de Juin voire de Juillet
de l'année, depuis sa création. Elle ne cesse de regrouper une
multitude de personnes venant non seulement de l'Afrique centrale, mais aussi
de d'autres sous-régions dont l'importance de rassemblement constitue un
intérêt particulier. C'est ce qui ressort de la participation
d'une dizaine de pays lors de la Foire de 2018 où dix (10) pays ont pris
part à cette dernière, au rang desquels certains pays de
l'Afrique de l'Ouest.
Conscient que la zone CEMAC est l'espace sous régional
le moins avancé dans le processus d'intégration et dans le but de
raffermir les solidarités et promouvoir le dynamisme au sein de la gente
féminine de la CEMAC, la foire touristique, artisanale,
culturelle de la CEMAC (FOTAC-CEMAC) est créée en 2013. C'est une
plateforme au même titre que la Fotrac. Alors que la foire est à
sa 7eme édition nationale, elle représente la
première édition d'envergure sous régionale. Elle s'est
ouverte le 04 mars 2019 à Yaoundé sur le thème "Promotion
de l'entreprenariat et du dynamisme féminin pour l'émergence de
la zone CEMAC".108
Il s'agit d'offrir aux femmes un espace idoine pour s'affirmer
et promouvoir leur condition à l'émergence de la
sous-région CEMAC. Cette mobilisation citoyenne autour de nombreuses
activités touristiques, artistiques, artisanales et culturelles ont
retenu l'attention du MINREX et celui du Ministère du Tourisme et des
Loisirs (MINTOUL). Ceux-ci, séance tenante, ont adopté le concept
et ont promis un soutien indéfectible : "Nous sommes
particulièrement intéresser à tout ce qui concerne
l'intégration sous régionale. Nous bénéficions
d'une certaine expérience et une parfaite connaissance de la
région. Donc, n'hésitez pas à prendre attache avec le
MINREX", déclare le représentant du MINREX à
l'équipe organisatrice. C'est donc des partenaires institutionnels de
poids que la foire touristique, artisanale et culturelle de la CEMAC se fait.
En présence des représentants du corps diplomatique, notamment le
représentant de la République démocratique du Congo Khou
Stanislas, le Conseiller de l'ambassadeur du Congo. Il est clair que le
dynamisme des femmes est indéniable109
Les femmes occupent de nombreux postes de
responsabilités au sein de la CEMAC. Elles occupent des postes qui vont
du régime international pour la catégorie des grands
fonctionnaires, au régime local, pour la catégorie des petits
fonctionnaires, que ce soit au niveau des organes, des Institutions
rattachées que des Institutions spécialisées, dans tous
les Etats de
108 Cameroon Tribune, quotidien bilingue n°
9126/5325, 34e année, mercredi 25 Juin 2008, p.9.
109
https://afrikinfo.net/fotac-cemac-2019-rendez-vous-le-04-mars/
consulté le 12/06/2019 à 12h02min.
100
la CEMAC. Ce qui leur permet de contribuer comme les hommes et
sans discrimination aucune à la dynamisation de la
sous-région.
Même au plan politique, économique que
socioculturel, les femmes jouent un rôle important pour le
développement de la sous-région. Dans le volet politique, les
Camerounaises, les Centrafricaines, les Congolaises, les
Equato-guinéennes, les Gabonaises comme les Tchadiennes jouent un
rôle important. Elles sont présentes dans les accords
multilatéraux signés entre les différents Etats de la
CEMAC, les grandes conférences que la sous-région tient avec
d'autres pays ou sous-régions110. Elles participent au
processus décisionnel de la CEMAC, à l'élaboration des
plans d'action de la Communauté. La paix n'est pas en reste, elles
contribuent à la stabilisation de la zone CEMAC, en participant à
des rencontres de réconciliation, de médiation et à des
OMP, comme celles initiées en Centrafrique par l'ONU pour
réinstaller la paix dans ce pays. L'économie est également
très prisée par ces femmes, dans tous les volets : agricole,
aquatique, commercial, industriel, que ce soit de manière formelle ou
informel111.
Les femmes de la CEMAC dynamisent aussi la sphère
socioculturelle à travers différents produits artisanaux le
sport, et des foires pour rapprocher les peuples de la sous-région. La
réalisation de tout ceci passe par plusieurs moyens, notamment les
événements sportifs comme la Coupe CEMAC, les
événements culturels, comme la FOTRAC, la FOTAC, des grands
moments d'attraction112. Ainsi loin d'être inférieures,
les femmes jouent un rôle complémentaire à celui des hommes
dans la CEMAC. Aussi, leur pouvoir bien que mal perçu par certains, est
indéniable, toutefois, elles font face à de nombreuses
difficultés au sein de cette Organisation Internationale sous
régionale, qu'il faille remédier. 113.
110 Cameroon Tribune, quotidien bilingue n°
9126/5325..., p.9.
111 Lucien Henry Ticky, entretien.
112 Echos d'Aujourd'hui, n° 16, p.10.
113 Jean Léonard Thierry Ondigui Mbassi, entretien.
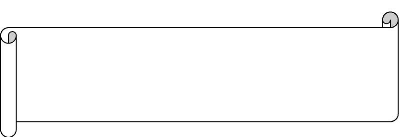
101
LES LIMITES A L'ACTION DIPLOMATIQUE DE LA FEMME AU SEIN
DE LA CEMAC
CHAPITRE III :
Les femmes en Afrique sont des agents économiques, des
cadres d'administration, des agents politiques, des agents sociaux1,
de la petite à la grande échelle, dans le cadre national comme
international. Au-delà de leurs activités
génératrices de revenus, elles sont les principaux leviers de
l'économie domestique et du bien-être familial. Elles jouent un
rôle indispensable, mais parfois méconnu des dirigeants au sein de
leur communauté et de leurs nations respectives2. Et
pourtant, sur l'ensemble du continent africain, les femmes se heurtent à
toute une série d'obstacles qui entravent la réalisation de leur
plein potentiel, qui sont parfois la conséquence de la conjoncture
internationale, des pratiques culturelles restrictives, aux lois
discriminatoires à des marchés du travail très
segmentés. Elles jouent un rôle important pour la dynamisation de
la CEMAC tant sur le plan politique, économique et socioculturel.
Cependant, cette action est empiétée par de nombreuses
difficultés qu'elles rencontrent3.
A. LA CONJONCTURE COMMUNAUTAIRE ET LES LOIS DEFAVORABLES
AUX FEMMES
D'après la BAD, l'élimination des
inégalités entre les genres et l'autonomisation des femmes
pourraient augmenter le potentiel de production d'un milliard d'Africains et
stimuleraient considérablement les potentialités de
développement du continent4. Cependant, les femmes sont
confrontées à de nombreux obstacles qui limitent leur travail
dans la CEMAC. Sont étudiés ici : les crises économiques,
les conflits frontaliers et les facteurs socioculturels5.
1E. Ahohe, M. Malick Bale, al., Les
économies de l'Afrique centrale : enjeux et défis de
l'économie verte en Afrique centrale, 2013, p.27
2 Marcelline Mebounou, 32 ans, Sous-directeur de la
sous-direction Afrique au MINREX, entre réalisé au Minrex le
24/01/2018.
3 Henry Lucien Ticky, 47 ans, Expert Principal CEMAC en
circulation, entretien réalisé à la Représentation
CEMAC au Cameroun à Yaoundé, le 15/10/2018.
4 BAD, Indice de l'égalité du genre
en Afrique, Autonomiser les femmes africaines : plan d'action,
Abidjan, 2015, p.5.
5 Marcelline Mebounou, entretien.
102
1. Les crises économiques
Dans la plupart des pays de l'Afrique, la discrimination
à l'égard des femmes se combine à d'autres formes de
disparités sociales et économiques, comme le lieu d'origine,
l'emplacement, la communauté, la catégorie sociale et le
métier. Facteurs qui jouent un rôle clé dans l'ampleur des
privations. Il est important de souligner que les personnes les plus
affectées par les crises internationales sont des femmes, qui sont
souvent les plus défavorisées à la base dans la plupart de
ces pays6.
Les crises économiques provoquent
généralement le déclin de l'économie mondiale, ce
qui affecte directement la production vouée à l'exportation. Par
un effet multiplicateur négatif, les marchés intérieurs,
l'inversion des mouvements de capitaux y compris les portefeuilles des
investissements et le crédit bancaire externe, la pro-cyclité de
l'écoulement de l'aide, l'impact de la crise sur les travailleurs
migrants et donc sur les transferts de fonds, la conséquente
dévaluation des taux de change qui affecte la production nationale et
les prix, la volatilité extrême des prix des denrées
alimentaires mondiales et les restrictions budgétaires dans beaucoup de
pays africains en développement qui ont déjà mené
d'importantes réductions de leurs dépenses publiques, affectant
ainsi l'accès aux services de base et la qualité de
vie7. Ces processus provoquent, de différentes
manières, des effets nuisibles aux femmes, dont plusieurs peuvent
s'empirer à court terme et ce, même si les économies se
rétablissent. Certains des effets principaux impliquent des impacts sur
l'emploi, le déclin du salaire réel et des revenus de
l'auto-emploi (activités en tant que travailleur indépendant),
des changements dans les modèles de la migration, l'impact des prix
élevés des denrées alimentaires sur la consommation
alimentaire, l'accès aux soins de santé, l'accès à
l'éducation et une plus grande exposition aux formes de violences
domestiques et autres, dues aux tensions sociales accrues8.
L'impact le plus immédiat et le plus direct de la crise
est généralement la déflation dans les entreprises. Ce qui
entraine la perte ou l'abandon d'emploi et par ricochet le chômage. Les
entreprises, à causes des crises internationales connaissent souvent des
déficits financiers, ce qui les met dans une incapacité de payer
leurs employés9. A cet effet, les femmes se trouvent
généralement majoritaire à la classe des employés
de second rôle, à côté d'un effectif masculin
dirigeant. Elles sont toutefois révoquées ou se trouvent dans la
contrainte d'abandonner pour
6 Ahohe, Malick Bale, al., Les
économies de l'Afrique centrale..., p.20.
7 Jayati Ghosh "L'impact de la crise sur les droits des femmes
: les perspectives sous régionales", Octobre, 2009, p.5-7.
8 Ibid.
9 Galloye née Iwandza Catherine, 53 ans,
Secrétaire particulier de l'Ambassadeur de la République du Congo
au Cameroun, entre tien réalisé à l'Ambassade de la
République du Congo au Cameroun, le 14/06/2019.
103
aller ailleurs. Ces crises affectent
généralement tous les secteurs d'activités (formel et
informel). Tandis que les emplois salariés diminuent, les travailleuses
de plusieurs pays se tournent vers des activités de sous-traitance
à domicile ou bien vers des activités au sein d'unités
très réduites, mal payées et sans aucun avantage
extra-professionnel.
Par ailleurs, le phénomène d'exportation des
produits pour l'industrie connait en Afrique centrale, une faible participation
des femmes. Quand bien même elles sont présentes, elles sont
à la sous-traitance. Très peu de femmes ont des capitaux pour
faire le commerce international à cause de leurs revenus qui sont
généralement inférieurs à ceux des hommes qui
occupent les mêmes postes dans des structures avec des meilleurs
salaires. A cela s'ajoute le manque de moyens leurs permettant de supporter le
coût d'imposition dans le marché mondial10.
C'est dans cette logique qu'en 2011, l'activité
économique au niveau mondial avait considérablement ralentie,
dans un contexte caractérisé par la persistance de la crise, la
dette souveraine en Europe et les difficultés budgétaires des
pays industrialisés. Chez le géant économique mondial (les
Etats-Unis), la reprise économique avait été moins forte
que prévu, en raison notamment d'un épisode de grande
sècheresse qui avait frappé près de 60% du territoire et
du déferlement de l'ouragan Sandy11. L'intensification de la
crise et la chute de la production dans la zone euro avaient eu des effets
négatifs sur la confiance des entreprises et des consommateurs au niveau
mondial. La progression de l'investissement des entreprises avait ralenti,
surtout dans le secteur de l'industrie manufacturière. La demande des
ménages s'était affaiblie. Certaines mesures
d'austérité prises par les gouvernements des pays de la zone euro
pour restructurer de manière ordonnée la dette de certains pays
en difficultés n'avaient fait que renforcer les turbulences sur les
marchés financiers et suscité de nouvelles préoccupations
sur un éventuel défaut de paiement de certains grands pays de la
zone. A cette épreuve, les pays de l'Afrique avaient relativement
été affectés12. C'est le cas des pays de la
zone CEMAC qui avaient connu une régression du pourcentage du PIB en
2011 par rapport en 2010, comme l'illustre le graphique ci-dessous :
10 Galloye née Iwandza Catherine, entretien.
11 Ahohe, Malick Bale, al., Les économies
de l'Afrique centrale..., p.30.
12 Ibid., p.18.
104
Graphique 1 : Taux de croissance du PIB
réel dans les pays de l'Afrique centrale entre 2010 et 2012

Source : E. Ahohe, M. Malick Bale, al.,
Les économies de l'Afrique centrale : enjeux et défis de
l'économie verte en Afrique centrale, 2013, p.30.
Ce graphique présente l'évolution triennale du
P11B de la CEMAC. Comme relevé plus haut, la CEMAC a connu une
régression du P11B à partir de 2011 à cause de la crise
économique mondiale.13 Cette crise a affecté aussi
bien les hommes que les femmes que ce soit dans des secteurs formels
qu'informel14. La plupart de ces femmes vivent ces crises dans les
ménages à travers soit l'inflation dans le marché ou la
détérioration des salaires dans les entreprises. Parlant des
dettes des pays de la CEMAC15, les conditions de remboursement de la
dette extérieure se sont traduites par la politique d'ajustement
structurel dont le coût social est très
élevé16. Les femmes ont également
été victimes de ces mesures. En plus des crises
économiques, les conflits frontaliers et internes font aussi partir des
entraves au travail des femmes dans la CEMAC.
13 Ahohe, Malick Bale, al., Les économies
de l'Afrique centrale..., p.30.
14 Anne Mindang, 35 ans, Cultivatrice centrafricaine,
entretien réalisé à Yaoundé le 15/06/2019.
15 Marie Gaspar Nicolas Messi, 52 ans, Assistant de
la Représentante de la CEMAC au Cameroun, entretien
réalisé à la Représentation de la CEMAC au Cameroun
à Yaoundé, 23/01/2018.
16 A. M. Bakyono, D. Nagnigui Kamara, al., Les
économies de l'Afrique centrale, Paris, Maisonneuve et Larose,
2005, pp.13-26.
105
2. Les conflits frontaliers et internes aux Etats :
cas de Boko Haram et du conflit centrafricain
Les Etats de la CEMAC depuis une décennie, sont en
proie à de nombreux conflits dans les zones frontalières. C'est
le cas de Boko-Haram. Existant depuis des années 2000 dans la zone
sahélienne, le conflit terroriste va s'étendre notamment en
Afrique centrale zone CEMAC et par conséquent dans la frontière
Tchad-Cameroun. En 2015 lors d'un sommet à paris, le Chef d'Etat
camerounais déclare la guerre à la "secte islamiste" Boko-Haram.
C'est ainsi que les combats vont s'acharner à l'Extrême-Nord du
Cameroun et du côté du Tchad, à cause de nombreux attentats
suicides orchestrés par ces terroristes dans ces zones. Une force
multinationale sera constituée pour faire obstruction à cet
ennemi non seulement national mais sous régional. Le combat va
dépasser le cadre national, pour devenir sous
régional17.
Cette guerre a plus que jamais couté des vies à
la population féminine des Etats de la CEMAC, des moyens financiers et
de nombreuses richesses. Aussi face à cette guerre, certaines femmes
battent en retraite, ce qui freine leurs initiatives au-delà des
frontières nationales. Le processus d'intégration, tant politique
qu'économique est ainsi empiété. De nombreuses femmes ont
été affectées, d'autres ont même perdu leurs vies,
pas parce qu'elles étaient aux combats, mais elles ont été
des victimes. D'autres par contre ont fait l'objet des kamikazes
indépendamment de leur volonté. Face à tout ceci, le
travail des femmes dans la sous-région a ralenti18.
Pour ce qui est du conflit centrafricain, le 24 Mars 2013, la
Seleka s'empare de Bangui (la capitale centrafricaine) et pousse
François Bozizé, le président en exercice depuis 2002 en
exil. Ce groupe armé disparate repose sur des alliances de circonstance.
Il a profité durant les premiers mois de la lassitude d'une partie de la
population envers le gouvernement Bozizé, accusé notamment de
corruption, de violences et de pressions envers les populations du Nord et de
favoriser son ethnie, les Gbayas. Pour faire face à la progression de la
Seleka plusieurs milices locales d'autodéfense s'organisent et se
structurent. Soutenus par les partisans de Bozizé et des militaires
restés fidèles, les anti-balakas gagnent en importance dans le
sud et l'ouest du pays. Acculé, sous la pression de l'ancien
allié Idriss Deby, président du Tchad, Michel Djotodia,
éphémère président, démissionne le 10
janvier 2014, neuf mois après sa prise de pouvoir. Accusé ainsi
que son Premier ministre, d'avoir laissé commettre les exactions
17 Marie Gaspar Nicolas Messi, entretien.
18 Yahya Adoum Mahamat, 59 ans, 1er
Secrétaire à l'Ambassade du Tchad au Cameroun, entretien
réalisé à l'Ambassade du Tchad le 01/03/2018.
106
contre les civils, et incapable de mettre un frein aux combats
entre milices, Michel Djotodia ne pouvait s'appuyer ni sur le soutien des
Centrafricains, ni du Tchad voisin, ni de la France, qui lance officiellement
l'opération Sangaris le 5 décembre 2013.19
Dans les jours qui suivaient, les exactions se
multiplièrent. Selon Amnesty International, en deux jours, environ 1000
chrétiens et 60 musulmans ont été tués par les
milices lors des combats. Les forces françaises interviennent
officiellement en décembre 2013. Mission Multidimensionnelle
Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en Centrafrique
(MINUSCA) qui succède à la Mission Internationale de Soutien
à la Centrafrique (MISCA), ne parviendra qu'à
freiner l'escalade de violences et la dérive vers des affrontements
communautaires. Fin 2015, on compte 450000 déplacés à
l'intérieur du pays et 500000 réfugiés dans les
États voisins. Près de 2.5 millions de Centrafricains, soit
environ la moitié de la population totale du pays ont un besoin urgent
d'aide humanitaire. Plus de 60 % d'entre eux vivent dans le plus extrême
dénuement. Dans ce conflit amorcé depuis 2013, les femmes paient
encore aujourd'hui un lourd tribut. Les motivations de celles qui ont choisi de
rejoindre les groupes armés sont diverses. L'indigence, le
désespoir et la défiance envers les autorités a pu en
pousser certaines à rejoindre la Seleka. Celles qui ont opté pour
les anti-balaka recherchaient pour la plupart la protection du groupe et la
vengeance, après les exactions commises envers leurs proches par les
combattants de la Seleka. En Centrafrique, les femmes ont pris les armes et
joué un rôle autre que celui de supplétives20.
Les femmes qui ont accompagné les groupes armés durant le conflit
en Centrafrique n'ont pas eu qu'un rôle supplétif. Du
côté des ex-Seleka comme des anti-balaka, elles sont venues
volontairement ou par la force, et un nombre important d'entre elles est devenu
combattants, en particulier du côté des ex-Seleka. Elles ont suivi
un entraînement militaire21.
Ce conflit interne a entrainé le ralentissement des
activités, non seulement en Centrafrique, mais aussi dans la
sous-région. Et de surcroît les femmes aussi bien que les hommes
ont subi les effets de cette guerre dans tous les domaines d'activité.
Toutes les femmes associées à l'un ou l'autre des groupes
armés rencontrent des difficultés, soit au sein même du
groupe soit pour retrouver leur communauté délaissée au
début du conflit. D'une manière générale, elles se
trouvent dans une situation de solitude extrême qui s'ajoute à
leur
19 D. Thiénot, "Les femmes entre les fronts
en République centrafricaine", in Rapport sur l'Afrique centrale
10, Institut d'Etudes de Sécurités, Septembre 2017,
pp.2-4.
20 Thiénot, "Les femmes entre les fronts...",
p.2.
21 Ibid.
107
vulnérabilité. Dans une période encore
instable de méfiance généralisée et de
prédation économique, leur communauté ne semble pas
prête à les accueillir22.
3. Les contraintes socioculturelles et les lois
défavorables aux femmes
Il en ressort des consultations au niveau des
différentes institutions nationales des pays de la CEMAC que la femme
est particulièrement vulnérable, à cause de plusieurs
facteurs qui sévissent encore malgré leur abolition par les
législations en vigueur. Ces considérations socioculturelles sont
d'une immensité que la liste ne saurait être exhaustive.
Les responsabilités familiales sont l'une de ces
contraintes. La proportion majoritaire des femmes des Etats de la CEMAC est
assignée au rôle qui consiste à l'essentiel des soins des
enfants et des tâches ménagères. Les femmes assument en
moyenne les trois-quarts des tâches ménagères. En zone
rurale, elles ont l'obligation de participer aux travaux champêtres, ce
qui influe sur leur rendement socioprofessionnel. Les femmes sont aussi
victimes des violences de toutes sortes, de la pauvreté. Elles sont
généralement victimes des violences conjugales à tous les
niveaux et représentent la couche la plus défavorable en
matière de revenus dans la société, celle victime d'une
grande paupérisation sociale23.
La polygamie est un élément narcotique des
femmes dans la société. Bien que sollicitée par la plupart
des hommes en Afrique, elle est souvent fustigée par des femmes, sauf
dans les cas d'exception où parfois la première femme est
stérile24. Ne voulant pas adopter d'enfant, encourage son
mari à prendre une seconde épouse. En effet, la polygamie est un
facteur de plusieurs maux dans les foyers conjugaux. La femme est certes
consciente du combat qui est sien, mais le poids des traditions pèse
encore sur elle, de telle sorte qu'elle est toujours victime de discriminations
et d'oppressions. Son plein épanouissement est freiné par un
ensemble de clichés de pratiques et croyances aussi bien
coutumières que religieuses. A la maison comme à l'école,
dans les affaires comme dans le gouvernement, elle demeure le "sexe faible".
Quand bien même elle serait compétente, elle est la moins
sollicitée comme le témoigne le palmarès
genre25.
Le déficit d'éducation et de la formation montre
que, moins de femmes sont scolarisées, d'autres abandonnent des
études, faute de moyens et moins de femmes se trouvent dans des
22 Thiénot, "Les femmes entre les fronts...",
pp.2-3.
23 A.M.F. Elanga Mbangono, "Les politiques sociales
au bénéfice des femmes en zone CEMAC", Mémoire de master
en relations internationales, IRIC, 2011-2012, p.9.
24 Inès Fotsing, 70 ans,
ménagère, entretien réalisé à Yaoundé
le 22 septembre 2018.
25 Galloye née Iwandza Catherine, 53 ans,
Secrétaire particulier de l'Ambassadeur de la République du Congo
au Cameroun, entretien réalisé à l'Ambassade de la
République du Congo au Cameroun le 14/06/2019.
108
enseignements professionnels. Par ailleurs, il existe
relativement moins d'écoles secondaires pour accueillir des filles des
Etats de la CEMAC, comme le témoigne par exemple le nombre de
Collèges D'enseignement Technique Industriel Féminin (CETIF). Ce
déficit qui relève toujours du caractère traditionnel de
la non-scolarisation des filles comme en témoigne Napoléon
Bonaparte "l'éducation publique ne convient point aux jeunes filles
puisqu'elles ne sont pas appelées à vivre en public. Le mariage
est toute leur destination"26.
La vulnérabilité en matière de
santé montre que les femmes sont plus touchées que les hommes en
matière de contamination des maladies. La science relève que la
femme est une sorte de "dépotoir", à cet effet, elle serait donc
plus affectée et par ricochet plus vulnérable que l'homme. En
outre, La non-maîtrise des ressources productrices comme la terre et les
biens constitue une contrainte défavorisant les femmes. La majeure
partie des femmes notamment dans les Etats de la CEMAC dépendent
entièrement des revenus de leurs conjoints. D'autres sont privées
d'héritage familial, ce qui expliquerait la faible proportion de femmes
propriétaires d'entreprises de commerce, d'exploitation agricole. Un
partage inégal des responsabilités au sein de la famille et du
ménage est aussi manifeste. Les hommes considèrent
généralement les travaux ménagers comme étant
l'apanage des femmes. Certains hommes voient en d'autres qui
s'entremêlent des travaux domestiques comme une sorte de "fille
garçon"27.
La faible représentation des femmes aux postes de
responsabilité. Une observation des secteurs publics et privés
des pays de la CEMAC permet de se rendre compte du petit nombre de femmes
occupant des postes de responsabilité. De ce fait, si la politique de
l'égalité des sexes est presque toujours mise en avant, il semble
que la classe dirigeante, essentiellement masculine, a bien du mal à en
intégrer ce principe. C'est ce qui implique des pourcentages aussi
médiocres des femmes au gouvernement. Les femmes sont
reléguées dans les activités mal
rémunérées et peu reconnues : des études montrent
que de nombreuses femmes dirigent des micros commerces, surtout dans
l'économie informelle, mais qu'elles sont en revanche moins nombreuses
dans les moyennes et les grandes entreprises. Plus une entreprise est
importante, moins il est probable qu'elle soit dirigée par une
femme28.
26 N. Bonaparte cité par O. Dhavermas,
Droits des femmes : pouvoirs des hommes, Paris, Seuil, 1978, p.241.
27 Aramatou Fadila, 22 ans, étudiante
tchadienne en 2eme année à l'Université de
Yaoundé II en Science politique, entretien réalisé le
25/01/2018.
28 OIT, 12eme Rapport de la Réunion
Régionale africaine, Johannesburg, Afrique du Sud, 11-14 Octobre
2011.
109
Dans les Etats CEMAC, la femme prise sous ce prisme occupe
place moins importante dans le partage du pouvoir et la responsabilité
en matière de prises de décisions. Ce qui explique sa place
toujours seconde dans les postes de responsabilités29.
Si affirmer la domination de l'homme, c'est reconnaître
l'infériorité, l'impuissance et par là, la soumission de
la femme, ce rapport de condescendance incontestable est pourtant bien loin de
révéler les enjeux véritables de l'option prise de la
femme de se laisser diriger. Aussi serait-il d'un intérêt certain
de procéder à l'analyse des relations apparemment très
simple qui unissent l'homme à la femme pour en découvrir les
véritables fondements cachés.
A l'issue d'une importante étude menée en
Afrique sur la légendaire soumission de la femme à l'homme qui en
profite souvent pour asservir, Fieloux Michelle (1988) relève que "si
les hommes se sont établis maîtres des femmes, ce n'est pas
toujours sans consentement de celles-ci. Et que ce consentement a, en retour
fourni aux femmes un réel pouvoir qui fait partir de leur
asservissement". Comme le dirait lors d'un culte du dimanche, un
prédicateur : "les femmes sont des ministres de l'intérieur et
les hommes ministres de l'extérieur". Pensée qui laisse traduire
la puissance absolue qu'elles incarnent au sein des foyers. Ce qui est en
adéquation avec les saintes écritures qui présentent le
rôle de la femme comme un rôle ni inférieur, ni
supérieur à celui de l'homme, mais complémentaire à
celui de l'homme. Car chacun joue son rôle à son niveau et
à son poste.
Il va sans dire que cette remarque qui corrobore une opinion
très largement partagée par les femmes des Etas de la CEMAC selon
laquelle le pouvoir dont dispose l'homme sur la femme est une véritable
bénédiction de Dieu, ce qui trahit tout effort de
libération de cette femme en même temps qu'elle dégage sa
part de responsabilité qu'elle tient dans son assujettissement. Par
ailleurs, Guillaume Garathier Chantal (1985) qui s'est consacrée
à l'étude du mariage chez les Fali du Nord Cameroun relève
que :
Chez les Fali, le rôle de la femme se joue dans la
différence qui n'est ni égalité ni opposition par rapport
au rôle de l'homme, mais plutôt complémentarité dans
le respect de l'harmonie du monde voulue par Dieu. Si l'homme est maître
incontesté dans les relations extérieures, soutient-elle à
la maison, elle (la femme) règne d'une façon aussi incontestable
sur le foyer de son mari.30
Cette conception pourrait ainsi laisser voir l'acceptation de
l'infériorité par la femme, non pas de son vouloir, mais pour
respecter et faire une volonté d'un ordre préétabli.
En effet, le genre est l'identité construite par
l'environnement social des industries : la féminité ou la
masculinité ne sont pas des données naturelles mais le
résultat de mécanisme de
29 R. Boudon, L'Inégalité des
chances, Paris, Armand Colin, 1973, cité par A.M.F. Elanga
Mbangono, "Les politiques sociales au bénéfice des femmes en zone
CEMAC...", p.108.
30 B. Ehrenreich, Rites de sang : origines et
histoire des passions de la guerre, Metropolitan book, 1997, p.52.
110
construction et de reproduction sociale. Consciemment ou
inconsciemment, la société s'organise selon le paradigme des
"choses des hommes" et des "choses des femmes" au point que l'on se convient
qu'il y a des domaines ou des niveaux socialement réservés
à tel ou tel des deux sexes31. Cette conception,
véritable stéréotype, est enracinée dans les
représentations sociales. Ce qui explique le fait que les femmes se sont
impliquées dans l'armée avec beaucoup de peine. Comme l'explique
Bouba Ehrenreich : le militaire est d'abord un homme. Il relève qu'il
existe une interdépendance entre la guerre, la virilité et
l'homme ; le militaire est homme dans la mesure où chaque homme est un
potentiel guerrier. A l'homme, l'oeuvre de la mort, à la femme l'oeuvre
de vie. La femme porte l'enfant et lui donne la vie32. Cette
différenciation naturalisée des rôles s'est
prolongée dans le droit du travail. C'est ainsi que la femme est
considérée comme "faible et fragile par nature", les mineurs aux
même titre que les enfants, "naturellement" condamnés à la
sphère domestique, à la reproduction33.
Les attitudes transmises d'une génération
à une autre, constituent également une cause de
l'infériorité féminine. La transmission des valeurs
culturelles et traditionnelles contribue à la perpétuation des
pratiques néfastes suivant les identités et les
spécificités de chaque pays. Tous ces stéréotypes
de la féminité : les clichés, les images, les symboles,
les préjugés et toutes sortes d'opinions arrêtés sur
la nature, l'identité et le statut de la femme, qu'ils soient d'origine
culturelle, historique, religieuse ou mythique, ces éléments qui
sont constitutifs de l'image que la société a créé
de la personnalité féminine déterminent fondamentalement
la perception et la conception que l'on a de la femme.
En zone CEMAC, il y'a une coexistence du droit coutumier et du
droit moderne, ce dualisme juridique entretenu par les différentes
institutions de la place rend le statut sociojuridique de la femme un peu
confus. Dès leur accession à l'indépendance, dans des
années 1960, la plupart des pays africains francophones ont opté
pour l'application du code civil français de 1958. Celui-ci s'est
révélé inadapté aux réalités de ces
pays. Ce qui a abouti à une coexistence de deux catégories de
droit notamment ce droit coutumier qui est oral et le droit moderne qui est
écrit.
Au Tchad par exemple, l'Ordonnance N°667/MJ du 21 mars
1967 portant réforme de l'organisation judicaire fait de la coutume une
composante prépondérante dans le système juridique
national. Cette Ordonnance dispose en son article 11 que : " en cas de silence
de la coutume, la loi doit être appliquée". Cela rend complexe la
situation d'autant plus que les juges
31 I. Théry, La
Distinction de sexe : Une nouvelle approche de l'égalité,
2007, p.218.
32 Ibid., p.218.
33 E. Durkheim, La division du travail
social, Paris, PUF, 1893, p.53.
111
ignorent les règles coutumières qui peuvent
s'appliquer à tel ou tel contentieux opposant les différentes
parties. La femme est alors celle qui est la plus défavorisée
dans cette situation. Elle subit les vicissitudes laissées par le vide
juridique par exemple dans la succession, la dot ou en cas de polygamie.
D'après le document de Politique Nationale de Genre de
2011-2012 au Cameroun, 52% de femmes ont déjà subi au moins une
fois la violence conjugale, 53% ont subi des violences depuis l'âge de 15
ans et au rang de ces violences, on compte les mutilations génitales,
les violences sexuelles, les mariages forcés et
précoces34. Cet état de chose a ceci de
spécifique que même si c'est sur le plan traditionnel qu'il puise
sa force et se nourrit, il parvient à suivre la femme partout où
elle pourrait se retrouver et par là affecte la condition de la femme
même dans le milieu académique, sa participation à la vie
politique et autre.
Le monde professionnel a longtemps connu une division du
travail dans les pays de la CEMAC ce qui n'a toujours pas été
chose facile pour la promotion professionnelle des femmes, réel facteur
de limitation jusqu'aujourd'hui de leur insertion dans la CEMAC. C'est dans
cette perspective que Pierre Bourdieu relève :
L'ordre social fonctionne comme une immense machine symbolique
tendant à ratifier la domination masculine sur laquelle il est
fondé. C'est la division sexuelle du travail, distribution très
stricte des activités imparties à chacun des deux sexes. Il
appartient, aux hommes situés du côté officiel, du public
d'accomplir tous les actes périlleux et spectaculaires qui, comme la
guerre, marquent des ruptures dans le cours ordinaire de la vie ; au contraire,
les femmes étaient situées du côté de
l'intérieur, se voient attribuer tous les travaux domestiques comme le
soin des enfants ainsi que le reste des travaux qui leurs sont
impartis.35
C'est à l'homme de "partir" et à la femme de
"rester" garder les enfants et la maison. Cette division sexuelle de l'espace
du travail demeure une réalité dans la professionnalisation des
métiers et ce qui n'est pas en reste dans l'attribution des postes de
responsabilité dans la l'espace communautaire CEMAC au vu des
différents postes de responsabilités qu'occupent les hommes et
les femmes dans cette institution36.
En outre, l'on dénote un manque de volonté
politique de la part des dirigeants de la sous-région à
l'égard des femmes : les femmes de la sous-région sont nombreuses
aujourd'hui à être formées dans les grandes écoles
et universités de leurs pays et du monde, dans des domaines divers.
Certaines ont fait montre de leurs compétences en d'importants postes
tant dans l'administration publique que privée. Il convient que les
femmes ne sont plus en marge de
34 Rapport de la CNDHL sur les droits de l'homme
en 2014, p.9.
35 P. Bourdieu, La domination masculine,
Paris, Seuil, 1998, p.36.
36 Baban Remy, 36 ans environ, Vigil depuis 3 ans
à la Représentation de la CEMAC Cameroun, entretien
réalisé à la Représentation CEMAC au Cameroun
à Yaoundé le 31/05/2019.
112
l'éducation et de l'instruction dans les
différentes sociétés car elles ont aujourd'hui des
aptitudes leurs permettant d'exercer toutes les fonctions au même titre
que les hommes. Cependant, la phallocratie de la société
politique, parfois aussi misogyne ne permet pas à la femme
d'accéder à tous les postes au sein de cette
homogénéité spatiale.
La présence limitée des femmes dans les partis
politiques est également un facteur interne qui limite la promotion des
femmes dans l'arène politique et donc diplomatique de cette
sous-région. En effet, les discours qui ont cours dans les partis
politiques frappent les esprits par leurs contradictions internes et notamment
le clivage qui règne entre l'application à la lettre des discours
politiques et le comportement des tenants des partis sur le terrain.
L'avènement du multipartisme et plus précisément
l'ouverture des partis politiques aux femmes prônée dans les
différents textes constitutifs des partis a suscité bien
d'espoirs pour les femmes en général et à celles de la
CEMAC en particulier, jadis abandonnées à leur triste sort. Mais
force est de constater que ces promesses ne sont plus les mêmes. Il est
observé que ces promesses ne sont pas toujours respectées lors
des investitures dans la scène politique. Par ailleurs, la
création des sections féminines dans les partis politiques
constitue également un moyen de constituer une scission entre le travail
de la femme et celui de l'homme. Cette situation empêche aux femmes de se
frotter aux hommes même dans les compétitions pour l'accession aux
différents postes37.
En plus de cela, l'un des obstacles à la promotion
effective de la femme est le décalage qui existe dans tous les domaines
entre la législation et son application. L'existence même
déjà des dispositions législatives discriminatoires ou non
adoptées à l'égard des femmes : droit à la
succession, à la propriété, au contrôle des biens,
à la liberté de circulation, à la garde des enfants, etc.
Toutes ces situations ne permettent pas qu'elles aient des avantages
proportionnels à leurs efforts et au même titre que l'homme. C'est
le cas en Guinée Equatoriale où la majorité nuptiale de la
fille est à 17 ans contrairement aux dispositions de la Convention sur
les Droits de l'Enfant (18 ans) et l'absence d'une législation en
matière de pénalisation du harcèlement sexuel. Aussi, il
faut noter la non-adoption du projet de code des personnes et de la famille, du
projet de code civil révisé et du projet de code de l'enfant qui
corrigent des idées juridiques et font plus de place aux droits des
femmes. Les innovations principales portaient sur le statut de la femme dans le
mariage, l'âge légal du mariage, le renforcement des peines contre
les auteurs des délits de violences faites aux femmes, le droit de garde
des enfants après divorce et le droit de jeune
37 A. Foulda, "Rapport de stage Académique
au Ministère de l'action sociale, de la solidarité nationale du
16 Octobre 2013 au 31 septembre 2014", Master professionnel en sociologie,
Université de Yaoundé I, 2014, pp.41-43.
113
fille et de la femme handicapée38. Face
à toutes ces difficultés d'ordre conjoncturel et socioculturel,
il est constaté que les femmes ne sont pas promues à tous les
plans pour participer au même titre que l'homme à la dynamisation
de la CEMAC. Par ailleurs, il existe également des problèmes
généraux à la libre circulation, épineux
problème donc à toujours fait face la sous-région.
B. LES PROBLEMES GENERAUX A LA LIBRE
CIRCULATION
La libre circulation est l'une des questions centrales dans la
dynamique diplomatique entreprise par la CEMAC car, l'on ne peut parler de
coopération entre les Etats sans évoquer la libre circulation.
Lorsqu'on parle de libre circulation, il s'agit de la circulation des
personnes, des biens, des services, des capitaux. C'est ainsi que pour
faciliter cette épreuve, la CEMAC a mis sur pied des textes juridiques
qui promeuvent notamment la circulation des personnes et des services, la
circulation des marchandises et la facilitation des transports, la libre
circulation des capitaux. Même si ce n'est pas toujours ce qui se
matérialise sur le terrain à travers des barrières
douanières, sanitaires, éducationnelles. Sans oublier les textes
élaborés qui ne sont pas appliqués.
1. Des barrières douanières, sanitaires et
éducationnelles
Pour faciliter la libre circulation, la CEMAC a mis sur pied
de nombreuses législations notamment : la Convention du 30 Janvier 2009
régissant l'Union Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(UEAC), l'Acte N°1/72/-UDEAC-70-A du 22 Décembre 1972 relatif
à la Convention Commune sur la libre circulation des personnes et le
droit d'établissement en UDEAC, l'Acte N°7/93-UDEAC-556-CD-SE1 du
21 Juin 1993 portant révision du Tarif Extérieur Commun (TEC) et
fixant les modalités d'application du Tarif Préférentiel
Généralisé (TPG), le Règlement N°
04/01-UEAC-089-CM-06 portant du Code Communautaire révisé de la
route, signé à Bangui le 03 Août 2000, la Convention
régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC), le
règlement N° 02/02/CEMAC/UMAC/CM du 14 Décembre 2000. Tous
ces textes régissant la libre circulation à la CEMAC s'appliquent
aussi bien aux hommes qu'aux femmes de la sous-région. Cependant, l'on
note la persistance des barrières douanières dans cette
communauté39.
38A. M. F. Elanga Mbangono., "Les politiques sociales
au bénéfice des femmes...", p.9. 39 Vision CEMAC,
publication de la CEMAC, n° 005, Février 2012, p.5.
114
Les barrières douanières dans la
sous-région CEMAC sont également autant de problèmes qui
entravent l'action des femmes entre Etats membres dont la Commission de la
CEMAC doit davantage y remédier40. Aussi, c'est le nombre
exorbitant des barrières douanières surtout dans les axes
routiers, qui entravent les échanges, le déplacement des
personnes, des biens dans la sous-région CEMAC et limitent aussi les
relations économiques, sociales et culturelles des femmes dans cette
communauté41. En outre, parfois il y a plusieurs
contrôles des forces de maintien de l'ordre dans ces Etats (des
gendarmes, des policiers, des douaniers et bien d'autres). Dans un axe, on peut
avoir dix contrôles et plus, comme à l'axe Douala-N'Djamena ou
Douala-Bangui. C'est pourquoi, les dirigeants tchadiens menacent de passer avec
leurs produits par la Centrafrique42.
En plus des problèmes liés aux barrières
douanières, les femmes font face à de nombreux problèmes
en matière d'accès à l'éducation et la santé
dans le cadre communautaire.
Pour ce qui est de la formation elle est limitée ou est
inexistante dans certaines localités de la sous-région, ou ne
fait pas toujours l'unanimité des différents Etats membres. Ce
qui justifie le faible taux de formation surtout de fille qui ont connu une
scolarisation tardive. C'est le cas dans les structures de formation sous
régionales suivantes : l'Ecole Supérieure des Sciences et
Techniques de l'Information et de la Communication (ESSTIC) et l'Ecole
Inter-Etats des Douanes (EIED). Parlant de l'ESSTIC, elle est
créée en 1970 et porte la dénomination d'Ecole
Supérieure Internationale de Journalisme de Yaoundé (ESIJY),
placée sous la tutelle d'une dizaine d'Etats africains. Cette
école de renom voit son nom évolué deux fois en trente
ans. En 1982, l'ESIJY devient nationale et prend l'appellation d'Ecole
Supérieure des Sciences et Techniques de l'Information (ESSTI). En 1991,
l'ESSTI devient grâce au développement des nouveaux métiers
de la communication, ESSTIC. Elle forme aujourd'hui dans les filières de
: Information documentaire, Journalisme, Publicité, Communication des
Organisations, Edition et Arts graphique.
A sa création, l'ESIJY avait une vocation
internationale et particulièrement régionale. Elle devait
accueillir des étudiants de toutes nationalités et
particulièrement les ressortissants de la sous-région Afrique
centrale. Chaque Etat était tenu de verser une contribution
financière, indispensable au soutien institutionnel de l'école.
Les premières années de fonctionnement de
40 Cameroon Tribune, quotidien bilingue
n° 8993/5192, 34e année, Décembre 2007, p.8.
41 Vision CEMAC n° 005..., p.5.
42 J. L. T. Mbassi Ondigui, "Les relations
culturelles entre Etats de la Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale (1959-2010)", Thèse de doctorat/Ph.D en histoire,
Université de Yaoundé I, Décembre 2014, p.388-392.
115
cette école ont respecté cette vocation. Force
est de constater aujourd'hui que son caractère international n'est plus
qu'un lointain souvenir43. Cette école permettait la
formation de nombreux ressortissants de l'Afrique en générale et
de la CEMAC en particulier. Ce qui permettait aux hommes et aux femmes de se
former dans tous ces domaines dont offre l'école. La nationalisation de
cette école limite l'enjeu sous régional et par
conséquent, le coût de formation pour les ressortissants d'un
autre pays ou d'une autre sous-région est élevé. Ce
facteur devient un problème non seulement pour les hommes, mais aussi
pour les femmes qui voudraient se faire former dans cette école.
Pour ce qui de l'EIED, située à Bangui, elle
voit le jour le 22 décembre 1972 par l'Acte 8/72-UDEAC-151 du Conseil
des Chefs d'Etat de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique
centrale. Quatre Etats avaient participé à sa naissance, à
savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo et le Gabon. Avec
l'adhésion de la Guinée équatoriale en 1983 et le retour
du Tchad en 1984 au sein de l'organisation sous régionale, l'EIED compte
aujourd'hui six Etats membres. L'EIED compte parmi les institutions de
formation spécialisées de la CEMAC telles que l'ISSEA à
Yaoundé et l'ISTA au Gabon. L'EIED a pour objectif la formation
professionnelle des agents des douanes et pour vocation la formation initiale
et la formation continue des stagiaires fonctionnaires et futurs fonctionnaires
des administrations des douanes des Etats membres et des opérations
économiques ou de tout autre Etat qui en fait la demande. Elle devait
assurer la formation et le perfectionnement des cadres des Douanes des Etats
membres. Alors que le Cameroun forme ses propres douaniers, cette école
ne reçoit seulement que quelques étudiants camerounais en
matière de formation des douanes. Par ailleurs, alors qu'il existe
également l'ENAM au Congo et au Gabon, la plus-value de l'école
en terme de formation devient faible. Cela diminue le pourcentage
d'apprentissage des femmes dans un espace communautaire44.
La santé est également un grand problème
pour les femmes de la sous-région. Elles se réclament d'une bonne
prise en charge en matière sanitaire. En République du Congo par
exemple, les hôpitaux sont minoritaires et ne peuvent prodiguer tous les
soins médicaux à cause de la précarité des
équipements et du manque des spécialistes dans divers domaines de
la santé. Ce qui parfois entraine des pertes en vies humaines dans des
cas de maladies qui le plus souvent nécessitent des interventions
d'urgences et très délicates45. En plus de ces
difficultés de libre
43 D. Avom, "Intégration régionale
dans la CEMAC : des problèmes institutionnels récurrents", in
Afrique Contemporaine, n°222, 2007, pp.199-221. In
www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2007-2-page-199.htm.
Consulté le 14/06/2019 à 8h05min.
44www.google.com/serach.EIED.
Consulté le 14/06/2019 à 16h22min.
45 Galloye née Iwandza Catherine, entretien.
116
circulation, l'on dénote également le retard de
l'application, voire des décisions prises mais qui ne sont pas
appliquées dans cette espace communautaire.
2. Les décisions non appliquées
De nombreuses décisions prises dans le cadre de la
CEMAC en général et sur la femme en particulier ont
généralement connu un retard en matière
d'applicabilité et voire d'autres ne sont même pas
appliquées. L'on s'interroge bien sur ce qui bloquerait des
décisions prises à l'unanimité des membres de la
communauté. Parlant par exemple des décisions sur la libre
circulation des biens, des personnes des capitaux et même des
idées, de nombreuses décisions ont été
adoptées par les Etats de la CEMAC. Cependant, elles ne connaissent pas
une application unanime de ces Etats. C'est le cas de l'article 8 de la
Convention commune et 27 de la Convention relative à l'Union Economique
de l'Afrique Centrale qui accordent certes la liberté de circulation des
personnes, des services, des marchandises et des capitaux, mais sont
généralement soumis aux formalités et aux limitations par
des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé
publique. Ce qui justifie que lors de la FOTRAC de 2016, les différents
membres du REFAC ont été retenus entre les frontières
Cameroun-Guinée Equatoriale et Cameroun Gabon. L'on s'interroge si cela
était dû la non-conformité ou alors c'était l'une
des magouilles douanières monotones46.
Aussi, le PER élaboré depuis 2011 par la CEMAC
tient compte de la question genre dans toutes ses dimensions47.
Cette politique économique a été élaborée
pour une durée de quinze ans, divisée en trois phases
quinquennales. Cependant, depuis 2011, un véritable changement en
matière d'équilibre de genre ne s'est opéré au sein
des structures de la CEMAC48. Le quota de fonctionnaires masculins
est largement toujours supérieur à celui des femmes, que ce soit
dans les organes centraux que des institutions spécialisées. Il
existe une marge de manoeuvre entre les décisions prises et
l'application de ces décisions49. Cela pourrait
également se justifier par le fait que depuis même la
création de l'UDEAC aucune politique en
46 Etienne Nguema, 38 ans, Administrateur civil au
Gabon, participant de la Fotrac 2017, entretien réalisé à
Kyé-ossi le 25/06/2017.
47 Le PER est une politique économique de la
CEMAC qui répond à une vision de l'avenir de la communauté
à l'horizon 2025, qui consiste à "faire de la CEMAC un espace
économique intégré émergent ou règnent la
sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance, au
service du développement humain". Cette politique tient compte de la
femme dans le plan économique, réclamant la mise en oeuvre d'un
réseau d'actrices économiques. L'implication de la femme dans le
processus de paix et de sécurité et l'amélioration de la
santé de la communauté tout entière et de la femme en
particulier. In CEMAC, PER, plan opérationnel 2011-2015, Décembre
2011, pp.7-104
48 Lucien Henry Ticky, entretien.
49 Idem.
117
matière de genre n'a été
élaborée dans la sous-région. Si oui, dans le cadre
national. Alors que les lois nationales ne s'appliquent pas dans le cadre de la
Communauté. Il importe donc pour la communauté de se doter des
instruments juridiques fiables et strictes pour la bonne mise en oeuvre des
politiques en matière d'équilibre sociale entre l'homme et la
femme au sein de la communauté.
C. AUTRES FORMES DE DIFFICULTES
De nombreux autres facteurs jouent défavorablement
à la promotion de la femme dans la CEMAC. Il s'agit notamment de
l'implication limitée du "gouvernement" de la CEMAC aux questions de
genre, le manque de volonté politique des Etats membres et l'absence du
budget alloué aux questions genre ou à la promotion de la femme
dans cette communauté.
1. L'implication limitée du "gouvernement" de la
CEMAC à la cause des femmes
L'implication limitée du "gouvernement" de la CEMAC est
à critiquer. Cette situation est engendrée par le laxisme des
décideurs de cette Organisation internationale sous régionale. De
manière générale, tout se passe comme si la CEMAC est
réservée aux chefs d'Etats, aux ministres, aux hauts cadres ou
aux élites mais pas aux autres. D'où lors des prises de
décisions par la conférence des chefs d'Etats et les sessions des
ministres, celles-ci sont adoptées et s'imposent à toute la
Communauté. Aussi, certains chefs d'Etats ne maîtrisent pas
toujours tous les maux dont les peuples, notamment les femmes font face.
Aussi, on remarque l'absence dans le traité instituant
la CEMAC, d'un Département en charge des questions de genre voire de la
femme au sein de la Commission de la CEMAC. En plus, quand on parle
d'intégration sous régionale, il est question de
l'intégration des peuples et non des décideurs ou des chefs
d'Etats, des ministres ou des recteurs des universités. Lorsqu'il est
constaté que très peu de femmes occupent de tels postes pour
décider au même titre que les hommes. Il est donc urgent d'y
impliquer les peuples notamment les femmes en faisant notamment des sondages
publiques sur les questions majeures les concernant, les émissions dans
les médias50où elles pourront contribuer et tout cela
permettra aux décideurs de mieux prendre des décisions qui
engagent toute la Communauté51.
50 Vision CEMAC, publication de la CEMAC
n° 001, 28 Décembre 2010, p.3.
51 Mbassi Ondigui, "Les relations culturelles entre
Etats ...", p.388.
118
En outre, la CEMAC est une organisation constituée des
organes et des institutions. Les administrateurs de ces structures parlent
moins, lors des conférences ou débats communautaires, des
questions de la femme, si non de la répartition égale des postes
de responsabilité au sein de l'organisation52. Car que ce
soit le gouvernement communautaire ou les gouvernements des Etats membres, le
silence constitue l'avis de chacun.
2. Le manque de Fonds et de volonté politique des
Etats membres
Concernant les Fonds, les femmes de la CEMAC font face
à de nombreuses difficultés d'ordre financier. La plupart des
associations ne bénéficient pas des fonds publics de la CEMAC.
Leurs fonds viennent des acteurs privés53. C'est le cas des
différents réseaux d'association féminine tels que le
Réseau des Femmes Parlementaires d'Afrique Centrale (RFPAC), du REFAC
dont le gouvernement de la CEMAC tarde toujours à reconnaître
comme institution spécialisée de la CEMAC54 et qui
pourrait mieux s'occuper des questions de la femme. Aussi, le gouvernement de
la CEMAC et même les gouvernements respectifs des Etats membres ne
soutiennent pas suffisamment la FOTRAC comme une foire de facilitation
d'intégration dans la communauté et en Afrique en
générale. Car cet événement communautaire
connaît depuis 2016 la participation de d'autres pays de la zone CEDEAO
comme le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte
d'Ivoire55 . Cela pourrait justifier le faible taux de participation
des populations de la communauté et de l'Afrique en
générale, lorsqu'il est observé l'importance de cet
événement pour le processus d'intégration de
l'Afrique56. Il est donc clair que les gouvernements des Etats
membres et celui de la communauté doivent revoir la place
accordée à cette foire dans leurs budgets pour contribuer
à faire de la FOTRAC un espace qui contribue au processus
d'intégration de la CEMAC57. Une preuve du rôle
indéniable de la femme dans cet espace géographique.
Prenant le cas du REFAC par exemple, ses activités
tournent autour de : le développement agropastoral et artisanal, des
voyages d'échange, d'étude, de découvertes des sites, des
symposiums, des séminaires, des formations, des séminaires
culturels, des activités sportives. D'autres activités sont
menées dans le cadre de la santé, à travers les campagnes
de sensibilisation, de promotion et de prévention des maladies telles
que le VIH, la drépanocytose,
52 Jean Léonard Thierry Mbassi Ondigui,
entretien.
53 Idem.
54 Ndong Owono Abang, entretien.
55 Lucien HenryTicky, entretien.
56 Idem.
57 Idem.
119
le diabète, le cancer et d'autres ; la distribution des
moustiquaires imprégnées dans les zones à risques, le
soutien et l'assistance aux personnes fragilisées par les maladies ou
vivant dans la précarité (enfants, femmes, personnes
âgées)58. Une attention particulière est
accordée à la formation, la sensibilisation des groupes sur la
lutte contre toutes les formes de violence, contre l'utilisation des Armes
Légères et de Petits Calibres (ALPC) en vue d'éradiquer
les trafics illicites des armes et celui des humains59. A partir de
cela, le REFAC nécessite une plus-value des pouvoir publics de la
communauté et des Etats membres.
Par ailleurs, le gouvernement de la CEMAC ne manifeste pas
toujours beaucoup de volonté politique en matière de promotion du
genre. Il existe très peu d'instruments juridiques en matière de
promotion de la femme au sein de cette espace communautaire60. De
l'UDEAC à la CEMAC, la volonté politique du gouvernement de la
communauté ne connait pas beaucoup d'évolution sur la question
d'égalité sociale. En effet, même le PER qui tient compte
de la question genre, ne s'applique totalement pas dans la proposition des
fonctionnaires dans la sous-région.
Il a été élaborée dans ce
programme économique régional, une volonté politique de
mettre sur pied un réseau d'actrices économiques pour
accélérer la mise en place effective d'un marché commun.
Cependant, cette initiative n'a point connu une matérialisation. Il en
est de même de l'initiative d'implication de la femme dans la paix et la
sécurité en Afrique centrale, qui tarde toujours à
connaitre des avancées notoires. Ceci démontre à
suffisance le manque de volonté politique des Etats mêmes de la
CEMAC sur la question d'équilibre sociale entre l'homme et la femme.
Il est donc constaté après cette longue analyse
des facteurs de limitation des femmes dans la communauté, que les femmes
font face à de nombreuses entraves dans la CEMAC. Ce qui ne leurs permet
pas de contribuer au tant que l'homme à la dynamisation de la
communauté. Toutefois, il n'est pas désavoué que la femme
depuis l'UDEAC jusqu'à la CEMAC, connait des avancées notoires
à matière de représentation dans les différents
postes de responsabilité dans la CEMAC61. Ce qui justifie le
chapitre suivant sur le bilan de la contribution diplomatique de la femme au
sein de la CEMAC. Même s'il faut relever qu'il y a des mesures à
prendre pour une meilleure implication de la femme dans cette
communauté.
58 Rapport FOTRAC, 7e édition
du 25 juin au 9 juillet 2016 à Kyé-Ossi, frontière
Cameroun-Gabon-Guinée Equatoriale, 2016, p.3.
59 Etienne Nguema, entretien.
60 Lucien Henry Ticky, entretien.
61 Idem.
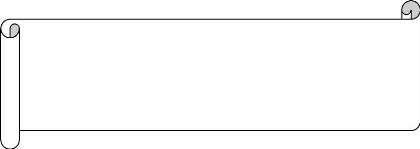
BILAN DE LA CONTRIBUTION DIPLOMATIQUE DE LA FEMME
AU
SEIN DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE SOUS
REGIONALE LA CEMAC
CHAPITRE IV :
120
La femme de l'UDEAC à la CEMAC occupe de nombreux postes
de responsabilité aux travers desquels elle joue un rôle important
pour l'avancement de la sous-région. C'est ce bilan que se propose de
ressortir ce chapitre pour montrer que ce rôle qu'elle joue depuis
l'UDEAC est dynamique car il s'est accru dans la CEMAC avec le temps.
A. DES REALISATIONS DIPLOMATIQUES DE LA FEMME DANS LA
CEMAC, ENJEU DE LEUR PRESENCE DANS DES POSTES DE RESPONSABILITE
De la Commission aux Représentations pays, passant par
les Institutions sous régionales, les femmes jouent un rôle
important, ce qui leurs permet d'occuper les postes de responsabilité au
même titre que les hommes dans la CEMAC.
1. Au sein de la Commission et des
Représentations-pays
De nombreuses femmes occupent des postes important depuis la
création de la CEMAC et cela se justifie par la plus-value que cette
institution accorde à cette dernière1. D'où sa
présence tant à la Commission de la CEMAC qu'aux
Représentations-pays.
Pour ce qui est de la Commission de la CEMAC, de 1964 à
1999 ou de l'UDEAC à la CEMAC, c'est le Secrétariat
Général. Aussi de 1999 à 2007 c'est le Secrétariat
Exécutif. À partir de 2007, on a la Commission de la CEMAC.
Dès lors, la Commission est l'organe exécutif de la
Communauté. C'est elle qui porte les dossiers auprès des
instances supérieures. Elle est en charge de l'organisation des Conseils
des ministres de l'UEAC et des Conférences des Chefs d'Etat de la CEMAC
dont elle assure le Secrétariat. La Commission est dirigée par un
Président. Elle composé de six Commissaires
désignés chacun par son Etat membre2. L'un des
Commissaires exerce la fonction de président et est secondé par
un autre qui assure la vice-
1 J. L. T. Mbassi Ondigui, "Les relations
culturelles entre Etats de la Communauté Economique et Monétaire
des Etats de l'Afrique Centrale", Thèse de Doctorat/Ph.D en histoire,
Université de Yaoundé I, Décembre 2014, pp.321-328.
2 Cf. Equipe dirigeante actuelle de la Commission de
la CEMAC, annexe N° X.
121
présidence. Les quatre autres Commissaires sont chacun
à la tête des départements techniques
ci-dessous3 :
- Département du Marché Commun (DMC) ;
- Département des Infrastructures et du
Développement Durable (DIDD) ;
- Département des Politiques Economiques,
Monétaires et Financières (DPEMF) ;
- Département de l'Education, de la Recherche et du
Développement Social, des
Droits de l'Homme et de la Bonne Gouvernance
(DERDSDHBG)4.
Le gouvernement de la Commission a un Mandat de 5 ans non
renouvelable. Les postes de Président et de Vice-Président sont
rotatifs par ordre alphabétique des noms des Etats membres. Par
ailleurs, le pays qui abrite le siège de l'institution ne peut occuper
le poste de Président ni de Vice-Président. La Commission
comprend aussi des cadres à régime international (Conseillers,
Directeurs, Sous-Directeurs, Chefs de Service et Experts), et des Agents locaux
recrutés sur place où se trouve le siège. Parmi les
cadres, l'Agent comptable et le Contrôleur financier sont nommés
par décision du Conseil des Ministres de l'UEAC. Pour raison
d'incompatibilité, ces deux postes ne peuvent être occupés
par des personnes ayant la même nationalité que le
Président ou le Vice-président. Par ailleurs, l'Agent comptable
avant de prendre fonction, prête serment devant la Cour de Justice de la
CEMAC et verse une caution. La Commission compte actuellement un effectif
d'environ 150 personnes. Son siège statuaire se trouve à Bangui
en République Centrafricaine sur l'avenue des Martyrs5.
Pour assurer sa représentation auprès des Etats
membres, elle dispose d'une Représentation dans chaque pays de la CEMAC.
Aussi seuls les ressortissants des six Etats de la Communauté peuvent
être employés à la Commission ainsi que dans toutes les
autres Institutions et Organes de la CEMAC. Le premier Président de la
Commission de la CEMAC est le Camerounais Antoine Ntsimi, nommé en 2007,
suivi du congolais Pierre Moussa en 2012. Actuellement c'est le gabonais Daniel
Nna Ondo depuis le 01 novembre 2017. Plusieurs femmes ont été
nommées au sein de la Commission de la CEMAC en tant que
vice-présidente de la Commission, mais aussi en tant que
représentantes auprès des Etats membres ou Directeurs,
Sous-Directeurs, Conseillers, Experts.
Parlant de la vice-présidence de la Commission de la
CEMAC, deux femmes ont déjà occupé ce poste jusqu'à
nos jours : Rosario Mbasogo Kung Nguidang de la Guinée Equatoriale
3 Cf. Equipe dirigeante actuelle de la Commission de
la CEMAC, annexe N° X.
4 Cf. Organigramme de la Commission de la CEMAC,
annexe N° XI.
5 www.cemac.int/qui sommes nous.
Consulté le 13/06/2019 à 6h30min
122
de 2012 à 2017 et Fatima Haram Acyl du Tchad qui
l'occupe depuis 2017.6 Il faut également noter qu'avant ces
femmes, ce poste de vice-président de la Commission a été
assuré par un homme en la personne de Jean Marie Maguena qui
siégeait à côté d'Antoine Ntsimi, Président
de 2007 à 20127. Cependant, les femmes n'avaient jamais
été ni Secrétaire principal, ni Secrétaire adjoint
à l'UDEAC. Mais elles ont travaillé en tant que fonctionnaires
à L'UDEAC. C'est ainsi qu'avec la décennie de la femme
lancée par les Nations Unies en 1975 et la réforme des lois de la
CEMAC comme l'introduction du PER en 2011 qui tient compte de
l'équilibre genre8, les femmes sont introduites à des
postes clés comme à la Commission ou les
Représentations-pays.
La première femme vice-Présidente de la CEMAC
est Rosario Mbasogo Kung Nguidang, de nationalité
Equato-guinéenne. Après ses études à
l'Université de Moscou, elle se voit confier les hautes
responsabilités dans son pays. Notamment au Cabinet du premier ministre
chargée de l'intégration sous régionale et du ministre
à la Présidence en charge de l'intégration. Ensuite elle
est Directrice générale de l'intégration régionale.
C'est ainsi qu'elle officie à partir de 2010 au sein de la Cellule
communautaire du Programme de la réforme institutionnelle de la CEMAC.
Elle s'est moulée dans les dossiers d'intégration notamment au
niveau sous régional, ce qui l'a conduit en 2012 à la
vice-présidence de la Commission de la CEMAC9. Elle a
été expert au sein de la Commission et a participé
à plusieurs conférences pendant qu'elle occupait ce poste,
contribuait dynamiquement à l'avancement de la sous-région. Cette
dernière a participé à plusieurs Conférences,
Sommets et Colloques au cours desquels elle a démontré
l'intelligentsia féminine pour l'évolution de la
CEMAC10.
6 www.cemac.int. Consulté le 12/08/2018
à 13h5min.
7 Vision CEMAC, publication de la CEMAC,
n° 001, 28 décembre 2010, p.2.
8 Lucien Henry Ticky, 47 ans, Expert Principal
CEMAC en circulation, entretien réalisé à la
Représentation CEMAC au Cameroun à Yaoundé, le
15/10/2018.
9 Vision CEMAC, n° 007, Septembre 2012,
p.9.
10 Jean Leonard Thierry Mbassi Ondigui, 47 ans,
Historien, entretien réalisé au département d'Histoire, le
20/03/2019.
123
Photo 15 : Rosario Mbasogo Kung Nguidang,
ancienne et première femme Vice-présidente de la Commission de la
CEMAC de 2012-2017.

Source :
https://www.google.com/search?source=hp&ei=Frk
XPP3046IackpIbgB&q=photo+ de+Rasario. Consulté le 24/04/2019
à 6h30min
En plus de cette dernière, Fatima Haram Acyl officie ce
poste depuis 2017. Détentrice d'un DEA en finance de l'Université
Xavier de Cincinnati aux Etats-Unis d'Amérique et d'une Maîtrise
en administration des affaires à l'Université de Moncton au
Canada, elle entame sa carrière aux Etats-Unis dans plusieurs cabinets
d'audits dont Pricewaterhouse Coopers (PwC). Elle a également
été Commissaire à l'Union Africaine en charge du Commerce
et de l'Industrie de 2012 à 2017. C'est ainsi qu'elle a contribué
valablement au processus d'intégration économique du continent en
vue de la mise en place de la Zone de Libre Echange Continental (ZLEC) et au
développement industriel de l'Afrique11. C'est ainsi que tous
ces atouts la porteront à la Vice-présidence de la Commission de
la CEMAC en 201712.
11 Vision CEMAC n° 007..., p.2.
12 Ibid.
13 Roger Faustin Ndzana, Lettre adressée
à Monsieur le Directeur Général de l'Agence de
Régulation des Télécommunications, Yaoundé, 04
avril 2013, p.1.
124
Photo 16 : Fatima Haram Acyl, actuelle
Vice-président de la Commission de la CEMAC depuis 2017.

Source :
https://www.google.com/search?source=hp&ei=Frk_XPP3046IackpIbgB&q=photo+de+Haram-acyl.
Consulté le 24/04/2019 à 6h30min.
Ces deux femmes susmentionnées démontrent la
place incontestée occupée par des femmes d'une grande
expérience professionnelle au sein des instances dirigeantes ou pilotes
de la CEMAC. En plus de la vice-présidence, d'autres femmes ont
été Commissaires au sein de la CEMAC et ont aussi joué un
rôle important. De même, d'autres continuent d'occuper ces postes
et jouent des rôles déterminant au sein de la CEMAC, pour
l'avancement de la sous-région. C'est le cas de Jacqueline Meyo Soua,
ancienne Commissaire à la Commission de la CEMAC. Elle a
participé à la concertation sur le système à mettre
en place pour le suivi des cargaisons par géolocalisation et par radio
communication sur les corridors Douala-Bangui et Douala-Ndjamena tenue en Mars
201313.
D'autres femmes ont parfois joué le rôle de
représentante des Commissaires de la CEMAC au cours des grandes
concertations internationales concernant la sous-région. C'est ce qui
ressort du rôle joué par la Centrafricaine Bernadette
Siéwé Youani, qui a représenté l'un des
Commissaires de la CEMAC lors de la Conférence tenue du 27 au 28
février 2014 à Yaoundé-Cameroun, organisée par la
Commission de la CEMAC et la Fondation pour les
125
Etudes et Recherches sur le Développement International
(FERDI), qui portait sur le renforcement de l'intégration pour
accélérer la croissance et les priorités pour la
CEMAC14.
En plus d'être Commissaire, les femmes ont occupé
de nombreux postes comme ceux de Directeur, Sous-Directeur, Conseiller ou
Expert, à travers lesquels elles jouent un rôle
considérable dans cette Communauté. Juliette Engoué par
exemple a été Sous-directeur du Commerce et de la concurrence
à la Commission de la CEMAC. Elle a joué le rôle de
rapporteur lors de la conférence sous régionale organisée
par la Commission de la CEMAC et la FERDI en 201415.
C'est également le cas dans la Commission où
l'on retrouve des professionnels libéraux agréés de la
fiscalité (CF et SCF) dont les femmes font parties.
Tableaux 9 : Quelques professionnels
libéraux agréés de la Fiscalités (CF/SCF) par la
Sous-Commission des Affaires Fiscales de la CEMAC à Ndjamena le Jeudi 26
Octobre 2017.
|
Numéros
|
Noms et Prénoms
|
Pays
|
Année
|
|
2
|
Bekolo Tataw Dorothy
|
Cameroun
|
2017
|
|
7
|
Ekotto Ndame épouse Bomsiti
|
Cameroun
|
|
1
|
Loudegue Evelyne
|
Centrafrique
|
|
3
|
Mokam Lipoe Laure Sylvie
|
Cameroun
|
|
5
|
Ngah Ohangza Léonie Christelle
|
Cameroun
|
|
6
|
Saha Nguefo Alice Laure
|
Cameroun
|
|
4
|
Zoundo Nimpa Hortense
|
Cameroun
|
Source : CEMAC, Sous-Commission des Affaires
Fiscales sur les agréments des Professionnels libéraux de la
Fiscalité (CF et SCF), Ndjamena, jeudi 26 octobre 2017.
Ce tableau ressort la liste des femmes que la Sous-Commission
des affaires fiscales de la CEMAC a accordé des agréments en
2017. Ces femmes ont obtenu leurs agréments lors des travaux du
Comité Inter-Etats tenus à Ndjamena, le Jeudi 26 octobre 2017.
Une séance présidée par Ahamad Teiro Issa le Directeur
adjoint des études de la législation et du contentieux à
la Direction Générale des Impôts,
délégué de la République du Tchad. La
troisième femme de ce Tableau, Loudegue Evelyne, Centrafricaine,
était par ailleurs Présidente du Comité Inter-Etats.
14 CEMAC, Conférence Sous
Régionale organisée par la Commission de la CEMAC et la
FERDI, "Renforcer l'intégration pour accélérer la
croissance : quelles priorités pour la CEMAC ?", Yaoundé, 27-28
février 2014, p.6.
15 Ibid., p.3.
126
A côté de cette Commission, plusieurs autres
femmes ont occupé de nombreux postes au sein d'autres organes de la
CEMAC, tels que la BEAC, la COBAC, la COSUMAF16.
La création de la Commission de la CEMAC en 2007 a
permis de mettre sur pied des Représentations-pays dans chaque Etat
membre. Ces Représentations-pays constituent des représentations
de la Commission de la CEMAC dans chaque Etat membre. Ainsi, à la
tête de chaque Etat, se trouve un Représentant de la Commission de
la CEMAC. Toutefois de 2007 à 2011, aucun pays de la CEMAC n'avait
encore accordé l'opportunité à une femme d'être
à la tête d'une Représentation-pays. C'est ainsi qu'en
2011, fut nommée à la tête de la Représentation de
la CEMAC au Cameroun, Malaïka Ndoumbe Ngollo. Cette dernière avait
occupé plusieurs postes à la Commission de la CEMAC, à
l'instar de celui chargé du développement et du partenariat,
avant d'être nommée à la tête de la
Représentation CEMAC Cameroun.
L'ancien Secrétariat Exécutif devenu la
Commission, est animée par un effectif de 130 personnes dirigées
par une équipe de six membres dont le président de la Commission,
le vice-président et quatre commissaires. En plus, six personnes par
représentation de celle-ci, soit un total d'environ 160 personnes pour
tout le personnel de la Commission. Aussi, les postes occupés respectent
le principe d'équilibre des pays dans la répartition entre les
six Etats membres de la CEMAC17. Même si cela ne tient pas
toujours compte de l'équilibre de genre. Ces femmes occupent aussi de
nombreux postes au sein des Institutions Spécialisées.
Il est constaté que les femmes au sein des
Représentations-pays n'ont pas encore connu un effectif
pléthorique jusqu'à ce jour. Lorsqu'il est noté
jusqu'à cette date qu'une seule femme a déjà occupé
ce poste dans une Etat membre : le Cameroun. Qu'est-ce qui pourrait justifier
une telle absence des femmes ? Cela pourrait renvoyer au manque de
volonté politique des Etats membres, à des textes adoptés
mais non appliqués par les Etats membres et toutes les barrières
qui peuvent exister en matière de limitation de la promotion des
femmes.
2. Des Institutions
spécialisées
On appelle Institutions Spécialisées, celles
issues des dispositions spéciales (art.1) du statut des fonctionnaires
de la CEMAC du 11 Décembre 200918. Il s'agit de l'ensemble
des
16 CEMAC, Conférence Sous Régionale
organisée par la Commission de la CEMAC et la FERDI..., p.4.
17 Mbassi Ondigui, "Les relations culturelles entre
Etats...", p.351.
18 Règlement N003109-UEAC-007-CM-20
Portant Statut des fonctionnaires de l'UDEAC, 11 décembre 2009,
p.2. Cf. annexe N° IX.
127
institutions citées au chapitre I. aussi, ces femmes ne
font pas l'exhaustivité de toutes les femmes présentes au sein de
ces Institutions spécialisées. Il s'agit de donner quelques
exemples de femmes à ces postes de soit Directeurs, Sous-directeurs,
Conseillers Principaux, Experts comptables, Président du Conseil
d'Administration (PCA), de simples agents. Pour mieux lister ces femmes, il est
capital de procéder par les tableaux. Ces Institutions choisies sont
entre autres : L'Ecole d'Hôtellerie et de Tourisme (E.H.T.), l'Ecole
Inter-Etats des Douanes (EIED), L'Institut Supérieur d'Economie et de
Statistiques Appliquées (ISSEA), le Comité des Pesticides
d'Afrique Centrale (CPAC), l'Organisation de Coordination pour la lutte Contre
les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC).
Tableaux 10 : Le personnel féminin dans
la direction de l'EHT- CEMAC de 2008 à 2011.
|
Noms et Prénoms
|
Fonctions
|
Pays
|
Années
|
|
Gertrude Nfono Edou
|
Directeur Général
|
Cameroun
|
200819
|
|
Angeline Florence Ngono
|
Représentant du Cameroun
|
Cameroun
|
2011
|
|
Mekondene Siankito Antoinette
|
Directeur des Affaires Administratives et Financières
|
//////
|
2011
|
|
Saïdou née Fatimatou
|
Agent comptable
|
//////
|
2008
|
Source : Echo de l'E.H. T-CEMAC,
N°002, Novembre 2011, p.3.
Ce tableau relève de nombreuses femmes qui ont
occupé des postes stratégiques au sein de l'E.H. T-CEMAC, et dont
le rôle a été déterminant en matière
d'hôtellerie et de tourisme en Afrique centrale zone CEMAC. Gertrude
Nfono Edou a été directrice de cette école pendant cinq
ans et son passage au sein de cette institution spécialisée de la
CEMAC lui a permis de contribuer à l'amélioration de la
qualité de l'enseignement et des infrastructures 20. Il en va
de même dans le Comité des Pesticides d'Afrique Centrale (CPAC)
où les femmes ne sont pas en reste, (cf. tableau 11).
19 Echo de l'E.H. T-CEMAC, n° 002,
Novembre 2011, p.3
20 Vision CEMAC, n° 001..., p.4.
128
Tableau 11 : Quelques fonctionnaires
féminins du CPAC de 2014 à 2017.
|
Noms et Prénoms
|
Fonctions
|
Pays
|
Années
|
|
Catherine Azouyangui
|
Directeur Général
|
|
201721
|
|
Marie Thérèse Ngo Dombol
|
Chef Service au CPAC
|
Cameroun
|
2014
|
|
Marie-Honorine Brahim
|
Inspecteur Phytosanitaire
|
Centrafrique
|
//////
|
|
Neloumta Madibe
|
Expert DPV
|
Tchad
|
//////
|
|
Suzanne Allogho Nsa
|
Agent LIEAP
|
Gabon
|
//////
|
Source : CPAC Info Pesticide,
N°0006, Avril-Juin 2009, p.16.
Initiative prise depuis 2001 au cours d'une réunion
organisée par AMEWG/GCP, d'initier une procédure d'harmonisation
des règlementations phytosanitaires en zone CEMAC. De fait, le CPAC voit
officiellement le jour en 2007 avec l'installation solennelle de son
Secrétariat permanent. Il s'agit pour les Etats de la CEMAC de faire
table rase sur les multiples législations en matière de
règlementations phytosanitaires, afin d'avoir une législation
commune et d'agir en synergie sur la question22.
Ce tableau relève en effet la participation des femmes
aux questions phytosanitaires de la sous-région. Leur rôle n'est
pas moindre à travers des différents postes qu'elles occupent.
Elles contribuent aussi à l'amélioration de la santé en
Afrique centrale. Catherine Azouyangui occupe le poste de Directeur
Général depuis 2017. En plus, l'enseignement est prisé
depuis la création des écoles sous régionales par les
femmes. C'est le cas dans l'ISSEA où le corps enseignant et
étudiant connaît la présence massive des femmes (cf.
tableau 12).
21 CPAC Info Pesticide, n° 0006, Avril-Juin 2009,
p.16.
22 Vision CEMAC, n° 001..., p.10.
129
Tableau 12 : Le Personnel enseignant
féminin de l'ISSEA de toutes les filières confondues en 2017.
|
Noms et Prénoms
|
Matière dispensée
|
Vacataire/Permanente
|
Pays
|
|
Christine Djockoua
|
Anglais
|
Vacataire
|
|
|
Colette Florence Mebada
|
Marketing
|
Vacataire
|
//////
|
|
Djiadeu née Njionwo
|
Anglais
|
Vacataire
|
//////
|
|
Edith Strafort Pedie
|
Analyse des données multidimensionnelles
|
Vacataire
|
//////
|
|
Elise Ndjiogoua
|
Anglais
|
Vacataire
|
//////
|
|
Emerentia Kongla Nkong
|
Anglais
|
Vacataire
|
//////
|
|
Suzanne Biwole
|
Français
|
Vacataire
|
//////
|
|
Yvonne Nane
|
Education physique
|
Permanente
|
Cameroun
|
|
Zang née Manjia M.
|
Mathématiques (Algèbre)
|
Vacataire
|
Cameroun
|
Source :
www.issea-cemac.org/index.php,
consulté le 25/04/2019 à 15h30min. GAGE
Ce tableau représente la liste des femmes faisant
partir du corps enseignant de l'ISSEA en 2017. Bien que minoritaire, elles
contribuent à l'apprentissage sous régional à travers des
disciplines multiples qu'elles dispensent aux différents
étudiants de la sous-région23. Aussi, quatre (4)
femmes sont secrétaires24. Ces secrétaires sont
respectivement : une Secrétaire principale et une assistante au
Secrétariat, la Secrétaire du Directeur général et
la Secrétaire du Directeur des études, toutes de
nationalité camerounaise. A côté de celles-ci, l'on
retrouve également une bibliothécaire et une femme
vigile25.
Il en est de même de l'OCEAC, une Institution
spécialisée qui connait aussi l'expertise féminine dans le
domaine de la santé, pour la lutte contre les endémies en Afrique
Centrale. Leur nombre est également pléthorique et à de
postes stratégiques. C'est le cas de Emilienne Yissibi Pola de
nationalité Congolaise, Expert Consultant au sein de cette organisation
depuis 201326.
23 Rapport d'activités de l'ISSEA,
année académique 2009-2010, p.4.
24 Rondo Lemercier, 24 ans, Etudiant centrafricain
à l'ISSEA en 4eme année IAS, entretien
réalisé à l'ISSEA, le 14/02/2018.
25 Claudine, 23 ans, étudiante camerounaise
à l'ISSEA, filière IAS 3eme année, entretien
réalisé le 10/05/2019.
26 Le Magazine de l'OCEAC, N°003,
Juillet 2003, p.29.
130
En outre, les femmes contribuent efficacement à la
dynamisation de l'EIED et occupent des postes prestigieux, (Cf. tableau13)
27.
Tableau 13 : Quelques femmes de 2010 à
2013 au sein de l'EIED
|
Noms et Prénoms
|
Fonctions
|
Pays
|
Années
|
|
Evelyne Loudege
|
Inspecteur des Services
Douaniers
|
Centrafrique
|
2010
|
|
Naissem Oulatar
|
Formateur permanent
|
///////
|
2013
|
|
Rita Taba
|
Chargée d'Etudes
|
Gabon
|
2010
|
Source : Projet du programme
d'activités de l'EIED, Note de présentation du projet du
Budget d'exercice 2011, p.4.
Ce tableau n'étant point exhaustif, laisse voir que la
femme n'est pas exempte du secteur des douanes, elle contribue également
aussi à l'implémentation du secteur douanier dans la
sous-région28 . En plus des Organes et Institutions
spécialisées étudiées ci-dessus, les femmes
occupent des postes au sein de d'autres structures comme les Associations
partenaires de la CEMAC. En plus de ces institutions
spécialisées, la femme joue un rôle important dans la CEMAC
à travers d'autres structures partenaires de la CEMAC.
3. Les autres structures partenaires de la
CEMAC.
Les femmes occupent également des postes dans plusieurs
autres structures qui sont considérées comme des Associations
partenaires de la CEMAC au sein desquelles elles jouent un rôle important
et militent considérablement pour une cohabitation pacifique et
prometteuse pour la dynamisation de la sous-région. C'est le cas
notamment de la Synergie Jeune-CEMAC, du REFAC.
a. Cas de la Synergie Jeune-CEMAC
Suite à la conférence des Chefs d'Etats de la
CEMAC tenue à Yaoundé du 24 au 25 Juin 2008 sous la
Présidence de Paul Biya, Président en exercice et au
Communiqué final qui stipule que la Conférence a par ailleurs
décidé de l'institutionnalisation d'une "Journée CEMAC"
dans les Etats membres le 16 Mars de chaque année, correspondant
à la signature du traité instituant la CEMAC en vue de la
sensibilisation des populations aux idéaux de l'intégration et du
renforcement de l'esprit communautaire nait l'idée de fonder la
SJ-CEMAC.
27 Projet du programme d'activités de
l'EIED, Note de présentation du projet du Budget d'exercice 2011,
p.4.
28 Lucien Henry Ticky, entretien.
131
Cette Synergie voit officiellement le jour le 18 Septembre
2008, en tant que structure sous régionale favorisant le brassage des
cultures entre les jeunes de la Communauté. Elle oeuvre pour devenir un
jour "Institution spécialisée de la CEMAC en charge des questions
relatives à la jeunesse communautaire"29 et a pour objectif
:
- faire connaître l'institution d'intégration
sous régionale, la CEMAC en vulgarisant : sa création, sa
structure, ses institutions spécialisées, ses grands chantiers.
Aussi, la libre circulation des personnes et des biens, Air CEMAC, le passeport
biométrique CEMAC, Programme Economique Régional (PER), le
Programme d'Intégration Régionale (PIR), l'Accord de Partenariat
Economique (APE). Mais aussi ses progrès à travers ses
réalisations, sa vision future.
- exalter et renforcer les liens de fraternité entre les
peuples des six Etats membres ; - Favoriser les échanges
interuniversitaires, mutualiser les ressources de formation existant dans la
zone et encourager la création de pôles d'excellence ;
- encourager les rencontres entre hommes d'affaires, et entre
opérateurs économiques et culturels de la sous-région ;
- organiser des rencontres sportives entre les Etats membres.
La SJ-CEMAC est une association reconnue par la CEMAC au sein
de laquelle les femmes occupent de nombreux postes et jouent un rôle
considérable. C'est le cas de Ruth Kamga, nommée
"Représentante et Ambassadrice" de la SJ-CEMAC.30 Nina Baho
qui est également déléguée générale
à l'Intégration/SJ-CEMAC depuis le 04 février
201231. Cette structure organise en collaboration avec plusieurs
écoles communautaires, des journées CEMAC qui connaissent
l'affluence aussi bien des hommes que des femmes.
b. Cas du REFAC et de la FOTRAC
Le Réseau des Femmes Actives de la CEMAC est
fondé en 2007 à Douala et légalisé en Janvier 2008.
Il regroupe des individus, des Groupes d'Initiatives Communes (GIC), des
associations et d'autres groupes d'Afrique centrale, sans distinction
d'âge, de race, de sexe ou de religion. Organisation non-gouvernementale
à but non lucratif et apolitique, son but premier est de fraterniser par
des échanges économiques et socioculturels. Ce Réseau a
progressivement installé ses antennes au Cameroun (2007), en RCA (2008),
au Gabon (2009), au Tchad (2010),
29 Journée internationale des jeunes de
la CEMAC, objectif citoyen, le courrier de la SJ-CEMAC, kit pour la
mobilisation et la sensibilisation, 1ere Edition, 18 Septembre 2012,
p.2.
30 Le Relais de l'Intégration, n°
0006, Juin 2012, SJ-CEMAC, p.4.
31 Ibid., p.7.
132
au Congo-Brazzaville (2011). Par ailleurs, des
activités sont organisées avec la Guinée Equatoriale
depuis 2011, dans le cadre de la foire transfrontalière annuelle. Cette
structure étend désormais ses tentacules en Angola et Sao
Tomé et Principe par des points focaux.
Le Réseau des femmes actives de la CEMAC oeuvre pour
lutter contre la pauvreté en fraternisant les femmes de la
sous-région d'Afrique centrale quelque soient leurs secteurs
d'activités, pour un développement durable. Il aide les femmes
à contribuer elles-mêmes à leur épanouissement tout
en les mettant en relation, pour des échanges fructueux. L'objectif
principal étant de favoriser l'intégration sous régionale
et lutter contre la pauvreté32.
Aussi, les activités du REFAC s'articulent sur le
développement agropastoral et artisanal, des voyages d'échange,
d'étude, de découvertes des sites, des symposiums, des
séminaires, des formations, des séminaires culturels, des
activités sportives. D'autres activités sont menées dans
le cadre de la santé, à travers les campagnes de sensibilisation,
de promotion et de prévention, avec notamment le VIH, la
drépanocytose, le diabète, le cancer et d'autres, la distribution
des moustiquaires imprégnées dans les zones à risques, le
soutien et l'assistance aux personnes fragilisées par les maladies ou
vivant dans la précarité (enfants, femmes, personnes
âgées). Une attention particulière est accordée
à la formation, la sensibilisation des groupes sur la lutte contre
toutes formes de violences, contre l'utilisation des Armes
Légères et de Petits Calibres (ALPC), en vue d'éradiquer
les trafics illicites des armes et humains33.
Par ailleurs, les femmes du REFAC demandent un accompagnement
beaucoup plus accru pour le développement des économies des pays
d'Afrique centrale et l'amélioration de la qualité de vies des
femmes (renforcement de leurs projets pour autonomiser tant la femme rurale
qu'urbaine car elles ont un large potentiel qui nécessite beaucoup plus
de considération et d'attention). A la tête de cette association,
se trouve Danielle Nlaté qui est la présidente fondatrice de ce
réseau des femmes dynamiques d'Afrique Centrale. Elle travaille
également avec plusieurs autres femmes de presque tous les secteurs
d'activités, qu'elles soient des femmes rurales ou urbaines et de
nationalités différentes, (cf. tableau 14).
32 Rapport FOTRAC 2016, 7e
édition du 25 juin au 9 juillet 2016 à Kyé-Ossi,
frontière Cameroun-Gabon-Guinée Equatoriale, p.5.
33 Etienne Nguema, 38 ans, Administrateur civil au
Gabon, participant de la Fotrac 2017, entretien réalisé à
Kyé-ossi le 25/06/2017.
133
Tableau 14 : Responsables féminins du
REFAC de cinq pays de la CEMAC.
|
Noms et Prénoms
|
Pays
|
|
Caroline Engome
|
RCA
|
|
Céline Narmadji
|
Tchad
|
|
Gisèle Solange Massala
|
Congo Brazzaville
|
|
Jeanne-Danielle Nlaté
|
Cameroun
|
|
Léna Lobe Edimo
|
Cameroun
|
|
Micheline Esseng Tomo
|
Gabon
|
Source : Rapport FOTRAC 2016,
7e édition du 25 juin au 9 juillet 2016 à
Kyé-Ossi, frontière Cameroun-Gabon-Guinée Equatoriale,
p.5.
Ce tableau présente le Bureau du personnel dirigeant et
représentant l'Association dans les différents pays de la
sous-région34. Il faut noter qu'en plus du rôle
économique du REFAC dans la communauté, c'est un organisme de
promotion culturelle dans la cadre de la FOTRAC.
Cette Foire est créée en 2010 par Danielle
Nlate. En 2013, elle s'étend désormais sur 14 jours contre 9 pour
les éditions précédentes. C'est une Foire multisectorielle
qui regroupe les acteurs de développement de tous les pays d'Afrique
centrale et les Administrations, les Chambres consulaires, les Organisations
Internationales, les Chancelleries, les Instituts de Recherches, les
Opérateurs Economiques. C'est un espace d'échanges, de partage
d'expériences surtout dirigé en faveur des femmes dans le cadre
de l'amélioration de leurs conditions de vie en milieu urbain et rural
pour une meilleure implication de celle-ci dans le développement de la
sous-région. Il s'agit d'un événement fort du
Réseau des femmes actives de la CEMAC35 qui se veut de
faciliter les échanges socio-économiques et culturels, la libre
circulation des personnes et des biens sans contrainte ni discrimination.
L'objectif est de sensibiliser et lutter contre la pauvreté dans la
CEMAC auprès de la gente féminine qui représente un
pourcentage élevé de la population de la
sous-région36.
Née de l'idée de pallier aux souffrances dont
les femmes font face aux frontières, la foire va s'intensifier davantage
par les contacts dans les régions de chaque pays de la CEMAC. Aussi,
l'idée sera initiée à la frontière commune Cameroun
- Gabon - Guinée Equatoriale37. Ce qui explique le choix de
la ville de Kyé-Ossi comme site principal de la FOTRAC.
34 Lucien Henry Ticky, entretien.
35 FOTRAC 2016 : du 25 juin au 09 juillet 2016
à Kyé-Ossi, frontière Cameroun-Gabon - Guinée
Equatoriale, 7e édition, p.5.
36 Afrique Centrale, Dossier
intégration, n° 109., p25.
37 Interview réalisée par Ruben
Tchounyabe à Danielle Nlate, Présidente du FOTRAC, in
Intégration n° 106, p.11.
134
Il est question pour les femmes, explique Danielle Nlate par
l'intermédiaire d'un entretien :
De réussir davantage là où les hommes
trainent le pas, à savoir, consolider l'intégration sous
régionale. En réunissant les femmes auteures d'une idée,
l'on est certain que les hommes accompagneront. La FOTRAC est surtout
dirigée par les femmes afin d'améliorer leurs conditions de vie
en milieu urbain et rural, pour leur meilleure implication dans le processus de
développement et d'intégration de la sous-région. Il
s'agit de l'autonomisation de la femme.38
Les activités de la Foire reposent sur les
expositions-ventes dans le village de la Foire, les espaces d'échange
entre les différents exposants pour d'éventuels partenariats et
joint-ventures, des espaces de promotion, des conférences-débats,
divers ateliers de formation des femmes à la prévention des
conflits, la paix et la sécurité en Afrique, des animations
culturelles avec des artistes de renommée internationale. Des groupes de
danse traditionnelle, et un tournoi de football féminin et masculin
baptisé "Tournoi de la fraternité" regroupant les équipes
du Cameroun, du Gabon, de la Guinée Equatoriale et une équipe
constituée des ressortissants des autres pays participants. Le premier
tournoi a débuté le 17 Juin 2014 et la finale s'est jouée
le 21 Juin 2014, suivie d'une marche sportive pour la paix et
l'intégration sous régionale, une campagne de sensibilisation
santé sur les grandes pandémies et les endémies de l'heure
(VIH, diabète, hypertension, cancer du sein).
Il existe d'autres associations comme le Réseau des
femmes parlementaires d'Afrique centrale, qui sont également des
organismes associatifs qui jouent un rôle important pour la promotion de
la femme en Afrique centrale et la dynamisation de la CEMAC. En plus d'occuper
de nombreux postes dans les structures de la CEMAC, les femmes jouent aussi un
rôle important comme démontré plus haut, (cf. chapitre
II).
B. L'IMPACT DE LA CONTRIBUTION DIPLOMATIQUE DES FEMMES
DANS LA CEMAC
La contribution des femmes dans les domaine politique,
économique et socioculturel dans la CEMAC, impacte
considérablement sur les questions de la sous-région.
1. La prise de grandes décisions et la
réforme des politiques communautaires
Le rôle des femmes dans la CEMAC entraine leur
présence dans la prise des grandes décisions de la
communauté, la réforme des politiques communautaires. Pour ce qui
est de la prise des grandes décisions, les femmes participent au
même titre que les hommes à des grandes
38 Entretien réalisé par
Marie-Noëlle Cruchi à Danielle Nlate, in Mutations,
n° 3163, 2012, p.7.
135
rencontres sous régionale au travers desquelles sont
élaborées les grandes politiques de la
Communauté39. C'est le cas de la Conférence sous
régionale organisée par la Commission de la CEMAC et la FERDI qui
portait sur le renforcement de l'intégration pour
accélérer la croissance notamment sur les priorités de la
CEMAC. Au cours de cette conférence tenue du 27 au 28 Février
2014 au Cameroun à l'hôtel Hilton de Yaoundé, plusieurs
femmes de la CEMAC ont pris part à cette rencontre internationale et ont
exposé leurs différents points de vue sur cette question de
l'intégration dans la CEMAC. Il s'agit notamment de Minette Libom
Lilikeng, directrice générale des Douanes camerounaise en cette
période, actuelle Ministre des postes et des
télécommunications. Elle a présenté l'état
des lieux des douanes en Afrique centrale, tout en ressortant quelques points
sur lesquels il faut palier40.
Aussi, Juliette Engoué, sous-Directrice du commerce et
de la concurrence à la Commission de la CEMAC a pris part à cette
conférence, au nom du directeur du commerce et de la concurrence
à la Commission de la CEMAC. Son exposé donnait la quintessence
sur la situation du commerce et de la concurrence dans la CEMAC. C'est dans
cette même ardeur que Rosario Mbasogo Kung Nguidang,
Vice-Présidente de la Commission de la CEMAC a pris part à cette
rencontre41. Au cours de cette conférence, de nombreuses
décisions sur l'intégration ont été adoptées
par le gouvernement de la CEMAC pour renforcer le processus
d'intégration dans la CEMAC et limiter les barrières
inter-états42.
En outre, la conférence entre le Fonds Monétaire
International (FMI) et les institutions de l'Afrique centrale a connu la
participation de de nombreuses femme parmi lesquelles : Babakas. Etant chef de
service à la Commission Bancaire d'Afrique centrale, elle a
participé au nom de la CEMAC à cette conférence pour
contribuer au processus d'allocation financier des institutions de Bretton Wood
en Afrique centrale43.
Pour ce qui est de la réforme des politiques de la
communauté, au cours des débats, des conférences, des
assises communautaires, des conférences des Chefs d'Etats et de
gouvernements, sont élaborées les nouvelles politiques de la
sous-région. Dans cette perspective, des femmes participent au
même titre que les hommes à l'élaboration des politiques
39 Marcelline Mebounou, 32 ans, Sous-directeur de
la sous-direction Afrique au MINREX, entre réalisé au Minrex le
24/01/2018.
40 CEMAC, Conférence Sous Régionale
organisée par la Commission de la CEMAC et la FERDI, pp.2-5.
41 Ibid.
42 Marie Gaspar Nicolas Messi, 52 ans, Assistant de
la Représentante de la CEMAC au Cameroun, entretien
réalisé à la Représentation de la CEMAC au Cameroun
à Yaoundé, 23/01/2018.
43 Liste des participants, Consultations
FMI/Institutions de l'Afrique centrale, Yaoundé, 2006, pp1-2.
136
de la sous-région, comme Secrétaires,
assistantes. Même si faut noter qu'elles ne participent pas directement
entend qu'esprit d'initiatives ou de proposition des politiques à
adoptées44. Cela est d'autant plus visible car elles
n'occupent pas de postes de président de la République et quand
même elles sont ministres, les hommes sont majoritaires. Toutefois, leur
rôle dans la CEMAC permet également la promotion du secteur
économique.
2. La promotion de l'intégration
économique dans la CEMAC et le vivre ensemble
Le processus d'intégration économique est l'un
des idéaux visés par la CEMAC. Les femmes ont pris très
tôt l'initiative de participer au processus d'intégration de cette
communauté. Elles contribuent à cet idéal à tous
les niveaux. Sur le plan agricole, elles sont pourvoyeuses de produits
agricoles qui contribuent à alimenter la
sous-région45. En tant que population majoritaire de la
CEMAC, leur main d'oeuvre est abondante. Etant donné qu'elles vendent
ces produits à proximité des frontières et au-delà
de leurs pays, elles facilitent l'intégration
économique46, et même les produits de l'aquaculture.
Les femmes participent à la dynamisation de la pêche sous
régionale à travers non seulement le projet de pêche
continentale lancé par la CEMAC en étroite ligne avec la
politique de l'Union africaine de pêche continentale, mais aussi par de
petits étangs privés47.
Le commerce est une activité qui a toujours connu un
afflux de femmes. Néanmoins elles sont présentes lors du commerce
à l'intérieur du pays ou de la sous-région et surtout au
niveau des zones frontalières48. Les frontières de la
CEMAC connaissent à cet effet un flux de petits commerçants et
commerçantes qui le plus souvent n'ont pas l'opportunité,
à cause des barrières douanières ou des moyens
limités pour faire du commerce au-delà des frontières
nationales. Plusieurs d'entre elles rencontrent des difficultés
liées au manque des documents officiels notamment le passeport, le
certificat de commerce49. Mais l'on ne saurait refouler
l'idée selon laquelle toutes ces activités économiques
frontalières ou transnationales contribuent à petite ou à
moyenne échelle, à l'alimentation des Etats de la CEMAC. De fait,
il est observé de nombreux touristes africains et internationaux dans
ces localités50.
44 Lucien Henry Ticky, entretien.
45 Idem.
46 Idem.
47 CEBEVIRHA, n° 003, Juin 2012, p.8.
48 Carine Djomo, 35 ans, Commerçante
Camerounaise, Yaoundé, le 25/06/2018.
49 Idem.
50 Etienne Nguema, entretien.
137
L'on pourrait ainsi affirmer que les femmes contribuent
à la dynamisation de l'économie sous régionale par
l'organisation des foires comme la FOTRAC, qui a un double volet :
économique et culturel. Elle a lieu chaque année entre Juin et
Juillet en fonction du calendrier établi par le REFAC et connait
l'exposition de nombreux produits agricoles, aquacoles, artistiques
cosmétiques et bien d'autres. Tout ceci contribue à promouvoir le
vivre ensemble dans cette communauté.
Le vivre ensemble est un idéal cher à tous les
Etats de la CEMAC. Il permet aux populations d'horizons divers51 de
cohabiter pacifiquement. Les femmes participent également à cet
idéal à travers le commerce inter-frontalier, mais aussi par
l'organisation des foires communautaires comme la FOTRAC et la FOTAC. Ces
solennités connaissent généralement la présence
massive des populations féminines venues de tous les horizons. Ces
populations apportent chacune son savoir-faire économique, culturel. De
nombreuses festivités ont lieu et sont des moments de
convivialité entre les peuples de la zone CEMAC, mais aussi de d'autres
sous-régions.52 Tout ceci permet de rapprocher les peuples et
d'éloigner la violence, les conflits entre les
africains53.
C. DES PERSPECTIVES POUR UNE MEILLEURE PROMOTION DE LA
FEMME DANS LA CEMAC
Les progrès les plus importants ont été
constatés en matière d'enseignement, que ce soit
l'alphabétisation ou l'instruction élémentaire dans la
plupart des pays de la CEMAC. Cependant, le bilan partiel des progrès
réalisés depuis en matière de considération ou de
promotion de la femme souligne que les femmes, malgré les mesures
adoptées sont toujours désavantagées en terme de salaire
et de nomination aux postes de responsabilités dans la CEMAC. C'est
ainsi qu'il est fondamental de ressortir dans le cadre de ce travail, quelques
mesures pour une considération équitable de l'homme et de la
femme dans la CEMAC54.
1. Des mesures institutionnelles
De nombreuses mesures sont entrevues sur le plan
institutionnel afin de mieux promouvoir la femme dans la CEMAC. L'institution
est une structure légale qui implémente
51 La diversité d'horizons ici renvois aux
origines, au pays, à la langue, à la culture et tout ce qui peut
faire la différence entre les individus. D'après Mbassi Ondigui,
entretien.
52 Carine Djomo, entretien.
53 Etienne Nguema, entretien.
54 Jean Léonard Thierry Mbassi Ondigui,
entretien.
138
les politiques élaborées à base des lois
obtenues par un consensus. C'est ainsi qu'il convient de créer des
commissions nationales sur les droits de la femme chargées de
préparer les projets de textes, en vue d'harmoniser les
législations nationales avec les conventions internationales, de combler
les vides juridiques et d'éliminer tous les obstacles à la
promotion de la femme. Ces commissions devront également travailler en
étroite collaboration avec les structures tant publiques que
privées pour des résultats plus probants. Il faut
également renforcer les institutions en vue d'établir des droits
égaux et des opportunités égales pour chaque tous. Cela
permettra une représentation égale des deux sexes dans les postes
de responsabilité au sein des institutions, et de surcroit une meilleure
plus-value sera observée dans cette institution55.
La réforme institutionnelle nécessite
également la mise sur pied des structures de contrôle et
d'évaluation au niveau des Etats, dont la dynamique permettra de
propulser la cause sous régionale. Ces structures devront suffisamment
être indépendantes afin de rendre des résultats
authentiques pour une meilleure action. Il faut doter les structures existantes
des infrastructures suffisantes, des formations appropriées et des
ressources financières suffisantes en créant par exemple un Fonds
spécial pour la femme et ce fonds devra être géré
par les femmes elles-mêmes pour la réalisation des projets de
développement relatif au développement des femmes et bien
évidemment dans le cadre national et de la communauté. En plus de
ces fonds nationaux, il devrait être inclut un fonds sous régional
pour la dynamisation des femmes de la sous-région CEMAC, avec un
comité de suivi.
Il est également judicieux de penser à
l'institutionnalisation du système de quota par le biais d'un texte
légal. Ce quota contribuera à équilibrer aussi des
responsabilités au sein des instances de la CEMAC56. Ceci
devrait également être valable dans toutes les Institutions
Spécialisées concernant tant les fonctionnaires à
régime international que les fonctionnaires à régime
local. En ce qui concerne la journée de la femme
décrétée depuis 1975 il importe de mettre sur pied, un
comité en charge de l'organisation des journées de la femme,
journées au cours desquelles l'on pourrait par exemple mieux expliquer
le bien-fondé d'une journée internationale de la femme, afin
d'éviter des cas de dérives des femmes pendant cette
dernière57, dépravations qui conduisent parfois
à la perte de vie par certaines femmes, voire même à la
destruction des foyers conjugaux.
55 Norbert Obasseliki, 55 environ, 1er
Conseiller à l'Ambassade de la République du Congo au Cameroun,
entretien réalisé à l'Ambassade du Congo le 14/06/2019.
56 Idem.
57 A. Moneyang Yana, "La promotion et la protection
des droits sociaux de la femme en Afrique centrale : cas du Cameroun", Rapport
de stage en relations internationales, IRIC, 2015-2016, p.35.
139
En 2007, la Commission de la CEMAC remplace le
Secrétariat Exécutif. Cette Commission est
représentée dans chaque Etat membre. Toutefois, il est
observé qu'il n'existe pas une Commission en charge des questions de
genre ou de la femme. Alors que la femme malgré son fort
déploiement dans cette organisation, reste moins
représentée à des postes stratégiques. Cela
nécessite dès lors la création d'une Commission sous
régionale en charge des questions de genre. Ladite Commission devra bien
évidement avoir des représentations nationales. En effet, la
Commission aura pour objectif de contribuer à la promotion de la femme,
renforcer, favoriser la prise en compte des politiques visant l'autonomisation
des femmes dans toutes les politiques communautaires en adéquation avec
les politiques nationales en zone CEMAC et veiller à l'exécution
de celle-ci. La Commission devra également lutter contre les
discriminations fondées sur le sexe et sensibiliser les citoyens de la
communauté à l'importance de la femme dans tous les domaines de
la vie, en fournissant une assistance technique aux autorités des Etats
membres. Elle devra conduire ses activités de manière
indépendante dans l'intérêt des citoyens. Cette Commission
aura une personnalité juridique et devra être
autonome58. Il nécessite aussi des améliorations dans
le cadre juridique car ce sont de bonnes lois qui font de bonnes
institutions
2. Dans le cadre juridique
Plusieurs mesures sont également à
élaborées dans le cadre juridique pour une meilleure
considération la femme dans la CEMAC. Parmi les principales mesures
juridiques à prendre au niveau communautaire pour assurer la
réalisation "des objectifs d'égalités", on peut souligner,
l'accès à la terre et autres moyens de production, à la
formation et au crédit pour toutes les femmes. La terre a longtemps
été perçue comme propriété masculine. Dans
certaines familles dans la CEMAC, il est communément reconnu que la
femme n'a pas le droit d'hériter que ce soit la terre ou aux biens
légués par un parent ou un tiers. Par contre, l'homme occupe
toujours la place de chef de famille et "naturellement" reconnu comme
héritier du défunt ou de la défunte. Cette conception de
la femme ne lui permet pas ainsi au fil des années, de jouir des biens
comme la terre et limite par conséquent ses propriétés.
Car même les espaces cultivés sont le plus souvent la
propriété d'un homme ou familiale. Face à cette
discrimination domaniale, les Etats de la sous-région devraient
élaborer des législations fortes pour promouvoir partout
l'accès des terres aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Quant à
l'accès aux crédits, les lois sur les finances doivent connaitre
une modification pour un accès de tous
58 Jean Léonard Thierry Mbassi Ondigui,
entretien.
140
(homme/femmes) aux crédits pour le financement des
projets, sans d'abord demander la permission de l'époux. Toutes lois
devraient non seulement être élaborées par chaque Etat
membre, mais aussi par un consensus sous régional59.
Pour ce qui est spécifiquement des droits de la femme,
ils ont généralement connu des abus que ce soit dans le cadre
familial que professionnel. Il est donc juste de renforcer des dispositions en
matière des droits de la femme et cela implique le fait que les
instruments juridiques déjà concluent soient scrupuleusement
appliqués et que des mesures pénales soient prises à
l'égard de tous ceux qui violent ces droits. Aussi, il est important de
maximiser la communication en ce qui concerne les droits des femmes notamment
à l'éducation par la sensibilisation de tous les acteurs
juridiques au respect des textes et l'encouragement des femmes à
revendiquer leurs droits et surtout les mettre en confiance afin qu'elles
puissent briser le silence. Comme il est de coutume observé que les
femmes victimes des abus de tous sortes préfèrent ou sont souvent
forcées au silence pour éviter d'être la rusée de
son environnement et ne pas être traitée de sycophante de la
société60.
Par ailleurs, la mise sur pied d'une politique commune en
matière de promotion des femmes permettra à la CEMAC
d'accélérer l'exécution de son mandat qui consiste en la
promotion du développement économique, social et culturel de la
sous-région à travers la coopération et
l'intégration. Aussi, cela aidera l'intégration de toutes les
couches sociales et permettra de réaliser tous les objectifs permettant
de consolider les efforts déployés par le passé en
matière d'égalité de genre.
L'échantillon des législations de la CEMAC doit
connaître une augmentation par l'élaboration des lois qui
garantissent l'égalité de la femme dans tous les secteurs
d'activité. La CEMAC, bien qu'étant une Communauté
économique et monétaire, couvre aussi le volet politique et
social. La garantie et l'application de tous les droits de la femme dans tous
ces domaines lui permettra de participer et de contribuer avec dynamisme
à la transformation de la CEMAC, par le travail qu'elles
réalisent déjà pour l'intégration des Etats membres
à travers aussi des groupes d'association, le commerce qu'elles
effectuent dans les zones frontalières et qui facilite le vivre ensemble
au sein de cette Communauté.61
Il faut élaborer un manifeste sous régional des
femmes en étroite ligne avec les politiques nationales, soutenant et
formant les femmes candidates aux élections (le manifeste
59 Moneyang Yana, "La promotion et la protection des
droits sociaux de la femme en Afrique centrale...", p.40.
60 A. Foulda, "Rapport de stage Académique
au Ministère de l'action sociale, de la solidarité nationale du
16 Octobre 2013 au 31 septembre 2014", Master professionnel en sociologie,
Université de Yaoundé I, 2014.
61 Moneyang Yana, " La promotion et la protection
des droits sociaux de la femme en Afrique centrale... ", p.40.
62
https://journalintegration.com/fotrac-2018-place-a-linterregionalisme-bas/.
Consulté le 19/04/2019 à 16h30min 63 Norbert
Obasseliki, entretien.
141
doit être un instrument de persuasion des hommes et des
femmes afin qu'ils/elles votent pour la femme, lorsque cette dernière
répond aux critères d'éligibilité). Il faut
organiser des ateliers dans tous les pays de la sous-région,
destinés à accroître les cadres de concertation sur les
sujets relatifs au statut de la femme, mais renforcer des capacités des
femmes à négocier. Il s'agit en effet de dénombrer les
femmes membres des institutions de formation par Etat membres de la CEMAC.
Apporter un appui à leur formation politique et renforcer leurs
aptitudes en communication/sensibilisation, tout en créant un
événement autour d'elles et les aider à préparer
leurs projets de campagne.
Il est important que les Associations féminines comme
le REFAC, soient reconnues comme des Institutions spécialisées de
la CEMAC et bénéficient des budgets annuels pour un meilleur
fonctionnement car leur champs d'action dépasse le cadre sous
régional et connaît la participation des pays de d'autres
sous-régions d'Afrique. C'est le cas, de la Foire
Transfrontalière de 2018 qui a connu la participation de nombreux pays
de l'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal, le Burkina Faso, la
Côte d'Ivoire62. En plus, le REFAC à travers la Fotrac
contribue non seulement à unir les peuples, mais à
développer le potentiel économique de la CEMAC et de l'Afrique en
générale.
Les Etats de la CEMAC doivent fructifier les échanges
entre eux, dans un cadre multilatéral qui devrait surpasser le cadre
bilatéral. Et ces échanges sur tous les plans devraient
être régis par des textes bien élaborés qui tiennent
compte de la promotion des deux sexes à travers le système de
quota. Pour ce qui est des conférences dans le cadre de la
communauté, avec d'autres organisations internationales ou d'autres
Etats hors de la CEMAC, la représentation devrait être
équilibrée en matière d'effectif entre les hommes et les
femmes. Il devrait avoir autant d'hommes que de femmes, tout en prenant en
compte le facteur compétence. Ce qui revient ici à questionner
les formations initiales tant au niveau national que sous
régional63.
3. Des mesures dans le cadre
sociopolitique
De nombreux éléments sociopolitiques continuent
d'entraver le dynamisme de la femme dans la CEMAC. D'où la
nécessité de remédier à cela.
Pour rendre le travail de la femme plus aisé, l'Etat
doit se montrer assez fort afin que soient éradiquées toutes les
pesanteurs socioculturelles défavorables au plein épanouissement
de la femme, l'éradication des violences à l'égard des
femmes. Nos traditions et coutumes ont
142
longtemps dénié le potentiel féminin dans
le développement de la vie extraconjugale. La femme a longtemps fait
l'objet d'une appartenance au foyer, s'occuper du ménage, des enfants et
du bien-être de son mari, qui lui est considéré comme le
maître de la vie hors du foyer, un "ministre de l'extérieur".
Il faut maximiser les capacités d'instruction des
femmes par la création des infrastructures scolaires et l'inscription
massive des femmes à ces écoles. Il faut noter que, même si
ces mesures existent dans ces différents Etats de la CEMAC, il est
capital qu'elles soient appliquées sans "condition". Longtemps il a
été considéré que l'homme doit poursuivre ses
études alors que la femme doit se préparer pour son futur foyer.
Cette conception de la femme a fait d'elle une analphabète et une
incapable de s'exprimer en publique, à cause de la non-maîtrise
des langues nationales et du dénie de le faire, qui a été
imposé par la société et perpétué par sa la
famille et ou sa belle-famille. La lutte contre l'analphabétisme des
femmes passe ainsi par la mise sur pied de nouvelles stratégies
encourageant l'éducation des jeunes filles, garantir le libre
accès des femmes à tous les niveaux d'enseignement, de formation,
d'emploi et de service de santé, lutter contre l'ignorance des droits
des femmes, par la création d'un centre de recherches d'informations et
documentation sur la femme dénommée pourquoi pas, "la Maison de
la femme"64.
Développer des possibilités d'emploi qui
permettent aux femmes de subvenir à leurs besoins est important, cela
leurs permettra d'être autonome et contribuer au développement de
leur pays et donc de la sous-région. Pour ce faire, il faut sensibiliser
les masses sociales, les leaders religieux et traditionnels et même, en
mettant par exemple sur pied un système d'encouragement et de soutien en
faveur de ceux qui promeuvent le bien-être social de la femme. En plus,
il faut assurer des conditions de rémunérations égales
pour les hommes et les femmes exerçant les mêmes fonctions, pour
éviter les disparités salariales, tout en éduquant les
populations sur l'importance de l'élimination des préjugés
à l'égard des femmes. Mettre en place des mécanismes qui
permettent de suivre la situation des femmes afin de l'améliorer. Pour
cela, l'existence des statistiques fiables et la mise à jour
régulière, sur la situation des femmes est
indispensable65.
Les femmes sont reconnues pour la plupart pour leur immense
employabilité au sein des ménages, ce qui parfois contraint ces
dernières à s'engager dans le monde professionnel. Cela explique
la présence de peu de femme dans le monde professionnel si non dans des
postes
64 Norbert Obasseliki, entretien.
65 Macelline Mebounou, entretien.
143
stratégiques des entreprises66. Ce qui
nécessite à promouvoir le partage des responsabilités
domestiques entre les deux sexes pour permettre aux deux conjoints d'exceller
dans le monde professionnel. En plus, effectuer des recherches qui devraient
mettre l'accent sur l'étude des problèmes soulevés par les
rapports entre droits et devoirs des hommes et des femmes, la condition et la
situation matérielle des femmes ; ladite recherche devrait
également dépister la discrimination dans l'enseignement et la
formation à l'égard des femmes.
D'après la Banque mondiale, pour promouvoir la femme,
il faut favoriser un développement économique incitant à
une participation plus grande des femmes et à un partage plus
équitable des ressources. De plus, partager des ressources et des postes
de responsabilités de façon équitables aux deux
sexes67. Par ailleurs, il faut procéder au recensement des
femmes spécialisées dans la formation, informer et les faire
connaître auprès des groupes désireux de mener des ateliers
de formation politique afin d'accroitre l'effectif des femmes dans la
politique. Encourager toutes les femmes qui occupent des postes de
responsabilité à tous les niveaux dans la sous-région
à se constituer en groupe de pression en vue d'exercer une pression sur
les mécanismes nationaux chargés des affaires
féminines68. Les mariages précoces sont aussi un
facteur de limitation de l'expansion professionnelle des femmes dans la
sous-région. Ainsi la lutte contre ce phénomène, qui a
pour corollaire les grossesses précoces constitue par conséquent
un obstacle à la réalisation des Objectifs du Millénaires
pour le Développement (OMD) et l'égalité des sexes.
Les femmes elles-mêmes constituent des obstacles
à leurs carrières professionnelles, car faisant
précocement des enfants, deviennent très tôt mères
et épouses. Cela hypothèque leur chance d'apporter leur pierre
à la construction de l'édifice69. Ce qui
nécessite de ce fait la proposition des outils de réflexion au
fondement de l'action collective féminine70. Par ailleurs,
elles peuvent utiliser l'idéologie infériorisant pour braver des
obstacles à leur hégémonie, pour faire entendre leurs
voix. Elles doivent aller au-devant de ce qu'elles considèrent comme
danger71 et ne pas céder aux scènes
d'infériorisation pour atteindre leurs objectifs et se hisser à
la haute échelle de la société.
66 Marcelline Mebounou, entretien.
67 R. H. Menye-Ella Ekotto, "Disparités de
genre et accès des salarié(e)s) à la formation
professionnelle continue au Cameroun : Une approche comparée du secteur
public et privé et du secteur privé de la ville de
Yaoundé", Mémoire de master en sociologie, Université de
Yaoundé I, 2014, p.25
68 E. Le-Yotha Nagartebaye, "La participation de la
femme à la vie politique au Tchad : 1933-2003", Mémoire de
maîtrise en sciences sociales, UCAC, 2003.
69 Régionale La Découverte,
Août, 2015, pp.26-27.
70 C. Guionnet, E. Neveu, Féminins/Masculin
: sociologie du genre, Paris, Armand Colin, 2005, p.20.
71 Ibid., pp.39-40.
144
Un bilan important au terme des décennies est que la
condition des femmes ne s'améliore pas automatiquement avec la
croissance économique. Il faut donc une volonté politique pour
intégrer les femmes au processus d'adaptation des politiques de
développement. Parmi ces stratégies de base à promouvoir,
nous pouvons souligner : la nécessité d'évaluer les
conséquences des politiques et des projets de développement sur
les femmes et d'inclure systématiquement les questions relatives aux
femmes dans tous les domaines et secteurs, tant au niveau local, national, sous
régional et international. Aussi de supprimer le parti pris en faveur
des hommes de la plupart des projets de développement, de
reconnaître, mesurer et intégrer dans les comptabilités
nationales, les statistiques économiques et les produits nationaux
bruts, le travail rémunéré et non
rémunéré des femmes. En plus d'instituer des horaires
souples pour tous afin d'encourager le partage des responsabilités
parentales et domestiques, de constituer des pépinières de leader
politique des femmes et promouvoir l'image des femmes.
De même, organiser une équipe technique pour
améliorer les programmes des partis politiques aux candidates et en
ressortir les actions et stratégies de promotion de la femme en vue
d'informer, à travers les médias toute la sous-région et
recourir aux langues de la sous-région pour informer l'électorat
féminin et en conditionner le vote. Aussi, de promouvoir la
représentation, la mobilisation et le militantisme des femmes dans les
Opérations de Maintien de la Paix, comme celles initiées par le
Conseil de Sécurité de l'ONU dans la sous-région pour la
Centrafrique.
C'est ce qui en ressort de la collaboration de la Division de
la Promotion de la Femme des Nations Unies (DAW), du Fonds de
Développement des Nations Unies pour la Femme (UNIFEM) qui a
amené le Conseil de Sécurité à adopter le 31
Octobre 2000, la Résolution 1325 portant sur la paix et la
sécurité72. Cette résolution a
été saluée comme étant la première
résolution à porter sur les femmes et le genre. Elle souligne
l'importance d'une pleine participation active des femmes, dans des conditions
d'égalité, à la prévention et au règlement
des conflits, ainsi qu'à l'édification et au maintien de la paix.
La résolution 1325 marque à ce jour le progrès le plus
significatif dans le processus souvent à faire des questions de genre,
de paix et de sécurité une préoccupation pertinente aux
quatre coins cardinaux. Grâce à son adoption, une barrière
a été brisée par la reconnaissance d'un lien entre la paix
et la sécurité internationale et la promotion des droits des
femmes. Les quatre premiers articles de cette résolution mettent les
femmes au centre des jeux de paix et de sécurité.
72 E. M. V. Beng, "Gestion et participation du
personnel féminin des forces de défense et de
sécurité camerounaise aux opérations de Maintien de la
Paix de 2000 à 2014", Mémoire de master professionnel en
sociologie, Université de Yaoundé I, 2015, p.36.
145
Les femmes doivent également saisir les
opportunités qui leur sont souvent offertes et faire acte de candidature
aux échéances électorales. Car même si la loi est
votée et promulguée, elle ne pourra s'appliquer et montrer son
intérêt que si les femmes elles-mêmes s'impliquent et
envahissent la sphère politique. L'on constate malheureusement que les
femmes sont aussi responsable de l'obstruction à leur insertion
véritable dans les instances de décisions, notamment par manque
de confiance en soi et de solidarité entre
elles-mêmes73. L'attitude des femmes par rapport à la
prise de parole publique ne devrait plus être différente à
celle des hommes. En effet, dans de nombreuses réunions en particulier
en politique ou l'économie, les femmes sont souvent beaucoup moins
nombreuses que les hommes à prendre la parole. Leurs interventions
devront être moins courtes comme d'habitude ou plus modeste (elles se
contentent souvent de poser une question plutôt que d'exposer leurs
propres idées)74.
Il est important que les gouvernements de la CEMAC, pensent
à la redistribution des richesses car cette redistribution est
disproportionnelle entre l'homme et la femme. Au Gabon par exemple, cela a
amené l'actuel président à créer, en fonction des
richesses qui se trouvent dans une localité, des industries, afin de
permettre aux populations de participer tous à la construction de leur
pays et de bénéficier également de ces richesses. Les
gouvernements communautaires devraient également favoriser
l'émancipation de la femme en permettant le suivi des projets tenus par
les femmes, en promouvant des associations féminines et en créant
des commissions de suivi de ces projets75. Ceci permettra aux femmes
de connaitre une meilleure plus-value dans leurs activités dans tous les
secteurs d'activité.
Il est important d'introduire une compensation pour les femmes
dynamiques dans cette sous-région. Au Gabon par exemple, Omar Bongo
avait instauré une cérémonie au cours de laquelle, la
femme qui s'était distinguée par son dynamisme était
primée. Cette initiative de l'ancien président avait donc
boosté la naissance des coopératives76. Par cette
pratique, cela peut permettre à la femme de la CEMAC d'être plus
entreprenante et pragmatique. Car son émancipation ne lui sera
donné que si elle travaille pour contribuer à toutes les
sphères de la société, la sphère familiale et
professionnelle.
La CEMAC est une institution communautaire qui
coopèrent multilatéralement avec ses Etats membres. Au sein de
cette communauté, la femme joue un rôle important. Toutefois,
elle
73 Régionale la Découverte...,
p.23.
74 M. Wilson, "Closing the leadership cap viewing",
New-York, p.40, in C. Durieux, Les femmes américaines en
politiques, Paris, Ellipses, 2008, pp.83-84.
75 Julie-Diane Benita Djambo, 42 ans
environ, Conseiller Economique et Commercial à l'Ambassade du Gabon au
Cameroun, entretien réalisé à l'Ambassade du Gabon au
Cameroun le 20/06/2019.
76 Idem.
146
est généralement confrontée à de
nombreuses difficultés. Tout ceci malgré l'adoption de nombreux
instruments juridiques nationaux, sous régionaux, régionaux et
internationaux77. D'où l'élaboration de nombreuses
recommandations qui sont d'ordre institutionnel, juridique et
socioculturel78.
77 Marie Gaspar Nicolas Messi, entretien.
78 Régionale la Découverte...,
p.25.
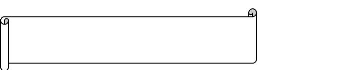
147
CONCLUSION GENERALE
La Communauté économique et monétaire de
l'Afrique centrale est constituée de six (06) Etats membres (le
Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et
le Tchad)1. Ces six Etats membres entretiennent de multiples
relations notamment politiques, économiques, socioculturelles.
L'avènement de cette structure est l'aboutissement d'un long processus.
Aussi, l'Union douanière équatoriale2 est née
pour préserver les marchés coloniaux, rebaptisés
"marchés tropicaux" des sociétés commerciales
françaises implantées en Afrique noire. La France sauvegardait
ses intérêts. Après les indépendances des Etats,
survenues pour la plupart en 1960, ils sont confrontés aux
problèmes économiques et à la recherche du
développement. Cela ne pouvait que les pousser à se regrouper. En
outre, la Commission économique des nations unies pour
l'Afrique3, avait proposé une nouvelle stratégie pour
le développement basée sur le regroupement des Etats en
entités géographiques qui soient fiables sur le plan
économique. Les petits Etats exigus, mal équipés ne
pouvaient rien devant des grands ensembles. La théorie des
réalistes qui partage le pragmatisme, montre comment de l'UDE, on
aboutira à l'Union douanière et économique de l'Afrique
centrale le 08 Décembre 1964.
Aussi, n'ayant pas atteint son ambition d'intégration
sous régionale, le traité des six Etats membres en 1994 aboutit
à la mise en place de la CEMAC en 1998. C'est une Organisation
interétatique sous régionale d'une superficie de 3020145
km2 avec environ 36,7 millions d'habitants jusqu'en
20104. Mais aussi, une personne juridique internationale
régie par le droit des Organisations internationales. C'est en 1999 que
sont définis ses objectifs avec un aspect économique majeur. Son
objectif primordial est de promouvoir le développement des Etats dans le
cadre de deux unions : l'Union économique de l'Afrique centrale et
l'Union monétaire de l'Afrique centrale, avec de multiples
missions5 notamment, l'établissement d'un marché
commun et d'une union de plus en plus étroite entre les peuples des
Etats membres, pour
1 Ndong Owono Abang, entretien, in J. L. T. Mbassi
Ondigui, "Les relations culturelles entre Etats de la Communauté
Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale",
Décembre 2014, p.416.
2J. R. Booh Booh, Organisation et Relations
Interafricaine, Yaoundé, ENAM, 1972, p.73.
3 Ibid., p.72.
4 Le Courrier de la SJ-CEMAC,
1ère édition, 18 Septembre 2012, p.10.
5 B. Lepouma-Mapoba," La libre circulation des
personnes et des biens dans la sous-région de l'Afrique Centrale",
Mémoire de master en Sciences politiques, CREPS, Université de
Yaoundé II, 2012, p.15.
148
raffermir la solidarité géographique et humaine,
la coordination des programmes de développement.
Cette communauté est constituée des hommes et
les femmes qui travaillent en synergie afin de la dynamiser. C'est dans cette
perspective que ce travail porte sur : "le rôle de la femme dans la
diplomatie de la CEMAC ". Il s'agissait pour nous de ressortir la contribution
de la femme dans la dynamique diplomatique des membres pour l'atteinte des
objectifs de la CEMAC.
Il en ressort que le rôle de la femme au sein de la
société, que ce soit en Afrique comme partout dans le monde, a
évolué dans le temps. En Afrique précoloniale, il existait
des sociétés matrilinéaires, mais la plupart des
sociétés africaines étaient patrilinéaires. L'homme
était le seul chef de famille et le pouvoir décisionnel lui
incombait. Une minorité de femme comme les femmes de certains chefs
participaient à certaines réunions importantes de la
société et à la prise des décisions. Le plus
souvent à l'absence de leurs époux. La femme était donc
résolue aux travaux domestiques et champêtres, elle contribuait au
bonheur de son mari et de la famille6, une sorte d'obéissance
au rôle préétabli, selon la thèse
Vétérino-testamentaire. Alors que l'homme était le
pourvoyeur de revenus familiaux. Car le travail des activités
génératrices de revenus lui revenait. Néanmoins, la femme
n'était pas oppressée7.
Cependant, avec l'arrivée des européens la
situation de la femme connaît une toute autre forme. Les femmes sont
quasiment reléguées au second rang, alors que l'homme est
au-devant de la scène. Car toute activité
génératrice de revenus revient exclusivement à l'homme
tandis que la femme s'occupe du foyer8. Certaines femmes sont faites
domestiques, esclaves sexuelles, et d'autres sont faites épouses des
colons. Car même le peu de pouvoir qu'elles avaient avant cette
période a disparu. Même si quelques rares seront faites espionnes
par l'administration au sein des communautés locales. C'est ainsi
qu'ayant subi toutes ces vicissitudes, elles vont prendre conscience et lutter
contre le colonialisme à travers des groupes de revendications et
conduire avec les hommes, leurs territoires à l'indépendance.
Après l'indépendance, ces femmes vont devoir
s'affirmer une fois de plus dans la société qui parfois est
misogyne, voire phallocrate. La théorie féministe
préconise la représentation de la femme au sein de la
société, c'est dans cette logique que les femmes vont devoir
lutter pour une représentation sociale, professionnelle au même
titre que les hommes.
6 L. Second, La Sainte Bible, Nouveau
testament, Printed for Bibles par Internet and GLIFA, 1910,
pp.1146-1147.
7 H. Ngoa, Non, La femme africaine n'était
pas opprimée, Yaoundé, Clé, 1975, p.35.
8 G. Mikelle, African feminism in subsaharan
Africa, Philadelphia University of Pennsylvania, 1997, p.16.
149
Car les coutumes d'antan n'ont pas disparu, et font leur
résurgence. Alors que les hommes préfèrent voir leur
conjointe à la maison, cette dernière se réclame d'une
compétence professionnelle pondérant celle de l'homme. Face
à ces revendications perpétuelles, les Etats de l'Afrique
centrale prennent conscience des pertes accusées par l'impéritie
concédée à l'égard de la femme, d'où la
nécessité de leurs accorder cette revendication sociale. Ces
Etats vont ratifier et élaborer de nombreuses législations dans
le cadre national, sous régional et international pour promouvoir la
femme dans la CEMAC. Ce qui explique l'ascension des femmes sur le plan
politique, économique et socioculturel, de surcroît le rôle
important qu'elles jouent dans cette communauté.
Depuis la création de l'UDEAC, les femmes ont
commencé à se mouler aux affaires de la communauté.
Même si elles n'occupaient pas les postes stratégiques, elles
occupaient des postes nobles9 et jouaient un rôle qui
n'était pas différent de celui des hommes10. Elles ont
intégré la sphère professionnelle qu'elles ont longtemps
observé être occupée par les hommes. Toutefois, aucune loi
pour les promouvoir dans l'UDEAC n'a été élaborée.
Ce qui pourrait justifier l'absence de ces dernières à des postes
clés depuis la création de l'institution.
Par ailleurs, les insuffisances de l'UDEAC conduisent à
la création de la CEMAC en 1994. C'est ainsi que l'on aboutit au
remplacement du Secrétariat Exécutif par la Commission de la
CEMAC, sans omettre la création de nouvelles Institutions
spécialisées dans cette communauté. Dès lors, la
question du genre dans la CEMAC va se poser avec acuité. Les
décideurs politiques de la CEMAC se retrouvent cette fois dans
l'impératif d'inclure la question genre, les préoccupations
concernant la femme dans leur agenda. Cependant, il faut noter que même
si cette question était discutée dans les conférences de
la communauté, aucune loi sur la question n'était
réellement élaborée.
Aussi, depuis les années 1970, le statut et la place de
la femme dans les sociétés ont connu des mutations. D'autant plus
que l'ONU lance dans les années 1975-1985, la "Décennie pour la
femme". Ce qui se traduit en 1975 avec la première conférence sur
la femme à Pékin. Très peu nombreuses avant la fin des
années 1960 ou réduit à des descriptions statiques et
pittoresques d'une condition féminine immuable, les femmes vont
émerger sous l'impulsion
9 Lucien Henry Ticky, 47 ans, Expert Principal
CEMAC en circulation, entretien réalisé à la
Représentation de la CEMAC au Cameroun à Yaoundé, le
15/10/2018.
10 Tableau des professionnels libéraux
agréés de la comptabilité par le Comité de
Direction de l'UDEAC, 31 juillet 1998, pp.5-17.
150
des mouvements féministes11. C'est dans
cette perspective que la Communauté économique et
monétaires des Etats de l'Afrique centrale va élaborer le
Programme économique régional, une vision dans laquelle elle
inclue la question genre, pour propulser le dynamisme féminin dans la
sous-région. Cependant, dès la mise sur pied de la CEMAC, avec la
question genre en actualité dans le monde, de nombreuses femmes vont
occuper des postes importants, que ce soit dans les Organes ou les Institutions
spécialisées de la CEMAC, (cf. chapitre II). C'est surtout
à partir des années 2000 que la présence des femmes dans
la Communauté s'accroit dans les différents Organes, les
Institutions spécialisées, mais aussi dans d'autres structures
partenaires de la CEMAC. Le rôle de la femme n'est plus indéniable
à cet effet dans la communauté.
Par ailleurs, la première femme est nommée en
2011 à la tête d'une Représentation pays dans la CEMAC.
Alors qu'en 2012, la vice-présidence de la Commission de la CEMAC
connaît la présence d'une femme également. Il en est de
même en 2017, avec la nomination de Fatima Haram Hacyl à la
tête de la vice-présidence de la Commission de la CEMAC
12. C'est dans la même initiative que les autres structures
partenaires de la CEMAC comme le REFAC, la Synergie jeunes et
différentes autres associations dans lesquelles le rôle
diplomatique des femmes pour l'avancement de la communauté n'est plus
à démontrer, promeuvent l'expertise féminine. Cette
promotion de la femme dans les différents pays de la CEMAC, les
amène à prouver leur savoir-faire au-delà des
frontières communautaires, d'où leur présence dans
d'autres institutions internationales notamment l'Union africaine,
l'ONU13.
Même s'il faut noter qu'à cause du
caractère naturel attribué à ses tâches et de ses
préoccupations, la femme africaine a longtemps été
sous-estimée dans son rôle qu'elle peut jouer comme actrice dans
la dynamique diplomatique entreprise par les Etats de la CEMAC. Ce d'autant
plus que ce qui pourrait être considéré comme son apport
est plus concentré dans les secteurs où l'enregistrement n'est
pas de règle, et donc presque ignoré par les statistiques
nationales, sous régionales et même internationales14,
(dans le travail domestique, l'artisanat, l'agriculture, le commerce des
vivres)15. C'est ainsi que le travail de la femme dans la sous-
11 F. Thébaud, "Les femmes", in Histoire
de l'humanité, le XXe : De 1914 à nos jours,
Volume VII, Londres, UNESCO, 2009, pp.208-230.
12 Lucien Henry Ticky, entretien.
13 Idem.
14 A. P. Temgoua, "Femme et intégration en
Afrique centrale", in A. Daniel, J-M. Essomba, Als., Dynamiques
d'intégration régionale en Afrique centrale, Tome 2,
Yaoundé, PUY, 2001, pp.609-616.
15 Ibid.
151
région est mal apprécié aussi bien par
les décideurs que par les populations elles-mêmes, très
imprégnées des idées préconçues sur le
rôle de la femme.
Cependant, de nombreux efforts consentis entre les Etats de la
CEMAC donne une plus-value à la femme, ce qui lui permet de jouer un
rôle aussi important que celui de l'homme dans les communautés
économiques régionales, sous régionales comme la CEMAC.
Toutefois, il est nécessaire de relever que le manque de
législations pour promouvoir la femme dans la CEMAC, est l'un des
principaux obstacles à son travail. Jusqu'à nos jours, le PER est
le seul instrument qui a mis en exergue la question genre dans la
communauté. Il n'existe véritablement pas encore d'instruments
juridiques pour promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme
dans l'espace communautaire, peut-être dans le cadre de la
législation onusienne.
Ceci pourrait être considéré comme une
interpellation vis-à-vis des Etats membre pour la mise sur pied
conjointe des lois pour promouvoir la femme et l'équilibre genre dans la
CEMAC, afin de mettre un terme à des déséquilibres de
représentation au sein des postes de responsabilité. Tout ceci
devrait corroborer avec les lois nationales16. La CEMAC deviendra
ainsi plus sensible aux questions relatives aux femmes et pourra apporter une
assistance de qualité aux Etats membres dans l'intégration de la
femme dans leurs plans nationaux et sous régionaux de
développement et leurs budgets. La politique encouragera de
surcroît la participation et la contribution des femmes dans tous les
secteurs, comme partenaires de la dynamique diplomatique entreprise par la
CEMAC17.
16 Jean Leonard Thierry Mbassi Ondigui, 47 ans,
Historien, entretien réalisé au département d'Histoire, le
20/03/2019.
17 Julie-Diane Benita Djambo, 42 ans environ,
Conseiller Economique et Commercial à l'Ambassade du Gabon au Cameroun,
entretien réalisé à l'Ambassade du Gabon au Cameroun, le
20/06/2019.
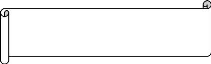
ANNEXES
152
153
Annexe N° I : Guide d'entretien n°1

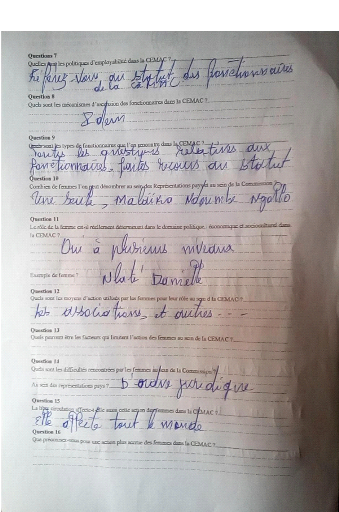
154
155
Annexe N° II : Guide d'entretien
n°2

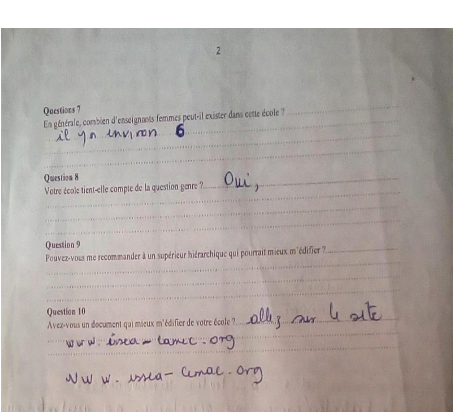
156
157
Annexe N° III : Traité instituant
la Communauté économique et monétaire de l'Afrique
centrale
Le Gouvernement de la République du Cameroun Le
Gouvernement de la République Centrafricaine
Le Gouvernement de la République du Congo
Le Gouvernement de la République Gabonaise
Le Gouvernement de la République de Guinée
Equatoriale
Le Gouvernement de la République du Tchad
Conscients de la nécessité de développer
ensemble toutes les ressources humaines et naturelles de leurs Etats membres et
de mettre celles-ci au service du bien-être général de
leurs peuples dans tous les domaines,
Résolus à donner une impulsion nouvelle et
décisive au processus d'intégration en Afrique Centrale par une
harmonisation accrue des politiques et des législations de leurs
Etats,
Prenant acte de l'approche d'intégration
proposée en UDEAC telle qu'inspirée par les Chefs d'Etat de l'OUA
lors de la Conférence d'Abuja en juillet 1991,
Considérant la nouvelle dynamique en cours dans la Zone
Franc, au demeurant nécessaire au regard des mutations et du recentrage
des stratégies de coopération et de développement
observés en Afrique et dur d'autres continents dont l'Europe,
Désireux de renforcer la solidarité entre leurs
peuples dans le respect de leurs identités nationales respectives,
Réaffirmant leur attachement aux principes de
liberté, de démocratie et de respect des droits fondamentaux des
personnes et l'Etat de droit,
Décident de créer une «Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale», en
abréviation CEMAC.
Article 1er - La mission essentielle de la
Communauté est de promouvoir un développement harmonieux des
Etats membres dans le cadre de l'institution de deux Unions : une Union
Economique et une Union Monétaire. Dans chacun de ces deux domaines, les
Etats membres entendent passer d'une situation de coopération, qui
existe déjà entre eux, à une situation, susceptible de
parachever le processus d'intégration économique et
monétaire.
Article 2 - Les parties signataires
décident du principe de création de quatre institutions
rattachées à la Communauté celle-ci :
158
?? L'Union Economique de l'Afrique Centrale
?? L'Union Monétaire de l'Afrique Centrale
?? Le Parlement Communautaire,
?? La Cour de Justice Communautaire, comprenant une Chambre
Judiciaire et une Chambre des
Comptes.
?? Les principaux organes de la Communauté sont :
?? La Conférence des Chefs d'Etat,
?? Le Conseil des Ministres,
?? Le Comité Ministériel,
?? Le Secrétariat Exécutif,
?? Le Comité Inter-Etats,
?? le Banque des Etats de l'Afrique Centrale,
?? La Commission Bancaire de l'Afrique centrale
?? L'Institution de Financement du Développement.
Article 3 - Les quatre Institutions
citées à l'article 2 ci-dessus feront l'objet de Conventions
séparées, à annexer respectivement au
présent Traité et dont elles feront intégralement partie.
Les Statuts des organes cités ci-dessus et existant déjà,
feront l'objet, si nécessaire de
modification par conventions séparées en vue de
leur harmonisation avec les dispositions des Actes régissant la
Communauté.
Article 4 - Le Parlement Communautaire, qui
sera créé ultérieurement par une Convention
séparée aura pour rôle essentiel de légiférer
par voie de directives.
Article 5 - La Cour de justice Communautaire
comporte deux Chambres : Un Chambre
Judiciaire et une Chambre des Comptes.
La Chambre Judiciaire assure le respect du droit dans
l'interprétation et dans
l'application du présent Traité et des
Conventions subséquentes.
La Chambre des Comptes assure le contrôle des comptes de
l'Union.
La composition, le fonctionnement et le champ de
compétence de chacune des deux Chambres sont contenus dans la Convention
instituant l'Union Economique de l'Afrique
Centrale.
Article 6 - Tout autre Etat africain,
partageant les mêmes idéaux que ceux auxquels les Etats
fondateurs se déclarent solennellement attachés,
pourra solliciter son adhésion à la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Centrale.
Source : CEMAC, Textes organiques,
Yaoundé, Ed. Saagraph, Mai 1998.
159
Cette adhésion ne pourra intervenir qu'après accord
unanime des membres fondateurs.
Toute adhésion ultérieure d'un nouvel Etat sera
subordonnée à l'accord unanime des membres de la
Communauté.
Article 7- Le présent Traité
rédigé en un exemplaire unique en langues française,
espagnole et anglaise, le français faisant foi en cas de divergence
d'interprétation, entrera en vigueur dès sa ratification par tous
les Etats signataires auprès de la République du Tchad,
désignée comme Etat dépositaire de tous les Actes
afférents à la Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale.
Fait à N'Djamena, le 16 Mars 1994.
160
Annexe N° IV : Organigramme de l'UDEAC
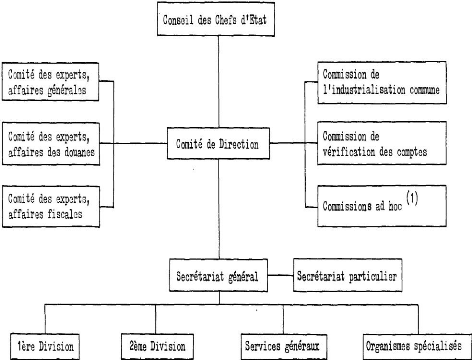
Source : J. Touscoz, J. Lormand,
Coopération scientifique et technique entre les Etats membres de
l'UDEAC, Paris, Unesco, 1977
161
Annexe N° V : Extrait de la Convention sur
l'Elimination de toutes les formes de
Discrimination à l'Egard des Femmes
(A.G. res. 34/180, 34 U. N. GAOR Supp. No. 46, à 193,
U.N. Doc. A/34/46,
entrée en vigueur le 3 septembre, 1981)
Les États parties à la présente
Convention,
[....]
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE Article 1
Aux fins de la présente Convention, l'expression
"discrimination à l'égard des femmes" vise toute distinction,
exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but
de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou
l'exercice par les femmes, quel que soit leur État matrimonial, sur la
base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de
l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique,
économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
Article 2
Les États parties condamnent la discrimination à
l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par
tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à
éliminer la discrimination à l'égard des femmes et,
à cette fin, s'engagent à :
a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre
disposition législative appropriée le principe de
l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est
déjà fait, et assurer par voie de législation ou par
d'autres moyens appropriés l'application effective du dit principe ;
b) Adopter des mesures législatives et d'autres
mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin,
interdisant toute discrimination à l'égard des femmes ;
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des
femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le
truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions
publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire
;
d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire
à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités
publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation
;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour
éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des
femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque ;
Source : Archives de la Représentation
de la CEMAC au Cameroun
162
f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris
des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi,
disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une
discrimination à l'égard des femmes ;
g) Abroger toutes les dispositions pénales qui
constituent une discrimination à l'égard des femmes.
Article 28
1. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les
États le texte des réserves qui auront été faites
au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de
la présente Convention ne sera autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées
à tout moment par voie de notification adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le
quel informe tous les États parties à la Convention. La
notification prendra effet à la date de réception.
Article 29
1. Tout différend entre deux ou plusieurs États
parties concernant l'interprétation ou l'application de la
présente Convention qui n'est pas réglé par voie de
négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un
d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande
d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur
l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le
différend à la Cour internationale de Justice, en déposant
une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout État partie pourra, au moment où il
signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par les
dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États
parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un
État partie qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout État partie qui aura formulé une
réserve conformément aux dispositions du paragraphe du
présent article pourra à tout moment lever cette réserve
par une notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 4
La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera
déposée auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
163
Annexe N° VI : Extrait du rapport de la
13eme session ordinaire de la conférence des chefs d'Etats de
LA CEMAC au cours de laquelle des nominations ont été
enregistrées à la cour de justice et à la cour des comptes
de la CEMAC, parmi lesquelles on retrouve les femmes

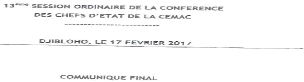
164
Source : Archives de la Représentation de
la CEMAC au Cameroun
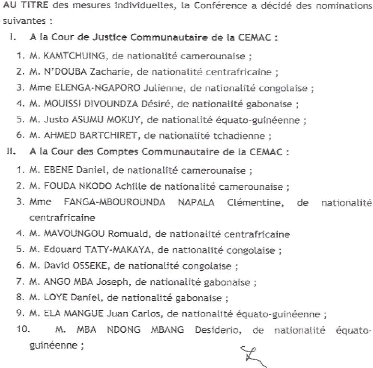
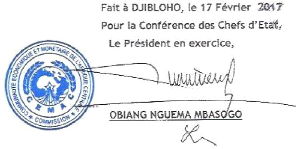
165
Annexe N° VII : Rapport de la
33eme session ordinaire du conseil des ministres de L'UEAC au cours
de laquelle une femme a été nommée fonctionnaire classe
exceptionnelle
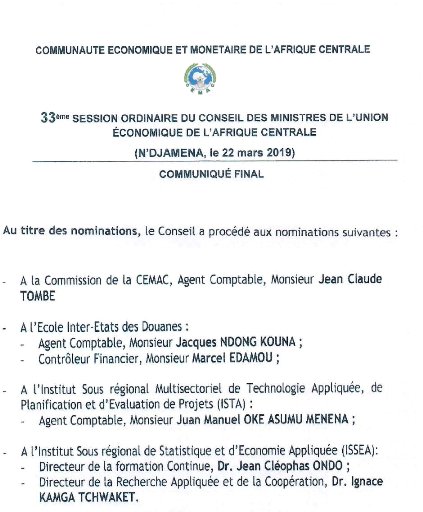
Source : Archives de la Représentation
de la CEMAC au Cameroun
166
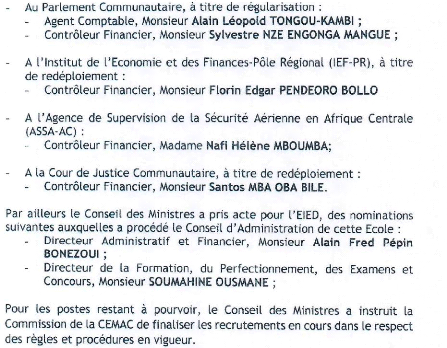
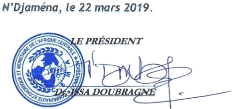
167
Annexe N° VIII : Exemple d'appel à
candidature à un poste d'une institution spécialisée de la
CEMAC : la CEBEVIRHA
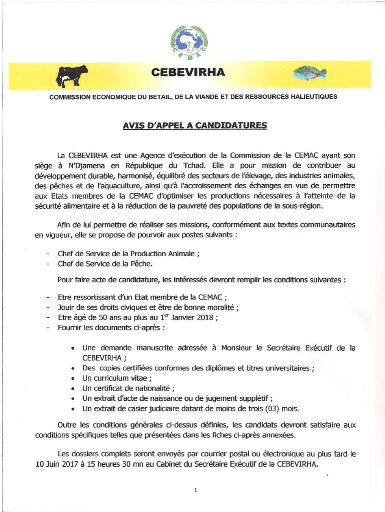
Source : Archives de la Représentation de
la CEMAC au Cameroun
168
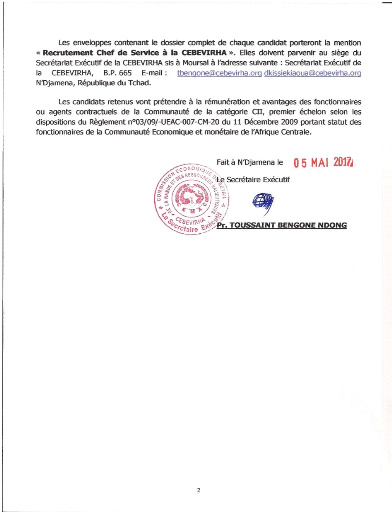
169
Annexe N° IX : Extrait du statut des
fonctionnaires de la CEMAC du 11 décembre 2009
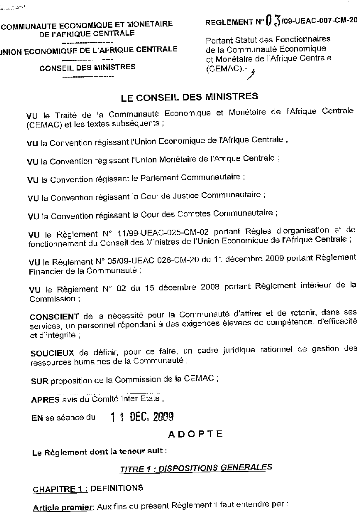
170
2
Communauté ou CEMAC :
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
;
Union ou UEAC : Union Economique de L'Afrique
Centrale ;
Union Monétaire ou UMAC : Union
Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Etat membre : Tout Etat partie prenante au
Traité de la Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale, tel que prévu par son préambule ;
Fonctionnaire de la Communauté : Toute
personne nommée et titularisée dans l'un des emplois permanents
ouverts dans les services d'une Institution, d'un Organe ou d'une Institution
Spécialisée de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Agent contractuel : Toute personne
nommée et titularisée dans un emploi permanent relevant des
classes HG à CIII tel que précisées à l'article 34
et à l'annexe du présent Règlement ;
Fonctionnaire du régime local : Toute
personne nommée et titularisée dans un emploi permanent relevant
des classes CIV à CVII des services généraux tel que
précisées à l'article 35 et à l'annexe du
présent statut ;
Organes : La Conférence des Chefs
d'Etat, le Conseil des Ministres, le Comité Ministériel, la
Commission, la Banque des Etats de l'Afrique Centrale, la Banque de
Développement des Etats de l'Afrique Centrale et la Commission Bancaire
de l'Afrique Centrale ;
Institutions : L'Union Economique de
l'Afrique Centrale, l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale, le
Parlement Communautaire, la Cour de Justice Communautaire et la Cour des
Comptes Communautaire;
Les Institutions Spécialisées :
Les Institutions Spécialisées de l'Union Economique de
l'Afrique Centrale et les Institutions Spécialisées de l'Union
Monétaire de l'Afrique Centrale, sauf dispositions spéciales.
CHAPITRE II : OBJET
Article 2 : Le statut des
fonctionnaires de la Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale a pour objet d'énoncer les principes
généraux qui régissent le déroulement de la
carrière des intéressés, notamment la politique de
recrutement et d'administration qui s'applique à eux, ainsi que les
droits et obligations de la Communauté et desdits fonctionnaires.
Sont exclus du champ d'application du présent
Règlement, le Président, le Vice-Président et les
Commissaires de la Commission, les Juges membres de la Cour de Justice
Communautaire, les membres de la Cour des Comptes Communautaire, les
Députés membres du Parlement Communautaire et les premiers
responsables des Institutions, Organes et Institutions
Spécialisées.
Article 3 : Les emplois de
fonctionnaires sont ouverts aux ressortissants des Etats membres, sans
distinction d'origine, de croyance ou de sexe.
171
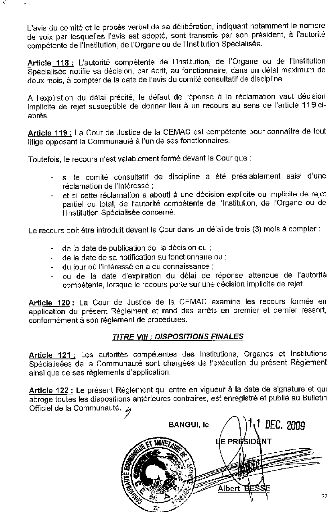
Source : Archives de la Représentation de
la CEMAC au Cameroun
172
Annexe N° X : Equipe dirigeante actuelle de
la Commission CEMAC nommée en 2017
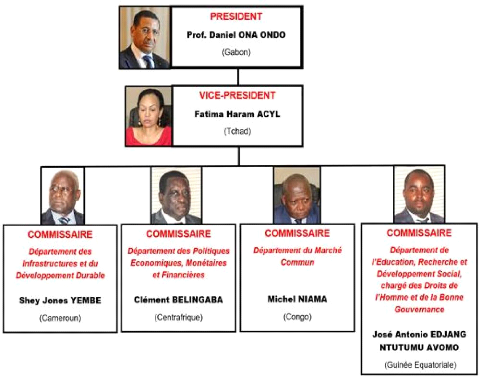
Source : Archives de la Représentation de
la CEMAC au Cameroun
173
Annexe N° XI : Organigramme de la
Commission de la CEMAC
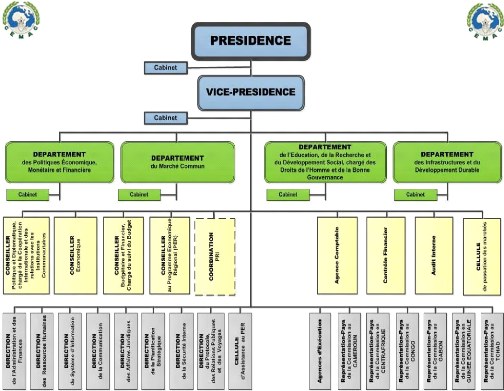
Source : Archives de la Représentation de
la CEMAC au Cameroun
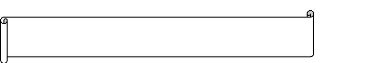
174
SOURCES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
I. SOURCES
A. ARCHIVES
- Archives de la CEMAC
- CEMAC, Conférence Sous Régionale
organisée par la Commission de la CEMAC et la
FERDI, "Renforcer l'intégration pour
accélérer la croissance : quelles priorités pour la
CEMAC T", Yaoundé, 27-28 février 2014.
- Compte-Rendu des travaux de la 3eme Session ordinaire de
la CRUROR/AC, Yaoundé le
20 novembre, 2007.
- FOTRAC, 7ème édition,
Kyé-Ossi, du 25 juin au 09 juillet 2016.
- FOTRAC, 9ème édition, du
25 juin au 09 juillet 2018.
- Journée internationale des jeunes de la
CEMAC, objectif citoyen, le courrier de la SJ-
CEMAC, kit pour la mobilisation et la sensibilisation,
1ere Edition, 18 Septembre 2012.
- Liste des Participants à la 3eme
Session ordinaire de la CRUROR/AC, Ndjamena
(CEBEVIRHA), du 19 au 21 décembre 2007.
- Liste des participants, Consultations FMI/Institutions de
l'Afrique centrale, Yaoundé,
2006.
- Ndzana R. F., Lettre adressée à Monsieur
le Directeur Général de l'Agence de Régulation
des Télécommunications, Yaoundé,
04 avril 2013.
- Organigramme de l'UDEAC.
- Procès-verbal de la 22ème
session ordinaire du Conseil des Ministres de l'UEAC,
Brazzaville (R. Congo), 19 décembre 2011.
- Projet du programme d'activités de l'EIED,
Note de présentation du projet du Budget
d'exercice 2011.
- Rapport FOTRAC, 5ème
édition, du 10 au 23 Juin 2014.
- Rapport FOTRAC, 7e édition du 25 juin
au 9 juillet 2016 à Kyé-Ossi, frontière Cameroun-
Gabon-Guinée Equatoriale, 2016.
- Règlement N003109-UEAC-007-CM-20 Portant
Statut, 11 décembre 2009.
- Règlement No 03/09-UEAC-007-CM-20 portant
statut des fonctionnaires de la
Communauté Economique et Monétaire des Etats de
l'Afrique Centrale, 11 décembre
2009.
- Répertoire des établissements
d'enseignement supérieur des pays membres de la CEMAC.
175
- Réunion du groupe de travail chargé de
l'élaboration du plan d'action et du chronogramme
d'activités, Rapport des Experts, Yaoundé, 14-15 Septembre
2010.
- Stratégie agricole commune des pays membres de la
CEMAC, Version provisoire - mai 2004.
- Tableau des professionnels libéraux
agréés de la comptabilité par le Comité de
Direction de l'UDEAC, 31 juillet 1998.
- Traité instituant la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale.
- Archives du Ministère des relations
extérieures
- Afrique Centrale, Dossier intégration,
N°109.
- Rapport 8eme Commission Mixte
Cameroun-Guinée Equatoriale, Yaoundé, 30 août 2012.
B. LES LOIS
- Code du travail camerounais issu de la loi n°92/007 du 14
août 1992.
- Constitution camerounaise du 18 Janvier 1996.
- Constitution de la République Centrafricaine.
- La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de
1981.
- La constitution équato-guinéenne adoptée
le 23 décembre 1990 et révisée en 2001.
- Loi constitutionnelle n° 1/1995 du 17 janvier 1995.
- Projet de la constitution de la République du Congo de
2002.
- Projet de modification de la constitution du Congo, Octobre
2015.
- Protocole à la charte africaine des droits l'homme et
des peuples relatifs aux droits des
femmes.
C. RAPPORTS
- Luntadila K. Mbanzulu, "La coopération diplomatique
Zaïre-Cameroun (1960-1988",
rapport de stage diplomatique, Yaoundé, IRIC, 1989.
- Moneyang Yana A., "La promotion et la protection des droits
sociaux de la femme en
Afrique centrale : cas du Cameroun", Rapport de Stage, IRIC,
2015-2016.
- OIT, 12eme Rapport de la Réunion
Régionale africaine, Johannesburg, Afrique du Sud, 11-
14 Octobre 2011.
- Rapport d'activités de l'ISSEA, année
académique 2009-2010.
- Rapport de la CNDHL sur les droits de l'homme en
2014.
176
- Rapport de la Réunion de lancement du Comité
Régional de Facilitation des Echanges en Afrique Centrale (CRFE-AC),
Pointe-Noire, République du Congo, du 30 avril au 1er mai
2018.
- Rapport périodique du Cameroun sur la CEDEF,
Février 2009, Septembre 2011.
- Rapport sur l'Afrique centrale 10, Institut d'Etudes
de Sécurités, Septembre 2017.
D. SOURCES NUMERIQUES
http://.www.lexilogos.com/latin(gaffiotphp?q=femme,
consulté le 11/02/2019 à 11h30min.
http://.dictionary-versonet/français.définition,
consulté le 12/02/2019 à 9h20min.
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/cef/,
consulté le 12/02/2019 à 14 h30min.
http://www.cemac.int/sites/default/files/ineditor/.pdf,
consulté le 03/06/2018 à
13h10min.
www.eied-cemac.org/-notes/statut_fonctionnaire8%20eied.html,
consulté le 13/04/2019 à 8h25min.
www.cemac.intel/Histoire, consulté le 01/02/2019 à
6h30min.
www.issea-cemac.org/index.php, consulté le 25/04/2019 à
15h30min
https://afrikinfo.net/fotac-cemac-2019-rendez-vous-le-04-mars/
consulté le 12/06/2019 à 11h03min.
www.google.com/serach.EIED.
Consulté le 14/06/2019 à 16h22min. www.cemac.int/qui_sommes_nous.
Consulté le 13/06/2019 à 13h5min.
https://journalintegration.com/fotrac-2018-place-a-linterregionalisme-bas/
consulté le 19/04/2019 à 16h30min.
www.izf.net/upload/institutions/integration/african/cemac,
consulté le 12/05/2019 à 12h30min.
E. SOURCES ORALES
|
Noms et Prénoms
|
Ages
|
Qualités
|
Dates et lieux
d'entretiens
|
|
Baban Remy
|
36 ans environ
|
Vigil depuis 3 ans à la
Représentation de la CEMAC Cameroun
|
Représentation CEMAC au Cameroun, Yaoundé
31/05/2019
|
|
Claudine
|
23 ans
|
Etudiante camerounaise à l'ISSEA,
3èmeannée IAS
|
ISSEA, 10/05/2019.
|
177
|
Djambo Benita Julie-Diane
|
42 ans environ
|
Conseiller Economique et Commercial à l'Ambassade du Gabon
au Cameroun
|
Ambassade du Gabon au Cameroun, 20/06/2019.
|
|
Djomo Carine
|
35 ans
|
Commerçante Camerounaise
|
Yaoundé, 25/06/2018.
|
|
Djoulaye Grégoire
|
25 ans
|
Etudiant tchadien à l'Université de Yaoundé
II
|
Université de Yaoundé II, 23/10/2018.
|
|
Fadila Aramatou
|
22 ans
|
Etudiante tchadienne en 2eme année à
l'Université de Yaoundé II en Science politique
|
Université de Yaoundé II, 25/01/2018.
|
|
Galloye née Iwandza Catherine
|
53 ans
|
Secrétaire particulier de
l'Ambassadeur de la République du Congo au Cameroun
|
Ambassade de la
République du Congo au Cameroun, 14/06/2019.
|
|
Grégoire Djoulaye
|
25 ans
|
Etudiant Tchadien à l'Université de Yaoundé
II
|
Université de Yaoundé II, 23/10/2018.
|
|
Inès Fotsing,
|
70 ans
|
Ménagère,
|
Yaoundé, 22/09/2018.
|
|
Makemba Nadège
|
60 ans environ
|
Chef de service retraité au Ministère de la
promotion de la femme et de la famille
|
Yaoundé, 25/01/2018.
|
|
Mebe Asoui Alexise Sabrina
|
24 ans
|
Etudiante camerounaise en 3eme année JAS
à l'JSSEA
|
ISSEA, 10/05/2019.
|
|
Mebounou Marcelline
|
32 ans
|
Sous-directeur de la sous-direction Afrique au Minrex
|
Minrex, 24/01/2018.
|
|
Messi Nicolas
Marie Gaspar
|
52 ans
|
Assistant de la Représentante de la CEMAC au Cameroun
|
Représentation de la
CEMAC au Cameroun à Yaoundé, 23/01/2018
|
|
Mindang Anne
|
35 ans
|
Cultivatrice centrafricaine
|
Yaoundé, le 15 juin 2019.
|
|
Minlo Aba
|
35 ans
|
Agent CROPSEC
|
Yaoundé, 25/05/2018.
|
|
Nguema Etienne
|
38 ans
|
Administrateur civil au Gabon, participant de la Fotrac 2017.
|
Kyé-ossi, 25/06/2019.
|
|
Nguema Rafael
|
60 ans
|
Enseignant gabonais retraité
|
Kyé-Ossi, 25/06/2017.
|
178
|
Obasseliki Norbert
|
55 ans environ
|
1er Conseiller à l'Ambassade la
République du Congo au Cameroun
|
Ambassade de la
République du Congo au Cameroun, 14/06/2019.
|
|
Obiang Cynthia
|
35 ans
|
Administrateur civil en Guinée Equatoriale
|
Kyé-Ossi, 25/06/2017.
|
|
Rondo Lemercier
|
24 ans
|
Etudiant centrafricain à l'ISSEA en 4eme
année IAS
|
ISSEA, 14/02/2018.
|
|
Simpa Emile
|
23 ans
|
Etudiant togolais en 3eme année TSS à
l'ISSEA
|
ISSEA, 14/02/2018.
|
|
Swana Berry
|
24 ans
|
Etudiant ressortissant de la RDC en 3eme année
IAS à l'ISSEA
|
ISSEA, 14/02/2018.
|
|
Ticky Lucien Henry
|
47 ans
|
Expert Principal CEMAC en circulation
|
Représentation CEMAC au Cameroun, Yaoundé
15/10/2018.
|
|
Yahya Adoum Mahamat
|
59 ans
|
1er Secrétaire à l'Ambassade du Tchad au
Cameroun
|
Ambassade du Tchad,
01/03/2018.
|
|
Mbassi Ondigui Jean Leonard Thierry
|
47 ans
|
Historien
|
Département d'Histoire,
20/03/2019.
|
F. THESES ET MEMOIRES
- Thèses
- Chendjou J.J., "Les bamilékés de
l'ouest-Cameroun : pouvoir économique et société
(1880-1916)", Thèse de doctorat 3e cycle en histoire,
Université de Paris, 1986.
- Chouala Y. A., "Désordre et Ordre dans l'Afrique
centrale actuelle : démocratisation, conflictualisation et transitions
géostratégiques régionales", Thèse de doctorat
3e cycle en relations internationales, IRIC, 1999.
- Mbassi Ondigui J.L.T., "Les relations
culturelles entre Etats de la Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale (1959-2010)", Thèse de doctorat/Ph.D en histoire,
Université de Yaoundé I, 2014.
- Ndjah Etolo E. V., "Dynamiques de genre et rapport de
pouvoir au sein des couples salariés à hypogamie féminine
: contribution à une sociologie de la vie conjugale en contexte urbain
camerounais", Thèse de doctorat/ Ph.D en sociologie, Université
de Yaoundé I, 2017.
179
- Mémoires
- Attadjoude D., "Le rôle des associations
féminines dans la promotion de la femme de la région de
l'Adamaoua : le cas du Réseau des Associations des Femmes de la Vina
(RAFVI)", Mémoire de master en sociologie, Université de
Yaoundé I, 2013.
- Bahoken Bekona H., "Les élections parlementaires dans
la région du Mbam au Cameroun : Essai d'analyse historique de 1946
à 1992", Mémoire de master en histoire, Université de
Yaoundé I, 2010.
- Beng E.M.V., "Gestion et participation du personnel
féminin des forces de défense et de sécurité
camerounaise aux opérations de Maintien de la Paix de 2000 à
2014, Mémoire de master professionnel en sociologie, Université
de Yaoundé I, 2015.
- Ekotto Menye Ella, R. H., "Disparité de genre et
accès des salarié(e)s) à la formation professionnelle
continue au Cameroun : une approche comparée du secteur public et du
secteur privé à Yaoundé", Mémoire de master en
sociologie, Université de Yaoundé I, 2014.
- Elanga Mbamgono A.M.F., "Les politiques sociales au
bénéfice des femmes en zone CEMAC", Mémoire de master en
relations internationales, IRIC, 2012.
- Faka, V., "La BAD et le développement
socioéconomique du Cameroun entre 1972 et 2010", Mémoire de
master en histoire, Université de Yaoundé I, 2017.
- Foulda A., "Rapport de stage Académique au
Ministère de l'action sociale, de la solidarité nationale du 16
Octobre 2013 au 31 septembre 2014", Master professionnel en sociologie,
Université de Yaoundé I, 2014.
- Hekebereya S., "La coopération sectorielle en Afrique
Centrale : le cas de la CEBEVIRHA (Commission Economique du Bétail, de
la Viande et des Ressources Halieutiques)", Mémoire de master en
relations internationales, IRIC, 2009.
- Koumba P.I., "L'intégration de la femme gabonaise
dans le processus de développement", Mémoire de maîtrise en
sociologie, 1979.
- Lepouma-Mapoba B., " La libre circulation des personnes et
des biens dans la sous-région de l'Afrique Centrale", Mémoire de
master en sciences politiques, Université de Yaoundé II, CREPS,
2012.
- Menye-Ella Ekotto R.H., "Disparités de genre et
accès des salarié(e)s) à la formation professionnelle
continue au Cameroun : Une approche comparée du secteur public et
privé et du secteur privé de la ville de Yaoundé",
Mémoire de master en sociologie, Université de Yaoundé I,
2014.
- Les périodiques camerounais
- Cameroon Tribune, quotidien bilingue n°
9126/5325, 34 e année, mercredi 25 Juin 2008.
180
- Nna J., "Sécurité et défense en Afrique
centrale 1960-2009", Mémoire de master en histoire, Université de
Yaoundé I, 2009.
- Ngartebaye E. L-Y., " La participation de la femme à
la vie politique au Tchad : 19332003", Mémoire de maîtrise en
sciences sociales, UCAC, 2003.
- Njingang F.E., "La Conférence de Beijing : impact sur
l'intégration politique, économique et socioprofessionnelle de la
femme au Cameroun", Mémoire de master en histoire, Université de
Yaoundé I.
- Sommo Pende A., "l'intégration sous régionale
en CEMAC à l'épreuve de la liberté de circulation des
biens et des personnes", Mémoire de master en Gouvernance et politique
publique, UCAC, 2010.
G. LES PERIODIQUES
- Les périodiques de la CEMAC
- Bulletin officiel CEMAC n° 1,
République du Cameroun, République Centrafricaine,
République du Congo, République du Gabon,
République de Guinée équatoriale,
République du Tchad, 2004.
- CEBEVIRHA Info, n° 003, Juin 2012.
- CPAC Info, Bulletin n° 006, Avril-Juin 2009.
- Echo de l'E.H. T-CEMAC, n° 002, Novembre 2011.
- Echos d'Aujourd'hui n° 15, CEMAC, Trimestriel,
Edition CEMAC, Juillet 2005.
- Echos d'Aujourd'hui n° 16, CEMAC, trimestriel,
Edition CEMAC, Août 2006.
- Hebdo Intégration, La tribune des communautés
n° 260 du lundi 30 janvier 2017.
- Le Courrier de la SJ-CEMAC 1ère
édition, 18 Septembre 2012.
- Le Magazine de l'OCEAC, n° 001, Novembre 2007.
- Le Magazine de l'OCEAC, n° 003, Juillet 2003.
- Le Relais de l'négation, n° 0006, Juin
2012.
- Vision CEMAC, n° 007, Septembre 2012.
- Vision CEMAC, n° 01, 28 décembre 2010.
- Vision CEMAC, publication de la CEMAC n° 003, 29
Octobre 2010.
- Vision CEMAC, publication de la CEMAC n° 005,
Février 2012.
181
- Cameroon Tribune, quotidien bilingue n°
8993/5192, 34e année, vendredi 07 Décembre
2007.
- Mutations, n° 3163, 2012.
- Relais Intégration, n° 0006, Juin
2012.
- Régionale la Découverte,
Juillet/Août, 2015.
II. BIBLIOGRAPHIE
A. OUVRAGES
- Ouvrages généraux
- ABC de la diplomatie, Département
fédéral des affaires étrangères, Berne, 2008.
- Aboa A. L., al., Démocratie et
développement en Afrique : perspectives des jeunes
chercheurs en Afrique, Dynamique nationales et
régionales du développement, Tome I,
Paris, L'Harmattan, 2013.
- Abwa D., al., Dynamiques d'intégration
régionale en Afrique centrale, Actes du Colloque
de Yaoundé, Tome 1, Yaoundé,
PUY, 2001.
- Ahohe E., Malick Bale M., al., Les économies
de l'Afrique centrale : enjeux et défis de
l'économie verte en Afrique centrale, 2013.
- BAD, Indice de l'égalité du genre en Afrique,
Autonomiser les femmes africaines : plan
d'action, Abidjan, 2015.
- Bakyono A. M., Nagnigui Kamara, D., al., Les
économies de l'Afrique centrale, Paris,
Maisonneuve et Larose, 2005.
- Balandier G., Sociologie actuelle de l'Afrique noire,
dynamique sociale en Afrique
centrale, Paris, PUF, 1963.
- Boddy-Evans A., What caused scramble for Africa?
Retrieved, 2012.
- Booh Booh J.R., Organisation et Relations
Interafricaine, Yaoundé, ENAM, 1972.
- Boudon R., L'Inégalité des chances,
Paris, Armand Colin, 1973
- Bourdieu P., La domination masculine, Paris, Seuil,
1998.
- Braillard P., Théories des systèmes et
relations internationales, Bruxelles, Bruyant, 1977.
- CEMAC, Textes organiques, Yaoundé, Ed.
Saagraph, Mai 1998.
, PER, plan opérationnel 2011-2015, Décembre
2011.
, Des centres et unités de recherche
rattachés, Yaoundé, Ed. Saagraph, Janvier 2006.
, Traité révisé de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC)du 16 mars 1994, révisé le 25
juin 2008.
182
- CINU, Communauté Economique pour l'Afrique, Genre
et éducation pour la culture de la
paix en Afrique, Septembre 2013.
- Commission économique pour l'Afrique, le Genre et
l'Education à la culture de la paix en
Afrique Centrale, septembre 2013.
- Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale, Programme Economique
Régional, Plan opérationnel,
décembre 2011.
- Cornevin M., Histoire de l'Afrique Contemporaine : de la
deuxième guerre mondiale à nos
jours, Paris, Payot, 1979.
- Delcorde R., Les mots de la diplomatie, Paris,
L'Harmattan, 2005.
- Delphy C., l'Ennemi principal, Paris, Syllepse,
1998.
- Diop C-A., L'unité culturelle de l'Afrique
noire, Paris, Présence africaine, 1982.
- Durkheim E., La division du travail social, Paris,
PUF, 1893.
- Ehrenreich B., Rites de sang : origines et histoire des
passions de la guerre, Metropolitan
book, 1997.
- Guionnet C., Neveu E., Féminins/Masculin :
sociologie du genre, Paris, Armand Colin,
2005.
- International Bank for Reconstruction and Development / The
World Bank, Briser les
Obstacles au Commerce Agricole Régional en Afrique
Centrale, Août 2018.
- Ki-Zerbo J., Histoire de l'Afrique Noire d'hier à
demain, Paris, Hatier, 1972.
- Klotz Lynch C., Le constructivisme dans la
théorie des relations internationales, Critique
internationale 2, 1999.
- Mirbeau O., La mort de Balzac, Paris,
Bibliothèque Charpentier - Fasquelle, 1907.
- Mukasa A. N., Salami A. O., Gender equality in
agriculture : What are really the benefits
for Sub-Saharan Africa ? Africa Economic Brief Chief
Economist Complex | AEB, 7(3),
2016.
- N'nah Métégue N., Histoire du Gabon. Des
origines à l'aube du XXIe siècle, Paris,
L'Harmattan, 2006.
- Ngapeth Biyong M-I., Cameroun : Combats pour
l'Indépendance, Paris, L'Harmattan,
2010.
- Onuf N., World of our making : Rules in social theory
and international relations,
Colombia University of Sourth Carolina, Press, 1989.
- Pourtier R., Atlas de l'UDEAC, Paris,
Ministère de la Coopération, 1993.
- Saurrugger, S., Théories et concepts de
l'intégration européenne, Paris, Science po, 2009.
183
- Second L., La Sainte Bible, Nouveau
testament, Printed for Bibles par Internet and GLIFA, 1910.
- Tamekamta A. Z., Le Cameroun à l'UDEAC : Bilan et
perspectives d'une gestion administrative contestée à
l'ère du Renouveau, Paris, L'Harmattan, 2011.
- Théry I., La Distinction de sexe : Une nouvelle
approche de l'égalité, 2007.
- Touscoz J., Lormand J., Coopération scientifique et
technique entre les Etats membres de l'UDEAC, Paris, Unesco, 1977.
- Vinay B., Coopération intra-africaine et
intégration l'expérience de l'UDEAC, Penant,1971.
- Ouvrages spécifiques
- Bilongo B., La femme noire africaine en situation, ou si la
femme africaine était opprimée
? Yaoundé, CNE, 1993.
- Dhavermas O., Droits des femmes : pouvoirs des hommes,
Paris, Seuil, 1978.
- Durieux C., Les femmes américaines en
politiques, Paris, Ellipses, 2008.
- Groupe de la BAD, Autonomiser les femmes : plan d'action,
Indice de l'égalité du genre
en Afrique 2015, Abidjan, 2015.
- Mianda G., Femmes africaines et pouvoir. Les
maraîchères de Kinshasa, Paris,
L'Harmattan, 1996.
- Mikelle G., African feminism in subsaharan Africa,
Philadelphia University of
Pennsylvania, 1997.
- Ngoa H., Non, La femme africaine n'était pas
opprimée, Yaoundé, Clé, 1975.
- Sutherland-Addy E., Diaw A., Des femmes écrivent
l'Afrique : L'Afrique de l'Ouest et du
Sahel, Paris, Karthala, 2007.
- Tsala Tsala J-P., La femme béti entre tradition et
modernité. Une demande en souffrance,
Paris, Université de Louis Pasteur, 1988.
- Vincent J.F., Tradition et transition. Entretiens avec les
femmes du Sud Cameroun, Paris,
Berger Levrault, 1976.
- Ouvrages méthodologiques
- Beaud M., L'art de la thèse : Comment
préparer et rédiger un mémoire de Master, une thèse
de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du
net, Paris, La Découverte, 2006.
- Bloch M., Apologie pour l'histoire ou métier
d'historien, Paris, Armand Colin, 1952.
184
- Braudel F., Ecrits sur l'histoire, Paris,
Edition Flammarion, 1969.
- Frangnière J. P., Comment réussir un
mémoire, comment présenter une thèse, comment
rédiger un rapport, Paris, Dunod, 1986.
- Grawitz M., Méthode des sciences sociales,
Paris, Dalloz, 11ème édition, 2001.
- Nda P., Méthodologie de la recherche, de la
problématique à la discussion des résultats. Comment
réaliser une thèse, un mémoire d'un bout à
l'autre. Collection Pédagogie, Abidjan, Edition universitaire de
Côte-d'Ivoire/ Université de Cocody, 2006.
- Prost A., Les douze leçons sur l'histoire,
Paris, Le Seuil, 1996.
- Quivy R., Van Campenhoudt L., Manuel de recherche en
sciences sociales, Paris, Dunod, 4e édition, 2006.
B. ARTICLES
- Achancho V., "Revue et analyse des stratégies
nationales d'investissements et des politiques agricoles en Afrique du Centre :
cas du Cameroun", in Reconstruire le potentiel alimentaire de l'Afrique de
l'Ouest, A. Elbehri (ed.), FAO/FIDA.
- Avom D., "Intégration régionale dans la CEMAC
: des problèmes institutionnels récurrents", in Afrique
Contemporaine, n°222, 2007.
- Bathili A., "La conférence de Berlin 1885 : causes et
conséquences", in Aujourd'hui l'Afrique, "Centenaire de la
Conférence de Berlin (1884-1885)", n°31-32.
- Flobert P., "Sur la validité des catégories de
voix et de diathèses en latin", in Moussy, C., Mellet S., La
validité des catégories attachées au verbe, Presses
de l'Université de Paris-Sorbonne, coll. "lingua Latina", recherches
linguistiques du Centre Alfred, n°1, 1ere ed., vol. 1, Septembre 1992.
- Fougeyrollas, P., Roy K., " Regard sur la notion de
rôles sociaux. Réflexion conceptuelle sur les rôles en lien
avec la problématique du processus de production du handicap", in
Service social, Vol. 45, n° 3, 1996.
- Itoumba O. P., "Les femmes et la politique au Gabon
(1956-2009)", in Revue gabonaise d'histoire et archéologie,
Editions Lumières, n°2, 2017.
- Jayati Ghosh, "L'impact de la crise sur les droits des
femmes : les perspectives sous régionales", Octobre, 2009.
- Kaunda E., "Étude sur le potentiel de l'aquaculture
en Afrique", Mai 2015.
- Kayembe Mungedi R., "L'intégration régionale
en Afrique : regard critique sur la prolifération des regroupements
régionaux", in Aboa, A. L., al., Démocratie et
185
développement en Afrique . perspectives des jeunes
chercheurs africains, Tome I, Paris, L'Harmattan, 2013.
- Loungou S., "La libre circulation des personnes au sein de
l'espace de la C.E.M.A.C : entre mythes et réalités", in
Revue belge de géographie, n°3, Open Edition Journals,
2010.
- Macleod A., "Théorie des relations internationales",
in T. Balzac et F. Ramel (dir)., Traité de relations
internationales, Paris, sciences Po, 2013.
- Malu-Malu M. D., "Guinée Equatoriale : le projet de
"femme idéale", pour l'égalité des droits entre les deux
sexes", 31 mai 2017.
- Mbarga Z.R., "Intégration Régionale, Fotrac
2018 : Place à l'interrégionalisme par le bas", publié le
11/07/2018, in
https://journalintegration.com/fotrac-2018-place-a-linterregionalisme-bas/.
Consulté le 19/04/2019.
- Ntahohari J., Ndayiziga, B., "Le rôle de la femme
burundaise dans la résolution pacifique des conflits", in UNESCO,
Les femmes et la paix en Afrique . Etudes de cas sur les pratiques
traditionnelles de résolution des conflits, Paris, Pointed in
France, 2003.
- Roberts R., "Peculiarities of Africa labor and working class
history", in Labor/travail, 1982.
- Temgoua A. P., "Statut et rôle de la femme dans la
société précoloniale", in Fame-Ndongo J., La femme
camerounaise et la promotion du patrimoine culturelle, Yaoundé,
CLE, 2002.
- Temgoua A.P., "Femme et intégration en Afrique
centrale", in Daniel, A., Essomba, J-M., al., Dynamiques
d'intégration régionale en Afrique centrale, Tome 2,
Yaoundé, PUY, 2001.
- Thébaud F., "Les femmes", in Histoire de
l'humanité, le XXe . De 1914 à nos jours, Vol 7,
Londres, UNESCO, 2009.
- Thiénot D., "Les femmes entre les fronts en
République centrafricaine", in Rapport sur l'Afrique centrale
10, Institut d'Etudes de Sécurités, Septembre 2017.
- Trepanier G., "La paysanne camerounaise entre
l'émancipation et l'aliénation", in Revue camerounaise des
études africaines, 1970.
- Virgili F., "L'Histoire des femmes et l'histoire des genres
aujourd'hui", in Revue d'histoire vingtième siècle,
Juillet-Septembre, n°20, 2002.
- Yana S. D., ". Statuts et rôles féminins au
Cameroun : Réalités d'hier, images d'aujourd'hui", in
Politique Africaine n°65, 1997.
- Zerabi, "Femmes au Maroc entre hier et aujourd'hui : quels
changements ?", in Recherches, vol 3, n°77.
186
C. DICTIONNAIRES
- Battistela D., al., Dictionnaire des Relations
internationales, Paris, Edition Dalloz, 3e
Edition 2012.
- Pastoureau M., Dictionnaire des couleurs de notre
temps, Paris, Hachette, 1991.
- Zézé Kalonji M. T., Dictionnaire des
organisations interafricaines, lexique et textes,
Paris, Edition Girof, 1997.
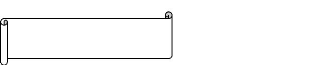
187
TABLE DES MATIERES
DEDICACE i
SOMMAIRE ii
TABLE DES
MATIERESREMERCIEMENTS iii
SIGLES, ACRONYMES, ABREVIATIONS iv
LISTE DES ILLUSTRATIONS vi
RESUME viii
ABSTRACT ix
INTRODUCTION GENERALE 1
1. Contexte et justification du sujet 1
2. Raisons de choix du sujet 2
3. Cadre géographique et chronologique 4
4. Définition des concepts 7
5. Cadre théorique 10
6. Intérêt de l'étude 15
7. Revue critique de la littérature 17
8. Problématique 23
9. Méthodologie 24
10. Difficultés rencontrées 26
11. Plan du travail 27
CHAPITRE I : PRESENTATION
DE LA FEMME EN AFRIQUE CENTRALE ZONE
CEMAC ..28
A. RAPPEL HISTORIQUE 29
1. Situation de la femme à l'ère
précoloniale 29
a. Le statut politico-juridique 29
b. La situation socio-économique 31
2. La femme à l'époque coloniale 34
a. Dans le domaine politico-juridique 34
b. Dans le domaine socio-économique 35
B. LA CREATION DE L'UDEAC ET LA PLACE RESERVEE AUX
FEMMES 38
1. Présentation de l'UDEAC 38
a. Les objectifs de l'UDEAC 39
188
b. Organes et institutions spécialisées de l'UDEAC
40
2. La place réservée aux femmes à l'UDEAC
42
3. Quelques femmes et les postes occupés au sein de
l'UDEAC 45
C. L'AVENEMENT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE
SOUS
REGIONALE LA CEMAC 46
1. Objectifs, missions et principes de la CEMAC 48
a. Les Objectifs 48
b. Les principes 49
c. Les missions 50
2. Les organes et les institutions spécialisées de
la CEMAC 51
a. Les organes 51
b. Les Institutions Spécialisées 52
CHAPITRE II : LE ROLE DE LA FEMME AU SEIN DE
L'ORGANISATION
INTERNATIONALE SOUS REGIONALE LA CEMAC 54
A. LES LEGISLATIONS EN FAVEUR DES FEMMES DANS LA CEMAC
54
1. Les législations internationales ratifiées par
les Etats de la CEMAC 54
2. Les législations nationales sur la femme 58
3. Les législations de l'Organisation Internationale sous
régionale la CEMAC 64
B. DE LA CONTRIBUTION DIPLOMATIQUE DE LA FEMME
66
1. La femme sur le plan politique 67
a. Dans les domaines de la paix, la sécurité et la
prévention des conflits en zone
CEMAC 67
b. Les femmes dans les grands débats et
l'élaboration des directives politiques de la
Communauté 69
c. L'expertise féminine dans le cadre bilatéral
pour un renforcement des relations
communautaires 72
2. Le rôle de la femme dans le volet économique
73
a. Dans l'agriculture 74
b. La pêche et l'élevage 76
c. Le secteur commercial : une étude à travers la
foire transfrontalière 80
3. La femme dans le domaine socioculturel 82
a. Dans la santé 83
b. La femme dans l'éducation, l'enseignement et la
formation 85
c. Dans le cadre du sport 88
d. Le domaine de l'art 90
189
C. LES MOYENS D'ACTION DE LA FEMME DANS LA CEMAC
92
1. Les groupes d'association : le REFAC et la Synergie
Jeune-CEMAC (SJ-CEMAC) 93
a. Le REFAC comme moyen d'action des femmes de la CEMAC 93
b. La SJ/CEMAC 93
2. Des événements culturels et sportifs : la coupe
de football CEMAC, la Coupe
d'Afrique des Nations de football et les foires communautaires
95
a. La coupe de football CEMAC et la Coupe des Nations de
Football 96
b. Les activités culturelles, artistiques et le dynamisme
des femmes dans la CEMAC 97
CHAPITRE III : LES LIMITES A L'ACTION DIPLOMATIQUE DE LA
FEMME AU
SEIN DE LA CEMAC 101
A. LA CONJONCTURE COMMUNAUTAIRE ET LES LOIS
DEFAVORABLES
AUX FEMMES 101
1. Les crises économiques 102
2. Les conflits frontaliers et internes aux Etats : cas de Boko
Haram et du conflit
centrafricain 105
3. Les contraintes socioculturelles et les lois
défavorables aux femmes 107
B. LES PROBLEMES GENERAUX A LA LIBRE CIRCULATION
113
1. Des barrières douanières, sanitaires et
éducationnelles 113
2. Les décisions non appliquées 116
C. AUTRES FORMES DE DIFFICULTES 117
1. L'implication limitée du "gouvernement" de la CEMAC
à la cause des femmes .. 117
2. Le manque de Fonds et de volonté politique des Etats
membres 118
CHAPITRE IV : BILAN DE LA CONTRIBUTION DIPLOMATIQUE DE LA
FEMME AU SEIN DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE SOUS REGIONALE LA
CEMAC 120
A. DES REALISATIONS DIPLOMATIQUES DE LA FEMME DANS LA
CEMAC,
ENJEUX DE LEUR PRESENCE DANS DES POSTES DE REPONSABILITE
. 120
1. Au sein de la Commission et des Représentations-pays
120
2. Des Institutions spécialisées 126
3. Les autres structures partenaires de la CEMAC. 130
a. Cas de la Synergie Jeune-CEMAC 130
b. Cas du REFAC et de la FOTRAC 131
B. L'IMPACT DES REALISATIONS DIPLOMATIQUES DES FEMMES
DANS LA
CEAMC, 134
1. La prise de grandes décisions et la réforme des
politiques communautaires 134
190
2. La promotion de l'intégration économique dans
la CEMAC et le vivre ensemble ...136
C. DES PERSPECTIVES POUR UNE MEILLEURE PROMOTION DE LA
FEMME
DANS LA CEMAC 137
1. Des mesures institutionnelles 137
2. Dans le cadre juridique 139
3. Des mesures dans le cadre sociopolitique 141
CONCLUSION GENERALE 147
ANNEXES 152
SOURCES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 174
| 


