|
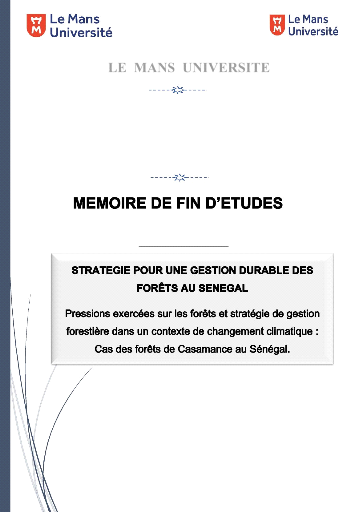
LE MANS UNIVERSITE
MASTER GESTION DES TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT LOCAL
Parcours
TRANSITION ECOLOGIQUE, DECHETS ET ECONOMIE CIRCULAIRE
EN AFRIQUE
THÈME DE MEMOIRE
Présenté et soutenu par :
M. DIOUF
Abdoul Aziz Sy
Professeur référent et Directeur de
mémoire : M. TSAYEM DEMAZE Moïse
Septembre 2023
1
REMERCIEMENTS
Ce travail est l'aboutissement d'un long cheminement
scolaire qui a nécessité de la part de
nombreuses personnes
des sacrifices pour notre personne et qu'il nous fait plaisir de
remercier
!!!!!!!!!!!!
Nous exprimons nos remerciements et notre profonde
gratitude à Monsieur Moïse TSAYEM
DEMAZE, Responsable
pédagogique du parcours Transition écologique, déchets et
économie
circulaire en Afrique (TREDECA) et Directeur de
mémoire pour sa disponibilité, ses conseils, ses
suggestions
et recommandations, sa participation active, l'encadrement et l'assistance
durant toute la
période de formation et de la réalisation de
ce document.
!!!!!!!!!!!!!!!!
Nos remerciements vont également à l'endroit
de ma femme Madame DIOUF Aissatou Kany pour ses conseils et assistance, son
soutien moral et ses encouragements durant toute la période de
formation.
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! A tous ceux qui, de près ou de loin, ont
contribué à la réussite de ce document
!!!
2
SOMMAIRE
Sigles et abréviations 6
INTRODUCTION 9
CHAPITRE 1 : CONTEXTE, PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE
14
I. CONTEXTE DE L'ETUDE 14
II. PROBLEMATIQUE 18
III. OBJECTIF GENERAL DE L'ETUDE 28
IV. METHODOLOGIE 28
1. Revue bibliographique 28
2. Recueil des données 29
3. Outils de collecte de données 30
4. Traitement et analyse des données, et
rédaction du document 30
CHAPITRE 2 : PRESENTATION DE LA ZONE CONCERNEE PAR
L'ETUDE 31
I. Présentation du Sénégal et de la
région de Casamance 31
1. Brève présentation du
Sénégal 31
1.1. Données physiques 31
1.2. Données climatologiques 31
1.3. Données hydrographiques 31
1.4. Données démographiques 32
1.5. Caractéristiques socio-démographiques
32
2. Présentation de la région de Casamance
32
II. Les ressources végétales au
Sénégal et les forêts casamançaises 36
3
CHAPITRE 3 : GESTION ET GOUVERNANCE DES RESSOURCES
FORESTIERES AU
SENEGAL 39
I. Cadres politique, juridique et institutionnel de la
gestion des ressources forestières 39
1. Cadre politique de la gestion des ressources
forestières 39
1.1. Le Plan Directeur de Développement Forestier
(PDDF) 41
1.2. Plan d'Action Forestier du Sénégal
(PAFS) 41
1.3. Plan National d'Action pour l'environnement (PNAE)
42
1.4. Programme d'Action Nationale de Lutte contre la
Désertification (PAN/LCD) 42
1.5. Lettre de Politique Sectorielle de l'Environnement
(LPSE) 43
1.6. La Stratégie Nationale et Plan Nationale
d'Actions pour la Conservation de la
Biodiversité (SPNAB) 44
1.7. Loi d'Orientation Agro-sylvo-pastorale (LOASP)
45
1.8. Politique Forestière du
Sénégal 2005-2025 (PFS) 46
1.9. Plan Sénégal Emergent (PSE)
47
2. Cadre juridique régissant la gestion des
ressources forestières 48
3. Cadre institutionnel de la gestion des ressources
forestières 51
3.1. L'administration centrale 51
3.2. L'administration déconcentrée
55
3.3. Le niveau décentralisé 56
3.3.1. Les collectivités territoriales
56
3.3.2. Les agences de développement 57
II. Evolutions de la gouvernance des ressources
forestières au Sénégal 58
1.
4
Approches et bref historique de la gouvernance
forestière 58
2. Différents acteurs de la gouvernance
forestière 61
2.1. Les acteurs étatiques de la gouvernance
forestière 62
2.1.1. Les niveaux central et déconcentré
62
2.1.2. Le niveau décentralisé
63
2.2. Les acteurs non étatiques de la gouvernance
forestière 64
III. Outils de gouvernance forestière
66
1. Les conventions locales 66
2. Les conventions locales et la gestion des ressources
naturelles 67
CHAPITRE 4 : ANALYSE ET DISCUSSION 69
I. Analyse des pressions exercées sur les
forêts en Casamance 69
1. Identification des différentes pressions sur
les forêts casamançaises 69
2. Les causes et les conséquences de la
déforestation et de la dégradation des forêts
en
région casamançaise 70
2.1. Les principales causes de la dégradation et
de la déforestation en Casamance 70
2.2. Les conséquences de la dégradation et
de la déforestation en Casamance 71
II. Analyse de la stratégie de gestion
forestière mise en oeuvre 72
III. Recommandations en faveur de l'amélioration de
la stratégie pour une gestion durable
des forêts en Casamance 73
CONCLUSION 75
BIBLIOGRAPHIE 76
TABLE DES MATIERES 89
Liste des figures
Figure 1 : Répartition mondiale des forêts par
domaine climatique 10
Figure 2 : Hausses et reculs de la surface forestière
mondiale par région de 1990 à 2020 16
Figure 3 : Taux annuel d'expansion de la forêt et de
déforestation de 1990 à 2020 19
Figure 4 : Bois abattu illégalement par des individus
23
Figure 5 : Bois saisit par les agents des eaux et forêts
23
Figure 6 : Importations chinoises de grumes et de sciages de
bois de rose en provenance des pays de la
CEDEAO, 2015 24
Figure 7 : Marché de Sare Bodjo, à un
kilomètre à l'intérieur de la Gambie 25
Figure 8 : Situation géographique de la région
naturelle de la Casamance 33
Figure 9 : Carte des trois régions administratives de
la Casamance 34
Figure 10 : Grands domaines de peuplements
végétaux 37
Figure 11 : Perte de couverture forestière dans la
région de Ziguinchor 38
Figure 12 : Frise chronologique de l'évolution de la
politique de gestion des ressources forestières au
Sénégal 40
Figure 13 : Frise chronologique de l'évolution des
approches dans le secteur forestier au Sénégal 60
Figure 14 : Graphe des acteurs de la gouvernance
forestière et relations entre acteurs 61
5
6
Sigles et abréviations
ADL : Agence de Développement Local
ADM : Agence de Développement Municipal
AFP : Agence France-Presse
AGM : Africa Green Magazine
ANEV : Agence Nationale des Ecovillages
ANGMV : Agence Nationale de la Grande Muraille Verte
ANSD : Agence Nationale de la Statistique et de la
Démographie
ARD : Agence Régionale de Développement
ASRGMV : Agence Sénégalaise de Reforestation, de la
Grande Muraille Verte
CADL : Centre d'Appui au Développement Local
CDB : Convention sur la Diversité Biologique
CDD : Commission du Développement Durable des Nations
unies
CDDC : Convergence pour le Désenclavement et le
Développement de la Casamance
CDN : Contribution déterminée au niveau National
CEA : Commission Economique pour l'Afrique
CEDEAO : Communauté Economique des États de
l'Afrique de l'Ouest
CFA : Colonies Françaises d'Afrique
CILSS : Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la
Sécheresse dans le Sahel
CIRAD : Centre de coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le
Développement
CNDD : Commission Nationale pour le Développement
Durable
CONSERE : Conseil Supérieur des Ressources Naturelles et
de l'Environnement CSE : Centre de Suivi Ecologique
7
CNULCD : Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la
Désertification
DAMCP : Direction des Aires Marines Communautaires
Protégées
DEEC : Direction de l'Environnement et des Etablissements
Classés
DEFCCS : Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la
Conservation des sols
DFVP : Direction des Financements Verts et des Partenariats
DIRPA : Direction de l'Information et des Relations publiques
des Armées
DPN : Direction des Parcs Nationaux
DPVE : Direction de la Planification et de la Veille
Environnementale
EHCVM : Enquête Harmonisée sur les Conditions de
Vie des Ménages
FAO : Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture
FMI : Fonds Monétaire International
GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du
Climat
GIZ : Agence de coopération internationale allemande
pour le développement
GMV : Grande Muraille Verte
HAL-LMU : Hyper Article en Ligne - Le Mans
Université
IFN : Inventaire Forestier National
IPAR : Initiative Prospective Agricole et Rural
IREF : Inspection Régionale des Eaux et Forêts
IRD : Institut de recherche pour le développement
LMU : Le Mans Université
LOASP : Loi d'Orientation Agro-sylvo-pastorale
LPSD : Lettres de Politiques Sectorielles de
Développement
LPSE : Lettre de Politique Sectorielle de l'Environnement
MEDD : Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable
MEPN : Ministère de l'Environnement et de la Protection de
la Nature
MEPNBRLA : Ministère de l'Environnement, de la Protection
de la Nature, des Bassins de
Rétention et des Lacs Artificiels
MFDC : Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance
ODD : Objectifs de Développement Durable
OIBT : Organisation Internationale des Bois Tropicaux
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PAFS : Plan d'Action Forestier
PAN/LCD : Programme d'Action Nationale de Lutte Contre la
Désertification
PDDF : Plan Directeur de Développement Forestier
PFS : Politique Forestière du Sénégal
PNAE : Plan National d'Action pour l'Environnement
RdS : République du Sénégal
SPNAB : Stratégie Nationale et Plan Nationale d'Actions
pour la Conservation de la
Biodiversité
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
USAID : Agence des Etats-Unis pour le développement international
8
9
INTRODUCTION
Les pressions opérées par nos
sociétés et leur mode de fonctionnement économique
mondialisée sont aujourd'hui à l'origine d'importants processus
de dégradation et de disparition des ressources forestières
à l'échelle mondiale et des changements climatiques
observés partout dans le monde (Naturefrance, 2022). Avec le
phénomène de mondialisation qui expose les forêts à
la pression des marchés internationaux, l'adaptation des territoires aux
changements environnementaux devient d'autant plus cruciale que
s'accélèrent et s'accentuent les bouleversements climatiques. En
effet, après la seconde guerre mondiale marquée par la
période de reconstruction et des changements profonds impulsés
par le phénomène de l'industrialisation, trois grands espaces de
déforestation active se dégagent dans le monde : l'Amazonie en
Amérique du Sud, l'Afrique équatoriale et la zone
Malaisie/Indonésie en Asie (FAO, 2006)1. Aujourd'hui,
l'Afrique est le seul continent où la déforestation et la
dégradation des forêts se poursuivent à un rythme alarmant
avec une progression la plus rapide au monde, d'après le dernier rapport
d'évaluation des ressources forestières mondiales de
l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO, 2020).
Selon le rapport de mission « Protection des forêts
tropicales et de leur biodiversité contre la dégradation et la
déforestation », la crise forestière mondiale est avant tout
une crise de surconsommation liée principalement aux activités
humaines (Le Guen, 2010). La mondialisation économique a entrainé
une consommation excessive des ressources naturelles, engendré des
pollutions de l'environnement et une destruction encore plus
accélérée des ressources déjà
surexploitées notamment les ressources forestières. Bien qu'elles
soient des ressources inégalement réparties
géographiquement sur le globe, les forêts du monde couvrent une
superficie totale estimée à 4,06 milliards d'hectares,
correspondant à 31% de la superficie terrestre mondiale, d'après
les résultats d'évaluation des ressources forestières
mondiales (FAO, 2020)2. L'Europe y compris la Russie héberge
le 1/4 de la superficie forestière mondiale. S'en suivent
l'Amérique du Sud (21%), l'Amérique du Nord et centrale (19%),
l'Afrique (16%), l'Asie (15%) et l'Océanie (5%). Plus de la
moitié soit précisément 54% des forêts mondiales se
trouvent localiser exclusivement dans cinq pays (Russie, 20% ; Brésil,
12% ; Canada, 9% ; USA, 8% ; Chine, 5%) et on estime qu'environ 45% de la
superficie forestière mondiale sont occupées par les forêts
tropicales en 2020.
1 FAO, Rapport d'évaluation des ressources
forestières mondiales « Résultats principaux de FRA 2005
»
2 FAO, Rapport d'évaluation des ressources
forestières mondiales « Résultats principaux de FRA 2020
»

10
Figure 1 : Répartition mondiale des forêts par
domaine climatique 3
Les forêts mondiales ont longtemps joué un
rôle primordial dans la création des microclimats et la
régulation du climat du globe terrestre. On distingue les forêts
primaires communément appelées forêts vierges ou anciennes
(ou encore originelles) hébergeant généralement d'immenses
arbres centenaires, des forêts secondaires constituées davantage
d'arbres de plus petites tailles et jeunes. Les forêts primaires
structurellement plus intactes et complexes par rapport aux secondaires,
fournissent en plus de la préservation de la biodiversité, de
nombreux services écosystémiques (maintien et protection des sols
et de la qualité des eaux, séquestration du carbone...). Les
forêts secondaires sont des forêts victimes de perturbations
profondes et offrent également des services écosystémiques
(épuration des eaux, fournir des produits forestiers, protection des
sols contre l'érosion, stockage du carbone...). D'après le
rapport du Global Forest Watch sur l'état des forêts tropicales du
monde, les forêts tropicales primaires permettent de stocker plus de
carbone en comparaison avec les autres forêts et procurent un habitat
à une biodiversité riche et très rare (Global Forest
Watch, 2020). Selon le Directeur du
3 Source : FAO, Rapport d'évaluation des
ressources forestières mondiales 2020.
11
Département des affaires internationales au
Ministère néerlandais de l'agriculture, de la nature et de la
qualité de l'alimentation, des études réalisées par
la FAO ont montré que les forêts emmagasinent d'énormes
quantités de carbone et on estime actuellement plus de 1000 milliards de
tonnes de carbone stockées par les forêts et les sols forestiers
mondiaux, soit l'équivalent de 2 fois plus que le volume présent
dans l'atmosphère (Hoogeveen, 2007).
D'après les résultats de l'étude
intitulée « Cartes mondiales des flux de carbone forestier du XXIe
siècle » publiés dans la revue Nature Climate Change, les
forêts mondiales ont absorbé 2 fois plus de gaz qu'elles n'en ont
émis sur la période allant de 2001 à 2019 (Férard,
2021). Chaque année, elles ont en moyenne consommé 16 milliards
de tonnes de CO2 annuellement contre 8,1 milliards de tonnes
libérées du fait de la déforestation et d'autres
perturbations (Harris et al., 2021). La destruction de ces forêts se
traduit par une réduction de la capacité de
l'écosystème mondial à stocker du carbone, donc moins de
CO2 absorbé et inversement une augmentation de l'effet de serre, cause
principale du réchauffement climatique de la planète. Depuis
2002, plus de la moitié des destructions de ressources
forestières tropicales sont enregistrées dans les forêts
localisées dans la région amazonienne ou dans ses environs
immédiats (Krogh, 2021). Selon l'ONG Rainforest Foundation Norway,
l'exploitation des ressources forestières et la conversion des terres
notamment pour des besoins de productions agricoles ont réduit à
néant 34% des forêts tropicales humides primaires et conduit
à la dégradation, la destruction partielle ou complète
puis à leur remplacement par des forêts secondaires de plus de 30%
des forêts tropicales primaires, les rendant plus vulnérables aux
feux de forêt ou à des potentielles exploitations
ultérieures.
La superficie forestière mondiale ne cesse de diminuer
au fil des années et les pertes de forêts dans le monde sont
énormes, même si toutefois le taux de perte forestière
nette a significativement depuis les années 90 grâce au recul du
rythme de la déforestation dans certaines régions et à
l'augmentation de la superficie forestière relative aux reboisements et
à l'expansion naturelle forestière, d'après le rapport de
l'Organisation mondiale de l'alimentation et l'agriculture sur
l'évaluation des ressources forestières mondiales (FAO, 2020).
Selon le même rapport, les pertes enregistrées à
l'échelle mondiale depuis l'année 1990 ont atteint près de
178 millions d'hectares de couvertures forestières, avec des taux
annuels de perte forestière nette respectifs de 7,8 millions d'hectares
durant la décennie 1990-2000, 5,2 millions entre 2000 à 2010 et
4,7 millions sur la période 2010-2020 (FAO, 2020). L'agriculture est
à l'origine de près de 80% de la déforestation ; les 20%
restants étant attribués par importance respectivement
accordée avant tout à l'industrialisation et la construction
d'infrastructures notamment les
12
routes et les barrages, ensuite aux activités
minières et dernièrement à l'urbanisation, si on se
réfère sur les données du rapport de l'Organisation sur la
situation des forêts du monde (FAO, 2016)4.
Au Sénégal, les formations forestières
essentiellement représentées par les forêts claires, les
forêts galeries et les forêts denses sèches sont
généralement localisées dans la partie Sud du territoire.
De 1965 à l'année 2000, les superficies des forêts ont
progressivement reculées, passant respectivement de 4,4% du territoire
sénégalaise à 2,6% (Tappan et al., 2004). D'après
le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse
dans le Sahel (CILSS), les forêts claires, les forêts galeries et
les savanes ont connu une importante baisse en termes de superficie, avec une
diminution de près de 12 000 km2 entre 1975 et 2013 (Solly et
al., 2021). Par ailleurs, une dégradation forestière très
avancée et une forte diminution de la couverture végétale
ont été constatées entre 1987 et 2018 dans la partie Sud
du pays, en région casamançaise d'après les enquêtes
réalisées dans le cadre d'une étude sur le suivi de la
déforestation par télédétection haute
résolution en Haute Casamance dirigée par des chercheurs du
département de géographie de l'Université de Ziguinchor
(Solly et al., 2018). De plus, l'étude avance que les principaux
facteurs à l'origine de ces phénomènes de
déforestation et dégradation forestière tournent autour
des défrichements agricoles, des nombreux feux de brousse, des coupes
démesurées ou non contrôlées de bois, l'augmentation
de la population et les variations de la pluviométrie.
Logiquement quand les forêts sont surexploitées,
détruites ou incendiées, elles deviennent elles-mêmes une
source de gaz à effet de serre (Sremski, 2022). Tout compte fait, la
destruction des forêts est synonyme d'émission de milliards de
tonnes de dioxyde de carbone chaque année dans notre atmosphère.
Aujourd'hui, il est nécessaire d'empêcher cette libération
de gaz dans l'atmosphère pour lutter contre le réchauffement
climatique, de protéger le patrimoine naturel forestier, le patrimoine
naturel mondial et l'environnement. Cette présente étude
s'intéresse de façon générale à la gestion
durable des ressources forestières en Afrique, plus
particulièrement au Sénégal. Elle cherche à traiter
les différentes pressions exercées sur les vastes forêts de
la région naturelle de la Casamance au Sénégal et à
proposer des solutions réalistes efficaces en faveur d'une
stratégie efficaces pour une gestion durable des forêts
casamançaises. Pour ce faire, l'étude tente dans un premier temps
d'aborder les cadres politique, juridique et institutionnel régissant la
gestion des ressources forestières et l'évolution de la
gouvernance forestière après un brève présentation
de la zone concernée par la présente étude. Ensuite,
elle
4 FAO, Rapport sur la situation des forêts du
monde, 2016.
s'oriente vers l'identification et l'analyse des
différentes pressions exercées sur les forêts de la
région de Casamance, les principales causes et les conséquences
découlant de ces différentes pressions. Enfin, elle cherche
à préconiser des solutions visant à améliorer la
stratégie pour une gestion durable des forêts après avoir
analysé la stratégie mise en oeuvre et identifier les principales
contraintes auxquelles elle est confrontée.
13
14
CHAPITRE 1 : CONTEXTE, PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE
I. CONTEXTE DE L'ETUDE
De nos jours, le changement climatique notamment les questions
sur le réchauffement climatique et les problématiques
liées à la déforestation et de la dégradation des
forêts dans les débats environnementaux qui animent en permanence
la vie politico-sociale sont autant de sujets d'actualités
internationales et occupent le devant de la scène mondiale. La
déforestation et la dégradation des forêts sont aujourd'hui
d'importants facteurs des changements climatiques et de la perte de
biodiversité forestière, deux des plus grands défis
environnementaux majeurs actuels auxquels l'humanité est
confrontée. On estime à l'échelle mondiale à 420
millions d'hectares de forêts la perte forestière imputée
à la déforestation entre 1990 et 2020, en majorité celle
due à l'essartage pour l'agriculture (FAO, 2020). Selon une étude
parue sur la revue Science et portant sur la classification des moteurs de la
perte mondiale des forêts, on estime à l'échelle mondiale
à près de 5 millions d'hectares, les pertes annuelles de
forêts entre les années 2001 et 2015 (Curtis et al., 2018).
L'expansion de l'agriculture constitue la cause directe
d'environ 80% de la déforestation mondiale (Kissinger, Herold et De Sy,
2012), avec des variations importantes selon les régions du monde.
Près de 60% des forêts sont dégradées dans le monde.
Selon l'indice Forest Landscape Integrity, révélé dans une
étude publiée en décembre 2020 dans la revue Nature
Communications, les forêts mondiales ont tellement été
dégradées que seulement 40% sont considérées comme
ayant une haute intégrité écologique c'est-à-dire
celles caractérisées par des niveaux élevés de
biodiversité, des services écosystémiques de haute
qualité et une forte résilience au changement climatique
(Grantham et al., 2020). Plusieurs travaux de recherches, divers rapports de
société civile voir même des discours politiques sont de
plus de plus orientés vers les thématiques relatives à la
dégradation des ressources forestières et la déforestation
(Capel, 20155 ; Cirad, 20206 ; Jacque, 20227 ;
Tsayem-Demaze, 20108 ; Hasan, 20199 ; Bakehe,
202010). Les causes sous-jacentes de ces processus de
dégradation et de déforestation sont
5 Rapport technique 2015 sur Agents et causes de la
déforestation et dégradation dans les sites pilotes du projet
6 Pourquoi les politiques actuelles de lutte contre la
déforestation sont-elles vouées à l'échec ?
Plaidoyer 2020.
7 Discours à la COP27 du Président Lula
sur la déforestation en Amazonie, Article Les Echos. 2022.
8 Éviter ou réduire la
déforestation pour atténuer le changement climatique : le pari de
la REDD. 2010
9 Évaluation de la dégradation des
forêts primaires par télédétection dans un espace de
front pionnier consolidé d'Amazonie orientale (Paragominas),
Thèse de doctorat 2019.
10 L'effet de la démocratie sur la
dégradation de l'environnement : le cas de la déforestation dans
le bassin du Congo, Article 2020.
15
surtout liées aux formes d'agriculture et d'industrie
minières adoptées par les sociétés à travers
leurs modes de fonctionnement économique mondialisé (Lanly,
2003).
Dans le bassin de l'Amazonie par exemple, les barrages et
routes transamazoniennes, les politiques de colonisation menée par le
gouvernement brésilien et les incitatifs économiques, ont
été les premières causes de la déforestation
(Beliveau, 2008 et Smouts, 2001). L'étude réalisée par
Smouts « La déforestation. Un débat sans conclusion
»11, dans "Forêts tropicales, jungle internationale"
apparaît comme la plus pertinente expliquant les causes de la
déforestation à l'échelle mondial selon l'avis de Paul
Leadley, écologue à l'université Paris-Saclay. Par
ailleurs, les facteurs de la déforestation sont multiples et
diffèrent selon les continents et les régions du monde, d'une
zone géographique à une autre. En Afrique et plus
particulièrement en Afrique subsaharienne, les activités
agricoles notamment l'agriculture de subsistance et l'agriculture commerciale
ont principalement été de loin la cause majeure du
défrichement des grandes forêts de la région, mais aussi
l'exploitation forestière industrielle et le commerce de bois (FAO et
al., 2015)
Les forêts tropicales d'Afrique et d'Amérique ont
depuis longtemps subi des pressions dues à la colonisation par
l'exportation des ressources forestières africaines
considérées avant comme des ressources inépuisables, et le
déboisement anarchique du bloc amazonien sous l'effet des
activités humaines. A partir de l'année 2000, c'est dans la zone
sud-américaine où les pertes annuelles nettes de forêts les
plus élevées ont été enregistrées avec
près de 4,3 millions d'hectares sur les cinq premières
années selon le rapport 2020 sur l'évaluation des ressources
forestières mondiales de l'Organisation mondiale pour l'alimentation et
l'agriculture. Toutefois sur la période de la dernière
décennie 2010-2020, l'Afrique se démarque et présente le
taux annuel net de perte forestière le plus élevé
évalué à 3,9 millions d'hectares contre 2,6 millions de la
région sud-américaine qui arrive en deuxième position,
tandis que l'Asie affiche sur la même période le gain net de
superficie forestière le plus important (FAO, 2020)12.
11 Dans Forêts tropicales, jungle
internationale. Les revers de l'écopolitique mondiale, 2001.
12 FAO, Rapport d'évaluation des ressources
forestières mondiales « Résultats principaux de FRA 2020
»
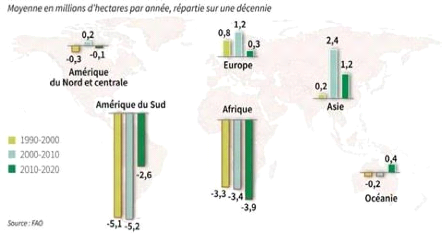
16
Figure 2 : Hausses et reculs de la surface forestière
mondiale par région de 1990 à 2020
Phénomène inquiétant en nette
progression, la déforestation est devenue aujourd'hui une
réalité préoccupante et pose soucis dans beaucoup de pays
du monde notamment et plus particulièrement en Afrique où les
forêts sont particulièrement vulnérables aux changements
globaux. L'Afrique héberge le second massif de forêt dense
tropicale humide au monde d'après les résultats d'une
étude de l'IRD et du CIRAD, publiés dans la revue Nature en
202113. En outre, elle constitue l'unique continent abritant le seul
puits de carbone encore important si on considère les trois principales
zones de forêts tropicales de la planète à savoir le bassin
de l'Amazone, le bassin du Congo et l'Asie du Sud-Est (Harris et Gibbs, 2021).
Les forêts tropicales constituent les écosystèmes les plus
importants en terme de séquestration du carbone. La biomasse
considérable leur permet d'absorber 50% de carbone de plus que les
autres forêts, jouant ainsi un rôle essentiel dans la
régulation du climat.
Les forêts sont des formations végétales
constituées d'arbres plantés ou spontanés, aux cimes
jointives ou peu espacées, dominant souvent un sous-bois arbustif ou
herbacé. Espace couvert par ce type de végétation. Massif
boisé d'au moins 4 ha avec une largeur moyenne en cime d'au moins 25
mètres ; des classes de superficie peuvent être distinguées
: 4 à 25 ha, 25 à 100, etc... (Définition de
l'IFN14). Ce sont des terres occupant une superficie de plus de 0,5
hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5
mètres et un couvert forestier de plus de 10%,
13 IRD et CIRAD, Des forêts
d'Afrique centrale particulièrement vulnérables aux changements
globaux, 2021.
14 Inventaire Forestier National
17
ou avec des arbres capables de remplir ces critères
(FAO). Couramment, nous en distinguons deux grands types : les forêts
primaires et les forêts secondaires. Les forêts primaires sont des
forêts vierges, qui sont restées identiques au fils des
siècles sans être transformées par la présence de
l'homme. Elles sont formées d'espèces indigènes où
aucune trace d'activité humaine n'est clairement visible et où
les processus écologiques ne sont pas sensiblement perturbés. Les
forêts secondaires, par opposition aux primaires, sont des forêts
qui ont repoussées, en une ou plusieurs phases après avoir
été détruites et/ou exploitées par l'homme.
Autrement dit, ce sont des forêts qui se sont
régénérées là où des forêts
primaires ont disparu sous l'impact sous l'effet de phénomènes
naturels ou des activités anthropiques.
"Les forêts représentent un "puits de carbone"
qui absorbe une quantité nette de 7,6 milliards de tonnes de CO2 par an,
soit 1,5 fois la quantité émise annuellement par les Etats-Unis",
d'après une étude sur les émissions et absorption de CO2
des forêts mondiales et réalisée par deux chercheurs pour
le Global Forest Watch (Harris et Gibbs, 2021). Comparables à un poumon,
les forêts assurent de nombreuses fonctions essentielles voir vitales
dont les quatre principales tournent autour de la production de bois (bois
d'oeuvre, bois-énergie, bois industrie), la préservation de la
biodiversité et des fonctionnalités écologiques, la
fonction sociale (activités de loisirs, tourisme, paysage,
bien-être des populations) et la protection contre les risques naturels
(crues, avalanches, chutes de blocs rocheux, érosion des sols,
glissement de terrains). Les forêts mondiales sont liées de
façon étroite au changements climatique, d'autant plus qu'elles
sont à la fois une cause, l'une des premières victimes et
également l'une des réponses pour atténuer les effets du
changement climatique.
Elles contribuent à atténuer le changement
climatique à travers trois processus plus connus sous le principe des
« 3 S » : la Séquestration du carbone par les arbres, le
Stockage du carbone dans les produits bois, et la Substitution dès lors
que le bois se substitue à d'autres matériaux ou énergies
plus émetteurs en carbone (Valade et Bellassen, 2020). De plus en plus,
il est de toute évidence manifeste que des fortes pressions sont
exercées sur les ressources forestières dans les pays des «
Suds » d'Afrique notamment au Sénégal et que les changements
climatiques ont des effets sur la répartition et la composition des
forêts. Il apparait donc nécessaire de mettre en place des
solutions concrètes pour apporter une réponse aux pressions
accrues qui s'exercent sur les forêts notamment la pression de
déforestation, de mettre en oeuvre des stratégies
forestières efficaces visant à réduire les fortes
pressions exercées sur les forêts et concourant à adapter
les forêts aux nouvelles conditions climatiques.
18
La gestion durable des forêts permet de garantir la
diversité biologique de ces dernières, leur productivité,
leur capacité de régénération, leur vitalité
et leur capacité de satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les
fonctions économiques, écologiques et sociales pertinentes aux
niveaux local, national et international, sans causer de préjudices
à d'autres écosystèmes (GIEC, 2009).15 Diverses
approches participatives de gestion associées à la foresterie
sociale ou agroforesterie ont intégré des instances
d'intervention internationales (Verdeaux, 1999). Tout compte fait, la gestion
durable des forêts apparaît comme un moyen de lutte contre la
déforestation et la dégradation des forêts, et constitue un
levier essentiel pour combattre le changement climatique d'après le
rapport spécial du GIEC sur le changement climatique, la
désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des
terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet
de serre dans les écosystèmes terrestres"16.
II. PROBLEMATIQUE
Le développement économique des activités
mondiales tel qu'on le connaît actuellement, ne s'est pas
réalisé sans conséquences sur l'environnement et les
ressources forestières dans le monde notamment en zone tropicale
où les forêts font parties des plus anciennes et des plus riches ;
elles sont des réserves de biodiversité et constituent l'un des
écosystèmes terrestres les plus primordiales de notre
planète (Mongabay, 2009). Ensemble de mutations techniques, sociales,
territoriales, démographiques et culturelles accompagnant la croissance
de la production17, il est à l'origine des fortes pressions
anthropiques exercées sur les forêts (exploitation
forestière, l'expansion agricole, fragmentation forestière,
l'extension urbaine, les feux de forêts...). Depuis 1990, le nombre
d'hectares de forêts disparus à l'échelle mondiale sous
l'effet de la déforestation est évalué à 420
millions d'hectares de forêt et ne cessent de continuer mais à un
rythme faible, d'après le rapport sur la situation des forêts dans
le monde (FAO, 2020).
15 Article L1 du Code forestier français
16 GIEC ? Rapport spécial sur le changement
climatique et l'utilisation des sols publié en août 2019.
17 Définition donnée par
Géoconfluences

19
Figure 3 : Taux annuel d'expansion de la forêt et de
déforestation de 1990 à 2020 18
Les activités humaines notamment celles relatives
à l'exploitation forestière et minière sont les
principales causes de la dégradation et de la disparition des
forêts, engendrant de multiples conséquences tels que les
phénomènes d'appauvrissement des ressources, des sols et de la
flore, l'érosion de la biodiversité, la fragilisation et la
destruction des écosystèmes, des habitats et des milieux naturels
à l'échelle mondiale. A chaque seconde, nous assistons à
une disparition de forêts tropicales de superficie équivalente
à un terrain de foot (Mayer, 2021). L'exploitation des ressources
forestières et la conversion des terres forestières notamment en
terres agricoles ont conduit à l'anéantissement de 34 % des
forêts tropicales humides primaires et entrainé d'une part, la
dégradation, la destruction complète ou partielle et d'autre
part, à leur substitution par des forêts secondaires de plus de
30% des forêts tropicales primaires, les rendant ainsi plus
vulnérables aux feux de forêts ou à des potentielles
exploitations ultérieures (FAO, 2021).
Les forêts tropicales primaires emmagasinent plus de
carbone que les secondaires et procurent un habitat à une
biodiversité d'une grande richesse. Considérées comme des
puits ou réservoirs de carbone, la destruction de ces forêts est
synonyme de libération du carbone sous forme de gaz à effet de
serre, entrainant une réduction de la capacité de
l'écosystème mondial à stocker du carbone (WWF France,
2012), donc moins de quantités de CO2 absorbé et par
conséquent une augmentation d'effet de serre, principale cause du
réchauffement climatique de notre planète. Contrairement à
l'Amérique du Sud qui a réduit de moitié la destruction de
ses forêts atteignant un taux annuel de pertes forestières nette
de 2,6 millions d'hectares sur la période 2010-2020, ce taux sur le
continent africain est estimé à 3,9 millions d'hectares contre
3,4
18 Source : FAO, Rapport d'évaluation des
ressources forestières mondiales 2020.
20
millions d'hectares enregistrés lors de la
décennie précédente (FAO, 2020)19. L'Afrique
est la région où la dégradation des forêts et la
déforestation sont les plus importantes de la planète
(Pépin, 2012). Pourtant, les forêts de ce continent demeurent un
véritable poumon vert pour le monde entier (Fleshman, 2008).
Selon le dernier rapport d'évaluation des ressources
forestières mondiales de la FAO, l'Afrique constitue le seul continent
où la déforestation et la dégradation se poursuivent
à un rythme alarmant avec une progression la plus rapide dans le monde,
contribuant significativement à la disparition de nombreuses
espèces végétales, animales et fongiques et par
conséquent au déclin actuel de la biodiversité. La
déforestation enregistrée sur le continent est en grande partie
due à l'agriculture de subsistance à petite échelle et
s'explique certainement par la croissance démographique selon Mme
Branthomme, experte à la FAO (Favrot, 2020). La conversion des
superficies forestières en surfaces affectées à
l'agriculture, à des fins de subsistance ou commerciales semble
être de très loin la cause majeure et la plus destructrice de la
forêt en Afrique, continent qui renferme plus de la moitié de la
proportion des pauvres soit près de 55%, la plus hausse au monde (CEA,
2023)20. La sécurité alimentaire et les moyens
d'existence de milliards de personnes à travers la planète
dépendent des forêts, à la fois abri pour l'essentiel de la
biodiversité terrestre et solution pour atténuer les effets des
changements climatiques.
Formidables réserves de biodiversités, les
forêts hébergent plus de 3/4 soit au moins 80% des espèces
d'animaux, de plantes et d'insectes dénombrées dans le monde
entier (Bodiguel, 2020). On estime la population mondiale qui en dépend
pour assurer sa subsistance à plus de 1,6 milliard de personnes
majoritairement pauvres, dont 70 millions concernent des peuples autochtones
(FAO, 2018). Selon les données récemment publiées par le
Fonds monétaire international, la très grande majorité des
vingt-cinq pays les plus pauvres du monde se trouve localisés sur le
continent africain (FMI, 2023). Parmi les 24 pays dont les ressources
forestières contribuent au minimum à 10% de leurs
économies, figurent dix-huit pays africains. Les populations africaines
pauvres de la plupart des territoires ruraux sont particulièrement
dépendantes des produits forestiers (Fleshman, 2008). Cette
pauvreté persistante sur le continent conjuguée à la
croissance démographique accentue les fortes pressions sur les
forêts, ces dernières constituent une source primordiale de vie,
d'alimentation à travers la richesse des produits comestibles qu'elles
nous procurent, de bois de chauffage ou énergie.
19 FAO, Rapport d'évaluation des ressources
forestières mondiales 2020.
20 CEA, Rapport de la Commission économique
pour l'Afrique 2023.
21
« Beaucoup de la déforestation dans la
région est due à l'agriculture de subsistance à petite
échelle », rapporte Branthomme, experte de l'Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture, lors d'un entretien accordé à
l'AFP21. Les activités humaines impactent fortement le
changement climatique et d'après une étude réalisée
par des chercheurs météorologues et publiée en janvier
2022 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America, les fortes pressions exercées sur les
forêts en région ouest-africaine augmenteraient le risque
d'inondations, (Taylor et al., 2022). La déforestation et la
dégradation des forêts sont à l'origine de nombreuses
conséquences néfastes sur les écosystèmes et les
milieux naturels, et suscitent de sérieux problèmes de
résilience d'autant plus qu'elles influent sur les inondations
liées aux tempêtes et intempéries. Ces
phénomènes provoquent également des nombreux effets
impactant sur les populations et les sociétés locales souvent
dépendant de l'écosystème forestier pour subvenir à
leurs besoins, engendrant divers problèmes socio-économiques tels
que les pertes de ressources issues d'arbres rares et les
phénomènes d'érosion des sols susceptible d'impacter
négativement l'agriculture.
Par ailleurs, les mauvaises politiques de gestion des
forêts se traduisant notamment par la surexploitation forestière,
les récoltes de quantités exagérées de bois de
chauffage et de plantes médicinales et la construction d'infrastructures
de transport concourent à accentuer le problème. Environ 70 % des
besoins énergétiques des habitants du continent africain sont
couverts par le bois, proportion incontestablement supérieure à
celle du reste du monde (Fleshman, 2008). Toutefois, pour remédier
à ces situations et relever les innombrables défis auxquels le
continent africain est confronté, la sauvegarde de ces véritables
et précieux écosystèmes que sont les forêts
constitue l'un des meilleurs moyens à la fois rapide et efficace devant
permettre de lutter contre les changements climatiques. En effet, la
préservation de ces forêts africaines notamment en zones
tropicales et le reboisement pour remplacer les arbres décimés
par la déforestation sont de nature à concourir à
l'atténuation de l'amplitude de l'évolution climatique et
à minimiser les effets des changements climatiques.
Plusieurs actions sur l'aménagement des forêts
ont été menées sur le continent par des organisations et
institutions internationales. C'est le cas de l'Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture avec notamment l'initiative de la Grande
muraille verte (GMV), vaste programme visant à lutter contre le
phénomène de la désertification au Sahel, à
permettre le stockage du carbone et à la restauration de la
biodiversité et à combattre les effets
21 GEO. Le recul s'accélère en Afrique
pour la forêt, mère nourricière des plus fragiles, mai
2020.
22
des changements climatiques (Markus, 2021). L'Afrique figure
parmi les continents où la part des forêts
bénéficiant de plans de gestion à long terme est l'une des
moins importants avec seulement 24% des forêts d'après le dernier
rapport d'évaluation des ressources forestières mondiales, certes
au-dessus de la moyenne mondiale (18%) et devant l'Amérique du Sud (17%)
mais très loin de l'Europe (96%) et l'Asie (64%).
Depuis 1989, le Sénégal dispose d'un plan
d'action forestier (PAFS adopté en 1992) qui a fait l'objet à
plusieurs reprises d'actualisation et de révision. Ce plan
découle lui-même de l'actualisation d'un outil de planification
des activités forestières dont le Sénégal
s'était doté officiellement en 1981, avec l'élaboration du
Plan Directeur de Développement Forestier (PDDF). A l'heure actuelle,
les enjeux majeurs de la gestion forestière au Sénégal
sont essentiellement de préserver la biodiversité et maintenir
l'équilibre socio-écologique, de limiter la dégradation
des sols et le stockage du carbone et plus particulièrement la lutte
contre l'exploitation démesurée des ressources
forestières. Le Sénégal fait face à des
défis majeurs dont les problématiques liées au
réchauffement climatique et à la préservation des
ressources naturelles.
Dans le Sud du Sénégal et plus
particulièrement dans la région naturelle de la Casamance
où sont localisées les vastes forêts denses
s'étendant sur une superficie de près de 30 000 hectares et
connues pour leurs essences d'arbres et leurs bois rares et précieux
(bois de rose aussi appelé bois de vène, poirier du Cayor), les
enjeux sont énormes et les pressions de plus en plus forte (Djeukoua,
2019). L'exploitation illégale des ressources forestières
notamment d'espèces de bois de grande valeur très
convoitées faisant l'objet d'une immense demande à
l'échelle mondiale, est un phénomène très
présent dans la région casamançaise et échappe au
contrôle de l'Etat sénégalais. Depuis 2010 jusqu'à
ce jour, plus de 10 000 hectares de forêts soit environ un million
d'arbres ont disparu en raison de l'abattage illégal dans cette
région naturelle considérée comme le poumon vert et
dernier bastion forestier du Sénégal (Sané, 2016 ;
Djeukoua, 2019)22.
22 D'après les conclusions d'une
enquête de terrain réalisée en 2016 par l'Association
Oceanium de Dakar dans le département de Médina Yoro Foula,
région de Kolda, et dans des villages en Gambie.

23
Figure 4 : Bois abattu illégalement par des
individus 23
Les vastes forêts de Casamance sont en train
d'être décimées par l'exploitation forestière
illégale et le trafic de bois précieux vers la Chine (via la
Gambie) surtout le bois de rose pour lequel la demande est
particulièrement forte, en l'occurrence du marché chinois.
Longtemps constitué comme l'un des trésors des forêts
casamançaises, le bois de rose ou vène est une espèce qui
fait l'objet de toutes les convoitises. Pourtant, c'est une espèce
protégée et interdite d'exportation depuis 1998 dans le Code
forestier sénégalais24. Selon l'AGM, les forêts
casamançaises continuent d'être « massacrées »
par des individus provenant majoritaire du pays voisin la Gambie, qui
exploitent de manière frauduleuse ces forêts pour récolter
des bois précieux25, malgré le déploiement
militaire et de nombreuses mesures sur la coupe de bois prises par le
gouvernement sénégalais.

Figure 5 : Bois saisit par les agents des eaux et
forêts 26
23 Source : AGM, 2019.
24 Oceanium de Dakar, « Restaurer notre
environnement pour que nos populations en vivent », avril 2021.
25 AGM. « Sénégal : Exploitation
illégal des ressources forestières en Casamance »,
décembre 2019.
26 Source : AGM, 2019.
24
Selon la Direction de l'information et des relations publiques
des Armées, 77 camions transportant illégalement du bois
provenant du Sénégal ont été immobilisés par
le détachement déployé au sein de la Force internationale
en territoire gambien, durant la période d'août à
décembre 2021 (DIRPA, 2022)27. Face à un Etat
quasi-impuissant, de grandes quantités de bois notamment du bois de rose
sont acheminés clandestinement par charrettes, voitures ou camions vers
la Gambie avec la complicité présumée d'autorités
gambiens, pour ensuite être exporté vers le continent asiatique,
plus précisément en Chine. Avec une superficie estimée
à 11 300 km2 (le plus petit pays d'Afrique continentale) et
bien que ses forêts soient pourtant presque entièrement
décimées, la Gambie expédie autant de bois vers la Chine
que la Guinée-Bissau ou la Côte d'Ivoire ou encore le Ghana. Elle
se positionne en deuxième place sur la liste des pays d'Afrique
exportateurs de bois de rose vers la République de Chine, avec un volume
des exportations grumes et de sciages de bois de rose vers la Chine
estimé à près de 58 000 mètres cubes de bois en
2015 (l'équivalent de 140 milles arbres) pour un montant de l'ordre de
41 millions de dollars soit plus de 24,5 milliards de Francs CFA (Caramel,
2016)28.
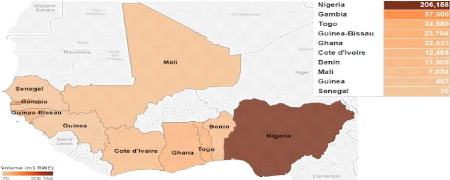
Figure 6 : Importations chinoises de grumes et de sciages de
bois de rose en provenance des pays de la CEDEAO, 2015 29
Selon une enquête de la BBC en 2020, la valeur de ces
exportations gambiennes de bois de rose est de l'ordre de 300 millions de
dollars (soit l'équivalent de 180 milliards de Francs CFA) au cours de
ces six dernières années (DIOP, 2022). Ce marché
très lucratif est au centre des tensions vives et persistances qui
sévissent de façon permanente, depuis plusieurs années
à la frontière sénégalo-gambienne. Cette
exploitation forestière illégale représente pour un
manque
27 DIRPA, annonce du mardi 25 janvier
2022.
28 Le Monde Afrique, « Entre
Gambie et Casamance, les saigneurs du bois de vène », mai 2016.
29 Source : Oceanium de Dakar
25
à gagner de près de 117 milliards de francs CFA
pour l'Etat sénégalais (BBC Africa Eye, 2020)30.
L'ampleur de cette exploitation forestière illégale qui
sévit dans cette région frontalière du territoire gambien
est arrivée à tel point que la disparition rapide des zones
boisées a atteint aujourd'hui un seuil critique (Djeukoua, 2019). Comme
en témoignent les images ci-dessous d'une vidéo31
filmée grâce à un drone qui permettent d'avoir une
idée un peu plus précise du pillage et l'ampleur des destructions
des forêts casamançaises, du trafic illégal de bois
précieux surtout du bois de rose ou vène particulièrement
apprécié des chinois pour la fabrication des meubles de luxes.
Ces images vues du ciel du marché de Sare Bodjo, village du territoire
gambien situé à 1 km de la frontière
sénégalaise, montrent disséminés sur de grandes
étendues un dépôt de milliers de troncs de bois de rose ou
vène, de larges baraquements et des camions, des chevaux et des
charrettes transportant le bois collecté depuis le territoire
sénégalais32.

Figure 7 : Marché de Sare Bodjo, à un
kilomètre à l'intérieur de la Gambie33
30 BBC Africa Eye, Reportage intitulé «
Les arbres qui saignent », 9 mars 2020.
31 Seneweb / publiée en mai 2016 par
l'Oceanium de Dakar, association sénégalaise oeuvrant pour la
protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles.
https://www.youtube.com/watch?v=ee0yLBh
NRE
32 Vidéo du pillage de bois de la Casamance par
des chinois publiée par l'Oceanium de Dakar, mai 2016.
33 BBC Africa Eye, mars 2020.
26
L'exploitation clandestine du bois a pris de l'ampleur au
cours des cinq dernières années en région
casamançaise. Certes, il est difficile de quantifier annuellement les
superficies dévastées mais c'est souvent en moyenne le chiffre de
40 000 hectares qui est annoncé et mis en avant par les autorités
sénégalaises selon Dr Baldé, expert géographe
spécialiste en gouvernance des ressources naturelles, tout en affirmant
que le vrai problème réside dans le fait que les besoins de
prélèvements des populations locales outrepassent les
capacités de régénération des
écosystèmes forestiers (Baldé, 2018)34.
Jusqu'en 2016, « Environ 10 000 hectares de forêts ont
été coupées et les 30 000 hectares restants risquent de
subir le même sort » affirme l'écologiste et ancien ministre
sénégalais de l'environnement Haïdar El Ali en
conférence de presse, avant d'ajouter que « avec l'implication de
la population sénégalaise locale dans le trafic illégal,
le taux de coupe avait plus que triplé en 2016 et on pourrait assister
à la disparition de plus de la moitié de la forêt restante
en une courte durée de moins de trois années ».
C'est autour de son successeur au ministère de
l'environnement Abdoulaye Bibi Baldé d'annoncer lors de la
Journée mondiale de l'environnement en 2015 que le pays a perdu une
superficie de massifs forestiers estimée à 1,2 millions
d'hectares entre 2010 et 2015 soit à l'espace de cinq années
(Ndao, 2021). Les forêts de la région casamançaise,
dernière grande zone boisée du pays, seront d'ici quelques
années irrémédiablement détruites si le trafic
illicite de bois vers la Gambie continue au rythme actuel (Sané, 2016).
Dans cette partie du territoire national, les fortes pressions exercées
sur les forêts sont croissantes, ne cessent de s'accentuer
d'années en années et sont à l'origine de la
dégradation des ressources naturelles et forestières. La
surexploitation des forêts casamançaises a été
depuis longtemps favorisée par une situation persistante
d'insécurité dans certaines zones et de conflit armé
depuis plus de 40 ans (depuis 1982), symbole de la lutte des rebelles
casamançais pour l'indépendance de la région de Casamance
(Ba, 2022).
Les évènements tragiques de janvier 2018
relatifs aux tueries dans la forêt de Bofa-Bayotte en Basse-Casamance qui
ont entrainé à la mort de 15 individus coupeurs de bois partis
chercher du bois et tués par des personnes armées supposés
appartenir au Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), en
attestent la visibilité et l'ampleur de ce phénomène
d'exploitation forestière illégale et rappellent l'acuité
de la question. La politique laxiste du gouvernement sénégalais
en matière de protection des forêts casamançaises est
pointée du doigt notamment par la Convergence pour le
désenclavement et le développement de la Casamance
34 Baldé. L'exploitation illégale de
bois de vène dans les communes de Badion et de Kandia en haute Casamance
: un évènement social et territorial, Thèse de doctorat
2018.
27
(CDDC) à travers sa déclaration : «
Dès lors que l'incident émane de l'exploitation abusive et
illégale des ressources naturelles de la Casamance, encore une fois
notre Etat a montré ses limites, son amateurisme et son
incapacité à pouvoir gérer avec efficience, pragmatisme et
rigueur des dossiers relevant de ses compétences» (Gaye,
2018)35.
Pour faire face à cette situation de tension et lutter
contre le trafic illégal de bois, plusieurs mesures sont prises par les
autorités sénégalais. Un nouveau code forestier
interdisant les exportations du bois et limitant l'exploitation locale au bois
mort a été adopté en novembre 2018. Les effectifs d'agents
des services des eaux et forêts ont augmenté jusqu'à
triplé entre 2014 et 2020 en vue de renforcer la surveillance des
ressources forestières et sensibiliser les populations locales (Gyuse,
2022). Toutefois les mesures prises n'ont pas permis de stopper le trafic
illégal et les évènements tragiques qui en
découlent. Ce commerce illégal de bois ne cesse de
prospérer au fil des années ; une véritable catastrophe
écologique qui génère des sommes d'argent colossales et
alimente la lutte armée. En témoigne le récent
événement de l'embuscade meurtrière du 24 janvier 2022
décrite dans l'article du 27 avril 2022 du magazine Jeune Afrique
intitulé « Sénégal : quand le trafic de bois alimente
la rébellion en Casamance »36.
Cette vaste région naturelle au Sud du territoire
sénégalais abrite une grande diversité d'espèces
végétales et est très souvent confrontée aux feux
de forêts aux conséquences multiples, aux coupes
irréfléchies par les sous-traitants de la compagnie fournisseuse
d'électricité (forêt pillée sur 50 ou 100 m de
profondeur au bord des routes de toutes ses espèces nobles), aux coupes
illégales au préjudice incommensurable, aux
prélèvements pour le fumage du poisson (Ba, 2022). Il est
manifeste que les forêts casamançaises subissent d'énormes
pressions anthropiques avérées qu'il serait nécessaire
bien les identifier et analyser en vue d'établir des stratégies
forestières efficaces pour une gestion durable des forêts en
région casamançaise et une bonne gouvernance forestière.
Ainsi, face à ces fortes pressions exercées qui dégradent
et détruisent les forêts, une bonne gouvernance des forêts
devrait permettre de répondre à la satisfaction durable des
besoins des populations casamançaises en produits forestiers ligneux et
non ligneux, sans pour autant compromettre les équilibres
socio-écologiques dans le contexte actuel de réchauffement
climatique.
35 Le Quotidien, Casamance - Tuerie dans la
forêt de Bofa-Bayotte : La Cddc accable les « parrains » du
trafic du bois, 18 janvier 2018.
https://lequotidien.sn/casamance-tuerie-dans-la-foret-de-bofa-bayotte-la-cddc-accable-les-parrains-du-trafic-du-bois/
36 Jeune Afrique Sénégal : quand le
trafic de bois alimente la rébellion en Casamance, article du 27 avril
2022.
https://www.jeuneafrique.com/1340050/politique/senegal-quand-le-trafic-de-bois-alimente-la-rebellion-en-casamance/
28
III. OBJECTIF GENERAL DE L'ETUDE
Compte tenu de l'enjeu majeur de la déforestation et de
la dégradation des forêts en Afrique dans la lutte contre le
changement climatique, l'objet global de notre présente étude
consiste à identifier et analyser les différentes pressions
exercées sur les vastes forêts de la région naturelle de la
Casamance au Sénégal afin d'établir une stratégie
efficace de gestion forestière pour une gestion durable des forêts
casamançaises. L'objectif global est ainsi scindé en plusieurs
objectifs spécifiques. De façon spécifique, il s`agira de
:
v 1 - faire une présentation générale de
la région de Casamance et de ses ressources forestières
v 2 - analyser les cadres politique, juridique et
institutionnel régissant la gestion des ressources forestières et
l'évolution de la gouvernance forestière
v 3 - identifier et analyser les différentes pressions
exercées sur les vastes forêts de la région
casamançaise, les principales causes et conséquences de ces
pressions.
v 4 - analyser la stratégie de gestion
forestière mise en oeuvre et identifier ses principales contraintes
v 5 - enfin d'établir des recommandations visant
à améliorer la stratégie forestière mise en oeuvre
pour une gestion durable des forêts casamançaises.
IV. METHODOLOGIE
La démarche méthodologique adoptée s'est
articulée autour de la revue bibliographique, de l'identification et de
la collecte de données disponibles et d'informations relatives au
domaine de l'étude notamment de la gestion des ressources
forestières, le recueil de données par la réalisation
d'entretiens individuels avec des personnes ressources des structures
évoluant dans le domaine de la gestion forestière au
Sénégal, l'analyse et le traitement des données
collectées et enfin la rédaction du document.
1. Revue bibliographique
La revue bibliographique s'est faite à partir
d'ouvrages, des articles et publications scientifiques, de document de
thèse et mémoires de fin d'études, et des documents divers
disponibles dans les bibliothèques de Le Mans Université (LMU)
notamment au niveau du portail numérique de publications scientifiques,
thèses et mémoires (HAL-LMU), à partir des
29
portails et plateformes d'informations et de revues
scientifiques et d'autres sites internet de recherche académiques...
Tout d'abord, nous avons mené une recherche
exploratoire sur les pressions exercées sur les forêts et la
gestion des ressources forestières dans l'objectif de collecter des
informations de bases relatives au domaine, en consultant au fur et à
mesure diverses sources capitalisées, tout en nous familiarisant avec la
terminologie du sujet. Cette phase exploratoire a permis dans son ensemble de
définir les concepts fondamentaux abordés à savoir «
pressions exercées sur les forêts », la «
stratégie forestière » et la « gestion durable des
forêts », d'avoir des idées et une compréhension plus
large du sujet.
Ensuite, une recherche documentaire plus avancée a
conduit à mieux cibler les recherches et de façon plus
précise sur les fortes pressions exercées sur les vastes
forêts localisées au Sud du Sénégal
particulièrement dans la région naturelle de la Casamance,
l'impact de ces pressions sur les écosystèmes forestiers
casamançaises et la stratégie mise en oeuvre pour la gestion
durable des ressources forestières de la Casamance, et plus largement du
Sénégal.
2. Recueil des données
Des entretiens individuels ont été
réalisés auprès des responsables des Inspections
Régionales des Eaux et Forêts (IREF) des trois régions
administratives (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) de la région
naturelle de la Casamance. Les IREF sont des services
déconcentrés et représentantes au niveau régional
de la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des
sols (DEFCCS) qui est la direction en charge des ressources forestières
au sein du Ministère de l'Environnement et du Développement
Durable (MEDD) du Sénégal.
D'autres entretiens individuels ont été
également réalisés notamment auprès
d'enseignant-chercheur au département de
Géographie et membre du laboratoire de Géomatique et
Environnement de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, la seule
université de la région casamançaise. D'autres structures
ont été sollicitées mais sans succès. C'est le cas
notamment de l'ONG Oceanium de Dakar qui oeuvre pour la protection de
l'environnement et la conservation des ressources naturelles ou encore de
Livelihoods-Sénégal pour restaurer les forêts de mangroves
dans les estuaires de la Casamance.
Toutefois, il est nécessaire de signaler que les
entretiens avec les responsable des Inspections Régionales des Eaux et
Forêts ne nous ont permis pas de disposer des données sur les
superficies forestières dégradées en région
casamançaise. Dans les rapports récents comme anciens, il
n'existe pas des données disponibles permettant
d'estimer la dégradation des forêts en Casamance. De plus, la
demande faite pour disposer de données sur les superficies
déforestées en Casamance s'est heurtée à un refus
des responsables avec comme raison principale, l'interdiction de tout transfert
ou partage de données en dehors de la structure.
3. Outils de collecte de données
Pour la collecte de données, un guide d'entretien a
été élaboré à cet effet à partir du
logiciel Sphinx et administré à distance par
téléphone et par Internet via un courrier électronique
auprès des personnes ressources (notamment des responsables des
Inspections des eaux et forêts de la région concernée et
d'enseignant-chercheur à l'Université Assane Seck de Ziguinchor)
pour la collecte des données et informations en fonction des
différentes cibles de l'enquête.
4. Traitement et analyse des données, et
rédaction du document
Les données recueillies à partir de
l'enquête par entretiens individuels ont été
traitées pour être analysées efficacement. L'ensemble du
travail de traitement et d'analyse des données s'est faite notamment
à l'aide du logiciel tableur Excel avec surtout l'utilisation
des fonctions « Analyse de données », « Tableau
croisé dynamique ». La rédaction de ce présent
document de mémoire s'est effectuée avec l'aide du logiciel de
traitement de texte Microsoft Word et la présentation pour la
soutenance se fera à partir du logiciel de présentation
Microsoft PowerPoint.
30
31
CHAPITRE 2 : PRESENTATION DE LA ZONE CONCERNEE PAR
L'ETUDE
I. Présentation du Sénégal et de la
région de Casamance 1. Brève présentation du
Sénégal
1.1. Données physiques
Bordé à l'ouest par l'océan Atlantique et
partageant ses frontières avec cinq (5) pays (le Mali à l'est, la
Mauritanie au nord, la Guinée et la Guinée-Bissau au sud, la
Gambie une quasi-enclave d'environ 25 km de large et près de 300 km de
profondeur à l'intérieur du territoire sénégalais),
le Sénégal est situé à l'extrême ouest du
continent africain, entre 12,5° et 16,5° de latitude Nord et
11,5° et 17,5° de longitude Ouest. Avec ses 700 km de côtes, le
pays dispose d'un territoire qui s'étend sur une superficie totale de
196 712 Km2.
1.2. Données climatologiques
Le Sénégal possède un climat de type
soudano-sahélien. La partie Sud du pays est caractérisé
par un climat tropical tandis que le climat au Nord du territoire est
semi-désertique. C'est un climat qui se distingue par l'alternance de
saison chaud et humide (couvrant la période de mi-juin à octobre)
et de saison sèche (de novembre à mi-juin). La
pluviométrie moyenne annuelle oscillent entre 300 à 1200
millimètres et varie selon un gradient pluviométrique croissant
du Nord en allant vers le Sud, d'une année à l'autre. Trois (3)
principales zones de pluviométrie sont identifiées sur le
territoire, se rapportant à trois (3) zones climatiques : une zone
semi-désertique dans la partie Nord du pays, une savane arborée
au centre et une zone forestière localisée au Sud du territoire
national.
1.3. Données hydrographiques
Le Sénégal dispose des ressources en eaux de
surfaces composées principalement de quatre (4) fleuves que sont,
respectivement et selon l'importance de la longueur : le fleuve
Sénégal (avec 1700 km de long), le fleuve Gambie (1130 km), le
fleuve Casamance (300 km) et le fleuve Saloum (250 km). À ces fleuves,
s'adjoignent des lacs et des rivières pour compléter le
régime hydrologique. La présence de grands barrages
hydroélectriques notamment ceux de Diama et de Manantali participent
à la maîtrise des ressources hydrauliques et concourent entres
autres, en faveur du développement de l'agriculture, de
l'approvisionnement énergétique et en eau potable.
32
1.4. Données démographiques
Le Sénégal dispose d'une population totale
estimée à plus de 16 209 000 habitants en 2019 (contre environ 15
726 000 hbts la précédente année) pour un taux
intercensitaire de l'ordre de 2,5%. La population féminine
représente près de 8 140 350 soit une proportion de 50,22% contre
49,78% de la population masculine. Cette population sénégalaise
se distingue par sa jeunesse avec une proportion de 48% de la population
âgée de 18 ans ou moins. Chez la population féminine, la
part de la jeunesse représente 47% tandis qu'elle est de 49,3% chez la
population masculine. Selon les nouvelles projections de l'ANSD, la population
sénégalaise est estimée à 18 258 000 habitants avec
50,26% de femmes et 49,74% d'hommes (ANDS, 2023).
1.5. Caractéristiques
socio-démographiques
En 2019, près de 6,13 millions de personnes vivaient
sous le seuil de pauvreté monétaire, d'après
l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
(EHCVM, 2018/2019) au Sénégal publié en septembre 2021
(ANSD, 2021). Le taux de pauvreté avoisinait les 37,8% à
l'échelle nationale, avec de grandes disparités selon le milieu
de résidence, selon les régions. Cette pauvreté est plus
intensifiée en milieu où près de 53,6% de la population
vivent sous le seuil de pauvreté tandis qu'en milieu urbain, on
enregistre une proportion de 19,8%. On estime que plus des 3/4 soit 75,4% des
pauvres se trouvent en milieu rural contre moins du 1/4 (24,6%) en milieu
urbain.
L'agriculture emploie environ 27,4% de la population active.
En milieu rural, elle reste le pourvoyeur majeur d'emplois avec une part de
50,3% des emplois contre 6,6% en milieu urbain d'après les
résultats de l'EHCVM 2018/2019. Par ailleurs, en matière
d'accès à l'énergie notamment pour la cuisson, les
principaux combustibles utilisés sont constitués par le bois
(45,2% : 32,8% ramassé et 12,4% acheté), le gaz (34,0%) et le
charbon de bois (18,7%). En milieu rural, le bois constitue principalement et
de façon générale le combustible le plus utilisé
avec près de 79% des ménages. Selon le mode d'acquisition du
bois, nous remarquons aussi qu'environ 64% des ménages ont recours au
bois ramassé contre 15 % pour le bois acheté.
2. Présentation de la région de Casamance
Région située à l'extrême Sud du
Sénégal entre la Gambie et la Guinée-Bissau et
bordée à l'Ouest par l'Océan Atlantique avec 86 km de
côtes, la Casamance est l'une des six (6) régions naturelles du
territoire national et compte une population d'environ 2,012 millions habitants
en 2019 composée majoritairement de jeunes et d'adolescents (78% ont
moins de 35 ans), d'après
33
les dernières données de l'Agence nationale de
la statistique et de la démographie (ANSD, 2021). D'une superficie
estimée à près de 29 000 km2, la région
naturelle et historique de Casamance est traversée par le fleuve du
même nom, 3ème grand fleuve avec ses 300 km de long
derrière le fleuve Gambie et le fleuve Sénégal.
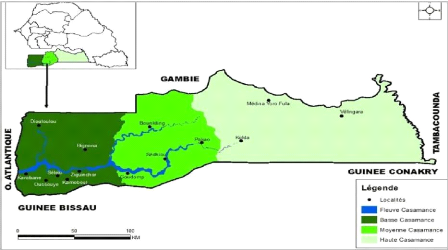
Figure 8 : Situation géographique de la
région naturelle de la Casamance 37
Cette région naturelle du Sud du Sénégal
dispose d'énormes potentialités agro-sylvo-pastorales
appréciables propices au développement socio-économique de
la région. Considérée comme le « grenier » du
Sénégal du fait des conditions climatiques douces avec un climat
de type soudano-guinéen, de ses terres fertiles et ses pluies abondantes
et régulières (Omotundo, 2011), elle constitue la partie la plus
arrosée du territoire avec une précipitation moyenne annuelle de
1400 mm (Sané, 2017 ; Faye et al., 2017). L'agriculture mobilise
près de 80% de la population et constitue le socle de l'économie
régionale. L'élevage y occupe une place importante et constitue
une activité essentielle pour cette région naturelle qui dispose
d'un fort potentiel fourrager et une source de revenu pour une part importante
de la population. (ADL, 2011). L'activité industrielle se réduit
essentiellement au traitement et au conditionnement de produits halieutiques et
des fruits, des usines à bois.
Divisée en trois grandes zones géographiques
(Basse, Moyenne et Haute Casamance), la région de Casamance se compose
de 113 communes, 9 départements et trois (3) régions
37 Source : Kafunel
34
administratives comptant chacune trois (3) départements
: la région de Ziguinchor qui correspond à la Basse Casamance, la
région de Sédhiou à la Moyenne et la région de
Kolda à la Haute Casamance.
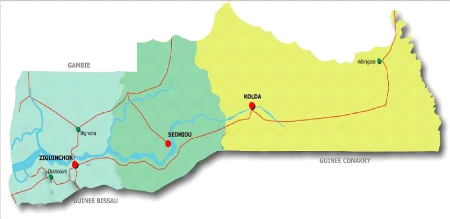
Figure 9 : Carte des trois régions administratives
de la Casamance38
? La région de Ziguinchor :
composée de trois départements (Ziguinchor, Bignona, Oussouye),
30 communes et 502 villages, elle couvre environ une superficie d'environ 7 340
km2 (soit 3,73% du territoire national). Sa population est
estimée en 2019 à 662 180 habitants soit près de 4% de la
population sénégalaise selon l'Agence nationale de la statistique
et de la démographie. La position géographique de la
région, sa façade maritime et son réseau hydrographique
lui confèrent une grande richesse en ressources halieutiques et en font
d'elle une plaque tournante du commerce sous régional. Les principales
activités économiques sont l'agriculture, la pêche et le
tourisme (ADL, 2021). Les formations végétales sont
caractérisées par des forêts denses sèches et des
forêts galeries ; la mangrove peuplant la zone fluviomaritime. Le domaine
forestier régional se distinguant par son immensité, couvre une
superficie de 116 700 hectares répartis dans 28 forêts
classées avec un taux de classement avoisinant les 25%. Le
département de Bignona concentre l'essentiel de la superficie du domaine
avec 18 forêts classées (taux de 19,5%) pour une superficie de
plus de 100 315 hectares (ANSD, 2021).
? La région de Sédhiou : l'une
des trois dernières régions nouvellement créées,
elle compte trois départements (Sédhiou, Goudomp et Bounkiling),
43 communes et 941
38 Source : Mycasamance
35
villages. La région de Sédhiou s'étend
sur une superficie de 7 330 km2 (soit 3,7% du territoire national).
Sa population est estimée à 553 000 habitants représentant
environ 3,4% de la population sénégalaise selon l'Agence
nationale de la statistique et de la démographie. Situé au centre
de la Casamance, c'est une région frontalière à trois pays
(la Gambie au Nord et la Guinée Bissau au Sud). Cette position
géographique confère à la région un potentiel
géostratégique énorme dans les dynamiques
économiques socioculturelles de la sous-région (ADL, 2021). Les
principales activités économiques sont l'agriculture
(l'élevage y constitue une activité essentielle), la pêche
et les activités piscicoles, le tourisme. Les formations
végétales se distinguent par une prépondérance de
la savane boisée. Le domaine forestier de la région couvre une
superficie de 84 500 hectares repartie dans 12 forêts classées
avec un taux de classement s'établissant à 11,5%. Le
département de Sédhiou concentre l'essentiel de la superficie du
domaine avec 9 forêts classées (taux de 22,63%) pour une
superficie de 62 003 hectares (ANSD, 2021).
? La région de Kolda : avec une
superficie estimée à 13 720 km2 soit 7% du territoire
national, elle est constituée de trois départements (Kolda,
Vélingara et Médina Yoro Foulah), 40 communes et environ 589
villages. Sa population est estimée en 2019 à 796 580 habitants
soit 4,9% de la population nationale selon l'Agence nationale de la statistique
et de la démographie. Partageant ses frontières avec la Gambie au
Nord, et au Sud avec la Guinée Bissau et la Guinée Conakry, la
position géographique de la région lui confère un
potentiel géostratégique énorme dans les dynamiques
économique et socioculturelles de la sous-région (ADL, 2021).
Région par essence d'élevage agropastoral, les principales
activités économiques sont l'élevage, l'agriculture, la
pêche et l'aquaculture. L'un des bastions forestiers du pays se
distinguant par l'envergure de son domaine classée, le domaine forestier
régional s'étend sur une superficie de plus de 334 330 hectares
répartis dans 14 forêts classées avec un taux de classement
de 24,4%. Le département de Vélingara et Médina Yoro
Foulah concentre la quasi-totalité de la superficie du domaine avec
respectivement 154 583 hectares (18 forêts classées, taux de
classement de 26,1%) et 144 167 hectares (3 forêts classées, taux
de 35,9%) (ANSD, 2021).
36
II. Les ressources végétales au
Sénégal et les forêts casamançaises
Au Sénégal, la superficie occupée par les
forêts est à près de 8,5 millions d'hectares (FAO,
2010)39. Le pays dispose d'un potentiel important d'espèces
végétales et présente une grande diversité
d'écosystèmes, offrant une véritable mosaïque
d'écosystèmes terrestres. En effet, quatre (4) grands ensembles
d'écosystèmes sont présents sur l'étendue du
territoire national : terrestres, fluviaux et lacustres, marins et
côtiers et ceux qu'on regroupe sous la dénomination «
écosystèmes particuliers » notamment les Niayes. Hormis les
formations de mangrove, les écosystèmes terrestres constituent
les milieux où on croise la plupart des écosystèmes
forestiers du pays (MEPN, 2010). Ces derniers sont représentés
par quatre types de formations végétales dont les principales
sont essentiellement constituées par les forêts, la savane et les
steppes.
Les forêts : géographiquement
localisées au Sud du Sénégal, elles occupent une
superficie estimée à 13 523 000 hectares d'après le
rapport d'évaluation des ressources forestières mondiale (FRA
2015). Elles sont pour l'essentiel constituées par des forêts
claires, des forêts denses sèches et des forêts galeries.
La savane : couvrant la plus grande partie
du territoire nationale, elle occupe le tiers centre du territoire et se
distingue par une savane arborée à arbustives (au Nord du pays)
représentée par des espèces ligneuses et une savane
boisée (au Sud) (Biodev30, 2021). Au Sénégal, la savane
s'étend sur une superficie estimée environ à 8 638 300
hectares40.
Les steppes : constituées de
formations herbeuses et arbustives, elles sont géographiquement
localisées dans le tiers nord du territoire nationale.
Représentées grosso modo par un tapis herbacé et
parsemées d'espèces ligneuses épineux, elles
s'étendent sur une superficie avoisinant les 3 553 800 hectares (FRA
2015 ; Biodev30, 2021).
Les formations particulières : elles
regroupent les zones humides qui hébergent la mangrove et les «
Niayes ». Ces dernières sont une zone littorale étroite
longue de 180 km et large de 25 à 30 km, parsemée d'un chapelet
de dépressions délimitées par des dunes vives reposant sur
une nappe phréatique peu profonde. S'agissant de la mangrove,
39 FAO, Evaluation des ressources forestières
mondiales (FRA2010), Rapport nationale Sénégal.
40 FAO, Rapport d'évaluation des ressources
forestières mondiale (FRA 2015)
37
elle est principalement localisée dans le bassin de la
Casamance, dans les deltas du Saloum et du fleuve Sénégal et
couvre une superficie de 213 130 hectares (FRA 2015).
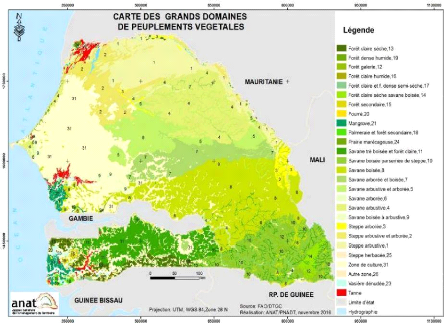
Figure 10 : Grands domaines de peuplements
végétaux
En somme, au Sénégal, on dénombre sur
l'étendue du territoire national 41 forêts aménagées
reparties sur une superficie estimée à 888 230 hectares et
géographiquement localisées dans dix (10) régions (Kolda,
Tamba, Kédougou, Sédhiou, Ziguinchor, Kaffrine, Kaolack, Fatick,
Thiès, Dakar) dont les trois régions administratives que
constitue la Casamance41.
Zone naturelle et forestière traversée par des
fleuves et des rivières, la région de Casamance dispose de divers
types de formations forestières constituant des habitats favorables
à la présence d'une faune assez importante (ANSD, 2012).
Réputée pour sa végétation abondante et ses
gigantesques arbres, cette région du Sud du pays abrite une grande
diversité d'espèces végétales et regorge de vastes
forêts denses. Ces dernières connues pour leurs essences d'arbres
et leurs bois précieux, s'étendent sur une superficie totale
estimée à 30 000 hectares42. La Haute et la Moyenne
Casamance hébergent les forêts sèches claires
caractérisées par une futaie
41 MGTDAT/ANAT, décembre 2018.
42 Source : AGM & ISS Africa, 2019.
38
d'arbres de tailles assez grandes et espacés pouvant
atteindre 10 à 15 mètres de hauteur (UICN, 1992). Tandis que les
forêts denses sèches sont pour l'essentiel géographiquement
situées en Basse Casamance, une zone fortement colonisée par les
mangroves (MEDD, 2015)43.
La région de Casamance compte de nombreuses
forêts classées qui s'étendent sur une superficie de 607
540 hectares. Au total, on dénombre 56 forêts classées
réparties comme suit : 30 forêts classées en
Basse-Casamance pour une superficie de 116 780 hectares, 12 en
Moyenne-Casamance pour plus de 84 450 hectares et enfin 14 en Haute-Casamance
pour 396 230 hectares. Ces forêts ont été
généralement classées par l'Etat soit pour la
création d'une réserve de bois d'énergie, soit pour la
protection des sols fragiles ou pour la préservation d'une
végétation rare et diversifiée ou enfin riche en essences
de valeur. Ce potentiel forestier très important à la fois riche
et varié, profite à plusieurs secteurs dont l'alimentation, la
construction, la fourniture d'énergie, les gîtes d'animaux...
(Sané et Mbaye, 2007). Toutefois, ces forêts continuent à
fortement subir jusqu'à présent de nombreuses pression de natures
et diverses. C'est le cas de la région de Ziguinchor, chef-lieu de la
Casamance qui a connu entre 2001 et 2021, une perte de couverture
arborée estimée à près de 4400 hectares comme
l'illustre la figure suivante.

Figure 11 : Perte de couverture forestière dans la
région de Ziguinchor44
43 Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable (MEDD), Plan National d'Actions pour la
Conservation de la Biodiversité (SPNAB), Rapport Août 2015.
44
https://public.flourish.studio/visualisation/10439055/
CHAPITRE 3 : GESTION ET GOUVERNANCE DES RESSOURCES
FORESTIERES
AU SENEGAL
I. Cadres politique, juridique et institutionnel de la
gestion des ressources forestières 1. Cadre politique de la gestion des
ressources forestières
A l'instar des autres pays sahélien, le
Sénégal a connu une succession de périodes de longue
sécheresse notamment durant la période 1970 à 1990 qui a
provoqué d'importants dégâts dont la disparition de
près de 40% de la superficie des forêts de mangrove depuis 1970
(Sambou, 2004 ; Ollivier, 2022). Ces épisodes de sècheresse
conjuguées aux facteurs anthropiques (défrichements, coupes de
bois, surpâturage...) ont été à l'origine de
dégradations quelquefois profond des formation végétales,
y compris du domaine forestier classé. L'impact de ces facteurs naturels
et anthropiques s'est traduit d'une part, par une réduction des surfaces
boisées et d'autre part, par une dégradation de la flore et de la
végétation (RdS, 1993). Cet impact fort et les inquiétudes
qu'il suscite, n'ont pas manqué d'attirer l'attention des
autorités publics sur la nécessité d'engager des actions
de lutte contre la tendance régressive notamment des surfaces
forestières (Diop, 2011). En ce sens, l'Etat du Sénégal
avait défini les orientations politiques relatives à la gestion
des ressources naturelles et procédé à
l'élaboration de documents stratégiques et d'outils de
planification et de gestion de la sécheresse, des ressources naturelles
et l'environnement (Diop & Goudiaby, 2008). De 1980 à
l'époque actuelle, la politique forestière a été
piloté en s'appuyant sur divers documents de référence
dont les principaux sont listés et brièvement décrits
ci-dessous.
39
Volonté d'améliorer la planification
stratégique, la gestion des risques et le suivi de la performance.
Découle de la révision du PDDF pour diverses
raisons (succès restreint, évolution de la situation
écologique et socio-économique de pays, lutte contre la
désertification.
PAFS
Pour honorer les engagements dans le cadre de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) pour
lutter contre la désertification et atténuer les effets de la
sécheresse.
PAN/LCD
Réactualisée en 2009 et 2016, la LPSE est un
instrument pour concilier la conservation et l'exploitation des ressources
naturelles et de l'environnement en vue de garantir un développement
durable et un meilleur cadre de vie.
LPSE
La nouvelle PFS traduit la volonté de l'Etat à
réduire la pauvreté par le biais de la conservation et la gestion
durable du potentiel forestier et de la diversité biologique, du
maintien des équilibres socio-écologiques afin d'assurer la
satisfaction des besoins en produits forestiers.

Politique visant à restaurer le couvert forestier par le
reboisement, la régénération assistée et la mise en
défens, et par l'aménagement participatif.
PFS
1981-2016
1993
1997
1998
2004
2014-2035
2005-2025
|
PDDF
Avec le PDDF, le Sénégal s'est doté pour la
première fois d'un véritable politique de planification
forestière.
|
PNAE
Volonté du pays d'établir un cadre
stratégique global de gestion durable des ressources naturelles et de
l'environnement.
S'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'initiatives
étatiques en conformité aux directives du Sommet de la
Planète Terre de Rio de Janeiro en juin 1992.
|
SPNAB
Politique d'amélioration de la conservation de la
biodiversité biologique pour le développement
socio-économique.
S'inscrit dans le cadre de la Convention sur la diversité
biologique (CDB) pour la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique et le partage juste et équitable des
bénéfices issues de l'utilisation des ressources
génétiques.
LOASP
Cadre de référence de la politique de
développement agro-sylvo-pastoral du pays sur les 20 prochaines
années, elle mets l'accent sur une bonne conservation des
écosystèmes et des sols.
La LOASP prend en considération les dispositions du Code
forestier notamment au sujet des défrichements, la gestion des parcours
pastoraux et les principes de la sylviculture.
PSE
Référentiel de la politique économique et
sociale du pays sur le moyen et long terme, un nouvel instrument visant
l'émergence économique du pays à l'horizon 2035.
Atteinte d'objectifs sectoriels stratégiques :
Amélioration de la connaissance des ressources naturelles,
Intensification de la lutte contre la dégradation des ressources et
l'environnement, Renforcement de capacités techniques et
institutionnelles des acteurs dans la mise en oeuvre d'actions de conservation
des ressources, Préservation des réserves de biosphère.
40
Figure 12 : Frise chronologique de l'évolution de la
politique de gestion des ressources
forestières au
Sénégal
41
1.1. Le Plan Directeur de Développement Forestier
(PDDF)
Elaboré en 1981, le PDDF a permis au
Sénégal de se doter officiellement pour la première fois
d'un véritable politique de planification forestière. Ce plan se
donne comme but de définir une stratégie d'action à moyen
et long terme (1981 à 2016) et de dégager un plan d'action
concourant à impulser une dynamique au profit de la conservation
forestière et des espaces naturels, tout en promouvant un accroissement
considérable des investissements publics engagés dans le
sous-secteur (FAO, 2003). A cette fin, les autorités du
Sénégal devaient s'adosser à cinq (5) objectifs :
maintenir le potentiel forestier et des équilibres
socio-écologiques, d'améliorer les connaissances des
problématiques forestiers, d'améliorer le cadre de vie en zone
rural, de répondre aux besoins prioritaires des populations et enfin de
réduire la dépendance de l'extérieur.
Le PDDF se propose comme objectif capital de favoriser une
meilleure harmonisation des programmes sectoriels et un cadre interactif
d'actions synergiques en zone rural (entre l'agriculture, l'élevage, la
foresterie et l'artisanat), de contribuer à établir une
cohérence effective des interventions, tout en incluant tous les aspects
socio-écologiques et économiques des terroirs et des populations
(Conseil Régionale de Dakar, 2003). Cette politique a permis d'accroitre
les investissements dans le sous-secteur forestier, de réaliser
l'inventaire des ressources forestières, d'estimer les tendances de la
demande et d'analyser les obstacles au développement forestier,
d'établir une stratégie à court, moyen et long terme, de
permettre à l'Etat du Sénégal de se décharger d'une
intervention massive et guère efficace. Toutefois, elle n'a pas permis
d'atteindre tous les objectifs escomptés dont celui de contrarier le
processus de dégradation des milieux naturels (Diop, 2005).
1.2. Plan d'Action Forestier du Sénégal
(PAFS)
Découlant de la révision du plan directeur pour
diverses raisons (succès restreint, évolution de la situation
écologique et socio-économique de pays, l'impératif
à mieux intégrer les efforts dans le contexte
sous-régional de lutte contre la désertification), le PAFS a
été adopté en 1993 après que l'Etat du
Sénégal s'est engagé quatre années avant dans le
processus de son élaboration. Il devait concourir à une meilleure
prise en compte des enseignements tirés d'expériences
antérieures et des évolutions actuelles en matière de
conservation des ressources naturelles. Le PAFS ambitionne essentiellement la
conservation du potentiel forestier et des équilibres
socio-écologiques, et l'assouvissement des besoins en produits ligneux
et non
42
ligneux des populations. Les actions majeures en faveur de la
conservation du potentiel forestier visent à garantir une protection
efficace des écosystèmes forestiers exposées au risque de
dégradation ou de disparition, ou précieux et profitable à
la conservation de la faune et de la flore, à restaurer les formations
forestières dégradées...
Celles au profit de la conservation des équilibres
tournaient autour de l'adoption de modèles de gestions des terroirs
propices à l'intégration des systèmes de production, de
garantir une productivité optimale et durable des systèmes,
d'entretenir un équilibre affermi entre les spéculations
agro-pastorales et la couverture boisée. Le PAFS a été
d'une grande utilité, servant jusqu'en 2005 de cadre de
référence de la politique forestière en dépit de
l'évolution de l'environnement institutionnel du pays. A travers ce
plan, de nombreux types d'opérations sylvicoles ont été
entrepris en faveur du maintien ou de l'amélioration du potentiel des
formations forestières, une importance croissante accordée
à la foresterie rurale et des actions communautaires tout en mettant en
avant le reboisement.
1.3. Plan National d'Action pour l'environnement (PNAE)
L'élaboration du PNAE a été le choix pour
le Sénégal d'exprimer sa volonté d'établir un cadre
stratégique global de gestion durable des ressources naturelles et de
l'environnement. S'insérant dans le cadre de la mise en oeuvre
d'initiatives étatiques en conformité aux directives du Sommet de
la Planète Terre de Rio de Janeiro en juin 1992, le PNAE a
été adopté en 1997 et sert de cadre stratégique
pour l'identification des priorités environnementales et la
définition des bases de systèmes efficaces de planification et de
gestion des ressources naturelle et de l'environnement. L'un des objectifs
majeurs du Plan consistait en la prise en considération de la dimension
environnementale dans la planification du développement
socio-économique. Ce plan donnait la priorité à la mise en
oeuvre de nouvelles approches relatives à l'aménagement et la
gestion des terroirs qui s'appuient sur l'implication des populations dans la
planification, la gestion et le suivi des actions (RdS, 1997).
1.4. Programme d'Action Nationale de Lutte contre la
Désertification (PAN/LCD)
Le Sénégalais a paraphé en 1994 et
entériné en 1996 la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification (CNULCD) qui ambitionne de lutter contre la
désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse
dans les pays gravement affectés notamment en Afrique (RdS, 1998).
Dès lors, le pays s'y est mis pour honorer ses engagements notamment en
élaborant et en mettant en oeuvre un programme d'Action National de
Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD). Ce plan devait permettre
d'apporter des solutions aux défis
43
majeurs tels qu'une meilleure connaissance de la
désertification et une maitrise par les populations locales des actions
de lutte à engager, des mesures de contrôle et d'évaluation
des effets de la sècheresse aux fins de leur atténuation, le
maintien d'un équilibre entre une exploitation raisonnable des
ressources pour la satisfaction des besoins actuels et une conservation
convenable pour garantir l'avenir, le renforcement du cadre institutionnel et
juridique pour améliorer l'efficacité des actions et
l'amélioration de la situation économique de manière
à mieux combattre la pauvreté (RdS, 1998).
Pour relever ces principaux défis, la démarche
opérationnelle prônée s'articulait autour d'une approche
participative, impliquant toutes les parties prenantes pertinents dans la
formulation des programmes. Les objectifs du PAN/LCD calqués sur ceux de
la CNULCD sont de régénérer les formations naturelles
dégradées, de restaurer et repeupler les habitats
dégradés, de mettre en défens les zones sensibles, de
protéger certaines espèces en danger ou menacées, de
lutter contre les feux de brousse, de créer des bois villageois
multifonctionnels, entre autres. Le PAN/LCD a permis d'une manière
globale l'implication de diverses catégories d'acteurs afin de susciter
un consensus élargi, le renforcement des instituts présents de
l'échelle local à l'echelle nationale, la mobilisation de moyens
financiers en vue d'appuyer les initiatives de lutte contre la
désertification, l'amélioration du dispositif d'observation et le
suivi des milieux, la lutte contre la dégradation des massifs forestiers
et des pâturages (MEPN, 1999).
1.5. Lettre de Politique Sectorielle de l'Environnement
(LPSE)
Le Sénégal, dans un souci d'amélioration
de sa planification stratégique, la gestion des risques et le suivi de
la performance a jugé nécessaire de s'équiper de lettres
de politiques sectorielles de développement (LPSD). Au niveau
ministériel et sectoriel, la Lettre de politiques sectorielles constitue
un instrument d'aide à la planification du développement et
contribue à la satisfaction des besoins des populations. C'est dans ce
cadre que s'inscrit la Lettre de Politique Sectorielle de l'environnement
(LPSE) adoptée en 2004 qui sera réactualisée deux fois en
2009 puis en 2016. Elle s'ambitionne de répondre à l'obligation
de concilier la conservation et l'exploitation des ressources naturelles et de
l'environnement en vue d'un développement durable et de
réorganiser les rôles de l'Etat et des acteurs non gouvernementaux
afin de garantir meilleur cadre de vie.
La LPSE initiale (2004) aspirait à assurer les
conditions de durabilité du développement socio-économique
dans une éventualité de forte croissance conciliable avec la
gestion et l'exploitation écologiquement raisonnable des ressources
naturelles et de l'environnement. Les orientations
44
de la lettre à l'égard de la gestion des
ressources naturelles étaient pour l'essentiel adossés aux
objectifs du PAFS tout en mettant en avant le renforcement des initiatives
relatives en termes d'intervention en régie et de promotion de
l'aménagement forestier régional, villageois ainsi que la
foresterie urbaine (MEPN, 2004). En 2009, de nouvelles orientations sont
approuvées de manière à garantir une bonne gestion
raisonnable des ressources et de l'environnement en vue de concourir à
réduire la pauvreté dans une éventualité de
développement durable (MEPNBRLA, 2009). L'une des nouveautés
repose sur le fait que l'une des priorités est accordée au
renforcement de l'appui conseil aux promoteurs pour le développement des
forêts privées.
La LPSE (2016) s'insère dans une nouvelle dynamique
avec comme vision d'accélérer sur le moyen et long terme le
développement économique et social du pays et garantir le
bien-être des populations dans l'intention de mieux s'accorder avec les
orientations du Plan Sénégal Emergent (PSE). Elle se fonde, entre
autres, sur l'intégration des principes de développement durable
dans le but de renverser la tendance à la dégradation des
ressources naturelles et de l'environnement, de diminuer voir arrêter
l'érosion de la biodiversité (MEDD, 2016). Ainsi, l'un des 2 axes
stratégiques de la LPSE est consacrée à la « Gestion
de l'environnement et des ressources naturelles » avec
spécifiquement comme objectif prédominant la réduction de
la dégradation de l'environnement et des ressources, des effets
négatifs du changement climatique et la perte de biodiversité
(MEDD, 2016).
1.6. La Stratégie Nationale et Plan Nationale
d'Actions pour la Conservation de la Biodiversité (SPNAB)
Préoccupé par l'amélioration de la
conservation de la diversité biologique, le Sénégal a
paraphé puis ratifié en 1994 la Convention sur la
diversité biologique (CDB) qui ambitionne la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique ainsi que le partage
juste et équitable des bénéfices émanant de
l'utilisation des ressources génétiques. Pour parvenir à
atteindre ces objectifs, le pays s'est doté d'une stratégie
nationale et d'un plan national d'actions pour la conservation de la
biodiversité (SPNAB). Plusieurs résultats en termes de
conservation des ressources biologiques ont été obtenus
grâce à la mise en oeuvre de la SPNAB. Néanmoins,
après une période d'une dizaine d'années, il était
primordial de prendre en considération de nombreuses interrogations
émergentes et de s'arrimer à la vision du PSE, cadre de
référence de la politique socio-économique du
Sénégal.
45
C'est pourquoi le pays s'est donné une nouvelle
politique avec une vision claire de restaurer, conserver et valoriser la
biodiversité en vue de fournir durablement des biens et services avec un
partage des bénéfices et avantages dans le but de concourir au
développent socio-économique (RdS, 2015). Quatre axes
stratégiques (A, B, C, D) ont été définis dont
« Axe stratégique B : Réduction des pressions,
restauration et conservation de la biodiversité ». Ces axes
sont déclinés en dix (10) objectifs et vingt et une (21) lignes
d'actions permettant de prendre en considération les
préoccupations relatives à l'amélioration de l'état
de conservation des espèces avant tout végétales, en
particulier la restauration des écosystèmes par le biais de
reboisement et la récupération des terres salées.
1.7. Loi d'Orientation Agro-sylvo-pastorale (LOASP)
Le Sénégal s'est doté au printemps 2004
d'une loi45 portant loi d'orientation agro-sylvo-pastorale (LOASP)
définissant sur 20 prochaines années le cadre de
développement agro-sylvo-pastoral. Cette loi prend en
considération toutes les activités économiques et leurs
fonctions sociales en zone rural et constitue un cadre de
référence du développement agricole (RdS, 2004).
Malgré l'exigence de garantir d'abondantes production agricoles et
pastorales, cette loi d'orientation agro-sylvo-Pastorale mets en avant une
bonne conservation des écosystèmes et des sols. La LOASP tient
compte des dispositions du Code forestier46 notamment au sujet des
défrichements, la gestion des parcours pastoraux et les principes de la
sylviculture.
D'ailleurs, l'un des 6 objectifs spécifiques inscrits
dans la loi47 permettant de répondre à cette
préoccupation est de protéger l'environnement et gérer
durablement les ressources naturelles notamment par une meilleure connaissance
et l'amélioration de la fertilité des sols (RdS, 2004). Les
alinéas de l'article 37 à l'article 41 sont dédiés
à la sylviculture et à l'aménagement forestier avec de
nombreuses dispositions concernant la production et l'exploitation
forestière, le reboisement, les élagages, la lutte contre les
feux de brousse, les coupes relatives à la gestion sanitaire et les
éclaircies... (RdS, 2004). Tant de dispositions et mesures qui
consentent à donner une place remarquable aux arbres au sein espaces
agricoles et pastoraux, ainsi que l'importance de l'agroforesterie. Toutefois,
cette nouvelle approche est très brièvement évoquée
lorsque dans l'article 37 il est abordé les avantages de la sylviculture
en matière de mise en valeur économique, écologique et
sociale du domaine forestier.
45 Loi n°2004-16 du 4 juin 2004 vote à
l'Assemblée Nationale le 25 mai 2004, promulgation le 04 juin 2004.
46 Loi 98-03 du 08 janvier 1998 et décret
98-164 d'application du 20 février 1998.
47 Article 6 de loi d'orientation
agro-sylvo-pastorale.
46
1.8. Politique Forestière du Sénégal
2005-2025 (PFS)
Conscient des fonctions socio-économiques et
écologiques et du contexte de dégradation grandissante des
ressources forestières en raison de facteurs naturels et anthropiques et
ce, depuis plusieurs décennies, l'Etat s'est doté d'une politique
forestière pour la période de 2005 à 2025 (PFS) avec pour
ambition de contribuer à réduire la pauvreté par le biais
de la conservation et la gestion durable du potentiel forestier et de la
diversité biologique, du maintien des équilibres
socio-écologiques afin d'assurer la satisfaction des besoins des
populations en produits forestiers. La politique forestière à
travers sa nouvelle vision, envisage mettre en avant une politique constante de
responsabilisation des collectivités territoriales, une politique
intégrée de développement agro-sylvo-pastoral, de
renforcer les capacités des structures de l'Etat, des
collectivités et des partenaires, d'impliquer activement le secteur
privé et la société civile, d'approfondir la connaissance
du potentiel et de la dynamique des peuplement forestiers et des
écosystèmes sur tout le territoire national (RdS, 2005).
La PFS doit concourir à restaurer le couvert forestier
d'une part, par le reboisement et la régénération
assistée aussi bien que par la mise en défens et d'autre part,
par l'aménagement participatif. Pour y parvenir, la PFS s'est
articulée autour de deux axes stratégiques : (1) «
Aménagement et la gestion rationnelle des ressources forestières
et fauniques » et (2) « Renforcement des capacités des
collectivités territoriales et des organisations communautaires de base
» (RdS, 2005). Le premier axe entend répondre à la
satisfaction des besoins des populations dans une perspective ne compromettant
pas la pérennité des ressources, en insistant sur une
exploitation fondée sur des principes d'aménagement et de gestion
raisonnable ainsi qu'une conservation durable des ressources forestières
et fauniques.
Plusieurs actions en faveur de l'exploitation rationnelle des
services et ressources forestières ont été définis
et se répartissent dans les deux composantes du premier axe : «
Aménagement et gestion rationnelle des forêts » et «
Gestion de la faune et conservation de la biodiversité ». La PFS,
référentiel des politiques forestières du pays met
davantage en avant la promotion de l'agroforesterie. L'une des activités
majeures du plan d'action de la PFS est dédié à la
régénération naturelle assistée de 11 000 hectares
durant les quatre premières années de mise en oeuvre de cette
politique (RdS, 2005). Avec l'évolution du contexte depuis 2005
notamment de la décentralisation et l'adoption des 17 Objectifs de
développement durable (dont l'objectif 15 relatif à la gestion
durable des forêts et la lutte contre la désertification), le
Sénégal s'est doté d'un nouveau cadre de
référence des politiques : le Plan Sénégal
Emergent.
47
1.9. Plan Sénégal Emergent (PSE)
Référentiel de la politique économique et
sociale sur le moyen et le long terme, le PSE constitue un nouvel instrument
visant l'émergence économique du Sénégal à
l'horizon 2035. A travers ce plan, l'Etat a pris conscience de l'exploitation
grandissante et non maitrisée des ressources dans un contexte de
dégradation environnementale faisant générer de nouveaux
obstacles au développement économique et aux perspectives de
création d'emplois (RdS, 2014). D'après le PSE, environ 60% de la
population sénégalaise est tributaire des secteurs ayant trait
aux ressources naturelles (agriculture, foresterie, etc....) pendant que les
risques liés à l'environnement et l'épuisement de
ressources naturelles constituent de sérieuses menaces sur la production
et par conséquent sur la croissance (RdS, 2014). L'Axe 2 du PSE
intitulé « capital humain, protection sociale et
développement durable » exprime l'engagement du
Sénégal à intégrer les principes du
développement durable dans les politiques environnementales et renverser
la tendance de diminution des ressources naturelles tout en continuant à
ambitionner la réduction de la perte de la diversité
biologique.
En ce sens, l'Etat ambitionne d'atteindre ces objectifs
sectoriels stratégiques : l'amélioration de la base de
connaissance de l'environnement et des ressources naturelles, l'intensification
de la lutte contre la dégradation environnementale et des ressources, le
renforcement de capacités techniques et institutionnelles des acteurs
dans la mise en oeuvre d'actions relatives à la conservation de
l'environnement et des ressources et enfin, la préservation des
réserves de biosphère et la promotion d'une économie verte
ainsi que la mobilisation des financements pour les emplois verts. Pour
l'atteinte de ces objectifs que le Sénégal s'est fixé, le
plan d'action prioritaire du PSE renferme un bon nombre de programmes et
projets expressément consacrés à renforcer les efforts
consentis dans la gestion rationnelle des ressources naturelles, dans une
perspective de développement durable.
De plus, le pays est dans un processus de finalisation de sa
contribution déterminée au niveau national (CDN), plan d'action
climatique ambitionnant la réduction des émissions et
l'adaptation aux effets des changements climatiques et qui s'insère dans
le cadre de la stratégie de développement du PSE. Deux (2)
rapports du volet « Adaptation » ont concerné l'agriculture et
la diversité biologique : le premier mettant en évidence la
restauration et l'amélioration de la fertilité des sols (Lô
et Sow, 2017) ; le second exposant les pistes et mesures d'adaptation au
changement climatiques dont le renforcement de la résiliences des
écosystèmes (Diouck et Kane, 2017). Quant au volet «
Atténuation », un rapport sectoriel a évoqué les
contributions déterminées au niveau national dans le secteur
ayant trait à la foresterie, avec un plan d'actions
48
et des orientations sur les efforts à consentir pour
reboiser massivement et mettre en défens les forêts et promouvoir
et mettre en oeuvre la régénération naturelle
assistée de même que l'agroforesterie (MEDD, 2017).
2. Cadre juridique régissant la gestion des
ressources forestières
Pour mener à bien les orientation politiques en termes
de gestion des ressources naturelles, le Sénégal a adopté
un ensemble de règles juridiques destinées au maintien ou au
rétablissement des équilibres écologiques indispensables
au développement économique et sociale du pays. Ces diverses
règles ont été prescrites par le biais d'un certain nombre
de textes. Parmi ces derniers, il y'a lieu de différencier ceux
adoptés sur le plan international et ceux définis au niveau
national pour constituer directement le soubassement de la gestion et de la
protection des ressources naturelles.
Sur le plan international, le Sénégal é
exprimé son intention de contribuer de manière significative
à l'effort mondial de conservation des ressources naturelles notamment
des ressources forestières. Cette volonté s'est
concrétisée à travers la signature et la ratification des
divers conventions et Accords internationaux multilatéraux sur
l'environnement exerçant une influence directe sur l'environnement et
les gestion des ressources. Parmi ces conventions, nous pouvons citer la
convention des Nations unies sur le diversité Biologique signée
en 1994 et ratifié en 1994), la convention des Nations unies sur la
lutte contre la désertification signée en 1994 et ratifiée
en 1995, la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques
signée en 1992 et ratifié en 1994, la convention de Ramsar ayant
trait aux zones humides d'importance internationale signée et
ratifiée en 1977, la convention de Washington sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction ratifiée en 1977, la convention de Paris sur la protection
du patrimoine mondial, culturel et naturel ratifiée en 1976, la
convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources
naturelle ratifiée en 1972. Bien que le Sénégal ait
adhéré à tous ces accords internationaux
multilatéraux sur l'environnement, il faut bien admettre que la plupart
des textes internationaux ne revêtent pas un caractère
contraignant.
Au niveau national, le Sénégal jouissait avant
l'indépendance d'une politique de conservation des ressources
forestière et fauniques sous l'initiative du service forestier
colonial48 (Ribot, 1995). L'indépendance acquise en 1960, le
pays s'est engagé à mettre en place un cadre
48 Décret 1900 portant Premier code
forestier puis Décret du 04 juillet 1935 portant Nouveau Code forestier
pour l'Afrique occidentale française.
49
juridique approprié, favorable pour promouvoir une
conservation et une gestion rationnelle des ressources naturelles notamment
forestières en vue de faire face à la dégradation de
l'environnement biophysique et de gérer convenablement les
activités humaines. Ainsi, plusieurs instruments juridiques ont
été élaborés, parmi lesquels on peut citer les
principaux (CSE, 2013) : la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine
national ; la loi 98-03 du 08 janvier 1998 portant Code forestier49
; la loi 67-28 du 23 mai 1967 relative à la faune et la gestion de la
chasse ; les lois 96-06 et 96-07 du 22 mars 1996 portant respectivement Code
des collectivités locales et transfert de compétences aux
collectivités ; la loi 2001-01 du 15 janvier portant Code de
l'environnement ; la LOASP ; la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant
Code général des collectivités territoriales ; la loi
constitutionnelle 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de celle de
200150.
Dans le domaine relatif à la gestion des ressources
forestières, ces instruments peuvent être réparties de
manière globale en trois grandes catégories.
La première a mis essentiellement l'accent sur le
rôle prédominant de l'Etat dans la gestion des ressources
forestières avec l'ensemble les forêts placées sous son
contrôle direct par le biais du service forestier51. Alors que
les populations notamment rurales sont cantonnées à
l'exploitation des produits forestiers de faible valeur commerciale, permettant
néanmoins leurs besoins par le biais de délivrance des droits
d'usage. L'administration forestière avait exclusivement la mainmise sur
l'ensemble des ressources forestières et toute forme d'appropriation de
ces ressources était complètement écartée.
Toutefois, cette première catégorie d'instruments n'était
plus adaptée au contexte socio-économique et politique du pays
mais aussi aux différentes orientations de la conférence de
Rio.
La seconde catégorie d'instruments ambitionnait
principalement de corriger certains manquements notamment de réduire le
caractère répressif, l'affirmation de la propriété
et le droit d'exploitation des ressources plantées par des
privés52. Mieux, ces instruments s'efforçaient de
favoriser et encourager l'implication des populations dans la protection et
la
49 Loi 98-03 du 08 janvier 1998 portant code
forestier modifiant la loi 93-06 du 04 février 1993 portant Code
forestier, modifiant à son tour la loi 65-23 du 09 février 1965
portant Code forestier.
50 Article 25-1 de la nouvelle constitution :
« Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont
utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie.
L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la
transparence et de façon à générer une croissance
économique, à promouvoir le bien-être de la population en
général et à être écologiquement durables
».
51 Loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine
national et loi 65-23 du 09 février 1965 portant Code forestier.
52 Loi 93-06 du 04 février 1993 portant Code
forestier.
50
restauration des ressources forestières par l'adoption
d'une approche participative et de terroir et notamment par le biais de la
conduite d'opérations de reboisement participatif.
La dernière catégorie d'instruments s'accordait
surtout à la volonté de l'Etat de faire la promotion d'un
développement local harmonieux et répondre efficacement aux
besoins des populations par le biais de la
décentralisation53. Le transfert de compétences
notamment dans le domaine de l'environnement et la gestion des ressources s'est
traduit par une volonté manifeste de placer l'acteur local au coeur de
la problématique liée à la gestion de ressources notamment
forestières. Cette volonté s'est concrétisée d'une
part, par la modification du code forestier en vue de favoriser une meilleure
implication des populations dans les efforts engagés en faveur de la
pérennisation du domaine forestier et d'autre part, par le biais de
l'Acte III de la décentralisation54 et l'adoption en 2018
d'une nouvelle loi portant code forestier55 visant entre autres,
à renforcer le pouvoir de gestion des collectivités territoriales
sur les forêts en dehors du domaine classé, à renforcer les
prérogatives des services déconcentrés dans la gestion
forestière, à mieux répartir les recettes
forestières entre l'Etat et les collectivités...
Quant à l'Acte III, il ambitionne de peser notamment en
matière en matière de gestion des ressources naturelles et
l'environnent, en renforçant les prérogatives des
collectivités dans la création et la gestion des forêts,
d'espaces protégés et de réserves naturelles, la gestion
de zones forestières de terroirs et de sites naturels présentant
un intérêt local, la gestion des bois communaux et la
création d'aires protégées. Le nouveau code forestier
permet de prendre en considération le contexte actuel surtout
politico-écologique et de favoriser la réadaptation des
règles générales de la gestion forestière et de la
gestion des arbres hors forêts et des terres à vocation
forestière dans l'optique de promouvoir une mise en valeur
socio-économique et écologique des ressources forestières
et des terres à vocation forestière.
En dépit de son caractère assez bien fourni, le
cadre juridique régissant la gestion des ressources forestières
présente toutefois des limites : les contradictions et vides juridiques
notamment la faible prise en considération dans les textes
législatifs et réglementaire des exigences, les ambitions, les
connaissances et capacités notamment des acteurs de base ; mais aussi la
non-accessibilité de ces textes (formats non adaptés de
même que contenu, concepts, langages) aux populations locales). Ce cadre
semble avoir besoin d'être épaulé par un cadre
institutionnel à la
53 Lois 96-06 et 96-07 du 22 mars 1996 portant
respectivement Code des collectivités locales et Transfert de
compétences aux collectivités.
54 Loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant
Code générale des collectivités locales, document
publié par OIT (Organisation internationale du Travail)
55 Loi 2018-25 du 12 novembre 2018 portant Code
forestier.
51
fois solide et stable, favorable pour mieux appliquer les
règles de base en termes de gestion des ressources naturelles.
3. Cadre institutionnel de la gestion des ressources
forestières
Pour apporter une réponse à la
dégradation environnementale et une meilleure gestion des ressources
naturelles, le Sénégal a adopté un grand nombre de
politiques de développement et de textes juridiques. En vue de rendre
opérationnel ces cadres, un cadre institutionnel de l'administration
concernant le domaine de la gestion des ressources et l'environnement a
été mise en place et impliquant diverses acteurs classés
et regroupés en trois (3) principaux niveaux hiérarchiques de
décision : central, déconcentré et
décentralisé auquel appartient principalement les
collectivités.
3.1. L'administration centrale
Au Sénégal, la gestion des ressources naturelles
fait intervenir au niveau de l'administration central plusieurs structures,
dont certaines appartiennent au ministère de l'environnement et d'autres
en dépendent.
O Le Ministère de l'Environnement et du
Développement durable (MEDD)
En charge de la préparation et de la mise en oeuvre de
la politique définie par le gouvernement en termes de veille
environnementale, de lutte contre les pollutions environnementales, de
protection de la nature, de la faune et de la flore56, le MEDD est
responsable entre autres, de la protection de l'environnement, de
l'exécution de la politique de protection et de
régénération des sols et s'assure de la prise de mesures
en faveur de la préservation de la faune et de la flore, de lutte contre
les feux de brousse. En relation avec les collectivités, il
s'attèle à promouvoir l'économie forestière ainsi
qu'une utilisation rationnelle des ressources forestières. Pour
accomplir ses missions, il s'appuie essentiellement sur quatre (4) directions
à savoir la DEFCCS, la DPN, la DEEC et la DAMCP.
O La Direction des Eaux, Forêts, Chasse et
Conservation des Sols (DEFCCS)
Principale structure accueillant des projets et programmes
ayant trait à la gestion des ressources naturelles et à la lutte
contre la désertification, cette direction est chargée
d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique forestière
nationale. Son mandat touche plusieurs domaines : conservation
56 Décret n° 2014-880 du 22 juillet 2014
relatif aux attributions du MEDD.
52
des sols, reboisement, gestion de la faune. En vue de
promouvoir une gestion durable des forêts et de la diversité
biologique, de répondre aux besoins des populations tout en garantissant
le maintien des équilibres socio-écologiques, la DEFCCS
mène de nombreuses actions essentiellement en faveur de la restauration
des milieux dégradés, de la mise en oeuvre des mesures
conservatoires, de la règlementation de l'utilisation des ressources, de
la protection et la rationalisation de l'exploitation des ressources.
O La Direction des Parcs Nationaux (DPN)
Créée en 1969 et chargée de mettre en
oeuvre de la politique du gouvernement, en conformité avec les
engagements contractés au niveau international par le
Sénégal en termes de conservation de la biodiversité, la
DPN ambitionne de gérer et de protéger les
écosystèmes naturels et de la faune. S'adonnant à la mise
en oeuvre des conventions internationales se rapportant à la bonne
gestion de l'environnement, elle a en charge, entre autres, de la consolidation
et du renforcement des acquis en matière de conservation de la
biodiversité dans les aires protégées mais
également de l'incitation à participer et à promouvoir des
initiatives privées dans les activités de gestion et de
valorisation des aires protégées et de manière
générale de la biodiversité. A l'echelle locale, elle
exhorte les populations à travers ses services
déconcentrés, dans les activités en faveur de la
conservation, la restauration et la valorisation du réseau des aires
protégées.
O La Direction de l'Environnement et des Etablissements
Classés (DEEC)
Créée en 1975, elle s'est en définitive
installée au Ministère de l'environnement et de la protection de
la nature57, après avoir transitée dans d'autres
départements ministériels. Sous la tutelle du MEED, elle s'occupe
de mettre en oeuvre la politique de l'Etat en termes d'environnement et plus
particulièrement de lutte contre les pollutions et les nuisances. Ses
principales missions consistent à prévenir et à
contrôler les pollutions et nuisances, à intégrer la
dimension environnementale dans les projets, programmes et politiques, au suivi
des actions de différents services et organismes opérant dans le
domaine de l'environnement. Ainsi, la DEEC joue un rôle important dans la
gestion et la restauration des ressources naturelles notamment et plus
particulièrement des ressources forestières.
O La Direction des Aires Marines Communautaires
Protégées (DAMCP)
57 Actuel Ministère de l'Environnement et du
Développement durable (MEDD).
53
Profondément préoccupé par la
préservation de la productivité des écosystèmes
notamment des écosystèmes côtiers et marins, le
Sénégal s'est lancé dans un processus visant à
mettre en place un réseau d'aires marines protégées avec
l'ambition de préserver sur le long terme la biodiversité,
d'utiliser durablement les ressources naturelles, de valoriser le patrimoine
côtier et marin, d'améliorer les conditions d'existence des
communautés. Créée en faveur du renforcement du dispositif
institutionnel58, la DAMCP est chargée de la mise en oeuvre
de la politique du gouvernement en termes de création, d'organisation et
de gestion de ce réseau d'aires marines protégées.
Spécifiquement, sa mission se résume à la conservation de
la biodiversité côtière et marine notamment en consolidant
et en renforçant le réseau, à appuyer les initiatives
communautaires pour favoriser l'émergence d'une gestion durable des
ressources, à mettre en place des cadre locaux de cogestion des
ressources et des aires marines protégées.
C'est ainsi qu'elle mène de façon
régulière et en relation avec les communautés locales, des
activités en faveur de la préservation des
écosystèmes de mangrove, de nombreuses initiatives relatives au
reboisement et à l'exploitation rationnelle des ressources au sein des
aires protégées. Au sein du MEDD, deux (2) autres directions
jouent un rôle significatif à côté de la DAMCP : la
Direction de la planification et de la veille environnementale (DPVE)
chargée de coordonner et d'harmoniser les actions et les
activités en faveur de la définition des stratégies et
politiques, et la Direction des financements verts et des partenariats (DFVP)
en charge du développement des mécanismes de recherche de
financements innovants, de la promotion notamment de l'économie verte et
des emplois verts.
O Le Conseil Supérieur des Ressources Naturelles
et de l'Environnement (CONSERE)
Créé59 en 1993, le CONSERE a servi de
cadre de concertation en faveur d'une orientation harmonieuse et efficiente de
la planification et de la gestion des ressources naturelles. Il devait
concourir à une coordination efficace de l'actions des
départements ministériels concernés par la gestion des
ressources naturelles et de l'environnement, afin de renforcer les politiques
et programmes. Sa mission principale consiste à coordonner et harmoniser
les initiatives sectorielles de gestion des ressources naturelles. Ayant
beaucoup servi durant la période des années 90 notamment à
l'élaboration de la SPNAB, du PAN/LCD ou encore du PNAE, le CONSERE
continue toujours d'exister officiellement, mais n'a toutefois pas abouti aux
résultats escomptés.
58 Décret n°2012-543 du 24 mai 2012.
59 Décret n°93-885 du 04 août
1993.
54
O La Commission Nationale pour le Développement
Durable (CNDD)
Mise en place60 en 1995 avec l'objectif d'oeuvrer
à l'élaboration d'une stratégie de développement
durable à l'echelle nationale, elle avait pour mission de dresser un
état des lieux et de réaliser l'évaluation de
l'état de mise en oeuvre de l'Agenda 21. A l'exemple de la CONSERE, la
CNDD a été d'une importance majeure dans l'élaboration de
nombreux cadre stratégiques notamment le PNAE. En 2008, d'autres
missions61 lui ont été assignées notamment la
définition d'une stratégie et l'élaboration d'un plan
d'action de développement durable au niveau national, la soumission
auprès de la Commission des Nations unies pour le développement
durable (CDD) d'un rapport annuel de développement durable et du plan
d'application Johannesburg, la facilitation des partages d'expériences
avec d'autres pays.
O L'Agence Nationale de la Grande Muraille Verte
(ANGMV)
Issue d'une vision continentale et pour mieux faire face aux
défis liés à la désertification et la
sècheresse, l'érosion de la biodiversité et les
changements climatiques, l'ANGMV cherche à stopper l'avancée du
désert, à mettre en valeur les zones dégradées et
à lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes.
Créée62 en 2008, l'agence mène diverses
activités relatives aux plantations, à la promotion de bonnes
pratiques de gestion durable des ressources en eau, des espaces de parcours,
des couloirs de passage, des forêts, des parcs, ... En effet, la
création de cette agence traduit une réelle volonté de
l'Etat sénégalais de contribuer d'une part, à freiner
l'avancée du désert, à la mise en valeur les zones
concernées à travers une gestion durable des ressources, à
promouvoir des activités agro-sylvo-pastorales et combattre la
pauvreté, à satisfaire les besoins en produits (ligneux et non
ligneux) des populations et à diversifier les systèmes
d'exploitations des terres ; et d'autre part, à restaurer les sols,
à améliorer la séquestration du carbone et à
protéger la diversité biologique.
Le programme de l'agence en ce qui concerne le
Sénégal portait sur le reboisement de 817 500 hectares dans une
bande de 545 km de long et 15 km de large. Ce programme a permis de produire
18,3 millions de plants, le reboisement de 42 500 hectares,
l'aménagement de pares-feux de 13 300 km et 13 000 hectares mis en
défens, d'après le directeur de l'agence avant son départ
en 2017 (Dogru, 2022). Toutefois en 2019, l'Agence a été
dissout63 à cause d'un cadre
60 Arrêté de la Primature n°5161 du
26 mai 1995.
61 Arrêté Primatoral n°8998 du 17
octobre 2008.
62 Décret 2008-1521 du 31 décembre 2008
fixant statut, règles organisation et fonctionnement.
63 Décret n° 2019-1708 du 09 octobre 2019
portant dissolution de l'ANGMV.
55
juridique devenu inadéquat notamment du fait des
nouvelles mesures juridiques64 pour être remplacée par
une nouvelle agence d'exécution65, connue sous l'appellation
l'Agence sénégalaise de reforestation, de la Grande muraille
verte (ASRGMV) exclusivement dédié à la reforestation et
au reverdissement avec l'intention de conférer plus d'impulsion,
d'autonomie et une importance majeure à l'activité reforestation
au niveau nationale.
O L'Agence Nationale des Ecovillages (ANEV)
Avec la volonté de s'orienter vers des politiques
s'inscrivant dans une démarche de développement durable et de
lutte contre la pauvreté, le Sénégal a jugé
nécessaire de prendre en considération les dimensions du
développement durable et de la pauvreté dans toutes les formes de
planification au niveau local et particulièrement à l'echelle du
village. C'est dans ce cadre que l'Etat a mis en place66 en 2008 une
nouvelle agence rattachée au MEDD et dénommée Agence
nationale des écovillages (ANEV) dans l'ambition de promouvoir
l'émergence d'un « développement écologique
participatif, solidaire, responsable et durable de l'ensemble des villages du
monde rural sénégalais ». Les principales missions de
l'ANEV consistent à créer des écovillages sur toute
l'étendue du pays, d'assister les populations au sein des villages
à organiser et aménager leurs espaces, à mettre en place
des pépinières au sein de chaque village pour satisfaire les
besoins en espèces végétales, à développer
des marchés ou des filières pour la satisfaction des besoins
alimentaires et promouvoir les produits écologiques provenant de ces
écovillages, à maitriser la ressources en eau (pour consommation
humaine et aussi pour le développement de l'agro-sylvo-pastorale).
En sus de toutes ces structures précédemment
décrites, de nombreuses et diverses autres structures et
ministères interviennent et jouent un rôle significatif dans la
gestion des ressources naturelles. Elles concernent le Comité national
du CILSS, le Centre de suivi écologique (CSE), les Ministères de
l'agriculture, de l'élevage, des pêches, de l'hydraulique, des
mines, des collectivités territoriales et en partie le Comité
nationale sur les changements climatiques.
3.2. L'administration déconcentrée
64 Loi 2018-25 du 12 novembre 2018 portant Code
forestier.
65 Décret n° 2019-1104 du 3 juillet
2019 portant création, et fixant les règles d'organisation et de
fonctionnement de l'ASRGMV.
66 Décret n° 2008-981 du 12 août
2008 portant création et fixant les règles d'organisation et de
fonctionnement de l'Agence nationale des Ecovillages
56
Au Sénégal, la gestion de l'environnement et des
ressources fait intervenir une multitude de structures diverses à
différentes échelles territoriales. Ces structures interviennent
en collaborant avec les services décentralisés mais aussi avec
les populations locales. Elles sont principalement représentées
par les services déconcentrés du Ministère de
l'environnement et du développement durable particulièrement les
représentants de la Direction des parcs nationaux et de la Direction des
aires marines communautaires protégées, des Inspections et
Directions régionales (surtout les IREF et les DEEC). En outre, d'autres
services déconcentrés (en charge de l'agriculture, de
l'élevage, de la pêche, de la planification, du
développement local, etc...) portent leurs contributions à la
gestion des ressources naturelles. Au plus bas niveau de
décentralisation, le plus grand nombre de ces services techniques est
constitué par des agents à l'occasion des Centres d'appui au
développement local (CADL). Ces derniers jouent un rôle
déterminant dans la gestion des ressources naturelles à l'echelle
des terroirs. Au plus haut niveau décentralisé et au niveau
départemental et local, ces services mènent diverses
activités en coordination avec l'administration territoriale par le
biais des comités de développement (régional,
départemental et locaux) qui se réunissent de façon
régulière pour discuter sur certaines questions relatives
à la gestion des ressources et l'environnement (reboisement, lutte
contre les feux de brousse, érection d'aires protégées,
etc.).
3.3. Le niveau décentralisé
A ce niveau, les instances fondamentales engagées dans
la gestion des ressources naturelle et de l'environnement sont essentiellement
constituées par les collectivités territoriales et des structures
d'appui et plus particulièrement les agences de développement.
3.3.1. Les collectivités territoriales
Depuis quelques décennies, le pays s'est engagé
dans un processus de décentralisation, avec trois (3) principales
réformes accomplies sur différente périodes. Tout d'abord,
la première réforme de 1972 est relative à la
création des communautés rurales. Ensuite, celle de 1996 est
vouée à la régionalisation avec notamment la région
qui est érigée en collectivité local et la création
des communes d'arrondissements. Cette réforme s'est distinguée
par l'édiction d'une loi permettant le transfert de compétences
dans presque une dizaine de domaines (dont la gestion des ressources naturelles
et l'environnement (Boutinot, 2002). En fin celle de 2013 intitulée
« Acte III de la décentralisation » s'est
caractérisée par l'érection du département en
collectivité locale et marque l'installation de la communalisation
intégrale des autres collectivités locales, tout en supprimant
régions collectivités locales et communes
57
d'arrondissement. Cette réforme procure un
environnement adapté et favorable à la construction des
fondements de la territorialisation des politiques publiques (y compris la
gestion des ressources et l'environnement) au niveau du département et
de la commune.
O Les compétences du département en
termes de gestion des ressources naturelles et d'environnement
L'érection de département en collectivité
s'est traduite par un transfert de compétences vers cette
dernière. Ainsi, le département se voit reconnaitre des
compétences67 notamment ayant trait à l'environnement
et la gestion des ressources naturelles. Nous pouvons en citer quelques parmi
d'autres : la création et la gestion des forêts, des espaces
protégées et des sites naturels ayant un intérêt
à l'echelle départemental ; élaborer et mettre en oeuvre
des plans d'actions de l'environnement, d'intervention et de prévention
des risques ; réaliser des pares-feux pour lutter contre les feux de
brousse ; répartir entre les différentes communes les quotas
relatifs à l'exploitation forestière ; délivrer une
autorisation de défrichement après délibéré
du conseil municipal ou une permis de coupe et d'abattage...
O Les compétences de la commune en ternes de
gestion des ressources naturelles et d'environnement
En 2013, l'Etat a décidé de procéder
à la communalisation intégrale68 pour
homogénéiser les différents échelons territoriaux
peu importe leur nature (rurale ou urbaine) en vue d'une l'harmonisation de son
architecture territoriale. Cette communalisation intégrale s'est
manifestée par l'érection des communes d'arrondissement et
communautés rurales en communes. Ces dernières se voient
attribuer plusieurs compétences69 dont la gestion des zones
forestières de terroirs, la gestion des zones naturelles
d'intérêt local, la création et gestion de bois communaux
et d'espaces naturels protégés, la réalisation
d'opérations de reboisement, l'élaboration de plans d'action en
faveur de l'environnement, la mise en défens.
3.3.2. Les agences de développement
En vue d'une gestion adaptée et adéquate des
compétences qui leur sont attribuées notamment dans le domaine de
l'environnement et de la gestion des ressources naturelles, les
collectivités territoriales s'appuient sur un certain nombre de
structures diverses. Ces dernières sont principalement
représentées par les Agences régionales de
développement (ARD) pour appuyer
67 Selon l'article 304 de la loi n°2013-10 du 28
décembre 2013 portant Code général des
Collectivités locales.
68 Loi n°2013-10 du 28 décembre 2013
portant Code général des Collectivités locales, document
publié par OIT
69 Selon l'article 305 de la loi n°2013-10 du 28
décembre 2013 portant Code général des
Collectivités locales.
58
les collectivités à coordonner et à
harmoniser leurs interventions et initiatives ; l'Agence de
développement municipal (ADM) pour contribuer à renforcer la
décentralisation et le développement local ; l'Agence de
développement local (ADL) pour promouvoir et coordonner les actions de
développement à l'echelle locale.
Toutefois, en dépit de la volonté politique de
l'Etat sénégalais de renforcer l'aspect participatif de la
gestion de l'environnement et des ressources naturelles par législation
adéquate et une réglementation adaptée, force est de
constater que l'implication des collectivités territoriales pourtant
essentielle dans la réussite de la mise en oeuvre de politique de
gestion rationnelle des ressources naturelles notamment forestières
(Retiere, 2015)70 demeure faible. D'ailleurs, certains agents des
Services ayant trait à la gestion des ressources forestières ont
du mal à reconnaitre pleinement les prérogatives des
collectivités territoriales et encore moins des populations locales sous
prétexte qu'elles ne disposent pas de capacités techniques
souvent complexes, requises pour la gestion convenable des forêts (Diop
2019).
II. Evolutions de la gouvernance des ressources
forestières au Sénégal 1. Approches et bref historique de
la gouvernance forestière
L'évolution de la gouvernance forestière au
Sénégal et celle relative aux politiques de décentration
et aux approches dans le secteur forestier notamment en termes de gestion des
ressources naturelles sont étroitement liées. Le secteur
forestier sénégalais a fait l'objet depuis l'ère
coloniale, d'une multitude de changements et constitue l'un des secteurs les
plus dynamiques en matière d'évolutions des approches. A
l'époque d'après la colonisation, l'administration
forestière insistait principalement sur une politique de nature
conservatiste à l'égard des ressources forestières. Bien
avant l'accession du pays à son indépendance en
196071, la gouvernance forestière au Sénégal a
connu de nombreuses évolution manifestes, de l'adoption d'approches
répressives jusqu'à celles de cogestion voir même
relativement autonome en ce qui concerne les collectivités territoriales
(Ribot, 1995 ; IPAR, 2015).
La gestion des ressources naturelles est passée de
centralisé (début 1960) à décentralisée
(dans les années 90) puis concertée (début année
2000) (Touré, 2011 ; Sène, 2014). Ces évolutions sont
marquées par la création de nombreuses cadres de concertation
pour une gestion en commun des ressources. En outre, elle sont
caractérisées notamment par une prise en
70 République du Sénégal - Land
degradation neutrality, Rapport national, septembre 2015.
71 Ce, depuis l'adoption du décret du 04
juillet 1935 portant Nouveau Code forestier pour l'AOF.
considération de la multiplicité des fonctions
écosystémiques des forêts et des divers usages et
intérêts des différentes catégories de parties
prenantes concernées par la gestion forestière durable (Diop,
2019). Dans cette optique, l'implication et la participation actives de
l'ensemble des divers acteurs sont indispensables pour une bonne gouvernance
forestière. Cette dernière se distingue selon une
définition d'Organisations internationales par « un processus
d'élaboration des politiques prévisible, ouvert et
renseigné, fondé sur la transparence ; une bureaucratie
imprégnée d'éthique professionnelle ; un exécutif
responsable de ses actions ; une société civile forte qui
participe aux décisions intéressant ce secteur et aux affaires
publiques en général » (FAO et OIBT, 2010).
Faisant référence à la façon de
faire et d'appliquer les décisions relatives à la gestion,
l'utilisation et la conservation des forêts par différentes
entités publiques (Etat, collectivités, entreprises publiques) et
privées (entreprises, ONG, Association, etc...), une gouvernance
forestière efficace implique l'ensemble des parties prenantes ainsi que
les secteurs les mieux appropriés et étudie les problèmes
majeurs relatifs aux forêts (FAO, 2020). C'est un fondement essentiel
pour une gestion forestière concertée et durable. Dès
lors, le pays s'est engagé à promouvoir la participation publique
en vue de favoriser l'implication des différents acteurs dans la
gouvernance forestière.
59
Période essentiellement
caractérisée par la protection, la conservation et le classement
de la plupart des forêts.
1930 : début du processus de
classement des forêts et des premières actions de reboisement
(plantation en régies).
Les forêts étaient
principalement placées sous le contrôle direct de l'Etat
colonial.
1941 : licence d'exploitation
autorisant les populations à se livrer à l'activité
d'exploitation commerciale (jusque-là réservée uniquement
aux citoyens français).
Multitude d'Actions de restauration
engagées à la suite de dégradation accentuée
liée à la longue sécheresse des années
1970.
Consolidation du dispositif de
conservation des ressources face à une menace sur les
écosystèmes forestiers et les milieux naturels.
Ère des initiatives
d'opérations de reboisement en régie de grande envergure (Projets
de fixation de dunes, de plantation, d'aménagement et
reboisement).
Approches dirigistes du service
forestier, mobilisation d'acteurs locaux, faible participation des
populations.
Consolidation des approches
participatives dans un contexte politico-institutionnel favorable,
marqué par la Décentralisation et le transfert de
compétences relatives à la gestion forestière
(Promulgation loi 96-07 du 22 mars 1996).
Communautés rurales
responsables de la gestion des forêts (non classées et non
privées) de leurs terroirs respectifs.
Nouvelle forme de participation
locale dans la foresterie communautaire à l'origine de l'adoption d'un
nouveau code forestier en 1998.
Nouvelle foresterie permettant aux
populations d'être responsabilisées de l'aménagement et la
gestion des ressources tout en y tirant profits.
Secteurs connexes (agriculture,
élevage) associés, intégration des programmes forestiers,
agricoles et pastoraux. Disciplines (économie, sociologie...)
intégrées dans les politiques forestières.
60
Période
Coloniale
|
|
Période des
années 1970
|
|
Période post
1990
|

Période
post-
coloniale

Premier code forestier (loi 65-23
du 9 février 1965) et
réforme foncière (loi sur le
Domaine national). Volonté
de l'Etat de règlementer
l'exploitation des ressources.
Politique insistant sur la
conservation des ressources forestières et fauniques et centrée
sur la protection forestière, le reboisement et les opérations
sylvicoles.
Mainmise absolue de
l'administration sur les ressources forestière.
Période notamment marquée par la création
de parcs, réserves.
Permis d'exploitation souvent
attribués à des urbains au détriment des populations
rurales riveraines limitées au droit d'usufruits pour leurs besoins (de
subsistance) en produits forestiers.
Période des
années 1980
Changement de politique
forestière : les forêts communautaires (plantées par les
villageois) à la place des initiatives de reboisement de grande
envergure (du service forestier).
Ère des projets
communautaires et de la foresterie rurale avec l'adoption du PDDF.
Emergence des approches participatives.
Définition de
méthodologies d'intervention
forestière en milieu rural avec insistance
particulière sur la participation des populations
locales.
1985 : Création de la
Direction Reboisement et Conservation des sols. Populations
considérées comme main-d'oeuvre bénévole
préoccupée par la restauration du couvert
végétal.
Figure 13 : Frise chronologique de l'évolution des
approches dans le secteur forestier au
Sénégal
61
2. Différents acteurs de la gouvernance
forestière
La gouvernance des ressources forestières fait
intervenir un très grand nombre d'acteurs composant l'environnement
institutionnel. Ces différents acteurs peuvent être
répartis essentiellement en deux (2) catégories : la
catégorie constituée par les acteurs relatifs à l'Etat et
la catégorie des acteurs non étatiques et en particulier les
organisations de base et les ONG locales qui jouent un rôle relativement
faible essentiellement axé sur la formation et la sensibilisation des
communautés locales.
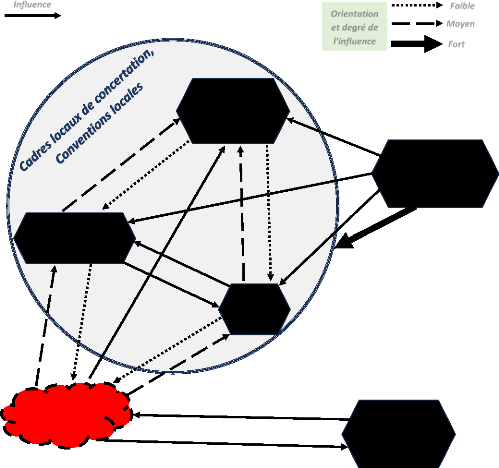
Influence
ACTEURS NON
ETATIQUES
(OCB, ONG)
PARTENAIRES
TECHNIQUES ET
FINANCIERS
COLLECTIVITES LOCALES
ETAT
Rébellion casamançaise
PRIVES PAYS
FRONTALIERS
(GAMBIE)
Orientation
et degré
de
l'influence
Faible Moyen
Fort
Figure 14 : Graphe des acteurs de la gouvernance
forestière et relations entre acteurs
62
La gouvernance des ressources forestières dans la
région de la région naturelle de la Casamance présente une
spécificité relative au longue conflit persistant, mettant en
évidence deux (2) acteurs majeurs : les rebelles qui participent au
pillage des ressources et embarrassent les efforts de surveillance et de
protection, et les acteurs du secteur privé originaires de la
République de Gambie travaillant de connivence avec les pilleurs
sénégalais en leur fournissant les équipements
nécessaires (matériels pour les coupes et véhicules de
transport) et en assurant le commercialisation des produits forestiers
frauduleusement exploités. Au sein des cadres locaux de concertation ou
des conventions locales, les populations conjointement avec d'autres acteurs
mènent des efforts louables à travers les associations à
but non lucratif appuyées par les partenaires techniques et financiers
qui conduisent des actions de protection de l'environnement en partenariat avec
les collectivités locales et les services techniques étatiques.
Ces initiatives en faveur des dynamiques multi-acteurs sont accompagnées
par divers bailleurs de fonds internationaux dont Livelihoods, la Fondation
ACRA...
2.1. Les acteurs étatiques de la gouvernance
forestière
Les acteurs étatiques ayant trait à la
gouvernance forestière sont répartis essentiellement en deux (2)
niveaux fondamentaux à savoir d'une part, les niveaux central et
déconcentré et d'autre part, le niveau
décentralisé.
2.1.1. Les niveaux central et déconcentré
Au niveau central, l'Etat du Sénégal
représente l'acteur primordial dans la mesure où il a la charge
d'élaborer tous les textes législatifs ou réglementaires
régissant le secteur forestier et joue un rôle
prééminent dans la gestion des ressources naturelles. Le niveau
central regroupe de nombreux et divers acteurs dont la Direction des Eaux et
Forêts, Chasses et de la Conservation des sols (DEFCCS) qui constitue la
principale structure de l'Etat en charge de la gestion des ressources
forestières. De façon spécifique, elle est chargée
d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique forestière au
niveau national et d'exercer les prérogatives étatiques dans les
domaines relatives à la conservation des sols, l'aménagement
forestier, la sylviculture, la gestion de la faune et la gestion des
écosystèmes forestiers. En outre, elle s'assure du bon
état de conservation du potentiel forestier et des équilibres
socio-écologiques tout en garantissant la satisfaction des besoins en
produits forestiers des populations
Du point de vue opérationnel, elle s'appuie au niveau
déconcentré sur des représentants qui assurent le relais
des décisions administratives (niveau régional : IREF ;
départemental : secteur des eaux et forêts ; arrondissement :
brigade forestière ; communauté rurale : triage
forestière).
63
Dans le domaine de l'environnement et de la gestion des
ressources naturelles notamment forestières, le Service forestier
apporte un appui technique et financier aux collectivités territoriales
notamment pour l'élaboration et exécution de plans
d'aménagement forestier et de projets et programmes prioritaires, la
formation et le renforcement de capacités, la mise en place de
systèmes d'information...
2.1.2. Le niveau décentralisé
Un certain nombre d'acteurs sont impliqués à ce
niveau dans la gestion des ressources forestières. Ils sont
principalement constitués par les agences de développement
à l'échelle régionale (ARD) mais ici on s'intéresse
particulièrement aux collectivités territoriales
(département et commune). Bien avant l'acte III de la
décentralisation, les collectivités locales constituées
par la région, la commune et la communauté rurale72
étaient des acteurs majeurs de la gouvernance forestière.
L'arrivée de cette réforme acte III de la
décentralisation73 réaffirme le rôle capital des
collectivités tout en permettant dans le cas présent, de
différencier deux (2) acteurs essentiels : le département et la
commune.
O Le Conseil départemental : instance
décisionnelle à ce niveau, il met en place un cadre de
concertation chargé de planifier et d'harmoniser les politiques
environnementales et de gestion de ressources naturelles. Instance
compétente pour l'autorisation préalable d'exploitation et/ou de
valorisation des produits et services forestiers74, il a le pouvoir
de s'ingérer dans la mise en oeuvre de plans d'aménagement et de
gestion des écosystèmes notamment des écosystèmes
forestiers. En outre, c'est cette assemblée qui autorise toute
occupation du domaine forestier protégé par divers
activités susceptible d'occasionner des dégâts
environnementaux. Par ailleurs, il dispose des prérogatives en
matière de restrictions ou de suppressions du droit d'usage en dehors du
domaine forestier classé.
O La commune : en dehors des
compétences reçues à travers l'adoption du nouveau code
forestier75, elle dispose des prérogatives en matière
de création de bois, forêt et réserve naturelle communaux.
Ces prérogatives font du conseil municipal un acteur
considérable
72 Loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant
Transfert de compétences aux régions, aux communes et aux
communautés rurales, publié par Gouvernement du
Sénégal
https://www.sec.gouv.sn/.
73 Loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code
générale des collectivités locales, document publié
par OIT.
74 Avec le Nouveau Code forestier : «
L'exploitation et/ou la valorisation des produits et services forestiers
dans les forêts relevant de la compétence des collectivités
territoriales est assujettie à l'autorisation préalable du
Conseil départemental concerné après avis du Conseil
municipal concerné »., Document publié en 2021 par le
CNCR.
75 Article 305 de la loi n° 2013-10 du 28
décembre 2013 portant Code général des
Collectivités locales détermine les compétences
accordées aux communes en termes d'environnement et de gestion des
ressources naturelles.
64
dans la gouvernance forestière bien que les
décisions relatives à ce domaine émanent du conseil
départemental ou du service forestier. Toutefois, son autorisation est
obligatoire pour la tenue au sein de son périmètre de
compétence hors du domaine privé, de diverses activités
relatives aux coupes et à l'abattage d'arbres, à l'élagage
et à l'écorçage d'arbres. Le conseil municipal intervient
dans le cadre de l'aménagement de massif forestier en participant
à l'ensemble des étapes d'élaboration et d'approbation du
plan d'aménagement et de gestion, en pilotant la mise en oeuvre de ce
plan, en créant un cadre de concertation et en appuyant le comité
inter-villageois à élaborer et appliquer la convention...
Dans l'ensemble, les législations et les
règlementations relatives à la deuxième réforme sur
la régionalisation et à la troisième
dénommée Acte III de la décentralisation confèrent
une importance remarquable aux collectivités territoriales. Ces
dernières jouent des rôles primordiaux en matière de
gestion des ressources naturelles surtout forestières, en s'appuyant
tout de même sur un certain nombre de services dont la DEFCCS à
travers ses représentants locaux et les centres d'appui et de
développement local. Les collectivités exercent leurs
compétences sous le contrôle d'autorités de
l'administration déconcentrée et de services de gestion
forestière (Diop, 2019), laissant penser à des limites ou des
insuffisances de la décentralisation en termes de transfert de
compétences aux collectivités territoriales.
2.2. Les acteurs non étatiques de la gouvernance
forestière
Au Sénégal, la gouvernance des ressources
forestière fait intervenir divers acteurs non étatiques
particulièrement une multitude d'acteurs locaux principalement
constitués de la société civile, des cadres locaux de
concertation, des autorités coutumières, des partenaires au
développement.
o La société civile notamment au niveau
local : l'apparition de divers phénomènes liés au
réchauffement climatique, l'extraction minière en zone
forestière, les iniquités dans la gestion et la
répartition des recettes forestières etc... ont poussé
plusieurs acteurs (ONG, associations) à oeuvrer en faveur du respect et
la défense des droits des populations locales et de l'environnement.
Dans cette perspective, de nombreuses initiatives ont été
lancées, dont récemment la création d'un comité
contre l'extraction du zircon de Niafrang en Casamance (menace de disparition
des forêts de mangrove) ou le collectif contre le projet d'extension des
carrières d'extraction du phosphate dans la région thiessoise, ou
encore les grands rassemblements contre les conséquences
désastreuses de l'extraction d'or à Kédougou (destruction
des forêts) (Fall, 2017).
o
65
Les cadre locaux de concertation : ce sont
des espaces de rencontres, d'échanges et de décision favorisant
le renforcement de l'approche participative et la transparence
démocratique dans le processus de la gestion forestière. Apparus
en même temps que la foresterie communautaire et l'approche
participative, ces cadres de concertation ont été effectivement
consolidés par le bais de projets d'aménagement des massifs
forestiers, sous l'influence de plusieurs partenaires internationaux (Banque
mondiale, GIZ, USAID) en vue de favoriser la participation des populations
à l'élaboration et la mise en oeuvre de plans
d'aménagement. De plus, ils concernent et rassemblent toutes les
différentes catégories socioprofessionnelles et adoptent la
plupart du temps la forme de comité villageois ou comité
inter-villageois. En matière de gestion forestière, ces
comités participent à la création et la gestion de
pares-feux, la gestion de feux de brousse, la surveillance des massifs
forestiers, l'accroissement de la productivité forestière, la
prévention et la gestion de conflits à l'interne...
o Les chefs de villages et les autorités
coutumières : représentants de l'autorité
administrative dans sa circonscription territoriale et détenteur d'un
pouvoir coutumier leur accordant un droit de regard notamment sur les
ressources forestières de son aire de compétence, les
autorités coutumières particulièrement les chefs de
villages assurent généralement la police administrative au sein
de leur villages respectifs. En ce sens, ils sont chargés d'arbitrer et
de gérer les conflits entre différents acteurs du village et
s'assurent en particulier de la participation de l'aménagement forestier
en faveur du développement de leur villages. En s'adjoignant le conseil
des notables, ils jouent traditionnellement des rôles primordiaux
(régulateur, médiateur, d'apaisement social) en faveur de la
prévention et la résolution des conflits relatives à
l'exploitation forestière et prennent part au processus de
démocratisation de la gestion forestière. Véritables
mobilisateurs communautaires, ils sont souvent associés à
diverses activités notamment celles en faveur de la reconstitution du
couvert végétal, dans le but de susciter l'adhésion et la
mobilisation des habitants de leurs villages respectifs.
o Les partenaires au développement :
leurs contributions substantielles au financement de la politique relative au
secteur forestier sénégalais continuent d'être
incontournables, compte tenu de l'importance des ressources financières
nécessaires pour la lutte contre la dégradation
forestière. Ces partenaires interviennent le plus souvent par le biais
d'une multitude de projets et programmes ayant traits notamment à
l'aménagement de massifs forestiers et la gestion forestière
durable. Tout bien compte, les partenaires au
66
développement constituent des acteurs incontournables
de la gestion forestière et exercent une influence plus ou moins forte
sur les orientations de la politique forestière et le processus
décisionnel au niveaux central et décentralisé.
III. Outils de gouvernance forestière
La mise en évidence des acteurs territoriaux dans la
gouvernance locale ne doit pas être pour autant une source de
négligence des dispositifs légaux et juridiques auxquels ces
acteurs doivent y faire face, que cela concerne des lois édictées
à l'echelle nationale (code civil, pénal, code de
l'environnement, forestier, des collectivités territoriales...), de
leurs déclinaisons, des règlements au niveaux nationaux et
communautaires notamment en matière de gestion des ressources
forestières des terroirs. Autrement dit, dans un environnement
marqué par la troisième réforme « Acte III de la
décentralisation » qui s'est traduite par le transfert de
compétences notamment la gestion des ressources naturelles avec la
volonté manifeste de placer l'acteur local au coeur de la
problématique forestière, un certain nombre d'outils juridiques
sont essentiellement nécessaires afin d'offrir à l'Etat et aux
collectivités des occasions favorables au renforcement de la
participation des populations à la gouvernance des ressources
forestières. Dans ce contexte, différents outils subsistent
évidemment en faveur d'une règlementation rationnelle relative
à l'accès et l'usage des ressources et la gestion de conflits.
Une étude réalisé en 2011 et intitulée «
Les conventions locales pour la gestion des ressources naturelles au
Sénégal : Entre autonomisation et problème d'appropriation
» permet de mettre en évidence quelques-uns de ces outils
notamment les plans d'action pour l'environnement, d'occupation des sols, les
plans locaux de développement, les conventions locales sur lesquelles
nous allons nous pencher.
1. Les conventions locales
Accords légitimes entre un certain nombre de parties
prenantes dans l'éventualité d'une régulation des
ressources notamment forestières (accès, usage, exploitation,
etc....), les conventions locales désignent des instruments innovants
fondés sur des règles établies de façon collective
par les acteurs locaux essentiels (Touré, 2011 ; Tall et Gueye, 2003).
En d'autres termes, elles sont des instruments de gestion locale permettant de
renforcer les processus traditionnels de régulation basés sur la
concertation. Longtemps réduites à une question émergente
en ce qui concerne la gestion partagé des ressources, les conventions
locales constituent des mécanismes de prévention et de gestion
des conflits entre les différents usagers mais aussi un enjeu capital
des processus de décentralisation. Tout bien considéré,
ces
67
conventions locales concourent d'une part, à une
règlementation rationnelle relative à l'accès et à
l'usage des ressources forestières et d'autre part, à une gestion
efficace des conflits entre usagers. Juridiquement, elle étaient
encadrées au préalable par des textes du code des
collectivités locales76. Ce dispositif a été
consolidé d'abord avec l'adoption de la troisième réforme
« Acte III de la décentralisation »77 puis par le
principe de libre administration des collectivités
territoriales78 et enfin par la loi portant nouveau code forestier
du pays79.
2. Les conventions locales et la gestion des ressources
naturelles
En matière de gestion, de conservation,
d'aménagement et d'exploitation des ressources forestières, les
conventions locales traduisent l'expression des souhaits des populations de
zones adjacentes à une forêt donnée et résultent
notamment, surtout des déclarations et des engagements des populations.
En effet, dans un contexte marqué par la déforestation et la
dégradation accélérée des ressources
forestières conjugué aux difficultés à satisfaire
leurs besoins essentiels en produits forestiers ligneux et non ligneux, les
populations notamment celles des zones rurales prennent de plus en plus
conscience du risque d'épuisement des ressources naturelles pourtant
longtemps considérées comme des ressources illimitées, et
qu'un changement d'habitudes ou de comportements est plus que jamais
indispensable. Cette prise de conscience a été le premier pas
notamment pour les habitants des villages riverains des forêts à
s'organiser souvent appuyés par les partenaires en vue de d'instaurer un
accès réglementé aux ressources forestières, de
gérer efficacement les éventuels conflits d'intérêts
et de veiller à une exploitation rationnelle et une gestion durable des
forêts villageoises.
A cette fin, un certain nombre de concertations villageoises
comme inter-villageoises au profit de la gestion forestière
communautaire ont été d'abord mis en évidence non
seulement pour impliquer l'ensemble des parties prenantes pertinents mais aussi
pour aider à la définition des stratégies efficaces,
adaptées au contexte local et pouvant induire un gestion durable des
forêts.
76 Décret n° 96-1134 du 27
décembre 1996 portant application de la loi n° 96-07 du 22 mars
1996 portant Transfert de compétences aux régions, communes et
communautés rurales, accorde aux collectivités des instruments
qui leur confèrent la possibilité à partir d'une gestion
et exploitation rationnelle des ressources et de l'environnement, de promouvoir
des politiques de développement durable.
77 Article 7 de la section 2 « Participation
citoyenne » de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant
Code général des Collectivités locales, précise que
: « l'organe exécutif au niveau local peut instituer dans la
collectivité, un cadre de concertation dans le but d'assurer la
participation effective des populations dans la gestion des affaires publiques
».
78 Article 102 de la loi constitutionnelle n°
2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution de 2001,
précise que : « Les collectivités territoriales
constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à
la gestion des affaires publiques... ».
79 Article 17 de la loi 2018-25 du 12 novembre
2018 portant Code forestier stipule que : « Les collectivités
territoriales peuvent conclure des conventions locales en faveur de la
convention des ressources naturelles de leur terroir... ».
Tout compte fait en matière de gestion des ressources
forestières, les conventions locales constituent un outil de
co-gouvernance et permettent de façon spécifique d'impulser un
ensemble de comportements en faveur d'une exploitation rationnelle et une
meilleur conservation de ressources forestière et de la
biodiversité, d'éliminer ou d'éviter les conflits
d'intérêts découlant de l'exploitation et
d'améliorer la satisfaction des besoins des différents acteurs
locaux.
68
69
CHAPITRE 4 : ANALYSE ET DISCUSSION
Ce quatrième chapitre est essentiellement
dédié à la présentation des résultats
obtenus à partir des entretiens individuels menés auprès
de personnes ressources. Il aborde l'identification des différentes
pressions exercées sur les forêts en Casamance, les causes et les
conséquences de la déforestation et de la dégradation des
forêts en région casamançaise, la stratégie de
gestion forestière mise en oeuvre et la préconisation des
solutions efficaces en faveur de l'amélioration de la stratégie
pour une gestion durable des forêts de la région naturelle de la
Casamance.
Les informations et les données traités faisant
l'objet d'analyses dans ce quatrième chapitre concernent principalement
celles recueillies par le biais d'enquêtes auprès des responsables
des Inspections Régionales des Eaux et Forêts (IREF) de
régions administratives (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) de la
région naturelle de la Casamance et
d'enseignant-chercheur au département de
Géographie de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, la seule
université de la région casamançaise. Les IREF sont des
services déconcentrés et représentantes au niveau
régional de la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la
Conservation des sols (DEFCCS) qui est la direction en charge des ressources
forestières au sein du Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable (MEDD) du Sénégal.
I. Analyse des pressions exercées sur les
forêts en Casamance
1. Identification des différentes pressions sur les
forêts casamançaises
En se basant sur les données recueillies lors des
entretiens et analysées, les vastes forêts de la région de
Casamance sont soumises à de fortes et diverses pressions de
déforestation et de dégradation qu'il serait absolument
nécessaire d'en identifier les majeures à forts impacts sur les
écosystèmes forestiers et plus généralement la
nature. Ainsi, les principales pressions de déforestation et de
dégradation forestière identifiés en région
casamançaise sont constituées par :
? les coupes frauduleuses d'arbres notamment
certaines espèces de valeur (bois d'oeuvre, bois de service, etc....)
;
? le trafic international de bois vers la
république de Chine (via la Gambie) tout au long de la
frontière sénégalo-gambienne ;
? les défrichements pour l'installation
ou l'expansion des cultures ;
70
? l'urbanisation galopante marquée par
l'étalement urbain dans certaines grandes communes comme
Bignona, Ziguinchor, Kolda etc... Cette forte urbanisation notamment des
communes de Bignona et Ziguinchor est en partie liée au conflit qui
sévit depuis 40 ans en Casamance ;
? les feux de brousse répétitifs
véritable fléau pour la biodiversité et les
différentes écosystèmes forestière de la
région naturelle de la Casamance ;
? les conditions de vie difficiles des
populations (pauvreté, précarité économique,
insécurité alimentaire, etc...).
2. Les causes et les conséquences de la
déforestation et de la dégradation des forêts en
région casamançaise
2.1. Les principales causes de la dégradation et de
la déforestation en Casamance
Depuis quelques années, les écosystèmes
forestiers de la région naturelle de la Casamance ont été
fortement dégradés, déforestés ou détruits
à cause de plusieurs facteurs anthropiques (liés aux
activités humaines) et naturels.
? Les principales causes anthropiques de la
déforestation et de la dégradation des forêts
casamançaise ont été identifiées et concernent de
façon spécifique les points suivants :
? Les exploitants forestiers locaux vivant en territoire
sénégalais et les agriculteurs en quête de nouvelles terres
à cultiver ;
? Les trafiquants de bois basés en République
de Gambie (notamment le bois de rose ou vène rare, précieux,
très convoité par ces derniers et très prisé sur le
marché chinois) ;
? L'avancée du front agricole ;
? L'agrandissement de certaines communes ;
? Le braconnage avec des armes à feux, les
récolteurs de miel etc.
? Les activités pastorales non contrôlées
notamment à Kolda, région par essence d'élevage
agropastoral.
71
? La principale cause naturelle est
constituée par les incendies de forêts causées par la
foudre. Cette dernière est souvent à l'origine des feux de
racines pouvant provoquer d'immenses incendies forestiers.
Toutefois, au-delà des principales causes de la
dégradation et de déforestation précédemment
recensées, le conflit casamançaise sur fond de rébellion
indépendantiste du Mouvement des forces démocratiques de
Casamance (MFDC) qui sévit depuis 40 ans dans la région,
participe tout autant à ces deux phénomènes, en favorisant
la dégradation des forêts et l'exploitation frauduleuse des
ressources forestières dans certaines zones caractérisées
par une insuffisance des contrôles et l'insécurité.
2.2. Les conséquences de la dégradation et
de la déforestation en Casamance
Les fortes pressions notamment anthropiques qui s'exercent
sur les écosystèmes forestiers de la région naturelle
casamançaise entrainent de nombreuses et lourdes conséquences
notamment un changement dans la structure forestière interne, de pertes
de fonctions des forêts et l'appauvrissement de la biodiversité de
ces écosystèmes forestiers. Globalement, les conséquences
de ces pressions sont la dégradation des ressources forestières
et une paupérisation des populations locales qui dépendent de
l'exploitation de ses ressources. De façon plus spécifiques, les
principales conséquences se traduisent par :
? la destruction à grande echelle du couvert
végétal ; ? la diminution du tapis herbacée ;
? l'érosion et l'appauvrissement des sols ;
? l'appauvrissement de la biodiversité forestière
;
? la diminution de la densité de certaines
espèces de valeur comme Kheya senegalensis
(caïlcédrat), Cordyla pinnata (poirier du Cayor),
Afzelia africana (Doussié) etc... ;
? l'augmentation de la température terrestre due à
la réduction du couvert végétal ;
? l'augmentation de la salinité de certains bas-fonds
due à l'avancée de la mer notamment sur le littorale
casamançais ;
? la disparition de certaines espèces
végétales qui ne résistent qu'à une certaine teneur
en sel.
72
II. Analyse de la stratégie de gestion
forestière mise en oeuvre
L'analyse de la stratégie de gestion forestière
actuellement mise en oeuvre au Sénégal permet de montrer que
cette dernière met l'accent sur un certains d'actions qu'il est
important de préciser. Ces actions stratégiques portent
principalement sur :
? la sensibilisation des acteurs du
développement rural sur les enjeux des ressources naturelles notamment
des ressources forestières, longtemps considérées surtout
par les populations locaux comme des ressources inépuisables et qu'il
est nécessaire de veiller pour la préservation des ressources
forestières ;
? la formation de l'ensemble des
différents acteurs qui exercent des métiers ou dans des domaine
ayant trait à la gestions des ressources naturelles et
forestières ;
? la lutte dans toutes ces formes contre les
exploitations forestières frauduleuses en dotant au service forestier
d'important moyens de lutte pour faire face au trafic illégale
international du bois précieux de la région de Casamance ;
? la création de comité
villageois de surveillance et de lutte contre les feux de brousse ou les
incendies de forêts dans chaque grande commune particulièrement
vulnérable à ces feux de brousse ou incendies de forêts
;
? la mise à disposition d'importants
équipements et matériels aux comités et aux unités
de lutte contre les feux de brousse ou incendies de forêts ;
? la réalisation d'opérations
de reboisement dans les zones ou espaces dégradés en vue de
favoriser la régénération d'espèces
particulièrement des espèces en voies de disparition.
Bien que la stratégie de gestion forestière
mise en oeuvre mette en évidence plusieurs actions essentielles en
faveur de la conservation et la restauration des forêts, elle est
toutefois confrontée à plusieurs obstacles ou contraintes de
diverses natures qui empêchent d'aboutir à un véritable
gestion forestière durable. Ces obstacles ou contraintes de diverses
natures sont essentiellement constitués par :
o l'insuffisance de moyens logistiques pour la
mobilité des agents forestiers afin d'assurer de manière
constante la surveillance de certains massifs forestiers menacés ;
o l'insuffisance de dotations en carburant pour sillonner et
contrôler les massifs forestiers menacés ;
o
73
la faible implication ou la non-implication d'un certain
nombre d'élus locaux sur la gestion des ressources forestières et
ce, bien que la compétence ait été
transférée aux collectivités locales depuis
199680 et l'adoption en 2018 d'une nouvelle loi portant code
forestier81 visant entre autres, à renforcer le pouvoir de
gestion des collectivités territoriales sur les forêts.
o la crise casamançaise, bien que ce soit un long
conflit de basse intensité, persiste toujours et contribue à
rendre difficile l'opérationnalisation des stratégies de gestion
des ressources forestières.
o enfin l'enclavement de certaines zones voir de la
région naturelle de la Casamance.
III. Recommandations en faveur de l'amélioration de
la stratégie pour une gestion durable des forêts en Casamance
En vue d'apporter des solutions réalistes aux
contraintes relevées et valoriser au mieux les atouts qui s'offrent en
faveur d'une stratégie forestière efficace, des recommandations
d'actions concrètes sont faites sur la base des options
stratégiques permettant d'aboutir à une gestion durable des
forêts de la région naturelle de la Casamance. Dans cette logique,
les mesures suivantes sont fortement préconisées :
? la formation des élus locaux sur la gestion des
ressources forestières dont la compétence leur ait
été transférée depuis 1996 ;
? la sensibilisation des acteurs locaux sur les enjeux du
changement climatique liés aux systèmes forestiers et les lourdes
conséquences qui découleraient des phénomènes de
déforestation et de la dégradation des forêts si l'on n'y
prend pas garde ;
? l'augmentation des dotations en moyens matériels et
logistiques (véhicules, moto, carburant) aux agents de base
chargés d'assurer la surveillance des massifs forestiers ;
? l'intensification de la lutte contre le trafic
illégal international de bois précieux en multipliant les
tournées de police forestière tout au long de la frontière
sénégalo-gambienne ;
80 Lois 96-06 et 96-07 du 22 mars 1996 portant
respectivement Code des collectivités locales et Transfert de
compétences aux collectivités.
81 Loi 2018-25 du 12 novembre 2018 portant Code
forestier.
? l'implication ou le renforcement de l'implication des autres
forces de sécurité et de défense (Gendarmerie,
armée nationale) sur la surveillance des ressources naturelles notamment
forestières ;
? le renforcement des moyens de surveillance des agents des eaux
et forêts et de l'armée ; ? le renforcement de la lutte contre la
corruption qui mine le secteur forestier ;
? travailler à la résolution de la crise
casamançaise pour un retour de la paix dans la région,
? élaborer et mettre en oeuvre des schémas
d'aménagement et des documents d'urbanisme pour préserver ou
gérer durablement les espaces forestiers.
74
75
CONCLUSION
Au Sénégal, les vastes forêts denses sont
essentiellement localisées au sud du territoire dans la région
naturelle de la Casamance, dernière grande zone boisée du pays
abritant une grande diversité d'espèces végétales.
Ce potentiel forestier riche et varié est d'une importance primordiale
et profite à plusieurs secteurs dont l'alimentation, la construction, la
fourniture d'énergie, les gîtes d'animaux... Les vastes
forêts de la région casamançaise sont connues pour leurs
essences d'arbres et leurs bois rares et précieux notamment le bois de
rose aussi appelé bois de vène, ou encore le poirier du Cayor.
Les enjeux des forêts casamançaises sont énormes à
la fois économiques, sociaux et environnementaux, et les
différentes pressions de déforestation et de dégradation
exercées sur ces vastes forêts sont de plus en plus fortes et
fréquentes au fil des années.
Dans cette région naturelle de la Casamance, les
nombreuses et divers natures de pressions identifiées sont
principalement constituées par les coupes frauduleuses d'arbres, le
trafic international de bois tout au long de la frontière
sénégalo-gambienne synonyme d'un véritable catastrophe
écologique, les défrichements relatifs à l'expansion
agricole, l'étalement urbain, les feux de brousse
répétitifs véritable fléau pour la
biodiversité et les écosystèmes forestiers
casamançaises, la précarité socio-économique et la
pauvreté persistante... Ces pressions exercées dégradent
et détruisent les forêts provoquant d'importants
dégâts dont la destruction à grande échelle du
couvert végétal, l'érosion et l'appauvrissement des sols
et de la biodiversité forestière, la réduction des
espèces végétales de valeur, la destruction des
espèces et d'habitats naturels dans certains bas-fonds.
Pour remédier à cette situation, la mise en
oeuvre d'une stratégie forestière efficace impliquant l'ensemble
des acteurs étatiques et non étatique (notamment les
collectivités territoriales) du secteur forestier et de secteurs
connexes, permettrait d'aboutir à une gestion durable des forêts
de la région de Casamance, zone la plus boisée dans le sud du
Sénégal. Une gestion durable des ressources forestières
devrait contribuer à la conservation et la restauration des forêts
tout en permettant de répondre à la satisfaction durable des
besoins des populations casamançaises en produits forestiers ligneux et
non ligneux, sans pour autant compromettre les équilibres
socio-écologiques dans le contexte actuel de changement climatique
marqué notamment par des événements extrêmes
liés au réchauffement climatique.
Au-delà des fortes pressions qu'elles subissement
actuellement et ce, depuis plusieurs années, les vastes forêts de
la région naturelle de la Casamance risquent toutefois d'être
confrontées à
d'autres pressions notamment celles relatives au projet
potentiel et controversé d'extraction du zircon dans la zone de Niafrang
en région casamançais, un projet82 auquel la
majorités des habitants s'oppose et qui crée la polémique
notamment à cause de ses potentiels impacts sociaux et
environnementaux.
76
BIBLIOGRAPHIE
ADL (2021). Observatoire national de la
décentralisation et du développement local. Profil administratif
et démographique des collectivités territoriales du Pôle
Casamance. Rapport n°01/2021, 162p.
https://www.observatoireadl.net/wp-content/uploads/2021/10/VF
Rapport-Thematique-1 -Profil-administratif-et-demographique
Pole-Casamance.pdf
82 [Reportage] Sénégal
: Niafrang résiste face au projet d'extraction de zircon.
https://www.business-humanrights.org/fr/derni%C3%A8res-actualit%C3%A9s/reportage-s%C3%A9n%C3%A9gal-niafrang-r%C3%A9siste-face-au-projet-dextraction-de-zircon/
77
AFP. (2020). Le recul s'accélère en Afrique
pour la forêt, mère nourricière des plus fragiles.
Geo.fr.
https://www.geo.fr/environnement/le-recul-saccelere-en-afrique-pour-la-foret-mere-nourriciere-des-plus-fragiles-200624
ANAT. (2020). Plan national d'Aménagement et de
Développement territorial (PNADT). Rapport final, juin 2020.
ANAT.
http://anat.sn/pnadt/PNADT-Rapport.pdf
Andre, D. (2014). Analyse de la gouvernance forestière
au Sénégal. Etude de l'Initiative Prospective Agricole et Rurale
(IPAR)/Rights and Ressources Initiatives, 30p.
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a91b90185037e5f11e9f99a989ac11dd-0050062013/related/Analysis-of-Forestry-Governance-in-Senegal.pdf
ANSD (2021). Enquête harmonisée sur les conditions
de vie des ménages (EHCVM) au Sénégal. Rapport final,
181p.
https://www.ansd.sn/sites/default/files/2022-11/Rapport-final-EHCVM-vf-Senegal.pdf
ANSD. (2021). Situation économique et sociale de la
région de Kolda de 2019.
https://www.ansd.sn/sites/default/files/2022-12/SES-Kolda-2019.pdf
ANSD. (2021). Situation économique et sociale de la
région de Sédhiou de 2019.
https://www.ansd.sn/sites/default/files/2022-12/SES-Sedhiou-2019.pdf
ANSD. (2021). Situation économique et sociale de la
région de Ziguinchor de 2019.
https://www.ansd.sn/sites/default/files/2022-12/SES-Ziguinchor-2019.pdf
ANSD. (2022). Situation économique et sociale du
Sénégal de 2019.
https://www.ansd.sn/sites/default/files/2022-04/0-SES-2019
presentation-pays.pdf
Bakehe, N. P. (2020). L'effet de la démocratie sur la
dégradation de l'environnement.
· Le cas de la
déforestation dans le bassin du Congo. Développement
durable et territoires. Économie, géographie, politique,
droit, sociologie, Vol. 11, n°3, Article Vol. 11, n°3.
https://doi.org/10.4000/developpementdurable.17857
BBC Africa Eye. (2020). Ces arbres qui saignent. BBC
News Afrique.
https://www.bbc.com/afrique/region-51801317
Béliveau, A. (2008). Déforestation et
agriculture sur brûlis en Amazonie brésilienne.
· Les
impacts de la première année de culture sur les sols de fermes
familiales de la région du Tapajós. Mémoire
d'études, UQAM.
https://archipel.uqam.ca/1412/1/M10433.pdf
78
Bodiguel, J. (2020). Objectif de Développement Durable -
Forêts, désertification et biodiversité.
Développement durable. Consulté 6 février 2023,
à l'adresse
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/biodiversity/
Capel, A.-C. (2015). Agents et causes de la
déforestation et de la dégradation forestière.
https://www.fao.org/3/i6490f/i6490f.pdf
Caramel, L. (2016). Entre Gambie et Casamance, les saigneurs
du bois de vène. Le Monde.fr.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/05/26/les-saigneurs-du-vene
4926559 3212.html
CEA (2023). L'Afrique doit endiguer la pauvreté et les
inégalités sociales pour atteindre ses objectifs de
développement. Rapport de la Commission économique pour
l'Afrique 2023. Consulté 11 juin 2023, à l'adresse
https://www.uneca.org/fr/stories/l%E2%80%99afrique-doit-endiguer-la-pauvret%C3%A9-et-les-in%C3%A9galit%C3%A9s-sociales-pour-atteindre-ses-objectifs
CDB (2020). Convention sur la diversité biologique. Vivre
en harmonie avec la nature. Décennie des Nations unies pour la
biodiversité, 68p.
https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-fr-web.pdf
CIRAD. (2022). Des forêts d'Afrique centrale
particulièrement vulnérables aux changements globaux.
CIRAD.
https://www.cirad.fr/espace-presse/communiques-de-presse/2021/changement-climatique-impact-foret
CIRAD. (2021). Pourquoi les politiques actuelles de lutte
contre la déforestation sont-elles vouées à
l'échec? CIRAD.
https://www.cirad.fr/espace-presse/communiques-de-presse/2020/jouer-pour-lutter-contre-la-deforestation
CNCR (2021). Boite à outils sur la gestion
forestière. 54p.
https://foncierausenegal.info/wp-
content/uploads/2021/04/boite a outils sur la gestion fonciere
senegal 1 0.pdf
Conseil Régionale de Dakar, 2003. Plan d'Action Forestier
Régional. 32p.
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/senegal
pafr dakar.pdf
Demba Ba, B., & Descroix, L. (2022). Analyse de Quelques
Conséquences du Conflit de Casamance sur les Ressources
Forestières dans le Département de Bignona
(Sénégal). Cadernos de Estudos Africanos, 42, Article 42.
https://doi.org/10.4000/cea.6713
79
Dia, A., & Niang, A. M. (2013). Le Projet Majeur Grande
Muraille Verte de l'Afrique: Contexte, historique, approche stratégique,
impacts attendus et gouvernance. In R.
Duponnois (Éd.), Le projet majeur africain de la
Grande Muraille Verte: Concepts et mise en oeuvre (p. 11-27). IRD
Éditions.
http://books.openedition.org/irdeditions/2110
Diallo, R. (2019). Grande Muraille verte. IEF, DT
ANGMV.
https://www.aalam-bi.com/sites/docthem/Grande%20muraille%20verte%20OK/GRANDE%20MURAILLE%20
VERTE%20.pdf
Diop, I. N. (2022,). Trafic de bois en Casamance: Une source
de richesse pour un tiers groupe | LinkedIn.
https://www.linkedin.com/pulse/trafic-de-bois-en-casamance-une-source-richesse-pour-un-diop/?originalSubdomain=fr
Diop, M. (2005). La ressource arborée: Bilan des
réalisations des projets forestiers dans la vallée du fleuve
Sénégal. Cas du PROGONA/PROWALO - Région de
Saint-Louis. Mémoire de Master, Ecole Nationale du Génie
Rural, des Eaux et des Forêts, Montpellier, 82p.
https://docplayer.fr/58265177-Ecole-nationale-du-genie-rural-des-eaux-vt-fl-co-et-des-forets-
.html
Diop, M. (2011). L'arbre et la forêt : Usages,
préférences, représentation et croyances chez les
populations riveraines de la forêt classée de Patako
(région de Fatick, Sénégal). Thèse de doctorat
Unique, Institut des Sciences de l'Environnement, Université Cheikh Anta
Diop, Dakar, 212p.
http://bibnum.ucad.sn/viewer.php?c=ths&d=THS-7435
Diop, M. (2019). Rapport d'étude : Revue du cadre
légal des politiques de reverdissement et de l'évolution des
approches de la gouvernance forestière au Sénégal.
Dakar - IED Afrique | Innovations Environnement Développement.
https://www.iedafrique.org/rapport-d-etude-revue-du-cadre-legal-des-politiques-de-reverdissement-et-de-883.html
Diop M., Goudiaby, A. 2008. Capitalisation des
expériences en matière de gestion des ressources naturelles au
Sénégal. Rapport SUN, 13p.
Djeukoua, B. (2019). Sénégal : Exploitation
illégal des ressources forestières en Casamance. Africa Green
Magazine.
http://www.africagreenmagazine.com/2019/12/senegal-exploitation-illegal-des.html
80
Dogru, A. (2022). Sénégal : La grande muraille,
une mue au vert pour freiner le désert et la pauvreté.
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/sénégal-la-grande-muraille-une-mue-au-vert-pour-freiner-le-désert-et-la-pauvreté/2616316
Fall, M. C. (2017). Gestion foncière et
décentralisation au Sénégal dans le contexte des
acquisitions foncières à grande échelle : Le cas de la
commune de Ngnith dans le département de Dagana. Thèse de
doctorat en Géographie, Université Michel de Montaigne - Bordeaux
III.
https://theses.hal.science/tel-01679748
FAO. La gouvernance et les régimes fonciers |
Réduction des émissions provenant du déboisement et de la
dégradation des forêts REDD+ | Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture. Consulté 8 avril 2023, à
l'adresse
https://www.fao.org/redd/areas-of-work/governance-and-tenure/fr/
FAO. (2021). Évaluation des ressources
forestières mondiales 2020 - Principaux résultats. Rome.
https://doi.org/10.4060/ca8753fr
FAO (2020). Nouvelles: Lancement de l'analyse la plus
complète des ressources forestières sous une forme
novatrice.
https://www.fao.org/news/story/fr/item/1298922/icode/
FAO. (2020). La situation des forêts du monde 2020 :
Forêts, biodiversité et activités humaine. FAO and
UNEP.
https://doi.org/10.4060/ca8642fr
FAO. (2016). Situation des forêts du monde 2016.
Forêts et agriculture : défis et possibilités concernant
l'utilisation des terres. Rome.
https://www.fao.org/3/i5588f/i5588f.pdf
FAO (2006). Évaluation des ressources
forestières mondiales 2005. Progrès vers la gestion
forestière durable.
https://www.fao.org/3/a0400f/a0400f.pdf
FAO. (2003). Expériences de la mise en oeuvre des
programmes forestiers nationaux au Sénégal. Sustainable
Forest Management Programme in African ACP Countries, FAO, 52p.
https://www.fao.org/3/AC919F/AC919F00.htm
FAO, PNUD, PNUE, UNITAR (2015). « Moteurs de
déforestation et de dégradation des forêts »,
Académie REDD+. Réduction des émissions causées
par la déforestation et la dégradation des forêts,
Chapitre 3. Journal d'apprentissage Edition 1 - automne 2015.
https://www.un-redd.org/sites/default/files/2021-10/112415
module3 FR.pdf
81
Favrot, J.-M. (2020). Démographie, l'impasse
évolutive : Des clefs pour de nouvelles relations Homme - Nature.
BoD - Books on Demand.
https://books.google.fr/books?id=k-yleaaaqbaj
Faye, C., Ndiaye, A., & Mbaye, I. (2017). Une
évaluation comparative des séquences de sècheresse
météorologique par indices, par échelles de temps et par
domaines climatiques au Sénégal. Journal of Water and
Environmental Sciences, 1(1), Article 1.
https://revues.imist.ma/index.php/jwes/article/download/6764/6538
Férard, E. (2021). Les forêts mondiales
absorbent-elles ou émettent-elles du CO2 ? Une étude fait le
point. Geo.fr.
https://www.geo.fr/environnement/les-forets-mondiales-absorbent-elles-ou-emettent-elles-du-co2-une-etude-fait-le-point-203680
Fleshman, M. (2008). Les forêts de l'Afrique, `poumons
du monde'. Afrique Renouveau.
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/january-2008/les-for%C3%AAts-de-l%E2%80%99afrique-%E2%80%98poumons-du-monde%E2%80%99
François Verdeaux (1999). La forêt-monde en question
: recomposition du rapport des sociétés à la forêt
dans les pays du Sud. Cahier des sciences humaine, Nouvelle série
n°9.
https://core.ac.uk/download/pdf/39848807.pdf
Gaye (2018). CASAMANCE - Tuerie dans la forêt de
Bofa-Bayotte : La Cddc accable les «parrains» du trafic du bois.
Lequotidien - Journal d'information Générale.
https://lequotidien.sn/casamance-tuerie-dans-la-foret-de-bofa-bayotte-la-cddc-accable-les-parrains-du-trafic-du-bois/
Géoconfluences ENS de Lyon/DGESCO. Forêt
(ISSN: 2492-7775). Consulté en mars 2023, à l'adresse
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/foret
GIEC (2019). Rapport spécial sur le changement
climatique, la désertification, la dégradation des sols, la
gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux
de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres.
Changement climatique et terres.
https://climat.be/changements-climatiques/changements-observes/rapports-du-giec/2019-rapport-special-sur-l-utilisation-des-sols
GIEC. (2019). La gestion durable des forêts, un levier
essentiel pour lutter contre le changement climatique. Office national des
forêts.
https://www.onf.fr/vivre-la-foret/+/480::rapport-du-giec-quel-role-de-la-foret-face-au-rechauffement-climatique.html
82
GIEC (2019). Le changement climatique, la
désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des
terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet
de serre dans les écosystèmes terrestres. Rapport
spécial sur le changement climatique et l'utilisation des terres,
août 2019.
https://climat.be/changements-climatiques/changements-observes/rapports-du-giec/2019-rapport-special-sur-l-utilisation-des-sols
Global Forest Watch Content (2021) Quantifying Carbon Fluxes
in Forests | Global Forest Watch Blog.
https://www.wri.org/blog/2021/01/forests-absorb-twice-much-carbon-they-emit-each-year
Global Forest Watch (2020). Déforestation : Les
forêts primaires parmi les plus menacées.
Actu-environnement.
https://www.actu-environnement.com/ae/news/deforestation-forets-primaires-menacees-rapport-global-forest-watch-FAO-35584.php4
Global Forest Watch Content (2019). L'année
dernière, le monde a perdu une superficie de forêt tropicale
primaire de la taille de la Belgique. Global Forest Watch Blog.
https://www.globalforestwatch.org/blog/fr/data-and-research/lannee-derniere-le-monde-a-perdu-une-superficie-de-foret-tropicale-primaire-de-la-taille-de-la-belgique
Grantham, H. S., Duncan, A., Evans, T. D., Jones, K. R., Beyer,
H. L., Schuster, R., Walston, J., Ray, J. C., Robinson, J. G., Callow, M.,
Clements, T., Costa, H. M., DeGemmis, A., Elsen, P. R., Ervin, J., Franco, P.,
Goldman, E., Goetz, S., Hansen, A., ... Watson, J. E. M. (2020).
Anthropogenic modification of forests means only 40% of remaining forests
have high ecosystem integrity. Nature Communications, 11(1), Article 1.
https://doi.org/10.1038/s41467-020-19493-3
Gyuse, T. (2022). Mesure forte pour mettre un terme au trafic
de bois de rose en Afrique de l'Ouest. Nouvelles de l'environnement.
https://fr.mongabay.com/2022/05/mesure-forte-pour-mettre-un-terme-au-trafic-de-bois-de-rose-en-afrique-de-louest/
Harris, N. L., Gibbs, D. A., Baccini, A., Birdsey, R. A., de
Bruin, S., Farina, M., Fatoyinbo, L., Hansen, M. C., Herold, M., Houghton, R.
A., Potapov, P. V., Suarez, D. R., Roman-Cuesta, R. M., Saatchi, S. S., Slay,
C. M., Turubanova, S. A., & Tyukavina, A. (2021). Global maps of
twenty-first century forest carbon fluxes. Nature Climate Change, 11(3),
Article 3.
https://www.nature.com/articles/s41558-020-00976-6
83
Hasan, A. F. (2019). Évaluation de la
dégradation des forêts primaires par
télédétection dans un espace de front pionnier
consolidé d'Amazonie orientale (Paragominas). Thèse de
doctorat en Géographie physique, Le Mans
Université, 243p.
https://agritrop.cirad.fr/595739/
Hoogeveen, H. (2007). Forêts et changement climatique:
D'un problème complexe à une solution intégrée.
Chronique ONU.
https://www.un.org/fr/chronicle/article/forets-et-changement-climatique-dun-probleme-complexe-une-solution-integree
IPAR. (2015). Améliorer la gouvernance
forestière au Sénégal : Enjeux actuels et perspectives.
Policy brief n°4, 4p. IPAR, initiative prospective agricole et
rurale.
https://www.ipar.sn/Policy-Brief-No4-2015-Ameliorer-la-gouvernance-forestiere-au-Senegal-enjeux.html
ISS Africa (2019). La destruction silencieuse des
dernières forêts du Sénégal. ISS Africa.
https://issafrica.org/fr/iss-today/la-destruction-silencieuse-des-dernieres-forets-du-senegal
Jacque, M. (2022). A la COP27, Lula promet de stopper la
déforestation en Amazonie. Les Echos.
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/a-la-cop27-lula-promet-de-stopper-la-deforestation-en-amazonie-1879646
Lanly, J.-P. (2003). Les facteurs de déforestation et
de dégradation des forêts. FAO, Communication au XIIe
Congrès forestier mondial, Québec.
https://www.fao.org/3/xii/ms12a-f.htm#P10
97
Le Guen, J. (2010). « Protection des forêts
tropicales et de leur biodiversité contre la dégradation et la
déforestation ». Rapport de mission, 104p.
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000542.pdf
Lô, HM., et Sow, S. 2017. Contributions
déterminées au niveau national (CDN) : volet adaptation. Secteur
de l'agriculture. MEDD-DEEC, 51p.
Markus, F. (2021). Une étude menée par la FAO
conclut que la Grande muraille verte d'Afrique donne un rendement de
l'investissement viable. Newsroom.
https://www.fao.org/newsroom/detail/africa-s-great-green-wall-gives-viable-return-on-investments-fao-led-study-161121/fr
Mayer, N. (2021). Chaque seconde, l'équivalent d'un
terrain de foot de forêt tropicale humide disparaît.
Futura.
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/foret-chaque-seconde-equivalent-terrain-foot-foret-tropicale-humide-disparait-75880/
84
Mayer, P. (2020). Lancement de l'analyse la plus
complète des ressources forestières sous une forme
novatrice. FAO Nouvelles.
https://www.fao.org/news/story/fr/item/1298922/icode/
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la
Nature (2010). Quatrième rapport national sur la mise en oeuvre de la
convention sur la diversité biologique, 132p.
https://www.cbd.int/doc/world/sn/sn-nr-04-fr.pdf
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la
Nature (2004). Lettre de politique du secteur de l'environnement et des
ressources naturelles, 21p.
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la
Nature (1999). Rapport national sur la mise en oeuvre de la convention des
Nations unies sur la lutte contre la désertification. Troisième
conférence des parties de Recife (Brésil), 34p.
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la
Nature, des Bassins de Rétention et des Lacs Artificiels (2009). Lettre
de politique du secteur de l'environnement et des ressources naturelles,
16p.
Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté
alimentaire. La gestion durable des forêts. Consulté 11
juin 2023, à l'adresse
https://agriculture.gouv.fr/la-gestion-durable-des-forets
Ministère de l'Environnement et du Développement
Durable (2017). Rapport annuel de performance (RAP) 2017 du MEDD, 89p.
https://chm.cbd.int/api/v2013/documents/1B1ECE54-E678-582A-3206-64226B5FF510/attachments/212118/Rapport%20annuel%20medd%202017.pdf
Ministère de l'environnement et du développement
durable (2016). Lettre de politique du secteur de l'environnement et du
développement durable 2016/2020. MEDD, Rapport,20p.
https://www.environnement.gouv.sn/documentations/lettre-de-politique-du-secteur-de-lenvironnement-et-du-d%C3%A9veloppement-durable-20162020
Ministère de l'Environnement et du Développement
Durable (2015). Stratégie nationale et Plan national d'actions pour la
biodiversité. Rapport final, 89p.
https://faolex.fao.org/docs/pdf/sen166823.pdf
Mongabay. (2009). Les forêts tropicales.
https://global.mongabay.com/fr/rainforests/
Naturefrance. (2022). Les conséquences des
activités économiques. Quelles activités
génèrent le plus de pression et quelles en sont les
conséquences sur l'environnement ? Article,
Pressions et menaces.
http://naturefrance.fr/les-consequences-des-activites-economiques
85
Ndao. (2021). Les forêts au Sénégal : Une
espèce en voie de disparition avancée. Greenpeace Africa.
Consulté 23 août 2023, à l'adresse
https://www.greenpeace.org/africa/fr/les-blogs/14276/les-forets-au-senegal-une-espece-en-voie-de-disparition-avancee/
Oceanium de Dakar. (2021). « Restaurer notre
environnement pour que nos populations en vivent ». Burkina Doc.
https://www.burkinadoc.milecole.org/agroecologie-afrique/agroecologie-senegal/article-oceanium-de-dakar/
Océanium de Dakar. (2016). Un drone filme le pillage
par la Chine des dernières forêts du
Sénégal--YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=ee0yLBh
NRE
Ollivier. (2022). Au Sénégal, les habitants du
sud du pays préservent la mangrove,
écosystème indispensable à leur
agriculture. Franceinfo.
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/au-senegal-les-habitants-du-sud-du-pays-preservent-la-mangrove-ecosysteme-indispensable-a-leur-agriculture
4964889.html
Omotundo, P. (2011). La Casamance, grenier du
Sénégal. Afrique 7, l'info du continent en continu.
https://www.afrique7.com/economie/404-la-casamance-grenier-du-senegal.html
ONU Info. (2020). La FAO présente l'analyse la plus
complète des ressources forestières sous une forme
novatrice.
https://news.un.org/fr/story/2020/07/1073501
Pépin, S. (2012). La déforestation: Un
problème pris au sérieux par les Africains. Perspective
Monde.
https://perspective.usherbrooke.ca//bilan/servlet/BMAnalyse/1362
Philip G. Curtis et al., (2018). Classification des moteurs de la
perte mondiale des forêts. Article revue Science. Vol. 361,
n°6407.
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aau3445
RdS. (2018). Code forestier | Gouvernement du
Sénégal.
https://www.sec.gouv.sn/publications/lois-et-reglements/code-forestier
RdS, 2015. La Stratégie Nationale et Plan National
d'Actions pour la Biodiversité. MEDD, 89p. RdS, 2014. Plan
Sénégal Emergent, 103p.
RdS, 2005. Politique Forestière du Sénégal
2005-2025. Document principal. MEPN, 156p. RdS, 2004. Loi d'orientation
agro-sylvo-pastorale, 26p.
RdS, 1998. Programme d'Action National de Lutte Contre la
Désertification. MEPN, 152p. RdS, 1997. Plan National d'Action pour
l'Environnement. MEPN, CONSERE, 123p.
86
RdS, 1993. Plan d'Action Forestier du Sénégal.
Volume II, Document principal, MDRH, 147p.
Retiere, A. (2015). République du
Sénégal - land degradation neutrality rapport national.
https://policycommons.net/artifacts/3135696/republique-du-senegal/3928929/
RFI. (2022). Le trafic de bois de rose au coeur des tensions
à la frontière entre la Gambie et la Casamance. Article
RFI.
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220130-le-trafic-de-bois-de-rose-au-c%C5%93ur-des-tensions-%C3%A0-la-fronti%C3%A8re-entre-la-gambie-et-la-casamance
Ribot, J. (1995). Historique de la gestion forestière
en Afrique de l'Ouest. Ou : Comment la
« science » exclut les paysans. International
Institute for Environment and Development, 17p.
https://www.iied.org/fr/9071iied
Sambou, B. (2004). Evaluation de l'état, de la
dynamique et des tendances évolutives de la flore et de la
végétation ligneuses dans les domaines soudanien et
sub-guinéen au Sénégal. Thèse de doctorat
d'Etat, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 210p.
http://bibnum.ucad.sn/viewer.php?c=ths&d=THS-7031
Sané, T. (2019). Vulnérabilité et
adaptabilité des systèmes agraires à la variabilité
climatique et aux changements sociaux en Basse-Casamance (Sud-Ouest du
Sénégal). Thèse de doctorat de géographie et
environnement, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 377p.
https://theses.hal.science/tel-02073093/file/Sane
Tidiane 2 va 20170925.pdf
Sané, C. (2016). Un drone filme le pillage du bois de
la Casamance par des
Chinois.
Seneweb.com.
https://www.seneweb.com/news/Video/un-drone-filme-le-pillage-du-bois-de-la-
n 183358.html
Sané, T. et Mbaye, I. (2007). Etat des lieux et
étude diagnostique de l'environnement de la Casamance. Annales de
la Faculté des Lettre et Sciences Humaines, n°37/B - 2007, 19p.
http://bibnum.ucad.sn/viewer.php?c=articles&d=sane%5ftidiane
Sen Environnement (2020). Exploitation illégale du
bois au Sénégal--Un véritable massacre en
Casamance.
https://senenvironnement.com/exploitation-illegale-du-bois-au-senegal-un-veritable-massacre-en-casamance/
Sene, A. (2014). Implication des acteurs non étatiques
dans la gouvernance des ressources naturelles au Sénégal : Cas
des ressources forestières à Ziguinchor et halieutiques à
Mbour.
87
Dans KOBOR, D. (Ed). Energies renouvelables et
développement durable. Revue ScienceLib, Toulouse, Editions Mersenne,
pp.109-130. ScienceLib - Editions Mersenne, 109-130.
https://www.researchgate.net/profile/Abdourahmane-Sene/publication/281439840_Gouvernance_des_ressources_naturelles_au_Senegal_Quelle_i
mplication_des_acteurs_non_etatiques/links/55e6f81908aeb65162627310/Gouvernance-des-ressources-naturelles-au-Senegal-Quelle-implication-des-acteurs-non-etatiques.pdf
Solly, B., Dieye, E. H. B., Sy, O., Jarju, A. M., & Tidiane,
S. (2021). Détection des zones de dégradation et de
régénération de la couverture végétale dans
le sud du Sénégal à travers l'analyse des tendances de
séries temporelles MODIS NDVI et des changements d'occupation des sols
à partir d'images LANDSAT. Revue Française de
Photogrammétrie et de Télédétection,
223(1), Article 1.
https://doi.org/10.52638/rfpt.2021.580
https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/download/580/318
Solly, B., Dièye, E., Oumar, S., & Barry, B. (2018).
Suivi de la déforestation par télédétection
Haute résolution dans le département de Médina Yoro Foulah
(Haute-Casamance, Sénégal). III, 38-41.
https://www.researchgate.net/profile/Boubacar-
Solly/publication/330524513 Suivi de la deforestation par
teledetection Haute resolution
_dans_le_departement_de_Medina_Yoro_Foulah_Haute-Casamance_Senegal/links/5c4ef8e7a6fdccd6b5cf3430/Suivi-de-la-deforestation-par-teledetection-Haute-resolution-dans-le-departement-de-Medina-Yoro-Foulah-Haute-Casamance-Senegal.pdf
Sremski. (2022). La forêt: Un outil de
régulation du climat. Green Hired.
https://greenhired.fr/la-foret-un-outil-de-regulation-du-climat/
Tall, S.M. et Gueye, M.B., 2003. Les conventions locales : un
outil de co-gouvernance en gestion des ressources naturelles, IIED, Dakar,
série Convention Locale n°1, 24p.
https://energypedia.info/images/a/a3/Peracod-conventions
locales.pdf
Tappan, G. G., Sall, M., Wood, E. C., & Cushing, M. (2004).
Ecoregions and land cover trends in Senegal. Journal of Arid
Environments, 59(3), 427-462.
https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2004.03.018
Taylor, C. M., Klein, C., Parker, D. J., Gerard, F., Semeena, V.
S., Barton, E. J., & Harris, B. L. (2022). «Late-stage»
deforestation enhances storm trends in coastal West Africa.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(2),
e2109285119.
https://doi.org/10.1073/pnas.2109285119
Tchiako, M. (2015). Gouvernance forestière en Afrique
Centrale: Quelles avancées ? L'actu des Ressources Naturelles en
Afrique.
https://mireilletchiako.wordpress.com/2015/06/27/gouvernance-forestiere-en-afrique-centrale-quelles-avancees/
Touré, E., (2011). « Les conventions locales pour
la gestion des ressources naturelles au Sénégal : Entre
automatisation et problème d'appropriation », VertigO - la
revue électronique en sciences de l'environnement, Vol. 11 Numéro
1, mai 2011.
https://journals.openedition.org/vertigo/10863
Tsayem Demaze, M. (2010). Éviter ou réduire la
déforestation pour atténuer le changement climatique : Le pari de
la REDD. Annales de géographie, 674(4), 338-358.
https://doi.org/10.3917/ag.674.0338
UICN (1992). Conservation et utilisation durable des
ressources naturelles du bassin hydrographique de la Casamance. Annales du
séminaire tenu du 22 au 26 octobre 1990 à Ziguinchor,
Sénégal, 180p.
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/1992-057.pdf
Valade, A., & Bellassen, V. (2020). Réchauffement
du climat: Est-ce que la forêt française peut apporter des
solutions d'ici 2050 ? Sciences Eaux & Territoires, Numéro
33(3), 70-77.
https://doi.org/10.3917/set.033.0070
WWF France. (2012). Comprendre l'impact de la forêt sur
le climat | WWF France. Communiqué de presse.
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/comprendre-limpact-de-la-foret-sur-le-climat
88
89
TABLE DES MATIERES
Sigles et abréviations 6
INTRODUCTION 9
CHAPITRE 1 : CONTEXTE, PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE
14
I. CONTEXTE DE L'ETUDE 14
II. PROBLEMATIQUE 18
III. OBJECTIF GENERAL DE L'ETUDE 28
IV. METHODOLOGIE 28
1. Revue bibliographique 28
2. Recueil des données 29
3. Outils de collecte de données 30
4. Traitement et analyse des données, et
rédaction du document 30
CHAPITRE 2 : PRESENTATION DE LA ZONE CONCERNEE PAR
L'ETUDE 31
I. Présentation du Sénégal et de la
région de Casamance 31
1. Brève présentation du
Sénégal 31
1.1. Données physiques 31
1.2. Données climatologiques 31
1.3. Données hydrographiques 31
1.4. Données démographiques 32
1.5. Caractéristiques socio-démographiques
32
2. Présentation de la région de Casamance
32
II. Les ressources végétales au
Sénégal et les forêts casamançaises 36
90
CHAPITRE 3 : GESTION ET GOUVERNANCE DES RESSOURCES
FORESTIERES AU
SENEGAL 39
I. Cadres politique, juridique et institutionnel de la
gestion des ressources forestières 39
1. Cadre politique de la gestion des ressources
forestières 39
1.1. Le Plan Directeur de Développement Forestier
(PDDF) 41
1.2. Plan d'Action Forestier du Sénégal
(PAFS) 41
1.3. Plan National d'Action pour l'environnement (PNAE)
42
1.4. Programme d'Action Nationale de Lutte contre la
Désertification (PAN/LCD) 42
1.5. Lettre de Politique Sectorielle de l'Environnement
(LPSE) 43
1.6. La Stratégie Nationale et Plan Nationale
d'Actions pour la Conservation de la
Biodiversité (SPNAB) 44
1.7. Loi d'Orientation Agro-sylvo-pastorale (LOASP)
45
1.8. Politique Forestière du
Sénégal 2005-2025 (PFS) 46
1.9. Plan Sénégal Emergent (PSE)
47
2. Cadre juridique régissant la gestion des
ressources forestières 48
3. Cadre institutionnel de la gestion des ressources
forestières 51
3.1. L'administration centrale 51
3.2. L'administration déconcentrée
55
3.3. Le niveau décentralisé 56
3.3.1. Les collectivités territoriales
56
3.3.2. Les agences de développement 57
II. Evolutions de la gouvernance des ressources
forestières au Sénégal 58
1.
91
Approches et bref historique de la gouvernance
forestière 58
2. Différents acteurs de la gouvernance
forestière 61
2.1. Les acteurs étatiques de la gouvernance
forestière 62
2.1.1. Les niveaux central et déconcentré
62
2.1.2. Le niveau décentralisé
63
2.2. Les acteurs non étatiques de la gouvernance
forestière 64
III. Outils de gouvernance forestière
66
1. Les conventions locales 66
2. Les conventions locales et la gestion des ressources
naturelles 67
CHAPITRE 4 : ANALYSE ET DISCUSSION 69
I. Analyse des pressions exercées sur les
forêts en Casamance 69
1. Identification des différentes pressions sur
les forêts casamançaises 69
2. Les causes et les conséquences de la
déforestation et de la dégradation des forêts
en
région casamançaise 70
2.1. Les principales causes de la dégradation et
de la déforestation en Casamance 70
2.2. Les conséquences de la dégradation et
de la déforestation en Casamance 71
II. Analyse de la stratégie de gestion
forestière mise en oeuvre 72
III. Recommandations en faveur de l'amélioration de
la stratégie pour une gestion durable
des forêts en Casamance 73
CONCLUSION 75
BIBLIOGRAPHIE 76
TABLE DES MATIERES 89
| 


