|
|
|
|
UNIVERSITE DE N'DJAMENA
**********
FACULTE DES SCIENCES EXACTES ET APPLIQUEES
**********
DEPARTEMENT DE
GEOLOGIE
*********
MASTER HYDROSIG
|
REPUBLIQUE DU TCHAD
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'EAU ET DE LA PECHE
PROJET ResEau
MEMOIRE DE FIN D'ETUDES EN VUE DE L'OBTENTION DU
DIPLOME DE MASTER EN HYDROGEOLOGIE ET SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE
(MASTER HYDROSIG).

THEME : `'CONTRIBUTION A L'ETUDE DE
LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET BACTERIOLOGIQUE DES POINTS D'EAU DANS LA VILLE
DE N'DJAMENA».
Présenté et Soutenu publiquement le 06
avril 2019
Par : AMANN HISSEINE ABDOUL
Ingénieur des travaux en
Hydrogéologie / N° Mle
017401168814954311018
Sous la Direction de :
Dr. BRAHIM TAHA DAHAB,
enseignant à l'Université de N'Djamena.
Et sous la
supervision de :
Dr MOUSSA ABDERAMANE, Maitre Assistant
CAMES, enseignant à l'Université de
N'Djamena
|
Jury d'évaluation :
Président : Dr Hamdane Annadif,
enseignant à l'Université de N'Djamena,
Rapporteur : Dr Adjeffa Epolyste, enseignant
à l'Université de N'Djamena, Rapporteur : Dr Moussa
Isseini, Maitre Assistant CAMES, Université de N'Djamena
|

ANNEE ACADEMIQUE 2017-2018
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page ii
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
DEDICACES
Je dédie ce mémoire à :
? A mon défunt père Boukar Abdoul. Papa tu
nous as inculqué l»honnêteté, le respect d'autrui, la
dignité et la rigueur dans le travail.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page iii
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
REMERCIEMENTS
Arrivé au terme de ce travail, il m'est agréable
d'exprimer toute ma gratitude et mes remerciements à tous ceux qui, par
leur enseignement, leur conseil et leur encouragement m'ont aidé
à sa réalisation.
Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance au Dr
BRAHIM TAHA DAHAB, qui malgré ses multiples occupations a accepté
d'encadrer ce travail d'initiation à la recherche ; ses encouragements
et ses conseils étaient pour moi une source de motivation.
Au Dr MOUSSA ABDERAMANE, mon co-encadreur qui m'a toujours
soutenu, encouragé. Sa rigueur scientifique m'a été d'une
aide précieuse. Merci du fond du coeur.
À tout le corps enseignant et personnel de
l'université de N'djamena et en particulier, à tous les
enseignants du Master HydroSIG pour tous les cours dispensés. Il s'agit
du Dr. MOUSSA ISSEINI, Dr. ABDERMANE HAMIT, Dr. KADJANGABA Edith, Dr. Job
ANDIGUE, Dr. MOUPENG BEDJAOUE, Dr. MASSING OURSINGBE, Dr. OUYA BONDORO Henry,
Dr. AHMED DORSOUMA, Mme DENENODJI Antoinette, M. Joseph LIBAR, M. LOUCKMANE
BICHARA, M. RIRABE Dieudonné, Dr. HAMZA BRAHIM, Dr EPOLYSTE ADJEFFA, M.
ABDELHAKIM MOUSTAPHA, M. WAROU, M. WALBADET Ezéchiel, et M. MAHAMAT NOUR
Abdallah.
A tout le personnel du laboratoire national des eaux à
N'Djamena pour leur accueil et leur courtoisie pendant mon stage, je pense
particulièrement à AKOINA MOURSAL pour sa disponibilité,
et ses encouragements sans cesse renouvelés à mon égard.
J'exprime ma profonde reconnaissance à mes aînés d'
HydroSIG en occurrence M. GUINBE AMNGAR, qui m'a guidé, orienté
et aidé lors de la collecte des données.
Au Projet ResEAu et ses partenaires techniques et financiers
qui ont mis en oeuvre le Master HydroSIG.
J'exprime enfin ma profonde reconnaissance à tous mes
amis et collègues avec lesquels nous avions passé des temps fous
à répéter, étudier. Il s'agit de : M. NOUBADOUM
OSEE, M. ABDEL-AZIZ ADOUDOU.
Je tiens également à exprimer toute ma
reconnaissance à tous ceux et celles qui ont contribué à
la réalisation de ce travail et dont le nom ne figure pas dans cette
liste.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page iv
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION : 1
I. PROBLEMATIQUE : 1
II.OBJECTIFS : 3
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE ET SES
CARACTERISTIQUES 5
Chapitre I- CADRE GEOGRAPHIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE 5
I- APERÇU GEOGRAPHIQUE 5
I.1.1. Situation de la République du Tchad 5
I.1.2. Localisation de la zone d'étude 5
I.2- facteurs climatiques 6
1.2.1. Le climat 6
1.2.2. Indice d'aridité 7
I.3.- pluviométrie 8
I.3.1.- données pluviométriques 8
I.3.2- température 9
I.3.3- température moyenne mensuelle 9
I.3.4-humidité 10
I.4 - évaporation 10
1.5- l'insolation 12
I.6- l-hydrographie 12
I.6.1- le Chari 13
I.6.2- le logone 14
I.7- la géomorphologie 14
I.8- le sol 14
I.9- la végétation 15
I.10- contexte socio-économique 16
1.10.1. La situation socio-économique de la ville de
N'djamena 16
Les secteurs privés et publics 16
I.11- la population/demographie 17
I.12- organisation administrative et sociale 17
Administration 17
Chapitre II- CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 19
II.1. Le pliocène et le quaternaire 19
II.1.1. Pliocène 19
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page v
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
II.1.2. Quaternaire 20
A. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 21
II.2. Les principales nappes phréatiques de
N'Djamena 22
II.3. Paramètres hydrodynamiques (Q, Q/S, K,
T, S) 24
II.4. Qualité des eaux de nappe 24
B. PRESENTATION DU LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX
24
II.5. Les textes législatifs et réglementaires
25
DEUXIEME PARTIE : MATERIELS ET METHODES 25
Chapitre III. MATERIELS ET METHODES 26
CADRE DE L'ETUDE 26
METHODOLOGIE 26
III.1. MATERIELS ET METHODES 27
III.1.1. Etudes de terrain 27
III.1.2. Mesures des niveaux statiques 29
III.1.3.Echantillonnage de l'eau 30
III.1.4 études de laboratoire 32
III.1.5 réalisation des différentes coupes
lithologiques 32
III.1.6 Calcul du niveau piézométrique 33
III.1.7 Calcul du gradient hydraulique 34
III.1.8 Matériels et dispositifs pour l'analyse
bactériologique 35
III.1.9 Méthode d'analyse, procédure et modes
opératoires 36
Les paramètres à analyser et méthodes
d'analyse 36
III.1.10 Analyse des paramètres
bactériologiques 38
Analyse et traitement des données 41
Limite de l'étude 41
III.2 RESULTATS: 42
III.2.2. Relation entre la lithologie et la contamination
bactériologique des points d'eau 48
III.2.3. levé des niveaux statique et
piézométrique 49
III.2.4 piézométrie de la nappe de
N'Djamena 49
III.3.RESULTATS DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES 51
III.3.1. Les paramètres physico-chimiques: 51
La température de l'eau 51
Le pH 51
Les solides totaux dissous 52
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page vi
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
La turbidité 52
La dureté totale (CaCO3) 53
Les sulfates 53
Bicarbonates : 54
Le calcium : 55
Chlorures : 55
Magnésium 56
Sodium 57
Potassium 58
Nitrates 59
Manganèse total: 61
Ammonium : 61
III.3.2. Les ions majeurs des eaux souterraines
62
III.3.2.1.Les cations 62
III.3.2.2. Les anions 62
Balance ionique des eaux souterraines 62
III.3.3. Faciès chimiques des eaux obtenus
à partir du diagramme de Piper : 64
III.3.4 Indice d'échange de base (IEB)
64
III.3.5 Faciès chimiques des eaux selon le
diagramme de Schoeller-Berkaloff : 65
III.3.6 Qualité des eaux de la nappe
66
III.3.7 Corrélation des éléments
chimiques 68
III.4.résultats des paramètres
bactériologiques. 69
III.4.1. impact socio-sanitaire de la consommation de
l'eau sur la santé de la population 75
Chapitre V- INTERPRETATION ET DISCUSSION
77
V.1.Paramètres hydrodynamiques 77
V.2.Corrélation des coupes
litho-stratigraphiques 77
V.3.Piézométrie 78
V.4.Qualité des eaux souterraines
79
V.4.1.Paramètres physico-chimiques
79
? La température : 79
? Le pH : 79
? La conductivité électrique :
79
V.4.2. les éléments chimiques
80
V.4.2.1.Les cations 80
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page vii
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
V.4.2.2.les anions 81
V.4.3.Indice d'échange de base (IEB)
83
V.4.4. rapports caractéristiques entre les
éléments majeurs 83
V.5.Qualité bactériologique des eaux
souterraines 85
CONCLUSION GENERALE 88
RECOMMANDATIONS 88
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 90
ANNEXES 93
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page viii
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
LISTE DES FIGURES
Figure 1:localisation de la zone d'étude 6
Figure 2: Histogramme des précipitations moyennes
mensuelles de 1984 à 2015 à la station de
N'Djamena - aéroport (source: DGMN/ mai 2015). 8
Figure
3:Histogramme des précipitations moyennes annuelles de 1984 à
2015 à la station de
N'Djamena- aéroport (source: DGMN/ Mai 2015). 8
Figure
4:Courbes de températures moyennes mensuelles de 1984 à 2015
à la station de N'Djamena-
aéroport (source: DGMN). 9
Figure 5: Humidité
moyenne mensuelle de 1984 à 2015 à la station de N'Djamena
aéroport (source:
DGMN) 10
Figure 6: Evaporation moyenne mensuelle de 1984
à 2015 à la station de N'Djamena-aéroport (source
DGMN). 11
Figure 7: Evaporation moyenne annuelle
cumulée des trente dernières années à la station
de
N'Djamena- aéroport (source: DGMN) 11
Figure 8: Courbe
de l'insolation moyenne mensuelle de 1984 à 2015 à la station de
N'Djamena-
aéroport (source: DGMN). 12
Figure 9 : hydrographie de la zone d'étude. 13
Figure 10: les arrondissements de N'Djamena. 18
Figure 11: matériels utilisés sur le terrain. 28
Figure 12: sites des mesures des niveaux statiques. 29
Figure 13: méthodes d'acquisition des données de
terrain. 30
Figure 14: localisation des points d'eau (forages)
étudiés. 32
Figure 15:carte de la répartition des sites des logs de la
ville de N'Djamena. 33
Figure 16: vue de quelques matériels et dispositifs
utilisés au laboratoire 35
Figure 17: opérations de prélèvements
d'échantillons sur le terrain et d'analyses au laboratoire. 40
Figure 18: coupe lithologique Farcha-Kartota. 44
Figure 19: coupe lithologique Milezi- Guinebor2. 45
Figure 20: coupe lithologique Diguel Est- Toukra. 45
Figure 21: coupe lithologique Boutalbagar- Bakara 46
Figure 22: coupe lithologique Dingagali- Boutalbagar. 47
Figure 23: coupe lithologique Moursal- Boutalbagar. 48
Figure 24:carte piézométrique de la ville de
N'Djamena obtenue par Arc Gis10. 50
Figure 25: carte piézométrique de la ville de
N'Djamena obtenue à partir de surfer 8. 50
Figure 26:carte de la répartition de la
conductivité des eaux souterraines à N'Djamena 52
Figure 27:carte de la répartition des duretés des
eaux souterraines dans la ville de N'Djamena. 53
Figure 28:carte de la répartition des sulfates des eaux
souterraines dans la zone d'étude. 54
Figure 29:carte de la répartition des bicarbonates des
eaux dans la ville de N'Djamena. 54
Figure 30: carte de la répartition du calcium des eaux
souterraines dans la ville de N'Djamena. 55
Figure 31: carte de la répartition des chlorures des eaux
souterraines de la ville de N'Djamena. 56
Figure 32: carte de la répartition du magnésium des
eaux souterraines dans la ville de N'Djamena. 57
Figure 33: carte de la répartition du sodium dans la ville
de N'Djamena. 58
Figure 34: carte de la répartition du potassium dans la
ville de N'Djamena. 59
Figure 35: carte de la répartition des nitrates dans les
eaux de la ville de N'Djamena. 60
Figure 36: carte de la répartition du fer à
N'Djamena. 60
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page ix
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Figure 37: carte de la répartition d'ammonium à
N'Djamena. 61
Figure 38: faciès chimiques des eaux de la ville de
N'Djamena 64
Figure 39: diagramme de Schoeller Berkaloff des eaux
souterraines de N'Djamena. 66
Figure 42: diagramme des entérocoques de 70
Figure 40: diagramme des Coliformes fécaux 70
Figure 41: diagramme des Coliformes totaux analysés
pendant l'hivernage. 70
Figure 43: carte des sites contaminés (points
rouges) par les germes totaux et fécaux 71
Figure 44: diagramme des E.Coli analysés
pendant 72
Figure 45: diagramme des Coliformes totaux analysés
pendant la 72
Figure 46: images illustrant parfaitement un environnant
malsain, facteur de contamination des
nappes. 76
Figure 47: coupe schématique montrant la
géométrie de la nappe d'eau souterraine de N'Djamena. 78
Figure 48: évolution des teneurs du bicarbonate en
fonction de la conductivité électrique. 80
Figure 49: évolution des teneurs du nitrate en fonction
du calcium. 82
Figure 50: rapports caractéristiques entre les
différents éléments majeurs. 85
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page x
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1:évolution de la population de N'Djamena. 17
Tableau 2 : les différents quartiers de la ville de
N'Djamena 18
Tableau 3: paramètres hydrodynamiques moyens de la nappe
de N'Djamena. 24
Tableau 4: résultats des paramètres hydrodynamiques
de quelques points d'eau de la ville de
N'Djamena. (Source : H2O-Consultants 2018).
42
Tableau 5: valeurs de la porosité efficace moyenne pour les
principaux réservoirs (CASTANY, G.
1982). 42
Tableau 6: vérification des erreurs des résultats
des analyses de l'eau souterraine. 63
Tableau 7: variation d'échange d'ions dans les eaux
souterraines. 65
Tableau 8: grille simplifiée pour l'évaluation de
la qualité globale des eaux souterraines. 67
Tableau 9: qualité globale des eaux souterraines de la
ville de N'Djamena. 67
Tableau 10: matrice de corrélation des
éléments chimiques des eaux de N'Djamena. 69
Tableau 11: résultats des analyses bactériologiques
des forages de la zone d'étude/ campagne 1 : du 13
au 19 septembre 2017. 73
Tableau 12: résultats des
analyses bactériologiques des forages de la zone d'étude/
campagne 2 : du 28
au 30 mars 2018. 73
Tableau 13: résultats des analyses
bactériologiques des forages de la zone d'étude/ campagne 3 :
mai-
juillet 2018. 74
Tableau 14: fréquence des maladies
liées à l'eau de consommation dans quelques centres de
santé de
N'Djamena. 75
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page xi
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
LISTE DES ABREVIATIONS
BP : Before Present (avant 1950, année de
référence)
BGR : Bundesanstalt Fur Geowissenschaften Und
Rohstoffe (Institut Fédéral des
Géosciences et de Ressources Naturelles.
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques
et Minières
CBLT : Commission du Bassin du Lac Tchad.
CPIG : Comité de Pilotage D'information
Géographique
DC : Division Climatologique
DGMN : Direction Générale De La
Météorologie Nationale
E : Est
EDTA : Acide Ethylène Diamine
Tétra Acétique
FAO : Food and Agriculture Organization of the
United Nations (Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.
Fig : Figure.
FIT : Front Intertropical
FMAT : La Flore Mésophile Aérobie
Totale
GPS : Global Positioning System
H : Heure
IEB : Indice d'Echange de Base
LB : Lunia Bertani
INSEED : Institut National De La Statistique,
D'études Economiques Et Démographiques
M : Mètre
M2 : Mètre carré
M3 : Mètre cube
MATDHU : Ministère de
l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de
l'Urbanisme.
N : Nord
NE : Nord -Est
NET : Noir d'ériochrome T
NP : Niveau Piézométrique
NS : Niveau Statique
OMS : Organisation Mondiale De La
Santé.
ORSTOM : Office de la Recherche Scientifique Et
Technique d'Outre Mer.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page xii
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
RGPH2 : Deuxième Recensement
Général De La Population Et De L'habitat
S : Sud
SDEA : Schéma Directeur De L'eau Et De
L'assainissement
STE : Société Tchadienne
d'Eau
SITEAU : Système d'Informations
Tchadien Sur l'Eau
TA : Titre Alcalimétrique
TAC : Titre Alcalimétrique Complet
UFC : Unité Formant Colonie
W : Ouest
WTW : Wissenschaftlich Technische
Werkstatten
ZCIT : Zone de Convergence Inter
Tropicale.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page xiii
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
RESUME
Le présent travail a pour but d'évaluer la
qualité physico-chimique et bactériologique des eaux souterraines
de la ville de N'Djamena et de déterminer les sources de pollution en
vue d'élaborer des mesures de prévention et d'atténuation
de risques. Dix huit points d'eau ont été contrôlés
pendant la période des hautes et basses eaux. Les paramètres
physico-chimiques (température, pH, conductivité) ont
été mesurés in situ pendant
l'échantillonnage. La turbidité et le taux de solide dissous ont
été évalués au laboratoire. Douze
éléments chimiques à savoir, la dureté calcique et
magnésienne, NO3-, SO42-,
Ca2+, Mg2+, HCO3-, Na+,
Cl-,K+, Fe, Mn, NH4+ ont été
analysés par dosage colorimétrique, par spectrophotométrie
d'une part et par la méthode volumétrique d'autre part. Les
germes fécaux (E. Coli), totaux et les entérocoques ont
été déterminés par la méthode de la membrane
filtrante.
Le sens de l'écoulement des eaux dans la zone
d'étude est du Sud vers le Nord. La température de l'eau avoisine
celle de l'air ambiant, les pH se situent autour de la neutralité,
l'analyse de la qualité globale de l'eau a révélé
que la quasi- totalité des points contrôlés sont de bonne
qualité. Ces eaux appartiennent à un seul faciès chimique,
à savoir bicarbonaté calcique à magnésienne. La
plupart des autres paramètres chimiques sont en deçà des
valeurs recommandées par l'OMS et de la norme tchadienne, à
l'exception de Toukra où la conductivité est supérieure
à la norme OMS.
Les germes indicateurs de contaminations fécales sont
présents dans 62% des forages, ce qui nécessite des traitements
de désinfection au chlore.
Les corrélations lithologiques réalisées
ont montré des variations latérales de faciès.
Mots clés : N'Djamena,
physico-chimique, bactériologique, pollution, échantillonnage,
qualité, fécale.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page xiv
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
ABSTRACT
The present work aims to evaluate the physicochemical and
bacteriological quality of groundwater of N'Djamena and to identify sources of
pollution with a view to developing prevention and risk mitigation measures.
Eighteen water points were monitored during the high and low water periods.
Physico-chemical parameters (temperature, pH, conductivity) were measured in
situ during sampling. Turbidity and dissolved solids were evaluated in the
laboratory. Twelve chemical elements namely, calcium and magnesium hardness,
NO3-, SO42-, Ca2 +, Mg2 +, HCO3-, Na +, Cl-, K
+, Fe, Mn, NH4 + were analyzed by colorimetric assay, by spectrophotometry on
the one hand and by the volumetric method on the other hand. Faecal (E. coli),
total and enterococcal germs were determined by the membrane filter method.
The direction of the flow of water in the study area is from
South to North. The temperature of the water is close to that of the ambient
air, the pH is around the neutrality, the analysis of the overall quality of
the water revealed that almost all the points checked are of good quality.
These waters belong to a single chemical facies, namely bicarbonate calcium to
magnesium. Most of the other chemical parameters are below the WHO recommended
values and the Chad standard, with the exception of Toukra where the
conductivity is higher than the WHO standard.
The indicator germs of fecal contamination are present in 62%
of the boreholes, which requires chlorine disinfection treatments.
The lithological correlations carried out showed lateral
variations of facies.
Key words: N'Djamena, physico-chemical,
bacteriological, pollution, sampling, quality, faecal.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 1
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
INTRODUCTION :
Partout dans le monde, la pression sur les ressources en eau
en général et sur les ressources en eau souterraine en
particulier est à la hausse (Nouayti N., et al (2015)), principalement
en raison d'une part, d'un contexte lié à l'accroissement de la
population avec comme corollaire l'expansion urbaine, le développement
industriel , le développement agricole et le tourisme avec du coup, une
demande croissante et une dégradation de la qualité de l'eau et
d'autre part, dans un contexte de changements climatiques dont les impacts sur
les ressources en eau sont de plus en plus évidentes .
Or, il n'y a pas de développement sans eau potable,
sans assainissement et sans hygiène, et un meilleur accès
à une eau de boisson saine peut se traduire par des
bénéfices tangibles pour la santé. (OMS, 2004).
Le Tchad, ne déroge pas à la règle
malheureusement et la disponibilité en eau jusqu'à présent
très limitée, risquerait de diminuer fortement à long
terme en raison de la rareté et le caractère aléatoire des
précipitations, le phénomène de désertification,
qui devient de plus en plus inquiétant, et menacent en plus des
agglomérations, les terrains agricoles et les infrastructures
d'irrigation (H, Abderamane ,2010). Ajouté à cela, une expansion
vertigineuse des principales agglomérations du Tchad, dont
l'illustration est donnée par la ville de N'Djamena notre zone
d'étude, expansion due à une forte croissance
démographique soit 3,5% par an (RGPH2), qui laisse présumer un
besoin encore croissant en eau potable.
La principale ressource en eau souterraine au Tchad
exploitable, est localisée dans le bassin du Lac Tchad avec une
superficie d'environ 2,5 millions de km2, c'est l'un des plus vastes
bassins endoréiques au monde et l'un des plus grands bassins
hydrogéologiques sédimentaires d'Afrique.
Le bassin du Lac Tchad comporte un sous bassin, le bassin du
Chari-Baguirmi où est logé notre secteur d'étude.
I. PROBLEMATIQUE :
L'eau souterraine constitue la ressource la plus importante et
relativement la plus accessible au Tchad en général et dans la
capitale N'Djamena en particulier puisqu'elle constitue une source
d'alimentation en eau potable, d'usage domestique et d'irrigation.
N'Djamena est comme toutes les capitales des Etats de
l'Afrique tropicale, équipée en installations produisant de l'eau
potable. Mais celles-ci ne desservent qu'une partie des quartiers de la ville
en raison de la vétusté du réseau de distribution d'eau,
son extension qui tarde à se faire et des conditions de distribution
sectorielle. C'est le cas avec la Société
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 2
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Tchadienne d'Eau, seule concessionnaire de l'état
tchadien chargée de la gestion et la distribution de l'eau potable, qui
ne couvre malheureusement pas l'ensemble de la capitale tchadienne (à
peine 30% du taux de couverture de N'Djamena, (PADUR,2013)).
C'est ainsi qu'une part importante de la population
n'hésite pas à faire recours aux forages à faible cout,
souvent de qualité préoccupante pour satisfaire leurs besoins
quotidiens, ignorant de ce fait que la majeure partie des eaux captées
par ces forages sont sujettes à des pollutions diverses en raison de la
nature lithologique des formations aquifères ou des sols
traversés, des épandages des ordures ménagères, des
eaux usées déversées sur le sol, des décharges
sauvages créées par ci et par là et des carences
d'hygiène, cela est aggravé par la croissance
démographique, augmentant les activités humaines, qui constituent
de plus en plus un réel danger pour l'environnement.
Or selon l'OMS, pour pouvoir protéger la santé,
l'eau destinée à la consommation doit être potable et de
bonne qualité.
Donc, c'est face à ces enjeux sanitaires,
socio-économiques et environnementaux devenus un défi dont tous
les acteurs doivent faire face, que nous avions opté pour le choix du
dit thème.
Hypothèses :
Les hypothèses qui sous-tendent notre recherche se
résument de la manière suivante :
- L'eau issue des forages sur certains sites (quartiers) de
notre zone d'étude n'est pas saine pour la consommation.
- La proximité des décharges et des fosses
d'aisance impactent sur la qualité des eaux de forages.
- Les mauvaises pratiques de l'hygiène et
d'assainissement sont des facteurs potentiels de contamination des eaux
souterraines (défécation à l'air libre notamment).
- La consommation de ces eaux est la cause de nombreuses
maladies hydriques (typhoïde, cholera, hépatite, diarrhée
...) au sein de la population.
Il serait donc judicieux avant de répondre à ces
assertions de faire une revue de l'hydrogéologie de la nappe du
Chari-Baguirmi et du coup, de notre zone d'étude.
Les anciens travaux de recherches relatifs à
l'hydrogéologie en général et à la connaissance du
fonctionnement des systèmes aquifères du Chari-Baguirmi dont fait
partie intégrante notre zone d'étude N'Djamena, ont
été amorcées en 1952 par (Abadie,J), suivi par les travaux
de recherche du BRGM vers la fin des années cinquante qui comprirent la
préparation de cartes hydrogéologiques de reconnaissance a 1/500
000 dont celle de Fort
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 3
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Lamy, complétés par les travaux des
équipes de l'ORSTOM dans les années 60.Les résultats
obtenus firent l'objet de deux synthèses, publiées en 1970 dont
la carte hydrogéologique a
1/1 500 000 avec notice explicative (par J
.L. Schneider).Ces travaux ont été complétés plus
tard par Schneider et Wolf en 1992 ( Massuel, 2001).
Les travaux récents menés dans la zone et
relatifs spécifiquement à la qualité des eaux souterraines
(physico- chimique et bactériologique) sont ceux du projet «
Gestion Durable de l'eau du bassin du lac Tchad ». Il s'agit d'un projet
de coopération technique entre la Commission du Bassin du Lac Tchad
(CBLT) et le BGR, projet qui a réalisé une analyse des eaux
souterraines de 52 forages équipés de pompes manuelles
situées dans la ville de N'Djamena (N.M Ronelngar, 2015). En outre dans
le cadre du projet « accès à l'eau potable et assainissement
dans les quartiers périphériques de la ville de N'Djamena»
piloté par la Voirie, un rapport sur la qualité
bactériologique des points d'eau souterraine des quartiers du
7éme et 9éme arrondissement a
été aussi mis à jour.
Nous n'occultons pas aussi les travaux de (Djoret (2000),
Massuel (2001), Kadjangaba (2007), Abdramane (2012)) qui ont trait à la
compréhension du fonctionnement du système aquifère du
Chari-Baguirmi, la compréhension des processus de recharge de
l'aquifère du quaternaire, des informations intéressantes sur
l'origine, la minéralisation, la géochimie et l'hydrodynamisme de
la nappe de N'Djamena. Tous ces travaux forment un jeu de données
très riches qui a servi de base pour ce travail (Bouchez. C, 2015).
Notre étude s'intéressera donc
spécifiquement à la qualité de l'eau captée par les
forages, elle nous permettra de dégager certaines causes de la
dégradation de ces eaux, de faire des propositions permettant à
nos populations d'observer des attitudes garantissant la qualité de
l'eau de consommation. Nous espérons que les résultats issus de
ce travail permettront de sensibiliser les décideurs pour une meilleure
application des normes de protection des forages en vue de la réduction
de l'incidence des maladies liées à l'eau.
II.OBJECTIFS :
Objectif global : Contribuer à la
connaissance de la ressource en eau (par la piézométrie) et de sa
qualité dans la ville de N'Djamena.
Objectifs spécifiques : Dans cette
étude, nous chercherons précisément à :
- Analyser les paramètres physico-chimiques et
bactériologiques de ces eaux et de vérifier s'ils
répondent aux normes de potabilité OMS/TCHAD ;
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 4
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
- rechercher les sources probables de pollution et
déterminer les niveaux de contamination physicochimique et
bactériologique des eaux de la nappe du plio-quaternaire à partir
des forages exploités par la population de la zone étudiée
;
- Evaluer les impacts de la consommation de ces eaux sur la
santé ;
- Faire des propositions pour l'amélioration de la
qualité des eaux consommées.
Pour atteindre ces objectifs, le rapport sera subdivisé
en trois parties :
? Dans la première partie, comportant deux chapitres,
nous présenterons le contexte d'étude et la problématique
dont la zone d'étude fait objet, nous relaterons le contexte
géographique, socio-économique, et nous aborderons la
géologie et l'hydrogéologie de la dite zone.
? La deuxième partie sera consacrée aux
paramètres et méthodes d'analyses.
? Dans la dernière partie, nous exposerons les
résultats obtenus lors de la recherche, suivie d'une discussion.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 5
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE ET SES
CARACTERISTIQUES
Chapitre I- CADRE GEOGRAPHIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE
Ce chapitre présente la zone d'étude sur le plan
physique et humain. En effet, il s'agit de localiser la zone d'étude sur
le plan régional, de présenter la population, le type de climat,
l'hydrologie, la pédologie, la géomorphologie, la
végétation, le contexte socio-économique et l'organisation
administrative.
I- APERÇU GEOGRAPHIQUE
I.1.1. Situation de la République du
Tchad
Le Tchad est situé entre le 8° et 23° de latitude Nord
et 14° et 24° de longitude Est avec une superficie de 1 284 000 km2.
Il est limité au Nord par la Libye, à l'Est par le Soudan, au Sud
par la République Centrafricaine, au Sud-ouest par le Cameroun et le
Nigeria, à l'Ouest par le Niger. C'est le cinquième pays le plus
vaste d'Afrique après le Soudan, la République
Démocratique du Congo, l'Algérie et la Libye. Le Tchad est un
pays enclavé au coeur de l'Afrique dans le centre d'une gigantesque
cuvette sédimentaire endoréique.
I.1.2. Localisation de la zone
d'étude
Le secteur qui fait l'objet de cette étude est la ville
de N'Djaména, située au centre-ouest du Tchad,
au confluent du fleuve Chari et du Logone, sur la rive droite du Chari et
s'étend sur 12° 03' et 12° 10' de latitude Nord et 15°
02' et 15° 07' de longitude Est sur une altitude moyenne de 295m ,en zone
sahélienne chaude et sèche. Elle est délimitée au
Nord par la sous-préfecture de Mani, à l'Est par la
sous-préfecture de Ligna, au Sud-est par la sous-préfecture du
Logone Chari, Mandalia notamment et à l'Ouest par le territoire
camerounais. N'Djamena s'étend sur 431 km2 environ.
La ville est en pleine extension spatiale. Cette extension de
la ville se fait de manière spontanée sur des terrains peu
propices à l'urbanisation et soumis régulièrement aux
inondations. A l'instar des autres villes africaines N'Djamena se
caractérise par l'explosion démographique et le manque d'un
schéma directeur d'urbanisation.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 6
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
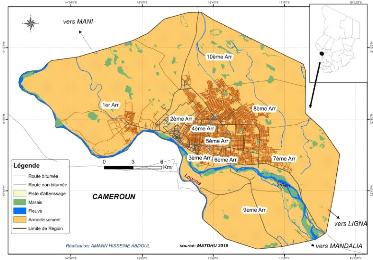
Figure 1:localisation de la zone
d'étude
I.2- Facteurs climatiques
Les paramètres climatiques étudiés dans
ce mémoire sont les précipitations, les températures,
l'humidité, l'insolation et l'évaporation. La connaissance de ces
paramètres permet de juger l'influence du climat sur la formation et le
renouvèlement de la ressource en eau tant en quantité qu'en
qualité, lesquels paramètres conditionnent l'écoulement
superficiel et souterrain;
Ces données qui sont fournies par la Division de
Climatologie (DC)! Direction d'Exploitation et d'Application
Météorologique (DEAM)! Direction Générale de
Météorologie Nationale (DGMN)/ mai/2015, portent sur les stations
de N'Djamena de 1984 à 2015.
1.2.1. Le climat
La ville de N'Djaména est soumise à un Climat
semi-aride sec et chaud. Par conséquent, les pluies dépendent
exclusivement de la position et de la structure du FIT et sont surtout
d'origine convective et issue d'un cumulo-nimbus isolé ou d'une
formation nuageuse se développant sous forme de ligne de grains qui se
déplace en général d'Est en Ouest à travers la
région sahélienne.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 7
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Le climat dans la zone d'étude est du type
sahélo-soudanien (Pias,J, 1970) caractérisé par une courte
période de pluie puis une longue période sèche. Le
régime des précipitations est associé à l'influence
de deux masses d'air, à savoir :
- l' Harmattan, masse d'air tropical continental chaud et sec
venant de l'Est et du Nord-est du Sahara,
- et la Mousson, masse d'air équatorial maritime,
instable, humide et relativement frais, venant du Sud-ouest et originaire de
l'anticyclone de Sainte-Hélène.
La Mousson relativement plus froide passe sous l'Harmattan et
l'axe de cette confluence est appelé Zone de Convergence Inter Tropicale
(ZCIT).
Le tracé au sol de ces deux masses d'air forme le Front
Inter Tropical ou FIT qui correspond à la zone de maximum de chaleur et
dont la position est responsable des précipitations .En août le
FIT remonte jusque vers le 20èmeparallèle et redescend
vers le sud au début de septembre (Kadjangaba, E, 2007).
Ill faut noter que les précipitations sont nulles
pendant 5 mois de l'année de novembre à mars tandis que les mois
de juillet et août sont bien arrosés avec respectivement une
moyenne de 150 mm et 175 mm.
1.2.2. Indice d'aridité
Les différentes caractéristiques du climat montrent
une zonalité particulièrement nette entre
le type tropical et le type désertique.
Cette zonalité est bien marquée avec l'indice
d'aridité de E. De Martonne et L. Aufrere (1925).
L'indice d'aridité de De Martonne noté IA est un
nombre sans unité, qui permet de définir le
degré d'aridité d'une région donnée
sur une échelle de cinq (05) classes. Il est donné par la
formule :
IA= P/T+10
Avec P: hauteur annuelle moyenne des
précipitations (en mm),
Et T: température moyenne annuelle
(°C).
Suivant les valeurs de l'indice de De Martonne, on établit
la classification de la manière
suivante :
IA < 5, climat hyperaride,
5 < IA < 7,5 climat désertique ;
7,5 < IA < 10 climat steppique ;
10 < IA < 20 climat semi- aride ;
IA > 20 climat tempéré.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 8
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Pour notre zone d'étude, pour un intervalle de 31 ans,
nous aurons : IA = 545 ,72/28,96+10 = 14.
La zone d'étude fait donc partie d'une zone
semi-aride.
I.3.- Pluviométrie
Les précipitations sont la principale source
d'alimentation des réserves d'eaux souterraines. Elles permettent une
appréciation indirecte de l'état des réserves en eau du
sol, la recharge et le régime des cours d'eau dans les bassins versants
(Saoud, I, 2014). En vue de suivre la répartition des
précipitations au cours de l'année hydrologique, nous avions
calculé la moyenne mensuelle sur les trente un ans
enregistrés.
I.3.1.- Données pluviométriques
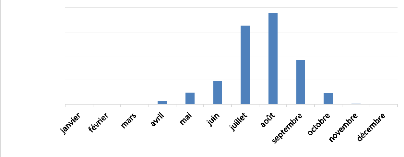
200
150
100
50
Précipitations moyennes (mm]
0
Mois
Figure 2: Histogramme des précipitations
moyennes mensuelles de 1984 à 2015 à la
station de N'Djamena -
aéroport (source: DGMN/ mai 2015).
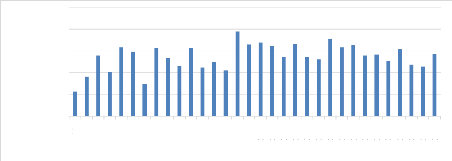
Précipitations moyennes (mm]
1000
400
800
600
200
0
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015
Année
Figure 3:Histogramme des précipitations moyennes
annuelles de 1984 à 2015 à la station de N'Djamena-
aéroport (source: DGMN/ Mai 2015).
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 9
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
L'histogramme des précipitations mensuelles (figure 2)
montre que les précipitations débutent au mois d'avril,
atteignent leur maximum au mois d'aout avec une lame d'eau maximale de l'ordre
de 188,73mm, et décroissent ensuite pour s'arrêter au mois
d'octobre. Le mois le plus sec est le mois d'avril avec une lame d'eau maximale
de 5,78 mm.
La figure 3 montre que la pluviométrie est très
variable d'une année à l'autre. On distingue des années
très sèches (1984, 1990) avec des lames d'eau respectivement de
226, et 296 mm et des années assez humides (1998, 2006) avec
respectivement des lames d'eau de 775,9 et 711,2 mm.
I.3.2- Température
La température est un paramètre très
important dans la caractérisation du régime climatique d'une
région donnée. Elle est également liée aux
phénomènes de condensation et d'évaporation, c'est un
facteur déterminant dans l'établissement du bilan hydrologique.
Elle varie selon la latitude et l'altitude.
I.3.3- Température moyenne mensuelle
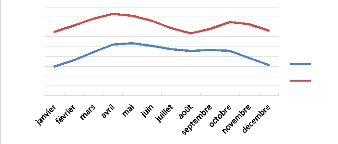
Temperature (°C)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Mois
Min Max
Figure 4:Courbes de températures moyennes
mensuelles de 1984 à 2015 à la station de
N'Djamena-
aéroport (source: DGMN).
Les températures moyennes mensuelles dans la zone
d'étude, calculées sur une période de 31 ans (1984- 2015)
oscillent entre 26°C et 28°C. Comme l'a souligné Djoret
(2000), le régime thermique annuel présente deux maxima : un
maxima principal se situe en mars -avril coïncidant avec la saison chaude
juste avant la résurgence des premières pluies ; et un
deuxième maxima se situant en octobre à la fin de la saison des
pluies. Notons cependant que
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 10
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
l'amplitude de variation de température est plus
élevée en janvier-février (Kadjangaba, 2007), du fait que
les températures sont plus fortes dans la journée et plus
fraiches la nuit.
I.3.4-Humidité
L'humidité relative de l'air est le rapport,
exprimé en pourcentage, de la tension de vapeur d'eau à la
tension de vapeur d'eau saturante. C'est un élément
atmosphérique très important puisqu'il donne le taux de
condensation de l'atmosphère.
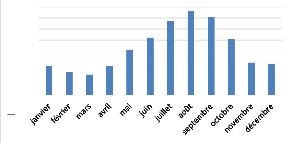
80
Humidité rélative (%)
Mois
70
60
50
40
30
20
10
0
Figure 5: Humidité moyenne mensuelle de 1984
à 2015 à la station de N'Djamena
aéroport (source:
DGMN)
Les données sont collectées à
l'aéroport de N'Djamena pour une période de 31 ans (1984 à
2015). Nous remarquons que les périodes les plus humides sont
situées aux mois d'août et septembre, avec un pic de taux
d'humidité moyenne de 76,15% au mois d'aout. Le taux d'humidité
n'est donc élevé que pendant la saison des pluies et diminue
progressivement jusqu'au mois de mars (18 ,45%) ; et avec les premières
pluies d'avril, il recommence par augmenter. Le taux d'humidité moyen
annuel se situe autour de 42%.
I.4 - Evaporation
C'est le processus physique de la transformation de l'eau en
vapeur. Elle est un paramètre essentiel, car elle représente une
partie de la fonction de « sortie » dans le bilan hydrologique d'une
région donnée. Cependant il est difficile de la mesurer, car elle
dépend de plusieurs facteurs qui sont variables dans l'espace et dans le
temps, tels que la température, les précipitations, la vitesse
des vents, l'humidité de l'air, l'état du sol et la
végétation.
Dans notre zone d'étude, pour une chronique de 31 ans
(1984-2015), nous constatons que l'évaporation atteint un maximum au
mois de mars avec 416 mm d'eau et un minimum en août avec 76,5mm
(fig.6).
L'année où l'évaporation la plus
importante a été enregistrée est 1984 avec une moyenne
annuelle de 3804 mm d'eau ; et celle où la plus faible moyenne annuelle
a été enregistrée est
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
1991 avec 1979 mm d'eau (fig.7). Toute fois pour la même
période (31 ans) nous relevons une moyenne annuelle d'évaporation
de 2862 mm d'eau, elle est de loin supérieure à la moyenne des
précipitations sur la même période qui est de 563 mm.
|
450 400 350 300 250 200 150 100 50
0
|
|
|
|
|
Evaporation (mm)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mois
|
|
Figure 6: Evaporation moyenne mensuelle de 1984
à 2015 à la station de
N'Djamena-
aéroport (source DGMN).
Evaporation moyenne annuelle
19 84 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013
Années
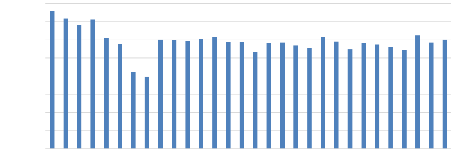
Evaporation moyenne annuelle
1 1 2 2 3 3
( m m )
m
2000
4000
3500
3000
2500
1500
1000
500
0
Figure 7: Evaporation moyenne annuelle cumulée
des trente dernières années à la
station de N'Djamena-
aéroport (source: DGMN)
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 11
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 12
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
1.5- L'insolation
La valeur de l'insolation journalière durant la
période de 1984-2015 est minimale en juillet et août pendant la
saison des pluies donc avec l'apport de la couverture nuageuse. Elle est
maximale au mois de novembre avec 10h d'ensoleillement.
|
12 10 8 6 4 2 0
|
|
|
|
|
Insolation (Heure)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mois
|
|
Figure 8: Courbe de l'insolation moyenne mensuelle de
1984 à 2015 à la station de
N'Djamena-aéroport (source:
DGMN).
I.6- l-Hydrographie
La ville de N'Djamena est située dans une plaine
alluviale très plate longée sur toute
sa bordure méridionale par le fleuve Chari. Celui-ci,
le plus important du Tchad, prend sa source dans le mont Yadé (en
Centrafrique). Il est rejoint par son principal affluent, le Logone, au niveau
de la ville ; ce dernier prend sa source dans le massif de l'Adamaoua au
Cameroun. De ce fait, ces fleuves ont un régime tropical acquis en
grande partie dans leur cours amont hors des frontières du Tchad, et ils
résultent de l'association de plusieurs cours d'eau (Kadjangaba,
2007).
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 13
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
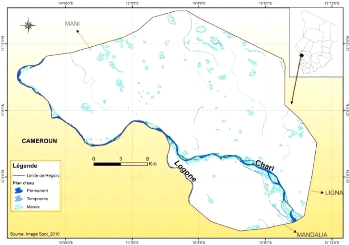
Figure 9 : hydrographie de la zone
d'étude.
I.6.1- Le Chari
Le Chari, 1200 km dont 800 km au Tchad, est le plus important
des cours d'eau tchadiens. Le Chari prend sa source en République
Centrafricaine et se jette au Lac Tchad après avoir traversé
toute la zone soudanienne et la zone sahélienne. A son entrée au
Tchad, le Chari est constitué par la réunion de Bamingui (356 km
de long), du Gribingui (418 km) et du Bangora (355 km) trois cours d'eau
situé en République Centrafricaine qui drainent un bassin de 80
000 km2. Le Chari représente 90% des apports en eaux du Lac
Tchad. Il est caractérisé par une faible pente (0,1 m/km entre le
confluent du Bahr Aouk et le Lac Tchad, 826 km) entrainent une
dégradation hydrographique marquée (défluents, plaine
d'inondation) (Massuel,S 2001).
Après son entrée au Tchad, il reçoit :
- sur sa rive droite :
. le Bahr Aouk,
. le Bahr Keita,
. le Bahr Salamat qui continue le bahr Azoum et va alimenter la
vaste dépression du sud
d'Am-Timan. A partir de la confluence du Bahr Salamat, le Chari
ne recevra plus rien sur sa
rive droite mais donnera naissance à quelques importants
défluents.
- sur sa rive gauche :
. la grande et la petite Sido,
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 14
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
. I'Ouham grossie du Mandoul, . le Ba-llli de Bousso,
. le Logone (Pias,j, 1970).
I.6.2- Le logone
Le Logone, 960 km prend sa source dans
le plateau de l'Adamoua au Cameroun à 1200m d'altitude et se jette dans
le Chari à N'Djamena après avoir traversé les villes de
Doba, Moundou, Laï et Bongor. il porte le nom de Wina au Cameroun,
reçoit la M'Béré grossie Du Ngou et de la Lim. L'ensemble
constitue le Logone occidental qui collecte la Pendé ou Logone oriental,
puis sur la rive gauche la Tandjilé issue des plateaux laka. Ce fleuve
ne recevra plus ensuite aucun affluent jusqu'à sa confluence avec le
Chari mais lui retourneront, plus en aval par l'intermédiaire de
défluents, des eaux perdues en amont. II sera aussi alimenté par
les cours d'eau descendus des Monts Mandara (mayo
Boula, Tsanaga, Balda, Motorsolo, Ranéo, Mangafé..
. ) qui vont se perdre dans un immense yaéré sur la rive gauche
au Cameroun (Pias,J, 1970).
I.7- La géomorphologie
La région présente une topographie assez
caractéristique due à son histoire géologique. Le paysage
se structure en d'immenses plaines exondées et inondables. Les zones
basses correspondent aux plaines inondables situées à
proximité du Chari, à l'Ouest de la ville aux alentours de
Farcha, Milezi. Le reste de la région est occupé par la plaine
exondée, domaine des terres cultivables en saison de pluies. L'altitude
varie de 299 m au Sud (à l'entrée de la ville en bordure du
Chari) et décroit à 292m environ au Nord-ouest.
I.8- Le sol
La République du Tchad présente une gamme de
sols très étendue allant des sols ferralitiques à des sols
désertiques et ceci en relation avec la variation climatique (humide au
Sud et désertique au Nord). Il faut signaler que ce sont surtout les
matériaux sédimentaires qui sont les plus abondants au Tchad,
notamment les formations d'âge quaternaire ancien à très
récent dans la majorité du territoire. Ces sédiments ont
été pour la plupart, déposés au cours d'extensions
lacustres du Lac Tchad. Celui-ci couvrait encore, à une époque
très récente, une
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 15
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
grande partie du pays. Il s'agit d'argiles lacustres ou de
sédiments argilo-sableux ou sableux, fluvio-lacustres ou fluviatiles.
En ce qui concerne notre zone d'étude, elle fait partie
du bassin alluvial du Logone et Chari caractérisé par des
vertisols, sols riches en argile issus de l'altération et du
dépôt fluvial, et des sols hydromorphes issus des plaines
d'inondation du Logone vers la partie Sud de N'Djamena. Ces sols qui se
différencient les uns des autres par un régime hydrique
légèrement dissemblable, sont tous argilo-sableux à
argileux, à nodules calcaires, assez riches en éléments
fertilisants. Inondés une partie de l'année, ils portent des
cultures de fin de saison des pluies (sorgho repiqué). Une très
faible étendue de cette terre est cultivée.
Aussi, le Nord et le Nord-est de la zone d'étude est
formé d'alignements sableux disposés en éventail qui ont
évolué en sols bruns subarides peu profonds (80 à 120 cm)
marqués par une légère accumulation de matière
organique décroissant progressivement avec la profondeur et donnant la
teinte brune. De valeur agricole identique aux sols ferrugineux tropicaux peu
lessivés, ils portent de cultures de petits mil et d'arachide. Les
dépôts argilo-sableux lacustres situés entre ces
alignements (sols hydromorphes ou halomorphes), sont incultes ou portent
quelques cultures de sorgho repiqué (Pias, J, 1970).
I.9- La végétation
Les formations végétales qui se succèdent
au Tchad s'ordonnent dans leur ensemble conformément à la
zonation climatique qui découle de la durée de la saison des
pluies et du total de celle-ci.
A cet effet, la zone d'étude correspond au domaine
sahélo-soudanien (précipitation comprise entre 700 et 500mm) avec
des incursions vers des domaines plus secs au Nord en fonction des sols et de
l'alimentation en eau.
La formation caractéristique est la savane arbustive
où dominent les acacias (A.seyal, A.scorpioides, A.senegal) et
autres arbustes épineux (Balanites aegyptiaca, Ziziphus
mauritania...). Le tapis graminéen est composé
d'Andropogonées.
Les anciennes jachères sont facilement
repérables à la prolifération de Calotropisprocera
rudérale caractéristique, ainsi qu'aux repousses
buissonnantes de doum (Hyphaenethebaica). (Pias, J, 1970).
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 16
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
I.10- Contexte socio-économique
N'Djaména souvent considérée comme la
capitale politique du Tchad, retrouve peu à peu son statut de capitale
économique du pays notamment de par sa forte croissance
démographique, le déclin du secteur cotonnier au Tchad, la
proximité de la frontière camerounaise stimulant les
échanges et l'achèvement de la raffinerie de Djermaya. D'autre
part, l'essor progressif de l'économie tchadienne est principalement
visible à N'Djaména qui timidement se modernise.
1.10.1. La situation socio-économique de la ville
de N'djamena Les secteurs privés et publics
La répartition de la population occupée selon le
statut dans la profession montre que les activités
"indépendantes" occupent plus de la moitié de la population
59,2%. Les salariés du secteur public ou para-public constituent 34,6%
du total des personnes en activité (V.Nguezoumka, 2010). Notons
également la faiblesse des employeurs, (c'est-à-dire les
exploitants des entreprises qui peuvent employer les salariés), durant
ces dernières années suites à la récession
économique.
Les activités économiques
L'activité économique de la ville de N'djamena
se caractérise par une relative
hétérogénéité comparativement à celle
des autres régions du pays, dominée par le secteur de
l'agriculture et de la pêche. L'activité dominante est le commerce
qui occupe 37% de personnes, soit environ 2 actifs N'Djamenois sur 5 (RGPH
1993). Le secteur primaire occuperait 9,1% des activités de la ville et
concerne celles qui sont liées à l'agriculture en
général et la culture maraichère en particulier.
Le secteur secondaire, localisé essentiellement dans le
premier arrondissement est représenté par les abattoirs de
Farcha, les boissons et glacières du Tchad, la compagnie Sucrière
du Tchad, les entreprises des travaux telles que SATOM, SNER, SETUBA etc. Le
secteur secondaire absorbe 19,7% de la population active à N'djamena.
Dans le secteur tertiaire, les quelques dizaines d'entreprises
d'import-export, de vente en gros et en détail, officiellement
enregistrées, vendent des produits pétroliers, des produits
électroménagers, les produits agricoles, etc. N'djamena comme
capitale assume les fonctions
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 17
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
politiques, administratives, et de service. Cependant, cette
économie est fortement handicapée par l'enclavement du pays au
coeur de la bande sahélienne. La ville de N'djamena présente de
difficultés en ce qui concerne son accès à la mer,
à cause de sa situation géographique qui pénalise son
économie.
I.11- La population/demographie
Il ya 100 ans environs, N'Djamena ne comptait que 4 000
habitants, vivant dans quatre quartiers, non compris celui des
Européens.
La population de N'Djaména est passé de 993 492
habitants en 2009 (RGPH2 2009). Tableau 1:évolution de la
population de N'Djamena.
Évolution de la population
1937
|
1940
|
1947
|
1968
|
1993
|
2005
|
2009
|
2012
|
9 976
|
12 552
|
18 375
|
126 483
|
529 555
|
721 000
|
993 492
|
1 092 066
|
|
I.12- organisation administrative et sociale
Administration
N'Djamena est la capitale et la plus grande ville du Tchad.
Depuis 2002, elle a un statut particulier. Devenue une région cette
même année, elle est divisée en dix arrondissements
municipaux (figure 10) et 64 quartiers (tableau 2).
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
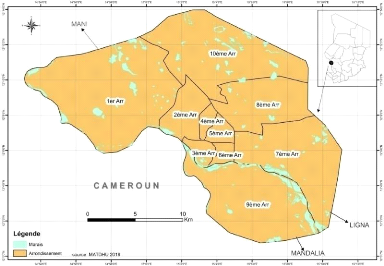
Figure 10: les arrondissements de N'Djamena. Tableau2 :
les différents quartiers de la ville de N'Djamena.
|
arrondissement
|
Quartiers (nbre)
|
Population (2009)
|
Noms des quartiers
|
|
1er
|
11
|
75 203
|
Allaya, Amsinéné ,Ardeb-Timan, Djougoulier, Farcha,
Guimeye, Karkandjeri, Madjorio, MassilAbcoma, Milezi, Zaraf
|
|
2éme
|
5
|
59 260
|
Bololo, DjambaNgato, Goudji, Klémat , Mardjandaffack
|
|
3éme
|
6
|
40 928
|
Ambassatna, Ardep, Djoumal, Djambalbarh, Gardolé1,
Kabalaye,
Sabangali
|
|
4éme
|
4
|
72 067
|
Blabine, Naga I, Naga II , Repos
|
|
5éme
|
3
|
100 948
|
Am-Riguebé , Champ de Fils, Ridina
|
|
6éme
|
2
|
45 500
|
Moursal , Paris-Congo
|
|
7éme
|
10
|
223 231
|
Ambatta ,Amtoukoui, Atrone, Boutalbagara, Chagoua,
Dembé,
Gassi, Habena, Kilwiti , Kourmanadji
|
|
8éme
|
6
|
184 641
|
Angabo, Diguel, Machaga ,Ndjari , Zaffaye-Est , Zaffaye-Ouest
|
|
9éme
|
7
|
75 593
|
Digangali , Gardolé 2 , Kabé , Ngoumna , Ngueli ,
Toukra ,
Walia
|
|
10éme
|
10
|
74 047
|
Achawayil , Djaballiro, Fondoré, Gaoui , Goudji-Charffa
,Gozator, HilléHoudjaj , Lamadji , Ouroula , Sadjeri
|
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 18
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 19
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Chapitre II- CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE
A. CONTEXTE GEOLOGIQUE
L'étude géologique est une étape
très importante pour la détermination de la nature lithologique
du sous-sol et en particulier celle du réservoir (Saoud, I, 2014).
Dans notre zone d'étude qui fait partie du bassin du
Lac Tchad, la datation des diatomées (ORSTOM, 1973), l'examen des
diagraphies effectuées dans les forages d'eau, puis dans les sondages de
recherche pétrolière a permis de mettre en évidence
plusieurs limites lithologiques correspondant à des variations de
paramètres physiques dans les formations plio-quaternaires et par suite
à apprécier les conditions régionales de
sédimentation (Schneider,J ,L,2001). De ce fait, le socle
précambrien se retrouve ainsi recouvert de formation tertiaire et
secondaire et il n'affleure que sur le pourtour du bassin. A cet effet, c'est
les formations du tertiaire et du quaternaire qui sont beaucoup plus
présentes dans notre zone d'étude.
II.1. Le pliocène et le quaternaire
Les roches les plus anciennes, précambriennes, les
séries primaires, le secondaire, n'affleurent pas dans notre zone
d'étude. Les séries du Continental Terminal bien
étudiées au Sud du Tchad, sont masquées par le
pliocène à N'Djamena. Des études récentes (forages,
sondages profonds) ont montré la présence du Continental terminal
sous les formations pliocènes et quaternaires ; c'est pourquoi nous
décrirons plus précisément le Pliocène et le
Quaternaire (Djoret, D, 2000).
II.1.1. Pliocène
Le Pliocène est bien représenté dans la
cuvette tchadienne, mais masqué par le quaternaire dans la zone
d'étude. Il est connu essentiellement grâce aux données de
rares forages d'eau ou du pétrole. Il débute par les sables
reposant sur le Continental terminal et se poursuit par une épaisse
série argileuse à intercalations sableuses. La limite avec le
quaternaire est mal définie. (Djoret, D, 2000).
Le pliocène inferieur : On attribue au
Pliocène inferieur les dépôts sableux situés a une
profondeur de 250-350 m/sol dans la partie centrale du bassin du lac Tchad.
(Schneider et Wolff, 1992). Il présente des intercalations argileuses au
sommet, qui correspond au réservoir de la nappe artésienne dans
le Chari- Baguirmi. Son toit se situe à 270m de profondeur au Nord de
N'Djamena (Djoret, D, 2000).
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 20
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Le pliocène moyen est
caractérisé par une sédimentation lacustre à
limnique très épaisse contenant des intercalations sableuses dont
l'une d'elle, épaisse de 10 à 30 m, renferme des eaux
contaminées par le gypse dissout (Djoret, D, 2000).
Le pliocène supérieur met fin
à la puissante série argileuse limnique du pliocène moyen.
La partie sommitale est marquée par un épisode aride avec la
présence de gypse dans les argiles. Cela est attesté par les
faciès sulfatés des eaux captées dans les puits du creux
piézométrique du Chari Baguirmi (Schneider et Wolff, 1992).
II.1.2. Quaternaire
Ce sont les formations quaternaires qui occupent la plus
grande place au coeur du bassin du Tchad. Notre zone d'étude qui se
trouve justement sur les bordures des dépôts du Quaternaire dans
le bassin du lac Tchad. Grace aux études de l'ORSTOM et du BRGM la
datation relative de ces formations a été fortement
précisée. La chronologie de leurs dépôts se confond
avec les variations de niveau du Lac Tchad liées aux variations
climatiques du dernier million d'années. Les périodes humides ont
favorisé le dépôt d'argiles, les périodes à
saisons alternées ont été marquées par le
dépôt d'alignements sableux deltaïques tandis que les
périodes arides accumulaient les formations dunaires. Elle est
recouverte par des formations Quaternaires anciennes et récentes dont
l'épaisseur peut être faible mais varie généralement
entre 50 à 70m (Schneider et Wolff, 1992).
L'étude de son remplissage sédimentaire (Pias,
1970) a permis de proposer une première chronologie des extensions
lacustres du quaternaire et des phénomènes
pédogénétiques qui se sont manifestés pendant la
phase d'émersion des sédiments (Philippe Mathieu, 1985).
On peut dire que l'histoire Quaternaire au Tchad se confond
avec celle des variations du niveau du Lac Tchad.
A N'Djamena, la profondeur du socle a été
estimée à 550m grâce aux investigations sismiques (BRGM,
1988) et les forages les plus profonds (356m) réalisé en 1950, et
celui du marché à mil (350m) captant la nappe du pliocène
ainsi que d'autres ont apporté des compléments d'informations sur
la lithologie et la stratigraphie de notre zone d'étude qui est
essentiellement Continental.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 21
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Pléistocène inférieur,
il peut atteindre 40m d'épaisseur dans le Chari- Baguirmi, et est
essentiellement
sableux.il repose sur l'épaisse
couche argileuse du Pliocène supérieur dans le Chari Baguirmi et
le Kanem. Ces sables parfois homogènes, renferment le plus souvent des
dépôts argileux lenticulaires (Djoret, D, 2000).
Pléistocène moyen, les limites
inferieures et supérieures du Pléistocène moyen au Tchad
sont conventionnelles et ont été établies en relation avec
les épisodes glaciaires en Europe. Il est formé de
sédiments de `'conditions humides», argiles lacustres, diatomites,
sables fluviatiles, alternant avec les dépôts de `'conditions
arides», grés argileux et sables, (Djoret, D,
2000).
Pléistocène supérieur,
selon Schneider (1994), la période aride qui marque la fin du
Pléistocène moyen et qui correspond à la glaciation du
Riss en Europe, est suive par un optimum climatique qui se traduit au Tchad par
une sédimentation fluviatile à lacustre jusqu'à 46 000 ans
B.P. ensuite trois épisodes arides marquent la fin du
Pléistocène supérieur dont le dernier correspond au
maximum des conditions froides du Würm.
Holocène inférieur (12 000- 9 200 ans
B.P), caractérisé par l'instauration de conditions
humides après remplissage des creux inters dunaires par l'eau
constituant ainsi des lacs.
Holocène moyen (10 000 - 4000 B.P), le
méga lac se met en place, les cordons dunaires à l'Est et au Sud
du bassin seraient les témoins de plages de ce grand lac, qui seraient
le résultat de plusieurs transgressions successives. Dans le Chari
Baguirmi, cette période est caractérisée par des
dépôts lacustres typiques, alternances complexes de sables et
d'argiles.
Holocène supérieur (4000 ans B.P
à l'actuel), caractérisé par une
dégradation des conditions climatiques et une aridification qui se
poursuit de nos jours, entrecoupée cependant par plusieurs
périodes humides. Il est formé de dépôts lacustres
argilo- sableux à niveaux tourbeux et diatomées, d'alluvions
fluviatiles et sables éoliens.
A. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
La zone d'étude appartient à la nappe du Chari
-Baguirmi, C'est une vaste plaine s'étendant d'Est en Ouest entre les
piedmonts du Guéra et la frontière avec le Cameroun (Logone), et
du Sud au Nord entre la base des koros et les premières dunes du Kanem
(BRGM, 1987).
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 22
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Toute la région qu'elle couvre est une succession de
terrains argilo-sableux compacts et très plats, coupés de zones
dunaires restreintes qui font saillie, ou au contraire de dépressions
argileuses inondées pendant la saison des pluies et qui sont en plus
nombreuses et étendues à mesure que l'on va vers le Sud.
D'un point de vue hydrogéologique, le Chari-Baguirmi
est scindé en deux sous régions, de part et d'autre du
12éme parallèle :
Le Chari-Baguirmi septentrional correspondant à la
carte hydrogéologique de N'Djamena et le Chari-Baguirmi
méridional, correspondant à la carte hydrogéologique de
Bongor.
En ce qui concerne notre zone d'étude, qui fait partie
du Chari-Baguirmi septentrional, c'est une plaine qui passe de 299m à
l'entrée Sud de la ville, vers Chagoua à 292m à la limite
Nord-ouest vers Milezi.
Selon Schneider (2001), l'aquifère de la nappe du Chari
Baguirmi qui se trouve dans les formations détritiques du quaternaire
est libre et générale, elle est localement surmontée par
des nappes alluviales, certaines temporaires. Cette nappe est alimentée
par le Chari et le Logone. En outre, selon le BRGM (1987), les forages de
N'Djamena ont montré sous la ville la puissance et l'extension
latérale importantes des couches sableuses déposées
postérieurement aux argiles pliocènes et antérieurement
aux argiles quaternaires. L'excellent aquifère sableux ainsi
créé provient des dépôts formés dans les
nombreux paléo chenaux du Chari qui ont fini par constituer une couche
continue ; cependant leur perméabilité peut diminuer
considérablement quand ils contiennent des particules argileuses en
grandes quantités. L'aquifère du Quaternaire constitue donc
l'unité hydrogéologique la plus remarquable de tout le bassin
tchadien. Il est fortement exploité pour les besoins en eau de la
population. Le Quaternaire consiste en une série largement
étalée de sédiments détritiques comprenant des
couches intercalées de sables ; de limons argileux, et d'argiles souvent
remaniées, fluviatiles, lacustres et éoliennes (Ngounou Ngatcha
et al, 2006).
II.2. Les principales nappes phréatiques de
N'Djamena Les nappes perchées
N'Djamena possède :
- des petites nappes perchées, isolées par
endroits à réserves limitées. Elles proviennent de
l'infiltration des eaux météoriques dans les alluvions des
anciens cours d'eau; l'infiltration est
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 23
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
bloquée par des couches argileuses qui constituent le
mur de ces "mares souterraines"(Schneider, J.L, 2001).
L'assèchement des points d'eau (puisards et puits profonds
de 2 à 8 m faiblement productifs) a lieu généralement au
milieu parfois en fin de saison sèche (Schneider, J.L, 2001).
Les nappes du pléistocène
inférieur
D'origine continentale, le sous-sol de la région se
caractérise par une grande
hétérogénéité spatiale et verticale. Les
quelques niveaux silteux ou argileux rencontrés n'ont pas une extension
latérale suffisante pour donner un caractère captif à la
nappe. Elle est considérée comme libre sur l'ensemble du bassin
(Zairi, R, 2008). Les constitutions lithologiques (sables argiles et limons) de
ce sous sol en grande partie alluvionnaires forment un réservoir pour
les eaux souterraines.
A N'Djamena, les formations fluvio-lacustres quaternaires
constituent l'aquifère phréatique principale et la plus
exploitée dont le sommet se situe aux alentours de 30-33 mètres.
Les dépôts semblent être à prédominance
sableuses et reposent sur l'épaisse série argileuse
pliocène à une profondeur de 50-60 mètres. Cette nappe est
contenue dans les formations du Quaternaire et plus spécifiquement dans
les formations du Pléistocène inférieur donc, et est
exploitée pour l'eau potable.
La partie nord de la zone d`étude se distingue par une
plus grande abondance de sables éoliens tandis que des sables
fluviatiles, parfois graveleux sont plus abondants au sud.
D'une manière générale, les descriptions
lithologiques mettent en évidence l'existence de deux séries :
- Une série supérieure formée de sable
fin et de silts non consolidés,
- Une série inférieure complexe, formée
de niveaux à épaisseurs très variables d'argile, de sable,
de silt et de graviers avec des noyaux gypseux et ferreux.
La nappe phréatique s'écoule de manière
convergente vers une dépression piézométrique
fermée située au nord dans le secteur compris entre Massaguet et
Moyto (Djoret (2000), Abderamane (2012)).
Globalement la région dispose d'une ressource en eau
satisfaisante avec un accès plus facile le long du Chari. Il peut
localement y avoir des zones moins productives, pouvant s'expliquer par la
présence de couches plus argileuses.
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
La nappe du pliocène
inférieur
On attribue au Pliocène inferieur les
dépôts sableux situés à une profondeur de 250-
350 m/sol dans la partie centrale du bassin du lac Tchad.
La formation aquifère du Pliocène est
composée d'une alternance de bancs sableux et argileux d'origine
fluviatile, de 5 à 10m d'épaisseur pour une épaisseur
totale d'environ 75m. Cette série se retrouve sur toute la zone du
bassin mais semble se biseauter vers le Sud et le Sud-ouest. C'est un
aquifère confiné dans le centre du bassin. L'écoulement se
fait du Sud-Est du bassin vers les pays bas au Nord-Est (Bouchez, 2015). La
nappe aquifère du pliocène a été mise en
évidence dans notre zone d'étude notamment par le forage
d'exploitation du marché à mil exécuté
jusqu'à 350m de profondeur en 2004 par Foraco.
II.3. Paramètres hydrodynamiques (Q, Q/S, K, T,
S)
La détermination de ces paramètres ne peut se
faire sans l'exécution de pompage d'essai de longue durée ou des
essais de puits. Une valeur moyenne de 6x10-3 m2/s de la
transmissivité de l'aquifère du quaternaire est proposé
sur la base des forages effectués dans le Chari Baguirmi (Schneider et
Wolff (1992)). La porosité varie beaucoup aussi avec une valeur
médiane autour de 10% (Bouchez. C, 2015).
Tableau 2: paramètres hydrodynamiques moyens de
la nappe de N'Djamena.
|
*Forages anciens
|
|
4.10-4< S<10-3
|
3.2.10-3<T<6.6.10-3
|
|
**Forages récents
|
40<Q<120
|
3.1.10-3<S<2.10-2
|
3.1.10-3<T<5.5.10-2
|
*valeurs moyennes de 6 anciens forages (Schneider et Wolff,
1992),
**valeurs moyennes de 5 forages récents (source :
Direction de l'hydraulique).
II.4. Qualité des eaux de nappe
La qualité des eaux destinées à la
consommation humaine doit respecter les normes de qualité
définies par le décret n°615/PR/PM/ME/2010 du 2
août2010 portant définition nationale de l'eau potable au Tchad et
les recommandations de l'OMS.
B. PRESENTATION DU LABORATOIRE NATIONAL DES
EAUX
Le Laboratoire National des Eaux (LNE) crée par la Loi
N°006/PR/2013 et basé à N'Djamena est la structure d'accueil
de notre stage ; et c'est là où nous avions effectué
toutes les analyses
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 24
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 25
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
durant cette étude. C'est un établissement
public à caractère scientifique, industriel et commercial
doté de la personnalité morale, juridique et jouissant d'une
autonomie de gestion. Placé sous la tutelle du Ministère en
charge de l'eau, il a pour mission de mettre en oeuvre la
stratégie du gouvernement en matière
d'études fondamentales et appliquées pour
la
caractérisation des eaux de surface et souterraines, l'analyse, le
contrôle, le suivi de la qualité de l'eau suivant les normes
requises pour tous les différents usages.
II.5. Les textes législatifs et
réglementaires Le cadre réglementaire
La synthèse chronologique des principaux textes
législatifs réglementant la gestion et la protection de l'eau de
consommation est la suivante :
La loi N° 016/PR/99 du 18 aout 1999, portant sur le code
de l'eau.
Les textes de 2002, complétés en 2007,
permettent l'organisation des services de gestion et d'exploitation des
ouvrages.
Par exemple, l'arrêté n° 28/MEE/DG/02 du 25
juin 2002 portant définition du cadre modèle de convention
particulière de transfert du pouvoir de délégation du
service public de l'eau potable de l'Etat à une collectivité
territoriale décentralisée.
Loi N°006/PR/2013, portant création du laboratoire
national des eaux (LNE).
Les textes de 2010 et 2011 fixent des normes de qualité
sur l'eau potable et des prescriptions techniques sur le matériel
d'hydraulique villageoise.
Par exemple, le décret n° 616/PR/PM/ME/2010 du 2
août 2010 portant procédure de contrôle et de suivi de la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Les textes de 2011 (nos 22 et 24) définissent certaines
conditions d'attribution des points d'eau entre autres. Il faut se dire que
l'application pose souvent problème.
DEUXIEME PARTIE : MATERIELS ET METHODES
La deuxième partie a pour objet la présentation
des différentes méthodes de traitement et d'analyse des
données mises en oeuvre pour mener à bien cette étude.
Elle concerne donc l'organisation des étapes de travail sur le terrain
et au laboratoire.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 26
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Chapitre III. MATERIELS ET METHODES
CADRE DE L'ETUDE
Le cadre de l'étude est constitué par les points
d'eau (forages) situées à travers la ville de N'Djamena. Notre
étude n'a pas pris en compte les eaux de puits, les eaux
embouteillées et celles des fleuves .Les points d'eau
échantillonnés ont été choisies de telle
manière à couvrir l'ensemble de la zone d'étude. Au total
dix huit (18) prélèvements ont été faits pour les
analyses physico-chimiques et vingt huit (28) autres pour les analyses
bactériologiques pendant trois campagnes. Pour les analyses
physicochimiques, nous avions eu à faire deux campagnes de
prélèvements (10 prélèvements en mars 2018
concernant les forages P1 à P10 et 8 autres en septembre 2018 sur les
points d'eau P11 à P18). Pour les analyses bactériologiques, deux
campagnes (septembre 2017 et mars 2018) ont concernées les mêmes
points d'eau P1 à P10. Autrement dit, les sites P1 à P10 ont fait
l'objet de 2 prélèvements chacun en septembre 2017 et mars 2018.
Ensuite une dernière campagne `'bactériologique» (septembre
2018) nous a conduis à faire 8 prélèvements sur les 8
sites P11 à P18.
METHODOLOGIE
L'approche méthodologique a reposé sur une
étude descriptive. La base documentaire a été
constituée à partir de différentes bibliographies. Une
revue des données, articles, rapports et travaux existants relatifs
à divers domaines de la zone d'étude, complétée par
quelques travaux de thèses ayant trait au thème ont
été opérées.
Les analyses comprenaient donc 46 échantillons d'eau
prélevés exclusivement au niveau des forages des consommateurs
localisés par leurs coordonnées géographiques par GPS. Les
paramètres physico-chimiques comprenaient la turbidité, la
conductivité, le pH, les solides totaux dissouts, la température
mesurés in situ à l'aide d'une sonde multi-paramètres; Les
analyses chimiques des éléments majeurs (cations et anions) ont
été effectuées par la méthode volumétrique
par EDTA (dureté totale, dosage du Ca2+, Mg2+,
alcalinité, HCO3- et Cl-) ; par la
photométrie d'absorption à flamme ( Na+,
K+) ; les autres paramètres sont mesurés à
l'aide d'un spectrophotomètre d'absorption moléculaire de type
HACH DR/2800 de très grande précision au laboratoire national des
eaux à N'Djamena. Les analyses des paramètres microbiologiques
ont été faites sur un milieu gélosé dans le
même laboratoire. Elles étaient constituées des coliformes
totaux, Escherichia coli (E coui) et des entérocoques
fécaux.
.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 27
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
La méthodologie a consisté à
évaluer la non-conformité des paramètres analysés
par rapport aux normes issues de la directive de potabilité de l'eau
proposée par l'OMS [2008]. La qualité d'un échantillon
d'eau est déclarée non-conforme lorsqu'au moins un des 19
paramètres physicochimiques ou bactériologiques analysés
ne respectait pas la norme.
Tous les paramètres sont mesurés selon les
protocoles décrits par RODIER et al., 1996.
III.1. MATERIELS ET METHODES
III.1.1. Etudes de terrain
Matériels utilisés :
Outils de géoréférencement
:
- Deux GPS (global positioning systéme) manuel et tactile
de marque Garmin, pour
relever les coordonnées des points de mesure et leur
altitude, une carte de la ville de
Ndjamena à l'échelle 1/12 500, produite par l'AFD
en 2012.
Outils pour l'échantillonnage d'eau
:
- Une valise WTW(Watech), contenant un multi paramètre de
terrain WTW pour
mesurer les paramètres physico-chimiques
(température, conductivité et potentiel en
Hydrogène) ;
- Un conductimètre pour les mesures de la
conductivité,
- Un mètre ruban pour mesurer les repères des
forages (piédestal ou hors sol),
- Deux boites de gants jetables ; Une boite de cache-nez
(bavettes) ;
- Un bruleur pour le flambage des robinets des forages,
- 30 flacons en verre DURAN de 250 ml préalablement
lavés et stérilisés à l'aide d'un
autoclave à vapeur non acidifiés pour
prélever les échantillons d'analyse
bactériologique,
- 20 flacons en polyéthylène de 500 ml non
acidifiés pour prélever les échantillons
d'analyse d'anions et cations,
- Des marqueurs indélébiles pour étiqueter
les échantillons,
- Une glacière pour la conservation des
échantillons d'eau,
- Un carnet de terrain pour les prises de note.
Outils de mesure de niveau :
- Une sonde piézométrique, pour mesurer les
niveaux statiques dans les différents ouvrages,
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 28
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
- Un double décamètre pour mesurer la distance
entre les points d'eau et les toilettes. - Un mètre métallique
pour mesurer les repères (piédestal, hors sol ou tête de
forage). Des appareils :
- Un appareil photo numérique pour les prises de vue,
- Un ordinateur portable.
Les logiciels de cartographies :
- Arc Gis 10.1; surfer 8.
Les logiciels de calcul et d'analyse
:
- Microsoft Excel , XLSTAT 2007 et Diagrammes.
Logiciel pour réalisation de log
stratigraphique :
- GESFOR, Adobe illustrator et paints.
Logiciel de traitement de texte :
- Microsoft word.
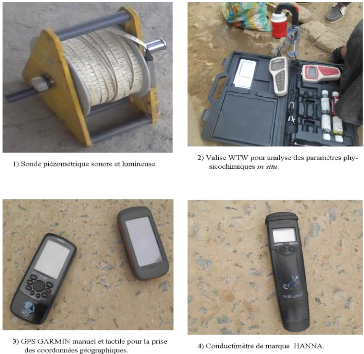
Figure 11: matériels utilisés sur le
terrain.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 29
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
III.1.2. Mesures des niveaux statiques
Les sites sur lesquels les mesures ont été
faites sont retenus avec comme souci, une répartition spatiale et
homogène sur toute la zone d'étude (figure 12). `'Une campagne
piézométrique» d'une semaine pendant la période des
basses eaux (mai- juin 2018) nous a emmené à faire des mesures
sur 40 forages, répartis dans les différents quartiers de la
ville de N'Djamena complétés par des données de 10 forages
de la STE (Société tchadienne d'eau) et 7 autres de la base de
données SITEAU. Ces mesures ont été faites à l'aide
d'une sonde lumineuse et sonore avec prise de coordonnées
géographiques sur chaque site.
Le mode opératoire consiste à introduire la
tête métallique de la sonde dans l'ouvrage ; au contact de la
surface de l'eau, elle déclenche un bruit sonore et le voyant lumineux
s'allume. La lecture est effectuée sur la graduation du ruban de la
sonde avec une précision de l'ordre de plus ou moins 5mm, et à
cette valeur lue (Niveau Statique), nous faisons la différence entre la
valeur mesurée par rapport au repère (piédestal le plus
souvent), suite à quoi nous retirons la hauteur du repère
(piédestal ou hors sol) pour obtenir le niveau par rapport au sol ; seul
bémol, la majeure partie de ces forages sont équipés de
pompes manuelles et ne disposent pas de regards pour le passage de la sonde ;
ce qui nous a emmené souvent à démonter
délicatement les pompes en question avant chaque opération pour
pouvoir introduire la sonde.
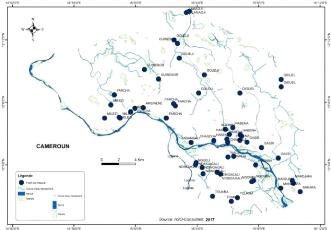
Figure 12: sites des mesures des niveaux
statiques.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 30
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena


Figure 13: méthodes d'acquisition des
données de terrain.
III.1.3.Echantillonnage de l'eau
? Protocole d'échantillonnage
d'eau
Au cours de trois campagnes de terrain d'une vingtaine de jours
(septembre 2017, 28 mars au 02 avril 2018 et septembre 2018), un total de 46
échantillons d'eaux a été prélevé, (28 pour
l'analyse bactériologique et 18 pour l'analyse physicochimique) tous
provenant des forages.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 31
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Les échantillonnages pour l'analyse physico chimique
ont été récupérés directement des forages
dans des flacons de 500 ml, et ont d'abord fait l'objet d'une analyse in
situ (mesure de PH, conductivité, température) avant
d'être ramenés au laboratoire dans les heures qui ont suivi les
prélèvements, et ce, afin d'éviter tout fractionnement
lié à l'évaporation ou la perte de vapeur d'eau par
diffusion, et/ou à un échange avec le milieu environnant ainsi
qu'avec le flacon.
Les échantillons destinés à l'analyse
bactériologique ont été prélevés avec le
plus grand soin dans les flacons stériles d'une contenance de 250 ml.
Les prélèvements ont été effectués à
l'aide de gants afin d'éviter le contact de l'échantillon avec la
main. Les robinets des forages ont été désinfectés
à l'alcool et à l'aide d'une flamme avant le
prélèvement. Les flacons sont étiquetés avec le nom
du point d'eau (quartier), la date de prélèvement, le type
d'ouvrage et l'heure du prélèvement. Les échantillons ont
été emballés et conservés dans une glacière
à 4°C et acheminés immédiatement au laboratoire
national des eaux à N'Djamena.
Enfin, dans le but de mieux apprécier les
caractéristiques physicochimiques et bactériologiques des eaux,
notre travail a été réalisé au niveau de 18 forages
comme nous l'avions mentionné, représentatifs (figure 14) de
notre zone d'étude à savoir :
|
+ P1 : situé à Ngueli,
+ P2 : à Dingagali,
+ P3 : à Toukra,
+ P5 : à Walia,
+ P6 : au niveau de l'AEP Chagoua,
+ P7 : à Gassi,
+ P8 : à Amkoundjara2,
+ P9 : à Amkoundjara1,
+ P10 : à Amtoukouin1
|
+ P11 : à Amriguébé,
+ P12 : à Ndjari Darsalam,
+ P13 : à Ndjari,
+ P14 à Ambatta,
+ P15 : à Amtoukouin 2,
+ P16 : à Sabangali,
+ P17 : à Farcha Djougoulié,
+ P18 : à Guinebor.
|
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 32
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
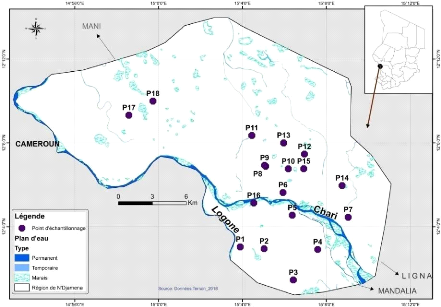
Figure 14: localisation des points d'eau (forages)
étudiés.
? Paramètres physico-chimiques mesurés in
situ.
Au nombre des paramètres physiques, on distingue la
température, la conductivité, et le pH. Ils sont mesurés
à l'aide d'un multi paramètre de type TWT et d'un kit
(conductimètre) de marque HANNA (voir figure 14).
III.1.4 études de laboratoire
III.1.5 réalisation des différentes coupes
lithologiques
Des corrélations litho-stratigraphiques suivant six
axes avec des orientations différentes (figure 15) ont été
réalisées à partir des documents de la STE et du bureau
d'études H2O-Consultants. Les profils utilisés sont nommés
(coupes lithologiques I, II, III, IV, V, VI) et seront décrit plus loin.
Ce travail a été réalisé en utilisant la lithologie
des anciens forages exécutés et suivi par différentes
entreprises et bureaux d'études.
Pour cette étude, les axes préférentiels
sont les suivants. Le premier, noté I (Farcha-Kartota), est
orienté suivant le Nord-ouest et le Sud-est et passe par 7 points d'eau
; l'axe II est orienté
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 33
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
selon le Sud -ouest et le Nord dans le septentrion de la zone
d'étude (Milezi-Guinebor); l'axe III est orienté suivant le
Nord-sud (Diguel Est- Toukra) et passe par 8 points ; l'axe IV
(Bakara-Boutalbagar) est orienté suivant le Sud-est et le Nord-ouest,
globalement à l'Est de la zone d'étude et passe par 3 points ;
l'axe V (Dingagali- Boutalbagar), est orienté selon la direction Sud-NE
de notre zone d'étude et enfin l'axe VI orienté suivant le SW-E
(Moursal-Boutalbagar).
Nous discuterons plus loin sur le choix de ces axes. Les sites
les plus éloignés sont sur un intervalle de 28 km et les plus
proches, moins de 1 km.
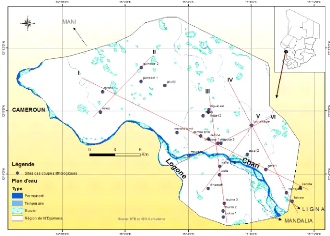
Figure 15:carte de la répartition des sites des
logs de la ville de N'Djamena.
III.1.6 Calcul du niveau
piézométrique
Le niveau piézométrique est un niveau d'eau
relevé dans un forage par un piézomètre. Il
caractérise la pression de la nappe en un point donné. La mesure
est ramenée au point 0 de la mer.
Autrement dit, c'est le niveau libre de l'eau observé
dans un puits ou forage rapporté à un niveau de
référence (nivellement). D'une certaine façon, il
correspond à la hauteur d'une colonne d'eau.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 34
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Le calcul du niveau piézométrique est
l'opération principale de l'inventaire de la ressource en eau
souterraine. Etant l'altitude du niveau d'eau, en équilibre naturel,
dans l'ouvrage, il est calculé par différence entre la côte
du sol (repère de l'ouvrage) z, et la profondeur de
l'eau, Hp. (H= z-Hp), (Castany, 1982). La profondeur de l'eau
dans l'ouvrage est mesurée par une sonde électrique et l'altitude
z par le GPS (Global Positionning System). Dans le cadre de cette étude
les valeurs des altitudes prises par le GPS ne sont qu'à titre
indicative compte tenu des incertitudes de mesures. Elles ont été
corrigées par le modèle de numérisation de terrain ASTER
(résolution 30 m×30 m).
III.1.7 Calcul du gradient hydraulique
Le gradient hydraulique noté (i) est le rapport entre
la différence de niveau piézométrique entre deux points de
la surface piézométrique par unité de longueur
mesurée le long d'une ligne de courant. Il est assimilable à la
pente de la surface piézométrique (Castany, 1982). C'est un
paramètre sans unité qui donne la différence
piézométrique par unité de longueur. La
détermination du gradient hydraulique se fait en appliquant la formule
suivante : i = ÄH/L ; Connaissant les niveaux piézométriques
de deux points A et B et la distance qui les séparent, on peut
déterminer le gradient hydraulique (i). i = (HA-HB)/L. Il permettra
d'identifier le sens de l'écoulement et de caler l'équidistance
lors du tracé de la carte piézométrique.
Pour notre cas, si nous prenons Farcha (HF=285m) et Lamadji
(HL=271) distant de L=12km= 12 000m, le gradient hydraulique (i) donnera : i =
ÄH/L = 285-271/12 000= 0,0011667.Le gradient est extrêmement
faible.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 35
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena


Figure 16: vue de quelques matériels et
dispositifs utilisés au laboratoire.
III.1.8 Matériels et dispositifs pour l'analyse
bactériologique Pour cette analyse, nous avons utilisé
les matériels suivant :
- Hotte, dispositif comportant une lampe UV utilisé pour
la désinfection de l'aire de
travail,(figure 16).
- Autoclave pour stériliser le matériel et le
milieu,
- Etuve réfrigéré pour l'incubation des
milieux de culture,
- Bain marie, milieu de culture,
- Membranes filtrantes,
- Microscope optique pour le dénombrement des germes.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 36
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
III.1.9 Méthode d'analyse, procédure et
modes opératoires
Pour l'acquisition des méthodes d'analyses de l'eau et
dans le but d'avoir des résultats à
Interpréter pour ce mémoire de fin
d'étude, nous avions eu à effectuer un stage pratique au niveau
du laboratoire national des eaux à N'Djamena, ce qui nous a permis de
nous familiariser à nouveau avec les méthodes classiques
d'analyses mais surtout de découvrir de nouvelles méthodes
innovantes telles que le DR ou spectrophotométrie d'absorption
moléculaire. Au cours de ce stage donc, nous avions fait les analyses de
46 échantillons d'eau prélevés dans la zone
d'étude. Nous avions jugé utile de décrire de
manière succincte les méthodes et modes opératoires de ces
analyses physico-chimiques et bactériologiques afin de nous permettre
d'apprécier et d'avoir un oeil critique sur la fiabilité des
résultats bien que ces méthodes soient validées par le
Ministère de l'Eau. Notons que les différentes analyses sont
effectuées au plus tard 24h après le
prélèvement.
Les paramètres à analyser et méthodes
d'analyse
? Paramètres physico-chimiques
Au nombre des paramètres physiques, on distingue la
température, la conductivité, le pH et le TDS. Ils sont
mesurés à l'aide d'un multi paramètre de type TWT et d'un
kit (conductimètre) de marque HANNA.
? Paramètres chimiques
Les paramètres chimiques déterminés sont
: la dureté calcique et magnésienne, le calcium (Ca2+),
le magnésium (Mg2+), le potassium (K+),
l'ammonium (NH4+), le sodium (Na+), les
nitrates (NO3-), les sulfates
(SO42-), les chlorures (Cl-) et les
bicarbonates (HCO3-), le fer (Fe), le manganèse
(Mn).
Les méthodes de dosage sont colorimétriques par
spectrophotométrie d'une part et par la méthode
volumétrique d'autre part. La méthode volumétrique est
utilisée pour les ions Ca2+, Mg2+,
HCO3- et Cl-. Les autres paramètres
sont mesurés à l'aide d'un spectrophotomètre de type HACH
DR/2800.
? Dosage des paramètres physico-chimiques ?
Détermination de la dureté totale
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 37
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Pour effectuer le dosage de la dureté calcique, on
prélève 50 ml de l'échantillon à analyser dans une
fiole jaugée de 50 ml. On ajoute 5 gouttes du NET (Noir d'Eriochrome T)
accompagné d'une solution titrée d'EDTA.
> Détermination de la dureté calcique
> Les ions calcium sont dosés par la méthode
complexométrique à l'EDTA. En effet, les alcalino terreux
présents dans l'eau sont amenés à former un complexe du
type chélate par le sel di sodique de l'EDTA (Acide Ethylène
Diamine Tétra Acétique).
> Détermination de la dureté
magnésienne
Elle est déterminée par la différence entre
la dureté totale et la dureté calcique.
> Dosage des chlorures par la méthode
volumétriques au nitrate d'argent
Les chlorures sont dosés en milieu neutre par une
solution titrée de Nitrate d'argent (incolore mais noircissant à
la lumière) en présence de Bichromate de Potassium
(Méthode de Mohr).
> Dosage des bicarbonates par la méthode
volumétrique avec indicateur coloré Les bicarbonates sont
dosés par la méthode volumétrique. Elle est basée
sur la neutralisation d'un certain volume d'eau par un acide minéral
dilué (acide sulfurique par exemple) en présence d'un indicateur
mixte.
> Dosage d'ammonium par la spectrophotométrie
d'absorption moléculaire
Le dosage de l'ammonium a été fait par la
méthode de Nessler. Au cours du dosage, le stabilisant minéral
complexe la dureté dans l'échantillon. L'agent dispersant,
l'alcool polyvinylique aide à la formation de la coloration dans la
réaction de Nessler avec les ions ammonium. Une coloration jaune
proportionnelle à la concentration de l'ammoniac se forme.
> Dosage des nitrates par la spectrophotométrie
d'absorption moléculaire
La méthode de réduction au cadmium est
utilisée pour le dosage des nitrates. Le domaine d'application se situe
entre 0,3 à 30,0 mg/L en NO3--N. Des concentrations plus
élevées peuvent être déterminées en
procédant à des dilutions. Le cadmium réduit le nitrate
dans l'échantillon en nitrite. L'ion nitrite réagit avec l'acide
sulfanilique pour former un sel de diazonium intermédiaire. Ce sel
réagit avec l'acide gentisique pour former un complexe coloré
ambré. La lecture est obtenue à 500 nm.
> Dosage des sulfates par la spectrophotométrie
d'absorption moléculaire
Les sulfates sont dosés par la méthode sulfaVer4
(réactifs en gélules). Le domaine d'application se situe entre 2
et 70 mg/L. Des concentrations plus élevées peuvent être
déterminées en procédant à des dilutions. Les ions
sulfate réagissent avec le baryum du réactif
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 38
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
SulfaVer4 pour former un précité de sulfate de
baryum insoluble. L'intensité de turbidité est proportionnelle
à la concentration en sulfate. Le réactif SulfaVer4 contient
aussi un agent stabilisant pour maintenir le précipité en
suspension. La lecture est obtenue à 450 nm.
? Le dosage du sodium et du potassium sont effectué
grâce au photomètre d'absorption à flamme.
? Dosage de la turbidité par la
spectrophotométrie d'absorption moléculaire
La méthode néphélométrique fait
appel à des turbidimètres pour la mesure de la dispersion ou de
l'atténuation de la lumière. La turbidité d'une eau est
due à la présence des matières en suspension finement
divisées : argile, limons grains de silice, matières organique
etc. Elle donne une idée sur la teneur en matières
colloïdales et en suspension dans l'eau. La turbidité se fait par
la méthode néphélométrique basée sur la
dispersion ou l'atténuation de la lumière incidente.
III.1.10 Analyse des paramètres
bactériologiques
L'objectif de l'analyse bactériologique d'une eau est
de rechercher des germes qui sont susceptibles d'être pathogènes,
ou des germes qui sont indicatrices de contaminations fécales. Selon
Rodier, cette analyse sert essentiellement au contrôle des eaux de
boisson qui ne doivent contenir aucun germe pathogène.
Généralement les normes de qualité bactériologique
des eaux de boisson se fondent sur le nombre de germes aérobies
mésophiles appelés couramment `'germes totaux» et sur la
présence des microorganismes non pathogènes en eux même,
mais servant d'indicateurs d'une contamination fécale d'origine humaine
ou animale. Ainsi les indicateurs utilisés sont le groupe de
bactéries des coliformes totaux (Escherichia coui) et les
entérocoques. Les eaux de boissons ne doivent pas contenir plus de 10
germes par ml (germes totaux), aucun E. coui, aucun entérocoque
par 100 ml. L'analyse bactériologique doit être effectuée
au plus tard 24h après le prélèvement pour éviter
l'effet de la lumière et de la température nocif sur la survie
des microorganismes.
Le matériel utilisé lors de ces analyses doit
être stérile pour éviter toute source de contamination.
Germes recherchés
Nous avons effectué pendant notre travail la recherche
des germes indicateurs de pollution qui sont :
- Les coliformes totaux
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 39
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
- Les coliformes fécaux
- Les entérocoques fécaux
- Les flores aérobies totales (à titre
indicatif).
III.1.11 Protocole et méthodes d'analyse
bactériologique
Une analyse bactériologique en milieu solide et/ou
liquide pour le dénombrement des germes respecte les étapes
suivantes :
- Une préparation du milieu de culture,
- Un ensemencement,
- Et une interprétation tel que décrit par
Rodier.
Les milieux de culture utilisés au laboratoire national
de l'eau sont de trois
types :
? Nous avions le chromocult (gélose) qui isole les
coliformes totaux, fécaux et E.coli.
? Le milieu (S) Stanetz et Barley qui isole les
entérocoques ;
? Le milieu (P) qui isole les flores meso-aero totales.
Les échantillons sont préalablement filtrés
aux membranes.
Méthode de la Membrane Filtrante
La méthode utilisée c'est le dénombrement
par filtration sur membrane qui retient les microorganismes. Le mode
opératoire est le suivant :
Après avoir filtré sous vide 100 ml de
l'échantillon sur une membrane millipore stérile, dont la
porosité est de 0,45 ìm, cette dernière est
déposée sur le milieu de culture spécifié pour
chaque germe recherché, puis incubé dans la température
optimal pour la multiplication des germes.
Durant l'incubation, des colonies se forment à la surface
de la membrane.
Germes test de contamination fécale
Pour les coliformes, le milieu de culture utilisé c'est le
Tergitol 7 agar au TTC et
l'incubation se fait pendant 24 à 48 heures à
une température de 37°C pour les coliformes totaux et de 44°C
pour les coliformes fécaux. Pour les streptocoques fécaux, le
milieu de culture utilisé c'est le milieu m-Enterococcus et l'incubation
se fait pendant 24 heures à une température de 37°C.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 40
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
La flore mésophile aérobie totale (FMAT) a
été recherchée par la méthode d'ensemencement en
profondeur. La culture des FMAT a été réalisée sur
milieu LB (Luria Bertani) et incubée à 37°C pendant 24
heures.
Les colonies jaunes-orange sont comptées comme des
coliformes, les colonies rouges ou rouges brique sont comptées comme des
streptocoques fécaux. Les résultats de dénombrement sont
exprimés en unité formant colonies (UFC) par 100 ml. Et les
colonies blanchâtres pour la FMAT, les résultats de
dénombrement sont exprimés en unité formant colonies (UFC)
par ml.
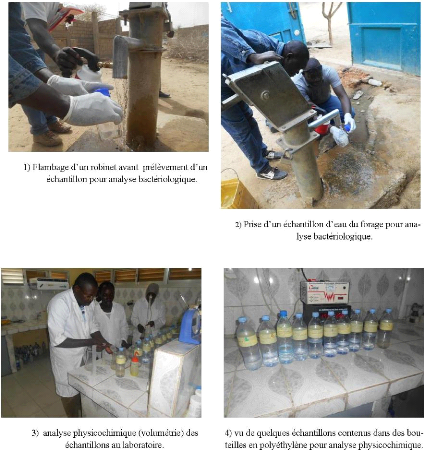
Figure 17: opérations de
prélèvements d'échantillons sur le terrain et d'analyses
au
laboratoire.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 41
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
III.1.12 Les méthodes
d'interprétation:
Dans cette étude pour l'interprétation des
résultats d'analyses, nous avons fait recours aux méthodes
suivantes :
-Cartographie de l'évolution des paramètres physico
chimiques : conductivité électrique, teneur en chlorure, teneur
en nitrates... par l'emploi du logiciel Arc GIS 10.
-Détermination du faciès chimique de la nappe par
les diagrammes de Piper et de Scholler-Berkaloff avec le logiciel Diagramme.
-Enfin, étude de la qualité de la nappe à
l'alimentation par la comparaison des résultats avec les normes de l'OMS
avec le logiciel Diagramme.
Analyse et traitement des données
L'analyse et le traitement statistique des données sont
rendus possible grâce : au logiciel Microsoft Excel utilisé pour
la codification des données et des résultats d'analyse du
laboratoire, au logiciel Arc GIS 10.1 utilisé pour le positionnement des
points de prélèvement ainsi que la situation géographique
des points d'eau de notre étude et XLSTAT pour la comparaison des
éléments chimiques par corrélation.
Limite de l'étude
Au cours de nos travaux de terrain, certaines difficultés
ont été rencontrées. Aux nombres desquelles on peut citer
:
- la réticence de certains utilisateurs pour le
démontage des pompes nécessaire pour les mesures de niveau
d'eau,
- des moyens logistiques et techniques très limités
pour approfondir les recherches notamment pour le prélèvement
d'échantillons supplémentaires etc.
- des essais de débits susceptibles de nous édifier
sur les paramètres hydrodynamiques et du coup sur la
vulnérabilité de la zone d'étude, peu nombreux,
- bref, des moyens financiers assez limités.
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
III.2 RESULTATS:
Les résultats sont la finalité ou l'aboutissement
de notre recherche et la base de notre discussion.
Pour la présente étude, les résultats sont
énumérés ci-dessous.
Tableau 3: résultats des paramètres
hydrodynamiques de quelques points d'eau de la ville de N'Djamena. (Source
: H2O-Consultants 2018).
|
Quartier
|
Transmissivité
(m2/s)
|
Debit
spécifique
(m3/h/m
)
|
Coefficient
d'emmagasinement*
(%)
|
Perméabilité** (m/s)
|
|
Walia (STE)
|
1,26x10-2
|
12,95
|
20
|
8,4x10-4
|
|
Mandjafa
|
1 ,1x10-2
|
10,81
|
20
|
1,8x10-3
|
|
Ndjari1
|
7,18x10-3
|
6,78
|
10
|
5,9x10-4
|
|
Ndjari (STE)
|
1,07x10-2
|
10,89
|
20
|
7,13x10-4
|
|
Toukra
|
1,18x 10-2
|
12,25
|
15
|
1,96x10-3
|
|
Moyenne
|
5,3x10-2
|
10,73
|
17
|
1,18x10-3
|
*les valeurs du coefficient d'emmagasinement
(ou porosité efficace en nappe libre) données à titre
indicatif, sont exprimées en fonction de la lithologie des terrains
aquifères observée et en corrélation avec le tableau de
CASTANY (tableau 5).
**les valeurs de la perméabilité sont
calculées sur la base de la formule : T= k.b => k=T/b
Avec : T : transmissivité en (m2/s), b :
épaisseur de la nappe mouillée (ici longueur des crépines)
en (m) et K coefficient de perméabilité en (m/s).
Tableau 4: valeurs de la porosité efficace moyenne
pour les principaux réservoirs (CASTANY, G. 1982).
|
Types de réservoirs
|
Porosité efficace
|
Types de réservoirs
|
Porosité efficace
|
|
(%)
|
|
(%)
|
|
Gravier gros
|
30
|
Sable gros
|
20
|
|
Gravier moyen
|
25
|
Sable moyen
|
15
|
|
Gravier fin
|
20
|
Sable fin
|
10
|
|
Gravier+sable
|
15 à 25
|
Sable très fin
|
5
|
|
Alluvions
|
8 à 10
|
Sable gros+silt
|
5
|
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page
42
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 43
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
III.2.1. Résultat des corrélations des
coupes litho- stratigraphiques
Dans cette partie de la représentation
géologique de terrain, nous allons décrire sommairement les
différentes structures géologiques des forages de la zone
d'étude et d'essayer de voir s'il ya une corrélation
lithologique, ensuite nous allons mettre en exergue l'allure des niveaux
piézométriques et d'identifier le substratum (ou mur de
l'aquifère), voire estimer sa profondeur au niveau de chaque point
d'eau. Ce qui nous permettra par la suite de déterminer la
géométrie globale et la structure de la nappe d'eau souterraine
de N'Djamena.
notre zone d'étude se trouve sur le bassin
sédimentaire du Tchad, réputé être strictement
continental (Moussa, A, 2010) ; le remplissage de ce bassin s'est fait durant
les différentes phases de sédimentation. Du point de vue
lithologique, les forages montrent de grandes entités
sédimentaires très hétérogènes et
comprennent, des séries fluviatiles, lacustres, voire deltaïques.
La lithologie présente des variations latérales de faciès
qui rend des corrélations difficiles. La nappe aquifère de notre
zone d'étude se trouve dans des formations sableuses ou
sablo-argileuses. Le niveau piézométrique baisse du Sud vers le
Nord.
Coupe lithologique N° I :
La coupe N°I montre des alternances verticales rapides
entre les dépôts fluviatiles (sable) et les dépôts
lacustres (argile) sur les 8 sites représentés,
caractéristiques de conditions de sédimentation du quaternaire
ancien. Cependant, nous remarquons une dominance des séries fluviatiles
allant jusqu'à 70 à 80% (secteur Dembé et Farcha). A Gassi
1 et 2, Kartota voire Chagoua1, nous observons un équilibre parfait
entre les séries lacustres faites d'argile, d'argile sableuse en
alternance avec des séries fluviatiles allant du sable fin à
moyen, du sable argileux. La surface piézométrique tend à
baisser du SE vers le NW, nous remarquons cependant sur la coupe une
légère hausse sur le site du marché à mil, lequel
site comportant un forage profond captif. Le mur ou substratum de la nappe du
quaternaire est observé à 51m au marché à mil et
seulement (vraisemblablement) autour de 43m à Kartota. Il n'est pas
visible sur certains logs.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 44
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena

Figure 18: coupe lithologique
Farcha-Kartota.
Coupe lithologique N° II
Sur la coupe II, les séries sableuses sont dominantes,
la surface de la nappe décroit vers le nord, le mur de la nappe est
identifié à 60m à Milezi et 55m à Guinebor2 (voir
figure 19).
Coupe lithologique N°III
Sur la coupe N°III , nous observons une
prédominance des séries argileuses à Ndjari STE, ce qui se
traduit par une valeur de transmissivité ( 7,18x10-3
m2/s) inférieure aux autres sites. Cette tendance est aussi
mise en évidence à Diguel Est, Chagoua1 et Walia STE où
les séries argileuses sont importantes. Dans le secteur Toukra par
contre, les séries sableuses sont omniprésentes ; la surface du
niveau piézométrique diminue globalement du Sud vers le Nord
(voir figure 20).
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 45
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
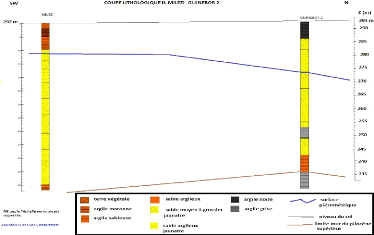
Figure 19: coupe lithologique Milezi-
Guinebor2.
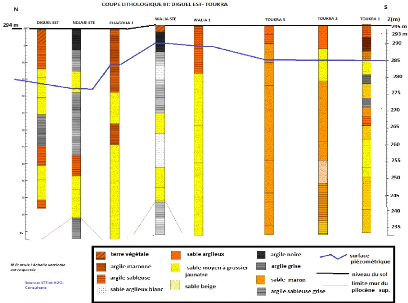
Figure 20: coupe lithologique Diguel Est-
Toukra.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 46
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Coupe lithologique N°IV
Cet axe regroupe des sites à l'Est de la zone
d'étude, sites caractérisés par une dominance des
formations sablo-argileuses ; l'aquifère est cependant contenue dans du
sable moyen à grossier. Dans ce secteur, le mur de la nappe se trouve
autour de 45m.

Figure 21: coupe lithologique Boutalbagar-
Bakara.
Coupe lithologique N° V
Le profil de cette coupe est orienté S-NE, à
Dingagali, la lithologie est dominée par des séries sableuses et
le niveau de la nappe est presque affleurant pendant la saison des pluies ;
à Walia -STE les formations argileuses sont dominantes, cependant la
nappe aquifère est logée dans
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 47
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
de séries sableuses (sable grossier) avec une
excellente transmissivité (1,26x10-2 m2/s), le mur
de la nappe est identifié aux alentours de 52m. Globalement le niveau
piézométrique décroit fortement de Dingagali à
Boutalbagar ; le mur lui, remonte plutôt et est identifié à
environ 45m à Boutalbagar qui est dominé par des formations
sableuses.
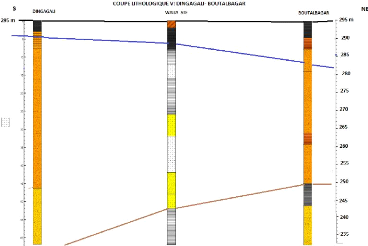

Figure 22: coupe lithologique Dingagali-
Boutalbagar.
Coupe lithologique N° VI
Comme pour les autres coupes, nous remarquons ici une
alternance entre l'argile, l'argile sableuse, le sable moyen à grossier
et le sable argileux. A Chagoua, les 20 premiers mètres sont argileux et
le mur n'est pas visible. A Moursal, le mur est identifié à
55métres. Le niveau piézométrique est presque constant sur
ce profil.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 48
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
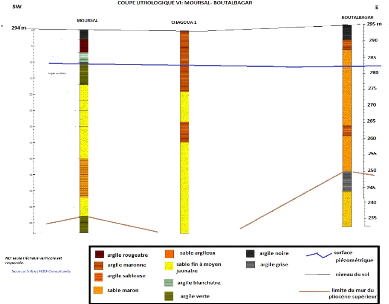
Figure 23: coupe lithologique Moursal-
Boutalbagar.
III.2.2. Relation entre la lithologie et la contamination
bactériologique des points d'eau Les sites à dominance
sableuse, perméable, transmissive où le niveau de la nappe est
sub-affleurant sont à priori vulnérables à une
contamination bactériologique comme l'ont démontré
Abderamane et al (2017) dans des travaux antérieurs dans notre
zone d'études. En effet, les quartiers longeant le fleuve Chari comme
Walia, Dingali, Chagoua, Gassi
( transmissivité moyenne de l'ordre de
1,3x10-2 m2/s) voire Farcha ont un terrain propice
à la contamination de la nappe compte tenu de la structure de leur zone
non saturée assez poreuse. Les cartes thématiques de
vulnérabilité élaborées à cet effet, par
Abderamane et al (2017) confirme cet état de
fait. Le recouvrement supérieur de la nappe n'est pas entièrement
imperméable et est le plus souvent sableux (Walia, Gassi, Farcha), le
niveau statique faible (4m à Dingagali) entre autres. Cela impacte sur
la contamination bactériologique comme nous verrons plus loin.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 49
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
III.2.3. levé des niveaux statique et
piézométrique
Les mesures des niveaux statiques ont été faites
pendant la période de basses eaux, en avril, mai et juin 2018. Les NS
varient de 4,29m à 22 ,50m ; tandis que les niveaux
piézométriques eux, oscillent entre 271m à 289m. Les
résultats sont consignés dans le tableau en annexe 2.1.
III.2.4 piézométrie de la nappe de
N'Djamena
L'étude piézométrique d'une nappe fournit
des renseignements de première importance sur les
caractéristiques de l'aquifère. Elle permet en particulier,
d'apprécier de façon globale les conditions d'écoulement
des eaux souterraines, ainsi que leurs conditions d'alimentation et de
drainance, et la variation de leurs réserves (ERIC GILLI et
al.2012).
Les études piézométriques
nécessitent de disposer d'un nivellement très précis de
points d'observation (puits, forage, piézomètre, sources) qui
permet de garantir la précision dans l'établissement des cartes
piézométriques. Celle-ci est tracée par interpolation
(kirgeage) entre les cotes relevées, sur la base des courbes
hydro-isohypses (ligne d'égale altitude de la surface
piézométrique) dont la qualité et l'équidistance
dépendent de la densité des points de mesure et de
l'échelle d'étude adoptée.
Le résultat de cette étude
piézométrique est représenté par les cartes
piézométriques ci-dessous (figures 24 et 25) obtenue par
l'utilisation des logiciels Arc Gis version 10 et surfer 8. La carte
piézométrique d'une nappe permet une vision instantanée de
son état à un moment précis. Elle sera donc établie
durant une période très courte, pour être
représentative sur l'ensemble du secteur couvert de conditions
identiques vis-à-vis des influences locales et des
événements périphériques (débit,
pluviométrie).
La surface piézométrique s'interprète, de
la même façon qu'une surface topographique, par sa morphologie, sa
pente ses variations intimes et ses anomalies
.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 50
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena

Figure 24:carte piézométrique de la ville
de N'Djamena obtenue par Arc Gis10.
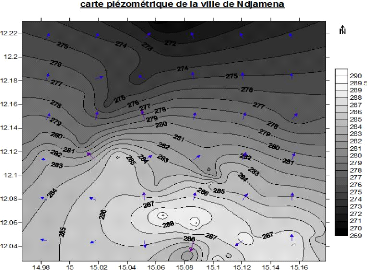
Figure 25: carte piézométrique de la ville
de N'Djamena obtenue à partir de surfer 8.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 51
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
III.3.RESULTATS DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
Le chimisme naturel des eaux dépend essentiellement de
la composition lithologique des milieux traversés et du temps de
séjour. Les résultats des analyses physico-chimiques des eaux de
la nappe de N'Djamena, ont montré une grande variation des
concentrations des éléments chimiques. Cependant, ces
dernières dépassent rarement les normes de potabilité.
III.3.1. Les paramètres
physico-chimiques:
Il s'agit des paramètres facilement mesurables et utiles
pour la détermination de l'état chimique des polluants dans
l'eau.
La température de l'eau
La température de l'eau est un facteur important dans
l'environnement aquatique du fait qu'elle régit la presque
totalité des réactions physiques, chimiques et biologiques. Dans
la zone d'étude, la température mesurée in situ a
présenté de faibles variations d'un point à un autre avec
un minimum de 29,1 °C (aux points P2 et P5) et un maximum de 31 °C
(point 7). Ces valeurs restent acceptables pour les normes OMS et tchadienne de
potabilité.
Le pH
Le pH de l'eau renseigne sur son acidité et son
alcalinité. Selon les recommandations de l'OMS, le pH des eaux
naturelles est généralement compris entre 6,5 à
9.Habituellement, les valeurs du pH se situent entre 6 et 8,5 dans les eaux
naturelles. La nature des terrains traversés par les eaux est la cause
naturelle, provoquant des variations importantes du pH. L'analyse de ces eaux a
dévoilé que le pH est proche de la neutralité, au niveau
de l'ensemble des points d'eau, les valeurs moyennes du pH au niveau de la zone
d'étude ont été dans les normes de potabilité de
l'eau souterraine, sauf dans les deux sites de Amkoundjara ( P8 et P9)
où les pH donnent des valeurs de 6,3 et 6 ,21 avec un maximum de 7,87 au
point (11).
La conductivité électrique des
eaux
La conductivité électrique désigne la
capacité de l'eau à conduire un courant électrique. Elle
est déterminée par la teneur en substances dissoutes, la charge
ionique, la capacité d'ionisation, la mobilité et la
température de l'eau. Par conséquent, la conductivité
électrique renseigne sur le degré de minéralisation d'une
eau. Les eaux des points contrôlés sont
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 52
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
moyennement minéralisées (Figure 26), avec des
valeurs qui oscillent entre 142 ìS/cm au point(5) et 969 ìS/cm au
point P9 et un pic de 1228 ìS/cm au point P3.

Figure 26:carte de la répartition de la
conductivité des eaux souterraines à N'Djamena
Les solides totaux dissous
Le TDS signifie total des solides dissouts et
représente la concentration totale des substances dissoutes dans l'eau.
Le TDS est composé de sels inorganiques et de quelques matières
organiques. Les sels inorganiques communs trouvés dans l'eau incluent le
calcium, le magnésium, le potassium et le sodium qui sont tous des
cations et des carbonates, nitrates, bicarbonates, chlorures et sulfates qui
sont tous des anions.
Ces minéraux peuvent provenir des sources d'eau
minérales contenus dans l'eau avec un taux élevé de
solides dissouts parce qu'elles ont coulé à travers des
régions où les roches contiennent beaucoup de sel. Dans la zone
d'étude, nous avons un minimum de 71mg/l au point (P5) et un maximum de
564 mg/l au point (P3).
La turbidité
La turbidité est due à la présence des
particules en suspension, notamment colloïdales (argiles, limons, grains
de silice, matière organique...), l'abondance de ces particules mesure
son degré de turbidité. Celle-ci sera d'autant plus faible que le
traitement de l'eau aura été
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 53
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
efficace. Dans notre zone d'étude, la turbidité
donne des valeurs de 0 NTU au point 7 et 10 et de 6,7 NTU au point P9 où
l'eau est très turbide.
La dureté totale (CaCO3)
Elle correspond à la somme des concentrations en
cations métalliques à l'exception de ceux des métaux
alcalins et de l'ion hydrogène. Dans la plupart des cas, la
dureté est surtout due aux ions Ca2+ et Mg2+
auxquels s'ajoutent quelques fois les ions ferreux, aluminium,
manganèse, strontium. Dans notre étude, elle a une valeur
minimale de 64 mg/l au P4 et une valeur maximale de 300 mg/l au P3. L'eau de
toukra, et amkoundjara est dure.
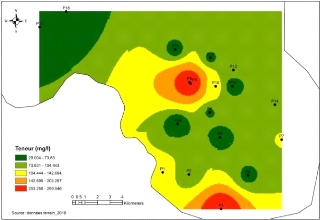
Figure 27:carte de la répartition des
duretés des eaux souterraines dans la ville de
N'Djamena.
Les sulfates
Dans les conditions naturelles, les sulfates, forment de
soufre dissous la plus répandue dans les eaux naturelles, ils ont
essentiellement deux origines : géochimique et atmosphérique. Du
fait de la solubilité élevée des sulfates, l'eau
souterraine en conditions normales peut en contenir jusqu'à 1,5 g/L.
L'oxydation des sulfures ainsi que la dégradation de la biomasse dans le
sol constituent d'autres sources possibles. De nombreuses activités
humaines et naturelles peuvent générer des apports de sulfates
dans l'eau souterraine : application d'engrais sulfatés,
précipitations chargées en dioxyde de soufre, etc... Les valeurs
des sulfates dans les eaux étudiées oscillent entre 4mg/L au
point P5 à 51mg/L au point P3 (Figure 28).
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 54
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
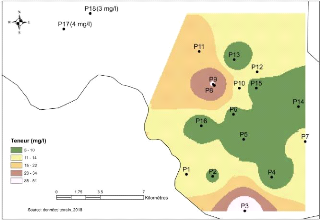
Figure 28:carte de la répartition des sulfates des
eaux souterraines dans la zone d'étude.
Bicarbonates :
La teneur en bicarbonates dans les eaux souterraines
dépend surtout de la présence des minéraux
carbonatés dans le sol et l'aquifère, ainsi que la teneur en CO2
de l'air et du sol dans le bassin d'alimentation. Les teneurs en bicarbonates
des points étudiés (figure 29) varient globalement entre un
minimum de 36 mg/L au point P18 et un maximum de 439,2 mg/L au P3.

Figure 29:carte de la répartition des bicarbonates
des eaux dans la ville de N'Djamena.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 55
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Le calcium :
Le calcium est généralement
l'élément dominant des eaux potables et sa teneur varie
essentiellement suivant la nature des terrains traversés (terrain
calcaire ou gypseux). Les teneurs en calcium des eaux contrôlées
(Figure 30) varient de 16,1 mg/L (P2) à 80 mg/L au point P9.
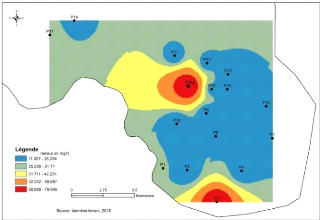
Figure 30: carte de la répartition du calcium des
eaux souterraines dans la ville de
N'Djamena.
Chlorures :
Les chlorures sont des anions inorganiques importants contenus
en concentrations variables dans les eaux naturelles,
généralement sous forme de sels de sodium (NaCl) et de potassium
(KCl). Ils sont souvent utilisés comme un indice de pollution. Les
chlorures existent dans toutes les eaux à des concentrations très
variables. L'origine peut être naturelle :
- Percolation à travers des terrains salés ;
- Infiltration des eaux marines dans les nappes
phréatiques et profondes ;
- Effet de l'activité humaine ;
- Industries extractives et dérivées
(soudières, salines, mines potasse, industries
pétrolières...).
Les teneurs en chlorures des échantillons d'eau
analysés (Figure 31) affichent des valeurs oscillant entre 1mg/L au
point (P18) et 48 mg/L au point (P3). Tous les points d'eau analysés
sont conformes aux normes, étant donné que la concentration en
chlorures est inférieure à celle recommandée par les
normes OMS et tchadienne dans le cas des eaux souterraines et qui est de
l'ordre de 250 mg/L. Par ailleurs, la minéralisation des eaux
souterraines augmente généralement avec le sens de
l'écoulement qui est ici du sud vers le Nord.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 56
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
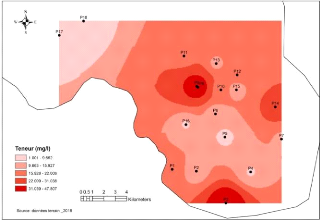
Figure 31: carte de la répartition des chlorures
des eaux souterraines de la ville de
N'Djamena.
Magnésium
La majorité des eaux naturelles contiennent
généralement une petite quantité de magnésium, sa
teneur dépend de la composition des roches sédimentaires
rencontrées. Il provient de l'attaque par l'acide carbonique des roches
magnésiennes et de la mise en solution du magnésium sous forme de
carbonates et bicarbonates. Dans les points d'eau analysés (Figure 32),
les teneurs en magnésium varient entre 2,4 et 24,3 mg/L, et toutes les
valeurs ne dépassent pas les normes OMS.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 57
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
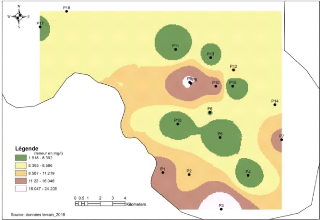
Figure 32: carte de la répartition du
magnésium des eaux souterraines dans la ville de
N'Djamena.
Sodium
Le sodium est un élément dit conservatif car une
fois en solution, aucune réaction ne permet de l'extraire de l'eau
souterraine. Les précipitations apportent une quantité de sodium
minime dans l'eau souterraine, les teneurs anormalement élevées
peuvent provenir du lessivage de sels, ou de la percolation à travers
des terrains salés ou de l'infiltration d'eaux saumâtres.
L'analyse des données a montré que les teneurs moyennes en sodium
dans les eaux des points étudiés varient de 12 mg/L à 81
mg/L (Figure 33).
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 58
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
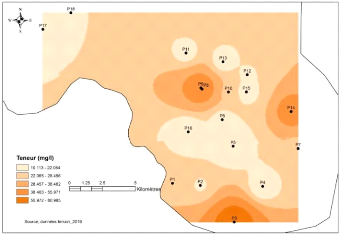
Figure 33: carte de la répartition du sodium
dans la ville de N'Djamena.
Potassium
Le potassium est généralement
l'élément majeur le moins abondant dans les eaux après le
sodium, le calcium et le magnésium ; Le potassium se rencontre sous
forme de chlorures doubles dans de nombreux minerais tels que la corrollite et
la sylvinite. On le trouve également dans les cendres des
végétaux sous forme de carbonate. Le potassium est un
élément indispensable à la vie et notamment à la
croissance des végétaux. La teneur en potassium est presque
constante dans les eaux naturelles. Celle-ci ne dépasse pas
habituellement 10 à 15 mg/L. Sa concentration dans les points d'eau
contrôlés (Figure 34) varie entre 0 ,5 mg/L et 8 mg/L ; ce qui est
dans les normes OMS. La valeur la plus élevée en potassium est
enregistrée au point (P3).
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 59
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena

Figure 34: carte de la répartition du potassium
dans la ville de N'Djamena.
Nitrates
Les nitrates constituent le stade final de l'oxydation de
l'azote organique, leur présence dans une eau polluée atteste que
le processus d'auto-épuration est déjà entamé.
L'activité humaine accélère le processus d'enrichissement
en cet élément sur les sols subissant l'érosion, ce qui
provoque l'infiltration des eaux usées, par les rejets des industries
minérales et d'engrais azoté. Dans les sites
étudiés et comme il est indiqué sur la figure (35), les
teneurs en nitrates varient entre 1,3 mg/L et 17 mg/L. Elles n'ont pas
dépassé les normes OMS. Les valeurs les plus
élevées sont enregistrées à Ngueli (P1) où
on note à proximité un abattoir.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 60
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
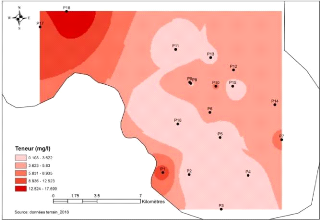
Figure 35: carte de la répartition des nitrates
dans les eaux de la ville de N'Djamena.
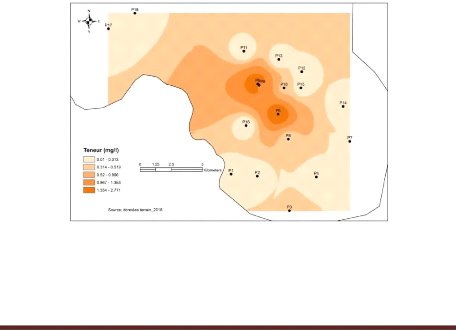
Figure 36: carte de la répartition du fer à
N'Djamena.
Fer : les teneurs du fer sur les sites
contrôlés respectent les normes OMS et tchadienne de
potabilité. La plus faible teneur est enregistrée au point (P13)
avec 0,03 mg/l et la teneur la plus élevée au point (P9) avec 2,9
mg/l. Une teneur élevée du fer a été
décelée à chagoua et amkoundjara.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 61
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Manganèse total:
On dénote une valeur minimale de 0 mg/l et une valeur
maximale de 0,08mg/l, tous en deçà de la norme OMS et
tchadienne.
Ammonium :
valeur minimale de 0,05 mg/l au point (P2) et une valeur maximale
de1,9 mg/l au point (P9) supérieure donc à la norme OMS.
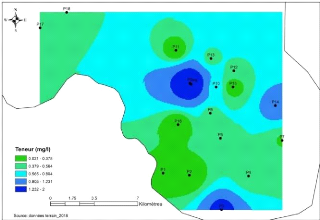
Figure 37: carte de la répartition d'ammonium
à N'Djamena.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 62
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
III.3.2. Les ions majeurs des eaux
souterraines
Les ions majeurs déterminés sont les cations
(Ca2+, Na+, K+, et Mg2+) et les
anions (Cl-, SO2-4 HCO-3, NO-3 ).
Les résultats obtenus sont consignés en annexe 3.1.
III.3.2.1.Les cations
Les teneurs des cations exprimées en mg/l (annexe 3.1)
montrent une variabilité d'un échantillon à l'autre. Les
teneurs en sodium varient de 12 mg/l à Walia barrière à
81mg/l à Toukra , les teneurs de potassium elles oscillent entre 0,5
mg/l à Farcha djougoulié à 8 mg/l à Toukra. ; Alors
que les teneurs en calcium elles varient de 11 ,2 mg/l à Sabangali
à 80 mg/l à Toukra. Le magnésium a une teneur de 1,9 mg/l
à Amtoukouin2 à 24 mg/l à Toukra.
III.3.2.2. Les anions
Quant aux anions, la concentration la plus faible en
bicarbonate est observée à Guinebor avec 36 mg/l et la plus
élevée à Toukra avec 439,2 mg/l. les teneurs en chlorure
varient elles de 1mg/l à Guinebor à 48 mg/l à Toukra.
Celles du sulfate de 0,1 mg/l à Sabangali à 51 mg/l à
Toukra. Et enfin, les teneurs en nitrate varient de 0,1 mg/l à Sabangali
à 17,7 mg/l à Guinebor.
Pour l'ensemble des analyses, l'anion dominant est le
bicarbonate avec une teneur moyenne de 146,17 mg/l ensuite viennent les ions
chlorures avec 17,83 mg/l, le sulfate avec une teneur moyenne de 13,67 mg/l et
enfin le nitrate avec 5,01 mg/l.
Les cations dominants sont respectivement le calcium avec
29,76 mg/l, le sodium avec une teneur moyenne de 28,33 mg/l, le
magnésium avec une teneur moyenne de 9,08 mg/l et enfin le potassium
avec 2,77 mg/l.
Balance ionique des eaux souterraines
C'est un principe basé sur
l'électro-neutralité de l'eau. Pour les éléments
majeurs, l'analyse chimique est considérée comme valide quand la
balance ionique BI= [(Ó cations- Ó anions)/ (Ó
cations+ Ó anions)] x100 n'excède pas +ou- 5%. Pour 83%
de ces analyses, cette condition est vérifiée. Les
échantillons d'Ambatta, Farcha Djougoulié et Guinebor ont
respectivement des balances ioniques de l'ordre de +9%, +36%, +48%. Ce qui est
supérieur à cette valeur limite indiqué ci-dessus. Cette
balance ionique peut provenir d'une erreur
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 63
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
analytique (résultats des analyses non valides) ; ou
encore dans l'analyse, certains cations ou anions n'auraient pas
été pris en compte.
Tableau 5: vérification des erreurs des
résultats des analyses de l'eau souterraine.
|
Noms
|
cations
|
anions
|
Balance ionique
|
|
Ngueli
|
3.71040
|
3.68690
|
+0%
|
|
Dingagali
|
2.58040
|
2.54640
|
+1%
|
|
Toukra
|
9.82870
|
9.64610
|
+1%
|
|
Ngonba
|
2.00910
|
1.94650
|
+2%
|
|
Walia
|
1.70580
|
1.64850
|
+2%
|
|
Chagoua
|
2.28480
|
2.11560
|
+4%
|
|
Gassi3
|
3.30030
|
3.23510
|
+1%
|
|
Amkoundjara2
|
7.54170
|
7.32350
|
+1%
|
|
Amkoundjara1
|
8.35200
|
8.01460
|
+2%
|
|
Amtoukouin1
|
3.57730
|
3.38780
|
+3%
|
|
Amriguébé
|
1.98280
|
1.96440
|
+0%
|
|
Ndjari darasalam
|
2.64470
|
2.54960
|
+2%
|
|
Ndjari
|
2.06050
|
2.02990
|
+1%
|
|
Ambatta
|
4.21800
|
3.50110
|
+9%
|
|
Amtoukouin2
|
1.74870
|
1.64330
|
+3%
|
|
Sabangali
|
1.23590
|
1.23900
|
+0%
|
|
Farcha dougoulié
|
2.81410
|
1.31260
|
+36%
|
|
Guinebor
|
2.73230
|
0.96623
|
+48%
|
En gras, valeurs de balance ionique supérieures à
5%.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 64
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
III.3.3. Faciès chimiques des eaux obtenus
à partir du diagramme de Piper :
Le faciès chimique des eaux souterraines
caractérisées par les différentes concentrations des ions
majeurs sont le résultat des environnements géologiques où
séjournent ces eaux.
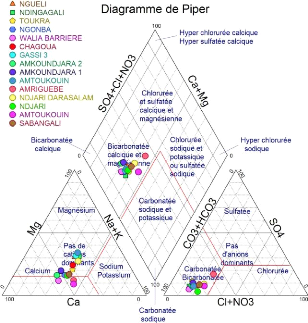
Figure 38: faciès chimiques des eaux de la ville
de N'Djamena
Le report des résultats des analyses des eaux sur le
diagramme de Piper montre un faciès à dominante
bicarbonaté calcique et magnésien avec aucun ion dominant sur
tous les sites. Les sites d'Ambatta, de farcha Djougoulié et de guinebor
ayant une balance ionique > + ou-5%, donc comportant une erreur analytique
(voir balance ionique, tableau 6), n'ont pas été pris en
compte.
III.3.4 Indice d'échange de base (IEB)
L'indice d'échange de base (IEB) est le rapport entre les
ions échangés et les ions de même nature primitivement
existant dans l'eau. Il est donné par la formule suivante :
IEB= [Cl- ] -( [Na+ ]+
[K+ ])/ [Cl- ]
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 65
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
L'IEB et est exprimé en milliéquivalent par litre
(mEq/l).
- Généralement, si IEB< 0, il ya relargage de
Na+ + K+ par les argiles, les teneurs de Ca2+
et Mg2+ diminuent.
- Si IEB est > 0, il ya rétention de Na+ +
K+ par les argiles, et les concentrations du Ca2+ et
Mg2+ augmentent.
Tableau 6: variation d'échange d'ions dans les
eaux souterraines.
|
N°
|
Quartier
|
IEB (mEq/l)
|
N°
|
Quartier
|
IEB (mEq/l)
|
|
1
|
Ngueli
|
-1.41
|
10
|
Amtoukouin1
|
-1.61
|
|
2
|
Dingagali
|
-1.9
|
11
|
Amriguebé
|
-0.8
|
|
3
|
Toukra
|
-1.75
|
12
|
Ndjari darasalam
|
-1.02
|
|
4
|
Ngonba
|
-1.72
|
13
|
Ndjari
|
-0.89
|
|
5
|
Walia barriére
|
-1.84
|
14
|
Ambatta
|
-1.64
|
|
6
|
Chagoua
|
-1.75
|
15
|
Amtoukouin2
|
-1.13
|
|
7
|
Gassi3
|
-1.71
|
16
|
Sabangali
|
-0.84
|
|
8
|
Amkoundjara2
|
-1.01
|
17
|
Farcha dougoulié
|
-8.4
|
|
9
|
Amkoundjara1
|
-0.97
|
18
|
Guinebor
|
-32.21
|
L'IEB varie entre -32.21 et -0.80 ; la valeur la plus
élevée est observée au forage d'Amriguebé.
III.3.5 Faciès chimiques des eaux selon le
diagramme de Schoeller-Berkaloff :
Le diagramme de Schoeller-Berkaloff est une
représentation graphique semi-logarithmique : sur les axes des abscisses
sont représentés les différents ions. Pour chacun des ions
majeurs, la teneur réelle en mg/L est reportée sur l'axe des
ordonnées, les points obtenus sont reliés par des segments de
droites. L'allure graphique obtenue (Figure 39) permet de visualiser le
faciès de l'eau minérale concernée. L'analyse du diagramme
de Schoeller-Berkaloff nous permet de conclure que les eaux de la nappe
présentent des profils identiques que ceux trouvés sur piper.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 66
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
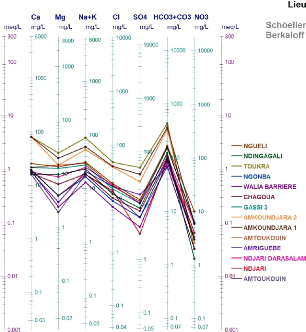
Figure 39: diagramme de Schoeller Berkaloff des eaux
souterraines de N'Djamena.
III.3.6 Qualité des eaux de la nappe
L'appréciation de la qualité des eaux
souterraines s'effectue par l'étude des paramètres de pollution,
puis par interprétation de la qualité globale sur la base d'une
grille simplifiée (Tableau 8) comportant trois paramètres
indicateurs de pollution physico-chimique et azotée, ces
paramètres sont :
· la conductivité électrique qui renseigne
sur la qualité minéralogique des eaux ;
· les ions chlorures qui renseignent sur la qualité
minéralogique et la pollution des eaux ;
· les nitrates, principaux indicateurs d'une pollution
d'eau souterraine.
Toutes les eaux (échantillons P1, à P18)
présentent globalement une bonne qualité. Cet état de fait
est du :
? A la minéralisation avec des valeurs maximales
enregistrées en conductivités de 1123u/cm (moyenne), aux teneurs
aux chlorures (qualité excellente), aux nitrates qui varient d'un
minimum de 0,1 mg/l au P16 et d'un maximum de 17,7 mg/l au P18 (excellente).
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page
67
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Tableau 7: grille simplifiée pour
l'évaluation de la qualité globale des eaux
souterraines.
|
paramètres
|
|
Chlorure (mg/l)
|
Nitrates (mg/l)
|
Excellente Bonne Moyenne Mauvaise Très mauvaise
|
< 400
|
< 200
|
< 5
|
|
200-300
|
5-25
|
|
300-750
|
25-50
|
|
750-1000
|
50-100
|
|
>1000
|
>100
|
|
L'analyse de tous les échantillons montre que la
qualité globale de l'eau est bonne en raison des teneurs
légèrement faible en conductivité électrique,
(exception des points P3, P8, et P9 avec des teneurs oscillant entre 790
à 1123 u/cm, légèrement élevée par rapport
aux autres points donc, mais dans les limites des valeurs de la grille).
La qualité des eaux en chlorure est excellente puisque
les teneurs sont toutes inférieures à 200 mg/l.
Ainsi donc 95 % des points échantillonnés sont de
bonne qualité intrinsèquement (tableau 9), sauf à toukra
où la qualité globale de l'eau est moyenne.
Tableau 8: qualité globale des eaux souterraines
de la ville de N'Djamena.
N° échantillons
|
Conductivité (u/cm)
|
Chlore (mg/l)
|
Nitrate (mg/l)
|
Qualité globale
|
P1
|
409
|
19
|
10
|
Bonne
|
P2
|
254
|
12
|
1,3
|
Bonne
|
P3
|
1123
|
48
|
2
|
moyenne
|
P4
|
228
|
9
|
3
|
Bonne
|
P5
|
142
|
7
|
3
|
Bonne
|
P6
|
235
|
10
|
4
|
Bonne
|
P7
|
343
|
15
|
6,4
|
Bonne
|
P8
|
790
|
39
|
2,6
|
Bonne
|
P9
|
969
|
40
|
6
|
Bonne
|
P10
|
352
|
17
|
6,1
|
Bonne
|
P11
|
508
|
17
|
2
|
Bonne
|
P12
|
514
|
18
|
5,8
|
Bonne
|
P13
|
254
|
14
|
3,3
|
Bonne
|
P14
|
325
|
30
|
5
|
Bonne
|
P15
|
299
|
13
|
2
|
Bonne
|
|
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
P16
|
176
|
8,9
|
0,1
|
Bonne
|
P17
|
320
|
3
|
10
|
Bonne
|
P18
|
311
|
1
|
17,7
|
Bonne
|
|
.
III.3.7 Corrélation des éléments
chimiques
La corrélation mesure la relation entre deux variables
ou plus .Les coefficients de corrélation sont compris dans l'intervalle
-1,00 à +1,00. La valeur -1,00 représente une parfaite
corrélation négative tandis que la valeur +1,00 représente
une parfaite corrélation positive. La valeur 0,00 représente une
absence de corrélation (ou l'indépendance entre les
variables).
L'analyse de la matrice (tableau10) permet de voir les
relations entre les éléments chimiques pris deux à deux,
en se basant sur le coefficient de corrélation
r. Nous avions les observations suivantes :
· La conductivité à une excellente
corrélation avec tous les ions majeurs ;
· Le bicarbonate est très bien corrélé
avec les ions chlorures, et le sulfate ;
· Il n'ya aucune corrélation entre le pH et les ions
majeurs ;
· Le calcium se corrèle bien avec l'ammonium ;
· Le magnésium se corrèle assez bien avec le
sodium, le potassium et les sulfates ;
· Le potassium à une excellente corrélation
avec les ions chlorures et les sulfates ;
· Le sodium à une excellente corrélation
avec les sulfates, le bicarbonate et les ions chlorures ;
· Le nitrate n'a aucune corrélation avec les
autres éléments chimiques.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 68
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Tableau 9: matrice de corrélation des
éléments chimiques des eaux de N'Djamena.
|
Variables
|
Ca2+
|
Mg2+
|
K+
|
Na+
|
HCO3
|
Cl-
|
SO4
|
NO3
|
fer
|
NH4
|
PH
|
Cond
|
|
Ca2+
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mg2+
|
0.789
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K+
|
0.841
|
0.839
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Na+
|
0.855
|
0.858
|
0.868
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HCO3
|
0.941
|
0.893
|
0.926
|
0.906
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cl-
|
0.857
|
0.782
|
0.924
|
0.921
|
0.931
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
SO4
|
0.891
|
0.843
|
0.949
|
0.942
|
0.947
|
0.946
|
1
|
|
|
|
|
|
|
NO3
|
-0.052
|
0.135
|
-0.194
|
-0.039
|
-0.180
|
-0.289
|
-0.197
|
1
|
|
|
|
|
|
fer
|
0.454
|
0.375
|
0.353
|
0.286
|
0.434
|
0.333
|
0.401
|
0.009
|
1
|
|
|
|
|
NH4
|
0.918
|
0.708
|
0.747
|
0.828
|
0.856
|
0.838
|
0.799
|
-0.008
|
0.491
|
1
|
|
|
|
PH
|
-0.720
|
-0.591
|
-0.512
|
-0.614
|
-0.697
|
-0.620
|
-0.560
|
-0.040
|
-0.340
|
-0.805
|
1
|
|
|
Cond
|
0.915
|
0.824
|
0.956
|
0.873
|
0.914
|
0.889
|
0.953
|
-0.061
|
0.390
|
0.796
|
-
0.529
|
1
|
Les valeurs en gras montrent une corrélation entre les
éléments.
III.4.résultats des paramètres
bactériologiques.
Pour déterminer la qualité
bactériologique de l'eau de notre zone d'étude, nous avons
recherché principalement trois micro-organismes indicateurs de
pollutions : ce sont les Coliformes totaux, Coliformes
fécaux (E.Coli) et les entérocoques
; la flore aérobie totale n'est analysée qu'à titre
indicatif. Les résultats sont consignés dans les tableaux 11, 12
et 13.
Pour notre étude, nous allons considérer deux
situations pour les résultats bactériologiques. Le
premier groupe de dix points d'eau P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10 a
fait l'objet de deux prélèvement chacun pendant l'hivernage,
période des hautes eaux(septembre 2017) et pendant la saison
sèche, période de basses eaux (mars -avril 2018).
Le deuxième groupe constitué de
huit points d'eau P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18 a fait l'objet d'un
seul prélèvement et d'analyse pendant la période des
basses eaux en juin - juillet 2018.
? Pour le 1er groupe de 10 points d'eau
analysé (P1 à P10) pendant la période des hautes eaux
(tableau 11), nous constatons que les Coliformes totaux sont
omniprésents dans 7 points d'eau sur 10 (P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10)
soit 70% des points d'eau échantillonnés (figure 40). La valeur
varie entre 13UFC/100ml à +100 UFC/100ml. Ce qui est donc
supérieure à la norme OMS et tchadienne.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 69
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
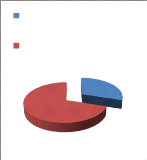
COLIFORMES TOTAUX négatif
COLIFORMES TOTAUX positif
70%
30%
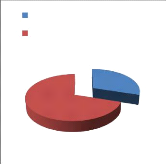
COLIFORMES FECAUX négatif COLIFORMES FECAUX positif
70%
30%
Figure 41: diagramme des Coliformes totaux
analysés pendant l'hivernage.
Figure 40: diagramme des Coliformes fécaux
analysés pendant l'hivernage.
De même, les Coliformes fécaux (E.Coli)
qui permettent de mettre en évidence une pollution d'origine
fécale sont présents dans 7 points d'eau (P2, P3, P4, P7, P8, P9,
P10) soit 70% des points d'eau contrôlés pendant l'hivernage
(figure 41) avec des concentrations oscillant entre 7 et plus de 100UFC/ml. Ce
qui est largement supérieur à la norme OMS qui préconise
une absence totale de ces germes dans l'eau de consommation.
Quant aux entérocoques, indicateurs de
pollution résiduelle ou ancienne, ils ne sont présents que dans
le point d'eau P10. Ce point d'eau n'est donc pas potable, dans la mesure
où les normes locales et OMS exigent l'absence totale de cette flore
dans les eaux destinées à la consommation. Ce point doit
être traité au chlore.
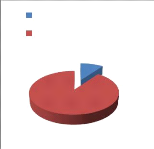
ENTEROCOQUES positif ENTEROCOQUES négatif
90%
10%
Figure 42: diagramme des entérocoques de
la
zone d'étude. campagne1.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 70
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 71
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
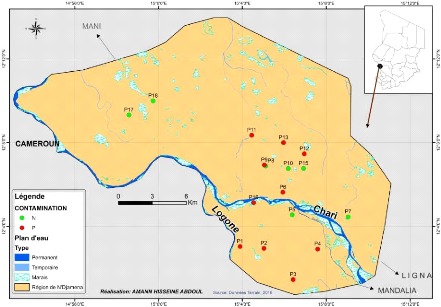
Figure 43: carte des sites contaminés (points
rouges) par les germes totaux et fécaux
En définitif, pendant la période des hautes
eaux, 70% des eaux du 1er groupe échantillonné ne sont
pas conformes aux normes OMS/TCHAD et sont impropres à la
consommation.
? Pour le 1er groupe de 10 points d'eau
analysé (P1 à P10) pendant la période des basses eaux
(tableau 12), nous constatons que les Coliformes totaux sont
omniprésents dans les points d'eau P1, P2, P3, P4, P6, P9, soit 60% des
points d'eau échantillonnés. Ils font donc leur apparition aux
points d'eau P1 et p6, pendant la période des basses eaux alors qu'ils
étaient absents pendant l'hivernage. Ce qui indique une nouvelle
contamination. Par contre ces mêmes Coliformes totaux ont
disparus des points d'eau P7, P8, et P10. Par ailleurs la contamination aux
Coliformes totaux persiste aux points P2, P3, P9. Ce qui indique une
pollution ponctuelle. La source de contamination doit y être
recherchée.
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
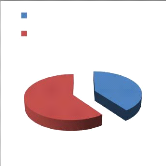
COLIFORMES TOTAUX négatif COLIFORMES TOTAUX positif
60%
40%
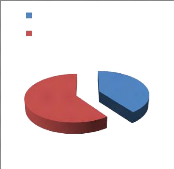
COLIFORMES FECAUX négatif COLIFORMES FECAUX positif
60%
40%
Figure 45: diagramme des Coliformes
totaux
analysés pendant la
période des basses eaux.
Figure 44: diagramme des
E.Coli
analysés pendant
la période des basses
eaux.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 72
Pour la même étude et pendant la période des
basses eaux, les Coliformes fécaux (E.Coli)
sont présents dans 6 points d'eau (P1, P2, P3, P4, P6, et
P9) soit 60% des points d'eau échantillonnés. Il ya trois
nouvelles contaminations par rapport à l'hivernage (P1, P4, P6). Alors
E.coli n'affectent pas toujours le point P5, qui est censé
être bien protégé par rapport aux latrines et toilettes sur
les deux périodes.
Quant aux entérocoques, pendant la période des
basses eaux, elles sont absentes dans tous les points d'eau
échantillonnés du 1er groupe (tableau 12).
? Pour le 2éme groupe de huit points d'eau
(P11 à P18), un seul prélèvement a été
effectué par forage pendant la période des basses eaux en mai et
début juillet 2018.On remarque la présence des Coliformes
totaux dans les points d'eau P11, P12, P13, P14, P16, soit 62% dans
l'ensemble des points d'eau du 2éme groupe. Leur
présence est étroitement liée à celle des
E.Coli ; ce qui indique une infiltration des eaux chargées de
germes. Seulement 38% des eaux de ce groupe respectent les normes OMS et
tchadienne, donc saine pour la consommation (tableau 13).
Les entérocoques sont absents sur les huit
points d'eau contrôlés pendant cette dernière campagne.
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la ville de
N'Djamena
Tableau 10: résultats des analyses
bactériologiques des forages de la zone d'étude/ campagne 1 : du
13 au 19 septembre 2017.
|
Nomenclature
|
Unité
|
P1
|
P2
|
P3
|
P4
|
P5
|
P6
|
P7
|
P8
|
P9
|
P10
|
|
Date prélèvement
|
|
14/09/17
|
13/09/17
|
14/09/17
|
|
14/09/17
|
14/09/18
|
14/09/17
|
18/09/17
|
18/09/17
|
18/09/17
|
|
Echerichia coli (24h à
36+/-1°C)/Gélose chromocult
|
UFC/100ml
|
0
|
>100
|
13
|
35
|
0
|
0
|
22
|
7
|
63
|
>100
|
|
Coliformes totaux présumés (24h à
36+/-1°C)/Gélose ch.
|
UFC/100ml
|
0
|
>100
|
13
|
>100
|
0
|
0
|
56
|
77
|
>100
|
>100
|
|
Entérocoques fécaux (48h à
36+/-1°C)/milieu S et B.
|
UFC/100ml
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25
|
|
Flore aérobie totale(24-48h à
36+/-1°C/PCA
|
UFC/100ml
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
Tableau 11: résultats des analyses
bactériologiques des forages de la zone d'étude/ campagne 2 : du
28 au 30 mars 2018.
|
Nomenclature
|
Unité
|
P1
|
P2
|
P3
|
P4
|
P5
|
P6
|
P7
|
P8
|
P9
|
P10
|
|
Date prélèvement
|
|
28/03/18
|
28/03/18
|
28/03/18
|
28/03/1 8
|
28/03/18
|
28/03/18
|
29/03/18
|
30/03/18
|
30/03/18
|
30/03/18
|
|
Echerichia coli (24h à
36+/-1°C)/Gélose chromocult
|
UFC/100ml
|
11
|
30
|
33
|
18
|
0
|
11
|
0
|
0
|
2
|
0
|
|
Coliformes totaux présumés (24h à
36+/-1°C)/Gélose ch.
|
UFC/100ml
|
40
|
>100
|
82
|
>100
|
0
|
80
|
0
|
0
|
86
|
0
|
|
Entérocoques fécaux (48h à
36+/-1°C)/milieu S et B.
|
UFC/100ml
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Flore aérobie totale(24-48h à
36+/-1°C/PCA
|
UFC/100ml
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 73
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 74
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la ville de
N'Djamena
Tableau 12: résultats des analyses
bactériologiques des forages de la zone d'étude/ campagne 3 :
mai-juillet 2018.
|
Nomenclature
|
Unité
|
P11
|
P12
|
P13
|
P14
|
P15
|
P16
|
P17
|
P18
|
|
Date prélèvement
|
|
26/06/18
|
13/02/18
|
13/02/18
|
01/10/18
|
25/07/18
|
21/02/18
|
28/03/18
|
04/18
|
|
Echerichia coli (24h à
36+/-1°C)/Gélose chromocult
|
UFC/100ml
|
11
|
30
|
33
|
18
|
0
|
11
|
0
|
0
|
|
Coliformes totaux présumés (24h à
36+/-1°C)/Gélose ch.
|
UFC/100ml
|
40
|
>100
|
82
|
>100
|
0
|
80
|
0
|
0
|
|
Entérocoques fécaux (48h à
36+/-1°C)/milieu S et B.
|
UFC/100ml
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Flore aérobie totale(24-48h à
36+/-1°C/PCA
|
UFC/100ml
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
>100
|
En rouge, eaux bactériologiquement non conformes par
rapport aux directives de OMS/TCHAD.
P1 :Ngueli p10 : Amtoukouin 1
p2 : Dingagali p11 : Amriguebé
p3 : Toukra p12 : Ndjari darasalam
p4 : Ngonba p13 : Ndjari
p5 : Walia barriére p14 : Ambatta
p6 : Chagoua p15 : Amtoukouin2
p7 : Gassi3 p16 :Sabangali
p8 : Amkoundjara2 p17 : Farcha Djougoulié
p9 : Amkoundjara1 p18 : Guinebor
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 75
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
III.4.1. Impact socio-sanitaire de la consommation de
l'eau sur la santé de la population
Tableau 13: fréquence des maladies liées
à l'eau de consommation dans quelques centres de santé de
N'Djamena.
|
Fréquence des maladies dans l'année
(%)
|
|
Centre de santé
|
paludisme
|
typhoïde
|
encombrement bronchique
|
maladies diarrhéiques
|
hépatite
|
autres
|
|
atrone
|
60
|
20
|
5
|
10
|
10
|
5
|
|
habbena
|
50
|
10
|
10
|
22
|
3
|
5
|
|
toukra
|
50
|
10
|
15
|
15
|
8
|
2
|
Source: Mme Nodjilembaye
Orbaye, Mr Dering Nadji Desiré, Mme Mountardé
née Layom (2018)
En rouge, maladies liées à la consommation de
l'eau contaminées par les germes fécaux.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 76
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena


Figure 46: images illustrant parfaitement un environnant
malsain, facteur de contamination des nappes.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 77
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Chapitre V- INTERPRETATION ET DISCUSSION
V.1.Paramètres hydrodynamiques
Comparativement aux anciennes valeurs des paramètres
hydrodynamiques fournies par Schneider et Wolff (1992) qui donnent une
transmissivité moyenne de 6x10-3 m2/s, une
perméabilité moyenne de 1,2x10-4 m/s et un coefficient
d'emmagasinement de l'ordre de 10%, les données actuelles montrent une
tendance à une amélioration de ces valeurs ;
l'interprétation de 5 forages actuels a donnée une valeur de
transmissivité moyenne de l'ordre de 5,3x10-2
m2/s, un coefficient d'emmagasinement de 17%. Ce qui implique que
les techniques de foration actuelles sont nettement probantes, et que la nappe
aquifère pérenne est de mieux en mieux identifiée et
connue, et que la disposition de l'équipement de captage
(crépines) évite souvent les horizons argileux, d'où les
valeurs intéressantes de perméabilités moyennes
observées (1,10x10-3 m/s). A titre d'exemple, un forage
exécuté sur financement de la STE à Walia en
février 2018, (tableau 3) à donné un débit de 315
m3/h, une transmissivité de 1,26x10-2
m2/s pour un coefficient d'emmagasinement estimé à 20%
! Ce qui est bien entendu énorme et découle d'une bonne
connaissance géologique du terrain et d'une excellente maitrise
technique de la foration.
V.2.Corrélation des coupes
litho-stratigraphiques
Dans notre zone d'étude, la corrélation des logs
(figure 47) montre d'abord que le mur de la nappe, fait d'argile compacte du
pliocène est globalement uniforme et se situerait autour de 50 et 60m
.Ce qui corrobore les affirmations de Schneider et Wolff (1992) ; mais ce mur
pourrait se situer beaucoup plus en profondeur (Dingagali et Walia STE,
jusqu'à 60m de foration, le substratum argileux n'a pas
été touché). Il peut aussi remonter à une
profondeur relativement faible (à Kartota, le substratum se situerait
autour de 45m).Par ailleurs, à l'Est de la zone d'étude, les
stratifications sont bien marquées, on remarque alternativement des
couches sableuses, argileuses avec des intercalations d'argile sableuse ou du
sable argileux. Au Nord-ouest et au Sud-ouest de N'Djamena, c'est beaucoup plus
les séries sableuses qui sont mises en évidence. Tout compte
fait, la variabilité de faciès est évidente aussi bien
latéralement que verticalement. C'est pourquoi, les corrélations
litho-stratigraphiques sont difficiles à établir compte tenu de
l'hétérogénéité du terrain. D'ailleurs, Il
apparait très difficile d'établir une stratification des terrains
du quaternaires comme l'a démontré N. Ngatcha, (1993) puisqu'il
s'agit dans l'ensemble des formations très diversifiés tant dans
l'espace que dans le temps
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 78
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
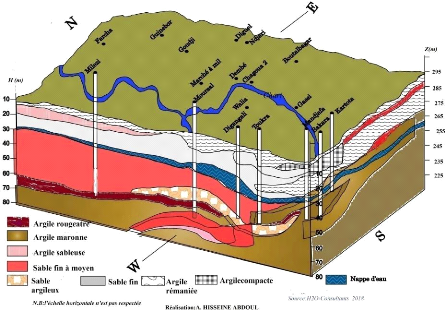
Figure 47: coupe schématique montrant la
géométrie de la nappe d'eau souterraine de N'Djamena.
V.3.Piézométrie
En ce qui concerne notre zone d'étude, les cartes
obtenues (figures 24 et 25) sont cohérentes dans leur globalité
avec toutes les autres cartes publiées. Nous remarquons en effet que
l'écoulement des eaux se fait du Sud vers le Nord, ce qui est en accord
avec le résultat de la piézométrie de BRGM (1987), Djoret
(2000) et Kadjangaba (2007). Seule particularité, nous avons une autre
orientation du sens d'écoulement des eaux, vers toukra au Sud. Trois
secteurs de creux ou dépression piézométrique sont mis en
évidence à l'extrême Nord de la zone d'étude,
lamadji notamment avec une cote maximale de 271m, et deux autres secteurs de
dépressions à Guinebor et Diguel. Le fait marquant est que la
lithologie des sites à dépression piézométrique
(Diguel Est, Ndjari) en question montre une dominance argileuse avec de faibles
transmissivités et de débits spécifiques relativement
moyens. La présence d'argile limite la conductivité
hydraulique.
En outre au sud de la zone d'étude, un secteur de
dôme piézométrique donc de recharge est nettement visible.
Ce secteur, aux alentours de Dingagali situé au niveau de la jonction
du
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 79
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Chari et du Logone, correspond assurément à des
aires privilégiées d'infiltration et de remontée d'eau;
d'ailleurs la valeur de la transmissivité élevée
1,2x10-2 m2/s, obtenue par l'interprétation des
résultats des essais de débits (voir fiche en annexe) prouve que
le secteur est bien perméable et productif, ce qui est confirmé
par les coupes lithologiques qui montrent une dominance sableuse à 90%
de la zone. Les zones les plus perméables, à dominance sableuse,
sont sous l'influence des infiltrations localisées des eaux de pluies et
de ruissellement (Kadjangaba ,2007). Ces zones perméables sont surtout
identifiées aux abords et tout le long du versant Sud-ouest, du Chari et
du Logone. Bref les sites aux voisinages du fleuve subiraient des recharges.
V.4.Qualité des eaux souterraines
V.4.1.Paramètres physico-chimiques
? La température :
Les valeurs de la température sont concentrées
entre 29 et 31°C avec une moyenne de 29,8°C. A priori, dans les zones
arides et semi aride, et pour les forages peu profonds, la température
des eaux souterraines avoisine celle de l'air ambiant qui donne une moyenne de
26 à 28°C dans notre zone d'étude. Ce qui traduit un
équilibre thermique du système aquifère avec
l'atmosphère.
? Le pH :
Le pH est un paramètre physico- chimique qui varie
fortement, cependant dans notre zone d'étude, il se situe autour de la
neutralité.il oscille entre
6,3 et 7,78 avec une moyenne de 7,06 ; le minimum est observé à
Amkoundjara2 et 1, prés d'une décharge et le maximum à
Amriguébé avec une valeur de 7,87. Toutes les valeurs ont
correspondu au pH des eaux naturelles et semble être provenir des
aquifères carbonatés.
? La conductivité électrique
:
La conductivité électrique renseigne sur le
degré de minéralisation d'une eau. Dans la zone
étudiée, on remarque que les conductivités varient de
manière spatiale. Elles sont comprises entre un minimum de142 uS/cm au
point P5 à Walia barrière où l'apport de la recharge par
le Chari est important et explique la baisse de minéralisation ; un
maximum de 1228 uS/cm observée au P3 à Toukra. Dans toute la
ville de N'Djamena, nous avons une moyenne de 419 uS/cm. Et globalement, les
eaux ayant une faible conductivité entre 100 et 200 uS/cm sont
localisées le long du Chari (Djoret, 2000). D'une façon
générale, la conductivité s'élève
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 80
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
progressivement de l'amont vers l'aval des cours d'eau. Notons
que 72% des échantillons ont une conductivité inférieure
à 500 uS/cm et seulement 18% ont des valeurs supérieures à
500 uS/cm. Les valeurs les plus élevées sont observées
beaucoup plus vers le Nord de N'Djamena quand on s'éloigne du fleuve. Ce
qui corrobore les résultats de BRGM(1987), Djoret (2000) et Kadjangaba
(2007). Cependant, le pic de la conductivité est observé
paradoxalement à Toukra au Sud de la zone étudiée. Cela
pourrait s'agir probablement d'un phénomène d'évaporation.
Les secteurs d'Amkoundjara1 et 2 montrent des valeurs avoisinant les 1000 uS/cm
; cela résulterait d'une pollution anthropique car ces secteurs
disposent de deux grandes décharges à ciel ouvert recueillant
toutes les ordures ménagères et les eaux usées et
industrielles.
Il est à noter qu'il ya une importante relation entre
la conductivité électrique et la teneur des
éléments majeurs, c'est pourquoi, on remarque la contribution
majoritaire des bicarbonates dans la minéralisation des eaux
étudiées. D'ailleurs la corrélation entre ces deux
éléments chimiques est excellente (r= 0,913). Ce qui est en
accord avec le résultat des travaux de Djoret (2000) dans la même
zone et de Ndedje-Allah (2015) dans la plaine de Naga au Sud-ouest de notre
zone d'étude.
Régression de HCO3 par Cond
(R2=0.835)
0 200 400 600 800 1000 1200
Cond
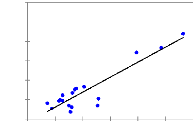
HCO3
400
600
500
300
200
100
0
Figure 48: évolution des teneurs du bicarbonate
en fonction de la conductivité
électrique.
V.4.2. les éléments chimiques
V.4.2.1.Les cations
Au regard des résultats des analyses chimiques des eaux
de notre zone d'étude, il ressort que le cation alcalino-terreux le plus
important est le calcium. Il est très répandu
dans la nature et
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 81
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
en particulier dans les roches calcaires ou sous forme de
carbonates (calcite (CaCO3), dolomite [(Ca,Mg) CO3]) ; c'est un composant
majeur de la dureté de l'eau et sa teneur varie essentiellement suivant
la nature des terrains traversés. Tous les points étudiés
ont des concentrations inferieures à la valeur maximale admissible qui
est de 200 mg/L. Les teneurs élevées en calcium pourraient
être attribuées à la dissolution de la calcite dont regorge
le réservoir de notre zone.
Le sodium, élément alcalin est
quant à lui, est un élément constant de l'eau ; toute
fois, sa concentration peut être variable. Indépendamment de la
lixiviation des formations géologiques contenant du Chlorure de sodium,
sa présence peut provenir de la décomposition des sels
minéraux comme les silicates de sodium ou d'aluminium. Sa teneur demeure
prédominante sur nos résultats par rapport au
magnésium et au potassium. Ceci
s'explique par le fait que ces deux ions (sodium et potassium) qui
appartiennent aux groupes des métaux alcalins sont absorbés par
les formations argileuses avec en priorité l'ion potassium, l'ion sodium
reste en solution (Ndedje-Allah, 2015). L'adsorption serait donc le facteur
déterminant et causerait la diminution de l'ion potassium. La teneur en
sodium reste toute fois faible dans nos eaux sauf à Amkoundjara
où la concentration assez élevée de cet ion serait due aux
eaux usées d'origine domestique riche en sodium, déversées
et ayant probablement polluées la nappe.
V.4.2.2.les anions
Pour les anions, tous nos échantillons ont des teneurs
élevées en bicarbonate par rapport aux autres
éléments dans la solution. Les valeurs élevées
seraient dues vraisemblablement à la circulation de ces eaux dans le
réservoir aquifère de nature calcaro-dolomitique, ou à la
dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau par la réaction suivante
:
H2O+CO2 <----> H2CO3<---->HCO-3+ H+
H2CO3+ CaCO3<----> Ca(HCO3)2
CaCO3<----> Ca2+ +HCO3- +
OH-
Quant aux ions chlorures, leur teneur dans nos eaux est faible
sauf à Toukra où nous relevons une valeur relativement
élevée. L'origine de cet ion pourrait être anthropique.
Les teneurs en sulfates élevées au niveau des
points d'eau de toukra, semblent être liées vraisemblablement au
contact de l'eau avec des encaissants de nature, gypsifères. Les autres
points contrôlés restent dans les normes recommandées, les
résultats obtenus sont similaires
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 82
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
aux conclusions dégagées dans le cadre de
l'étude concernant la zone en question par Djoret (2001) et Kadjaganba
(2008) confirmant l'origine géologique des sulfates.
Sur la figure 49, nous remarquons que le nitrate ne
corrèle pas avec le calcium ni avec aucun ion majeur ; ce qui suppose
que la présence du nitrate dans nos eaux notamment à Guinebor et
Ngueli , à une origine anthropique.
Régression de Ca2+ par NO3
(R2=0.003)
0 5 10 15 20
NO3
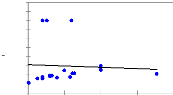
Ca2+
100
40
90
80
70
60
50
30
20
10
0
Figure 49: évolution des teneurs du nitrate en
fonction du calcium.
Quant aux éléments indésirables, nous
constatons la présence du fer, à l'état ferreux dans
quelques points de nos eaux. Celui ci est très soluble dans l'eau et
précipite à la suite du dégagement de l'anhydre carbonique
par l'oxydation à l'air. Dans les eaux contrôlées, les
teneurs les plus élevées sont observée à
Amkoundjara1 et Chagoua. Sur le premier site nommé, l'origine pourrait
être attribuée à la lixiviation de terrains
traversés ou à une pollution anthropique. A chagoua, zone
alluvionnaire, l'eau extraite de la nappe peut avoir une teneur en fer et
éventuellement en manganèse supérieure à l'eau
infiltrée à partir du cours d'eau ; ceci pourrait s'expliquer par
la concentration d'ions métalliques au niveau des boues tapissant le lit
du fleuve. Indépendamment des saveurs désagréables pouvant
être perçue à partir de 0,05mg/l, le fer développe
dans l'eau la turbidité rougeâtre peu engageante pour un
consommateur. Enfin les eaux ferrugineuses ont l'inconvénient de tacher
le linge. L'élimination du fer peut se faire par oxydo-aération
suivie d'une filtration quand il est présent naturellement dans les eaux
souterraines.
Sur le diagramme de piper, le faciès des eaux est dans
l'ensemble bicarbonaté calcique et magnésien, ce qui est
caractéristique des eaux souterraines se trouvant proches de la zone de
recharge ; Ce qui sous tend la richesse du réservoir en minéraux
argileux, résultat en accord avec celui des travaux de Kadjangaba (2007)
dans la même zone.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 83
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
V.4.3.Indice d'échange de base (IEB)
Le tableau 7 de la variation d'échange des ions dans
notre zone, montre que les valeurs de l'IEB de nos échantillons sont
toutes inférieures à zéro. Ce qui indique que les
minéraux argileux ont fixés les ions calcium présents dans
les eaux de la nappe ; en outre le potassium et le sodium sont issus des
réactions d'échange de base au niveau d'argile présente
dans les horizons sableux. Autrement dit, le Ca2+ et le
Mg2+ de l'eau de la zone étudiée sont remplacés
par les ions Na+ et K+ dans les formations
encaissantes.
V.4.4. rapports caractéristiques entre les
éléments majeurs
Les relations entre les éléments chimiques,
HCO-3 ,Ca2+ ,Na+, Mg2+, SO4-2,
Cl-, sont mises en évidence sur la matrice du tableau 10 et
montrent une dominance des ions Ca-HCO3- par rapport aux autres
ions. Les différentes relations entre éléments majeurs
sont mises en exergue sur la figure 51.
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena

Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 84
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena

Figure 50: rapports caractéristiques entre les
différents éléments majeurs.
V.5.Qualité bactériologique des eaux
souterraines
Les eaux souterraines présentent en
général une bonne protection contre la contamination
microbiologique et sont peu vulnérables aux pollutions externes à
l'exception des nappes superficielles non protégées par un
recouvrement semi perméable ou imperméable. Malheureusement,
cette bonne qualité microbiologique de ces eaux peut être
menacée par des contaminations de surfaces, suite à des
conceptions inadéquates des forages, des puisards, des latrines et
autres fosses d'aisance (Ndeje-Allah, 2015).
Cet état de fait est manifeste dans certains points de
notre zone d'étude, où les eaux superficielles chargées en
microorganismes et germes de tout genre s'infiltrant dans le sol sablonneux,
parviennent à la nappe sans avoir bénéficié d'une
filtration efficace, et occasionnent une multitude de pollutions ponctuelles.
Les puisards et latrines non étanches contribuent aussi et de
manière non négligeable à cette pollution de la nappe.
Dans le cadre de notre étude, pendant l'hivernage, nous
constatons que la pollution bactériologique affecte beaucoup plus le
secteur Sud-est de N'Djamena, de l'autre coté du
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 85
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 86
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
fleuve, là où le sommet de la nappe est proche
de la surface du sol, que les terrains qui surmontent l'aquifère sont
perméables (P2, P3, P4, P7), que les sources de pollution sont
importantes. Cette vulnérabilité de la nappe dans cette partie de
la zone d'étude a été signalée par Abderamane et al
(2017).La même tendance de la pollution est observée au
Nord-est, au voisinage du Chari. Pendant la période de basses eaux, la
quasi-totalité de la pollution est toujours persistante au Sud-est de
N'Djamena (P1, P2, P3, P4, P6,) compte tenu des caractéristiques
pédologique et lithologique que nous avions
énumérées ci haut. Pour la dernière campagne de
prélèvement (2éme groupe de 8 forages), la
pollution bactériologique est signalée beaucoup plus à
l'Est de N'Djamena (P11, P12, P13, P14, P16).
Cet état de fait s'explique surtout par les conditions
défavorables d'hygiène, l'utilisation de la nature comme lieu
d'aisance (21% de la population de N'Djamena défèque à
l'air libre selon le SDEA 2003-2020). Le comble est qu'il n'existe même
pas de réseaux d'évacuation d'eaux usées dans notre zone
d'étude. Quant aux ordures ménagères, les communes
assurent le service en régie, lequel s'avère fortement
limité par le manque de capacité d'enlèvement journalier
et de moyens financiers. Les ordures s'entassent de jour en jour et avec
l'arrivée de la saison des pluies, libèrent les germes qui
s'infiltrent dans la nappe avec l'écoulement de l'eau.
Ainsi, sur le 1er groupe de 10 points
d'eau contrôlés, seul le P5 est censé
être étanche et bien protégé et n'a montré
aucune contamination bactériologique ni pendant l'hivernage, ni pendant
la période de basses eaux. Les points P2, P3, P4, et P9
présentent une contamination persistante en Coliformes totaux
et en E. Coli pendant les deux périodes ; Leur
présence dans l'eau souterraines est associée à la
matière organique en décomposition (pelouse, foin, bois,
matières fécales, etc.), introduits par, le ruissellement et les
infiltrations des fortes pluies en période d'hivernage. La
présence en nombre élevé des Coliformes totaux
(P2, P4, P9, P10) est un signal d'alarme qui démontre une
détérioration de la qualité de l'eau. Un nettoyage de ces
forages doit être effectué. A priori, si les
entérocoques sont présents en nombre beaucoup plus
élevé que les coliformes fécaux, il s'agit
probablement d'une contamination résiduelle puisque les
entérocoques survivent plus longtemps dans l'environnement. Or pour
notre étude, ces Entérocoques ne sont présents
que sur un seul point d'eau (P10), ce qui suppose que les contaminations par
les Coliformes fécaux (E.Coli ) sont récentes
et consécutives aux infiltrations des eaux de surface, des eaux vannes
(toilettes et latrines dont le niveau remonte avec la recharge observée
en cette période de hautes eaux). Ces résultats sont en accord
avec
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 87
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
ceux obtenus dans la commune d'Abomey-Calavi au Benin par
TANIGNON en 2011. Par ailleurs nous remarquons une disparition de la pollution
bactériologique aux points P7, P8, P10 pendant la période de
basses eaux, ceci s'explique par le fait qu'en cette période, le niveau
piézométrique baisse et n'accélère pas la
propagation des polluants microscopiques se trouvant sur le sol où
piégés dans la zone non saturée. Ce qui confirme encore
que les infiltrations des eaux pendant l'hivernage sont probablement un facteur
de contamination.
Il est à signaler une nouvelle pollution aux points P1
et P16, ce qui s'expliquerait par la proximité des latrines non
étanches et ne respectant pas la distance de 15métres comme nous
l'avions remarqué sur 90% des secteurs étudiés.
Sur le 2éme groupe de 8 forages
contrôlés, nous remarquons que le P15 n'a pas de
contamination, donc bien protégé. Par ailleurs le P17 et le P18
sont aussi exempts de contamination.
Ainsi donc, 11 points d'eau sur 18 analysés, soit un
pourcentage de 61% présentent une pollution bactériologique donc
non conformes pour la consommation conformément aux recommandations de
l'OMS/TCHAD.
Tout compte fait, les pollutions bactériologiques sont
invariablement présentent pendant toute la période de
l'année avec sensiblement une fréquence un peu
élevée pendant la saison des pluies. La pollution est
donc ponctuelle liée à chaque point d'eau.
Il faut enfin noter que les maladies liées directement
à la consommation de ces eaux (typhoïde, diarrhée, troubles
d'estomac, hépatite...), sont la cause d'environ 25 à 30% de
consultation en moyenne dans les centres de santé de notre zone
d'étude (voir tableau 14).
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 88
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
CONCLUSION GENERALE
La présente étude a permis une évaluation
de la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux de la
nappe souterraine de N'Djamena.
L'analyse de la qualité globale des eaux
(physico-chimique) a révélée que N'Djamena regorge
d'une eau de très bonne qualité de manière
intrinsèque et présente un seul faciès bicarbonaté
calcique et magnésien. En amont de la zone d'étude, à
toukra la dégradation de la qualité des eaux semble être
liée essentiellement aux phénomènes d'évaporation,
à la présence de chlorure, issu des eaux usées
déversées sans traitement dans le sol et du sulfate
résultant du contact de l'eau avec des encaissants de nature
gypsifères. Il en ait de même du site d'amkoundjara1 où la
présence du fer, de l'ammonium serait due à une pollution
anthropique. Les eaux de la partie aval du bassin sont
caractérisées par des valeurs élevées de la
conductivité électrique. Ces valeurs sont tout de même dans
les normes OMS/ TCHAD.
L'analyse bactériologique a
révélée que 61% des points d'eau contrôlés
sont affectés par des germes fécaux, totaux et des
entérocoques !ce qui est alarmant car selon les recommandations de
l'OMS, de telles eaux sont impropres pour la consommation.
En définitif, la mauvaise qualité
bactériologique des eaux de N'Djamena est liée à une
pollution anthropique, donc à un apport extérieur.
Tout de même il serait souhaitable d'étendre
cette étude pour optimiser ces résultats.
RECOMMANDATIONS
Les résultats de notre travail permettront de mettre
à la disposition des décideurs des informations et données
de base susceptibles d'améliorer la qualité de l'eau de
consommation ; ceci passe par :
- l'élaboration des actions à mettre en place
sur les zones potentiellement à risques pour recouvrer ou
préserver la qualité de l'eau captée (protection des
forages, éloignement des forages de principales sources de
pollution...).
? A l'endroit des autorités administratives :
- Une sensibilisation de la population pour le changement de
comportement ; une éducation sanitaire en encourageant les
sensibilisations sur les médias ;
- un contrôle régulier sur la qualité des
forages ;
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 89
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
- une extension du réseau d'adduction d'eau potable ;
- mettre sur pied des textes d'application des normes
d'équipement des forages ; - mettre sur place un système
d'évacuation des eaux usées à travers toute la ville ; -
subventionner la construction des latrines modernes.
? A l'endroit de la population :
- respecter la distance minimale de 15m entre les latrines,
puisards et les forages ;
- traiter l'eau des forages au chlore avant et après la
saison des pluies ;
- faire de sorte que les puisards et fosses septiques soient le
plus étanches possibles ;
- éviter les vidanges des fosses d'aisances dans les rues
et faire appel aux services
compétents pour ce travail.
- les ménages doivent assurer une gestion des ordures de
manière optimale.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 90
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES :
Abderamane, H. (2012).Etude du fonctionnement
hydrogéochimique du système aquifère du Chari Baguirmi
(République du Tchad) ; thèse de Doctorat, Université de
Poitiers, 288 pages.
Abderamane Hamid, KENGNI Lucas, IDDO Ernest Sakamou,
NJUEYA Kopa Adoua (2017). Evaluation de la vulnérabilité
à la pollution de la nappe aquifère à N'Djamena (Tchad)
par l'utilisation de la méthode DRASTIC. Mémoire.
BGR, (décembre 2014). Analyse microbienne
et chimique de l'eau potable à N'Djamena Mai-Juin 2013.
BRGM, (1987). Actualisation des connaissances
sur les ressources en eau souterraine de la République du Tchad.
Deuxième partie : Synthèse des données
hydrogéologiques et carte à 1/1500000e, 116p.
BRGM, (1987). Actualisation des connaissances
sur les ressources en eau souterraine de la République du Tchad.
Troisième partie : Synthèse des données géologiques
et carte à 1/1500000e, 104 p.
Camille Bouchez, (2015). Bilan et dynamique des
interactions rivières-lac(s)-aquifères dans le bassin
hydrologique du lac Tchad. Approche couplée géochimie et
modélisation des transferts. Thèse de doctorat. Université
Aix-Marseille.277 pages.
Carte géologique du Tchad, échelle
1/1 500 000 par J-P. Wolff.
CASTANY, G. (1982). Principes et méthodes
de l'hydrogéologie. Edition Dunod, paris, 373 pages.
DJORET, D. (2000). Etude de la recharge de la
nappe du Chari Baguirmi (Tchad) par les méthodes chimiques et
isotopiques. Thèse de doctorat. Université d'Avignon et des pays
de Vaucluses, 186p.
ERIC GILLI, CHRISTIAN MANGAN, JACQUES MUDRY.(2012).
Hydrogéologie. Objets, méthodes, applications. 3é
édition Dunod.
H2O-Consultants (2017). Bureau d'études.
Rapports techniques exécution, suivi et contrôle des travaux de
forages à N'Djamena.
Kadjangaba, E. (2007). Etude hydrochimique et
isotopique du système zone non saturée-nappe dans la zone urbaine
de N'Djamena : impact de la pollution ; thèse de Doctorat,
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, 185 pages.
Massuel, S. (2001) .Modélisation
hydrodynamique de la nappe phréatique quaternaire du bassin du lac
Tchad. DEA Sciences de l'eau dans l'environnement continental.
Université de Montpellier II, Université d'Avignon et des pays de
Vaucluse 2001, 85p.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 91
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
MOUSSA Abderamane (2010). Les séries
sédimentaires fluviatiles, lacustres et éoliennes du bassin du
Tchad depuis le Miocène Terminal. Thèse de doctorat,
Université de Strasbourg, 202 pages.
Ndedje-Allah Mélanie Ronelngar (2015).
Contribution à la connaissance hydrogéologique des
aquifères du Quaternaire à la plaine de Naga (Sud-ouest du
Tchad). Mémoire de Master en Géoscience et Environnement.
NGARAM Nambatingar (2011) .Contribution à
l'étude analytique des polluants (en particulier de type métaux
lourds) dans les eaux du fleuve Chari lors de sa traversée de la ville
de N'Djamena. Thèse de l'université de Lyon.
NGOUNOU NGATCHA Benjamin, (1993).
Hydrogéologie d'aquifères complexes en zone semi-aride.
Les aquifères quaternaire du Grand Yaéré (Nord Cameroun).
Thèse de Doctorat. Université Joseph Fourier- Grenoble1.
NGOUNOU NGATCHA Benjamin, Jacques Mudry, Jean
François Aranyossi, Emmanuel Naah, Jean Sarroh Reynaud (2006).
Apport de la géologie, de l'hydrogéologie et des
isotopes de l'environnement à la connaissance des `'nappes en
creux» du grand Yaéré (Nord Cameroun). Article.
Nouayti N., Khattach D., Hilali M, (2015) .
Evaluation de la qualité physico-chimique des eaux souterraines des
nappes du Jurassique du haut bassin de Ziz (Haut Atlas central, Maroc) .
OMS, (2004).Directives de qualité pour
l'eau de boisson, 3e édition.
ORSTOM, (1970). Contribution géophysique
à la connaissance géologique bassin du lac Tchad.
ORSTOM, (1973). Le plioquaternaire ancien du
Tchad. Évolution des associations de diatomées, stratigraphie,
paléoécologie.
PADUR, (2013). Projet d'appui au
développement urbain.
PHILIPPE MATHIEU, (1985). Le
post-paléozoïque au Tchad.
PIAS, J,(1970). Notice explicative N° 41
carte pédologique du Tchad à 1/1.000.000 vol. 1 PIAS, J
(1969). Les sols du Tchad.
RGPH2, (2009). Deuxième recensement
général de la population et de l'habitat. Rapport provisoire.
Rodier (1978). L'analyse de l'eau. 9e
édition Dunod technique. Paris, 1136 pages.
Saadia BRICHA, Kadija OUNINE, Said OULKHEIR, Nourredine
EL HALOUI, Benaissa ATTARASSI, (avril 2007). Etude de la
qualité physicochimique et
bactériologique de la nappe phréatique M'nasra
(Maroc).
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 92
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
SAOUD Ibrahim (2014). Master de recherches.
Contribution à l'étude hydrochimique de la nappe du
Sénonien dans la région de Guerrara.
Schneider, J.L (2001). Géologie,
archéologie. Ressources minérales et énergétiques.
Edition 2001.
Schneider, J.L (2001). Géologie,
archéologie, hydrogéologie. Volume2. Carte de valorisation des
eaux souterraines a 1: 1 500 000 .Edition 2001
Schneider, J.L et Wolff, J.P (1992). Carte
géologique et cartes hydrogéologiques à 1 :1 500 000 de la
République du Tchad. Mémoire explicatif.
SDEA, schéma directeur de l'eau et de
l'assainissement 2003-2020.
Vincent NGUEZOUMKA KEBMAKI (2010). Master de
Recherche en Géographie. Université de Ngaoundéré,
Cameroun -
Yvan Noé TANIGNON Adingni, (2011).
Problématique de l'urbanisation et protection des ressources en
Eau souterraine : cas de la commune d'Abomey-Calavi. Mémoire de
Master.
ZAIRI,R, (2008). Thèse de doctorat. Etude
géochimique et hydrodynamique de la nappe libre du Bassin du Lac Tchad
dans les régions de Diffa (Niger oriental) et du Bornou (nord-est du
Nigeria). Université de Montpellier II .Sciences et techniques du
Languedoc. 209 pages.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 93
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
ANNEXES
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
ANNEXE 1 : données climatologiques
ANNEXE 1.1 Pluviométrie (mm) pour
N'Djaména Aéroport
|
Année
|
janvier
|
février
|
mars
|
avril
|
mai
|
juin
|
juillet
|
août
|
septembre
|
octobre
|
novembre
|
décembre
|
|
1984
|
0
|
0
|
0
|
47.4
|
21.7
|
35.4
|
70.2
|
34.2
|
16.6
|
0.6
|
0
|
0
|
|
1985
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9.4
|
18.4
|
92.1
|
161
|
82.7
|
1.3
|
0
|
0
|
|
1986
|
0
|
0
|
1.4
|
6.1
|
17.7
|
13.8
|
236.2
|
129
|
151
|
0.3
|
0
|
0
|
|
1987
|
0
|
0
|
0
|
0
|
68.6
|
67.7
|
67.3
|
130
|
44.4
|
26.8
|
0
|
0
|
|
1988
|
0
|
0
|
0
|
0
|
56.9
|
24.4
|
191.8
|
203
|
154
|
0.6
|
0
|
0
|
|
1989
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.6
|
84
|
180.4
|
186
|
62.1
|
79.3
|
0
|
0
|
|
1990
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.2
|
17.1
|
171.8
|
81.7
|
14
|
1.4
|
0
|
6
|
|
1991
|
0
|
0
|
0
|
19.4
|
78.2
|
31.4
|
159.2
|
281
|
60.1
|
0.6
|
0
|
0
|
|
1992
|
0
|
0
|
1.2
|
4.3
|
21.9
|
57.3
|
149.9
|
166
|
109
|
27.7
|
0
|
0
|
|
1993
|
0
|
0
|
0
|
5.8
|
38.7
|
45.4
|
121
|
198
|
46
|
5
|
0
|
0
|
|
1994
|
0
|
0
|
0
|
17.5
|
0
|
42.9
|
164.6
|
233
|
149
|
20.5
|
0
|
0
|
|
1995
|
0
|
0
|
0
|
4
|
2.6
|
30.4
|
147.1
|
120
|
119
|
22.8
|
0
|
0
|
|
1996
|
0
|
0
|
0
|
16.2
|
19.6
|
21.8
|
103.9
|
225
|
60.1
|
51.7
|
0
|
0
|
|
1997
|
0
|
0
|
0
|
13.1
|
9.1
|
62.3
|
135.1
|
146
|
37.4
|
19.1
|
0
|
0
|
|
1998
|
0
|
0
|
0
|
10
|
11.2
|
88.2
|
239
|
287
|
118
|
22.4
|
0
|
0
|
|
1999
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15
|
307.3
|
192
|
87.7
|
32.9
|
25.6
|
0
|
|
2000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
59.8
|
90.8
|
249.7
|
197
|
40.4
|
39.1
|
0
|
0
|
|
2001
|
0
|
0
|
0
|
1.2
|
18.1
|
45.8
|
135.9
|
163
|
251
|
29.8
|
0
|
0
|
|
2002
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
42.4
|
122.1
|
147
|
152
|
80.3
|
0
|
0
|
|
2003
|
0
|
0
|
0
|
0.4
|
109.3
|
51.1
|
113.6
|
292
|
81.1
|
16.7
|
0
|
0
|
|
2004
|
0
|
0
|
0
|
38.7
|
55.1
|
52.8
|
175.5
|
143
|
51.6
|
27.6
|
0
|
0
|
|
2005
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15.3
|
53.6
|
170.7
|
190
|
79.9
|
10.3
|
0
|
0
|
|
2006
|
0
|
0
|
0
|
1
|
31.7
|
87.4
|
174.8
|
295
|
83.5
|
37.6
|
0
|
0
|
|
2007
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10.5
|
106.9
|
218.5
|
180
|
72.5
|
29.4
|
16.5
|
0
|
|
2008
|
0
|
0
|
0
|
0
|
44.7
|
50.5
|
215.8
|
298
|
38.5
|
8
|
0
|
0
|
|
2009
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12.7
|
145
|
232
|
111
|
54.1
|
0
|
0
|
|
2010
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.8
|
51.5
|
215.3
|
123
|
156
|
20.7
|
0
|
0
|
|
2011
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10.8
|
77.2
|
59.6
|
180.6
|
156.2
|
22.6
|
0
|
0
|
|
2012
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30.1
|
53.8
|
154.3
|
266.9
|
94.3
|
13.8
|
0
|
0
|
|
2013
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.3
|
20.6
|
122.7
|
249.9
|
75.1
|
0
|
0
|
0
|
|
2014
|
0
|
0
|
0
|
0
|
26.9
|
4.6
|
173.1
|
147.4
|
86.3
|
17.1
|
0
|
0
|
2015 0 0 0 0 0.9 81.2 243.4 162 81.9 1.1 0 0
moy
ANNEXE 1.2 Températures minimales (°C) pour
N'Djaména Aéro.
|
Année
|
janvier
|
février
|
mars
|
avril
|
mai
|
juin
|
juillet
|
août
|
septembre
|
octobre
|
novembre
|
décembre
|
|
1984
|
14.2
|
17.9
|
23.6
|
26.1
|
26.4
|
25.8
|
23.6
|
24.1
|
24
|
24.2
|
20
|
15.6
|
|
1985
|
18.2
|
16.5
|
24.3
|
25.1
|
27.5
|
25.6
|
23.4
|
22.9
|
23.1
|
23
|
20.2
|
16.4
|
|
1986
|
14.4
|
19
|
23.9
|
26.1
|
26.9
|
25.8
|
23.1
|
22.8
|
22.4
|
22.2
|
19.3
|
15.2
|
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 94
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
|
1987
|
14.5
|
18
|
21.7
|
24.1
|
26.2
|
24.3
|
25.2
|
23.1
|
23.8
|
22.6
|
18.7
|
16.2
|
|
1988
|
15.6
|
17.4
|
23.2
|
26.3
|
26.7
|
25.1
|
23.3
|
22.5
|
22.3
|
20.5
|
17.4
|
15.7
|
|
1989
|
11.2
|
13.6
|
19
|
23.7
|
25.7
|
23.9
|
22.7
|
22.3
|
22.9
|
22.4
|
18.7
|
15.4
|
|
1990
|
16.8
|
16.6
|
19.8
|
26.2
|
27
|
26.3
|
22.7
|
22.9
|
23.6
|
23.2
|
21.7
|
19.1
|
|
1991
|
15.6
|
19.7
|
22.9
|
26.2
|
25.4
|
25.7
|
23.5
|
22.3
|
24.1
|
21.4
|
19.4
|
14.6
|
|
1992
|
13.9
|
16.2
|
23.1
|
26.8
|
26
|
25
|
23.1
|
22.2
|
22.6
|
21
|
18.7
|
14.6
|
|
1993
|
13
|
16.1
|
22.1
|
25.1
|
25.9
|
25.2
|
23.7
|
22.7
|
22.8
|
22.7
|
20.5
|
16.3
|
|
1994
|
15.9
|
17
|
22.4
|
26.7
|
27.2
|
25.9
|
23.5
|
22.2
|
23.3
|
23.4
|
17.6
|
13.4
|
|
1995
|
12.7
|
15.1
|
22.4
|
26.1
|
26.8
|
26.2
|
24.1
|
23
|
22.8
|
22
|
17.6
|
16.5
|
|
1996
|
15.3
|
18.3
|
23.6
|
25.6
|
27
|
25.3
|
24.3
|
22.3
|
23
|
21.9
|
17.2
|
15.6
|
|
1997
|
16.4
|
15.2
|
22.4
|
25.8
|
25.9
|
25.1
|
23.5
|
22.9
|
24
|
24.7
|
20.2
|
15.7
|
|
1998
|
14.9
|
19.2
|
20.6
|
26.7
|
28.7
|
26.2
|
23.8
|
23
|
23.6
|
23.7
|
20.8
|
16.5
|
|
1999
|
15.4
|
19
|
22
|
26
|
26.6
|
25.7
|
22.9
|
22.3
|
22.8
|
22.5
|
14
|
14.9
|
|
2000
|
16.8
|
14.7
|
19.8
|
25.7
|
25.8
|
25.2
|
22.9
|
22.2
|
23.4
|
21.5
|
18.8
|
13.9
|
|
2001
|
12.3
|
15.2
|
21.2
|
26.4
|
26.5
|
24.9
|
23.5
|
22.8
|
22.5
|
22
|
18.2
|
16.2
|
|
2002
|
12.8
|
16.7
|
22.7
|
26.8
|
26.6
|
25.3
|
24.4
|
23.2
|
23
|
22
|
18.5
|
14.9
|
|
2003
|
14.4
|
18.4
|
21.5
|
27
|
26.1
|
24.8
|
23.7
|
22.6
|
23.4
|
23.3
|
20.8
|
15.4
|
|
2004
|
15.5
|
16.9
|
21.4
|
25.8
|
27
|
25.7
|
23.4
|
23.1
|
23.8
|
23.1
|
19.8
|
16.3
|
|
2005
|
14.7
|
21.8
|
25.4
|
26.9
|
27.3
|
25.2
|
23.8
|
23.3
|
23.6
|
23
|
19.5
|
17.3
|
|
2006
|
17.8
|
21.1
|
23
|
24.9
|
26.9
|
25.4
|
24.4
|
23.4
|
23.4
|
23.5
|
18.3
|
14.1
|
|
2007
|
13.8
|
18.9
|
21.4
|
27.1
|
27.5
|
25.4
|
23.8
|
22.7
|
23.2
|
22.5
|
20.9
|
16.3
|
|
2008
|
14.2
|
19.4
|
18.9
|
25.6
|
26.4
|
25
|
23.1
|
22.9
|
23.7
|
23
|
19.2
|
17.4
|
|
2009
|
17.1
|
20.1
|
22.2
|
26.4
|
26.3
|
25.9
|
24.3
|
22.9
|
24.1
|
23.8
|
19.4
|
15.7
|
|
2010
|
16.2
|
20.6
|
22.3
|
27.4
|
28.3
|
26.5
|
24.3
|
23.8
|
23.5
|
24.4
|
20.7
|
15.7
|
|
2011
|
13.9
|
21.4
|
22.7
|
26.1
|
27.3
|
25.5
|
24.1
|
23
|
23.5
|
23.3
|
18.3
|
14.7
|
|
2012
|
14.7
|
20.5
|
21.2
|
27.7
|
26.9
|
25.4
|
23.8
|
22.4
|
23.8
|
24.3
|
19.8
|
15.5
|
|
2013
|
16.7
|
19
|
23.7
|
26.5
|
27.3
|
25.9
|
24.1
|
22.9
|
23.5
|
23.4
|
19.8
|
17.4
|
|
2014
|
15.2
|
20.1
|
23.7
|
26.7
|
24.2
|
23
|
22.8
|
21.6
|
21.4
|
23.3
|
19.6
|
15.9
|
2015 14.1 20.1 22.4 23.5 28.1 25.7 23.9 23 23.6 23.3 19.6 13.9
ANNEXE 1.3 Températures maximales (°C) pour
N'Djaména Aéro.
|
Année
|
janvier
|
février
|
mars
|
avril
|
mai
|
juin
|
juillet
|
août
|
septembre
|
octobre
|
novembre
|
décembre
|
|
1984
|
30.8
|
34.7
|
40.1
|
40.9
|
39.8
|
38.7
|
35.8
|
35.9
|
35.6
|
38.3
|
35.9
|
31.4
|
|
1985
|
35
|
32.4
|
39.6
|
39.1
|
40.7
|
37.8
|
32.8
|
32.8
|
33.9
|
38
|
36.8
|
32
|
|
1986
|
32.4
|
37
|
40.2
|
42.4
|
40.9
|
38.9
|
32.4
|
31.3
|
32.5
|
37.4
|
36.4
|
31.1
|
|
1987
|
33.1
|
35.7
|
38.5
|
39.8
|
41.4
|
36.5
|
36.7
|
32.4
|
35.9
|
37.3
|
36.4
|
33.6
|
|
1988
|
31.9
|
34.7
|
39.6
|
42.2
|
40.7
|
37.4
|
33.2
|
30.3
|
31.5
|
35.7
|
36.1
|
32.1
|
|
1989
|
28.7
|
31
|
36.8
|
41.4
|
38.9
|
37.4
|
33
|
31.4
|
33.5
|
36.4
|
36.1
|
32
|
|
1990
|
34.1
|
32.2
|
36.2
|
42.6
|
40.8
|
39.8
|
32.3
|
33.4
|
36.4
|
38.6
|
38.6
|
36.4
|
|
1991
|
32.1
|
37.8
|
39.2
|
40.9
|
36.2
|
37.4
|
33.1
|
30.7
|
34.5
|
37.5
|
36.6
|
31.5
|
|
1992
|
30.6
|
32.2
|
39.1
|
40.9
|
39.9
|
38
|
33.4
|
30
|
32.9
|
37.5
|
34.7
|
33.2
|
|
1993
|
29.5
|
34.1
|
39
|
40.9
|
39.7
|
38.1
|
34.5
|
32
|
33.8
|
38.4
|
38.2
|
32.8
|
|
1994
|
32.6
|
34.5
|
39.8
|
41
|
41.1
|
38.1
|
33
|
29.5
|
32.2
|
36.4
|
34.9
|
31.1
|
|
1995
|
30.7
|
32.7
|
39.5
|
40.9
|
40.8
|
38.1
|
34.3
|
31.5
|
33.2
|
36.3
|
35
|
34.4
|
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 95
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
|
1996
|
34.8
|
37.5
|
40.4
|
41.4
|
40.4
|
37.6
|
35.2
|
32.7
|
33.7
|
36.8
|
34.7
|
34.9
|
|
1997
|
27.5
|
27.4
|
35.3
|
38.7
|
40.2
|
37.7
|
35.3
|
35
|
37.9
|
38.9
|
35
|
30.2
|
|
1998
|
29
|
32.6
|
34.4
|
40.1
|
42.3
|
39.6
|
33.9
|
30.5
|
32.6
|
37.6
|
36.3
|
32.1
|
|
1999
|
34.3
|
38
|
41.8
|
42.6
|
41.2
|
39.5
|
42.4
|
30.7
|
32.5
|
35.4
|
37.5
|
33.6
|
|
20
|
35.1
|
32.4
|
33
|
40.1
|
39.1
|
36.9
|
31.8
|
30.1
|
33.6
|
33.7
|
31.7
|
27
|
|
2001
|
32.9
|
34.1
|
39.5
|
42.4
|
41.6
|
37.8
|
33
|
31.5
|
33.1
|
37.5
|
37.3
|
35.3
|
|
2002
|
30
|
35
|
40.1
|
43.1
|
43.1
|
39.1
|
36
|
32.6
|
34.5
|
36.7
|
37.2
|
33.5
|
|
2003
|
34.3
|
37.4
|
38.8
|
42.8
|
41.3
|
36.9
|
34
|
30.9
|
33.6
|
38
|
37.5
|
33.3
|
|
2004
|
33.2
|
35.2
|
37.9
|
43
|
40.7
|
38.1
|
34
|
32.7
|
35.7
|
39
|
37.9
|
35.1
|
|
2005
|
31.8
|
39.8
|
41.3
|
42.5
|
41
|
37.4
|
34.2
|
32
|
34.5
|
37.8
|
37.6
|
36.2
|
|
2006
|
36.7
|
39.3
|
40.1
|
41.7
|
40.1
|
38.4
|
35.9
|
31.9
|
33.5
|
37.5
|
35.6
|
32.4
|
|
2007
|
31.3
|
37.1
|
39.9
|
42.8
|
41.7
|
38.3
|
34.1
|
30.7
|
33.8
|
38.9
|
38.3
|
34.9
|
|
2008
|
30.7
|
37.8
|
41.4
|
40.3
|
40.6
|
38.4
|
34.7
|
31.7
|
34.2
|
37.8
|
30.1
|
35.8
|
|
2009
|
35.9
|
38.1
|
39.8
|
41.9
|
40.6
|
40.4
|
36
|
33.1
|
35.6
|
38.4
|
36.8
|
35.1
|
|
2010
|
35.6
|
39.1
|
39.7
|
43.6
|
43
|
39.1
|
33.5
|
31.8
|
33.1
|
36.8
|
38.2
|
34.3
|
|
2011
|
32.3
|
38.9
|
40.4
|
42.1
|
41.7
|
38.2
|
35.6
|
32.5
|
34.7
|
38.1
|
37.1
|
33.1
|
|
2012
|
33.1
|
38.2
|
38.4
|
43.2
|
40.1
|
35.8
|
31.9
|
30
|
33.5
|
37.6
|
37.7
|
34.3
|
|
2013
|
34.7
|
37.8
|
43
|
42.3
|
41.9
|
39.1
|
35.2
|
30.7
|
34.5
|
39.1
|
37.3
|
34.2
|
|
2014
|
33.5
|
38.1
|
39.6
|
42.2
|
36.2
|
34.8
|
32.2
|
30.6
|
31.3
|
37.5
|
36.5
|
33.9
|
2015 31.3 37.6 40.2 40.4 42.1 38.5 34.9 31.6 34.2 37.9 36.6
28.8
ANNEXE 1.4 Evaporation Piche (mm) pour
N'Djaména
Aéro.
|
Année
|
janvier
|
février
|
mars
|
avril
|
mai
|
juin
|
juillet
|
août
|
septembre
|
octobre
|
novembre
|
décembre
|
|
1984
|
340.7
|
392.6
|
473.8
|
389.7
|
297.6
|
280.0
|
204.4
|
187.1
|
189.1
|
333.1
|
383.9
|
332.0
|
|
1985
|
355.7
|
378.3
|
409.8
|
461.6
|
337.3
|
275.5
|
153.7
|
117.6
|
130.6
|
337.6
|
322.2
|
304.6
|
|
1986
|
312.6
|
373.8
|
445.1
|
439.9
|
355.8
|
282.5
|
152.6
|
97.2
|
90.2
|
247.9
|
304.1
|
296.2
|
|
1987
|
310.3
|
355.3
|
420.9
|
517.3
|
402.7
|
197.7
|
208.1
|
92.2
|
144.1
|
277.0
|
315.2
|
315.6
|
|
1988
|
280.9
|
372.0
|
451.6
|
395.9
|
330.2
|
223.3
|
151.9
|
70.7
|
80.3
|
195.8
|
250.7
|
253.6
|
|
1989
|
281.3
|
297.8
|
418.8
|
369.5
|
306.0
|
203.1
|
128.6
|
70.1
|
101.5
|
130.6
|
303.2
|
277.7
|
|
1990
|
272.5
|
338.1
|
376.3
|
256.0
|
160.5
|
112.0
|
73.2
|
60.0
|
54.3
|
80.1
|
134.9
|
189.0
|
|
1991
|
325.8
|
302.8
|
365.5
|
182.4
|
82.0
|
77.8
|
63.1
|
56.0
|
60.5
|
81.9
|
149.7
|
231.7
|
|
1992
|
278.3
|
376.1
|
418.9
|
393.6
|
267.9
|
237.8
|
132.2
|
60.1
|
79.0
|
193.0
|
270.8
|
287.7
|
|
1993
|
304.0
|
302.5
|
399.3
|
328.0
|
270.9
|
212.9
|
148.0
|
100.2
|
97.4
|
236.4
|
302.4
|
285.3
|
|
1994
|
275.4
|
338.9
|
473.1
|
343.8
|
327.2
|
250.5
|
124.9
|
62.4
|
73.2
|
141.5
|
272.4
|
277.8
|
|
1995
|
281.5
|
291.5
|
424.1
|
382.3
|
305.5
|
231.0
|
160.5
|
84.3
|
85.1
|
181.3
|
293.5
|
295.8
|
|
1996
|
295.6
|
329.3
|
454.7
|
370.6
|
283.8
|
207.1
|
160.0
|
93.8
|
93.8
|
202.1
|
306.5
|
281.8
|
|
1997
|
330.5
|
351.6
|
417.3
|
301.3
|
260.6
|
189.5
|
128.2
|
78.8
|
137.3
|
177.9
|
290.9
|
270.1
|
|
1998
|
329.8
|
349.8
|
411.4
|
364.4
|
328.8
|
223.3
|
122.5
|
54.3
|
74.8
|
160.0
|
268.7
|
245.4
|
|
1999
|
254.0
|
271.8
|
382.7
|
402.0
|
261.3
|
211.3
|
176.8
|
52.5
|
56.8
|
129.9
|
227.4
|
231.0
|
|
2000
|
263.7
|
280.4
|
386.4
|
363.3
|
321.7
|
212.4
|
121.6
|
68.8
|
112.7
|
202.6
|
323.1
|
255.6
|
|
2001
|
290.2
|
291.7
|
433.3
|
341.2
|
307.4
|
193.9
|
134.5
|
69.9
|
72.2
|
222.3
|
287
|
285
|
|
2002
|
273.1
|
280.7
|
415.4
|
330
|
331.4
|
210.5
|
148.4
|
78.3
|
81.2
|
167.6
|
256
|
263.6
|
|
2003
|
244.6
|
272.1
|
376.1
|
377.5
|
350.6
|
178.4
|
130.1
|
62.6
|
74.5
|
162.1
|
274
|
274.4
|
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 96
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
|
2004
|
279.7
|
339.6
|
419.8
|
399.5
|
292.1
|
215
|
131.5
|
86.4
|
132
|
227.5
|
302
|
262.5
|
|
2005
|
252.8
|
336.3
|
451.1
|
368.8
|
328.5
|
196.6
|
146.4
|
69.9
|
87.1
|
183.1
|
269
|
253
|
|
2006
|
259.9
|
265.3
|
370.2
|
369.9
|
257.8
|
202.6
|
161.2
|
70.7
|
81
|
174.8
|
271
|
256
|
|
2007
|
306.2
|
308.6
|
415.1
|
349
|
293.9
|
199.6
|
125
|
50.4
|
79.5
|
197.8
|
281
|
297.8
|
|
2008
|
256.5
|
324.1
|
414
|
350.2
|
285.8
|
192.6
|
117.8
|
55
|
86.3
|
224.2
|
282
|
278.6
|
|
2009
|
268.6
|
339.5
|
396.1
|
272.9
|
266.9
|
235.2
|
164.5
|
75.1
|
106
|
165.9
|
247
|
265.6
|
|
2010
|
247.1
|
305
|
348.8
|
358.9
|
298.1
|
208.4
|
105.4
|
53.5
|
107
|
143.1
|
278
|
275.7
|
|
2011
|
285.6
|
328.9
|
481.6
|
408
|
326.7
|
207
|
154.5
|
86
|
108
|
203.7
|
266
|
259.7
|
|
2012
|
272.8
|
339.4
|
479.4
|
409.1
|
295.9
|
194.2
|
102.5
|
60.6
|
84
|
167.5
|
251
|
259.4
|
|
2013
|
258.8
|
327.1
|
397.2
|
397.9
|
287.4
|
239.6
|
146
|
69.9
|
98.5
|
223.4
|
287
|
272.7
|
|
2014
|
268.1
|
331
|
379.5
|
342.6
|
295
|
252.7
|
**
|
77.7
|
102
|
168.6
|
**
|
**
|
ANNEXE 1.5 Humidités Relatives Minimales (%)
pour N'Djaména
|
Année
|
janvier
|
février
|
mars
|
avril
|
mai
|
juin
|
juillet
|
août
|
septembre
|
octobre
|
novembre
|
décembre
|
|
1984
|
10
|
8
|
7
|
16
|
23
|
22
|
31
|
32
|
30
|
15
|
9
|
11
|
|
1985
|
8
|
6
|
10
|
6
|
16
|
26
|
44
|
48
|
42
|
13
|
10
|
11
|
|
1986
|
8
|
6
|
6
|
8
|
14
|
22
|
46
|
55
|
52
|
18
|
11
|
10
|
|
1987
|
7
|
6
|
8
|
7
|
15
|
24
|
45
|
52
|
47
|
16
|
11
|
11
|
|
1990
|
8
|
7
|
8
|
9
|
18
|
21
|
49
|
47
|
44
|
17
|
10
|
12
|
|
1991
|
10
|
10
|
8
|
14
|
36
|
32
|
47
|
60
|
42
|
18
|
10
|
11
|
|
1992
|
11
|
7
|
10
|
11
|
22
|
25
|
44
|
49
|
43
|
16
|
10
|
11
|
|
1993
|
13
|
7
|
6
|
12
|
22
|
28
|
41
|
53
|
44
|
16
|
11
|
11
|
|
1994
|
13
|
6
|
5
|
14
|
14
|
26
|
48
|
65
|
55
|
30
|
11
|
15
|
|
1995
|
16
|
13
|
10
|
13
|
18
|
30
|
43
|
57
|
50
|
24
|
10
|
11
|
|
1996
|
33
|
13
|
6
|
11
|
23
|
29
|
40
|
51
|
50
|
22
|
10
|
12
|
|
1997
|
9
|
11
|
8
|
17
|
23
|
26
|
47
|
55
|
39
|
26
|
11
|
9
|
|
1998
|
8
|
8
|
12
|
16
|
18
|
28
|
51
|
67
|
56
|
32
|
14
|
15
|
|
1999
|
11
|
9
|
8
|
11
|
20
|
25
|
52
|
63
|
58
|
32
|
14
|
13
|
|
2000
|
15
|
13
|
9
|
14
|
32
|
32
|
50
|
61
|
46
|
22
|
16
|
14
|
|
2001
|
13
|
14
|
8
|
12
|
21
|
28
|
46
|
57
|
56
|
21
|
14
|
17
|
|
2002
|
16
|
10
|
9
|
16
|
15
|
30
|
43
|
60
|
53
|
31
|
18
|
16
|
|
2003
|
13
|
10
|
10
|
15
|
20
|
39
|
50
|
65
|
55
|
30
|
13
|
14
|
|
2004
|
14
|
15
|
11
|
12
|
29
|
34
|
49
|
58
|
43
|
23
|
14
|
11
|
|
2005
|
12
|
11
|
11
|
15
|
22
|
35
|
49
|
61
|
48
|
25
|
15
|
15
|
|
2006
|
18
|
9
|
9
|
10
|
23
|
33
|
44
|
60
|
52
|
30
|
16
|
19
|
|
2007
|
16
|
10
|
8
|
14
|
22
|
32
|
47
|
64
|
49
|
19
|
15
|
12
|
|
2008
|
17
|
8
|
8
|
13
|
21
|
30
|
45
|
60
|
48
|
21
|
13
|
12
|
|
2009
|
9
|
7
|
9
|
18
|
59
|
24
|
43
|
58
|
50
|
30
|
16
|
12
|
|
2010
|
14
|
11
|
8
|
10
|
19
|
32
|
52
|
66
|
59
|
41
|
19
|
14
|
|
2011
|
12
|
11
|
10
|
13
|
22
|
36
|
43
|
58
|
51
|
28
|
12
|
12
|
|
2012
|
11
|
10
|
8
|
12
|
24
|
36
|
55
|
64
|
55
|
31
|
16
|
10
|
|
2013
|
12
|
11
|
9
|
12
|
21
|
32
|
43
|
65
|
50
|
28
|
12
|
15
|
|
2014
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
Mémoire de Master rédigé par
Amann Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 97
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
ANNEXE 1.6 Humidités Relatives Maximales (%) pour
N'Djaména
|
Année
|
janvier
|
février
|
mars
|
avril
|
mai
|
juin
|
juillet
|
août
|
septembre
|
octobre
|
novembre
|
décembre
|
|
1984
|
33
|
31
|
30
|
46
|
69
|
66
|
78
|
82
|
79
|
53
|
30
|
35
|
|
1985
|
28
|
21
|
32
|
23
|
54
|
70
|
91
|
92
|
92
|
53
|
41
|
38
|
|
1986
|
38
|
31
|
29
|
30
|
54
|
69
|
90
|
94
|
95
|
72
|
41
|
38
|
|
1987
|
36
|
31
|
32
|
19
|
45
|
79
|
77
|
93
|
89
|
62
|
37
|
34
|
|
1988
|
35
|
26
|
22
|
38
|
59
|
78
|
90
|
95
|
97
|
83
|
57
|
53
|
|
1989
|
37
|
29
|
25
|
37
|
59
|
74
|
91
|
96
|
93
|
70
|
39
|
39
|
|
1990
|
35
|
27
|
18
|
41
|
62
|
67
|
92
|
93
|
87
|
57
|
39
|
37
|
|
1991
|
32
|
29
|
26
|
48
|
80
|
79
|
91
|
97
|
92
|
78
|
38
|
39
|
|
1992
|
39
|
23
|
32
|
38
|
66
|
76
|
89
|
95
|
95
|
75
|
46
|
38
|
|
1993
|
38
|
27
|
27
|
45
|
66
|
78
|
85
|
94
|
93
|
67
|
39
|
41
|
|
1994
|
40
|
26
|
20
|
46
|
52
|
71
|
90
|
96
|
95
|
90
|
48
|
43
|
|
1995
|
51
|
42
|
34
|
43
|
61
|
75
|
86
|
96
|
96
|
86
|
43
|
37
|
|
1996
|
36
|
38
|
29
|
42
|
68
|
77
|
85
|
94
|
93
|
80
|
41
|
42
|
|
1997
|
34
|
25
|
27
|
53
|
66
|
78
|
91
|
97
|
90
|
85
|
47
|
41
|
|
1998
|
33
|
27
|
28
|
41
|
60
|
74
|
91
|
97
|
97
|
86
|
55
|
51
|
|
1999
|
47
|
47
|
34
|
36
|
62
|
74
|
94
|
99
|
98
|
92
|
60
|
52
|
|
2000
|
49
|
44
|
33
|
44
|
63
|
79
|
91
|
97
|
94
|
78
|
47
|
51
|
|
2001
|
48
|
42
|
34
|
46
|
69
|
80
|
90
|
96
|
96
|
75
|
48
|
51
|
|
2002
|
44
|
40
|
34
|
51
|
55
|
75
|
85
|
94
|
94
|
83
|
57
|
48
|
|
2003
|
48
|
37
|
34
|
46
|
52
|
83
|
92
|
96
|
92
|
88
|
53
|
48
|
|
2004
|
48
|
39
|
28
|
44
|
72
|
79
|
92
|
95
|
91
|
73
|
47
|
41
|
|
2005
|
38
|
35
|
27
|
43
|
58
|
83
|
92
|
95
|
94
|
78
|
45
|
49
|
|
2006
|
46
|
38
|
29
|
30
|
68
|
80
|
87
|
95
|
94
|
82
|
48
|
49
|
|
2007
|
46
|
36
|
30
|
45
|
63
|
78
|
89
|
97
|
95
|
82
|
50
|
38
|
|
2008
|
47
|
31
|
30
|
40
|
66
|
76
|
91
|
95
|
93
|
67
|
43
|
46
|
|
2009
|
39
|
25
|
24
|
58
|
23
|
64
|
85
|
95
|
91
|
84
|
52
|
43
|
|
2010
|
43
|
32
|
26
|
34
|
54
|
71
|
90
|
95
|
95
|
91
|
57
|
43
|
|
2011
|
41
|
35
|
24
|
34
|
59
|
77
|
87
|
93
|
94
|
76
|
41
|
40
|
|
2012
|
35
|
32
|
24
|
35
|
61
|
76
|
91
|
96
|
93
|
86
|
54
|
44
|
|
2013
|
43
|
35
|
29
|
39
|
61
|
73
|
85
|
94
|
90
|
82
|
47
|
43
|
|
2014
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
ANNEXE 1.7 Durée de l'ensoleillement (Heure et
dixième) pour N'Djamena
|
Année
|
janvier
|
février
|
mars
|
avril
|
mai
|
juin
|
juillet
|
août
|
septembre
|
octobre
|
novembre
|
décembre
|
|
1984
|
9.2
|
8.8
|
9.0
|
8.6
|
9.4
|
8.8
|
8.2
|
8.2
|
6.7
|
9.4
|
9.6
|
8.7
|
|
1985
|
9.1
|
7.0
|
7.9
|
8.1
|
9.8
|
5.3
|
7.2
|
7.0
|
7.8
|
9.1
|
9.9
|
9.0
|
|
1986
|
9.8
|
9.7
|
8.7
|
10.0
|
9.1
|
8.8
|
6.6
|
6.8
|
8.0
|
9.6
|
9.6
|
8.8
|
|
1987
|
10.0
|
9.6
|
8.2
|
9.1
|
10.1
|
9.0
|
8.6
|
6.4
|
8.6
|
9.4
|
10.0
|
9.6
|
|
1988
|
8.9
|
9.7
|
8.9
|
9.6
|
8.4
|
8.6
|
6.7
|
5.4
|
6.6
|
9.9
|
10.2
|
8.8
|
|
1989
|
10.0
|
10.0
|
9.9
|
10.0
|
7.6
|
8.9
|
6.9
|
7.4
|
7.4
|
9.5
|
10.0
|
9.6
|
|
1990
|
9.4
|
9.8
|
9.9
|
10.1
|
9.8
|
9.1
|
5.6
|
8.5
|
8.2
|
9.1
|
9.3
|
9.2
|
|
1991
|
9.8
|
10.0
|
8.9
|
8.6
|
6.6
|
9.0
|
7.3
|
6.4
|
8.8
|
8.9
|
9.8
|
9.3
|
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 98
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
|
1992
|
8.8
|
9.6
|
7.3
|
6.5
|
7.3
|
7.1
|
5.8
|
4.6
|
7.4
|
9.8
|
9.4
|
10.0
|
|
1993
|
9.5
|
10.0
|
8.9
|
9.0
|
9.3
|
9.0
|
7.4
|
7.4
|
7.6
|
9.4
|
9.9
|
9.7
|
|
1994
|
9.5
|
9.3
|
10.2
|
7.8
|
9.7
|
8.8
|
7.2
|
6.0
|
7.6
|
9.2
|
10.2
|
9.8
|
|
1995
|
9.7
|
10.3
|
9.1
|
8.6
|
9.7
|
8.7
|
7.2
|
6.5
|
8.3
|
8.9
|
10.1
|
10.5
|
|
1996
|
10.3
|
10.1
|
8.8
|
9.3
|
9.1
|
8.8
|
7.7
|
7.2
|
6.9
|
9.1
|
10.2
|
10.3
|
|
1997
|
10.0
|
9.4
|
8.5
|
7.6
|
8.8
|
7.3
|
7.5
|
7.3
|
7.9
|
8.0
|
9.6
|
9.8
|
|
1998
|
9.6
|
9.5
|
8.7
|
9.1
|
9.4
|
8.5
|
5.8
|
5.7
|
6.8
|
9.2
|
10.0
|
9.8
|
|
1999
|
10.1
|
9.8
|
10.4
|
9.9
|
8.8
|
9.1
|
6.1
|
6.9
|
6.4
|
8.8
|
9.9
|
10.3
|
|
2000
|
10.1
|
9.8
|
10.1
|
10.2
|
10.0
|
9.3
|
7.0
|
7.5
|
8.4
|
9.0
|
10.5
|
10.1
|
|
2001
|
10.5
|
9.7
|
10.2
|
9.1
|
9.1
|
7.4
|
7.1
|
6.1
|
8.3
|
9.8
|
10.7
|
10.5
|
|
2002
|
9.8
|
9.6
|
9.1
|
9.1
|
10.0
|
8.0
|
7.1
|
7.2
|
7.9
|
8.7
|
9.8
|
10.3
|
|
2003
|
10.2
|
9.7
|
8.7
|
8.6
|
9.4
|
8.1
|
7.2
|
5.7
|
7.8
|
9.1
|
9.9
|
9.6
|
|
2004
|
9.3
|
9.6
|
8.7
|
9.8
|
9.2
|
7.9
|
6.9
|
6.7
|
8.5
|
9.1
|
10.0
|
9.9
|
|
2005
|
9.1
|
8.9
|
8.3
|
8.1
|
7.6
|
6.8
|
7.4
|
7.1
|
7.6
|
9.5
|
10.4
|
10.2
|
|
2006
|
9.9
|
9.5
|
7.9
|
9.6
|
7.5
|
8.1
|
7.9
|
6.2
|
6.6
|
9.1
|
10.1
|
10.3
|
|
2007
|
9.7
|
10.0
|
9.6
|
8.6
|
7.7
|
8.4
|
8.0
|
5.4
|
7.3
|
9.9
|
10.1
|
10.1
|
|
2008
|
9.5
|
9.8
|
9.9
|
7.5
|
9.6
|
8.7
|
8.2
|
5.9
|
6.6
|
9.1
|
10.3
|
10.0
|
|
2009
|
9.6
|
9.5
|
8.6
|
7.3
|
8.1
|
8.1
|
7.4
|
6.3
|
8.1
|
7.7
|
9.7
|
10.4
|
|
2010
|
10.2
|
10.1
|
8.0
|
8.7
|
8.7
|
7.5
|
5.5
|
5.9
|
7.4
|
8.6
|
10.2
|
10.3
|
|
2011
|
10
|
9
|
9.9
|
8.9
|
8.8
|
7.8
|
7
|
6.4
|
8
|
9.5
|
10.6
|
10.2
|
|
2012
|
10.1
|
8.8
|
8.7
|
8.2
|
7.6
|
6.5
|
5.4
|
5.8
|
7.9
|
9.2
|
10.2
|
10.3
|
|
2013
|
9.6
|
9.6
|
8.9
|
8.3
|
8.5
|
7.8
|
7.1
|
6.1
|
7.6
|
9.1
|
10.2
|
10.1
|
|
2014
|
9.5
|
10.1
|
8.4
|
8.5
|
10
|
9.3
|
7.1
|
6.7
|
8.8
|
9.8
|
10.1
|
10.2
|
** = Données manquantes.
SOURCE : Division de la Climatologie
(DC)/Direction d'Exploitation et d'Application Météorologique
(DEAM) /Direction Générale de la Météorologie
Nationale (DGMN)/Mai/2015.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 99
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 100
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
ANNEXE 2 : données hydrodynamiques
ANNEXE 2.1 : Niveau piézométrique des points d'eau
de N'Djamena.
|
N°
|
QUARTIER
|
X
|
Y
|
COTE TOPO
|
NS
|
N. PIEZOMETRIQUE
|
|
1
|
MANDJAFA
|
15.15729°
|
12.04189°
|
295
|
6,9
|
288,1
|
|
2
|
BAKARA
|
15.17825°
|
12.03810°
|
295
|
9,78
|
285,22
|
|
3
|
MANDJAFA
|
15.17098°
|
12.04707°
|
294
|
9,32
|
284,68
|
|
4
|
MANDJAFA
|
15.16985°
|
12.04981°
|
295
|
8,64
|
286,36
|
|
5
|
GASSI
|
15.15455°
|
12.07396°
|
295
|
9,95
|
285,05
|
|
6
|
GASSI
|
15.13637°
|
12.08516°
|
294
|
10,5
|
283,5
|
|
7
|
GASSI
|
15.12067°
|
12.09093°
|
294
|
9,6
|
284,4
|
|
8
|
HABENA
|
15.11293°
|
12.09290°
|
294
|
9,83
|
284,17
|
|
9
|
WALIA
|
15.10624°
|
12.07591°
|
294
|
7,1
|
286.9
|
|
10
|
WALIA
|
15.10004°
|
12.07514°
|
294
|
6,72
|
287,28
|
|
11
|
NGUELI
|
15.06490°
|
12.06705°
|
294
|
4,16
|
289,84
|
|
12
|
NDINGAGALI
|
15.08834°
|
12.05889°
|
294
|
4,29
|
289,71
|
|
13
|
NDINGAGALI
|
15.09212°
|
12.05687°
|
294
|
6,19
|
287,81
|
|
14
|
TOUKRA
|
15.10364°
|
12.02785°
|
295
|
6,7
|
288,3
|
|
15
|
NGONBA
|
15.12588°
|
12.04874°
|
295
|
5,88
|
289,12
|
|
16
|
NGONBA
|
15.09723°
|
12.10472°
|
294
|
13,31
|
280,69
|
|
17
|
HABENA
|
15.10159°
|
12.09926°
|
294
|
12,3
|
281,7
|
|
18
|
CHAGOUA
|
15.09977°
|
12.09090°
|
294
|
9,91
|
284,09
|
|
19
|
SABANGALI
|
15.06008°
|
12.09060°
|
293
|
9,1
|
283,9
|
|
20
|
FARCHA
|
14.99953°
|
12.12706°
|
293
|
12,25
|
280,75
|
|
21
|
FARCHA
|
14.99481°
|
12.12347°
|
293
|
12,22
|
280,78
|
|
22
|
MILEZI
|
14.98232°
|
12.11755°
|
293
|
10,18
|
282,82
|
|
23
|
MILEZI
|
14.97338°
|
12.13071°
|
293
|
13,2
|
279,8
|
|
24
|
FARCHA
|
14.977080°
|
12.14141°
|
293
|
13,15
|
279,85
|
|
25
|
GUINEBOR
|
15.00984°
|
12.16846°
|
293
|
15,85
|
277,15
|
|
27
|
GUINEBOR
|
15.04542°
|
12.19628°
|
293
|
18,76
|
274,24
|
|
28
|
AMSINENE
|
15.0083332°
|
12.1277781°
|
293
|
14,55
|
278,45
|
|
29
|
MILEZI
|
14.96666°
|
12.11666°
|
293
|
12,54
|
280,46
|
|
30
|
GUINEBOR
|
15.0249999°
|
12.158333°
|
293
|
18,2
|
274,8
|
|
31
|
MILEZI
|
14.98333°
|
12.116666°
|
293
|
10,05
|
282,95
|
|
32
|
HABENA
|
15.09888°
|
12.094166°
|
294
|
8,5
|
285,5
|
|
33
|
FARCHA
|
15.041111°
|
12.1319447°
|
293
|
11,17
|
281,83
|
|
34
|
HABENA
|
15.114722°
|
12.097222°
|
294
|
9,47
|
284,53
|
|
35
|
HABENA
|
15.113333°
|
12.09888°
|
294
|
9,35
|
284,65
|
|
36
|
GOUDJI
|
15.0683°
|
12.14333°
|
293
|
12,82
|
280,18
|
|
37
|
GOUDJI
|
15.074444°
|
12.16277°
|
293
|
15,69
|
277,31
|
|
38
|
HABENA
|
15.105278°
|
12.106389°
|
294
|
10,52
|
283,48
|
|
39
|
CHAGOUA
|
15.084722°
|
12.092499°
|
294
|
8,18
|
285,82
|
|
40
|
FARCHA
|
15.043055°
|
12.1297226°
|
293
|
10,96
|
282,04
|
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 101
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
|
41
|
FARCHA
|
15.0333°
|
12.11666°
|
293
|
6,84
|
286,16
|
|
42
|
|
15.0333°
|
12.11666°
|
293
|
10,96
|
282,04
|
|
43
|
DIGUEL
|
15.15771°
|
12.15777°
|
293
|
16,29
|
276,71
|
|
44
|
DIGUEL
|
15.1130552°
|
12.14333°
|
294
|
14,84
|
279,16
|
|
45
|
TOUKRA
|
15.11027°
|
12.03166°
|
295
|
9,47
|
285,53
|
|
46
|
NDINGAGALI
|
15.07306°
|
12.05722°
|
294
|
6,32
|
287,68
|
|
47
|
NDINGAGALI
|
15.071944°
|
12.06388°
|
294
|
5,88
|
288,12
|
|
48
|
NDINGAGALI
|
15.06555°
|
12.0691671°
|
294
|
5,36
|
288,64
|
|
49
|
TOUKRA
|
15.08333°
|
12.0333°
|
294
|
11,89
|
282,11
|
|
50
|
NDINGAGALI
|
15.065556°
|
12.0691671°
|
294
|
5,36
|
288,64
|
|
51
|
NGONBA
|
15.130000°
|
12.0666°
|
294
|
7,78
|
286,22
|
|
52
|
NGONBA
|
15.127777°
|
12.050000°
|
295
|
8,65
|
286,35
|
|
53
|
GOUDJI
|
15.04166°
|
12.19999°
|
293
|
18,09
|
274,91
|
|
54
|
GOUDJI
|
15.04722°
|
12.180555°
|
293
|
19,45
|
273,55
|
|
55
|
GOUDJI
|
15.15777°
|
12.14999°
|
294
|
17,81
|
276,19
|
|
56
|
LAMADJI
|
15.05833°
|
12.23055°
|
292
|
22,5
|
269.5
|
|
57
|
LAMADJI
|
15.05500°
|
12.229167°
|
292
|
20,85
|
271,15
|
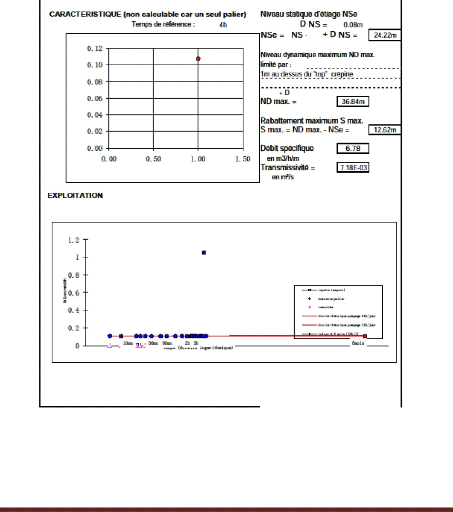
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 102
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
ANNEXE 2.2 fiches d'essai de pompage
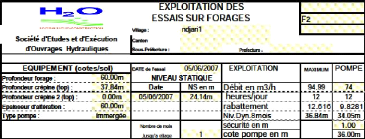
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 103
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
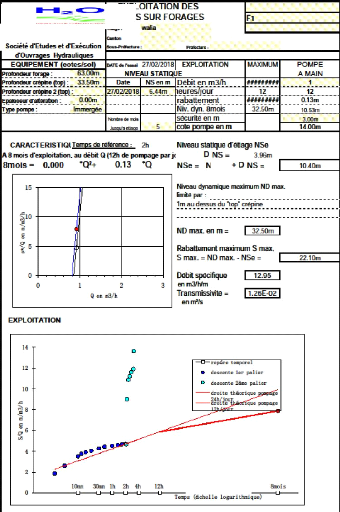
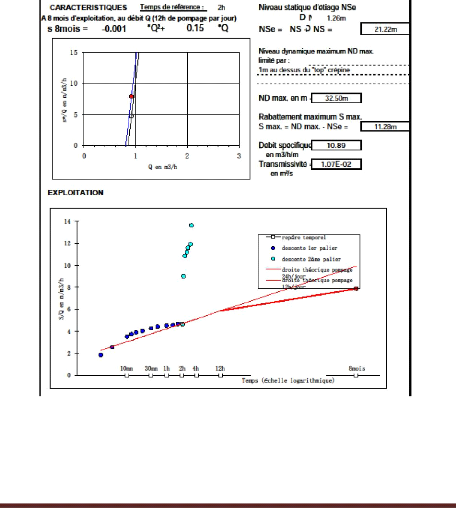
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 104
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
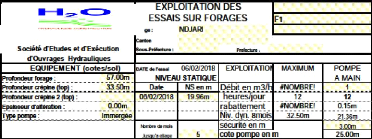
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la ville de
N'Djamena
ANNEXE 3 : données chimiques
ANNEXE 3.1 : résultats des analyses
physico- chimiques des points d'eau à N'Djamena.
|
N° FORAGE
|
X
|
Y
|
NOMS
|
Ca2+ (mg/l)
|
Mg2+ (mg/l)
|
K+ (mg/l)
|
Na+ (mg/l)
|
HCO3- (mg/l)
|
Cl- (mg/l)
|
SO42- (mg/l)
|
NO3- (mg/l)
|
Fer+ (mg/l)
|
Mn- (mg/l)
|
NH4 + (mg/l)
|
PH
|
Cond (u/cm)
|
Turbidité (NTU)
|
Dureté Tot
|
|
P1
|
15.065
|
12.05
|
NGUELI
|
|
25.6
|
|
13.6
|
|
3
|
|
28
|
165.9
|
|
19
|
|
13
|
|
10
|
|
0.1
|
|
0.02
|
|
0.22
|
7.05
|
409
|
|
|
0.3
|
|
120
|
|
P2
|
15.084
|
12.05
|
DINGAGALI
|
|
16
|
|
9.7
|
|
2.2
|
|
21
|
122
|
|
12
|
|
9
|
|
1.3
|
|
0.1
|
|
0.08
|
|
0.05
|
7.49
|
254
|
|
|
0.3
|
|
80
|
|
P3
|
15.107
|
12.02
|
TOUKRA
|
|
80
|
|
24.3
|
|
8
|
|
81
|
439.2
|
|
48
|
|
51
|
|
2
|
|
0.4
|
|
0.06
|
|
1.5
|
6.69
|
1123
|
|
|
0.1
|
|
300
|
|
P4
|
15.127
|
12.05
|
NGONBA
|
|
19.2
|
|
3.9
|
|
1.5
|
|
15
|
92.7
|
|
9
|
|
6
|
|
3
|
|
0.2
|
|
0.07
|
|
0.42
|
7.01
|
228
|
|
|
0.2
|
|
64
|
|
P5
|
15.106
|
12.08
|
WALIA BARRIERE
|
|
18.4
|
|
2.4
|
|
1.1
|
|
12
|
80.5
|
|
7
|
|
4
|
|
3
|
|
0.3
|
|
0
|
|
0.43
|
6.75
|
142
|
|
|
0.3
|
|
56
|
|
P6
|
15.099
|
12.09
|
CHAGOUA
|
|
16.8
|
|
6.3
|
|
1.8
|
|
17
|
97.6
|
|
10.1
|
|
8
|
|
4
|
|
2.1
|
|
0.05
|
|
0.47
|
7.48
|
235
|
|
|
0.1
|
|
68
|
|
P7
|
15.151
|
12.07
|
GASSI 3
|
|
21.6
|
|
12.6
|
|
2.5
|
|
25
|
151.3
|
|
15
|
|
11
|
|
6.4
|
|
0.26
|
|
0.01
|
|
0.35
|
7.27
|
343
|
|
|
0
|
|
106
|
|
P8
|
15.085
|
12.11
|
AMKOUNDJARA 2
|
|
80
|
|
14.6
|
|
5
|
|
48
|
341.6
|
|
39
|
|
28
|
|
2.6
|
|
0.4
|
|
0
|
|
2
|
6.21
|
790
|
|
|
0.1
|
|
260
|
|
P9
|
15.084
|
12.12
|
AMKOUNDJARA 1
|
|
80
|
|
19.4
|
|
6
|
|
54
|
366
|
|
40
|
|
38
|
|
6
|
|
2.9
|
|
0
|
|
1.9
|
6.3
|
969
|
|
|
6.7
|
|
280
|
|
P10
|
15.103
|
12.11
|
AMTOUKOUIN1
|
|
21.6
|
|
14.6
|
|
2.6
|
|
27
|
156.2
|
|
17
|
|
12
|
|
6.1
|
|
0.4
|
|
0
|
|
0.64
|
6.66
|
352
|
|
|
0
|
|
114
|
|
P11
|
15.074
|
12.14
|
AMRIGUEBE
|
|
17.6
|
|
2.9
|
|
3
|
|
18
|
68.3
|
|
17
|
|
16
|
|
2
|
|
0.01
|
|
|
|
0.1
|
7.87
|
508
|
|
|
0.1
|
|
56
|
|
P12
|
15.116
|
12.12
|
NDJARI DARASALAM
|
|
17.6
|
|
8.7
|
|
4
|
|
21
|
104.9
|
|
18
|
|
11
|
|
5.8
|
|
0.11
|
|
|
|
0.52
|
7.31
|
514
|
|
|
1.3
|
|
80
|
|
P13
|
15.099
|
12.13
|
NDJARI
|
|
19.2
|
|
3.9
|
|
2.3
|
|
16
|
92.7
|
|
14
|
|
3
|
|
3.3
|
|
0.03
|
|
|
|
0.45
|
7.36
|
254
|
|
|
2.8
|
|
64
|
|
P14
|
15.465
|
12.1
|
AMBATTA
|
|
24.8
|
|
8.3
|
|
2.3
|
|
50
|
134.2
|
|
30
|
|
18
|
|
5
|
|
0.03
|
|
|
|
1.12
|
6.89
|
325
|
|
|
0.1
|
|
96
|
|
P15
|
15.115
|
12.11
|
AMTOUKOUIN2
|
|
16
|
|
1.9
|
|
1.7
|
|
17
|
68.3
|
|
13
|
|
6
|
|
2
|
|
0.1
|
|
|
|
0.1
|
7.08
|
299
|
|
|
0.9
|
|
48
|
|
P16
|
15.076
|
12.09
|
SABANGALI
|
|
11.2
|
|
2.5
|
|
1.2
|
|
10.1
|
53.7
|
|
8.9
|
|
5.1
|
|
0.1
|
|
0.01
|
|
|
|
0.02
|
7.25
|
176
|
|
|
0
|
|
40
|
|
P17
|
14.976
|
12.16
|
FARCHA DJOUGOULIE
|
|
30
|
|
6
|
|
0.5
|
|
18
|
60
|
|
3
|
|
4
|
|
10
|
|
0.1
|
|
|
|
0.4
|
7.48
|
320
|
|
|
0.1
|
|
35
|
|
P18
|
14.996
|
12.17
|
GUINEBOR
|
|
21
|
|
8
|
|
1.3
|
|
22
|
36
|
|
1
|
|
3
|
|
17.7
|
|
0.15
|
|
|
|
0.5
|
7.03
|
311
|
|
|
0.3
|
|
29
|
|
NORME OMS 2008
|
=
|
100
|
=
|
50
|
=
|
12
|
=
|
200
|
Pas
d'indication
|
=
|
250
|
=
|
250
|
=
|
50
|
=
|
0,3
|
=
|
0,5
|
=
|
1,5
|
6,5-8,5
|
=1000
|
=
|
5
|
|
1000
|
|
En rouge, valeurs supérieures à la norme
OMS.
.
,
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 105
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la ville de
N'Djamena
ANNEXE 3.2
Désinfection d'un puits
Pour désinfecter un puits, on utilise de l'eau de javel
dont la teneur en hypochlorite de Sodium est d'environ 5%.
En premier lieu, à l'exception des puits tubés,
on doit désinfecter les parois à l'aide d'une vadrouille propre
et d'une solution d'eau javellisée.
PUITS DE SURFACE
|
Diamètre du
puits
(millimètres)
|
Profondeur d'eau dans le puits
(mètres)
|
|
1
|
1,5
|
2
|
2,5
|
3
|
3,5
|
4
|
|
Millilitres d'eau de Javel
|
|
914
|
700 ml
|
1 000 ml
|
1 300 ml
|
1 600 ml
|
2 000 ml
|
2 300 ml
|
2 600 ml
|
|
1 067
|
900 ml
|
1 400 ml
|
1 800 ml
|
2 200 ml
|
2 700 ml
|
3 100 ml
|
3 600 ml
|
|
1 219
|
1 200 ml
|
1 800 ml
|
2 300 ml
|
2 900 ml
|
3 500 ml
|
4 000 ml
|
4 700 ml
|
|
1 372
|
1 500 ml
|
2 200 ml
|
3 000 ml
|
3 700 ml
|
4 400 ml
|
5 200 ml
|
5 900 ml
|
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 106
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la ville de
N'Djamena
|
1
|
524
|
1
|
800 m!
|
2
|
700 m!
|
3
|
700 m!
|
4
|
600 m!
|
5
|
500 m!
|
6
|
400 m!
|
7
|
300 m!
|
|
1
|
676
|
2
|
200 m!
|
3
|
300 m!
|
4
|
400 m!
|
5
|
500 m!
|
6
|
600 m!
|
7
|
700 m!
|
8
|
800 m!
|
Note : Un puits de surface est généralement
constitué de tuyaux en béton superposés et dont le
diamètre est le plus souvent supérieur à 600 mm. Sa
profondeur excède rarement neuf mètres.
PUITS TUBULAIRE OU ARTÉSIEN
|
Diamètre du
puits
(mi!!imètres)
|
Profondeur d'eau dans le puits
(mètres)
|
|
15
|
30
|
45
|
60
|
|
Millilitres d'eau de Javel
|
|
50
|
30 m!
|
60 m!
|
90 m!
|
120 m!
|
|
65
|
50 m!
|
100 m!
|
150 m!
|
190 m!
|
|
76
|
60 m!
|
140 m!
|
200 m!
|
270 m!
|
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 107
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la ville de
N'Djamena
|
89
|
90 m!
|
190 m!
|
280 m!
|
400 m!
|
|
102
|
120 m!
|
250 m!
|
370 m!
|
500 m!
|
|
127
|
190 m!
|
380 m!
|
570 m!
|
800 m!
|
|
152
|
270 m!
|
540 m!
|
820 m!
|
1 100 m!
|
Note : Un puits tubulaire est foré lorsque la nappe
d'eau souterraine est profonde ou lorsque la surface est rocheuse. Il est
constitué d'un tuyau d'acier d'un diamètre inférieur
à 80 mm et d'une longueur de plus de six mètres.
Source : Laboratoire BSL 2018
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 108
| 


