Lieux de mémoires et
citoyen.ne.s numérique, un
dialogue impossible ?



PAUL GOURMAUD
-
Promotion 2023-2024
Master 2 Digital Design
en double diplôme avec
l'ENSAM
3
ABSTRACT
This dissertation is a grouping of my research carried out
during the first phase of my end-of-study project about places of memory and
how they participate in shaping collective memory. Regarding the multiplication
of contemporary conflicts and their media coverage, from the war in Ukraine to
the war between Israel and Hamas, memories are accumulating, and it is
legitimate to ask how we will remember those events and their victims in the
next future ?
Looking at the way we remember the past today, from the First
World War to the Algerian War commemorations, this can give us few ways to
predict how we will pratice remembrance in the future. Thereby, our
contemporary places of remembrance: monuments, museums, battlefields are at the
centre of the commemoration process. Among this list, I choose to focus on
monuments, places that can be summed up as a few metal plaques hidden in an
alley or large concrete esplanades in memory of thousands of soldiers. They
only live when they are looked at, surveyed or touched, which is also why I
have chosen to question the relationship between those places and the
contemporary citizens
4
PRÉAMBULE
Début d'année 2023, j'ai un peu de temps devant
moi et je me dis que ce sera l'occasion de chercher de l'inspiration pour mon
projet de fin d'étude. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment, me
vient en tête ce chapitre de cours d'histoire sur le « devoir de
mémoire », il y avait quelque chose que je trouvais assez
mystérieux et profond dans cette notion, mais je n'arrivai pas vraiment
à mettre le doigt dessus. Vendéen de naissance, je me rappelle
qu'un mémorial sur les guerres de Vendée se situe à
quelques kilomètres de chez moi. Étant plus petit, j'avais
déjà pu le visiter avec mes parents, probablement un peu trop
petit, car je n'en n'avais gardé aucun souvenir. Je décide donc
de m'y rendre, peut-être que des souvenirs me reviendront.
Une fois sur place, je me rends compte que le site est
séparé en deux parties : l'Historial, permettant d'arpenter
l'histoire de la Vendée, de la préhistoire au Moyen Âge
à nos jours. Et de l'autre côté, le mémorial, un
gros bloc de béton posé au-dessus de la rivière de la
Boulogne et faisant partie d'un parcours de marche un peu plus grand. Je
décide donc de commencer par l'Historial et de visiter le
mémorial juste après, le meilleur pour la fin. L'Historial
étant grand et dense en informations, même un après-
5
midi entier ne suffira pas pour lire tous les détails.
Je me dirige donc enfin vers la partie qui m'intéresse le plus : le
mémorial.
Je me retrouve alors debout devant deux grandes portes, le
grand bâtiment aux inspirations brutalistes semble fermé. Je
décide quand même de tenter ma chance en tirant un peu sur l'une
d'elles. La porte grince et s'ouvre lentement, me laissant assez de place pour
entrer à l'intérieur. Malgré la beauté sobre du
lieu, une voix provenant d'un haut-parleur me rappelle que je suis sur les
terres d'une tragédie : 564 villageois des Lucs-sur-Boulogne et des
communes alentours seront massacrés par les troupes républicaines
les 28 février et 1er mars 1794. Bon, le ton est donné, mais je
reste cependant figé dans un étrange mélange de tristesse
et de contemplation, une sensation particulière qui deviendra le point
de départ de mon projet sur les lieux de mémoires.
6
SOMMAIRE
2.1 - Big Data et maîtrise de l'archivage 27
2.2 - Mémoire numérique et rôle du citoyen
34
INTRODUCTION 8
I - LES COMPOSANTES DE LA MÉMOIRE
10
1 - Les enjeux de la mémoire 12
1.1 - Mémoire & Histoire 13
1.2 - Que sont les lieux de mémoires ? 17
2 - Les lieux de mémoires 2.0 26
RÉFÉRENCES 121
7
II - LES MUTATIONS DE LA MÉMOIRE 46
3 - Les lieux de mémoires : rien ne se perd tout se
transforme 48
3.1 - Les témoins dans l'histoire 49
3.2 - les fondations du monument aux morts 54
3.3 - Le monument aux morts contemporains 58
4 - Une réappropriation compliquée 68
4.1 - Les politiques mémorielles et leurs limites 69
4.2 - Le cas complexe de la Guerre d'Algérie 72
5 - Nouveau secteur, le tourisme de mémoire
76
5.1 - Le tourisme de mémoire pré & post
covid 77
5.2 - De l'expérience transmise à
l'expérience vécue 81
III - PENSER LA MÉMOIRE AUTREMENT
94
6 - Réveiller le monument 96
6.1 - Le monument, une relation tactile 97
6.2 - Rendre le monument vivant 100
7 - Le point de vue du designer 106
7.1 - Le designer, un acteur social 107
7.2 - Le designer, un acteur sensible 109
SYNTHESE 118
1 Murphy, M [@MariaRMGBNews]. (2023, 15 avril). Today I had
one of the most harrowing experiences of my life [Tweet]. X.
https://urlz.fr/pD12
8
INTRODUCTION
« Aujourd'hui, j'ai vécu une des
expériences les plus difficiles de ma vie. En revanche, il ne semble pas
que tout le monde l'ait trouvée aussi poignante. » (traduit de
l'anglais)1. Ce tweet posté le 15 avril 2023 par la
journaliste britannique Maria Murphy est également accompagné
d'une photo sur laquelle une touriste prend la pose en étant assise sur
les rails menant au camp d'Auschwitz en Pologne. Ces nouveaux comportements sur
les lieux de mémoires ne sont pas anodins, ils sont le signe d'une
mutation de la manière de commémorer. Il ne s'agit pourtant pas
que de changements à échelles individuelles. Les institutions
liées à la mémoire, que ce soit les musées, les
ministères, font de plus en plus appel au numérique afin de
continuer à intéresser un public qui souhaite découvrir le
passé autrement. Et ce en gardant des limites morales identifiables, en
tout cas pour la plupart, un point sur lequel nous reviendrons par la suite. Il
n'est donc désormais pas anodin de découvrir la mémoire
d'un lieu à l'aide de son téléphone ou avec un casque de
réalité virtuelle. Pourtant, un grand nombre de lieux de
mémoire plus discrets s'invisibilisent progressivement en se confondant
dans le paysage urbain. Cette statue commémorant les morts Lavallois de
la guerre franco-prussienne de 1870-
9
71 est posée entre le parking d'un Intermarché
et un carrefour passant. Ou encore cette plaque, en souvenir des civils nantais
morts pendant les bombardements de 1943, entourée de boutiques et d'une
borne de vélos en libre service. Et pourtant, il s'agit bien pour la
plupart de monuments érigés par et pour les citoyens. Partant de
ce constat, quelles relations peuvent exister entre les lieux de
mémoire et le citoyen à l'ère de
la transition numérique ?
Dans un premier temps, il s'agira donc d'expliquer comment
fonctionne la mémoire au sens historique du terme, et pourquoi elle est
nécessaire à l'échelle individuelle comme à
l'échelle collective. L'enjeu sera également de faire le lien
avec le citoyen d'aujourd'hui et son rôle dans la préservation de
cette mémoire, notamment sur le plan numérique, en questionnant
les limites de cet outil. Par la suite, nous verrons que les besoins et les
moyens de commémorer se transforment, ce qui ne favorise pas la
reconnaissance de ces lieux particuliers que sont les monuments aux morts,
pourtant symbole fort de la transmission de la mémoire. Nous
questionnerons dans le même temps les politiques mémorielles
menées depuis la fin du XXe siècle en France et comment elles
peuvent entraver une réappropriation citoyenne des lieux de
mémoire. Enfin, nous tenterons de voir comment des approches d'artistes
et de designers centrées sur le sensible et le social peuvent apporter
un regard nouveau sur la mémoire et la citoyenneté.
10
LES COMPOSANTES DE LA MÉMOIRE


11
« Nous portons toujours avec nous et en nous une
quantité de personnes qui ne se confondent pas. » (Halbwachs.
M, 1950)

12
Les enjeux de la mémoire

13
1.1 Mémoire & Histoire
« L'histoire et la mémoire ont en commun une
actualisation du passé, mais l'histoire cherche à comprendre le
passé pour en libérer le présent, alors que la
mémoire entretient le poids du passé sur le présent.
» 2 (Tudesq. A, 2007) Ainsi, même si chacune souhaite
éclairer le passé, elles n'ont pas les mêmes approches.
L'Histoire cherche à avoir une vision globale et tend vers une
quête de vérité, même si en réalité
cette discipline reste humaine et donc sélective dans son
éclairage du passé. Le travail des historiens est donc en partie
guidé par la mémoire, qui entretient un rapport affectif avec le
passé et sélectionne sciemment des événements
qu'elle juge importants au regard de ses propres valeurs morales. Et par
mémoire, je parle ici de mémoire collective, une notion sur
laquelle nous reviendrons plus tard, mais que l'on peut assimiler à une
famille, une association, un État... Le lien entre ces deux notions
s'est cependant renforcé et conscientisé à partir de la
fin du XXe siècle.
2 Tudesq, A. (2007). Histoire et mémoire : une relation
ambiguë et contradictoire Dans Presses universitaires de Bordeaux eBooks
(p. 97-106). consulté le 14 novembre 2023, à l'adresse https ://
doi.org/10.4000/books.
pub.26371
14
On pourrait situer l'émergence de cette «
révolution mémorielle » 3 (Noël P. M., 2011) à
partir des années 70, marquées notamment par les procès
d'Adolf Eichmann (1961) et un peu plus tard celui de Klaus Barbie (1987), tous
deux responsables de la mort de milliers de juifs sous l'Allemagne nazie. Ces
deux procès seront filmés, mais celui de Klaus Barbie, plus
récent, s'étant déroulé à Lyon en France,
semble davantage documenté. En effet, on retrouve facilement des
vidéos retraçant le déroulement du procès ainsi que
sa médiatisation. Ainsi, à l'extérieur du tribunal, il est
difficile de ne pas ressentir d'empathie pour les victimes qui
témoignent devant les micros. Une transition est alors en train de
s'opérer : la mémoire des années qui suivent la fin de la
Seconde Guerre mondiale célèbre les valeurs de la
résistance, sacrifice, courage, abnégation. Mais à la
suite des procès évoqués plus haut, la mémoire du
résistant laisse progressivement sa place à la mémoire de
la victime juive. Les modalités de discours mutent également dans
ce sens avec un « plus jamais ça » qui se transforme en «
devoir de mémoire ». Cette volonté se traduit par la
transmission d'une mémoire douloureuse par les victimes. À
l'école, aux commémorations, dans les musées, les
témoignages veulent assurer une passation de connaissances entre
générations : il ne faut pas oublier. Cette
3 Noël, P. (2011, 15 avril). Entre histoire de la
mémoire et mémoire de l'histoire : esquisse de la réponse
épistémo-logique des historiens au défi mémoriel en
France. Conserveries Mémorielles. Consulté le 14 novembre 2023,
à l'adresse
https://journals.openedition.org/cm/820
15
rhétorique est aussi reprise et accentuée par
les institutions, quitte parfois à faire peser le poids d'une
mémoire non vécue sur les épaules d'une
génération qui devrait ainsi assumer le rôle de nouvelle
victime. Comme en février 2008, où le président Nicolas
Sarkozy demandait à ce que chaque enfant de CM2 se voit attribuer la
mémoire d'un enfant français victime de la Shoah. Une
décision spontanée, qui fut vivement critiquée par la
suite. Ces multiples insistances n'auraient donc pas favorisé la
transmission de valeurs fortes contre l'antisémitisme, mais au contraire
plutôt amorcé une repentance contreproductive. «
Peut-être trop de mémoire a-t-il provoqué sélection
et oubli chez les récepteurs, au lieu de les prémunir contre
l'antisémitisme » 4 (Benbassa. E, 2005). Ainsi, en septembre 2022,
une étude de l'IFOP réalisée pour l'Union des
étudiants juifs de France démontre qu'environ 33 % des jeunes
Français âgés de 15 à 24 ans estiment que la
commémoration de la Shoah empêche l'expression de la
mémoire d'autres drames de l'histoire. 5
D'autre part, nous pouvons aussi questionner la place de
l'historien dans ce nouveau paysage mémoriel. Ce
4 Benbassa, E. (2004). Regain antisémite : faillite du
devoir de mémoire ? MéDium, 2(1), 3-15. consulté le 14
novembre 2023, à l'adresse
https://doi.
org/10.3917/mediu.002.0003
5 Dabi, F., & Legrand, F. (2022), Le regard des jeunes sur la
Shoah : connaissance, représentations et transmission, IFOP,
consulté le 14 novembre 2023, https ://
urlz.fr/os1t
16
dernier, en établissant les faits du passé et en
tentant de leur donner du sens, nous permet aussi de nous construire au
présent et de mieux appréhender l'avenir. Pourtant, comme nous
l'avons vu précédemment, le concept de « devoir de
mémoire » s'est développé et s'est substitué
à l'histoire pour penser l'avenir. Désormais, il s'agit moins
d'apprendre une suite d'événements diversifiés et
structurants pour comprendre le présent. Mais il s'agit plus de se
souvenir d'événements marquants émotionnellement en
espérant ne pas reproduire les mêmes erreurs dans le futur. Alors
pourquoi encore pratiquer l'Histoire aujourd'hui ? Face à cette question
identitaire, certains historiens ont préféré adopter une
approche épistémologique sur leur discipline, en questionnant
notamment l'histoire de la mémoire :
« L'objectivation de la mémoire permet, par
ailleurs, à l'historien d'affirmer sa fonction sociale, mise en cause
par le défi mémoriel. » 6 (Noël . P.M, 2011)
Ainsi, l'intérêt est de diversifier les pistes de
recherche afin d'offrir de nouvelles perspectives à la
compréhension du passé et de sortir du cône de vision
imposé par « le devoir de mémoire ». On pourrait citer
par exemple les recherches menées par la sociologue polonaise Barbara
Engelking sur les récits de rêves durant la période de
l'Holocauste
6 Noël, P. (2011, 15 avril). Entre histoire de la
mémoire et mémoire de l'histoire : esquisse de la réponse
épistémo-logique des historiens au défi mémoriel en
France. Conserveries Mémorielles. Consulté le 14 novembre 2023,
à l'adresse
https://journals.openedition.org/cm/820
17
7 (Engelking. B, 2018), permettant une approche
sensible qui vient compléter d'autres sources plus « froides
». Ou encore la pratique de « l'ego-histoire »
théorisée en 1987 par l'historien français Pierre Nora
dans la publication de son ouvrage Essais d'ego-histoire, que l'on pourrait
résumer à une collection d'autobiographies d'historiens.
Cependant, il s'agit plus finement d'un exercice délimité par un
cadre formelle empêchant l'expression du « je » en faveur du
récit d'un travail d'historien mis en parallèle d'un contexte
historique plus global. Parmi l'ensemble de ces nouvelles pratiques, les
travaux de Pierre Nora sur les « lieux de mémoires »
constitueront une avancée majeure, et c'est ce que nous nous attacherons
à mieux définir dans ce qui suit.
1.2 Que sont les lieux de mémoires ?
Pour commencer, cette notion de « Lieux de
mémoires » fait écho à des « Lieux »
matériels ou immatériels, comme le définit Pierre Nora
dans le premier tome de son travail sur les Lieux de mémoires : «
Ces lieux, il fallait les entendre à tous les sens du mot, du plus
matériel et concret, comme les monuments au morts et les Archives
nationales, au plus abstrait et intellectuellement
7 Engelking, B. (2018). Des rêves comme source pour
l'histoire de l'Holocauste ? Vingtième siècle. Revue d'histoire,
139, 94-109, consulté le 14 novembre 2023, à l'adresse
https://doi.org/10.3917/ving.139.0094
18
construit, comme la notion de lignage, de
génération, ou même de région et d'homme
mémoire » 8 (Nora. P, 1984). Ces derniers évoluent en
même temps que la mémoire collective et sont tributaire de
l'intérêt ou du désintérêt des citoyens qui
trouveront plus de sens dans un monument plutôt qu'un autre. Les raisons
peuvent être multiples : une mémoire trop lointaine, la forme du
lieu qui n'est plus assez évocatrice etc. Si l'on reste sur l'exemple
des monuments publics (monuments aux morts, statues, stèles), la simple
performance artistique ou technique dans l'élaboration du monument n'est
pas suffisante afin de marquer les esprits et transmettre la mémoire. Il
faut aussi que ceux-ci possèdent une forte dimension symbolique afin
qu'ils trouvent du sens aux yeux des citoyens. Au mieux il vivra donc au
présent ; au rythme des cérémonies, des discours, des
discussions, lui permettant ainsi de devenir un lieu d'échange entre le
passé et le présent.
Ainsi lors des commémorations du 11 novembre 2023
à Nantes, c'est le Monument aux morts de la guerre de 1914-1918,
près du Quai Ceineray qui est choisit. Malgré le nom qui lui est
attribué, ce n'est pas simplement un hommage aux morts de la
première guerre mondiale, car deux plaques supplémentaires sont
posés devant la façade. L'une à la mémoire des
morts nantais pendant la
8 Nora, P. (1984). Les Lieux de mémoire T. 1 : La
République (Vol. 1). Gallimard.
19
seconde guerre mondiale et l'autre pour ceux tombés au
cours des opérations en Afrique française du Nord (AFN) entre
1952 et 1962, notamment durant la guerre d'Algérie. Ce monument
possède ainsi une valeur symbolique forte en rassemblant plusieurs
mémoires importantes à un seul endroit. D'autant plus que sur ce
dernier sont gravés les noms des nantais morts pendant la
première guerre mondiale, renforçant encore davantage le lien
émotionnel avec le lieu. Par opposition, de l'autre côté de
l'esplanade se trouve le monument aux morts de la guerre de 1870, en
mémoire des ligériens tombés pendant la guerre
franco-allemande de 1870. Nous parlons ici d'événements
lointains, qui se retrouve aux côtés de mémoires plus
récentes déjà installées dans notre mémoire
collective contemporaine. Sur la forme, c'est un piédestal
composé de plusieurs statues, au sommet celle d'un homme terrassant un
aigle, et sur les côtés, 4 statues d'hommes représentant
chacune une catégorie de soldats. Ici, la grande différence avec
le monument du Quai Ceineray, est que celui-ci n'appose aucun noms, il
commémore des valeurs mais pas des Hommes. Les différences se
trouvent aussi sur le plan symbolique ; d'un côté ce monument
exprimant une volonté de revanche patriotique, avec la figure de l'aigle
dominé. Et de l'autre, le monument du Quai Ceineray, où la nation
se met en retrait au profit des soldats qui ce sont sacrifiés pour
elle.
20
1.3 Mémoire collective et rôle du
citoyen
Nous évoquions donc précédemment que les
lieux de mémoire sont représentatifs de l'état de la
mémoire collective à un moment donné, mais qu'est-ce que
la mémoire collective ? Et quelles sont ces relations avec les
mémoires individuelles ? Il est tout d'abord important de comprendre que
la construction de la mémoire collective est un processus en mouvement
constant. Il nous est impossible de tout retenir, impossible d'accumuler
l'ensemble des mémoires individuelles afin de persister dans le temps.
« Ne sont retenus que les événements perçus comme
structurants dans la construction de notre identité collective. » 9
(Denis Peschanski cité par L. Cailloce). Une sorte de filtrage
s'opère donc pour ne garder que les mémoires qui ont du sens et
qui permettent à un groupe d'avancer. Au fil du temps, il y a donc
également des mémoires qui s'ajoutent et d'autres qui sont
oubliées, certaines étant encore trop vives dans les esprits pour
être digérées. Elles sont alors invoquées plus tard
dans la mémoire collective.
Reprenons l'exemple de l'évolution rapide de la
mémoire après la Seconde Guerre mondiale : dans les années
40, c'est la figure du résistant qui s'impose : elle
9 Cailloce, L. (2014, 18 septembre). Comment se construit la
mémoire collective CNRS Le journal, consulté le 18 novembre 2023,
à l'adresse
https://
lejournal.cnrs.fr/articles/comment-se-construit-la-memoire-collective
21
permet l'identification à un héros avec les
valeurs qui en découlent comme le sens du sacrifice, le courage... Cela
permet de sortir de la guerre avec une figure réconfortante, en se
disant que l'on n'a finalement pas tout perdu. Mais cette figure
héroïque cédera progressivement sa place à celle de
la victime juive, la figure du « juste » à partir des
années 70. Cependant, déjà quelques années
après la fin de la guerre, des initiatives apparaissent afin de
dénoncer les événements de la Shoah. Citons par exemple le
film Nuit et brouillard réalisé par Alain Resnais en 1956, dont
les images sont restées imprimées dans ma tête depuis mon
premier visionnage en classe d'histoire au collège. À sa sortie,
le film sera malgré tout censuré à multiples reprises ; en
effet, il est encore trop tôt pour parler explicitement de la Shoah,
notamment car les pays impliqués comme la France ou l'Allemagne
n'assument pas encore ouvertement leurs responsabilités. C'est ainsi
à partir du procès d'Adolf Eichmann en 1961 que les choses se
débloquent, la condamnation de la Shoah devient officielle et il est
désormais possible d'en parler sans détour. Suivront donc
plusieurs nouveaux films, dont la série télévisée
Holocauste de Marvin Chomsky en 1978 et plus tard Shoah de Claude Lanzmann en
1985. C'est quand finalement la mémoire intègre la sphère
politique que les enjeux prennent une autre tournure. En 1995, Jacques Chirac
prononce ainsi son discours pour le 53e anniversaire de la rafle du Vel d'hiv,
dans lequel il reconnaît la responsabilité de la France dans la
déportation. Ainsi, aucune mémoire ne s'intègre dans
nos
22
esprits en une fois, comme le démontre la construction
de celle de la Shoah. Le temps est l'élément principal, d'autant
plus lorsqu'on parle d'événements traumatiques. Par la suite, si
la mémoire fait sens pour assez de personnes, les initiatives
proposées pour en parler s'enchaînent et ancrent un souvenir plus
ou moins durable de cette mémoire dans notre mémoire
collective.
Quant à la mémoire d'aujourd'hui, même si
elle garde bien sûr les traces de ce passé, elle a dû faire
de la place pour de nouveaux événements : les attentats du 11
septembre 2001, ceux du 15 novembre 2015, ou encore, dans un tout autre
registre, la pandémie de la COVID-19. On notera d'ailleurs le
parallèle effectué par le président Emmanuel Macron dans
son élocution du 16 mars 2020 annonçant le premier confinement :
« Nous sommes en guerre, toute l'action du gouvernement et du parlement
doit être tournée désormais vers le combat contre
l'épidémie. » 10. En utilisant une
rhétorique implicitement liée à notre mémoire de la
guerre, il ravive des valeurs ciblées de notre mémoire collective
afin de justifier des actions prises au présent. C'est également
l'une des raisons qui explique la mouvance de la mémoire collective,
elle est enrichie d'événements nouveaux, mais également
exploitée comme
10 Le Monde. (2023, 16 mars). « Nous sommes en guerre »
: le discours de Macron face au coronavirus (extraits) [Vidéo] YouTube,
consulté le 18 novembre 2023, à l'adresse
https://www.youtube.com/watch
?v=N5lcM0qA1XY
23
un outil aux services d'intentions politiques comme vue
précédemment. Mais elle est aussi considérée comme
un repère social, servant en partie à la construction identitaire
des individus.
Comme le démontre le sociologue français Maurice
Halbwachs, théoricien du concept de mémoire collective : «
Mais nos souvenirs demeurent collectifs, et ils nous sont rappelés par
les autres. Alors même qu'il s'agit d'événements auxquels
nous seuls avons été mêlés et d'objets que nous
seuls avons vus. C'est qu'en réalité nous ne sommes jamais seuls.
Il n'est pas nécessaire que d'autres hommes soient là, qui se
distinguent matériellement de nous : car nous portons toujours avec nous
et en nous une quantité de personnes qui ne se confondent pas. » 11
(Halbwachs. M, 1950). Cependant, ce sont bien deux entités qui
s'influencent mutuellement. La mémoire collective est bien nourrie par
les mémoires individuelles, qui se nourrissent en retour de la
mémoire collective. Étant donné l'influence de l'une sur
l'autre, on peut aussi se demander quel rôle, quelles
responsabilités tient le citoyen dans l'élaboration de la
mémoire collective ? Nous avons vu précédemment qu'il y a
besoin de temps et d'une succession d'actions significatives pour qu'un
événement
11 Halbwachs, M. (1950). La mémoire collective (2e
éd.) [Édition numérique]. Paris : Les Presses
universitaires de France, consulté le 18 novembre 2023, à
l'adresse https //
shorturl.at/gGVW6
12 Prost, A., & Nora, P. (1984). Les monuments aux morts.
Dans Les Lieux de mémoires, La République, La Nation (Vol. 1).
Gallimard.
24
puisse l'intégrer. Ces actions peuvent être
immatériels, comme avec un discours, ou bien plus concrètes dans
le cas de la construction de monuments aux morts par exemple. Partant de cet
exemple, l'historien français Antoine Prost a pu en déterminer
plusieurs catégories, dont l'une qu'il qualifie de « monuments
civiques », les définissant comme « dépouillé,
il n'arbore pas d'allégorie, si ce n'est la croix de guerre [...] ne
préjuge pas des opinions des citoyens : chacun se soumet au devoir
civique et reste libre de donner cours à sa tristesse ou à son
orgueil patriotique. » 12 (Nora & Prost, 1984). Il s'agirait ainsi de
monuments permettant une plus grande liberté de commémorer, qui
ne contraignent pas le citoyen dans la manière dont il veut se souvenir.
Ce sont aussi potentiellement des monuments qui peuvent mieux durer dans le
temps en s'offrant à quiconque voudra l'approcher, traversant les
générations et les époques pour transmettre des valeurs
avec un message apaisé. Même si nous pouvons reconnaître
qu'après le traumatisme de la Première Guerre mondiale, il fut
difficile de retenir ses émotions et d'exprimer un message qui puisse
devenir plus « universel ».
À Nantes, certains monuments contiennent des
caractéristiques décrites par cette catégorie. Prenons
l'exemple de l'un d'eux situé sur l'île, caché dans une
25
ruelle. C'est une stèle arborant les inscriptions
suivantes : « La mutualité de la Loire-inférieure à
ses enfants morts pour la France », une formule propre au monument civique
qui reste malgré tout assez courante. Se différenciant ainsi des
monuments dits « patriotiques » avec des formules du type : «
Morts pour la Patrie », « Gloire aux enfants de... », «
Gloire à nos héros »... Même si l'on pourrait nuancer
en relevant que le monument pris en exemple n'est pas totalement
dépouillé, il contient en plus du message gravé une
sculpture en bas-relief d'une femme tenant un faisceau de licteurs : « Les
faisceaux sont constitués par l'assemblage de branches longues et fines
liées autour d'une hache par des lanières. » Dans la Rome
antique, ces faisceaux étaient portés par des licteurs, officiers
au service des magistrats et dont ils exécutaient les sentences. »
13 Cet objet est souvent utilisé pour représenter la
République française, ainsi que les valeurs de paix et de
justice.
Et donc, qu'en est-il aujourd'hui de nos lieux de
mémoire contemporains ? Quelle matière créons-nous pour
les générations suivantes ? À quoi ressemblent les outils
de mémoire du citoyen 2.0 ?
13 Le faisceau de licteur. (2022, 15 décembre).
Élysée. Consulté le 6 février 2024, à
l'adresse https ://
www.elysee.fr/la-presidence/le-faisceau-de-licteur
26
Les lieux de mémoires 2.0

27
2.1 - Big Data et maîtrise de l'archivage
Chaque minute en 2022 : 500 heures de vidéos
étaient mises en ligne sur YouTube, plus de 100 000 heures ont
été passées en meeting sur Zoom, près de 6 millions
de recherches ont été faites sur Google d'après le 10e
rapport annuel « Data never sleeps » de l'entreprise DOMO
14 . Cette quantité démesurée d'informations
représente ce que nous appelons aujourd'hui le « big data » ou
en bon français « mégadonnées ». En 2014, la
Commission générale de terminologie et de néologie, en
plus de proposer cette traduction, nous donne également cette
définition : « Données structurées ou non dont le
très grand volume requiert des outils d'analyse adaptés. »
15 . Cela implique donc que l'on parle certes d'une grande quantité
d'informations, mais également de la manière dont elles sont
traitées et si des conclusions peuvent en être tirées.
Ceux qui s'intéressent au sujet s'attachent aussi
à le définir en 5 points, ou plutôt en 5 V : volume,
vitesse, variété, valeur et vérité. Permettant
ainsi de comprendre les enjeux contemporains qui se posent à propos de
la
14 Data Never Sleeps 10.0. (2022). DOMO. Consulté le 6
février 2024, à l'adresse https ://
www.domo.com/data-never-sleeps
15 Commission générale de terminologie et de
néologie Vocabulaire de l'informatique, mégadonnées (2014,
août 22). Journal officiel de la République française, 89.
Consulté le 10 février 2023, à l'adresse
https://urlz.fr/pEXs
28
gestion de ces données. Pour commencer, le volume est
ce qui a été évoqué plus haut, c'est la
quantité entropique d'informations auxquelles nous faisons face
aujourd'hui. Et l'on parle bien ici de données produites en continue et
non en séquences que l'on pourrait déterminer et contrôler.
« De surcroît, une très vaste majorité -
peut-être de 95 à 98 % - des données issues d'Internet sont
« bruyantes », c'est-à-dire non structurées et
dynamiques plutôt que statiques et convenablement rangées. »
16 (Babinet. G, 2015) À cela s'ajoute donc la vitesse de création
de ces données. Dans une logique de production continue, il nous est
impossible de traiter l'ensemble des données en temps réel. De
fait, il y a donc le risque qu'elles deviennent obsolètes de plus en
plus rapidement, à cause de l'évolution technique des outils
utilisés pour les décrypter. Et même s'il est
théoriquement possible de le faire, il y a aussi le risque qu'elles
basculent dans l'oubli, car elles n'ont pas été
référencées. C'est pourquoi il devient nécessaire
aujourd'hui d'utiliser ce qu'on appelle les métadonnées (traduit
de l'anglais). « Les métadonnées peuvent être des
informations sur un objet ou une ressource qui décrivent des
caractéristiques telles que le contenu, la qualité, le format,
l'emplacement et les informations de contact. Il peut décrire des
éléments physiques ainsi que des éléments
numériques (documents, fichiers audiovisuels, images, ensembles de
données) et
16 Babinet, G. (2015). Big Data, penser l'homme et le monde
autrement [Pombo.free]. Le Passeur éditeur. http ://
pombo.free.fr/babinet2015.pdf
29
peut prendre des formes allant du texte libre (tel que des
fichiers « Lisez-moi ») au contenu standardisé,
structuré et lisible par une machine » 17. Ce travail de
référencement est déjà assez fastidieux, mais est
complexifié par la variété des supports que nous
produisons. En effet, les données purement numériques comme le
SMS ou la recherche sur un navigateur sont enrichies par la numérisation
croissante de documents réels. Si l'on prend l'exemple du fond
d'archives de la ville de Nantes consultable en ligne, dans la catégorie
« archives numérisées », on remarque déjà
plusieurs typologies de documents que l'on pourrait regrouper d'après
leurs formes : Les photographies, les illustrations ainsi que les documents
écrits. Ainsi, chaque catégorie requiert des
métadonnées appropriées. Par exemple, pour les
illustrations, la base de donnée possède un groupe d'archives
nommé « carte et plans », dans lequel on retrouve des
métadonnées qui leur sont propres, comme par exemple le
critère de la technique utilisée (impression, aquarelle...). Mais
dans l'ensemble, seuls quelques critères diffèrent d'une archive
à une autre, principalement pour des questions de formes. Pour le reste,
le minimum reste d'intégrer l'auteur et le contexte de création,
qui sont d'ailleurs parfois directement intégrés dans le
document. Cependant, il est toujours préférable d'être
rigoureux
17 ARDC. (2022, 13 mai). Metadata. ARDC (Australian Research Data
Commons). Consulté le 7 février 2024, à l'adresse
https://ardc.edu.au/resource/
metadata/
30
dans la rédaction des métadonnées, car si
le document est amené à disparaître ou à être
illisible, dans ce cas-là, il ne restera plus rien de sa mémoire
: « Les objets de la culture numérique contiennent potentiellement
tout ce qu'il faut pour que la question de leur oubli (voulu ou redouté)
soit intégrée dès le départ à leur mise en
oeuvre, faisant de la thématique de l'oubli un élément
central de la production » 18 (Cotte. D, 2020) Il reste ainsi deux
dimensions que nous n'avons pas encore abordées : la valeur et la
vérité, apparues plus récemment dans la définition
du concept de Big Data. Elles sont liées et tentent de répondre
à la même question : pourquoi s'intéresser à cette
donnée plutôt qu'une autre ? C'est une question à laquelle
une réponse économique est souvent apportée en estimant
l'intérêt que peut apporter la connaissance de ces facteurs pour
une entreprise. Dans ce cas, si des réseaux de données sont
correctement analysés, cela peut permettre de prédire des
tendances et d'agir en conséquence. Si nous revenons sur le principe de
la préservation d'archives, ces facteurs sont tout aussi importants et
se vérifient en fonction de la qualité d'écriture des
métadonnées.
Nous avons donc une responsabilité sur la
pérennité de nos objets numériques, et cela perdure bien
au-delà de
18 Cotte, D. (2017). La culture numérique entre
l'appréhension de l'oubli et la fabrication de la mémoire -
K@iros. Kairos, 2(2). Consulté le 19 novembre 2023, à l'adresse,
https://revues-msh.uca.fr/kairos/index.php?id=213
31
l'étape de leur création. Cependant, cela ne
veut pas dire que nous devons tout mémoriser, comme nous l'avons vu
précédemment en parlant de la construction de la mémoire
collective. L'oubli est tout aussi important que la mémoire. Ainsi,
malgré le phénomène démesuré du big data, il
est possible pour chacun de faire valoir son droit à l'oubli comme le
stipule l'article 17 du RGPD (Règlement général sur la
protection des données) : « La personne concernée a le droit
d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs
délais, des données à caractère personnel la
concernant » 19. La question de la persistance des
données d'une personne après sa mort fait aussi partie des choses
prises en compte par certains acteurs du numérique. Facebook propose par
exemple de transformer le compte d'une personne décédée en
compte commémoratif, à la condition que la personne
décédée ait désigné un « contact
légataire » au préalable. Cette personne est ensuite la
seule responsable du compte et peut choisir de le garder ou de le supprimer.
Nous voyons avec cet exemple que nous devenons de plus en plus responsables de
la gestion de nos données en ligne, car même après notre
mort, il n'est pas dit que nos avatars virtuels disparaîtront avec nous
automatiquement. Cette rigueur, nous devons aussi l'adopter dans le cas
où nous souhaitons archiver des
19 CNIL. (2016, 23 mai). CHAPITRE III - Droits de la personne
concernée. Consulté le 7 février 2024, à l'adresse
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17
32
données et être sûr qu'elles puissent
être retrouvées dans leur intégrité même quand
nous ne serons plus là.
Pour cela, il existe plusieurs méthodes afin d'assurer
la pérennité des données que l'on souhaite transmettre.
Professeur en Sciences de l'information et de la communication, Dominique COTTE
propose 3 caractéristiques à prendre en compte dans la
constitution d'une mémoire numérique : la
répétabilité, la granularité et la
traçabilité 20 (Cotte. D, 2020). La
répétabilité consiste à s'assurer qu'une
donnée archivée sera toujours lisible, «
répétable » dans 10 ans. De ce fait, dès le stade de
création, il faut penser au format dans lequel l'archive sera lue afin
d'anticiper les problèmes que pourra poser sa lecture dans un futur plus
ou moins proche. Par exemple, le site Internet Archives met à
disposition un outil de recherche appelé « Wayback Machine »
21 permettant de consulter un réseau d'archives constitué de plus
de 800 milliards de pages web. Cet outil permet ainsi de remonter l'histoire
d'une page Web et de voir à quoi elle ressemblait, du moins jusqu'en
2001, l'archivage ayant réellement débuté à partir
de cette année. Dans le cas où une archive serait malgré
tout
20 Cotte, D. (2017). La culture numérique entre
l'appréhension de l'oubli et la fabrication de la mémoire -
K@iros. Kairos, 2(2). Consulté le 19 novembre 2023, à l'adresse,
https://revues-msh.uca.fr/kairos/index.php?id=213
21 Internet Archives. (2001). Wayback Machine. Consulté
le 8 février 2024, à l'adresse https://archive.org/
33
illisible, il est possible de la fragmenter afin de pouvoir la
recomposer ensuite, ce qu'on appelle aussi la granularité de
l'information. Dans le cas d'un album de musique par exemple, même si
l'un des morceaux est corrompu, il reste malgré tout la
possibilité que les autres fragments soient intacts. Également,
grâce aux développements de logiciels supportés par
l'intelligence artificielle, on pourrait facilement imaginer un outil
permettant de reconstituer des archives manquantes en se basant sur des
fragments appartenant au même contexte. C'est déjà ce que
proposent les mécanismes d'autocomplétion, certains proposant
justement de l'autocomplétion musicale 22. Cependant, comme
nous l'avons vu précédemment, afin de comprendre et de faire
comprendre une archive, il est nécessaire d'assurer que les
métadonnées à son égard soient bien
renseignées, autrement dit qu'elle soit traçable. D'autant plus
que la création de ces données se fait sur la base d'un recyclage
constant, à la manière du téléphone arabe, il peut
devenir difficile de retracer l'information depuis sa source originale. Si l'on
reste sur l'analogie musicale, la technique du sampling ou
d'échantillonnage consiste par exemple à récupérer
une source sonore et à l'intégrer dans une nouvelle composition.
Dépendamment de la manière dont l'échantillon est
intégré, cela peut même lui donner davantage de
visibilité. À titre d'exemple,
22 Freedman, D. (2017). TapCompose. TapCompose. Consulté
le 8 février 2024, à l'adresse https://www.tapcompose.com/
34
plusieurs artistes appartenant au mouvement de la «
french touch » ont fondé leur succès sur cette
méthode, dont les Daft Punk, Justice, Cassius, etc.
L'expansion actuelle de ces technologies numériques
démontre ainsi que nous devons rester vigilants et rigoureux dans notre
manière de construire nos archives contemporaines. Un travail de tri aux
échelles individuelles et collectives est nécessaire afin de
transmettre des archives intègres et intelligibles pour les
générations futures.
2.2 - Mémoire numérique et rôle du
citoyen
Dès 1642, lorsque Blaise PASCAL développe la
Pascaline, la première machine à calculer de l'histoire, il
imaginait déjà les limites de son invention quant à son
utilisation par l'Homme : « La machine d'arithmétique fait des
effets qui approchent plus de la pensée que tout ce que font les
animaux. Mais elle ne fait rien qui puisse faire dire qu'elle a de la
volonté comme les animaux. » 23. Pascal souligne ici que les
machines ne possèdent pas de volonté propre, contrairement aux
animaux. Les animaux sont capables de prendre des décisions, d'agir de
manière autonome et de répondre à leur environnement en
fonction
23 Clermont-Ferrand, G. (s. d.). Pensées de Blaise
Pascal. Consulté le 19 novembre 2023, à l'adresse
http://www.penseesdepascal.fr/XXVI/XXVI6-moderne.php
35
de leurs besoins et de leurs instincts. Ils ont une forme de
conscience et de volonté qui leur permet de s'adapter à
différentes situations de manière flexible, ce que les machines
ne peuvent pas faire. Cela démontre que nous ne pouvons pas
déléguer la responsabilité de la transmission de la
mémoire à une machine, car ce processus nous oblige à
sélectionner des mémoires qui ont du sens pour des êtres
sensibles comme nous, et dépendent donc de conditions morales que seul
nous sommes capables de définir. Nous pouvons bien sûr transmettre
un héritage physique, comme des vyniles, des magazines, des
dessins...
Mais force est de constater que le numérique est
aujourd'hui un outil indispensable à maîtriser pour quiconque
souhaite transmettre un héritage, comme nous l'avons vu
précédemment. L'archivage des données est en fait un des
nombreux enjeux auquel doit faire face le « citoyen numérique
» aujourd'hui, en plus de la protection de ses données en ligne
notamment. Plusieurs organismes (la CNIL, le CSA, le Défenseur des
droits et l'Hadopi) ont ainsi créés le « kit
pédagogique du citoyen numérique » 24, à
destination de formateurs et de parents qui souhaitent éduquer les plus
jeunes sur les enjeux du numérique. Le kit rassemble ainsi divers
ressources autour des thématiques
24 Arcom. (s. d.). Kit pédagogique du citoyen
numérique : retrouvez toutes les ressources. Arcom le Régulateur
de la Communication et Numérique. Consulté le 8 février
2024, à l'adresse
https://shorturl.at/sCHM9
36
suivantes : les droits sur internet, la protection de la vie
privée en ligne, le respect de la création ainsi que
l'utilisation raisonné et citoyenne des écrans. Il y a ainsi une
volonté de questionner le rôle du numérique et voir comment
son utilisation pourrait faciliter les initiatives citoyennes, surtout
lorsqu'on remarque un taux d'abstention plus élevés chez les plus
jeunes. En effet, en 2022 l'INSEE relève une abstention
systématique aux élections présidentielles et
législatives plus élevés chez les moins de 40 ans. Avec un
taux de 25 % chez les 25-29 ans contre 13 % pour les 4044 ans. Ont notent
malgré tout un manque d'intérêt global pour ces
élections avec seulement 1/3 des électeurs qui ont votés
à la fois aux présidentielles et aux législatives
25.
Alors, est-ce que les outils numériques pourrait
constituer une alternative satisfaisante ? En l'occurrence, les réseau
sociaux sont déjà largement utilisés afin d'organiser des
mouvements de contestations : « l'engagement sur les réseaux
sociaux même quand il est peu coûteux peut constituer le premier
geste qui va faire entrer dans un parcours d'engagement. » 26 (Aschieri
& Popelin, 2017).
25 Insee, & Bloch, K. (2022, 17 novembre). Élections
présidentielle et législatives de 2022 : seul un tiers des
électeurs a voté à tous les tours[Base de données].
INSEE. Consulté le 11 février 2024, à l'adresse
https://www.insee.fr/ fr/statistiques/6658145
26 Aschieri, G., & Popelin, A. (2017). Réseaux
sociaux numériques : comment renforcer l'engagement citoyen ? Journeaux
Officiels. Consulté le 9 février 2024, à l'adresse
https://urlz.fr/pEHW
37
A titre d'exemple, le mouvement des Gilets jaunes avait
réellement commencer sur le réseaux sociaux avant de prendre de
l'ampleur via les manifestations dans les rues.
En revanche, malgré les multiples opportunités
offertes pas ces outils, certaines limites se posent quant à
l'exploitation de nos données personnelles en ligne. Pour ce faire nous
devons nous intéresser au modèle économique imposé
par les entreprises majeures du numériques, résumé par
l'acronyme GAFAM (Google (Alphabet), Amazon, Facebook (Meta), Apple,
Microsoft). En effet, pour proposer leurs services, ces entreprises font
l'acquisition des données fournit par un utilisateur donné, et en
échange elles lui proposent des recommandions personnalisés. Les
risques qui se posent en premier lieu sont à propos de la protection de
la vie privée. Il suffit de regarder les outils utilisés par ces
entreprises pour comprendre que l'exploitation de nos données est au
centre de leur système économique. Parmi eux ont retrouvent les
algorithmes de pertinence, il permettent de déterminer les
résultats les plus pertinents d'après une requête
formulé par l'utilisateur. Au début, ces algorithmes proposaient
des résultats similaires pour une même requête, signifiant
que des utilisateurs différents pouvaient obtenir les mêmes
résultats. Mais à partir de 2007, ils se sont
perfectionnés et propose désormais des résultats en
fonction des intérêts propres de chaque utilisateur. A partir de
là, une « boucle de recommandations » s'enclenche, car
chaque
27 Constant, P. (2018). Modèles économiques des
GAFAM et vie privée. Dans Santé, numérique et droit-s (p.
307-318).
https://doi.org/10.4000/books.putc.4463
38
page visitée permettra de fournir des critères
de sélection supplémentaires pour la prochaine requête.
Avec l'arrivée des assistants personnels tel que Google assistant ce
processus est encore davantage facilité. « L'aide fournie par
l'assistant se paie alors par l'abdication subreptice de tout contrôle
sur les données personnelles » 27 (Constant. P, 2018). En d'autres
termes, pour bénéficier de leurs fonctionnalités, il faut
renoncer à une partie de sa vie privée sans forcément en
être pleinement conscient. Ici, le pouvoir ne revient donc pas à
celui qui créer la donnée mais à celui qui sait comment
l'organiser et la rediriger.
Ce système de profilage, en offrant des recommandations
adaptés au profil des individus, comporte le risque de
fragmenterlamémoire collective.Au lieu de créer un espace
partagé et transparent où chacun peut s'exprimer librement, il
créé plutôt des bulles filtrantes, où chaque
individu est enfermé dans ses propres intérêts. En somme,
plutôt que de favoriser l'expression et la diversité, l'essor du
web pourrait au contraire accentuer les divisions et les
incompréhensions :« les nouveaux médias sociaux tendent
à accroître la fragmentation de société
déjà fragmentées
39
et donc à faire disparaître l'espace public
» 28 (Ganascia. J, 2023). Et ce système est un frein à la
construction de la mémoire collective, car suivant la définition
reprise de Maurice Halbwachs précédemment, « Mais nos
souvenirs demeurent collectifs [...] nous portons toujours avec nous et en nous
une quantité de personnes qui ne se confondent pas » 29 (Halbwachs.
M, 1950). Cela démontre que nous ne pouvons pas espérer
construire une mémoire collective solide en évoluant dans un
environnement numérique ethnocentré. Afin de mieux
appréhender ces systèmes de surveillance, Steve Mann, un
professeur canadien imagine le concept de « sousveillance » dans les
années 90 afin d'opposer une résistance aux déploiement
des systèmes de surveillances, notamment les caméras dans les
espaces publics 30 (Mann, 2004). L'idée étant de
fabriquer des systèmes d'enregistrements vidéos afin de «
surveiller ceux qui nous surveille ». C'est une philosophie que l'on peut
également transposer aux technologies du web évoquées
précédemment. En revanche dans cet environnement, il est plus
difficile de quantifier d'où peut provenir la
28 Ganascia, J. (s. d.). Le futur de la mémoire
à l'heure du numérique et de ChatGPT [Rediffusion]. Dans WebTV.
Semaine de la mémoire, Lille, Haut de France, France.
https://urlz.fr/ox0S
29 Halbwachs, M. (1950). La mémoire collective (2e
éd.) [Édition numérique]. Paris : Les Presses
universitaires de France, consulté le 18 novembre 2023, à
l'adresse https //
shorturl.at/gGVW6
30 Mann, S. (2004). « Sousveillance » : inverse
surveillance in multimedia imaging. ACM Multimedia, 620-627.
https://doi.org/10.1145/1027527.1027673
40
surveillance, car dès lors que nous partageons nos
données publiquement, qui de nos amis ou du service d'hébergement
espionne vraiment nos données. De cette manière, de plus en plus
d'outils propose de se protéger contre la collecte de nos données
personnelles, à l'image d'extensions web comme Qwant VIPrivacy.
Développée par l'entreprise Qwant, qui est à l'origine un
moteur de recherche lancé en 2013, la même année que les
révélations du lanceur d'alerte Edward Snowden sur les outils de
surveillance de masse utilisés par les services de renseignement
américain. Qwant, par opposition souhaite à tout prix ne rien
savoir sur ses utilisateurs : « Qwant ne sait rien sur vous et ça
change tout ! ». L'entreprise possède également un blog sur
lequel sont publiés des articles divers sur les bonne pratiques à
avoir pour protéger ses données en ligne. Parmi eux ont trouve
aussi des articles explicitement « anti-google » : « Comment
vivre sans Google : les alternatives qui protègent ta vie privée
» 31, avec donc une sélection de navigateur, de services
de messagerie garantissant une meilleure protection de nos données.
Cette position affirmée ne favorise cependant pas la
compréhension réel du sujet, à titre d'exemple l'un des
derniers articles parût « Pourquoi c'est important de
protéger sa vie privée en
31 Team Qwant. (2023, 7 décembre). Comment vivre sans
Google : les alternatives qui protègent ta vie privée. Qwant.
Consulté le 7 février 2024, à l'adresse
https://urls.fr/fqFHxR
41
ligne ? » 32 ne se résume qu'à 4 points
apportant chacun une réponse courte à la question posée
par l'article. En guise de conclusion, l'article rappel que Qwant constitue une
réponse adéquate à la protection de nos données, en
proposant également des liens de téléchargement pour son
moteur de recherche. « Les dispositifs numériques que nous
utilisons de manière ordinaire, et qui permettent ainsi des formes de
braconnage du contrôle social, ne sont pas neutres. Si la sousveillance
permet de fournir un autre regard sur les formes de surveillance, de documenter
les structures étatiques ou privées les déployant,
d'alimenter le débat démocratique sur les questions de
renseignement et de vie privée, les médiations techniques qui
favorisent le développement de ces débats dans l'espace public
doivent être comprises de tous. » 33 (Aloing. C, 2016). Ici la
sousveillance qualifie également la volonté de renseigner sur les
structures de surveillance en plus de fournir des outils concrets pour agir
comme avec l'exemple de Qwant. En revanche, comme le souligne la citation, un
point de vue plus mesuré et pédagogue sur les technologies
numériques est préférable afin d'assurer leur bonne
compréhension. La CNIL (Commission Nationale de l'informatique et
32 Team Qwant. (2024, 23 janvier). Pourquoi c'est important de
protéger sa vie privée en ligne ? Qwant. Consulté le 7
février 2024, à l'adresse https://urls.fr/ Cpqew3
33 Aloing, C. (2016). La sousveillance. Vers un renseignement
ordinaire. Hermès, la revue, 76, 68-73. consulté le 16 novembre
2023, à l'adresse,
https://
www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2016-3-page-68.htm
34 Beaudouin, V. (2019). Comment s'élabore la
mémoire collective sur le web ? Réseaux, n° 214-215(2),
141-169.
https://doi.org/10.3917/res.214.0141
42
des Libertés), même si son déploiement
n'est pas moins politique, fournit par exemple des informations plus
détaillées sur l'exercice de nos droits et devoirs dans
l'environnement numérique.
Puisque cet environnement est relativement récent et
évolue très rapidement il est normal que sa compréhension
et sa maîtrise prenne du temps. Malgré les limites
évoqués précédemment, les initiatives fleurissent
afin de construire une mémoire collective via les outils du web. En
2019, une étude a été menée afin de comprendre
l'influence d'internet sur la construction et la transmission de la
mémoire collective, se basant sur les archives web collectés par
la bibliothèque nationale de France 34 (Beaudoin, 2019).
L'étude s'appuie ainsi sur des forums, des blogs et constitués
à partir de 2014 à propos de la première guerre mondiale,
ainsi que sur leurs auteurs. Ont constate que les forums permettent de
retrouver une forme d'espace public ou le lien social est aussi important que
l'acquisition de connaissances. En effet, les usagers de ces outils sont
volontaires et désireux d'apprendre sans contrainte extérieur, ce
qui fait la différence. Il est aussi noté qu'il y a une
volonté de leur part de faire preuve de rigueur dans la documentation
des différents sujets. De plus avec la numérisation croissante
des documents physiques, le
43
travail de ces historiens amateurs est appuyé par une
grande quantité d'archives. Il est ainsi possible pour eux de faire un
travail de relation, de comparaison entre des archives récentes et
anciennes. En reconstituant la vie des soldats de cette guerre via les archives
qu'ils ont laissés derrière eux, c'est une façon pour ces
usagers de lutter contre l'oubli de cette histoire et leur éviter une
seconde mort. Leur travail est en fait guidé par une volonté de
ne pas oublier le passé, de continuer à réalisé un
« devoir de mémoire » à leur échelles : «
Alors que tous les témoins ont disparu, ces mémoriaux
numériques constituent des lieux d'un genre nouveau qui tentent, en
s'appuyant sur des sources, de reconstituer au plus près ce qu'a pu
être l'expérience vécue. Il n'y a donc pas antinomie entre
mémoire et histoire : le travail historiographique, documenté,
sourcé étant mis au service de la mémoire. » 35
(Beaudoin, 2019)
35 Beaudouin, V. (2019). Comment s'élabore la
mémoire collective sur le web ? Réseaux, n° 214-215(2),
141-169.
https://doi.org/10.3917/res.214.0141
44
LES COMPOSANTES DE LA MÉMOIRE
Conclusion

45
Au long de cette première partie nous avons vu que les
rapports entre l'histoire et la mémoire ont évolués depuis
plusieurs années. Il y a désormais une volonté de se
réapproprié l'histoire et raconter des récits qui
construisent une mémoire qui à plus de sens pour les historiens,
les états, les associations ou les individus. Ces changements
s'expliquent aussi par une mutation des lieux de mémoires. Même si
les mémoriaux physiques tel que les stèles, les plaques, les
statues ne sont pas complètement désert, les multiples acteurs de
la mémoires cherchent de nouveaux milieux afin de construire la
mémoire collective. De fait, les évolutions permises par l'essor
du numérique ont permis le développement de nouveaux outils (les
forums, les réseaux sociaux) qui deviennent progressivement nos lieux de
mémoires contemporains. Ces outils particulièrement
récents comparés aux lieux de mémoires « physiques
» (stèles, statues), restent malgré tout un défi pour
le citoyen d'aujourd'hui qui doit encore apprendre à s'en servir afin de
préserver ses données personnelles et assurer une transmission
mémorielle intègre pour les prochaines générations.
Est-ce que cela signifie pour autant la disparition de nos lieux de
mémoires physiques ? Quelles est leur place dans notre mémoire
collective ? Ont-ils perdu de leur sens au yeux du citoyen ?
46
LES MUTATIONS DE LA MÉMOIRE


47
« visiter un champ de bataille ou un
camp
d'extermination mettrait les touristes en contact
avec leur propre
destructivité » (Binik. O, 2016)

48
Les lieux de mémoires : rien ne se perd tout se
transforme


49
3.1 - Les témoins dans l'histoire
Le temps passe et les événements dupassé
s'éloignent de nous inexorablement. Ceux qui les ont vécues de
l'intérieur, les témoins, disparaissent et disparaîtront
quoi que l'on fasse, laissant derrière eux des témoignages et
autres archives diverses (journaux intimes, lettres) dont la
responsabilité sera déléguée aux
générations qui les suivront. « L'ère du
témoin » est une formule utilisée pour la première
fois par l'historienne Annette Wieviorka à la fin des années 90
dans un ouvrage du même nom. Son travail s'appuie sur les vagues de
témoignages des victimes de la Shoah pendant les années 90 et au
début des années 2000. Analysant ainsi les différentes
phases de considération de ces traces particulières, de
l'ignorance à la reconnaissance, voire à l'instrumentalisation.
En effet, les tout premiers témoignages veulent laisser une trace pour
ne pas oublier, mais la position du survivant n'est pas encore mise en avant
socialement pour que ces documents sortent de l'ombre. Mais c'est à
partir de 1962, lors du procès d'Adolf Eichmann, que le statut social du
témoignage change, la figure du survivant devenant par la suite
inhérente à l'écriture de l'histoire de la Shoah.
Même si cela a permis aux survivants une meilleure reconnaissance
sociale, l'instrumentalisation politique de leur parole n'a pas pour autant
favorisé une pratique objective de l'Histoire, de par les attributs
affectifs des témoignages qui ne sont pas pertinents pour sa
pratique.
50
C'est donc dans les années qui suivront que
débutera « l'ère du témoin »,
caractérisée par une collecte massive de témoignages afin
de garder une trace de ce passé 36 (Chevalier, 2000).
À titre d'exemple, L'INA possède une rubrique intitulée
Grands entretiens compilant des séries d'interviews diverses, dans
laquelle on retrouve une séquence sur la mémoire de la Shoah
37. Sont ainsi compilés 105 témoignages de victimes de
la Shoah (anciens déportés, enfants de déportés,
résistants...) durant chacun plus d'une heure. Ils n'ont pas
été montés, mais possèdent cependant un chapitrage
détaillé, facilitant leur visionnage. De plus, ces interviews
sont aussi accompagnées d'interventions « d'acteurs de la
mémoire » (historiens, magistrats, diplomates) afin de replacer le
témoignage des victimes dans leur contexte. Ces vidéos sont
désormais accessibles en permanence et nous rappellent à quel
point il est aujourd'hui facile d'immortaliser des moments du passé, et
en l'occurrence des témoignages.
Si l'on se réfère ainsi aux conflits
contemporains fréquemment actualisés par l'actualité
internationale, nous
36 Chevalier, Y. (2000). Wieviorka (Annette), L'Ère du
témoin. Archives des Sciences Sociales des Religions, 110, 110.
Consulté le 19 novembre 2023, à l'adresse
https://doi.org/10.4000/assr.20611
37 INA. (s. d.). Collection Mémoires de la Shoah - Grands
entretiens patrimoniaux. Consulté le 19 novembre 2023, à
l'adresse https://entretiens.ina.fr/ memoires-de-la-shoah
51
constatons que la mémoire des victimes se construit
alors même que les conflits ne sont pas officiellement terminés.
Il y a une forme d'accélération dans la production de contenu.
Ainsi, au moment où ces lignes sont écrites, la guerre entre
Israël et le Hamas n'est toujours pas terminée, et malgré
tout, la construction des mémoires s'est déjà
amorcée. Une cérémonie d'hommage nationale a ainsi
été organisée à Paris le 4 février 2024 en
l'honneur des victimes françaises des attaques terroristes
perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023 38.
L'événement à partir duquel Israël rentrera en guerre
contre l'organisation terroriste. La forte présence des médias
d'informations dans le conflit entraîne également la propagation
d'un flux important de données. Parmi ce flux, on retrouve ainsi les
témoignages de survivants accessible très facilement en ligne
39.
À l'image des mémoires et des témoignages
des victimes de la Shoah, ces vidéos ne peuvent attester de l'Histoire
exacte du conflit et sont donc à prendre avec de la distance, du moins
si l'on adopte le regard de l'historien. Car de nouveau, même s'il est
plus facile aujourd'hui d'avoir des informations « brutes » sur les
caractéristiques d'un
38 Élysée. (2024, 7 février).
Cérémonie d'hommage national aux victimes françaises des
attaques terroristes du 7 octobre en Israël. Élysée.
Consulté le 12 février 2024, à l'adresse
https://urls.fr/UNpM5q
39 Le Monde. (2023, 30 décembre). Mia Schem et Chen
Almog-Goldstein, ex-otages israéliennes racontent leur captivité
à Gaza [Vidéo]. YouTube. Consulté le 12 février
2024, à l'adresse
https://www.youtube.com/watch?v=NlPUzbO65oQ
52
témoignage : Nom de l'auteur. Ice de l'interview, date
de celle-ci, nom du média chargé de l'interview... La
véracité des propos et des intentions de la victime sont
nuancées en fonction de la situation micro (conditions de l'entretien
par exemple) et macro (contexte de l'événement).
Cette production intensive et continued'informations
entraîne une forme d'accélération dans la construction des
mémoires collectives, d'autant que c'est un processus qui s'appuie sur
des événements qui ne sont pas encore terminés. Cependant,
les constats qui ont été faits sur la gestion des
témoignages des victimes de la Shoah peuvent nous éclairer sur la
manière dont il est possible d'appréhender nos témoignages
contemporains. « Dès lors qu'il s'agit moins de faire preuve que de
chercher du sens, le triptyque trace, document, question [...] laisse la porte
ouverte aux renouvellements, sans doute infinis, des écritures de
l'histoire, puisque les interrogations posées au passé se
multiplient au rythme du présent. » 40 (Zalc, 2018). Autrement dit,
dans le cadre du travail d'histoire mené sur la Shoah, les travaux
d'investigations se voulaient être un rempart contre le
négationnisme et l'effacement des traces par les nazis. Ces positions
militantes commencent donc à s'apaiser aujourd'hui et laissent
progressivement
40 Zalc, C. (2018). Passages de témoins. Vingtième
Siècle. Revue d'histoire, 139, 2-21. consulté le 15 juin 2023,
à l'adresse
https://doi.org/10.3917/
ving.139.0002
53
leur place à un travail qui s'effectue pour le sens et
non pour les preuves. Dans le cas de la mémoire de la Shoah, la
disparition progressive des témoins incite donc à renouveler les
modalités d'écriture de l'Histoire. Nous en revenons à des
exemples cités précédemment, à l'image du travail
de Barbara Engelking sur les récits de rêves pendant l'Holocauste,
et dans quelle mesure ces traces pourraient être pertinentes dans
l'écriture de cette histoire. Concernant la manière dont sont
écrites celles de nos événements contemporains, telle la
guerre sur la bande de Gaza évoquée précédemment,
ou bien des événements passés, tels les attentats du 11
septembre 2001. Il est légitime de se demander si l'écriture de
l'histoire de ces événements n'est pas plus portée par une
volonté de faire justice que par une quête de sens ? Et si cela
est problématique pour les acteurs contemporains liés à
ces événements (historiens, victimes) ?
Ainsi, le témoin est une figure emblématique et
malgré tout nécessaire dans la transmission du passé,
d'autant qu'en chacun d'eux réside une volonté de parler de ce
qu'ils ont vécu. Cependant, même si leur témoignage
provoque facilement l'empathie, il ne permet pas toujours d'effectuer un
travail d'histoire de par la dimension affective non nécessaire à
cette tâche et la difficulté potentielle à cerner les
conditions de création d'un tel témoignage. Ce faisant, lorsque
le témoin disparaît, c'est une connexion importante avec le
passé qui est perdue. Même si cela peut
Ainsi, moins de monuments seront construits et
54
permettre de renouveler le récit historique, les
témoins laissent derrière eux des traces également
nécessaires dans la compréhension du passé, mais qui
peuvent devenir étrangères dans un contexte contemporain. Nous
pouvons parler ici d'écrits, d'images, ou bien de monuments aux
morts.
3.2 - les fondations du monument aux morts
Il nous arrive parfois de passer à côté de
cet édifice, une sculpture verticale de béton, tantôt avec
une statue, tantôt sans. Une inscription est gravée en majuscule
« En mémoire de ces soldats morts pour la France », suivie
d'une liste de noms nous rappelant que près de 1,5 million de soldats et
de civils français périront lors du premier conflit mondial de
1914 à 1918. L'érection des monuments aux morts connaît un
réel développement dans les années qui suivront la fin de
cette guerre. En revanche, ces initiatives ne se limitent pas seulement
à cette période : déjà à partir de la guerre
franco-allemande de 1870-71, des monuments aux morts sont construits.
Seulement, contrairement aux monuments de 1914-18, ceux-ci résultent
majoritairement d'initiatives privées et s'établissent dans un
esprit de revanche vis-à-vis de la perte de deux départements
français, ceux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, plus communément
connus comme l'Alsace-Lorraine.
55
avec une symbolique plus patriotique comparativement à
ceux de la Première Guerre mondiale 41 (Prost & Nora,
1984). À ce titre, le 25 octobre 1919, face à l'ampleur des
pertes humaines, l'État met en place une loi consacrée «
à la commémoration et à la glorification des morts pour la
France au cours de la Grande Guerre ». Cette loi promet entre autres aux
communes d'offrir une subvention à utiliser pour la glorification de
leurs héros locaux, notamment via l'édification de monuments aux
morts.
Cependant, cette décision est à nuancer au
regard de ses résultats réels. Dans un premier temps, certaines
des propositions formulées dans le texte de loi n'ont tout simplement
pas été mises en place, comme par exemple le dépôt
des noms de soldats morts pour la France au Panthéon ou encore la
construction d'un monument en leur honneur à Paris (même si la
dépouille d'un soldat français inconnu sera déposée
sous l'Arc de Triomphe en 1920). D'autre part, les subventions pour les
communes n'ont été fixées qu'en juillet 1920 et n'ont
couvert qu'entre 5 % et 26 % du coût du monument érigé ;
cette aide sera finalement arrêtée en 1925. 42 (Julien,
2016). Enfin, la date du 11 novembre
41 Prost, A., & Nora, P. (1984). Les monuments aux morts.
Dans Les Lieux de mémoires, La République, La Nation (Vol. 1).
Gallimard.
42 Julien, E. (2016, 29 septembre). La loi du 25 octobre 1919 et
sa postérité. Le Souvenir Français. Consulté le 13
février 2024, à l'adresse
https://le-souvenir-francais.fr/la-loi-du-25-octobre-1919-et-sa-posterite/
56
que l'on connaît aujourd'hui afin de commémorer
« tous les morts de la France » n'était à l'origine pas
celle choisie. La loi du 25 octobre avait en effet préféré
les dates du 1er et du 2 novembre à celle du 11, respectivement le jour
de la Toussaint et de la fête des morts, afin de privilégier des
commémorations endeuillées plutôt que victorieuses. Mais
à plusieurs reprises, les associations d'anciens combattants se sont
levées contre cette décision, préférant la date du
11 novembre. Elles continueront ainsi à réaliser leurs propres
cérémonies en 1919 et en 1920, avant que le gouvernement ne
décide finalement d'officialiser cette date en rendant le 11 novembre
férié le 8 novembre 1920. Par la suite, l'addition de nouveaux
conflits dans la mémoire collective entraîne, le 28 février
2012, le vote de la loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous
les morts de la France. Ce texte, en plus des soldats, rend donc hommage aux
civils ainsi qu'à ceux ayant péri lors d'opérations
extérieures.
Ainsi, la date du 11 novembre tire ses racines d'initiatives
que l'on pourrait qualifier de « citoyennes », car elle émane
directement du peuple qui affirme trouver davantage de sens en cette date.
Même si nous pourrions nuancer en disant que les associations d'anciens
combattants ne sont pas exactement représentatives de l'ensemble de la
population française en cette période ; leur volonté
semble malgré tout en accord avec la situation démographique du
pays après la guerre. En effet, la France fut le pays le plus durement
touché au regard de
57
ses pertes militaires. 70 % des soldats mobilisés ont
été tués ou blessés, avec parmi eux 15 000 gueules
cassées 43. Malgré tout, l'épreuve du temps
fait que les cérémonies du 11 novembre perdent progressivement de
leur sens aux yeux des citoyens d'aujourd'hui. Ce qui vaut aussi pour les
monuments aux morts qui vivent surtout au travers de ces mêmes
cérémonies. « Aux héritiers d'aujourd'hui, il
continue d'adresser un langage plus ou moins clair, plus ou moins audible. Le
signifié a pu changer ou perdre de sa vigueur, le signifiant demeure
pour sa part gravé dans le marbre et le bronze. » 44 (David, 2013).
Pourtant, ces édifices sont des portails temporels vers le passé,
dans la mesure où chaque détail de leur conception a dû
être pris en compte à un moment donné, de leur
justification architecturale à la symbolique de leur emplacement. En
effet, pourquoi avoir choisi de l'avoir placé dans un cimetière
plutôt que directement dans l'espace public ? Le monument se veut-il
être plus proche des vivants, ou au contraire appartenir aux morts ?
Également, son emplacement peut être choisi en
fonction de la topographie du lieu, et de cette manière, le
43 WeDoData. (2014). Guerre 14-18 : une population
transformée [Base de données ; Infographie en ligne]. Dans 14-18,
un monde en guerre.
https:// shorturl.at/dhrV1
44 David, F. (2013). Comprendre le monument aux morts
[OpenEditionBooks]. Codex. consulté le 10 septembre 2023, à
l'adresse
https://doi.org/10.4000/books.
codex.967
58
parcours pour y arriver devient une forme de narration. Dans
le cas du mémorial de la Vendée à Lucs-sur-Boulogne
(datant de la révolution, mais constituant un exemple pertinent dans ce
cas-là), le mémorial ayant été construit en 1993
marque le début du parcours afin de monter jusqu'à la chapelle
commémorative du Petit-Luc dans laquelle on retrouve des plaques
commémoratives avec les noms des 564 résidents du village
tués pendant la Révolution. La chapelle étant
placée sur un terrain surélevé, il faut gravir la colline,
faire un effort pour monter jusqu'à celle-ci, et enfin profiter d'un
espace de quiétude en l'honneur de ces victimes. Mais ce sont autant
d'informations qui se perdent avec le temps et qu'il est nécessaire de
rendre accessibles à celui ou celle qui veut faire parler le monument
aux morts. D'autant plus lorsque l'on s'intéresse à la symbolique
d'un emplacement. Car dans l'exemple d'un monument aux morts établi en
milieu urbain, depuis son érection, l'agencement des bâtiments a
évolué autour de lui, le rendant de plus en plus anachronique par
rapport au contexte contemporain.
3.3 - Le monument aux morts contemporains
Ainsi, comment le Monument aux morts est-il perçu
aujourd'hui dans l'espace public ? Plus particulièrement dans l'espace
urbain ? Ces questions et les recherches de terrain que j'ai menées par
la suite ont sûrement été inspirées par les travaux
de Laurent Aucher à propos des
59
pratiques nouvelles des visiteurs sur le mémorial de la
Shoah à Berlin 45 (Aucher. L, 2018). Bien que l'on parle ici
d'un « mémorial » et non d'un « monument aux morts
», car plus récent et avec une gestion de l'espace
différente des monuments de la Première Guerre mondiale. Ainsi,
j'ai également souhaité mener mes propres observations sur les
lieux de mémoire de ma région afin de comprendre comment ils
s'intègrent et comment ils sont perçus dans l'espace urbain
aujourd'hui. Réalisés en juillet et septembre 2023, la
météo était estivale et les promeneurs nombreux dans les
rues. Ce fut l'un de mes premiers constats, sûrement dû aux
températures clémentes : certaines personnes profitaient ainsi
des abords de certains monuments pour se détendre, s'allonger et dormir
un peu, ou s'asseoir pour bouquiner. Ainsi, les qualités des
interactions avec le monument dépendent de la manière dont il est
agencé. Par exemple, le monument aux 50 otages à Nantes est
constitué d'une structure verticale centrale avec autour des marches qui
descendent progressivement vers le sol. Le monument est construit juste
à côté de l'Erdre et offre également une vue directe
sur la rivière avec un promontoire permettant de s'asseoir et de
profiter de la vue. Ce monument, certes commémorant une mémoire
lourde, peut aussi se transformer en espace de détente, à la
45 Aucher.L, (2018).«Devant le mémorial,
derrière le paradoxe», Géographie et cultures, 105, 11-30.
consulté le 26 juin 2023, à l'adresse,
https://journals.
openedition.org/gc/6351
60
manière d'un square de taille réduite
46 Ce sont des constats qui peuvent être faits sur d'autres
lieux de mémoires, étant donné que ces derniers
s'intègrent dans un espace public qui évolue avec leur temps. Ils
se fondent peu à peu dans le décor et sont utilisés au
regard de leurs fonctions pratiques. Ils peuvent aussi devenir des espaces
propices au jeu, même si ces comportements restaient minoritaires et
limités à des enfants. Globalement, lorsque ces édifices
sont finalement remarqués, c'est grâce au hasard ou à une
balade qui prévoyait un détour par ce lieu. « Il n'y avait
pas une valeur historique que je voulais connaître, c'était dans
mon parcours nantais de la journée » 47. Encore que
l'extrait présenté ici est tiré d'un échange au
mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes, un lieu de
mémoire bien plus autonome que les autres, dans la mesure où ce
dernier offre des explications audios ainsi que des infographies pour le
replacer dans son contexte. C'est une forme de mini-musée accessible
gratuitement et qui affiche explicitement sa volonté d'apprendre une
histoire à un public plus ou moins averti, « provoquant le hasard
» pour qu'il soit approché. Ce sont également des lieux qui
sont parcourus autrement, soumis aux normes de l'espace public, comme avec ces
vélos accrochés aux rambardes d'entrée du
mémorial,
46 D'après des observations et des photographies faites
sur le monument des 50 otages à Nantes l'après midi du
08/07/2023
47 D'après une série de 6 interviews menés
au mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes l'après
midi du 21/06/2023
61

Photos sur le monument aux 50 otages à
Nantes, Paul
Gourmaud (c)
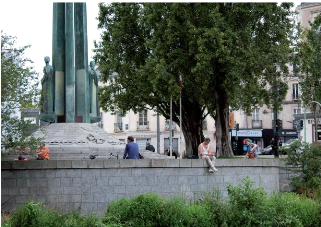
62
ou bien alors, des cyclistes faisant un petit détour
par l'esplanade de celui-ci, appréciant ainsi la vue sur la Loire. En
effet, ces lieux de mémoire sont à l'image des rochers dans un
cours d'eau : ils sont bien là, visibles, mais sont posés au
milieu des flux de l'espace urbain qui obéissent à leurs propres
règles. D'autre part, si un lieu de mémoire est finalement
remarqué, c'est l'occasion pour certaines personnes d'immortaliser ce
moment. Comme à Paris lors de mes observations sur un mémorial
bien plus récent, commémorant les morts de la Première
Guerre mondiale et situé sur l'un des murs extérieurs du
cimetière du Père-Lachaise. Installé en 2018 à
l'initiative d'Anne Hidalgo, ce sont au total 94 000 noms de Parisiens morts
pendant le conflit qui sont gravés sur des plaques métalliques.
Le tout, mesurant une longueur totale de 270 mètres, le monument
souhaite ainsi représenter l'échelle du conflit et l'ampleur du
sacrifice humain. À plusieurs reprises donc, des couples de
sexagénaires parcouraient les noms (également classés par
ordre alphabétique), n'hésitant pas à faire glisser un
doigt sur les plaques. Lorsqu'ils semblaient avoir trouvé un nom
familier, ils l'immortalisaient avec une photo ou un selfie 48.
Cette volonté de garder une trace se retrouve aussi au moment des
commémorations, comme à Nantes lors de la cérémonie
du 11 novembre 2023 organisée sur
48 D'après des observations et des photographies faites
sur le monument en mémoire des parisien morts pendant la première
guerre mondiale à Paris le matin du 29/09/2023
63
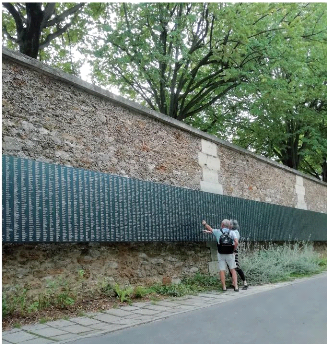
Photo sur le mémorial attenant au cimetière du
Père-Lachaise à Paris, Paul Gourmaud (c)
64
le monument en mémoire des Nantais morts pendant la
Première Guerre mondiale. Déjà pendant la
cérémonie, des photographes se frayent un passage dans la foule
pour immortaliser l'événement : les discours, les musiciens et
les personnalités présentes. À la fin du dernier discours,
la foule se disperse enfin autour du monument, l'atmosphère se
détend, des discussions émergent, et de nouveau, c'est le temps
des photos. Un groupe de jeunes appartenant à la
délégation de la frégate de défense Chevalier Paul
prend ainsi la pose pour une photo de groupe, avec en toile de fond le
monument, silencieux 49.
Face à la disparition des témoins, c'est un
moyen de continuer à assurer une discussion sur ces mémoires, car
ce sont autant de photos qui peuvent être partagées avec quelqu'un
qui n'aurait pas été présent et réemployées
dans le futur afin de se souvenir qu'en ce jour, une foule s'était
réunie pour se souvenir des morts de la première guerre mondiale.
C'est également, comme nous l'avons vu précédemment, une
forme de réappropriation de la mémoire par une écriture de
l'Histoire qui s'individualise. Nous pouvons également noter des
modifications formelles sur les monuments construits en mémoire des
conflits suivant ceux de 14-18. Ils ne se nomment d'ailleurs plus couramment
« monuments aux morts », mais plutôt «
49 D'après des observations et des photographies faites
durant la cérémonies du 11 novembre 2023 à Nantes.
65

Photos d'observations à la cérémonie du
11
novemvre 2023, Paul Gourmaud (c)

66
mémoriaux », un terme qui s'élargit
même aux musées documentant ces conflits. Ces mémoriaux,
contrairement à ceux de la Première Guerre mondiale,
célèbrent moins des individus que des groupes, avec des monuments
en l'honneur des résistants ou des juifs dans le cadre de la Seconde
Guerre mondiale.
Ce sont aussi des monuments qui utilisent un mode de
représentation nouveau, avec des structures plus complexes, moins
brutes, plus expressives afin de permettre aux visiteurs de se projeter vers
les événements passés 50 (Trouche, 2015). Une
section du cimetière du Père-Lachaise est ainsi
dédiée aux mémoires des victimes de la Shoah. De la tombe,
on passe à la sculpture. Et souvent, on se retrouve face à des
représentations de corps humains squelettiques, témoignant de la
souffrance endurée par les victimes. De cette manière, les choix
symboliques et esthétiques des monuments de la Première Guerre
mondiale sont dépassés par ceux qui sont faits pour nos monuments
plus récents. Sans pour autant parler de concurrence, sachant qu'il
arrive que les conflits contemporains comme la seconde guerre mondiale ou les
OPEX (opérations militaires extérieures de la France) soient
ajoutés à des monuments de la première guerre mondiale.
Ainsi, il
50 Trouche, D. (2015, 7 janvier). Du monument aux morts au
mémorial. Hypothèses. Consulté le 14 février 2024,
à l'adresse
https://sms.hypotheses.
org/4652
67
convient de se souvenir des monuments aux morts en gardant en
tête les codes qui les font revivre, et dans le même temps, il faut
construire des mémoriaux qui auront du sens pour les
générations futures afin de leur faciliter ce travail de
compréhension. En somme, il y a un double travail à faire, en
maintenant une continuité entre ce qui a été et ce qui est
à venir. Certains acteurs ont ainsi compris que mener des actions
mémorielles afin de maintenir cette continuité pouvait devenir un
levier puissant pour fédérer des personnes à leurs
causes...
68
Une réappropriation compliquée


69
4.1 - Les politiques mémorielles et leurs
limites
De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque les politiques
mémorielles ? Ce sont en fait des actions menées par
l'État afin de proposer une écriture du récit national qui
fait sens pour ses concitoyens. Ainsi, même si ces actions peuvent
paraître récentes aujourd'hui à cause de leurs
fréquences, c'est bien parce que les années 90 ont marqué
un tournant dans la manière de les réaliser. En effet, à
partir de la fin du XVIIIe siècle, l'État s'est engagé
dans la construction d'un récit national glorifiant des
événements emblématiques tels que le 14 juillet 1789 ou le
11 novembre 1918, ainsi que des figures héroïques (hommes
politiques, résistants, artistes) qui ont contribué à la
grandeur ou à la défense de la France. Ce récit, visant
à unifier une population composite en partageant les mêmes
références à un passé glorieux, a été
promu notamment à travers l'éducation. Cette politique
mémorielle a perduré jusque dans les années 1980,
orientant la perception collective de l'histoire nationale et la valorisation
des acteurs et événements qui la composent 51 (Ledoux,
2023). Mais, depuis les années 90, ces politiques mémorielles ne
sont plus orchestrées pour glorifier des événements et des
acteurs du passé.
51 Ledoux, S. (2023, 12 mai). Les politiques mémorielles
en France depuis les années 1990 Vie publique Consulté le 12
novembre 2023, à l'adresse https ://
urlz.fr/pyHJ
70
Désormais, les victimes des conflits et les atteintes
aux droits de l'homme ont supplanté la valorisation de la
souveraineté de la nation. Ces nouvelles politiques mémorielles
impliquent également une obligation morale de l'État à ne
pas oublier les mémoires des victimes de ses conflits, ce « devoir
de mémoire » ayant aussi pour objectif de prévenir le retour
de ces événements à l'avenir. Ces décisions passent
notamment par l'application des lois mémorielles, cette
dénomination ne signifiant pas que ces lois bénéficient
d'un statut particulier. Elles permettent d'appliquer un point de vue officiel
à des évènements historiques. La première de ces
lois fut ainsi adoptée le 13 juillet 1990, c'est la loi Gayssot
réprimant tous les actes racistes, antisémites ou
xénophobes. Elle considère également les actes
négationnistes comme des délits. Ces actions mémorielles
passent aussi par des discours, des actions directes du chef d'État qui
se place en narrateur de l'histoire et promet, avec ses actions, «
d'être celui qui soigne les maux de la société ».
En effet, la mémoire est désormais devenue un
levier parmi d'autres afin de gagner une partie de l'opinion publique. Ainsi,
donc parmi les conseillers du président, on peut retrouver un «
conseiller mémoire » chargé de veiller à
l'organisation des grands anniversaires, tels que l'armistice du 11 novembre ou
la fête nationale du 14 juillet. Cependant, cette nouvelle direction est
critiquée, notamment par des juristes qui considèrent que
certaines
71

L'historien Benjamin Stora et Emmanuel
Macron, lors de la
remise du rapport sur la
colonisation et la guerre d'Algérie
72
lois mémorielles, dont la loi Gayssot, ne contiennent
pas de mesures assez précises pour légiférer correctement
; de ce fait, elles n'ont qu'une finalité idéologique
52 (Duclos-Grisier, 2021). Cette transformation des politiques
mémorielles incite chaque nouveau président à investir un
terrain qui n'a pas déjà été conquis et à y
exercer un « devoir de mémoire » toujours plus rigoureux. Le
président actuel Emmanuel Macron a par exemple choisi celui de la
colonisation, notamment en axant ces efforts sur la Guerre d'Algérie.
Ainsi, le 20 janvier 2021, l'historien Benjamin Stora remettait un rapport au
président sur « ses conclusions et recommandations sur la
mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie »
53. Quelques mois après, le président annoncera qu'un
réseau d'archives classifié en rapport avec
l'événement sera ouvert. L'accès aux archives est
important, c'est la matière nécessaire pour les historiens afin
d'éclairer le passé.
Cependant, si l'on se rattache aux politiques
mémorielles, depuis le début des années 2000, on remarque
qu'elles sont davantage orientées vers des problématiques
identitaires, chaque action mémorielle se faisant pour la
52 Duclos-Grisier, A. (2021, 3 mai). Lois mémorielles :
la loi, la politique et l'Histoire. Vie publique Consulté le 15
février 2024, à l'adresse https ://urlz.fr/ pz2D
53 Elysée. (2021, 20 janvier). Remise du rapport sur la
mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie.
Consulté le 15 février 2024, à l'adresse
https://urlz.fr/pERC
54 Préfet du Nord. (s. d.). Cérémonies
officielles & protocole. Les Services de L'État Dans le Nord.
Consulté le 15 février 2024, à l'adresse
https://urlz.fr/pzgJ
73
mémoire d'un groupe (les harkis, les juifs, les
arméniens, etc.). Le risque étant de provoquer des tensions entre
ces différentes mémoires, car si certaines sont
valorisées, d'autres restent dans l'ombre. Nous sommes alors face
à une situation contre-productive pour la construction de la
mémoire collective, dans la mesure où un processus de
synthèse est nécessaire pour assurer une transmission
intelligible. C'est de cette tension que témoigne le calendrier des
commémorations désormais bien rempli. En effet, pour 2024, on
compte 17 dates prévues, sans compter les anniversaires des conflits
importants 54. Parmi cet agenda chargé, on retrouve 3 dates
reliées à la Guerre d'Algérie, le 19 mars, le 25 septembre
et le 9 décembre, symptomatiques d'un manque de consensus sur cette
mémoire.
4.2 - Le cas complexe de la Guerre d'Algérie
Les politiques mémorielles, malgré les
avancées qu'elles permettent dans l'éclairage du passé
(notamment via la déclassification des archives), peuvent aussi devenir
la source de tensions mémorielles. La Guerre d'Algérie est un
exemple particulier, car sa commémoration reste encore
problématique en France. S'attarder sur cet exemple peut nous permettre
de comprendre les causes qui amènent à ce qu'une mémoire
ne passe pas. Tout d'abord, la guerre
74
d'Algérie, déjà dans ses racines,
contient des ambivalences qui la rendent difficile à commémorer.
Ce conflit a en effet impliqué une diversité d'acteurs aux
revendications bien différentes. On parle d'ailleurs des mémoires
et non pas de la mémoire de la guerre d'Algérie.
Cette guerre aura ainsi duré 8 ans, officiellement de
1954 à 1962 en Algérie, et opposant principalement l'armée
française au FLN (Front de libération nationale) et à sa
section armée, l'ALN (Armée de libération nationale). Du
côté de l'armée française, on retrouve des soldats
avec de l'expérience, ayant déjà combattu en Indochine,
mais cultivant un ressentiment après avoir participé à une
guerre très impopulaire. Ces « rappelés » arrivent donc
en Algérie avec un esprit revanchard, ils ne veulent pas perdre «
l'Algérie française ». À leurs côtés, on
retrouve les « appelés » des militaires plus jeunes,
abandonnant leur travail, leurs familles pour participer à leur
première guerre. Ils sont beaucoup plus nombreux que les
rappelés, mais seront traumatisés par leur expérience sur
le champ de bataille. Parmi eux, l'armée française recrutera
aussi des Algériens, majoritairement des paysans, ce sont les «
Harkis ». Ces soldats supplétifs rejoindront l'armée
française pour des raisons très diverses. Mais ils sont pris dans
un entre-deux : d'un côté, ils subissent la méfiance des
autres soldats français, et de l'autre, le risque de représailles
de leur propre peuple qui les voient comme des traîtres. Enfin, parmi les
victimes, on compte aussi les
75
civils. En Algérie, ce sont principalement les «
pieds-noirs », des colons européens qui se sont établis en
« Algérie française » avant la guerre 55
(Dalisson, 2018).
Ainsi, les accords d'Évian signés le 18 mars
1962 instaurent un cessez-le-feu en Algérie et la fin officielle de la
guerre. Cependant, il n'est pas encore question d'utiliser le mot « guerre
», on parle plutôt des « événements » ou des
« opérations de maintien de l'ordre », jusqu'en 1999 où
une loi est votée pour adopter l'expression « à la guerre
d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc ». Ce manque de
clarté transparaît aussi dans le choix des dates de
commémorations qui sont encore débattues, témoignant d'un
manque de consensus entre les multiples acteurs de cette mémoire. La
principale, le 19 mars, est la « journée nationale du souvenir et
du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la Guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc »
(Duclos-Grisier, 202 ) 56. Cette date acte la fin officielle de la
guerre, mais pour certaines communautés telles que les harkis ou les
pieds noirs, elle marque aussi le début des violences à
55 Dalisson, R. (s. d.). L'impossible commémoration de la
guerre d'Algérie (De 1962 à nos jours) | Canal U. Dans Canal-U
[Rediffusion]. Université de Roue, Rouen, Normandie, France.
Consulté le 26 juillet 2023, à l'adresse,
https:// urlz.fr/pDrP
56 Duclos-Grisier, A. (2023, 16 mars). Guerre d'Algérie
: quelle célébration du 19 mars 1962 ? Vie Publique.
Consulté le 16 février 2024, à l'adresse
https://urlz. fr/c87F
76
leur encontre. À l'image du 5 juillet 1962, quelques
mois après les accords d'Évian, où des centaines de
personnes seront tuées à Oran, la ville la plus européenne
d'Algérie, les causes de la fusillade restent encore mal connues tout
comme le nombre de victimes exact 57. En plus du 19 mars, le 5
décembre célèbre également l'ensemble des morts
pour la France pendant la guerre d'Algérie ainsi que les combats du
Maroc et de la Tunisie. La différence étant que cette date est
accolée à l'érection d'un mémorial à
l'initiative de Jacques Chirac en 2002. La date n'a donc pas de relation
directe avec l'histoire des événements et peut se confondre avec
celle du 19 mars 58. On note finalement que le 25 septembre est
spécifiquement dédié à la mémoire des
anciens harkis et autres membres des formations supplétives ayant servi
aux côtés de l'armée française.
Ainsi, chaque commune, chaque association peut décider
de commémorer l'une ou l'autre des dates proposées en fonction de
son point de vue sur les événements. Ce n'est donc pas pour
faciliter la discussion autour de ces mémoires et le problème
provient peut-être davantage
57 Mémoires des hommes. (2022, 4 juillet). Victimes des
massacres d'Oran le 5 juillet 1962. Mémoire des Hommes. Consulté
le 16 février 2024, à l'adresse
https://urlz.fr/pzMD
58 SGA du ministère des Armées. (2022, 12
décembre). [De la mémoire à l'Histoire] Comprendre la
Journée nationale d'hommage du 5 décembre [Vidéo].
YouTube. Consulté le 16 février 2024, à l'adresse
https://www.youtube.com/ watch?v=CTB6fLSrL1Q
77
d'un manque de pédagogie autour de ces histoires, comme
le suggère l'historien Rémi Dalisson : « Il faut sortir des
mythes d'une identité française, gauloise qui ne devrait pas
changer, surtout à l'ère des migrations comme aujourd'hui [...]
Tout ça, ce sont des problèmes mal expliqués,
instrumentalisés, comme l'est la guerre d'Algérie et comme l'est
la commémoration. » 59 (Dalisson, 2018)
59 Dalisson, R. (s. d.). L'impossible commémoration de la
guerre d'Algérie (De 1962 à nos jours) | Canal U. Dans Canal-U
[Rediffusion]. Université de Roue, Rouen, Normandie, France.
Consulté le 26 juillet 2023, à l'adresse,
https:// urlz.fr/pDrP
78
Nouveau secteur, le tourisme de mémoire


79
5.1 - Le tourisme de mémoire pré &
post covid
L'intérêt pour la mémoire ne se joue pas
simplement qu'au niveau politique, mais également aux échelles
individuelles. On remarque ainsi un intérêt croissant pour la
visite de lieux de mémoire. Dès lors, on s'intéresse
à ce qu'on définit aujourd'hui comme le « tourisme de
mémoire ». Cette pratique n'est pas exclusivement basée sur
la visite de lieux historiques où s'est déroulé une
bataille ou un massacre, elle peut aussi se faire dans des mémoriaux ou
des musées qui sont délocalisés de
l'événement qu'ils commémorent. Les dimensions
mémorielles et historiques sont ainsi mélangées
dépendamment de la nature du lieu.
Afin de mieux définir ce terme, il peut-être
judicieux de comprendre qui sont les visiteurs pratiquant ce type de tourisme ?
Dans un premier temps, certaines personnes visitent ces lieux, car elles
entretiennent un rapport personnel avec lui ou parce que leurs descendants ont
eu un rapport avec l'événement. D'autre part, cela peut aussi
concerner les personnes motivées par une démarche scientifique ou
pédagogique, à l'image des visites scolaires 60
(Crahay, 2015). Ainsi, en 2019, on compte 1,3 millions de scolaires parmi les
15,2 millions d'entrées enregistrées
60 Crahay, F. (2015). Tourisme mémoriel. Témoigner
Entre Histoire et Mémoire, 117, 151-152. Consulté le 17
février 2024, à l'adresse
https://journals.
openedition.org/temoigner/1215
80
dans les lieux de mémoire des conflits contemporains
61. Ce chiffre record sera cependant suivi par une chute des
fréquentations en 2020 à cause de la pandémie de la
COVID-19, avec seulement 3,8 millions d'entrées enregistrées
62. Ce changement brutal a forcé les institutions
mémorielles à faire évoluer leurs propositions en fonction
des nouvelles contraintes et des nouvelles attentes induites par la
pandémie. En effet, les confinements à répétition,
le port du masque, les distanciations, sont autant de contraintes qui ne vont
pas avec la pratique plus globale du tourisme.
Cette période a cependant pu nous inciter à
mieux connaître des lieux d'intérêt proches de chez nous,
plutôt qu'à chercher le dépaysement à des centaines
de kilomètres. Cette pratique d'un tourisme plus local et plus durable,
le « slow tourism » pourrait ainsi remettre en cause une forme de
consommation frénétique sur des lieux touristiques bondés
63 (Briant et al., 2020). Concernant les
61 Wyckaert, M., & Mansueto, A. (2020). 15,2 millions
d'entrées dans les lieux de mémoires des conflits contemporains
en France en 2019. Dans Ecodef. Consulté le 14 septembre 2023, à
l'adresse
https://urlz.fr/pAkc
62 OED. (2021). Chute de la fréquentation des lieux de
mémoire des conflits contemporains en 2020. Dans Ecodef. Consulté
le 14 septembre 2023, à l'adresse
https://urlz.fr/pAkc
63 Briant, E., Bechet, M., Machemehl, C., & Suchet, A.
(2020). Utopies d'un tourisme en renouvellement. Teoros, 39(3). consulté
le 17 février 2024, à l'adresse
http://journals.openedition.org/teoros/7312
81
lieux de mémoire, cela signifie entre autres un
ajustement des dispositifs numériques afin d'assurer une
médiation qui soit adaptée à ces nouveaux enjeux. À
partir des années 80, avec l'arrivée progressive d'un «
devoir de mémoire » collectif, le numérique avait
déjà sa place dans certains lieux afin d'appuyer une
médiation centrée sur l'immersion et l'anticipation de la
disparition des témoins. Comme dans le cinéma circulaire «
Arromanches 360 », situé à proximité des plages du
débarquement en Normandie ; construit en 1994, il propose d'être
littéralement entouré d'images et de vidéos d'archives,
proposant ainsi une expérience immersive dans ce passé tragique.
Il sera par la suite rattaché au site du mémorial de Caen en
2012.Désormais, il propose des projections de films thématiques
afin de compléter la visite du mémorial, garantissant, en plus
d'un apport pédagogique, une expérience émotionnelle forte
: « Des débarquements sur les 5 plages de la Manche et du Calvados
au tragique bombardement du Havre le 12 septembre, la bataille de Normandie a
duré 100 jours. Vivez 20 minutes d'une pure intensité historique
! » 64. En effet, en plus d'une évolution probable vers
une forme de tourisme plus locale, comme avec des parcours thématiques
et des visites plus autonomes, il y a aussi une volonté de la part des
visiteurs de vivre une expérience émotionnelle forte.
64 Arromanches 360. (2024, 17 janvier). Le cinéma
360° - Arromanches 360. Consulté le 17 juillet 2023, à
l'adresse
https://www.arromanches360.fr/le-lieu/
le-cinema-360/
82

Vue de l'intérieur du cinéma
circulaire
Arromanche 360 en Normandie (c)
83
C'est pourquoi l'amélioration des technologies
présentes dans nos smartphones et l'augmentation de leur puissance
(géolocalisation, réalité augmentée, gyroscope,
etc.) permet aux musées de renouveler leurs médiations.
L'entreprise Baludik propose par exemple depuis 2015 un outil à
destination notamment des offices de tourisme afin de promouvoir le patrimoine
historique et les événements d'une ville 65. L'outil a
déjà été utilisé par la ville de Nantes afin
de créer des parcours thématiques permettant de découvrir
l'histoire de la traite négrière ou encore celle du
cimetière de la Chauvinière (en partenariat avec l'Office
national des anciens combattants) par exemple. Ces différents parcours
rendent ainsi le visiteur complètement autonome, le responsabilisant
également dans la préservation du patrimoine ainsi que sur la
transmission et la construction de la mémoire collective. D'autant que
les derniers chiffres donnés sur la fréquentation des lieux de
mémoire des conflits contemporains sont largement en hausse depuis la
pandémie, avec, en 2022, 11,4 millions d'entrées
enregistrées. 66
65 Le concept - Baludik. (2023, 17 octobre). Baludik.
Consulté le 13 novembre 2023, à l'adresse
https://baludik.fr/concept/
66 Prené, L. (2023). Avec la fin des restrictions
sanitaires, la fréquentation des lieux de mémoires des conflits
contemporains bondit en 2022. Dans Ecodef. Consulté le 15 janvier 2024,
à l'adresse
https://urlz.fr/pAkc
84
5.2 - De l'expérience transmise à
l'expérience vécue
Le tourisme de mémoire constitue désormais un
nouvel enjeu important dans la construction de la mémoire collective, en
accompagnant les politiques mémorielles et en s'appuyant sur les
avancées du numérique. Cependant, dans la définition du
concept, nous avons oublié une catégorie particulière de
touristes et probablement la plus nombreuse. En plus de ceux ayant une relation
personnelle avec le lieu et de ceux qui le visitent pour des raisons
scientifiques et/ou pédagogiques, il y a également des personnes
qui le visitent par simple attrait culturel ou touristique. De fait, tandis que
les intentions des deux premières catégories sont assez
explicites, pour cette dernière, nous sommes en droit de mieux
comprendre leurs intentions réelles ? S'agit-il d'une attirance malsaine
pour les lieux où se sont déroulés des drames humains ?
Est-ce un phénomène récent qui pourrait témoigner
d'un changement global dans les pratiques commémoratives ? Ces multiples
questions peuvent être reliées au concept de « tourisme noir
» défini comme suit par ses théoriciens : « le
phénomène qui englobe la présentation et la consommation
(par les visiteurs) de sites liés à la mort et aux catastrophes
réels et commercialisés ». 67 (Lennon &
Foley, 2000).
67 Lennon, J., & Foley, M. (2000). Dark tourism the
attraction of death and disaster [Internet archives]. London ; New York :
Continuum. Consulté le 14 février 2023, à l'adresse
https://archive.org/details/darktourism0000lenn
85

Ambassadeur de l'entreprise « Chernobyl
Story Tours
» (c) proposant des visites du
site de la catastrophe
nuéclaire.
86
Ce terme, depuis sa création, a été
enrichi de nouvelles pratiques qui constitueraient une forme de tourisme noir.
Pour les plus récentes, on retrouve par exemple le tourisme
apocalyptique ou de la dernière chance, qui consiste à visiter
des écosystèmes amenés à disparaître, en
raison du réchauffement climatique par exemple. Paradoxalement, si cette
forme de tourisme est pratiquée de manière excessive, elle
participe aussi à l'accélération de la disparition de ces
écosystèmes. 68 (Eijgelaar et al., 2010). Ainsi, ces
nouvelles formes de tourisme cohabitent avec d'autres dont le contexte est bien
différent, comme la visite de lieux où se sont
déroulés des génocides, à l'image du camp
d'Auschwitz-Birkenau. Sous ce concept large de « tourisme noir », on
retrouve ainsi des sous-pratiques dont les intentions touristiques sont
très différentes. Cependant, les recherches successives sur ce
concept s'axent principalement sur deux principes : la mise en marché
des lieux de souffrance ainsi que les motivations des touristes. 69
(Baillargeon, 2016). Même si l'exploration du contexte et des
conséquences économiques de cette pratique peuvent nous
éclairer sur
68 Eijgelaar, E., Thaper, C., & Peeters, P. (2010). Antarctic
cruise tourism : the paradoxes of ambassadorship, «last chance
tourism» and greenhouse gas emissions. Journal Of Sustainable Tourism,
18(3), 337-354. Consulté le 17 février 2023, à l'adresse
https://doi.org/10.1080/09669581003653534
69 Baillargeon, T. (2016). Le tourisme noir : l'étrange
cas du Dr Jekyll et de M. Hyde. Teoros, 35. consulté le 18
février 2024, à l'adresse
http://journals.
openedition.org/teoros/2839
87
les bienfaits et les dommages causés aux environnements
et aux personnes des lieux visités, ce n'est pas le point que nous
allons aborder par la suite.
Ce qui va nous intéresser, c'est bien de comprendre les
motivations des personnes visitant des lieux de mémoire où se
sont déroulés des drames humains. J'entends donc ici des lieux
comme le camp d'Auschwitz-Birkenau, l'ancien village d'Oradour-sur-Glane ou
encore les champs de bataille à Verdun. Ainsi, j'ai pu mener une
série d'interviews sur certains lieux de mémoire nantais afin de
mieux comprendre les intentions des passants et des visiteurs qui approchaient
ces lieux. Dans un premier temps, on remarque que la notion de respect revient
très souvent lorsqu'il leur est demandé l'attitude à
adopter dans ce type de lieu. « Ici, je pense qu'il faut rester assez
sérieux, sinon ça reviendra à aller dans des camps de
concentration et à faire des blagues sur les juifs ! » « Faut
être respectueux, pas parler trop fort, on respecte l'endroit, on ne va
pas aller faire des graffitis » 70. Ces derniers extraits
proviennent de jeunes réalisant un voyage à Nantes dans le cadre
du SNU (Service national universel) et la notion de respect est clairement
identifiée, notamment vis-à-vis du lieu. D'autres interventions
de personnes plus âgées permettent de comprendre que l'attitude
adoptée peut faire écho à des
70 D'après une série de 6 interviews de visiteurs
aléatoires au mémorial de l'abolition de l'esclavage à
Nantes l'après midi du 21/06/2023
88
conflits contemporains, tels que la guerre en Ukraine : «
Il faut avoir du respect, même par rapport à ce qu'il s'est
passé, on est un peu triste, ça gêne un peu quand on sait
ce qu'il s'est passé, il ne faudrait pas que ça se reproduise,
mais bon, ce n'est pas qu'une illusion quand on voit la guerre en Ukraine.
» 71 Enfin, certaines remarques attestent d'une ambivalence dans les
émotions à l'approche de ces lieux, ainsi qu'une
difficulté à bien les qualifier : « C'est dur à
décrire comme émotion, mais c'est un peu mélangé
entre les émotions tristes et de la reconnaissance », (traduit de
l'anglais) « C'est assez triste de voir tous ses noms, il y en a
tellement, ce sont tous des gens décédés et c'est triste,
c'est un sentiment étrange » 72. Bien qu'ici, nous
parlions de visiteurs qui se sont arrêtés par hasard ou
s'apprêtaient à passer à côté des
mémoriaux sans les remarquer. Leurs intentions de « visites »
ne sont donc pas les mêmes que pour les visiteurs des lieux de
mémoire qui sont directement implantés sur les
événements passés. Tels que des champs de bataille ou des
camps d'extermination.
Cependant, ces lieux dégagent tous une ambiance
particulière commune au regard du but de leur préservation
71 D'après une série de 6 interviews de visiteurs
aléatoires au mémorial de l'abolition de l'esclavage à
Nantes l'après midi du 21/06/2023
72 D'après séries de 7 interviews de visiteurs
aléatoires au monument aux morts de la guerre 14-18 à Nantes
près du quai Ceineray, l'après midi du 26/09/23
89
dans le temps et de la typologie d'événements
auxquels ils sont rattachés. Ainsi, nous pourrions tenter d'expliquer ce
« sentiment étrange » et comprendre en quoi il peut être
la cause des visites sur ces lieux. Selon le point de vue psychologique, nous
sommes conditionnés à l'équilibre entre nos pulsions et
les limites de la réalité. D'après cette approche, la
limite du droit joue un rôle crucial dans la société en
nous aidant à contrôler ces pulsions et à nous conformer
aux normes collectives. Cela nous apaise et nous pousse à respecter
certaines limites pour le bien de tous. Cependant, cet équilibre est
fragile, surtout lorsque la justice ne semble pas fiable ou lorsque des
individus sont injustement traités. Dans de telles situations,
enfreindre la loi peut devenir tentant, révélant un état
émotionnel complexe. Le fait de violer les règles fait ressurgir
un désir refoulé de satisfaction personnelle, ce qui suscite
à la fois de l'amertume pour la transgression et une prise de conscience
de nos impulsions profondes.
« De ce point de vue, visiter un champ de bataille ou un
camp d'extermination mettrait les touristes en contact avec leur propre
destructivité, la composante animale qui se trouve en chacun. Ils ne
cherchent pas seulement le point de vue de la victime, mais aussi celui de
l'auteur de violence. L'exploration des endroits sombres permettrait donc de
savoir ce qui se passe lorsque le principe de réalité est
brisé et que le principe de plaisir se manifeste dans sa forme la plus
extrême et obscure, lorsqu'une rupture dans
90
les règles se produit. » 73 (Binik. O, 2016).
Ainsi, en surface, cette quête d'émotion «
voyeuriste » lorsque le « tourisme de mémoire » est
perçu de manière négative permet en fait, dans une forme
de catharsis, de se mettre à la place de l'auteur des crimes et de
dépasser la fameuse « limite », de manière fictive. De
cette manière, cette approche émotionnelle permet de s'approprier
le point de vue de l'auteur de ces crimes et de mieux comprendre ses
intentions, dans une quête de sens et non dans une quête de
sensationnalisme. Dans ce cadre, le très récent film de Jonathan
Glazer La zone d'intérêt, sorti en 2023 et adapté du roman
du même titre du romancier britannique Martin Amis, peut nous donner de
nouvelles clés de compréhension. Le film nous raconte l'histoire
du commandant Rudolf Hoss, alors responsable de la « gestion » du
camp d'Auschwitz, et de sa famille, dans leur villa située juste
à côté du camp. En adoptant ainsi le point de vue de
l'auteur des crimes, cela nous permet de comprendre le sens derrière les
agissements inhumains des Nazis. Le film nous montre ainsi que ces
exécutants ne font partie que d'une plus grande machine ne
considérant les Juifs que comme du Menschenmaterial, soit du «
matériau humain ». Les nazis n'agissent alors qu'avec une
attitude
73 Binik, O. (2016). Dans les terres sauvages à la
recherche du sublime. La dimension émotionnelle du tourisme sombre.
Teoros, 35.
http://journals.
openedition.org/teoros/2844
91
dite sachlich, que l'on pourrait qualifier par le fait
d'être « objectif, professionnel, froid et réifiant,
c'est-à-dire de transformer les gens en choses » 74 (Baralon. M,
2024). De ce point de vue, le film dresse également des constats qui
peuvent être comparés à des problématiques de notre
présent, dont la question du darwinisme social, comme quoi la vie est un
combat et que seuls les plus forts peuvent réussir à subsister
via la figure de Rudolf Hoss, homme froid, seulement préoccupé
par les chiffres et sa propre réussite plus que par les vies humaines
qu'il sacrifie.
Ainsi, ce renouvellement dans les pratiques touristiques sur
les lieux de mémoire témoigne d'une certaine volonté de
réappropriation mémorielle. D'autant que depuis la
Première Guerre mondiale, les conflits contemporains ont connu une
résonance internationale qui s'est encore élargie avec les
mémoires de la Shoah. Depuis les années 90, une forme
d'hypermnésie se met en place, et chaque événement du
passé, aussi éloigné soit-il, ne doit pas être
oublié pour ne pas être commis une deuxième fois, à
l'image des mémoires de l'esclavage. Nous sommes là dans une
manifestation claire du « présentisme », où les
frontières entre passé et présent deviennent floues,
rendant les contemporains responsables de toutes les mémoires de
74 Baralon, M. (2024, janvier 29). Johann Chapoutot : « Ce
film est à la pointe de ce qui se fait en sciences humaines sur la Shoah
» . Trois Couleurs. Consulté le 18 février 2024, à
l'adresse
https://urlz.fr/pACh
92
leurs ancêtres 75 (Rousso, 2007). Cependant,
comme nous l'avons vu précédemment, ce « devoir de
mémoire » ne favorise pas pour autant une réappropriation
saine. Cette réappropriation croissante peut-être également
entravée par les lieux de mémoires en eux-mêmes et par
leurs règles morales de bonne conduite. On parle alors ici des «
usages primaires » 76 (Aucher, 2018) afin de qualifier les comportements
qui sont considérés comme étant adaptés au lieu :
attitudes silencieuses, contemplatives, etc. Dans un second temps, les «
usages secondaires » qualifient les comportements que l'on pourrait
qualifier de touristiques. C'est-à-dire, comme nous l'avons
évoqué précédemment, utiliser le monument au regard
de son utilité pratique ou encore l'utiliser comme un espace de jeu.
Dans les cas extrêmes, que je n'ai pas observés, il peut
également s'agir d'actes irrespectueux, voire antisémites.
Cependant comme le précise Brigitte Sion, experte dans
les domaine des musée et de mémoriaux : « La présence
d'objets associés au deuil et au souvenir, ainsi que la posture sombre
et silencieuse de ces visiteurs identifient le champ des stèles comme
mémorial.
75 Rousso, H. (2007). Vers une mondialisation de la
mémoire. Vingtième Siècle. Revue d'histoire. 94.3-10,
consulté le 26 juin 2023, à l'adresse,
https://
doi.org/10.3917/ving.094.0003
76 Aucher. L, (2018).«Devant le mémorial,
derrière le paradoxe», Géographie et cultures, 105, 11-30.
consulté le 26 juin 2023, à l'adresse,
https://journals.
openedition.org/gc/6351
93
Cependant, les traces matérielles sont rapidement
enlevées par le personnel d'intendance, comme si les stèles
devaient être admirées comme oeuvres d'art et non servir de lieu
de mémoire 77 (Sion, 2013). Ainsi les usages primaires
imposés par les lieux de mémoires peuvent empêcher une
forme de réappropriation individuelle au nom d'une morale
considéré comme appropriée. Cependant, nous avons aussi vu
que le renouvellement des pratiques commémoratives
s'accélère et que les cadres moraux proposés par les
institutions mémorielles pourraient bientôt devenir insuffisants.
En témoignent les actes déplacés qui continuent de se
propager sur certains lieux de mémoire assez touristiques, notamment le
fameux « selfie » 78.
77 Sion Brigitte, 2013, « Le Mémorial de la Shoah
à Berlin : échec et succès », in Denis Peschanski
(dir.), Mémoire et mémorialisation, vol. 1, Paris, Hermann, p.
279-293.
78 Le Parisien. (2023, 17 avril). Selfies : le mémorial
d'Auschwitz rappelle à l'ordre ses visiteurs tentés de prendre la
pose. Le Parisien. Consulté le 18 février 2024, à
l'adresse
https://urlz.fr/pALH
94
LES MUTATIONS DE LA MÉMOIRE
Conclusion

95
Au long de cette seconde partie, nous avons observé que
les témoins de l'histoire disparaissent et qu'ils laissent
derrière eux des traces de leur passé (archives, monuments) qui,
sans eux, sont plus difficiles à comprendre avec nos yeux de
contemporains. Cela doit nous rappeler qu'en plus de préserver notre
passé, nous devons aussi nous assurer de laisser des traces
compréhensibles de notre présent. Car qui nous dit que nos lieux
de mémoire liés par exemple au terrorisme seront toujours compris
dans 40 ans ? Ainsi, depuis les années 90 et la résurgence des
mémoires de la Shoah, nous assistons à de profonds changements
dans nos pratiques commémoratives. Pour comprendre le passé,
l'histoire simplement transmise ne suffit plus. Il s'agit désormais de
vivre une expérience émotionnellement forte, de s'immerger dans
le passé pour mieux le comprendre et se le réapproprier.
Cependant, cette réappropriation peut être entravée par des
politiques mémorielles dont la gestion du passé n'est pas
centrée sur la recherche de sens, mais par des problématiques
identitaires et idéologiques. Ce sont également les lieux de
mémoire et leur gestion morale qui sont mis à l'épreuve
par les nouveaux comportements des touristes qu'il faut pouvoir réguler
sans aller à l'encontre de leurs libertés individuelles.
96
PENSER LA MÉMOIRE AUTREMENT
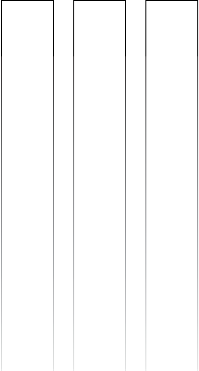

97
« Mon métier, par définition, c'est de
faire des
objets inertes. Néanmoins, je les dessine pour qu'il
se
crée une forme d'attraction, une énergie invisible
entre ce
que j'ai produit et une personne qui va la
voir ou la posséder.
» (Lehanneur. M, 2023)

98
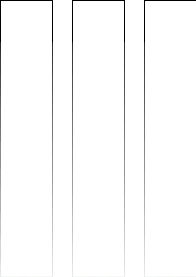
Réveiller le monument

99
6.1 Le monument, une relation tactile
« Découvrir et faire vivre un monument aux morts,
cela suscite immanquablement un ressenti. [...] Certains pourraient imaginer
faire toucher du doigt ou même caresser de la paume la froideur du
matériau pour accéder à une sensation physique. » 79
(David, 2013) Le monument est avant toute chose un objet tangible, et s'il
s'invisibilise progressivement, c'est aussi peut-être parce que nous
avons oublié son côté sensible. C'est pourquoi, au long des
interviews que j'ai pu mener sur le mémorial de la Première
Guerre mondiale à Nantes, j'ai aussi proposé aux personnes
interrogées de toucher de la matière amenée pour
l'occasion (contreplaqué, morceaux de tissus) et de la comparer au
béton du monument. L'objectif étant de comprendre, selon
l'opinion des passants, pourquoi la pierre serait une matière plus
justifiée que du bois ou du tissu dans la construction d'un monument.
La majorité des réponses obtenues s'accordent
sur la forme et la matière de celui-ci, qui lui permet de
résister à l'épreuve du temps et de devenir un marqueur
pérenne du passé : « La matière que vous proposez,
c'est un peu un manque de respect envers le monument, les morts sont
79 David, F. (2013). Comprendre le monument aux morts
[OpenEditionBooks]. Codex. consulté le 10 septembre 2023, à
l'adresse
https://doi.org/10.4000/books.
codex.967
100
assimilés à la pierre, ça renvoie au
travail nécessaire et à la souffrance pour en arriver là,
au travail du tailleur de pierre », « le bois, ça
peut-être une planche de n'importe quoi, ça a pu être
coupé il y a deux semaines, alors que ça (la pierre), ça
fait partie de notre histoire en fait, y a plus d'émotion là
dedans, y a plus de vécue » 80. Ainsi, on note
l'importance accordée par les visiteurs aux caractéristiques du
matériau du monument. En partant d'un simple contact tactile avec la
pierre, il est ensuite facile de déduire des valeurs symboliques, «
travail du tailleur de pierre », « souffrance », «
sacrifice » et de dériver vers un récit historique
lié au monument.
Cette forme de pédagogie in situ est ainsi
déjà éprouvée par les voyages scolaires qui
représentent une part non négligeable de la fréquentation
des lieux de mémoires en France, avec 546 000 entrées
recensées en 2022 81. En effet, les neurosciences ont
démontré que les stimulus émotionnels pouvaient dans
certaines conditions améliorer la qualité de l'apprentissage. Les
influences des émotions sur l'apprentissage et la mémoire peuvent
être expliquées en termes de composantes attentionnelles
80 D'après une série de 7 interviews menés
au monument en hommage aux morts nantais de la première guerre mondiale
à Nantes l'après midi du 21/06/2023
81 Prené, L. (2023). Avec la fin des restrictions
sanitaires, la fréquentation des lieux de mémoires des conflits
contemporains bondit en 2022. Dans Ecodef. Consulté le 15 janvier 2024,
à l'adresse
https://urlz.fr/pAkc
101
et motivationnelles. Les composantes attentionnelles
améliorent le traitement perceptif, c'est à dire le traitement
des stimulus provenant de notre environnement à travers nos sens (la
vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat) et aident à
sélectionner et à organiser l'information pertinente. Tandis que
les composantes motivationnelles induisent la curiosité, encourageant
ainsi l'exploration et préparant le cerveau à apprendre et
à se souvenir 82 (Tyng et al., 2017).
Pour aller plus loin, la sculptrice et peintre Quitterie
Ithurbide (malheureusement décédée en 2020) a
réalisé des sculptures en bas-relief de peintures
célèbres, afin notamment de rendre accessibles ces peintures aux
personnes malvoyantes 83 (Ithurbide. Q, 2018). Ces sculptures sont
faites en céramique et permettent également aux personnes
capables visuellement d'apprécier les tableaux en ayant enfin la
possibilité de toucher une version alternative. Également, afin
d'aider à la compréhension des lumières dans le tableau,
l'artiste a fait l'usage de différents émaux afin de retranscrire
tactilement les zones d'ombres et les zones éclairées. Ici, la
dimension tactile permet de donner des clés de compréhension
supplémentaires dans
82 Tyng, C. M., Amin, H. U., Saad, M. N. M., & Malik, A. S.
(2017). The Influences of Emotion on Learning and Memory. Frontiers In
Psychology, 8. consulté le 19 février 2024, à l'adresse
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01454
83 Quitterie Ithurbide. (2018, 30 octobre). express Quitterie
Ithurbide DEF 4mb s [Vidéo]. YouTube. Consulté le 17 octobre
2023, à l'adresse
https://www.
youtube.com/watch?v=Uo_AkyCZQKY
102
la lecture d'une oeuvre picturale qu'on ne peut pas toucher.
Les sens se complètent et viennent renforcer une certaine immersion,
à l'image de ce que l'on peut ressentir si l'on prend le temps de
visiter un mémorial physique.
6.2 Rendre le monument vivant
Par nature, s'il est entretenu, un monument est vivant. Un
simple regard, une visite, des cérémonies sont autant de moyens
pour lui permettre de rester en vie. Il existe pourtant des initiatives bien
plus littérales qui viennent questionner la place du monument, pour le
faire passer d'un lieu pour les morts à un lieu pour les vivants.
Ainsi, le 13 juillet 1996 marquera la fin de la restauration
du monument délabré de la commune française de Biron,
érigé en 1921. À la demande de la commission du
ministère de la Culture de l'époque, l'artiste allemand Jochen
Gerz sera garant de cette restauration afin de créer un monument vivant.
Ainsi, chaque nouvel habitant de la commune, lorsqu'il atteint la
majorité, est invité à répondre à une
question gardée secrète. Chacune des réponses est ensuite
gravée sur une plaque et accrochée au monument 84.
Dans un autre registre, des mémoriaux vivant en ligne
84 Gerz, J. (s. d.). Le monument vivant de Biron. Jochen Gerz.
Consulté le 19 février 2024, à l'adresse
https://jochengerz.eu/works/le-monument-vivant-de-biron
85 Vimy : Mémorial vivant. (2022, 9 avril).
Consulté le 19 novembre 2023, à l'adresse
https://livingmemorialvivant.ca/
103
font également leur apparition. Par exemple, le
mémorial de Vimy au Canada, commémorant les Canadiens morts en
France pendant la Première Guerre mondiale, possède
également une déclinaison numérique permettant de
réaliser un « pèlerinage numérique »
85. Cette expérience se présente sous la forme d'un
site web, sur lequel il est possible de découvrir des témoignages
de vétérans de plusieurs conflits différents (Seconde
guerre mondiale, Guerre de Corée, Afghanistan...). Ainsi, le
mémorial est susceptible d'évoluer dans le temps si d'autres
conflits sont à venir, car le site Web offre également la
possibilité d'ajouter son propre témoignage afin d'enrichir la
collection déjà existante. De plus, l'expérience se veut
immersive et sensible, au moyen de visuels et d'effets sonores
travaillés.
La création de ces mémoriaux vivants va de pair
avec les formes de réappropriation mémorielles que nous avons
vues précédemment. Ils permettent de consigner les nouveaux
événements du présent avec des outils que nous connaissons
(témoignages vidéo, par exemple) en s'ajoutant à un corpus
d'archives appartenant au passé. C'est ainsi un moyen de créer un
lien entre le passé et le futur, en entretenant notre mémoire au
présent. Les enjeux qui se jouent ici sont importants, car si l'on parle
ici de réappropriation mémorielle à l'échelle
internationale, on
104
constate un accroissement des mouvements sociaux. Ces derniers
sont perçus comme une réponse à l'inégalité,
à l'injustice et à l'incapacité perçue des
gouvernements à agir dans des domaines tels que la fiscalité,
l'économie, la santé et l'environnement. Ces mouvements ne sont
pas simplement réactifs, mais expriment également un désir
chez les acteurs sociaux de reprendre le contrôle de leur destin
collectif. Ces mouvements remettent en question le modèle traditionnel
de représentation politique et aspirent à une forme de «
démocratie réelle » basée sur des interactions
horizontales, l'autonomie, la collaboration et le partage des
compétences 86 (Forero Mendoza et al., 2023).
Ainsi, ces dernières années ont vu
apparaître de nouveaux mouvements de contestations internationales,
à l'image des révolutions du printemps arabe à partir de
2010. En effet, après plusieurs décennies à subir les
conséquences de régimes autoritaires et gouvernés par une
seule partie, les revendications des protestataires pouvaient se résumer
en une seule affirmation : une recherche de dignité. D'une part par la
reconnaissance d'une forme de citoyenneté fondée sur les
libertés politiques, d'autre part par une amélioration de la
situation sociale alors
86 Forero Mendoza, S., Hohlfeldt, M., & Peyraga, P. (2023).
L'art en partage citoyen : introduction [Hal open science]. Dans L'art en
partage citoyen (p. 9-24). Orbis Tertius.
https://hal.science/hal-04293401
105
profondément inégale 87. Un peu plus
récemment, et dans un autre registre, c'est le mouvement
américain March for our lives qui s'est créé en 2018 en
réaction aux multiples fusillades dans le pays et demandant un
contrôle accru des armes à feu. Depuis, le mouvement s'est
propagé à l'international et a encouragé certaines actions
politiques en faveur d'une meilleure législation des armes à feu
88.
Enfin, si l'on se rattache au cas du monument vivant, il
existe aussi des initiatives qui ont pris une dimension citoyenne, en faisant
de la mémoire un enjeu qui dépasse les frontières
nationales. C'est par exemple le cas pour le projet Stolpersteine que l'on
pourrait traduire par « pierre trébuchante » 89,
officialisé en 2015. À l'origine de ce projet, l'artiste allemand
Gunter Demnig, créa des pavés en béton couverts d'une
plaque de laiton en mémoire des victimes de la Shoah. Les pavés
sont indicatifs et placés aux derniers endroits de vies des personnes
disparues. À ce jour, 90 000 Stolpersteine ont été
installés, d'après les derniers chiffres de 2022, dans une
vingtaine de pays dont la France (seule la ville de Paris refuse encore
leurs
87 Chagnollaud, J. (2020, 24 février). Aux origines des
printemps arabes. Vie Publique. Consulté le 20 février 2024,
à l'adresse
https://urlz.fr/pBNo
88 March for our Lives. (2018). Consulté le 20
février 2024, à l'adresse https:// marchforourlives.org/
89 Stolpersteine. (s. d.). Consulté le 10 février
2024, à l'adresse
https://www.
stolpersteine.eu/en
106

L'artiste Gunter Demnig à l'oeuvre (c)
107
installations), la Russie ou encore l'Irlande. De plus, le
site web du projet permet de rendre autonomes les personnes souhaitant faire
les démarches afin d'installer ces pavés commémoratifs,
sachant qu'il s'agit encore d'un projet indépendant. Malgré le
fait que le projet et ses contraintes morales restent contrôlées
par l'artiste qui l'a initié, la démarche fait sens pour les
acteurs qui souhaitent faire installer des pavés dans leur village ou
dans leurs villes. Ainsi, ce type de démarche permet d'ouvrir le
débat sur les solutions possibles aux nouveaux enjeux de
réappropriation des lieux de mémoire et de la mémoire en
général.
108
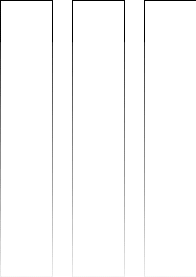
Le point de vue du designer

109
7.1 - Le designer, un acteur social
Selon Alain Findeli, théoricien du design : « La
fin ou le but du design est d'améliorer ou au moins de maintenir
l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. » Cette
citation démontre que le design n'est pas simplement une performance
technique ou esthétique, c'est une discipline résolument
centrée sur des problématiques d'usage qui définissent
ensuite les deux premières dimensions. On parle même aujourd'hui
de « design social » afin de qualifier des méthodes et des
actions concrètes pour résoudre des problèmes du quotidien
à l'échelle des
citoyen.ne.s d'aujourd'hui. Au regard du
phénomène d'augmentation des mouvements sociaux que nous avons vu
précédemment, on peut même se demander s'il y a encore
besoin de designer aujourd'hui ? Si nous ne sommes pas de trop et que les gens
peuvent en fait se débrouiller sans nous ?
Si l'on devait répondre de suite à cette menace
d'extinction, on pourrait essayer de comprendre en quoi les outils et les
méthodes utilisés par les designers peuvent accompagner les
démarches sociales et faciliter l'émancipation des citoyens.ne.s.
Il faut de fait s'intéresser à la « pensée design
» ou au « design thinking », qualifiant un ensemble de
règles de créations qui partent de problématiques d'usages
pour finir par la création d'un produit ou d'un service qui essaye d'y
répondre au mieux. Parmi les caractéristiques de cette
méthodologie, plusieurs
90 Findeli, A. (2015). Le design social. The Complete Works Of
Alain Findeli. Consulté le 20 février 2024, à l'adresse
https://urlz.fr/pCrr
110
décrivent le rôle que le designer peut jouer en
collaboration avec d'autres acteurs sociaux (associations, municipalités
etc.) ou d'autres professions (ingénieur, architecte, analyste etc.)
afin d'améliorer « l'habitabilité du monde ». Dans un
premier temps, les designers « pensent le monde de façon
finalisée ». 90 (Findeli, 2015), c'est-à-dire
qu'ils réfléchissent dans une logique de projet, avec une phase
de conception et une phase de réception. Cela signifie qu'ils mettent
leur image de designer, leur image de « marque » en jeu d'une
certaine manière, car ils s'engagent à respecter un certain
nombre de valeurs qui déterminent leur crédibilité. Il
peut s'agir de préserver l'environnement en utilisant des
matériaux recyclés ou encore de collaborer avec des partenaires
qui assurent une provenance locale de leurs matières premières.
Ces valeurs n'ont aucun intérêt à devenir des promesses,
car les designers imaginent des solutions pour le présent et donc
prennent aussi en compte les problématiques du présent. Mais
surtout, ils ne créent pas des besoins, ils y répondent. Ainsi,
ils possèdent aussi une « expertise d'usage » qu'ils
intègrent directement dans leurs outils de conception. Avant qu'un objet
ou un service soit enfin livré, il est modifié à multiples
reprises en fonction des critiques des usagers à son égard. Cette
dimension permet de garder à l'esprit ce qui est purement «
nécessaire » dans la solution produite et donc de
s'arrêter
111
quand elle devient assez satisfaisante pour répondre au
problème posé à l'origine. Ceci permettant un gain de
temps et une projection facile du produit fini, faisant du designer un
partenaire idéal pour les acteurs sociaux soucieux de provoquer une
amélioration de leurs conditions. À ce titre, l'agence de design
parisienne « Vraiment vraiment » 91, crée des
projets afin de « défendre l'intérêt
général », cela passe par des ateliers afin d'imaginer un
futur plus soutenable avec la participation de
citoyen.ne.s et d'élu.e.s. Ou
encore la création de « fournitures publiques libres », des
objets publics qui se veulent inclusifs et faciles à entretenir dans le
temps.
7.2 - Le designer, un acteur sensible
« Mon métier, par définition, c'est de
faire des objets inertes. Néanmoins, je les dessine pour qu'il se
crée une forme d'attraction, une énergie invisible entre ce que
j'ai produit et une personne qui va la voir ou la posséder. » 92
Mathieu Lehanneur est le designer qui se cache derrière le design de la
future flamme olympique. Dans son travail, la nature et l'instinct ont une
place prépondérante. Chacune
91 Vraiment Vraiment - Design d'intérêt
général. (2023, 6 décembre). Consulté le 20
février 2024, à l'adresse https://vraimentvraiment.com/
92 Maison & Objet. (2023, 21 décembre). Mathieu
Lehanneur - Masterclass Maison&Objet [Vidéo] YouTube.
Consulté le 20 février 2024, à l'adresse https ://
www.youtube.com/watch
?v=x9-4N-v7z2I
112
de ses créations espère pouvoir éveiller
l'instinct primaire qui réside en chacun de nous, celui que chaque
être humain possède indifféremment de son ethnie ou de sa
religion. De cette manière, ses objets dans leurs formes s'inscrivent
dans une démarche biomimétique, c'est-à-dire « qui
imite la nature », à l'image de ses tables « Ocean Memories
» sculptées dans un bloc de marbre et imitant les remous de l'eau
au repos.
Cette démarche rappelle ce que peuvent ressentir
certaines personnes lors de la visite d'un mémorial, un sentiment
étrange ou de malaise, comme si le monument dégageait une sorte
d'aura. Cette dimension a d'ailleurs été relevée par une
personne que j'ai interrogée sur le mémorial de l'abolition de
l'esclavage à Nantes : « La mémoire, c'est aussi ça,
faire parler les fantômes d'une certaine manière, il y a une
dimension spectrale qui peut-être convoquée, quelque part, quand
on consacre un lieu, il y a quelque chose de magique aussi. » 93
Après avoir discuté avec la personne par la suite, j'ai appris
qu'elle était également artiste et anthropologue, ce qui peut
expliquer ce point de vue inhabituel, du moins dans le cadre de mes
interviews.
Cette dimension sensorielle se retrouve aussi aux
balbutiements de l'Histoire du design. En effet, au début
93 D'après une série de 6 interviews menés
au mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes l'après
midi du 21/06/2023
113

Une table de la collection « Ocean Memories»
du
designer Mathieu Lehanneur (c)
114
du XXe siècle est théorisée la Gesfalt
94 (Levanier. J, 2021) par des psychologues allemands, permettant de
comprendre la manière dont les formes sont traitées et comprises
par notre cerveau, sans pour autant l'affirmer comme une science exacte. Cette
théorie sera par la suite reprise et diffusée dans les
années 1930 par des artistes et des designers comme Walter Gropius ou
Vassily Kandinsky. Elle est notamment très parlante pour la pratique du
design graphique, car la maîtrise des codes de la hiérarchie ou de
la complémentarité entre les formes permet de renforcer le sens
d'une image. Depuis, les technologies ont évoluées et l'apport du
numérique en la matière permet aujourd'hui d'imaginer des
expériences multisensorielles, même si la majorité
n'utilise surtout que l'ouïe et la vue, à l'image des casques de
réalité virtuelle.
Ces évolutions permettent aussi de se projeter sur des
pratiques comme « l'affective computing » 95 (Wang et al., 2022) ou
« l'informatique affective », décrivant les capacités
d'un ordinateur à comprendre les émotions
94 Levanier, J. (2021). La théorie de la Gestalt en design
: l'influence de la psychologie sur notre perception. 99designs.
Consulté le 19 février 2024, à l'adresse
https://99designs.fr/blog/conseils-design/theorie-gestalt/
95 Wang, Y., Song, W., Tao, W., Liotta, A., Yang, D., Li, X.,
Gao, S., Sun, Y., Ge, W., Zhang, W., & Zhang, W. (2022). A systematic
review on affective computing : emotion models, databases, and recent advances.
Information Fusion, 83-84, 19-52. Consulté le 19 février 2024,
à l'adresse
https://doi.
org/10.1016/j.inffus.2022.03.009
96 Borsari, A., & Brulé, É. (2016). Le
sensible comme projet : regards croisés. HermèS, n° 74(1),
176.
https://doi.org/10.3917/herm.074.0176
115
humaines et à pouvoir y répondre avec des
émotions adaptées. Cette technologie se base notamment sur des
données physiques (vidéo, audio, texte etc.) et permet par
exemple aux assistants virtuels comme Google Assistant ou Siri d'ajuster leurs
réponses en fonction des émotions de l'utilisateur. Cela peut
aussi être utilisé sur les réseaux sociaux par des
entreprises désireuses de mieux comprendre les commentaires des
consommateurs sur ces produits et ainsi d'améliorer leurs offres. En
dehors de l'application commerciale, la question du design sensoriel permet de
renouveler la pratique en utilisant la physiologie comme moyen de
développer des solutions plus humaines et inclusives : « Le design
sensoriel est complémentaire d'une approche anthropologique pour
répondre à des questions précises [...] mais aussi pour
renouveler l'approche de la matière et la question du rapport au monde.
En effet, l'implication des sens dans la communication, et plus encore
lorsqu'il faut pallier un déficit, est avant tout l'appréhension
d'un environnement en relation avec le corps humain. » 96 (Borsari &
Brulé, 2016). Dans la pratique, nous avons vu que cette conception du
design peut se traduire par un travail inspiré de la nature, à
l'image de Mathieu Lehanneur évoqué
précédemment.
Mais d'autres designers vont plus loin et proposent
116
de mettre le sensoriel au centre de leur travail. L'architecte
et designer Neri Oxman a par exemple créé un masque
imprimé en 3D, le Lazarus, immortalisant le dernier souffle d'une
personne décédée, le masque transparent
révélant alors une sorte de fluide de couleurs figé
97. Ce projet est une réinterprétation moderne du
masque de mort et permet également d'imaginer les futures pratiques
funéraires et mémorielles.
97 Oxman, N. (2016). Lazarus. Oxman. Consulté le 19
février 2024, à l'adresse
https://oxman.com/projects/lazarus

117
Le masque Lazarus, par Neri Oxman (c)
118
PENSER LA MÉMOIRE AUTREMENT
Conclusion
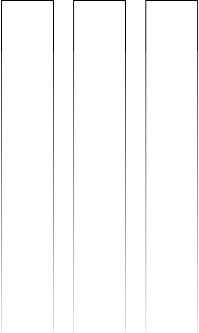
119
Cette partie finale nous aura permis de voir que la
préservation de la mémoire est aussi bien un acte sensible que
collectif. Et même si le numérique permet aujourd'hui de
renouveler le patrimoine commémoratif en rendant les mémoriaux
vivants, il y a toujours une nécessité de préserver nos
monuments physiques. Les stèles, les plaques, les statues permettent un
apport sensoriel unique qui va de pair avec l'apprentissage de leurs histoires.
Le designer, malgré les multiples casquettes que l'on peut lui donner,
est aussi un acteur sensible dont le travail est centré sur l'humain. En
plus des collaborations menées sur le terrain de la citoyenneté,
la méthodologie du designer pourrait aussi aider à la
préservation de la mémoire.
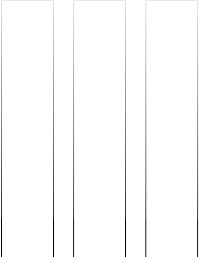
120
SYNTHESE
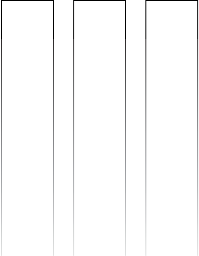
121
Winston Churchill disait qu'un peuple qui oublie son
passé est condamné à le revivre, d'autant que depuis les
années 90, et la résurgence des mémoires de la Shoah, la
préservation de la mémoire et la condamnation de l'oubli n'ont
jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui.
L'impératif d'un « devoir de mémoire » s'est
créé envers le passé, et chaque mémoire demande
à être ressuscitée. Le citoyen qui est au coeur de ce
processus de transmission mémorielle dispose désormais des outils
numériques afin d'archiver le passé et de construire la
mémoire du futur. Des outils qui restent cependant à
maîtriser au regard de leur puissance et de leur instrumentalisation par
les grandes entreprises du secteur. Ces modifications du statut du citoyen
s'accompagnent aussi d'une transformation des pratiques mémorielles,
basculant vers une transmission et un apprentissage qui se font par
l'expérience vécue plutôt que par l'expérience
transmise. Les flux de données ininterrompus connectent les individus au
reste du monde et incitent les acteurs mémoriels comme les touristes
à voir de leurs propres yeux les effets du réchauffement
climatique (doomsday tourism, tourisme de l'apocalypse) ou encore ceux des
écarts de richesses et de la pauvreté dans le monde (slum tourism
ou tourisme de la pauvreté). Cela s'applique par conséquent au
tourisme de mémoire, en proie à un engouement important depuis
quelques années. Ce secteur évolue afin de proposer des
expériences qui invitent à s'immerger toujours plus dans le
passé. Cette médiation plaît à un réseau
d'acteurs mémoriels qui cherchent, par
122
l'émotion et l'incarnation de personnages historiques,
à mieux comprendre le passé. Cela démontre une
volonté de se réapproprier les lieux de mémoire et
l'histoire qu'ils racontent, aussi par des pratiques qui peuvent sortir du
cadre moral de ces mêmes lieux. L'écriture de l'histoire est aussi
une des préoccupations des politiques nationales aujourd'hui. Cependant,
ces politiques sont souvent source de controverses à cause d'un «
devoir de mémoire » excessif et instrumentalisé. Ainsi, cela
complique d'une certaine manière le travail du citoyen, qui cherche
à trouver le sens dans les événements et les acteurs du
passé. Donc finalement, en se demandant pourquoi et non pas comment
commémorer. Afin d'accompagner ces actions, le designer peut avoir son
rôle à jouer, d'une part grâce à des outils
méthodologiques favorisant les actions sociales, et d'autre part par une
approche sensorielle qui s'adapte aux récits des lieux de
mémoire. Alors, afin de commencer ce travail de collaboration, nous
pourrions nous demander comment le designer pourrait encourager une
réappropriation citoyenne des lieux de mémoire afin de
préserver notre héritage mémoriel avec pédagogie ?
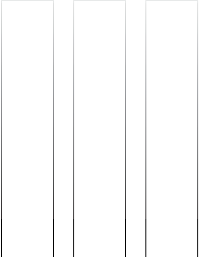
123
RÉFÉRENCES
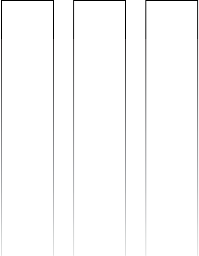
124
Articles en ligne
· Aloing, C. (2016). La sousveillance. Vers un
renseignement ordinaire. Hermès, la revue, 76, 68-73. consulté le
16 novembre 2023, à l'adresse,
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2016-3-page-68.htm
· ARDC. (2022, 13 mai). Metadata. ARDC (Australian Research
Data Commons). Consulté le 7 février 2024, à l'adresse
https://ardc.edu.au/ resource/metadata/
· Arcom. (s. d.). Kit pédagogique du citoyen
numérique : retrouvez toutes les ressources. Arcom le Régulateur
de la Communication et Numérique. Consulté le 8 février
2024, à l'adresse
https://shorturl.at/sCHM9
· Aucher.L, (2018).«Devant le mémorial,
derrière le paradoxe», Géographie et cultures, 105, 11-30.
consulté le 26 juin 2023, à l'adresse,
https://journals.
openedition.org/gc/6351
· Aurell, J. A. I. (2017). L'ego-histoire en perspective :
réflexions sur la nature d'un projet historiographique ambitieux.
Cahiers De Civilisation Medievale, 238, 125-138. consulté le 15 novembre
2023, à l'adresse,
https://doi.
org/10.4000/ccm.1884
· Baillargeon, T. (2016). Le tourisme noir :
l'étrange cas du Dr Jekyll et de M. Hyde. Teoros, 35. consulté le
18 février 2024, à l'adresse
http://journals.
openedition.org/teoros/2839
· Babinet, G. (2015). Big Data, penser l'homme et le monde
autrement [Pombo.free]. Le Passeur éditeur. http ://
pombo.free.fr/babinet2015.pdf
· Baralon, M. (2024, janvier 29). Johann Chapoutot : «
Ce film est à la pointe de ce qui se fait en sciences humaines sur la
Shoah » . Trois Couleurs. Consulté le 18 février 2024,
à l'adresse
https://urlz.fr/pACh
· Benbassa, E. (2005). Regain antisémite : faillite
du devoir de mémoire ? Médium, 2, 3-15. consulté le 16
novembre 2023, à l'adresse,
https://www.
librairiemartelle.com/ebook/9791095192718-medium-n-2-janvier-mars-2005-collectif/
· Beaudouin, V. (2019). Comment s'élabore la
mémoire collective sur le web ? Réseaux, n° 214-215(2),
141-169.
https://doi.org/10.3917/res.214.0141
125
· Binik, O. (2016). Dans les terres sauvages à la
recherche du sublime. La dimension émotionnelle du tourisme sombre.
Teoros, 35.
http://journals.
openedition.org/teoros/2844
· Borsari, A., & Brulé, É. (2016). Le
sensible comme projet : regards croisés. HermèS, n° 74(1),
176.
https://doi.org/10.3917/herm.074.0176
· Briant, E., Bechet, M., Machemehl, C., & Suchet, A.
(2020). Utopies d'un tourisme en renouvellement. Teoros, 39(3). consulté
le 17 février 2024, à l'adresse
http://journals.openedition.org/teoros/7312
· Cailloce, L. (2014, 18 septembre). Comment se construit
la mémoire collective ? CNRS Le journal, consulté le 18 novembre
2023,
https://
lejournal.cnrs.fr/articles/comment-se-construit-la-memoire-collective
· Canopé. (s. d.). La « concurrence
mémorielle » . Consulté le 20 novembre 2023, à
l'adresse
https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/la-concurrence-memorielle.html
· Chagnollaud, J. (2020, 24 février). Aux
origines des printemps arabes. Vie Publique. Consulté le 20
février 2024, à l'adresse
https://urlz.fr/pBNo
· Chevalier.D, Lefort.I.(2016) Le touriste,
l'émotion et la mémoire douloureuse, Carnets de
géographes, consulté le 26 juin, à l'adresse,
https://
doi.org/10.4000/cdg.644
· Chevalier, Y. (2000). Wieviorka (Annette), L'Ère
du témoin. Archives des Sciences Sociales des Religions, 110, 110.
Consulté le 19 novembre 2023, à l'adresse
https://doi.org/10.4000/assr.20611
· Commission générale de terminologie et de
néologie Vocabulaire de l'informatique, mégadonnées (2014,
août 22). Journal officiel de la République française, 89.
Consulté le 10 février 2023, à l'adresse
https:// urlz.fr/pEXs
· Cotte, D. (2017). La culture numérique entre
l'appréhension de l'oubli et la fabrication de la mémoire -
K@iros. Kairos, 2(2). Consulté le 19 novembre 2023, à l'adresse,
https://revues-msh.uca.fr/kairos/index.php?id=213
· Crahay, F. (2015). Tourisme mémoriel.
Témoigner Entre Histoire et Mémoire, 117, 151-152.
Consulté le 17 février 2024, à l'adresse
https://
journals.openedition.org/temoigner/1215
126
· Duclos-Grisier, A. (2021, 3 mai). Lois mémorielles
: la loi, la politique et l'Histoire. Vie publique Consulté le 15
février 2024, à l'adresse https ://
urlz. fr/pz2D
· Duclos-Grisier, A. (2023, 16 mars). Guerre
d'Algérie : quelle célébration du 19 mars 1962 ? Vie
Publique. Consulté le 16 février 2024, à l'adresse
https:// urlz.fr/c87F
· CNIL. (2016, 23 mai). CHAPITRE III - Droits de la
personne concernée. Consulté le 7 février 2024, à
l'adresse
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17
· Engelking B. (2018). Des rêves comme source pour
l'histoire de l'Holocauste ?. Vingtième Siècle. Revue d'histoire,
139, 94-109, consulté le 14 novembre 2023,
https://doi.org/10.3917/ving.139.0094
· Eijgelaar, E., Thaper, C., & Peeters, P. (2010).
Antarctic cruise tourism : the paradoxes of ambassadorship, «last chance
tourism» and greenhouse gas emissions. Journal Of Sustainable Tourism,
18(3), 337-354. Consulté le 17 février 2023, à l'adresse
https://doi.org/10.1080/09669581003653534
· Élysée. (2024, 7 février).
Cérémonie d'hommage national aux victimes françaises des
attaques terroristes du 7 octobre en Israël. Élysée.
Consulté le 12 février 2024, à l'adresse
https://urls.fr/UNpM5q
· Elysée. (2021, 20 janvier). Remise du rapport sur
la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie.
Consulté le 15 février 2024, à l'adresse
https://urlz.fr/pERC
· Findeli, A. (2015). Le design social. The Complete Works
Of Alain Findeli. Consulté le 20 février 2024, à l'adresse
https://urlz.fr/pCrr
· Forero Mendoza, S., Hohlfeldt, M., & Peyraga, P.
(2023). L'art en partage citoyen : introduction [Hal open science]. Dans L'art
en partage citoyen (p. 9-24). Orbis Tertius.
https://hal.science/hal-04293401
· Gensburger, S. (2002). Les figures du juste et du
résistant et l'évolution de la mémoire historique
française de l'occupation. Revue de science politique, 52, 291-322.
consulté le 16 novembre 2023, à l'adresse,
https://www.cairn.
info/revue-francaise-de-science-politique-2002-2-page-291.htm
127
· Jacquot.S, Chareyron.G, Cousin.S. (2018) Le tourisme de
mémoire au prisme du « big data ». Cartographier les
circulations touristiques pour observer les pratiques mémorielles,
Mondes du Tourisme. Consulté le 26 juin, à l'adresse,
https://doi.org/10.4000/tourisme.1713
· Julien, E. (2016, 29 septembre). La loi du 25 octobre
1919 et sa postérité. Le Souvenir Français.
Consulté le 13 février 2024, à l'adresse
https://le-souvenir-francais.fr/la-loi-du-25-octobre-1919-et-sa-posterite/
· Lalieu, O. (2022, 30 juin). Destruction du Vél'
d'Hiv' : pourquoi préserver des lieux de mémoire authentiques ?
Vie publique, au coeur du débat public. Consulté le 23 août
6apr. J.-C., à l'adresse https://www.vie-publique.fr/
parole-dexpert/285526-destruction-du-vel-dhiv-preserver-des-lieux-de-memoire-authentiques
· Lennon, J., & Foley, M. (2000). Dark tourism the
attraction of death and disaster [Internet archives]. London ; New York :
Continuum. Consulté le 14 février 2023, à l'adresse
https://archive.org/details/darktourism0000lenn
· Lapid .Y.(2018) «Pédagogie des lieux de
mémoire
et responsabilisation», Témoigner. Entre histoire
et mémoire, 126, 79-91. consulté le 26 juin 2023, à
l'adresse,
https://doi.org/10.4000/temoigner.7238
· Ledoux, S. (2023, 12 mai). Les politiques
mémorielles en France depuis les années 1990 Vie publique
Consulté le 12 novembre 2023, à l'adresse https ://
urlz.fr/pyHJ
· Le faisceau de licteur. (2022, 15 décembre).
Élysée. Consulté le 6 février 2024, à
l'adresse https ://
www.elysee.fr/la-presidence/le-faisceau-de-licteur
· Le Parisien. (2023, 17 avril). Selfies : le
mémorial d'Auschwitz rappelle à l'ordre ses visiteurs
tentés de prendre la pose. Le Parisien. Consulté le 18
février 2024, à l'adresse
https://urlz.fr/pALH
· Levanier, J. (2021). La théorie de la Gestalt en
design : l'influence de la psychologie sur notre perception. 99designs.
Consulté le 19 février 2024, à l'adresse
https://99designs.fr/blog/conseils-design/theorie-gestalt/
· Mann, S. (2004). « Sousveillance » : inverse
surveillance in multimedia imaging. ACM Multimedia, 620-627.
https://doi.
org/10.1145/1027527.1027673
128
· Mémoires des hommes. (2022, 4 juillet). Victimes
des massacres d'Oran le 5 juillet 1962. Mémoire des Hommes.
Consulté le 16 février 2024, à l'adresse
https://urlz.fr/pzMD
· Michel, A. (2014). Geoffrey Grandjean et
Jérôme Jamin, La concurrence mémorielle. Témoigner,
117, 140-142. consulté le 16 juin 2023, à l'adresse,
https://doi.org/10.4000/temoigner.833
· Noël P.M. (2011). Entre histoire de la
mémoire et mémoire de l'histoire : esquisse de la réponse
épistémo-logique des historiens au défi mémoriel en
France. Conserveries mémorielles. 9. consulté le 14 novembre
2023, à l'adresse,
http://journals.openedition.org/cm/820
· Pellistrandi, J. (2019). Devoir de mémoire :
comment le définir aujourd'hui ? Revue défense nationale, 816,
9-11. consulté le 11 juin 2023, à l'adresse,
https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2019-1.htm
· Petitier, P. (1989). Les Lieux de mémoire, sous la
direction de P. Nora. Romantisme, 63, 103-110. consulté le 15 novembre
2023, à l'adresse,
https://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1989_num_19_63_5570
· Préfet du Nord. (s. d.). Cérémonies
officielles & protocole. Les Services de L'État Dans le Nord.
Consulté le 15 février 2024, à l'adresse https://urlz.fr/
pzgJ
· Rioux, J. (2010). À propos du « devoir de
mémoire » . Inflexions, 13, 41-49. consulté le 11 juin 2023,
à l'adresse,
https://www.cairn.info/revue-inflexions-2010-1-page-41.htm?contenu=article
· Rousso, H. (2007). Vers une mondialisation de la
mémoire. Vingtième Siècle. Revue d'histoire. 94.3-10,
consulté le 26 juin 2023, à l'adresse,
https://doi.org/10.3917/ving.094.0003
· Team Qwant. (2023, 7 décembre). Comment vivre sans
Google : les alternatives qui protègent ta vie privée. Qwant.
Consulté le 7 février 2024, à l'adresse
https://urls.fr/fqFHxR
· Team Qwant. (2024, 23 janvier). Pourquoi c'est important
de protéger sa vie privée en ligne ? Qwant. Consulté le 7
février 2024, à l'adresse
https://urls. fr/Cpqew3
129
· Trouche, D. (2015, 7 janvier). Du monument aux morts au
mémorial. Hypothèses. Consulté le 14 février 2024,
à l'adresse
https://sms.hypotheses.
org/4652
· Tudesq, A. (2007). Histoire et mémoire : une
relation ambiguë et
contradictoire Dans Presses universitaires de Bordeaux eBooks
(p. 97-106). consulté le 14 novembre 2023, à l'adresse https ://
doi.org/10.4000/books.
pub.26371
· Tyng, C. M., Amin, H. U., Saad, M. N. M., & Malik, A.
S. (2017). The Influences of Emotion on Learning and Memory. Frontiers In
Psychology, 8. consulté le 19 février 2024, à l'adresse
https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2017.01454
· Villoz, L. (2017, août 23). « Il y a une
compétition entre les différents visiteurs sur les lieux de
mémoire » .
Réformés.ch.
Consulté le 23 juin 2023, à l'adresse
https://www.reformes.ch/story/2017/08/il-y-une-competition-entre-les-differents-visiteurs-sur-les-lieux-de-shoah-dossier
· Wang, Y., Song, W., Tao, W., Liotta, A., Yang, D., Li,
X., Gao, S., Sun, Y., Ge, W., Zhang, W., & Zhang, W. (2022). A systematic
review on affective computing : emotion models, databases, and recent advances.
Information Fusion, 83-84, 19-52. Consulté le 19 février 2024,
à l'adresse
https://doi.
org/10.1016/j.inffus.2022.03.009
· Yazbek. E. (2011). Histoire, mémoire et fiction
dans le cinéma américain contemporain, Conserveries
mémorielles. 9. consulté le 14 novembre 2023, à l'adresse,
http://journals.openedition.org/cm/832
· Zalc, C. (2018). Passages de témoins.
Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 139, 2-21. consulté le
15 juin 2023, à l'adresse
https://doi.org/10.3917/
ving.139.0002
130
Livres
· Brice, C. (2008). Monuments : pacificateurs ou agitateurs
de mémoire. Dans : Pascal Blanchard éd., Les guerres de
mémoires: La France et son histoire. Enjeux politiques, controverses
historiques, stratégies médiatiques (pp. 199208). Paris: La
Découverte.
· Benbassa, E. (2008). À qui sert la guerre des
mémoires ?. Dans : Pascal Blanchard éd., Les guerres de
mémoires: La France et son histoire. Enjeux politiques, controverses
historiques, stratégies médiatiques (pp. 252-261). Paris: La
Découverte.
https://doi.org/10.3917/dec.blanc.2008.01.0252
· Castra.M. (2013), « Socialisation », in Paugam
Serge (dir.), Les 100 mots de la sociologie, Paris, Presses universitaires de
France, coll. « Que Sais-Je ? », p. 97-98. consulté le 15
novembre 2023, à l'adresse,
https://journals.
openedition.org/sociologie/1992
· Constant, P. (2018). Modèles économiques
des GAFAM et vie privée. Dans Santé, numérique et droit-s
(p. 307-318).
https://doi.org/10.4000/books.
putc.4463
· David, F. (2013). Comprendre le monument aux morts
[OpenEditionBooks]. Codex. consulté le 10 septembre 2023, à
l'adresse
https://doi.org/10.4000/
books.codex.967
· Halbwachs, M. (1950). La mémoire collective (2e
éd.) [Édition numérique]. Paris : Les Presses
universitaires de France, consulté le 18 novembre 2023, à
l'adresse,
https://shorturl.at/gGVW6
· Nora, P. (1984). Les Lieux de mémoire T.1 : La
République (Vol. 1). Gallimard.
· Prost, A., & Nora, P. (1984). Les monuments aux
morts. Dans Les Lieux de mémoires, La République, La Nation (Vol.
1). Gallimard.
· Sion Brigitte, 2013, « Le Mémorial de la
Shoah à Berlin : échec et succès », in Denis
Peschanski (dir.), Mémoire et mémorialisation, vol. 1, Paris,
Hermann, p. 279-293.
131
Ensemble de données
· Dabi, F., & Legrand, F. (2022), Le regard des jeunes
sur la Shoah : connaissance, représentations et transmission, IFOP,
consulté le 14 novembre 2023,
https://www.ifop.com/publication/le-regard-des-jeunes-sur-la-shoah-connaissance-representations-et-transmission-2/
· Data Never Sleeps 10.0. (2022). DOMO. Consulté le
6 février 2024, à l'adresse https ://
www.domo.com/data-never-sleeps
· OED. (2021). Chute de la fréquentation des lieux
de mémoire des conflits contemporains en 2020. Dans Ecodef.
Consulté le 14 septembre 2023, à l'adresse
https://urlz.fr/pAkc
· Insee, & Bloch, K. (2022, 17 novembre).
Élections présidentielle et législatives de 2022 : seul un
tiers des électeurs a voté à tous les tours[Base de
données]. INSEE. Consulté le 11 février 2024, à
l'adresse
https://www.
insee.fr/fr/statistiques/6658145
· Orbel, L., Costet, J., Falaize, B., Alexandre, Mericskay,
& Mut, K. (2003). Entre mémoire et savoir : l'enseignement de la
shoah et des guerres de décolonisation. Dans Rapport de recherche de
l'équipe de l'Académie de Versaille. INRP.
· Prené, L. (2023). Avec la fin des restrictions
sanitaires, la fréquentation des lieux de mémoires des conflits
contemporains bondit en 2022. Dans Ecodef. Consulté le 15 janvier 2024,
à l'adresse
https://urlz.fr/pAkc
· WeDoData. (2014). Guerre 14-18 : une population
transformée [Base de données ; Infographie en ligne]. Dans 14-18,
un monde en guerre.
https:// shorturl.at/dhrV1
· Wyckaert, M., & Mansueto, A. (2020). 15,2 millions
d'entrées dans les lieux de mémoires des conflits contemporains
en France en 2019. Dans Ecodef. Consulté le 14 septembre 2023, à
l'adresse
https://urlz.fr/pAkc
132
Conférences
· Dalisson, R. (s. d.). L'impossible commémoration
de la guerre d'Algérie (De 1962 à nos jours) | Canal U. Dans
Canal-U [Rediffusion]. Université de Roue, Rouen, Normandie, France.
Consulté le 26 juillet 2023, à l'adresse,
https://urlz.fr/pDrP
· Ganascia, J. (s. d.). Le futur de la mémoire
à l'heure du numérique et de ChatGPT [Rediffusion]. Dans WebTV.
Semaine de la mémoire, Lille, Haut de France, France.
https://urlz.fr/ox0S
· Nantes Digital Week, & MOBETIE, M. (s. d.). Les arts
numériques racontent l'Histoire - Nantes Digital Week. Dans Nantes
Digital Week. Nantes digital week, Nantes, Pays de la loire, France.
https://
nantesdigitalweek.com/evenements/arts-numeriques-histoire/
Vidéos
· Blow Up, l'actualité du cinéma (ou presque)
- ARTE. (2019, 20 mars). Face à l'Histoire : La guerre d'Algérie
- Blow up - ARTE [Vidéo]. YouTube. Consulté le 26 juin 2023,
à l'adresse, https://www.youtube.com/ watch?v=LlP1nS8K5gQ
· Le Monde. (2023, 16 mars). « Nous sommes en guerre
» : le discours de Macron face au coronavirus (extraits) [Vidéo].
YouTube, consulté le 18 novembre 2023,
https://www.youtube.com/watch?v=N5lcM0qA1XY
· Le Monde. (2023, 30 décembre). Mia Schem et Chen
Almog-Goldstein, ex-otages israéliennes racontent leur captivité
à Gaza [Vidéo]. YouTube. Consulté le 12 février
2024, à l'adresse https://www.youtube.com/ watch?v=NlPUzbO65oQ
· Maison&Objet. (2023, 21 décembre). Mathieu
Lehanneur - Masterclass Maison&Objet [Vidéo]. YouTube.
Consulté le 20 février 2024, à l'adresse
https://www.youtube.com/watch?v=x9-4N-v7z2I
· Quitterie Ithurbide. (2018, 30 octobre). express
Quitterie Ithurbide DEF 4mb s [Vidéo]. YouTube. Consulté le 17
octobre 2023, à l'adresse
https://www.
youtube.com/watch?v=Uo_AkyCZQKY
133
· SGA du ministère des Armées. (2022, 12
décembre). [De la mémoire à l'Histoire] Comprendre la
Journée nationale d'hommage du 5 décembre [Vidéo].
YouTube. Consulté le 16 février 2024, à l'adresse
https://www.
youtube.com/watch?v=CTB6fLSrL1Q
· VLAN ! (2023, 13 juin). # 268 Comment le Design influence
votre comportement avec Mathieu Lehanneur [Vidéo]. YouTube.
Consulté le 11 septembre 2023, à l'adresse
https://www.youtube.com/ watch?v=5jqjlhynKZY
Sites webs
· Arromanches 360. (2024, 17 janvier). Le cinéma
360° - Arromanches 360. Consulté le 17 juillet 2023, à
l'adresse
https://www.arromanches360.fr/le-lieu/le-cinema-360/
· Belaubre, P. (Réalisateur). (2023). La BNF en
chiffres. BnF - Site institutionnel. Consulté le 19 novembre 2023,
à l'adresse, https://urlz.fr/ owUK
· Clermont-Ferrand, G. (s. d.). Pensées de Blaise
Pascal. Consulté le 19 novembre 2023, à l'adresse
http://www.penseesdepascal.fr/XXVI/XXVI6-moderne.php
· Freedman, D. (2017). TapCompose. TapCompose.
Consulté le 8 février 2024, à l'adresse
https://www.tapcompose.com/
· Gerz, J. (s. d.). Le monument vivant de Biron. Jochen
Gerz. Consulté le 19 février 2024, à l'adresse
https://jochengerz.eu/works/le-monument-vivant-de-biron
· INA. (s. d.). Collection Mémoires de la Shoah -
Grands entretiens patrimoniaux. Consulté le 19 novembre 2023, à
l'adresse
https://entretiens.
ina.fr/memoires-de-la-shoah
· Internet Archives. (2001). Wayback Machine.
Consulté le 8 février 2024, à l'adresse
https://archive.org/
134
· March for our Lives. (2018). Consulté le 20
février 2024, à l'adresse https:// marchforourlives.org/
· Le concept - Baludik. (2023, 17 octobre). Baludik.
Consulté le 13 novembre 2023, à l'adresse
https://baludik.fr/concept/
· Lehanneur, M. (s. d.). Mathieu Lehanneur | Ocean
Memories, Low Table. Mathieu Lehanneur. Consulté le 4 octobre 2023,
à l'adresse
https://www.
mathieulehanneur.fr/project/ocean-memories-low-table-232
· Les monuments aux morts, France, Belgique, autre pays.
(s. d.). Consulté le 23 octobre 2023, à l'adresse
https://monumentsmorts.univ-lille.fr//
· Oxman, N. (2016). Lazarus. Oxman. Consulté le 19
février 2024, à l'adresse
https://oxman.com/projects/lazarus
· Stolpersteine. (s. d.). Consulté le 10
février 2024, à l'adresse
https://www.
stolpersteine.eu/en
· Vimy : Mémorial vivant. (2022, 9 avril).
Consulté le 19 novembre 2023, à l'adresse
https://livingmemorialvivant.ca/
· Vraiment Vraiment - Design d'intérêt
général. (2023, 6 décembre). Consulté le 20
février 2024, à l'adresse https://vraimentvraiment.com/
Réseaux sociaux
· Murphy, M [@MariaRMGBNews]. (2023, 15 avril). Today I had
one of the most harrowing experiences of my life [Tweet]. X.
https://urlz.fr/pD12
Images
· Demnig.K (inconnu) [photographie], Stolpersteine,
https://www.
stolpersteine.eu/en/gallery
· Hartmann. C (2021) [photographie], AFP,
https://urlz.fr/pEWe
135
· Inconnu (inconnu) [photographie], Mathieu Lehanneur,
https://www.
mathieulehanneur.fr/project/ocean-memories-low-table-232
· Inconnu (inconnu) [photographie], Chernibyl story tours,
https://
chernobylstory.com/photo-video/
· Thierry M.A (inconnu) [photographie], Cinéma
circulaire Arromanches,
https://www.normandie-tourisme.fr/les-incontournables/arromanches/
· Zadelhoff, D (2016), Child with Lazarus mask
[photographie], OXMAN,
https://oxman.com/projects/lazarus
Rapports
· Aschieri, G., & Popelin, A. (2017). Réseaux
sociaux numériques : comment renforcer l'engagement citoyen ? Journeaux
Officiels. Consulté le 9 février 2024, à l'adresse
https://urlz.fr/pEHW
Observations
· Gourmaud. P, observations et photographies sur 3 lieux de
mémoires nantais, l'après midi du 08/07/2023, Nantes
Ces observations m'ont permis de comprendre comment les
lieux de mémoire, et plus particulièrement les monuments aux
morts, sont utilisés aux quotidiens, sachant qu'ils sont
intégrés à l'espace urbain.
· Gourmaud. P, observations et photographies sur le
mémorial de la guerre 14-18 près du cimetière du
Père Lachaise, la matinée du 29/09/2023, Paris
Ces observations ont confirmé plusieurs points
déjà relevés lors de mes observations
précédentes à Nantes, comme l'ignorance des monuments.
Mais elles m'ont aussi permis d'identifier de nouveaux comportements, comme la
création de contenu se basant sur l'expérience de la visite de ce
monument
136
Interviews
· GOURMAUD.P, séries de 6 interviews de visiteurs
aléatoires au mémorial pour l'abolition de l'esclavage,
l'après midi du 21/06/2023, Nantes
Ces séries d'interviews m'ont permis de comprendre
les sentiments ambivalents que les visiteurs peuvent ressentir lors de la
visite d'un lieu de mémoire, d'avoir leur point de vue sur la notion de
« devoir de mémoire » et également de connaître
leur point de vue sur l'arrivée des nouvelles technologies dans le
tourisme de mémoire.
· GOURMAUD.P, séries de 7 interviews de visiteurs
aléatoires au monument aux morts de la guerre 14-18, l'après midi
du 26/09/23, Nantes quai Ceineray
Pour cette nouvelle série d'interviews, je voulais
comprendre l'utilité de la physicalité du monument aux morts en
interrogeant les passants à proximité. En leur faisant toucher
différents échantillons de matière, j'ai pu comprendre que
la pierre est un matériau aux yeux de chacun des interviewés,
perçu comme robuste, révélateur du temps qui
passe.
137



