|

Présenté par : Sous la direction de :
M. Soudjay MAOULIDA Dr Adama SOW BADJI
UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
(UCAD)
MEMOIRE DE FIN DE CYCLE
Pour l'obtention du Diplôme de Master
II
METHODES STATISTIQUES ET ECONOMETRIQUES
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
(FASEG)
Département d'Analyse et Politique
Economique
Thème :
Maitre de conférences titulaire à
l'UCAD
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
DEDICACES
Je dédie ce travail :
? A mon regretté père SOUDJAY Athoumani, qui
nous a quitté très tôt (qu'ALLAH l'accueille dans son
Paradis Eternel !)
? A ma vaillante mère ZALHATA M'madi Mtsahoi, pour son
affection, son soutien et ses sacrifices pour la réussite de ma
vie
? A ma soeur ECHATA Soudjay pour son encouragement et son
soutien financier durant le déroulement de ma formation
? A Mohamed AMINA
? A tous mes frères et soeurs de ma famille
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY I
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
REMERCIEMENTS
Ce mémoire est le fruit d'un travail longtemps
réfléchi et produit grâce aux efforts et sacrifices que
j'ai fourni pendant une longue durée. C'est le resultat de mon cursus
universitaire. Toutefois, il n'aurait sans doute pas vu le jour sans le
concours de beaucoup de personnes.
Je tiens à remercier tout d'abord le Tout Puissant
Allah qui m'a donné la force physique, morale, intellectuelle, le
courage et la santé pour achever ce noble travail.
Sont nombreux à pouvoir contribuer à la
réalisation de ce document qui constitue mes premiers pas vers la
recherche. Je tiens à leurs exprimer, à travers ces quelques
lignes toute ma
reconnaissance.
+ A ma chère encadreur Adama SOW BADJI, Maitre de
conférences Titulaire à l'UCAD, pour sa
générosité, sa simplicité d'approche et ses
précieux conseils. Ses encouragements, sa compréhension et son
engagement nous ont permis de réaliser ce présent travail et nous
lui en sommes très reconnaissants. Elle restera toujours une
référence et un guide pour nous.
+ Au responsable du Master, Fodiyé Bakary DOUCOURE,
Professeur agrégé à l'Université Cheikh Anta Diop
de Dakar pour sa simplicité et sa disponibilité à
l'égard des étudiants.
+ A tous les enseignants du Master MSE et aux personnels de
l'administration.
+ A mes Parents qui sont physiquement loin mais
très proches du coeur, pour le soutien sans faille qu'ils apportent
à mon égard durant mes études.
+ A ma famille Sénégalaise, Mme Fanta
Ciré Samaté qui m'a accueillie comme un de leur
+ Je remercie également toute ma famille sans oublier
mes nièces et mes neveux
+ Un grand merci à mes frères AHMED Soudjay,
YOUSSOUF Moindzé, RADJAB
Soudjay, SAID Soudjay et ELAMINE Soudjay pour leurs
encouragement
+ Egalement à mes soeurs ECHATA Soudjay, FATIMA
Soudjay et MARIAMA Soudjay
+ A tous mes camarades de la FASEG
+ A Mme Fatima Ahmed Ben Mhoumadi et son mari
+ A toutes les personnes qui ont, de près ou de loin,
contribué à la rédaction de ce
mémoire.
+ A tous mes amis (es), mes promotionnels (elles) dont il
serait difficile de les énumérés
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY II
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY III
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
SIGLES ET ACRONYMES
AGIR : Alliance Globale pour la
Résilience
ANSD : Agence National de la Statistique et
de la Démographie
BAD : Banque Africaine de
Développement
BCEAO : Banque Centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest
BIT: Bureau International de Travail
BM : Banque Mondiale
|
BTP : CEA :
|
Bâtiment et Travaux Publics
Commission économique pour l'Afrique des Nations unie
|
CEDEAO : Communauté Économique Des
États De L'Afrique De L'Ouest
CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire en Afrique Centrale
CIC : Courbe d'Incidence de la Croissance
|
CILSS :
|
Comité permanent Inter Etats de Lutte contre la
Sècheresse dans le Sahel
|
CPP : Croissance de la Population
DOUV : Degré d'Ouverture
DSRP: Document Stratégique de
Réduction de la Pauvreté
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY IV
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
ECOWAP : Politique Agricole de la CEDEAO
EMOP : Equipe Mobile d'Ouvriers
Professionnels
FCFA : Franc de la Communauté
Financière Africaine
FMI : Fond Monétaire Internationale
GINI : Indice de GINI
IADM : Initiative Allégement de la
Dette Multilatérale
IBW : Institutions de Bretton woods
IED : Investissements Etrangers Directs
LAC : Amérique Latine et les
Caraïbes
MCG : Moindre Carré
Général
MCO : Moindre Carré Ordinaires
MCG Moindre Carré
Général
NASAN : Nouvelle Alliance pour la
Sécurité Alimentaire et la Nutrition
NEPAD : Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique
OCDE : Organisation de Coopération et
de Développement Economique
ODD : Objectifs de Développement
Durable
OMD : Objectifs du Millénaire pour le
Développement
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY V
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
ONU : Organisation des Nations Unies
PAS : Programme d'Ajustement Structurel
PAU : Politique Agricole de l'UEMOA
PDDAA : Programme Détaillé de
Développement de l'Agriculture Africaine
PGF : Productivité Globale des
Facteurs
PIB : Produit Intérieur Brut
PIBh : Produit Intérieur Brut par
habitant
PME : Petites et Moyennes Entreprises
PMI : Petites et Moyennes Industries
PNB : Produit national brut
PNIA : Programmes Nationaux d'Investissements
Agricoles
PNUD : Programme des Nations unies pour le
développement
PPA : Parité de Pouvoir d'Achat
PPTE : Pays Pauvres Très
Endettés
PRIA : Programme Régional
d'Investissements Agricoles
PRSA : Programme Régional pour la
Sécurité Alimentaire
SRP : Stratégies de Réduction
de la Pauvreté
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
TBS : Taux Brut de Scolarisation
TMMI : Taux de Mortalité Maternelle et
Infantile
TRC : Transparence Responsabilité et
Corruption
UEMOA : Union Monétaire et Ouest
Africain.
US : United States
WDI : Base de données de la Banque
mondiale
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY VI
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX Liste des figures
Figure 1: Evolution de l'incidence de la
pauvreté dans les Etats de l'UEMO 10
Figure 2: Décomposition des variables
affectant la distribution et la pauvreté en effet
distributif et de croissance
25
Figure 3: Test de corrélation du PIB/hab
sur le taux de la pauvreté au seuil de 1,90$ par
jour 46
Liste des tableaux
Tableau 1 : Taux brut de scolarisation (en %)
12
Tableau 2: Estimations de l'élasticité
de la croissance de la pauvreté et du taux de
croissance du PIB requis pour réduire
l'incidence de la pauvreté de 4 % par an. 15
Tableau 3 : Statistique descriptive des variables du
modèle 41
Tableau 4: Impact de la croissance sur la
pauvreté avec l'indice du Ratio de la population pauvre disposant de
moins de 1.90$ par jour (2011 PPA) en % de la
population nationale 42
Tableau 5: Matrice de corrélation des
variables du modèle 45
Tableau 6: Effet de la croissance sur la
pauvreté avec l'indice de l'écart de
pauvreté
à 1,90 $ par jour (2011 PPP)
47
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY VII
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY VIII
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
SOMMAIRE
DEDICACES I
REMERCIEMENTS II
SIGLES ET ACRONYMES III
LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX VII
SOMMAIRE VIII
RESUME IX
ABSTRAIT X
INTRODUCTION GENERALE 1
Chapitre I : CARACTÉRISTIQUES ET
ÉVOLUTIONS DE LA CROISSANCE ET DE
LA PAUVRETÉ 6
Section 1 : Profil de la croissance et Évolution
de la pauvreté des Etats de l'UEMOA . 6
Section 2 : Croissance pro-pauvres et politiques de
réduction de la pauvreté au sein de
l'UEMOA 13
Chapitre II : REVUE DE LA LITTÉRATURE SUR LA
CROISSANCE
ECONOMIQUE ET PAUVRETÉ 20
Section 1 : Analyse théorique du lien entre
croissance économique et pauvreté 20
Section 2 : Evidences empiriques de la relation entre
croissance économique et
pauvreté 29
CHAPITRE III : ANALYSE EMPIRIQUE, INTERPRETATION DES
RESULTATS
ET RECOMMANDATIONS DES POLITIQUES ECONOMIQUES
37
Section 1 : Présentation des modèles et
description des variables 37
Section 2 : Estimations et tests de spécifications
41
Section 3 : Résultats et recommandations de
politiques économiques 47
CONCLUSION GENERALE 52
BIBLIOGRAPHIE XI
ANNEXES XIV
TABLE DES MATIERES XXIII
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
RESUME
Vu l'importance porté sur la relation entre croissance
économique et pauvreté, l'objectif principal de ce travail
consiste de déterminer l'impact de la croissance économique sur
la réduction de la pauvreté dans les pays de l'UEMOA sur la
période 1991 à 2015.
La démarche adoptée vise à utiliser une
régression paramétrique linéaire de la pauvreté
pour estimer l'élasticité de la pauvreté par rapport
à la croissance, à partir des données de panel statique et
dynamique dans une zone bien définie.
L'analyse empirique nous a fourni des estimations sur
l'incidence de la pauvreté et de l'indice de l'écart de
pauvreté, au seuil de 1,90$(2011 PPA) par jour par rapport aux variables
de contrôles. Sur la base du modèle à effets
aléatoires, les résultats des régressions montrent que la
croissance économique à un effet positif sur la réduction
de la pauvreté et les inégalités des revenus ont tendance
aussi à aggraver la pauvreté.
De ce fait, l'augmentation de la croissance doit donc
s'accompagner d'une politique de maitrise des inégalités car une
croissance accompagnée d'une forte inégalité réduit
son efficacité et agit défavorablement à la
réduction de la pauvreté.
Mots clés: croissance économique, pauvreté,
inégalité, UEMOA
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY IX
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
ABSTRAIT
Considering the important interest between the relationship of
economic growth and poverty. The principal objectif of this work is to
déterminante the impact of economic growth on the poverty in the UEMOA
countries in the period of 1991 to 2015.
The necessary steps seems relevant because of the economic
methodology which focuses on an analysis of panel data static and dynamic in a
well defined area. We have used a linear parametric regression of poverty to
estimate the elasticity of poverty in relation to growth.
The empiric analyse provided us with estimates of the poverty
rate and the gap index about 1,90$(2011PPA) by day with respect to the control
variable. On the basic model of random effect the regression result show that
the economic growth has a positif effect of the poverty reducation.
Also income inequallity has a significant and positif effect
on poverty. Therefore the increase in growth must accompanied by a policy to
control inequalities because of growth accompanied by high inequality reduces
its effiviency and it is not favorable to the poor.
Key words: Economic growth, Poverty, Inequality, WAEMU
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY X
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
INTRODUCTION GENERALE
Les pays de l'UEMOA, appartenant tous à la zone franc,
affichent des disparités économiques importantes dont les
autorités et organismes mondiaux tentent à élaborer des
stratégies pour atteindre une croissance durable et nécessaire
à réduire la pauvreté.
Cette croissance économique est l'indicateur principal
pour apprecier la performance économique d'un pays. Chaque pays tend
à enregistrer un taux important pour maintenir l'évolution de son
activité économique à long terme et de garantir une
stabilité économique. Théoriquement la croissance se
traduit par une augmentation des ressources de productions, du revenu, d'une
réduction de la pauvreté et de l'amélioration du
bien-être de la société.
La croissance selon Kuznets, Prix Nobel d'économie en
1971, est définie comme étant « l'augmentation à long
terme de la capacité d'offrir une diversité croissante de biens,
cette capacité croissante étant fondée sur le
progrès de la technologie et les ajustements institutionnels et
idéologiques qu'elle demande ». De ce fait, la croissance
économique est décrite dans une logique de processus
d'accroissement de l'activité économique afin d'augmenter
significativement la richesse nationale.
Elle constitue souvent un objectif en soi pour les pays,
qu'ils soient économiquement riches ou pauvres pour assurer un
équilibre économique. Pour celà, des mesures importantes
sont souvent prises par les autorités pour améliorer les
conditions de vie des citoyens à travers les programmes de croissance
accélérée. Les dirigeants de l'UEMOA ont
érigé au rang de leurs priorités, la lutte contre la
pauvreté. Ce défi majeur du développement passe par des
politiques économiques et sociales susceptibles de combattre ce
fléau.
Au niveau du bien-être social, il est
généralement admis que la croissance économique est d'une
part génératrice de nouveau revenu par l'effet de la
distribution, et d'autre part elle fait profiter au moins dans une certaine
mesure à toutes les couches de la population pour satisfaire leurs
besoins quotidiens.
De ce fait, la pauvreté absolue définie par
référence à un seuil de pauvreté est associé
à un pouvoir d'achat fixe permettant de couvrir l'ensemble des besoins
essentiels, qu'ils soient physiques et sociaux. Faire de la réduction de
la pauvreté absolue le but primordial du développement revient
à dire que l'un de ses objectifs premiers est de garantir la
satisfaction
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 1
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
des besoins fondamentaux de chacun. Mais, à l'image des
besoins fondamentaux, le seuil de pauvreté est pluridimensionnel,
recouvrant principalement deux aspects - un seuil de pauvreté lié
aux revenus (pour les besoins que l'on peut satisfaire grâce à ses
gains) et des seuils non monétaires (pour les autres besoins),
Bourguignon, 2014.
Cette définition absolue de la pauvreté, que de
nombreux pays utilisent, doit être opposée à une
définition relative où le seuil de pauvreté est
défini non pas en termes de besoins fondamentaux bien établis,
mais comme une proportion fixe du revenu moyen de la population. Il est
à noter que la définition de la pauvreté relative parfois
qualifiée de «privation relative» devient en quelque sorte
indépendante de la croissance.
En effet, le seuil de pauvreté absolue est
calculé à partir d'un panier de biens alimentaires, auquel
s'ajoutent les dépenses en habillement, en logement, en
transport et en énergie, indispensables pour la survie du ménage.
Dans l'UEMOA, la ligne de pauvreté varie d'un pays à l'autre. Les
dernières données actualisées en 2010
révèlent qu'elle est plus faible au Burkina et plus
élevée au Togo. En effet, le seuil de pauvreté est
ressorti à 109.891FCFA par an et par habitant au Burkina contre 271.057
FCFA au Togo. A l'échelle de l'Union, il est estimé à
182.072 FCFA. La Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le
Sénégal et le Togo se situent au-dessus de ce seuil. Sur la base
des seuils nationaux de pauvreté, et en fonction des années de
déroulement des enquêtes, l'incidence de la pauvreté,
c'est-à-dire le nombre des personnes pauvres, est évalué
à 49,4% en 2010 dans l'Union. Elle est plus élevée en
Guinée-Bissau (69,3%) et dépasse la moyenne sous régionale
au Niger, au Sénégal et au Togo. En revanche, elle apparaît
plus faible au Bénin 35,2% (BCEAO, 2012).
Cependant, l'élimination rapide de la pauvreté
absolue, sous toutes ses formes, passe par des stratégies de croissance
et des politiques distributives dont la combinaison est propre à chaque
pays. Cette relation entre croissance économique, distribution du revenu
et pauvreté soulève un intérêt important depuis
quelques années. En effet, des études récentes tendent
à montrer qu'il n'existe pas de lien systématique entre
croissance rapide et augmentation des inégalités, contrairement
à l'hypothèse avancée par Kuznets dans les années
50.
Au cours des années 90, la lutte contre la
pauvreté a fait l'objet d'évolutions profondes, sensibles
à travers les mesures adoptées par les institutions de Bretton
Woods. Ce n'est qu'en 1999 que l'élaboration d'un document
stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) est
devenue
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 2
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
obligatoire pour les pays qui bénéficient des
mesures d'annulation de leur dette (initiative "pays pauvres très
endettés") ou de prêts du FMI.
Alors qu'au début de la décennie, les
allègements de la dette devaient permettre l'accroissement des
dépenses publiques en direction des seuls secteurs de la santé et
de l'éducation, l'approche a, par la suite, été
élargie. Du point de vue stratégique, les programmes d'Ajustement
structurels (PAS) menées depuis les années quatre-vingt, ont
donné certes, une plus grande stabilité macroéconomique et
un taux de change fixé à sa « juste » valeur qui sont
probablement favorables aux pauvres comme le suggèrent les
résultats d'Agenor [2002].
La lutte contre la pauvreté ne cesse de faire
écho dans le débat économique et devient une
préoccupation au premier rang des Etats membres de l'Organisation des
Nations Unies (ONU). C'est ainsi que l'agenda 2000, avait mis en avant
l'éradication de la pauvreté. L'objectif de réduction de
l'extrême pauvreté et de la faim est apparu au premier rang des
huit priorités que se sont assignés, notamment dans le cadre des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). La premiere
cible de cet objectif visait à réduire de moitié, à
l'horizon 2015, l'extrême pauvreté et la faim dans le monde
où ces problèmes se posent avec acuité, notamment en Asie
du Sud-Est et en Afrique Subsaharienne. Mais cet objectif n'était pas au
rendez-vous, ainsi un nouvel agenda des objectifs de développement
durable(ODD) est mis en place ayant pour ambition première
d'éradiquer la pauvreté d'ici 2030.
En marge du développement, la croissance est une
solution pour répondre au phénomène du bien-être
social, en termes de réduction de pauvreté. Elle doit
s'accompagner des mesures et des normes permettant aux pauvres de participer
activement au processus d'accroissement de la richesse et d'en tirer les
premiers bénéfices afin d'enregistrer des résultats
important en terme d'amélioration des niveaux de vie. La croissance sera
inclusive dans ce sens qu'il s'agit de faire émerger la croissance par
la base, puis d'en faire profiter l'ensemble de la population par un flux de
bas en haut.
La mise en place de telles mesures nécessite une
stratégie économique ouvertement orienté en faveur des
pauvres. Concrètement, il s'agit d'identifier les régions et les
secteurs d'activités caractérisées par des forts taux de
pauvreté constituant un potentiel de main d'oeuvre inexploité et
d'en améliorer la productivité. Ainsi, la croissance
économique émane de la base et les pauvres sont les premiers
à en retirer les fruits. La réussite de ces programmes est
également
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 3
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
conditionnelle au fait que les pauvres soient concertés
et qu'ils aient un rôle actif dans la mise en place de ceux-ci (Sen,
1998).
Les programmes de développement avec croissance
inclusive, aujourd'hui soutenus par la Banque mondiale, ont donné des
résultats encourageants, notamment en Chine, en Inde, au Chili, au Costa
Rica ou encore au Sénégal. Néanmoins, ils restent soumis
à la critique qui voudrait que l'orientation de politiques
économiques en faveur des populations pauvres crée des
distorsions qui finalement réduisent le bien-être de la nation.
C'est le traditionnel débat entre égalité et
efficacité, qui dépend finalement de ce que l'on entend par
bien-être social.
Si aujourd'hui des pays de l'Union observent des taux de
croissances économiques très importantes pourtant la
pauvreté n'est significativement pas réduite par rapport aux
autres régions du monde, ceci peut être dû au biais des
« inégalités » de revenus. De la façon dont les
gains de la croissance sont repartis à l'ensemble de la population
dépend de l'efficacité des résultats en termes de lutte
contre la pauvreté (Bhagwati, 1988).
Alors que l'expérience asiatique tend effectivement
à mettre en évidence cette corrélation étroite
entre croissance économique et réduction de la pauvreté,
cette relation semble moins évidente en Afrique subsaharienne. En effet,
dans la zone UEMOA, la croissance moyenne dépasse les 5% ces
dernières années, elle se distingue d'un pays à l'autre.
Mais la pertinence de cette croissance est beaucoup remise en cause quant
à la distribution équitable de ses fruits et de son implication
dans l'allégement de la pauvreté. Malgré cette forte
croissance, elle ne se fait pas ressentir sur le changement des conditions de
vie des personnes vivant en dessous du seuil de la pauvreté. La
réduction de la pauvreté est très lente par rapport
à l'accroissement de la croissance. Il ne fait pas beaucoup de doute
qu'aujourd'hui le foisonnement des recherches sur les relations entre
croissance économique et pauvreté fait écho quant à
l'évolution continue du taux de croissance et à
l'inquiétude que cela induite à l'amélioration des
conditions de vie de la population. Cependant, il apparait primordial de
chercher à savoir si cette croissance est soutenable et effective en
termes de réduction de la pauvreté dans l'Union, si elle est
inclusive et suffisante pour réduire significativement la
pauvreté. Ainsi nous allons analyser son impact sur la réduction
de la pauvreté dans les 8 pays de la zone de l'UEMOA.
Les questions de recherches qui permettront
d'appréhender le lien de ces deux concepts vont tourner autour de
l'apport et la limite de la croissance sur la pauvreté. Certes la
croissance est généralement favorable à la
réduction de la pauvreté, mais suffise-t-elle, elle seule de
réduire
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 4
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
la pauvreté ? Les économistes ont
été contraints d'admettre que la croissance seule ne suffisait
pas à réduire la pauvreté. Voilà ce que traduit
cette prise en compte de la question des inégalités. Un pays peut
enregistrer une forte croissance et celle-ci ne profite qu'à une
minorité déjà nantie. Et cela vaut dans les pays les plus
pauvres comme dans les pays industrialisés.
Le bilan empirique indique que la croissance s'accompagne
souvent d'une réduction de la pauvreté, mais que le lien entre
croissance économique et croissance de l'inégalité n'est
pas systématique. En effet, les nouvelles recherches mettent en
évidence la redistribution de cette richesse que chaque pays tente
à enregistrer, afin de réduire les «
inégalités » observés. La réduction des
inégalités est reprise par l'objectif numéro 10 des ODD,
qui a fait aussi l'objet de la conférence de G7 à Biarritz en
2019.
Dans notre travail, l'objectif principal consiste à
analyser les effets de la croissance économique et
d'inégalité sur la variation de la pauvreté dans l'Union.
Pour mener à bien ce travail scientifique, nous avons formulé
trois (3) objectifs spécifiques.
Il s'agit :
i) D'étudier la situation de la pauvreté dans les
pays de l'UEMOA ;
ii) D'analyser l'effet de la croissance économique et
des inégalités de revenus sur la réduction de la
pauvreté dans l'Union ;
iii) D'identifier les canaux à travers lesquels les
effets de la politique macroéconomique se transmettent aux pauvres.
Pour parvenir à ces objectifs, nous allons chercher
surtout à tester d'une part l'hypothèse de réduction de la
pauvreté par une augmentation de la croissance et d'autre part
l'hypothèse de la baisse de la pauvreté suite à une
réduction des inégalités. Pour ce faire, notre travail
sera structuré en trois chapitres. Le premier permettra de faire une
analyse sur les caractéristiques et évolutions de la croissance
et pauvreté dans les pays de l'UEMOA. Le deuxième chapitre est
axé sur la revue de la littérature à travers les analyses
théoriques et empiriques sur la croissance et pauvreté. Le
troisième est constitué d'une analyse empirique à l'aide
d'un modèle de panel sur l'effet de la croissance économique et
les variables de contrôles pour la lutte contre la pauvreté.
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 5
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Chapitre I : CARACTÉRISTIQUES ET
ÉVOLUTIONS DE LA CROISSANCE ET DE LA PAUVRETÉ
Introduction
Ce chapitre permet d'analyser l'évolution de la
croissance et de la pauvreté dans l'Union, et aussi d'apprécier
les facteurs pouvant peser sur les perspectives en matière
d'accroissement de la richesse nationale et de politiques de réduction
de l'extrême pauvreté. Il est reparti en deux sections. Dans la
première, nous allons faire une analyse sur les tendances de la
croissance économique et de la pauvreté dans les pays de l'UEMOA.
Dans la deuxième, nous allons mettre en exergue le lien entre croissance
et rééducation de la pauvreté ainsi parcourir les
politiques et stratégies mises en oeuvre pour une croissance
pro-pauvre.
Section 1 : Profil de la croissance et Évolution
de la pauvreté des Etats de l'UEMOA
Perroux, définie la croissance économique comme
étant « l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs
périodes longues d'un indicateur de dimension, pour une nation, le
produit global net en temps réel ». Avec une évolution
récente, la croissance économique est axée sur un
accroissement de la production dans les secteurs intensifs en mains d'oeuvre,
susceptible de diminuer la pauvreté via une augmentation de l'emploi et
donc, une pression à la hausse sur les salaires (Bradley et Nielson,
2003).
Ce lien est très interessant dans la mesure où
il permet de voir à quel niveau la pauvreté diminuera si la
croissance augmente. Cependant il devient intéressant de voir
l'évolution de cet indicateur dans l'UEMOA afin de pouvoir
évaluer la performance de l'économie de cette Zone.
I.1. Etat des performances de croissance économique
des pays de l'UEMOA
Au lendemain des indépendances les pays membres de
l'Union ont hérité d'une croissance soutenable, l'économie
était en parfaite évolution. Mais arrivée aux
années quatre-vingt, la crise économique mondiale causée
par la chute des cours des matières premières, le surendettement
extérieur dû à la dépréciation du dollar et
la perte de compétitivité des économies à renverser
cette bonne tendance. Ajouté à cela l'absence de bonne
gouvernance, les conflits civils et les catastrophes naturelles, les pays de
l'UEMOA se trouvent en difficultés économiques.
En effet, la dévaluation de la monnaie en 1994
était inévitable du fait de la perte de performance des
économies de la zone. Cependant, la période 1994-1999, la
croissance économique dans la
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 6
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
majorité des pays se vu redresser suite à
l'augmentation du revenu par habitant. Le PIB réel a augmenté en
moyenne de 5,2% contre 0,5% entre 1990-1993. L'économie a
retrouvé un souffle d'oxygène, l'inflation a été
maîtrisée et le rétablissement des comptes publics a
été positif.
La conjoncture économique s'est fortement
redressée, la progression de la compétitivité prix et le
redressement des finances publiques ont conduit à une hausse du taux de
croissance de 6.5% en 1996 et à une réduction du déficit
public. Cette situation se traduit par une baisse importante du taux
d'inflation de plus de 17 points pour s'établir à 10.3% en 1995
contre 27% en 1994.
Par ailleurs, certains pays de la zone notamment la Côte
d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Togo ont connu des crises
socio-politiques majeures au début des années 2000, entrainant
des croissances négatives. Durant cette période post mise en
oeuvre du Pacte de Stabilité, l'UEMOA a réalisé un taux de
croissance annuel moyen du PIB réel de 3.4%, malgré la forte
récession mondiale, la croissance a été plus stable et
positive pour l'ensemble des pays de l'Union.
L'ensemble des pays de l'UEMOA, à l'exception de la
Guinée-Bissau et du Mali, ont connu une accélération de
leur croissance. Les plus fortes progressions ont été
enregistrées au Burkina Faso (+ 9,8% après - 4 ,7%) et au Niger
(+10,8% après en 2,1%). Dans les pays côtiers, les performances de
croissance se sont également inscrite en hausse par rapport à
2011, atteignent +5,4% au Benin ; +3,5% au Sénégal et +5,9% au
Togo. En revanche, la Guinée Bissau et le Mali sont entrés en
récession (respectivement -1,5% et -1,2%) car l'activité
économique ayant été affectée par les crises socio
politiques survenues en 2012 (BCEAO)
La croissance dans l'ensemble suit un dynamisme
d'évolution mais en deçà du niveau minimal (7 %) requis
pour réduire très significativement la pauvreté. La
croissance moyenne au lendemain de la dévaluation jusqu'en 2016 est de
4,10% largement faible pour atteindre les objectifs des ODD. Il est donc
interessant de s'interroger sur les atouts de cette croissance pour permettre
d'élaborer des stratégies de croissance
accélérée.
I.2. Politique de la croissance et cadre
macroéconomique de l'UEMOA
Selon le modèle néoclassique de la croissance,
Solow (1956), le stock capital, le progrès technique et de la croissance
de la population sont les conditionnements de la croissance
équilibrée régulière. Cependant, cette
hypothèse de convergence inconditionnelle est loin d'être
vérifiée par les études empiriques, ce qui a poussé
à chercher des approches alternatives avec notamment la théorie
endogène (Barro, 1986). Plusieurs facteurs sont pris en compte pour
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 7
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
analyser la croissance mais l'accent sera mis principalement
sur la pertinence de l'ouverture au commerce international et la
stabilité des agrégats macroéconomique pour faciliter
l'investissement.
? L'ouverture au commerce international
De nos jours, l'intégration régionale et
l'ouverture au commerce international sont considérés comme des
leviers susceptibles d'accroître la richesse des pays pauvres. Les pays
dont leurs taux d'ouvertures sont plus élevés tendent à
prouver que cette stratégie constitue un facteur déterminant de
leur développement. La théorie des avantages comparatives de D.
Ricardo qui prévoit qu'un pays doit se spécialiser dans la
production des biens pour lesquels les coûts relatifs sont les plus
faibles, et à échanger les biens qu'il ne produit pas,
étale le comportement entreprit par des pays de l'Union pour relancer
son économie. Suivant cette logique tous les pays peuvent gagner du
libre-échange s'ils se spécialisent.
Les échanges avec l'extérieur permettent
à un pays de canaliser ses investissements dans les domaines où
il tire des avantages comparatifs, ce qui augmente la productivité
globale dans l'économie. Cependant, l'élasticité de la
demande par rapport au revenu sur le marché international dépasse
forcement celle du marché restreint d'un pays à faible revenu.
Les producteurs peuvent profiter de cet élargissement du marché
pour réaliser des économies d'échelles, ce qui augmente
leur efficience et, par conséquent, leur valeur ajoutée.
Selon une étude faite par Brochart(1984) sur des
séries de données temporelles spécifiquement dans chaque
pays de la zone franc, une corrélation significative et positive a
été observée dans deux cas avec les pays de l'Union,
l'analyse empirique montre qu'une augmentation des exportations de 5% accroit
le PIB à prix constants de 0 ,4% au Sénégal.
En analysant de façon spécifique, le commerce de
l'Union apparaît d'un dynamisme non négligeable. Par contre, par
rapport au commerce mondial, les échanges commerciaux enregistrent un
léger décollage. La part du commerce des marchandises de l'Union
dans celui du monde se situe à 0,16% en 2011 et 2012 après
s'être établit autour de 0,10% entre 2000 et 2005 puis 0,13% en
2009. Ces chiffres montrent clairement que les marchandises des Etats membres
de l'Union sont peu présentes sur le marché mondial. Cette
faiblesse n'est pas spécifiquement pour l'UEMOA mais pour le continent
Africain de manière générale.
? Stabilité de l'environnement
macroéconomique et performance de la croissance
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 8
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Fisher (1993) a étudié la relation entre la
stabilité macroéconomique et la croissance. Il a défini la
stabilité d'un environnement macroéconomique par une inflation
prévisible et faible, un taux d'intérêt approprié,
une politique fiscale stable et un taux de change réel
compétitif. Les résultats prouvaient une corrélation
positive et élevée entre l'investissement et la production.
Le contexte économique récent de l'UEMOA, a
également bénéficié de la baisse des tensions
inflationnistes après les niveaux élevés
enregistrés en 2011. Le taux d'inflation annuel moyen est ressorti
à 2,6% contre 3,9% en 2011. Cette évolution mesure l'impact des
mesures prises pour contrecarrer l'augmentation des prix des produits
alimentaires et la baisse des cours internationaux.
Par ailleurs, au lendemain de la dévaluation, la
dimension de l'investissement a été insuffisante pour jouer son
rôle de relance des économies afin de pouvoir enregistrer une
dynamique de croissance accélérée. En effet, l'espace
économique de l'Union est caractérisé par une
évolution négative du stock de capital sur une longue
période.
Ce phénomène a entrainé un processus de
décapitalisation dans la plupart des économies de l'union.
Toutefois, en dépit de ce trend baissier, l'investissement a cru au
cours de la dernière décennie à un rythme annuel moyen
supérieur à celui de la valeur ajoutée (sauf au Mali, et
au Niger ) de sorte que le taux d'investissement a tendance à augmenter
tout en demeurant à un niveau inférieur au taux d'investissement
des années 70. Cette situation s'est traduite par une baisse
tendancielle de la productivité globale des facteurs (PGF).
II. Évolution de la pauvreté dans les
économies des pays de l'UEMOA
La réduction de la pauvreté est restée
extrêmement modeste. La dévaluation a considérablement
accru l'incidence de la pauvreté, que la relance de la croissance n'a
pas réussi à le réduire sensiblement. L'extrême
pauvreté en revanche semble avoir quelque peu diminué.
II.1. Evolution de l'incidence de la pauvreté au
niveau des Etats
L'état des pays l'UEMOA affiche un repli de la
pauvreté monétaire (Graphique N°2, Annexe 1) au Mali, au
Niger, au Sénégal et au Togo. En se référant des
seuils nationaux de pauvreté, l'incidence de la pauvreté,
c'est-à-dire le nombre de personnes pauvres, est évaluée
à 49,4% en 2010 dans l'Union. Elle apparaît plus faible au
Bénin (35,2%), mais plus élevée en Guinée-Bissau
(69,3%), (BCEAO, 2012).
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 9
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 10
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Au Sénégal, l'incidence de la pauvreté a
connu une régression passant de 55,2% en 2001/2002 à 48,3%, en
2005/2006, avant d'atteindre 46,7%, en 2010/2011. Quant au Mali, elle est
passée de 55,6% en 2001 à 47,4% en 2006, puis à 43,6% en
2010 sur la base d'un seuil de pauvreté en termes réels de 165
431 CFA en 2010. Au Niger, la pauvreté affiche un recul lent de 1993
à 2005 (63,7% à 62,1%) et un recul rapide pour se situer à
48,2% en 2011. De 2005 à 2008, le Togo affiche la même tendance.
Au Burkina Faso, l'incidence diminue légèrement, elle est
passée de 51,1% en 2003 à 46,7% en 2009 pour s'établir
à 40,1% en 2014, (BCEAO, 2012 et BM).
Contrairement au Bénin, en Côte d'Ivoire et en
Guinée Bissau où une pauvreté stable ou en hausse
légère se constate. Au Bénin, l'incidence de la
pauvreté est passée de 29,6% avant les DSRP à 36,2% en
2011 pour s'établir à 40,1% en 2015. En Côte d'Ivoire, le
niveau de pauvreté a augmenté de 4,8% entre 1998 et 2002, passant
de 33,6% à 38,4%. Le conflit de l'armé en 2002 a accentué
les difficultés économiques et a accru le niveau de
pauvreté qui remonte à 48,9% en 2008. Mais grâce à
la stabilité politique de ces dernières années, la
pauvreté s'est reculée légèrement à 46,3% en
2015. Quant au Guinée Bissau, l'incidence de la pauvreté augmente
de 4,6 points, elle est passée de 64,7% en 2002 à 69,3% en 2010,
(BCEAO, 2012 et BM).
Figure 1: Evolution de l'incidence de la
pauvreté dans les Etats de l'UEMO
|
80 70 60 50 40 30 20 10 0
|
|
|
|
|
Bénin Burkina Côte Guinée Mali Niger
Sénégal Togo
Faso d'Ivoire Bissau
Incidence de la pauvreté par période 1994 -1999
Avant DRSP Incidence de la pauvreté par période 2000 - 2005 DSRP
I
Incidence de la pauvreté par période 2006 - 2009
DSRP II + DSRRP - AO Incidence de la pauvreté par période 2010 -
2011 DSRP III + DSRRP - AO Incidence de la pauvreté par période
2014 - 2015 Base de Donées BM
Sources : Rapports nationaux sur la pauvreté et base
de données de la BM, présenté par l'auteur
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Par rapport au milieu, la pauvreté est très
dense en milieu rural qu'en milieu urbain (Annexe 2). En effet, dans les zones
rurales, la proportion des pauvres varie de 33 % à 88 % contre 16,5 %
à 74% dans les zones urbaines. L'analyse du phénomène de
pauvreté en Afrique de l'Ouest montre que les facteurs
socioéconomiques tels que l'âge, la taille du ménage, le
niveau d'instruction du chef de ménage constituent des
déterminants de la pauvreté. Ainsi, la pauvreté augmente
avec la taille des ménages, en particulier en milieu urbain. Par exemple
au Bénin, dans les ménages de plus de six personnes, l'incidence
de la pauvreté est deux fois plus élevée que dans les
ménages de moins de trois personnes. Au Sénégal, la taille
moyenne des 20 % des ménages les plus pauvres dépasse 10
personnes alors que celle des 20 % des ménages les plus riches est de
moins 8 personnes.
II.2. Evolution des indicateurs sociaux
La pauvreté est un phénomène
multidimensionnel, pour apprecier son évolution vis-à-vis du
bien-être de la population, il est important aussi d'analyser les
indicateurs sociaux. Il s'agit entre autre les aspects relatifs à la
qualité des ressources humaines (éducation) et à
l'accès aux infrastructures de base (accès à la
santé, à l'eau potable, à l'électricité,
etc.)
En général, le taux brut de scolarisation
(TBS)1 et le taux d'alphabétisation des jeunes (15-24 ans)
sont les indicateurs de base pour apprecier cette évolution. Selon les
données de la BAD (2016), le TBS couvrant la période 1995-2014,
(à l'exception de la Guinée Bissau dont pour des raisons de
manque de données la période s'est arrêtée en 2010)
est en hausse de 31,2% en moyenne, avec des fortes variations d'un pays
à l'autre (cf. tableau n° 1).
Sur la même période, les hausses les plus
importantes du TBS ont été enregistrées au Bénin
(56,2%) et au Burkina (48,1%), tandis que les plus faibles progressions sont
observées au Togo (21,4%) et au Sénégal (25%). Par rapport
au genre, les taux de scolarisation des filles et des garçons sont en
constant progression dans tous les pays, se situant, en 2014, respectivement
entre 65 et 121,4% d'une part, et 75,9 et 128,6%, d'autre part (cf. tableau
n° 1).
La progression favorable du taux brut de scolarisation
observée au niveau de l'Union serait due à une
amélioration de l'accès à l'éducation,
accompagnée, dans certains cas, d'une efficacité du
1 C'est le rapport du nombre d'enfants inscrits au
cours de l'année sur le nombre d'enfants de la tranche d'âge
scolarisable, qui est de 6 à 11 ans. Les proportions supérieures
à 100% indiquent une présence massive des enfants en dehors de
cette tranche d'âge scolarisable
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 11
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
système éducatif. Seul le Togo, le Bénin
et la Guinée Bissau qui atteignent un TBS plus de 100% les autres leurs
TBS se rapprochent de plus en plus à ceux des pays performants.
Par ailleurs, le taux d'alphabétisation des jeunes a
progressé, entre 2005 et 2015 au Niger, en Côte d'Ivoire et au
Bénin ensuite régressé globalement dans le reste. Le Niger
enregistre le taux le plus élevé (80,9%) en 2015, contrairement
au Togo qui a le taux le plus faible (33,5%) sur la même année.
Les Etats les plus avancés ont, en 2015, des taux qui dépassent
les 60%, (BAD, 2016)
Cependant, l'objectif d'un taux d'alphabétisation de
100% en 2015 tel qu'il était définit par les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) n'est pas atteint pour
tous ces Etats. Cela est probablement causé par la faiblesse de
l'accessibilité et de l'encadrement; la gestion non satisfaisante des
ressources humaines et financières; les contraintes budgétaires
et de l'insuffisance d'infrastructures et de matériels didactiques.
Tableau 1 : Taux brut de
scolarisation (en %)
|
Pays
|
1995 (1)
|
2014 (2)
|
Evolution (2) - (1)
|
|
Total
|
F
|
G
|
Total
|
F
|
G
|
Total F
56,2 70,5
48,1 54,2
19,3 24,2
|
G
|
|
Bénin
|
69,4
|
49,4
|
89,7
|
125,6
|
119,9
|
131,1
|
41,4
|
|
Burkina Faso
|
38,8
|
30,9
|
46,6
|
86,9
|
85,1
|
88,7
|
42,1
|
|
Côte d'Ivoire
|
70,3
|
59,4
|
81,3
|
89,6
|
83,6
|
95,5
|
14,2
|
|
Guinée Bissau
(1995 à 2010)
|
52,8
|
38,6
|
67
|
113,7
|
109,8
|
117,5
|
60,9
|
71,2
|
50,5
|
|
Mali
|
39
|
31,6
|
46
|
77,2
|
73
|
81,2
|
38,2 41,4
41,6 42,8
25 35,9
21,4 37,7
|
35,2
|
|
Niger
|
29
|
22,2
|
35,5
|
70,6
|
65
|
75,9
|
40,4
|
|
Sénégal
|
55,9
|
48,4
|
63,2
|
80,9
|
84,3
|
77,5
|
14,3
|
|
Togo
|
103,7
|
83,7
|
123,8
|
125,1
|
121,4
|
128,6
|
4,8
|
Source : BAD (2016) : Indicateurs sur le genre, la
pauvreté et l'environnement dans les pays africains
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 12
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Section 2 : Croissance pro-pauvres et politiques de
réduction de la pauvreté au sein de l'UEMOA
Au cours de la dernière décennie, les Etats de
l'UEMOA se sont engagés à des reformes importantes pour redresser
leur cadre macroéconomique afin de lutter contre la pauvreté.
Cela à travers un ensemble de politique inclusive et une croissance
rapide malgré jugé insuffisante.
1. Croissance pro-pauvres et leur extension aux dimensions
non monétaires de la pauvreté
Nouvellement apparue, la croissance pro-pauvre accorde un
intérêt très particulier aux pauvres. Les
économistes ont été contraints d'admettre que la
croissance elle seule ne suffisait pas à réduire la
pauvreté. Ils mettent à présent l'accent sur la croissance
pro-pauvre « pro-poor growth (PPG), concept qui représente un
véritable dépassement de l'approche dite du « trickle
down2 » (« effet de diffusion vers le bas »).
Dans la mesure où la réduction de la
pauvreté est considérée comme objectif prioritaire dans
l'agenda du développement, celle-ci peut être atteinte par la
stimulation de la croissance économique et/ou par une atténuation
des inégalités des revenus. En outre, la pauvreté peut
être attaquée d'abord par des politiques de croissance inclusive
à travers des politiques industrielles intensives en main-d'oeuvre.
Deuxièmement la redistribution, qui demande des bases fiscales assez
puissantes et stables. Enfin, investir dans le capital humain des personnes les
plus pauvres en leur donnant accès à de meilleurs systèmes
de santé et d'éducation.
La relation croissance et pauvreté émerge
fondamentalement, deux visions concurrentes. Une vision dont l'économie
du développement a largement insisté en expliquant que les fruits
de la croissance se diffusent automatiquement à l'ensemble des segments
de la société, conformément à la
célèbre hypothèse « trickle down ». Plus
précisément, cette hypothèse laisse comprendre que les
riches seront les premiers à bénéficier les fruits de la
croissance puis par un effet redistributif, les pauvres en profiteraient
à leur tour. De ce fait, le développement est
appréhendé comme un flux de richesses allant des riches vers les
pauvres. Dans une telle situation, les effets de la croissance sur les pauvres
ne peuvent être qu'amoindris.
2 Le terme trickle-down, qui désigne
l'économie des retombées, décrit, en fait, la croissance
capitaliste dans une économie de marché comme étant un
processus inégalitaire du point de vue distributif et dont les
bénéfices se propagent de manière graduelle et en
général de façon incomplète d'une minorité
vers la majorité de la population.
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 13
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Le résultat issu d'un certain nombre d'études
empiriques récentes suggère qu'en moyenne, les revenus des
pauvres augmentent dans la même proportion que le revenu global, de sorte
que « la croissance est bonne pour les pauvres ». Ceci implique que
la clé de la réduction de la pauvreté est une croissance
économique rapide et que les gouvernements n'ont donc pas besoin de
poursuivre des politiques de PPG (Dollar et Kraay, 2002).
Cependant, d'autres études empiriques soulignent
l'existence des fortes différences sur la manière dont les
pauvres perçoivent les dividendes de la croissance économique,
qui reposent sur des différences importantes et spécifiques aux
pays en matière de répartition initiale des revenus et des
actifs. En conséquence, une stratégie de lutte contre la
pauvreté doit incorporer des programmes de redistribution en faveur des
pauvres (Ravallion, 2001).
La relation entre croissance et pauvreté est complexe
et fait intervenir le niveau et les variations des inégalités
économiques et sociales. D'un point de vue théorique, le concept
de PPG s'appuie sur les travaux récents portant sur le triangle
pauvreté-inégalité-croissance (Bourguignon, 2003). Ces
travaux montrent que la réduction de la pauvreté est fonction du
taux de croissance et de la variation de la distribution du revenu.
De manière générale, la PPG peut se
définir comme la croissance qui bénéficie aux pauvres et
leur offre des opportunités d'améliorer leur situation
économique. Mais cette définition ne donne aucune indication du
degré et du seuil à partir duquel la croissance peut être
considérée comme telle. Toutefois, elle présente
l'intérêt de rappeler que les stratégies de
développement doivent s'intéresser aux deux dimensions «
croissance » et « pauvreté » en y intégrant le
rôle déterminant joué par la redistribution.
C'est clair que la croissance est une composante
nécessaire mais elle seule ne peut pas réduire la
pauvreté. Dans la plupart des pays de l'UEMOA, le taux de croissance
économique annuel moyen excède rarement 5 % sur la période
1994-2016. Même pour les pays ayant une croissance moyenne qui
excède 5%, le taux réalisé est inférieur au minimum
requis pour pouvoir lutter efficacement contre la pauvreté.
En tenant compte des élasticités entre
croissance et la réduction de la pauvreté, une étude de la
CEA a montré que, pour réduire la pauvreté de
moitié en 17 ans dans les Etats de l'UEMOA, il faut une croissance
annuelle d'au moins 7 %. Avec un taux de croissance pareil, la pauvreté
diminuera significativement de 4 % par an. Globalement, les performances
économiques n'ont pas été suffisantes pour réduire
substantiellement la pauvreté (Voir tableau 2).
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 14
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Avec un taux de croissance annuel moyen de 4 % à 5 %
retenu pour le moyen terme dans les documents de stratégies de
réduction de la pauvreté (DSRP) nationaux et une incidence de la
pauvreté de 30 à plus 80 % en 1998, il était difficile aux
Etats membres de réduire de moitié la pauvreté pendant la
période escomptée notamment jusqu'à en 2015.
Ainsi, le Bénin aurait besoin d'un taux de croissance
de 6.6% alors que son taux de croissance moyen entre 1994 et 2016 était
de 4.32%. Quant au Sénégal, il aurait besoin d'un de croissance
de 6,30% alors que son taux de croissance moyen entre 1994 et 2016 était
de 4.06%. Le Togo est le pays qui a besoin d'un taux très
élevé dans la zone notamment 8,16% pour pouvoir réduire
significativement la pauvreté, or dans la période 1994 à
2016, son niveau de croissance moyenne est mitigé avec un taux de 3,88%
largement faible pour atteindre cet objectif (CEA, 1999)
Tableau 2: Estimations de
l'élasticité de la croissance de la pauvreté et du taux de
croissance du FIB requis pour réduire l'incidence de la pauvreté
de 4 % par an.
Elasticité de la Croissance Taux de croissance Taux de
croissance
croissance de la requise par de la population du PIB requis
pauvreté habitant
|
Bénin
|
-1,8
|
3,70
|
2.90
|
6,60
|
|
Burkina
|
-1,01
|
3,96
|
2.80
|
6,76
|
|
Côte d'Ivoire
|
-1,06
|
3,77
|
3,10
|
6,87
|
|
Guinée Bissau
|
-0,88
|
4,55
|
2,10
|
6,65
|
|
Mali
|
-0,81
|
4,94
|
2,80
|
7,74
|
|
Niger
|
-0,62
|
6,45
|
3,3
|
9,75
|
|
Sénégal
|
-1,08
|
3,70
|
2,60
|
6,30
|
|
Togo
|
-0,79
|
5,06
|
3,10
|
8,16
|
Source : CEA : Rapport Economique sur l'Afrique, 1999
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 15
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 16
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
? Concept de croissance pro-pauvre et indicateur de
politique pro-pauvres
La croissance pro-pauvre est définie au sens large,
comme toute croissance qui réduit significativement la pauvreté
(OCDE, 2001 et Nations unies, 2000). Cependant, pour donner une
définition très pointue de ce concept, deux approches sont
généralement appréhendées:
- L'approche dite "relative" considère une croissance
pro-pauvres lorsque les plus pauvres bénéficient plus que les
autres des fruits de la croissance, la croissance est donc accompagnée
d'une réduction des inégalités (White et Anderson, 2001 ;
Kakwani et Pernia, 2000).
- La seconde, dite «absolue», considère comme
croissance pro-pauvres une croissance qui accélère la croissance
du revenu des pauvres indépendamment de l'évolution des
inégalités (Ravallion and Chen, 2003).
L'analyse empirique indique que souvent l'effet de la
croissance économique sur la pauvreté est positif et l'impact de
l'inégalité sur la pauvreté est négatif. Cependant,
la pauvreté peut s'accroître si l'inégalité des
revenus s'accentue au cours du processus de croissance. Ainsi, la grande
question qui se pose est de savoir comment accélérer le rythme de
réduction de la pauvreté et de l'inégalité. Quelles
sont les politiques pro-pauvres les plus efficaces ?
Pour donner des piste de réponse, Kakwani (1993, 2001)
propose « le taux marginal proportionnel de substitution entre la
croissance et l'inégalité des revenus ». Ce taux indique le
pourcentage d'accroissement du revenu moyen nécessaire pour que la
pauvreté ne change pas consécutivement à une variation de
1 % de l'indice de Gini. Il est égal au rapport -
précédé du signe moins - entre l'élasticité
partielle de la pauvreté par rapport à l'indicateur de
l'inégalité (í) et l'élasticité croissance
de la pauvreté (ç).
IGTI = (1)
Ti
Plus ce rapport est grand (>1), plus grands sont les
avantages des politiques pro-pauvres de redistribution qui réduiraient
l'inégalité. Plus l'IGTI est petit (<1), plus grands sont les
avantages des politiques de croissance pro-pauvres. Ainsi, pour des pays
où l'inégalité initiale est élevée,
même de faibles réductions de l'inégalité auront un
impact significatif sur la réduction de la pauvreté.
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 17
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
2. Politiques de croissance et de réduction de la
pauvreté
Les efforts accomplis ont ainsi permis à plusieurs
d'entre eux d'être éligibles à différentes
facilités accordées par la communauté internationale,
notamment l'Initiative en faveur des Pays Pauvres très Endettés
(IPPTE) et l'Initiative d'Allégement de la Dette Multilatérale
(IADM). L'endettement externe de l'Union est poursuivi par la baisse suite
à ses efforts en se situant à 57,4% en 2005 contre 60,6% en 2004.
Il se situait à 64,8% en 2003 et 71,1% en 2002.
C'est dans ce contexte que les autorités ont mis en
place des politiques de croissance accélérée, à
travers des programmes de renforcement des infrastructures et des projets
visant à élargir et diversifier la base productive des
économies. L'agriculture est au coeur de ses actions car il
représente une large part du produit intérieur brut (PIB), et
emploie une proportion significative de la population active. Il produit la
majeure partie des denrées alimentaires de base et devient la source de
subsistance et de revenus pour plus de la moitié de la population de ces
pays.
Par ailleurs, afin de stimuler davantage l'expansion de la
croissance observée ces dernières années, et d'assurer une
redistribution profitable de ses retombés, les Etats membres de l'Union
ont décidé de donner une nouvelle impulsion à leurs
actions, en matière d'inclusion financière. Ainsi, au cours de sa
session ordinaire des 24 et 25 juin 2016, le Conseil des Ministres a
adopté le document cadre de politique et de stratégie
régionale d'inclusion financière, de même que le plan
d'actions et le budget qui y afférents. A cet effet, le système
financier inclusif devient un levier important pour assurer une croissance
soutenue et durable, en même temps de réduire la pauvreté,
les inégalités et l'exclusion sociale.
Par ailleurs, pour mieux aider les Etats à relever les
défis de la performance agricole, des politiques et programmes
régionaux ont été élaborés. Les principaux
sont : (1) La politique agricole de l'UEMOA (PAU), (2) la politique agricole de
la CEDEAO (ECOWAP), (3) le Programme Détaillé de
Développement de l'Agriculture Africaine (PDDAA), volet agricole du
NEPAD, qui prévoit un Programme Régional d'Investissements
Agricoles (PRIA) et des Programmes Nationaux d'Investissements agricoles (PNIA)
sur la période 2009-2015, (4) les engagements de Maputo de 2003, pris
par le Sommet de l'Union Africaine, visaient à allouer 10% du budget
public annuel à l'agriculture dans les différents Etats membres
et à réaliser une croissance agricole minimale de 6%, (5) la
« Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la
nutrition » qui a été initiée lors du sommet du G8 en
mai 2012 et qui couvre 24 pays dont 19 africains, (6) l'Alliance Globale pour
la Résilience (AGIR)- Sahel et Afrique de l'Ouest qui est
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
un partenariat pour le renforcement de la résilience
qui s'adresse à 17 Etats de la CEDEAO, de l'UEMOA et du CILSS et qui
sera déclinée en priorités nationales «
résilience », (7) le Programme Régional pour la
Sécurité Alimentaire, adopté par l'UEMOA en 1999.
? Accélération durable de la croissance et
transformation de l'économie pour une croissance pro-pauvre
Soutenir l'économie nationale dans un processus
d'accroissement de la richesse constitue le premier facteur de lutte contre la
pauvreté. L'émergence d'une croissance pro-pauvre et l'innovation
de l'activité économique ont été amorcée au
sein de l'UEMOA. En outre, les efforts consentis par les Etats visent à
dynamiser et intensifier la performance du secteur privé, diversifier
l'économie et promouvoir l'intégration régionale.
Ainsi, des mesures d'accompagnements ont été
consenties pour améliorer le climat des affaires, poursuivre les
réformes structurelles en vue d'attirer les investissements directs
étrangers (IDE) et promouvoir les Petites et Moyennes Entreprises, ainsi
que les Petites et Moyennes Industries (PME/PMI). Le code des investissements a
été également revisité, et des réformes
ambitieuses ont été mises en oeuvre pour assainir l'environnement
judiciaire.
Des reformes du système financier pour accroître
le taux de crédit et faciliter l'octroi de crédit bancaire,
notamment en faveur des femmes, et la promotion de la microfinance, ont
été au coeur des actions entreprises pour favoriser une
croissance accélérée. Le nombre d'institutions de
microfinance a atteint 873 en 2010 contre 571 en 2005 et l'effectif des
bénéficiaires des prestations des SFD est ressorti à 11,5
millions de personnes contre 4,3 millions en 2005.
Par rapport à la diversification de l'économie
et la promotion de l'intégration régionale, les Etats de l'Union
se sont impliqués fortement dans la promotion des secteurs porteurs de
croissance, notamment le secteur agricole et ses filières de production.
Ainsi, des actions concrètes ont été entreprises pour
l'intensification de la production dans le secteur agricole, qui est le secteur
qui absorbe une grande partie de la population dont nombreux sont les pauvres.
Les principales mesures prises, concernent la promotion de l'autosuffisance
alimentaire et l'amélioration de la compétitivité des
filières, à travers la promotion de la culture
irriguée.
Au long de ce chapitre, nous avons étalé les
tendances de la croissance économique, celle de la pauvreté mais
également mettre en évidence le lien entre ces deux notions. En
effet, les taux de
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 18
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 19
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
croissance enregistrés ces dernières
années n'ont pas atteint le niveau minimal requis (7% en moyenne par an)
pour pouvoir réduire de moitié la pauvreté. La
pauvreté a connu un repli sur certains pays (Mali, du Niger, du
Sénégal et du Togo) et une stagnation ou augmentation dans les
autres. Les analyses montrent que la croissance elle seule ne suffit pas de
réduire la pauvreté. C'est ainsi que les économistes et
praticiens du développement ont mis en avant la croissance pro-pauvre,
une croissance au quelle les retombés vont d'abord aux pauvres. Le
mécanisme de transmission passe d'abord à un ensemble de
politiques inclusives qui se traduit par une intensification de la
main-d'oeuvre des personnes se trouvant dans les couches
défavorisés. L'autre voie consiste à agir sur la
distribution de la richesse afin d'atténuer les inégalités
car ces derniers représentent un frein à la réduction de
la pauvreté. Enfin, investir dans le capital humain des personnes les
plus pauvres en leur donnant accès à des meilleurs
systèmes de santé et éducation. C'est ainsi que nous
allons faire un sursaut sur la revue de la littérature pour mieux
comprendre les postulats des économistes et praticiens du
développement.
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 20
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Chapitre II : REVUE DE LA LITTÉRATURE SUR LA
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETÉ
Au lendemain de la dépression des années trente
et de la guerre mondiale, la théorie de la croissance comme l'essentiel
de la macroéconomie, fut naitre dans le débat économique.
Ce sont les instruments de type keynésien (taux d'intérêt
réels négatifs, crédits sélectifs, banques de
développement etc.) qui sont privilégiés pour organiser la
croissance. Les effets de cette croissance contribuent à priori dans le
développement. Cette main d'oeuvre employée permet à la
population active d'assurer un minimum de survie. De ce fait, la
problématique de la croissance et de la pauvreté, de la
redistribution des richesses et des inégalités dans les pays
Africains est au coeur des débats économiques et fait l'objet de
plusieurs travaux empiriques.
Partant du modèle néoclassique de Solow (1956)
qui fut le point du départ de la théorie de la croissance, des
théories contemporaines de la croissance jusqu'aux théories de la
croissance endogène développées ces dernières
années, nous allons au long de ce chapitre mettre en évidence la
relation croissance économique et pauvreté. La première
section s'intéresse à l'analyse théorique de la croissance
économique et son apport pour la réduction de la pauvreté
et la deuxième à l'analyse les aspects empiriques entre
croissance économiques et pauvreté.
Section 1 : Analyse théorique du lien entre
croissance économique et pauvreté
L'étude de la littérature soulève des
controverses importantes entre les économistes et entre les politiques
publiques de développement. Dans cette section, la première
partie va détailler les fondements théoriques, et la
deuxième effectuera un survol sur les récentes théories de
la croissance et son lien avec la pauvreté et la distribution des
revenus.
1.1 Fondements théoriques
La croissance a suscité beaucoup de débat dans
la littérature économique, les économistes de
développement mettaient en avant le principe d'accumulation du capital
humain dans la production de la croissance.
Dans la période des années cinquante, la
croissance économique était décomposée en trois
facteurs : la croissance de l'offre de travail, la croissance du capital et la
croissance des facteurs de productivité. L'analyse de la croissance est
devenue clair qu'à partir du modèle de Solow. En effet, le
modèle néoclassique développé par Solow (1956)
fournit le point du départ de la
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
théorie de la croissance. Selon sa théorie,
trois facteurs déterminent la production : le capital, le travail et la
technologie. Cette théorie est basée sur certaines
hypothèses telles que l'efficience des marchés et la
rationalité des comportements de ses différents intervenants.
La structure du modèle néoclassique repose sur
le fait que les firmes ne veulent plus acquérir de capital en raison de
la baisse des rendements marginaux qui s'explique par le fait qu'il n'y a plus
de facteur travail pour une unité supplémentaire du capital. Bien
que ce modèle soit plus clair sur les évolutions des
déterminants de la croissance, il souffre de plusieurs limites. Une des
critiques qui fut adressée concerne l'intérêt
accordé au progrès technologique. En effet, la théorie
néoclassique considère le progrès technologique comme une
variable exogène. Cette limite va être résolue, par la
suite, par la théorie de croissance endogène. Comme son nom
l'indique, cette théorie considère le progrès
technologique comme une variable endogène. Elle met l'accent sur trois
déterminants principaux de la croissance : la recherche et le
développement, le capital humain, et l'innovation.
Durant les années cinquante et soixante marquée
par l'influence accrue des écris des économistes de
développement, la Banque mondiale pensait que la meilleure façon
d'aider les pauvres, c'était de stimuler la croissance
économique. Elle avait donc foi dans les retombées positives sur
les pauvres d'une croissance rapide tirée par les investissements lourds
en capital physique et dans les infrastructures économiques. Cette foi
à la croissance prenait son origine dans l'hypothèse selon
laquelle ses avantages finiraient par être largement distribués en
masses sous la forme d'emplois ou d'autres opportunités
économiques, (Ehrhart, 2006).
Le lien entre croissance et pauvreté a
été soutenu depuis les classiques et les économistes
modernes. Adam Smith était formel au sujet de l'importance de la
croissance dans la réduction de la pauvreté. « Elle est en
phase de progression lorsque la société est en phase de
constitution de la richesse plutôt qu'au stade d'aboutissement, et
lorsque les conditions des pauvres qui travaillent, c'est-à-dire la
majorité de la population, semblent être les plus heureuses et les
plus confortables. Ces conditions sont difficiles quand la relation
croissance/pauvre est à l'état stationnaire, et misérables
à l'état déclin » (Smith, 1937).
Plus récemment, Lewis (1955), dans son enquête
magistrale sur la croissance, a abordé de façon exhaustive
plusieurs aspects de la croissance, y compris sa relation avec la
pauvreté. Son annexe, intitulée « La croissance est-elle
souhaitable ? » anticipe tout ce que les critiques contemporains ont dit
sur la croissance, et va même au-delà ! Mais bien entendu, Smith
et Lewis
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 21
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 22
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
avaient écrit bien avant la réapparition
récente des régressions sur différents pays, et avant que
Wolfensohn, le président de la Banque mondiale, et son Grand Vizir de
l'économie de l'époque, Joseph Stiglitz, n'aient
été considérés comme partisans de ceux qui
mettaient en doute l'existence, le sens et la force de ladite relation
(Wolfensohn et al., 1999)
En effet, particulièrement, les modèles de
développement « classiques » de Lewis (1954) et de Fei et
Ranis (1961) suggéraient que la croissance du secteur industriel, si
elle était soutenue, conduirait effectivement à une propagation
de ses bénéfices à travers, tout d'abord, un effet de
diffusion verticale vers le bas (vertical trickle-down effect) des riches vers
les pauvres dans le secteur moderne puis via un effet de diffusion horizontale
(horizontal spread effect) de l'enclave industrielle en expansion vers le
secteur traditionnel3. C'est par cet effet redistributif, (via les
dépenses publiques ou privées) que les pauvres pouvaient en
profiter à leur tour.
Cette croyance en l'économie des retombées
implique donc que, même si la pauvreté diminue substantiellement
dans un contexte de croissance rapide, il n'en demeure pas moins que,
conformément aux enseignements des modèles d'une économie
duale de Lewis (1954) et de Fei et Ranis (1961) et à la
célèbre conjecture de Kuznets (1955), les
inégalités de revenu commencent par augmenter puis
décroît au fur et à mesure que l'économie se
développe, les bénéfices de la croissance allant
inévitablement, au cours des premières étapes du
développement, davantage aux riches qu'aux pauvres avant de se diffuser
automatiquement par la suite plus largement au sein des couches sociales les
plus défavorisées de la population.
Du fait que, la réduction de la pauvreté devait
arriver non seulement graduelle mais aussi dans un ordre hiérarchique
bien précis, elle concernerait d'abord les capitalistes et les
travailleurs urbains puis les paysans, (Ehrhart, 2006). La répartition
des revenus est donc considérée étant indispensable
à la réalisation d'une croissance profitable aux pauvres. Il
devait donc il y avoir un compromis clair entre répartition et
croissance.
Dans une telle configuration, les bénéfices que
les pauvres tirent de la croissance ne peuvent être qu'indirects et
amoindris. C'est dans cette perspective que les économistes de
développement ont proposé la croissance pro-pauvre comme solution
à ces résultats insatisfaisants, en termes de réduction de
la pauvreté. Elle peut être définie comme un processus qui
permet aux pauvres de participer activement à la croissance
économique et d'en être ainsi les premiers
bénéficiaires. On parlera alors de croissance inclusive.
3 Pour une présentation des différentes
versions du trickle-down effect, voir notamment Arndt (1983).
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
En effet, une croissance économique forte peut induire
des résultats mitigés en matière de réduction de la
pauvreté dans un contexte de forte inégalité de revenu
(Addison et Cornia, 2001). Cette évidence intéressante remet
d'emblée en cause la théorie Kaldorienne (Kaldor 1956), selon
laquelle une forte inégalité est utile pour la croissance
économique, car les plus riches ont une plus forte propension à
épargner que les pauvres; ce qui est essentielle pour l'investissement
en capital physique et donc pour la réduction de la pauvreté.
Ainsi, des fortes inégalités affectent
négativement la croissance du produit par tête (Benabou, 1996 ;
Perotti, 1996). Pour réduire la pauvreté, la croissance doit
s'accompagner de la mise en place de politiques de réduction des
inégalités présentes et futures (Bourguignon, 2003; Cling
et al, 2002). La redistribution des revenus et des richesses jouent alors un
rôle crucial dans la relation croissance-pauvreté. Cela dit,
l'impact de la croissance économique sur la pauvreté
dépend de la manière dont la croissance agit sur les
inégalités.
Selon la théorie économique, un niveau
élevé de croissance est essentiel pour réduire la
pauvreté (Dollar et Kraay, 2001, 2002 ; Ravallion, 2004). Mais en
Afrique, les élasticités de la croissance-pauvreté
différenciées souvent faibles, ont nourri et relancé le
débat économique sur le sujet. Le nombre persistant de pauvres
dans le monde notamment dans les pays en développement et ayant parfois
de forte croissance remet au coeur des débats l'efficacité de
cette croissance à réduire la pauvreté (Epaulard,
2003).
Dans la mesure où d'autres auteurs pensent que la
croissance économique ne contribue pas directement à la
réduction de la pauvreté dans l'Afrique, la littérature
ressente met en évidence la problématique de la croissance
pro-pauvre. Elle a montré le rôle ou l'importance de la
redistribution des fruits de la croissance pour lutter efficacement contre la
pauvreté.
Depuis les travaux pionniers de Kuznets (1955), mettant en
évidence la relation en forme de « U inversée »
postulant que les inégalités générées par la
croissance économique tendent à augmenter dans les
premières phases du développement du fait des changements dans la
structure économique et à baisser par la suite, plusieurs travaux
empiriques ont montré que cette relation n'est pas souvent
vérifiée.
1.2 Développement théoriques
récents
Au début des années cinquante, la
littérature économique considérait que la croissance
n'était favorable qu'aux riches Kakwani et al. (2000). En effet, ne
disposant pas de capital humain ni
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 23
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
financier, les pauvres ne pouvaient recevoir qu'une faible
partie des bénéfices de la croissance (grâce à la
redistribution) : c'est la théorie du « Trickle down
».
En dépit des taux de croissance économique
élevés sans précédent, la pauvreté et les
inégalités sont restées néanmoins fortes dans la
plupart des pays sous-développés. Le Bureau international du
travail (BIT), « il était devenu de plus en plus évident,
particulièrement à partir de l'expérience des pays en voie
de développement, que la croissance rapide au niveau national ne
réduit pas automatiquement la pauvreté ou
l'inégalité ou n'assure pas un emploi productif suffisant »
(BIT, 1976).
Egalement, l'approche de la Banque mondiale en matière
de lutte contre la pauvreté a connu des changements radicaux qui
reflétaient, d'une part, les progrès croissants, accomplis par le
milieu académique dans l'analyse très complexe des interactions
entre la croissance économique, l'inégalité des revenus et
des richesses et la pauvreté et, d'autre part, le niveau
d'intérêt, manifesté par le monde politique à
l'égard du thème de la réduction de la pauvreté.
Pour mieux appréhender cette nouvelle vision, les
économistes de développement mettent en évidence des
stratégies visant à réduire la pauvreté. Selon
Bourguignon (2004), dès lors qu'elle vise à réduire la
pauvreté absolue sous toutes ses formes (monétaires et non
monétaires), une stratégie de développement est
entièrement déterminée par ses considérations en
matière de croissance et de répartition. Par conséquent,
le véritable défi à relever consiste à identifier
la nature des liens entre croissance et répartition, le poids variable
alloué respectivement aux objectifs de croissance et de
redistribution.
D'autre part, selon Bourguignon (2004),
l'«inégalité» (ou la «distribution») fait
référence aux écarts de revenu relatif dans l'ensemble de
la population, c'est-à-dire aux différences de revenu obtenues
après normalisation des données observées par rapport
à la moyenne de la population de façon à les rendre
indépendantes de l'échelle des revenus. Et la
«croissance» comme le changement exprimé en pourcentage, du
niveau de bien-être moyen (par exemple, le revenu) qui apparaît
dans l'enquête auprès des ménages.
Cette dernière passe par des stratégies de
croissance4 et des politiques distributives dont la combinaison
pourrait être propre à chaque pays. Par exemple, une croissance
moyenne de 1% du revenu par habitant peut entraîner une réduction
de la proportion des gens vivant dans une
4 Volontairement orientées vers les
pauvres
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 24
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
pauvreté extrême allant jusqu' à 4%, mais
pouvant aussi être inférieure à 1%, selon le pays et la
période (Ravallion, 2004).
Ainsi, ces différentes stratégies de
réduction de la pauvreté ont mis l'accent, à des
degrés divers, sur les mesures destinées à stimuler la
croissance d'une part, et sur les politiques de redistribution d'autre part.
Figure 2: Décomposition des variables
affectant la distribution et la pauvreté en effet distributif et de
croissance
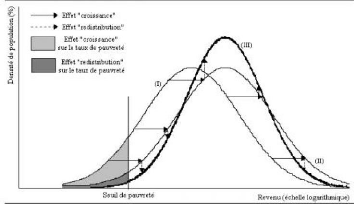
Partant dans ce sens, une variation de la pauvreté est
donc une fonction de la croissance, de la distribution et de la variation de la
distribution. Ce principe est illustré par la figure (1), où
l'indice numérique de pauvreté correspond à la zone
située sous la courbe de densité à gauche du seuil de
pauvreté (fixé ici à 1 USD par jour).
Cette figure fait apparaître la densité de la
distribution du revenu, à savoir le nombre d'individus à chaque
niveau de revenu (représenté sur l'échelle logarithmique
en abscisse). Le passage de la distribution initiale à la nouvelle
distribution s'effectue via une étape intermédiaire qui est la
translation horizontale de la courbe de densité initiale vers la courbe
(I).
L'échelle logarithmique figurant en abscisse, cette
variation correspond à la même augmentation proportionnelle de
tous les revenus de la population et tient lieu d'«effet de
croissance» pur, sans que la distribution des revenus relatifs ne soit
modifiée. Ensuite, le déplacement de la courbe (I) vers la
nouvelle courbe de distribution se produit à revenu moyen
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 25
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 26
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
constant et correspond à la variation du revenu
«relatif» dans la distribution ou à l'«effet
distributif».
De ce fait, il est possible de décomposer la
réduction de la pauvreté en un effet dû à la
croissance et un effet dû à la réduction des
inégalités. Des travaux récents (Bourguignon 2004, Cling
et al 2004, Lopez (2004) montrent que l'élasticité de la
réduction de la pauvreté à la croissance dépend
à la fois de l'inégalité de départ des revenus et
de l'écart entre revenu moyen et ligne de pauvreté. Ainsi, pour
les pays les plus pauvres, la réduction de la pauvreté est
bridée par une distribution inégalitaire des revenus5
et des défaillances de marché qui handicapent la situation des
plus pauvres (Dercon, 2004).
Cependant, au cours des années 90, la lutte contre la
pauvreté a fait l'objet d'évolutions profondes, sensibles
à travers les mesures adoptées par les institutions de Bretton
Woods. Ce n'est qu'en 1999 que l'élaboration d'un document
stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) est devenue
obligatoire pour les pays qui bénéficient des mesures
d'annulation de leur dette (initiative "pays pauvres très
endettés") ou de prêts du FMI. Les DSRP ont cherché
à promouvoir une approche de plus en plus globale de la réduction
de la pauvreté. La thématique de la croissance pro-pauvre
s'inscrit dans cette perspective.
En outre, la croissance pro-pauvre est apparue comme une
alternative aux modèles de redistribution qui conduisent à une
très faible réduction de la pauvreté. L'idée ici,
contrairement à la théorie du « Trickle down
», est de faire émerger la croissance à partir de la base
(les pauvres), c'est-à-dire de mettre les pauvres au coeur du processus
de création de richesse. En effet, comme le souligne Dollar et Kraay
(2002), la croissance à elle seule est insuffisante pour engendrer une
réduction significative de la pauvreté.
Ceci nous amène à soulever la question selon
laquelle, pourquoi la croissance ne profite toujours pas aux plus pauvres ? Par
conséquent, la prise en compte du lien entre la distribution des revenus
et la croissance est cruciale pour toute politique tendant à assurer une
croissance pro-pauvre. Toutefois, comme le souligne Lopez (2004), la question
la plus importante et sans nul doute la plus difficile est celle de savoir de
combien les pauvres doivent bénéficier de la croissance pour
qu'elle soit qualifiée de pro-pauvre.
5 D'après les enquêtes, l'inégalité
mesurée par le coefficient de Gini serait presque aussi forte en Afrique
de l'Ouest que dans les pays les plus inégalitaires d'Amérique
latine - ce qui est loin d'être intuitif.
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 27
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Cette question s'intéresse donc à la mesure de
la croissance pro-pauvre. Heureusement, les chercheurs ont proposé une
multitude de mesures pour déterminer empiriquement l'impact de la
croissance sur les plus démunis : la courbe d'incidence de la croissance
(CIC) de Ravallion et Chen (2003) ; le taux de croissance pro-pauvre de
Ravallion et Chen (2003) ; la courbe de croissance de la pauvreté de
(Son, 2004) ; le biais de pauvreté de croissance de McCulloch et Baulch
(1999) ; l'indice de la croissance pro-pauvre de Kakwani et al. (2000) ;
etc.
Selon l'OCDE, la croissance est qualifiée de pro-pauvre
lorsqu'elle s'accompagne d'une réduction significative de la
pauvreté. Cette définition est vaste et nous fournit peu
d'informations.
Certains proposent une approche relative pour définir
la croissance pro-pauvre, en considérant que la croissance est
pro-pauvre lorsqu'elle s'accompagne d'une réduction des
inégalités de revenu (White et al., 2001; Klasen, 2004). D'autres
préfèrent l'approche absolue qui définit la croissance
pro-pauvre comme étant une croissance qui réduit le taux de
pauvreté (Kakwani et al., 2000, 2002).
A l'évidence, l'efficacité de la croissance
comme vecteur de réduction de la pauvreté dépend en partie
des inégalités de revenu. Selon l'approche relative la croissance
est dite pro-pauvre lorsque le taux de croissance du revenu des individus
pauvres est plus important que celui des individus non pauvres (White and
Anderson, 2001; Klasen, 2004). Ainsi, dans le cadre d'une politique
économique pro-pauvre, la réduction de la pauvreté sera
plus forte comparée à une politique de croissance pour laquelle
les inégalités de revenu restent inchangées pour tous,
(McCulloch and Baulch, 1999; Kakwani and Son, 2002).
Autrement dit, elle s'intéresse à la
réduction des inégalités de revenu en faveur des pauvres
suite à une période de croissance économique. C'est
principalement pour cette raison qu'on parle de définition relative de
la croissance pro-pauvre. Ces deux approches posent problème.
La première approche conduit à un paradoxe :
préférer une plus faible croissance (au motif de la
priorité accordée à la réduction des
inégalités) à une croissance plus forte, certes plus
inégalitaire, mais où le revenu des pauvres augmenterait plus
rapidement.
La seconde approche amène quant à elle à
considérer une croissance très inégalitaire comme
pro-pauvres : La plupart des pays, hormis la Roumanie, voient croissance et
réduction de l'incidence de la pauvreté aller de pair. Une telle
définition de la croissance pro-pauvre tend
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
donc à annuler toute spécificité par
rapport à la croissance. De plus, l'utilisation de l'incidence de la
pauvreté tend à focaliser l'attention sur les personnes se
situant juste en dessous du seuil de pauvreté. Un indicateur comme le
taux de croissance du revenu des pauvres (Ravallion & Chen, 2003) peut
paraître préférable.
Cette approche permet de se concentrer essentiellement sur le
lien entre pauvreté et croissance et non sur la distribution du revenu.
Cette approche est cohérente avec le premier des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés en 2000
(objectif 1, cible 1 : réduire de moitié en 2015 la proportion de
la population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour).
Cette seconde approche est beaucoup moins contraignante que celle de l'approche
relative la croissance dans la mesure où elle se focalise sur les
variations de l'indice de mesure de la pauvreté suite à un
épisode de croissance.
Osmani et al. (2005) proposent une version particulière
en agrégeant les deux approches précédentes. Ainsi, selon
lui, la croissance sera pro-pauvre lorsqu'elle réduit à la fois
la pauvreté et les inégalités. Cette approche a le
mérite d'insister sur les interactions possibles entre croissance,
inégalité et pauvreté.
Le véritable enjeu de l'élaboration d'une
stratégie de développement visant à réduire la
pauvreté réside davantage dans les interactions entre
distribution et croissance que dans les relations entre, d'une part,
pauvreté et croissance et, d'autre part, pauvreté et
inégalités, qui restent essentiellement arithmétiques.
Les économistes conviennent en général
que la croissance est essentielle pour réduire la pauvreté
(-revenu), à condition que la répartition du revenu reste plus ou
moins constante. La réalité tend d'ailleurs à le confirmer
(Deininger et Squire, 1996 ; Dollar et Kraay, 2001 ; Ravallion, 2001 et 2003).
Cependant, le vrai problème de l'élaboration d'une
stratégie de développement est de savoir si la croissance et la
distribution sont indépendantes ou si, au contraire, elles sont
étroitement liées (Bourguignon, 2004).
Au-delà de la question de la distribution des revenus,
on remarque aussi que les niveaux de développement humain sont
très variables entre pays à revenus pourtant comparables
(l'Afrique étant généralement en retard par rapport
à l'Asie). Les liens entre croissance économique et
réduction de la pauvreté sont affectés par les choix
politiques et des facteurs structurels propres à chaque pays. D'autre
part la pauvreté est un phénomène global, les contraintes
imposées par
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 28
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 29
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
le manque de revenus sur les individus s'accompagnant de leur
incapacité à prendre en main leur destin, que l'augmentation du
PIB par tête ne suffit pas à éradiquer (Delleur, 2005)
La croissance est donc indispensable pour réduction de
la pauvreté mais il est aussi nécessaire que cette croissance
s'accompagne d'une politique économique axée
spécifiquement sur les plus pauvres et d'une maitrise des
inégalités des revenus.
Section 2 : Evidences empiriques de la relation entre
croissance économique et pauvreté
L'analyse de cette littérature a permis la mise en
évidence de controverses importantes entre les économistes. Si
certains montrent que, l'accroissement de la croissance a effet positif quel
que soit sa nature sur la réduction de la pauvreté d'autres
montrent que cet effet est positif s'il s'accompagne d'une réduction des
inégalités de revenus plus ou moins constante. Dans cette section
nous allons exposer dans la première partie les aspects
théoriques de l'effet positif de la croissance économique et la
pauvreté. La deuxième consiste à mettre l'accent sur les
approches théoriques des interactions entre croissance,
inégalité et pauvreté. Dans cette partie l'analyse de la
pauvreté sera faite d'une part sur l' « effet distributif » et
d'autre part sur l' « effet croissance ».
2.1 Aspects empirique de la relation entre croissance
économique et réduction de la pauvreté.
Dans la littérature portant la question de croissance
et pauvreté, nombreux des travaux empiriques ont été
mené ces dernières années. Cependant, l'expérience
du développement montre que la croissance est une condition
nécessaire mais pas suffisante pour réduire significativement la
pauvreté. La théorie de l'économie des retombées a
connu ses limites quand nombreux de pays en développement arrivant
à garder une croissance accélérée pendant plusieurs
années pourtant le taux de la pauvreté ne se réduit pas
proportionnellement avec le taux de la croissance.
Le Rapport de 1990 de la Banque mondiale sur la
pauvreté conclut que la stratégie la plus efficace pour faire
reculer la pauvreté à long terme comprend entre autre, la
création d'activités rémunératrices pour les
pauvres grâce à un modèle de croissance encourageant
l'utilisation efficace de la main d'oeuvre et l'amélioration des
conditions de vie actuelles des pauvres et de leur aptitude à saisir les
chances qui leur sont données grâce à l'accès aux
services sociaux.
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
D'ailleurs, l'expérience des pays d'Asie de l'Est (en
particulier l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande) qui ont
réussi à réduire sensiblement la pauvreté à
long terme ont misé sur une croissance à forte intensité
de travail avec, au premier plan, l'agriculture. Cette stratégie a
permis d'accroitre les revenus des pauvres (Ehrhart, 2006).
Dans ces pays, la croissance orientée vers l'emploi a
suscité une demande de facteurs de production détenus par les
pauvres et, dans le même temps, l'amélioration du niveau de
compétence et la qualité de la main d'oeuvre ont permis aux
pauvres de saisir les opportunités créées par la
croissance économique. Suivant ce processus, les pauvres ont
participé à la croissance par leur forte intensité de
travail qui est un des facteurs de la production. C'est ainsi que, les
interventions des pouvoirs publics doivent être de nature à
stimuler le développement rural et à faciliter la création
d'emplois dans les zones urbaines.
Les responsables politiques Indiens viennent d'approuver ce
phénomène à travers les travaux de Srinivasan et Bardhan
(1974), lors du projet d''éradication de la pauvreté des masses
en quinze ans (de 1961 à 1976). Dans ce travail, il a été
prouvé que pour éradiquer la pauvreté uniquement des
individus pouvant bénéficier du processus de création de
revenus de l'économie, il faut compter sur un rythme annuel moyen de
croissance supérieure à 7 %.
Srinivasan montre que la relation négative entre la
croissance et la pauvreté (toutes les deux des variables
exogènes) repose sur l'hypothèse qu'une croissance plus rapide
est le resultat de facteurs de rentabilité des actifs détenus par
les pauvres. Par exemple, si l'avantage comparatif de l'économie
concernant les biens et services réside dans la production pour laquelle
les actifs des pauvres sont intensivement utilisés, une modification
exogène de la politique commerciale qui encourage la production de tels
bien et services réduira la pauvreté et augmentera le taux de
croissance, du moins à court terme, tant qu'une partie des gains
d'efficacité est investie dans l'accumulation de capital humain et
physique.
Par ailleurs, des études menées au cours des
années 1990 sur quelques pays africains montrent qu'en période de
croissance, la pauvreté a baissé : au Ghana entre 1988 et 1992,
au Nigeria entre 1985 et 1992, en Tanzanie entre 1983 et 1991.
Symétriquement, une augmentation de la pauvreté a pu être
constatée durant des phases de décroissance du PIB par tête
comme en Côte d'Ivoire entre 1985 et 1992, au Bénin entre 1986 et
1996, au Cameroun de 1987 à 1994, à Madagascar de 1960 à
1995. Par contre, aucune situation de diminution de la pauvreté en
période de récession n'a pu être constatée en
Afrique. On observe cependant des augmentations
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 30
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
de la pauvreté en période de faible croissance
(Côte d'Ivoire, 1993-95, Tanzanie, 1993-95, Ouganda, 1989-95) mais aussi,
plus rarement, en période de forte croissance (Soudan, 199196). I1
semble donc qu'il existe bien une relation entre la croissance et la diminution
de la pauvreté, mais on ne peut pas affirmer qu'elle est
systématique, (Guénard et al., 2001).
En outre, Deaton et Drèze (2002) ont fait une
réflexion ces dernières décennies sur l'évolution
récente de l'inégalité et de la pauvreté en Inde.
Dans leur récent article sur la «pauvreté et
l'inégalité en Inde», les données d'enquête
fournies par trois cessions quinquennales de questionnaires (respectivement
conduites au cours des périodes 1987-1988, 1993-1994, et 1999-2000) sur
la consommation des ménages pour un panier de biens durables et non
durables ont été utilisé pour évaluer le nombre
d'individus qui vivent sous le seuil de pauvreté, divisé par la
population totale, pour obtenir ce que l'on appelle le head-count ratio.
Le premier résultat principal rapporté par ces
deux auteurs, est celui selon lequel, même lorsque l'on prend en compte
les modifications des questionnaires d'une cession à l'autre
(méthodologie officielle), ou les changements dans les indices de prix
au cours du temps (méthodologie ajustée), la pauvreté a
baissé de manière substantielle au cours des vingt
dernières années, à la fois dans les zones rurales et
urbaines. En Inde la réduction a connu une baisse importante durant ces
dernières années avec une croissance soutenue.
Autre étude portant sur la croissance et la
réduction de la pauvreté a été faite en Egypte de
1990 à 2004, relève que l'évolution des variables
d'intérêt (le taux de croissance, le niveau de pauvreté et
le degré d'inégalité) n'a pas été uniforme
sur la même période. L'auteur de cette étude, distingue
deux périodes, une (1990-1995) selon laquelle le rythme de la croissance
a été comparativement le plus faible (hausse de 1,44%) mais elle
a été suivit d'un important progrès en matière de
réduction de la pauvreté monétaire, (avec des diminutions
de l'ampleur, de la profondeur et de la sévérité de la
pauvreté respectivement égales à 11,25%, à 10,82%
et à 8,46%). Cette situation peut s'expliquer par la réduction
importante de l'inégalité dans la répartition des
dépenses (-1,20%), (Ehrhart, 2008).
Et une seconde période, dont la croissance ayant un
rythme d'accélération (+3,21%) a conduit à une
réduction substantielle du pourcentage de pauvres dans (-7,34%) et de
l'intensité de la pauvreté (-1,84%). Mais cette situation s'est
traduite par un accroissement notable de la sévérité de la
pauvreté (+4,85%), c'est-à-dire de l'indicateur de la
pauvreté qui accorde le poids le plus important au bien-être des
plus pauvres. Cette dégradation résulte de l'accentuation de
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 31
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 32
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
l'inégalité totale mesurée par l'indice
de Gini (+2,12%). La croissance a eu donc un effet sur la réduction de
la pauvreté mais d'autre part, une augmentation des
inégalités a été observée, (Ehrhart,
2008),
D'autres études empiriques ont analysé
l'évolution de la pauvreté dans ce même pays (El-Laithy,
Lokshin et Banerji, 2003 ; World Bank and Ministry of Planning, Government of
the Arab Republic of Egypt, 2002) soit sur la période 1990/91et 2004/05.
Les auteurs montrent que la pauvreté diminue sensiblement durant les
années 90, quel que soit l'indicateur de pauvreté
considéré. Ils attribuent cette baisse importante de la
pauvreté à une forte reprise/accélération de la
croissance du PIB en 1994/95, qui s'est poursuivie jusqu'à la fin de la
décennie, (Kheir-El-Din et al., 2006).
Cependant les auteurs soulignent que la répartition des
dépenses n'a pas été uniforme. En effet, l'indice de Gini
a diminué très nettement (passant de 44,6% à 34,5%) durant
la première moitié des années 90 en raison de la hausse
des revenus agricoles qui est survenue à la suite des efforts de
stabilisation et de libéralisation entrepris par l'économie
égyptienne. En revanche, on assiste à une légère
remontée de l'inégalité des dépenses durant la
seconde moitié de la décennie. Celle-ci s'explique par
l'aggravation de l'inégalité dans la répartition des
dépenses dans les gouvernorats métropolitains et en particulier
dans ceux situés en Haute-Egypte (World Bank and Ministry of Planning,
Government of the Arab Republic of Egypt, 2002).
De ce fait, il est clair qu'à travers un
mécanisme d'accélération de la croissance, des
progrès important en matière de réduction de la
pauvreté seront observés mais ce phénomène doit
s'accompagner d'une réduction des inégalités de
distribution des revenus. Cependant la croissance impact significativement la
pauvreté une fois que les inégalités sont
maitrisés.
Par ailleurs, deux enquêtes effectuées sur 99
ménages des pays en développement et en transition, concernant la
consommation ou le revenu moyen et du taux de pauvreté (moins de 2$ par
jour), dans 47 cas, le taux de croissance annuel moyen de la consommation ou du
revenu par tête est positif, dans 42 cas il est négatif. Les
résultats de cette étude nous dit qu'en moyenne une augmentation
(resp. baisse) de 1% du revenu par tête se traduit par une baisse (resp.
une hausse) de 1,4% du taux de pauvreté (ie, l'élasticité
du taux de pauvreté à l'activité économique serait
de -1,4). En moyenne, un pays qui connaîtrait une croissance de 5%
verrait son taux de pauvreté baisser d'environ 9%, passant par exemple
de 70% à 64,6% (Épaulard, 2002).
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
D'autres estimations économétriques sur les
mêmes données montrent que l'on peut raisonnablement conclure que
l'élasticité moyenne du taux de pauvreté serait de l'ordre
de -1,1 seulement et serait identique à la hausse et à la baisse
: une contraction de l'activité de 1% n'augmente pas la pauvreté
davantage que ne la réduit une augmentation de l'activité de 1%,
(Epaulard, 2003).
2.2 Aspects empiriques de la relation entre repartions de
revenu et inégalités sur la réduction de la
pauvreté.
D'après le Rapport sur le développement dans le
monde de 2000-2001 de la Banque mondiale, les dimensions de la pauvreté
sont multiples et doivent bénéficier d'une attention
égale. Dans ce Rapport, la Banque mondiale rappelle néanmoins que
la croissance économique globale est indispensable au
développement des opportunités matérielles des pauvres.
Elle affirme, à ce sujet, que « les mesures favorables aux
marchés (market-friendly policies), telles que l'ouverture au commerce
international, une inflation faible et un secteur public de taille
modérée et des règles de droit bien établies,
profitent, en moyenne, autant aux pauvres qu'aux non-pauvres » (Banque
mondiale, 2001).
Le Rapport de 2000-2001 attire son attention aux canaux par
lesquels la croissance économique peut être
bénéficiée aux pauvres. Elle soutient que « pour un
taux de croissance donné, l'ampleur de la réduction de la
pauvreté dépend des variations dans la répartition du
revenu accompagnant la croissance et des inégalités initiales, au
plan des revenus, des actifs et de l'accès aux opportunités qui
permettent aux pauvres de bénéficier des fruits de la croissance
» Les auteurs de ce rapport affirment selon une réflexion
consacrés aux inégalités que l'élasticité de
la réduction de la pauvreté par rapport à la croissance
(qui mesure l'ampleur de la diminution de la pauvreté induite par un
montant donné de croissance économique) est évidemment
supérieure si l'inégalité est faible ou si elle baisse :
une faible inégalité est favorable à la réduction
de la pauvreté parce que, pour tout accroissement donné du revenu
national, un volume plus grand de ressources réelles sera disponible
pour les groupes à revenus faibles; la baisse de
l'inégalité est également un élément
favorable dans la mesure où la part dans le revenu des pauvres
s'accroît, (Banque mondiale, 2001).
Une idée assez répandue parmi les
économistes, et aussi au-delà de la sphère des
économistes, voudrait que pour un pays en développement, les
inégalités de revenus s'accroissent à mesure que le pays
se développe pour atteindre un seuil maximum à partir duquel tout
développement
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 33
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 34
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
ultérieur s'accompagne d'une réduction des
inégalités. On aura reconnu là, l'hypothèse
initialement émise par Kuznets. Si cette hypothèse était
vérifiée cela signifierait que le lien entre croissance et
réduction de la pauvreté serait plus faible que celui
prédit par l'élasticité théorique du taux de
pauvreté à la croissance.
L'hypothèse de Kuznets a fait l'objet d'un grand nombre
d'études empiriques et, à ce jour, le consensus parmi les
économistes est qu'il n'y a rien d'automatique dans le fait que
développement et inégalités de revenus croissent de pair
dans les premières phases du développement économique.
Ainsi par exemple, au Bangladesh, en Egypte et à Taiwan, la croissance
se serait accompagnée d'une réduction des
inégalités alors qu'au Chili, en Chine et en Pologne, la
croissance se serait accompagnée d'un accroissement des
inégalités (Rodrik, 2000). En exploitant un échantillon de
234 enquêtes de niveau de vie des ménages des pays en
développement et en transition, Ravallion (2001) montre que lorsque le
revenu ou la consommation moyenne augmente, il y a à peu près une
chance sur deux que les inégalités augmentent et une chance sur
deux qu'elles diminuent.
L'impact de la croissance économique sur le niveau de
pauvreté dépendra, d'une part, de son effet sur le revenu moyen
et, d'autre part, de son effet sur l'inégalité. Des mesures de la
sensibilité de la pauvreté par rapport à la croissance et
à l'inégalité permettent alors de voir si un accroissement
moyen de la consommation ou du revenu tend à réduire la
pauvreté tandis qu'à l'inverse, une augmentation de
l'inégalité tend à l'accroître.
Le cas de la Côte d'Ivoire entre 1985 et 1988 est, sur
ces questions, riche d'enseignement. I1 montre que l'augmentation de la
pauvreté est essentiellement le résultat de la baisse du PIB par
tête, la réduction des inégalités ayant plutôt
eu pour effet de contribuer à la réduction de la pauvreté,
et surtout de l'extrême pauvreté.
Ainsi, s'il n'y avait pas eu de croissance négative, la
pauvreté aurait quand même baissé de 20%, et
l'extrême pauvreté de 40%, par le seul fait de la réduction
des inégalités. De même, à Madagascar de 1962
à 1980, l'augmentation de la pauvreté rurale est essentiellement
due à l'augmentation des inégalités dans la distribution
des revenus ruraux, alors que la croissance de la pauvreté urbaine
résulte de performances médiocres en termes de croissance
(Guénard et al., 2001).
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Ces résultats montrent simplement que pour
réduire la pauvreté au niveau global, il faut,
parallèlement à une relance de la croissance, mettre en place des
politiques géographiquement différenciées capables de
réduire les disparités sectorielles.
Une étude effectuée sur plusieurs capitales
africaines montre que les niveaux de pauvreté sont plus sensibles
à la variation des inégalités de revenu qu'à la
variation des revenus. Ainsi, pour l'ensemble formé d'Abidjan, Bamako,
Conakry, Ouagadougou et Yaoundé, toute augmentation de 1% du coefficient
de Gini se traduit par une augmentation de la pauvreté comprise entre 2
et 7% alors que l'accroissement du revenu moyen n'entraîne qu'une
augmentation de 0,5 à 1,3% de la pauvreté. A Yaoundé, un
accroissement du revenu moyen de 1% n'induit une réduction du ratio de
pauvreté que de 0,75 %.
Un autre aspect lié au niveau initial de
développement peut aussi expliquer le lien de la croissance avec la
réduction de la pauvreté. Par exemple, les pays d'Afrique et les
pays d'Amérique latine ont une élasticité du taux de
pauvreté à la croissance de l'ordre de -1. Pour les pays
d'Afrique, elle est le résultat d'un faible niveau de
développement et d'une distribution des revenus assez égalitaire
alors que pour les pays d'Amérique latine, davantage
développés, elle est le résultat des fortes
inégalités des revenus.
Epaulard (2003) présente d'autres tests
économétriques qui montrent que lorsque l'on distingue les
épisodes de croissance et ceux de contraction de l'activité, on
obtient que pour les épisodes de croissance, le taux de pauvreté
est réduit en moyenne comme le prévoit l'élasticité
théorique, alors que pour les épisodes de contraction de
l'activité et de crise, le taux de pauvreté augmente moins que ce
que prédit l'élasticité théorique.
Conformément à la littérature empirique
(Bourguignon, 2003 ; Fosu, 2010 et Epaulard, 2009), on déduit que
l'élasticité croissance du revenu à la pauvreté (en
valeur absolue) décroit avec le niveau initial des
inégalités, ainsi qu'avec la part du seuil standard de
pauvreté dans la moyenne des revenus. Cela dit, pour les régions
ou les pays présentant un niveau initial faible
d'inégalités et un niveau élevé de revenu moyen par
rapport à la pauvreté, la réponse de la réduction
de la pauvreté à la croissance du revenu par tête est plus
forte. A contrario, les pays ayant un niveau faible de revenu par tête et
une forte inégalité présenteront une faible
élasticité (en valeur absolue) croissance-pauvreté.
Cette deuxième partie nous a permis de mettre en
évidence le lien existant entre la croissance et la réduction de
la pauvreté. Selon des études faites, il a été
constaté que ce lien existe mais il
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 35
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
n'est toujours pas automatique. Pour arriver à
réduire la pauvreté, il est nécessaire
d'accélérer la croissance mais cette condition n'est pas
suffisante, d'autre facteurs sont à prendre en compte notamment les
politiques économiques mettant l'accent sur le bien-être de la
population surtout les citoyens sensiblement touchés par la
pauvreté.
Cependant dans un pays ou une zone où la
réduction de la pauvreté est devenue un objectif phare en soi
afin d'atteindre un développement très soutenu, celle-ci peut
être réalisée par la stimulation de la croissance
économique et/ou une atténuation des inégalités des
revenus et des actifs. La relation entre croissance et pauvreté tient
compte alors de la vision des économistes de développement qui
stipulent que les fruits de la croissance se diffusent automatiquement à
l'ensemble des segments de la société, conformément
à la célèbre hypothèse du « trickle down
».
D'autre part, d'autres travaux montrent que la
réduction de la pauvreté est fonction du taux de croissance et de
la variation de la distribution du revenu. De ce fait la croissance dite pro
pauvre consiste à offrir des opportunités permettant
d'améliorer la situation économique des personnes pauvres.
Cependant pour que la croissance soit bénéfique
aux pauvres, il faut que ces derniers participent massivement à
l'accroissement de la richesse nationale. Il est donc important que les
politiques économiques s'orientent sur le secteur agricole car ce
secteur emploi un effectif important des personnes vivant dans le milieu rural
qui est le milieu le plus touché par ce phénomène. D'un
autre côté, cette croissance peut agir sur les
inégalités. Une croissance accompagnée d'une forte
disparité des revenus ne contribue pas significativement à la
réduction de la pauvreté. Par conséquent, pour que la
croissance agisse significativement à la pauvreté il faut une
maitrise des inégalités donc une politique de réduction
des disparités des revenus.
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 36
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 37
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
CHAPITRE III : ANALYSE EMPIRIQUE, INTERPRETATION DES
RESULTATS ET RECOMMANDATIONS DES POLITIQUES ECONOMIQUES
Introduction
Dans ce chapitre nous allons présenter le modèle
théorique et la méthodologie adoptée pour tester
empiriquement les hypothèses de recherche ainsi indiquer la provenance
des données. En suite procéder aux tests
économétriques permettant de valider le modèle à
partir du Logiciel STATA 15, afin de pouvoir élucider les
recommandations des politiques économiques adaptées permettant de
réduire la pauvreté. Et cela à travers
l'interprétation des différents résultats obtenus. Pour ce
faire, nous allons utiliser des données annuelles issues de la base de
données de la banque mondiale (WDI, 2019) couvrant la période
1991 à 2015. Cette étude empirique s'applique sur les 8 pays de
l'UEMOA. Pour atteindre notre objectif, nous allons en premier temps
présenter les modèles, dans un deuxième temps les
estimations et la spécification du modèle et en troisième
temps faire l'analyse des résultats et décliner quelques
recommandations.
Section 1 : Présentation des modèles et
description des variables
Dans la présente section, nous présenterons les
modèles théoriques et économétriques qui seront par
la suite utilisées pour répondre à notre
problématique et décrire les variables explicatives qui
influencent la pauvreté.
1.1 Origine du modèle théorique
Pour expliquer comment la croissance peut avoir un impact
à l'amélioration du développement humain, il est essentiel
de comprendre le lien croissance-pauvreté et le rôle de
l'inégalité (de revenus) dans la réduction de la
pauvreté. C'est pourquoi, nous utilisons une régression
paramétrique linéaire de la pauvreté pour estimer
l'élasticité de la pauvreté à la croissance.
Plusieurs auteurs ont mené des travaux destinés à analyser
le lien croissance-pauvreté et inégalité (par exemple
Bourguignon, 2003 ; Dollar, 2001). Ainsi, pour arriver au modèle
d'estimation, nous partons du modèle de base développé par
Ravallion (1997) et Chen (1997) qui s'énonce comme suit :
?????????? = ???? + ??1????(??????) + ??2????(??????) + ????????
+ ?????? (2)
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
où ?? est une mesure de la pauvreté dans le pays
i pour l'année t ; sont les effets fixes
reflétant
les différences entre les pays au cours du temps. ??
représente le revenu par tête ; ??1 est
l'élasticité de la pauvreté par rapport à la
croissance économique ; ??2 est l'élasticité de
la pauvreté aux inégalités de revenu ayant comme proxy
l'indice de Gini, G. L'élasticité associée à
l'inégalité est supposée positive dans la mesure où
des taux de pauvreté élevés sont associés à
de fortes inégalités de revenu (Birdsall et Londono, 1997 ;
Ravallion, 1997) ; ?? est un vecteur
contenant les élasticités de la pauvreté
par rapport aux variables de contrôles et est le terme d'erreur incluant
les erreurs de mesure de l'indicateur de pauvreté.
Ce modèle de base, a fait l'objet de plusieurs tests.
Cependant les études de (Collier et Dollar, 2001 ; Bhalla, 2002),
montrent qu'une augmentation du revenu par tête réduit la
pauvreté, ainsi
le signe espéré pour le coefficient est
négatif 1.2 Modèle
économétrique
En prenant en compte les autres variables de contrôles
qui ont une grande influences autant sur la croissance économique et sur
la pauvreté, le modèle de base s'est élargi. Nous obtenons
un modèle adaptée à celle proposée par Ravallion et
Chen (1997) et utilisée par plusieurs économistes comme et Adams
(2004) ; Bourguignon (2003) ; Epaulard (2003) ; Fosu (2009, 2010, 2011) ;
Ravallion (1997) ; Chen (1997) ; Banque mondiale (2006a) ; Banque mondiale
(2006b) ; Kalwij et Verschoor (2007) qui va nous permettre d'analyser comment
la croissance et les inégalités affectent la pauvreté. Il
s'énonce ainsi:
?????????? = ??0 + ??1????(???? ??h????) + ??2????(??????) +
??3???????????????? + ??4?????????????? + ??5?????????????? + ??????
(3)
(?? = 1, ... , ?? ; ?? = 1, ... , ????)
Où ???? ?????? est le logarithme l'indice d'effectifs
mesuré comme la proportion de la population en dessous du seuil de
pauvreté dans la région i pendant la période t ;
??????????h est le logarithme du PIB par habitant ; ???????????????? est le
logarithme de l'indice de GINI ; ???????????????? représente le
logarithme de degré d'ouverture; ?????????????? le logarithme de la
croissance démographique, ?????????????? le logarithme du classement de
la transparence de la responsabilité et de la corruption; ??0
est le terme à effet fixe et ?????? un terme d'erreur de la fluctuation
de l'estimation de la pauvreté.
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 38
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 39
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Pour expliquer les changements dans les taux de
pauvreté, le modèle (3) est mieux adapté que ceux
intégrant uniquement la croissance économique, car les
inégalités affectent les changements dans le taux de
pauvreté ainsi que le niveau de développement. Toutes choses
étant égales par ailleurs, le coefficient
devrait être négatif : la croissance est bonne pour les
pauvres (Dollar et Kraay, 2001). Suivant les travaux
empiriques de Fosu (2010), le coefficient ??2 est supposé de
signe positif. Un niveau initial important d'inégalité a un effet
adverse sur l'effet puissant de l'accélération de la croissance
sur la réduction de la pauvreté, il n'est pas favorable pour les
pauvres. Pour le coefficient ??4, il est supposé positif, la preuve
suggère qu'une forte fécondité est autant un
symptôme de la pauvreté comme une cause. Il existe
généralement une relation positive entre la croissance
démographique et la pauvreté.
1.3 Descriptions des variables
Notre variable expliquée est la pauvreté. Nos
variables d'intérêt sont : Le Pib/habitant, l'indice de Gini, le
degré d'ouverture, la croissance démographique et la transparence
responsabilité et corruption
Variable endogène : P0 : Ratio
de la population pauvre en disposant de moins de 1.90$ par jour (2011 PPA) en %
de la population nationale. Il est défini comme le rapport
entre le nombre de personnes qui tombent sous le seuil de la pauvreté et
de la population totale ou bien comme la proportion de ménages dont le
revenu (ou la consommation selon la conception de l'enquête) est
inférieur au seuil. Pour l'estimation de l'élasticité
croissance-pauvreté, l'indicateur le plus utilisé est le taux de
pauvreté ou l'incidence de la pauvreté. Le seuil de 1,90$ par
jour est choisi selon la disponibilité des données.
Le PIB par habitant (en parité d'achat
constante de 2010) qui est le produit intérieur brut divisé par
la population en milieu de l'année. Il est représenté dans
nos estimations par PIBh.
L'indice Gini de l'inégalité des
revenus6 (GINI), il est couramment
utilisé dans les analyses pour mesurer les inégalités et
évaluer l'impact de la croissance sur la pauvreté. Une croissance
accompagnée d'une forte inégalité de revenu n'est pas
favorable aux pauvres. Pour son calcul, en général, les
économistes effectuent des enquêtes auprès des
ménages. Le revenu total d'un ménage, déduction faite des
impôts directs (ou la consommation totale du ménages) est
divisé par le nombre des personnes qui composent ce ménage. Puis
tous les individus pris en compte
6 Le coefficient de Gini mesuré est une mesure
standard de l'inégalité qui se situe entre zéro
(égalité parfaite) et 100 (inégalité parfaite)
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 40
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
dans l'enquête sont classés, du plus pauvre au
plus riche, en fonction de leur revenu. Sur un plan graphique, le coefficient
de Gini peut aisément être représenté par la surface
entre la courbe de Lorenz (résume le cumul des revenus par tête)
et la ligne d'égalité.
Le Degré d'ouverture (DOUV), qui est
la somme des exportations plus les importations en pourcentage du PIB. Il se
calcule à partir du taux d'ouverture qui s'obtient en additionnant des
exportations et importations d'un pays que l'on divise par 2 puis par le PIB de
ce pays, le tout en multipliant par 100. Cette mesure est introduite dans le
modèle pour tenir compte de l'influence d'une politique
d'intégration commerciale sur la pauvreté. Certaines
études ont montré que le commerce en tant que marché
important peut réduire la pauvreté dans les pays en
développement par le biais de la croissance économique.
La Croissance de la population (CPP) : Il
existe généralement une relation positive entre la croissance
démographique et la pauvreté. Mais, ce lien est
complexe7, l'expérience suggèrent qu'une
fécondité élevée est autant un symptôme de la
pauvreté comme une cause.
Transparence responsabilité et corruption (TRC)
qui représente le classement de la transparence, de la
responsabilisation et de la corruption dans le secteur public par l'EPIN
(1=faible et 6=élevée). Cet indicateur évalue dans quelle
mesure les dirigeants peuvent être tenus responsables de leurs
utilisations des fonds et des résultats de leurs actions par les
électeurs et par la législature et le système judiciaire,
ainsi que dans quelle mesure les hauts fonctionnaires du secteur public doivent
rendre des comptes au sujet de leurs décisions administratives, de
l'utilisation des ressources et des résultats obtenus (Banque mondiale).
La théorie veut qu'une fois que la corruption est très
importante, la pauvreté augmente davantage.
D'autre part, ce modèle repose sur les hypothèses
suivantes :
Avant de les énoncer, une hypothèse de recherche
est définie comme une présomption de comportement ou de relation
entre des objets étudiés, fondés sur une réflexion
et s'appuyant sur une connaissance antérieure du phénomène
étudié8.
7 Voir, par exemple, la Banque mondiale (2001). Les
objectifs de développement international : renforcer les engagements et
mesurer les progrès. Note du contenu préparée par le
Groupe de la Banque mondiale pour la Conférence de Westminster sur la
pauvreté des enfants, Londres, 26 février, pp.12.
8 Thiétart et coll.2003
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Hypothèse 1 : La PIB par habitant a un impact significatif
négatif sur la pauvreté autrement dit le signe
espéré pour le coefficient est négatif.
Hypothèse 2 : L'inégalité du revenu a une
influence significative positive sur la pauvreté autrement dit
??2 est positif.
Hypothèse 3 : Le degré d'ouverture influence
significativement la croissance économique qui par la suite impact la
réduction de la pauvreté, autrement dit le signe de
??3 est négatif.
1.4. Statistique descriptive des variables
Avant de procédé aux tests de spécification
nous allons tout d'abord effectuer une description des différentes
variables utilisées dans les estimations ultérieures et
énoncer les signes respectivement entendus pour chaque variable.
Tableau 3 : Statistique descriptive des variables du
modèle
|
Variables N. Obs Moyenne Std. Dev Min Max
Signes
|
|
Pauvreté P0
|
30
|
49,047
|
14,523
|
19,6
|
81,6
|
|
|
Indice GINI
|
35
|
41,597
|
5,597
|
31,5
|
54,1
|
+
|
|
PIB/hab
|
200
|
719,023
|
327,3233
|
322,778
|
11462,284
|
-
|
|
DOUV
|
33,0189
|
14,212
|
14,31
|
103,92
|
-
|
|
CPP
|
2,906
|
0,425
|
2,085
|
3,907
|
+/-
|
|
TRC
|
97
|
2,927
|
0,528
|
2
|
3,5
|
-
|
Zone Période
8 pays de l 'UEMOA
199 1 -201 5
On peut remarquer que le taux de pauvreté moyenne dans
l'ensemble des pays de l'UEMOA est de 49,047% tandis que le pic maximum est de
81,6%. La dispersion par rapport à la moyenne du ratio de la population
pauvre est de 14,523%. La moyenne de l'indice de GINI est de 41,597 ; son
écart-type est faible qui signifie que les valeurs sont peu
dispersées autour de la moyenne.
Section 2 : Estimations et tests de
spécifications
L'étude empirique se porte sur des données de
panel traitées à partir du logiciel stata. L'analyse à
partir d'un modèle de panel permet d'obtenir trois modèles
différents à savoir le modèle sans effets, le
modèle à effets fixes, le modèle aléatoires avec
leurs estimateurs respectifs du MCO, du Within et du MCG. La méthode des
MCO permet de prendre en considération
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 41
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 42
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
l'hétérogénéité des pays. Pour
cela, on se réfère au test de Hausman. Et la méthode de
MCG permet de contrôler en plus de
l'hétérogénéité,
l'endogénéité entre les variables.
2.1. Estimations économétriques
Compte tenu de la structure des données, nous avons choisi
l'approche par estimations en données de panel. Cette approche est
manifestée en raison de sa pertinence portée sur l'analyse des
données empiriques et également par la formation de
données qui sont sous la forme de données de panel. Elle a fait
l'objet d'étude importante porté par Fosu (2010).
? Estimation des paramètres
Le tableau ci-dessous représente les estimations des
paramètres des 3 modèles. Il se trouve que la relation entre la
variable dépendante et les variables explicatives sont identiques pour
tous les individus. Ci-dessous est représentée l'estimation des
paramètres du modèle logarithmique.
Tableau 4: Impact de la croissance sur la
pauvreté avec l'indice du Ratio de la population pauvre disposant de
moins de 1.90$ par jour (2011 PPA) en % de la population
nationale
|
Variables Modèle sans effet Modèle à
effet fixe Modèle à effet aléatoire
|
|
InPIBh
|
-0,701*
|
-0,779***
|
-0,669*
|
|
InGINI
|
0,672**
|
0,693**
|
0,727*
|
|
InDOUV
|
-0,102
|
-0,087
|
-0,107
|
|
InCPP
|
-0,518
|
-0,335
|
-0,387***
|
|
InTRC
|
0,508**
|
0,586
|
0,472***
|
|
Constant
|
6,290
|
2,731
|
5,818
|
|
R2
|
72,52%
|
83,44
|
84,35
|
N.B : Les notations (*), (**) et (***) indiquent
respectivement la significativité des variables aux seuils de 1%, 5% et
à 10%. (cf Annexe : A4, A5 et A6).
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
2.2. Tests de spécification
Nous allons effectuer les tests de spécifications pour
déterminer l'estimateur le plus performant. Le rôle d'un test de
spécification en données de panel consiste à justifier et
garantir le choix optimal du modèle le plus performant entre les
trois.
2.2.1 Test de Fischer
Le test de Fisher nous permet de déterminer la presence
du modèle sans effet ou du modèle à effets fixes.
L'hypothèse de presence d'effets fixes est retenue si la P-value
(Prob<F) est inférieure au seuil de 5%. Ce test est effectué
automatiquement par l'estimation des paramètres du modèle
à effets fixes. Le logiciel Stata donne :
F test that all u_i=0: F(7, 14) = 3.93 Prob > F =
0.0141
Ainsi la statistique de Fisher vaut 3,93 avec une
probabilité critique (0,0141) inférieure au seuil de 5%.
L'hypothèse nulle d'absence d'effets est rejetée, donc la
pauvreté n'est pas la même pour l'ensemble de
l'échantillon, l'estimateur Within est meilleur que l'estimateur des
MCO. Le modèle à effets fixes est meilleur que celui sans
effets.
2.2.2 Test de Breusch-Pagan
Le processus consiste à tester l'hypothèse H0
d'absence d'effets contre celle de la présence d'effets
aléatoires (H1). L'instruction xttest0 de stata permet d'effectuer ce
test, après estimation du modèle à effets
aléatoires. Ainsi, la statistique Breusch-Pagan (8,81) indique une
probabilité critique de 0,0015 qui est inférieure au seuil de 1%.
(cf annexe A7). L'hypothèse nulle d'absence
d'effets est rejetée au seuil de 1%. Le test de multiplicateur de
LaGrange suggère que l'estimateur des MCG est plus performant que celui
des MCO et rejette logiquement l'estimateur par les MCO dans la dimension
totale.
2.2.3 Test de Hausman
Le test de Hausman permet de prendre une décision entre
la présence d'effets aléatoires(H0) et la présence
d'effets fixes(H1). Etant donné que les tests de Fisher et de
Breusch-Pagan indiquent la presence d'effets spécifiques, nous
effectuons le test de Hausman pour discriminer les effets fixes et
aléatoires. Ainsi, l'hypothèse d'effets aléatoire est
rejetée si la P-value (Prob>chi2) est supérieure à 5%.
La probabilité critique (0.9961) est supérieure aux seuils
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 43
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 44
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
conventionnels de 1%, 5% et 10% (cf annexe A8).
L'hypothèse nulle d'absence de corrélation entre les effets
individuels et les variables explicatives n'est pas rejetée. Pour cela,
nous devons donc privilégier l'adoption d'un modèle à
effet aléatoire et retenir l'estimateur MCG. Ce dernier est le plus
performant pour expliquer la significativité des variables
explicatives.
2.3.Test de validation du modèle
Après avoir effectué à l'estimation du
modèle à travers les tests de spécifications, nous allons
procéder à la validation du modèle. Pour ce faire, il sera
nécessaire d'utiliser des critères économiques,
statistiques et économétriques afin de vérifier la
significativité du modèle.
2.3.1. Test de normalité des erreurs
Le test de normalité de Jarque et Bera (1984) est
fondé sur la notion du Skewness (asymétrie) et du Kurtosis
(aplatissement). Il permet de vérifier la normalité des
résidus. Par conséquent si la valeur calculée de la
statistique de Jarque Bera est inférieure au seuil, l'hypothèse
nulle de normalité des erreurs est retenue. Dans le cas où, la
valeur de JB est supérieure ou égale au seuil, l'hypothèse
nulle de normalité est rejetée. La valeur lue de JB au seuil de
5% est de 5,991
et la valeur calculée s'obtient à partir de cette
formule : ???? = ?? L??2 6 + (k-3)2
24 j . Apres
exécution du test sur stata 15, la valeur de JB
calculée vaut 1,550 (voir annexe
A13). Ainsi l'hypothèse nulle de normalité des
erreurs n'est pas rejetée, les résidus suivent une loi
normale.
2.3.2. Test
d'hétéroscédasticité des erreurs du
modèle
Ce test peut être fait à l'aide de plusieurs tests,
par exemple les tests de Breusch-Pagan, test de Goldfeld, test de Gleisjer et
test de White. Dans notre étude, nous prenons le test de Breusch-Pagan
pour tester l'hétéroscédasticité. Le processus
consiste à tester l'hypothèse nulle
d'homoscédasticité contre l'hypothèse alternative H1
hétéroscédasticité des résidus. Si la
probabilité associée au test est inférieure au seuil, on
rejette l'hypothèse d'homoscédasticité (H0). En revanche,
si la probabilité est supérieure au seuil, l'hypothèse
nulle est vérifiée.
La probabilité associée à la statistique
Chi(2) de Breusch-Pagan vaut 0,2881(Voir annexe A14)
supérieurs aux seuils conventionnels, alors
l'hypothèse nulle est vérifiée et nous pouvons supposer
l'homoscédasticité des résidus.
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
2.3.3. Test de spécification de Ramsey
Le test de spécification de Ramsey permet de
vérifier la spécification du modèle. Si l'hypothèse
nulle (H0) n'est pas rejetée, le modèle est bien
spécifié ; en revanche si l'hypothèse nulle est
rejetée le modèle est mal spécifié.
Apres exécution de la commande ovtest sur stata, nous
constatons que la probabilité critique(0,0623) est supérieure aux
seuils de 1% et 5% (voir Annexe A15). Nous ne
rejetons pas l'hypothèse H0, le modèle est donc bien
spécifié.
2.3.4. Test de corrélation
Le test de corrélation permet de voir à quel
point les variables sont liées. Afin d'identifier la présence de
corrélation, nous allons baser notre conclusion sur la valeur
indiquée par Kennedy (1985) où la valeur est égale
à 0.8. Donc, si les coefficients illustrés dans les
différents tableaux sont supérieurs ou égaux à 0.8,
on peut conclure à l'existence de problème de
corrélation.
Tableau 5: Matrice de corrélation des
variables du modèle
|
P0
|
PIBh
|
GINI
|
CPP
|
DOUV
|
TRC
|
|
P0
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
PIBh
|
-0,8403*
|
1,000
|
|
|
|
|
|
GINI
|
0.2959
|
0.0157
|
1.000
|
|
|
|
|
CPP
|
0.3690*
|
-0.3872*
|
-0.4127*
|
1.0000
|
|
|
|
DOUV
|
-0.3127*
|
0.1186*
|
-0.0527
|
-0.2117*
|
1.0000
|
|
|
TRC
|
0.2503
|
0.0278
|
-0.1323
|
0.2419*
|
-0.3737*
|
1.0000
|
Certains variables sont fortement corrélés
tandis que d'autres n'en ont pas. Le PIB par tete et le degré
d'ouverture sont corrélés négativement à la
pauvreté tandis que la croissance démographique est
corrélée positivement à la pauvreté. Par rapport au
PIB par habitant, la croissance est corrélée négativement
tandis que le degré d'ouverture est corrélé positivement.
L'indice de GINI et la croissance démographique sont
corrélées négativement.
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 45
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
2.4.Examen graphique
Nous allons dans ce paragraphe, analyser le graphique de la
relation du PIB par habitant et le taux de pauvreté.
Figure 3: Test de corrélation du PIB/hab
sur le taux de la pauvreté au seuil de 1,90$ par jour

Ce graphique nous permet de détecter la
corrélation entre le PIB par habitant et le taux de pauvreté.
Après avoir examiné ce graphique, le constat est clair, ces deux
variables sont fortement corrélées avec une corrélation
négative. Le nuage des points se rapproche pour la plupart des points
à la droite de régression, Le coefficient de corrélation
vaut -0,82 (cf annexe A9), cela explique la forte dépendance de ces deux
variables et confirme à nouveau l'impact significatif du PIB par
habitant sur à la pauvreté.
2.3 Exercice de robustesse : Tester l'effet de la
croissance sur la pauvreté avec l'indice de l'écart de
pauvreté à 1,90 $ par jour (2011 PPP)
L'exercice robuste nous permet de suivre la tendance des
personnes susceptibles de tomber dans la pauvreté.
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 46
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 47
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Tableau 6: Effet de la croissance sur la
pauvreté avec l'indice de l'écart de pauvreté à
1,90 $ par jour (2011 PPP)
|
Variables Modèle sans effet Modèle à
effet fixe Modèle à effet aléatoire
|
|
InPIBh
|
-0,946*
|
-1,067**
|
-0,966*
|
|
InGINI
|
2,309*
|
2,249**
|
2,282*
|
|
InDOUV
|
-0,142
|
-0,078
|
-0,114
|
|
InCPP
|
-0,619
|
-0,636***
|
-0,636**
|
|
InTRC
|
0,657**
|
0,5149
|
0,518
|
|
Constant
|
0,949
|
1,909
|
1,251
|
|
R2
|
84,61%
|
83,28
|
83,24
|
N.B : Les notations (*), (**) et (***) indiquent
respectivement la significativité des variables aux seuils de 1%, 5% et
à 10%. (Voir en annexe A10, A11, A12)
Section 3 : Résultats et recommandations de
politiques économiques
Dans cette section nous allons interpréter les
résultats obtenus à partir des estimations
précédentes et énumérer certaines recommandations
jugées nécessaires pour l'amélioration du niveau de vie de
la population pauvre des pays de l'UEMOA.
3.1 Interprétation des résultats
En vue des différents tests effectués notamment
le test de Fischer (Likelihood Ratio Test), le test de Breusch et Pagan (le
LM-test) et le test de Hausman, le modèle à effet
aléatoire est le plus privilégié pour mieux expliquer la
significative des variables. L'estimateur MCG est le plus performant pour mener
à bien l'analyse de notre étude. Cependant, le
modèle à effets
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
aléatoire est le meilleur modèle pour
estimer l'impact de la croissance sur la pauvreté des pays de
l'UEMOA.
Pour ce modèle, le R2 le plus pertinent est
le R2 betwen qui permet de donner une idée sur la
contribution des effets aléatoires du modèle. Sa valeur vaut
0,8435, cela indique que 84,35% des fluctuations de la pauvreté (Ratio
de la population pauvre en disposant de moins de 1.90$ par jour (2011 PPA) en %
de la population nationale) sont expliquées par le PIB par habitant,
l'indice de Gini, la croissance de la population, le degré d'ouverture
et la perception de la corruption. Les fluctuations restantes sont prises en
compte par d'autres facteurs en dehors du modèle
représenté par ??????. La valeur importante du coefficient de
détermination signifie que le modèle a un fort pouvoir
explicatif. Aux termes des différentes estimations, on note aussi une
significativité globale du modèle avec une probabilité
nulle (Prob>chi2 =0,0000). Cela se confirme par le test de Fischer.
Par ailleurs, l'analyse de la matrice de corrélation a
montré que la corrélation est bien élevée qui
illustre les liaisons entre les variables. En effet, les corrélations
entre les variables exogènes sont inférieures à 0.8, on
conclut donc à l'absence de problème de corrélation.
Egalement, l'identification de
l'hétéroscédasticité montre que la
probabilité associée à la statistique Breusch-Pagan (8,81)
est inférieure aux seuils conventionnels. Donc l'hypothèse
d'hétéroscédasticité est retenue.
Par rapport aux hypothèses mises, la première
hypothèse portant impact du PIB par habitant sur
^
la pauvreté est largement validée. Le
coefficient fi = -0,669 associé à la variable
PIBh est négatif et significatif aux seuils conventionnels. On peut donc
dire que la croissance importante enregistrée dans les pays de l'UEMOA a
un effet sur la réduction de la pauvreté.
Ce resultat confirme les études de (Collier et Dollar,
2001 ; Bhalla, 2002), il est en conformité avec les résultats de
Madeleine TOMO NKONO portant sur l'analyse empirique de l'impact de la
pauvreté sur la croissance dans la zone CEMAC et UEMOA. Cependant
si la croissance augmente de 10%, la pauvreté va diminuer de
6,69%. Toutes choses égales par ailleurs.
L'hypothèse 2, elle aussi est
validée. L'indice de Gini agit significativement et positivement sur la
pauvreté. Une croissance accompagnée d'une augmentation des
inégalités de revenu ne
^
|
favorise pas la réduction de la pauvreté.
L'élasticité de la pauvreté-inégalités vaut
f2
|
= 0,727.
|
L'effet marginal est positif, cela implique qu'une
augmentation de 10% les inégalités va
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 48
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 49
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
entrainer une augmentation de la pauvreté
7,27%, toutes choses égales par ailleurs. Cette
hypothèse confirme aussi les travaux expliquant l'effet des
inégalités sur la pauvreté.
Par rapport à l'hypothèse 3 du
modèle, les résultats obtenus ne valident pas l'hypothèse
préalablement posée. L'effet du degré d'ouverture n'est
pas significatif sur la pauvreté mais agit négativement sur la
pauvreté. Cela peut être causé par la faible ouverture au
commerce international des pays de la zone et la difficulté des
économies Africaines à s'insérer dans le processus de la
mondialisation.
Par rapport à l'effet de la croissance
démographique sur la pauvreté, la variable croissance de la
population est significative et positive. Ce qui est contradictoire à
notre hypothèse de base étant donné que l'effet marginal
pauvreté-croissance démographique est négatif. Ainsi, les
résultats obtenus après estimation indiquent qu'une
augmentation de 10% de la croissance de démographique
entraine une réduction de la pauvreté de 3,88%,
toutes choses égales par
=
^
ailleurs. L'élasticité de la croissance
démographique par rapport à la pauvreté vaut fl,
-0, 388. Cela peut s'expliquer par l'augmentation du taux de
scolarisation des pays de l'UMEOA qui est source de perfection de main d'oeuvre
qualifié. Une fois que le capital humain s'améliore, la
production s'amplifie.
Par rapport à la significativité de la variable
la transparence, responsabilité et corruption, elle agit positivement et
significativement sur la pauvreté. Cela laisse comprendre qu'un pays qui
se rapproche à 6 au classement de la transparence, de la
responsabilisation et de la corruption dans le secteur public est susceptible
d'avoir une pauvreté très élevée.
Sur ce, ces résultats cadrent parfaitement avec les
conclusions de la théorie économique mettant en évidence
l'importance de ces facteurs pour l'explication du modèle. Le non
significativité du degré d'ouverture peut probablement
s'expliquer par le fait que les économies Africaines accusent un retard
au niveau de la mondialisation.
Pour notre test de robustesse, nous allons à nouveau
estimer l'équation (3), avec l'indice d'écart de pauvreté,
les résultats sont indiqués en annexe. Cette mesure
reflète l'ampleur de la pauvreté ainsi que son incidence. C'est
un exercice supplémentaire du modèle de panel appliqué sur
les pays de l'UEMOA afin de savoir la tendance des personnes susceptibles de
tomber dans la pauvreté. Comme dans l'étude
précédente, nous utilisons également les trois
modèles, modèle sans effets, modèle à effet simple
et modèle à effet aléatoire pour faire l'analyse du
phénomène.
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Après simulation du modèle, la tendance de la
significativité des variables de l'indice d'écart de la
pauvreté sont similaires à celle obtenue avec le Ratio de la
population. Cependant le degré d'ouverture n'est pas significatif dans
les trois modèles. L'indice de la transparence, responsabilité et
corruption n'est significatif que sur le modèle sans effet au seuil de
5%.
Avec l'indice de Gini, le coefficient de
l'élasticité de l'indice de Gini par rapport à
l'écart de la
|
^
pauvreté ????
|
a triplé dans les trois modèles impliquant une
forte inégalité dans la dispersion de
|
la pauvreté contrairement au niveau du Ratio de la
population pauvre dont l'élasticité était moyennement
faible. Tout en maintenent sa significativité, ce coefficient est
passé de 0,727 à 2,282 avec le modèle à effets
aléatoire. Cela implique qu'une augmentation de 10% des
inégalités va entrainer une augmentation de 22,82 de
l'écart de la pauvreté, toutes choses égales par
ailleurs. La tendance est pareille dans les deux autres modèles. En
outre, les résultats trouvés de l'indice d'écart de
pauvreté ne modifient pas nos conclusions préalables de l'effet
de la croissance sur la pauvreté.
3.2 Recommandations des politiques économiques
L'analyse des résultats nous permet de dégager
quelques recommandations en termes de politique de croissance économique
jugées importantes d'accélérer la croissance et la
réduction de la pauvreté.
L'étude nous montre qu'il y a un lien entre la
croissance économique et la pauvreté. Cependant, la croissance
elle seule ne suffit pas de réduire la pauvreté, il faut
renforcer les stratégies de croissance accélérée et
parallèlement mettre en place une politique de maitrise des
inégalités car une croissance accompagnée d'une forte
inégalité n'est pas favorable aux pauvres. L'augmentation du taux
de croissance du PIB réel par tête se traduit par une hausse du
taux des dépenses de consommation finale des ménages par
tête. Ainsi, le PIB réel par tête apparait comme un
principal déterminant macro-économique et agit comme un facteur
principal dans la réduction de la pauvreté.
D'autre part mettre en place des politiques de redistribution
de la richesse. Pour cela, il faut des bases fiscales larges et assez stables.
La question de la réduction des inégalités doit être
au coeur des stratégies des pouvoirs publics et en faire une
priorité afin de réduire significativement la pauvreté.
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 50
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Ayant constaté que la corruption engendre des effets
néfastes pour la lutte contre la pauvreté, les pays dont le
niveau de corruption est élevé ont un taux de pauvreté
très conséquent. Ainsi, il faut mettre en place une politique de
bonne gouvernance et de transparence permettant d'assurer la continuité
des actions entreprises pour relancer l'économie. Ces deux notions sont
primordiales pour promouvoir une croissance durable et garantir une
stabilité de long terme.
Egalement, il faut mettre en place des politiques
macroéconomiques et sectorielles favorisant la croissance pro-pauvre
notamment en orientant davantage les dépenses d'éducation et de
santé aux profits de la population plus touché par la
pauvreté. Il s'agit donc de mettre l'accent sur les politiques de
croissance inclusive. Cela peut se traduire par des politiques industrielles
intensives en main-d'oeuvre. Ceci en mettant en place des mesures de
prévention et de securité afin d'éviter que ceux qui sont
proches de la pauvreté n'y tombent au moindre choc économique. Il
faut également renforcer l'intégration régionale.
D'autre part, il faut tenter de renforcer la bonne gouvernance
pour mettre une barrière à la corruption car la fragilité
des institutions est un obstacle au développement. En effet, la lutte
contre la mauvaise gouvernance serait une façon plus pragmatique de
lutter contre les inégalités, car au bout du compte, ce sont
toujours les plus pauvres qui paient le prix des dysfonctionnements des
Etats.
Les résultats obtenus dans notre étude ne
confirment pas le lien important des politiques d'ouvertures commerciales pour
réduire la pauvreté. Cela est dû au fait que, les
marchandises des Etats membres de l'Union sont peu présentes sur le
marché mondial. En dehors de ce resultat, nombreux d'études
empiriques tentent à identifier ce lien mais des nuances apparaissent
toujours quant à la conclusion. L'effet notamment de politiques
d'ouverture commerciales sur la pauvreté est difficile à
établir (Dollar et Kraay, 2000). C'est ainsi qu'une politique de
renforcement des exportations des marchandises est tres recommandée pour
faire pour augmenter la croissance économique et réduire par
conséquence la pauvreté.
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 51
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 52
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre travail, l'objectif principal consistait
à analyser l'impact de la croissance économique sur la
pauvreté dans les pays de l'UEMOA. Notre argument de base suppose qu'une
augmentation de la croissance économique entraine une réduction
de la pauvreté, néanmoins cet effet peut etre amoindri par
l'inégalité des revenus s'il n'est pas bien maitrisé.
Alors que l'expérience asiatique tend effectivement
à mettre en évidence cette corrélation étroite
entre croissance économique et réduction de la pauvreté,
elle semble moins évidente en Afrique subsaharienne. La croissance
moyenne dépasse les 5% ces dernières années pourtant ses
fruits et son implication dans l'allégement de la pauvreté semble
moins ressenti.
La démarche adoptée dans ce travail se veut
pertinente en raison de la méthodologie économétrique
utilisée qui se porte sur une analyse des données de panel
statique et dynamique dans une zone bien définie. En suite sur
l'importance de l'intégration de la variable inégalité de
revenu et d'autres variables de contrôles dans l'étude de l'impact
de la croissance économique sur la pauvreté. Nous avons
utilisés une régression paramétrique linéaire de la
pauvreté pour estimer l'élasticité de la pauvreté
par rapport à la croissance.
L'atteinte de cet objectif s'est traduite d'abord par la
présentation des concepts de base de la pauvreté, la croissance
économique en passant par la notion de répartition de revenu pour
finir sur l'effet ressenti de la croissance économique et les variables
de contrôles dans la lutte contre la pauvreté. Cependant, il nous
a paru raisonnable de tester d'une part l'hypothèse de réduction
de la pauvreté par une augmentation de la croissance et d'autre part
l'hypothèse de la baisse de la pauvreté suite à une
réduction des inégalités.
La notion de la pauvreté s'est avérée
préoccupante, les autorités de l'UEMOA ont érigé au
premier rang des priorités la réduction de la pauvreté.
Selon son enjeu multidimensionnel, les multiples approches relatives à
la définition de la pauvreté, nous ont conduits à
considérer la pauvreté monétaire dans notre
étude.
Cette étude a permis de comprendre le rôle majeur
que peut jouer la croissance au profit de la réduction de la
pauvreté. Cette pauvreté peut être réduite par une
croissance économique inclusive axée sur une production de biens
et services ou encore une création d'emploi et de
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
richesse. Cette croissance économique peut être
mesurée par plusieurs indicateurs. Nous avons choisi l'indicateur de PIB
par tête.
D'autre part la pauvreté peut être
également réduite grâce à une réduction des
inégalités cela à travers un partage rationnel de revenu.
L'efficacité de la croissance à réduire la pauvreté
dépend pour chaque pays de son niveau initial de développement et
des inégalités de revenu. Une croissance accompagnée d'une
forte inégalité ne favorise pas la réduction de la
pauvreté.
Beaucoup d'économistes ont fait d'études
relatives à l'effet de la croissance économique sur la
réduction de la pauvreté. Trois postulats ont été
établis à travers le triangle de «
croissance-pauvreté-inégalités ».
(1) la croissance est bonne pour les pauvres à travers la
théorie de la croissance pro-pauvre
(2) la croissance comme une condition nécessaire, mais
non suffisante.
(3) la croissance est suffisante pour les pauvres à
travers la théorie de l'économie des retombées.
Après simulation, nous avons adopté le
modèle à effet aléatoire et retenir l'estimateur MCG qui
est le plus performant pour expliquer la significativité des variables
explicatives. L'analyse empirique nous a fournis des estimations du taux de
pauvreté et de l'indice de l'écart de pauvreté, au seuil
de 1,90$ par jour avec des spécifications d'effets aléatoires.
À cet égard, nos estimations montrent qu'elles sont
significatives pour stimuler la réduction de la pauvreté. Comme
Adams (2004), Epaulard (2003) et Fosu (2009, 2010, 2011), nos résultats
économétriques montrent que la croissance économique joue
un rôle vital dans la réduction de la pauvreté. Les
résultats de la régression montrent que la croissance
économique et l'inégalité des revenus ont un impact
statistiquement significatif pour la réduction de la pauvreté.
Cependant, la croissance économique doit être
accompagnée d'une politique de maitrise des inégalités car
une croissance accompagnée d'une forte inégalité n'est pas
favorable aux pauvres. D'autre part, il est essentiel de mettre en place des
politiques macroéconomiques et sectorielles favorisant la croissance
pro-pauvre et d'orienter davantage les dépenses d'éducation et de
santé aux profits de la population plus touché par la
pauvreté.
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 53
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
BIBLIOGRAPHIE
Adams,
JR. et Richard, H. 2003 « Croissance
économique, inégalités et pauvreté ». Aghion,
P. et Armendáriz, B., 2004 « Croissance endogène et
réduction de la pauvreté ». Attanasio, O. et Binelli, C.,
2004 « Inégalités, croissance et politiques redistributives
». Avom, D. et Carmignani, F., 2008 « Pauvreté, croissance et
redistribution ».
BAD, 2012, 2016 « Indicateurs sur le genre, la
pauvreté et l'environnement dans les pays africains ».
BCEAO « Perspectives économiques des Etats de l'UEMOA
en 2006 ». BCEAO, 2002, 2011, 2014, 2016 « rapport annuel de la BCEAO
».
Berenger, V., 2008 « Analyse de l'impact de la croissance
sur la pauvreté et identification des stratégies de croissance
bénéfique aux pauvres (« pro-poor growth strategies »).
Etude des cas pour six pays partenaires méditerranéens : Egypte,
Israël, Liban, Maroc, Tunisie et Turquie. Rapport final du projet de
recherche FEM 31-06R »
Bourguignon, F., 2004 « Le triangle
pauvreté-croissance-inégalités ».
CEDEAO « Profil de pauvreté dans les pays de la
CEDEAO ».
Chataîgner, J-M., Raffinot, M., 2005 « la croissance
pro-pauvres : définition et politiques ».
Cling, J., De Vreyer, Ph. Razafindrakoto, M. et Roubaud, F.,
2004 « La croissance ne suffît pas pour réduire la
pauvreté »
Datt, G. et Ravallion, M., 2002 « Why Has Economic Growth
Been More Pro-Poor in Some States of India Than Others ? » Journal of
Development Economics, 68, pp. 381-400.
Delleur, P., 2005 « Commerce, croissance et réduction
de la pauvreté »
Dollar, D., et Kraay, A., 2000 « Growth is good for the poor
», Washington D.C, World Bank.
Dollar, D., Kraay, A. (2001) « Commerce, croissance et
pauvreté. Politique de la Banque mondiale Document de travail de
recherche n ° 2615 »
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY XI
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Dollar, D., Kraay, A. (2002) « La croissance est bonne pour
les pauvres. La Banque mondiale, Journal of Economic Growth, vol 7, n ° 3,
p. 195-225 ».
Ehrhart, C., 2006 « Croissance, redistribution et lutte
contre la pauvreté : l'évolution non linéaire de
l'approche de la Banque mondiale »
Ehrhart, C., 2012 « La croissance a-t-elle été
favorable aux pauvres en Égypte sur la période 1990-2004 ?
»
Épaulard, A., 2003 « Croissance et réduction
de la pauvreté dans les pays en développement et les pays en
transition »
Épaulard, A., 2003 « Performance
macroéconomique et réduction de la pauvreté »
Fall, EL., Alofa, J. et Akplogan, M., 2015 « De la relation
entre croissance et pauvreté en Afrique : Pourquoi l'Afrique n'a-t-elle
pas suffisamment réduit la pauvreté sur la période des
OMD? »
Fosu, A.K. « Growth, inequality, and poverty reduction in
developing countries: Recent global evidence »
Ftiti, Z. « Stabilité-croissance et performance
économique : quelle relation selon une revue de la littérature ?
»
Griffoni, C. 2006 « Croissance économique et
pauvreté : une application de l'indice de « croissance pro-pauvre
» au cas du Maroc entre 1985 et 1999 »
Guénard, C. et Dubois, J. « Inégalités,
croissance et pauvreté en Afrique subsaharienne »
Mbandza, J., 2009 « Pauvreté et pertinence des
modèles de croissance dans les pays en développement »
MOHAMED BELLO, I. « Gouvernance et Réduction de la
pauvreté dans les pays de l'UEMOA : Comptabilisation du mécanisme
de transmission »
Mokaddem, L. et Boulila, G. « croissance pro-pauvres dans
des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord
Muet, P.A., 1993, « Les théories contemporaines de la
croissance »
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY XII
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY XIII
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Sen, A. « Analyse de la pauvreté : de l'approche en
termes d'Utilité à l'approche par les capabilités
»
Srinivasan, T.N., 2000 « Croissance et allégement de
la pauvreté : les leçons tirées de l'expérience du
développement »
Tanimoune, N.A., Plane, P., 2005 « Performance et
convergence des politiques économiques en zone franc »
TOMO NKONO, M. « Does economic growth affect poverty in
CEMAC and WAEMU zone1? : An empirical comparative analysis with panel data
»
UEMOA, 2016, « Premier rapport sur l'état de la
pauvreté au sein de l'UEMOA 2000-2010 »
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY XIV
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
ANNEXES
A1 : Evolution de l'incidence de la pauvreté dans
les Etats de l'UEMOA
|
Etats
|
Incidence de la pauvreté
|
|
1994-1999
|
2000 - 2005
|
2006 - 2009
|
2010 - 2011
|
2014 - 2015
|
|
Avant DRSP
|
DSRP I
|
DSRP II + DSRRP - AO
|
DSRP III + DSRRP - AO
|
Base de
Données BM
|
|
Bénin
|
29,6
|
28,4
|
35,2
|
36,2
|
40,1
|
|
Burkina
Faso
|
45,6
|
38,4
|
48,9
|
-
|
40,1
|
|
Côte
d'Ivoire
|
33,6
|
38,4
|
48,9
|
-
|
46,3
|
|
Guinée
Bissau
|
-
|
64,7
|
-
|
69,3
|
-
|
|
Mali
|
-
|
55,6
|
47,5
|
43,6
|
-
|
|
Niger
|
-
|
62,1
|
59,5
|
-
|
44,5
|
|
Sénégal
|
67,9
|
55,2
|
48,3
|
46,7
|
-
|
|
Togo
|
-
|
-
|
61,7
|
58,7
|
55,1
|
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
A2 : Evolution de l'incidence de la pauvreté
dans les zones urbaines et rurales des Etats de l'UEMOA
|
Etats
|
Zone
|
Incidence de la pauvreté par période
|
|
94 -99
|
00 - 05
|
06 - 09
|
10 - 11
|
14 - 15
|
|
Avant
DRSP
|
DSRP I
|
DSRP II +
DSRRP - AO
|
DSRP III +
DSRRP - AO
|
Base de
données BM
|
|
Bénin
|
Urbain
|
23,3
|
23,6
|
29,8
|
31,4
|
-
|
|
Rural
|
33
|
31,6
|
38,4
|
39,7
|
-
|
|
Burkina
Faso
|
Urbain
|
16,5
|
19,9
|
27,5
|
-
|
13,7
|
|
Rural
|
51
|
52,3
|
52,2
|
-
|
47,5
|
|
Côte
d'Ivoire
|
Urbain
|
-
|
24,5
|
29,5
|
-
|
35,9
|
|
Rural
|
-
|
49
|
62,5
|
-
|
56,8
|
|
Guinée
Bissau
|
Urbain
|
-
|
51,6
|
-
|
51
|
-
|
|
Rural
|
-
|
69,7
|
-
|
75,6
|
-
|
|
Mali
|
Urbain
|
-
|
27,7
|
18,5
|
18,9
|
-
|
|
Rural
|
-
|
64,8
|
57
|
50,6
|
-
|
|
Niger
|
Urbain
|
52,2
|
-
|
44,1
|
-
|
-
|
|
Rural
|
65,7
|
44,1
|
65,7
|
-
|
-
|
|
Sénégal
|
Urbain
|
56,4
|
38,1
|
28,1
|
26,2
|
-
|
|
Rural
|
71
|
65,1
|
58,8
|
57,3
|
-
|
|
Togo
|
Urbain
|
-
|
-
|
37,1
|
34,1
|
35,9
|
|
Rural
|
-
|
-
|
75,1
|
73,4
|
68,7
|
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY XV
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY XVI
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
A3 : Evolution de la profondeur de la pauvreté
dans les Etats de l'UEMOA
|
Etats
|
Profondeur de la pauvreté par période
|
|
1994 -1999
|
2000 - 2005
|
2006 - 2009
|
2010 - 2011
|
2014 - 2015
|
|
Avant DRSP
|
DSRP I
|
DSRP II +
DSRRP - AO
|
DSRP III +
DSRRP - AO
|
Base de
données BM
|
|
Bénin
|
8,7
|
10,9
|
10,4
|
9,8
|
-
|
|
Burkina Faso
|
13,7
|
15,5
|
14,9
|
-
|
9,7
|
|
Côte d'Ivoire
|
-
|
12,9
|
18,2
|
-
|
16,3
|
|
Guinée Bissau
|
-
|
0,05
|
-
|
-
|
-
|
|
Mali
|
-
|
21,2
|
16,7
|
13,2
|
-
|
|
Niger
|
21,4
|
24,1
|
19,6
|
19,6
|
-
|
|
Sénégal
|
-
|
17,3
|
15,5
|
14,5
|
-
|
|
Togo
|
-
|
-
|
23,6
|
24,4
|
22,1
|
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY XVII
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
A4: Régression du modèle sans effets, indice de
taux de pauvreté au seuil de 1,90$ par jour par jour (2011 PPP) sur les
variables explicatives.
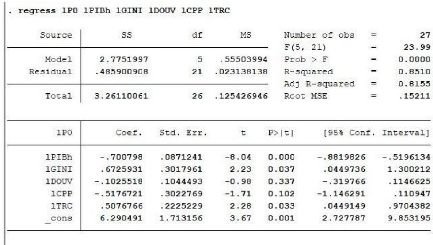
A5: Régression du modèle à
effets fixes, indice de taux de pauvreté au seuil de 1,90$ par jour par
jour (2011 PPP) sur les variables explicatives.
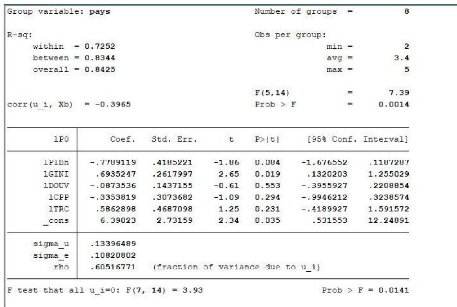
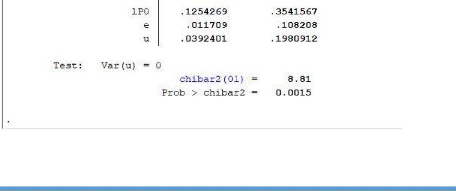
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY XVIII
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
A6 : Régression du modèle à effets
aléatoires, indice de taux de pauvreté au seuil de 1,90$ par jour
par jour (2011 PPP) sur les variables explicatives.
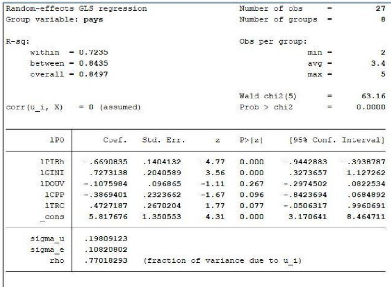
A7 : Test de Breusch-Pagan

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY XIX
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
A8 : Test de Hausman
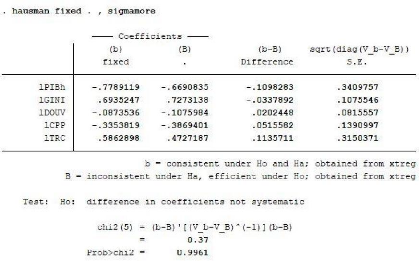
A9 : Test de corrélation
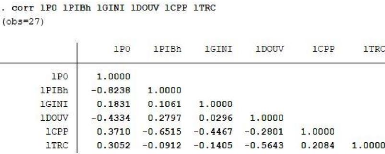
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY XX
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
A10 : Régression du modèle sans effets, indice de
l'écart de la pauvreté au seuil de 1,90$ par jour par jour (2011
PPP) sur les variables explicatives

A11 : Régression du modèle à effets fixes,
application de l'indice de l'écart de la pauvreté au seuil de
1,90$ par jour par jour (2011 PPP) sur les variables explicatives
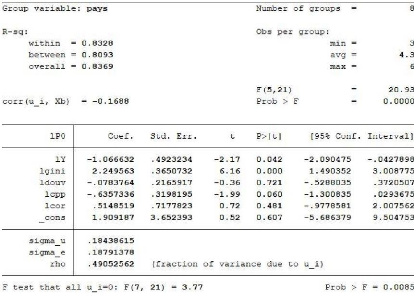
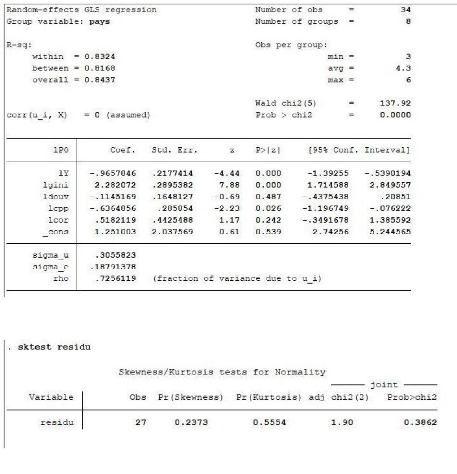
A13. Test de normalité de normalité des
résidus
A15. Test d'hétéroscédasticité des
erreurs du modèle
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY XXI
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
A12 : Régression du modèle à effets
aléatoire, application de l'indice de l'écart de la
pauvreté au seuil de 1,90$ par jour par jour (2011 PPP) sur les
variables explicatives
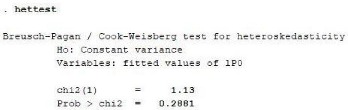
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY XXII
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
A15. Test de spécification de Ramsey
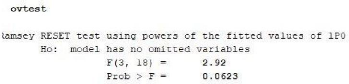
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY XXIII
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
TABLE DES MATIERES
DEDICACES I
REMERCIEMENTS II
SIGLES ET ACRONYMES III
LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX VII
SOMMAIRE VIII
RESUME VIII
ABSTRAIT X
INTRODUCTION GENERALE 1
Chapitre I : CARACTÉRISTIQUES ET
ÉVOLUTIONS DE LA CROISSANCE ET DE
LA PAUVRETÉ 6
Section 1 : Profil de la croissance et Évolution
de la pauvreté des Etats de l'UEMOA . 6
I.1. Etat des performances de croissance
économique des pays de l'UEMOA 6
I.2. Politique de la croissance et cadre
macroéconomique de l'UEMOA 7
II. Évolution de la pauvreté dans les
économies des pays de l'UEMOA 9
II.1. Evolution de l'incidence de la pauvreté au
niveau des Etats 9
II.2. Evolution des indicateurs sociaux
11
Section 2 : Croissance pro-pauvres et politiques de
réduction de la pauvreté au sein de
l'UEMOA 13
1. Croissance pro-pauvres et leur extension aux
dimensions non monétaires de la
pauvreté 13
2. Politiques de croissance et de réduction de la
pauvreté 17
Chapitre II : REVUE DE LA LITTÉRATURE SUR LA
CROISSANCE
ECONOMIQUE ET PAUVRETÉ 20
Section 1 : Analyse théorique de la croissance
économique et pauvreté 20
1.1 Fondements théoriques 20
1.2 Développement théoriques récents
23
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY XXIV
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
Section 2 : Evidences empiriques entre croissance
économique et pauvreté 29
2.1 Aspects empiriques de l'effet de la croissance
économique sur la réduction de
la pauvreté. 29
2.2 Aspects empiriques de l'effet de la croissance
économique et des inégalités sur
la réduction de la pauvreté.
33
CHAPITRE III : ANALYSE EMPIRIQUE, INTERPRETATION DES
RESULTATS
ET RECOMMANDATIONS DES POLITIQUES ECONOMIQUES
37
Section 1 : Présentation des modèles et
description des variables 37
1.1 Origine du modèle théorique
37
1.2 Modèle économétrique
38
1.3 Descriptions des variables 39
1.4. Statistique descriptive des variables 41
Section 2 : Estimations et tests de spécifications
41
2.2. Tests de spécification 43
2.2.1 Test de Fischer 43
2.2.2 Test de Breusch-Pagan 43
2.2.3 Test de Hausman 43
2.3. Test de validation du modèle 44
2.3.1. Test de normalité des erreurs
44
2.3.2. Test
d'hétéroscédasticité des erreurs du modèle
44
2.3.3. Test de spécification de Ramsey
45
2.3.4. Test de corrélation 45
2.4. Examen graphique 46
2.3 Exercice de robustesse : Tester l'effet de la
croissance sur la pauvreté avec
l'indice de l'écart de pauvreté à
1,90 $ par jour (2011 PPP) 46
Section 3 : Résultats et recommandations de
politiques économiques 47
3.1 Interprétation des résultats
47
3.2 Recommandations des politiques économiques
50
CONCLUSION GENERALE 52
BIBLIOGRAPHIE XI
MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET
ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY XXV
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
ANNEXES XIV
A1 : Evolution de l'incidence de la pauvreté dans
les Etats de l'UEMOA XIV
A2 : Evolution de l'incidence de la pauvreté dans
les zones urbaines et rurales des
Etats de l'UEMOA XV
A3 : Evolution de la profondeur de la pauvreté
dans les Etats de l'UEMOA XVI
A4: Régression du modèle sans effets,
indice de taux de pauvreté au seuil de 1,90$ par
jour par jour (2011 PPP) sur les variables explicatives.
XVII
A5: Régression du modèle à effets
fixes, indice de taux de pauvreté au seuil de 1,90$
par jour par jour (2011 PPP) sur les variables
explicatives. XVII
A6 : Régression du modèle à effets
aléatoires, indice de taux de pauvreté au seuil de
1,90$ par jour par jour (2011 PPP) sur les variables
explicatives. XVIII
A7 : Test de Breusch-Pagan XVIII
A8 : Test de Hausman XIX
A9 : Test de corrélation XIX
A10 : Régression du modèle sans effets,
indice de l'écart de la pauvreté au seuil de
1,90$ par jour par jour (2011 PPP) sur les variables
explicatives XX
A11 : Régression du modèle à effets
fixes, application de l'indice de l'écart de la pauvreté au seuil
de 1,90$ par jour par jour (2011 PPP) sur les variables
explicatives
XX
A12 : Régression du modèle à effets
aléatoire, application de l'indice de l'écart de la
pauvreté au seuil de 1,90$ par jour par jour (2011 PPP) sur les
variables explicatives
XXI
A13. Test de normalité de normalité des
résidus XXI
A14. Test
d'hétéroscédasticité des erreurs du modèle
XXI
A15. Test de spécification de Ramsey
XXII
TABLE DES MATIERES XXIII
| 


