EPIGRAPHIE
« Car lequel de vous s'il veut bâtir une
tour, ne s'assied d'abord pour calculer le coût et voir s'il a de quoi la
terminer. »
Luc14 :28
DEDICACE
A vous mon père, Pascal Mutombo
Mwanasahu ;
A vous ma mère Henriette MBUYI
MWAMBA ;
A vous mes frères et soeurs : Stanis TSHUNZA,
Martin MUKENDI, Elie KAYUMBI, Adel YOMBO, Roger MATAMBA, Papy MWAMBA, Marie
NDAYA, Trésor MUTOMBO, et la petite Déborah KAJA ;
A mes cousins et cousines ;
A mes nièces et neveux ;
A mes amis ;
A tous ceux qui me sont chers, je dédie ce modeste
travail fruit de vos soutiens moraux et matériels.
KANTU MUTOMBO Laurent Christian
REMERCIEMENTS
Le présent travail n'est pas seulement le fruit de
nos propres efforts mais aussi les efforts de bien de personnes à qui
nous exprimons nos vifs remerciements.
Nos remerciements s'adressent à toutes les
autorités académiques et corps professoral de l'INSTITUT
DUPERIEUR DE STATISTIQUES, pour nous avoir assuré une formation
adéquate, sans laquelle nous ne serions pas à la hauteur de la
rédaction du présent travail et en particulier au chef des
travaux LUNGANGA KABUNDI Prospère et à l'assistant Christian
BASUME d'avoir eu la volonté d'initier et de corriger le présent
travail malgré leurs multiples préoccupations.
Nos remerciements sont ensuite adressés à
vous parents, Pascal Mutombo Mwanasahu et Henriette MBUYI MWAMBA pour vos
soucis de responsable, vos sacrifices consentis pour nous et pour vos
privations endurées pour notre éducation et notre formation, que
le tout puissant vous inspire davantage pour conduire notre famille vers des
destinés lesplus meilleurs.
Nos remerciements s'adressent également à
vous mes frères et soeurs Stanis TSHUNZA, Martin MUKENDI, Elie KAYUMBI,
Adel YOMBO, Roger MATAMBA, Papy MWAMBA, Marie NDAYA, Trésor MUTOMBO, et
la petite Déborah KAJA pour votre affection fraternelle.
Nous ne pouvons pas terminer, sans remercier nos
compagnons, il s'agit de : Joël KABEYA, Hugo BINENE, Rex MAYUKA,
Freddy KABAMBA, Jules KAHOZI, Mike FWAMBA, Dany TSHIKALA, Junior KYANZA qui par
leurs remarques nous encouragent à travailler.
Enfin, à tous ceux qui de près ou de loin
ont contribué moralement ou matériellement à
l'aboutissement de ce travail.
Nous disons merci.
KANTU MUTOMBO Laurent Christian
INTRODUCTION
I. PRESENTATION DU SUJET
A la création, toute entreprise cherche à se
constituer un capital nécessaire capable de couvrir les frais de premier
établissement tels que : les frais de constitution, des frais de
publicité et de lancement, les frais de fonctionnement antérieurs
au démarrage etc. l'acquisition des valeurs actives ainsi que les fonds
de roulement de ceci découle le calcul d'un capital initial fixe
nécessaire. Par ailleurs l'efficacité de la firme dépendra
autant de la qualité de l'organisation et de la gestion qu'à
celle des équipements et des procédés d'exécution
des tâches matérielles.
Concrètement l'entreprise doit faire un choix entre le
financement interne c'est-à-dire les apports des propriétaires et
le financement externe constitué du capital emprunté.
Après que la firme aura résolu les problèmes liés
à l'origine des capitaux, il lui faudra s'assurer d'une
sécurité financière ; les problèmes
liés à la transformation des ressources obtenues en emplois ou en
capitaux productifs.
Face à l'environnement économique dynamique,
l'entreprise est souvent confrontée à des difficultés
telles que la concurrence, le changement des exigences fiscales et sociales,
l'inflation monétaire ce qui demandent une plus grande
compétitivité pour permettre à l'entreprise de faire face
tant aux opportunités qu'aux menaces d'équilibre
financière pensons-nous devient un miroir, une sorte de chemin à
suivre par l'entreprise pour le respect de la règle dite de
« l'équilibre financier minimum » pour palier tant
soit peu aux risques. Toutes fois, le respect de la dite règle ne
signifie pas « absence des problèmes », mais un
minimum de sécurité financière car tout dépendra
comme nous l'avons dit tantôt du caractère changeant des
réalités économiques.
Ainsi, l'analyse financière devient un outil
indispensable dans la gestion d'une entreprise qui justifie notre
sujet : « analyse financière comme outil
indispensable dans la gestion d'une entreprise
pétrolière. »
Exemple United Petroleum
II. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Avant d'aborder le vif de notre sujet, il est
nécessaire de préciser le motif du choix de celui-ci. Par
après nous allons présenter successivement l'intérêt
personnel de ce sujet, d'intérêt scientifique ainsi que de
l'entreprise United Petroleum.
II.1. Choix du sujet
Le choix du sujet traité dans ce travail a
été motivé par le fait que, United Petroleum contribue
dans l'approvisionnement, le stockage et la distribution du carburant. Par
conséquent une entreprise oeuvrant dans ce domaine doit être
financièrement équilibrée et rentable pour assurer
régulièrement son activité.
Ainsi nous avons voulu vérifier si United Petroleum
garde son équilibre financier et si elle est rentable pour atteindre ses
objectifs. La seconde motivation a été celle de nous rassurer de
la conformité de la théorie relative à la gestion
financière apprise tout au long de notre formation académique
à la pratique sur terrain. Ceci nous a permis de démontrer
l'importance de l'analyse financière dans une entreprise.
II.2. Intérêt du
sujet
a. intérêt personnel
C'est pour nous un plaisir de traiter un sujet du domaine de
l'analyse financière, car nous estimons que les recherches sur le sujet
contribueront à améliorer notre expérience surtout au
travail.
A partir de ce sujet nous avons eu une occasion propice
d'approfondir l'étude et la pratique de l'analyse financière
d'une entreprise qui est un outil indispensable à sa
pérennité.
b. intérêt scientifique
Étant donné que notre travail est un travail de
recherche orientée dans le domaine de gestion, il constitue un document
qui met en évidence des données réelles, qualitatives et
vérifiables pouvant servir à d'autres recherches
ultérieures. Nous allons chercher à démontrer de quelle
manière l'analyse financière devient un outil indispensable dans
la gestion des entreprises, en l'occurrence des établissements
commerciaux du domaine pétrolier.
c. intérêt sociétal
Cette étude pourra être bénéfique
à United Petroleum étant donné qu'elle va dégager
sa santé financière. Elle pourra aussi intéresser les
partenaires de cette institution qui suivent de près sa gestion. Enfin
l'étude présente de l'intérêt à toute
entreprise commerciale soucieuse d'assurer sa pérennité car
l'analyse financière est un instrument dynamique et indispensable
à la gestion éclairée de toute entreprise par les
renseignements qu'elle est susceptible de fournir.
III. ETAT DE LA QUESTION
Par état de la question, nous entendons l'incertitude
des connaissances cadrant avec notre sujet, il a pour objectif de prouver
l'originalité de notre sujet d'étude. L'état de la
question est une phase ou étape par laquelle le chercheur fait allusions
aux travaux antérieurs pour éviter des redites. Il consiste en un
dénombrement de travaux scientifiques antérieurs ayant trait
à un sujet de recherche scientifique.
A cet effet nous avons fait appel d'une manière
éveillé aux travaux de nos prédécesseurs ayant
abordé presque le même sujet que le nôtre dans
différentes optiques, c'est notamment :
ILUNGA BINENE Hugo qui a abordé dans son mémoire
« Analyse de la structure financière comme outil de gestion
par excellence »cas de la Brasimba1(*),a formulé sa problématique, aini dans
quelle mesure l'analyse de la structure financière serait un outil de
gestion par excellence au sein d'une entreprise et quelle serait sa
répercussion de cette dernière sur la rentabilité
économique.
En guise de conclusion, le chercheur a affirmé que la
structure financière serait un outil de gestion par excellence au sein
d'une entreprise si les indicateurs sont calculés
régulièrement pour permettre une bonne prise des décisions
et orienter la firme vers la réalisation de ses objectifs.
MWENZA MBUMBA, dans son travail de fin d'étude
intitulé « analyse de l'équilibre financier par la
méthode de fonds de roulement et son impact sur la structure
financière » cas de la STL2(*), le récipiendaire a tourné sa
réflexion autour du questionnaire suivant : quel est l'impact de la
structure financière ?
Le précité a conclu en disant que la STL a eu un
déséquilibre financier mais elle était solvable pendant
toute la période ayant fait l'objet de son analyse.
En ce qui concerne notre travail, le point de
démarcation se situe sur le fait que nous avons fait appel aux notions
essentielles de l'analyse financière pour dégager son importance
dans la gestion d'United Petroleum.
IV. PROBLEMATIQUE
Notre problématique dans ce travail se présente
comme suit :
Ø Comment et en quoi l'analyse financière serait
indispensable à la gestion d'une entreprise pour qu'elle influe sur sa
rentabilité économico-financière ?
V. HYPOTHESE
En rapport, la question que nous nous sommes posée dans
la problématique nous proposons la réponse suivante :
L'analyse financière serait un outil de gestion
indispensable au sein de l'entreprise si les indicateurs sont calculés
régulièrement et cela constitueraient un tableau de bords qui
jouerait une fonction d'aide à la prise de décisions et la
répercussion de cette analyse aurait un impact positif sur la
rentabilité économico-financière. Si les gestionnaires,
après calcul des différents indicateurs, mettaient en oeuvre les
résultats obtenus, cela va conduire l'entreprise à assurer son
équilibre financier et permettre son autofinancement.
VI. METHODES ET
TECHNIQUES
1. Méthodes
analytique
Entreprendre une recherche et la mener à bon port
requiert les instruments appropriés permettant d'obtenir les
informations utiles et les méthodes adoptés.3(*)
En effet, la méthodologie est un ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre un objectif.
Dans notre travail, nous avons utilisé la
méthode analytique qui consiste à permettre l'analyse
scientifique et d'une façon systématique toutes les informations
et les données récoltées à l'entreprise United
Petroleum.
2. Techniques
La technique est un procédé ou un moyen
utilisé dans la récolte des faits à des informations. La
technique est aussi un outil à un instrument de recherche dont se
servent les chercheurs pour recueillir les données. Pour notre travail
nous avons fait appel aux techniques suivantes :
- Technique documentaire ;
- Technique d'interview.
a. technique documentaire :
elle consiste à faire une analyse approfondie sur le document
écrit dans le but d'arriver à la détermination des faits
ou phénomène dont les documents portent des traces en vue
d'obtenir des notions précises dans le domaine étudié.
b. Technique d'interview : elle
constitue un procès de communication entre l'intervieweur et
l'interviewé, procès au cours duquel le premier tente d'obtenir
du second les informations dont il a besoin.
VII. DELIMITATION DU
SUJET
Elle est opérée par rapport à l'espace de
l'étude et par rapport au temps de la période concernée
par la recherche.
1. Délimitation
temporelle
La période allant de 2013 à 2016 nous permettra
d'analyser la structure financière au sein d'United Petroleum,
étant donné que les données de 2017 n'étaient pas
encore disponibles.
2. Délimitation
spatiale
Notre sujet traitera sur la ville de Lubumbashi, ou HYPER
PSARO, notre cadre d'étude possède une direction
générale et usine de production des produits pétroliers
(UNITED PETROLEUM).
VIII. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Hormis l'introduction générale et la conclusion
générale, ce travail comprend les chapitres suivants :
- Chapitre 1 considération générales et
théories avec objectif de définir les concepts de base et de
développer des notions clés tout au long de notre
travail ;
- Chapitre 2 présentation du champ
d'investigation ;
- Chapitre 3 quant à lui porte sur un cadre pratique de
l'analyse financière comme outil indispensable dans la gestion d'une
entreprise pétrolière, cas de United Petroleum.
CHAPITRE I : LES
CONSIDERATIONS GENERALES
SECTION 1 : DEFINITION
DES CONCEPTS DE BASE
I.1.1. L'entreprise
En réalité, le mot
« entreprise » comporte plusieurs définitions selon
les auteurs classés d'après les différents domaines de
formation tels que les juristes, les spécialistes en sciences de
gestion, en sciences humaines. D'une manière générale
l'entreprise est « une structure économique et sociale,
financièrement indépendante, produisant des biens et services
destinés à un marché concurrentiel ou monopolistique. Elle
constitue l'unité fondamentale de l'économie de
marché. »4(*)
Selon MOUSSON, l'entreprise se définit comme une
organisation dans laquelle un entrepreneur affecte le revenu de production
à la production des biens et des services destinés à
l'échange dans le but lucratif.5(*)
Etymologiquement le terme dérive de
« entreprendre » daté d'environ 1430-1440 avec le
sens de « prendre entre ses mains » aux environs 1480 il
prit l'acceptation actuelle de « prendre un risque relever un
défi, oser un objectif.
Trois aspects ressortent de cette définition :
- L'entreprise produit : elle crée ou transforme
des biens ou services susceptibles de satisfaire les besoins des individus, des
autres entreprises ou des collectivités.
- L'entreprise produit pour le marché, cela veut dire
qu'elle vend les biens ou les services produit.
- L'entreprise est financièrement indépendante
c'est-à-dire qu'elle produit et vend de sa propre autorité sous
sa responsabilité à ses risques et péril.
I.1.1.2. Classification des
entreprises
Les entreprises peuvent être classées selon
plusieurs critères :
A. EN FONCTION DE LEUR ACTIVITE
- Entreprise artisanale : elle n'emploie pas plus de dix
salariés.
- Entreprise commerciale : elle achète des biens
qu'elle revend sans transformation.
- Entreprise industrielle : elle transforme les
matières premières et vend des produit finis (ou semi-fini),
elle appartient au secteur secondaire celui de la transformation.
- Société de service : elle revend un
travail sans fabrication d'objets physiques.
B. EN FONCTION DE LEUR SECTEUR ECONOMIQUE
(déterminé par leur activité principale)
- Secteur primaire : agriculture, sylviculture,
pêche, parfois mines.
- Secteur secondaire : industrie, bâtiment et
travaux publiques.
- Secteur tertiaire : service.
C. EN FONCTION DE LEUR TAILLE ET DE LEUR IMPACT ECONOMIQUE
Les entreprises sont regroupées en trois
catégories ci-après :
- Les grandes entreprises : celles qui se
caractérisent par une accumulation importante des productions et des
valeurs circulantes avec un effectif de 500 salariés et plus.
- Les petites et moyennes entreprises (PME) : avec un
effectif d'au moins 499 salariés et le total actif et passif du bilan ne
dépassent pas 3.500.000fc.
- Les multinationales : qui sont les fiscales des grandes
entreprises de pays développés et se trouvent dans plusieurs
pays.
D. EN FONCTION DE LEUR STATUT JURIDIQUE
- Les entreprises privées : celle qui
appartiennent à une personne physiques ou morale.
- Les entreprises semi publiques : dans lesquelles une
partie du capital appartient aux personnes physiques ou morales et une autre
à l'Etat.
- Les entreprises sociétaires : dans lesquelles le
capital appartient à plusieurs personnes appelées
associés.
- Les sociétés des personnes : celles dans
lesquelles chaque associé s'engage personnellement jusqu'à la
concurrence de son apport.
- Les sociétés de coopération : sont
celles qui sont composées d'associés dont le nombre et les
apports sont variables et dont les parts sont incessibles à des
tiers.
I.1.1.3. Mission de
l'entreprise
La mission définit les activités ainsi que les
grandes orientations d'une entreprise ; elle répond à des
questions telles que : « quel est notre business ou encore
qui sommes-nous et à quoi voulons nous arriver ? »
Elle doit être clairement définie car elle
constitue une fondation solide sur laquelle devrait se bâtir des
réalistes objectifs, plans et activités. Il est donc important
pour toute organisation de se définir elle-même avant d'entamer
quoique ce soit. Cela permettra de mobiliser toutes les forces vives de
l'organisation en vue d'atteindre l'objectif commun.
I.1.1.4. Objectif de
l'entreprise
Les objectifs ou visées stratégiques se
définissent en termes de résultats que l'organisation tente
d'atteindre.
Ces résultats sont des mesures de la performance
à laquelle veut tendre l'organisation. La fixation des objectifs est
d'une importance cruciale car « tant que la direction de
l'organisation ne se fixe pas des mesures de performances en termes de
positions à atteindre et par un engagement spécifique au niveau
de l'action à entreprendre, il y'a un grand risque que la mission
stratégique puisse rester une bonne intention mais jamais une
réalisation.
I.1.1.5. Croissance d'une
entreprise
La croissance de la firme est devenue depuis plusieurs
années un sujet passionnant dans la littérature de la gestion des
entreprises. Elle a été définie de plusieurs
manières par plusieurs auteurs et doctrinaires. « GLUECK
l'entend comme étant la politique que l'entreprise poursuit lorsque elle
fixe la barre de ses objectifs à un niveau très
élevé que celui du temps passé. »6(*)
La formulation des stratégies consiste en un ensemble
de dispositions que l'entreprise doit prendre en compte pour atteindre les
objectifs qu'elle s'est fixé. Cette tâche implique la prise en
compte de tous les aspects de la situation interne et externe de l'organisation
en vue de sortir un plan d'action permettant d'atteindre des objectifs de
l'entreprise. Il s'agit concrètement de rechercher les moyens à
utiliser pour prendre en compte les opportunités de l'environnement afin
de minimiser les menaces pour atteindre les objectifs.
I.1.1.6. Portefeuille d'une
entreprise
Lorsque la direction a examiné les différentes
opportunités de croissance de l'entreprise, elle est plus apte à
prendre des décisions au sujet de ses lignes des produits existants.
La direction évalue ainsi tous les domaines de son
activité afin de pouvoir décider lesquels maintenir, diminuer ou
éliminer dans son portefeuille de produits. Son travail sera toujours de
revoir le portefeuille d'activités en retirant les affaires peu
intéressantes et en ajoutant de nouvelles qui s'annoncent
fructueuses.
I.1.2. Gestion
Le concept de gestion a été défini par
plusieurs auteurs de différentes manières. Pierre G. et Bergeron
définissent la gestion comme étant « un processus par
lequel on planifie, organise, dirige et contrôle les ressources d'une
organisation afin d'atteindre le but visé. »7(*)
Pour P. LAUZER et R. TELLER « gérer une
entreprise c'est la conduire vers les objectifs qui lui ont été
assignés dans le cadre d'une politique concertée, par les
responsables, en mettant en oeuvre les ressources qui leurs sont
confiées. »7(*)
D'après J. MEYER « l'action de gestion
apparait comme l'utilisation optimale par un responsable des moyens à sa
disposition pour atteindre les objectifs fixés. Cette action est
intermédiaire entre l'action de direction qui a le pouvoir sur les
objectifs et sur les moyens et à l'action d'exécution qui n'a pas
le pouvoir ni sur les moyens.8(*)
De ces définitions nous retiendrons que la gestion
consiste à :
- Choisir les objectifs à long terme de
l'entreprise ;
- S'assurer de leur réalisation progressive en vue de
rentabiliser le capital investi dans l'expansion de l'activité.
I.1.2.1. Outils de gestion
Le pilotage d'une entreprise est une activité qui
consiste à faire des multiples choix, à prendre des
décisions dans le but d'atteindre des objectifs préfixes.
L'objectif principal poursuivi par les entreprises est la réalisation
d'un profit financier. La plupart des décisions sont des
décisions opérationnelles qui engagent l'entreprise sur le moyen
et long terme, on parle alors de décisions stratégiques.
L'ensemble de ces décisions constitue la gestion.
Une gestion efficiente tient compte des contraintes
économiques et juridiques propres à l'environnement de
l'entreprise et s'appuie sur des outils d'aide à la décision. Les
outils de gestion sont nombreux ; ils peuvent être classés en
deux grandes catégories :
- Les outils de prévision ;
- Les outils d'analyse.
I.1.2.1.1. Outils de
prévision
La gestion prévisionnelle est un système de
gestion orienté vers le futur et qui permet au responsable de disposer
d'une information préalable à la prise de décision. Cette
démarche prévisionnelle a un ensemble d'outils qui sont
généralement classés en 3 catégories.
A. LE PLAN STRATEGIQUE
Cette activité consiste à présenter les
grandes lignes de l'entreprise en décrivant la phase qu'elle occupera
dans l'environnement futur.
Cette présentation s'effectue d'une part par un
diagnostic interne en déterminant les forces et faiblesses de
l'organisation et d'autre part par un diagnostic externe en décrivant
les menaces et les opportunités de l'environnement.
B. LE PLAN OPERATIONNEL
Ce plan permet de programmer les moyens nécessaires
à la réalisation des objectifs après la
détermination des choix stratégiques. Il conduit à
envisager le futur proche de l'organisation sous diffèrent
aspects : investissement, financement, rentabilité.
C. LE PLAN A COURT TERME OU LE BUDGET
Christian RAULET définit le budget comme étant
« l'expression quantitative et financière d'un programme
d'action envisagé pour une période
donnée. »9(*)
I.1.2.1.2. Outils d'analyse
L'analyse financière est une méthode de
traitement de l'information qui permet au comptable, au contrôleur, au
gestionnaire, à l'analyste,... enfin d'établir un jugement sur la
santé financière actuelle et future de l'entreprise dans laquelle
il doit travailler. Afin de parvenir à cela, un certain nombre d'outils
lui semblent essentiels.
I.1.2.1.2.1. La comptabilité
générale
La comptabilité générale est
définie comme une technique de suivi d'enregistrement, des variations en
quantités ou valeurs que les transactions et opérations
effectuées impriment sur l'ensemble du patrimoine de l'entreprise.
« c'est un système de traitement de
l'information financière permettant de rassembler, de suivre et
d'enregistrer en unité monétaire, les opérations de
l'entreprise en vue d'obtenir les documents de synthèse utilisable et
interprétable pour les dirigeants de l'entreprise et pour les tiers afin
de leur faciliter la prise de décision
économique. »10(*)
Elle constitue la première source d'information de
l'analyse, elle présente, cependant des limites si bien que d'autres
outils modernes d'analyse de performance de l'entreprise sont venus la
compléter, ces sont notamment :
- La comptabilité analytique ;
- Le contrôle budgétaire ;
- Le tableau de bord.
Au cours de notre recherche nous avons pris en compte la
comptabilité générale comme source principale des
données utiles pour l'analyse financière.
v Les données de base chiffrées et
traitées en comptabilité
On a vu dans les paragraphes précédents que
l'entreprise est faite par l'ensemble des transactions. Ces transactions
peuvent être matérialisées par des flux réels et des
flux monétaires. Cela se justifie par le fait que l'entreprise travaille
dans un contexte environnemental.
- Les flux réels sont des flux des biens achetés
ou vendus : ils portent sur des biens matériels ;
- Les flux quasi-réels sont des mouvements de valeur en
provenance des facteurs de production. Ils peuvent être des flux de
prestation diverse reçus des autres agents économiques et ils
peuvent consister en :
- Travail apporté par le personnel, prestation dont
la mesure est salaire ;
- Les prestations financière garanties par les
préteurs, prestations dont la mesure est l'intérêt.
- Les flux financiers des paiements : ils sont la
contrepartie des flux réels et quasi-réels.
Comme vu précédemment, l'objectif de toute
entreprise est la réalisation de bénéfices grâce
à l'achat et vente des marchandises. Ainsi au bout d'un exercice
comptable, l'entreprise est tenue d'établir un bilan faisant ressortir
le résultat de l'exercice (bénéfice ou perte).
v Les traitements comptables
La comptabilité s'occupe des opérations
financières d'une entreprise, en se basant sur des pièces
justificatives qui sont tenues par catégorie d'opération (achat,
vente, règlement,...) et puis saisies et enregistrées grâce
à des moyens manuels ou informatique dans des registres comptables et
d'une façon quotidienne. Ces traitements permettent de :
- Conserver la mémoire des opérations qui
caractérisent la vie de l'entreprise ;
- Connaitre à tout moment la position de
trésorerie ;
- Produire de façon intermittente au moins une fois par
an des états appelés documents de synthèse (compte de
résultat, bilan et annexe) c'est à partir de ces documents de
synthèse que se base l'analyse financière.
Des documents de
synthèse : ils sont également appelés
comptes annuels ou états financiers ; il s'agit de :
- Bilan ;
- Compte de résultat ;
- Soldes caractéristiques de gestion ;
- Les annexes.
Le bilan : le bilan est la traduction
comptable de l'ensemble des ressources d'une entreprise et des emplois à
un instant donné. Techniquement il se présente sous forme d'un
tableau dont la partie droite est appelée passif et la partie gauche
actif.11(*)
Le bilan donne des informations sur la situation
financière et sur la valeur de l'entreprise, d'où son
éclatement en 4 sortes de bilan.
a. Bilan fonctionnel : il
permet de vérifier si les ressources financent les emplois de même
degré de liquidité et de calculer les indicateurs suivants :
le besoin en fonds de roulement, la trésorerie et l'autonomie
financière que nous analyserons dans les pages qui suivent.
b. Bilan financier : il
permet de :
- de vérifier la solvabilité de
l'entreprise, c'est-à-dire sa capacité de s'acquitter de ses
dettes à court termes à l'aide de ses actifs circulants.
- calculer les divers ratios financiers tels que la
liquidité, le fonds de roulement net global et le fonds de roulement
financier.
- dresser un tableau de financement qui permet d'expliquer
comment les emplois stables réalisés au cours de l'exercice ont
été financé et comment s'est formé la variation du
FRNG.
c. Bilan de
liquidité : c'est un bilan qui reprend des
éléments patrimoniaux évalués à leur valeur
actuelle ou vénale.
d. Bilan consolidé :
il comprend les éléments d'actif et de passif de toutes les
entreprises ou filiales d'une multinationale ou de toutes les branches d'une
société.
Le compte de résultat : est la
synthèse ou la récapitulation d'une part, de toutes les charges
(ou frais ou couts) et d'autre part de tous les produits (ou revenus)
enregistrés par l'entreprise au cours d'un seul exercice.12(*) Il sert à
déterminer le résultat de l'exercice concerné.
Les soldes caractéristiques de
gestion : les comptes de charge et de perte ainsi que les comptes
de produits et de profit ne fonctionnent qu'en cours d'exercice, mais en fin
d'exercice, ils participent à la détermination des soldes
caractéristiques de gestion disparaissent à la fin de l'exercice
comptable concerné.
L'annexe : est constitué d'un
ensemble d'information qui complète les renseignements donnés
dans le bilan et le compte de résultat.
SECTION II :
CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR L'ANALYSEFINANCIERE
Le but de l'analyse financière est de réaliser
une évaluation d'entreprise, selon le cas :
- Soit pour évaluer la solvabilité de
l'entreprise (pour lui consentir un crédit par exemple, et plus
généralement pour nouer des relations d'affaires avec
elle) : analyse crédit.
- Soit pour estimer la valeur de l'entreprise dans une optique
de cession de participation d'achat ou de vente d'actions en bourse :
évaluation d'actions boursière.13(*)
I.2.1 Définition de
l'analyse financière
Selon Elie COHEN, l'analyse financière constitue
« un ensemble de concept, des méthodes et d'instruments qui
permettent de formuler une appréciation relative à la situation
financière de l'entreprise, aux risques qui l'affectent au niveaux et
à la qualité de ses performances. »14(*)
En s'appuyant sur le traitement et interprétation
d'informations comptables ou d'autres informations de gestion, cette discipline
participe à des démarches de diagnostic de contrôle et
d'évaluation qui ont tout d'abord concerné les entreprises
privées à caractère capitaliste, mais grâce à
l'extension de son champ d'application, ses méthodes tendent à
être utilisées de plus en plus largement et concerne aujourd'hui
toutes les institutions dotées d'une certaine autonomie
financière qu'il s'agisse des entreprises de toute forme, des
associations, des coopératives, des mutuelles ou de la plupart des
établissements publics.15(*)
I.2.2. Historique de l'analyse
financière
A la veille de la crise de 1929, qui devrait introduire une
profonde mutation des habitudes, le métier des banquiers consistait
essentiellement à assurer les mouvements des comptes et à
octroyer des facilités des caisses occasionnelles. Le problème
était d'assurer le financement d'industries naissantes (charbon,
textile, construction, mécanique,...). Des crédits d'exploitation
étaient consentis moyennant des solides garanties destinés
à éviter une confusion entre le risque du banquier et celui de
l'entreprise.
Les garanties permettent en effet au banquier de s'assurer du
remboursement du sort de l'entreprise débitrice. De telles garanties
reposaient sur des biens faisant partie du patrimoine de l'entreprise, mais non
directement affectés par son exploitation ou tout simplement sur le
patrimoine personnel du propriétaire de l'entreprise. Le patrimoine
était essentiellement constitué aux yeux des gens de
l'époque, comme depuis toujours en France, par des biens fonciers et
immobiliers. Il en résulte que le risque du crédit bancaire
était alors lié aux modalités juridiques de la prise de
garantie. Encore fallait-il vérifier que le bien donné en
garantie avait une valeur réelle de l'actif net en cas de liquidation,
joint à la difficulté d'évaluer les biens donnés en
garantie et à déterminer l'indépendance à
l'égard de l'exploitation de l'entreprise, montreront aux banquiers que
la simple optique de la recherche de la solvabilité était
suffisante pour déterminer rationnellement la décision d'octroi
d'un crédit.
Un éclairage complémentaire se trouvait
indispensable : « analyse de la structure financière de
l'entreprise. » Des lors « l'analyse financière
comme outil indispensable dans la gestion d'une entreprise » trouve
sa justification et sa raison d'être.
I.2.3. Importance et
étapes de l'analyse financière
L'analyse financière est un outil indispensable
à la bonne marche de l'entreprise. Son objectif consiste à
utiliser les ressources limitées d'un agent économique de la
façon la plus efficace possible. BERZILE Regan distingue trois
décisions essentielles pouvant être prise sur base de la gestion
financière.16(*)
- La décision d'investir ;
- La décision de financer l'entreprise ;
- La décision de distribuer les dividendes.
Ces trois types de décisions reviennent à la
responsabilité du Directeur financier d'une entreprise sur plusieurs
plans à savoir :
- La planification et la prévision
financière ;
- L'analyse des états financiers ;
- Le suivi et l'évaluation de la performance de
l'entreprise.
Plusieurs agents économiques s'intéressent
à l'information financière publiée par les entreprises. Il
s'agit notamment des créanciers à court terme, à long
terme et à moyen terme ; principalement les banquiers, les
actionnaires actuels et éventuels, les services gouvernementaux, les
représentants syndicaux et les gestionnaires. Chacun de ces auteurs
utilise ces informations pour ses propres intérêts. Le banquier
étudie la demande de prêt à court terme et
s'intéresse à déterminer si l'emprunteur sera à
mesure de faire face à ses échéances à court terme.
Le détenteur des obligations à long terme examine la structure du
capital, la couverture des intérêts et ainsi que
l'évaluation de la situation financière. Quant à
l'actionnaire, il se préoccupe de la solvabilité ainsi que de la
rentabilité de l'entreprise.
En tenant compte des intérêts divergent de tous
ces acteurs, l'analyse financière demeure fondamentalement
« un outil et une méthode permettant de définir
l'entreprise à partir de quelques points clés.17(*)
Pour être en mesure de porter un jugement sur la
situation d'une entreprise l'analyse doit tenir compte de l'ensemble
d'information disponible, surtout celles publiées par la
comptabilité ou par d'autres sources. Généralement
plusieurs étapes doivent être suivies à savoir :
1. Préciser les objectifs de l'analyse ;
2. Procéder à l'examen global des états
financiers, cet examen porte généralement sur les emplois
(actifs), des ressources (passif), les ventes et les
bénéfices ;
3. Analyser le rapport du vérificateur,
l'énoncé des principes comptables, les notes aux états
financiers et d'autres informations pertinentes ;
4. Appliquer les techniques d'analyse comme les ratios,
l'étude du bilan en masse et autres ;
5. Enfin, porter un jugement sur la situation, formuler des
recommandations et prendre des conclusions.
I.2.4. Quelques
stratégies financières d'une entreprise
Comme vu précédemment l'entreprise
définit le plan de son devenir, de cela elle va procéder à
un certain nombre des choix des moyens pour optimiser sa politique
financière. De ce fait l'entreprise ne pourra pas compter sur ses fonds
propres (capital et résultat), elle sera peut-être dans ce cas
contrainte de limiter une politique d'investissement que le marché
aurait voulu plus large.
L'entreprise peut enfin se financer de façon externe,
dans ce cas elle fait recours aux marchés financiers disponibles et
accepter de perdre une partie de son autonomie financière pour accroitre
ses actifs. Elle pourra le faire de plusieurs manières : subvention
d'équipement, appels à des organisations
spécialisées en matière de crédit, émettre
elle-même sur le marché financier des obligations,
c'est-à-dire des titres des créances portant
intérêts, fusion avec les entreprises similaires.
I.2.5. Méthodes
d'appréciation des entreprises
L'analyse financière a un caractère
rétrospectif. Elle porte sur l'évolution passée et les
caractéristiques constantes au moment de l'analyse. Elle se distingue
ainsi des travaux prévisionnels ouverts vers des actions. L'analyse
financière comporte cependant une phase de synthèse et
d'interprétation dont l'objet est de déterminer
l'évaluation probable. La situation constatée à un moment
donné contient potentiellement les éléments de
transformations de cette situation. Le prolongement des tendances
constatées au cours d'une période permet également
d'anticiper l'évolution de la situation financière en tenant
compte des éléments nouveaux susceptibles d'intervenir.
Ainsi il existe des méthodes permettant
d'apprécier ou de suivre l'évolution de la situation
financière d'une entreprise. Ces méthodes consistent à
faire des rapports existant entre les postes du bilan ou groupe des postes du
bilan ou encore entre ces postes et les résultats. Cette
démarcheregroupe les deux pôles de l'analyse financière.
L'équilibre financier d'une part, la rentabilité et
évaluation d'autre part.
Pour valider nos hypothèses, nous avons utilisés
deux méthodes :
- L'analyse par le fonds de roulement ;
- L'analyse par la méthode des ratios.
I.2.5.1. Principe de
l'équilibre financier
La synthèse du bilan permet de rapprocher succinctement
par grands blocs l'origine des capitaux et l'emploi qui en est fait,
c'est-à-dire d'étudier la structure financière de
l'entreprise.18(*) Les
valeurs immobilisées ne peuvent pas être financés par des
dettes à court termes sans caractère permanent. Ainsi,
l'équilibre minimum est respecté si les capitaux utilisés
pour financer les immobilisations restent à la disponibilité de
l'entreprise pour une durée au moins correspondant à la
durée de l'immobilisation.
C'est pourquoi toute entreprise doit veiller à
respecter cet équilibre financier minimum c'est-à-dire que les
valeurs immobilisées doivent être financées par les
capitaux permanent et les valeurs circulantes par l'exigible à court
terme, donc les ressources doivent être financées par les emplois
de même durée. Par exemple on ne peut pas acheter un immeuble par
un crédit à court terme. Toutes fois l'entreprise ne doit pas
essayer de se contenter de cet équilibre, elle doit avoir un fonds de
roulement positif pour couvrir des imprévus au lieu de recourir aux
dettes si ainsi le cas l'entreprise se fait l'extension à éviter
le gaspillage.
I.2.5.1.1. ETUDE DU FONDS DE
ROULEMENT
Le fonds de roulement est le fondement même du principe
de l'équilibre financier. Il est défini comme étant
l'excédent des capitaux permanents qui reste à la disposition de
l'entreprise après avoir financé les actifs acycliques.
Mathématiquement nous avons :
Par le haut du bilan :
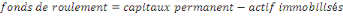
Par le bas du bilan :
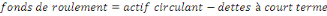
I.2.5.1.2. DEFINITION ET ETUDE
DE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est la différence
entre les besoins cycliques (liés à l'exploitation) exclu les
postes de trésorerie et les ressources cycliques. D'où :
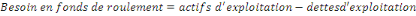
Pour mieux comprendre le BFR, il est nécessaire de
comprendre la notion du cycle d'exploitation qui est à l'origine de ce
besoin. Dans une entreprise commerciale de cycle d'exploitation est
composé d'une part de l'ensemble des opérations d'exploitations
telles que : les achats des marchandises, leur stockage ainsi que les
ventes, les opérations sont appelées communément besoin
d'exploitation. Et d'autre part par des opérations appelées
ressources d'exploitation ou ressources cyclique qui regroupent les dettes
d'exploitation à savoir :
- Avance et acomptes sur commande en cours ;
- Dettes fournisseurs et acomptes rattachés ;
- Produits constatés d'avance relatifs à
l'exploitation.
Toutes fois la différence entre ces besoins
d'exploitation et ressources d'exploitations constitue le besoin d'exploitation
ou besoin en fonds de roulement.
De cette théorie deux situations se
dégagent :
v Le BFR peut être négatif, on parlera alors
d'une ressource de financement.
v Le BFR peut être positif, on parle d'un besoin de
financement
I.2.5.1.3. NOTIONS DE
TRESORERIE
Les notions de fonds de roulement et de trésorerie
sontinséparables dans la mesureoù la première
étudie la solvabilité globale de l'entreprise en confrontant tout
l'actif circulant à l'exigible à court terme sans tenir compte ni
du degré de liquidité des éléments d'actifs
circulants ni des dettes à court terme à honorer à des
brèves échéances, alors que la seconde est beaucoup plus
exigeante que la première. Elle s'intéresse à la
solvabilité à très bref délais. Elle met en
relation les éléments de l'actifs circulant les plus liquides aux
dettes à court termes.19(*)
Cela étant, il faut étudier le BFR pour
apprécier si la trésorerie est saine ou serrée. Elle est
saine si le FRN est élevé, rappelons également qu'elle
dépend des BFR, d'où la formule.
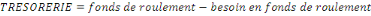
Comme dans le cas précédent l'étude de la
trésorerie peut dégager deux situations suivantes :
- Quand le fonds de roulement est inférieur aux besoins
en fonds de roulement, on parle d'une trésorerie négative
(trésorerie serrée) ;
- Quand le fonds de roulement est supérieur aux besoins
en fonds de roulement, on parle d'une trésorerie positive
(trésorerie saine).
D'après Henry MEUNIER François, la
trésorerie d'une entreprise à une date donnée est la
différence à cette même date entre les ressources mises en
oeuvre pour financer son activité et les besoins entrainés par
cette même activité.
Cependant la gestion de la trésorerie, doit assurer les
relations quotidiennes avec les banques et de décider de la
répartition et de l'utilisation des crédits disponibles.
C'est à partir de l'interprétation de la
position de trésorerie qu'intervienne la gestion proprement dite dont la
phase finale est constituée par le contrôle de l'évolution
de la trésorerie par rapport au budget.
I.2.5.1.4. NOTIONS DE
RENTABILITE
Globalement, la rentabilité peut être
définie comme « l'aptitude de l'entreprise à
secréter un résultat exprimé en unité
monétaire. »20(*) La rentabilité est donc un critère de
ce qui est rentable, c'est-à-dire soit qu'il produit une rente et par
expansion donne un bénéfice suffisant, soit qu'il donne des bons
résultats. Etudier la rentabilité d'une entreprise, c'est
apprécier le résultat dégagé à chacun des
niveaux reconnus comme significatif. Il est ainsi possible de porter un
jugement sur l'efficacité de la gestion courante par les dirigeants de
l'entreprise et de prévoir le montant des capitaux propres aux quels la
société pourra avoir recours pour un fonctionnement et son
développement.21(*)
Ainsi, la rentabilité s'appréhende à
trois niveaux selon les objectifs de l'analyse : « il
s'agit de la rentabilité commerciale, de la rentabilité
économique et de la rentabilité financière. »
1. RENTABILITE COMMERCIALE
Elle a trait à la politique de prix de l'entreprise et
à la marge brute qu'elle prélève sur le prix de revient
des produits vendus.
2. RENTABILITE FINANCIERE
La finalité de l'entreprise est d'offrir une bonne
rentabilité à ses actionnaires, il convient d'évaluer
cette rentabilité par rapport aux capitaux propres investi, le ratio
est :
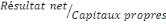
3. RENTABILITE ECONOMIQUE
L'entreprise a besoin de l'ensemble de ses actifs pour
générer ses bénéfices, il est donc important de
mesurer la rentabilité qu'elle génère sur ses
investissements, le ratio est :
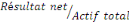
I.2.6. Analyse par la
méthode des ratios
Plusieurs auteurs du domaine de l'analyse financière
restent unanimes à affirmer que seule l'analyse fondée sur les
fonds de roulement ne suffit pas pour porter un jugement définitif sur
la santé financière d'une entreprise, ainsi
préconisent-ils le recours à la deuxième approche de
l'analyse financière, celles des ratios.
I.2.6.1. Définitions et
interprétations
Le ratio est le rapport expressif entre deux grandeurs
caractéristiques (significatives) de la situation du potentiel de
l'activité ou de rendement de l'entreprise.22(*) Ce rapport est expressif car
à partir de deux données, l'on peut établir une nouvelle
information de nature différente.
Ce rapport permet à l'analyste de raisonner sur la
situation financière d'une entreprise. Il peut être exprimé
soit sous forme d'un quotient, soit sous forme d'un pourcentage. Les ratios
peuvent servir à mesurer les relations qui existent entre les
éléments de la structure de l'actif et du passif ou pour
apprécier l'équilibre entre le degré de liquidité
et le degré d'exigibilité.23(*) En effet si certains ratios peuvent être
utilisés directement pour apprécier la santé
financière d'une entreprise, ils comportent un certain nombre
d'inconvénients parmi lesquels nous pouvons citer :
- La méthode de ratios s'applique sur l'analyse de
l'évolution de plusieurs bilans successifs ;
- Le calcul des ratios ne permet pas de prédire
l'avenir, c'est pourquoi il doit être renforcé par d'autres outils
permettant de convertir le passé au futur.
I.2.6.2. Ratios de
solvabilité à long terme
La solvabilité se définit comme étant la
capacité d'apurer l'exigibilité avec la réalisation de
l'actif. Les ratios de solvabilité permettent de connaitre la
solvabilité générale de l'entreprise, pour enfin
apprécier sa valeur du point de vue financier.
Les banques en générale et les bailleurs de
fonds en particuliers préfèrent ces ratios pour apprécier
le degré de solvabilité de l'entreprise sous étude.
· Ratios de financement de l'actif immobilisé
Ce ratio peut être décomposé en plusieurs
types de ratios :
- Ratio de financement des immobilisations aux fonds propres,
et il est calculé comme suit :
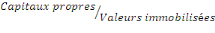
Ce ratio nous indique la part des capitaux propres dans le
financement de l'entreprise et il doit être supérieur ou
égal à 1 et lorsqu'il est supérieur à 1 cela
signifie que les capitaux propres financent aussi une partie des valeurs
circulantes, c'est-à-dire que l'entreprise respecte le principe de
l'équilibre financier et par conséquent dispose d'un fonds de
roulement propre.
- Ratio de financement des immobilisations aux capitaux
permanents
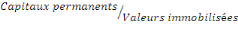
Ce ratio est une expression du fonds de roulement et de
déterminer son importance et son évolution dans le temps. Il
permet d'apprécier la part des capitaux permanents d'une entreprise dans
le financement des valeurs immobilisées. Ces deux ratios c-hauts
cités indiquent dans quelle mesure les capitaux propres et permanents
sont investis dans les constructions, machines et autres moyen de
production.
- Ratio de financement des immobilisations par les dettes
à long et moyen termes : ce ratio indique la part des dettes
à long et moyen termes dans le financement des actifs fixes. Il est
calculé comme suit :
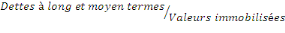
Il est en effet intéressant de déterminer le
rapport existant entre les valeurs immobilisées et l'ensemble de
l'actif, car l'entreprise qui mobilise une trop grande partie de son actif
résiste difficilement aux crises économiques.
D'où le ratio d'immobilisation :
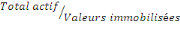
En dehors de ces ratios ci-haut mentionnés, il est
conseillé de calculer le ratio de couverture de l'actif circulant, ce
ratio permet de connaitre dans quelle mesure le fonds de roulement couvre les
actifs circulants, il se calcule de la manière suivante :
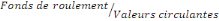
I.2.6.3. Ratio d'autonomie financière
L'étude de cette catégorie des ratios permet
d'éclaircir la mesure selon laquelle la répartition entre les
capitaux propres et permanents s'effectue.
Trois principaux types des ratios sont classés dans
cette catégorie.
- Ratio d'endettement :
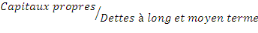
Ce ratio permet de connaitre l'importance des capitaux dans
les dettes à long et à moyen terme.
- Ratio d'indépendance financière :
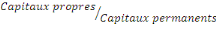
Ce ratio permet de connaitre la part qu'occupent les capitaux
propres dans l'ensemble de capitaux permanents utilisés par
l'entreprise.
- Ratio d'indépendance financière :
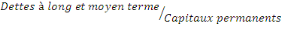
Ce ratio permet de connaitre l'importance de l'exigible par
rapport aux capitaux permanents dont dispose l'entreprise.
I.2.6.4. Ratios de
solvabilité à court terme
Le suivi de l'évolution de la situation
financière d'une entreprise reste une préoccupation majeure de
ses dirigeant, nous avons vu que l'entreprise doit faire un suivi de la
politique de liquidité, pour pouvoir survivre, c'est pourquoi la gestion
financière exige un suivi particulier de la liquidité dont
dispose l'entreprise, ainsi pour ce faire divers ratios sont utilisés
parmi eux nous pouvons citer :
- Ratio de liquidité générale
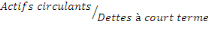
Ce ratio montre la mesure selon laquelle les actifs circulants
couvrent les dettes à court terme, en d'autres termes, il nous permet
d'apprécier si l'entreprise dispose d'une marge de
sécurité suffisante.
- Ratio de liquidité immédiate
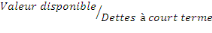
Ce ratio permet de voir dans quelle mesure les valeurs
disponibles peuvent financer les dettes à court termes.
- Ratio de liquidité relative
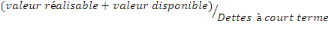
Ce ratio exprime la capacité de l'entreprise à
honorer ses engagements à court terme. Ce ratio ne contient pas des
stocks puisqu'ils sont moins liquides que les réalisables et les
disponibles. Pour que ce ratio soit significatif, il faut que la durée
de transformation des créances en liquide soit supérieur à
celle des dettes à court terme
I.2.7. Capacité
d'autofinancement
La capacité d'autofinancement (CAF) quantifie au cours
d'une période le potentiel de l'entreprise à dégager, par
son activité, une ressource. Cette ressource interne pourra être
utilisée notamment pour financer des nouveaux investissements,
rembourser des emprunts ou verser des dividendes aux propriétaires de
l'entreprise.
La CAF se calcule à partir du résultat net au
quel on ajoute les charges calculées (dotations aux amortissements)
apparaissant dans le compte de résultat. Premièrement il faut
retrancher les quotes part de subventions d'investissement virées au
compte de résultat qui sont des produits. Deuxièmement il faut
rajouter la valeur nette comptable des éléments actifs
cédés et soustraire les produits de cessions des
éléments d'actifs. On y ajoute des charges d'amortissements parce
que cet argent ne quitte pas l'entreprise, il est juste gardé dans ses
caisses pour constituer ce que l'on appelle charge non
décaissées. Elles servent à rembourser les dettes,
investir à nouveau, renforcer le stock, etc.,...
Conclusion partielle
Nous voici arrivé au terme du premier chapitre de notre
étude qui a pour titre Considérations générales
dans lequel nous avons définis les concepts de bases tels que
l'entreprise qui est une cellule économique pour la production des biens
et services utilisés à la vente pour en tirer un profit, la
gestion qui est un processus par lequel on planifie, organise, dirige et
contrôle les ressources d'une organisation afin d'atteindre le but. Nous
avons parlé en large sur l'analyse financière qui a pour but de
réaliser l'évaluation d'entreprise selon le cas soit pour
évaluer la solvabilité de l'entreprise soit pour estimer la
valeur de l'entreprise dans une optique de cession de participation d'achat ou
de vente d'actions ou en bourse.
CHAP II. PRESENTATION
DU CADRE D'ETUDE
II.1. APERCU HISTORIQUE
United Petroleum est une société privée
du groupe HYPER PSARO, née de la dissolution de la société
JOVENNA (ex PETROKATANGA), localisé au numéro 4 de l'avenue
MULUNDU, Quartier Industriel, commune de KAMPEMBA dans la Province du
Haut-Katanga à Lubumbashi. Elle a effectivement commencé ses
activités entant qu'United Pétroleum depuis le 11 février
1999.
Des lors, elle évolue toujours dans le souci de
l'amélioration et de perfectionnement de l'acquit, faisant des efforts
jour au jour afin de lier l'utile à l'agréable et répondre
aux normes techniques, administratives et environnementales exigés.
II.2. SITUATION
GEOGRAPHIQUE
L'entreprise United Pétroleum est une
société à responsabilité limitée (SPRL) elle
se situe au numéro 4 de l'avenue MULUNDU au quartier industriel dans la
commune KAMPEMBA ville de Lubumbashi province du Haut-Katanga.
II.3. OBJET SOCIAL
L'objectif de la société United Pétroleum
est l'importation, le stockage, la commercialisation et le transport des
carburants terrestres principalement (essence, gasoil, pétrole) et
variation selon les besoins des clients (Argos et Jet A1).
Elle assume aussi dans la vente de lubrifiant : les
huiles moteurs, hydrauliques, de transmission, des transformations,
disjoncteurs de transfert de chaleur en gros emballages (fut de 200, 209, 210
litres) ainsi qu'en petits emballages (bidons de 5L ; 1L ; 0,5 et
¼ litres), les graisses et dégraissant ainsi que les produits de
nettoyage moteurs et matériels électriques.
II.4. ROLE ECONOMIQUE ET
SOCIAL
II.4.1. Rôle
économique
L'entreprise United Pétroleum a pour fonction de
commercialiser ses produits par l'importation, satisfaire sa clientèle
et contribuer au développement du pays.
II.4.2. Rôle social
Le fonctionnement du marché du travail
révèle d'une sorte de géométrie variable qui fait
que l'augmentation des emplois entraine une augmentation corrélative du
monde des demande d'emploi, cela fait ressembler la lutte contre le
chômage à un ouvrage jamais terminé or pour reconstruire le
plein emploi, il ne suffit pas de répondre aux demandes apparentes, mais
aussi à celles qui aujourd'hui cachée ne manqueront pas de se
manifester dès que la situation de l'emploi s'améliorera le
défi est donc double.
a. Effectif personnel
Pour répondre à la réduction du
chômage, l'entreprise United Pétroleum emploie 284 travailleurs
composés des cadres universitaires qualifiés, de techniciens bien
mondés et des agents d'exécution pour une société
qui se respecte. United Pétroleum visant toujours l'excellence, elle
travaille scrupuleusement de façon à répondre avec
acquitté aux normes tant administratives que techniques. En dehors du
salaire octroyé aux travailleurs. L'entreprise assure aussi les soins
médicaux à son personnel ainsi que tous les avantages sociaux.
United Pétroleum contribue à la vie sociale de
la population congolaise en faisant des dons et améliore les conditions
de celle-ci par la réduction de prix de certains produits.
b. Base des données sur le capital
humain
L'homme étant l'auteur du domaine social, la
coopération technique et la mise en valeur du capital humain constituent
une composante de poids.
Ainsi donc United Pétroleum a mis en place un des
éléments de la stratégie qui est l'inventaire ou base des
données de capacités existantes et portes feuilles, l'innovation
de cette base des données spécialisée est qu'elle met en
parallèle les besoins en matière de main d'oeuvre et les
possibilités offertes aux experts.
II.5. LABORATOIRE
D'ANALYSE
Afin d'assurer de la qualité de ses produits, United
Pétroleum dispose d'un laboratoire moderne équipé pour les
analyses physicochimiques des carburants et des lubrifiants.
On y trouve des machines telles que :
- Le spectromètre ;
- Le thermomètre ;
- Le viscosimètre ;
- Le distillateur ;
- Le testeur de flash point (point d'inflation) ;
- La pompe manuelle pour détecter le sulfure
d'hydrogène ;
- L'éture ;
- La plaque chauffante, etc.,...
II.6. CAPACITE DE
STOCKAGE
Pour l'entreposage (stockage) de ses produits, United
Pétroleum a des tanks et des citernes réparties comme
suit :
· GASOIL : 3 050 m3
· ESSENCE : 4 510 m3
· PETROLE : 50 m3
Et un entrepôt pour les lubrifiants de 927 m2
de superficie.
II.7. VOLUME
D'IMPORTATION
Les importations moyennes mensuelles d'United Pétroleum
sont de l'ordre de :
· GASOIL : #177; 8.000 m3
· ESSENCE : #177; 1.200 m3
· PETROLE : #177; 45 m3
· LUBRIFIANTS : #177; 905 m3
II.8. CLIENTELE
Son volume d'importation est sa capacité de stockage
lui permettent d'approvisionner, sans être à cours de stock, les
grandes sociétés minières de la place telle que TFM, BOSS
MINING, EGMF FOREST, RUASHI MINING,... et les stations des services pour la
revente, elle en a au total 7.
II.9. DISTRIBUTIONS DES
PRODUITS
United Pétroleum assure la distribution de ses produits
par son charroi automobile de 28 camions citernes et 14 wagons citernes par la
voie ferrée allant d'une capacité de 30 à 40
m3pour les grandes quantités aux réservoirs et en
futs.
II.10. ORGANISATION
STRUCTURELLE DE UNITED PETROLEUM
II.10.1. Organisation
structurelle
Dans toute entreprise, il est recommandé une certaine
organisation, la manière dont les tâches et responsabilités
sont définies et repartis selon les compétences d'un chacun en
vue d'une évolution et d'un rendement meilleur du travail.
Nous considérons United Pétroleum comme un
système ou toutes les activités sont centrées au
siège de Lubumbashi et dont les différents services sous la
responsabilité de la direction générale.
II.10.2. Organisation
fonctionnelle
United Pétroleum est dirigé par un directeur
général secondé par deux directeurs adjoints qui
s'occupent respectivement de la direction commerciale et technique. Elle est
composée des services principaux :
- Direction générale ;
- Direction commerciale ;
- Direction technique ;
- Direction financière ;
- Direction administrative ;
- Service information et d'exploitation.
LA DIRECTION GENERALE
Elle est constitué de la haute hiérarchie de
l'organisation, elle supervise et planifie l'ordonnancement des
opérations d'approvisionnements, elle conçoit le plan
d'action.
LA DIRECTION COMMERCIALE
Elle s'occupe des différents services, à
savoir :
- Service de comptabilité ;
- Service import et export ;
- Service de contrôle et service de réception des
commandes ;
- Service marketing.
Le service de comptabilité, import-export s'occupe de
la comptabilité de l'entreprise (comptabilité
générale) et des états financiers (bilan, le tableau de
formation du résultat et le tableau de financement). Ce
département s'occupe aussi de contrôle de recettes et des
dépenses de l'entreprise ainsi que des comptabilités des biens
importés.
Ce département de comptabilité s'occupe en fait
de la centralisation de toutes les écritures comptables, de la gestion
du plan comptable de la consolidation de la balance et représentation et
du suivi rigoureux de l'application des principes.
LA DIRECTION TECHNIQUE
Elle s'occupe des services généraux et assure la
maintenance de tous les matériels dont dispose l'entreprise en son sein,
le dépôt, les stations, les garages,...
LA DIRECTION FINANCIERE
Elle évalue financièrement l'ensemble
d'opérations qui se déroulent au sein de la
société. Elle comprend :
- La trésorerie : elle planifie les
dépenses de l'entreprise ;
- Le contrôle de gestion qui s'occupe à part
entière de la caisse et vérifie les mouvements
financiers ;
- La comptabilité : c'est ici ou il y'a la
facturation et la caisse pour les carburants de joli site.
United Petroleum dispose de deux types de clients à
savoir :
· Ceux qui payent à crédit qui sont
facturés au magasin Hyper Psaro ;
· Ceux qui payent au comptant au site de joli site,
l'argent est déposé chaque soir au magasin Hyper Psaro.
DIRECTION ADMINISTRATIVE
Elle s'occupe de la gestion administrative de l'entreprise et
fonctionne en étroite collaboration avec la direction
générale. Elle regorge en son sein le service du personnel.
SERVICE D'INFORMATION ET D'EXPLOITATION
C'est dans ce service que fait la gestion des stocks physiques
et théoriques des entrées et des sorties, la livraison des
produits vers les clients, l'établissement des bon de commande.
ORGANIGRAMME DE UNITED PETROLEUM
DIRECTEUR ADJOINT
251648000251668480LABORATOIRE
251654144251667456251666432251665408251664384251663360EXPLOITATION
251652096251662336251661312251660288251659264251658240251657216TECHNIQUE
251656192COMPTABILITE
251655168IMPORT-EXPORT
251653120ADMINISTRATION
251651072INSPECTION
251650048SECRETAIRE DE DIRECTION
251649024
DIRECTEUR GENERAL
251646976Source: United Petroleum
CONCLUSION PARTIELLE
Nous voici arriver au terme de notre deuxième chapitre
intitulé « Présentation du cadre
d'étude. » ce chapitre a parlé sur l'entreprise United
Pétroleum qui est une entreprise privée SPRL du groupe Hyper
Psaro, on le retrouve sur l'avenue MULUNDU quartier industriel, commune de
Kampemba, ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga.
Cette entreprise est spécialisée dans
l'importation, le stockage, la commercialisation et le transport des carburants
ainsi que de certains lubrifiants. Elle est dirigée par un directeur
général qui est secondé par deux directeurs adjoints. Elle
a pour service principaux : la direction générale, la
direction commerciale, direction technique, la direction financière, la
direction administrative et le service information et d'exploitation. Avec un
personnel de 284 agents United Pétroleum est considéré
comme un système ou toutes les activités sont centrées au
siège de Lubumbashi et dont les différents services sous la
responsabilité de la direction générale.
CHAPITRE III :
L'ANALYSE FINANCIERE D'UNITED PETROLEUM
Dans ce chapitre nous aurons à traiter les données
chiffrées et cela se fera comme suit :
1. Présentation des données
chiffrées ;
2. Etude de la situation financière ;
3. Etude de la rentabilité ;
4. Etude de la capacité d'autofinancement ;
5. Etude des ratios de rotations ;
6. Constat et suggestion.
SECTION I :
PRESENTATION DES DONNEES
1.1. Bilan comptable
Tableau n°1 Actif en CDF
|
N°
|
Intitulé
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
20
22
23
26
|
Actif immobilisées
Charges immobilisées
Terrain
Autres immobilisations
Titresde participations
|
-
-
3439399395
5173500
|
-
8900000
11104201308
-
|
-
8900000
13227947693
223354840
|
57914675
8900000
149944577814
277954840
|
|
Total actif immobilisées
|
3444572895
|
11113101308
|
13451302533
|
150289347329
|
|
31
33
35
40.7
41
42
44
46
47
47.5
48
|
Actif circulant
· Stock
Marchandises
Emballages commerciaux
Stock à l'extérieur
· Créances
Fournisseurs avances
Clients
Personnel
Etat
Associés et groupes
Débiteurs divers
Autres créance
Comptes de régularisation
|
4104774000
19231100
-
-
9293911798
-
-
305283571
39841942125
-
-
|
11153626911
-
2250000
-
15371191630
7227938
-
294750101
8673072143
-
15300000
|
8025086782
-
-
186344580
39470376474
14796358
246521334
108836555
4083312353
76050799
15300000
|
14819244321
-
-
50447253
46677862802
26499237
18056190
56400410
20199922470
20172898275
15299999
|
|
Total actif circulant
|
54958787888
|
36501675071
|
51683477744
|
104520113916
|
|
52
57
|
Trésorerie actif
Banque
caisse
|
1410953294
-
|
613425305
370831043
|
597613808
-
|
1741852700
2086882260
|
|
Total trésorerie actif
|
1410953294
|
984256348
|
597613808
|
3828734960
|
|
TOTAL ACTIF
|
58403360783
|
47614776379
|
66274541476
|
256154713246
|
Tableau n°2 Passif en CDF
|
N°
|
Intitulé
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
10
11.3
12
13
19
|
Capitaux propres
Capital
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat net
Provision règlementées
|
375000
294891796
80912408
1673508550
-
|
375000
37544204
370607101
2031574701
-
|
375000
-
746351305
513015985
3660560010
|
934441
-
1259367290
1407397537
4024780296
|
|
Total capitaux propres
|
2049627754
|
2778301006
|
4920302300
|
6692479564
|
|
16
|
Dettes financières
Emprunt
|
339884878
|
-
|
-
|
-
|
|
Total dettes financières
|
339884878
|
|
|
|
|
40
41.3
42
44
46
47
|
Passif circulant
Fournisseurs
Clients avances
Personnel
Etat
Associés
Créditeurs divers
Ecart de conversion passif
Découvert bancaire
|
1841930339
3845099309
12578827
188680742
40986416002
361730
9138781202
-
|
1841930339
5299561060
156219368
188680742
-
7159571463
30190512401
-
|
30190512401
144578317
420140424
156219368
44516755
-
292588510712
1139761199
|
160802604598
21798
1436219368
4201402424
30214017040
198375341
55045603112
1345252001
|
|
Total passif circulant
|
56013848151
|
44836475373
|
61354239176
|
249462233682
|
|
TOTAL PASSIF
|
58403360783
|
47614776379
|
66274541476
|
256154713246
|
Source : United Petroleum
1.2. Tableau de formation des
résultats
Tableau n°3 TFR en CDF
|
N°
|
Désignation
|
D/C
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
70.1
60.31
|
Vente
Stocks vendus
|
C
D
|
65576003281
6823133909
|
13450898460
128915805642
|
159147303162
151461753008
|
155492890000
148495709569
|
|
13.21
|
Marge brute
|
C
|
58752869372
|
5593178518
|
7685550154
|
6997180435
|
|
13.21
61
62
|
Marge brute
Charge à transférer
Transport
Service extérieur B
|
C
D
D
D
|
58752869372
807029721
223858208
544893928
|
5593178518
939431121
370254981
1265079566
|
76855015
965082055
892369856
1760496343
|
6997180435
268269077
171115224
1880177968
|
|
13.3
|
Valeur ajoutée
|
C
|
57177087515
|
3018412850
|
4076601899
|
4677618165
|
|
13.3
66
|
Valeur ajoutée
Charge du Person.
|
C
D
|
57177087515
281682014
|
3018412850
448528550
|
4076601899
1056066329
|
4677618165
1271364153
|
|
13.4
|
Excèdent brut d'ex.
|
C
|
5685405501
|
2569884300
|
3020535570
|
3406254012
|
|
13.4
65
64
67
|
EBE
Autres charges
Impôts et taxes
Intérêts accordés
|
C
D
D
D
|
5685405501
96757515
205467662
14686911
|
2569884300
511742274
15779999
-
|
3020535570
54315876
272722691
202959
|
3406254012
64942381
-
588617132
|
|
13.5
|
Résultat Brut d'ex
|
C
|
56578840366
|
1854806908
|
2933666134
|
4231283328
|
|
13.5
68
|
RBE
Dotation aux Am.
|
C
D
|
56578840366
35733133
|
1854806908
1067628242
|
2933666134
1281439584
|
4231283328
1435886352
|
|
13.51
|
Résultat d'exploit.
|
C
|
123975673
|
787178666
|
1625226550
|
2795396976
|
|
13.6
|
Résultat sur cession
|
C
|
|
|
32828434
|
|
|
13.8
|
Résultat net Hors ex
|
C
|
-41937340
|
-75040553
|
561687230
|
317960003
|
|
13.7
89
|
Résultat net av imp
Impôt sur revenu
|
C
D
|
1758511155
85002605
|
2369105713
337531012
|
1123367754
610351769
|
2477436973
107003943
|
|
13.9
|
Résultat Net
|
C
|
1673508550
|
2031574701
|
513015985
|
1407397537
|
Source : United Petroleum
Tableau n°4 bilan simplifié
|
Désignation
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
· ACTIF
Actifs immobilisés
Stocks
Créances
trésorerie
|
3444572895
4106697100
49441137494
1410953294
|
11113101308
11155876911
24361541812
984256348
|
13451302533
8025086782
44200538353
-542147391
|
150289347329
14819244321
87217386636
2483482959
|
|
TOTAL ACTIF
|
58403360783
|
47614776379
|
65134780277
|
254809461245
|
|
· PASSIF
Capitaux propres
Dettes financières
Passif circulant
|
2049627754
339884878
56013848151
|
2778301006
-
44836475373
|
4920302300
-
60214477977
|
6692479564
-
24811981681
|
|
TOTAL PASSIF
|
58403360783
|
47614776379
|
65134780277
|
254809461245
|
Source : nous même sur base des tableaux 1 et 2
Tableau n°5 bilan financier synthétique
|
Désignation
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
· ACTIF
Actifs immobilisés
Actif circulant
|
3444572895
54958787888
|
11113101308
46501675071
|
13451302533
516834777744
|
150289347329
104520113916
|
|
TOTAL ACTIF
|
58403360783
|
47614776379
|
65134780277
|
254809461245
|
|
· PASSIF
Passif permanent
Passif circulant
|
2389512632
56013848151
|
2778301006
44836475373
|
4920302300
60214477977
|
6692479564
24811981681
|
|
TOTAL PASSIF
|
58403360783
|
47614776379
|
65134780277
|
254809461245
|
Source : nous même sur base des tableaux 1 et 2
SECTION II : ETUDE DE
LA SITUATION FINANCIERE
2.1. Examen du fonds de
roulement net, Besoin en fonds de roulementet la trésorerie nette
1. calcul du fonds de roulement
Tableau n°6.1 : calcul du fonds de roulement net (FRN)
par le haut du bilan
|
DESIGNATION
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
Capitaux permanent (1)
|
2389512632
|
2778301006
|
4920302300
|
6692479564
|
|
Actifs immobilisées (2)
|
3444572895
|
11113101308
|
13451302533
|
150289347329
|
|
FRN= (1) - (2)
|
(1055060263)
|
(8334800302)
|
(8531000233)
|
(143596867765)
|
Source : sous même à partir des tableaux 1 et
2
Par le bas du bilan :
Tableau n°6.2 : calcul du fonds de roulement net (FRN)
par le bas du bilan
|
DESIGNATION
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
Actif circulant (1)
|
54958787888
|
36501675071
|
51683477744
|
104520113916
|
|
Dettes à CT (2)
|
56013848151
|
44836475373
|
60214477977
|
248116981681
|
|
FRN= (1) - (2)
|
(1055060263)
|
(8334800302)
|
(8531000233)
|
(143596867765)
|
Source : sous même à partir des tableaux 1et
2
En observant le tableau ci haut, on voit que le fonds de
roulement est négatif durant toute la période de notre
étude, cet état des choses montre que les capitaux permanents
n'arrivent pas à couvrir la totalité des actifs
immobilisés fixes et dans ce cas la station recourt à des
financements à court terme.
2. Calcul du besoin en fonds de roulement
Tableau n°7 : Calcul du besoin en fonds de roulement
(BFR)
|
DESIGNATION
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
Actif d'exploit. (1)
|
53547834594
|
35517418723
|
52225625135
|
64132562902
|
|
Passif d'exploit. (2)
|
56013848151
|
44836475373
|
60214477977
|
248116981681
|
|
BFR = (1) - (2)
|
-2466013557
|
-9319056650
|
-7988852842
|
-146080350724
|
Source : sous même sur base du tableau 5
En analysant le tableau ci-dessus, nous remarquons que le besoin
en fonds de roulement est négatif sur toute la période sous
études, cela est du fait que les valeurs circulantes sont
inférieures aux dettes financières à court terme et
l'entreprise est capable financièrement de faire face à ses
engagements à moins d'un an.
3. Calcul de la trésorerie nette (TN)
Tableau n°8 : Trésorerie nette (TN)
|
DESIGNATION
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
FRN (1)
|
-1055060263
|
-8334800302
|
-8531000233
|
-143596867765
|
|
BFR (2)
|
-2466013557
|
-9319056650
|
-7988852842
|
-146080350724
|
|
TN= (1) - (2)
|
1410953294
|
984256348
|
(542147391)
|
2483482959
|
Source : sous même sur base du tableau n°7 et
8
Il ressort de ce tableau que la trésorerie est
négative seulement en 2015, ce qui signifie que le fonds de roulement
est inférieur au besoin en fonds de roulement et pendant cette
année l'entreprise recours au financement externe pour pouvoir faire
face à ses activités courantes, mais pour les autres
années elle est positive et cela veut dire que l'entreprise dispose des
liquidités en son sein qui reste à sa disposition après
avoir financé le cycle d'exploitation.
2.2. Méthode des
ratios
2.2.1. Ratio de
liquidité générale (RLG)
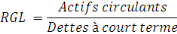
Tableau n°9 : calcul RLG
|
DESIGNATION
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
Actif circulant (1)
|
54958787888
|
36501675071
|
51683477744
|
104520113916
|
|
Dettes à CT (2)
|
56013848151
|
44836475373
|
60214477977
|
248116981681
|
|
RLG= (1) /(2)
|
0,98116429601
|
0,8140670146
|
0,85832310568
|
0,42125336689
|
Source : sous même sur base du tableau 5
En analysant le tableau du RLG, on remarque qu'il est
inférieur à 1 et cela veut dire que l'entreprise n'est pas
capable de faire face à ses dettes à court termes.
2.2.2. Ratio de
liquidité réduite (RLR)
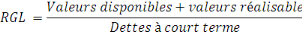
Tableau n°10 calcul du RLR
|
DESIGNATION
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
Créances (1)
|
49441137494
|
24361541812
|
44200538353
|
87217386636
|
|
Trésorerie (2)
|
1410953294
|
984256348
|
-542147391
|
2483482959
|
|
Dettes à CT (3)
|
56013848151
|
44836475373
|
60214477977
|
24811981681
|
|
RLR = [(1) (2)]/ (3)
|
0,90784854936
|
0,56529417063
|
0,72504806865
|
0,36152652264
|
Source : sous même sur base du tableau 5
En observant l'évolution des ratios de liquidité
réduite, nous constatons qu'ils sont inférieur à 1 ce qui
stipule que l'entreprise n'est pas capable à faire face à ses
dettes à court termes.
2.2.3. Ratio de
liquidité immédiate (RLI)
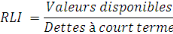
Tableau n°11 : calcul du RLI
|
DESIGNATION
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
Disponibles (1)
|
1410953294
|
984256348
|
-542147391
|
2483482959
|
|
Dettes à CT (2)
|
56013848151
|
44836475373
|
60214477977
|
248116981681
|
|
RLI= (1) /(2)
|
0,0251893655
|
0,021195213473
|
0,00900360527
|
0,01000932279
|
Source : sous même sur base du tableau 5
Pour ce tableau, il ressort que le ratio de liquidité
immédiate reste inférieur à 1 sur toute la période
sous études et cela veut dire que l'entreprise n'est pas capable de
faire face à ses exigibles à court terme.
2.2.4. Ratio de
solvabilité (RS)
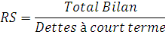
Tableau n°12 : calcul RS
|
DESIGNATION
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
Total Bilan (1)
|
58403360783
|
47614776379
|
65134780277
|
254809461245
|
|
Dettes à CT (2)
|
56013848151
|
44836475373
|
60214477977
|
248116981681
|
|
RS = (1) /(2)
|
1,04
|
1,06
|
1,08
|
1,03
|
Source : sous même sur base du tableau 5
En analysant les ratios d'endettement nous constatons que
l'entreprise ne jouit pas d'une bonne autonomie financière sur toute la
période sous examen, car ses ratios sont supérieurs à
1.
SECTION 3 ETUDE DE LA
RENTABILITE
3.1. RENTABILITE
COMMERCIALE
TABLEAU N°13 CALCUL DE LA RENTABILITE COMMERCIALE
|
DESIGNATION
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
RESULTAT NET (1)
|
1673508550
|
2031574701
|
513015985
|
1407397537
|
|
CHIFFRES D'AFFAIRES (2)
|
65576003281
|
13450898460
|
159147303162
|
155492890000
|
|
RTE C/CIALE=1/2X100
|
2,550
|
15,10
|
0,32
|
0,91
|
Source : nous-mêmes sur base du tableau 3
En observant l'évolution de la rentabilité
commerciale, nous trouvons qu'elle est positive durant la période de
notre étude, c'est-à-dire qu'UNITED PETROLUM a quand-même
une capacité à secréter des excédents
destinés à couvrir les coûts des capitaux
engagés.
3.2. RENTABILITE ECONOMIQUE
(ROI) ET RENTABILITE FINANCIERE
TABLEAU N°14
|
DESIGNATION
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
RESULTAT NET (1)
|
1673508550
|
2031574701
|
513015985
|
1407397537
|
|
RESULTAT BRUT D'EXP (2)
|
56578840366
|
1854806908
|
2933666134
|
4231283328
|
|
TOTAL ACTIF (3)
|
58403360783
|
47614776379
|
65134780277
|
254809461245
|
|
CAPITAUX PROPRES
|
2049627754
|
2778301006
|
4920302300
|
6692479564
|
|
ROI=2/3 X 100
|
96,88
|
3,90
|
4,50
|
1,66
|
|
ROE=1/4 X 100
|
81,65
|
73,12
|
10,43
|
21,03
|
Source : nous-mêmes sur base du tableau 3
En observant ce tableau, nous trouvons que la
rentabilité économique de l'entreprise UNITED PETROLUM est
positive durant toute la période de notre étude mais étant
très faible pour 2014 à 2016, cela suppose qu'il y a une faible
capacité bénéficiaire d'UNITED PETROLUM tout en
neutralisant la rémunération de capital investi. Quant à
l'évolution de la rentabilité financière, nous remarquons
qu'elle est positive durant la période sous étude.
SECTION 4 ETUDE DE LA
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
TABLEAU N°15 DETERMINATION DE LA CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT
|
DESIGNATION
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
RESULTAT NET (1)
|
1673508550
|
2031574701
|
513015985
|
1407397537
|
|
DOATION AUX AMORTS (2)
|
35733133
|
1067628242
|
1281439584
|
1483690711
|
|
CAF=(1) + (2) X100
|
1709241683
|
3099202943
|
1794455569
|
2891088248
|
Source : nous-mêmes sur base du tableau 3
Le résultat trouvé dans ce tableau ci-haut
montre que UNITED PETROLUM est en mesure de s'autofinancer. Toutefois, nous
allons concrétiser notre analyse en calculant certains ratios issus de
cette capacité d'autofinancement
TABLEAU N°16 RATIOS 1 : CAF/CHIFFRES D'AFFAIRES
|
DESIGNATION
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
CAF (1)
|
1709241683
|
3099202943
|
1794455569
|
2891088248
|
|
CHIFFRES D'AFFAIRES (2)
|
65576003281
|
13450898460
|
159147303162
|
155492890000
|
|
RATIO 2= ½ X 100
|
2,60
|
23,041
|
11,25
|
1,86
|
Source : nous-mêmes sur base du tableau 3
Pour 100F du chiffre d'affaires, le montant qui est
destiné à assurer à la fois le renouvellement des
immobilisations et la croissance de l'entreprise est de 2,6% en 2013 ;
23,041% en 2014 ; 11,25% en 2015 et 1,86% en 2016.
TABLEAU N°17 RATIOS 2 : CAF/TOTAL BILAN
|
DESIGNATION
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
CAF (1)
|
1709241683
|
3099202943
|
1794455569
|
2891088248
|
|
TOTAL BILAN (2)
|
58403360783
|
47614776379
|
65134780277
|
254809461245
|
|
RATIO 2= ½ X 100
|
2,93
|
6,51
|
2,76
|
1,14
|
Source : nous-mêmes sur base des tableaux 1 et 3
En 2014 UNITED PETROLUM présente un bon signe de ratio,
cette situation est bonne pour une entreprise qui possède certaines
possibilités de garder un niveau d'autofinancement mais pour les autres
années, elle est faible.
SECTION 5 RATIOS DE
ROTATIONS
5.1. ROTATION DES CAPITAUX
PROPRES
TABLEAU N°18 ROTATION DES CAPITAUX PROPRES
|
DESIGNATION
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
CAPITAUX PROPRES (1)
|
2049627754
|
2778301006
|
4920302300
|
6692479564
|
|
CHIFFRES D'AFFAIRES (2)
|
65576003281
|
13450898460
|
159147303162
|
155492890000
|
|
ROTATION (2) / (1)
|
32 fois
|
9 fois
|
32 fois
|
23 fois
|
|
DUREE DE ROTATION =1/2 X 360
|
11,2 Jours
|
68 jours
|
11 jours
|
16 jours
|
Source : nous-mêmes sur base des tableaux 1 et 3
La rotation des capitaux propres d'United Pétroleum a
était atteinte plus de 9 fois l'an ce qui est assez bonne.
5.2. DELAI DE ROTATION
TABLEAU N°19 DELAI DE ROTATION STOCK
|
DESIGNATION
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
Stock en début (1)
|
3466701891
|
4106697100
|
11155876911
|
8025086782
|
|
Stock à la fin (2)
|
4106697100
|
11155876911
|
8025086782
|
14819244321
|
|
Approvisionnement (3)
|
6823133909
|
128915805642
|
131461753008
|
148495709569
|
|
Stock moyen (4)= (1+2)/3
|
3786699496
|
7631287006
|
15168420302
|
11422165552
|
|
Rotation = 4 x 360 jours
|
198 jours
|
21 jours
|
36 jours
|
28 jours
|
Source : nous-mêmes sur base des tableaux 1 et 3
En 2013, United Petroleum a réalisé son stock
après 198 jours soit 2 fois en 2014 après 21 jours soit 16 fois
en 2015 après 36 jours soit 9 fois et en 2016 après 28 jours soit
13 fois.
5.3. ROTATION DES CREANCES
CLIENTS
Ce ratio indique la durée des crédits
accordés par une entreprise. Pour notre cas ce ratio se présente
dans le tableau suivant :
Tableau n°20 : Délai de rotation des
créances clients
|
Désignation
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
Créances clients (1)
|
9293211798
|
15371191630
|
39470376474
|
46677862802
|
|
Chiffres d'affaires (2)
|
65576003281
|
13450898460
|
159147303162
|
155492890000
|
|
Délai de rotation : 1 x 360 jours/
2
|
51 jours
|
411 jours
|
89 jours
|
108 jours
|
Source : nous-mêmes sur base des tableaux 1 et 3
En moyenne les clients d'United Petroleum règlent leurs
créances après 165 jours et nous remarquons qu'en 2015 il y'a un
grand délai de rotation ce qui n'est pas bien pour une entreprise.
5.4. ROTATION DES DETTES
FOURNISSEURS
Ce ratio indique la durée des crédits
accordés par les fournisseurs (échéances) ce délai
serait suffisant d'autant puisqu'il soit supérieur au délai de
recouvrement des créances clients. Le tableau suivant nous permet de
calculer ce délai :
Tableau n°20 : Délai de rotation des
créances clients
|
Désignation
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
Fournisseur (1)
|
1841930339
|
1841930339
|
30190512401
|
160802604598
|
|
Achat de l'année (2)
|
6823133909
|
128915805642
|
151461753008
|
148495709569
|
|
Délai de rotation : 1 x 360 jours/
2
|
97 jours
|
5 jours
|
72 jours
|
389 jours
|
Source : nous-mêmes sur base des tableaux2 et 3
Vu que la moyenne du délai de règlement des
dettes envers les fournisseurs, les fournisseurs sont courts par rapport au
délai de recouvrement des créances sur les clients, la situation
n'est pas bonne pour ces quatre ans de notre étude.
SECTION 6 : CONSTAT ET
SUGGESTIONS
a. Constat général
L'étude que nous venons de mener sur l'entreprise
United Petroleum Hyper Psaro, sur la période de 2013 à 2016 en ce
qui concerne l'analyse financière. Nous a permis de répondre aux
préoccupations de la structure financière et de la
rentabilité économico financière.
Apres notre analyse des données chiffrées, on
voit que l'entreprise United Petroleum présente une bonne situation
financière durant toute la période de notre étude et cela
s'explique par :
- Le fonds de roulement est négatif de 2013 à
2016 ;
- Le besoin en fonds de roulement est négatif sur toute
la période sous examen ;
- La trésorerie est négative en 2015 et positive
pour les autres années ;
- En général la liquidité de l'entreprise
est bonne ;
- United Petroleum présente une situation
financière assez bonne concernant la solvabilité durant toute la
période de notre étude ;
- La capacité d'autofinancement n'est pas assez
très large mais cela permet à l'entreprise de s'autofinancer.
b. Suggestions
United Petroleum est une entreprise privée, nous
suggérons aux responsables de :
- Continuer avec sa gestion et de chercher une
indépendance financière vus que sa trésorerie est bonne
durant les quatre ans.
- Continuer à diversifier leur activité, afin
d'accroitre beaucoup plus des recettes.
Conclusion partielle
Au terme de ce chapitre qui traite sur l'analyse financier
d'United Petroleum, nous avons constaté que cette entreprise
présente des bonnes rentabilités économiques,
financière et commerciales. Avec les rentabilités et le calcul de
la capacité d'autofinancement, l'analyse nous a montré qu'United
Petroleum, a été à mesure de s'autofinancer chaque
année ; la capacité d'autofinancement n'a pas
été assez large comme les ratios calculés à ce
sujet les prouvent.
Les ratios de rotation de capitaux ont témoigné
que l'activité d'United Petroleum évolue assez bien. Les chiffres
d'affaires ont était à mesure de couvrir les capitaux propres
plus de 9 fois par an, la vitesse de rotation des stocks n'est pas trop rapide.
Le délai de rotation des créances clients est supérieur
par rapport au délai de rotation des dettes fournisseurs.
En considérant les éléments ci-haut, nous
disons que la rentabilité d'United Petroleum n'est pas vraiment trop
suffisante, mais du moins elle arrive à atteindre l'autofinancement.
CONCLUSION GENERALE
Nous voici arrivé au terme de notre étude qui a
pour titre « analyse financière comme outil indispensable dans
la gestion d'une entreprise pétrolière ca s de United
Petroleum.
Tout au long de notre recherche il a était question de
savoir en quoi l'analyse financière serait indispensable à la
gestion d'une entreprise pour qu'elle influe sur sa rentabilité
économico-financière ?
Comme réponse provisoire à la question
posée l'analyse financière serait un outil de gestion
indispensable su sein de l'entreprise si les indicateurs sont calculés
régulièrement et cela constitueraient un tableau de bord qui
jouerait une fonction d'aide à la prise des décisions et la
répercussion de cette analyse aurait un impact positif sur la
rentabilité économico-financière si les gestionnaires
après calcul des différents indicateurs mettaient en oeuvre les
résultats obtenus.
Ainsi pour UNITED PETROLEUM en observant le niveau de
rentabilité nous voyons qu'elles restent positives sur toute la
période sous étude. Ce qui est une bonne chose pour la survie de
l'entreprise. Cette entreprise doit continuer à gérer sa
situation financière à moindre coût pour assurer la survie,
la pérennité et arriver à faire face à ses
engagements à court terme.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1. BERGERON, la gestion moderne et théorique et cas,
éd. Gaëtan, Paris 1984, p.64
2. BERZILE R, Analyse financière, édition HRW
Montréal, 1998, p.15
3. BRUNO S., Nouvelles trésorerie d'entreprise, 5eme
éd, Dunod, Paris 1977, p.38
4. BRUNO S., Nouvelles trésorerie d'entreprise, 5eme
éd, Dunod, Paris
5. COLAISSE B., la gestion financière de l'entreprise,
PUF, Paris 1993, p.299
6. COHEN E., analyse financière, 4eme édition
economica, Paris
7. FARBERA A., 2LEMENT D4ANALYSE FINANCI7RE, ULB, Janvier
2002, p.24
8. Georges DE PALLENS, Gestion financière de
l'entreprise, 5eme édition, Paris
9. P. LAUZER et R. TELLER, contrôle de gestion et
budget, 5eme édition, Ed SIREY 1989
10. J. MEYER, le contrôle de gestion, 3eme
édition, PUF, Paris 1969
11. MOUSSON, Précis d'économie politique, 4eme
édition, Paris, 1965
12. SOLNIK B., gestion financière, éd. Dunod,
6eme éd, 2001, p.16
13. G TERRY et S FRANKLIN, principe de management éd,
economica, paris 1985
14. VERNIMEN P., finance de l'entreprise, 2eme édition,
Dalloz, paris 1996, p.174
15. GEORGES DE PALLENG, Gestion financière de
l'entreprise, 5eme édition, Paris
16. SOLNIK B., Gestion financière, éd. Dunod,
6eme éd, Paris
II. MEMOIRES ET TRAVAUX DE FIN D'ETUDE
1. ILUNGA BINENE Hugo, Etudiant L2 Comptabilité,
ISS-Lubumbashi, 2016-1017
2. MWENZE MBUMBA, Etudiant L2 Comptabilité,
ISC-Lubumbashi, 2009-1010
III. COURS
1. Ass Delphin KAKUDJI, Cours de contrôle de gestion,
inédit ISS-Lubumbashi, 2018
2. Ass Jean MWANZA, Méthodes de recherches
scientifiques, ISS-Lubumbashi, 2014-2015
3. John LWANDU, analyse des états financiers,
ISS-Lubumbashi, 2015
4. P.O José MWANYA, Cours de gestion financière,
Inédit, ISS/Lubumbashi 2015-2016.
IV. AUTRES DOCUMENTS
1. Rapport annuel 2013, 2014, 2015,2016 et archives United
Petroleum
2. Entreprise Wikipédia
Table des matières
EPIGRAPHE.............................................................................................I
DEDICACE.............................................................................................II
REMERCIEMENTS.................................................................................III
INTRODUCTION
I
I. PRESENTATION DU SUJET
1
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET
1
II.1. Choix du sujet
2
II.2. Intérêt du sujet
2
III. ETAT DE LA QUESTION
3
IV. PROBLEMATIQUE
3
V. HYPOTHESE
4
VI. METHODES ET TECHNIQUES
4
1. Méthodes analytique
4
2. Techniques
4
VII. DELIMITATION DU SUJET
5
1. Délimitation temporelle
5
2. Délimitation spatiale
5
VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
5
CHAPITRE I : LES CONSIDERATIONS GENERALES
6
SECTION 1 : DEFINITION DES CONCEPTS DE
BASE
6
I.1.1. L'entreprise
6
I.1.1.2. Classification des entreprises
6
I.1.1.3. Mission de l'entreprise
7
I.1.1.4. Objectif de l'entreprise
8
I.1.1.5. Croissance d'une entreprise
8
I.1.1.6. Portefeuille d'une entreprise
8
I.1.2. Gestion
9
I.1.2.1. Outils de gestion
9
I.1.2.1.1. Outils de prévision
9
I.1.2.1.2. Outils d'analyse
10
SECTION II : CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR
L'ANALYSE FINANCIERE
14
I.2.1 Définition de l'analyse
financière
14
I.2.2. Historique de l'analyse
financière
14
I.2.3. Importance et étapes de l'analyse
financière
15
I.2.4. Quelques stratégies financière
d'une entreprise
16
I.2.5. Méthodes d'appréciation des
entreprises
16
I.2.5.1. principe de l'équilibre
financier
17
I.2.5.1.1. ETUDE DU FONDS DE ROULEMENT
17
I.2.5.1.2. DEFINITION ET ETUDE DE BESOIN EN FONDS
DE ROULEMENT
18
I.2.5.1.3. NOTIONS DE TRESORERIE
18
I.2.5.1.4. NOTIONS DE RENTABILITE
19
I.2.6. Analyse par la méthode des ratios
20
I.2.6.1. Définitions et
interprétations
20
I.2.6.2. Ratios de solvabilité à long
terme
21
I.2.6.4. Ratios de solvabilité à
court terme
23
I.2.7. Capacité d'autofinancement
23
Conclusion partielle
25
CHAP II. PRESENTATION DU CADRE D'ETUDE
26
II.1. APERCU HISTORIQUE
26
II.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE
26
II.3. OBJET SOCIAL
26
II.4. ROLE ECONOMIQUE ET SOCIAL
27
II.4.1. Rôle économique
27
II.4.2. Rôle social
27
II.5. LABORATOIRE D'ANALYSE
28
II.6. CAPACITE DE STOCKAGE
28
II.7. VOLUME D'IMPORTATION
28
II.8. CLIENTELE
29
II.9. DISTRIBUTIONS DES PRODUITS
29
II.10. ORGANISATION STRUCTURELLE D'UNITED
PETROLEUM
29
II.10.1. Organisation structurelle
29
II.10.2. organisation fonctionnelle
29
CONCLUSION PARTIELLE
33
CHAPITRE III : L'ANALYSE FINANCIERE D'UNITED
PETROLEUM
34
SECTION I : PRESENTATION DES DONNEES
35
1.1. Bilan comptable
35
1.2. Tableau de formation des résultats
37
SECTION II : ETUDE DE LA SITUATION
FINANCIERE
39
2.1. Examen du fonds de roulement net, Besoin en
fonds de roulement et la trésorerie nette
39
2.2. Méthode des ratios
40
2.2.1. Ratio de liquidité
générale (RLG)
40
2.2.2. Ratio de liquidité réduite
(RLR)
40
2.2.3. Ratio de liquidité immédiate
(RLI)
41
2.2.4. Ratio de solvabilité (RS)
41
SECTION 3 ETUDE DE LA RENTABILITE
41
3.1. RENTABILITE COMMERCIALE
41
3.2. RENTABILITE ECONOMIQUE (ROI) ET RENTABILITE
FINANCIERE
42
SECTION 4 ETUDE DE LA CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT
42
SECTION 4 RATIOS DE ROTATIONS
43
5.1. ROTATION DES CAPITAUX PROPRES
43
5.1. DELAI DE ROTATION DES STOCKS
43
5.3. ROTATION DES CREANCES CLIENTS
44
5.4. ROTATION DES DETTES FOURNISSEURS
44
SECTION 6 : CONSTAT ET SUGGESTION
45
Conclusion partielle
46
CONCLUSION GENERALE
47
BIBLIOGRAPHIE
48

* 1 ILUNGA BINENE Hugo, Etudiant
L2 Comptabilité, ISS-Lubumbashi, 2016-1017
* 2 MWENZE MBUMBA, Etudiant L2
Comptabilité, ISC-Lubumbashi, 2009-1010
* 3 Jean MWANZA,
Méthodes de recherches scientifiques, ISS-Lubumbashi,
2014-2015
* 4 Entreprise
Wikipédia
* 5 MOUSSON, Précis
d'économie politique, 4eme édition, Paris, 1965
* 6 BERGERON, la gestion
moderne et théorique et cas, éd. Gaëtan, Paris 1984,
p.64
* 8 PIERRE G et BERGERON,
Principe de management, ed. Économique, Paris, 1985.
* 7 P. LAUZER et R. TELLER,
contrôle de gestion et budget, 5eme édition, Ed SIREY
1989.
* 8 J. MEYER, le
contrôle de gestion, 3eme édition, PUF, Paris 1969
* 9 Ass Delphin KAKUDJI, Cours
de contrôle de gestion, inédit ISS-Lubumbashi, 2018
* 10 SOLNIK B., Gestion
financière, éd. Dunod, 6eme éd, Paris
* 11 John LWANDU, cours
d'analyse des états financiers, ISS-Lubumbashi, G3 SCOFI, INEDIT,
2015.
* 12 COHEN E., analyse
financière, 4eme édition economica, Paris
* 13 P.O JOSE MWANYA, cours
de gestion financière, ISS-Lubumbashi, inédit,
2015-2016
* 14 Idem
* 15 BERZILE R, Analyse
financière, édition HRW Montréal, 1998, p.15
* 16 VERNIMEN P., finance de
l'entreprise, 2eme édition, Dalloz, paris 1996, p.174
* 17 Georges DE PALLENS,
Gestion financière de l'entreprise, 5eme édition, Paris
* 18 GEORGES DE PALLENG,
Gestion financière de l'entreprise, 5eme édition, Paris
* 19 P.O JOSE MWANYA, cours
de gestion financière, inédit, ISS-Lubumbashi, 2015-2016
* 20 COLAISSE B., la gestion
financière de l'entreprise, PUF, Paris 1993, p.299
* 21 FARBERA A.,
Elément d'analyse financière, ULB, Janvier 2002, p.24
* 22 BRUNO S., Nouvelles
trésorerie d'entreprise, 5eme éd, Dunod, Paris 1977, p.38
* 23BRUNO S., Nouvelles
trésorerie d'entreprise, 5eme éd, Dunod, Paris 1977, p.38
| 


