|
Session 2022
DU MAS DES BOURBOUX CÔME
CAFERUIS
INITIER ET ACCOMPAGNER UN CHANGEMENT DES
PRATIQUES
PROFESSIONNELLES EN CSAPA
PERMETTRE À L'USAGER DE DROGUES D'ÊTRE
ACTEUR
DE SON PROJET DE SOIN,
FACILITER L'INSTAURATION DE
L'ALLIANCE
THÉRAPEUTIQUE
ATTESTATION DE NON-PLAGIAT
Je soussigné, Côme du Mas des Bourboux,
atteste sur l'honneur que le présent dossier a été
écrit de ma main, et que toutes les sources d'information externes ont
été citées. Je certifie également que je n'ai pas
contrefait, ni falsifié, ni copié l'oeuvre d'autrui afin de la
faire passer pour mienne.
Fait à Montpellier, le 5 janvier 2022
Signature du candidat
Sommaire
INTRODUCTION 1
1 L'HÉBERGEMENT EN APPARTEMENTS
THÉRAPEUTIQUES DANS UN CSAPA : DE L'ABSTINENCE AU BAS SEUIL
D'EXIGENCE
THÉRAPEUTIQUE 3
1.1 La structure 3
1.2 Un public présentant des problématiques souvent
multiples et complexes 6
1.3 Le cadre légal des CSAPA et l'histoire de la RDRD en
quelques dates 7
1.4 Les enjeux du soin dans les CSAPA : instauration et maintien
de l'alliance
thérapeutique 14
2 LA MISE EN PLACE DE l'ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE UN
ENJEU
FRAGILISÉ PAR LE NON RESPECT DE LA LOI
17
2.1 Méthodologie 19
2.2 Des carences dans le respect des droits des usagers et dans
l'organisation :
une structure qui méconnaît le cadre légal
21
2.2.1 Des manquements aux droits de l'usager qui l'empêchent
d'être
pleinement acteur de son projet. 21
l L'admission est exclusivement administrative et s'opère
sans co-
construction d'un projet de soin. 21
l Le déficit d'information entrave l'instauration et le
maintien de l'alliance
thérapeutique. 23
l L'accompagnement ne prend pas assez en compte la
complexité de la
situation des individus. 25
l La fréquence des entrevues entre les professionnels et
les usagers est
insuffisante. Aucune action ne vient pallier le sentiment de
vide laissé par
l'arrêt ou la réduction des consommations.
27
2.2.2 La RDRD, une stratégie qui inspire de la méfiance et
ne fait pas
sens commun. 28
l L'obligation légale de mise-à-disposition de
matériel de RDRD n'est pas
respectée. 28
l La formation des professionnels est insuffisante. 30
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022
l Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS
- session 2022
Le manque de moyens humains et financiers, l'organisation de
la structure constituent des freins au changement. 31
2.2.3 Ces dysfonctionnements occasionnent des risques pour les
usagers,
les professionnels et la structure. 32
2.3 Réussir l'alliance thérapeutique : des
objectifs stratégiques à fixer 34
3 GARANTIR UNE PRISE EN CHARGE DE QUALITÉ EN
CSAPA : PERMETTRE A l' USAGER D'ÊTRE ACTEUR DE SON PROJET DE
SOIN 36
3.1 Objectif intermédiaire 1 : Proposer une
offre de soin respectueuse des droits
des usagers 37
l 3.1.A Améliorer les procédures de
pré-admission et d'admission en axant ces
étapes sur la co-construction 37
l 3.1.B Rendre systématique une information
complète 39
l 3.1.C Prendre en compte la complexité de la situation
des individus 40
l 3.1.D Augmenter la fréquence des entrevues entre les
professionnels et les usagers. Proposer des activités visant à
lutter contre le sentiment de vide laissé
par l'arrêt ou la diminution des consommations 42
3.2
Objectif intermédiaire 2 : Accompagner les changements dans le
fonctionnement de la structure et des pratiques professionnelles pour permettre
la
mise en place d'une réelle implémentation de la
RDRD 43
l 3.2.A Former et sensibiliser les professionnels à la
RDRD 43
l 3.2.B Mettre à disposition du matériel de RDRD
avec plusieurs modalités 44
l 3.2.C Envisager des changements dans l'utilisation des moyens
physiques
et financiers ainsi que dans l'organisation de la structure 46
CONCLUSION 48
BIBLIOGRAPHIE 50
LISTE DES ANNEXES I
ANNEXES II/XIV
Liste des sigles utilisés
AERLI : Accompagnement et Éducation aux
Risques Liés à l'Injection
ANESM : Agence Nationale de l'Évaluation
et de la qualité des Établissements et Services
sociaux et Médico-sociaux
ARS : Agence Régionale de Santé
ASUD : Auto-Support des Usagers de Drogues
CASF : Code de l'Action Sociale et des
Familles
CCAA : Centres de Cure Ambulatoire en
Alcoologie
CHRS : Centre d'Hébergement et de
Réinsertion Sociale
CHSCT : Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CMU : Couverture Maladie Universelle
CSAPA : Centre de Soins, d'Accompagnement et de
Prévention en Addictologie
CSS : Couverture Santé Solidaire
CSST : Centre Spécialisé de Soins
aux Toxicomanes
CTR : Centre Thérapeutique
Résidentiel
DHU : Dispositif d'Hébergement
d'Urgence
DIHAL : Délégation
Interministérielle à l'Hébergement et à
l'Accès au Logement
DUERP : Document Unique d'Évaluation des
Risques Professionnels
ELSA : Équipe de Liaison et de Soin en
Addictologies
FALC : Facile à Lire et à
Comprendre
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences
HAS : Haute Autorité de Santé
LAM : Lits d'Accueil
Médicalisés
LHSS : Lits Haltes Soins Santé
MILDECA : Mission Interministérielle de
Lutte contre les Drogues et les Conduites
Addictives
OFDT : Office Français des Drogues et des
Toxicomanies
PES : Programme d'Échange de Seringues
RDR : Réduction des Risques liés
à l'usage de drogue
RDRD : Réduction des Risques et des
Dommages liés à l'usage de Drogue
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé
RUIS : Responsable d'Unité d'Intervention
Sociale
SCMR : Salle de Consommation à Moindre
Risque
TSO : Traitement de Substitution aux
Opiacés
VHC : Virus de l'Hépatite C
VIH : Virus de l'Immunodéficience
Humaine
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022
INTRODUCTION
|
« Je gère un centre de soins résidentiel,
ex post-cure, où on ne distribue pas de matériel. Pourquoi ?
Parce que je n'ai pas encore réussi à convaincre la majeure
partie de l'équipe qui était là depuis des années,
qui travaillait dans des logiques très abstinentielles ; et donc pour
eux la RDR (Réduction des Risques) est un discours
opposé à la logique abstinentielle... J'ai
réussi à leur faire accepter que les
personnes puissent avoir des objectifs différenciés de
l'abstinence, qu'il puisse y avoir des consommations pendant le séjour,
qu'elles ne soient pas des motifs de fin de séjour, pour autant on en
n'est pas encore à la distribution de matériel. » :
propos d'un chef de service en CSAPA.
|
Cet extrait d'un entretien que j'ai mené illustre bien
la tension qui anime ce RUIS. Le réel des actions de la structure n'est
pas en accord avec le prescrit. Sa volonté que la structure respecte le
cadre légal et les bonnes pratiques professionnelles se heurte encore
à une certaine résistance de l'équipe. Il est conscient
que l'intérêt de ce changement de culture doit être
argumenté, accompagné et s'inscrit dans une stratégie
qu'il s'agit de mettre en oeuvre avec la temporalité adéquate.
En poste de cadre dans un Centre de Soin, d'Accompagnement et
de Prévention en Addictologie (CSAPA) de la région, je constate
que la structure ne se conforme pas entièrement à ses obligations
légales et ce malgré l'engagement professionnel de la
majorité des membres de l'équipe. En effet, la loi enjoint aux
CSAPA d'informer pleinement les usagers de leurs droits, devoirs et des
prestations proposées par l'organisation. L'absence d'obligation
d'abstinence doit être formulée. Des actions de Réduction
des Risques et des Dommages doivent être mises en place. Les
professionnels ont donc aussi la mission d'accompagner les usagers dans la
gestion et la sécurisation de leurs consommations et leur fournir du
matériel de consommation à moindre risque.
Ces obligations réglementaires ne sont pas
respectées ce qui engendre des risques pour tous les acteurs : usagers,
salariés, RUIS, et en définitive pour l'organisation, son image
et sa pérennité. Cette culture institutionnelle, installée
depuis la création de la structure doit donc être
questionnée et changée en profondeur. Elle va à l'encontre
des évolutions du secteur. Nous sommes passés d'une injonction
thérapeutique qui fait encore écho dans la perception de certains
usagers et professionnels à un accompagnement vers le
rétablissement. Un chemin non linéaire où les rechutes
peuvent survenir mais dans lequel le choix éclairé de l'usager
doit prévaloir: aller vers un mieux-être plutôt que de
mobiliser toutes les énergies sur une guérison
hypothétique dont le principal indicateur serait l'abstinence totale.
Le risque majeur de cette situation est que la confiance ne
s'installe pas et que la relation de soin soit impossible à mettre en
place. Cette méconnaissance du cadre légal entrave la
qualité de la prise en charge et ne permet pas l'accomplissement des
missions obligatoires des CSAPA, dont celle de la réinsertion sociale.
Ne pas donner toutes les
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 1 -
informations à l'usager, ne pas lui permettre
d'être co-constructeur de son projet de soin revient, en effet, à
ne pas lui permettre d'être acteur, maître de son histoire. Si les
accompagnants ne lui reconnaissent pas cette place, n'élaborent pas avec
lui un parcours individualisé et contractualisé, comment
permettre l'instauration de l'alliance thérapeutique, seule à
même de fédérer les énergies vers un
rétablissement ?
De nombreux textes législatifs encadrent l'action des
CSAPA. La Loi la plus récente est la Loi n° 2016-41 du 26 janvier
2016 de modernisation de notre système de santé qui
réaffirme l'obligation de Réduction des Risques et des Dommages.
La loi 2002-2 du 2 janvier 2002, elle, impose un accompagnement
individualisé et met l'usager et sa participation au centre des
préoccupations des structures sociales et médicaux-sociales. Ces
lois sont le fruit d'une longue évolution de la façon dont
l'individu, usager de structure et, en l'occurrence, consommateur de
substances, est appréhendé par le législateur et par les
professionnels du travail social. En tant que RUIS, je veux que ces injonctions
fassent sens au sein de l'équipe. C'est l'objet de la stratégie
que je mets en oeuvre.
Deux obligations légales ne sont pas entièrement
respectées ce qui nuit à l'efficience du parcours de l'usager
dans la structure et complexifie l'instauration de l'alliance
thérapeutique: l'élaboration conjointe d'un projet individuel de
soin ainsi que la mise en place d'actions en RDRD, notamment la mise à
disposition de matériel de consommation à moindre risque.
L'analyse de ces constats me permet de poser la
problématique suivante : Comment initier et accompagner un changement
des pratiques professionnelles afin de proposer un projet de soin
personnalisé de qualité conforme à la législation ?
Comment garantir l'instauration et le maintien de l'alliance
thérapeutique ?
En tant que cadre, je fais l'hypothèse qu'initier
et accompagner un changement des pratiques professionnelles est de nature
à permettre l'instauration et le maintien de l'alliance
thérapeutique et améliorera la qualité du parcours des
usagers de ce CSAPA.
4 Dans un premier temps, je décris la structure dans
laquelle j'exerce ma fonction, le public accueilli, son évolution ainsi
que le cadre législatif réglementant l'action des CSAPA.
4 Dans un deuxième temps, j'analyse les
éléments que je recueille grâce à la démarche
méthodologique que j'ai élaborée, tant dans la structure
dans laquelle je travaille que dans différents autres CSAPA.
4 Dans un troisième temps, je présente la
stratégie d'actions que j'envisage de mettre en oeuvre pour initier un
changement profond des pratiques professionnelles puis je décris les
modalités précises de leur évaluation.
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 2 -
1 L'HÉBERGEMENT EN APPARTEMENTS
THÉRAPEUTIQUES DANS UN CSAPA : DE L'ABSTINENCE AU BAS SEUIL D'EXIGENCE
THÉRAPEUTIQUE
1.1 La structure et son fonctionnement
Je suis actuellement cadre dans un Centre de Soin
d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA). La
création des CSAPA a été annoncée par la Loi du
2/01/2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Cette loi,
centrée sur l'usager, met notamment l'accent sur la
nécessité de prévenir les risques sociaux et
médico-sociaux. Les premiers CSAPA ont vu le jour à la suite de
la Circulaire DGS/SD 6B n° 2006-119 du 10 mars 2006. Ce texte contraint
les Centres Spécialisés de Soins aux Toxicomanes (CSST) et les
Centres de Cure Ambulatoire en Alcoologie (CCAA) à devenir des CSAPA.
Cette fusion montre un changement dans la façon dont est
appréhendée la dépendance, alcool et substances
psychoactives étant dorénavant traités par des structures
de même type.
Le CSAPA au sein duquel je suis cadre a été
créé en 1996 sous le statut de Centre Spécialisé de
Soins aux Toxicomanes. Il s'agissait d'un Centre Thérapeutique
Résidentiel (CTR), une modalité particulière de CSAPA,
visant à être une passerelle entre le sevrage à
l'hôpital et l'entrée en post-cure. Il n'en existait que deux en
France à cette époque. Il était destiné à
l'accueil collectif de 8 personnes pour des séjours de quatre semaines
afin de prévenir la rechute après un sevrage. En 2005, l'Agence
Régionale de Santé (ARS) a autorisé une extension de six
places en appartements thérapeutiques, puis de 2 de plus en 2012.
l Une équipe pluriprofessionnelle
Selon le projet d'établissement 2018 / 2023, les
missions de ce CSAPA sont: « l'accueil, l'hébergement,
l'observation, l'information, l'évaluation et l'orientation
médico-sociaux de toute personne majeure en prise avec des
problématiques d'addiction et de dépendance (alcoolisme,
toxicomanie).»
L'équipe que j'encadre est ainsi constituée :
une secrétaire administrative, un médecin psychiatre, un
psychologue, deux surveillants de nuit, un infirmier et 5 éducateurs
spécialisés. Trois éducateurs ont la tâche
d'accompagner les huit usagers du collectif et deux autres les huit usagers en
appartements thérapeutiques. Un directeur dirige l'établissement
ainsi que deux autres structures spécialisées dans
l'addictologie. J'ai décidé de centrer ce mémoire sur les
personnes hébergées en appartements thérapeutiques, car
elles ont la liberté d'aller-venir. Il n'en est, pour l'instant, pas de
même pour les usagers hébergés au sein du collectif; une
réflexion sur cette question éthique est en cours à ce
sujet.
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 3 -
l L'hébergement en appartements
thérapeutiques : Une modalité particulière, un
accompagnement nécessitant la prise en compte des différentes
problématiques de l'usager.
L'hébergement en appartements thérapeutique est
rendu possible par la circulaire CSAPA DGSM du 28/02/2008 et a notamment pour
vocation d'accueillir des personnes qui souhaitent continuer un accompagnement
thérapeutique engagé et souvent suivent un traitement lourd et de
longue durée : Traitement de Substitution aux Opiacés (TSO),
traitement contre le VIH ou le VHC1 . Ce séjour de mise
à l'abri a pour but de permettre à la personne « de
reconquérir son autonomie, de restaurer des liens sociaux (par exemple,
à travers le partage des tâches quotidiennes dans l'appartement)
et professionnels (recherche de formation, d'emploi, etc
)2».
Ces personnes sont hébergées dans des studios
loués à des particuliers par l'association. Parmi ces huit
appartements, l'un est dédié à la Réduction des
Risques et des Dommages (RDRD) à titre d'expérimentation. Les
personnes qui y sont accueillies sont des consommateurs actifs de psychotropes.
Dans les CSAPA, les usagers sont pris en charge avec des objectifs
précis : se sevrer, faire une pause et apprendre à
sécuriser ou mieux gérer leurs consommations.
l La notion de seuil, garante de la qualité du
parcours
Pour ces objectifs de gestion et de sécurisation des
consommations, on parle d'accueil inconditionnel ou de « bas seuil
d'exigence ». L'équipe du CSAPA n'a pour le moment pas les outils
pour accompagner les usagers dans ces deux objectifs que ce soit en termes de
formation, de disponibilité ou de matériel de consommation
à moindre risque.
Voici une définition de la notion de seuil «
Les objectifs de la substitution chez les personnes héroïnomanes
peuvent être de deux ordres, selon que l'on vise un soin de l'individu
dépendant, ou selon que l'on vise avant tout à l'aider à
gérer son comportement et à le rendre plus acceptable pour la
société. A ces deux objectifs correspondent des stratégies
différentes impliquant des exigences modulées permettant d'entrer
dans les dispositifs et d'y rester. Le niveau de ces exigences est
appelé "seuil" et conditionne l'accessibilité aux
dispositifs.3 »
La sociologue Lise Dassieu explique la naissance de ce
concept: « En ce qui concerne les usagers de drogues, la notion de
seuil s'est également construite « par le bas » : elle
apparaît au même moment que des préoccupations sur
l'élargissement de l'accès aux services
1 VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine et VHC :
Virus de l'Hépatite C
2 Projet d'établissement de la structure
3 Mission interministérielle de lutte contre les drogues
et les conduites addictives (MILDECA) : Lexique : seuil
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 4 -
de soin vers ceux qui en étaient autrefois exclus.
Le terme est introduit dans la politique française des drogues avec les
mesures de réduction des risques dans les années 1990. Là
encore, le bas seuil est mis en avant, puisque les nouvelles politiques,
s'inspirant des expériences étrangères, se proposent de
rompre avec l'exigence d'abstinence de l'ancien secteur
spécialisé afin de proposer une réponse aux personnes ne
souhaitant ou ne pouvant arrêter leur consommation (Coppel, 2002)
4».
Ainsi, proposer des modalités d'accueil et de soin
bas-seuil implique que certains usagers continuent de consommer un ou plusieurs
produits, de manière ponctuelle ou chronique. Il faut alors que
l'accompagnement prenne en compte l'éventualité de ces
consommations et permette de réduire autant que possible les risques
afférents. Lors d'entretiens avec des usagers de la structure, j'ai
constaté qu'ils continuaient majoritairement à consommer une ou
plusieurs substances. Leur projet n'est pas toujours de cesser la consommation
de toutes les substances.
En tant que cadre du CSAPA, je dois amener l'équipe
à modifier son fonctionnement en tenant davantage compte de cet
élément. Cet état de fait doit être pris en compte
par les professionnels. Je me donne comme mission principale de les accompagner
à adapter leurs pratiques professionnelles afin d'améliorer la
qualité de la prise en soin des usagers.
l La Réduction Des Risques et des Dommages :
une approche pragmatique de l'addictologie
La loi enjoint les CSAPA à entreprendre des actions de
Réduction des Risques et des Dommages. La Réduction Des Risques
et Des Dommages est une approche pragmatique des mécanismes de
l'addiction, elle vise à réduire les risques sanitaires et
sociaux liés aux consommations de psychotropes. « Elle
reconnaît que l'arrêt de la consommation n'est pas possible pour
certaines personnes, à certains moments de leur trajectoire, et qu'il
faut alors mobiliser des leviers pragmatiques et adaptés pour
améliorer leur qualité de vie5 ». Par
ailleurs, il s'agit de prendre en compte le savoir expérientiel des
usagers, de les considérer comme experts de leur situation et de mettre
en valeur leur pouvoir d'agir. J'aborderai plus loin cet élément
essentiel de la prise en soin.
Les résidents des appartements sont des personnes qui
souhaitent: soit consolider leur sevrage, soit apprendre à
sécuriser et gérer leurs consommations. Pour ces deux seuils
4 Dassieu Lise, « Les seuils de la substitution : regard
sociologique sur l'accès aux traitements de substitution aux
opiacés », Psychotropes,
2013/3-4 (Vol. 19), p. 149-172, 2013, p152
5 Mission interministérielle de lutte contre les
drogues et les conduites addictives (MILDECA) : L'essentiel sur ... la
réduction des risques et des
dommages : une politique entre
humanisme, sciences et pragmatisme, septembre 2020, p1
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS
- session 2022 - 5 -
d'exigence (bas seuil/gestion/sécurisation, haut
seuil/abstinence), les personnes sont censées avoir déjà
pris du recul par rapport à leurs consommations et être capables
d'habiter un logement de manière autonome ou presque. Les professionnels
sont chargés d'accompagner les personnes sur le savoir-habiter, les
démarches administratives, la recherche d'emploi, la
réinstauration du lien social et la coordination des soins en
collaboration avec les partenaires.
Ces huit personnes sont amenées à se rendre au
CSAPA pour rencontrer les professionnels et parfois pour se voir
délivrer leur traitement de substitution aux opiacés ou d'autres
traitements. La durée de séjour est ajustable (6 à 24
mois). La durée moyenne des séjours des sortants était de
15 mois en 2019.
Selon le projet d'établissement, pendant le premier
mois, le suivi de l'équipe socio-éducative se décline
à raison de deux entretiens en présentiel (visites à
domicile ou entretiens dans les locaux) et d'un échange
téléphonique par semaine. Une synthèse est
réalisée à la fin du mois et les objectifs du
séjour sont fixés, à priori, conjointement. Cette
synthèse n'est pas un document contractuel, elle est
rédigée par un travailleur social après l'entretien. Je
souligne là un décalage préoccupant entre la loi et la
réalité du terrain. Enfin, les perspectives d'orientation sont
également étudiées. Par la suite, cet étayage est
adapté au degré d'autonomie de la personne et des
synthèses sont effectuées chaque trimestre.
1.2 Un public présentant des
problématiques souvent multiples et complexes
Selon le rapport d'activité 2019, l'âge moyen
des personnes accueillies était d'environ 40 ans. Il s'agissait de
personnes de sexe masculin pour 69 % des effectifs, très majoritairement
bénéficiaires de minimas sociaux. Certaines personnes ne
disposaient d'aucun revenu. Aucune de ces personnes ne disposait de logement
stable et autonome et certaines parlaient peu le français (le plus
souvent des personnes issues des pays d'Europe de l'est, République
Tchèque et Géorgie notamment). 61 % étaient couverts par
la Couverture Maladie Universelle (CMU), devenue la Complémentaire
Santé Solidaire (CSS), et certains ne disposaient d'aucune couverture
sociale. Les consommations de produits psychotropes, raison de leur prise en
charge, étaient dans l'ordre : cocaïne / crack, alcool et
opiacés (héroïne, sulfate de morphine et autres).
Par ailleurs, actuellement, 5 usagers
bénéficient de la Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH). Parmi eux, 4 sont diagnostiqués
comme présentant des troubles bipolaires ou psychotiques. On parle dans
ce cas de pathologies duelles : « Le double diagnostic en addictologie
correspond à l'association d'un trouble de l'usage de substances
et
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 6 -
d'un trouble psychiatrique. D'autres termes ont pu voir
le jour au fur et à mesure du temps tels que « comorbidité
», « co-occurrence », « pathologies duelles » ou
encore plus récemment « trouble duel 6». Je
reviendrai sur la prise en charge des usagers souffrants de cette pathologie en
fin de partie. D'autres éléments associés peuvent impacter
également la prise en soin (handicap intellectuel ou autre, isolement
familial, problèmes de santé chroniques, logement, autonomie
financière, maîtrise du français, etc.).
Le rapport de l'Office Français des Drogues et
Toxicomanie (OFDT) de 20167 donne des statistiques moyennes de
personnes hébergées dans les CSAPA en appartement
thérapeutiques. Il s'agit d'hommes pour environ 75 %. 47% avaient 40 ans
et plus et la tendance au vieillissement est très importante (21 % de
plus de 40 ans en 2005) ce qui a des conséquences car l'âge
avançant les comorbidités s'accumulent.
En tant que cadre je veille à ce que l'équipe
tienne compte de la diversité du public accueilli afin de garantir aux
usagers une offre de soin efficiente. Ces personnes ont toutes des trajectoires
différentes mais ont presque toutes connu l'errance. Certaines disposent
de revenus mais pas toutes. Il en est de même pour la couverture sociale,
l'aptitude à parler français, les handicaps physiques ou
psychologiques. Elles sont, ou ont été dépendantes de
substances diverses et n'en sont pas au même stade de leur parcours de
soin. De plus, nombre de ces personnes ne disposent d'aucune solution de sortie
du dispositif.
1.3 Le cadre légal des CSAPA et l'histoire de
la RDRD en quelques dates8
Pour bien saisir comment la relation de soin, de «
prendre soin » peut s'installer, il est essentiel de se pencher sur
l'histoire de la Réduction des Risques et des Dommages et sur le
contexte juridique qui a permis aux CSAPA de voir le jour. Par la suite, je
compte utiliser cette partie comme document de formation à destination
des professionnels. Comprendre comment la RDRD a fini par s'imposer comme outil
de dialogue et de soin peut permettre de poser les bases d'une culture commune.
Par ailleurs, je me rends compte que cette liste de lois et de dates
peut-être difficile à appréhender. Il s'agira de
réaliser un support plus fonctionnel.
l L'origine de la RDRD : La Grande-Bretagne
fait figure de précurseur en matière de RDRD. En 1926, les
membres de la commission Rolleston rendent légale la prescription de
6 Boumendjel, May, et Amine Benyamina. « 15. Les «
pathologies duelles » en addictologie : état des lieux et prise en
charge », Michel Reynaud
éd., Traité d'addictologie. Lavoisier,
2016, p139
7 Observatoire français des drogues et des toxicomanies
(OFDT) : Christophe Palle, Malisa Rattanatray, Les centres de soins,
d'accompagnement
et de prévention en addictologie en 2016, octobre
2018
8 Partie basée sur : Gautré, D. (2013) Une
expérience de responsable d'unité d'intervention sociale en
CAARUD (Mémoire de CAFERUIS non
publié -Ifocas) et sur : Alain Morel, Jean-Pierre
Couteron, L'Aide-mémoire de la réduction des risques en
addictologie, Paris : Dunod, 2019
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 7 -
morphine et d'héroïne aux consommateurs partant
du principe que la gestion ou le sevrage prend souvent 10 à 20 ans avant
d'être pérenne. Cette mesure a permis de limiter l'impact social
et sanitaire des consommations. Cette approche pragmatique se retrouve au
milieu des années 80, quand pour lutter contre le SIDA, le gouvernement
autorise la distribution de matériel d'injection et l'accès
à la méthadone. On trouve d'autres exemples de politiques
publiques précoces de RDRD aux Pays-bas et en Suisse.
l En France métropolitaine, avant les années
60, les consommateurs de drogues sont quasiment invisibles. Ils sont en
majorité des personnes ayant commencé à consommer dans les
colonies françaises.
l En 1965, le mouvement de contre-culture né aux
États-Unis gagne l'Europe et avec lui l'arrivée des consommations
festives de cannabis et de LSD notamment. Le début des années 70
est marqué par l'entrée de l'héroïne, des
barbituriques et des amphétamines.
s La Loi de 1970 marque le début de la
politique de prohibition. La Loi n°70-1320 du 31 décembre
1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à
la répression du trafic et de l'usage illicite des substances
vénéneuses marque cette époque. Ce texte considère
le consommateur de drogue comme malade mais aussi comme délinquant.
Depuis, toutes consommations sont passibles d'amendes voir de peines de prison.
On assiste aujourd'hui à une forte remise en cause de cette loi. Comme
d'autres structures en addictologie, les CSAPA, notamment ceux qui
adhèrent à la Fédération Addiction, participent
à cette réflexion. J'envisage d'amener l'équipe à
avoir un rôle actif dans ce mouvement d'évolution des politiques
publiques.
l En parallèle de la prohibition, le texte
énonce le principe de l'injonction thérapeutique avec
l'abstinence comme unique finalité. Les structures
spécialisées en addictologie commencent alors à voir le
jour. A partir de 1975, la consommation d'héroïne explose et touche
désormais tous les milieux. L'épidémie de SIDA
apparaît à la fin de cette décennie ; les personnes
homosexuelles sont les plus touchées. J'ajoute ici que les deux sujets
sont liés. Les personnes hébergées en CSAPA dans les
appartements thérapeutiques souffrent de pathologies lourdes. Les
maladies sexuellement transmissibles en font partie. Il s'agit là d'un
autre élément de complexité à prendre en
considération.
l Les consommateurs de drogues par voie-intraveineuse sont la
deuxième population la plus atteinte, viennent ensuite les
hémophiles et les personnes incarcérées.
Parallèlement, le trafic continue de croître. Des associations de
santé communautaires sont créées aux États-
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 8 -
Unis en 1983, puis en France avec Aides en 1984 et Act Up en
1994 avec l'objectif de considérer les personnes concernées comme
expertes de leurs pratiques et actrices de leurs projets de soin. On parle
alors d'association d'auto-support. Dès 1985 des voix
s'élèvent pour faciliter l'accès au matériel
d'injection à moindre risque mais l'idéologie dominante
considère que cela mènerait à une banalisation de la
toxicomanie, à une incitation à la consommation. Autre exemple de
cette vision coercitive du traitement de la dépendance, en 1985, le
Ministre de la justice Albin Chalandon annonce l'ouverture de 1 600 places de
prison dédiées à la désintoxication et de 2 000
places pour l'association « Le Patriarche » qui prônait un
traitement dur de l'addiction. Des associations, des magistrats et des
personnalités politiques s'opposent à ces projets.
l En 1986, l'association AIDES publie une brochure de RDRD :
« Une seringue, ça ne se prête pas. »
l L'émergence des structures de
réduction des risques a lieu hors du cadre légal. Le
Décret n°87-328 du 13 mai 1987, dit Décret Barzach, autorise
la vente de seringue dans les pharmacies et sans prescription. Ce texte annonce
le début de la RDRD en France. La pandémie continue pourtant de
s'étendre. En 1986, Médecins du Monde (MDM) ouvre un centre de
dépistage anonyme et gratuit, tenu par des bénévoles. En
1988, MDM ouvre un Programme d'Échange de Seringues (PES) mobile
malgré l'interdiction de distribuer des seringues dans la
rue9, interdiction qui prendra fin en 1995. D'autres groupes
d'auto-support d'usagers naissent également à cette
période, l'association ASUD (Auto-Support des Usagers de Drogues)
notamment. En 1993 des associations de militants de l'auto-support et des
professionnels de la santé et de l'humanitaire montent le collectif
« Limiter la casse » et publient un appel dans le Monde et
Libération : « Des toxicomanes meurent chaque jour du sida,
d'hépatite, de septicémie par suicide ou par overdose. Ces morts
peuvent être évitées, c'est ce qu'on appelle la
réduction des risques...». La conclusion de ce texte est la
suivante : « L'alternative entre incarcération ou obligation de
soin est une impasse. La responsabilité des pouvoirs publics est
engagée comme elle le fut dans l'affaire du sang contaminé. Parce
qu'une seule injection suffit pour devenir séropositif, parce que les
toxicomanes sont nos enfants, nos conjoints, nos voisins, nos amis, parce qu'on
ne gagnera pas contre le sida en oubliant les toxicomanes, limitons la casse !
10». Des structures d'accueil dédiées aux
consommateurs voient le jour à Paris et Marseille, les boutiques. Elles
offrent aux consommateurs un accès à l'hygiène et un
programme d'échange de seringue. Notons que ces structures se sont
créées dans l'illégalité.
9 Histoire & Principes de la réduction des risques,
entre santé publique et changement social, Issoudun, Médecins du
Monde, AFD, juin 2013, p37
10 Anne Coppel, Peut-on civiliser les drogues? de la guerre
à la drogue à la réduction des risques, La
découverte, Alternatives sociales, 2002
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 9 -
l En 1994, lors de l'installation de la commission de
réflexion sur la lutte contre la drogue et la toxicomanie, Simone Veil,
alors ministre de la santé se prononce clairement en faveur de la RDRD
et la création de structures d'accueil « bas seuil » pour les
usagers : « La réduction des risques de SIDA passe aussi par
une réflexion sans tabou sur les modes de contaminations des toxicomanes
: la contamination par échanges de seringues souillées, la
contamination par des rapports sexuels non protégés. Nombreux
sont les toxicomanes qui se piquent, nombreux sont les toxicomanes des deux
sexes qui se prostituent.11 »
l Les consommations se diversifient, une
prévalence qui augmente. Dès le début des
années 90, l'offre de produits stupéfiants se diversifie.
D'une manière générale, le cannabis est
consommé de manière exponentielle, la poly-consommation se
développe. La cocaïne n'est plus cantonnée aux classes
hautes de la population. Le crack (cocaïne base) fait son entrée
à Paris. Les détournements de médicaments s'intensifient
(Subutex®, Benzodiazépines, Kétamine, Ritaline, Morphine,
etc.).
l Un cadre légal est finalement posé,
les traitements de substitutions aux opiacés sont
légalisés. D'autres boutiques ouvrent alors
portées par SOS Drogues Internationale, MDM et AIDES. Le cadre
légal évolue avec la Circulaire DGS:SP3 n° 4 du 11 janvier
1995 relative aux orientations dans le domaine de la prise en charge des
toxicomanes. Ce texte autorise les médecins des CSST à distribuer
de la méthadone, un des traitements de substitution aux opiacés.
Le Décret n°95-255 du 7 mars 1995 rend enfin légale la
distribution de matériel d'injection stérile.
l Un autre TSO, la buprénorphine haut dosage
(Subutex®) fait son entrée légale en France en
février 1996. Les médecins généralistes ont le
droit de la prescrire.
l La RDRD entre dans la législation
française. La Circulaire DIV/DPT-LSSP/MILDT n° 2001-14 du
9 janvier 2001 relative à la politique de la ville et à la
politique de lutte contre la drogue et de prévention des
dépendances officialise la RDRD comme une politique qui : «
qualifie l'ensemble des informations, des aides et des prises en charge
proposées aux consommateurs de substances psychoactives et notamment aux
usagers de drogue intraveineuses, pour réduire les risques et les
dommages sanitaires et sociaux liés à leur consommation
». Je note ici que dans l'esprit de la loi l'information des usagers
constitue la priorité.
11 Déclarations de Mme Simone Veil, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur les réflexions à
mener et les mesures prises en matière de lutte contre la toxicomanie,
Paris les 9 mars et 5 mai 1994
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 10 -
l La loi 2002-2 impose un accompagnement
individualisé. La Loi du 2/01/2002 rénovant l'action
sociale et médico-sociale annonce la mise en place future des CSAPA.
L'article L.312-1, alinéa 9 du CASF définit ces
établissements: « Les
établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de
personnes confrontées à des difficultés spécifiques
en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à
l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et
de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique »
l Ce texte préconise aussi dans son article 5 de
conduire des : « Actions éducatives,
médico-éducatives, médicales, thérapeutiques,
pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne,
à son niveau de développement, à ses potentialités,
à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge
». Il est donc ici question de prévention. Le lien avec les
conduites addictives est clair.
l La notion de droit des usagers, absente de la loi du 30
juin 1975, est introduite. Elle affirme ainsi dans sa section 2 que les usagers
ont droit à une : «Une prise en charge et un accompagnement
individualisé de qualité favorisant son développement, son
autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à
ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit
systématiquement être recherché lorsque la personne est
apte à exprimer sa volonté et à participer à la
décision.12 »
Cette obligation a pour but de favoriser l'instauration d'un
dialogue sincère et véritable entre professionnels et usagers
dans les structures sociales et médico-sociales. Ce dialogue est une
composante essentielle du traitement des consommations dans les structures en
addictologie. C'est la condition d'une alliance thérapeutique durable,
une notion que je définirai plus loin notamment au regard des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l'Agence Nationale de
l'Évaluation et de la qualité des Établissements et
Services sociaux et Médico-sociaux (ANESM ) intitulées : «
les attentes de la personne et le projet personnalisé » et
publiées en 2008.
Ainsi, la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rend
obligatoire le projet personnalisé. Il doit être
élaboré dans les 6 mois suivant l'admission au sein d'un
établissement ou d'un service social et médico-social.
12 Article L. 311-3 du code de l'action sociale et des
familles
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 11 -
l L'ouverture des CSAPA et CAARUD : la Loi
santé de 2004. La Loi n° 2004-806 du 9 août 2004,
dite Loi santé, citée précédemment, marque
l'entrée concrète et opérationnelle de la RDRD dans le
cadre juridique. Ce texte prévoit l'ouverture des CAARUD (Centres
d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour
Usagers de Drogues). Ces structures à « bas seuil d'exigence »
remplacent les « boutiques ». Les professionnels des CAARUD ne se
limitent pas à l'accueil, l'accès à l'hygiène et au
matériel d'injection, ils mènent des actions d'« Aller vers
», dans la rue, les squats, les terrains, en milieu festif, etc. Les
premiers CSAPA ouvrent en 2006.
l Le décret n° 2005-347 du 14 avril 2005
définit les objectifs de la RDR, dont le premier : «
prévenir les infections sévères, aiguës ou
chroniques, en particulier celles liées à l'utilisation commune
du matériel d'injection ». Il énonce une liste de
modalités d'interventions dont « la distribution et la
promotion du matériel d'hygiène et de prévention
».
l La RDRD devient une obligation légale pour
les CSAPA. Le Décret n° 2007-877 du 14 mai 2007 relatif
aux missions des CSAPA vient modifier le Code de la Santé Publique.
Ainsi, l'article D. 3411-2 précise que les CSAPA doivent assurer «
La réduction des risques associés à la consommation de
substances psychoactives ».
l La Circulaire n° DGS/M/2008/79 du 28 février
200813 relative à la mise en place des CSAPA et à la
mise en place des schémas régionaux médico-sociaux
d'addictologie stipule que « les CSAPA doivent assurer la prise en
charge et la réduction des risques ». Par ailleurs, les CSAPA
« doivent mettre à disposition de leurs usagers des outils de
réduction des risques ». Il s'agit ici de lutter contre
l'overdose, les contaminations par le VHC, le VIH et plus largement contre les
comorbidités entraînées par des pratiques à risques.
La mission de RDRD des CSAPA « a pour but, non seulement de limiter
les risques sanitaires et sociaux liés à l'usage de substances
psychoactives, mais aussi de contribuer au processus de soin, au maintien et
à la restauration du lien social. » Cette mission est rendue
obligatoire.
l Le contexte récent est marqué par de
fortes évolutions. La Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé (Art. L. 3411-8.-I du
code de la santé publique) vient promouvoir les actions de RDRD : «
la politique de réduction des risques et des dommages en direction
des usagers de drogue vise à prévenir les dommages sanitaires,
psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la
mortalité par surdose liés à la consommation de substances
psychoactives ou classées comme stupéfiants. »
En atteste les points 3 et 4 :« 3° «
Promouvoir et distribuer des matériels et produits de
santé
13 Extrait en annexe 1
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 12 -
destinés à la réduction des risques
; 4° Promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les
procédures de prévention des risques. »
Selon l'article L. 3411-6 : les CSAPA « assurent
obligatoirement des missions d'accompagnement médico-psycho-social, de
soins, de réduction des risques et des dommages et de prévention
individuelle et collective. »
l C'est cette loi qui autorise aussi l'expérimentation
des salles de consommation à moindre risque. Deux salles ouvrent cette
année : une à Paris et la seconde à Strasbourg. «
Les salles de consommation à moindre risque (SCMR) visent un double
objectif : améliorer la santé publique comme la
tranquillité publique. « Elles sont un élément d'une
palette très large d'accompagnement et de soins pour des usagers de
drogues qui s'injectent...très marginalisés et pour lesquels ce
dispositif est une première étape d'entrée dans le
parcours de réduction des risques et de soin ....14».
Elles deviennent les Haltes Soin Addiction en 2021.
l En 2019, la Haute Autorité de Santé
(HAS) publie une Recommandation de Bonne pratique concernant la RDRD et les
CSAPA. En voici un extrait : « tout au long de
l'accompagnement, lorsque des consommations ou des pratiques à risque
sont évoquées auprès de tout professionnel de
l'équipe, informer la personne des modalités de mise à
disposition de matériel et d'éducation aux pratiques à
moindre risque par le CSAPA ». Ce texte préconise notamment
l'inscription de la RDRD dans le projet d'établissement et l'emploi de
travailleurs-pairs. Ces recommandations constituent un levier pour accompagner
un changement des pratiques et peuvent être utilisées à des
fins d'évaluation interne de la qualité.
l La politique de RDRD a démontré son
efficacité puisque la prévalence des nouveaux cas de VIH parmi
les consommateurs de drogues injecteurs a fortement baissé. Elle est
passée de près de 1750 en 1995 à 38 en 2016 selon l'Office
Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT)15. En 2018, 8
millions de seringues ont été distribuées par les CAARUD
contre 3,8 millions en 2008 toujours selon l'OFDT. L'offre thérapeutique
des antidotes aux opioïdes en France s'est récemment
développée avec l'autorisation de mise sur le marché de la
Naloxone prête à l'emploi en 2019. Un antidote qui permet de
maintenir la personne en overdose éveillée en attendant les
secours. Notons que depuis quelques années des associations distribuent
du matériel de consommation par voie postale gratuitement, l'association
SAFE notamment.
l La RDRD est entrée dans la pratique et constitue un
élément essentiel de la prise en charge de l'addiction ; elle est
déterminante dans la politique de santé publique actuelle.
14
www.drogues.gouv.fr : Salles de
consommation moindre risque, 13/11/2018
15
www.ofdt.fr : Évolution du
nombre de nouveaux cas de sida liés à l'usage de drogues par voie
injectable depuis 1995
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 13 -
1.4 Les enjeux du soin dans les CSAPA : instauration
et maintien de l'alliance thérapeutique
« - Dans les premiers entretiens, est ce que tu as
été tranquillisé sur cette question, est-ce
qu'on t'a
dit que si jamais...le parcours de soin en addictologie c'est un chemin qui
n'est pas
droit..On t'a parlé de la possibilité que tu fasses
des rechutes ? Que tu perdrais pas forcément
ton appartement ?
-
On me l'a pas dit. On ne me l'a pas dit comme ça et même si on me
l'a dit, j'avais tendance à
pas le croire. À me dire, oui on
me dit ça pour me rassurer mais à pas faire confiance en fait.
À
me dire, on va te dire ça par ce qu'on voit que tu es
peut-être pas très bien alors on va pas
encore plus t'enfoncer.
Dans la défiance, un peu. Mais je le suis de moins en moins.
-
D'où l'importance de bâtir une relation de partenariat !
- Oui,
oui, mais c'est ça que j'ai compris pleinement maintenant et qui fait
que le travail est plus
important, est plus sincère... Mais il m'a
fallu du temps pour faire confiance aussi. »
Entretien avec un
usager du CSAPA
Cet échange illustre bien le déficit
d'information qui a marqué le début de la prise en charge de cet
usager. C'est pourtant dans les premières semaines que la prise de
risque est la plus importante. C'est aussi à ce moment que les liens de
confiance devraient se nouer. Je relève aussi que la difficulté
à créer la relation s'explique en partie par des
représentations mutuelles sur lesquelles il s'agit de travailler en
équipe.
l De la notion d'abstinence à celle du
rétablissement :
La politique publique de soin en addictologie a longtemps
été marquée par le « triangle d'or »
décrit par Alain Ehrenberg : « l'abstinence comme idéal
normatif, la désintoxication pour ceux qui ont subi l'attrait des
paradis artificiels, l'éradication des drogues de la
société comme horizon politique. 16». La loi
de santé publique du 31 décembre 1970 en est l'illustration. Elle
fait entrer dans la législation l'injonction thérapeutique, une
mesure visant à lutter contre les troubles de l'ordre public et les
troubles psychopathologiques liés à la consommation de
stupéfiant. L»abstinence est le seul projet valable, le
consommateur est délinquant et l'État est garant du soin comme du
châtiment. L'usager de drogue est privé de toute initiative, son
savoir expérientiel n'est pas pris en compte et le soin se
conçoit uniquement de manière descendante. Cet état
d'esprit reste dominant jusqu'à l'explosion de l'épidémie
du VIH au début des années
16 Ehrenberg Alain. Comment vivre avec les drogues ? Questions de
recherche et enjeux politiques. In: Communications, 62, 1996. Vivre avec les
drogues. p6
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 14 -
90. Cette époque, marquée par la naissance des
groupes d'auto-support et de la réduction des risques et des dommages,
voit l'émergence d'une nouvelle vision du soin en addictologie : le
rétablissement.
La notion de rétablissement vient de la psychiatrie et
s'est progressivement développée dans de nombreux pays comme base
de la politique publique en matière de santé mentale. Le concept
est repris en France dans le Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017
relatif au projet territorial de santé mentale qui donne la
priorité à « l'organisation du parcours de santé
et de vie de qualité et sans rupture, notamment pour les personnes
souffrant de troubles psychiques graves et s'inscrivant dans la durée,
en situation ou à risque de handicap psychique, en vue de leur
rétablissement et de leur inclusion sociale.». Le soin devient
« prendre soin », un échange, la maladie mentale une
expérience qui doit être prise en compte pour que la personne
recouvre son « pouvoir d'agir ». Le savoir expérientiel des
patients est valorisé car il est la source de son rétablissement
et pourra servir aux autres patients. Ce concept a d'ailleurs été
l'origine de l'émergence de nouveaux métiers : travailleurs-pairs
et médiateurs de santé pairs17.
s Une définition de l'alliance
thérapeutique :
Ce qui est recherché alors dans le soin c'est
l'échange sincère et durable entre soignants et soignés,
une réelle alliance thérapeutique. Le concept d'alliance
thérapeutique vient aussi de la psychiatrie, en voici une
définition : « un accord commun, plus ou moins explicite entre
deux protagonistes d'ordre intellectuel et affectif. Ce terme peut
évoquer celui de lien à ceci près que dans le cadre du
soin il s'agit plus d'un accord mutuel dans un cadre professionnel envers une
prise en charge pour le recouvrement d'un mieux-être.
18» Il s'agit d'un accord qui passe par la collaboration
et la confiance. L'établissement d'un lien sincère est donc la
condition du soin. L'empathie, le non-jugement, le maintien du lien sont pour
le soignant à la base de cette alliance.
Ces concepts ont rapidement été utilisés
en addictologie. D'abord car nombre de patients en addictologie souffrent de
pathologies duelles. Ensuite, car la notion de rétablissement oblige les
soignants à prendre en compte la complexité du vécu de
l'usager en vue de son insertion dans la vie citoyenne. Le soin en addictologie
est donc nécessairement pluri-disciplinaire. D'ailleurs le mot soignants
est entendu ici comme tout professionnel de la structure qu'il soit infirmier,
psychiatre, médecin, psychologue ou travailleur social.
17 Voir partie 3.2.C du plan d'action
18 Bachelart, M. (2012). 26. L'alliance thérapeutique.
Dans : Antoine Bioy éd., L'Aide-mémoire de psychologie
médicale et de psychologie du soin: En 58 notions (pp. 161-168).
Paris: Dunod, p 161
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 15 -
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 16 -
Le passage suivant illustre bien la diversité des
problématiques auxquelles doivent faire face usagers et
professionnels.
« Je vais le dire en entier, c'est un poème.
C'est un trouble bipolaire affectif de type anxio-
dépressif
à récurrence sévère et
généralisée. Ça veut dire qu'en fait je n'ai pas
d'épisode
maniaque. Je peux faire un léger épisode
hypomane si je prends une substance ou quoi mais
c'est hypomane, c'est pas
maniaque. Par contre je suis de type anxio-dépressif. »
Un
usager de CSAPA en soin pour addiction à l'alcool et la cocaïne.
Le soin en addictologie est aussi partenarial, les patients
étant suivis avant et après leur passage au sein de CSAPA par
d'autres structures (cliniques, CHU, CAARUD, accueils de jour, etc.). Parfois,
les patients sont suivis pendant leur hébergement en CSAPA. C'est le cas
de cet usager. Dans ce cas, la coordination entre les équipes est
primordiale, une réflexion éthique sur le secret partagé
est alors à mener.
Ainsi, les CSAPA doivent mettre à disposition du
matériel de consommation à moindre de risque, et entreprendre des
actions de RDRD, quelles que soient les drogues et les modes de consommation.
C'est une obligation légale. Les professionnels de ces structures
doivent également prendre le temps d'élaborer avec les usagers un
projet de soin individualisé. C'est l'esprit de la loi de 2002-2 qui met
la question du droit et du respect de l'usager au coeur du fonctionnement des
structures sociales et médico-sociales.
Comme nous allons le voir dans la partie suivante, la
structure dans laquelle je suis en poste ne respecte pas entièrement ces
deux injonctions.
En tant que responsable d'unité d'intervention sociale,
c'est mon rôle d'accompagner ce changement et de mettre en place les
outils permettant le rétablissement des usagers pris en charge.
2 LA MISE EN PLACE DE L'ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE,
UN ENJEU FRAGILISÉ PAR LE NON RESPECT DE LA LOI
L'objectif de la prise-en-soin en CSAPA est le
rétablissement. Cette notion n'est pas forcément
appréhendée de la même manière par les
professionnels. Évaluer l'aptitude de l'usager à l'autonomie avec
comme unique grille de référence les représentations
personnelles et donc subjectives des « soignants » est une entreprise
risquée et potentiellement dommageable pour l'usager.
Je constate qu'il manque ici une grille d'évaluation
des compétences des individus à gérer la vie courante,
à utiliser de manière efficiente les dispositifs de droit commun,
le soin, etc. L'absence d'indicateurs objectivables du rétablissement
fait défaut. Je souligne, qu'en position de chef de service, je me dois
d'évaluer la qualité des interventions auprès des usagers
et notamment l'évolution de leur capacité d'autonomie.
4 Ne pas reconnaître l'individu comme
co-constructeur de son projet de soin, ne pas mener une réelle
stratégie de RDRD entrave l'instauration de l'alliance
thérapeutique.
Il manque une définition claire des objectifs du
séjour. Sans cette étape, il devient difficile pour moi et pour
les membres de l'équipe, de décider du moment opportun pour
envisager et préparer correctement la sortie du dispositif. Sans cette
étape, évaluer la qualité du parcours est une tâche
ardue voire impossible.
L'atteinte d'un certain rétablissement passe par
l'existence d'une réelle mise en oeuvre de la RDRD et par l'information
exhaustive sur les droits des usagers, dont la non-obligation d'abstinence. La
co-construction et la contractualisation du projet de soin sont aussi des
conditions de l'efficience du parcours de l'individu. L'absence de mise en
oeuvre de ces éléments entrave l'instauration et le maintien de
l'alliance thérapeutique. Mon expérience de chef de service m'a
permis de constater des écarts vis-à-vis de ces obligations
légales.
Mon objectif est de permettre à l'usager d'être
pleinement acteur de son projet de soin et ainsi de rendre possible l'alliance
thérapeutique. Cela suppose non seulement que l'usager soit
considéré comme acteur mais aussi se sente assez en confiance
pour occuper cette place.
Encore une fois, il est impératif qu'en fin de
parcours, la personne accompagnée gagne en autonomie et puisse
accéder aux dispositifs de droits commun dans les domaines de la
santé, l'emploi et logement. C'est la mission obligatoire
d'intégration sociale des CSAPA. Il arrive pourtant que les usagers
quittent le dispositif car le temps imparti (maximum deux ans)
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 17 -
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 18 -
est écoulé, ou parce que leur situation
vis-à-vis du droit rend leur intégration sociale plus difficile
à mettre en oeuvre (cas de ressortissants européens sans droits
aux prestations sociales par exemple).
4 Un accompagnement, des objectifs multiples :
Les usagers intègrent la structure avec plusieurs objectifs en
plus de soigner leur(s) addiction(s). En atteste ce passage d'une lettre de
demande d'admission :
« Mon projet repose, comme l'indique le rapport
complété par le thérapeute, sur le soin. En effet
il
est primordial de reprendre et poursuivre le suivi
médico-psychologique.
J'ai donc besoin d'un cadre
thérapeutique sécurisant et d'assistance dans mes
démarches
quant à trouver un logement...J'ai besoin de vos
conseils sur le plan social et sur mes droits.
En bref, j'ai besoin de
retrouver un semblant de vie sociale. »
Un usager du CSAPA
Cette personne est infirmière, avait un logement, un
emploi, des relations sociales, un conjoint. Elle s'est trouvée en
grande difficulté à cause de son addiction et de ses troubles
psychologiques. Sa demande est une prise en charge globale de sa situation en
vue d'un mieux-être.
Je remarque qu'à l'heure actuelle, le CSAPA dans
lequel je suis cadre intermédiaire ne met pas en oeuvre toutes les
actions nécessaires pour l'assurer d'un parcours de qualité. Dans
cette partie, je m'attacherai à présenter les résultats de
mon investigation :
4 Je décrirai la méthodologie utilisée.
4 J'analyserai les dysfonctionnements fonctionnels et
organisationnels, ainsi que les écarts avec le cadre
réglementaire, qui nuisent à la qualité du parcours de
l'usager dans la structure. Je repérerai les leviers qui pourront aider
à la construction de mon plan d'action.
4 J'identifierai les freins et risques du côté
des usagers de la structure.
4 J'effectuerai la même analyse auprès des
professionnels de la structure (cadre, travailleurs sociaux, psychologue,
médecin et infirmier).
4 Je repérerai les risques pour la structure ainsi que
pour le cadre que je suis.
4 En conclusion de cette partie, j'énoncerai les
objectifs stratégiques. Ils constitueront la base d'un plan d'action
qu'il s'agira de discuter en équipe pluri-disciplinaire avec le soutien
de la direction et du pôle qualité de l'association.
2.1 Méthodologie
J'ai abordé la réflexion par un entretien avec
le directeur de la structure. J'ai ensuite échangé de
manière informelle avec les éducateurs spécialisés,
l'infirmier puis avec des usagers. Par ailleurs, j'ai effectué des
recherches documentaires sur le sujet. J'ai ainsi pu me baser notamment sur des
écrits de la Fédération Addiction, de Médecins du
Monde, de l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, de la
Mission interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites
Addictives, de la HAS ainsi que d'écrits universitaires cités
dans ce mémoire.
J'ai ensuite élaboré un
questionnaire19 à destination des professionnels des CSAPA
avec hébergements ouverts en AT et collectifs et/ou ambulatoires. Pour
rédiger le questionnaire, je me suis inspiré d'une étude
20 de la Fédération Addiction menée entre 2012
et 2014. Cette étude, dont les résultats sont parus en 2015,
avait permis d'interroger des professionnels de 126 CSAPA (27% des CSAPA du
territoire) avec comme objectif de faire l'état des pratiques en
matière de RDRD. L'idée était d'utiliser le questionnaire
comme trame d'entretien et base de la discussion. Lors de ces discussions, il a
été essentiel de rassurer mes interlocuteurs sur le respect de
l'anonymat.
J'ai contacté des professionnels de 8 structures, dont
4 avec hébergement. Les entretiens ont été
réalisés avec : deux médecins addictologues, trois chefs
de service, deux infirmiers, un psychologue et deux travailleurs sociaux.
Lorsque la situation sanitaire l'a permis, j'ai également
interrogé deux usagers hébergés en appartement
thérapeutique.
Le but de cette démarche était de comparer les
pratiques des CSAPA et d'identifier les freins à l'accompagnement tout
en repérant les bonnes pratiques, les initiatives innovantes en
matière de RDRD. Ce travail a permis de mettre en lumière les
représentations des professionnels vis à vis des usagers et
inversement. Il m'a conduit à identifier des positionnements
éthiques et des cultures professionnelles ayant des impacts importants
sur la relation de soin et engendrant des risques pour les professionnels et
les usagers de la structure.
Par ailleurs, j'ai participé activement à
l'évaluation interne de la structure. Cette démarche a
été l'occasion pour moi de rencontrer le directeur de nombreuses
fois. J'ai pris du temps avec les membres de l'équipe (infirmier,
travailleurs sociaux, secrétaire, usagers).
19 En annexe 2
20 Fédération Addiction : Agir en réduction
des risques, en CSAPA et en CAARUD, décembre 2015
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 19 -
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 20 -
J'ai pu analyser les points forts et les points faibles du
dispositif. J'ai réuni tous les éléments de preuves, c'est
à dire les protocoles (circuit du linge, utilisation des
véhicules, évènements indésirables, gestion des
déchets contaminés, etc), les documents obligatoires tel que le
Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) , le
plan de reprise de l'activité, les évaluations internes et
externes ainsi que les comptes rendus de réunions, du Conseil de Vie
Sociale, etc. Je me suis également basé sur les rapports d'audit
interne et externe du dispositif.
J'ai soulevé les manquements lors des réunions
d'équipe et échangé avec deux personnes du pole
qualité du groupe et le directeur général. La
démarche, qui a duré 11 mois a été l'occasion de
nous interroger sur nos pratiques et positionnements éthiques, notamment
lors de journées institutionnelles. Enfin, j'ai commencé à
opérer des changements concrets au sein de la structure. J'ai notamment
complété l'affichage légal à destination des
salariés, des usagers et mis à jour les classeurs des
procédures dans l'infirmerie et le bureau des éducateurs.
Le référentiel de cette évaluation,
commun aux autres structures du groupe, est construit autour de 5 axes :
- 1 : L'exercice des droits et libertés individuels
- 2 : La protection des personnes et la prévention des
facteurs de risques
- 3 : Les spécificités d'accueil dans les CSAPA
- 4 : L'élaboration du projet personnalisé
- 5 : La politique de l'établissement et
l'établissement dans son environnement
Cette évaluation a donné lieu à un plan
d'action avec échéances et nominations des responsables des
changements à opérer.
Je me suis également appuyé sur le
référentiel des acquis de l'expérience pour le CAFERUIS
afin d'utiliser la bonne terminologie.
Encore une fois, la HAS a publié en 2019 des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur la prévention
des addictions et la RDRD par les CSAPA.
Cette même autorité, appelée l'ANESM
(Agence Nationale de l'Évaluation et de la qualité des
Établissements et Services sociaux et Médico-Sociaux) à
l'époque, a publié en 2008
des recommandations intitulées : « Les attentes de
la personne et le projet personnalisé » et « La bientraitance,
définitions et repères pour la mise en oeuvre ».
Ces documents constituent une base pour évaluer le
fonctionnement de la structure ainsi que de réels appuis à la
réalisation de changements car elles ont une valeur technique et
objective.
Par ailleurs, je compte aussi m'appuyer sur ces
recommandations car elles me permettront de légitimer mes
préconisations. Il s'agit là d'un travail d'experts.
2.2 Des carences dans le respect des droits des
usagers et dans l'organisation : une structure qui méconnaît le
cadre légal
Les problèmes sont transversaux et structurels. J'ai
décidé de séparer mes analyses en trois parties. Cependant
ces entraves au soin sont interdépendantes, ce qui rajoute de la
complexité à la compréhension de ces faiblesses en termes
de management stratégique. Pour autant, je me fixe la tâche
d'aboutir à un diagnostic, des objectifs stratégiques, des moyens
et des indicateurs concordants et clairement formulés.
2.2.1 Des manquements aux droits de l'usager qui
l'empêchent d'être pleinement acteur de son projet.
l L'admission est exclusivement administrative et
s'opère sans co-construction d'un projet de soin.
L'ANESM (aujourd'hui HAS) définit le principe de
l'usager co-auteur de son parcours dans le repère 1 de ses
recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur la bientraitance :
« Reconnaître la personne dans ce qu'elle veut
être et lui donner tous les moyens d'y parvenir suppose en effet de
mettre en place des modalités précises de recueil et de prise en
compte de ses préférences et de ses difficultés. C'est ce
que nous avons appelé ici le principe de l'usager co-auteur de son
parcours. 21». J'utilise dans mon écrit le
mot d'acteur mais le sens est le même.
« - Ton admission elle s'est passée comment?
Qui a reçu ton courrier, qui t'as répondu, qui tu
as eu au
téléphone au début?
21 ANESM (Aujourd'hui la HAS): Recommandations de bonnes
pratiques professionnelles, La bientraitance, définitions et
repères pour la mise en oeuvre , juin 2008, p18
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 21 -
- Ça a été un contact que j'ai eu par
le biais de mon assistante sociale de la clinique où
j'étais.
- J'ai constitué moi même mon dossier qui a
été reçu ici par X (éducateur
spécialisé) qui m'a
ensuite convoqué à un
entretien. Suite à ça j'étais dans l'expectative, enfin
j'attendais. Puis X a
fait passer mon dossier en commission, mon dossier a
été accepté et du coup je suis rentré
en
appartement thérapeutique.
- D'accord, donc tout a
été fait avec X.
- C'est ça.
- Tous les premiers
contacts...
- C'est ça X et mon assistante sociale
- Et ton
assistante sociale. Jusqu'à l'entrée dans les lieux qui a
été effectuée aussi par X?
- Tout à fait
»
Un usager du CSAPA
Cet extrait montre que l'étape de pré-admission
est surtout administrative. D'ailleurs le chef de service de l'époque
n'y participait pas. Il y a là un véritable enjeu pour le
Responsable d'Unité d'Intervention Sociale que je suis. La
présence d'un cadre lors de ce moment clef de l'accompagnement est un
gage de qualité et montre à quel point le projet de soin de
l'usager est pris au sérieux. Participer à la construction des
projets individuels et assurer leurs suivis est l'une des missions principales
d'un chef de service.
Les étapes de pré-admission et d'admission ont
pour but de déterminer le projet de l'usager avec lui. Si cette
démarche n'est pas approfondie, l'offre de soin tend à être
normalisée. Le contrat de séjour des personnes accueillies en AT
en est la preuve. Il n'aborde pas l'absence d'obligation d'abstinence.
L'éventualité de consommation de substances dans l'appartement
lors de la prise en charge n'est pas évoquée. Il y a donc un
défaut d'information sincère et véritable, l'usager ne
connaissant pas l'étendue exacte de ses droits et de ses obligations.
Dans le témoignage ci-dessus l'usager envoie son
dossier avec l'aide de l'assistante sociale. Il ne sera reçu par le chef
de service qu'un mois après son arrivée pour un entretien. Il
signera alors le contrat de séjour et quelques semaines plus tard un
temps de synthèse aura lieu avec l'éducateur. Cette
synthèse qui fait office de Projet Personnalisé sera
rédigée par un des deux éducateurs après
l'entrevue, ne sera pas lue à l'usager et ne sera pas signée par
lui. L'éducateur qui rédige le document respecte peut-être
les dires de l'usager mais l'usager ne sait pas ce qui est écrit et ne
l'accepte pas formellement. L'éducateur peut, en toute
sincérité, sur ou mal interpréter les dires de l'usager,
et c'est seulement cette interprétation qui fera figure de projet.
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 22 -
Ainsi, les objectifs ne sont pas négociés car
le document n'est pas élaboré conjointement. La qualité du
parcours du résident s'en trouve affectée car il ne connaît
pas les conditions de sa prise en soin.
Il est par ailleurs impossible d'évaluer des pratiques
professionnelles basées sur une absence de négociation, de
consensus. L'expertise de l'usager sur sa situation n'est pas au centre du
projet car ses attentes ne sont pas recueillies de manière formelle.
C'est pourtant ce que conseille la HAS dans ses
recommandations : « Favoriser la co-construction et l'appropriation par la
personne de son projet de soin et d'accompagnement » (point
3.2.2)22.
l Le déficit d'information entrave
l'instauration et le maintien de l'alliance thérapeutique.
L'instauration d'une relation de confiance, d'une alliance
thérapeutique est souvent difficile et son maintien est fragile. Si
certains usagers souhaitent se sevrer, d'autres craignent d'exprimer un projet
de soin ayant une autre finalité que le sevrage.
L'exemple qui suit est parlant. Il s'agit d'un usager «
slameur » : il s'injecte des substances pour avoir des pratiques sexuelles
plus performantes.
- « Je sais que tu ne
t'injectes pas tout seul, les rares fois où tu t'injectes. Est ce
qu'à des
moments, est ce qu'il t'a été proposé
du matériel stérile d'injection, en cas de prise de
risques,
des roule-ta-paille, du gel lubrifiant, je sais qu'il y a des
préservatifs ici, et surtout prodigué des
conseils liés
à ça ?
- Après pour la coke ça m'est
arrivé de rien avoir et du coup de prendre un billet, je sais
que
c'est nul. Après pour le matériel quand il y a eu des
injections c'est toujours stérile, fermé, etc.
Par contre on
m'a jamais proposé, on m'a jamais dit tiens Y est ce que ça te
dirais de slamer
(injecter les produits psychotropes dans le cadre de
relations sexuelles), j'ai une seringue. Ça
on ne me l'a jamais
dit.
- C'est pas comme ça que je voyais les choses, au cas où,
au cas où...
- Ha, au cas où, je sais que je peux aller en
pharmacie, y a des stériboxs.
- T'es au courant de tout ça
?
- Oui oui. »
Entretien avec un usager du CSAPA
22 Haute Autorité de Santé : Recommandation de
bonne pratique, La prévention des addictions et la réduction des
risques et des dommages par les centres de soins d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA), septembre 2019, p34
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 23 -
Les professionnels que j'ai interrogés soulignent que
les usagers sont soumis aux attendus supposés de la
société et ont tendance à minimiser les consommations
voire à les cacher plus tard, pensant que l'abstinence est le seul
objectif valable, audible par les soignants. Ce tabou trouve en partie sa
source dans les « postulats qui ont fondé la législation
au XX? siècle : il y a des « bonnes » et de « mauvaises
» drogues, l'usage des « mauvaises » doit être lourdement
sanctionné en toute circonstance et il faut faire payer à
l'usager le prix du plaisir volé, par le reniement et la
punition23 ». Cette difficulté pour l'usager
à s'ouvrir sur ces consommations s'explique aussi par la Loi n°
70-1320 du 31 décembre 1970, préalablement citée et encore
en vigueur aujourd'hui. Cette loi fait de la « cure de
désintoxication » « l'alpha et l'oméga de
toute guérison/rédemption 24».
Un compte rendu d'une réunion du CVS de 2018 (Conseil
de Vie Sociale) montre bien ce sentiment de culpabilité:
« En cas de coup dur et de consommation, Mr Y
n'arrive pas à solliciter l'équipe quand il en
ressent le
besoin, car il a le sentiment d'avoir cassé le travail effectué.
»
De fait, omettre d'informer les usagers de l'absence
d'obligation d'abstinence revient à interdire les consommations. En
effet, hormis pour l'alcool et des médicaments, l'usage et la
détention de toute substance psychoactive sont illégaux. Le
règlement de fonctionnement25 de la structure ne mentionne
pas ses points. Il énonce simplement l'interdiction de consommer des
produits psychoactifs sur le centre y compris de l'alcool, ce qui est
d'ailleurs discutable. Il comporte aussi un point sur l'interdiction de vendre,
acheter et échanger ces substances sur le centre. Ce que l'on peut faire
à l'extérieur est passé sous silence.
L'éventualité d'une reprise de consommations massives
quotidiennes rendant le soin impossible n'est pas non plus
évoquée. C'est pourtant dans les faits souvent un motif de fin de
prise en charge.
Les discussions menées avec certains professionnels de
terrain montrent qu'ils préfèrent conduire des entretiens avec
des personnes sobres et accompagner des personnes abstinentes, la communication
étant plus simple. Cela sécurise les professionnels et
réduit, selon eux, les risques de surdose et de passage à l'acte
pendant l'entretien.
Cependant nier la réalité du terrain peut
mettre les usagers en situation de risque liés aux syndromes de sevrage
brutal (delirium tremens pour l'alcool par exemple) ou au contraire
d'alcoolisation massive avant l'entretien par peur du manque ou
appréhension du rendez-vous.
23 Alain Morel, Pierre Chappard, Jean-Pierre Couteron,
L'Aide-mémoire de la réduction des risques en
addictologie, Paris : Dunod, 2012, 345 p, p4 et p5
24 Idem
25 En annexe 3
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 24 -
Ce positionnement est aussi contraire au cadre
réglementaire et aux principes éthiques. Le confort des
professionnels prime sur le respect des droits des usagers. Je pense qu'il
s'agit là d'un fonctionnement pervers contraire à la
déontologie du travail social.
Ce type d'habitudes et de pratiques professionnelles est
profondément ancré et prend le dessus sur le cadre
réglementaire prescrit.
Les chefs de service et les autres professionnels que j'ai
interrogés affirment qu'évoquer le sujet des consommations serait
pour certains une incitation. Il arrive aussi parfois que des usagers
craignent, par effet miroir, de se voir tenter de consommer par des discours
trop ouverts sur le sujet. Nombre d'entre eux ont un lourd passé
institutionnel et les structures spécialisées en addictologie
comme les centres d'hébergement ont longtemps eu un discours basé
sur l'abstinence.
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles et
des expériences réalisées pendant les confinements
successifs (protocoles de distribution alcool et présence
d'équipe de CAARUD dans les centres d'hébergement par
exemple26) font actuellement changer la tendance et évoluer
les comportements des salariés27 .
Enfin, j'attire l'attention du lecteur sur un
élément symptomatique des lacunes dans l'obligation
d'information. Lors de ma prise de poste, l'affichage légal
n'était pas en accord avec la Loi : règlement de fonctionnement,
compte rendu du CVS, livret de fonctionnement, numéros d'urgence,
etc.
Je me suis attaché à cette mise en
conformité, parce que ce mode de communication visuelle est essentiel et
car d'une visite du Comité d'Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail (CHSCT) était iminente.
Garantir la circulation de l'information envers les membres
de l'équipe et les personnes accueillies est une priorité que je
me donne.
l L'accompagnement ne prend pas assez en compte la
complexité de la situation des individus.
Le passage qui suit est une autre démonstration que le
dialogue ne s'installe pas. De plus l'usager qui parle ici souffre de
pathologies duelles. Son passé institutionnel est déjà
long et marqué par le passage dans de nombreuses structures, ce qui rend
l'échange encore plus difficile à établir. Il est palpable
qu'au début de cet accompagnement l'usager manifestait de la
méfiance et de la défiance vis à vis des soignants.
26 Fédération Addiction : Acte du colloque :
L'accueil inconditionnel au défi des consommations, Synthèse
& perspectives, Atelier : Héberger ou consommer, octobre 2017,
p32
27 Pour en savoir plus : Délégation
Interministérielle à l'Hébergement et à
l'Accès au Logement (DIHAL) : L'accompagnement de personnes
présentant des problématiques d'addiction ou des
troubles de santé mentale dans le cadre de la pandémie COVID 19,
recommandations et retour d'expérience, avril 2020
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 25 -
« - Je peux te demander quel produit tu consommais
?
-Alcool
-Uniquement ?
-Seulement.
-Et qui conduisait à des
pratiques à risques, pour toi, pour les autres ?
-Tout à fait
parce que quand j'ai emménagé le 10 décembre, quelques
jours après j'ai
consommé de façon massive l'alcool
pendant 3 jours. Ils l'ont su quelques semaines après...
-Tu ne leur
as pas dit ?
- Non je ne leur ai pas dit tout de suite. En même temps
je sortais de clinique. Donc, j'ai informé
plus la clinique. Parce
que j'étais encore rattachée à la clinique.
-Et
pourquoi tu ne l'as pas dit aux éducateurs ?
-Parce que j'avais peur
de perdre cet appartement, j'avais peur de perdre l'appartement...
-
Ça sous-entend que dans les premiers temps, tu n'as pas compris que tu
avais le droit d'en
parler.
-Exactement. Je pense qu'il y avait un manque
d'information. Pas un manque d'information
mais de bien me rappeler que
c'est pas les consommations qui vont faire que tu vas perdre
ton
appartement. C'est juste qu'il faut dire les choses, juste dire les
choses. Ma pathologie fait que,
il n'y a pas que l'alcool, il y a la
pathologie derrière qui fait que j'ai beaucoup de mal à dire
les
choses. »
Un usager du CSAPA
Dans la suite de cet entretien, l'usager raconte que
l'éducateur est venu quelques fois entre l'épisode de rechute et
le moment où l'usager le verbalise. D'après les dires de l'usager
dans la suite de l'entretien, l'attitude de l'éducateur lors des visites
à domicile laissait supposer qu'il savait que l'usager consommait
régulièrement. Cette absence de verbalisation a eu pour
conséquence l'installation d'un non-dit connu des deux parties et des
prises de risque pour l'usager. Je me pose également la question du
partenariat entre l'hôpital de jour et le CSAPA, la coordination des
soins étant manifestement défaillante. Il manque un travail
précis de repérage des besoins des usagers et une mobilisation
des ressources du territoire.
Le soin en CSAPA se doit d'être holistique et viser le
mieux-être de la personne dans tous les domaines. Ce n'est pas ici le
cas, la complexité du réel de l'individu n'est pas prise en
compte. Je relève ici que les professionnels manquent des leviers
nécessaires à l'instauration d'une communication interne de
qualité: absence de réunions de service auxquelles la
totalité des salariés ou presque serait présente, pas
d'études de situations d'usagers programmées, pas de
système informatique permettant une traçabilité et un
suivi, et un cahier de liaison pas assez renseigné.
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 26 -
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 27 -
Comme je l'ai écrit précédemment en
présentant le profil des usagers de la structure, le vieillissement, le
défaut de couverture sociale, l'absence de logement, de travail, de
liens sociaux sont autant d'éléments à prendre en compte
et à analyser. Ce sont aussi autant de partenariats dont l'absence
impacte lourdement le parcours des usagers. De plus, la veille
institutionnelle, notamment sur l'évolution du public n'est pas
correctement effectuée, aucun temps de réunion particulier ne lui
est consacré.
l La fréquence des entrevues entre les
professionnels et les usagers est insuffisante. Aucune action ne vient pallier
le sentiment de vide laissé par l'arrêt ou la réduction des
consommations
Les besoins des usagers en contacts avec des professionnels
(fréquence des visites à domicile, contacts
téléphoniques, rencontres au centre) ne sont pas assez pris en
considération alors que la qualité du séjour en
dépend. Ces contacts ne sont pas suffisants.
Lors d'une réunion du CVS, un usager parle de la
difficulté à maintenir le lien:« Mr X insiste sur le
fait qu'il est difficile de verbaliser ses consommations quand le lien est
distendu depuis plusieurs semaines. » Depuis ce compte-rendu, le
projet d'établissement 2018-2023 comporte un passage dans lequel
l'équipe s'engage au minimum à un contact par semaine :
Les modalités de ce suivi sont définies avec
la personne accueillie et se décomposent comme suit :
- Un suivi de l'équipe socio-éducative, qui
se décline à raison de deux entretiens physiques par semaine
(visite à domicile ou entretien dans les locaux du CSAPA Entracte) et
d'un échange téléphonique par semaine. Un éducateur
est en charge de l'ensemble des accompagnements au sein des appartements
thérapeutiques, appuyé par un un co-référent
désigné au sein de l'équipe pour chaque
résident.
- Un suivi médical est assuré par
l`équipe médicale du CSAPA dont les modalités sont
définies avec le médecin et l'infirmière (voir
ci-après).
- Un suivi psychologique par le psychologue de
l'établissement, ou en lien avec un partenaire externe. Cet
accompagnement est adaptable et modulable au regard du niveau d'autonomie, des
choix et des aspirations sur l'ensemble des préoccupations et
difficultés éventuelles de la personne. Par exemple une aide
à la gestion du budget ou une aide à la vie quotidienne peuvent
être mises en place (conseils et apprentissage cuisine, entretien de
l'appartement...).

Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 28 -
Depuis mon arrivée au CSAPA je n'ai pas constaté
que ces modalités de contacts avec les usagers aient été
respectées. Le suivi de l'équipe socio-éducative en
particulier est sporadique et bien souvent le lien se distend, se rompt et le
parcours de l'usager perd en qualité.
Il arrive même parfois que ce parcours se termine par
un retour à la rue, rien ou presque n'ayant changé dans la
situation personnelle de l'usager. Cela montre que les démarches n'ont
pas été effectuées pendant le séjour et / ou que
les liens avec le service orienteur et le lieu de vie de la personne avant son
entrée n'ont pas été maintenus.
Enfin, il ressort des entretiens que j'ai menés que le
week-end et les fêtes sont des moments de risques. Ce sont des moments
où les travailleurs sociaux référents sont absents. Il est
primordial de remédier à ce manque afin d'assurer aux usagers une
possibilité de contact permanente. De même, aucune action
individuelle ou collective n'est proposée aux usagers à part la
participation trimestrielle au CVS et aux ateliers de retour à l'emploi
délégués à un partenaire. Ils sont sensés
rejoindre une activité sportive ou culturelle existante en ville. C'est
un pas vers l'extérieur bien difficile à effectuer, en
début de parcours en particulier. Il s'avère que peu d'usagers
pratiquent des activités dans la cité.
2.2.2 La RDRD, une stratégie qui inspire de la
méfiance et ne fait pas sens commun.
l L'obligation légale de
mise-à-disposition légale de matériel de RDRD n'est pas
respectée.
Il existe un malaise chez certains professionnels à
mener des actions de RDRD individualisées (excepté en ce qui
concerne les sérologies et dépistages divers).
Dans l'enquête que j'ai menée, seules 5
structures sur 8 distribuaient du matériel de RDRD (dans
l»enquête de la Fédération Addiction 58,5 % de CSAPA
distribuaient des kits d'injection28).
Lors d'un entretien avec un directeur de structure, celui-ci
évoquait le fait que peu de CSAPA répondaient à leurs
obligations légales :
« On peut mettre des kits, ne pas les distribuer ou
les distribuer du bout de la main et ne pas
avoir de discours autour de
ça (la RDRD) ou avoir un discours très culpabilisant ».
Cette citation
du même professionnel souligne les
représentations existantes vis-à-vis des consommations
et
l'absence d'adhésion de certains professionnels à la RDRD :
« Dans le secret de leurs
organisations, ils restent sur un truc
très abstinenciel et opposé à la RDRD 29»
.
L'enquête réalisée montre que 5 des 8
structures informaient les usagers de l'absence d'obligation d'abstinence. Ce
tabou, malaise ou défaut d'adhésion à la RDRD a une autre
conséquence : il arrive à des professionnels de donner du
matériel sans en informer le reste de l'équipe, ce qui a
forcément des répercussions sur la dynamique de travail. La
question de mise-à-disposition de matériel de RDRD, le fait
d'admettre que des usagers continuent à consommer la ou les substances
pour lesquelles ils sont dans le soin (ou d'autres) nécessite un minimum
de consensus au sein de l'équipe. Ce n'est pas le cas dans le CSAPA dans
lequel je suis en poste, comme dans d'autres. Il existe alors un vrai manque de
sens et de culture communs.
La cohésion d'équipe risque fortement d'en
être affectée, entraînant potentiellement tensions et
dégradation du climat social. Malgré cette insuffisance de
formation certains éducateurs seraient pour rendre conforme les
documents rendus obligatoires par la loi 2002, informer les usagers de
manière plus efficace et commencer à distribuer du
matériel. Cette volonté se heurte aux pratiques professionnelles
d'autres salariés en poste dans la structure depuis plusieurs
années sans doute un peu enfermés dans la routine et parfois
désabusés. Dans le secteur, l'usure professionnelle est
fréquente. C'était sans doute le cas d'un des éducateurs
référents des appartements thérapeutiques. Depuis 10 ans
en poste, il privilégie les contacts téléphoniques aux
rendez-vous. Il ne prend ni le temps d'analyser en profondeur les besoins des
usagers, ni de fixer des priorités dans l'accompagnement. Cela a pour
conséquences un suivi qui perd en qualité et souvent des parcours
des usagers dans la structure se soldant par des sorties sans solution. Ainsi
le manque de sens et de motivation dans ses missions provoque des situations de
maltraitance des usagers. On peut imputer en partie cette responsabilité
à un management passé qui n'avait pas su créer de
culture
28 En annexe 4
29 Autres extraits de l'entretien en annexe 5
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 29 -
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 30 -
commune et insuffler la dynamique nécessaire à
l'épanouissement de tous les salariés via des formations
adaptées notamment. C'est pourtant le rôle du RUIS de
prévenir l'usure professionnelle et de susciter la participation des
salariés.
Je souligne cependant qu'accompagner ce public est difficile,
tant les problématiques des personnes sont complexes. Les « sorties
de route » ou écarts au règlement intérieur des
usagers sont souvent vécus comme des échecs par les
professionnels. De plus, surviennent parfois des épisodes douloureux,
overdoses, accès de violence ou de paranoïa, décompensations
voire décès. Il existe des séances d'analyse des pratiques
(6 par ans) mais il manque à mon avis des espaces de parole et de prise
de recul supplémentaires. Je tiens néanmoins à relever que
la majorité des salariés sont expérimentés et
engagés dans leurs actions au quotidien et profondément
bienveillants envers les usagers. Cela constituera un point fort une fois
qu'une base de culture commune sera établie.
Enfin, le CSAPA ne dispose pas de stock de matériel de
consommation à moindre risque. Lorsque les personnes sont accueillies en
rendez-vous, les éducateurs ne peuvent donc leur en fournir.
Notons que l'évaluation interne 2021 à laquelle
j'ai pris part préconise enfin d' : « Envisager de mettre
à disposition du matériel de RDRD et conteneurs DASRI
(déchets d'activités de soins à risques infectieux)
pour les usagers hébergés en appartement thérapeutique
». Cette évaluation a été validée par la
direction générale et les responsables qualité. Il s'agit
donc d'un levier sur lequel je compte m'appuyer pour communiquer sur cette
nécessité d'avoir, de distribuer et de récupérer du
matériel. Cette mission implique de former le personnel à son
utilisation et aux règles d'hygiènes afférentes.
l La formation des professionnels est
insuffisante.
Lors de la réalisation de mon enquête, dans 5
des 8 structures interrogées tous les professionnels étaient
formés à la RDRD. Cela ne signifie pas que tous adhéraient
à cette approche du soin en addictologie. Dans la structure au sein de
laquelle j'officie ce n'est pas le cas. Les professionnels sont peu
formés. Le médecin généraliste, l'infirmier et
trois éducateurs spécialisés ont été
formés en interne. Le psychologue, deux éducateurs
spécialisés et les deux surveillants de nuits n'ont
effectué aucune formation en RDRD. Enfin, un des deux éducateurs
responsables du suivi des appartements thérapeutiques a travaillé
en CAARUD mais depuis 10 ans qu'il est en poste en CSAPA, il n'a pas
actualisé ses connaissances. Il s'agit d'ailleurs du salarié en
situation d'usure professionnelle.
Le rapport de la Fédération Addiction de 2015
indique que dans 89 % des CSAPA interrogés, il y avait un professionnel
formé. Il s'agissait dans les 2/3 des cas de l'infirmier. Seuls 12 % des
CSAPA avaient l'ensemble des professionnels de leur équipe formé.
Lors de discussions informelles avec des travailleurs sociaux et infirmiers
j'ai pu constater que les temps de formation dédiés aux pratiques
en addictologie et donc à la RDRD dans leurs organismes de formation
étaient quasi-inexistants.
Il ne s'agit pas uniquement de connaître le
matériel et de savoir le distribuer mais aussi d'apprendre à
dialoguer sur le sujet des consommations, de connaître les gestes qui
peuvent sauver ou réduire les risques. L'équipe doit avoir les
compétences pour animer des temps individuels ou communautaires qui
permettent de libérer la parole. Ces techniques de communication sont
quasi-inexistantes à ce jour dans ce CSAPA. J'explore plusieurs pistes
de formation sur ces dernières dans mon plan d'action.
Je remédie à cette faiblesse grâce
à plusieurs modalités. La HAS en suggère dans ses
recommandations. La Fédération Addiction qui représente le
secteur de l'addictologie au sein de la HAS propose une liste de formations.
J'ai identifié ces acteurs comme appuis pour convaincre l'équipe
et la direction que mon plan d'action est légitime et conforme à
la déontologie du secteur.
l Le manque de moyens humains et financiers,
l'organisation de la structure constituent des freins au
changement.
« -Il y a une certaine difficulté à
aborder la question des rechutes et le fait que le parcours de
soin n'est
pas linéaire. Est ce que tu peux identifier des raisons à cette
difficulté de dialogue ?
Pourquoi les usagers mettent des semaines
à dire, par exemple : il y a deux semaines, j'ai eu
un gros
épisode de consommation ?
- Moi je pense que c'est toujours pareil,
c'est une histoire de moyens et que si on avait la
possibilité de les
visiter beaucoup plus régulièrement, c'est évident qu'on
serait beaucoup plus
au fait, au courant de ce qui se passe en temps et en
heure, à chaque fois...Si on va les voir
une fois tous les quinze
jours, toutes les trois semaines, c'est évident qu'il se passe
tellement
de choses dans ce laps de temps que tu passes à travers de
choses. Je pense que c'est
vraiment une histoire de moyens.
»
Un infirmier du CSAPA
Comme je l'ai déjà évoqué
précédemment, la structure comprend deux services, l'un ouvert et
l'autre en internat. Il y a deux équipes distinctes, l'équipe de
l'internat compte le plus
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 31 -
de membres. L'équipe des appartements
thérapeutiques n'est pas toujours présente en réunion
d'équipe. Pourtant les usagers des deux services ont pour certains les
mêmes profils . Parfois, des usagers des appartements
thérapeutiques sont hébergés temporairement dans
l'internat.
L»absence de ces temps d'échange rend complexe la
création d'une culture d'intervention commune. Ils auraient pourtant
l'avantage de pallier l'isolement des éducateurs en charge des AT dans
la structure (ils occupent un bureau séparé, situé au sous
sol). Je constate qu'il manque aux éducateurs des AT des espaces de
partage des situations et des parcours des usagers. Pour les professionnels,
ces réunions constituent aussi des moments de formation car les
échanges permettent d'envisager d'autres possibilités, de se
transmettre des contacts de partenaires, de se tenir informés des
nouvelles approches en addictologie, etc. La prise en charge des usagers aurait
vraiment à y gagner si les éducateurs des AT étaient
systématiquement présents. Pour le RUIS que je suis, la
communication interne en serait facilitée. Je serais à même
de recueillir, traiter et transmettre les propositions des professionnels de
terrain et d'assurer une meilleure diffusion de l'information à
l'équipe.
Il existe par contre des besoins qu'il s'agira de faire
financer ou de trouver en interne :
- Les besoins en matériels de RDRD - Les besoins de
formation en RDRD
2.2.3 Ces dysfonctionnements occasionnent des risques
pour les usagers, les professionnels et la structure.
Cette analyse m'a permis d'identifier un certain nombre de
risques.
4 Pour les usagers:
l Une information insuffisante :
- des risques liés à la réutilisation de
matériel usagé, le matériel n'étant pas mis
à disposition - des risques liés aux pratiques sexuelles non
protégées. Ce sujet très intime demande une réelle
proximité entre professionnels et usagers.
- des risques que les consommations de substances deviennent
incontrôlées et entraînent accidents de conduite, chutes,
maladies chroniques, etc
l Un projet de soin peu individualisé, des contacts trop
disparates avec l'équipe éducative : - des risques psychologiques
liés à la solitude de leur situation. L'étayage est
insuffisant, il ne permet pas de limiter les facteurs de risques et peut
aggraver la détresse psychologique souvent déjà
présente.
- des risques de sortie du dispositif sans solution
pérenne
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 32 -
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 33 -
- des risques que leur expression sur le dispositif ne soit pas
recueillie ou que l'absence de confiance mutuelle biaise leurs propos, ce qui
rendrait l'évaluation de l'action impossible à réaliser
- le risque que leur expertise ne soit pas prise en compte et
reconnue et ne puisse servir à la prise en charge des usagers futurs
l Une équipe insuffisamment formée, des risques
psychosociaux pour les salariés :
- des risques liés à des situations de violence,
d'évènements indésirables à leur encontre - le
risque psychologique lié au fait de faire un travail qui perd son sens
et pour lequel les professionnels n'ont pas les moyens de fournir une
prestation de qualité (brown-out en anglais). Ce risque est d'autant
plus important que la démotivation entraînée par cette
perte de sens peut être contagieuse.
-Le risque d'usure professionnelle
- des risques physiques comme les accidents d'exposition au sang
et aux virus en cas de blessure avec du matériel de consommation
souillé (risque peu probable mais à prendre en compte)
l Un manque de culture commune :
- un éclatement possible de l'équipe : le fait
d'avoir des professionnels peu soudés ou ayant des positionnements
éthiques sur la RDRD opposés peut mener à l'affrontement
et impacter fortement le climat social et donc le fonctionnement de la
structure.
J'ajoute que le DUERP n'était pas à jour
à mon arrivé et que les professionnels ne saisissaient pas
l'importance de ce document. C'est là aussi une lacune significative et
c'est mon rôle de RUIS que de mettre à jour cet outil et de le
faire exister auprès des professionnels.
4 Des risques managériaux pour le RUIS :
- le risque que la communication interne avec les
éducateurs soit inopérante étant donné qu'ils sont
le plus souvent absents des réunions d'équipe
- le risque que l'évaluation de nos interventions soit
rendue impossible
- Le risque de conduire des actions non pertinentes car ne
tenant pas compte de l'évolution du public et du savoir
expérientiel des usagers
- le risque de conflit dans l'équipe par manque de
culture commune (énoncé plus haut) rendant difficile un
management efficient et entraînant un climat social
dégradé
- Un accroissement du risque qu'un accident, voire un
décès d'un usager surviennent. Au-delà du drame humain, un
tel évènement engagerait ma responsabilité et celle de la
direction.
4
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 34 -
Des risques pour le devenir de la structure existent
également :
- Ne pas se conformer au cadre légal c'est prendre le
risque de se voir sanctionner par l'autorité de tarification, l'ARS en
l'occurrence, avec un impact éventuel sur le financement. Il existe un
risque encore plus grand, c'est celui de perdre la confiance des partenaires,
des autres structures du même domaine et des travailleurs sociaux du
territoire. Il en va de la réputation de la structure, donc des
professionnels (crédibilité et autorité du directeur et du
RUIS que je suis) et plus loin du groupe auquel elle est rattachée. Un
cadre est pourtant garant de l'image et des valeurs de la structure et du
groupe qu'il représente. La responsabilité de cette communication
externe est essentielle et se construit jour après jour.
2.3 Réussir l'alliance thérapeutique : des
objectifs stratégiques à fixer
Pour résumer, les exigences d'admission posées
dans le projet d'établissement et l'accompagnement proposé sont
souvent inadaptés au vécu des personnes et ne prennent pas la
mesure de la complexité et la diversité de leur parcours. Le fait
que certains usagers continuent à consommer n'entraîne pas
d'actions idoines. Le dialogue et l'information sur cette question est
compliqué, parfois occulté.
Les prises en charge des usagers ne sont pas assez
personnalisées et se limitent à deux modalités (bas seuil
et moyen / haut seuil). Les salariés n'ont pas les compétences
pour appréhender cette complexité et mener des accompagnements de
qualité. C'est tout l'enjeu du changement des pratiques professionnelles
que j'envisage d'initier et de l'intérêt pour ce changement que je
veux susciter.
Concernant les manquements aux droits des usagers, mon plan
d'action comprendra les axes stratégiques suivants :
l Je modifie la procédure d 'admission qui est
exclusivement administrative Je veux garantir la co-construction de chaque
projet de soin.
l Je pallie le déficit d'information qui entrave
l'instauration et le maintien de l'alliance thérapeutique.
l Je veux que l'accompagnement prenne désormais
réellement en compte la complexité de la situation des
individus.
l
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 35 -
J'augmente la fréquence des entrevues entre les
professionnels et les usagers. Je me donne la mission de trouver des
activités permettant de lutter contre le sentiment de vide laissé
par l'arrêt ou la réduction des consommations.
De même, l'organisation actuelle de la structure ne
permet pas de se conformer au cadre légal et les points suivants sont
à traiter :
l Je vérifie que la structure suit l'obligation
légale de mise-à-disposition de matériel de RDRD.
l Je considère aussi comme impératif de
compléter la formation des professionnels.
l Je mène une réflexion sur le manque de moyens
physiques et financiers et l'organisation actuelle de la structure car ils
constituent des freins au changement.
Deux obligations légales ne sont pas entièrement
respectées ce qui nuit à l'efficience du parcours de l'usager
dans la structure et complexifie l'instauration de l'alliance
thérapeutique: l'élaboration conjointe d'un projet individuel de
soin ainsi que la mise en place d'actions en RDRD, notamment la mise à
disposition de matériel de consommation à moindre risque.
L'analyse de ces constats me permet de poser la
problématique suivante : Comment initier et accompagner un changement
des pratiques professionnelles afin de proposer un projet de soin
personnalisé de qualité conforme à la législation ?
Comment garantir l'instauration et le maintien de l'alliance
thérapeutique ?
En tant que cadre, je fais l'hypothèse qu'initier
et accompagner un changement des pratiques professionnelles est de nature
à permettre l'instauration et le maintien de l'alliance
thérapeutique et améliorera la qualité du parcours des
usagers de ce CSAPA.
4 Mon objectif général: Permettre
à l'usager de CSAPA d'être acteur de son projet de
soin en
facilitant l'instauration de l'alliance thérapeutique
l Objectif intermédiaire 1 : Proposer une offre
de soin respectueuse des droits des usagers
l Objectif intermédiaire 2 : Accompagner les
changements dans le fonctionnement de la structure et des pratiques
professionnelles pour permettre la mise en place d'une réelle
implémentation de la Réduction des Risques et des
Dommages
|
3 GARANTIR UNE PRISE EN CHARGE DE QUALITÉ EN
CSAPA : PERMETTRE À l' USAGER D'ÊTRE ACTEUR DE SON PROJET DE
SOIN
4 Mon objectif général:
Permettre à l'usager de CSAPA d'être
acteur de son projet de soin en facilitant
l'instauration de l'alliance
thérapeutique
|
J'énonce, ci-dessous, ma stratégie à
court moyen et long terme (deux ans et demie). Je définis mon plan
d'action et le met en oeuvre après validation par la direction et en
accord avec l'équipe. De la même manière que pour les
constats et leur analyse, ces actions sont présentées de
manière séparée mais devront être
considérées dans leur complexité en tant qu'ensemble. Pour
penser ce plan d'action, je me suis appuyé notamment sur les
recommandations de bonnes pratiques et documents suivants :
-Haute Autorité de Santé : Recommandation de
bonne pratique, La prévention des addictions et la réduction des
risques et des dommages par les centres de soins d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA), septembre 2019
-ANESM (Aujourd'hui la HAS): Recommandations de bonnes
pratiques
professionnelles, La bientraitance, définitions et
repères pour la mise en oeuvre , juin 2008 -HAS : Grande
précarité et troubles psychiques - Note de cadrage, septembre
2021 -UNAPEI, Nous Aussi, L'information pour tous, Règles
européennes pour une
information facile à lire et à comprendre, 2009
-Fédération Addiction : Repère(s,
Participation des usagers : de l'implication à la coopération',
septembre 2020
Je repère les propositions qui me semblent pertinentes
au vu du fonctionnement actuel de l'organisation et j'opère des choix.
Je me base aussi sur les entretiens menés avec des professionnels ayant
des approches innovantes que j'ai interrogés lors de ma recherche. Par
plusieurs moyens, je veux faire en sorte que la structure devienne une
organisation apprenante, que les professionnels sachent mettre en question
leurs pratiques et apprennent les uns des autres. Mon propos n'est pas
nécessairement de mettre en place toutes ces mesures
immédiatement. Je m'attache aussi à identifier avec
l'équipe et la direction des actions prioritaires. Les actions
acceptées sont intégrées dans un tableau de suivi avec
échéances et indication des responsables de leurs mises en
oeuvre30. Ces actions seront également
présentées sous la forme d'un planning31. Les
indicateurs d'évaluation sont décrits. Je propose une
évaluation intermédiaire dans un an.
30 En annexe 6
31 En annexe7
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 36 -
3.1 Objectif intermédiaire 1 : Proposer une
offre de soin respectueuse des droits des usagers
3.1.A Améliorer les procédures de
pré-admission et d'admission en axant ces étapes sur la
co-construction
Je mets en place une procédure d'admission
«qui favorise l'exercice du choix
éclairé32» de l'usager. Dans le même
temps les professionnels se doivent d'évaluer «l'adaptation du
séjour à son projet de vie33
».
Je m'assure qu'à l'arrivée de la personne,
l'équipe pluri-professionnelle réalise un bilan global de la
situation de la personne (santé, état psychologique et situation
sociale).
Si la personne y consent, je fais le lien avec les services
orienteurs et autres accompagnateurs de la personne avant son arrivée
dans la structure.
Enfin, et c'est ce qui me paraît crucial et constitue
également ma responsabilité en tant que RUIS, je veille à
une co-élaboration du projet de soin et d'accompagnement «
À partir de la demande de la personne, de ses attentes, de ses
capacités et de l'analyse des besoins issue de l'évaluation
globale de sa situation 34».
Les actions envisagées :
À court terme :
1. L'admission (y compris la visite des locaux) et la
première synthèse mensuelle sont réalisées en ma
présence ainsi qu'en celle d'un des deux éducateurs
référents. Je veille à ce que les documents (contrat de
séjour et Projet Personnalisé) soient rédigés et
lus en présence de l'usager. Je tiens aussi à ce que le contrat
de séjour (règlement de fonctionnement inclus) soit lu avec
l'usager.
Je me rends donc disponible pour l'admission de chaque nouvel
usager ainsi que pour la première synthèse. Cela me permettra de
participer à l'analyse de la situation de la personne accueillie et de
fixer avec elle et l'éducateur référent des objectifs de
travail clairs et évaluables. C'est aussi l'occasion de pallier le
manque d'information vis-à-vis des usagers. Par ailleurs, j'envisage
aussi ces actions comme une forme de tutorat, sinon de croisement des approches
et techniques d'entretien pour les éducateurs dédiés au
suivi de ces usagers comme pour moi.
32 Haute Autorité de Santé : Recommandation de
bonne pratique, La prévention des addictions et la réduction des
risques et des dommages par les centres de soins d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA), septembre 2019, p34
33 idem
34 Haute Autorité de Santé : Recommandation de
bonne pratique, La prévention des addictions et la réduction des
risques et des dommages par les centres de soins d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA), septembre 2019, p35
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 37 -
Cette présence double est l'occasion de mettre en
question nos pratiques professionnelles respectives. Je vois aussi cette action
comme l'opportunité de porter un double regard sur les situations et
d'améliorer nos pratiques respectives.
À moyen terme :
2. Je formalise les contacts avec les services orienteurs
sociaux, médicaux et notamment ceux qui accompagnent fréquemment
les usagers du territoire.
Je charge un binôme (infirmier et
moniteur-éducateur de l'hébergement collectif) de
répertorier et contacter ces structures. L'idée étant de
pouvoir réunir des professionnels de ces structures en présentiel
et en virtuel au moins une fois dans l'année avec l'objectif de
présenter notre structure, nos valeurs et de partager sur la
nécessité de coordonner nos actions. Ainsi les services
orienteurs seront à même de diriger l'usager vers une structure
qui lui convient et qu'il a choisi. Le but recherché est de
développer le partenariat qui fait actuellement défaut et de
créer un réseau. Je planifierai et animerai la réunion. Je
laisse aux deux professionnels le soin de présenter la structure et dans
un second temps d'exposer les situations d'accompagnement qui nous posent
problème ou soulèvent des questions (en anonymisant les
situations). Cette recherche de solutions a aussi l'intérêt de
renforcer les liens partenariaux.
3. J'organise la phase de pré-admission avec un
contact entre l'usager et le travailleur social référent puis un
autre rendez-vous avec l'infirmier si possible en présence d'un membre
du service orienteur. Mon objectif est de créer deux grilles
précises de recueil des attentes et objectifs de l'usager, l'une
relative à la santé et l'autre à l'insertion / la
réinsertion sociale. Je me propose de m'atteler à cette
tâche avec le médecin psychiatre (s'il est disponible) et un des
travailleurs sociaux de l'équipe. J'organise une réunion de
discussion et de partage des tâches, puis une pour réaliser le
document un mois et demi après. Enfin, je prévois une
période de test de 4 mois, puis un retour à l'équipe avant
l'adoption de l'outil.
Les indicateurs d'évaluation de ces actions
:
1. Le cadre est présent à 100 % des admissions et
des premières synthèses
2. La réunion annuelle partenaires « orienteurs
» est effective. 80 % des partenaires « clef » sont
présents : Lits Haltes Soins Santé, lits d'accueil
médicalisés (LAM), département addictologie du CHU,
Équipe de liaison et de soin en addictologies (ELSA), CSAPA ambulatoires
de la régions, CAARUD de la région, Centre d'Hébergement
et de Réinsertion Sociale (CHRS), Dispositif d'hébergement
d'urgence (DHU), associations chargées de la réinsertion des
sortants d'incarcération et accueils de jour.
3.A. Les deux réunions de pré-admission ont lieu
systématiquement pour 100 % des usagers (y compris ceux qui ont
décidé de ne pas intégrer la structure où n'ont pas
été retenus).
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 38 -
3.B. Les grilles de recueil des attentes et objectifs sont
remplies et utilisées comme document d'accompagnement d'ici 4 mois.
3.1.B Rendre systématique une information
complète
Je tiens à ce que la structure respecte cette
formulation de la HAS : « Informer, premier support à
l'autonomie35».
Cette instance rappelle aussi le cadre légal : «
l'usager (et/ou ses proches ou représentants légaux) doit
être informé de l'ensemble de ses droits et des
possibilités qui s'ouvrent à lui dans le cadre de son
accompagnement.36 ». J'ai repéré lors de mon
analyse que des informations obligatoires ne sont pas transmises aux usagers
avec pour conséquences des risques pour les différents acteurs et
une mise à mal de l'alliance thérapeutique.
De plus, nos prestations, qui devront rapidement être
en accord avec les missions obligatoires des CSAPA, doivent être plus
nettement communiquées aux usagers. Sans information complète,
l'usager ne peut être autonome et donc acteur de son projet. Je pense
donc que le plus urgent est de compléter le règlement
intérieur. Je veux ensuite réécrire la partie « Nos
engagements37 » du contrat de séjour dans laquelle nos
prestations sont décrites. En outre, un autre élément
central : l'information spécifique à la stratégie de RDRD
sera étudiée dans l'objectif stratégique 3.2.
La transmission de l'information doit être
effectuée de façon adaptée. Il est impératif que
les professionnels vérifient que tous les éléments
transmis ont bien été compris. En tant que chef de service, je
dois répondre à cette exigence en utilisant les technologies de
l'information et de la communication. Sur le plan pratique, j'envisage donc de
travailler à multiplier les modes de communication : traductions,
rédaction de certains outils de la loi 2002-2 avec une terminologie
simple et précise, rédaction en utilisant la méthode
Facile à Lire et à Comprendre38 (FALC), etc.
Les actions envisagées :
À court terme :
1. Sous un mois et en accord avec la direction, je
rédige personnellement un point manquant au règlement
intérieur : l'absence d'obligation d'abstinence. Avant cette
rédaction,
35 ANESM (Aujourd'hui la HAS): Recommandations de bonnes
pratiques professionnelles, La bientraitance, définitions et
repères pour la mise en oeuvre , juin 2008, p20
36 ANESM (Aujourd'hui la HAS): Recommandations de bonnes
pratiques professionnelles, La bientraitance, définitions et
repères pour la mise en oeuvre , juin 2008, p20
37 En annexe 8
38 UNAPEI, Nous Aussi, L'information pour tous, Règles
européennes pour une information facile à lire et à
comprendre, 2009
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 39 -
lors de la prochaine réunion d'équipe je demande
à l'équipe d'effectuer un brainstorming de 20 minutes pour
réfléchir ensemble à une formulation aisément
compréhensible.
2. Sous un mois, je fais le même travail sur la partie
« Nos engagements » du contrat de séjour avec la même
méthode de travail.
À moyen terme :
3. Je forme un des éducateurs intéressés
des appartements thérapeutiques à la rédaction en FALC. Un
organisme de formation propose une initiation de deux jours en e-learning. Je
présente la fiche d'information à l'équipe et le devis
à la direction39. Si la direction le permet j'organise cette
formation dans les 3 mois à venir. Je délègue à ce
professionnel la rédaction en FALC du contrat de séjour (incluant
le règlement intérieur) dans les 6 mois à venir en
veillant à la participation effective d'un usager volontaire.
À long terme :
4. Le groupe dont dépend la structure dédie des
fonds aux frais de traduction. Compte tenu de l'origine géographique des
usagers envoyant des demandes d'admission et du public acceuilli dans les
CAARUD de la région, je propose de faire traduire le contrat de
séjour, rédigé en FALC en anglais, espagnol,
géorgien, russe et tchèque. J'ai identifié le
géorgien et le tchèque comme étant les traductions
à réaliser en premier.
Les indicateurs d'évaluation de ces actions
:
1 et 2. Le brainstorming sur la réécriture les
parties du règlement de fonctionnement et du contrat de séjour
est effectif lors de la prochaine réunion d'équipe. Ces
paragraphes sont rédigés le lendemain, validés par la
direction sous une semaine (si possible). Les documents sont actualisés
et utilisés lors de la prochaine admission.
3. Un des éducateurs a validé les deux jours de
formation de rédaction en FALC sous 3 mois. Le contrat de séjour
est rédigé en FALC avec la participation d'un usager et
validé par la direction sous 6 mois.
4. Le contrat de séjour est traduit en tchèque
et géorgien d'ici 1 an. Le document est traduit dans les autres langues
d'ici 1 an et demi.
3.1.C Prendre en compte la complexité de la
situation des individus
J'ai déjà donné quelques pistes plus
haut (en 3.1.A) avec notamment les actions 2 (relations partenariales) et 3
(lien avec le service orienteur et création d'une grille
d'évaluation
39 En annexe 9
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 40 -
des attentes et objectifs des usagers). Par ailleurs, je
relève dans mon diagnostic l'absence de veille sur l'évolution du
public. Le manque d'outils dont disposent les professionnels pour accompagner
des personnes ayant nécessairement des situations complexes a des
conséquences parfois tragiques et au moins génératrices de
risques pour les acteurs.
Dans sa note de cadrage « Grande
précarité et troubles psychiques 40», la HAS
constate « une mise en oeuvre progressive de modèles
d'accompagnement sanitaire et social innovants ». En plus de
l'accompagnement axé sur le rétablissement et la RDRD
relatés plus haut, la HAS propose d'autres approches : « le
case-management, l'accompagnement intensif dans la communauté (Assertive
Community Treatment); l'Individual Placement and Support (IPS), l'approche par
les forces.» Ces approches sont relativement nouvelles pour moi, aussi, je
ne suis pas encore suffisamment informé pour les utiliser dans le CSAPA.
Je tiens à me documenter et à prendre du temps pour
décider des approches les plus appropriées aux objectifs de nos
actions.
En tant que cadre, j'ai l'ambition de développer les
compétences individuelles et collectives permettant d'appréhender
la complexité des situations individuelles et ainsi assurer une prise en
charge de qualité aux usagers.
Les actions envisagées :
À court terme :
1. La question de l'évolution des publics concerne
l'équipe dans son ensemble. Je charge un des professionnels du collectif
de réaliser une synthèse sur l'évolution des publics dans
la région et en France en partant des sources que j'ai citées
dans ce document : rapport de l'OFDT, de la Fédération Addiction,
etc. Je tiens aussi à ce qu'il contacte les autres CSAPA ambulatoires et
avec hébergements de la région sur cette même
problématique.
Sur l'hébergement collectif, il y a des moments calmes
dans la journée et après le dîner. Aussi confier cette
tâche à un éducateur du collectif me paraît
envisageable. Je prévois que ce professionnel consacrera un temps
dédié d'environ 2 heures par semaines à ce travail et je
demande un compte-rendu une fois par mois en réunion d'équipe. Je
l'écris dans le point qui suit mais mon souhait est de mobiliser les
éducateurs des AT dans leurs contacts avec les usagers, je ne veux pas
leur attribuer trop de tâches de recherche.
2. Avec la même démarche que pour l'action
précédente, je délègue à un
moniteur-éducateur chargé du collectif la tâche de
répertorier les partenaires, de repérer les acteurs du secteur de
l'addictologie, mais aussi de l'hébergement, du logement et de l'emploi
qui ont des
40 Haute Autorité de Santé : Grande
précarité et troubles psychiques - Note de cadrage, septembre
2021, p7
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 41 -
approches innovantes. Il s'agit d'étendre cette
recherche à tout le territoire national. Les modalités de
compte-rendu à l'équipe seront les mêmes qu'au point 1.
À moyen terme :
3. J'invite le chef du département addictologie du CHU
du département (dont dépend aussi un CSAPA ambulatoire). Je sais
que cette personne se déplace volontiers dans les structures. Je veux
lui demander de faire une intervention d'un après-midi sur les
typologies des publics et l'évolution des ces dernières. Je la
contacte personnellement et prépare avec elle l'intervention. Cette
entreprise sera encore une occasion de développer le partenariat. Je
souhaite, en effet, dans un futur proche, faire en sorte que le personnel
médical du CSAPA fasse de courtes immersions dans son service. J'entends
pouvoir organiser cette réunion d'ici 6 mois.
À long terme :
4. J'avance personnellement dans la compréhension des
nouvelles approches d'accompagnement conseillées par la HAS. Je me
laisse l'année pour rassembler de la documentation et des devis pour des
formations. J'en ferai une synthèse à destination de la direction
et une présentation à l'équipe dans un an.
Les indicateurs d'évaluation de ces actions
:
1 et 2. Les comptes rendus sur l'évolution des publics et
sur les approches innovantes ont bien lieu une fois par mois lors de
réunions d'équipe. Ils sont compilés dans un fichier
informatique et accessibles à tous.
3. L'intervention du chef du département addictologie du
CHU a lieu sous 6 mois.
4. La synthèse sur les approches innovantes est
réalisée d'ici un an.
3.1.D Augmenter la fréquence des entrevues
entre les professionnels et les usagers. Proposer des activités visant
à lutter contre le sentiment de vide laissé par l'arrêt ou
la diminution des consommations
Les actions envisagées :
À court terme :
1. Pour cette action, je tiens à ce que les objectifs
fixés dans le projet d'établissement 2018-2023 soient
respectés, à savoir un contact minimum par semaine pour chaque
usager. Je préconise des visites à domicile car l'état du
logement est souvent un bon indicateur de l'état
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 42 -
psychologique des résidents. Il y a huit usagers et
deux éducateurs référents. Cela fait 4 visites par
éducateurs, c'est réalisable. Je propose qu'ils se
déplacent avec un ordinateur portable pour faire les démarches
administratives. Quand il n'y a pas de démarches à
réaliser, j'envisage des ateliers cuisine, de savoir habiter
(ménage, bricolage, etc.). Des discussions sur la gestion du budget
peuvent être menées à cette occasion car ces moments sont
un moyen d'aborder la question de la gestion des consommations. En tant que
RUIS, je me porte garant de l'effectivité de cette action.
2. Je convie les usagers des appartements
thérapeutiques aux activités sportives proposées aux
usagers du collectif. Je demande lors de chaque admission les loisirs ou
activités sportives ou culturelles que les usagers souhaitent pratiquer.
J'en évalue ensuite la faisabilité. Je note que plusieurs
associations du territoire proposent des activités gratuites aux
personnes en situation d'exclusion. Ces deux dispositions sont à mettre
en place d'ici deux semaines.
Les indicateurs d'évaluation de ces actions
:
1- La visite hebdomadaire est effective pour 100 % des
usagers.
2- 100 % des usagers pratique une activité de loisir.
3.2 Objectif intermédiaire 2 : Accompagner les
changements dans le fonctionnement de la structure et des pratiques
professionnelles pour permettre la mise en place d'une réelle
implémentation de la RDRD
3.2.A Former et sensibiliser les professionnels à
la RDRD Les actions envisagées :
À moyen terme :
1. Je forme l'ensemble du personnel accompagnant à la
conduite d'entretien avec des personnes consommatrices, une technique
étant l'entretien motivationnel (certains sont déjà
formés) : Dans l'entretien motivationnel, c'est le patient qui
énonce ses motivations au changement et se convainc lui-même de
changer. Cela suppose que les professionnels s'entraînent à
instaurer une conversation qui permette cette formulation. Dans ce mode de
communication : « L'atmosphère créée par
l'attitude empathique du thérapeute permet au patient d'explorer le
changement en sécurité 41». Sur le plan de
l'accompagnement collectif, les thérapies comportementales et cognitives
de prévention de la rechute sont également une aide
41 Fortini, C. & Daeppen, J. (2011). L'entretien
motivationnel : développements récents.
Psychothérapies, 3(3), 159-165.
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 43 -
précieuse. Leurs buts sont d'aider les patients «
à maîtriser les stratégies comportementales efficaces dans
la bonne gestion de ces situations à haut risque 42».
Une formation à l'entretien motivationnel est proposée par la
Fédération Addiction. Le besoin de ces formations ayant
été clairement repéré, je propose à la
direction de les intégrer au plan de formation. Elles devront avoir lieu
à des moments différents pour chaque professionnel afin de ne pas
pénaliser l'action. Elles seront également systématiques
pour chaque professionnel recruté. Ce sont de courtes formations aux
coûts réduits. Je présente les documents relatifs à
ces formations à l'équipe.43
2. Je vérifie qu'une veille systématique sur les
nouveaux produits, modes de consommations et outils de RDRD soit
réalisée. Pour cette action, je m'appuie sur les
compétences de certains professionnels en interne et me tourne vers des
professionnels en CAARUD. J'organise deux réunions d'équipe par
an dédiées à cette veille.
Pour l'action 2, de veille, je contacte
régulièrement les membres de réseau de partenaires (en
particulier le centre d'addictovigilance du département). Je
vérifie que ces informations soient diffusées lors des
réunions d'équipe de manière continuelle en plus de la
participation de professionnels de CAARUD lors des deux réunions
d'équipe de l'année.
Les indicateurs d'évaluation de ces actions
:
1. La totalité de l'équipe est formée
à l'entretien motivationnel à l'échéance N+1.
2. Des professionnels d'un CAARUD de la région sont
effectivement présents à deux réunions d'équipe
dans l'année.
3.2.B Mettre à disposition du matériel de
RDRD avec plusieurs modalités
Je rappelle à l'équipe les conseils de
la HAS44 : Il faut tout d'abord « Informer la
personne du matériel de réduction des risques disponible, des
modalités de sa délivrance et de sa récupération au
sein du CSAPA. ».
L'organisme préconise aussi d'envisager d'avoir
recours à de multiples modalités d'information : affichage,
plaquettes, ateliers, éducation par les pairs, etc. Parmi les
thématiques proposées par la HAS, je mets la priorité sur
les suivantes:
- les risques liés aux substances et aux consommations
concomitantes de plusieurs substances - la formation à l'utilisation des
divers matériels de RDRD
- les risques liés au partage et à la
réutilisation du matériel
-la promotion des alternatives à l'injection
42 Aubin, H. (2004). De l'approche par produit au concept
d'addiction. Revue Projet, 5(5), p 85
43 En annexe 10
44 Haute Autorité de Santé : Recommandation de
bonne pratique, La prévention des addictions et la réduction des
risques et des dommages par les centres de soins d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA), septembre 2019, p36
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 44 -
-l'éducation à l'injection à moindre
risque (Accompagnement et Éducation aux Risques Liés à
l'Injection, AERLI)45
- la gestion et / ou la réduction des consommations
à risque (y compris pour l'alcool et le tabac) - la réduction des
consommations à risque ou la gestion des consommations d'alcool.
De plus, la HAS conseille d' « Anticiper avec la
personne les éventuels besoins en matériel lors de ses sorties
(weekends...). » Notons que j'ai évoqué le fait que le
risque était plus important lors des fêtes et des week-end dans
mon diagnostic.
Enfin, ce que nous ne faisons pas encore : je fixe comme
impératif à l'équipe d'évaluer avec l'usager ses
besoins en matériel de RDRD. L'objectif est qu'il ait à sa
disposition du matériel chaque fois qu'il veut consommer. Je rappelle
que l'évaluation interne de 2021 nous interpelle à ce sujet. Nous
devons mettre du matériel à disposition rapidement.
Les actions envisagées :
À court terme :
1.Je mets en place un groupe de travail pour
réfléchir aux modalités d'accès au matériel
de RDRD. Il sera constitué de deux travailleurs sociaux, du psychologue
et de l'infirmier. Idéalement j'aimerais proposer à un ou deux
ex-usagers d'y prendre part. Je planifie deux réunions de deux heures
dans le mois qui vient. Je ne serai présent que lors de la seconde
réunion afin de leur laisser la liberté de s'exprimer. Les
entretiens réalisés lors de mon enquête m'ont permis
d'identifier plusieurs possibilités de mise à disposition:
Je m'assure de la mise à disposition de
matériel de consommation à moindre risque en libre accès
dans un endroit discret de la structure afin que les usagers puissent se servir
sans être obligés d'en informer le personnel.
Je m'assure de la mise à disposition de
matériel de consommation dans le bureau des éducateurs de
manière visible afin d'ouvrir des possibilités de dialogue.
Je contrôle que le matériel soit effectivement
distribué lors des visites à domicile
Je vérifie l'installation d'une trousse de secours et
de RDRD dans les appartements contenant en plus du matériel classique de
premier secours, de la Naloxone46 et du matériel de
consommation à moindre risque. Cette action est efficiente d'ici un
mois.
Ces actions supposent une demande de financement à
l'ARS de matériel ou une convention avec un CAARUD pour l'achat ou le
don de matériel. A très court terme, je suggère de signer
une convention avec un CAARUD du territoire d'ores et déjà
financé pour l'achat de matériel afin qu'il nous en fournisse. Si
nous devons acheter ce matériel, étant donné que nous
45 En annexe 10
46 Solution injectable qui empêche l'overdose au
opiacés le temps de contacter les secours
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 45 -
n'accueillons que 8 usagers à la fois, le coût de
l'achat du matériel sera réduit. Par contre, je m'assure que tous
les types de consommables sont présents et accessibles à nos
usagers.
Les indicateurs d'évaluation de ces actions
:
1.A. Le matériel est disponible, y compris de
manière discrète, sous un mois dans une armoire du centre.
1.B. La trousse de secours est présente dans tous les
appartements. Elle contient aussi de la Naloxone et du matériel de
consommation à moindre risque. Un après-midi de formation a eu
lieu pour expliquer l'utilisation de la Naloxone, dans les 2 mois à
venir.
1.C. Différentes d'autres modalités de mise
à disposition sont mises en oeuvre, sous 6 mois.
3.2.C Envisager des changements dans l'utilisation
des moyens physiques et financiers ainsi que dans l'organisation de la
structure
Les actions envisagées :
À moyen terme :
1. Je réorganise le planning pour que tout le monde
participe aux réunions et pour assurer une astreinte week-end et jours
fériés. Je veux impérativement travailler à cette
tâche. Cela implique cependant une consultation des représentants
du personnel. Je ne veux pas créer de l'insécurité dans
cette nouvelle organisation. Il est donc nécessaire que chacun comprenne
en quoi la présence d'une équipe pluri-professionnelle au complet
permet d'assurer la qualité de la prise en charge. Il est aussi
primordial de permettre aux usagers de bénéficier de la
présence des professionnels les week-ends. Je tiens à
élaborer et à gérer ces futurs plannings en travaillant
avec la direction. L'accomplissement de cette action passe notamment par une
prise de responsabilité plus importante de certains membres de
l'équipe, s'ils l'acceptent. Le recrutement, notamment d'un travailleur
pair, pourra aider à cette réorganisation (voir ci-dessous).
À long terme :
2. Je recrute un travailleur pair avec l'accord de la
direction. Dans ses recommandations sur la RDRD dans les CSAPA, la HAS
suggère : « le recours à l'éducation par les pairs et
au soutien entre pairs (groupes d'auto-support, de parole, d'entraide,
pairs-experts...)47». Un tel recrutement est justifié
car le savoir expérientiel du pair-aidant et sa connaissance des codes
de communication propres au public accueilli améliorera certainement la
prise en soin des
47 Haute Autorité de Santé : Recommandation de
bonne pratique, La prévention des addictions et la réduction des
risques et des dommages par les centres de soins d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA), septembre 2019, p35
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 46 -
usagers48. De fait les message de RDRD seront mieux
compris, et cela facilitera l'instauration de la confiance. Il s'agit aussi de
croiser les regards ; l'analyse d'un pair apportera des éléments
que les autres professionnels ne seront pas forcément en mesure de
déceler. C'est donc une possibilité que je compte bien envisager.
Je constate que le turn-over dans l'équipe est important. Aussi lors
d'un prochain départ j'aimerais engager un travailleur pair. Il pourra
travailler à mi-temps sur les appartements thérapeutiques et
à mi-temps sur l'hébergement collectif. En fonction du
salarié qui part (en fonction de son salaire), il est même
envisageable d'embaucher deux personnes pour un total de 1,5 équivalent
temps plein, cela facilitera l'accomplissement de l'objectif
précédent.
J'identifie la ou les bonnes personnes. Le recrutement d'un
ressortissant des pays d'Europe de l'est ayant été soigné
en CSAPA me semble une bonne option. Selon sa formation initiale, et s'il le
souhaite, il faudra alors le faire monter en compétence (diplôme
de médiateur de santé pair, diplôme universitaire en
addictologie, certification en français par exemple). En accord avec la
direction, je me charge du recrutement en m'appuyant sur mes contacts dans le
secteur. J'ajoute que les coûts de formation seront compensés par
le fait que le salaire de ce ou ces salariés sera forcément
moindre que celui d'un éducateur spécialisé, du moins
pendant les premiers temps de sa prise de poste.
Les indicateurs d'évaluation de ces actions
:
1. Le nouveau planning, incluant des astreintes de week-end est
mis en place d'ici 6 mois.
2. Un travailleur pair est recruté d'ici 1 an et demi
(selon les départs des professionnels travaillant dans la structure)
48 Partie inspirée de : Fédération Addiction
: Repère(s, Participation des usagers : de l'implication à la
coopération', septembre 2020
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 47 -
Conclusion
Donner davantage de pouvoir d'agir aux usagers des structures
sociales et médico-sociales est une priorité affichée des
gouvernements qui se sont succédés depuis plus de deux
décennies. C'est aussi la volonté de nombre de cadres et
salariés du secteur.
Cette ambition d'envisager la personne comme
co-élaboratrice de son projet enjoint aux cadres et salariés
d'envisager des changements de pratiques professionnelles au sein des
organisations dans lesquelles ils sont en poste. Dans le secteur du soin en
addictologie, le choix éclairé de la personne accueillie est une
des conditions sine qua non à l'instauration de l'alliance
thérapeutique. Prendre en compte le savoir expérientiel de
l'individu en est une autre.
Comment, en effet, bâtir un projet de soin pertinent et
individualisé, un parcours balisé et efficient sans prendre en
compte le savoir que la personne a accumulé pendant ses années de
dépendance? Quelle qualité auront nos accompagnements futurs, nos
pratiques si nous ne tirons pas d'abord des enseignements du vécu des
usagers eux-mêmes ?
Les professionnels du travail social, de la santé et de
l'encadrement ont une vision forcément partielle des risques pris ou
encourus par les usagers. Leur niveau de compréhension de
l'évolution des pratiques de consommation dépend aussi de ce que
les usagers veulent bien dévoiler. Dans cette structure en particulier,
ils ne sont pas assez dotés d'outils pour appréhender ces
réalités si diverses et en perpétuel changement.
Ce manque d'information, associé à un
étayage insuffisant, empêchent la confiance de s'installer,
l'alliance thérapeutique de s'instaurer avec au final des
conséquences sur l'efficience du parcours de l'usager. Parfois le
séjour se solde même par une sortie sans solution.
J'ai voulu, en tant que RUIS, interroger la
réalité de la participation active de l'usager dans ce CSAPA en
particulier, tant elle conditionne la qualité de la prestation. Ma
participation à l'évaluation interne m'a donné l'occasion
de pointer ces écarts entre les attendus de la Loi, les pratiques du
secteur et de les analyser dans mon diagnostic.
L'organisation actuelle de la structure contribue à la
multiplication des risques pour les acteurs : risques physiques et
psychologiques pour les usagers, risques de perte de sens au travail et d'usure
pour les professionnels. Ces difficultés complexifient le management de
l'équipe et ma capacité à la faire évoluer. L'image
de la structure et de l'association peut à terme être
dégradée avec des conséquences sur les relations
tissées avec les partenaires.
Remédier à ces faiblesses implique la conception
et la mise en oeuvre d'un plan d'action qui s'envisage en fixant des
priorités :
- À court terme, la revue du protocole des phases
d'admission et de pré-admission, la réécriture partielle
du livret d'accueil, l'augmentation des contacts avec les usagers et la mise
à disposition de matériel de consommation à moindre risque
seront les principales mesures.
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 48 -
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 49 -
- À long terme, le recrutement et la formation d'un
travailleur pair, parlant une langue slave si possible sera essentiel.
J'ai élaboré des indicateurs d'atteinte des
objectifs qui permettent d'évaluer les actions entreprises. Ces
résultats seront à la base d'un nouveau plan d'action.
La rédaction de ce mémoire, le travail de
recherche, d'entretiens ont été une aide pour comprendre la place
que j'occupe en tant que Responsable d'Unité d'Intervention Sociale.
J'ai pu me familiariser avec la démarche
d'évaluation interne et prendre une place active dans sa mise en oeuvre
à travers des échanges avec le pôle qualité du
groupe, mesurant par là-même l'impact qu'elle pouvait avoir sur la
qualité du service rendu à l'usager.
J'ai enrichi mes connaissances en RDRD et découvert les
approches du soin en addictologie. Je sais désormais que mon rôle
de cadre est aussi de faire vivre des façons de travailler innovantes
pour qu'elles enrichissent les pratiques professionnelles et suscitent la
motivation constructive de l'équipe.
J'ai pris davantage conscience de l'importance de fournir des
prestations individualisées qui prennent tout son sens pour
l'usager-sujet. J'ai saisi qu'il s'agit là d'un enjeu éthique qui
doit être sans cesse questionné en équipe : «
travailler avec l'usager plutôt que pour lui ».
Une fois les membres de l'équipe engagés dans la
réorganisation de l'action, quand la structure répondra aux
attentes des autorités et au niveau d'exigence attendu par les instances
expertes du secteur, je m'attacherai à réfléchir à
d'autres optimisations de l'instauration et de la pérennité de
l'alliance thérapeutique.
Pour le service des appartements thérapeutiques, je
compte réfléchir à l'accueil avec alcool dans la
structure. Le sevrage étant un préalable à l'admission,
cela constitue un barrage pour des usagers qui auraient d'autres
priorités de soin et ne désireraient pas cesser totalement leur
consommation d'alcool. Ainsi que je l'ai écrit dans le plan d'action, ce
travail de mémoire me donne envie de d'approfondir mes recherches autour
des approches novatrices d'accompagnement des personnes dépendantes aux
substances psychotropes. Enfin, je veux questionner et faire évoluer le
modèle d'hébergement collectif. Cette organisation
présente plusieurs inconvénients. La vie en commun peut amener
à des situations de conflits entre usagers voire entre salariés,
surtout dans le contexte actuel de la pandémie. La communauté ne
prépare pas à l'autonomie et n'assure pas la mission de
réinsertion sociale des CSAPA. L'insertion par le logement me
paraît une option intéressante à étudier à
travers la découverte d'expériences déjà en cours
sur le territoire.
J'envisage de porter ces débats lorsque ma
stratégie de réduction des risques dans les appartements
thérapeutiques fera sens commun et aura montré son
efficacité.
Bibliographie
Textes juridiques :
· Loi n°70-1320 du 31 décembre 1970 relative
aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la
répression du trafic et de l'usage illicite des substances
vénéneuses
· Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 novant l'action
sociale et médico-sociale
· Loi no 2004-806 du 9 août 2004, dite loi
santé
· Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé
· Décret n°87-328 du 13 mai 1987 portant
suspension des dispositions du décret n° 72-200 du 13 mars 1972
réglementant le commerce et l'importation des seringues et des aiguilles
destinées aux injections parentérales en vue de lutter contre
l'extension de la toxicomanie
· Décret n°95-255 du 7 mars 1995 modifiant le
décret n° 72-200 du 13 mars 1972 réglementant le commerce et
l'importation des seringues et des aiguilles destinées aux injections
parentérales en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanie
· Décret no 2007-877 du 14 mai 2007
· Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017
relatif au projet territorial de santé mentale
· Circulaire DGS:SP3 n° 4 du 11 janvier 1995
· Circulaire DIV/DPT-LSSP/MILDT n° 2001-14 du 9
janvier 2001 relative à la politique de la ville et à la
politique de lutte contre la drogue et de prévention des
dépendances
· Circulaire N°DGS/SD 6B no 2006-119 du 10 mars
2006
· Circulaire N°DGS/M/2008/79 du 28 février
2008
Livres :
· Alain Morel, Pierre Chappard, Jean-Pierre
Couteron, L'Aide-mémoire de la réduction des risques en
addictologie, Paris : Dunod, 2012, 345 p
· Alain Morel, Jean-Pierre Couteron,
L'Aide-mémoire de la réduction des risques en
addictologie, Paris : Dunod, 2019, 702 p
· Anne Coppel, Peut-on civiliser les drogues? de la
guerre à la drogue à la réduction des risques, La
découverte, Alternatives sociales, 2002, 384p
· Histoire & Principes de la
réduction des risques, entre santé publique et changement
social, Issoudun, Médecins du Monde, AFD, juin 2013, 133
p
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 50 -
Revues :
· Dassieu Lise, « Les seuils de la
substitution : regard sociologique sur l'accès aux traitements
de substitution aux opiacés », Psychotropes, 2013/3-4
(Vol. 19), p. 149-172, 2013
https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2013-3-page-149.html
Ressources Internet :
· ANESM (Aujourd'hui la HAS):
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, les attentes de la
personne et le projet personnalisé, décembre 2008
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/reco_projet.pdf
· ANESM (Aujourd'hui la HAS):
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, La bientraitance,
définitions et repères pour la mise en oeuvre , juin 2008
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/reco_bientraitance.pdf
· CAIRN : Fortini,C.&
Daeppen,J.(2011).L'entretien motivationnel : développements
récents. Psychothérapies, 3(3), 159-165.
https://doi.org/10.3917/psys.113.0159
· CAIRN : Roux, P., Debrus, M., Rojas
Castro, (2017). De la recherche communautaire à la transformation
sociale : l'exemple du projet ANRS-AERLI sur l'accompagnement et
l'éducation aux risques liés à l'injection.
Psychotropes, 2(2), p 57
https://doi.org/10.3917/psyt.232.0057
· CAIRN : Aubin, H. (2004). De l'approche
par produit au concept d'addiction. Revue Projet, 5(5), p 85
https://doi.org/10.3917/pro.282.0085
· CAIRN : Rivoirard, A. (2012). Soins et
dépendance: Dans les centres postcure en
alcoologie. Le sociographe, 3(3), p 37
https://doi.org/10.3917/graph.039.0037
· CAIRN : Boumendjel, May, et Amine
Benyamina. « 15. Les « pathologies duelles » en addictologie :
état des lieux et prise en charge », Michel Reynaud éd.,
Traité d'addictologie. Lavoisier, 2016, pp. 139-149.
https://www.cairn.info/traite-d-addictologie--9782257206503-page-139.htm
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 51 -
· CAIRN : Bachelart, M. (2012). 26.
L'alliance thérapeutique. Dans : Antoine Bioy éd.,
L'Aide-mémoire de psychologie médicale et de psychologie du
soin: En 58 notions (pp. 161-168). Paris: Dunod.
https://www.cairn.info/l-aide-memoire-de-psychologie-medicale--9782100570157-page
161.htm
· CAIRN : Lambrette, Grégory.
« Entre addiction et abstinence une recherche d'alternatives ou la
co-construction d'un problème accessible à une solution. Une
application de la thérapie stratégique »,
Thérapie Familiale, vol. 31, no. 1, 2010, pp. 49-64.
https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2010-1-page-49.htm
· Fédération Addiction :
Agir en réduction des risques, en CSAPA et en CAARUD,
décembre 2015
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2016/01/Agir-en-reduction-des-risques-1.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2016/01/Questionnaire-CSAPA-RDR.pdf
· Fédération Addiction : Loi
de santé et réduction des risques et des dommages (RdRD)
Où en est-on depuis l'adoption de la loi de santé en 2016 ?
Synthèse de la Journée des Adhérents du vendredi 16 mars
2018
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2018/10/synthese-JA-BAT.pdf
· Fédération Addiction :
Délégation Interministérielle à
l'Hébergement et à l'Accès au Logement (DIHAL) :
L'accompagnement de personnes présentant des problématiques
d'addiction ou des troubles de santé mentale dans le cadre de la
pandémie COVID 19, recommandations et retour d'expérience, avril
2020
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2020/04/FICHE-RECOMMANDATIONS-ADDICTIONS-SANTE-MENTALE_Covid-19-080420201.pdf
· Fédération Addiction :
Repère(s, Participation des usagers : de l'implication à
la coopération', septembre 2020
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2020/09/Guide-reperes-usagers-fedeaddiction.pdf
Fédération Addiction : Acte du
colloque : L'accueil inconditionnel au défi des consommations,
Synthèse & perspectives, Atelier : Héberger ou consommer,
octobre 2017
https://fr.calameo.com/read/005544858d510c49e8a56
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 52 -
·
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 53 -
Haute Autorité de Santé (HAS):
Recommandation de bonne pratique, La prévention des addictions et la
réduction des risques et des dommages par les centres de soins
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), septembre
2019
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-01/
la_prevention_des_addictions_et_la_reduction_des_risques_et_des_dommages_par_les_cs
apa-_recommandations.pdf
· HAS : Grande précarité et
troubles psychiques - Note de cadrage, septembre 2021
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/
note_cadrage_has_precarite_troubles_psychiques.pdf
· Mission Interministérielle de Lutte contre
les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA) : L'essentiel sur
... la réduction des risques et des dommages : une politique entre
humanisme, sciences et pragmatisme, septembre 2020
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier-essentiel_sur_rdrdr_2020-09.pdf
· MILDECA : Lexique : seuil
https://www.drogues.gouv.fr/comprendre/lexique/seuil
· Observatoire français des drogues et des
toxicomanies (OFDT) : Christophe Palle, Malisa Rattanatray, Les
centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie en
2016, octobre 2018
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcpya.pdf
· OFDT : Cristina Díaz
Gómez, Les CAARUD en 2018 analyse des rapports d'activité annuels
standardisés(ASA-CAARUD)
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/RA-ASA-CAARUD-2018.pdf
· OFDT : Julien Morel d'Arleux, Drogues,
Chiffres clés - 8e édition, juin 2019, 8 p
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/drogues-chiffres-cles/drogues-chiffres-cles-8eme-edition-2019/
· OFDT : Christophe Palle, Bilan RECAP
2019, Évolution des caractéristiques des personnes prises en
charge dans les CSAPA 2007-2019, novembre 2020
· Persée : Ehrenberg Alain.
Comment vivre avec les drogues ? Questions de recherche et enjeux politiques.
In: Communications, 62, 1996. Vivre avec les drogues. pp. 5-26;
https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1996_num_62_1_1932
· Revue médicale suisse : Fabio
Rollo, Loic Menneret, Réflexions sur les soins en addictologie, juin
2018
https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2018/revue-medicale-suisse-610/reflexions-sur-les-soins-en-addictologie
· UNAPEI : UNAPEI, Nous Aussi,
L'information pour tous, Règles européennes pour une information
facile à lire et à comprendre, 2009
file:///C:/Users/33783/Desktop/Base/L'information-pour-tous-Règles-européennes-pour-une-information-facile-à-lire-et-à-comprendre.pdf
· Vie publique : Déclarations de
Mme Simone Veil, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville, sur les réflexions à mener et les mesures prises en
matière de lutte contre la toxicomanie, Paris les 9 mars et 5 mai 1994.
Installation de la commission de réflexion sur la lutte contre la drogue
et la toxicomanie, à Paris le 9 mars 1994. Colloque international sur
les drogues illicites
https://www.vie-publique.fr/discours/205685-declarations-de-mme-simone-veil-ministre-des-affaires-sociales-de-la-s
Documents institutionnels :
· Comptes-rendus des réunions d'équipe
· Comptes-rendus des réunions du CVS
· Contrat de séjour Appartements
thérapeutiques
· DIPC hébergement collectif
· DUERP, 2019
· Évaluation interne 2021
· Livret d'accueil Appartements thérapeutiques
· Livret d'accueil hébergement collectif
· Projet d'établissement 2018 / 2023
· Projet personnel Appartements thérapeutiques
· Projet personnel hébergement collectif
· Protocoles et procédures divers
· Plan de Reprise de l'activité 3, 2018
· Rapport d'activité 2019
· Rapport d'audit interne 2018
Autres ressources :
· Gautré, D. (2013) Une expérience de
responsable d'unité d'intervention sociale en CAARUD (Mémoire de
CAFERUIS non publié -IFOCAS)
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 - 54 -
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 I
Liste des annexes
Annexe 1 : Extrait de la circulaire N°DGS/M/2008/79 du 28
février 2008 II
Annexe 2 : Le questionnaire III
Annexe 3 : Extrait du livret d'accueil, le règlement de
fonctionnement V
VI
Annexe 4 : Fédération Addiction : Matériel
de RDR distribué en CSAPA, décembre 2015, p 48
Annexe 5: Extraits d'entretien avec un directeur de CSAPA
résidentiel VII
Annexe 6 : Tableau de suivi des actions avec
échéances et responsables d'action VIII
Annexe 7 : Calendrier des actions envisagées X
Annexe 8 : Extrait du livret d'accueil : « Nos
engagements » XII
Annexe 9 : Devis pour une formation à la
rédaction en FALC XIII
Annexe 10 : 3 exemples de formations proposées par la
Fédération Addiction XIV
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 II
Annexes
Annexe 1 : Extrait de la circulaire N°DGS/M/2008/79
du 28 février 2008
Cette circulaire, relative à la mise en place des
centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et
à la mise en place des schémas régionaux
médico-sociaux d'addictologie énonce les missions obligatoires
des CSAPA
2. Réduction des risques Tous les CSAPA, qu'ils soient
spécialisés ou non, ont l'obligation de mettre en oeuvre des
mesures de réduction des risques à destination du public qu'ils
prennent en charge. Ainsi, la réduction des risques concerne les usagers
de drogues illicites et les personnes en difficulté avec leur
consommation d'alcool. Cependant les modalités de réduction des
risques pour les personnes en difficulté avec l'alcool seront
précisées ultérieurement sur la base d'une expertise
scientifique au niveau national. La réduction des risques s'adresse aux
personnes qui, du fait de leur addiction, peuvent avoir des comportements
à risques. Ces risques sont liés aux produits eux-mêmes,
aux modes d'usage, aux circonstances de consommations. La mission de
réduction des risques des CSAPA a pour but non seulement de limiter les
risques sanitaires et sociaux liés à l'usage de substances
psychoactives, mais aussi de contribuer au processus de soin, au maintien et
à la restauration du lien social. Les activités de
réduction des risques doivent ainsi s'articuler avec les autres missions
développées dans les CSAPA. Les modalités de mise en
oeuvre des actions de réduction des risques devront être
précisées dans le projet thérapeutique du CSAPA. Un effort
tout particulier devra être consenti aux actions visant à
réduire les contaminations par les virus hépatotropes. Toute
personne prise en charge par un CSAPA doit pouvoir bénéficier de
séances d'informations collectives et/ou, de conseils
personnalisés d'éducation à la santé
(hygiène, prévention des risques infectieux, overdose...). Elle
est accompagnée tout au long de son parcours pour élaborer et
mettre en oeuvre sa propre stratégie de réduction des risques.
Avec son accord, l'usager sera orienté et/ou accompagné pour des
examens complémentaires, vers des consultations
spécialisées en concertation avec le médecin
généraliste. Conformément au décret du 14 avril
2005 approuvant le référentiel national des actions de
réduction des risques en direction des usagers de drogue et
complétant le code de la santé publique, les CSAPA doivent mettre
à disposition de leurs usagers des outils de réduction des
risques.
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 III
Annexe 2 : Le questionnaire :
La réduction des risques et des
dommages en CSAPA
ambulatoire et en
appartement thérapeutique
4 Profil de la personne interrogée :
1. Quelle est votre profession ? Personnel d'encadrement
Travailleur /Travailleuse social
IDE
2. Depuis quand travaillez-vous en CSAPA ?
|
Médecin addictologue Autre
|
4 Le CSAPA dans lequel vous travaillez :
3. Au sein de quel type de CSAPA travaillez-:vous ?
Ambulatoire
Ambulatoire avec des structures résidentielles
éclatées Autre
4. Quelle est l'origine de votre CSAPA ?
Auto-support Hospitalier Associatif Autre
4 La RDRD dans votre CSAPA :
5. La RDRD figure-t-elle au projet d'établissement ?
Oui Non
6. Avez-vous noué des partenariats autour de la RDRD ou
participez-vous aux actions de RDRD portées par des partenaires ? Si oui
avec qui et quelles en sont les finalités ?
7. Travaillez-vous avec ?
Des usagers bénévoles Des travailleurs pairs
8. Y a-t-il un professionnel dédié à la
réduction des risques (distribution de matériel, accompagnement,
communication...) ?
Oui Non
Si oui quelle est sa profession ?
9. Des professionnels travaillant dans votre CSAPA ont-ils
été formés à la RDRD ?
Oui Non
10. Menez-vous des actions de prévention de l'overdose
?
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 IV
Oui Non
11. Quelles formes d'accompagnements à la RDRD
proposez-vous ?
Informations sur les produits et les mélanges
Dépistages
Activité de prévention de la rechute
Analyse de produits
Consultation d'accompagnement pratique à la RDRD (ex
AERLI)
Groupe de parole sur les produits et les pratiques
Formation à l'utilisation de matériel de
consommation à moindre risque
Autre
12. Distribuez-vous du matériel de consommation à
moindre risque ?
Oui Non
13. Informez-vous les usagers sur les lieux de délivrance
de matériel ?
Oui Non
14. Les usagers sont-ils informés des dangers des
mélanges de produits, des mésusages et détournements des
traitements ?
Oui Non
15. Les usagers sont-ils informés qu'ils n'ont pas
d'obligation de sevrage vis-à-vis de l'établissement ?
Oui Non
Commentaires
16. Comment est abordée la question de la gestion, de la
sécurisation des consommations ?
17. Acceptez-vous en entretien des usagers manifestement sous
influence de produit ?
Oui Non
Commentaires
18. La consommation d'alcool est-elle permise au sein de votre
structure ?
Oui Non
lors des entretiens ?
Oui Non
19. Menez-vous des actions hors les murs (aller vers) ?
Oui Non
20. Organisez-vous la récupération du
matériel usagé ?
Oui Non
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 V
Annexe 3 : Extrait du livret d'accueil : le
règlement de fonctionnement
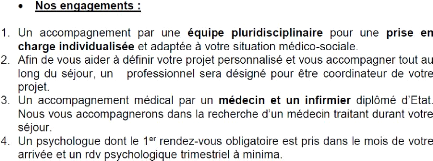
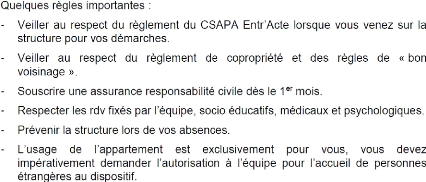
Annexe 4 : Fédération Addiction :
Matériel de RDR distribué en CSAPA, décembre 2015, p
48
Qat
Fiche 5
Le matériel de réduction des
risques
Quel roatér#el est tielik'ré en CSAPA?
Non ex.
Ùui9L%
l7iNlribu4i4on Jr re.Iérielde Y.DR{Grd.plliqui
$.
r... r1.111.aravlln. PnsrNrilr. I., InLu
Nor
IIJ dlnk1l.41
rL InI r.,nl.
OmWnlo- rdnq.i.l..0
tkr ~,Irnri r~.r..
limier.. I nn
9ar.m
Rlr.ra.ii,ll,~
hngxn. dn.16.11.
C.0 PPI
L i,1rul. Wilar d.
·hauh'u
u th, dlIuk.
Zan p.. erd malIma.1
AMIN 462.6 Mlia%
ihax
9 ihax
aA1`
41rw. «vlriunu,.
JN xu
rPnrtil
1l4rinun a W w
nf.nMru ~a*
1444r1.1 d1nM#114. '1116.
d'nIxnw+rrn
·
·
·1
Les CSAPA ont quasiment tous des kits
ti-iujectioll mais leurs positionnements sont divers autour de la
délivrance dans un marne lieu de Initériel de RDR et de MSO.
Cet enjeu parait être rl double sens :
Des intemenentsr notamment des médecins
délivrant des traitements de substitution, interrogent une
«injonction paraddxalb r entre aide à. ]e diminution et ii la
substitution et abord d'une pratique d'usage dans un ii rne lieu :
«IZs ajoutent pour se
fair', saigner, leur objectif narmalertioit
il est la »_ «,!e délivre un traitement de
subsfifutkon je ne peux rias faine lest- !Iy aurait sinon
une injonction paradoxale, voire incitative_ On se limite à
«faites affenirr~rY, utilifiez dae seringues propres»
pour mir qui recnrtcommerlt »-
Les solkitiona Si iq clone diverses :
prciposilirin du malérie] fin entretien, dés ]'accueil, pur un
intervenant tiers-
« MJlrrie si on a
une mission RER. ça nou s
Jcentsiait tres cumpri[iué et an se
sentait tut peu sehizopilrllri üaJ
depart t de dnnner d4,m rbté le
flacon de ISO et ia
rirxj
·au
· !ow de
iuirJ `rl - Donc te qu'orteil
test qui.
si la permrtne est en soin Mea nou_a, et qI me demande du
rrtalérfeI --- !e rte M reçrr s que dart_s
le alfirc de ta rchlUCtion d $
risques (,1 Les patirents b'ntiuia'
·Jr w de. mander
d 17nfirmiire, maintenant i~. Ki.rbent d qui
Kudr'e2rser, >,
Les n 4,iljl
·rrN
L`J7j
·11~
·1's {Ikl lls BIS /ravaa i i l'l'
l'S ]'; I I }St i [IrnL
·j
Lu YY{d111'tii petl Y'Ilt k'xpriuIer
une _ 1 I l hrise cm une i'nl.` -4-Vis de
la iiréti+L"na'J.' ll
[uatlr'ril'] e Il.' Cr
hpk;alkxlltil#IIMnri tin spin {hi (SAPA-,
IIw [Y' iLlruü Ill'O Cl'
Lucal]{`]hl hillt d' pp4R
J110 I LE`r i{'I, 17111i i ['[1111[17l' 1i1.11 IV [Ii IlY
i CYIJ I ii h(Y
oil ti`airret drk iuuw, l'uuulll' {'u ~i'nusij;i
eralit
I Ll h (I I1aI1lIhM1 du madùriel L'n
CSAPA domnI Itx
SUI r-- e P1,4 rfi wl1reLr Cfitlipliquli
pr r lesl1vr i 1Jt ri
de prendre dil ild tad a ikrt
k!ii i.
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire
CAFERUIS -- session 2022
VI
F1.11.1.1.44. 1441rI,I prnlr rwrwr4414w
·=4
FOI
|
I1 rwcN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 10 YO
11t01ErIcI d-Wt.1hu 6. {imjihwlur ;l+y
|
li. Ki
|
{p i4 711. li4 40 460
|
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 VII
Annexe 5 : Extraits d'entretien avec un directeur de
CSAPA résidentiel
« De manière concrète, il n'y a pas
beaucoup de CSAPA qui mènent une politique de RDR digne de ce nom sauf
qu'en fait, ils ne le disent pas ! »
Rechute et risque :
« Pour nous c'est une évidence que pour des gens
qui sont dans l'abstinence ou dans une baisse conséquente de
consommation, la tolérance n'est plus la même au produit et donc
le risque est quasiment là le plus important. Donc si on ne permet pas
l'accès au matériel et d'avoir une discussion sur la RDR, c'est
qu'on a pas compris le phénomène de l'addiction. »
Parcours d'une usagère :
« Elle est allée au-delà de ce qu'elle
pensait. Elle est venue dans une structure avec un souhait d'abstinence qui
n'était pas forcément si évident que ça pour
elle-même. Moi je pense qu'elle a réussi à clarifier son
positionnement et à trouver quelque chose de satisfaisant pour elle dans
quelque chose de ponctuel, de plaisir et beaucoup plus maîtrisé.
En d'autres temps elle aurait été virée au bout de trois
mois.
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS --
session 2022
VIII
Annexe 6 : Tableau de suivi des actions avec
échéances et responsables d'action
a
|
Objectif intermédiaire 1 : Proposer
une-Offre-de soin respectueuse des droits des usagers
|
3.1.A Améliorer les procédures de
pré-admission et d'admission en axant ces étapes sur la
co-construction
|
Nouvelle action
|
|
La réunion partenaire est effective
2 réunions de repérage des attentes et besoins ont
lieu pour 100 % des usagers
Les grilles de recueil des attentes et objectifs sont remplies
et
utilisées
formation complète
|
|
|
|
|
|
:0-.
·
~
|
|
|
|
|
|
Évaluation I Indicateurs
|
Le brainstorming sur la réécriture les parties
du règlement de fonctionnement et du contrat de séjour est
effectué lors de la prochaine réunion d'équipe. Ces
paragraphes sont rédigés le
lendemain, validés par la direction sous une semaine
(si possible). Les documents sont actualisés et utilisés lors de
la
prochaine admission.
|
Un des éducateurs a validé les deux jours de
formation de
rédaction en FALC sous 3 mois. Le contrat de
séjour est
rédigé en FALC avec la participation d'un usager et
validé par
la direction sous 6 mois.
|
Le contrat de séjour est traduit en tchèque et
géorgien d'ici 1
ans. Le document est traduit dans les autres langues
d'ici 1
ans et demi.
|
|
Échéances
|
immédiat
|
cv
|
an
E
|
cn
E
|
3.1.B. Rendre systématique une in
|
immédiat
|
immédiat
|
ul
a .60
,Q E
c'S
|
1 an puis 1 an et demi
|
|
personnes
référentes
|
cadre
|
éducateur x,
infirmier,
cadre
|
éducateur Y,
infirmier,
psychiatre,
cadre
|
éducateurs X et Y
|
équipe,
direction,
cadre
|
cadre
|
éducateur Z
|
Direction,
cadre
|
|
Actions envisagées
|
t L'admission et la première synthèse mensuelle
sont réalisées en
présence d'un des éducateurs
référents ainsi qu'en présence du cadre.
Le contrat de
séjour et le PP sont rédigés et lus en présence
de
l'usager le contrat de séjour est lu avec l'usager.
|
2 Repérer les partenaires et organiser une
réunion annuelle afin de
présenter le structure,
améliorer les oemandes d'admissions et
partager nos analyse des
situations
|
3A Organiser le phase de pré-admission avec un contact
entre
l'usager et le travailleur social référent, un autre
rendez-vous avec
l'infirmier si possible en présence d'un membre du
service orienteur.
|
3.B. Créer deux grilles précises de recueil des
attentes et objectifs de l'usager, l'une relative à la santé et
l'autre à l'insertion I la réinsertion
sociale
|
1. Avant le prochaine acinission rédiger
personnellement un point manquant au règlement de fonctionnement :
l'absence d'obligation d'abstinence. (lors de la prochaine réunion
d'équipe, brainstorming de 20 minutes)
|
2. Avant la prochaine admission rédiger personnellement e
Nos
engagements » du contrat de séjour. (lors de la
prochaine réunion
d'Prniine hrainctnrminn dP 7n mini ripç]
|
3. Former un des éducateurs des appartements
thérapeutiques à la
rédaction en FALC
|
4. Faire traduire le contrat de séjour,
rédigé en FALC en anglais,
espagnol, géorgien, russe et
tchèque. Le géorgien et le tchèque sont
les traductions
à réaliser en premier.
|
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS --
session 2022
IX
Nouvelle
|
action
|
3.1_C_ Prendre en compte la complexité des situations de
l'individu I
|
|
|
|
|
3.1_D. Augmenter la fréquence des entrevues entre les
professionnels et les usagers_ Proposer des activités visant à
lutter contre le sentiment de vide laissé par l'arrêt des
consommations
|
|
|
Objectif intermédiaire 2 : Accompagner les changements
dans le fonctionnement de la structure et des pratiques professionnelles pour
permettre la mise en place d'une réelle
implémentation de la
Réduction des Risques et des Dommages
|
3.2.& Former et sensibiliser les professionnels à la
Réduction des Risques et des Dommages I
C
|
|
|
iel de Réduction des Risques et des Dommages avec
plusieurs modalités I
|
|
|
|
32_C_ Envisager des changements dans l'utilisation des moyens
physiques et financiers ainsi que dans l'organisation de la structure I
|
|
|
|
u-Ô
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions envisagées I personnes Échéances I
Évaluation 1 Indicateurs
référentes
|
Les comptes rendus sur l'évolution des publics ont lieu
une
fois par mois lors de réunions d'équipe_ Ils sont
compilés dans
un fichier informatique et accessibles à
tous.
|
Les comptes rendus sur les approches innovantes ont lieu
une
fois par mois lors de réunions d'équipe_ Ils sont
compilés dans
un fichier informatique et accessibles à tous
|
L'intervention du chef du département addictologie du CHU
a lieu sous 6 mois.
|
La synthèse sur les modes d'accompagnement innovants est
réalisée d'ici un an.
|
La visite hebdomadaire est effective pour 100 % des usagers.
|
100 % des usagers pratique une activité de loisir.
|
La totalité de l'équipe est formée à
l'entretien motivationnel à l'échéance N+1_
|
Des professionnels d'un CAARUD de la région sont
présents à deux réunions d'équipe dans
l'année.
|
Le matériel est disponible, y compris de manière
discrète, à un mois dans une armoire du centre.
|
La trousse de secours est présente dans tous
les
appartements. Elle contient aussi de la naloxone et
du
matériel de consommation à moindre risque du
matériel de
consommation à moindre risque Un après-midi
de formation a
eu lieu pour expliquer l'utilisation de la Naloxone, dans les
2
mois à venir
|
Différentes autres modalités de mise à
disposition sont mise en oeuvre, sous 6 mois
|
Le nouveau planning, incluant des astreintes de week-end est mis
en place d'ici 6 mois.
|
Un travailleur pair est recruté d'ici 1 an et demi
|
|
r r
N co
'5 ,,'5 E
r
|
N c
,,E
E r-
|
O
co
|
co
r
|
2 semaines
|
N
N
E ÿ cy
|
|
r
|
p
E
--
|
t6
m N r
|
6 mois
|
O
E
co
|
E
-co
o
m
r
|
|
co --
~
E .~
|
éducateur B (collectif)
it~
|
cadre
|
N
m
|
éducateurs , cadre
|
cadre
|
Direction,
équipe, cadre
|
Cadre,
partenaires du CAARUD
|
2 éducateurs, infirmier,
psychologue, cadre, 2
usagers
|
2
U
|
cadre
|
Direction,
équipe, CSE,
cadre
|
C
O N
mcu d
|
|
t Réaliser une synthèse sur l'évolution
des publics dans la région et en France_ Contacter les autres CSAPA
ambulatoires et avec hébergements de la région sur cette
méme problématique.
|
2 Repérer les acteurs du secteur de l'addictologie, mais
aussi de
l'hébergement, du logement et de l'emploi qui ont des
approches
innovantes (sur toute la France)
|
3. Inviter le chef du département addictologie du CHU
du département pair une intervention sur la typologie des publics
et leurs évolutions
|
4. Rédger une synthèse sur les modes
d'accompagnement innovants à destination de la direction et une
présentation à l'équipe dans un an.
|
1. rencontrer une fois par semaine chaque usager, si possible
dans son logement.
|
2 Convier les usagers aux activités proposées aux
usagers du collectif
|
t Former l'ensemble du personnel accompagnant à la
conduite
d'entretien avec des personnes consommatrices, une technique
étant l'entretien motivationnel
|
2. Réaliser une veille sir les nouveaux produits, modes
de
consommations et outils de RDRD
|
3.2_B_ Mettre à disposition du mater
|
1.A. Ivlettre en place un groupe de travail pour
réfléchir aux modalités d'accès au matériel
de RDRD
|
1.B. Installer dune trousse de secours et de RDRD dans les
appartements contenant en plus du matériel classique de
premier
secours, de la Naloxone
|
1.C. Identifier plusieurs possibilités de mise à
disposition de matériel de RDRD R les rendre effectifs
|
1_ Mettre en place un nouveau planning avec astreintes de
l'égi ipe
éducative les week-end
|
2 Recruter un travailleur pair
|
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS --
session 2022
X
Annexe 7 : Calendrier des actions envisagées
|
Objectif général:
Permettre à l'usager de CSAPAd'être acteur de son
projet de, soin
|
Objectif intermédiaire 1 : Proposer une offre de soin
respectueuse des droits des usagers
|
3.1.A Améliorer les procédures de
pré-admission et d'admission en axant ces étapes sur
la co-construction
|
N N
|
|
|
|
|
formation complète
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l'individu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01-07-23 f31-
12-23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N '1.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N N
o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N N
cn o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N W
|
|
|
N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
oN
Rl r
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
N
co
|
|
|
|
|
|
|
|
|
les situations de
|
|
|
|
|
|
N N
knry
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o
N N
|
|
|
|
|
3.1.B. Rendre systématique une in
|
|
|
|
|
3.1.C. Prendre en compte la complexité
|
|
|
|
|
|
o
N N
N
No
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NN N
ô
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
'01-01-22 15-
0122
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
person nes
référentes
|
e
i
|
éducateurs, infirmier, cadre
|
--X` b5 L V.
tl-- N~
~
c '--J-1
|
n
N `
c
|
équipe,
direction.
cadre
|
[ü
v
[a.
|
éducateur.7
|
Direction.
cadre
|
éducateur A (collectif)
|
m Juei
|
.
as
|
1
C
|
|
N y
Q] Edcd N
â1
N G
O
|
t [admission et la première synthèse mensuelle
sont réalisées en
présence d'un des éducateurs
référents ainsi qu'en présence du
cadre. Le contrat de
séjour et le PP sont rédigés et lus en
présence
de l'usager. le contrat de séjour est lu avec l'usager.
|
2. Repérer les partenaires et organiser une
réunion annuelle afin de
présenter la structura
améliorer les demandes d'admissions et
partager nos analyse des
situations.
|
3.A. Organiser la phase de pré-admission avec un
contact entre l'usager et le travailleur social référent, un
autre rendez-vous avec l'infirmier si possible en présence d'un membre
du service orienteur
|
3.B. Créer deux grilles précises de recueil des
attentes et objectifs
de l'usager, l'une relative à la santé
et l'autre à l'insertion / la
réinsertion sociale
|
t Avant la prochaine admission rédiger personnellement un
point manquant au règlement de fonctionnement : l'absence d'obligation
d'abstinence. (lors de la prochaine réunion d'équipe.
brainstorming de 20 minutes)
|
2. Avant la prochaine admission rédiger personnellement
a Nos
engagements e du contrat de séjour. (lors de la prochaine
réunion
d'équipe. brainstorming de 20 minutes)
|
3. Former un des éducateurs des appartements
thérapeutiques à la rédaction en FALC
|
4. Faire traduire le contrat de séjour,
rédigé en FALC en anglais, espagnol, géorgien, russe et
tchèque. Le géorgien et le tchèque
sont les traductions à réaliser en
.premier.
|
1. Réaliser une synthèse sur l'évolution
des publics dans la région et en France. Contacter les autres CSAPA
ambulatoires et avec hébergements de la répon sur cette
méme problématique.
|
2. Repérer les acteurs du secteur de l'addlctologie, mais
aussi de
l'hébergement, du logement et de l'emploi qui sri des
approches
innovantes (sur toute la France)
|
3. Inviter le chef du département addictologie du CHU
du
département pour une intervention sur la typologie des publics
et
leurs évolutions
|
4. Rédiger une synthèse sur les modes
d'accompagnement
innovants à destination de la direction et une
présentation à
l'équipe dans un an.
|
XI
~~
|
0
|
3.1.D. Augmenter la fréquence des entrevues entre les
professionnels et les usagers. Proposer des activités visant â
lutter contre le sentiment de vide laissé par l'arrêt des
consommations
|
|
|
T Objectif intermédiaire 2 : Accompagner les
changements dans le fonctionnement de la structure et des pratiques
professionnelles pour permettre la mise en place d'une réelle
implémentation de la Réduction des Risques et des
Dommages
|
d) U]
E
E c.
0
40 d) `b
|
|
|
Risques et des Dommages avec_plusieurs modalités
I '.
|
|
|
|
|
|
3.2.G. Envisager des changements dans l'utilisation des moyens
physiques et financiers ainsi que dans l'organisation de la structure
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
oQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
..--
o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QAls
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r
|
|
|
ry
N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
|
|
|
|
|
F
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
|
|
|
|
s
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a
|
|
i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.A- Former et sensibiliser les professionnels â la
Réduction des Risques ei
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s
|
|
f
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r
|
|
|
|
|
|
|
|
~
|
|
|
|
|
|
|
3.2.B. Matre â disposai du matériel de
Réduction des
|
|
|
|
|
+
|
F
|
|
|
5:1ee
ôen
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
·
|
|
|
N [V N e-V
..-- 6
o
M en
C
C d]
C
b
o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/1
|
|
|
|
|
N
,CL/
|
Cadre,
partenaires du CAARUD
|
en
N
|
N
|
|
|
F 1
|
Direction,
équipe, CSE,
cadre
|
|
|
1. rencontrer une fois par semaine chaque usager, si possible
dans son logement.
|
2. Convier les usagers aux activités proposées aux
usagers du
collectif
|
1. Former l'ensemble du personnel accompagnant à la
conduite
d'entretien avec des personnes consommatrices, une
technique
étant l'entretien motivationnel
|
2. Réaliser une veille sur les nouveaux produits, modes
de
consommations et outils de RDRD
|
1.A. Mettre en place un groupe de travail pour
réfléchir aux
modalités d'accès au
matériel de RDRD
|
1.B. Installer d'une trousse de secours et de RDRD dans les
appartements contenant en plus du matériel classique de
premier secours, de la Naloxone
|
1.C. Identifier plusieurs possibilités de mise à
disposition de
matériel de RDRD et les rendre effectifs
|
1. Mettre en place un nouveau planning avec astreintes de
l'équipe éducative les week-end
|
2. Recruter un travailleur pair
|
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS --
session 2022
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 XII
Annexe 8 : Extrait du livret d'accueil : « Nos
engagements »
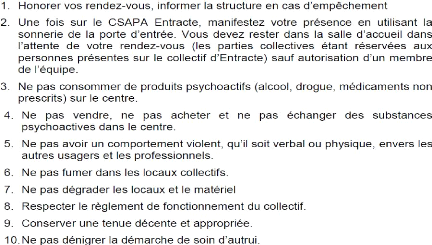
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS --
session 2022 XIII
Annexe 9 : Devis pour une formation à la
rédaction en FALC
NIRef devis 602 du 19/11/2021
Formation FALC interentreprise
Cdts règlement : Comptant Limite de validité :
18/01/22

Réf. article
Désignadon
ate
PUNT
%TVA
HT
1.00 490.00 20.00 490.00
F_FALC_INTE Formation FALC inter entreprise - initiation en
e-teaming tutor R
|
Total E HT
|
490.00
|
|
Total TVA
|
98.00
|
|
Total C TTC
|
580.00
|
Merci de wire confiance.
Hon pour accord le
Norn, gualitt et segnature ou cacher du client
Dates de formation
|
initiation
|
|
|
Début
|
Fin
|
|
19/01/2022
|
09/02/2022
|
|
16/02/2022
|
09/03/2022
|
|
16/03/2022
|
06/04/2022
|
Rédiger et publier
en Facile à Lire et â Comprendre
(FALC)
Le Facile a Lire et â Comprendre i(FALC) est
une transcription
d'un Langage classique en Largage compréhensible par
tous.
Le FALC a d'abord été cri par les
personnes en situation de handicap
mental Pourtant un public bien plus large est concerné.
Cette formation est basée sur les x
Régler Européennes
pour une information facile â Lire et â comprendre
· d'I ncLuslon Europe_
Dans un souci d'aceessihilite universelle, nous y
intégrons
Les fondamentaux pour une publication
numériquement accessibLe.
... Objectifs de La formation
Définir l'information accessible et identifier ses
origines du FALC + Reconnaître Les enjeux du Facile A
Lire et è Comprendre Identifier les
difficultés Face A l'Information
+ Repérer les grands principes du FALC
Appliquer une méthode pour construire son information
+
AppLiquer les réglas européennes pour créer,
transcrire et relire en FALC
+ Appliquer Les règles de mise en page
papier
Sens) lai li ser la publication numériquement
accessible
NOUVEAU
relearning tutoré
+ Tester auprès du publie cible
... Programme - PrsentieI ou
Cycle 1 - Initiation
+ :accessibilité h l'information
aujourd'hui
+ Les enjeux du langage Facile 3 Lire et b
Comprendre
+ Les difficultés face é
l'Information et Les grands pr Incipes du FALC
+ Le Facile h Lire et 8
Comprendre : une met/vade et des ou tl La
Le Farcit!? é Lire et
é Comprendre : Les règles européennes
+ AteLler pratique :rédaction ou transcription én
FALC
Cycle 2 - Perfectionnement
+ La pu blicatlon papier et numérique
dans Word = Lés bonnes pratiqués
+ Atelier pratique = Organisation, rédaction,
relecture, diagnostic
et publication 'Nord de vos travaux FALC
Atelier pratique :la validation auprès du public cible
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS --
session 2022
XIV
Annexe 10 : 3 exemples de formations proposées
par la Fédération Addiction
Formation RDR et substances
psychoactives :
éthique, posture, pratiques
20 au 24 septembre 2021
5 jours de formation (35h) - En visioconférence en
fonction des
conditions sanitaires
Fil rouge : Martine LACOSTE, Vice presidente
Fédération Addiction, Directrice de l'association Clémence
Isaure & Pierre CHAPPARD, Président de Psychoactif et chef de
service du CSAPA Trait d'Union
La Réduction des Risques (RDR) a comme objectif
prioritaire de réduire les risques sanitaires, psychologiques, sociaux,
de prévenir les dommages, d'éviter l'aggravation des usages. Elle
contribue aussi à h médiation sociale. Fondée sur une
approche pragmatique, dans un souci de respect et de dignité des
personnes, la RDR reconnait les usagers comme des sujets responsables et
citoyens, capables de faire des choix et, pour peu qu'on leur en donne les
moyens, de se protéger et de protéger autrui.
Il s'agit, dans le non jugement, d'intervenir le plus
précocement possible dans la trajectoire des usagers actifs et d'agir au
plus près des usages et des pratiques à risques, tant des
substances illégales que de l'alcool.
La formation abordera la RORtant sur le plan éthique,
que sur les postures et les pratiques, tout autant que le cadre légal
qui les soutient. Elle vise également l'articulation des pratiques entre
soin et RDR. Plus largement, il s'agira d'interroger quelle est la place et la
parole de l'expertise des usagers dans les dispositifs
|
Tarifs
|
|
|
|
Adhérent Personne Physique
|
550
|
€
|
|
Personnel de Structure Adhérente
|
750
|
€
|
|
Non-Adhérent
|
950
|
€
|
|
Formation Continue
|
1250 €
|
|
|
|
L'Entretien Motivationnel Niveau 1
18, 25 janvier et 1 février 2021
3 jours de formation (21h) - En visio
conférence
Fil rouge : Dr Pascal CACHE, M.D., Genève, Suisse.
L'entretien motivationnel (EM), développé par
les deux psychologues William Miller et Stephen Rollnick au cours des
années 80, se définit comme une approche relationnelle
guidée et centrée sur le client/patient, dant le but est de
susciter ou renforcer la motivation au changement.
Résolument centrée sur le clientfpatientk cette
méthode se déroule dans une atmosphère d'acceptation de la
personne, de sa perception et de son libre choix_ Les attitudes du
professionnel consisteront en une exploration empathique et valorisante de
l'ambivalence de la personne face au changement en évitant la
confrontation et la persuasion_
Cette approche relationnelle (et non une simple technique) est
particulièrement indiquée dans le domaine des addictions
puisqu'elle permet d'intégrer l'ambivalence du client/patient comme une
composante essentielle du processus de changement.
La formation sera axée sur l'acquisition de nouvelles
compétences et se fera majoritairement à travers des exercices de
mise en application des concepts exposés_ Les méthodes
pédagogiques se dérouleront dans une atmosphère de respect
des participants_
|
Tarifs
|
Adhérent Personne Physique
|
330
|
€
|
|
Personnel de Structure Adhérente
|
450
|
€
|
|
Non-Adhérent
|
570
|
€
|
|
Formation Continue
|
750
|
€
|
Côme du Mas des Bourboux - Mémoire CAFERUIS -
session 2022 XV

|
DU MAS DES
BOURBOUX
|
Côme
|
Session 2022
|
|
Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de
responsable d'unité
d'intervention sociale
|
|
INITIER ET ACCOMPAGNER UN CHANGEMENT DES
PRATIQUES
PROFESSIONNELLES EN CENTRE DE SOIN, D'ACCOMPAGNEMENT ET
DE
PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE
PERMETTRE À L'USAGER DE
DROGUES D'ÊTRE ACTEUR DE SON PROJET DE
SOIN
|
|
Résumé :
Les CSAPA accueillent des usagers de substances
psychoactives qui souhaitent soit devenir abstinents, soit avancer dans la
gestion et la sécurisation de leurs consommations. Dans les deux cas, le
chemin est long et l'éventualité d'une reprise des consommations
se doit d'être prise en compte. Envisager ce risque impose aux
professionnels d'informer les usagers sur l'absence d'obligation d'abstinence.
Ils doivent mettre en place des actions visant à le minimiser le risque
de rechute et les risques inhérents aux consommations. La Loi n°
2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé
enjoint d'ailleurs les CSAPA à
entreprendre des actions de
Réduction des Risques et des Dommages.
Dans ces structures, le parcours de vie et la
situation des individus sont très variés. Il est essentiel de
prendre en considération cette diversité. La loi 2002-2 du 2
janvier 2002 impose un accompagnement individualisé. Celui-ci est
impossible, si l'usager n'est pas co-constructeur de son projet, si son savoir
expérientiel n'est pas reconnu.
Comment permettre alors l'instauration de l'alliance
thérapeutique, seule à même de fédérer les
énergies vers un rétablissement?
Je suis cadre dans une structure qui ne respecte pas
encore entièrement ces obligations légales ce qui nuit à
la qualité du parcours de l'individu et entraîne de multiples
risques.
Dans ce mémoire, je présente des notions
incontournables concernant la prise en soin en addictologie et j'analyse la
situation dans la structure ainsi que dans d'autres structures du même
type. Je propose une stratégie afin d'améliorer la qualité
des prestations. Je conclue cette analyse sur un plan d'action précis et
évaluable.
|
|
Mots clés :
CSAPA, Pratiques professionnelles, Réduction Des
Risques et des Dommages,
accompagnement au changement, addiction, sevrage,
abstinence,
rétablissement, alliance thérapeutique,
prévention, drogues, Insertion sociale, usure
professionnelle,
|
|
Le centre de formation n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans
les
mémoires : ces opinions doivent être
considérées comme propres à leurs
auteurs.
|
| 


