|

Joris ASTIER
Mémoire
Master 2 Conseil éditorial
Sous la direction du Professeur Eric LEGUAY
Université Paris-Sorbonne - UFR de Philosophie
Année 2016-2017
MUSEOMIX
People Make Museums
Merci enfin à ma famille et mes amis pour leurs
relectures et leur présence quotidienne.
REMERCIEMENTS
Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble du
corps enseignant du Master 2 Conseil éditorial qui a su nous apporter
tous les outils nécessaires à notre incursion progressive dans le
monde professionnel.
Merci en particulier à Eric Leguay qui m'a
suggéré ce sujet sur lequel j'ai pu trouver des pistes de
réflexion fascinantes et qui a aiguillé l'élaboration de
ma rédaction.
Aussi, merci à la promotion du Master 2 conseil
éditorial pour son soutien quotidien et sa joie de vivre grâce
à laquelle nous avons pu travailler dans d'agréables
conditions.
Merci encore à One Heart Communication pour m'avoir
transmis les compétences et le savoir-être que mon poste de chef
de projet junior et responsable de production nécessitait.
SOMMAIRE
INTRODUCTION P. 1
PARTIE I - MUSEOMIX : L'HISTOIRE D'UNE CULTURE
COLLABORATIVE P. 4
A/ EMERGENCE D'UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER LA
MATIÈRE CULTURELLE P. 4
B/ UN MODÈLE COLLABORATIF RÉPLIQUÉ :
L'ENGOUEMENT CROISSANT AUTOUR DU CONCEPT
MUSEOMIX P. 6
PARTIE II - MUSEOMIX 2016 : UNE CULTURE COLLABORATIVE AU
SERVICE DE LA PERFORMANCE
MUSÉALE ? P. 10
A/ AVANT L'ÉVÉNEMENT P. 10
B/ PENDANT L'ÉVÉNEMENT P. 11
C/ APRÈS L'ÉVÉNEMENT P. 13
PARTIE III - PROBLÈMES, INFLUENCE ET PERSPECTIVES
D'UN DISPOSITIF DE MÉDIATION
CULTURELLE P. 15
A/ PROBLÈMES ET SOLUTIONS POTENTIELLES P.
15
B/ INFLUENCE P. 16
C/ PERSPECTIVES P. 18
CONCLUSION P. 20
ANNEXES P.
22
ENTRETIEN P. 37
SOURCES MOBILISÉES P.
40
1
INTRODUCTION
Depuis plusieurs années se dessine une modernisation de
la société. L'explosion du numérique et des nouveaux
usages qu'il introduit nous offre des perspectives d'amélioration qui
nous paraissent aujourd'hui sans limite. Que ce soit à l'échelle
de l'individu ou à celle des rapports internationaux, le
numérique modifie en profondeur notre façon de penser,
d'interagir et d'agir. Il impacte toutes nos activités et apporte une
multiplicité des solutions qui nous permettent d'offrir des services
adaptés aux nouveaux besoins qu'il a lui-même
créés.
Dans le secteur de la culture, il a radicalement
transformé les usages et facilité l'accès à
l'information, et donc sa diffusion. L'exemple de la Bibliothèque
nationale de France constitue à cet égard un exemple frappant.
Lancée en 1997 par la BnF, la bibliothèque en ligne Gallica
recense aujourd'hui plus de 4 millions d'ouvrages accessibles à tous
ceux munis d'un ordinateur, en seulement quelques clics. L'accessibilité
atteint son paroxysme par le numérique.
L'espace muséal n'a pas non plus été mis
à l'écart de ce nouveau système évolutif. Pour
promouvoir l'accès aux oeuvres, les musées améliorent
depuis les années 2000 leur maîtrise des outils
technologiques1 et commencent aujourd'hui à
privilégier l'usage de l'open data. Ainsi le Rijksmuseum d'Amsterdam, la
National Gallery de Washington, le Getty Research Institute de Los Angeles et
le Metropolitan Museum of Art de New York proposent-ils des
bibliothèques en ligne contenant des centaines de milliers d'images
haute définition des oeuvres qu'ils possèdent. De plus, leur
téléchargement est gratuit et, la grande majorité de ces
réalisations étant tombée depuis longtemps dans le domaine
public, leur utilisation est libre de tout droit, même à des fins
commerciales. Mais l'innovation culturelle ne s'arrête pas là. La
Smithsonian Institution, soucieuse d'offrir aux utilisateurs la
possibilité de posséder l'oeuvre de leur choix chez eux, a
lancé une visionneuse en ligne qui permet au public de manipuler les
objets en 3D. Au total, 14 millions d'oeuvres figurant parmi ses collections
ont été sélectionnées pour être
numérisées et potentiellement imprimées en volume dans les
foyers2. Un tournant dans l'histoire muséal a
été amorcé.
Cette volonté d'innovation s'inscrit dans un
élan plus global d'interactions entre les musées et le public3.
Depuis plusieurs années, les acteurs du milieu cherchent de nouvelles
approches pour
1 Dominique Gélinas, « Le sensorium
synthétique : réflexion sur l'utilisation de l'expographie
immersive numérique et muséale », Conserveries
mémorielles [En ligne], #16 | 2014, mis en ligne le 25 septembre 2014,
consulté le 08 octobre 2017. URL :
http://cm.revues.org/2000
2
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/20140818trib000844827/le-numerique-reinvente-la-consommation-culturelle.html
3 Michel Côté, « Préface
» dans Lucie Daignault, Bernard Schiele, Les musées et leurs
publics : savoirs et enjeux, Presses universitaires du Québec,
Québec, 2014, préface.
2
impliquer davantage les visiteurs dans l'évolution et
la transmission de la culture4. En témoignent les nombreuses initiatives
qui transforment en profondeur l'expérience muséale. Des serious
games aux activités immersives par réalité virtuelle, en
passant par les nombreuses applications disponibles sur mobile, les lignes de
partage entre le spectateur et l'acteur semblent s'effacer progressivement. Le
musée tend à devenir un symbole emblématique du vivre
ensemble et du faire ensemble5. Avec l'éventail d'objets technologiques
qui est mis à sa disposition, le public a davantage le sentiment de
« construire » ou de « vivre » l'univers muséal plus
qu'il ne l'observe passivement. Le cas d'Erasme, le laboratoire d'innovation
ouverte du département du Rhône, est à ce titre
significatif. Ce « living lab », ouvert à tous, met les
technologies au service de la transmission du savoir ou de l'action sociale en
appliquant de nouvelles méthodes, telles que le co-design ou le
détournement de la culture numérique6. Son Museolab,
un espace de maquette et d'expérimentation autour du numérique et
de la muséographie, vise à tester de nouveaux concepts qui
pourront être intégrés aux futurs projets des
musées. Dans cette dynamique de transformation culturelle, citoyens,
habitants et usagers sont considérés comme les acteurs
clés du processus de recherche et d'innovation.
De cette volonté de construction collective et
collaborative est né Museomix. Ce concept, qui a officiellement vu le
jour en 2011, est un événement annuel créatif7
consacré aux nouvelles formes de médiation et au
numérique. S'inspirant du hackathon, il réunit pendant trois
jours des participants, dont les profils doivent être variés afin
d'apporter une diversité des idées et des
compétences8, pour concevoir et prototyper des
expériences innovantes au coeur d'un musée. Museomix a aussi pour
objectif de faire naître une communauté « techno-culture
» mélangeant passionnés de musées et
passionnés de nouvelles technologies pour que des projets concrets
puissent émerger9. Cinq principes régissent le fonctionnement du
concept :
10
- un musée forum : transformer l'expérience de
visite des publics à travers des dispositifs favorisant
l'échange, le partage, la contribution des publics entre eux et du
public avec les institutions
4 Lucie Daignault, L'évaluation muséale
: savoirs et savoir-faire, Presses universitaires du Québec,
Québec, 2012, p. 1.
5
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/158462/1722777/version/2/file/MCC_20170303_DP-Mus%C3%A9es-XXI%C3%A8me-si%C3%A8cle.pdf.
6
http://www.erasme.org/#all
7 Lucas Introna, Donncha Kavanagh, Séamas Kelly, Wanda
Orlikowski, Susan Scott (eds.), Beyond Interpretivism? New Encounters with
Technology and Organization, Springer, New York, 2016, p. 152.
8
http://www.lemonde.fr/arts/article/2014/11/07/museomix-le-marathon-creatif-connecte-remixe-les-musees_4520468_1655012.html
9 Serge Chaumier, Camille Françoise, « Museomix :
l'invention d'un musée du XXIe siècle », La Lettre de
l'OCIM, 156, 2014, p. 7.
3
- un musée ouvert : dispositif critique des institutions
culturelles
- un musée laboratoire : expérimenter et tester des
prototypes de médiation
- un musée en réseau : mutualiser les attitudes,
les connaissances, l'expérience de professionnels de la culture ayant
des intérêts divers et variés
- une gouvernance horizontale : favoriser le travail en
équipes et l'autonomie, conjuguer les talents de ses contributeurs.
En plaçant au coeur du processus d'innovation la
collaboration, Museomix ouvre de nouvelles perspectives sur la façon de
penser l'évolution du milieu culturel. Par son intermédiaire, une
nouvelle voie a été ouverte : la culture collaborative.
Au travers du prisme de Museomix et des mécaniques
technologiques et sociales qu'il mobilise, nous tenterons de mesurer tous les
enjeux de cette nouvelle approche que représente la culture
collaborative.
Dans un premier temps, nous nous efforcerons d'observer
l'évolution et la diffusion de cette culture collaborative à
travers les différentes éditions de Museomix, en nous concentrant
sur les effets qu'elle produit sur les participants, les institutions et le
public.
Dans un second temps, nous nous focaliserons sur la
dernière édition en date pour saisir le fonctionnement du
mécanisme et ses résultats.
Enfin, nous tenterons d'adopter une démarche analytique
et prospective pour mesurer l'inßuence qu'exerce Museomix dans le milieu
culturel via la culture collaborative.
4
PARTIE I
MUSEOMIX : L'HISTOIRE D'UNE CULTURE COLLABORATIVE
EMERGENCE D'UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER LA
MATIÈRE CULTURELLE
Au commencement, des acteurs de l'univers muséal
observent un décalage important entre les pratiques de médiation
instaurées par les institutions culturelles, les pratiques sociales du
numérique et le potentiel en termes de médiation que
possèdent les nouveaux médias. Soucieux d'offrir une place
d'« acteur » de l'institution muséale aux visiteurs et non de
« consommateur », ils ouvrent la voie à la culture
collaborative. En 2011 naît alors la première édition de
Museomix.
A l'origine de Museomix, une équipe diversifiée
alliant particuliers et structures innovantes. Samuel Bausson, webmaster du
musée de Toulouse, et Julien Dorra, enseignant des nouvelles
technologies dans plusieurs écoles et facultés, s'associent
à Buzzeum, une agence spécialisée dans l'innovation
culturelle, à l'agence nod-A, experte en conseil des pratiques
innovantes, et au centre Erasme pour donner forme à ce nouveau concept.
La première édition se tiendra au musée des Arts
décoratifs à Paris. Des appels à projets sont alors
lancés11 et les équipes retenues, constituées
de chefs de projets, de médiateurs, de développeurs et de bien
d'autres métiers divers et complémentaires (Annexes, Fig. 1),
travailleront intensément pendant trois jours pour donner corps à
leurs idées (Annexes, Fig. 2).
Sébastien Magro, chef de projet numérique et
participant de cette première édition, nous livre son sentiment
à la sortie de l'événement : « Soudain, le
numérique au musée n'était plus pour moi un centre
d'intérêt personnel et professionnel, c'était devenu une
réalité, partagée par au moins une centaine de personnes
capables de donner de leur temps pour un projet utopique : (re)mixer le
musée12. » Le concept suscite l'engouement chez les
participants. Une situation dialogique s'instaure non seulement entre ces
derniers mais également entre l'oeuvre et le museomixeur13.
Parce qu'il développe les principes collaboratif et participatif, le
fonctionnement de Museomix s'inscrit au coeur des tendances actuelles,
notamment dans celles du développement durable. Le musée
citoyen,
11
12
13
http://www.ladn.eu/news-business/actualites-agences/museomix-remixe-les-musees/
http://blog.sebastienmagro.net/2012/05/21/retour-sur-museomix-premiere-edition/
Serge Chaumier, La médiation culturelle, Armand Colin,
« Collection U », Paris, 2013, p. 118-119.
5
évoqué depuis plusieurs années, trouve
dans cet événement annuel son terrain d'accomplissement,
puisqu'il ajoute aux anciennes espérances écomuséales les
formes les plus évoluées et les aspects les plus technologiques
du « fab-lab »14. Plus encore, il ouvre de nouvelles
perspectives sur la façon de construire la matière culturelle. Le
même témoin poursuit : « Je retire aussi de cette
expérience une grande confiance en l'avenir et en l'évolution des
institutions culturelles : malgré les lenteurs administratives,
malgré leur fonctionnement vertical et hiérarchique, je reste
persuadé que les musées ont la possibilité de changer,
d'évoluer pour intégrer le numérique dans leur
fonctionnement. Plus largement, je crois que les institutions culturelles
pourront s'ouvrir aux dimensions participatives et collaboratives qui
découlent du numérique, si elles s'appuient sur leur deux grandes
forces : la richesse de leurs contenus et l'énergie dont sont capables
leurs communautés15. »
Le rôle du public est lui aussi central dans le
processus d'innovation. A distance, par le biais du numérique, il
s'intègre au modèle collaboratif par deux modes d'intervention.
Premièrement, il peut apporter son soutien par une contribution
financière. En effet, Museomix fonctionne sur le volontariat et certains
des participants se proposent même de payer leur logement pour
réduire les coûts que l'événement engendre
(planification et organisation, matériels technologiques, logistiques
d'accueil, promotion et diffusion, etc.). Nous retrouvons aujourd'hui
sur internet des traces laissées par la participation financière
du public pour cette première édition. Le site de financement
participatif Ulule dévoile par exemple une collecte de dons
s'élevant à 500 euros et atteignant 100% des objectifs
fixés (Annexes, Fig. 3). L'intérêt suscité par le
concept ne se limite donc pas aux participants.
Deuxièmement, il ne faut pas minimiser le poids des
réseaux sociaux dans la diffusion du savoir et dans la construction
collective des idées innovantes. De plus en plus munis de community
managers et de communicants, les musées s'accaparent progressivement le
web 2.0 pour en faire un outil de communication culturelle efficace. Le concept
Museomix repose aussi en partie sur la communication. C'est de cette
façon qu'il se fait connaître et qu'il attire de nouveaux
participants. Mais les équipes Museomix sont aussi souvent
composées de communicants dont le rôle est de relayer leurs
projets sur les réseaux. Les internautes sont ainsi conviés
à participer au processus de création, qui devient dès
lors extra-muros et d'intérêt public. Ils peuvent donner leurs
avis et
14 Le « fab-lab » (contraction de l'anglais
fabrication laboratory, laboratoire de fabrication) est un lieu ouvert à
tous dans lequel toutes sortes d'outils servant à la conception et la
réalisation d'objets, notamment des machines-outils pilotées par
ordinateur, sont mis à disposition du public.
15
http://blog.sebastienmagro.net/2012/05/21/retour-sur-museomix-premiere-edition/
6
proposer des pistes d'amélioration pour les projets
diffusés. Par les interactions sociales qu'il mobilise, le
numérique offre à l'objet créatif des possibilités
évolutives quasiment infinies.
Au terme de cette première édition, onze
prototypes ont pu voir le jour et être présentés au public.
Parmi eux, le projet Strat, l'un des plus ambitieux d'un point de vue
muséographique, retiendra l'attention. A travers ce concept, il s'agit
d'augmenter numériquement une pièce entière du
musée, le Cabinet des fables, par des technologies immersives utilisant
uniquement le déplacement du visiteur comme interface (Annexes, Fig. 4).
Par l'immersion, le visiteur est beaucoup plus affecté par son
expérience muséale16. Mais les concepts innovants et
les futurs projets fusent déjà dans l'esprit des participants. Le
témoignage d'Yves-Armel Martin, fondateur du centre Erasme, en dit long
sur cette véritable réaction en chaîne des idées que
produit Museomix : « En entendant les conversations autour de cette salle,
cela m'a donné l'idée d'un sujet à exploiter : parmi les
fables présentées dans ce cabinet, certaines nous sont inconnues.
Il y aurait un beau projet à monter de participation des publics (en
ligne ou en atelier) pour imaginer et écrire ces fables disparues
simplement en partant de leur traces picturales dans cette
pièce17. » Au moment même où
l'événement s'achève, le modèle Museomix est
déjà destiné à être
répliqué.
UN MODÈLE COLLABORATIF RÉPLIQUÉ
: L'ENGOUEMENT CROISSANT AUTOUR DU CONCEPT
MUSEOMIX
Le modèle proposé par Museomix séduit
tant le public que les acteurs du milieu muséal. Le ministère de
la culture l'accompagne le soutient également18. Après
le succès de l'édition de 2011, d'autres voient le jour. Les 19,
20 et 21 octobre 2012 se tient la deuxième édition du concept, au
musée Gallo-romain de Lyon Fourvière cette fois, et aboutit
à la création de huit prototypes19. Mais c'est en 2013
qu'il prend véritablement son essor. Six lieux, répartis sur
trois pays, accueillent pendant trois jours des participants de toutes
professions. Ainsi les musées de Grenoble, Lens, Nantes, Paris,
Québec et Shropshire ouvrent-ils leurs portes à la culture
collaborative. Il en ressort une répartition majoritairement
française mais qui préfigure néanmoins un
élargissement du modèle à l'échelle
internationale.
16 Florence Belaën, « L'immersion dans les
musées de science : médiation ou séduction ? »,
Culture & Musées, n°5, 2005, p. 99.
17
http://www.erasme.org/Strat
18
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000331.pdf
Mais pourquoi le concept est-il aussi rapidement repris par
les institutions culturelles ? Outre cet aspect de co-construction entre le
public et les musées, l'efficacité de l'événement
convainc à bien des égards. L'intérêt qu'ont les
institutions d'intégrer Museomix à leur système
évolutif est évident. Véritable laboratoire de recherche
en innovation et lieu d'expérimentation, regroupant chercheurs, testeurs
et techniciens de tous horizons, tels que peu de structures peuvent se
permettre de financer, il représente une aubaine. Les participants
s'investissent énergiquement en peu de temps et produisent des projets
concrets, tandis que le coût total de l'opération reste moindre.
Des pistes de renouvellement leur sont ainsi proposées sans grand
investissement financier de leur part.
Mais, au-delà de ce profit, l'événement
représente aussi pour les institutions une stratégie de
positionnement. En se faisant l'hôte de Museomix, le lieu d'accueil se
situe à l'intersection entre culture et technologie et se positionne
clairement comme incubateur de solutions culturelles innovantes. Grâce
à cette stratégie, les institutions partent à la
conquête de nouveaux publics. Combien de passionnés de nouvelles
technologies ne se seraient jamais déplacés au musée sans
lui ajouter une dimension hautement innovante ? L'intérêt
porté à l'espace muséal naît alors des
médiations qu'il est possible d'y déployer, et non l'inverse.
Enfin, plus en arrière-plan parce que plus
aléatoire, Museomix peut également permettre de repenser le
système hiérarchique et les rapports de travail au sein
même des institutions culturelles. En participant à
l'événement, les musées choisissent logiquement de s'y
impliquer pleinement. Au moins une partie du personnel s'investit, quelque soit
sa position hiérarchique, pour collaborer à un projet commun de
manière égalitaire, sans distinction sociale ni professionnelle.
En revisitant son fonctionnement interne l'espace de quelques jours, le
musée peut s'ouvrir sur de nouvelles façons de travailler et
conserver « l'esprit Museomix » après l'achèvement de
l'opération. La nouvelle dynamique professionnelle insufflée
pendant les longs mois de préparation et pendant ces trois jours
intenses est susceptible d'imprégner les méthodes de travail du
personnel et de les faire perdurer sur le long terme. Mais ce schéma est
aléatoire puisqu'il dépend de la façon d'entrevoir le
concept. Il ne peut fonctionner lorsque le lieu d'accueil n'y voit qu'un moyen
efficace pour communiquer sur sa modernité. Ainsi le musée de
Louvre-Lens a-t-il délaissé cette dynamique après
l'achèvement de l'opération, à l'inverse des musées
de Lyon et de Grenoble. Museomix est pourtant une belle occasion de
dénicher de nouvelles formes de management d'équipes, plus
collaboratives et moins soumises à l'autorité
hiérarchique. Pour Catherine Barra, chercheuse-archéologue et
museomixeuse, avec qui nous avons réalisé une interview, Museomix
est une expérience incroyable qui ne peut qu'imprégner le
personnel du musée après son achèvement : « Museomix
ne peut pas ne pas laisser de traces. On ne peut pas accueillir 150 personnes
le week-end, s'impliquer à fond avec elles pour bâtir des projets
concrets qui peuvent changer les choses, et retourner au même endroit
le
7
8
lundi sans que cette énergie n'ait impacté le
personnel20. » L'institution tend à se transformer en
profondeur21.
De l'édition de 2013 éclosent alors
cinquante-huit prototypes, dont dix-huit en dehors de l'hexagone22.
L'événement produit sur les participants une émotion tout
aussi vive que lors de la première édition. Myrlène Numa,
museomixeuse experte en technologie et fonctionnement, témoigne : «
J'ai découvert Museomix au détour d'un tweet, j'ai d'abord
été très étonnée par l'originalité du
concept. C'est un véritable challenge d'arriver à élaborer
des propositions originales qui apporteront de nouvelles perspectives dans la
manière d'appréhender le musée. Je suis convaincue qu'un
tel événement participe à en faire un lieu ouvert à
tous, en connexion avec son temps et qui puise dans différents univers
pour mener à bien sa mission d'éducation et de médiation.
Lorsque je vois la qualité des prototypes des éditions
précédentes et la matière que l'on a à disposition
ici à Nantes mais aussi sur les autres lieux de la manifestation, je me
dis qu'il y a un beau défi à relever 23. »
C'est pourquoi s'enchaînent les éditions et se
multiplient les pays d'accueil. Le concept répond aux attentes d'une
société en quête d'innovation par l'échange culturel
et technologique. Qu'il s'agisse des individus ou des institutions, le culture
collaborative ouvre de nouvelles voies de médiation grâce
auxquelles naissent des solutions innovantes fondées sur une dynamique
de travail transformée.
Dans les années suivantes, le concept continue
logiquement à gagner en notoriété. En 2014, sept
musées accueilleront l'événement, répartis sur
quatre pays (France, Canada, Angleterre et Suisse), avec toujours une dominante
française. En 2015, nous assistons à une plus vaste expansion du
phénomène, qui touche onze musées dans cinq
pays24 (France, Canada, Suisse, Belgique et Mexique), avec cette
fois une majorité extra-nationale (Annexes, Fig. 5). Un goût
prononcé pour la culture collaborative se diffuse dans le monde entier.
Mais ce modèle, aussi innovant soit-il, est-il si performant ?
Amène-t-il à des résultats probants ? Une fois
l'événement achevé, que reste-t-il concrètement de
Museomix dans le musée ? Pour répondre à ces questions, il
nous faudra, en nous
20 Entretien téléphonique réalisé
avec Catherine Barra, le 7 octobre 2017. L'intégralité de
l'entretien se trouvera à la fin de cette étude.
21
22
23
Paul Rasse, Le musée réinventé. Culture,
patrimoine, médiation, CNRS éditions, Paris, 2017, p. 2.
http://www.museomix.org/editions/edition-2013/
http://www.museomix.org/wp-content/uploads/2013/07/dossier-de-presse-museomix.pdf
24
http://www.20minutes.fr/rennes/1729779-20151113-rennes-marathon-creatif-week-end-musee-bretagne
9
focalisant sur la dernière édition en date
(2016), analyser dans son ensemble le déroulement et la construction du
modèle collaboratif proposé par Museomix.

PARTIE II
MUSEOMIX 2016 : UNE CULTURE COLLABORATIVE AU SERVICE
DE LA
PERFORMANCE MUSÉALE ?
AVANT L'ÉVÉNEMENT
Suite au succès de l'édition de 2015 sont
lancés, comme chaque année, en janvier, des appels à
projets en vue de l'édition suivante. Depuis sa création,
l'organisation pré-événementielle du concept n'a que
très peu changé dans son fonctionnement, excepté le fait
qu'avec le déploiement géographique qu'ont connu les
précédentes éditions, Museomix est désormais
administré par zones (à peu près équivalentes aux
régions en France puis, en dehors, chaque pays correspond à une
seule zone). Les porteurs de projets se manifestent alors et sont
sélectionnés par la zone géographique dans laquelle ils se
trouvent. Dans le même temps et de la même façon, les
musées qui souhaitent participer à l'opération prennent
contact avec la zone qui les concernent. Tous les musées, pourvu qu'ils
répondent aux critères nécessaires pour recevoir un
Museomix (l'espace, les oeuvres, les ressources humaines dont ils disposent,
etc.) sont de fait sélectionnés. Une organisation avec
les musées doit être effectuée en amont pour prévoir
les espaces et les aspects pratiques (un large espace de travail pour toutes
les équipes, un fab-lab comprenant toutes les machines, un espace
média destiné aux lives, etc.). Une
fois les projets et les musées sélectionnés, les appels
à participation commencent. Comme nous l'avons déjà
évoqué, les métiers exercés ne sont pas un
critère d'exclusion, car c'est de la diversité professionnelle
que naîtra l'innovation culturelle. Néanmoins, le nombre de
participants par musée est limité et déterminé en
fonction de l'espace dont ce dernier dispose. Ce qui, malgré tout,
n'empêche pas un participant de demander à être
affecté à un autre musée situé dans une
région plus lointaine. Les participants sont répartis en six
catégories pour assurer l'équilibre des différents groupes
:
- interactions et usages (muséographie, UX,
etc.),
- communication et diffusion (community management,
rédaction, etc.)
- fabrication (mécanique, menuiserie, etc.)
- technologie et fonctionnement (développement web,
électronique, etc.)
- contenus (conservation, recherche, etc.)
- magic (tout ce qui est externe aux autres domaines).
11
Ces appels à participation sont ouverts jusqu'à
la fin septembre. A l'approche du jour J, l'équipe web est
déjà mobilisée pour assurer la communication en ligne
autour de l'événement, tandis que l'équipe d'organisation
s'occupe des derniers préparatifs sur place, dans les musées.
L'édition commence alors à la fin du mois d'octobre ou au
début du mois de novembre. En 2016, l'événement se tient
presque simultanément dans les 15 musées participants,
du 10 au 13 novembre. Cette sixième édition se
déroule en France, en Suisse25, au Canada, en Italie et en
Belgique.
PENDANT L'ÉVÉNEMENT
Les 10 et 11 novembre, les participants se réunissent
et se rencontrent dans les différents musées où ils se
sont préalablement inscrits. Les porteurs de projets pitchent alors
leurs idées et chaque participant rejoint le projet par lequel il est le
plus attiré. Les organisateurs, quant à eux, veillent à la
bonne répartition des compétences au sein de chaque groupe,
constitué de six, sept ou huit personnes. Le travail de brainstorming
peut alors être engagé 26 (Annexes, Fig. 6). Les
différentes équipes commencent à échanger des
idées, explorer la situation, imaginer les solutions possibles avant de
cadrer leur projet et de s'accorder sur une direction commune. Les membres de
l'équipe se documentent, cherchent des exemples effectués
ailleurs (travail de benchmark) et réalisent des schémas et des
storyboards d'interaction. Ils jouent également les variations de
scénarios possibles dans les espaces d'exposition pour penser le
prototype le plus adapté au besoin identifié. Les coachs sont
là pour aider, donner des indications, pointer sur des
opportunités et créer des liens de mutualisation entre les
équipes. Le soir, chaque équipe présente son projet aux
autres. Elle explique la manière dont l'expérience muséale
du visiteur sera transformée une fois le dispositif mis en place. Ce qui
permet de se poser des questions entre équipes pour dénicher de
nouvelles idées créatives. C'est aussi un moment collectif
privilégié pour construire une cohésion entre tous les
participants. Car Museomix n'est pas un marathon créatif concurrentiel
ou compétitif ; la collaboration est effective non seulement au sein des
équipes mais aussi entre elles. Au musée Tolomeo de Bologne
(Italie) pitchent ainsi deux équipes, tandis qu'à Grasse six
équipes présentent leurs projets et discutent de leurs
idées. De l'autre côté de l'Atlantique, à
Québec, c'est dans un monastère augustin que les participants
échangeront autour de leurs prototypes pour alimenter le processus
créatif.
25
http://fablab-leman.fr/wp-content/uploads/2017/01/FabLac-RapportActivités-2015-16.pdf
26 Timothy Kuhn, Karen L Ashcraft, Francois
Cooren, The Work of Communication: Relational Perspectives on Working and
Organizing in Contemporary Capitalism, Routledge, New York, 2017, p. 99.
12
Le deuxième jour est celui des tests et des
ajustements. Après avoir reçu les retours de leurs pairs et des
co-organisateurs, les équipes sont désormais prêtes
à donner matière à leurs idées. Les prototypes sont
construits et chacun exerce un rôle bien spécifique au sein de son
projet : l'expert contenus garantit un prototype fondé sur des
données scientifiques, le bricoleur le fabrique, le développeur
le fait fonctionner, le graphiste le rend visuellement attractif, le
communicant le documente et le diffuse (sur internet et les réseaux
sociaux), et le médiateur proposera, lors du troisième et dernier
jour, cette expérience à vivre aux visiteurs (Annexes, Fig. 7).
Les facilitateurs et les coachs s'assurent que les participants avancent et les
aident à se sortir de situations bloquantes. Le Tech shop met à
disposition tout le matériel dont les équipes ont besoin
(tablettes tactiles, systèmes sons, composants électronique,
etc.) et c'est au fab-lab que les prototypes sont
réalisés. Après une journée de construction
intensive, les équipes montrent une video-prototype de leur projet le
soir, en utilisant des Legos ou des découpages en papier. Les
vidéos racontent l'histoire du visiteur, son parcours, ses actions, ses
pensées et ses ressentis lorsqu'il interagit avec le prototype. La phase
de construction arrive à son terme et laisse place à celle de la
présentation auprès du public.
Le troisième jour, après que les participants
aient terminé les derniers ajustements pendant la matinée, le
public est invité à venir découvrir les prototypes
créés au long de ces deux jours. En amont, les community managers
et les employés du musée ont communiqué en ligne autour de
l'événement pour lui offrir un maximum de visibilité. Car
les visiteurs sont le public cible de l'opération. Pour Catherine Barra,
ils sont le moteur qui donne tant d'énergie au concept : « Le
public a une place centrale dans les Museomix. Non pas en tant qu'acteurs, mais
en tant que consommateurs. Tous ces dispositifs sont créés pour
le public. [É] Le but premier de l'opération, c'est le partage
avec le public. Il est le cobaye et le coeur du système. L'idée
est toujours de proposer quelque chose qui améliorera son
expérience et qui le poussera à s'engager un peu plus dans le
domaine culturel27. » Le Palais du Tau à Reims, l'un des
hôtes de l'édition de 2016, communique l'événement
sur son site et convie les internautes à venir visiter les projets
exposés (Annexes, Fig. 8). Pour garantir le fait qu'ils se
déplaceront en grand nombre, l'entrée est gratuite.
Les visiteurs observent, questionnent les équipes,
doutent ou s'enthousiasment face à ces réalisations novatrices.
Au musée Saint-Raymond de Toulouse, les retours d'expérience sont
enrichissants. Le prototype Pose divine, qui propose au public de
découvrir l'univers des travaux d'Hercule en l'invitant à adopter
les poses herculéennes, attire l'attention du visiteur en gamifiant le
concept. Ainsi, comme le community manager de l'équipe l'a posté
sur Twitter, les familles et surtout les enfants se sont pris au jeu (Annexes,
Fig. 9). Mais la médiation humaine reste l'élément le
|
27
|
Entretien téléphonique réalisé avec
Catherine Barra, le 7 octobre 2017. L'intégralité de l'entretien
se trouvera à la fin
|
de cette étude.
13
plus attrayant de la transmission du savoir : l'expert contenu
réussit à tenir le public en haleine à travers le
récit des travaux d'Hercule 28.
APRÈS L'ÉVÉNEMENT
Que reste-t-il de Muséomix après son
achèvement ? Est-il un événement passager qui a seulement
produit un engouement éphémère ou a-t-il réellement
apporté des éléments concrets au musée ? Un peu des
deux. En fait, tout dépend de la manière dont le musée
souhaite exploiter la dynamique de travail qui a animé son espace
pendant ces quelques jours d'effervescence. Cela vaut autant pour les rapports
de travail, que nous avons déjà évoqués
précédemment, que pour le devenir des prototypes
réalisés pendant l'opération. Même si l'organisation
de Muséomix n'inclut pas, pour le moment, la post-production
systématique des prototypes, leur pérennisation est
encouragée et accompagnée autant que possible. Ce sont souvent
les équipes elles-mêmes qui travaillent avec le musée, ou
indépendamment, à faire évoluer leurs prototypes vers une
solution stabilisée. Certains musées choisissent de
développer un ou plusieurs projets(s), mais le matériel qui sert
à leur réalisation est prêté par des fab-lab ou
d'autres structures, il faut donc le rendre. Pour pouvoir les
développer, le musée doit les budgétiser et lancer des
appels d'offres. Ce qui prend un certain temps puisque, sorti de
Muséomix, comme nous le confirme Catherine Barra, « la `vie
réelle' reprend son cours ainsi que les démarches administratives
qui l'accompagnent29. »
Mais cet effort n'empêche pas les musées
d'entreprendre la pérennisation des prototypes. Si la
démonstration devant le public lors du dernier jour s'est
avérée pertinente, le projet peut représenter un apport
substantiel à l'espace muséal. En 2012, quatre des dix
dispositifs ont été définitivement adoptés par le
musée Gallo-Romain sur un budget propre. Pour l'année 2016, comme
l'a fièrement tweeté le Museomix de la région, deux des
sept prototypes présentés au musée Saint-Raymond de
Toulouse seront retravaillés et mis à disposition du public dans
les prochaines années (Annexes, Fig. 10). Il s'agit des projets
Chaux Must Go On !, qui propose d'éclairer, par des jeux de
lumière et de signalétique, le four à chaux du
musée et YODO, You Only Die Once, qui permet à
l'utilisateur de concevoir son propre sarcophage à partir des programmes
décoratifs de la collection pour décoder les symboles qu'ils
renferment 30 (Annexes, Fig. 11). Les deux
prototypes sélectionnés
28
29
http://saintraymond.toulouse.fr/Museomix-au-MSR-les-prototypes-crees_a848.html
Entretien téléphonique réalisé
avec Catherine Barra, le 7 octobre 2017. L'intégralité de
l'entretien se trouvera à la fin de cette étude.
30
https://archeomuse.eu/2016/11/20/museomix-2016/
sont centrés sur le contenu31,
reflétant l'attrait du public pour cette forme de médiation
culturelle. Grâce à la mise en production des prototypes, les
musées prouvent que « l'esprit Museomix » peut perdurer et que
le modèle collaboratif qu'il propose produit de réels
résultats dans l'espace culturel.
14
31
https://cehistoire.hypotheses.org/900
15
PARTIE III
PROBLÈMES, INFLUENCE ET PERSPECTIVES D'UN DISPOSITIF
DE
MÉDIATION CULTURELLE
PROBLÈMES IDENTIFIÉS ET SOLUTIONS
POTENTIELLES
Nous l'avons vu, le dispositif de médiation
déployé par Museomix, malgré des résultats encore
trop hétérogènes, débouche sur de très
belles perspectives pour le devenir muséal. Cependant, plusieurs
problèmes bridant le processus de création ou la mise en
production des projets peuvent être dégagés.
L'événement laisse certes la parole à
tous les participants de façon égalitaire, mais, au-delà
des murs du musée, celle du public n'est guère
écoutée. Que ce soit pour donner des pistes d'amélioration
via les réseaux sociaux durant l'opération ou pour offrir au
prototype créé davantage de consistance technologique et/ou
culturelle pendant la phase de post-production, le public n'est pas
pensé comme un acteur du processus créatif. Pourtant, le
modèle collaboratif proposé par Museomix, qui prône la
diversité comme élément central de l'innovation, s'inscrit
parfaitement dans cette démarche. Donner plus de voix à la parole
du public ne pourrait qu'accroître les chances de dénicher des
solutions innovantes. Ainsi, des formulaires accompagnant la description des
projets pourraient être diffusés, ou des systèmes de votes
mis en place, afin que tous puissent donner un avis et surtout des perspectives
d'évolution. Car c'est d'un engagement collectif que naîtront de
réels résultats ; la réaction en chaîne des
idées produite pendant l'opération, que nous avons
déjà évoquée, pourrait atteindre une dimension
beaucoup plus grande si la voix était aussi donnée au public.
Un autre problème est celui de la réticence des
musées à recevoir l'événement. Dans l'entretien que
nous avons réalisé, Catherine Barra nous en parle : « Mais
le concept peine malgré tout à pénétrer les
musées, qui le trouvent trop exigeant : l'accueillir implique de trouver
un budget et de confier son espace à un grand groupe de personnes qui va
le désordonner pendant quelques jours32. » En fait, ce
sont surtout les grands musées qui ont cette mentalité. Beaucoup
de visiteurs y affluent déjà et leurs pratiques sont de fait trop
institutionnalisées pour accueillir l'opération. Si un
|
32
|
Entretien téléphonique réalisé avec
Catherine Barra, le 7 octobre 2017. L'intégralité de l'entretien
se trouvera à la fin
|
de cette étude.
16
grand musée se faisait l'hôte de Museomix, la
décision ne pourrait qu'émaner de la direction et il y aurait de
grandes chances pour que l'événement soit envisagé comme
une opération marketing. Il est probable que peu de traces resteraient
de Museomix après son achèvement. En revanche, pour les petits
musées de province, comme celui de Guéret (dans la Creuse),
l'événement représente une véritable aubaine. D'une
part, il leur permet de trouver de nouvelles façons de consommer leurs
produits, car ces petites structures ne bénéficient que de
très peu de personnel et rares sont les personnes en charge d'un tel
développement. D'autre part, il leur permet de booster leur potentiel
culturel. De cette manière, ces musées gagnent en
visibilité et peuvent trouver des investissements futurs pour
réaliser d'autres projets ou pour développer les prototypes
créés pour l'occasion. En touchant de plus en plus de petites
structures, peut-être le phénomène Museomix pourra-t-il
progressivement séduire les grandes institutions, souvent
considérées comme trop fermées à la culture
collaborative et comme « poussiéreuses ».
Enfin, nous avons dégagé dans cette étude
un troisième problème, qui concerne la pérennisation des
projets. Cette dernière n'est pas systématisée et il
revient aux musées d'entreprendre les démarches administratives
pour leur mise en production. Museomix n'a pas pour vocation la gestion de ce
que l'événement a produit pendant ses trois jours
d'effectivité. Il en résulte de grandes difficultés pour
mettre à disposition du public de nouvelles formes de consommation
culturelles. C'est du système administratif français que doit
être opéré le changement. En rendant très difficiles
la mise en place d'éléments évolutifs, il bride par
contre-coup le processus créatif et limite les effets d'innovation que
souhaite produire Museomix.
INFLUENCE
Face à ces problèmes, d'autres structures
reprennent la démarche de Museomix en l'adaptant à un public
cible donné qui reste en marge du phénomène. C'est par
exemple le cas de labOmusée, organisé par Museomix
Rhône-Alpes, Cybèle (société d'assistance à
la conception de médiation), Patrimoine Aurhalpin (association
régionale qui valorise le patrimoine) et la Fondation Renault. LabOmix a
pour but de reprendre le même principe que Museomix, mais adaptable aux
musées locaux avec les problématiques qui y sont liées33.
La première édition a eu lieu en 2016 au musée de la
Grande Chartreuse et portait comme problématique locale « comment
faire prendre conscience aux personnes qui viennent dans les alentours du
musée que près d'ici vivent des moines et qu'un musée
parle de leur histoire et de leur mode de vie ? ». Nous le voyons, le
concept est
33
https://labomusee.fr/a-propos/
17
davantage centré sur le caractère local de
l'espace muséal. Cette première édition a abouti à
la création de deux prototypes. Parmi eux, L'appât son
proposait aux visiteurs, en les munissant d'un casque sonore, de
s'immerger dans la vie quotidienne du monastère et des moines chartreux
en reproduisant les bruits qu'ils pouvaient entendre tous les jours (Annexes,
Fig. 12).
Mais l'influence exercée par Museomix dépasse le
cadre strictement muséal. Le phénomène
a également pénétré l'enseignement,
et notamment les collèges. Le cas d'Edumix est à cet
égard
significatif. Initié par le réseau des
LearningLabs34 et le centre Erasme, Edumix se dit être une
transposition dans le monde de l'éducation du format
Museomix35. Le mouvement vise à :
- décloisonner des habitudes et des communautés
- initier et renforcer une communauté d'innovateurs
- former aux méthodes agiles
- amorcer la transformation numérique d'une institution
- ouvrir des pistes innovantes.
Le concept a vu sa première édition naître
en 2017 et dix projets ont été concrétisés
jusqu'à présent. L'un deux, Un collège sur mesure,
propose à chaque élève un parcours
individualisé qui valorise ses progrès et qui lui permet de
s'engager dans des projets liés à ses centres
d'intérêts. Sur une application à caractère ludique,
l'élève est identifié à un avatar et il peut
répondre à des questions liées aux éléments
de cours abordés lors du trimestre et surveiller sa marge de progression
au long de l'année (Annexes, Fig. 13). Le but du projet est clair : il
s'agit d'accroître l'intérêt des élèves pour
les matières enseignées au collège ainsi que de permettre
aux enseignants de valoriser les connaissances et les compétences que
développe leur discipline. En pénétrant l'enseignement, et
donc le quotidien des élèves, l'enjeu est ici considérable
: l'apprentissage est non plus considéré comme un devoir mais
comme un objectif. Ce concept reprend l'esprit Museomix dans sa conception mais
emprunte aussi beaucoup au mouvement des serious games qui tend de plus en plus
à pénétrer le milieu professoral.
Enfin, un troisième exemple d'influence a
émergé de nos recherches documentaires. Il s'agit des
BiblioRemix, un mouvement qui implique les lecteurs dans la transformation
des
34 Les LearningLabs sont des espaces innovants
dédiés aux nouvelles formes d'apprentissage exploitant notamment
les possibilités offertes par les nouvelles technologies de
l'information et de la communication.
35
http://www.edumix.fr/a-propos/
18
bibliothèques36. Après tout, si le
concept a réussi à toucher le musée, pourquoi le
modèle ne pourrait-il pas être dupliqué pour d'autres
institutions culturelles ? Ainsi le BiblioRemix, né en juin 201337, vise
à réunir des participants aux compétences diverses
(lecteurs, informaticiens, bibliothécaires, designers, architectes,
etc.) pour mettre en place des dispositifs concrets qui correspondent
à leur vision de la bibliothèque idéale 38. Les
groupes imaginent, prototypent et expérimentent alors des
réponses aux problématiques identifiées par les
professionnels des bibliothèques lors de l'exercice de leurs fonctions.
Le mouvement semble prendre une ampleur plus importante que Museomix, puisqu'il
est parvenu assez vite à toucher la plus grande institution
française : la BnF. Le 29 mai dernier se sont regroupés des
bibliomixeurs dans l'enceinte de la bibliothèque pour imaginer
collectivement son futur pôle Média39. Le 17 juin, le
public a été invité à découvrir et à
échanger autour des huit projets d'évolution des salles et de
leurs services que les bibliomixeurs ont proposés40. Au
regard du mode de communication déployé pour l'occasion, il
semble que la BnF ait très vite capté les enjeux de l'opinion
publique dans le processus d'innovation, puisque les visiteurs, mais aussi les
internautes (Twitter), sont invités à voter pour les projets
qu'ils souhaitent voir aboutir (Annexes, Fig. 14). La BnF comprend que
les transformations mises en place seront destinées au public, et qu'il
est donc primordial qu'il puisse s'exprimer sur le sujet.
PERSPECTIVES
La vague Museomix se propage efficacement puisque des envies
de nouvelles formes de médiation culturelle naissent un peu partout et
construisent des réseaux de personnes appréhendant
différemment les musées et les problématiques liées
aux services proposés au public41. Par cette nouvelle
façon de penser la transmission du savoir, Museomix souhaite irriguer
les institutions, les territoires et les individus pour que son esprit puisse
donner à des structures locales l'envie d'agir à leur
échelle. Le concept a d'ores et déjà réussi le tour
de force d'opérer un brassage entre les entreprises, les
collectivités, les professionnels et les amateurs du monde
muséal. En mobilisant des
36
http://www.letelegramme.fr/finistere/plougastel-daoulas/biblioremix-penser-la-bibliotheque-de-
demain-23-03-2017-11445602.php
37
http://www.enssib.fr/biblio-remix-esprit-lab-en-bibliotheque
39
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/anx_actu_bib/a.170529_biblioremix.html
40
http://www.bnf.fr/documents/170529_biblioremix_reglement.pdf
41 Serge Chaumier, Camille Françoise, «
Museomix : l'invention d'un musée du XXIe siècle», La Lettre
de l'OCIM, 156, 2014, p. 9-10.
19
individus et structures de tous horizons, Muséomix
crée des communautés diversifiées et engagées dans
un projet commun : donner à la matière culturelle de nouvelles
formes de consommation.
Il serait par ailleurs intéressant d'élargir la
démarche amorcée par Museomix au-delà des musées.
Nous l'avons vu juste avant, d'autres institutions reprennent le modèle
collaboratif qu'il propose, et cela semble trouver son efficacité au
sein de ces structures. Mais le paradigme culturel n'est pas qu'un
conglomérat d'organismes qui cherchent à trouver de façon
autonome de nouvelles solutions pour transmettre leur propre patrimoine. Pour
que la culture puisse être condensée et transmise le plus
efficacement possible, ces institutions doivent constituer un ensemble
cohérent et être liées par un système
d'interrelations. Et le numérique peut en faciliter les usages. Prenons
les exemples des bibliothèques et des musées, cités plus
haut. Dans le fond, ces deux institutions exercent les mêmes fonctions au
sein du système culturel : ils en sont les conservateurs. Nous pourrions
donc envisager de les connecter par la voie numérique : une application
pourrait par exemple mettre en relation la base de données d'un
musée et celle d'une bibliothèque. Puisque les vestiges
archéologiques et les textes parlent d'un même objet, l'histoire,
il est nécessaire de les relier pour mobiliser toutes les sources dont
notre patrimoine dispose sur cet objet. Ainsi, aux musées des Beaux-Arts
de Lausanne, l'utilisateur de l'application pourrait observer le tableau du
massacre de la Saint-Barthélémy de François Dubois tout en
lisant les mémoires de Marguerite de Valois sur
l'événement, conservés à la BnF (Annexes, Fig. 15).
Ce n'est que l'une des nombreuses innovations que les liaisons
institutionnelles et le modèle collaboratif proposé par Museomix
pourraient permettre.
20
CONCLUSION
Le concept Museomix et les mécaniques sociales et
technologiques qu'il mobilise ouvrent de nouvelles perspectives dans la
façon de penser l'évolution du système culturel. Le nombre
toujours plus croissant des musées qui y participent est significatif
d'un réel besoin d'élargir le processus d'innovation culturelle
à l'ensemble de la société. En donnant la parole aux
acteurs extérieurs du musée, l'institution ouvre ses portes
à des idées neuves qui sauront séduire un visiteur
lassé par l'image poussiéreuse qu'elle
véhicule42. La dynamique de travail qu'insuffle
l'événement possède également le potentiel de
transformer en interne les méthodes professionnelles d'un musée,
régies par l'autorité hiérarchique et bien souvent
réfractaires aux idées extérieures.
En observant avec précision le déroulement d'une
édition, nous comprenons qu'il ne s'agit pas uniquement de créer
des prototypes qui seront exploitables et exploités par les
musées. Il s'agit aussi d'une mécanique sociale : de
véritables communautés qui partagent une même vision de
l'avenir se forment à cette occasion. Des communautés qui
investiront par la suite d'autres espaces et qui dissémineront leur
idéologie un peu partout ailleurs. Car, même si les prototypes
représentent le résultat matériel d'une édition,
les liens sociaux créés lors de l'opération sont
essentiels à la multiplication et au renforcement des communautés
Museomix. Dans un premier temps, tout l'enjeu est la diffusion de cet esprit
collaboratif. Plus ce dernier touchera d'individus, plus grandes seront les
communautés et donc les chances d'obtenir des résultats
matériels probants.
Malgré les problèmes identifiés lors de
cette étude, Museomix possède un très grand potentiel
d'innovation. Les structures qui reprennent sa démarche l'ont d'ailleurs
bien compris. Les BiblioRemix en sont un exemple frappant. Bien entendu, cette
dimension collaborative pourrait être déclinée dans
quantité d'autres domaines, mais celui de la culture s'y prête
particulièrement bien. Comme chacun possède son patrimoine
familial et souhaite le développer, le patrimoine national n'est qu'une
extension de ce système et il appartient à tout le monde de
l'améliorer en apportant sa pierre à l'édifice. Le
modèle collaboratif fourni par Museomix n'est qu'une esquisse d'un
schéma beaucoup plus vaste. Une fois que les institutions l'auront
poussé davantage, il sera alors possible de répliquer ce
modèle entre elles. La culture aura alors atteint une dimension tout
autre et les possibilités d'utilisation seront immenses.
La septième édition de Museomix aura lieu les
10, 11 et 12 novembre prochain. La notoriété du concept suit la
logique de sa courbe d'évolution : l'événement se tiendra
dans huit pays (France,
42
http://www.museomix.org/wp-content/uploads/2013/06/rapport-inmediats.pdf
21
Brésil, Belgique, Italie, Espagne, Suisse, Autriche et
Mexique) et continuera de former de nouvelles communautés. Nous sommes
impatients d'observer les résultats qu'il produira.
ANNEXES
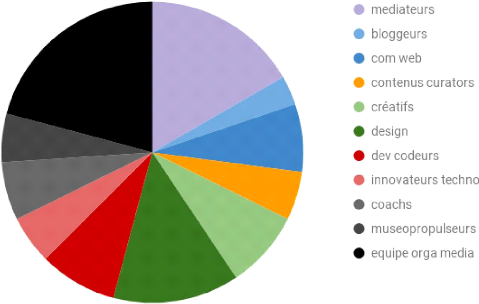
22
FIG. 1 : PROPORTIONS DES PROFESSIONS DES PARTICIPANTS DE
MUSEOMIX (2011)
23
FIG. 2 : PREMIÈRE ÉDITION DE MUSEOMIX AUX ARTS
DÉCORATIFS DE PARIS (2011)
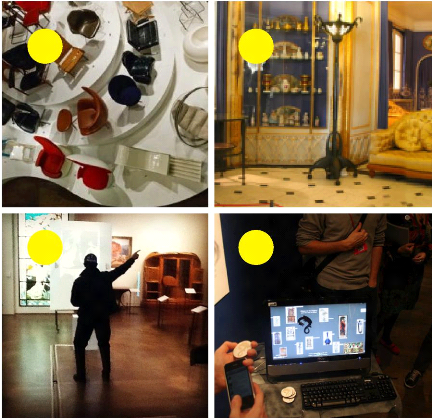
|
The Place to Seat : Choisir un fauteuil sur Museotouch, se
prendre en photo sur ce siège, retrouver son profil en ligne et
l'échanger.
Savez-vous garder un secret ? : Une mise en ambiance sonore et
interactive de l'appartement de Jeanne Lanvin.
La danse serpentine : Une installation des chevaux modernistes
permettant au public de faire danser une représentation de Loïe
Fuller.
Opération Dragon : Le visiteur est invité à
participer à une quête avec un objet liant (une lampe torche) qui
va l'emmener à travers différents espaces du musée.
|
24
FIG. 3 : LE PROJET STRAT (2011)

Lorsque les pieds du visiteur touchent le marqueur au sol, des
commentaires sonores se
déclenchent et content l'histoire de l'oeuvre
que l'on observe.
FIG. 4 : PARTICIPATION FINANCIÈRE DU PUBLIC POUR
MUSEOMIX SUR ULULE (20H)
|
Menu
|
+ Proposer un projet
|
ulule
|
Q Rechercher Se connecter
|
|
500 €
collectés sur un objectif de 500 €
|

Financé le 15 nov. 2011
Créateur
Museomix
 1 proles créé
® Envoyer un message
Museomix : 3 jours pour (re)mixer le
musée
Soutenez Museomix !

Q 0 commentaire Q 16 contrlbuteurs
0 news
Auk Arts Oëcorati1s
11,12,13 noue!nbre 2011
Acruell
f museomix
G
·
3 jours pour
(ré tnuenter
le musée
à l heure du numérLque
25
https://fr.ulule.com/museomix-vernissage/
26
FIG. 5 : ÉVOLUTION DE L'ENGOUEMENT INTERNATIONAL POUR LE
CONCEPT MUSEOMIX
ET LA CULTURE COLLABORATIVE (2011-2015)
Nombre de musées museomixés
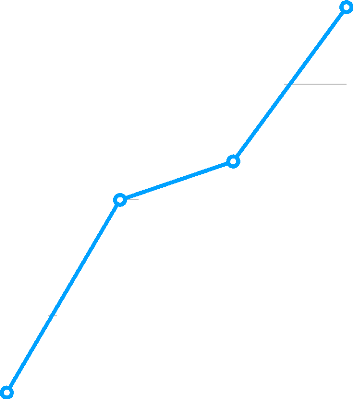
12
9
6
3
0
2011 2012 2013 2014 2015
27
FIG. 6 : BRAINSTORMING ET SCÉNARIO UTILISATEUR DU PROJET
ODORAM(O)A, JOUR 1
(GRASSE, 2016)

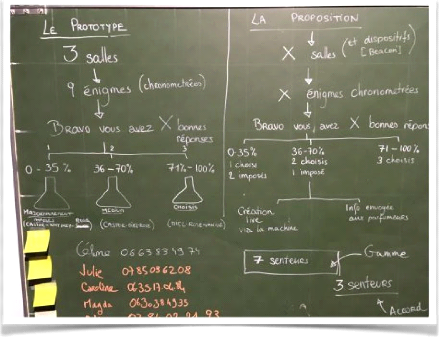
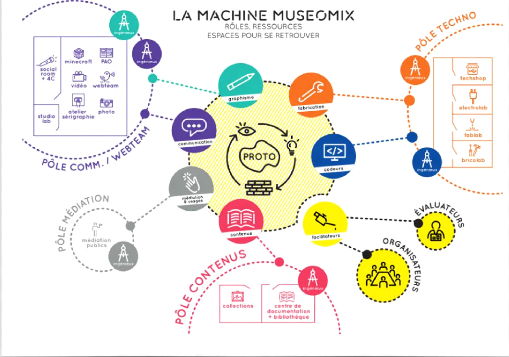
Collection{
centre de
doeumantelien
bibliolhfqu
·
LA MACHINE MUSEOMIX,
RÔLES, RESSOURCES
ESPACES POUR SE RETROUVER
min aft P®
social
ü oom
· IC
atelier photo
;WOO~rigrOphi--...
lab
·
f
1xNI,olfurY f
O
RG
·,
'`
·~'s
f ; m
^ 1
·
·
28
FIG. 7 : ARTICULATION DES ROLES SUR LES DIFFÉRENTS
PÔLES PENDANT LES TROIS
JOURS (EXEMPLE DE MUSEOMIX RENNES, 2015)
FIG. 8 : INVITATION DU PALAIS DU TAU AUX VISITEURS POUR
OBSERVER LES PROTOTYPES
PRODUITS PAR LES MUSEOMIXEURS (2016)
|
A PRÉPARER SA VISITE ACTUALITÉS EXPLORER
|
ACCUEIL CENTRE OEa - +.
· 4
MORTONQ FR ) MONYMENTS NRIIYNRYM~ LE
RÉSEAU
|
Paa.a,1la.-anoll1: olu,cv
aa?alaisduTau
BILLETTERIE
HORAIRES
ACCÈS
Q"
RÉSEAU SOCIAUX
SERVICES
CONTACTSI
VUSEOV X 2016 AU PALAIS DU TAU
Ti NOVEMBRE 2016 >13 NOVEMBRE 2016 ÉVÉNEMENT
Rendez-vous le dimanche 13 novembre à partir de 15h
pour découvrir des prototypes innovants créés pour vous.
L'entrée est gratuite pour La us.
1,14USEOMIX
EST
29
Le monument change ses horaires traditionnels dimanche 13
novembre et ouvre exceptionnellement et gratuitement de 15h a 18h à
l'occasion de museomix I
En effet, à l'issue des trois jours de travail intense,
le public pourra découvrir les prototypes créés pour
eux.
MUSEOMIX, QU'EST-CE-QUE C'EST ?
30
FIG. 9 : CONCEPT ET TWEET DE L'ÉQUIPE « L'HYDRE DE
SAINT-RAYMOND » LORS DE LA
PRÉSENTATION DU PROTOTYPE
AUPRÈS DU PUBLIC (2016)


31
FIG. 10 : TWEET DE MUSÉOMIX OCCITANIE
PYRÉNÉES CONCERNANT LA PÉRENNISATION DE DEUX PROTOTYPES
PAR LE MUSÉE SAINT-RAYMOND DE TOULOUSE (2017)
32
FIG. 11 : LE PROTOTYPE YODO (YOU ONLY DIE ONCE)
SÉLECTIONNÉ POUR ÊTRE
PÉRENNISÉ PAR LE
MUSÉE SAINT-RAYMOND DE TOULOUSE (2016)
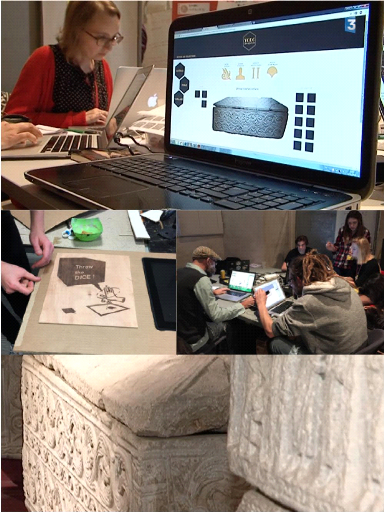
33
FIG. 12 : LE PROTOTYPE L'APPÂT SON PROPOSÉ PAR
LABOMUSÉE (2016)
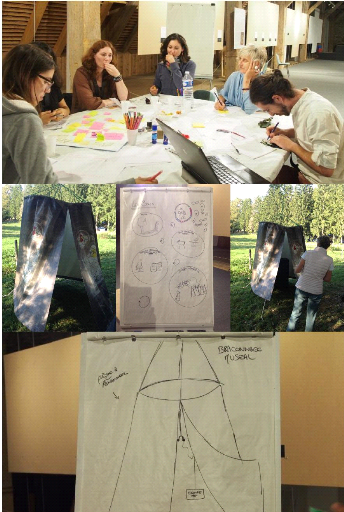
34
FIG. 13 : PROJET UN COLLÈGE SUR MESURE PROPOSÉ
LORS DE LA PREMIÈRE
ÉDITION D'EDUMIX (2017)
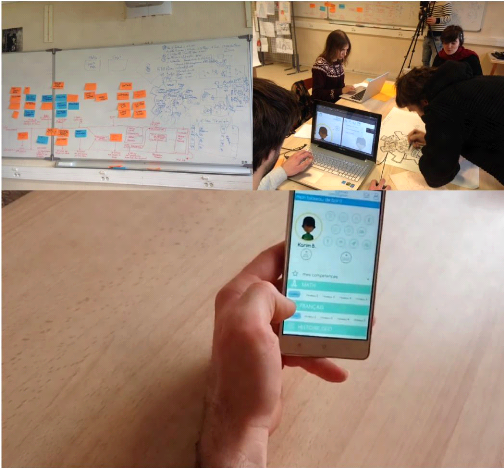
35
FIG. 14 : TWEET DE LA BNF INVITANT LE PUBLIC À VOTER
POUR LE MEILLEUR
PROJET LORS DE L'ÉVÉNEMENT BIBLIOREMIX
(2017)


36
FIG. 15 : PERSPECTIVES D'INTERCONNEXION ENTRE
BIBLIOTHÈQUES ET MUSÉES
PAR LE NUMÉRIQUE ET LA CULTURE
COLLABORATIVE
37
ENTRETIEN
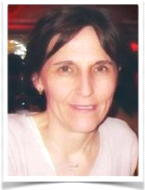
Entretien téléphonique réalisé avec
Catherine Barra, chercheuse-archéologue (INRAP), museomixeuse depuis
2013 et représentante de Museomix Ile-de-France. Le 7 octobre 2017.
De quel constat a émergé
l'idée de Muséomix et de cette notion de culture collaborative
qui manquait à l'univers muséal ?
« Les fondateurs ont un jour décidé qu'il
fallait monter quelque chose de nouveau dans les musées, endroits
souvent considérés comme trop fermés et
poussiéreux. Le musée des arts déco à Paris a
accueilli la première édition en 2011. La caractéristique
première de Museomix, c'est la mentalité nouvelle qu'il fait
émerger, matérialisé par la manière de travailler
qui est différente, où il n'y a pas de hiérarchie, et qui
mobilise une équipe pluridisciplinaire qui peut monter des projets sans
validation administrative, donc très vite. Pendant 3 jours, la
créativité n'est pas bridée : des personnes qui ne se
connaissent pas se rassemblent, écrivent leur scénario et
réalisent leur prototype en toute liberté. »
Comment Museomix est-il parvenu à
pénétrer de plus en plus de musées ?
« Cela remonte à l'année 2012 où,
après le succès de l'édition de l'année
précédente, beaucoup de candidats se sont portés
volontaires, mais très peu ont été
sélectionnés en raison de l'espace prévu pour le seul
musée que nous avions. Nous avons donc décidé d'essaimer
l'événement et de trouver plus de musées pour
l'accueillir. Des communautés locales se sont créées par
l'impulsion d'anciens muséomixeurs. L'organisation a changé : au
départ, les fondateurs étaient au pilotage, mais depuis 2016,
nous sommes passés dans un fonctionnement d'interco :
c'est-à-dire que les communautés gèrent leur
opération par une organisation horizontale. Des réunions sont
d'ailleurs régulièrement organisées par les
communautés pour penser l'évolution du concept à
l'échelle locale.
Museomix a aussi impressionné les politiques dans les
petits musées. Par exemple, dans le musée de Guéret,
habitué à accueillir très peu de visiteurs, lorsque 150
personnes sont arrivées et qu'elles ont créé des
prototypes pour ce musée, cela montrait qu'il possédait un
potentiel culturel. A l'inverse des grands musées qui comptent plusieurs
centaines de milliers de visiteurs par an, Museomix compte pour
38
ces petites structures : il leur donne de la visibilité
et elles peuvent ainsi trouver des investissements futurs pour réaliser
d'autres projets ou pour pérenniser les prototypes créés
pour l'occasion. »
Et le rôle du public dans tout ça
?
« Le public a une place centrale dans les Museomix. Non
pas en tant qu'acteurs, mais en tant que consommateurs. Tous ces dispositifs
sont créés pour le public. Hormis les professionnels du monde
muséal, la plupart des participants de l'événement font
aussi partie de ce public. Pour chaque projet, ils se questionnent : «
Cela m'apporterait-il une expérience muséale différente ?
». Le but premier de l'opération, c'est le partage avec le public.
Il est le cobaye et le coeur du système. L'idée est toujours de
proposer quelque chose qui améliorera son expérience et qui le
poussera à s'engager un peu plus dans le domaine culturel. »
A travers la chronologie de vos différentes
éditions, avez-vous observé des évolutions dans les
mentalités sur le plan de la collaboration dans le milieu de la culture
?
« D'un point de vue institutionnel, Museomix a
réussi le tour de force de rallier à sa cause le ministère
de la Culture, qui est maintenant l'un de ses partenaires. Mais le concept
peine malgré tout à pénétrer les musées, qui
le trouvent trop exigeant : l'accueillir implique de trouver un budget et de
confier son espace à un grand groupe de personnes qui va le
désordonner pendant quelques jours. »
Selon vous, Museomix peut-il transformer les
méthodes de travail d'un musée qui l'a accueilli
?
« Museomix ne peut pas ne pas laisser de traces. On ne
peut pas accueillir 150 personnes le week-end, s'impliquer à fond avec
elles pour bâtir des projets concrets qui peuvent changer les choses, et
retourner au même endroit le lundi sans que cette énergie n'ait
impacté le personnel. Lorsque je suis allée au musée
d'Arles en 2014, je me suis aperçue que quelque chose avait
changé. Museomix avait laissé des traces : le personnel se
sentait plus important. Les filles de l'accueil avaient participé
à la mixroom à Arles, à savoir des interviews de
museomixeurs réalisées dans un petit studio. Nous avons
proposé à ces filles de faire les camerawomen. D'après
Fabrice, un employé du musée d'Arles, l'ambiance était
vraiment différente après Museomix. Et c'est tout à fait
normal : pendant l'opération, les « petites
39
mains » sont valorisées, elles se rendent compte
qu'elles sont importantes aussi et qu'elles peuvent participer au processus
créatif. »
Après Museomix, que deviennent les prototypes
?
« Les prototypes sont présentés aux
visiteurs pendant 1 semaine. Certains musées choisissent par la suite de
les pérenniser, mais le matériel servant à les
réaliser pour l'occasion est prêté par des fab-lab et
d'autres structures, il faut alors le rendre. Pour les développer, le
musée va donc budgétiser le projet, et proposer des appels
d'offres. Légalement, les modèles construits pendant Museomix
sont sous la licence Creative Commons. En choisissant de pérenniser les
prototypes, le musée s'engage à les identifier à leurs
créateurs, soit les museomixeurs.
Il est fréquent que les projets soient
pérennisés. Mais cela prend du temps car, une fois que Museomix
est terminé, la `vie réelle' reprend son cours ainsi que les
démarches administratives qui l'accompagnent. Certains musées ont
choisi de garder parmi leurs collections un certain nombre de prototypes : le
musée dauphinois, par exemple, a pérennisé l'an dernier un
prototype de l'édition de 2013. A Arles a été
pérennisé le prototype Antik.en.Kit qui permet au
visiteur d'explorer un contenu vidéo mêlant images du monument
aujourd'hui et à l'époque pour observer son évolution. Au
musée d'art et d'archéologie de Guéret, deux prototypes
créés en novembre 2015 vont aussi être
pérennisés : le MuSeo-teaSinG de l'équipe des Cartonniers
et le Museocluedo de l'équipe des Mythos, sous forme d'application
téléchargeable sur le portable du visiteur pour ce dernier.
»
Le modèle collaboratif proposé par
Museomix a-t-il inspiré d'autres structures ?
« Oui. Depuis 2011, beaucoup de structures ont repris
cette démarche. Par exemple, des Biblioremix se sont montés dans
quantités de bibliothèques. La BNF, quant à elle, a
organisé un hackathon sur le modèle de Museomix. Un autre concept
découlant de Museomix sont les Edumix, qui visent à remixer des
collèges. Hack My Church, créé par d'anciens
museomixeurs, a été mis en place à Lyon et a
cherché à transformer l'église en lieu de prières
numériques à travers des interfaces graphiques qui faisaient
monter les prières vers le ciel. Tous ces exemples ne sont qu'une partie
de ce qu'a inspiré Museomix. »
- Propos recueillis par Joris Astier,
7 octobre 2017.
40
SOURCES MOBILISÉES
ÉTUDES
Belaën Florence, « L'immersion dans
les musées de science : médiation ou séduction ? »,
Culture & Musées, n°5, 2005, p. 91-110.
Chaumier Serge, Françoise
Camille, « Museomix : l'invention d'un musée du XXIe
siècle », La Lettre de l'OCIM, 156, 2014.
Chaumier Serge, La médiation
culturelle, Armand Colin, « Collection U », Paris, 2013.
Côté Michel, «
Préface » dans Lucie Daignault, Bernard Schiele, Les
musées et leurs publics : savoirs et enjeux, Presses universitaires
du Québec, Québec, 2014.
Daignault Lucie, L'évaluation
muséale : savoirs et savoir-faire, Presses universitaires du
Québec, Québec, 2012.
Gélinas Dominique, « Le sensorium
synthétique : réflexion sur l'utilisation de l'expographie
immersive numérique et muséale », Conserveries
mémorielles [En ligne], #16 | 2014, mis en ligne le 25 septembre
2014, consulté le 08 octobre 2017. URL :
http:// cm.revues.org/2000
Introna Lucas, Kavanagh
Donncha, Kelly Séamas, Orlikowski
Wanda, Scott Susan (eds.), Beyond Interpretivism?
New Encounters with Technology and Organization, Springer, New York,
2016.
Kuhn Timothy, Ashcraft L.
Karen, Cooren François, The Work of
Communication: Relational Perspectives on Working and Organizing in
Contemporary Capitalism, Routledge, New York, 2017.
Rasse Paul, Le musée
réinventé. Culture, patrimoine, médiation, CNRS
éditions, Paris, 2017.
WEBOGRAPHIE
ARTICLES MÉDIAS
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/20140818trib000844827/le-numerique-reinvente-la-consommation-culturelle.html
41
http://www.lemonde.fr/arts/article/2014/11/07/museomix-le-marathon-creatif-connecte-remixe-les-musees_4520468_1655012.html
http://www.ladn.eu/news-business/actualites-agences/museomix-remixe-les-musees/
https://actu.epfl.ch/news/museomix-to-take-over-the-artlab-building/
http://www.20minutes.fr/rennes/1729779-20151113-rennes-marathon-creatif-week-end-musee-bretagne
http://www.internetactu.net/2012/11/15/les-dispositifs-creatifs-en-questions-12-ce-que-la-creativite-libere/
http://www.liberation.fr/ecrans/2014/01/09/domaine-public-camille-claudel-en-3d-sur-ta-cheminee_971343
http://www.letelegramme.fr/finistere/plougastel-daoulas/biblioremix-penser-la-bibliotheque-de-demain-23-03-2017-11445602.php
RAPPORTS INSTITUTIONNELS
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/158462/1722777/version/2/file/
MCC_20170303_DP-Mus%C3%A9es-XXI%C3%A8me-si%C3%A8cle.pdf.
http://www.museomix.org/wp-content/uploads/2013/06/rapport-inmediats.pdf
http://fablab-leman.fr/wp-content/uploads/2017/01/FabLac-RapportActivités-2015-16.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000331.pdf
http://www.bnf.fr/documents/170529_biblioremix_reglement.pdf
SITES INTERNET
http://www.erasme.org
http://www.museomix.org/ http://blog.sebastienmagro.net/
http://saintraymond.toulouse.fr/ https://archeomuse.eu/
https://cehistoire.hypotheses.org/ https://labomusee.fr/
http://www.edumix.fr/ http://www.enssib.fr/ https://biblioremix.wordpress.com/
http://www.bnf.fr/ https://fr.ulule.com/
RÉSEAUX SOCIAUX
https://www.facebook.com/Museomix/
https://twitter.com/museomix
https://www.flickr.com/photos/museomix/
https://twitter.com/biblioremix
https://www.youtube.com/watch?v=QT1et9NqQg8
http://museomix.tumblr.com
ENTRETIEN RÉALISÉ AVEC CATHERINE BARRA,
CHERCHEUSE-ARCHÉOLOGUE ET REPRÉSENTANTE MUSEOMIX IDF. LE 7
OCTOBRE 2017.
| 


