
 |
à‰tat des lieux de l'oeuvre des ONG internationales dans la région centre du Cameroun de 1960 à 2010.( Télécharger le fichier original )par Judith Tsafack Institut des Relations Internationales du Cameroun - Master 2013 |
Source: Tsafack Judith 52 Les organisations n'ont pas toutes fournies les informations demandées, ce qui explique la présence des cases vides dans ce tableau. 50 1) Selon les critères identitaires Les OING établies dans la région du Centre sont en très grande majorité des associations à caractère laïc et apolitique. Du point de vue de leur nature, on peut y voir une certaine homogénéité. Toutefois, on peut les distinguer non seulement selon la période à laquelle elles se sont installées au Cameroun, mais aussi en fonction des rapports qu'elles entretiennent avec leur Etat d'origine. ? La période d'établissement La législation nationale en matière d'associations a connu une certaine évolution. La loi de Juin 1967 y relative a été abrogée par celle de décembre 1990, elle-même complétée par celle de Juillet 1999. On distingue alors d'un côté les OING installées au Cameroun avant 1990 c'est-à-dire sous l'ancienne loi, et de l'autre, les organisations présentes après Décembre 1990, donc sous le régime de la loi actuelle. Des résultats de cette étude, il ressort que des 23 OING répertoriées, 9 d'entre elles soit 37% se sont installées au Cameroun avant 1990 contre 15 représentants 63% pour celles installées au Cameroun après cette date. Avant 1990 A partir de 1990
58% 42% Graphique 1: Répartition des OING selon la période d'établissement au Cameroun Lorsqu'on y regarde de plus près, il apparaît que le choix de la période d'établissement est plus lié au contexte socio-économique ambiant qu'au cadre légal national. Certes, la loi de 1990 a probablement offert un cadre plus propice à l'installation des ONG étrangères au Cameroun. Cependant, l'analyse poussée des résultats nous permet de penser que les ONG 51 actives avant 1990 (France Volontaires, COE, Catholic Relief Services, SNV, INADES53 et FAIRMED) se sont installées pour certaines quelques années après les indépendances afin de contribuer au développement économique et social du jeune Etat qu'était le Cameroun en ce moment. Certaines ont même connu une évolution : c'est le cas de France Volontaires qui s'installa dans la région du Centre sous le nom de l'AFVP (Association Française des Volontaires du Progrès). La SNV par exemple était une Association de Volontaires Néerlandais (SNV comme sigle de Stichting Nederlandse Vrijwilligers en Néerlandais). Plus tard, elle est passée à l'organisation de coopération néerlandaise pour devenir Organisation néerlandaise de développement. Nous constatons que ces OING installées au Cameroun après les indépendances ont évolué avec le développement du Cameroun et ont pour certaines changé leur nom en fonction des facteurs soient internes à l'organisation, soient internes au pays dans lequel elles exercent. Quant aux organisations installées à partir de 1990 qui représentent d'ailleurs plus de la moitié du nombre total d'OING, il est logique de penser que les programmes d'ajustements structurels (PAS) auxquels les Etats africains entre autres le Cameroun, ont été soumis à la fin des années 1980 ont eu un effet dévastateur plongeant les populations camerounaises dans la pauvreté. A travers les PAS, les Institutions Financières Internationales (Banque Mondiale et Fonds Monétaire International) ont obligé le Cameroun à effectuer de nombreuses coupes budgétaires dont les populations en sont devenues les principales victimes. En réalité, les années 1990 marquent un tournant décisif dans la compréhension des questions de sous-développement et de lutte contre la pauvreté. A l'inverse de la décennie 80 qualifiée de « perdue » par divers théoriciens hétérodoxes du développement, elles ont été caractérisées par un changement considérable dans la réflexion sur le « marché » du développement et les méthodes pour le promouvoir. Les enseignements tirés de l'échec des PAS, conjugués aux innovations dans le domaine des théories économiques, institutionnelles, politiques et sociales ont débouché sur une nouvelle perspective qui semble être caractérisée par une compréhension plus large et plus intégrée du développement54. C'est dans cette optique d'une compréhension plus étendue du développement que s'inscrivent dès lors la plupart des initiatives et politiques de coopération au développement en faveur des populations des pays dont les économies ont subi de telles 53 Inades Formation, certes organisation transnationale (africaine), est classée parmi les ONG internationales dans le cadre de cette étude. 54 DIOUBATE Badara., Histoire et fondements théoriques de l'économie du développement, Op Cit. 52 détériorations. Il s'agit désormais de prendre en compte la nécessité de soutenir les pays du tiers-monde dans la correction des méfaits causés par la mise en place dans ces pays des programmes de développement inadaptés, et qui se sont avérés au final contre productifs. C'est également pourquoi la société civile du Nord manifeste son élan de solidarité vis-à-vis de celle du Cameroun en créant des branches de certaines organisations occidentales au Cameroun avec pour but d'améliorer les conditions de vie des populations qui subissent cette pauvreté. ? Les rapports avec l'Etat d'origine Selon Pierre MICHELETTI, les associations de solidarité internationale peuvent être distinguées en fonction de la nature des rapports qu'elles entretiennent avec leur Etat d'origine. Dans ce cas, on en distingue trois principaux types : y' Le modèle rhéno-scandinave ayant des relations fortes avec leurs Etats (Ex. Suède, Danemark). y' Le modèle anglo-saxon où l'on a affaire à des ONG plus libérales dans l'esprit et dans la logique de leur financement. y' Modèle méditerranéen hérité des thèses de De Tocqueville au XIXè siècle : les ONG se positionnent comme des outils de contre pouvoir.55 Dans le cadre du Cameroun en général et dans la région du Centre en particulier, la troisième catégorie de cette typologie est tout à fait inexistante. Les OING se positionnant comme des outils de contre pouvoir sont beaucoup plus présentes dans les grandes démocraties occidentales, où il règne un rapport de force dynamique entre les autorités gouvernementales et les diverses entités de contradiction. Dans notre contexte, seuls les deux premiers types d'organisation sont présents. En effet, au regard de la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association, l'article 4 précise que les actions des associations doivent être conformes à la Constitution, aux lois et aux bonnes moeurs, et ne doivent pas porter atteinte à la sécurité, à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, à l'intégration nationale et à la forme républicaine de l'Etat. En outre, étant donné qu'au Cameroun, les associations (autre que les partis politiques) sont tenues de conserver un caractère apolitique, quand bien même une association étrangère traiterait des questions politiques dans son pays d'origine, en s'installant au 55 MICHELETTI Pierre, Les enjeux contemporains de l'action humanitaire non gouvernementale, IRIC, CA2D, 2012. 53 Cameroun, elle se doit de respecter la législation en vigueur. Par conséquent, elle ne saurait s'immiscer dans des questions politiques au point de se positionner comme un outil de contrepouvoir. Toutefois, cette disposition ne les empêche pas de mener des actions de plaidoyer auprès des autorités étatiques. La répartition en fonction des diverses catégories est précisée dans le diagramme ci-dessous. La plupart de ces organisations sont de type anglo-saxon (Plan Cameroon, WWF, Sight Savers, MSF, Planète Urgence, VSO, Geoaid Cameroon, SOS villages d'enfants). Elles jouissent d'une certaine autonomie vis-à-vis de leurs Etats d'origine. C'est pourquoi une partie considérable des initiatives prises l'est de façon indépendante de l'Etat d'origine. C'est donc une collaboration directe entre les sociétés civiles du Nord et celles du Sud. Les ONG d'origine américaine telles que Counter Part International, Management Sciences for Health, International Medical Corps, Global Viral Forecast Initiative appartiennent au modèle rhéno-scandinave. Leurs ressources financières proviennent principalement du gouvernement américain soit directement des départements d'Etat, soit de l'Agence Américaine d'aide au développement USAID. 2) Selon les critères d'effectivité Les critères ici présentés portent sur les modalités d'action des OING dans la région d'étude. Ils prennent en compte le champ d'action, les visées que se fixent lesdites structures, le type de population auxquelles elles s'intéressent, leurs capacités humaines et même financières. ? Les domaines d'intervention Ces organisations agissent dans la région du Centre dans des domaines assez divers. Leurs initiatives répondent à des besoins identifiés soit directement par les populations auprès desquelles elles interviennent, soit par les organisations elles-mêmes, ou encore en fonction des priorités définies par le gouvernement. Si certaines OING mettent l'accent sur un volet bien précis, d'autres par contre couvrent des champs d'intervention multiples. Il s'agit notamment de l'éducation (l'accès à l'éducation primaire pour les populations les plus défavorisées, et dans une moindre mesure, la qualité de l'éducation secondaire) ; les droits de la personne humaine (avec une insistance sur les droits des catégories vulnérables telles que les femmes, les enfants, la jeune fille, les minorités) ; le genre ; le développement local ; les problématiques environnementales 54 (environnement et conservation) ; la recherche et production (en vue de la mise en place d'un savoir-faire et des solutions adaptées aux exigences du contexte) ; la santé (notamment la lutte contre le VIH/SIDA, la santé maternelle et infantile, l'éradication des maladies liées à la pauvreté, l'accès pour tous aux soins de première nécessité...) ; l'eau et l'assainissement ; l'humanitaire ; les questions de gouvernance (lutte contre la corruption, liberté d'expression...) ; l'agriculture (formation aux techniques agricoles et aux métiers du secteur agropastoral...). Le tableau ci-dessous (fig.1) récapitule les divers domaines dans lesquels interviennent les structures identifiées. 55 Tableau 2: Matrice d'intervention des OING présentes dans le Centre
Source: Tsafack Judith 56 La lecture de cette matrice nous permet de constater qu'un accent particulier est mis sur les domaines identifiés comme étant les plus sensibles. Il est important de remarquer que ces aspects sont tous liés aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) dont le but principal est de réduire l'état de précarité dans lequel vivent certaines populations de la planète. Parmi ceux-ci, on retrouve la santé (OMD 4 : Réduire la mortalité infantile, OMD 5 : Améliorer la santé maternelle, OMD 6 : Combattre le VIH/Sida, le paludisme et d'autres maladies) ; l'éducation (OMD 2 : Assurer l'éducation primaire pour tous), le développement (OMD 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement), l'environnement (OMD 7 : Assurer un environnement durable). Le graphique ci-dessous représente une répartition des divers domaines d'intervention en fonction de leur importance. Graphique 2: Répartition des OING par domaine d'intervention
Urgences 7% Eau et 6% Gouvernance 4% Agriculture 4% VIH/SIDA Répartition par domaine d'activité Santé 24% 12% Education 14% Droits de l'Homme 10% Environnement 7% Développement local 12% Source : Judith Tsafack Ce diagramme nous montre que 24% des OING présentent dans le Centre interviennent dans le domaine de la santé, 14 % dans l'éducation, 12% dans le VIH/SIDA, 12% également dans le développement local. S'agissant de la santé et le VIH/SIDA, cet engouement des OING est en partie justifié par l'intensité de la lutte contre cette pandémie qui touchait 5,5% de la population camerounaise en 2004 et le paludisme dont le taux de 57 prévalence national était d'environ 40% la même année.56 A cela s'ajoute la prise en charge de la santé maternelle et infantile. D'ailleurs, selon le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE), le nombre de femmes qui décèdent à la suite d'un accouchement au Cameroun est passé de 430 à 669 pour 100.000 naissances entre 1998 et 2004. Nous notons ainsi une dégradation de la situation sanitaire qui appelle à une intensification des efforts de la part des différents acteurs en matière de santé. De plus, le domaine de la santé à lui seul est évoqué dans trois OMD à la fois (OMD 4 : Réduire la mortalité infantile, OMD 5 : Améliorer la santé maternelle, OMD 6 : Combattre le VIH/Sida, le paludisme et d'autres maladies), et le rôle des OING consiste entre autres à la poursuite de ces objectifs, ce qui peut justifier qu'elles soient un certain nombre à se préoccuper de ces questions. Il en ressort également que 12% de ces organisations interviennent dans des questions de développement local. Dans le cadre des thématiques d'intervention, le terme développement local désigne l'ensemble des actions dont le but immédiat est l'augmentation du niveau de revenu des populations locales. Une telle proportion justifie la précarité dans laquelle vivent les populations de notre région d'étude. Si le niveau de vie dans la ville de Yaoundé semble relativement élevé, on ne saurait faire le même constat pour les autres départements. En outre, dans la région, il existe un besoin réel de maîtrise et réduction du taux de chômage des jeunes. Quant à l'éducation, elle mobilise 14% des OING, l'éducation primaire constituant la principale priorité. Malgré une légère hausse du taux de scolarisation primaire au Cameroun entre 2001 et 200757, il faut reconnaître que la qualité de l'éducation continue de poser problème. En plus, le poids de la culture camerounaise contribue à la sous-scolarisation de la jeune fille, ce qui pousse un nombre considérable d'organisations sensibles à la question du genre à s'intéresser à l'éducation de la jeune fille. La protection de l'environnement dans l'ensemble occupe également une place de choix parmi les objectifs définis. 7% de la population étudiée y consacre des activités. On retrouve d'ailleurs pas moins de trois organisations spécialisées sur les questions liées à l'environnement. En effet, cet intérêt des OING pour l'environnement peut se justifier par l'augmentation des atteintes à la biodiversité (exploitation abusive des ressources forestières, le braconnage...). Néanmoins, leurs interventions dans la région du Centre concernent beaucoup plus l'appui au gouvernement en matière de définition des stratégies de protection 56 Institut National de la Statistique, Rapport Enquête Démographique et de Santé Cameroun (EDSC), 2004. 57 Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi, Cameroun, 2009. 58 de l'environnement et des espèces menacées, les actions de terrain se focalisant sur d'autres régions. Les droits de la personne humaine, l'eau et l'assainissement ainsi que l'assistance humanitaire font l'objet d'un certain intérêt (23% pour les trois réunis). Les sujets les moins traitées sont ceux relatifs à la gouvernance et à l'agriculture58. Ces secteurs réunis intéressent moins de 10% des structures recensées. Si cette répartition selon les domaines d'activités révèle une certaine pertinence, d'autres facteurs peuvent être pris en compte pour effectuer cette classification. ? Les ressources humaines Les OING présentent dans le Centre agissent parfois dans des domaines similaires, mais leurs actions n'ont pas nécessairement une ampleur identique. Celle-ci varie notamment en fonction des capacités d'intervention de l'une ou l'autre structure. Pour évaluer ces dernières, l'on pourrait se référer à un indicateur de capacité, à l'instar de la dotation en ressources humaines qui constitue une clé du succès des actions de ces organisations. L'observation de la réalité de l'oeuvre des ONG internationales dans la région Centre du Cameroun révèle une grande disparité en termes de personnel déployé. En effet, elles emploient plus d'un millier de personnes, sans distinction de genre avec une moyenne d'environ 73 employés par organisation. L'histogramme ci-dessous montre une répartition des organisations en fonction du nombre d'employés recensés.59 58 Le secteur agricole camerounais est pourtant en pleine effervescence, mais ici, l'Etat agit en collaboration principalement avec les institutions internationales et interétatiques ainsi que les organismes de coopération. Au niveau national, il fait participer les collectivités territoriales ainsi que les ONG et associations nationales. 59 Le personnel dont il est question concerne l'ONG dans son ensemble, les employés peuvent donc être affectés à des tâches effectuées dans des régions autres que le Centre. Par ailleurs, une distinction n'a pas été faite entre le personnel permanent salarié d'une part, et le personnel temporaire non salarié d'autre part, constitué de volontaires, bénévoles, stagiaires. 59 Graphique 3: Effectif des employés par OING
418 35 36 6 31 17 71 143 2 11 38 50 42 140 Source : Judith Tsafack Il ressort de cette représentation que, dans la région du Centre, l'on peut distinguer en fonction du personnel employé d'une part des structures qui comptent plus d'une centaine d'employés, et que l'on peut qualifier de « grandes » OING, il s'agit de l'Association COE (41%), Plan Cameroun (14%), WWF (14%). D'autre part des « petites » structures qui comptent quant à elles moins d'une trentaine d'employés à l'instar de Inades Formation (2%), GVFI (2%), Geoaid (1%), Helen Keller (1%), France Volontaires (1%), Planète Urgence (moins de 1%). Cette hétérogénéité apparente s'explique part le fait que certaines « grandes » structures mobilisent un effectif considérable afin de faire face à leurs besoins d'intervention dans des domaines assez variés. De plus, leurs zones géographiques d'intervention couvrent plusieurs régions du Cameroun dans lesquelles elles possèdent parfois des bureaux. C'est le cas par exemple de : ? Associazione COE (Zone d'intervention : Centre, Nord, Ouest, Extrême-Nord, Littoral. Bureaux régionaux : Mbalmayo, Garoua, Bafoussam, Douala). ? Plan Cameroon (Zone d'intervention : Centre, Est, Nord-ouest, Nord, Adamoua et Extrême-Nord. Bureaux régionaux : Yaoundé, Bertoua, Bamenda, Garoua et Maroua). ? WWF (Zone d'intervention : Centre, Est, Sud, Sud-ouest. Bureaux régionaux : Yokadouma, Campo'o Man, Jengi). A l'opposé, d'autres organisations, les « petites », optent pour des tâches beaucoup plus ciblées, généralement dans un domaine bien spécifique requérant une expertise certaine. 60 Ces structurent utilisent alors un personnel dont l'effectif est beaucoup moins important, mais avec des qualifications beaucoup plus poussées. Elles se constituent dès lors comme un soutien technique pour le gouvernement et leur rôle consiste ainsi à conseiller les instances publiques sur les décisions à prendre, à les accompagner dans l'exécution des décisions prises et à jouer un rôle de plaidoyer lorsque ces dernières s'écartent de ce qui est considéré comme la norme à suivre. Il faut également observer qu'il s'agit pour certaines d'entre elles, des organisations de volontariat international. Elles utilisent un modèle qui selon elles ne nécessitent pas absolument un effectif élevé au niveau du Cameroun. Elles sont tout simplement des plateformes d'interface entre les organisations locales nécessiteuses d'une expertise donnée et le volontaire qui est disposé à mettre ses connaissances et compétences au profit de l'organisation locale identifiée par l'OING. Les volontaires quant à eux, viennent souvent d'un pays étranger, la France pour Planète Urgence et depuis quelques années, de plusieurs pays du monde en ce qui concerne France Volontaires. Nous constatons que les organisations de volontariat international disposent d'une petite équipe de coordination au Cameroun. Les volontaires sont soit des salariés en Occident qui profitent de leur congé pour mener une action sociale au Cameroun, soit, de jeunes volontaires qui viennent séjourner au Cameroun pour une durée d'un à deux ans afin de mettre leur connaissance au profit des organisations locales, et en retour acquérir une expérience professionnelle. D'autres par contre, bien qu'installées dans la région du Centre, n'y mènent aucune action. Leurs locaux de Yaoundé servent en effet de bureau de coordination. C'est le cas de VSO, Counter Part International .... Les ressources humaines peuvent également être scindées en fonction de la nationalité d'origine. On peut distinguer d'une part les employés nationaux, d'autre part, les employés internationaux. De manière générale, 94% des employés sont des camerounais, alors que seuls 6% sont d'origine étrangère. C'est dire que ces structures prennent en compte le capital humain local dans la réalisation de leurs activités. Nous constatons ainsi que dans l'ensemble, les OING font plus recourt au personnel local qu'au personnel international. D'un côté, on peut se dire que le personnel international, généralement à des postes de management coûte extrêmement cher pour l'organisation. Et d'un autre coté, l'Etat du Cameroun se rassure lors de la signature de l'Accord d'Etablissement de l'OING au Cameroun qu'elle emploiera à une certaine proportion la main d'oeuvre locale. Ce personnel varie en fonction des domaines d'intervention. On y retrouve des spécialistes de la santé pour celles exerçant dans le domaine de la santé et du VIH Sida, les spécialistes de l'éducation pour le domaine de l'éducation, des 61 ingénieurs pour la thématique Eau et Assainissement, des juristes pour des questions de droits de l'Homme, des Ecologistes, Environnementalistes et Socio économistes pour des questions de Conservation et environnement, des sociologues, anthropologues et économistes pour des questions de développement, pour ne citer que ceux-là. A cela, s'ajoute le personnel administratif et financier. Il faut préciser ici que les locaux sont présents à tous les niveaux de responsabilité et occupent quelquefois des positions hiérarchiques considérables notamment celles de Directeur national : COE (Mr MBARGA Georges Alex), Fairmed (Dr UM BOOCK), INADES Formation Cameroun (Mme MBEZELE Elisabeth Epse MBALLA)... L'aspect genre retient également notre attention dans cette étude. Des treize OING ayant répondu à la question sur le nombre d'hommes et femmes employés, nous constatons qu'elles emploient 62% d'hommes contre 38% de femmes. Nous constatons ainsi que, si certaines d'entre elles accordent une attention particulière à l'aspect genre dans le recrutement du personnel, il n'en est de même pour d'autres. Spécifiquement, le COE est celle qui prend le plus en compte l'approche genre dans le recrutement de son personnel. Graphique 4: Répartition du personnel des OING en fonction du genre Approche Genre
FEMMES 38% HOMMES 62% Source : Judith Tsafack Contrairement à ce qui est constaté dans la majorité des cas, le COE emploie 214 femmes contre 204 hommes, soit 67%, donc plus de femmes que d'hommes ! Ceci pourrait se justifier non seulement par le souci d'équilibre entre les genres, mais aussi et surtout par la nature des thématiques dans les quelles cette organisation intervient. Il s'agit notamment la santé, l'éducation, la formation professionnelle en Industrie d'Habillement (IH) et l'Economie Sociale et Familiale (ESF). Apparemment, ce sont des domaines qui font considérablement appel à une main d'oeuvre féminine (infirmières, aides-soignantes, institutrices, enseignantes 62 d'ESF et IH). Dans cette même logique, Counter Part International emploie environ 46% de femmes et Sight Savers International en compte 36%. Si la prise en compte des ressources humaines donne une idée assez précise des capacités d'intervention de ces structures, l'analyse de leurs ressources financières apporte un complément d'information indispensable à une étude pertinente. ? Les ressources financières Les ressources financières sont une condition sine qua none au fonctionnement de toute structure, entreprise, organisation et les OING ne sont pas en reste. Si les capacités en termes de personnel déployé permettent une certaine évaluation de l'ampleur de l'action des OING dans le Centre, la prise en compte des moyens financiers mobilisés pour la réalisation des différentes actions donne également un aperçu assez révélateur de l'étendue de leur oeuvre. L'histogramme60 ci-dessous présente la répartition des OING en fonction de leurs capacités financières. Il prend en compte uniquement la moyenne du budget annuel de chaque structure. Graphique 5: Ressources financières par OING Budget annuel moyen (en euros)
Source : Judith Tsafack 60 Seules les organisations ayant acceptées de nous fournir leurs données financières sont présentées dans ce graphique. 63 Dans cet histogramme, on constate une certaine divergence quant aux ressources financières mobilisées. L'ensemble des OING ici considérées réuni un montant d'environ 30 millions d'euros par an, pour une moyenne de près de deux millions et demi d'euros par structure. Cette statistique ne ressort pas toutefois la grande variabilité que l'on peut constater d'une organisation à l'autre. Parmi les 23 OING répertoriées desquelles 18 nous ont accordé une collecte d'informations, une moyenne de 60% a accepté de nous fournir des informations sur leur budget annuel ainsi que les sources de financement. Pour d'autres, les informations financières sont des données sensibles qu'elles ne souhaitent pas partager. Le budget le plus considérable est celui de Plan Cameroon qui tourne autour de huit millions et demi d'euros (5 milliards de FCFA), soit plus du triple de la moyenne !61 Dans cette catégorie, on retrouve d'autres organisations à l'instar du WWF avec plus de quatre millions et demi d'euros (3 milliards de FCFA), Counter Part nantie à peu près de la même dotation financière, et trois millions d'euros (un peu plus de 1,9 milliards de FCFA) pour la SNV. Par ailleurs, on retrouve également des ONG avec des budgets beaucoup plus modestes comme Inades Formation qui dispose 305 000 euros (soit environ 200 millions de FCFA) et Planète Urgence avec 200 000 euros (plus de 131 millions de FCFA)... Cette disparité entre les différentes enveloppes budgétaires s'explique d'une part par les méthodes de mobilisation des ressources financières, et d'autre part par le poids des partenaires financiers. Ainsi, certaines OING possèdent des mécanismes assez variés pour la récolte fonds ou plutôt d'accès au financement. Pour la plupart, elles reçoivent un financement de base et de façon régulière de leur siège. En plus de ces financements s'ajoutent les diverses subventions, les contributions des particuliers et des entreprises. A côté de cela, certaines dans le cadre des partenariats avec les bureaux nationaux62 de l'ONG en Occident, reçoivent des fonds pour le financement des projets précis, c'est le cas de Plan Cameroon et du WWF. Des OING telles que Counter Part International et la SNV reçoivent des fonds du gouvernement de leur pays d'origine, respectivement le Département d'Etat américain à l'Agriculture et la Direction Générale de la Coopération Internationale du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères (DGIS). De cette étude, il ressort également que la crise financière en Europe a eu un impact considérable sur les budgets des OING et elles 61 Seul le budget annuel global est pris en compte ici. Abstraction est faite des autres paramètres de comparaison. Une répartition par projet aurait été plus pertinente, mais elle a été rendue impossible du fait de l'inaccessibilité d'une telle statistique auprès des structures enquêtées. 62 Les bureaux nationaux sont des représentations nationales de l'ONG. Elles se retrouvent généralement dans les pays dits du Nord. Leur travail consiste à mobiliser des fonds dans leurs pays pour soutenir les bureaux programmes qui se trouvent dans les pays en développement. 64 réfléchissent désormais à nouer des contacts avec de nouveaux partenaires financiers, à des alternatives qui pourront leur permettre de traverser cette période difficile. Outre cette classification qui nous a permis de prendre conscience du profil pluriel des OING que l'on retrouve dans notre région d'étude, l'environnement dans lequel elles évoluent constitue également une donnée qui permet de rendre compte fidèlement de leur action. Paragraphe B) Environnement et partenariatEvaluer l'effectivité de la participation des OING dans le développement de la région du Centre nécessite que l'on prenne également en considération non seulement l'environnement dans lequel évoluent ces dernières, mais aussi la nature et même la qualité des partenariats noués avec les divers acteurs impliqués dans la réalisation de leurs différentes actions. 1) Description de l'environnement Dans le Centre, le cadre dans lequel se déploient les diverses OING regorge de particularités et de spécificités dont la nature se répercute systématiquement sur la qualité et même la portée des actions menées. Ainsi, il convient de dresser le portrait de cet environnement en ressortant principalement ses aspects singuliers, aussi bien sur les plans juridique et politique, qu'économique, voire social. ? Environnement politico-juridique Du point de vue juridique, l'exercice des activités des OING a connu une certaine évolution au cours de notre période d'étude. En effet, ce n'est qu'en 1967 que la loi n°67/LF/19 du 12 juin 1967 sur la liberté d'association entre en vigueur. Elle constitue alors le fondement de l'oeuvre des OING au Cameroun, et servira de référence quant à leurs modalités d'existence et même de fonctionnement, et ce, pendant plus d'une vingtaine d'années. Suite au vent de démocratisation qui va souffler sur l'ensemble du continent dans les années 90, la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association viendra abroger la précédente. Elle opère une distinction entre d'une part les associations étrangères (dont les OING) et les associations religieuses qui sont soumises au régime d'autorisation, et d'autre part les autres associations fonctionnant quant à elles sous le régime de la déclaration.63 Elle sera modifiée et complétée par la loi n°99/011 du 20 juillet 1999 qui 63 Loi N° 090/50 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association au Cameroun, Op Cit. 65 précisera que : « Les partis politiques, les syndicats, les associations sportives et les organisations non gouvernementales sont régies par des textes particuliers » (Article 5 (4) nouveau). ? Environnement socio-économique Le Cameroun est progressivement sorti de son évolution politico-économique timorée des années 1960 pour engager une décennie de croissance forte entre 1975 et 1986. Au cours de cette période, il engage une tentative de modernisation et de développement essentiellement basée sur l'action directe ou indirecte de l'Etat. En dépit des transformations suscitées par cette croissance, le Cameroun ne parvient pas toujours à utiliser de manière optimale ses ressources agricoles ou minières (cacao, café, coton, bois, pétrole, etc.) pour moderniser et diversifier son économie et pour la faire asseoir sur un appareil industriel modernisateur et mobilisateur. Progressivement, la crise s'installe entre 1985 et 1986, conduisant à un long processus d'ajustement structurel entre 1988 et 2008 dont le pays aura beaucoup de mal à sortir. En 1994, dévaluation du Franc CFA contribuera à l'accentuation de la détérioration économique du Cameroun. Même après avoir récupéré une certaine marge de manoeuvre avec l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE en mai 2006, le pays ne s'est pas toujours installé dans une véritable stratégie autonome de sortie de la crise par une politique économique de post-ajustement. Ces évènements ont contraint le Pays à réaliser prioritairement les objectifs d'équilibre des finances publiques, au détriment des préoccupations d'industrialisation visant la création de la valeur ajoutée et des besoins sociaux des populations. 2) Les différents partenariats Dans l'accomplissement de leurs diverses tâches, les ONG n'agissent pas nécessairement de manière solitaire. Elles peuvent s'associer soit à l'administration publique à travers ses démembrements ministériels, soit à d'autres organisations non gouvernementales, qu'elles soient internationales ou nationales, soit aux organisations internationales (OI). ? Partenariat OING À Etat Le partenariat avec l'Etat (départements ministériels, services déconcentrés, collectivités territoriales décentralisées) est primordial pour toute action des ONG présentes sur le territoire national. En réalité, la principale raison d'être de ces structures dans notre 66 pays est de soutenir le gouvernement dans la réalisation de ses principales missions, en vue de la promotion d'un véritable développement économique et social. A cet effet, elles se situent comme des partenaires privilégiés de l'action gouvernementale dans leurs divers domaines d'intervention. S'il est vrai que le mouvement associatif constitue un secteur à part entière ayant ses propres structures et motivations, il est cependant caractérisé par un intérêt constant pour les politiques publiques L'étude réalisée montre que la grande majorité de ces structures juge fructueux le partenariat avec l'Etat. Les rapports entre les OING installées dans le Centre du pays et l'Etat camerounais restent très dynamiques. Le fait que ces structures appuient les autorités nationales dans leurs politiques de développement ne remet aucunement en cause leur autonomie. En effet, les OING agissent conformément à leur identité. Les résultats de l'enquête ont montré que 64% de ces organisations étaient de type anglo-saxon, c'est-à-dire que leur fonctionnement est indépendant de leurs Etats d'origine. Le partenariat ainsi établi est une collaboration égalitaire où chacune des parties apporte sa contribution dans la poursuite des objectifs fixés. Dans le cas de certaines structures assez spécialisées, elles effectuent un travail d'expertise qui permet d'éclairer l'action publique et préciser des pistes d'intervention claires. D'autres par contre disposent d'une solide expérience et de capacités reconnues pour des travaux de terrain. Du point de vue financier, il a été constaté que la majeure partie du financement de ces structures provenait soit des fonds propres, soit des dons privés, soit des financements octroyés par des organisations internationales pour la réalisation des projets précis. Certes, l'Etat accorde des subventions à travers ses départements ministériels qui interviennent dans des domaines spécifiques, mais cette contribution reste marginale. Les OING dans le Centre ont ainsi conservé toute leur autonomie financière vis-à-vis de l'Etat. Faire le constat d'une telle synergie n'exclue en rien l'existence des points de discorde, de la perplexité, de la suspicion entre ces deux entités. En réalité, il faut reconnaître que la perception réciproque des acteurs OING/Etat a évolué avec le temps. Si les débuts ont été marqués par une certaine méfiance envers ces organisations étrangères, ce climat quelque peu ombrageux a progressivement cédé le pas à une amélioration et une harmonisation des rapports. Néanmoins, les procédures règlementaires et administratives constituent encore un obstacle pour certaines organisations qui les trouvent complexe, bien que la plupart des responsables se réservent de les commenter. La question de la gouvernance reste également un point soucieux pour les OING qui financent des activités menées par l'Etat dans le cadre de ce partenariat. 67 ? Partenariat OING À OING Outre la collaboration qu'elles établissent avec l'Etat, ces structures ont mis en place des partenariats avec d'autres OING, afin de mener des actions coordonnées, et donc plus efficaces, quoi que cette forme de collaboration soit plutôt timide. Plusieurs causes peuvent justifier un tel rapprochement. D'une part, la nature toujours limitée des budgets face aux activités à mener. En réalité, les tâches à exécuter demandent la mobilisation de moyens colossaux en termes financiers et logistiques. En plus, il est fréquent de remarquer que plusieurs organisations interviennent dans des domaines très similaires. Afin de promouvoir une utilisation plus efficiente de leurs ressources, chacune se consacre alors à des tâches spécifiques, mais complémentaires à celles effectuées par les autres. D'autre part, le rapprochement entre ces différentes structures peut s'expliquer par la pluralité des leurs compétences. Puisqu'elles interviennent dans des domaines variés, une seule d'entre elles ne pourrait couvrir complètement un projet qui nécessite des expertises diverses. Alors chacune y participera selon ses compétences. Toutefois, il faut relever que cette collaboration n'a pas toujours été de mise. En effet, elle a été quelque fois perturbée par la course aux financements qui amenait les OING à se cacher mutuellement des informations sur les bailleurs, les fonds alloués aux projets, etc. Cependant, quelques responsables d'OING nous ont rapporté que ces relations se sont améliorées au fil du temps. En effet, ces acteurs comprennent de plus en plus la nécessité d'une meilleure coordination de leurs actions. Sous l'initiative de Barro Famari, Directeur National de Plan Cameroon, un forum de concertation des OING a été crée au Cameroun 2012 et vise entre autres le partage des informations, la coordination des actions, le renforcement des capacités du personnel des organisations membres. Il s'agit jusqu'ici d'un regroupement informel, accessible à toutes les OING opérant au Cameroun. A côté de ces formes de collaboration sus-évoquées, un autre type de partenariat liant OING et OI prend progressivement de l'ampleur. ? Partenariat OING - OI Dans le cadre de cette étude, nous entendons par OI, principalement la Banque Mondiale et certaines organisations du système des Nations Unies. Le partenariat OING À OI est très développé au Cameroun surtout pour des organisations (OING et OI) qui interviennent dans les mêmes domaines. 68 Nous avons ici quelques exemples de projets qui sont le fruit d'un partenariat OING-OI réalisés pour certains dans la région du Centre et autres régions du Cameroun pour d'autres : le Projet Violence Against Girls financé par ONU Femmes et mis en oeuvre par Plan Cameroon ; le Projet d'Appui au Secteur Educatif au Cameroun, financement de la Banque Mondiale au gouvernement camerounais et mis en oeuvre par plusieurs OING entre autres Plan Cameroon, Catholic Relief services ; le Projet d'Assistance aux refugies urbains de Yaoundé et ses environs, financé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et mis en oeuvre par Plan Cameroon, pour ne citer que ceux-là. Cette autre forme de partenariat prend de l'ampleur et concerne des projets aux ressources considérables. On constate ainsi une certaine complémentarité entre les organisations nées de conventions internationales et les organisations qui sont des entités non étatiques. Dans cette forme de partenariat, les OI fournissent les ressources financières tandis que les OING se chargent de la mise en oeuvre du projet. S'il est vrai que l'étude de la participation effective des OING au développement de la région Centre du Cameroun passe par une catégorisation de ces dernières et les rapports qu'elles entretiennent avec leurs différents partenaires, la prise en compte des actions concrètes qu'elles réalisent constitue la clé de voûte de cette analyse. Section II) Les réalisations des organisations internationales non gouvernementales dans la région du Centre duCamerounLe constat fait au cours de cette étude nous a révélé que la grande majorité des structures identifiées, bien qu'ayant leurs principaux sièges dans la région du Centre qui abrite la capitale politique du Cameroun, conduisent le clair de leurs initiatives dans d'autres régions. Il sera présenté ici les quelques-unes qui sont déployées dans la région qui nous intéresse. Par ailleurs, il est assez délicat d'identifier des actions menées par une organisation unique à l'endroit des populations cibles. Dans la plupart des cas, ces actions sont le résultat d'une synergie entre plusieurs OING ou entre une OING et l'Etat, à travers un département ministériel ou une agence spécialisée et couvrent très souvent des domaines divers, dont certains sont considérés comme prioritaires (A) et les autres moins sollicités (B). 69 Paragraphe A) Les domaines dits prioritairesLes initiatives menées au profit des populations varient très souvent en fonction des types de besoins, des capacités d'action prenant en compte les ressources disponibles et même des domaines ciblés. S'agissant de ces domaines, la priorité qui leur est accordée varie, ne serait-ce qu'en partie, en fonction de l'analyse situationnelle faite par chaque structure et des priorités qu'elle s'est définie suite à celle-ci. 64 Ceux-ci ne sont pas considérés comme prioritaires de façon purement arbitraire, mais suite aux résultats issus de l'analyse des données liées à notre étude, car ce sont ceux qui font l'objet du plus grand intérêt de la part des différentes OING. Il s'agit principalement de la santé y compris le VIH/SIDA (1), du développement local et de l'éducation (2) qui concentrent plus de la moitié des initiatives (62%). 1) La santé y compris le VIH/SIDAEn matière de santé, plusieurs structures ont posé des gestes remarquables dans la région du Centre. Ces actions sont axées sur l'approvisionnement en soins médicaux, la protection maternelle et infantile, la lutte contre les maladies tropicales négligées et le prise en charge des personnes infectées, la lutte contre le paludisme, la tuberculose ... Concernant le VIH/SIDA, ces initiatives sont principalement orientées vers la prévention, le dépistage et le traitement des personnes infectées. Parmi celles-ci, on retrouve le COE qui est à l'origine de multiples actions en faveur des populations de cette région en matière de santé. On y compte la création de l'Hôpital Saint Luc de Mbalmayo, le Centre de santé Monseigneur Jean ZOA. L'Hôpital Saint Luc de Mbalmayo reçoit des patients provenant de l'ensemble du Cameroun et même des pays voisins et se fixe plusieurs objectifs, notamment le renforcement de la participation à la lutte contre les grandes endémies (VIH/SIDA et paludisme) et le renforcement de la lutte contre la cécité évitable dans les régions du Centre et du Sud Cameroun. Les services accordés couvrent des domaines aussi variés que les soins de santé primaires et les services spécialisés. Dans le cadre de ces activités, le COE bénéficie du soutien de plusieurs partenaires locaux (le Ministère de la santé publique, le Comité National de Lutte Contre le Sida, le Centre International de Recherche Chantal Biya) et étrangers (le fonds D, la province autonome de Trente, le ministère italien des affaires étrangères). 64 On peut considérer qu'un cadre international existe et qui définit les priorités en matière d'action de coopération au développement, il s'agit des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui sont au nombre de huit. 70 Le Centre de santé Monseigneur Jean ZOA quant à lui reçoit des patients provenant de l'aire de santé et du district de santé de Nkoldongo et des autres districts de santé de la ville de Yaoundé. Les activités menées sont diverses et se rapprochent étroitement de celles menées par l'Hôpital Saint Luc de Mbalmayo avec une innovation dans la réalisation de la médecine alternative et par les techniques de rééquilibrage énergétique. La mise en place de cette structure a connu l'implication de divers partenaires entre autres l'Organisation Catholique de la Santé au Cameroun, le MINSANTE, l'Ecole catholique des infirmiers de Yaoundé, le Centre pasteur de Yaoundé ; l'Organisation de Coordination pour la lutte contre les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC)65 ; le Ministère Français des Affaires Etrangères ; les Hôpitaux de Toulouse. Pour la réalisation de ces actions, l'apport financier de certains bailleurs de fonds a été enregistré parmi lesquels l'Etat du Cameroun, la Fondation Lambriana de Milan et certaines communautés italiennes. Une autre structure à intervenir dans le domaine de la santé dans la région du Centre est la fondation Helen Keller International (HKI). Elle intervient notamment dans la lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN) les plus en vue (onchocercose, filariose lymphatique, schistosomiase ou bilharziose, vers intestinaux, trachome). Bien que ses actions couvrent l'étendue du territoire national, des gestes précis concernent la région du Centre. Ainsi, HKI soutient le MINSANTE dans sa stratégie de lutte coordonnée et intégrée contre ces cinq MTN. HKI en partenariat avec la coalition des ONG de développement et de lutte contre l'onchocercose et les MTN, les organisations des Nations Unies, appuient le MINSANTE dans l'organisation des distributions de masse intégrée des médicaments dans les communautés et en milieu scolaire ; afin, soit d'éliminer la maladie (onchocercose, filariose lymphatique, trachome) soit de réduire la morbidité (schistosomiase, vers intestinaux). A cet effet, diverses activités ont été menées parmi lesquelles l'assistance pour le renforcement du système de santé et le renforcement des capacités des personnels de santé à tous les niveaux, des membres de la communauté et des enseignants ; l'assistance à la commande des médicaments ; l'amélioration des outils de collecte et de gestion des données ; l'assistance au raffinage de la cartographie des maladies ; l'assistance aux activités de suivi-évaluation. Médecins Sans Frontières (MSF) intervient également dans le domaine de la santé. OEuvrant au Cameroun depuis 1984, elle l'une des premières ONG à avoir introduit les 65 OCEAC: Organisation de Coordination et de Coopération pour la lutte contre les Grandes Endémies en Afrique Centrale. 71 traitements antirétroviraux dans le pays à travers différents projets menés dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA66. Dans la région du Centre et particulièrement à Akonolinga, MSF prend en charge les patients souffrant de l'ulcère de Buruli67. Le projet démarre en 2002 et vise l'amélioration de la prise en charge globale et la diminution de la souffrance causée par cette infection. Le pavillon Buruli, devenu un centre fonctionnel important, insiste sur la détection précoce, la formation du personnel sanitaire et la coopération inter-acteurs. En 2008, MSF introduit les pansements nouvelle génération qui facilitent la cicatrisation des plaies. SOS villages d'enfants Cameroun travaille également dans le domaine de la santé dans notre région d'étude. En 1998, le Dispensaire SOS Hermann Gmeiner de Mbalmayo lance ses activités ayant pour objectif la protection maternelle et infantile. Ce centre médical propose des services de vaccination, des conseils en matière d'hygiène, de nutrition et de premiers secours. Il apporte également un soutien social, psychologique et thérapeutique aux enfants et aux jeunes du village d'enfants. Ce centre participe aussi aux programmes nationaux de santé en collaboration avec le MINSANTE au travers des services de santé de district de Mbalmayo. La lutte contre le VIH/SIDA constitue également un enjeu prioritaire au sein de l'unité médicale SOS de Mbalmayo. Ce centre propose aux familles touchées par VIH/SIDA des conseils pour améliorer leur hygiène de vie ainsi que des tests de dépistage et le traitement aux antirétroviraux. Par ailleurs, CARE Cameroun a mené des actions dans le cadre du projet PRISIDA (Prévention des IST/VIH/SIDA sur les axes routiers auprès des camionneurs et des populations riveraines). Ce projet financé par l'Agence Canadienne de Développement International (ACDI), à hauteur de 2 milliards de Francs CFA couvrait l'étendue du territoire national (y compris la région du Centre). Débuté en 2004 et achevé en 2009, il avait pour principal objectif de contribuer à la réduction de la propagation des IST/VIH/SIDA chez les populations riveraines des principaux axes routiers, auprès des camionneurs de longue distance et des femmes libres. A cet effet, des activités ont été mises en oeuvre, notamment l'identification des besoins en développement de capacité des sites en matière de la prise en charge syndromique des IST ; la mise en place d'un stock initial de médicaments dans chaque centre de santé ; la sensibilisation des structures de santé sur l'importance d'inclure les besoins et les perspectives des femmes dans la prise de décisions affectant les services qui 66 Médecins Sans Frontières, Médecins Sans Frontières au Cameroun, Brochure de présentation, 2012. 67 L'Ulcère de Buruli, Maladie Tropicale Négligée (MTN), est une infection apparentée à la tuberculose et à la lèpre et peut causer des blessures des blessures douloureuses et des déformations physiques entraînant souvent une stigmatisation sociale. 72 leurs sont offerts ; le suivi et l'évaluation des activités des structures d'encadrement des personnes infectées et la formation des responsables des structures et leaders communautaires à la gestion, aux aspects Égalité des Sexes, et aux différents aspects de la communication pour le changement de comportement. 2) L'éducation et le développement localPour améliorer la qualité de l'éducation, le COE a crée plusieurs établissements scolaires dans la ville de Mbalmayo dont l'école maternelle et primaire « l'Espoir », le Collège Nina GIANETTI ainsi que le foyer du Centre de Promotion Sociale. La première se donne pour objectif de former et préparer les enfants au certificat d'études primaires (CEP) pour leur insertion au cycle secondaire et à la vie. Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités sont mises en oeuvre, notamment le suivi et l'encadrement des élèves tout au long de leur cycle maternel et primaire. Plusieurs acteurs se sont constitués en partenaires de ces actions, notamment le Secrétariat à l'Education du diocèse de Mbalmayo, le Centre d'Animation Sociale et Sanitaire de Yaoundé. Par ailleurs, le financement de ces activités a été rendu possible grâce au soutien du Diocèse de Mbalmayo, la participation des familles des enfants, diverses communautés italiennes. Quant au collège Nina GIANETTI, son principal objectif est de fournir aux jeunes tous les moyens sains leur permettant de découvrir leurs capacités, de se prendre en charge pour assumer leur existence de manière responsable et faire face aux sollicitations de la vie. Les principales activités menées portent sur la couverture des programmes d'enseignement officiel ; la formation continue des enseignants; le suivi psychosocial des élèves ainsi que l'orientation scolaire et l'organisation des conférences-débats sur plusieurs thèmes formatifs. Toutes ces activités se sont déployées dans le cadre d'un partenariat avec le Service Catholique de l'Education du diocèse de Mbalmayo, le Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC). SOS villages d'enfants Cameroun mène également des actions en faveur de l'éducation dans la région du Centre. Elle y possède deux institutions scolaires à savoir un jardin d'Enfants SOS et une Ecole Primaire SOS Hermann Gmeiner. Les deux institutions accueillent les enfants du village SOS de Mbamayo, mais également les enfants des communautés environnantes. Elles comptent environ une centaine d'enfants à la maternelle et environ 300 élèves au primaire. Ces institutions scolaires ont pour objectif de garantir à tous les enfants du village SOS et du Programme de renforcement de la famille, un accès à une 73 éducation de qualité, indépendamment de leur sexe, leur origine, leur religion, leurs capacités, leur état de santé ou leur situation dans tout autre domaine. A travers le programme bourse scolaire, SOS villages d'enfants Cameroun soutient les familles défavorisées, afin que leurs enfants aient accès à l'éducation, en les aidant à financer les frais de scolarité, le matériel scolaire et didactique. L'encadrement scolaire dans les écoles SOS est guidé par les principes de l'éducation formelle à savoir, l'enseignement centré sur l'enfant, le soutien aux parents d'élèves, l'investissement dans la qualité des enseignements, l'efficacité et la coopération avec les partenaires pour garantir la continuité et participer au renforcement de la justice sociale. SOS vient ainsi en appui au gouvernement à travers la création des institutions scolaires dans les localités où sont implantés des villages d'enfants notamment Mbalmayo, pour la région du Centre. Parmi les actions de développement local, l'Institut Africain pour le Développement Economique et Social (INADES) au Cameroun, y a oeuvré de façon significative dans la région du Centre. Pour contribuer à l'amélioration des revenus des paysans et particulièrement des femmes, des actions d'appui sont menées dans le cadre du projet d'appui à la commercialisation des produits agricoles par INADES Formation Cameroun depuis 2006, en faveur des petits producteurs dans deux régions du pays, notamment à l'Est et au Centre. Dans cette dernière, un point d'honneur a été mis sur le désenclavement de la localité d'Edzendouan car, malgré le fort potentiel de production de la zone, elle est longtemps restée inaccessible aux transporteurs et acheteurs du fait du mauvais état des pistes locales et l'inorganisation des producteurs. Ces derniers ont été structurés en unions de GIC et un dispositif d'évacuation des produits vivriers a été mis en place. La mobilisation permanente des producteurs a permis l'entretien manuel de 32 Km de piste et les bénéficiaires du projet ont été soutenus, de manière ponctuelle, grâce au partenariat avec l'Association des Communicateurs et Rédacteurs de l'Agroalimentaire (ACRA) via le financement de l'Union Européenne (UE). Actuellement, plusieurs transporteurs accèdent dans au moins 40% des villages du district, et les revenus des paysans locaux se sont accrus de manière significative. En outre, les groupes ont été accompagnés dans la gestion des revenus issus de la commercialisation de leurs produits ainsi qu'à l'entretien communautaire des pistes rurales. Il faut également noté que des cours par correspondance sont offerts par IFC, notamment le Cours d'Apprentissage Agricole. Dans le même domaine d'actions et en partenariat avec la commune de Mengang, Plan Cameroon a réalisé un projet d'équipements scolaires (salles de classes, des latrines et un forage construit) au profit des populations de la communauté de Mimbang. Voir photographies ci-dessous. Ecole publique de Mimbang, construite et équipée par Plan Cameroon dans la Commune de Mengang.
Photo 2: EP de Mimbang, vue d'ensemble
Photo 4: Devanture d'une salle de classe Photo 1: Approvisionnement de l'école en eau de forage
Photo 3: Intérieur d'une salle de classe Photo 6: Latrines Photo 5: Plaque de l'Ecole Publique de Mimbang Source: Tsafack Judith, Janvier 2012
75 Paragraphe B) Les domaines secondaires et les autres domainesOutre les domaines les plus sollicités que sont la santé y compris le VIH/SIDA, l'éducation et le développement local, les actions des ONG internationales dans la région Centre du Cameroun portent également sur des domaines beaucoup moins en vue tels que les droits de l'Homme, l'environnement, l'humanitaire (1). D'autres structures choisissent de mener quant à elles des actions dans les autres domaines notamment l'eau et l'assainissement, l'agriculture, la gouvernance (2). 1) Les domaines secondairesS'agissant des domaines secondaires, Plan Cameroon a oeuvré pour le renforcement de la participation et l'engagement des enfants et des jeunes dans la région du Centre, afin d'appuyer la construction de la citoyenneté et la démocratie. A cet effet, des centaines d'associations de jeunes ont été mises en place et disposent désormais d'un potentiel leur permettant de bénéficier du Plan de développement de la jeunesse du Cameroun. Concernant les droits des enfants, Plan Cameroon a mis sur pied le projet pilote des droits de l'enfant dont l'une des composantes majeures était de s'assurer que les enfants ont droit à une identité, un nom et une nationalité comme indiqué dans l'article 7 de la Convention des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant (CNUDE). Des plateformes d'actions ont ainsi été créées et renforcées dans les communautés dudit projet (Mengang, Akonolinga, Ngat dans le département du Nyon-et-Mfoumou et Dzeng dans le Nyon-et-So'o). Les enfants ont été formés sur leurs droits et sur les processus électoraux à travers la création des centaines de gouvernements d'enfants dans les écoles. En outre, des forums d'enfants ont été crées et renforcés. Des ONG répertoriées dans le cadre de cette étude, au moins trois d'entre elles (Plan Cameroon, MSF, CARE) ont eu à intervenir dans des activités d'urgence humanitaire dans notre région d'étude. Certes, nous n'avons relevé aucune intervention humanitaire majeure de la part de ces structures au cours de notre période d'étude (ce qui n'exclut en rien cette éventualité), toutefois certaines de leurs actions mériteraient d'être soulignées. Ainsi, MSF et Plan Cameroon sont intervenues lors de l'épidémie de choléra qui a secoué la région du Centre en 2011, respectivement à travers la prise en charge des patients et la distribution des kits sanitaires. 76 Par ailleurs, bien que la thématique environnement retienne l'attention d'un certain nombre d'organisations identifiées (WWF, UICN, WCS) leurs actions de terrain sont principalement menées dans des zones forestières et des réserves naturelles situées en dehors des limites de la région du Centre. Toutefois, elles apportent un appui technique aux départements ministériels en charge des questions environnementales (MINEPDED, MINFOF), aussi bien au niveau central que dans les démembrements régionaux et départementaux des localités où elles interviennent. 2) Les autres domainesConcernant les actions techniques, le COE s'y investit à travers des structures spécialisées telles que l'institut de formation artistique (IFA) et le Centre d'Art Appliqué (CAA) qui forment des artistes chevronnés (voir oeuvres d'art ci-dessous). Situé dans la ville de Mbalmayo, l'IFA participe aussi aux expositions et autres salons d'artisanat dans l'étendue du territoire. Ses élèves proviennent du territoire national et des pays environnants. Ses objectifs sont entre autres d'assurer aux apprenants une formation artistique dans des spécialités diverses telles que la céramique, la peinture, la sculpture et la décoration ; de promouvoir l'enseignement artistique sur l'ensemble du territoire national et dans la sous région d'Afrique Centrale. Parmi les principaux partenaires, on retrouve l'Université Catholique d'Afrique Centrale ; l'Université de Yaoundé1 ; la Société Civile des arts Plastiques; la Libre Académie des Beaux A rts de Brescia en Italie. Photo 7: Atelier de poterie du CAA de Photo 8 : OEuvres d'art du CAA de Mbalmayo Mbalmayo
Source: Foe Ambara, décembre 2012 77 En outre, le CAA situé au sein du centre de Promotion Sociale de Mbalmayo où il a ses ateliers et une salle d'exposition. Il expose aussi ses produits à Douala, à Limbé et à Edéa et ils sont commercialisés dans toute l'étendue du territoire camerounais et dans le monde entier. Il se fixe pour principal objectif l'amélioration de la qualité artistique des objets et produits en sauvegardant les formes et techniques de l'Afrique mises au goût du jour. L'essentiel de l'activité du CAA se déroule au sein de ses 3ateliers : céramique, graphisme et imprimerie. Le CAA fait partie du site touristique du Centre de Promotion Sociale et à cet effet, il accueille divers touristes. Le financement de ses activités provient principalement de la vente des produits du centre. Ci-dessous quelques photos prises à l'IFA de Mbalmayo. CONCLUSIONL'objectif du présent chapitre était de démontrer la participation effective de ces OING au développement de la région Centre du Cameroun. L'identification de ces dernières nous a permis de mettre en lumière la pluralité de leurs différents profils. Un répertoire68 de 23 OING identifiées a été élaboré. De cette étude, il ressort que la grande majorité de ces structures s'est installée au Cameroun après 1990, année de la proclamation de la nouvelle loi sur la liberté d'association au Cameroun, mais aussi et surtout de la remise en cause des PAS et la prise en compte de leurs effets dévastateurs sur les économies du Sud. Il nous a également été donné de constater qu'un accent particulier est mis sur la santé, l'éducation et le développement. Par ailleurs, certaines organisations comptent un nombre considérables d'employés alors que d'autres disposent d'effectifs plus modestes. Certaines structures bénéficient d'un budget considérable, alors que d'autres par contre possèdent une enveloppe réduite qui limite considérablement les actions menées. Pour une meilleure efficacité de celles-ci, ces différentes organisations établissent des partenariats avec l'Etat et d'autres organisations. S'agissant des actions concrètes, un nombre considérable d'initiatives réalisées ont été relevées entre autres dans les domaines de la santé, l'éducation, le développement, les droits de l'Homme... Au vue de ce qui précède, il nous revient de conclure que l'oeuvre des ONG internationales dans la région Centre du Cameroun est une participation effective au développement de ladite région, non seulement à travers les moyens dont elles se dotent, mais surtout du fait des diverses actions qu'elles y mènent. Il convient tout de même d'analyser 68 Ce répertoire présente un certain nombre d'informations sur les ONGI notamment l'adresse, la mission, les domaines d'activités ainsi que les zones d'intervention. Il est disponible en annexe de ce document. 78 leurs insuffisances afin de faire des recommandations susceptibles d'améliorer les résultats obtenus.
CHAPITRE IV : LIMITES ET PERSPECTIVES
D'AMELIORATION
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# |
Les forces |
Les faiblesses |
|
Distribution |
V' Grande représentation des OING dans la région du Centre |
V' Répartition géographique inégale entre les départements de la région ; V' Concentration dans la ville de Yaoundé |
|
Ressources humaines |
V' Recours aux compétences locales ; V' Expertise locale disponible ; |
V' Personnel très réduit pour certaines OING ; V' Postes clefs généralement occupés par le personnel international ou des expatriés localement recrutés ; V' Grand déséquilibre entre la rémunération des expatriés et celle du personnel local. |
|
Ressources financières |
V' Ressources financières considérables dans l'ensemble ; V' Financement régulier en provenance du siège de |
V' Grande disparité dans les budgets des OING ; V' Dépendance aux financements extérieurs ; |

Domaines d'intervention
Communication
l'ONG ;
V' Disponibilité des subventions des bureaux nationaux pour les grandes OING ;
V' Elargissement des sources de financement ;
V' Procédures financières transparentes ;
V' Redevabilité aux bailleurs et aux bénéficiaires comme critère de bonne gouvernance ;
V' Multiplicité de thématiques d'intervention;
V' Priorité accordée à la santé + VIH/Sida, l'éducation, le développement, priorités définies par l'Etat ;
V' Communication active pour
V' Fonds provenant
principalement des pays et bailleurs occidentaux ;
V' Impact de la crise financière en Occident sur les budgets des OING ;
V' Scepticisme de certains contribuables européens vis-à-vis de l'aide au développement.
V' Coûts élevés des opérations ;
V' Dilapidation des fonds en fin d'exercice budgétaire sous prétexte de rapatriement de l'excédent aux bailleurs;
V' Retour des fonds vers les pays d'origine;69
V' Mauvaise gouvernance dans la gestion des fonds.
V' Certains domaines pourtant porteurs (agriculture par exemple) ne sont pas une priorité pour les OING ;
V' Forte présence d'OING (bureaux nationaux) contre une faible proportion d'actions menées ;
V' Insuffisance de coordination des actions dans les mêmes domaines.
V' Faible visibilité des actions
81
69 Il s'agit de la volonté manifeste des OING à recruter un personnel international ressortissant du pays d'origine de l'ONG. Il coûte assez cher pour l'organisation qui consacre finalement une bonne partie de son budget aux dépenses liées au personnel international.
82
|
et visibilité |
||
|
Environnement |
||
|
certaines OING ; V' Envoi des rapports annuels aux Ministères partenaires ; V' Proximité et complicité avec les populations locales. |
||
|
V' Favorable à l'émergence des OING. V' Privilèges accordés par l'Etat ; V' Stabilité politique dans la région ; V' Hospitalité des populations ; V' Capital humain local qualifié et disponible. |
||
|
d'autres OING; V' Sous-information de l'Etat au sujet des activités de certaines; V' Rapports d'activités non transmis de manière systématique au MINADT comme prévu par la loi de 1990. V' Absence des preuves de réalisations ; V' Refus du partage des informations financières pour certaines. |
||
|
V' Insuffisance de coordination des actions ; V' Compétition entre les OING dans la recherche des financements ; V' Priorité de la recherche des fonds sur l'amélioration de la qualité de vie des populations vulnérables. V' Méfaits de la corruption. |
||
|
Rapport avec l'Etat |
Rapports et implication des populations locales
|
V' Bons rapports avec l'Etat dans l'ensemble ; V' Appui de l'action gouvernementale dans les différents domaines d'intervention. |
|
|
V' Rapports de collaboration V' Valorisation des connaissances locales ; V' Implication des populations |
|
|
V' Faible implication des populations dans la conception des projets ; V' Méfiance de la population |

Partenariat
Le savoir local
V' Implication de l'Etat dans la majorité des actions mises en oeuvre dans la région ;
V' Partenariats souvent formalisés par des accords;
V' Existence de nombreux partenariats entre OING et organisations locales ;
V' Partenariats multi-acteurs (Etat/Bailleurs/OING/Associati ons locales).
V' Affirmation par les OING de la prise en compte du savoir local dans l'accompagnement des populations bénéficiaires ;
V' Point de départ de la stratégie de travail dans une communauté pour certaines OING ;
V' Connaissances à valoriser absolument ;
V' Savoir indispensable à la compréhension du contexte local.
locales dans la mise en oeuvre
de leurs activités.
V' Lenteur dans l'octroi de l'agrément;
V' Mauvaise gouvernance comme cause de la durée éphémère de certains partenariats.
V' Sous-estimation du savoir local par les OING;
V' Mauvaises pratiques des populations qui compromettent l'atteinte des objectifs des OING ;
V' Non réceptivité de la part des populations des
pratiques exogènes.
83
Source : Tsafack Judith
A partir de ce tableau, nous constatons qu'autant les ONG disposent de multiples atouts, autant elles font face aux difficultés qui contribuent à l'inefficacité et l'inefficience de leur action. Ces obstacles sont aussi bien d'ordre interne qu'externe. Afin de parvenir à des recommandations, nous procéderons à une analyse des limites imputables aux OING (A) et des obstacles qui relèvent des acteurs locaux (B).
84
L'analyse des forces et des faiblesses des OING oeuvrant dans la région du Centre nous présente un ensemble de facteurs internes qui constitue des limites à leurs réalisations. Ce sont des éléments liés aux organisations et qui méritent une grande attention ainsi qu'un changement afin de les transformer en forces. Nous nous attarderons ici sur leur distribution géographique dans la région d'étude, la sous valorisation des compétences locales, la course aux financements, les thématiques d'intervention, le non respect de la règlementation, l'environnement et la gouvernance, l'insuffisance de visibilité et la durabilité des actions.
i. Distribution géographique des OING
Les OING actives dans la région du Centre sont principalement installées dans le département du Mfoundi et plus particulièrement à Yaoundé. Les 23 organisations répertoriées dans le cadre de ce travail y ont chacune un bureau, et généralement situé au quartier Bastos. Quatre d'entre elles possèdent tout de même des locaux en plus dans d'autres départements de la région, notamment un bureau SOS village d'enfants à Mbalmayo ; un bureau MSF à Akonolinga ; un bureau du COE à Mbalmayo également et un bureau régional de Plan Cameroon au quartier Nkomo à Yaoundé.
Nous constatons ainsi que la ville de Yaoundé représente un obstacle à l'installation des OING dans d'autres départements de la région, probablement du fait de son statut de capitale politique et siège des institutions. S'il est vrai que les bureaux de Yaoundé sont des bureaux de coordination, il est cependant à noter que certaines OING certes installées dans cette ville n'y mènent aucune action, encore moins dans la région. C'est le cas par exemple de VSO, International Medical Corps, Counter Part International, Sightsavers... A priori, l'on peut se dire que les populations pauvres de la région du Centre, entourées d'un nombre considérable d'OING, sont mieux prémunies contre les problèmes de santé, d'éducation, de pauvreté. Mais dans la réalité, la concentration desdites organisation dans la région ne leur est pas nécessairement favorable.
85
ii. Sous valorisation des compétences locales et retour des fonds dans les pays d'origine des OING
Les OING présentes dans la région font à coup sûr recours aux ressources humaines locales. On y retrouve du personnel avec différentes statuts : temporaires, consultants, personnel aux contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il ne devrait d'ailleurs pas en être autrement puisque les accords d'établissement/accords de siège ou encore accords de partenariat entre le gouvernement camerounais et ces OING prévoient généralement des articles sur la priorité à donner au recrutement du personnel camerounais par les OING. « Dans presque tous les arrangements institutionnels, il est spécifié en termes suffisamment clair, que la préférence des recrutements est donnée aux cadres nationaux, en somme aux ressortissants du pays hôte »70. D'ailleurs, si les ressources humaines de ces organisations étrangères sont à 95% constituées du personnel local, généralement de nationalité camerounaise contre 5% de personnel international (exclusivement des expatriés et généralement du pays d'origine de l'OING), il va s'en dire que ce personnel international occupe très souvent les postes stratégiques de l'organisation. Et même si un cadre camerounais se situerait plus ou moins dans la même échelle/catégorie que l'international, il est peu probable que la rémunération des deux catégories de personnel soit la même71. Nous constatons que le personnel international coûte beaucoup plus cher que le personnel local aux mêmes qualifications.72 Le personnel camerounais quant à lui occupe généralement pour les plus nantis de qualification académique et d'expérience professionnelle, des postes de « middle management »73. Ce n'est pour autant pas dire qu'il y ait un manque quelconque des ressources humaines locales hautement qualifiées pour siéger dans la « cour des grands » dans ces OING. Bien plus, certains expatriés arrivés au Cameroun dans le cadre d'un projet particulier et sensés quitter le Cameroun à la fin dudit projet en repartent difficilement. Compte tenu de l'étroitesse du réseau des expatriés des organisations internationales, certains sont tout simplement cooptés par leurs proches exerçant dans les OING et parfois à des postes de très haute responsabilité. Et comme le caractère d'expatrié va avec un traitement exceptionnel, cette catégorie de personnel, bien que recrutée au niveau
70TONME Shanda, Le système des organisations internationales non gouvernementale : Emergence d'un Droit international spécifique ?, L'Harmattan, 2010, Paris, 246 P, p. 121.
71 Ces informations sont basées sur des faits empiriques car, nous n'avons pas pu collecter des données y relatives auprès des OING.
72 Les coûts dont nous faisons allusion ici ne concernent pas seulement le salaire, mais également tous les avantages liés à l'international (scolarité enfants, factures eau et électricité, et bien d'autres).
73 Nous entendons par middle managers le personnel qui se situe entre les décideurs et les exécutants, ce qu'on pourrait appeler des managers intermédiaires.
86
local comme le personnel camerounais, jouit pourtant des avantages dont ne sauraient bénéficier les nationaux.
Toutefois, nous ne saurons dire que les OING intervenant dans la région Centre du Cameroun n'utilisent pas les ressources humaines disponibles au niveau local, car les résultats de cette étude l'ont fortement confirmé. Seulement, il convient de noter que ces ressources sont parfois sous-valorisées voire sous-estimées.
iii. La course aux financements
Si les OING bénéficient à priori des mêmes facilités dans la mise en oeuvre de leurs activités, elles n'ont certes pas les mêmes moyens financiers et par conséquent, leurs actions, leur notoriété et leur visibilité sont fonction de leurs ressources financières. Du coup, les organisations font des calculs stratégiques afin d'obtenir le maximum de financements possibles. Elles sont prêtes à délaisser des communautés qui sont dans l'extrême nécessité pour élaborer des propositions de projet pour une intervention dans des zones prioritaires aux yeux de certains bailleurs de fonds, celles-ci n'étant pas nécessairement les plus vulnérables.
Il existe également une grande disparité entre les ressources financières des OING installées dans la région. Les plus petites en termes de ressources financières font face aux difficultés aussi bien dans leur fonctionnement quotidien que dans la mise en oeuvre des projets. Celles aux budgets « costauds » attirent les ressources humaines les plus qualifiées parce qu'elles ont les moyens d'offrir des conditions alléchantes, tandis que les petites ont de la peine à recruter et doivent fonctionner avec un personnel très réduit. La logistique qu'elles peuvent acquérir se limite au strict minimum, ces situations combinées impactent à coup sûr sur l'atteinte de leurs objectifs.
D'une part, les OING faisant l'objet de notre étude sont principalement d'origine occidentale et la quasi-totalité de leurs ressources financières provient des pays occidentaux. Ainsi, la crise financière qui secoue les pays occidentaux n'est pas sans effets sur les bailleurs de fonds des OING.
D'autre part, les résultats mitigés de l'aide au développement ou encore la gestion opaque des ressources dans nos pays fait naître en certains contribuables un scepticisme qui se répercute sur les subventions allouées par leurs Etats d'origine aux OING. Elles ne sont pas épargnées du problème de gouvernance, même celles l'ayant choisie comme thématique d'intervention. Somme toutes, la question des ressources financières reste problématique auprès de ces organisations. Toutes déclarent que les besoins nécessitant leur intervention
87
sont supérieurs aux moyens financiers disponibles, ce qui expliquerait peut-être leur course effrénée aux financements.
iv. Domaines d'intervention
Les résultats de cette étude montrent que certaines thématiques (santé, éducation et développement) retiennent particulièrement l'attention des OING. Dans le cadre des domaines d'activités, le terme développement inclut le développement local, le développement économique, le développement organisationnel et institutionnel, le développement rural. Sans désigner donc pas un élément isolé, il renvoie à un ensemble de sous-domaines qui constituent ce secteur. En même temps, certains domaines sectoriels tels l'agriculture, la gouvernance, l'eau et l'assainissement ne préoccupent qu'une très petite poignée d'OING dans la région. Il se pose donc un problème dans le choix des domaines d'intervention. En plus, les OING intervenant dans le même domaine ne coordonnent pas toujours leurs efforts.
v. Respect mitigé de la réglementation
La loi N° 90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association demande aux associations de faire parvenir annuellement leurs rapports d'activités au MINATD. Malheureusement, cet envoi ne se fait pas de façon systématique comme l'exige les textes. Shanda TONME pointe du doigt les OING en ces termes : « ...bien que les instruments et arrangements l'exigent explicitement, il n'y a presque jamais de rapport d'activités adressé au gouvernement du pays hôte. Dans leur état d'esprit, elles viennent apporter la vie et le bonheur automatique et ne croient plus qu'il soit normal de leur demander de se conformer à cette prescription des textes qui parlent de rapport d'activité »74.
En effet, certaines OING envoient des rapports annuels qui ne sont qu'une brève synthèse des activités menées au courant de l'année. Ainsi, les autorités camerounaises ne sont pas suffisamment informées des réalisations de certaines de ces organisations. Elles ne savent non plus si leurs actions rentrent uniquement dans le cadre de l'atteinte des objectifs avoués, où si celles-ci se livrent à d'autres activités d'intérêt personnel. Le contrôle voulu par le législateur échappe ainsi aux autorités.
74 TONME Shanda, Le système des organisations internationales non gouvernementales : Emergence d'un Droit international spécifique ?, Op cit.
vi. 88
Insuffisance de visibilité des actions
Les OING installées dans la région Centre du Cameroun agissent au-delà de cette zone. Leurs actions varient couvrent divers domaines tels que l'éducation, la santé, les droits de l'homme, l'eau et l'assainissement, l'environnement, l'agriculture... S'il est vrai que leur oeuvre couvre diverses thématiques et différentes régions du Cameroun, il faut cependant souligner le manque de visibilité des actions menées par ces organisations, voire desdites organisations elles-mêmes. Les preuves de leurs réalisations ne sont pas toujours communiquées. Il se pose donc un problème d'insuffisance de communication. Il ne s'agit non plus de demander à ces dernières de faire un tapage médiatique autour des projets qu'elles réalisent.
vii. Environnement et gouvernance
L'environnement dans lequel évoluent ces organisations présente aussi bien des atouts que des faiblesses qui freinent une bonne mise en oeuvre de leurs activités. Les OING mènent une compétition plus ou moins ouverte entre elles en vue de l'obtention des financements. Comme nous l'avons déjà constaté plus haut, la course aux financements constitue un élément qui contribue considérablement à la dégradation de l'environnement dans lequel interviennent ces organisations. Par ailleurs, il faut noter que le Cameroun en général fait face au fléau de la corruption et des détournements et, le secteur des OING n'en est pas épargné. Lorsque le système de gestion financière n'est pas suffisamment performant, certains employés mal intentionnés n'hésitent pas à profiter des faiblesses du système pour en tirer des gains personnels.
viii. Implication des populations
La quasi-totalité des OING rencontrées dans le cadre de cette recherche déclarent impliquer les populations dans la mise en oeuvre de leurs activités. Certaines affirment que les besoins sont d'ailleurs identifiés par les bénéficiaires eux-mêmes, d'autres vont plus loin en disant qu'elles accompagnent les populations dans leurs initiatives. Toutefois, il nous revient de constater que leur implication dans la phase de conception des projets reste mitigée. Les projets sont généralement conçus dans des bureaux quelques fois après une étude de base sur le terrain et ce n'est que lorsqu'un financement est acquis qu'un rapprochement avec les bénéficiaires s'opère, ce qui crée quelque fois frustration, méfiance, voire une suspicion de la part des populations. En effet, celles-ci ne se reconnaissent pas dans de tels projets et peinent à se les approprier.
89
ix. La durabilité des actions
A quelques exceptions près, les actions menées par les OING au Cameroun en général sont des projets de court et moyen terme (= 5 ans), rarement de longue durée. Si cette brève échéance ne constitue pas un problème pour des projets de réalisation des infrastructures, il n'en est pas de même pour des actions visant le changement de comportements d'une population donnée. En effet, il est difficile de croire que les membres d'une société, habitués à une certaine culture et à certaines pratiques puissent en quelques mois, modifier leurs habitus suite à quelques réunions de sensibilisation. Ainsi, des fonds sont alloués aux pareils projets mais ceux-ci n'atteignent que rarement l'objectif visé.
Si certains facteurs internes aux organisations représentent un frein à l'atteinte des objectifs avoués, les acteurs locaux y ont eux aussi une part de responsabilité qui mérite notre attention.
Les limites à une action efficace des OING ne sont pas le seul apanage de ces dernières, d'autres acteurs contribuent à cette situation notamment l'Etat75, les partenaires d'exécution (organisations locales et autres prestataires) et les populations locales.
? L'Etat
Dans leurs missions, les OING présentes au Cameroun accompagnent l'Etat afin d'améliorer les conditions de vie des populations dans des domaines d'intérêt général prédéfinis par ce dernier76. Cet appui ne saurait donc se faire sans les institutions chargées des questions relatives à leurs différents domaines d'intervention. Ainsi, les ONG établissent soit des relations formelles matérialisées par des protocoles d'accord dans le cadre de la mise en oeuvre d'une action ponctuelle, soit dans la réalisation d'une série d'actions ou tout simplement des relations informelles qui permettent à l'OING et au partenaire étatique de travailler ensemble sur des questions précises. Toutefois, certains facteurs internes à l'Etat empêchent ce dernier de faciliter l'appui attendu de ses partenaires que sont les organisations non gouvernementales internationales.
75 Départements ministériels et services déconcentrés de l'Etat
76 Conformément à la loi de 1990 sur la liberté d'association.
i. 90
La mauvaise gouvernance
Les partenariats OING-Etat sont très accentués et aboutissent quelque fois soit au financement par les OING de certaines activités engagées par les départements ministériels et/ou leurs services déconcentrés. Seulement, ces financements n'échappent pas toujours à une gestion opaque, à la corruption et aux détournements. Les fonds alloués à certains partenaires institutionnels à titre de financement d'une activité précise sont parfois consacrés partiellement à l'activité en question, et quelque fois, détournés de la localité initiale pour être investis dans des zones non prioritaire. Cette mauvaise pratique peut créer chez ces OING un certain découragement et conduire quelque fois à la fin du partenariat avec certaines institutions. Il est clair que cette mauvaise gouvernance représente un obstacle à l'atteinte des différents objectifs de développement que se sont fixés, aussi bien les Nations Unies à l'échéance 2015 (OMD) que ceux formulés par le Chef de l'Etat pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035, et qui, sont désormais des cadres de référence toute action de développement au Cameroun.
ii. La lenteur dans l'octroi de l'agrément
La loi N° 90/053 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d'association au Cameroun en son article 16, alinéa 1, stipule que « les associations étrangères ne peuvent exercer aucune activité sur le territoire sans autorisation préalable du Ministre chargé de l'Administration territoriale après avis conforme du Ministre chargé des Relations Extérieures ».
Si elle est précise quant à l'autorisation préalable du MINADT, une certaine ambigüité demeure en ce qui concerne le délai de traitement de la demande d'agrément. Dans la pratique, l'on se rend compte que les OING qui sollicitent une autorisation du gouvernement peuvent attendre plusieurs années avant de l'obtenir. Situation embarrassante, qui pousse certaines organisations, soit à exercer sous le couvert d'autres, soit de façon illégale et ce, pas forcément pour s'opposer aux dispositions légales, encore moins du fait de certaines intentions inavouées, mais plutôt parce qu'elles pensent qu'à travers quelques réalisations, le gouvernement disposera des faits pour mieux analyser leur requête. Cette stratégie ne conduit pas toujours aux résultats escomptés.
Si une OING est informée du temps nécessaire pour le traitement de sa demande d'autorisation, nous pensons qu'elle s'y prendra à temps et n'engagera pas d'activités au Cameroun avant la décision du gouvernement. Dans la longue attente, certaines associations sont amenées à débourser des sommes considérables (destinés aux pauvres) pour garantir le
91
suivi des dossiers. Sans reprocher à l'Etat son attribut de souveraineté (enquête de moralité), nous ne saurons ne pas considérer cette lenteur comme une limite à l'action des OING installées au Cameroun en général.
Bien plus, le décret N° 2005/104 du 13 avril 2005 portant organisation du MINATD précise que le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation sur les ONG, ainsi que l'instruction des dossiers de demande d'agrément au statut d'ONG sont des questions dont se charge le Service des ONG, appartenant à la sous-direction des libertés publiques, cette dernière dépendant de la direction des affaires politiques (Article 27, alinéa 1). Ainsi, si seul un Service du MINATD est chargé des questions relatives aux ONG locales et ONG internationales, ceci justifierait à suffisance cette lenteur, étant donné l'ampleur des sollicitations de demandes d'agrément de la part des ONG locales et des organisations internationales non gouvernementales au Cameroun.
iii. Le détournement des projets à des fins politiques
Les actions mises en oeuvre par les OING au Cameroun le sont principalement sous forme de projet, qu'elles soient de durée courte, moyenne ou longue. Certains de ces projets doivent être validés par des autorités compétentes dans le domaine concerné qui en abusent quelquefois. C'est le cas par exemple, de la réorientation à des fins stratégiques d'un projet vers des localités qui leurs sont favorables ; l'insertion « exigée » de leurs proches dans le personnel du projet, les manoeuvres de corruption, et lorsque ces démarches démagogiques ne trouvent pas écho favorable auprès des OING, certains projets se meurent dans des bureaux. Si l'Etat en tant qu'acteur local est aussi responsable de l'inefficacité de l'action des OING au Cameroun, qu'en est-il des organisations et entreprises locales ?
? Les organisations et entreprises locales
Les actions des OING sont généralement menées avec divers partenaires parmi lesquels les organisations et entreprises locales. Divers contrats sont ainsi signés par ces entités pour la mise en oeuvre des projets précis dont la réalisation pose quelquefois problème notamment en matière de professionnalisme et de gouvernance.
i. Le manque de professionnalisme
Bien qu'il existe au Cameroun une expertise assez variée, il faut cependant noter que le personnel de certaines associations locales, surtout celui des communautés rurales ne
92
dispose pas toujours des compétences nécessaires pour une réussite optimale de leurs activités, en grande partie financées par des OING. En effet, elles constituent très souvent les partenaires les plus indiqués pour la réalisation des projets de développement local, car elles maîtrisent mieux les réalités inhérentes à leur contexte. Toutefois, ces associations ne se forment pas toujours sur la base des critères de compétence, mais plutôt selon une logique d'affinité. C'est pourquoi, au moment de la mise en oeuvre du projet, il est récurrent de se retrouver face à des nombreuses difficultés liées pour la plupart à l'incompétence du personnel.
ii. La mauvaise gouvernance
Partant des organisations locales en passant par les entreprises, les problèmes de gouvernance demeurent des questions de fonds au Cameroun, notamment dans la gestion des budgets, la facturation des honoraires, les rapports qui ne reflètent pas les réalisations effectives sur le terrain.
On garde en mémoire ce cas où une entreprise sélectionnée pour la réhabilitation des salles de classe dans certaines écoles de la République dans le cadre d'un projet d'appui au système éducatif, a explicitement facturé un nombre de salles réhabilitées supérieur à celui effectivement rénové. Son rapport a été validé par l'ingénieur de suivi, pourtant employé et payé par l'OING maître d'ouvrage. Cet exemple montre à quel point les alliances sont montées de part et d'autre pour spolier les ressources financières des projets et parfois avec la complicité du personnel même de l'OING. Certains prestataires n'hésitent d'ailleurs pas à transférer dans leurs comptes privés des ressources destinées à la réalisation du projet !
Si l'efficacité de l'oeuvre des ONG se heurte aux difficultés qui émanent pour certains des organisations et prestataires locaux, qu'en est-il des populations locales qui bénéficient en effet de ces actions ?
? Les populations locales
Les limites à l'action des OING dans la région du Centre sont le fait d'un ensemble de facteurs imputables à tous les acteurs impliqués dans le processus, y compris les populations locales.
i. 93
La tragédie des Communaux
Le concept de « tragédie des Communaux »77 fût développé par Garrett HARDIN en 1968 dans le domaine de l'agriculture. Il a imaginé un pâturage ouvert à tous où l'on devrait s'attendre à ce que chaque éleveur essaie d'y mettre autant de bétail que possible, puisqu'il s'agit d'un terrain commun. Le pâturage n'étant pas une ressource illimitée, arrive le jour où il commence à s'épuiser. En tant qu'être rationnel, chaque éleveur cherche à y ajouter une bête de plus afin de maximiser son gain avant l'épuisement total de la réserve. Chaque homme est enfermé dans un système qui le contraint à augmenter son troupeau sans limite (dans un monde limité). La ruine est la destination vers laquelle tous les hommes se ruent, chacun à la poursuite de son propre meilleur intérêt dans une société qui croit en la liberté des communaux. La liberté dans les communaux apporte la ruine à tous. Il ajoute, une bête, et encore une et ils font tous la même chose jusqu'à ce que le pâturage s'épuise totalement et est abandonné par tous. Nous sommes ici dans une situation où le bien est commun, bien de tous et donc propriété de personne.
Ce concept de tragédie des communaux, utilisé dans le domaine de l'agriculture est transposable à celui des projets de développement et explique suffisamment l'échec en termes de durabilité, des projets de développement qui sont rétrocédés aux populations et qui nécessitent un entretien par celles-ci. Lorsqu'une OING arrive dans une localité faisant face à un problème d'approvisionnement en eau potable par exemple, elle y construit des puits ou des forages et prévient ainsi les populations des maladies hydriques. Lorsque le forage est opérationnel, toute la population est enthousiaste et à priori, elle pense à l'utiliser aussi longtemps que possible. Elle en bénéficie jusqu'au jour où survient une déficience dans le forage. Au lieu de penser à la réparation, chaque membre de la communauté reste en rejette la responsabilité à ses congénères. Bien plus, chacun cherche à remplir tous ses récipients avant que le forage ne soit totalement abimé. C'est malheureusement la triste réalité des projets de développement infrastructurels. Ils n'ont qu'une courte durée de vie à cause de leur caractère « de bien commun » à tous.
ii. La méfiance
La majorité des projets de développement ont lieu en zone rurale. En effet, c'est principalement dans les zones enclavées et éloignées des centres urbains que subsistent encore d'énormes besoins, et parfois dans tous les secteurs. Certaines populations des communautés
77 Pour plus d'informations, voir article sur la tragédie des communaux, Garett HARDIN, publié dans Science, 1968.
reculées adhèrent peu à certains projets, surtout lorsque le but visé est le changement de comportements ou des habitudes des membres d'une société. Elles ne sont pas toujours réceptives, ce qui rend la tâche difficile à l'organisation. Les méfaits de la colonisation et les représentations sociales du « blanc » qui en découlent ne sont pas sans effets sur certaines populations qui préfèrent émettre des réserves quant au désintéressement de l'action des OING, principalement d'origine occidentale.
iii. Les mauvaises pratiques
L'analyse du contexte et la prise en compte des particularités locales constituent un point important dans la conception d'un projet de développement. L'on ne saurait, même pour une action de bienfaisance, débarquer dans une communauté pour la mise en oeuvre d'un quelconque projet sans au préalable chercher à comprendre la culture de ce peuple. La culture est en effet constituée d'un ensemble d'éléments qui permettent aux membres d'une société donnée de trouver des solutions à leurs besoins. Selon Bronislaw Malinowski (1944), « les éléments constitutifs d'une culture auraient pour fonction de satisfaire les besoins essentiels de l'homme [...]. Par voie de conséquence, la culture constitue l'ensemble des réponses fonctionnelles à tous ces besoins, la culture désigne un ensemble de solutions »78.
A priori, l'on ne saurait reprocher à un peuple de faire usage de ses us et coutumes pour subvenir aux multiples besoins qui sont siens. Seulement, il s'avère que certaines pratiques culturelles ne contribuent pas nécessairement au bien-être des membres de la communauté (dépôt des déchets organiques humains dans l'atmosphère, braconnage, discrimination à l'endroit des minorités telles que les albinos...).
Cette première section nous a permis d'examiner en profondeur les limites aussi bien internes qu'externes aux OING et, aussi convient-il de formuler des recommandations en vue d'une intervention plus efficace et efficiente desdites organisations.
94
78 MBONJI EDJENGUELE, Cultures et développement, Master «Coopération internationale, Action humanitaire et Développement Durable», IRIC, 2011, P6.
95
Les ONG internationales installées dans la région du Centre jouent un rôle de plus en plus important dans le processus de développement du Cameroun en général, et de la région en particulier. L'évolution et les mutations que connaissent ces organisations induisent une multitude de comportements et de pratiques des différents acteurs impliqués dans leur fonctionnement et dans la mise en oeuvre de leurs activités. L'oeuvre des OING principalement sous forme de projets passe par un processus qui met en jeu divers acteurs internes (personnel de l'organisation) et externes (Etat, bénéficiaires, prestataires). Le comportement de chacun de ces acteurs peut influer sur les résultats du projet.
Lors du diagnostic des forces et des faiblesses des OING, nous avons relevé un certain nombre de points qui constituent des limites à une action efficace de celles-ci dans la région. Les principales recommandations y relative dans cette étude seront formulées aussi bien à l'endroit des OING (A) que des acteurs locaux (B).
Les recommandations à l'endroit des OING porteront sur : la valorisation des compétences locales, la territorialisation des organisations et des interventions, les domaines d'intervention, la visibilité des actions, la gouvernance et l'éthique.
? Reconsidérer les ressources humaines
Le personnel des OING recensées dans le cadre de cette étude est en majorité constitué des nationaux. Ce personnel localement recruté est principalement camerounais et dans quelques exceptions, on y retrouve des expatriés résidant au Cameroun. Toutefois, ces compétences locales ne sont pas suffisamment valorisées. Elles n'occupent que rarement des positions stratégiques, celles-ci étant généralement confiées au personnel international. Ces internationaux sont très coûteux par rapport au personnel local, à cause des multiples avantages dont ils bénéficient. Du coup, une bonne partie des ressources financières de l'organisation n'est non pas consacrée au public cible, mais plutôt aux expatriés qui travaillent
96
pour l'organisation. De nos jours, il est difficile de dire que l'expertise que recherchent les OING est introuvable au Cameroun. Alors, il faudrait:
1. Revaloriser les compétences locales
Il faut continuer de donner la possibilité au personnel local dûment qualifié d'accéder à des postes de leadership, de décision et pourquoi pas leur confier de la direction de l'organisation. Nous avons d'ailleurs quelques exemples d'organisations (SOS villages d'enfants Cameroun, COE, UICN, FAIRMED, GEOAID, INADES, PSI/ACMS, Sight Savers International, VSO, WCS et WWF) dont les directeurs/représentants sont des nationaux. Même si certains sont recrutés comme personnel international, ils résident dans leur pays et ne coûteront certainement moins chers qu'un expatrié.
2. Réduire le personnel international, accroitre la gouvernance et confier plus de responsabilité aux locaux.
Le personnel international travaillant dans les OING bénéficie de divers privilèges prévus par l'Etat camerounais et de plusieurs avantages qui leurs sont accordés en interne, soit du fait du caractère international de leur position, soit du niveau du poste même. Ainsi, diverses charges telles que le logement, la scolarité des enfants, les factures d'eau et d'électricité, certaines dépenses domestiques du personnel international sont couvertes par l'organisation. A priori, on peut penser que ces charges sont négligeables, mais non. Elles représentent un pourcentage considérable des ressources financières de l'organisation. Il faudrait donc le réduire afin d'en conserver le minimum possible, ce qui permettrait à l'organisation de réduire les coûts.
3. Initier, voire encourager le bénévolat dans les organisations
Plusieurs personnes sont disposées à travailler dans des organisations internationales pour apporter leur contribution à l'oeuvre de ces dernières et pendant ce même temps acquérir une expérience professionnelle qu'elles pourraient valoriser plus tard, aussi bien dans la même organisation que dans une autre, en temps que bénévole ou comme salarié. Il faudrait donc que les OING adoptent une véritable politique de bénévolat afin de valoriser au maximum cette offre de compétences locales.
? Couverture territoriale et domaines d'intervention
La configuration actuelle des OING dans la région du Centre laisse apparaitre un déséquilibre dans la distribution territoriale de ces organisations ainsi qu'un engouement pour les domaines de la santé, l'éducation et le développement. Les recommandations qui suivent visent à combler ce déséquilibre spatial et thématique.
4. 97
Mettre sur pied une politique de proximité à travers la création des postes
d'agents de terrain.
La localisation géographique des OING dans la seule ville de Yaoundé représente une limite à l'action desdites organisations. Il faudrait dans la mesure du possible que des agents de terrain puissent résider au niveau des communautés afin de garder une certaine proximité et mieux appréhender la réalité et le vécu quotidien des populations. Ceci permettrait de concevoir avec elles des projets à la hauteur de leurs réels besoins. Une autre possibilité serait la création des bureaux régionaux. Quelques organisations telles que MSF, SOS villages d'enfants, COE, Plan Cameroon en disposent dans le Centre, respectivement à Akonolinga, Mbalmayo, Yaoundé et à Nkomo.
5. Cibler les zones de faible intervention et mettre sur pied une stratégie de coordination de l'assistance afin de couvrir le maximum de communautés.
Tandis que certaines communautés n'obtiennent aucune assistance des OING, d'autres en reçoivent de trop. Ainsi, on peut retrouver des zones dans lesquelles plusieurs organisations interviennent simultanément, alors qu'elles auraient pu former un partenariat et confier la mise en oeuvre des projets concernant une même thématique à une seule d'entre elles, ce qui réduirait les coûts et permettrait de couvrir d'autres zones. Pour parvenir à cette coordination, il faudrait que les organisations aient pour objectif commun le bien-être des populations et que le choix de l'intervention dans une zone donnée ne soit pas guidé par la course aux financements.
6. Revoir le choix des thématiques d'intervention
Les départements ministériels chargés des thématiques porteuses et peu développées par les OING (agriculture, gouvernance, eau et assainissement, environnement, etc.) sont appelés à mettre en oeuvre des stratégies visant à encourager leur implication dans lesdits secteurs. L'agriculture par exemple est un domaine porteur pour la sécurité alimentaire des ménages et le développement économique du Cameroun. Malheureusement, elle ne suscite pas encore un engouement de la part des principaux acteurs de développement (Etat, institutions académiques, partenaires au développement, populations locales,). Les communautés se mettent de plus en plus en groupes (GIC et GIE) pour des projets d'agriculture. Un appui des OING que ce soit en termes de renforcement des capacités ou d'assistance financière permettrait aux populations d'améliorer de manière autonome leurs conditions de vie.
7. 98
Accroître la visibilité des organisations et de leurs actions
Si une organisation décide de s'installer dans un pays et d'apporter son assistance à ses populations, elle devrait prendre conscience de la nécessité de rendre compte non seulement aux bailleurs de fonds, mais également aux autorités du pays hôte et aux bénéficiaires de leurs actions. Il est curieux de constater que certaines organisations qui dans leur principe de travail prétendent « briser le silence et dénoncer les atrocités » considèrent la moindre information les concernant comme confidentielle. S'il est difficile de collecter des informations auprès de pareilles organisations, on constate également que leurs sites web n'en disent que très peu. Sans leur demander de faire un tapage médiatique autour de leurs réalisations, il est cependant important de communiquer, de rendre visible leur présence et porter à la connaissance du public camerounais les actions qui sont les leurs.
? Gouvernance et éthique
La question de la gouvernance est transversale et s'adresse aussi bien aux OING qu'aux acteurs locaux.
8. Mettre la gouvernance et l'éthique au centre de toute politique de développement
Si la mauvaise gestion de l'Aide Publique au Développement (APD) a eu pour corollaire l'émergence des ONG internationales au Cameroun, elle n'épargne non plus cette forme de coopération bien que, dans ce cas, l'aide ne soit pas directement adressée à l'Etat, preuve que celui-ci n'a pas le monopole de la mauvaise gouvernance. Pour les OING, la gestion transparente des fonds est d'autant plus importante que leurs ressources financières proviennent soit des contribuables dans d'autres pays, soit des donations des particuliers qui attendent des résultats. L'acquisition des systèmes de gestion plus performants devrait être privilégiée afin d'éviter toute distraction de fonds au niveau même de l'organisation. Des procédures strictes devraient également être mises en place afin de démanteler des circuits de fraude qui existent dans certaines organisations et, des sanctions rigoureuses devraient s'en suivre.
Comme nous l'avons reconnu plus haut, les actions des OING et même leur efficacité sont susceptibles d'être influencées par le comportement de leurs partenaires, notamment les acteurs locaux. Cette influence concerne non seulement le cadre réglementaire, mais également les questions liées à la gouvernance.
99
? Le cadre réglementaire
La loi N° 90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association au Cameroun en son article 16, alinéa 1 stipule que soumet l'exercice d'une quelconque activité par les associations étrangères à l'obtention préalable d'une autorisation du gouvernement, bien qu'elle reste imprécise sur les délais de traitement de la demande d'autorisation. Il faudrait à cet effet :
1. Réviser le cadre réglementaire
Il convient de lever toute ambigüité autour de cette question en précisant la durée nécessaire au traitement des dossiers de demande d'autorisation.
Au vu de l'importance sans cesse croissante des OING comme acteur de développement au Cameroun, considérant les moyens qu'elles mettent jeu pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, nous pensons qu'il faut créer toute une direction au MINADT (Direction de la coopération non gouvernementale par exemple) chargée des relations avec les ONG internationales opérant au Cameroun ou désirant s'installer au Cameroun. La mise en place d'une telle structure dotée d'assez de ressources humaines permettrait de résoudre l'épineux problème de lenteur dans le traitement des demandes d'agrément des OING. Le cas échéant, on pourrait confier cette responsabilité à une agence placée sous la tutelle du MINATD.
2. Le MINATD devrait prendre des dispositions adéquates et se rassurer que
chaque OING lui fasse parvenir son rapport d'activités à la fin de chaque année. Comme nous avons pu le constater plus haut, les OING ne transmettent pas systématiquement leurs rapports d'activités au MINATD tel que stipulé dans la loi de 1990. Alors, il faudrait se demander si ces autorités ont connaissance des actions menées par ces organisations au Cameroun. Si elles ne reçoivent pas ces rapports, comment pourront-elles savoir si ces organisations ne se livrent pas à des activités douteuses ? Alors, le MINATD devrait prendre les mesures appropriées afin que toute organisation qui s'abstient de se conformer à la réglementation en vigueur soit passible des sanctions qui devraient être définies par la loi.
? Responsabilité des populations
Les projets de développement, dès lors qu'ils sont rétrocédés aux populations bénéficiaires, la maintenance desdits projets incombe désormais à ces dernières. Toutefois, nous avons pu relever à travers le concept de « tragédie des Communaux » que les populations bénéficiaires n'assurent que très peu la durabilité des réalisations dont bénéficient leurs communautés. Ainsi, il faudrait :
3. 100
Mettre en place des mécanismes d'implication des populations dans la réalisation des projets.
En effet, les populations gagneraient à apporter leur contribution (même en nature) dans la réalisation des projets de développement de leur localité. Cet apport garantirait leur implication réelle et les rendrait ainsi plus responsables de la maintenance et la sauvegarde des ouvrages issus de ces projets.
? Amélioration des performances des organisations locales
Afin de conserver la compétitivité au niveau local, ces organisations doivent :
4. Solliciter un appui extérieur en vue du renforcement des capacités locales
Elles peuvent ainsi solliciter les services de certaines organisations de volontariat international, notamment France Volontaires et Planète Urgence, véritables interfaces entre les volontaires nantis de connaissances techniques et les organisations locales nécessiteuses du renforcement de leurs capacités dans des domaines spécifiques. Elles peuvent également solliciter l'appui de certaines OING disposant de compétences dans les domaines mis en cause.
? Gouvernance et éthique
La question de la gouvernance s'adresse aussi bien aux OING qu'aux acteurs locaux.
5. Accorder une place primordiale aux questions de gouvernance et d'éthique. L'impact de la corruption et des détournements sur les résultats de l'aide au développement n'est pas l'apanage de notre région d'étude, non plus du Cameroun.
? Nous avons pu le constater au niveau des limites, certains officiels camerounais portent entrave au bon déroulement des procédures administratives, notamment le traitement des dossiers de demande d'agrément, le blocage de certains projets pour des intérêts personnels. D'autres par contre réorientent certaines actions des OING vers des localités qui leurs sont favorables. Par ailleurs, d'aucuns détourneraient tout simplement des fonds destinés aux projets de développement pour les orienter vers leurs compte privés. Il faudrait à cet effet multiplier les procédures de contrôle et de vérification notamment à travers l'organisation des audits financiers et l'intervention du Contrôle Supérieur de l'Etat (CONSUPE) ; mettre sur pied une politique de tolérance zéro en matière de corruption et un régime de sanctions exemplaire.
101
? Quant aux prestataires qui sont pour la plus part des organisations et entreprises locales, il convient de dire que les OING ne sont pas des « boîtes à sous ». Les prestations doivent être réalisées en toute honnêteté et conformément aux clauses contractuelles. Il n'est pas question de dresser un rapport qui fait état de la réalisation d'un nombre d'ouvrages supérieur à la réalité.
La mauvaise gouvernance demeure jusqu'ici l'un des fléaux qui sapent à coup sûr les efforts du développement. Ainsi, pour une action plus efficace des OING dans la région du Centre, tous et chaque acteur devrait à son niveau reconsidérer l'éthique et la bonne gouvernance comme gage du succès des actions de développement et d'amélioration des conditions de vie des camerounais.
102
Tableau 4: Destinataires et priorisation des recommandations
|
Recommandation |
Destinataire |
Priorisation |
||
|
A. Le cadre législatif et institutionnel |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
||||
|
Tous les acteurs |
Moyen terme |
|||
103
Le rôle des OING dans le processus de développement au Cameroun en général est sans cesse croissant. Ces organisations non étatiques représentent aujourd'hui des partenaires importants et comptent parmi les Partenaires Techniques et Financiers du gouvernement du Cameroun. Leurs actions apportent un appui considérable à l'Etat, garant des droits économiques, sociaux et culturels des populations camerounaises. Autant, le Cameroun dispose des atouts qui facilitent cet appui à l'action étatique, autant d'autres facteurs constituent des limites à lever afin de permettre une amélioration de la qualité de l'action des OING au Cameroun. Ces limites qui sont pour certaines d'ordre interne aux OING et pour d'autres liées aux acteurs locaux sont fort heureusement remédiables. La sous valorisation des compétences locales, l'injustice salariale, la course aux financements sont quelques unes de ces limites imputables aux OING, tandis que la lenteur administrative, l'irresponsabilité, la méfiance et les mauvaises pratiques sont attribuables aux acteurs locaux. La mauvaise gouvernance constitue une limite transversale et imputable aux différents acteurs impliqués dans le processus, qu'il s'agisse des OING, de l'Etat, des organisations locales etc.
C'est à ces divers acteurs que s'adressent les recommandations que nous avons formulé notamment la revalorisation des compétences locales, la coordination des actions, la reconsidération des thématiques d'intervention, la visibilité et la durabilité des actions ,la révision du cadre règlementaire, la création d'une institution en charge de la gestion de questions relatives aux OING. Par ailleurs, l'éthique et la transparence doivent être au centre de toute politique de développement de chacun de ces différents acteurs.
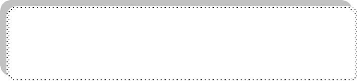
104
105
Au terme de ce travail dont l'objectif était de dresser un état des lieux de l'oeuvre des ONG internationales dans la région Centre du Cameroun de 1960 à 2010, nous relevons que notre approche s'est subdivisée en deux idées.
Dans la première partie, il s'est agi de présenter les fondements sociologiques, juridiques et politiques ayant servi de socle à l'émergence des OING au Cameroun. Ici nous avons relevé que la solidarité humaine, l'esprit d'un monde dans lequel l'on vit en communauté ont contribué à la responsabilité de porter assistance aux personnes vulnérables dans le monde. Des conventions internationales, régionales ainsi que des lois nationales ont légitimé l'existence des ONG et l'accomplissement par ces dernières des missions d'intérêt général, légitimant ainsi la solidarité aussi bien à l'échelle nationale, régionale qu'internationale. Cette solidarité s'exprimant à l'échelle internationale aboutit à l'arrivée dans les années 1960 des premières organisations de la société civile du Nord au Cameroun. Les résultats mitigés de la coopération gouvernementale (notamment de l'aide publique au développement), les méfaits des réformes économiques imposés par les institutions financières internationales et l'échec des politiques nationales inadaptées ont à joué un rôle important dans la détérioration des conditions de vie des populations au Cameroun. Dès lors, les pays du Nord comprennent la nécessité de faire des ONG de véritables partenaires au développement. Ces dernières s'installent progressivement au Cameroun et font désormais partie des acteurs clef du développement socio-économique du Cameroun.
Dans la deuxième partie, nous avons présenté une classification et une caractérisation des OING opérant dans la région du Centre, leurs différentes formes de partenariat qu'elles établissent dans le cadre de leurs activités, ainsi qu'une mise en relief de leurs actions concrètes dans cette localité. Ensuite, nous avons examiné les facteurs qui constituent des limites à une action efficace des OING et des recommandations ont été formulées à l'endroit des différents acteurs impliqués dans ce processus.
En effet, les OING actives dans notre région d'étude sont principalement d'origine occidentale et de type anglo-saxon. En effet, en dehors des ONG d'origine américaine dont les financements proviennent en grande partie du gouvernement américain, les autres sont indépendantes de leurs Etats d'origine du point de vue financier. Leurs ressources financières proviennent donc des sources diverses (siège de l'OING, bailleurs de fonds, les organisations internationales, les multinationales, les particuliers ...) et constituent pour certaines des enveloppes très considérables. Les ressources humaines quant à elles sont principalement constituées des nationaux quoi que les positions stratégiques soient plus occupées par le personnel international parfois du pays d'origine de l'ONG. Dans la mise en oeuvre de leurs
106
projets, ces organisations établissent des partenariats avec d'autres acteurs notamment l'Etat, les OI, d'autres OING, les ONG et entreprises locales ... Ces projets sont principalement axées sur des questions de développement notamment la santé et le VIH/SIDA, l'éducation, le développement local, les droits de l'homme, l'environnement, et quelquefois sur des questions d'urgence humanitaire. Ces faits exposés confirment notre hypothèse de départ selon laquelle l'oeuvre des OING dans la région Centre du Cameroun est principalement axée sur le développement en vue d'une amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Il convient ici de préciser que les interventions dans les domaines de la santé, le VIH/SIDA, l'éducation et le développement local retiennent plus l'attention des OING et couvrent plus de la moitié de leurs réalisations dans la région.
Toutefois, cette oeuvre sociale en faveur des personnes vulnérables de la région du Centre pourrait être plus efficace si une attention particulière était accordée par les différents intervenants à la question de bonne gouvernance. Elle devrait en effet occuper une place centrale dans les stratégies aussi bien des OING que l'Etat. Une révision du cadre réglementaire, une revalorisation des compétences locales, une réorientation des thématiques d'intervention, l'implication des populations dès la phase de conception des projets et une meilleure coordination des actions contribuerait à une action efficace et efficiente.
Au moment de terminer ce travail, nous réalisons l'importance et en même temps la complexité de la question de gouvernance au niveau global. En effet, si cette dernière a contribué à l'émergence des OING dans les pays en développement, il faut cependant dire qu'elle représente aujourd'hui un problème majeur pour cette catégorie d'acteurs du développement. Alors devrons-nous penser à une nouvelle catégorie d'acteurs ? Si non, ne devrait-on pas repenser l'aide au développement dans son ensemble ?
Finalement, loin d'être utopique, loin de remettre en cause l'action bienfaisante des OING au Cameroun, la question suivante nous taraude certes l'esprit : une amélioration significative du niveau de gouvernance au Cameroun ne permettrait-elle pas à l'Etat de garantir les droits économiques et sociaux de ses citoyens, réduisant ainsi sa dépendance à l'aide extérieure entre autres celle des organisations internationales non gouvernementales ?
107
BADIE (B.) & SMOUTS (M-C.), Le retournement du monde. Sociologie de la scène internationale, Presses de la Fondation Nationale des sciences politiques & Dalloz, Paris, 1992, 249 p.
EISENMANN (C.), Les sciences sociales dans l'enseignement supérieur, Droit, Paris, UNESCO, 1972, 201 p.
DURKHEIM (E.), Les règles de la méthode sociologique, Alcan, 1919, pp. 20-58. DURKHEIM (E.), De la division du travail social, Alcan, 1932, 457 p.
FEBVRE (L.), Combats pour l'Histoire, Paris, Armand Colin, 1992, 455 p. GAUTHIER (B.), Recherche sociale, De la problématique à la collecte des données, Québec, Presses de l'Université du Québec, 1997, 529 p.
GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences sociales, in Recherche et méthodologie en sciences humaines, LAMOUREUX (A), Laval, QC, Editions Etudes Vivantes, 1995. Paris, Dalloz, 1986, pp. 402 - 414.
KING (A).et SCHNEIDER (B.), Questions de survie, la révolution mondiale a commencé, Calmann-Lévy, 1991, 232 p.
LAMOUREUX, (A.), Recherche et méthodologie en sciences humaines, Laval, QC, Editions Etudes Vivantes, 1995.
LONG (D.), Définir une problématique de recherche, Université de Moncton, 2004, 34 p.
ROSENEAU (J.N.), Turbulences in World Politics: A theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton, University Press, 1990, 504 p.
ROUSSEAU Jean Jacques, Du contrat social ou Principes du droit politique, version numérique rédigée par Jean-Marie TREMBLAY, collection "Les classiques des sciences sociales", l'Université du Québec, Chicoutimi, Canada, 2002.
RUBIO, (F.), Dictionnaire pratique des organisations non gouvernementales (ONG), éd. Ellipses, 2004
TREMBLAY (R.R.) & PERRIER (Y.), Outils et méthodes de travail intellectuel, les Editions de la Chenelière, 2006, 230 p.
II. 108
OUVRAGES SPECIALISES
CONDAMINES C., L'aide humanitaire entre la politique et les affaires, Paris, L'Harmattan, 1989, 234 p.
DE SENARCLENS (P.), L'humanitaire en catastrophe, Presses de Sciences-po, collection La Bibliothèque du citoyen, Paris, 1999, 146 p.
DELER (J-P.), FAURE (Y-A.), PIVETEAU (A.) & ROCA (P.J.) in ONG et développement ONG et développement : société, économie, politique, Karthala, 1998, pp. 183-191.
LE COCONNIER, (M.L.) & POMMIER (B.), L'action humanitaire : Pour une solidarité internationale. 1ère édition : Collection "Que sais-je ?", PUF, Paris, 2009, 127 p.
MBONDA, (E.M.), L'action humanitaire en Afrique: Lieux et enjeux, 2008, 182 MICHELETTI, (P.), Humanitaire .
· s'adapter ou renoncer, Marabout, 2008, 245 p. RYFMAN (P), La question humanitaire. Histoire, problématiques, acteurs et enjeux de l'aide humanitaire, Paris Ellipses, 1999, 208 p.TONME (S.), Le système des organisations internationales non gouvernementales : Emergence d'un Droit international spécifique ?, L'Harmattan, Paris, 2010, 246 p.
III. ARTICLES
ANDREANI (G.), Gouvernance globale .
· origines d'une
idée in Politique étrangère, n° 3, 2001, pp.
549-568.
BATTISTALLA (D.), pour Sciences Humaines, Rubrique Courants et disciplines, 2007.
DOUBATE (B.), Privatisations et relations individus-société en Afrique - le cas des réformes institutionnelles du secteur privé promues par le FMI et la Banque mondiale Acad, Political Economy, France.
HARDIN (G.), la tragédie des communaux,
article publié dans Science, 1968. JACQUET (P.) & COMOLET (E.),
l'aide au développement, un instrument pour la gouvernance mondiale
?, in annuaire français de relations internationales, 2009.
JENTZSCH (C.), Gouvernance globale .
· origine d'une
idée, note de lecture, in Institut pour un nouveau débat sur
la gouvernance, 2005.
109
KENMOGNE (B.), Politique camerounaise en matière d'ONG in D+C Développement et Coopération, Frankfurt, No. 4, Juillet/Août 2002.
KIPLING Rudyard, The white man's burden: the United States and the Philippine Islands, in McClure's Magazine, vol. 12, no 4, 1899.
OWONA NGUINI, La légitimité et la crédibilité des OSC dans le nouveau contexte camerounais issu de la tripartite in atelier partenaires techniques et financiers (PTF) sur les acquis de la société civile camerounaise, Yaoundé, 27 et 28 mai 2010.
Agenda 21 À Chapitre 27 : Renforcement du rôle des organisations non gouvernementales : Partenaires pour le développement durable, Sommet de la Terre, Rio, 1992.
COE Cameroun, cinquante ans du COE dans le monde, 40 ans au Cameroun,
célébrations pour un nouveau départ, revue N° 011 « spécial 50 ans », décembre 2009.
COE Cameroun, le COE réaffirme son engagement comme organisme de volontariat international chrétien, promoteur de l'art et de la culture, revue N°013 décembre 11.
COE Cameroun, rapport d'activités, 2011. COE Cameroun, rapport d'activités, 2008. COE Cameroun, rapport d'activités, 2009.
Commission indépendante sur les problèmes de développement international sous la présidence de WILLY BRANDT, Rapport, Paris, Gallimard, 1980, p. 33.
Counter Part International, annual report, 2011.
Helen Keller International, rapport annuel, 2010.
Helen Keller International, simple solution, dramatic results, 2009. Inades Formation Cameroun, rapport d'activités, 2009. Inades Formation Cameroun, rapport d'activités, 2010.
110
Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité, Les associations marocaines de développement : Diagnostic, analyses et perspectives, Rapport d'étude, Royaume du Maroc, 2010, 57 p.
Plan Cameroon, rapport annuel, 2008.
Plan Cameroon, rapport annuel, 2009.
Planète Urgence, Rapport annuel, 2010.
Rapport de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge sur l'État des lieux et recommandations. Faim, catastrophes, espoir : repenser l'action humanitaire en Afrique, 2009.
Rapport du PNUD sur le développement humain, 2007.
Rapport Enquête Démographique et de Santé Cameroun (EDSC), INS, 2004.
Rapport final de l'Etude sur la participation des Organisations Non
Gouvernementales à la mise en oeuvre du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, par BAH (C.S.), pour la GTZ, Conakry, 2003, 89 p.
Rapport général de la table ronde portant sur le thème : La bonne gouvernance : objet et condition du financement du développement, Paris, 20 et 21 novembre 2003.
SNV Cameroun, rapport annuel, 2008.
SOS Villages d'Enfants Cameroun, faits et chiffres, 2011.
GODONOU DOSSOU, Etude prospective du renforcement de la coordination de l'action humanitaire du ministère des affaires étrangères de l'intégration africaine de la francophonie et des béninois de l'extérieur, ENAM, Bénin, 2008.
LOWE GNINTEDEM, Les ONG et la protection de l'environnement en Afrique Centrale, Mémoire de Maîtrise en droit et carrières judiciaires, Université de Limoges, France, 2003.
MOUAFO NGATOM (S.H.), La coopération non gouvernementale à l'épreuve de la réduction de la pauvreté au Cameroun: une analyse sociologique des relations Bailleurs de fonds-ONG nationales, Mémoire de Maîtrise de Sociologie, Université de Yaoundé I, Cameroun, 2006.
111
NDO MINLA'A (S.R.), La participation des ONG à la coopération EU/Cameroun, Mémoire du Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS), IRIC, 2002. NGOLA MBELLE, (J.D.), Du hameau de Mvondé à la ville de Belabo : 1960 - 1982, Mémoire de DIPES II, École Normale Supérieure de Yaoundé, Cameroun, 2003. NKUISSI B., Nkongsamba, les années obscures de la fondation, mémoire de DES en histoire, Université de Lille, France, 1977.
WAYA, (J.H.), Analyse de la gestion environnementale du projet pipeline Tchad-Cameroun dans la localité de Belabo, Monographie de DCJA, Institut National de la Jeunesse et des Sports, Yaoundé, Cameroun, 2010.
Textes internationaux
Charte des Nations Unies du 26 juin 1945.
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) Du 10 décembre 1948.
La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981.
La Convention européenne (no 124) sur la reconnaissance de la personnalité juridique
des organisations internationales non gouvernementales et leur protection en droit
international.
Le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 23 mars 1976.
Les 1ère et 2ème Conventions de Yaoundé de 1963 et de 1969.
Les Conventions de Lomé de 1975 et 1980 entre les Communauté des Etats
Européens et les Etats d'Afrique, Caraïbes et Pacifique
L'accord de Cotonou du 23 juin 2000 entre l'Union Européenne les Etats d'Afrique,
Caraïbes et Pacifique.
Textes nationaux
La Constitution camerounaise de 1972, révisée le 18 janvier 1996.
La loi N° 67/LF/19 du 12 Juin 1967, premier cadre légal soumis au « régime
d'Etat ».
La loi N° 90/050 du 12 décembre 1990 sur la liberté d'association au Cameroun.
La loi N°99/014 du 22 décembre 1999 portant organisation des ONG au Cameroun.
VII. 112
SITES INTERNET
Adresse des ONG internationales au Cameroun dans
( www.lespagesjaunesafrique.com), consulté le consulté le 20 juin 2012.
Faim, catastrophes, espoir : repenser l'action humanitaire en Afrique du site ( www.ifrc.org/Global/Publications), consulté le 05 février 2012.
Les réalisations de Médecins Sans Frontières au Cameroun du site ( www.msf.ch), consulté le 12 octobre 2012.
Qu'est-ce que la Solidarité internationale du site ( www.fage.org), consulté le 15 février 2012.
www.ambafrance-cm.org/France-Volontaires consulté le 14 février 2013. www.icrc.org consulté le 11 février 2012.
www.mémoireonline.com, consulté le 10 novembre 2012.
VIII. DOCUMENTS INEDITS
DIOUBATE (B.), Histoire et fondements théoriques de l'économie du développement, IRIC, CA2D, 2012.
ELAME ESOH, Histoire et fondements du concept de développement durable: Unité 6 : Développement durable et interculturalité : concepts et outils, Master Course « Coopération internationale, Action humanitaire et Développement Durable», Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata, Università Cà Foscari di Venezia, 2011.
MARELLI (S.), Architecture organisationnelle et de gestion des ONG : le cas des
ONG italiennes, Master «Coopération internationale, Action humanitaire et Développement Durable», IRIC, 2012.
MBONJI EDJENGUELE, 2011, Cultures et développement, Master Coopération internationale, Action humanitaire et Développement Durable, IRIC, 2012. MICHELETTI (P.), Les enjeux contemporains de l'action humanitaire non gouvernementale, IRIC, CA2D, 2012.
MOUELLE KOMBI (N.), Droit International Public, «Coopération internationale, Action humanitaire et Développement Durable», IRIC, 2011.
SAWADOGO (G.), Considérations épistémologiques et cadre de recherche en sciences sociales : conception du mémoire, Master «Coopération internationale, Action humanitaire et Développement Durable», IRIC, 2012.
113
114
Annexe 1: Répertoire des ONG internationales présentes dans la Région Centre du Cameroun À mars 2013.
1.
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
Mission : CARE participe au mouvement mondial qui s'est engagé de manière concertée à diminuer de moitié la pauvreté d'ici à 2015, en particulier celle des femmes, dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Dans tous ses programmes, CARE porte une attention particulière à la condition des femmes, premières victimes de la pauvreté dans le monde.
Domaine d'activités : Santé et VIH/SIDA, Eau et Assainissement, Intégration des populations au développement économique.
Zone d'intervention : Grand Nord et Grand Sud
2.
|
Nom |
Catholic Relief Services |
|
Représentante pays |
Lori Kunze |
|
Adresse |
Bastos, B.P. 1851 Yaoundé |
|
Téléphone |
(237) 22 21 55 61 |
|
Fax |
22 20 51 58 |
Mission : Porter assistance aux plus pauvres à travers le monde, tout en travaillant dans un esprit de l'éducation sociale catholique afin de promouvoir le caractère sacré de la vie humaine et la dignité de l'être humain. Quoi que fonctionnant sur les principes de l'église catholique, l'organisation apporte son assistance à tous et indépendamment de leur appartenance religieuse.
Domaine d'activités : Gouvernance, Renforcement des capacités ; Eau, Hygiène et Assainissement ; Santé y compris le VIH /Sida ; Droits de l'Homme.
Zone d'intervention : Centre, Est, Littoral, Nord-Ouest, Sud-ouest, Ouest et Extrême-Nord.
3. 115
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
Mission : Promotion intégrale de l'Homme
Domaine d'activités : Education, développement, droits de l'Homme Santé, Sport, Culture, environnement
Zone d'intervention : Centre, Littoral, Ouest, Nord.
4.
|
Nom |
Counter Part International |
|
Directeur National |
Désiré Yameogo |
|
Adresse |
B.P 4388 Yaoundé, Cameroun |
|
Téléphone |
(237) 22 20 75 60 |
Mission : Développement économique et social
Domaine d'activités : Agriculture, Education, Droits de l'Homme, Humanitaire, Santé, Développement.
Zone d'intervention : Centre, Littoral, Nord-Ouest, Sud-ouest, Nord et Extrême-Nord.
5. 116
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
Mission : Permettre aux personnes pauvres et malades d'accéder aux services de santé, éradiquer la lèpre et les maladies liées à la pauvreté, promouvoir une santé sociale juste et équitable.
Domaine d'activités : Santé, Education, Humanitaire, Développement. Zone d'intervention : Etendue du territoire national
6.
|
Nom |
France Volontaires (AFVP jusqu'en 2010) |
|
Directeur National |
Karim Doumbia |
|
Adresse |
Rue de l'Institut Matamfen |
|
Téléphone |
(237) 22 20 07 72 / 96 15 09 52 |
Mission : Contribuer au développement qualitatif et quantitatif des différentes formes d'engagement volontaire et solidaire à l'international, les Volontariats Internationaux d'Echange et de Solidarité (VIES).
Domaine d'activités : Santé, Education, Animation, Développement infrastructurel, local et rural. Zone d'intervention : Partie francophone du Cameroun
7. 117
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|||
Mission : Geoaid travaille avec les partenaires internationaux et locaux pour faciliter les programmes de développement durable qui permettent aux communautés d'améliorer la santé communautaire, l'agriculture, l'éducation et la formation et, le développement des petites entreprises.
Domaine d'activités : Agriculture, Education, Santé, Développement économique.
Zone d'intervention : Centre et Est.
8.
|
Nom |
Global Viral Forecasting Initiative (GVFI) |
|
Directeur National |
Ubald Tamoufe |
|
Adresse |
Carrefour Intendance B.P. 7039 Yaoundé |
|
Téléphone |
(237) 22 22 91 75 |
|
Fax |
(237) 22 22 84 29 |
Mission : Recherche et prévention en santé des infections zoonotiques émergentes et ré-émergentes. Domaine d'activités : VIH/SIDA, Infections zoonotiques chez les animaux, Transfert de technologie. Zone d'intervention : Centre, Est, Sud et Sud-Ouest.
9. 118
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
Mission : Prévenir la cécité et réduire la malnutrition chez les personnes les plus vulnérables. Domaine d'activités : Santé
Zone d'intervention : Etendue du territoire avec une concentration d'activités dans les régions du centre, de l'Extrême-Nord et de l'Est.
10.
|
Nom |
INADES Formation Cameroun |
|
Directrice Nationale |
Mbezele Fouda Elisabeth épse Mballa Atangana |
|
Adresse |
Ngousso B.P. 11 Yaoundé, Cameroun |
|
Téléphone |
(237) 22 21 15 51 / 22 21 17 48 |
|
Fax |
(237) 22 21 11 44 |
Mission : Renforcement du pouvoir des paysans pour leur permettre de participer à la construction d'une société civile forte.
Domaine d'activités : Développement local et Droits de l'Homme Zone d'intervention : Territoire national.
11. 119
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|||
Mission : Soins et santé primaires des refugiés
Domaine d'activités : Santé, Humanitaire, Eau et assainissement Zone d'intervention : Adamaoua, Nord, Est.
12.
|
Nom de l'ONG |
Management Sciences for Health (MSH) Program: Systems for Improved Access to Pharmaceutical and Services (SIAPS) |
|
Directeur du programme |
Dr. Kaze Gege Buki |
|
Adresse |
Immeuble N °1067 de la SCI Foulassi Rue 1750 Nouvelle Route Bastos Po Box 35551 Yaoundé - Cameroun |
|
Téléphone |
+237 76 33 39 17 |
Mission : MSH se donne pour mission de sauver des vies et d'améliorer la santé des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables dans le monde, à travers la réduction de l'écart entre la connaissance et l'action en santé publique.
Au Cameroun, les interventions SIAPS sont conçues pour apporter une réponse immédiate aux problèmes pharmaceutiques quotidiens, tout en développant un cadre stratégique et les compétences humaines pour le renforcement du système dans le moyen et long terme.
Domaine d'activités : Santé (gouvernance, accès aux services, information, gestion pharmaceutique, financement, renforcement des capacités du personnel de santé).
Zone d'intervention : Sud-ouest, Nord- oust, Est, Adamaoua, Littoral et Centre.
13. 120
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
Domaine d'activités : Santé, y compris le VIH sida. Zone d'intervention : Centre, Extrême-Nord
14.
|
Nom |
Plan Cameroon |
|
Directeur National |
Famari Barro |
|
Adresse |
Bastos, face Ambassade d'Allemagne B.P. 25236 Yaoundé |
|
Téléphone |
(237) 22 21 54 58 |
|
Fax |
(237) 22 21 54 57 |
Mission : Mettre en place un système d'amélioration durable de la qualité de vie des enfants démunis dans les pays en voie de développement, à travers un processus qui rassemble les gens de cultures différentes et ajoute un sens et de la valeur à leurs vies.
Domaine d'activités : Education, Eau et Assainissement, Protection de l'enfant, Santé y compris le VIH/SIDA, Urgences humanitaires, Sécurité économiques des ménages.
Zone d'intervention : Centre, Est, Nord-Ouest, Adamaoua, Nord, Extrême-Nord.
15. 121
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
Mission : Soutenir des structures locales porteuses de projet de développement via des missions de Congé Solidaire au Cameroun. Le Congé solidaire est un dispositif de l'association Planète Urgence, mobilisant des professionnels français au service de la solidarité internationale.
Domaine d'activités : Formation des adultes, Appui scolaire, Protection de l'environnement. Zone d'intervention : Tout le territoire camerounais
16.
|
Nom |
Population Services International / ACMS |
|
Représentant Pays |
Auguste Kpognon |
|
Adresse |
Dragages, Mballa II B.P. 14025 Yaoundé |
|
Téléphone |
(237) 22 21 94 19 |
|
Fax |
(237) 22 20 92 24 |
Mission : Améliorer de façon mesurable la santé des populations pauvres et vulnérables dans le monde, par le biais du marketing social de la planification familiale et des produits/services de santé, de la communication de la santé.
Domaine d'activités : Santé, marketing social.
Zone d'intervention : Etendue du territoire national.
17. 122
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
Mission : Lutter contre la cécité évitable et promouvoir l'inclusion sociale et les droits des personnes handicapées.
Domaine d'activités : Santé, inclusion sociale, droits de l'Homme. Zone d'intervention : Sud Ouest, Nord Ouest, Extrême-Nord.
18.
|
Nom |
SNV Cameroun (Organisation néerlandaise de Développement |
|
Directeur National |
Duncan Campbell |
|
Adresse |
Nouvelle route Bastos B.P. 1239 Yaoundé, Cameroun |
|
Téléphone |
(237) 22 20 27 72 / 22 21 45 38 |
|
Fax |
(237) 22 20 84 64 |
Mission : Appui au développement à travers le renforcement des capacités des acteurs locaux Domaines d'activités : Développement
Zone d'intervention : L'étendue du territoire camerounais
19. 123
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
Mission : Prise en charge à long terme des enfants orphelins et abandonnés et, appui au développement des communautés locales.
Domaine d'activités : Prise en charge familial ; Renforcement de la famille ; L'éducation ; Santé ; Plaidoyer
Zone d'intervention : Centre et Littoral
20.
|
Nom |
Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) |
|
Directeur National |
Dr Leonard Usongo |
|
Adresse |
Ekoudou À Bastos B.P. 5506 Yaoundé, Cameroun |
|
Téléphone |
(237) 22 21 64 96 |
|
Fax |
(237) 22 21 64 97 |
Mission : Conservation de la nature et des processus écologiques en :
- Préservant la diversité génétique, celle des espèces et celle des écosystèmes ;
- Veillant à ce que l'utilisation des ressources naturelles renouvelables soit durable dans
l'immédiat et à long terme, pour assurer la protection de la vie dans son ensemble ; - Encourageant la prise de mesures visant à réduire la pollution ainsi que le gaspillage
dans l'exploitation et la consommation des ressources et de l'énergie.
-
Domaine d'activités : Gestion de l'environnement Zone d'intervention : Cameroun et pays voisins.
21. 124
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
Mission : Augmenter le pouvoir économique des femmes défavorisées. Domaine d'activités : Santé, Education, Développement Zone d'intervention : Extrême-Nord, Nord-Ouest, Est.
22.
|
Nom |
Wildlife Conservation Society (WCS) |
|
Directeur National |
Dr Fotso Roger |
|
Adresse |
BP : 3055 Messa Yaoundé, Cameroun |
|
Téléphone |
(237) 22 20 26 45 |
|
Fax |
(237) 22 20 26 45 |
Mission : Sauvegarder la faune et les habitats naturels, suivant une approche scientifique fondée sur une meilleure compréhension des pressions et menaces qui pèsent sur cette faune et ses habitats.
Domaine d'activités : Environnement et Conservation.
Zone d'intervention : Parc National de Deng Deng, Parc National de Mbam et Djerem, Parc National de Takamanda et Reserve de Kagwene
125
23.
|
Nom |
World Wide Fund for Nature (WWF) |
|
|
Directeur National |
Hanson Njiforti |
|
|
Adresse |
Derrière l'usine BAT - Bastos B.P. 6776 Yaoundé, Cameroun |
|
|
Téléphone |
(237) 22 21 70 83 / 75 50 00 35 / 99 50 |
36 21 |
|
Fax |
(237) 22 21 70 85 / 22 21 42 40 |
|
Mission : WWF Cameroun partage la mission de WWF dans l'ensemble qui est de stopper la dégradation de la planète et de construire un avenir dans lequel les hommes vivent en harmonie avec la nature. Afin de contribuer à cette mission, WWF Cameroun se déploie sur les thématiques suivantes :
? La conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers, marins et d'eaux douces ainsi que la protection des espèces en voie de disparition ;
? Les changements climatiques ;
? Les industries extractives et les grandes infrastructures (barrage, ports...) ;
? La participation des communautés locales et Autochtones à la gestion durable des ressources naturelles et de leur accès équitable au partage des revenus ;
? La définition et la mise en oeuvre des politiques, des cadres législatifs et institutionnels favorables à la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable des ressources naturelles et la prise en compte des changements climatiques.
Domaine d'activités : Environnement et Développement
Zone d'intervention : Régions du Sud, Est, Sud-ouest, Nord et Extrême-Nord.
Source : Tsafack Judith, mars 2013
126
Cette fiche est élaborée dans le cadre d'une recherche académique visant à collecter des informations sur les ONG internationales installées dans la région Centre du Cameroun. Les informations reçues permettront de dresser un état des lieux de l'oeuvre des ONG internationales et seront exclusivement utilisées dans le cadre de notre mémoire de Master 2 Coopération internationale, action humanitaire et développement durable.
En vous assurant un traitement en toute confidentialité, nous vous remercions d'avance pour votre bonne collaboration.
I. Description de l'ONG
Nom de l'ONG :
Adresse :
Téléphone : .
Télécopie :
E-mail :
Site web :
Directeur National :
Statut juridique :
Date d'établissement au Cameroun :
Date d'obtention de l'agrément du gouvernement camerounais :
Nature : Laïque Religieuse Politique
II. Mission de l'ONG
Objectifs de l'ONG :
Domaines d'intervention :
Santé Education Sport Humanitaire Développement local
Droits de l'Homme Culture Economie Environnement
Autres (à préciser)
Public cible :
Principaux bénéficiaires
Zone (s) d'intervention dans la région :
III. Capacités d'intervention
y' Les ressources humaines
Nombre total d'employés : .... Hommes : Femmes :
Personnel International : .
Personnel national : .
Bénévoles : .
Volontaires :
y' Les ressources financières
Budget annuel général de l'ONG :
Apport propre :
Subventions :
Vos principaux bailleurs de fonds :
Autres sources de financement (à préciser) :
Nous vous saurons gré de bien vouloir mettre à notre disposition les différents rapports d'activités élaborées par l'organisation.
127
Merci pour votre disponibilité.
128
Cet entretien est élaboré dans le cadre d'une recherche académique visant à collecter des informations sur les ONG internationales opérant dans la région du centre du Cameroun entre 1960 et 2010. Les informations collectées permettront de faire un état des lieux de l'oeuvre des ONG internationales et seront exclusivement utilisées dans le cadre de notre mémoire de Master 2 en Coopération internationale, action humanitaire et développement durable.
En vous assurant un traitement en toute confidentialité, nous vous remercions d'avance pour votre bonne collaboration.
I. Réalisations de l'ONG jusqu'en 2010 Quelles sont les actions concrètes réalisées par l'ONG dans la région du Centre ?
Quels sont les partenaires opérationnels de ces actions ?
NB : Collecter les rapports d'activités de l'organisation (préalablement demandés).
II. Stratégie de mise en oeuvre
Quelle est votre approche de travail ? Défendez-vous des valeurs particulières ? Si oui lesquelles ?
III. Rapports avec les acteurs locaux
Quel type de relations entretenez-vous avec : Les pouvoirs publics camerounais? Les autorités traditionnelles ? Les populations bénéficiaires de vos actions ?
Avez-vous identifié de bonnes pratiques locales à pérenniser ? Si oui, lesquelles ? Quelles sont les méthodes/astuces utilisées pour lutter contre les mauvaises pratiques ?
L'organisation dispose t'elle d'un mécanisme d'implication des populations aux actions menées ?
Comment identifiez-vous les besoins des populations ? Par elles-mêmes ? Par les autorités locales ? Par les agences extérieures ?
Quels outils utilisez-vous dans la communication avec les acteurs locaux (autorités locales, population bénéficiaire, partenaires, etc.) ?
Quelle est votre approche par rapport à la prise en compte du savoir local dans la conception de la mise en oeuvre de vos actions ?
Quelle expertise recherchez-vous auprès des ressources humaines locales ?
IV. Partenariat
Quels sont vos partenaires institutionnels et vos partenaires opérationnels (Etat, ONG internationales, ONG nationales, ONG locales ...) ? Quelle appréciation faites-vous de ce partenariat ?
Quels sont vos partenaires financiers ?
De quel mécanisme dispose l'organisation pour assurer une gestion transparente des fonds reçus ?
V. Difficultés et Perspectives
Faites-vous face aux difficultés (culturelles, financières, politiques, géographiques, etc.) lors de la mise en oeuvre de vos actions ?
Si oui, comment gérez-vous ces problèmes?
Quels sont vos grands succès ?
Comment voyez-vous l'avenir de l'organisation dans un contexte de durabilité ? Quel commentaire pouvez-vous faire sur cette étude ?
129
Merci pour votre disponibilité.
130
SOMMAIRE i
DEDICACE i
REMERCIEMENTS ii
SIGLES ET ABREVIATIONS iii
LISTE DES TABLEAUX vi
LISTE DES GRAPHIQUES vii
LISTE DES CARTES ET PHOTOGRAPHIES viii
LISTE DES ANNEXES ix
RESUME x
ABSTRACT xi
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : LES FONDEMENTS SOCIOLOGIQUES, JURIDIQUES ET POLITIQUES DE L'ACTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES DANS LA
REGION CENTRE DU CAMEROUN 16
CHAPITRE I : LES FONDEMENTS SOCIOLOGIQUES DE L'OEUVRE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES DANS LA REGION DU CENTRE DU
CAMEROUN 18
Section I) L'évolution de la solidarité humaine 18
Paragraphe A) L'approche traditionnelle de la solidarité 19
Paragraphe B) L'opinion publique occidentale (le fardeau de l'homme blanc) 20
Section II) La structuration de la solidarité humaine à l'échelle internationale 22
» 23
Paragraphe B) De l'idée de « communauté internationale » à la solidarité internationale
25
CHAPITRE II : LES FONDEMENTS JURIDIQUES ET POLITIQUES DE L'ACTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES DANS LA REGION DU
CENTRE 28
Section I) Les sources juridiques des l'action des organisations internationales non
gouvernementales au Cameroun 28
131
Paragraphe A) Le cadre juridique de l'émergence des organisations internationales non
gouvernementales au Cameroun 29
1) Sur le Plan international 29
2) Sur le plan national 31
Paragraphe B) Le cadre institutionnel des organisations internationales non
gouvernementales au Cameroun 34
1) Les structures étatiques d'appui aux ONG 34
2) Les structures non étatiques d'appui aux associations et ONG 35
Section II) Les fondements politiques de l'action des organisations internationales non
gouvernementales au Cameroun 37
Paragraphe A) La gouvernance globale 37
1) L'idée de la gouvernance mondiale 37
2) Les ONG internationales et les autres acteurs dans la gouvernance globale 38
Paragraphe B) L'échec de la coopération gouvernementale 40
1) Les résultats mitigés de l'Aide Publique au développement et les méfaits des
Programmes d'Ajustement Structurels 40
2) Les OING, véritables acteurs de la solidarité internationale ? 42
DEUXIEME PARTIE : LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES ET
LEURS REALISATIONS DANS LA REGION CENTRE DU CAMEROUN 44
CHAPITRE III : UNE PARTICIPATION EFFECTIVE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON
GOUVERNEMENTALES AU DEVELOPPEMENT DE LA REGION CENTRE DU CAMEROUN 46
Section I) Un profil pluriel des organisations internationales non gouvernementales
présentes dans la région Centre du Cameroun 48
Paragraphe A) Caractéristiques et classification des organisations internationales non
gouvernementales présentes dans la région du Centre 48
1) Selon les critères identitaires 50
2) Selon les critères d'effectivité 53
Paragraphe B) Environnement et partenariat 64
1) Description de l'environnement 64
2) Les différents partenariats 65
Section II) Les réalisations des organisations internationales non gouvernementales dans la
région du Centre du Cameroun 68
132
Paragraphe A) Les domaines dits prioritaires 69
1) La santé y compris le VIH/SIDA 69
2) L'éducation et le développement local 72
Paragraphe B) Les domaines secondaires et les autres domaines 75
1) Les domaines secondaires 75
2) Les autres domaines 76
CHAPITRE IV : LIMITES ET PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE L'ACTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES DANS LA REGION CENTRE
DU CAMEROUN 79
Section I) Les limites à l'efficacité des organisations internationales non gouvernementales
actives dans la région du Centre 80
Paragraphe A) Les limites imputables aux organisations internationales non
gouvernementales 84
Paragraphe B) Les limites imputables aux acteurs locaux 89
Section II) Perspectives d'amélioration de l'oeuvre des organisations internationales non
gouvernementales dans la région du Centre 95
Paragraphe A) Recommandations à l'endroit des organisations internationales non
gouvernementales 95
Paragraphe B) Les recommandations à l'endroit des acteurs locaux 98
CONCLUSION GENERALE 104
BIBLIOGRAPHIE 107
ANNEXES 113
TABLE DES MATIERES 130

