|
GROUPE BK-UNIVERSITE
Institut International de Management
Cotonou-BENIN
CHAMBRE ECONOMIQUE EUROPEENNE
Fondation Universitaire Mercure
Bruxelles-BELGIQUE

MEMOIRE DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION DU
DIPLOME DE
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
OPTION : MANAGEMENT DES
PROJETS
THEME
Problématique de la gestion des Adductions
d'Eau Villageoises dans le département du Couffo : enjeux et
perspectives
Soutenu par :
Dégbey DJIDJI
Sous la direction de :
Maître de stage Directeur de Mémoire
Dr Ing. Arnaud ZANNOU M.
Pascal MEGNIGBETO
Septembre 2014
Promotion 2008-2009
www.groupe-bk.com
AVERTISSEMENT
Tout droit réservé à l'auteur
contre le copyright et le plagiat
LES OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE N'ENGAGENT QUE SON
AUTEUR ET EN AUCUNE FAÇON LE GROUPE BK-UNIVERSITE ET SES
INSTITUTIONS
AVANT PROPOS
En
choisissant ce thème à la fin de ma formation de Master in
Business and Administration, option Gestion des Projets, nous nourrissons
l'ambition d'apporter notre pierre à l'amélioration des
conditions d'approvisionnement en eau potable des populations du
département du Couffo. Le développement d'une localité ne
peut jamais se dissocier de la satisfaction des conditions minimales des
populations en matière d'eau potable.
Contribuer véritablement à la
réduction des difficultés qu'éprouvent les femmes et les
enfants à aller chercher de l'eau tous les matins et tous les soirs fait
partie de notre prérogative, car le développement de la nation
part de la base. Cette étude qui porte sur la problématique de la
gestion des adductions d'eau villageoise dans le département du Couffo
trouve son originalité dans le fait qu'aucune recherche de cette
envergure n'a par le passé abordé la question
spécifiquement pour le département.
Ainsi, elle permettra aux
élus locaux d'adopter une politique plus appropriée en
matière de gestion des AEV afin de garantir leur pérennité
et le service public permanent de l'eau. Les pannes de longues durées
constatées sur les ouvrages sont plus préjudiciables que les
maladies opportunistes causées par ces eaux de qualité douteuse.
Ceci réduit l'efficacité et le dynamisme des populations dans les
différentes activités génératrices de revenus,
sources de financement de l'éducation des enfants et de la satisfaction
des besoins fondamentaux de l'homme.
Poser la problématique de
la gestion des Adductions d'Eau Villageoises et proposer des
alternatives ; c'est de cette manière que nous pensons apporter
notre modeste contribution au processus de développement communautaire
dans notre département, oeuvrant ainsi pour la mise en oeuvre des
objectifs du millénaire pour le Développement et les
prérogatives de la décentralisation.
DEDICACE
Je dédie ce travail :
C au Seigneur Dieu Tout Puissant qui ne m'a jamais
abandonné et qui continue de guider mes pas,
C à mon père et à ma mère,
C à mon épouse et mes enfants pour tous les
sacrifices consentis.
REMERCIEMENTS
Tous mes remerciements vont :
A mon Directeur de mémoire, Monsieur Pascal MEGNIGBETO
et au maître de stage Dr Ing. Arnaud ZANNOU qui n'ont
ménagé aucun effort pour accepter de suivre ce travail, de me
faire profiter de leurs compétences techniques et de me donner les
orientations nécessaires dans le cadre de la rédaction de ce
mémoire de Master II.
- A mes soeurs Marie, Louise, Houéfa et à mon
petit frère Eugène K. DJIDJI, pour n'avoir jamais douté de
ma détermination.
- A mes fils, Agnon Elfried Boris, Mahouna Junior Béni,
Elom Ephraïm Exaucé pour le courage qu'ils m'inspirent.
- A ma tendre épouse ASSOUTO-DJIDJI Joséphine
qui me soutient dans toutes mes initiatives.
- A tout le personnel de la Direction Générale
de l'Eau en particulier le DAEP Monsieur Germain LOKO, le coordonnateur du
Projet PADEAR GTZ/Kfw Monsieur MARCOS Philibert, le Coordonnateur Initiative
Eau Monsieur FATON Dieudonné, Monsieur HOUNSOULIN Théophile,
Monsieur OUSSOU Benoît, Monsieur OROU-MOH Bani et Madame Alexandrine
HONFO-LEGBA qui n'ont ménagé aucun effort afin de m'apporter leur
soutien pour la réussite de ce travail.
- Aux agents des différentes mairies du Couffo qui
m'ont aidé dans le cadre de ce travail et du Service de l'Eau du
Couffo.
- A tous les amis, parents et frères qui, de
près ou de loin, m'ont soutenu pour ce travail, recevez ici tous mes
sentiments de gratitude et de reconnaissance.
SIGLES ET ACRONYMES
|
AEV
|
: Adduction d'Eau Villageoise
|
|
ASECNA
|
: Agence pour la Sécurité de la Navigation
Aérienne en Afrique et à
Madagascar
|
|
AUE
|
: Association des Usagers d'Eau
|
|
AUEP
|
: Association des Usagers d'Eau Potable
|
|
BF
|
: Borne Fontaine
|
|
CENATEL
|
: CEntre NAtional de TELédetection et de la
Surveillance
de la Couverture Forestière
|
|
CRDS
|
: Centre Régional de Développement Sanitaire
|
|
DAC
|
: Dossier d'Appel à Concurrence
|
|
DAEP
|
: Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable
|
|
DDSP
|
: Direction Départementale de la Santé
Publique
|
|
DG Eau
|
: Direction Générale de l'Eau
|
|
DH
|
: Direction de l'Hydraulique
|
|
DHAB
|
: Direction de l'Hygiène et de l'Assainissement
à la Base
|
|
DIE
|
: Direction de l'Information sur l'Eau
|
|
DIEPA
|
: Décennie Internationale de l'Eau Potable et de
l'Assainissement
|
|
DSRP
|
: Document de Stratégies de Réduction de la
Pauvreté.
|
|
FED
|
: Fonds Européen de Développement
|
|
FLASH
|
: Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines
|
|
FPM
|
: Forage équipé de Pompe à
Motricité humaine
|
|
HAADI Sud
|
: Projet Hydraulique et Assainissement en Appui au
Développement
Institutionnel Sud
|
|
IGN
|
: Institut Géographique National
|
|
IIM
|
: Institut International de Management
|
|
ImS
|
: Intermédiation Sociale
|
|
INSAE
|
: Institut National de la Statistique et de l'Analyse
Economique
|
|
OMD
|
: Objectifs du Millénaire pour le
Développement
|
|
OMS
|
: Organisation Mondiale de la Santé.
|
|
PADEAR
|
: Projet d'Assistance au
Développement du Secteur de l'Alimentation
en Eau Potable et de l'Assainissement en milieu Rural
|
|
PDC
|
: Plan de Développement Communal
|
|
PE
|
: Point d'Eau
|
|
PEA
|
: Poste d'Eau Autonome
|
|
PM
|
: Puits Moderne
|
|
PPEA
|
: Programme Pluriannuel d'appui au secteur de l'Eau
et de l'Assainissement
|
|
PTF
|
: Partenaires Techniques et Financiers
|
|
RGPH3
|
: Recensement Général de la Population et de
l'Habitat de 2002
|
|
S Eau
|
: Service de l'Eau
|
|
SBEE
|
: Société Béninoise d'Electricité
et d'Eau
|
|
SEPS
|
: Service des Etudes, de la
Planification et du Suivi
|
|
SERHAU-SA
|
: Société d'Etude Régionale, d'Habitat et
d'Aménagement
Urbain.- Société Anonyme
|
|
SHU
|
: Service Hydraulique Urbaine
|
|
SONEB
|
: Société Nationale des
Eaux du Bénin
|
|
UAC
|
: Université d'Abomey
Calavi.
|
|
UNB
|
: Université Nationale du
Bénin
|
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT
2
AVANT PROPOS
3
DEDICACE
4
REMERCIEMENTS
5
SIGLES ET ACRONYMES
6
SOMMAIRE
8
LISTE DES FIGURES
10
LISTE DES PHOTOS
10
RESUME
11
ABSTRACT
12
INTRODUCTION
13
1ERE PARTIE : LES DONNEES GENERALES
15
CHAPITRE1 : PROBLEMATIQUE
15
I.1. Etude du contexte de l'étude
15
I.2. Etat des lieux de la situation problématique
18
I.3. Enoncé du problème
20
I.4. Description des dimensions du problème
20
I.5. Formulation des questions des recherche
21
CHAPITRE 2 : REVUE DE LITTERATURE ET CADRE DE
REFERENCE THEORIQUE DE L'ETUDE
22
II.1. Revue de litterature
22
II.2. Cadre de reference theorique de l'etude
23
II. 3.Definition operationnelle des concepts
25
II.4. Hypotheses et objectifs de recherche
27
II.5. Les objectifs
29
2E PARTIE : METHODOLOGIE ET ANALYSE DES
DONNEES
30
CHAPITRE 3 : CADRE D'ETUDE ET METHODOLOGIE DE
TRAVAIL
30
III.1.Cadre de l'étude
30
III.2.Evolution démographique du département du
Couffo
32
III.3.Structure socio économique
33
III.4.Approche méthodologique
33
CHAPITRE 4- ANALYSE ET INTERPRETATION DES DONNEES
37
IV. Analyse des données
37
IV.1. Evaluation des AEV dans le département du Couffo
37
IV.2. Présentation des résultats et
décisions
51
Iv.3. Rôles et responsabilités des acteurs dans le
suivi de la gestion des AEV
57
IV.4. Recommandations
59
IV.5. Présentation des critères de
vérification de l'hypothèse
66
CONCLUSION
68
BIBLIOGRAPHIE
71
ANNEXES 73
LISTE DES TABLEAUX
|
Tableau I
|
: Tableau synoptique
|
|
Tableau II
|
: Etat actuel des AEV dans le département du Couffo
|
|
Tableau III
|
: Sources d'alimentation électrique des réseaux
d'adduction d'eau villageoise dans le Couffo
|
|
Tableau IV
|
: Situation des AEV dans le Couffo
|
|
Tableau V
|
: Point sur la transmission et l'analyse des documents de
suivi
|
|
Tableau VI
|
: Situation actuelle du processus d'affermage dans les
6 communes du Couffo
|
|
Tableau VII
|
: Tableau des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces
(FFOM)
|
|
Tableau VIII
|
: Plan d'action pour le raccordement des AEV au réseau
électrique SBEE
|
LISTE DES FIGURES
|
Figure n°1
|
: Evolution démographique dans le département
du Couffo
|
|
Figure n°2
|
: Différentes sources d'alimentation en énergie des
AEV
du Couffo
|
|
Figure n° 3
|
: Evolution des Adductions d'Eau Villageoise dans
le Couffo de 1990 à 2011
|
LISTE DES PHOTOS
|
Photo n°1
|
: Un château d'eau à Doko (commune de Toviklin)
|
|
Photo n° 2
|
: Une Borne Fontaine dans le Couffo
|
|
Photo n° 3
|
: Carte de situation géographique du département du
Couffo
|
RESUME
La gestion des AEV est un problème majeur dans le
processus d'amélioration du service public de l'eau au Bénin. En
effet, le Bénin dispose d'un pack de 450 AEV dont 61 dans le
département du Couffo. Ces ouvrages se trouvent confrontés
à d'énormes problèmes dont la gestion pour garantir leur
pérennité. En vue de pallier ce problème, le processus de
professionnalisation de la gestion des AEV a été engagé
dans toutes les six communes du département.
Afin d'analyser la situation et de cerner le contour
réel des problèmes, une enquête de terrain en
été entreprise à travers des questionnaires et des guides
d'entretien avec les différents acteurs concernés du secteur de
l'eau dans toutes les communes de la zone d'étude pour recueillir les
données relatives à la situation .
L'analyse des données issues de cette enquête a
permis d'aboutir aux principaux résultats suivants :
- 30% des AEV présentent des problèmes majeurs
avec une situation très contrastée suivant les communes sur les
62% mis en affermage effectif,
- Les communes, actuellement maîtres d'ouvrages ne
respectent pas les guides élaborés dans le cadre de la
professionnalisation des AEV, et
- Les redevances ne sont pas fixées en fonction de
calculs objectifs pour garantir la pérennité et l'autofinancement
des ouvrages.
Somme toute, il faut retenir qu'il est impérieux de
revoir la façon dont la gestion des AEV est conduite en actualisant les
outils nécessaires en concertation avec les différents
acteurs.
Mots clés : Professionnalisation, AEV,
affermage, Acteurs, Couffo
ABSTRACT
AEV management is a major problem in the process of improving
the public water service in Benin. Indeed, Benin has a pack of 450 AEV
including 61 in the department of Couffo. These books are facing huge problems
with management to ensure their sustainability. In order to overcome this
problem, the process of professionalization of management AEV has been engaged
in all six municipalities in the department.
To analyze the situation and identify the real contour
problems , a field survey was conducted in through questionnaires and interview
guides with various stakeholders in the water sector in all public area study
to collect data on the situation. The analysis of data from this investigation
has lead to the following main results :
- 30% of AEV have major problems with a very mixed according
to the Commons on 62% being effective farming situation
- Common , currently building owners do not comply with
guidelines developed through the professionalization of AEV and
- The fees are not set according to objective calculations to
ensure the continuity and flow structures.
All in all, we must remember that it is imperative to review
how management AEV is conducted by updating the necessary tools in consultation
with various stakeholders.
Key words: Professionalization, AEV, affermage,
Stakeholders, Couffo
INTRODUCTION
L'eau, tout comme l'air, est une denrée
consubstantielle à la vie. Antoine de Saint- Exupéry
n'a pas hésité à confirmer que « Eau,
plus que la vie, tu es la vie », (Terre des hommes 1938, 218 p).
Elle est d'une nécessité impérieuse pour l'homme chez qui
elle représente 90% de son volume et 2/3 de son poids corporel (L.
ODOULAMI, 1998, p 23).
L'accès à cette ressource a toujours
été un souci permanent pour l'humanité. La Sainte
Bible rapporte que Moïse conduisant le peuple d'Israël lors de
la traversée du désert (aux environs de 1250 ans avant
Jésus-Christ) a dû faire face, à plusieurs reprises,
à de vives contestations de ce peuple chaque fois qu'il manquait de
l'eau à boire1(*).
Des siècles se sont écoulés et le
problème de l'eau reste toujours d'actualité. En effet,
l'approvisionnement en eau potable (AEP) est sujet, aujourd'hui encore,
à d'énormes difficultés. C'est ainsi que le PNUD a
intitulé le Rapport Mondial sur le Développement Humain (2006)
comme suit : « au-delà de la pénurie :
pouvoir, pauvreté et crise mondiale de l'eau ». Au moins
1,1 milliard de personnes sont toujours privées
d'eau potable dans le monde ; en Afrique, 330 millions de personnes manquent toujours du liquide de vie. Les
projections de David Brooks pour l'avenir sont encore
plus pessimistes ; il écrit : « Au cours
des 25 prochaines années, le tiers de la population mondiale fera face
à une grave pénurie d'eau. De toute évidence, les
inégalités quant à la disponibilité et à
l'approvisionnement d'eau douce sont une question de vie ou de mort, et
constituent, en matière de gouvernance, un des impératifs les
plus catégoriques de notre temps. » (p.13)
Au Bénin, bien que n'étant pas
particulièrement critique, la situation de l'eau potable en milieu rural
et semi urbain nécessite, tout de même, une certaine vigilance des
décideurs nationaux de ce secteur. Elle laisse distinguer deux grands
aspects : la construction des ouvrages hydrauliques et la stratégie
de leur gestion.
Il reste alors à réfléchir encore de
façon plus approfondie sur la question cruciale de la stratégie
de gestion des ouvrages. Cette réflexion paraît aussi importante
que les efforts de mobilisation des financements car la
pérennité des infrastructures, la rentabilité et l'impact
à long terme des investissements en dépendent. Certes, il existe
depuis 2005 un document de "stratégie nationale d'approvisionnement
en eau potable 2005-2015". Mais depuis son adoption, ce document reste
inopérant compte tenu des contingences et susceptibilités
liées à sa mise en application. Mais, il est en cours de
relecture afin d'être adapté aux nouvelles exigences de la
décentralisation et du transfert des compétences aux communes.
En effet, selon une étude diagnostique conduite sur le
plan national par la cellule de coordination du Programme "Initiative Eau pour
les centres semi-urbains" en 2008, 73% des AEV ne
disposent pas de capacité financière suffisante pour le
renouvellement de leur équipement, conséquence d'une gestion
actuelle des AEV qualifiée de médiocre. Etant donné que
cette capacité financière est le principal indicateur de la
pérennité du système, il urge de se poser de questions. De
plus, les ouvrages d'alimentation en eau potable au
Bénin sont réalisés mais restent à être mieux
gérés afin de garantir une meilleure pérennité.
Selon le rapport d'exécution du BPO 2011, le taux de panne est
évalué à 10% comparativement à l'année 2010
où le taux de panne est évalué à 9%.Cette situation
est imputable au relâchement du suivi appui aux ouvrages de la part des
nouveaux maîtres d'ouvrage que sont les communes.
D'où la nécessité de mettre en
place une nouvelle politique de gestion afin de mieux garantir la
pérennité du service de l'eau fourni par ce type d'ouvrage.
Le présent mémoire s'inscrit dans cette
dynamique et se propose donc de faire l'état des lieux de la gestion
des AEV existants, analyser leur gestion et faire ressortir les
difficultés inhérentes et enfin proposer des solutions
d'amélioration de la gestion professionnalisée des AEV en vue de
garantir le service permanent de l'eau dans le département.
1ERE PARTIE : LES DONNEES
GENERALES
Chapitre1 : PROBLEMATIQUE
I.1. Etude du contexte de
l'étude
Dès les années 1990, les adductions d'eau
villageoises se sont rapidement développées au Bénin pour
approvisionner de façon efficace des villages ou des ensembles de
localités d'au moins 2 000 habitants. Ce chiffre de 2 000 habitants
représente le seuil économique qui permet de gérer
durablement l'installation c'est-à-dire d'équilibrer les recettes
et les charges de fonctionnement, de maintenance et de renouvellement avec un
prix de l'eau acceptable. Pour cette même raison, des postes d'eau
autonomes (PEA) équipés dune rampe de distribution ont
été réalisés pour desservir des localités
présentant des concentrations de 750 à 1 000 personnes.
Conformément au principe de la gestion communautaire
des AEV régie par le décret N°96- 317 du 2 août 1996,
la gestion des ouvrages a alors été confiée à des
associations d'usagers de l'eau (AUE). Dans ce contexte, la DG-Eau,
déléguait sa fonction de maître d'ouvrage au S-Eau qui
signait avec l'AUE une convention de cession et d'exploitation des
Équipements des systèmes d'eau potable. A l'exception de
l'ouvrage de captage qui restait la propriété de l'Etat, le reste
de l'infrastructure devenait, à la signature de la convention, la
propriété de l'AUE2(*).
La loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des
communes en République du Bénin qui dispose que la commune est
maître d'ouvrage dans le domaine de la fourniture et de la distribution
d'eau potable sur son territoire a rendu caduc le système de gestion
communautaire. La commune, maître d'ouvrage, est désormais
propriétaire des infrastructures d'AEP présentes sur son
territoire et exerce ses compétences en conformité avec la
stratégie sectorielle.
A cet effet, la commune veille à la mise en oeuvre du
système de suivi afin de garantir la viabilité et la
pérennité des ouvrages. Elle commande les audits, assure le
respect des directives pour l'établissement des prix et la
révision des tarifs, contrôle les comptes d'exploitation
prévisionnels et la qualité du service. Un diagnostic des AEV
réalisé en 2007 au démarrage de l'initiative Eau 2 a mis
en évidence les nombreuses insuffisances de la gestion communautaire en
matière de gestion technique et financière qui mettaient en
péril la pérennité de l'approvisionnement en eau. La
DG-Eau a alors entrepris d'appuyer le processus de professionnalisation de la
gestion des AEV à travers :
? Un atelier national sur la définition dune gestion
pérenne des AEV;
? Un atelier national sur les modalités de mise en
oeuvre de la gestion professionnelle des AEV qui a conduit la
définition de différents modes de délégation de
gestion de l'AEV par la commune :
Contrat fermier : délégation par la commune un
fermier
? Contrat association : délégation de la gestion
une association de consommateurs ;
? Contrat tripartite : commune association de consommateurs
fermier
? Contrat production-distribution : contrat commune fermier
(pour la production) et contrat fermier - association de consommateurs (pour la
distribution)
En effet, l'AEP en milieu rural du Bénin est toujours
sous le régime de propriété commune27(
*) ;
c'est-à-dire qu'un ensemble d'individus désignés par la
communauté a le contrôle de la ressource. Les équipements
de fourniture d'eau constituent les propriétés collectives des
usagers locaux. L'initiative d'entretien et de renouvellement doit venir d'eux.
Dans la mise en place de ces équipements, les communautés ont
apporté collectivement leur participation et sont responsables de la
gestion de ces équipements.
Avec l'avènement de la décentralisation en
décembre 2002 et les textes de lois y afférents, l'Etat central
est appelé à céder la maîtrise d'ouvrage aux
collectivités décentralisées que sont les communes. En
effet, la loi n°97-09 du 15 janv. 1999 portant organisation des communes
en République du Bénin dit en son article 93 que « la
commune a la charge de la fourniture et de la distribution de l'eau
potable..... ». L'article 108 précise comme suit les
modalités d'exercice de cette compétence : « la
commune exerce ses compétences en conformité avec les
stratégies sectorielles, les réglementations et les normes
nationales en vigueur ».
Or, adoptée en mars 2005, "la stratégie
nationale de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural du Bénin
(2005-2015) " stipule que : « tirant leçon des
expériences du passé, la gestion du service de l'eau potable en
milieu rural, pour être durable doit se baser sur le principe de
délégation. ». De là, le document indique
l'option de double délégation aux communes
(Délégation de la commune à une AUEP, qui, à son
tour, délègue la gestion à un opérateur
privé).
C'est dans un tel contexte que la Direction
Générale de l'eau, sous l'impulsion de la cellule "Initiative
Eau", a réalisé une étude diagnostique du système
actuel de gestion de l'eau potable en milieu rural. Cette étude
révèle une gestion actuelle médiocre28(
*).
Les AUEP reconnaissent la plupart des problèmes de gestion et estiment
qu'ils peuvent être résolus à travers un suivi et
appui-conseil plus régulier et une meilleure formation. Par contre, les
Maires, moins optimistes, considèrent la gestion communautaire
globalement comme un échec. Ils avancent comme arguments, l'absence de
responsabilités des gestionnaires actuels, le manque de transparence de
leur gestion et l'impunité dont ils bénéficient.
C'est donc pour harmoniser les points de vue que la DGEau a
initié un "atelier national sur la gestion des Adductions d'Eau
Villageoises" qui s'est déroulé du 20 au 22 juin 2006 à
Cotonou. Cet atelier qui a regroupé l'ensemble des acteurs du secteur
(Maires, responsables d'AUE, ONG, secteurs privés, services centraux du
ministère de l'eau, etc.), après s'être inspiré des
expériences de délégation de gestion dans six pays de la
sous-région ouest africaine, a préconisé les quatre
options de gestion qui suivent (sur les six soumis à la
réflexion des participants) :
- option 2 : délégation de la gestion de
l'AEV par la commune à une AUEP
- option 4 : contrat tripartite entre la commune, l'AUEP
et un fermier ;
- option 5 : délégation par la commune de
la partie production à un fermier et de la partie distribution de l'eau
à une AUEP ;
- option 6 : délégation par la commune
à un fermier.
Au nombre des options que l'atelier a rejeté figure
celle dite de "la double délégation" qui, faut-il le rappeler,
est curieusement celle retenue dans le document de stratégie nationale.
Cette ambivalence voire contradiction de prescriptions au niveau national n'est
pas de nature à faciliter la compréhension des intentions des
décideurs nationaux du secteur.
I.2. Etat des lieux de la
situation problématique
L'eau constitue un bien considéré à
l'instar de l'air, comme essentiel à la vie humaine. Elle est la plus
cruciale des ressources naturelles et qui rend la vie possible et soutient les
écosystèmes et les entreprises de l'homme. L'eau est à la
fois une ressource stratégique et l'élément de base
fondamental nécessaire à une économie saine (L.
ODOULAMI , 1998, p 23). L'accès à cette ressource pose
encore d'énormes difficultés dans plusieurs régions du
monde dont particulièrement les pays en voie de développement. En
effet, un milliard quatre cent millions environ d'êtres humains dans le
monde n'avaient toujours pas accès en 2003 à l'eau potable et
parmi eux, 450 millions se situaient en Afrique (Gauthier, 2004).
Alors qu'environ 85% de la population urbaine en Afrique ont
de l'eau potable, 55% de la population rurale n'y ont toujours pas accès
(Enterprise Works World Wide, 2003). La situation est surtout alarmante dans
les pays désertiques et sahéliens où un litre d'eau vaut
plus qu'un lingot d'or (l'eau s'obtient dans certains pays désertiques
par échange avec de l'or, parfois l'existence de ce métal ne
garantit aucune sécurité en approvisionnement en eau car elle
manque avec acuité). Sur le plan national, l'approvisionnement en eau
potable en milieu rural reste faible.
La situation oblige cependant encore plus de la moitié
de la population rurale de s'approvisionner au marigot, à la
rivière, au puits non protégé et même à
partir des citernes remplies d'eau de pluie et mal entretenues (PROTOS, janvier
2006). Il existe un lien direct entre le manque d'accès à l'eau
et toutes sortes de maladies dont sont victimes les populations pauvres dans le
monde, en particulier dans les pays en voie de développement (Briand et
Lemaître, 2004).
Aujourd'hui elle fait objet de grandes préoccupations
des chefs d'État et de gouvernements et de plusieurs institutions
nationales, régionales ou internationales comme l'Union Africaine, le
NEPAD, l'OMS, l'UNICEF etc. , compte tenu de l'enjeu qu'elle représente
dans la vie de l'homme à travers plusieurs projets ou programmes.
Au Bénin, des populations continuent de souffrir de
l'eau en particulier dans le Département du Couffo. En effet, le taux de
desserte dans cette région du Bénin est de 60,9% (Base de
Données Intégrées ; BDI, mai 2012) si l'on prend en
compte tous les points d'eau (FPM, PEA, AEV). Les AEV constituent une
amélioration du niveau de service de l'eau.
En effet, pour favoriser une pérennité des
ouvrages, le processus de professionnalisation de la gestion des AEV a
été engagé dans toutes les communes des 11
départements du Bénin ; mais son bilan actuel reste encore
mitigé avec 62% des AEV seulement en affermage effectif dont 30%
présentent des problèmes majeurs avec une situation très
contrastée suivant les communes (DG-Eau/GIZ, mai
2012).
Le critère majeur jouant sur l'avancement et le bon
déroulement du processus est d'abord la compréhension et
l'implication des élus d'une commune, et en premier lieu le maire,
renforcé par la présence dans les services communaux d'un
responsable du secteur eau et assainissement ; cependant, d'autres
éléments jouent un rôle important dans les
difficultés actuelles de mise en place de l'affermage des AEV :
· de nombreux appels à concurrence se sont
révélés infructueux du fait de l'absence, ou du nombre
trop faible d'offres recevables ;
· la non rentabilité structurelle de quelques
AEV ;
· les consommations constatées plus faibles que
celles prévues lors des études : populations
surestimées et/ou concurrence des autres points d'eau ;
· la mise en affermage d'AEV thermiques anciennes sans
réhabilitation du système de pompage ;
· la réticence, voire le blocage du processus par
les anciens gestionnaires ;
· la fixation du prix de l'eau et du montant des
redevances faite sans s'appuyer sur des éléments objectifs.
Il apparaît donc fondamental qu'en ce qui concerne la
dynamisation du suivi de la gestion des AEV, de poursuivre l'appui aux communes
dans le processus de professionnalisation.
I.3. Enoncé du
problème
Le Couffo fait partie des départements ayant
bénéficié de la réalisation d'AEV depuis 1990.
Cependant, le suivi de la gestion par la commune est aussi insuffisant avec
seulement 47% des AEV en affermage pour lesquelles le fermier fournit
régulièrement à la commune les comptes rendus mensuels. On
constate, pour la régularité de remise des documents, le
même contraste entre les communes que celui déjà
relevé pour l'évolution du processus de mise en affermage. Et
même lorsque les données de suivi sont fournies
régulièrement, il n'y a pratiquement aucune analyse de la part de
la commune.
Par ailleurs, la gestion communautaire qui était faite
de ces ouvrages a laissé champ libre aux gestionnaires communautaires
d'utiliser les fonds issus de la vente de l'eau à d'autres fins. La
conséquence immédiate est l'abandon des ouvrages (car les fonds
sont dilapidés), les Bornes Fontaines restent plusieurs mois sans
être réparées. Du coup, les populations font recours
à d'autres sources alternatives dont les eaux de citerne et de puits
traditionnels pour lesquelles l'entretien n'est pas du tout assuré. Cet
état de chose ralentit l'allure de l'atteinte des objectifs, car une
chose est d'avoir l'ouvrage, mais l'autre chose la plus importante est la
permanence de la fourniture de l'eau aux populations.
I.4. Description des dimensions du
problème
La gestion des adductions d'eau villageoises dans le Couffo
pose d'énormes problèmes qui méritent d'être
étudiés afin de tenter des approches de solutions.
L'approvisionnement en eau potable à partir des
adductions d'eau villageoise (AEV) s'est rapidement développé au
Bénin ces dernières années pour l'alimentation en eau
potable de village ou ensemble de villages de 2.000 à plus de 10.000
habitants. Il existe ainsi actuellement plus de 60 AEV sur l'ensemble du
département. Dans le passé, la gestion des AEV a
été confiée par l'Etat à des Associations des
Usagers de l'Eau (AUE) créées au sein des communautés
concernées. Cependant, à partir de 2003, le contexte du secteur
de l'eau, et par conséquent de la gestion des AEV, a
profondément changé avec la mise en place effective des communes
dans le cadre de la décentralisation administrative. Aujourd'hui, la
maîtrise d'ouvrage pour l'alimentation en eau potable de leur territoire
revient par la loi aux communes. Après deux à trois années
de mise en oeuvre, la gestion communautaire des AEV a montré ses
limites. Un diagnostic exhaustif des AEV réalisées en 2007 au
démarrage de l'Initiative Eau dans les centres semi-urbains a mis en
lumière certaines insuffisances de la gestion communautaire au
début de la professionnalisation qui constituent un risque pour la
durabilité de ces équipements.
I.5. Formulation des questions des
recherche
En analysant cet état de chose, trois questions
principales motivent le choix de ce thème de recherche:
· Quelle est la situation actuelle des AEV dans le
département du Couffo ?
· Qu'est-ce qui justifient les nombreux problèmes
rencontrés par les acteurs en ce qui concerne la gestion des
AEV dans le département du Couffo?
· Ne faut-il pas adopter de nouvelles stratégies
pour gérer au mieux les AEV dans le département du
Couffo?
Pour répondre à ces préoccupations, nous
ferons d'abord un état des lieux sur la situation, ensuite nous
évaluerons les impacts induits et enfin, nous ferons des propositions
concrètes en vue de palier ce problème.
CHAPITRE 2 : REVUE DE LITTERATURE ET CADRE DE REFERENCE
THEORIQUE DE L'ETUDE
II.1. REVUE DE LITTERATURE
En 2007, une étude commanditée dans le cadre du
programme Initiative Eau a révélé que l'approvisionnement
en eau potable à partir des adductions d'eau villageoise (AEV) s'est
rapidement développé au Bénin pour l'alimentation en eau
potable de villages ou ensemble de villages de 2.000 à plus de 10.000
habitants. Ainsi Il existe actuellement plus de 340 AEV sur l'ensemble du
territoire avec une population d'environ neuf (9) millions d'habitants
desservis en milieu rural et semi-urbain.
De la même manière, le problème
d'entretien et de maintenance des AEV fait couler d'encre et de salive de sorte
que la Banque Mondiale a entrepris une étude sur le suivi de la gestion
des AEV. A cet effet, elle a choisi cinquante sites pilotes qui doivent faire
objet d'une expérimentation à travers une plate forme
mutualisée à base des téléphones portables
où les informations sont communiquées à tous les
gestionnaires d'AEV. Ces informations sont recueillies par le
délégataire qui les analyse et prend des décisions
conséquentes pour la bonne gestion des ouvrages et l'assurance à
plein temps du service public de l'eau. Cette approche permettra une meilleure
gouvernance des AEV et assurera la pérennité de l'ouvrage.
L'expérience de la phase pilote a été
présenté le 20 juin 2013. L'étape de la vulgarisation se
poursuivra dans les prochains jours car la phase pilote a été
concluante selon le responsable du Programme Eau Potable et Assainissement de
la Banque Mondiale.
En 2008 plus tôt, André ADOMOU, dans le cadre de
l'obtention de son diplôme de DESS en Développement et gestion des
projets écrivait qu'en milieu rural au Bénin, la gestion des
ouvrages de l'eau potable est confiée depuis 1996 aux communautés
qui, à travers les Associations communautaires d'Usagers de l'Eau
Potable, ont reçu de l'Etat le droit d'exploitation, d'entretien, de
maintenance et de renouvellement de l'équipement à travers la
vente de l'eau.
La Direction Générale de l'Eau a
diligenté en 2006 une étude diagnostique sur le plan national de
la gestion communautaire des Adductions d'Eau Villageoises (AEV). Cette
étude a révélé que 73% des
AEV ne disposent pas de capacité financière suffisante pour le
renouvellement de leur équipement. Etant donné que cette
capacité financière est le principal indicateur de la
pérennité du système, il convient de repenser la politique
de gestion desdits ouvrages.
C'est ainsi, qu'après le diagnostic national, il reste
à approfondir la question au niveau local. Les questions principales
qu'il s'est posées lors de cette étude sont :
« La gestion communautaire constitue-t-elle un handicap pour la
pérennité du service de l'eau potable? Les AEV de la commune
disposent-elles de capacité suffisante pour le renouvellement de leur
équipement ? Quels sont les facteurs limitants de cette
capacité financière ? »
II.2. CADRE DE REFERENCE THEORIQUE
DE L'ETUDE
II.2.1. LA BIOGEOGRAPHIE DU MILIEU
II.2.2. Le milieu naturel
Le département du Couffo est créé en
19993(*) à la suite
de la réforme de l'organisation administrative et territoriale de cette
même année. Elle couvre une superficie de 2 404
Km2.
Elle compte six communes à savoir Aplahoué,
Djakotomey, Dogbo, Lalo, Toviklin et Klouékanmey.
Il fait partie de la 6e zone agro écologique
qui représente la zone de terre de barre de Klouékanmè,
Djakotomey, Dogbo et Toviklin.
II.2.2.1. Le relief
Le département du Couffo présente un relief
relativement peu accidenté. Elle se situe sur le plateau
sédimentaire du continental terminal. Sa situation
hydrogéologique est caractérisée par le
sédimentaire avec l'affleurement du socle par endroit. Ce plateau
présente un relief structural comme tous les autres reliefs de
l'Afrique occidentale soudanienne. Il est constitué de formations
sédimentaires qui se sont déposées successivement sur le
socle précambrien (granite et grès). Les sols sont ferralitiques
et argilo sableux fortement dégradés mais très bien
drainés et à faible capacité de rétention. Il
s'agit en réalité des sols profonds et faciles à
travailler selon la culture. La nappe phréatique y est très
profonde (60 à 110 m de profondeur).
II.2.3. L'HYDROGRAPHIE ET L'HYDROLOGIE
II.2.3.1- Climat et hydrologie
Le département du Couffo connaît un climat de
type subéquatorial avec deux saisons de pluies et deux saisons
sèches. La température est relativement élevée.
L'amplitude thermique est de 6°C avec un maximum de 34°7C
enregistré en saison sèche (février -mars- avril) sans
grande variation entre le jour et la nuit. Le degré
hygrométrique, comme dans tout le Bénin, est moins
élevé que dans les autres climats de type subéquatorial.
Il n'atteint que rarement les 80% tandis que l'évapo-transpiration
n'excède que rarement 1000 mm. Le nombre de jours de pluie tourne autour
de 100 jours par an.
Un seul cours d'eau traverse le département. Il s'agit
du fleuve Couffo. Il existe quelques plans d'eau non importants où
pourraient se développer les activités de pêche. De
même, la nappe phréatique est très profonde, ce qui ne
favorise pas la réalisation des ouvrages en hydraulique villageoise. Ces
facteurs ajoutés aux conditions climatiques et hydrologiques ont un
impact négatif sur l'approvisionnement en eau dans la zone. Il s'agit en
fait des zones hydrogéologiquement difficiles.
II.2.3.2- Précipitation et
végétation
La pluviométrie se situe entre 800 et 1400 mm d'eau par
an. Cette situation d'insuffisance se trouve aggravée par les
aléas climatiques observés ces dernières années
avec des répercussions désastreuses sur le secteur agricole.
La végétation naturelle a complètement
disparu pour faire place à une jachère arbustive et aux palmiers
à huile dont les performances agronomiques restent très faibles.
Dans cette région, la période de croissance
végétative varie entre 80 jours et 100 jours. Cette
végétation est aussi dominée en dehors du palmier
à huile de graminées.
II. 3. DEFINITION
OPERATIONNELLE DES CONCEPTS
Dans le cadre de la rédaction de ce mémoire, les
concepts utilisés sont ici ceux relatifs au secteur de l'eau et qui
concernent en particulier les ouvrages complexes.
AEV : Adduction d'Eau Villageoise ;
elle peut se comprendre comme étant un type d'ouvrage constitué
d'un forage équipé d'un système de pompage motorisé
relié à un réservoir de stockage et à un
réseau de distribution d'eau plus ou moins complexe.
Photo n°1 : un château d'eau à Doko
(commune de Toviklin)

Cliché : Dégbey DJIDJI, janvier 2013
Un château d'eau est un
réservoir en béton armée ou parfois métallique
conçu pour contenir une certaine quantité d'eau pompée du
forage par une pompe électrique pour desservir des localités.
L'eau est distribuée par des canalisations
enterrées qui alimentent des bornes fontaines publiques et des
branchements particuliers.
Le système peut desservir plusieurs localités
pouvant dépendre de plusieurs arrondissements, voire de plusieurs
communes.
Les AEV présentent de nombreux avantages par rapport
aux ouvrages simples :
- suppression du pompage manuel,
- moins d'attente aux points de distribution,
- des points de distribution plus proches des
consommateurs,
- possibilité, sous certaines conditions, de disposer
de branchements particuliers à domicile,
- possibilité d'extension du réseau sans
investissements lourds.
Les adductions d'eau villageoises sont une bonne solution pour
l'alimentation en eau potable des villages importants totalisant 2 000
habitants ou plus, ou pour des groupes de villages et localités proches
les uns des autres et où la population totale est supérieure
à 2 000 habitants (Etude pour la dynamisation du suivi de la gestion des
Adductions d'Eau Villageoises Mai 2012).
Photo n° 2, Une Borne Fontaine dans le
Couffo

Cliché :
Dégbey DJIDJI, janvier 2013
II.4.
HYPOTHESES ET OBJECTIFS DE RECHERCHE
II.4.1. HYPOTHESES DE RECHERCHE
Les hypothèses qui guideront notre travail se
présentent comme suit :
- Les Adductions d'Eau Villageoises dans le département
du Couffo enregistrent assez de pannes,
- L'absence d'un système de suivi régulier des
AEV au niveau des communes du Couffo favorise l'inexistence d'un service
permanent de l'eau ;
- La mise en affermage est un mode qui favorise la bonne
gestion des AEV.
II.4.2. LES VARIABLES
Le processus d'affermage des AEV est en cours mais rencontre
déjà des difficultés que ce soit au niveau du choix des
fermiers, de la fixation du prix de l'eau et du montant des redevances mais
aussi dans l'exécution du contrat lui-même en ce qui concerne le
respect par les deux parties de certaines dispositions de ce contrat.
Parmi les différentes difficultés
rencontrées ou que l'on peut craindre à terme, les plus
importantes, constituant des risques majeurs pour la durabilité de la
gestion, sont les suivantes :
· La « non rentabilité » de
certaines AEV liée à :
- Une trop faible population desservie.
- Une trop faible consommation unitaire liée à
la forte concurrence de points d'eau alternatifs (FPM et/ou puits modernes et
traditionnels) où l'eau est soit gratuite (la plupart des puits), soit
moins chère (FPM) ; cet aspect n'a pas été toujours
pris en compte dans le dimensionnement des équipements ce qui a
amené à construire des ouvrages surdimensionnés (la
production constatée après la mise en service de l'AEV se
révèle beaucoup plus faible que celle prévue dans le
dimensionnement).
· La mise en affermage d'AEV thermiques anciennes sans
réhabilitation préalable dont le système de pompage
(groupe électrogène et pompe) a déjà
dépassé 6000 heures de fonctionnement (soit la moitié de
la durée de vie « normale ») présente des
risques majeurs pour la durabilité de la gestion. En effet, si l'AEV est
mise en affermage en l'état, le fermier se trouve dans une situation
délicate : il doit exploiter un équipement ancien
entraînant des charges d'exploitation et de maintenance
élevées (en particulier de grosses réparations) dès
le démarrage du contrat.
De plus, le groupe et la pompe arriveront assez rapidement
à la fin théorique de leur durée de vie et devront
être remplacées grâce à la redevance renouvellement
alors que le fermier n'aura versé la redevance renouvellement que depuis
la mise en affermage et donc les montants seront insuffisants pour financer le
renouvellement.
· Une insuffisance de la ressource en eau qui ne
concerne, dans les 6 départements où intervient GIZ, que quelques
AEV situées dans le socle mais qui évidemment est
rédhibitoire pour la durabilité de la gestion.
En dehors de ces problèmes cruciaux pour la
durabilité de la gestion de certaines AEV évoqués
ci-dessus, le raccordement du système de pompage au réseau
électrique de la SBEE, constitue un élément
déterminant dans l'amélioration de la rentabilité de la
gestion de toutes AEV
II.4.3. LES INDICATEURS
Les principaux indicateurs qui font objet de la
présente recherche sont relatifs à :
ü l'état actuel des AEV,
ü le niveau de professionnalisation des AEV et
ü le niveau du suivi.
Aujourd'hui, sur les soixante et une (61) AEV du Couffo, 72%
ont été mis théoriquement en affermage dont 30% des AEV
connaissent des problèmes majeurs (Soit des robinets non fonctionnels,
des groupes électrogènes en panne, les tuyaux PVC cassés
à des endroits, ou la pompe est grillée). De la même
manière, 28% des AEV mise en affermage ne rendent pas compte de
façon régulière à la commune (enquête de
terrain).
Ces indicateurs nous permettront de mieux analyser la
situation et de proposer d'autres outils de suivi des AEV dans le Couffo.
II.5. LES OBJECTIFS
II.5.1. Objectif
général
L'objectif général de cette étude est de
contribuer à la pérennité du service permanent de l'eau en
proposant des approches de solutions de gestion des adductions d'eau
villageoise dans le département du Couffo.
II.5.2. Objectifs
spécifiques
q Faire l'état des lieux sur la gestion des AEV
existants dans le département du Couffo;
q Analyser la gestion des AEV et faire ressortir les
difficultés inhérentes;
q Formuler des propositions d'amélioration de la
gestion professionnalisée des Adductions d'Eau Potable en vue de
garantir le service permanent de l'eau dans ledit département.
2e PARTIE : METHODOLOGIE ET ANALYSE DES DONNEES
Chapitre 3 : CADRE D'ETUDE ET
METHODOLOGIE DE TRAVAIL
III.1. Cadre de l'étude
III.1.1. Présentation de la
zone d'étude
Le département du Couffo est situé au Sud-Ouest
du Bénin. Il a une superficie totale de 2 404 km², une population
de 524 586 habitants en 2002 et une densité de 218 hab/km². Le
Couffo est peuplé d'Adja, fon, mina, kotafon, ayizo, sahouè,
etc.
On y découvre quelques sites touristiques tels que la
demeure des hommes à queue à Dogbo, le Palais royal de
Kinkinhoué, le palais d'Adjahonmè, les vestiges du passage des
allemands sur la colline de Lanta, etc.
Le département du Couffo comprend 6 communes :
Aplahoué,
Djakotomey,
Dogbo,
Klouékanmè,
Lalo,
Toviklin. Il se situe entre
6°57'43?
latitude Nord et 1°48'06? longitude Est. Il est limité au Nord
par le département du Zou, au Sud par le département du Mono,
à l'Est par le département du Zou et à l'ouest par le
Togo.
III.1.2. Situation
Géographique du département du Couffo
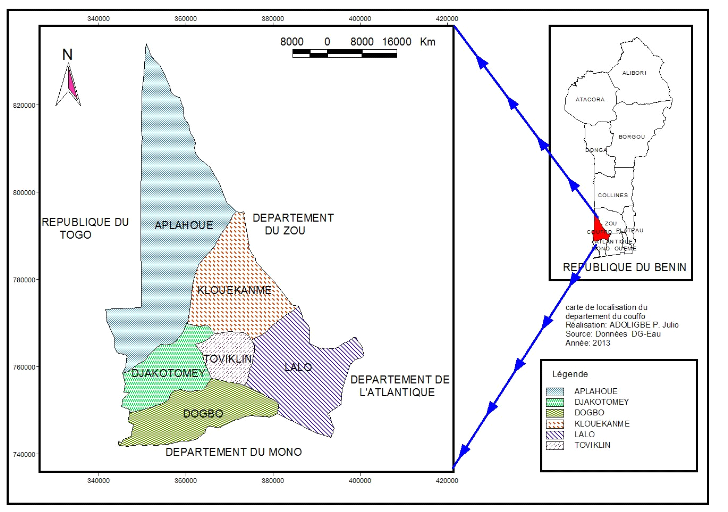
Photo N° 3 : Carte de situation
géographique du département du Couffo
III.2. Evolution démographique du département du
Couffo
La population du Couffo selon l'estimation de l'INSAE en 2008
est de 702 588 habitants en 2011. Cette population est à dominance
féminine (373 220 femmes) soit 53,12% de la population totale
contre 46,88% pour les hommes, 329 368 hommes), (Projections
départementales 2002-2030, INSAE 2011, page 85).
Elle est en majorité jeune, à l'instar de
l'ensemble de la population béninoise (trois personnes sur quatre sont
âgées de moins de trente ans) et sa densité humaine est de
506 habitants au km2.
Le graphique ci-après traduit l'évolution de la
population de 2003 à 2029.
Graphique n°1 : Evolution
démographique dans le département du Couffo
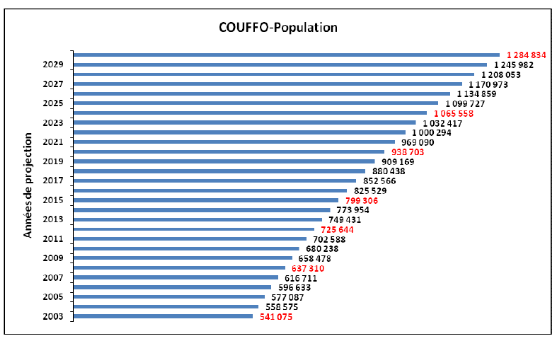
Figure 2 : Evolution démographique
dans le département du Couffo
Source : INSAE, Décembre 2008
Le graphique ci-dessus illustre l'évolution de la
population du Couffo de 2003 à 2030 selon les estimations de 2008 et en
tenant compte du taux d'accroissement démographique du
département.
De l'analyse des résultats des projections dans le
Couffo, il ressort qu'on assisterait de 2003 à 2030 à une
croissance soutenue de la population. En effet l'effectif de la population
devrait passer de 541.075 habitants en 2003 à 749.431 habitants en 2013,
puis à 1.284.834 habitants en 2030.
Selon la norme de la stratégie nationale
d'approvisionnement en eau potable (1 point d'eau pour 250 habitants), il faut
alors 2 659 points d'eau pour tout le département du Couffo
(Données BDI / DGEau/DDMEE, mai 2012). Ainsi, il est clair que des
stratégies doivent être mises en place pour permettre d'atteindre
les OMD dans le secteur dans ce département.
III.3-
Structure socio économique
La population du
département du Couffo est en majorité agricole. Ce secteur
constitue la principale source de revenu pour la quasi totalité de la
population rurale du département. Mais dans les centres urbains, les
populations s'adonnent aux petits commerces comme la vente de divers dans des
boutiques, l'achat et la revente des produits agricoles surtout chez les
femmes. Toutefois, il faut retenir que les activités agricoles dominent
le milieu rural mais en revanche le milieu urbain est
caractérisé par le petit commerce et les services, toute
activité qui nécessite l'utilisation intense de l'eau. Du coup,
il est nécessaire pour chaque population surtout dans les gros villages
(Populations atteignant 2000 habitants et plus), de chercher à
améliorer le niveau de service de l'eau dans les ménages.
III.4. Approche
méthodologique
Pour faire un état des lieux sur la
problématique de la gestion des AEV dans le département du
Couffo, une démarche méthodologique s'impose. Notre recherche
étant spécifique aux adductions d'eau villageoise du
département du Couffo, nous avons dénombré 59 AEV. Pour
que les résultats de la recherche soit significatif, nous avons
sillonné toutes les AEV pour recenser les problèmes
spécifiques à chacune d'elle afin de pouvoir faire une analyse
objective de la situation et de proposer une approche de solutions
adéquate.
Dans le cadre de ce travail, la méthodologie
adopttée comporte essentiellement trois phases à savoir :
- la recherche documentaire
- la collecte des données sur le terrain
- le traitement des données.
III.4.1. La recherche documentaire
C'est la recherche bibliographique : elle s'est
intéressée en majorité à l'état des
adductions d'eau villageoises et les travaux spécifiques disponibles sur
le thème. Nous avons disposé d'une documentation assez riche et
variée sur le thème, mais peu d'informations sur notre
problématique. Certes, le souci d'acquérir des connaissances
fiables et dignes d'intérêt scientifique nous a permis d'orienter
nos recherches vers le Service de documentation de la DG-Eau, le service de la
Banque de Données Intégrées (BDI), les
bibliothèques et les services spécialisés suivants :
UAC, FLASH, Service de l'Eau du Couffo, les mairies du Couffo, INSAE, la
Direction Régionale de la SONEB à Lokossa, DDS Mono Couffo,
etc....
Tous ces éléments sont résumés
dans le tableau ci-dessous:
Tableau I : Tableau synoptique
|
Centre
|
Nature du document
|
Type d'information
|
|
Centre de documentation de la DG Eau
|
Mémoires, thèses, articles, rapports
d'études
|
Approche méthodologique et informations sur l'état
des AEV
|
|
Bibliothèque de la préfecture de Lokossa
|
Livres, rapports et articles
|
Données et informations sur le cadre d'étude
|
|
Centre de documentation de l'INSAE
|
Rapports RGPH1979, 1992, 2002.
|
Données démographiques et statistiques sur la zone
d'étude
|
|
Centre de documentation de la FLASH/UAC/ IIM
|
Mémoires, thèses, articles
|
Revue de littérature et
Information sur le cadre d'étude
|
|
SBDI/DGEau
|
Taux de desserte, état des lieux sur les AEV dans le
Couffo,
|
Informations pour les analyses pertinentes de l'étude
|
III.4.2. Recherche sur le terrain
Après la collecte de la documentation de base, nous
avons effectué des recherches sur le terrain.
Ces travaux ont duré un mois environ et se sont
déroulés en deux périodes : l'une pendant la saison
sèche et l'autre pendant la pleine saison pluvieuse;
caractérisées par deux phénomènes climatiques.
La saison sèche et la saison pluvieuse ont
été choisies afin d'étudier l'état de
fonctionnement des AEV dans le Couffo et le comportement des populations face
aux problèmes de l'eau. Ces recherches ont été
menées par l'intermédiaire :
des fiches d'enquête élaborées pour
appréhender l'état de fonctionnement des AEV, la durée
des pannes et les procédures envisagées pour régler le
problème,
d'interviews et de discussions avec les responsables politico
administratifs locaux et centraux, les techniciens et les utilisateurs des
points d'eau pour évaluer l'impact du non fonctionnement des AEV sur la
vie des populations.
Nos enquêtes ont porté sur les six communes du
département du Couffo à savoir : Aplahoué,
Djakotomey, Dogbo, Klouékanmey,Lalo, Toviklin.
Pour avoir des informations fiables, toutes les AEV des
communes ont été visitées. Dans ce cadre, nous avons
bénéficié du concours des chefs de village, des agents de
la mairie, quelques personnes ressources recommandées par le maire et
les agents du Service de l'Eau du Couffo.
Enfin nous avons procédé au
dépouillement des résultats des enquêtes et exploité
toutes les données recueillies.
III.4.3. Le traitement des données
Après le travail sur le terrain, il importe d'analyser
les informations recueillies, les comparer à la réalité.
Les données recueillies sur le terrain nous ont permis de comprendre
les stratégies mises en place pour la gestion des AEV et les
problèmes qui en découlent. Etant en service à la
Direction Générale de l'Eau, nous avons eu l'occasion de nous
familiariser avec les termes techniques, les différentes
procédures et stratégies mises en oeuvre par cette institution
pour apporter des approches de solutions.
A cet effet, vu l'importance et l'envergure des
présents travaux, nous avons utilisé les techniques
suivantes :
- l'évaluation quantitative et qualitative des
ressources en eau,
- la méthode SWOT (Forces, Faiblesse,
Opportunités et Menaces)
- l'autofinancement des AEV
- Le cash flow et la rentabilité des AEV
CHAPITRE 4- ANALYSE ET
INTERPRETATION DES DONNEES
Ce
chapitre présente les résultats obtenus à la suite du
traitement des données recueillies sur le terrain.
IV. Analyse des données
IV .1. Evaluation des AEV dans le
département du Couffo
IV.1.1. Etat actuel des Adductions
d'Eau Villageoise dans le Couffo
Comme tout ouvrage hydraulique, les AEV sont exploitées
par les populations auxquelles elles sont destinées et par
conséquent s'usent ; méritant par conséquent une
attention particulière afin de garantir leur durabilité et leur
pérennité. Ainsi, dans le département du Couffo, il est
nécessaire que le point des différentes AEV soit fait afin de se
mettre à l'évidence de leur état et des dispositions
à prendre dans ce sens pour garantir le service permanent de l'eau dans
ce département.
Le tableau suivant résume la situation de l'état
actuel des AEV dans le département.
Tableau II : Etat actuel des AEV dans le
département du Couffo
|
N°
|
Commune
|
Arrondissement
|
Village_SE
|
Energie
|
Mode_Gestion
|
Financement
|
Observations
|
|
1
|
APLAHOUE
|
APLAHOUE
|
AFLANTAN
|
Thermique
|
Com-Fermier
|
IE
|
14 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
2
|
APLAHOUE
|
APLAHOUE
|
DJIKPAME
|
Thermique
|
Com-Fermier
|
JAPON
|
16 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
3
|
APLAHOUE
|
ATOME
|
AGNAME
|
Thermique
|
Com-Fermier
|
AFD
|
12 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
4
|
APLAHOUE
|
DEKPO
|
DEKANDJI
|
Thermique
|
Com-GIE-Fermier
|
KFW
|
64 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
5
|
APLAHOUE
|
DEKPO
|
LAGBAVE
|
Thermique
|
Com-GIE-Fermier
|
GTZ
|
21 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
6
|
APLAHOUE
|
GODOHOU
|
SINLITA
|
Thermique
|
Com-Fermier
|
PAYS BAS
|
14 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
7
|
APLAHOUE
|
GODOHOU
|
WAKPE
|
Thermique
|
Com-Fermier
|
JAPON 6
|
20 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
8
|
APLAHOUE
|
GODOHOU
|
ZAME
|
Thermique
|
Com-Fermier
|
GTZ/KFW
|
28 Robinets fonctionnels et 14 en panne
|
|
9
|
APLAHOUE
|
KISSAMEY
|
KELETOME
|
Thermique
|
Com-GIE-Fermier
|
KFW
|
54 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
10
|
APLAHOUE
|
KISSAMEY
|
TANNOU
|
Thermique
|
Com-GIE-Fermier
|
7e FED
|
11 Robinets fonctionnels et 1 en panne
|
|
11
|
DJAKOTOMEY
|
ADJINTIMEY
|
DOUMAHOU
|
Thermique
|
Com-fermier
|
AFD
|
4 Robinets fonctionnels et 1 en panne
|
|
12
|
DJAKOTOMEY
|
ADJINTIMEY
|
HEKPE
|
Thermique
|
Com-fermier
|
7è FED
|
24 Robinets fonctionnels et 6 en panne
|
|
13
|
DJAKOTOMEY
|
BETOUMEY
|
AISSANHOUE
|
Thermique
|
Com-fermier
|
JAPON
|
8 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
14
|
DJAKOTOMEY
|
BETOUMEY
|
BETOUMEY
|
Thermique
|
Com-fermier
|
GTZ/KFW
|
3 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
15
|
DJAKOTOMEY
|
GOHOMEY
|
LOKO-ATOUI
|
Thermique
|
Déléguée
|
JAPON 6
|
14 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
16
|
DJAKOTOMEY
|
HOUEGAMEY
|
HOUEGAMEY
|
Thermique
|
Déléguée
|
PAYS BAS
|
42 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
17
|
DJAKOTOMEY
|
KPOBA
|
FANTCHOUTCHEHOUE
|
Thermique
|
Déléguée
|
Initiative Eau
|
18 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
18
|
DJAKOTOMEY
|
KPOBA
|
KPOBA
|
Thermique
|
|
JAPON
|
14 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
19
|
DJAKOTOMEY
|
SOKOUHOUE
|
ZOUZOUVOU
|
Thermique
|
Déléguée
|
PEP 1C
|
36 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
20
|
DJAKOTOMEY
|
BETOUME
|
HOLOULOKO-ZOHOUDJI
|
Thermique
|
Non déléguée
|
Plan Bénin
|
20 robinets fonctionnels
|
|
21
|
DOGBO
|
AYOMI
|
KPODAHA
|
Thermique
|
Com-fermier
|
Japon
|
25 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
22
|
DOGBO
|
AYOMI
|
AGOSSOUHOUE
|
Thermique
|
Com-fermier
|
Japon
|
06 robinets
|
|
23
|
DOGBO
|
DEVE
|
DEVE-HOME
|
Thermique
|
Com-fermier
|
AFD
|
11 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
24
|
DOGBO
|
HONTON
|
ATCHANHOUE
|
SBEE
|
Com-fermier
|
6e FED
|
14 Robinets fonctionnels et 1 en panne
|
|
25
|
DOGBO
|
KPOHA
|
KPOHA
|
SBEE
|
Com-fermier
|
GTZ/KFW
|
14 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
26
|
DOGBO
|
LOKOGOHOUE
|
TCHIGOSSOUHOUE
|
Thermique
|
Com-fermier
|
GTZ/KFW
|
11 Robinets fonctionnels
|
|
27
|
DOGBO
|
LOKOGOHOUE
|
LOKOGO HOUE
|
thermique
|
Com-fermier
|
GTZ/KFW
|
44 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
28
|
DOGBO
|
MADJRE
|
MADJRE
|
Thermique
|
Com-fermier
|
GTZ/KFW
|
34 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
29
|
DOGBO
|
TOTA
|
DAHOUE
|
SBEE
|
Com-fermier
|
GTZ/KFW
|
20 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
30
|
DOGBO
|
TOTA
|
GOUHOUN
|
Thermique
|
Com-fermier
|
GTZ/KFW
|
8 Robinets fonctionnels et 2 en panne
|
|
31
|
DOGBO
|
TOTA
|
HONGLOUI-KPOGODOU
|
Thermique
|
Com-fermier
|
7e FED
|
17 Robinets fonctionnels et 1 en panne
|
|
32
|
DOGBO
|
TOTA
|
KPODAVE-GNAMAME
|
SBEE
|
Com-fermier
|
GTZ/KFW
|
33 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
33
|
DOGBO
|
TOTCHANGNI
|
TOTCHANGNI
|
Thermique
|
Com-fermier
|
GTZ/KFW
|
30 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
34
|
DOGBO
|
TOTA
|
AGBEGNIDONHOUE
|
Thermique
|
Com-fermier
|
GTZ/KFW
|
24 Robinets fonctionnels et O en panne
|
|
35
|
KLOUEKANME
|
ADJAHONME
|
ADJAHONME CENTRE
|
Thermique
|
Com-GIE-Fermier
|
AFD
|
27 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
36
|
KLOUEKANME
|
ADJAHONME
|
GODOHOU
|
Thermique
|
Com-GIE-Fermier
|
GTZ/Kfw
|
32 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
37
|
KLOUEKANME
|
DJOTTO
|
GLOLIHOUE
|
Thermique
|
Com-GIE-Fermier
|
GTZ/Kfw
|
11 Robinets fonctionnels et 1 en panne
|
|
38
|
KLOUEKANME
|
HONDJI
|
KOGBETOHOUE
|
Thermique
|
Com-GIE-Fermier
|
JAPON IV
|
31 Robinets non fonctionnels
|
|
39
|
KLOUEKANME
|
DJOTTO
|
DAVIHOUE-ABLOMEY
|
Thermique
|
Com-GIE-Fermier
|
SONEB
|
|
|
40
|
KLOUEKANME
|
KLOUEKANME
|
TCHANVEDJI III
|
Thermique
|
Com-GIE-Fermier
|
GTZ/KFW
|
18 Robinets fonctionnels et 2 en panne
|
|
41
|
KLOUEKANME
|
LANTA
|
TOKANME-ALIHO
|
Thermique
|
Com-GIE-Fermier
|
7e FED
|
14 Robinets fonctionnels et 6 en panne
|
|
42
|
KLOUEKANME
|
TCHIKPE
|
AKOUEGBADJA
|
Thermique
|
Com-GIE-Fermier
|
GTZ/Kfw
|
24 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
43
|
KLOUEKANME
|
TCHIKPE
|
AKOUEGBADJA
|
Thermique
|
Com-GIE-Fermier
|
GTZ/Kfw Phase 6
|
25 Robinets fonctionnels et 28 en panne
|
|
44
|
KLOUEKANME
|
TCHIKPE
|
SOKPAME
|
Thermique
|
Com-GIE-Fermier
|
GTZ/Kfw
|
AEV en panne
|
|
45
|
KLOUEKANME
|
TCHIKPE
|
ZOUNZONKANME
|
Thermique
|
Com-GIE-Fermier
|
PEP 1C
|
12 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
46
|
LALO
|
ADOUKANDJI
|
ADOUKANDJI
|
Thermique
|
En cours
|
Plan Bénin
|
AEV en panne
|
|
47
|
LALO
|
BANIGBE
|
BANIGBE
|
Thermique
|
|
GTZ/KFW
|
6 Robinets fonctionnels et 6 en panne
|
|
48
|
LALO
|
GNIZOUNME
|
DJIBAHOUN
|
Thermique
|
En cours
|
GTZ/KFW
|
10 Robinets fonctionnels et 10 en panne (groupe en panne)
|
|
49
|
LALO
|
GNIZOUNME
|
GNIZOUNME
|
Thermique
|
En cours
|
Plan Bénin
|
18 Robinets fonctionnels et 18 en panne
|
|
50
|
LALO
|
HLASSAME
|
SOHOUNOUHOUE
|
Thermique
|
En cours
|
7e FED
|
14 Robinets fonctionnels et 18 en panne
|
|
51
|
LALO
|
HLASSAME
|
SOWANOUHOUE
|
Thermique
|
En cours
|
Plan Bénin
|
AEV en panne
|
|
52
|
LALO
|
LALO
|
KOUTIME (TCHIKPE)
|
Thermique
|
En cours
|
Plan Bénin
|
16 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
53
|
LALO
|
LALO
|
LALO CENTRE
|
SBEE
|
|
JAPON
|
5 Robinets fonctionnels et 1 en panne
|
|
54
|
TOVIKLIN
|
ADJIDO
|
ATCHIOUME (GBEKO)
|
Thermique
|
Déléguée
|
7e FED
|
10 Robinets fonctionnels et 10 en panne
|
|
55
|
TOVIKLIN
|
AVEDJIN
|
NATABOUHOUE
|
SBEE
|
Déléguée
|
Initiative Eau
|
30 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
56
|
TOVIKLIN
|
HOUEDOGLI
|
TADOKOME
|
Thermique
|
Déléguée
|
Initiative Eau
|
10 Robinets fonctionnels et 2 en panne
|
|
57
|
TOVIKLIN
|
MISSINKO
|
MISSINKO
|
SBEE
|
Déléguée
|
PAYS BAS
|
36 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
58
|
TOVIKLIN
|
TANNOU-GOLA
|
TANNOU GOLA
|
Thermique
|
Déléguée
|
INITIATIVE EAU
|
40 Robinets fonctionnels et 0 en panne
|
|
59
|
TOVIKLIN
|
DOKO
|
GBOHIZOUNHOUE
|
Thermique
|
Déléguée
|
PLAN BENIN
|
20 Robinets et 0 en panne
|
Source : Données de
terrain, janvier 2013.
A l'analyse de ce tableau, il est
ressort que les AEV dans le département du Couffo sont en
majorité alimentées par des groupes électrogènes
(92%). Seulement quelques unes sont alimentées par la SBEE (8%). Ceci
explique les différents problèmes enregistrés sur le
réseau (panne du groupe électrogène, consommation en
carburant, difficultés d'entretiens et réparation du groupe) et
les difficultés de paiement. Par ailleurs, le coût de
l'énergie thermique est plus cher que celui de la SBEE. Du coup, les
fréquences des pannes sont assez répétitives sur les
réseaux alimentés par les groupes électrogènes que
sur ceux alimentés par la SBEE. Par conséquent, une AEV peut
rester non fonctionnelle durant trois à six mois voire même plus
du simple fait que le groupe électrogène est tombé en
panne. Du moment où les gestionnaires ne géraient pas bien, les
ouvrages ne sont pas en mesure de répondre à cette exigence
financière. Par conséquent, les populations sont plongées
dans cette situation de vulnérabilité qui les oblige à
retourner vers les anciennes sources d'eau c'est-à-dire aller vers les
sources d'eau de qualité douteuse.
Nécessité de raccorder le plus grand
nombre possible d'AEV existantes au réseau électrique de la
SBEE
Compte tenu des importantes extensions récentes du
réseau de la SBEE, les forages de nombreuses AEV se retrouvent sur ou
très proches du réseau électrique. Leur raccordement
augmentera la rentabilité de l'affermage, et pourrait, dans certains
cas, permettre une baisse du prix de l'eau. Le raccordement au réseau de
la SBEE de ces AEV devrait constituer une priorité pour les prochains
programmes d'investissement, notamment de la KfW.
Tableau III : sources d'alimentation électrique des
réseaux d'adduction d'eau villageoise dans le Couffo
|
Source d'alimentation des AEV
|
Nbre total d'AEV
|
Pourcentage
|
|
AEV alimentée par source thermique
|
56
|
91,80
|
|
AEV alimentée par la SBEE
|
5
|
8,20
|
Source : BDI/DGEau, 2012 et données de
terrain, janvier 2013
NB : L'alimentation des réseaux par
les sources d'énergie solaires est inexistante dans le
département.

Figure 3 : Différente source
d'alimentation en énergie des AEV du Couffo
Source : BDI/DGEau, 2012 et données de
terrain, janvier 2013
IV.1.2. Evolution
générale des AEV dans le département du Couffo de 1990
à 2011
Le souci d'améliorer le service public de l'eau et la
garantie d'un niveau d'accès appréciable des populations à
cette denrée a obligé les acteurs à passer à la
multiplication de ces types d'ouvrages dans le département. En effet, le
sol du Couffo étant un territoire du biseau sec, retrouver la ressource
eau souterraine est un problème majeur. C'est ce qui justifie
l'adoption des AEV comme le principal type d'ouvrage d'eau dans le
département par les acteurs avec la réalisation des forages
à gros débit. Ceci facilite l'alimentation en eau potable de
plusieurs localités à ressource limitée.
Depuis l'avènement des Adductions d'Eau Villageoises au
Bénin, le Couffo a bénéficié de 61 AEV dont la
situation est présentée dans le tableau ci-dessous (BDI-DGEAu,
Mai 2012 et données de terrain, janvier 2013).
Tableau IV : Situation des AEV dans le Couffo
|
Période quinquennale
Départements
|
Avant 1996]
|
[1997-2001]
|
[2002-2006]
|
[2007-2011]
|
TOTAL
|
|
Couffo
|
0
|
20
|
15
|
26
|
61
|

Figure 3 : Evolution des Adductions
d'Eau Villageoises dans le Couffo de 1990 à 2011
De l'analyse de ce graphique, il est apparait que la situation
des AEV du département du Couffo a évolué en dents de
scie. En effet, avant 1996, aucune AEV n'a été
réalisée dans ce département. C'est seulement à
partir de 1997 que ce type d'ouvrage a commencé à être
réalisé. Ainsi, de 1997 à 2001, 20 AEV ont
été réalisées, entre 2002 et 2006 par contre, la
tendance a baissé et est passée de 20 à 15 AEV pour une
même durée. En revanche, le nombre d'ouvrages d'AEV a
évolué pendant la période de 2007 à 2011. Cette
période a connu une nette amélioration atteignant 26 AEV avec le
concours de certaines ONGs comme Plan-Bénin qui a réalisé
en 2012, deux AEV dont une à Djakotomey et l'autre à Toviklin en
considérant l'épineuse question du niveau de service de l'eau.
Cette situation s'explique par le fait que ce type d'ouvrage
n'était pas adopté au départ avant 1996. Mais vu les
besoins en eau dus à la croissance démographique, le type
d'ouvrage hydraulique adapté à cette situation est l'Adduction
d'Eau Villageoise. Elle alimente plusieurs localités et villages avec un
niveau de service plus amélioré ; diminuant les peines des
populations qui désormais prennent l'eau à la Borne Fontaine
à des coûts relativement accessibles. La troisième
période qui couvre 2002 à 2006 a connu un peu de baisse parce
qu'il fallait analyser l'impact de ses AEV sur la vie des populations ainsi que
leur gestion. Parallèlement, des stratégies sétaient mises
en oeuvre pour évaluer ces impacts en l'occurrence la mise en place du
programme Initiative Eau. Le rebondissement de la réalisation des AEV
entre 2007 et 2011 s'explique par le fait que le processus d'affermage des AEV
a été enclenché pour permettre de mieux gérer les
ouvrages. En somme, au fur et à mesure que les ouvrages sont mis en
affermage, la Direction Générale de l'Eau a le courage de
continuer à réaliser des AEV. Enfin, les Partenaires Techniques
et Financiers eux aussi ont beaucoup accompagné la réalisation de
ce type d'ouvrage comme la GIZ/Kfw, le PPEA et le consortium de partenaires
regroupé sous le Pot Commun Initiative Eau.
IV. 1.3- Analyse des
problèmes liés au suivi de la gestion des AEV
La situation spécifique de suivi de la gestion des AEV
a été analysée à travers les points suivants
:
ü Réalité et régularité de la
fourniture du compte rendu périodique par le fermier ;
ü Circuit de transmission de ce compte rendu (quand il
existe) entre les différents acteurs (à l'intérieur de la
commune et par rapport au S-Eau) ;
ü Conformité de ce document avec celui
prévu dans le guide ImS AEV ;
ü Evaluation du niveau d'analyse de ces documents par la
commune ou le S-Eau.
IV.1.3.1- Les documents de suivi prévus dans le guide
ImS AEV
Trois fiches doivent être transmises chaque mois par le
fermier à la commune : il s'agit en réalité du compte
rendu technique et financier, de la fiche récapitulative
production/distribution et la fiche récapitulative gestion.
Il n'est par contre pas précisé dans le guide
qu'une copie de ces fiches soit transmise au S-Eau. Cette insuffisance
crée des failles qui impactent négativement la gestion des AEV.
IV.1.3.2. Constats sur la
transmission et l'analyse des documents de suivi
La transmission des fiches de suivi mensuel à la commune
est très variable :
- elle est le plus souvent régulière lorsque
l'affermage est effectif sans problèmes majeurs ;
- elle est quasi inexistante lorsque le processus est
bloqué et que les anciennes AUE continuent de gérer. Même
des AUE qui envoyaient régulièrement leurs compte rendus ont
tendance à ne plus l'envoyer lorsque le processus de leur remplacement
par des fermiers est enclenché.
Par rapport à l'analyse des documents, il apparait
qu'elle est quasi inexistante au niveau des communes et qu'elle concerne
essentiellement, quand elle existe, la vérification du paiement des
redevances à la commune. Il y a donc à ce niveau un énorme
travail à faire.
Par contre, il est très rare que les fiches de suivi
soient transmises au S-Eau sauf lorsque ce sont d'anciennes AUE
« transformées » en Groupement
d'Intérêt Economique qui gèrent. Les S-Eau ne disposent
donc que de peu d'informations, voire d'aucune information dans beaucoup de
cas, pour assurer leur rôle d'appui-conseil auprès des communes et
leur fonction de régulation du secteur.
On peut conclure que la régularité du suivi est
directement liée à la qualité et à
l'effectivité de la mise en affermage des AEV.
Le tableau suivant résume la situation de la
transmission et de l'analyse des documents de suivi dans le département
du Couffo.
Tableau V : Point sur la transmission et
l'analyse des documents de suivi
|
Commune
|
Nombre AEV
|
CR de suivi transmis
|
|
Existantes
|
Neuves (encore
sous garantie)
|
En affermage effectif
|
En affermage affectif mais avec
problèmes majeurs
|
Contrat d'affermage signé
mais pas encore effectif
|
Processus d'affermage en
cours
|
Processus non encore lancé
|
Régulier
|
Irrégulier
|
Pas de CR
|
|
Total
|
61
|
3
|
44
|
17
|
6
|
16
|
2
|
27
|
11
|
19
|
|
|
5%
|
72%
|
28%
|
10%
|
26%
|
3%
|
44%
|
18%
|
31%
|
Le tableau ci-dessus montre les différents indicateurs
de suivi de la gestion des AEV dans le Couffo. En effet, sur les 61 AEV, et
selon les outils de suivi de la gestion des AEV, 31% ne rendent pas compte
à la commune, 18% envoient les comptes rendus mais de façon
irrégulière et 44% rend compte régulièrement. Du
coup, la moyenne des AEV du Couffo fonctionne de façon
irrégulière.
Plusieurs raisons expliquent cet état de
chose :
- Non maîtrise du plan de recollement de l'AEV pour
facilement procéder à des réparations et entretiens de
l'ouvrage ;
- Le faible niveau scolaire des exploitants des AEV si elle
mise en affermage ;
- Le mauvais fonctionnement des Associations des Consommateurs
d'Eau Potable (ACEP) ou encore la mauvaise volonté des membres à
rendre compte.
Par ailleurs, parmi les 72% des AEV mises en affermage dans
les six communes, 28% présentent des problèmes majeurs notamment
la panne du groupe électrogène, la cassure des tuyaux PVC et les
robinets défaillants. Ainsi, le réseau, bien qu'existant ne
fonctionne pas, et en conséquence, les populations continuent de vivre
sans accès à l'eau potable.
IV.1.3.3. Etat d'avancement du
processus d'affermage
Le processus de professionnalisation de la gestion des AEV est
lancé dans toutes les communes ; par contre l'état
d'avancement du processus est très différent d'une commune
à l'autre. Le tableau ci-après synthétise la situation
actuelle du processus d'affermage dans les 6 communes du Couffo.
Tableau VI: Situation
actuelle du processus d'affermage dans les 6 communes du Couffo
|
Commune
|
Nombre AEV
|
CR de suivi transmis
|
|
Existantes
|
Neuves (encore
sous garantie)
|
En affermage effectif
|
En affermage affectif mais avec
problèmes majeurs
|
Contrat d'affermage signé
mais pas encore effectif
|
Processus d'affermage en
cours
|
Processus non encore lancé
|
Régulier
|
Irrégulier
|
Pas de CR
|
|
Aplahoué
|
10
|
0
|
10
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
7
|
|
Djakotomey
|
12
|
1
|
8
|
4
|
0
|
8
|
2
|
3
|
1
|
4
|
|
Dogbo
|
13
|
1
|
13
|
3
|
2
|
0
|
0
|
12
|
1
|
2
|
|
Klouekanmè
|
11
|
0
|
9
|
2
|
2
|
0
|
0
|
9
|
2
|
2
|
|
Lalo
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
0
|
|
|
|
|
Toviklin
|
7
|
1
|
4
|
1
|
2
|
0
|
0
|
3
|
4
|
4
|
|
Total
|
61
|
3
|
44
|
17
|
6
|
16
|
2
|
27
|
11
|
19
|
|
|
5%
|
72%
|
28%
|
10%
|
26%
|
3%
|
44%
|
18%
|
31%
|
Dans la commune de Dogbo, la mise
en affermage des treize (13) AEV de la commune a rencontré d'importantes
difficultés et seules deux (2) AEV (Kpodaha et Honton) sont actuellement
en affermage effectif (mais ne fournissent pas de compte rendus à la
commune), le DAC s'étant révélé infructueux pour
les 11 autres AEV. Il existe une forte réticence des anciennes AUE pour
la mise en affermage ; elles veulent avoir un fermier « du
village » ce qui a amené la commune à lancer le DAC AEV
par AEV et non par lots de plusieurs AEV. Cette approche n'ayant pas aussi
réussi, un nouveau DAC a été lancé laissant la
possibilité aux soumissionnaires de pouvoir gérer plusieurs AEV,
il a été donc procédé à l'allotissement dans
les DAC. Ce qui a aboutit au choix de six fermiers à savoir CHEVIDA,
TCHIMADO et Fils, HDL et Fils, LA RELANCE, LE GROUPE SOLGAS et le GROUPE ZAIKO.
Aujourd'hui, toutes les AEV de DOGBO sont mises en affermage. Mais certaines
AEV sont en pannes et il revient à la mairie de les réparer avant
de les remettre au fermier. La mairie n'ayant pas assez de ressources
financières pour procéder à ces réparations, elle
attend le vote du budget de 2013 pour résoudre le problème.
Dans la commune d'Aplahoué, toutes les dix (10) AEV
sont en affermage mais dans la réalité sept (7) d'entre elles
présentent des problèmes graves, les exploitants ne versent pas
les redevances et ne rendent pas compte à la mairie. De plus, il existe
de nombreux problèmes techniques avec des groupes anciens (à
Atomè et Aflantan, le groupe est en panne). On constate aussi, comme
dans la commune de Dogbo, une forte réticence des anciennes AUE :
par exemple à Dekpo, c'est encore l'AUE qui gère malgré la
signature d'un contrat avec un fermier.
La situation est légèrement meilleure dans la
commune de Djakotomey où toutes les 8 AEV sont en affermage mais
où des problèmes majeurs subsistent sur 4 AEV. Il y a le non
paiement des redevances et une AEV est en panne (Aïsanhoué). A ce
niveau, une lettre de mise en demeure de la commune a été
envoyée au fermier et au comité mis en place par la commune
sur l'AEV de Hékpé.
Les neuf (9) AEV de la commune de Klouékanmé
contractuellement sont en affermage, mais certaines d'entres elles enregistrent
de sérieux problèmes comme sur l'AEV de DJOTTO où le
rendement de la pompe n'étant pas optimal, la mairie a prévu
changer ladite pompe qui n'a jamais été fait faute de ressources
financières. La même situation se remarque sur l'AEV d' Adjahonmey
où l'AEV était en panne malgré l'adjudication faite au
fermier, l'ouvrage n'a jamais été géré par ce
dernier. C'est maintenant que la mairie l'a rappelé pour prendre en
charge l'ouvrage car les réparations ont été faites.
Dans la commune de Lalo, aucune AEV n'est encore en affermage
effectif, le DAC ayant été relancé. Il faut noter
qu'actuellement 4 des 9 AEV de la commune sont en pannes.
Dans la commune de Toviklin, les sept (7) AEV sont en
affermage effectif mais les comptes rendus sont irréguliers ; et
diverses situations caractérisent chaque réseau. Six (06) AEV
sont effectivement gérées par les fermiers sous contrat commune
fermier. Mais la dernière AEV réalisée par Plan
Bénin est mis en service seulement en fin janvier dernier et
géré provisoirement par un comité local en attendant le
recrutement d'un fermier.
IV.1.3.4. Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces
(FFOM) de la mise en
affermage des AEV dans le département du Couffo
Des discussions de groupes d'acteurs (Responsables Eau,
Fermiers, chefs d'arrondissement, chefs de villages et notables) ont
été organisées par AEV. Par la technique de brainstorming,
les Forces (facteurs positifs internes), les Faiblesses (facteurs
négatifs internes), les Opportunités (facteurs positifs externes)
et les Menaces (facteurs négatifs externes) ont été
recueillis et synthétisés dans le tableau ci-après.
Tableau VII : Tableau des Forces,
Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM)
|
Forces
|
Faiblesses
|
Opportunités
|
Menaces
|
|
1. Existence d'une division technique pour la mise en oeuvre des
projets d'eau et le suivi technique et financier des AEV.
|
1. Pérennité du service d'approvisionnement en eau
potable peu assurée compte tenu des indicateurs actuels de gestion de
nombres d'AEV et des insuffisances de fonctionnement des ACEP.
|
1- Existence dans le département d'ONG et de projets de
développement intervenant dans le secteur eau potable
|
Risque de blocage des financements extérieurs pour faute
de réformes nécessaires à la gestion pérenne des
AEV
|
|
2. Acteurs communaux favorables à la maîtrise
d'ouvrage communale des ouvrages d'eau potable et aux réformes
nécessaires à une gestion pérenne des AEV.
|
2. Appropriation des réseaux d'AEV par de petits groupes
de personnes qui en font une gestion presque personnalisée
-imprécision des documents de gestion des AEV
-méconnaissance du réseau de l'AEV empêchant
le gestionnaire d'effectuer facilement des réparations
|
2-Existence d'appui conseil promis par le Service de l'Eau et des
Assistants Techniques
|
|
Source: résultats de nos
enquêtes, janvier 2013
IV.2. Présentation des
résultats et décisions
Cette partie du mémoire décrit les
différents problèmes relevés lors de nos enquêtes et
des analyses issues des observations et des entretiens avec les
différents acteurs du secteur.
Les problèmes majeurs rencontrés, qui mettent en
péril le contrat d'affermage, concernent essentiellement l'absence
totale de versement des redevances et de compte rendus à la commune, la
défaillance pure et simple du fermier.
IV.2.1. Le processus de
recrutement des fermiers
IV.2.1.1. L'appel à concurrence
Dans de nombreuses communes, les procédures d'appel
à concurrence pour le choix du fermier ont dû être
relancées, parfois à deux reprises, pour les raisons
suivantes :
· absence d'offres ou une seule offre
· aucune offre acceptable
Ces situations peuvent être expliquées par des
conditions d'éligibilité parfois très contraignantes quand
on sait que le « métier » de fermier est nouveau et
que finalement personne ne peut se réclamer d'une réelle
expérience dans ce domaine d'une part et des conditions de
publicité insuffisante : souvent la publicité reste locale,
les communes (mais aussi les usagers) souhaitant un fermier
« local » et la mise en affermage AEV par AEV (avec
parfois des AEV petites et donc peu ou pas rentables pour le fermier) au lieu
d'un allotissement regroupant plusieurs AEV, rendant le contrat d'affermage
plus intéressant d'autre part.
Il faut remarquer que, par rapport à des appels
à concurrence « classiques » (fournitures ou
travaux), les critères d'attribution d'une délégation de
gestion ne sont pas aussi simples et que les membres de la cellule communale de
passation de marchés publics ne maîtrisent pas toujours les
éléments conduisant au choix du fermier.
IV.2.1.2. Mise en place de l'affermage d'AEV thermiques
anciennes non réhabilitées
Une des conditions pour la mise en affermage des AEV
thermiques anciennes est la réhabilitation préalable du
système de pompage. Dans la réalité, la plupart des AEV
thermiques anciennes ont été mises en affermage sans
réhabilitation préalable. De ce fait, des interventions lourdes
sur le groupe électrogène s'avèrent nécessaires
rapidement, ce qui pénalise fortement le fermier qui se retourne vers la
commune pour assurer le coût de ces réparations.
Dans cette situation, la notion de « grosses
réparations », qui ne figure pas dans le contrat d'affermage
(toutes les réparations sont à la charge du fermier sauf le
renouvellement du groupe et de la pompe qui sont à la charge de la
commune) est introduite et le fermier demande à la commune de prendre en
charge ce type de réparations.
Ces AEV en pannes qui ont été mises en affermage
n'ont jamais fonctionné car le contrat signé ne le stipule nulle
part et de surcroît le fermier n'en a pas les moyens.
IV.2.1.3. Non rentabilité structurelle de certaines
AEV
Certaines AEV n'ont pas la taille critique suffisante pour
être « rentables » c'est-à-dire
générer des recettes suffisantes pour assurer un équilibre
financier durable de l'exploitation (surtout les charges de renouvellement du
système de pompage) et permettre un revenu minimum au fermier. Dans
d'autres cas, la population est suffisante mais la présence de nombreux
points d'eau alternatifs pérennes où l'eau est gratuite (puits)
ou moins chère (PEA privés, FPM) fait que la consommation
constatée sur l'AEV est nettement inférieure à celle
prévue dans le dimensionnement et dans l'analyse financière du
fermier.
Une autre solution serait d'uniformiser le prix de l'eau
à l'AEV et aux FPM.
Les communes du Couffo n'en sont pas encore arrivées
à ce stade.
IV.2.1.4. Fixation du prix de vente de l'eau et des redevances
sans réel calcul
Un logiciel de calcul de rentabilité, permettant de
déterminer un prix de vente de l'eau et des montants de redevance sur
des bases objectives a été élaboré par le programme
AFD ; l'ensemble des S-Eau ainsi que les Chefs des Services Techniques et
les Chefs Services Planification et Développement Local de toutes les
communes disposent de ce logiciel et ont été formés
à son utilisation.
Malgré cela, l'utilisation de ce logiciel n'est pas
généralisée. En outre, dans certaines communes, la
fixation du prix de vente de l'eau n'a pas été faite sur des
bases objectives. Par exemple, certaines communes (comme Lalo Aplahoué
et Djakotomey) ont décidé un prix de vente et des montants de
redevance uniformes pour l'ensemble des AEV de la commune ; en soi, c'est
une bonne décision si l'ensemble des AEV d'une commune est
confiée à un seul.
IV.2.1.5. Consommations inférieures aux consommations
prévues
Le dimensionnement des AEV se fait sur la base de la
population à desservir et sur un niveau de consommation unitaire
prédéfini, aboutissant à fixer une production
journalière. Tous les calculs de fixation du prix de l'eau et du montant
des redevances sont basés sur ce niveau de production prévu.
Or, il est fréquent que les consommations
constatées sur les AEV soient significativement inférieures
à celles prévues dans le dimensionnement et dans le processus de
calcul du prix de vente de l'eau et des montants des redevances. Ce constat est
grave car tous ces calculs économiques deviennent alors caducs.
Deux explications, qui peuvent se combiner, peuvent être
avancées :
- mauvaise évaluation de la population à
desservir lors du dimensionnement de l'AEV : en particulier, prise en
compte de la population globale des différents villages administratifs
concernés au lieu de la population des seules localités à
desservir ;
- prise en compte d'une consommation unitaire
journalière trop élevée qui amène à des
surdimensionnements : le diagnostic du secteur des AEV
réalisé en 2007 a montré que la consommation moyenne est
de 8 litres par jour et par habitant. Or, à titre d'exemple, la
consommation constatée au cours de la mission de terrain pour l'AEV de
Doko (Toviklin) est de 1,8 litres/jour/habitant du fait de la concurrence de
nombreux autres points d'eau. La concurrence des points d'eau alternatifs est
déterminante : la présence de FPM, de PEA privés et
de puits traditionnels ou modernes a une influence majeure sur la consommation
de l'eau de l'AEV.
IV.2.1.5. Résistance voire blocage des anciens
gestionnaires des AEV
Au démarrage du processus de mise en affermage, toutes
les AEV étaient gérées par une Association d'Usagers de
l'Eau (AUE).
Lors du processus de mise en affermage, les communes se sont
souvent heurtées à la résistance, voire à un
blocage du processus de la part de l'AUE. Il faut signaler que ces
résistances viennent essentiellement des quelques personnes qui
géraient effectivement l'AEV et pas forcément de l'ensemble de la
communauté. Les actions d'informations menées progressivement par
la commune auprès des communautés ont permis de débloquer
la plupart des situations, avec parfois certains aménagements de la part
de la commune, tels que des contrats d'affermage tripartites ou la
délégation de gestion à une structure privée
créée par les anciens gestionnaires.
IV.2.1.6. Mauvaise base de calcul des redevances et/ou non
versement des redevances
Le contrat d'affermage prévoit clairement que les
redevances soient calculées sur la base des m3 produits et
non les m3 distribués ; cette disposition est importante
car elle responsabilise le fermier sur le bon entretien du réseau
(intervention rapide en cas de casse des canalisations ou des fuites du
réservoir).
Certains fermiers, arguant de pertes importantes sur le
réseau, font pression sur la commune pour que le calcul des redevances
soit basé sur le nombre de m3 vendus et non sur les
m3 produits comme cela est prévu au contrat.
Le fait de baser les redevances sur les m3 vendus
réduit le montant des redevances et n'incite pas le fermier à
faire des réparations rapides. Le problème de
« pertes » relativement important n'est pas rare mais n'est
pas forcément lié à des pertes physiques (fuites, casses
de conduites) : il peut être dû à un problème de
comptage : les compteurs des bornes fontaines sont moins fiables que les
compteurs à la tête de forage et il peut y avoir des
différences importantes.
Certains fermiers ne versent pas du tout de redevances tandis
que d'autres versent encore la redevance de renouvellement sur les anciens
comptes de renouvellement des AUE dans les Caisse Locale de Crédit
Agricole et Mutuel, contrairement aux dispositions du contrat.
IV.2.1.7. Compétences des fermiers et des
maintenanciers
Du point de vue technique, les exploitants, employés
des fermiers chargés de l'exploitation et de l'entretien courant, et qui
sont souvent les anciens exploitants du temps de la gestion communautaire,
maîtrisent assez bien leur travail. Le problème se situe plus au
niveau des maintenanciers, sollicités pour les interventions plus
importantes : leurs compétences sont souvent faibles, comme parfois
leur honnêteté (réparations non durables à des
coûts prohibitifs). Ce problème est sérieux et peut avoir
des conséquences graves sur la durabilité de l'AEV.
IV.2.1.8. Quelques problèmes techniques
Des problèmes techniques ont été
identifiés, qui ont une incidence directe sur la rentabilité de
l'affermage :
Mauvaise adéquation groupe
électrogène/pompe immergée (le plus souvent groupe
surdimensionné entraînant des surcoûts d'exploitation
énormes), cas de la Commune de Klouékanmey;
Utilisation de PVC pour des traversées de marigot
(risques accrus de casse).
Il faut noter enfin que pratiquement aucun fermier ne
possède les plans du réseau, ce qui ne facilite pas les
interventions sur le réseau. Ceci est la conséquence de la non
implication des maires à la réalisation des AEV (ces cas se
rencontrent surtout sur les anciennes AEV).
IV.2.1.9. La couverture des charges d'exploitation
Les charges d'exploitation des AEV sont les
suivantes :
· Charges du personnel ;
Dépenses de fonctionnement du système de
pompage : carburant, lubrifiants et filtres pour groupe, factures de la
SBEE si raccordement au réseau de la SBEE ;
· Dépenses de petit entretien du
réseau.
Les charges de renouvellement, correspondant à la
redevance de renouvellement versée par le fermier à la commune,
et les redevances communales ne font pas partie des charges d'exploitation.
A priori, toutes les AEV qu'elles soient en affermage ou
encore gérées par des AUE couvrent leurs charges d'exploitation
qui sont proportionnelles au nombre de m3 produits :
Les frais du personnel dépendent de la production
(rémunération de l'exploitant et des fontainiers au m3
produit) ;
Les frais de fonctionnement courant du système de
pompage sont aussi proportionnels à la production.
Donc, si le prix de l'eau a été calculé
sur des bases objectives (ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas),
les recettes doivent couvrir les charges d'exploitation. Cependant, certaines
petites AEV desservant une population limitée n'ont pas une production
suffisante pour permettre au personnel du fermier de percevoir une
rémunération minimale. Au cours du diagnostic du secteur des AEV
réalisé en 20074(*), 14% des AEV existantes se trouvaient dans ce cas.
Mais il faut ajouter à ce chiffre les AEV de taille suffisante mais
où les productions constatées sont très inférieures
à celles qui avaient été prévues, ce qui rend aussi
les revenus des exploitants, des fontainiers et des fermiers très
faibles.
En l'absence actuelle de données de suivi de la gestion
des AEV suffisamment complètes (c'est l'objet de la présente
étude d'améliorer cette situation), on ne peut pas quantifier
précisément la proportion d'AEV trop petites et ne couvrant pas
leurs charges d'exploitation ou dont le niveau de production est faible.
Cependant, l'analyse rapide des AEV des 6 communes visitées au cours de
la présente étude montre que la proportion d'AEV se situant dans
les deux cas décrits ci-dessus, pourrait être d'un ordre de
grandeur de 30%.
La mise en place du logiciel de suivi de la gestion des AEV
tel que décrit ci-après devrait permettre de disposer de
données suffisantes pour définir la proportion d'AEV ayant un
niveau de production insuffisant, ce qui constitue un risque pour la
durabilité de l'affermage.
Iv.3.
Rôles et responsabilités des acteurs dans le suivi de la gestion
des AEV
Le contrat d'affermage est signé entre la commune et le
fermier : ils doivent être les premiers acteurs
responsabilisés dans le suivi de la gestion des AEV.
La commune : en tant que maître
d'ouvrage et autorité délégante, la commune a la
responsabilité de contrôler / vérifier que le fermier
assure le service public de l'eau potable conformément aux dispositions
de son contrat.
Le fermier : son rôle est
d'assurer le service public de l'eau potable par délégation de la
commune et il est responsable, par rapport au suivi, de fournir mensuellement
les 3 fiches de suivi à la commune.
Au sein de la commune, la répartition des rôles et
responsabilités est la suivante :
Les Services Techniques :
o ils reçoivent les fiches de suivi fournies par le
fermier et les analysent avec l'outil de suivi qui génère
automatiquement la situation de la gestion de chaque AEV et une fiche
synthétique communale ;
o ils identifient les problèmes : en cas de
problème mineur, ils en font part au fermier après en avoir
informé l'élu en charge de l'eau. Si les problèmes
identifiés sont suffisamment graves pour nécessiter des
décisions, ils demandent une réunion du Cadre de Concertation sur
l'Eau et l'Assainissement (CCEA) ;
o ils transmettent la fiche synthétique de suivi
communale aux S-Eau.
Le CCEA (Cadre de Concertation Eau et Assainissement)
:
o Il constitue le cadre de discussions face aux
problèmes sérieux de gestion des AEV ;
o Il propose des solutions au maire
Le Maire :
o Il prend les décisions.
Le Service de l'Eau :
o Il assure un appui-conseil auprès des communes mais
aussi ont un rôle de régulation du secteur et à ce titre,
il doit s'assurer que la délégation du service public de l'eau
potable se déroule conformément aux dispositions de la
stratégie nationale en vigueur,
o Il agrège au niveau départemental les
synthèses communales et établit une synthèse
départementale de la situation des AEV qu'il transmet à la
DG-Eau,
o Il peut saisir le préfet en cas
d'irrégularité constatée de la part de la commune par
rapport à la délégation de gestion.
La Direction Générale de l'Eau :
o Elle analyse les synthèses départementales
pour évaluer la situation nationale de la gestion des AEV.
Le Préfet :
o Il s'assure de la légalité des
décisions de la commune.
D'une manière
générale, la mission a permis de véritablement
diagnostiquer l'enjeu de cette nouvelle approche de gestion par
professionnalisation pour les différents acteurs du secteur de l'eau
potable en milieu rural.
Pratiquement dans toutes les communes, ce processus de gestion
professionnalisée a connu une mise en oeuvre à travers la prise
des arrêtés ou des PV de délibération.
La forte participation des acteurs rencontrés à
tous les niveaux aux séances de travail témoigne de
l'intérêt que les uns et les autres ont accordé aux
résultats de cette mission. Le niveau de mise en gestion
professionnalisée des AEV a évolué dans la plupart des
communes visitées.
A l'issu de l'analyse des informations collectées
auprès des acteurs et de la revue documentaires, les grandes lignes des
résultats issus de cette mission se présentent comme suit.
IV.3.1. Le choix des options de gestion
En prélude au choix d'options de gestion des AEV au
niveau des communes, il a été organisé au niveau de
toutes les communes visitées, de vaste campagne d'informations et
d'explications par les Services de l'Eau sur les quatre (4) options disponibles
:
?? Option 1: Délégation par la Commune à
un Fermier
?? Option 2: Contrat Tripartite Commune/AUE/Fermier
?? Option 3: Délégation par la Commune de la
production à un Fermier et de la distribution à une AUE
?? Option 4: Délégation par la Commune à
une AUE (GIE).
Toutes les communes visitées ont reconnue le fait
qu'elles ont été informées de manière exhaustive
par la DG-Eau et d'autres organes sur la nouvelle démarche au niveau du
secteur d'eau dans le cadre du processus de la décentralisation.
IV.4. Recommandations
IV.4.1. Amélioration des
conditions de mise en affermage
Ces actions concernent essentiellement des travaux et des
fournitures permettant d'améliorer les conditions de mise en affermage
des AEV :
- réhabilitation des systèmes de pompage des AEV
thermiques anciennes
- raccordement au réseau électrique de la SBEE
des AEV sur ou proches de ce réseau.
En ce qui concerne les possibilités de financement, il
faut d'abord rechercher les financements auprès des communes, en
particulier celles où il existe des comptes de renouvellement des
anciennes AUE avec des liquidités (dont c'était d'ailleurs
l'objet). Quelques communes ont d'ailleurs engagé des actions dans ce
sens.
IV.4.2. Poursuite de l'expérimentation des
systèmes de chloration continue
L'expérimentation de la mise en place de système
de chloration continue sur les AEV doit être poursuivie. Un accent
particulier devra être mis sur la formation des acteurs de terrain avec
comme objectif de disposer de techniciens compétents (maintenanciers
notamment) dans le cadre de la future généralisation de ces
systèmes sur les AEV.
IV.4.2. Mise en affermage effectif
des AEV non encore affermées et amélioration de
l'exécution des contrats d'affermage actuels
Certaines des actions nécessaires pour atteindre ces
deux objectifs doivent, pour être efficaces, être menées
concomitamment dans une commune. En effet, dans la plupart des communes il
existe à la fois des AEV déjà en affermage et d'autres non
encore affermées. Dans ces conditions, les actions nécessaires
pour l'atteinte de ces deux objectifs seront menées d'une manière
globale.
Ces actions sont décrites comme suit :
q Réunions
d'échanges entre communes
Des réunions départementales d'échanges
entre les communes seront réalisées pour confronter les
expériences des différentes communes à la fois sur le
processus de contractualisation et la mise en oeuvre des contrats. Ces
réunions permettront d'identifier les problèmes
rencontrés, de présenter les solutions apportées à
certains problèmes par certaines communes et de proposer des
améliorations dans le processus d'affermage ainsi que dans les
dispositions des contrats. Ces réunions concernent toutes les communes
et donc aussi bien le problème des AEV non encore affermées que
celles dont le contrat d'affermage est en cours d'exécution.
q Amélioration
des outils
Sur la base de l'expérience acquise depuis plus de 5
ans d'affermage des AEV et en tenant compte des éléments
tirés des réunions départementales entre communes, les
différents outils liés à l'affermage seront
actualisés et améliorés.
q Actualisation du logiciel de calcul de
rentabilité des AEV
La version actualisée du logiciel devra notamment
pouvoir prendre en compte :
o l'existence de plusieurs systèmes de pompage pour une
AEV,
o les coûts liés à un système de
chloration, systèmes qui devraient être
généralisés,
o les coûts de suivi de la qualité de l'eau.
q Amélioration des Dossiers d'Appel
à Concurrence (DAC).
Une amélioration des conditions de publicité des
DAC est nécessaire. En effet, toujours dans le souci de trouver un
fermier « local » pour répondre aux soucis des
communautés d'avoir un fermier « du terroir » , la
publicité est le plus souvent très locale, ce qui restreint la
concurrence.
L'évaluation des offres pour les contrats d'affermage
doit aussi être précisée car elle est très
différente d'une évaluation pour des travaux ou des services avec
la difficulté supplémentaire que le métier est très
nouveau.
Enfin, les plans des réseaux ne sont quasiment jamais
joints au contrat et il faut appuyer les communes pour récupérer
ces plans et les joindre au contrat des fermiers.
q Actualisation et amélioration des
contrats, notamment sur les points suivants :
Durée du contrat
L'opportunité de modifier les durées de contrat
couramment pratiqués (2 à 3 ans) sera analysée ainsi que
la durée de période d'essai (généralement de 1 an
pour l'instant).
Caution
Le problème de la caution doit être
analysé, en particulier la fixation de son montant ainsi que de son
utilisation et de son éventuelle restitution. Il faut aussi que tous les
acteurs concernés comprennent le principe même et le rôle de
cette caution, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement.
Base de calcul des redevances et lieux de
paiement
Cet aspect important devra aussi être analysé car
il a fait l'objet dans de nombreux cas, de discussions entre le fermier et la
commune (sur la base des m3 produits ou des m3
vendus).
Intégration des FPM dans le contrat
La concurrence des autres points d'eau, que ce soient les
points d'eau traditionnels ou les FPM constitue la raison essentielle des
faibles productions et consommations constatées par rapport aux
prévisions ; les modalités d'intégration de la gestion des
FPM dans le contrat d'affermage doivent être analysées ; en ce qui
concerne les points d'eau traditionnels, il faut envisager des campagnes de
sensibilisation locales avec les autorités communales pour la promotion
de l'eau potable (voir plus loin).
Analyses physico-chimiques et bactériologique
à réaliser par le fermier
Ces aspects devront être intégrés dans le
contrat. Les fermiers doivent tous les ans procéder à l'analyse
de l'eau pour s'assurer de la qualité de l'eau consommée par les
populations.
Possibilité d''allotissement de l'affermage des
AEV
L'allotissement est un aspect très important. On
constate que dans les communes qui ont mis en affermage leurs AEV par lot de
plusieurs AEV, l'affermage fonctionne de manière beaucoup plus
satisfaisante et que les conditions de durabilité de l'affermage sont
bien meilleures. Cette option a d'ailleurs permis de mettre en affermage de
petites AEV qui, affermées isolément, n'auraient pas
été « rentables ». La mise en affermage de l'ensemble
des AEV d'une commune, mise en oeuvre actuellement dans une seule commune,
constitue certainement la solution d'avenir. Malheureusement les
résistances « sociales » (le plus souvent la résistance
des anciens gestionnaires) amène les communes à affermer AEV par
AEV pour contourner cette résistance en choisissant un fermier «
local ».
Modalités de prise en charge de l'entretien lourd
des groupes
L'entretien lourd du groupe électrogène (au bout
de 6 000heures) constitue une dépense importante (500.000FCFA pour
un groupe TR1, 700.000FCFA pour un groupe TR2 et 900.000FCFA pour un groupe
TR3) mais programmable (on peut connaître à peu près la
période où le groupe atteindra 6000 heures). Le problème
est que le fermier n'aura pas forcément les liquidités, ce qui
risque de retarder, voire annuler la révision des 6000 heures avec des
incidences graves sur la durée de vie du groupe. On pourrait envisager
que le coût de la révision soit prise en charge par la commune et
qu'il soit intégré à la redevance renouvellement.
La clarification de la notion de « grosses
réparations »
La notion de « grosse réparations » ne figure
pas dans le contrat mais dans la pratique, les fermiers l'assimilent au
renouvellement et demandent aux communes de prendre en charge ces coûts,
ceci crée une certaine confusion et présente des risques pour le
renouvellement du système de pompage lorsqu'une partie des ressources
communales est utilisée pour les « grosses réparations
». De plus, la notion de « grosses réparations » est
très floue (quelles réparations peuvent être
considérées comme « grosses réparations »?). Il
faut alors clarifier dans le contrat, ces notions.
q Campagne d'informations
des communes sur les outils améliorés
Une fois les différents outils actualisés et
améliorés, une campagne d'information des communes sur ces outils
sera réalisée pour présenter ces outils. Elle se fera en
parallèle avec les actions d'appui pour la mise en affermage des AEV non
encore affermées et l'amélioration de l'affermage des AEV
déjà effectif.
q Appui aux communes dans
la préparation, l'attribution et le démarrage effectif des
contrats d'affermage pour les AEV non encore affermées
Sur la base des outils actualisés et
améliorés, un appui régulier sera donné aux
communes pour :
- définir avec la commune, et pour chaque AEV, les
principaux éléments du contrat (prix de l'eau, montant des
redevances) en utilisant le logiciel de calcul de rentabilité des AEV
actualisé ;
- appuyer les communes pour l'évaluation des offres et
le démarrage effectif des contrats ;
- s'assurer du contrôle de légalité des
contrats par le préfet.
q Appui aux communes pour
les contrats en cours
Parallèlement à l'appui apporté aux communes
pour la mise en affermage des AEV non encore affermées, un appui sera
donné pour améliorer l'exécution des contrats en cours.
q Appui aux communes pour évaluer les contrats
d'affermage en cours
Appui pour une campagne communale dans toutes les AEV de la
commune pour la promotion de l'usage de l'eau des AEV par
rapport aux points d'eau traditionnels. Pour augmenter les consommations, une
campagne de promotion de l'utilisation préférentielle de l'eau
des AEV par rapport aux autres points d'eau, en particulier les points d'eau
traditionnels sera conçue et un appui sera donné aux communes
pour la mettre en oeuvre. La sensibilisation des communes sera aussi
menée pour éviter la réalisation de nouveaux puits dans
les périmètres des AEV (par exemple, à Manigri dans la
commune de Bassila, des puits modernes sont en cours de construction par une
ONG).
q Appui aux communes dans les rencontres
périodiques commune/fermiers
- Renforcement des
capacités des acteurs
Les actions de renforcement des capacités des acteurs
seront poursuivies et complétées.
· Formation et agrément des maintenanciers
(au moins 1 par commune)
Ce point est très important et l'absence de
maintenanciers compétents intervenant pour des coûts acceptables a
toujours constitué un handicap sérieux dans la bonne gestion
technique des AEV. Une identification des maintenanciers potentiels a
été déjà réalisée et un programme de
formation est en cours d'élaboration par le Centre de Formation des
Métiers de l'Eau (CFME) ; il est à souligner qu'il faut
garder ouvert la liste d'agrément des maintenanciers, l'objectif
étant bien sûr d'avoir des maintenanciers compétents mais
aussi d'éviter des situations de monopole et faire en sorte qu'un
minimum de concurrence puisse exister.
Poursuite de la formation des fermiers, exploitants et
plombiers
Les modules de formation préparés par le CFME et
déjà expérimentés pour les premiers fermiers,
exploitants et plombiers seront actualisés pour former les nouveaux
fermiers, exploitants et plombiers.
· Formation spécifique sur les compteurs
et la recherche simple de fuites (fermiers, exploitants et maintenanciers) sur
les réseaux.
Le problème des compteurs est suffisamment important
pour justifier une formation spécifique sur leurs entretiens, leurs
calibrages. Une action doit aussi être envisagée pour former les
exploitants et les maintenanciers aux méthodes simples de
détection de fuites sur les réseaux.
· Formation des Receveurs Percepteurs et Services
Administratifs et Financiers des communes pour la traçabilité et
l'utilisation des redevances
Cette formation, destinée aux receveurs percepteurs
communaux et aux responsables administratifs et financiers des communes,
s'avère indispensable pour une bonne gestion des redevances, condition
impérative pour assurer le renouvellement des systèmes de pompage
dans de bonnes conditions. Cette formation pourrait être
réalisée par l'expert local finances publiques qui vient de
terminer l'étude sur la traçabilité et la gestion des
redevances.
q Suivi
La dynamisation du suivi de la gestion des AEV sera
réalisée essentiellement à travers la mise en place du
logiciel de suivi dans les communes. Cette mise en place se fera en plusieurs
étapes. Il s'agit de :
- la vérification du matériel existant dans les
communes (en particulier de la disponibilité du logiciel ACCESS et
identification de la version) ;
- la désignation par la commune d'un ou deux
responsables ;
- organiser des ateliers régionaux de
présentation du logiciel, regroupant communes, S-Eau et
fermiers ;
- l'installation du logiciel de suivi et l'organisation d'une
formation dans les six (06) communes et regroupera le personnel des communes.
Les S-Eau (C/CISE notamment) seront aussi formés à cette
occasion.
q
Régulation
Le logiciel de suivi de la gestion des AEV mis en place au
niveau des communes pour permettre à celles-ci de suivre le contrat
d'affermage constitue aussi un outil de base pour les S-Eau, à travers
la synthèse communale de suivi de la gestion automatiquement
généré par le logiciel, pour assurer son rôle de
régulation du secteur au niveau local.
Outre la formation sur le logiciel de suivi qui sera
dispensée au personnel des S-Eau en même temps qu'au personnel
communal, un atelier national sera réalisé pour préciser
le rôle de régulation dévolu à la DG-Eau au niveau
national et aux S-Eau au niveau régional.
IV.5. Présentation des
critères de vérification de l'hypothèse
Cette partie du mémoire va ressortir les
critères qui infirment ou confirment les hypothèses qui ont
motivées ce travail.
IV.5.1. Confirmation et infirmation des hypothèses
Les conclusions qui suivent sont issues des résultats
majeurs obtenus. Ils sont ceux qui ont un rapport direct avec les
hypothèses et qui aident à répondre aux
préoccupations essentielles de ce travail : les Adductions d'Eau
Villageoises dans le département du Couffo enregistrent assez de pannes.
En effet, selon les résultats de nos enquêtes sur le terrain
consignés dans le tableau V de ce mémoire, 28% des AEV dans le
département du Couffo sont en affermages mais enregistrent de
problèmes majeurs. Ceci confirme cette première hypothèse
énoncée dans ce mémoire. Elle répond donc à
la préoccupation de la question n°11 du questionnaire pour les agents du Service de l'Eau et
des fermiers.
La deuxième hypothèse se confirme en analysant
les résultats du tableau V qui montre clairement que 31% des AEV mises
en affermage ne sont pas du tout suivi car les trois fiches mises à la
disposition des fermiers n'obligent pas le fermier à rendre compte
régulièrement à la mairie. C'est pourquoi il est
nécessaire que la mairie trouve un moyen de suivre la gestion des AEV
sans passer nécessairement par un fermier.
Quant à la troisième hypothèse, sa
confirmation est mitigée car malgré que les ouvrages soient mis
en affermage, il existe d'autres paramètres majeurs à prendre en
considération avant sa confirmation. C'est ce qui justifie les
difficultés rencontrées lors la gestion des AEV. Ces
paramètres concernent la clarification du contenu des contrats qui lient
les fermiers aux communes, la notion des grosses réparations, le garde
four à mettre en place dans ce processus pour que les fermiers soient
obligés de rendre régulièrement compte au maire de la
gestion des AEV.
CONCLUSION
Cette étude sur la problématique de la gestion
des Adductions d'Eau Villageoises a été entreprise en vue de
mieux orienter ce processus en cours dans le département et
d'éclairer les décisions des autorités de ces
différentes communes sur le choix raisonné de l'option de gestion
du service de l'eau potable.
Ce travail a été autant qu'il se peut,
objectivement mené sans prétention d'avoir fait un diagnostic
exhaustif du secteur eau potable du département. Mais le présent
mémoire a révélé, certaines des failles du
système de gestion en vigueur que nous résumons en quelques
points essentiels à savoir:
- la gestion communautaire à l'état actuel ne
rassure pas sur la pérennité du service de fourniture de l'eau
potable aux populations du Couffo : comptes-rendus de gestion
insuffisants, démocratie interne biaisée, fréquence
de conflits internes entre responsables gestionnaires ou du fait de
prétendants à la gestion.
- l'utilisation des fonds issus de la vente de l'eau par les
Associations des Consommateurs d'Eau Potable à d'autres fins. De ce
fait, les AEV ne sont pas rentables et sont pour la plupart en panne à
cause de la mauvaise volonté des ACEP à les rendre autonome en
oeuvrant pour leur autonomisation (rémédiation
systématique aux pannes qui surviennent à travers les
économies faites issues de la vente et versées entre temps dans
un compte ouvert à cet effet au lieu de la poche de quelques individus).
Du coup, il est en ce moment très difficile de passer au nouveau
processus en cours (professionnalisation de la gestion) car certains ouvrages
sont en pannes. La mairie n'ayant pas les moyens financiers de les
réhabiliter, il s'ensuit que l'ouvrage sera abandonné attendant
un jour, un PTF pour la résolution du problème ; mais
jusqu'à quand ?
- le type d'énergie utilisé (groupe
électrogène, ou abonnement à la Société
Béninoise de l'Energie Electrique) ; et la consommation par
tête d'habitant de l'eau potable sont, tout de même, autant
d'autres facteurs qui influencent négativement la rentabilité des
AEV.
Au vu de tout ceci, nous suggérons de repenser la
stratégie en priorisant l'option professionnelle.
Certes, on note un taux de fonctionnalité des points
d'eau acceptable (75,5%). Mais si rien n'est fait dans le sens de
l'amélioration des indicateurs de performance des AEV, le pire est
à craindre dans un proche avenir surtout dans la mesure où le
processus de transfert de la maîtrise d'ouvrage à la commune est
très lent et les réformes engagées par les services
compétents tardent à prendre véritablement forme sur le
terrain. Ainsi, nous suggérons qu'il est impérieux de s'employer
à fermer les fissures que la présente étude a
dévoilées au risque qu'elles ne deviennent demain des gouffres,
après demain des crevasses. C'est pourquoi, nous avons
élaboré de concert avec les acteurs locaux intervenant dans le
service d'eau potable de la commune les quatre orientations stratégiques
qui suivent :
- renforcer les capacités d'intervention de la division
technique de la mairie ;
- renforcer les capacités de compréhension des
acteurs communaux (AUEP, élus, notables...) sur les réformes
en cours;
- Prendre des mesures en vue de l'amélioration des
indicateurs financiers de gestion des AEV ;
- opter pour la professionnalisation à moyen terme de
la gestion des AEV.
L'option de professionnalisation de la gestion des AEV est
incarnée aujourd'hui par la politique sectorielle de l'Etat. Mais le
processus doit être conduit avec doigté et méthode. La
stratégie qui a consisté à transformer les actuels
Comités Directeurs en Groupements d'Intérêts Economiques
(GIE) a suscité des remous et autres malentendus parce l'idée,
non seulement, n'a pas été discuté avec les acteurs
locaux, mais parachutée de l'extérieur sans l'effort minimum de
communication et de partage que requiert un changement de si grande envergure.
Il nous semble plus judicieux de concrétiser d'abord la maîtrise
d'ouvrage communale du secteur par la signature avec les gestionnaires actuels
des cahiers de charges stipulant clairement leurs droits et obligations et la
prise de mesures limitant le développement des surcoûts de gestion
avant d'envisager la gestion professionnalisée. De toutes les
façons, la professionnalisation du service d'approvisionnement en eau
potable doit être entendue comme un processus et non comme une
panacée imposée une fois pour toute dans la
précipitation.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages généraux
1) BOUZID (M.) 1967 :
Données hydrologiques sur le bassin sédimentaire côtier du
Dahomey, FAO, 56 p.
2) de SAINT EXUPERY (A.) 1938: Terre
des hommes, 218 p.
3) DESJEUX (D.) 1975 :
L'eau : quels enjeux pour les sociétés rurales, l'harmattan,
Paris, 220p.
4) DIAGANA (B.) 1983 : Etude des
consommations en eau en milieu rural, CIEH, Ouagadougou, 55p.
5) INSAE 2004 : Cahiers des
villages et quartiers de ville du département du Couffo, 25 p.
6) INSAE, 2008, Projection de la
Population et de l'Habitation 2003-2030, Cotonou, Bénin, 136 p.
7) REED (R.), FRANCEYS (R.) et PICKFORD
(J.) 1995 : Guide de l'assainissement individuel, OMS,
Genève, 258 p.
8) SLANSKY (M.) 1954 : Etude
géographique et hydrologique du Bas-Dahomey, DFMG Gouvernement
Fédéral de l'AOF, 270 p.
9) SNV et Plan Bénin
2003 : Synthèse du Plan de Développement Communal (PDC) de
Toviklin, 80p.
10) VILLAND (M.C.) 1990: Eau et
Santé : Elément d'un manuel pédagogique pour des
programmes d'hydrauliques villageoises dans les pays en
développement : Ministère de la coopération du
développement, 71 p.
Ouvrages spécifiques
11) DG-Eau (2012) :
Stratégie nationale de l'approvisionnement en eau potable en milieu
rural du Bénin 2005-2015 actualisée, 26 p.
12) NACE (R..)
1969 : L'eau et l'homme : Aperçu mondial UNESCO, Paris, 50p.
13) PINEO (C.S.) 1975 : Adduction
d'eau et évacuation des excréta dans les pays en
développement, quelques réflexions, OMS, Genève 43
pages
Mémoires et rapports
14) ADJAMONSI (P.) 1994 :
Qualité de l'eau et problèmes de santé à Cotonou,
Mémoire de maîtrise en géographie, 107p.
15) ADOMOU (A.) 2008 :
Décentralisation et Gouvernance de l'eau potable en milieu rural au
Bénin: cas de la commune de Toffo, Université de Bouaké et
Institut Universitaire du Bénin, mémoire pour l'obtention du
Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en
Gestion des projets 67 p.
16) BDI/DG-Eau 2012 :
Données et caractéristiques des Adductions d'Eau Villageoises
dans le Couffo, non paginé pages
17) DANON (O.) 1991: L'eau dans
la vie des populations dans la sous préfecture de DJIDJA, mémoire
de maîtrise en Géographie, UNB, 132 p.
18) DDSP 2006 : Annuaire des
statistiques sanitaires SEPS, 95 p.
19) DEGUENON (A.) 1982 : Etude
d'un projet d'alimentation en eau potable de Tori-Bossito, Mémoire de
fin de formation en Génie civil, UNB, 84 P.
20) DG-Eau, 2007 : Guide de
l'intermédiation sociale spécifique aux Adductions d'Eau
Villageoises, PADEAR, 108 p.
21) DG-Eau/GIZ 2012: Etude pour la
dynamisation du suivi de la gestion des Adductions d'Eau Villageoises, IGIP
Afrique, 69 p.
22) DOSSA (P.) 1995 :
Aménagement et gestion d'une source à Tokanmey Kpodji dans la
commune de Klouékanmey, mémoire de maîtrise de
géographie, 125 p.
23) FICHTNER Water and Transportation)
2010 : Evaluation du processus de professionnalisation de la gestion des
AEV - Bénin, Proj. No. 610-1139, 131 p.
24) KLELE (J.) 2003 : Rapport de
l'enquête sur l'état des lieux des infrastructures
d'assainissement et hydraulique dans la commune de Toviklin, 121 p.
25) ODOULAMI (L.) 1999 :
Approvisionnement eu eau dans les grandes villes du Bénin. Quelles
politiques pour l'avenir ? Cas de Cotonou, Porto-Novo et Parakou.
Mémoire pour l'obtention du Diplôme d'Etude Approfondie (D.E.A.),
UNB, 55P.
Articles
26) AMOUGOU (J.) 2002 : L'eau,
bien public, bien privé : l'Etat, les communautés locales et
les multinationales, in L'eau, patrimoine commun de l'humanité, CETRI et
L'Harmattan, 16 pages.
27) GUERARD (S.) 2003 : Choisir
un mode d'exploitation : gestion directe ou gestion
déléguée, in Guide pratique de la gestion de l'eau,
éditions Weka, 11 p.
28) JANIQUE (E.) 2003 : Eau et
assainissement : croyances, modes et modèles, Paris, Agence
Française de Développement AFD, 15p.
ANNEXES
Questionnaires pour les
fermiers
A- Identification du fermier
1-
Nom :.............................Prénom :..........................................
2- Sexe .................................Nationalité
....................................
3-
Structure :........................................................................ ....
4- Age....................................Commune
........................
5- Niveau d'instruction
Primaire Supérieur
Analphabète secondaire
Quelle est votre
profession ?.....................................................................
B- Identification de l'AEV
affermée
1- Date de réalisation de
l'AEV :.....................Capacité du château :
......m3
2- Date de mise en
affermage........................Financement : ....................
3- Nombre de BF :
4- Nombre de branchement particulier :
5- Source d'énergie : SBEE Thermique
Solaire
- Si la source d'alimentation est la SBEE, existe-t-il un groupe
relais ?
6- Nombre de forages pour l'AEV : 1 2
3
7- nombre de châteaux pour l'AEV : 1 2 3
8-Type de
contrat :.................................................................
9- Etat de l'AEV à la mise en affermage :
- Fuite de conduite Oui Non
- Groupe en panne : Oui Non
si oui, depuis combien de
temps ?...........................................................................
C- Gestion de
l'AEV
1- Quelles sont les données techniques dont vous disposez
sur l'AEV ?
- Plan de recollement : Oui Non
- Puissance du
groupe :.....................................................................
- Longueur du
réseau :......................................................................
- Nombre de BF
fonctionnelle.............................................................
- Nombre de BF en
panne..................................................................
2- Combien d'agents avez-vous à votre charge ?
- Gestionnaire :
- Vendeur :
- Chargé des réparations :
-
Autres........................................................................
d- système de recouvrement
des fonds
1- Combien coûte la bassine d'eau ?
2- Comment recouvrez-vous les recettes issues de la vente de
l'eau
3- Quelle est la fréquence de la vente de l'eau
a- Pendant la saison des pluies ?
b- Pendant la saison sèche ?
4- Quel est en moyenne la recette issue de la vente de
l'eau par mois ?
5- Est-ce que le réseau est il rentable ?
E- difficultés rencontrées
Quels sont les problèmes que vous rencontrez sur
l'ensemble du réseau ?
Que suggérez-vous pour une meilleure gestion des
AEV ?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Merci pour votre disponibilité
Questionnaires pour les
agents de la mairie
Nom :.........................................................................................
Prénom :.....................................................................................
Fonction :....................................................................................
Commune
de :..............................................................................
1-Combien d'AEV existe-t-il dans votre commune ?
2- Date de réalisation de
l'AEV :.....................Capacité du château :
......m3
3- Date de mise en
affermage........................Financement : ....................
4- Nombre de BF :
5- Nombre de branchement particulier :
6- Source d'énergie : SBEE Thermique
Solaire
- Si la source d'alimentation est la SBEE, existe-t-il un groupe
relais ?
7- Nombre de forages pour l'AEV : 1 2
3
8- nombre de châteaux pour l'AEV : 1 2 3
9-Type de
contrat :.................................................................
10- Etat de l'AEV à la mise en affermage :
- Fuite de conduite Oui Non
- Groupe en panne : Oui Non
- Autres (cassure, vandalisme)
si oui, depuis combien de
temps ?...........................................................................
- Situation de la gestion des AEV dans votre commune
1- Compte rendu de la gestion des AEV (pourcentage)
2- Quelles sont les stratégies en vue pour un meilleur
approvisionnement en eau potable dans l'arrondissement ?
................................................................................................................................................................................................
3- Combien d'agents d'hygiènes existent il dans votre
commune ?
................................................................................................
4- Comment sont elles gérées les ordures
ménagères dans la commune ?
5- Quelles sont vos suggestions ?
Questionnaires pour les
agents du SEau/Couffo
Nom :.........................................................................................
Prénom :.....................................................................................
Fonction :....................................................................................
1-Combien d'AEV existe-t-il dans votre département ?
2- Combien sont mise en affermage ?
3- Source d'énergie : SBEE Thermique
Solaire
- Si la source d'alimentation est la SBEE, existe-t-il un groupe
relais ?
7- Nombre de château :
...1..................2.....................3................
8- Nombre de forages pour l'AEV : 1 2
3
9- nombre de châteaux pour l'AEV : 1 2 3
10-Type de
contrat :.................................................................
11- Etat de l'AEV à la mise en affermage :
- Fuite de conduite Oui Non
- Groupe en panne : Oui Non
- Autres (cassure, vandalisme)
si oui, depuis combien de
temps ?...........................................................................
B- SYNTHESE
|
Commune
|
Nombre AEV
|
CR de suivi transmis
|
|
Existantes
|
Neuves (encore
sous garantie)
|
En affermage effectif
|
En affermage affectif mais avec
problèmes majeurs
|
Contrat d'affermage signé
mais pas encore effectif
|
Processus d'affermage en
cours
|
Processus non ancore lancé
|
Régulier
|
Irrégulier
|
Pas de CR
|
|
Aplahoue
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Djakotomey
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dogbo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klouekanme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lalo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toviklin
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62%
|
33%
|
4%
|
38%
|
0%
|
|
|
|
Merci pour votre appui
TYPE DE CONTRAT
Ce document constitue une base de discussion pour la
commune
Les textes encadrés sont des commentaires sur les
différents articles
Exemple de
CONTRAT D'AFFERMAGE
OPTION CONTRAT COMMUNE /
FERMIER
Conformément à la
délibération du Conseil Communal en date
du ......................
Il est important que la décision de signer le contrat
d'affermage soit prise en conseil communal et non par le maire seul.
Il est passé un contrat
entre :
La commune de .................. représentée par
son maire, Mme /M. .............. désignée ci-
après par "la commune"
Et
M............ (ou la société
............représentée par Mme/M. ..........),
domicilié(e) à ............ , inscrit(e) au registre du commerce
de ............, sous le n°.............., sous le régime
de........... désigné ci- après par "le
fermier",
Il faut que le fermier dispose d'un RC
Il a été exposé et convenu ce qui
suit :
CHAPITRE I - OBJET ET DURÉE DU CONTRAT
Article 1 - Objet du contrat
La commune confie au fermier, qui accepte, l'exploitation, la
gestion et la maintenance de l'AEV de............dont la description exacte
figure dans l'annexe 1 du présent contrat.
Un état des lieux contradictoire sera dressé
avant la mise à la disposition du fermier des équipements
Il est important que l'état exact des ouvrages et
des équipements soit connu de la commune et du fermier avant le
démarrage du contrat pour éviter des risques de litiges dans
l'exécution du contrat. L'expérience de gestion
déléguée au Niger montre que la mise en affermage de
systèmes existants non totalement réhabilités (en
particulier en ce qui concerne le système de pompage) aboutit rapidement
à des conflits entre le fermier et l'autorité contractante sur le
remplacement du système de pompage et à une rupture du contrat
par le fermier.
Article 2 - Pièces constitutives du
contrat
Les annexes suivantes sont considérées comme
faisant partie intégrante du présent contrat :
Annexe 1 : Plan du réseau et description des
ouvrages et des équipements,
Annexe 2 : Etat des lieux contradictoire signé
par le fermier et la commune,
Annexe 3 : Modèle de compte d'exploitation
annuel.
On peut aussi rajouter en annexe la liste des prestataires
extérieurs pour les réparations
Article 3 - Entrée en vigueur et
durée du contrat
3.1 Entrée en vigueur
Le présent contrat entrera en vigueur
après :
· sa signature par les parties,
· la signature de l'état des lieux
contradictoire,
· le versement sur le compte du fonds de renouvellement
et d'extensions (ou sur un « fonds communal de l'eau »
à créer) d'une caution d'exploitation de................ FCFA
(montant en lettres............ de francs CFA),
La caution est saisie par la commune en cas
défaillance du fermier ou de non paiement des redevances par le fermier.
Sinon, elle est restituée au fermier à la fin du contrat. La
commune est libre de fixer le montant de cette caution
· la fourniture à la commune de la liste du
personnel d'exploitation avec leurs noms et adresses.
3.2 Durée
Le présent contrat est conclu pour une durée de
...ans. Il sera renouvelable par période de ....ans, et par tacite
reconduction, à défaut de dénonciation par la commune ou
le fermier au moins six
mois avant l'échéance prévue.
La durée du contrat ne doit être ni trop
longue (la commune ne doit pas être trop dépendante du fermier) ni
trop courte (pour que ce soit intéressant pour le fermier). Une
durée entre trois et cinq ans apparaît raisonnable. Une
période d'essai d'un an peut aussi être prévue.
CHAPITRE II - OBLIGATIONS DES PARTIES
Article 4 - Obligations de la
commune.
La commune contrôle le service de l'eau rendu par le
fermier et est responsable du renouvellement des équipements. La commune
s'engage à ne rien faire qui puisse dégrader les
équipements. Elle s'engage, en cas de destruction partielle ou
d'endommagement de son fait, à prendre en charge
l'intégralité des frais de remise en état du
matériel ainsi que les frais annexes tels que les frais de transport,
d'installation, de démontage et de remontage.
Sauf en cas de défaillance dûment
constatée du fermier, la commune s'interdit d'intervenir par
elle-même ou de faire intervenir un tiers pour le dépannage du
matériel sans l'accord du fermier.
Article 5 - Obligations du fermier
Le fermier devra assurer à ses risques et
périls, sous sa responsabilité, la gestion de l'AEV, à la
satisfaction des usagers. Ses tâches couvrent l'exploitation du
système ainsi que l'entretien et la réparation de l'ensemble des
ouvrages et des équipements, à l'exception du forage
lui-même.
Le fermier a la responsabilité de l'ensemble des
activités permettant d'assurer le service de l'eau : il embauche et
rémunère le personnel nécessaire, se procure et paye les
consommables et les pièces détachées nécessaires et
fait appel, pour les réparations, à des prestataires
extérieurs qu'il rémunère (s'il ne fait pas lui-même
les réparations). Le seul aspect dont il n'est pas responsable est le
renouvellement des équipements et les extensions pour le financement
desquels il paye une redevance à la commune ; il peut cependant,
avec l'accord de la commune, procéder à des extensions sur ses
propres fonds.
Le fermier devra entretenir en bon état de
fonctionnement les ouvrages et les équipements qui lui ont
été donnés en gestion en respectant les normes techniques
et s'abstenir de les dégrader. I1 devra veiller à maintenir en
permanence un lot de pièces de rechange en vue de permettre une
intervention immédiate pour l'entretien et les petites
réparations.
Le fermier sera tenu en cas de destruction partielle ou
d'endommagement de son fait, de prendre en charge l'intégralité
des frais de remise en état du matériel ainsi que tous les frais
annexes qui s'y rattachent.
Les travaux d'entretien courant sont effectués par des
agents du fermier ou désignés par lui.
Les travaux de réparation sont effectués par des
agents du fermier ou désignés par lui.
Les prestataires pour les réparations doivent
être identifiés si le fermier ne les exécute pas
lui-même.
Le fermier doit assurer la protection des installations contre
les déprédations et les vols.
Le groupe électrogène ne doit être
démarré que pour les périodes de pompage.
Cette disposition fait référence à
une possible utilisation du groupe par le fermier pour une
« pré électrification » aux alentours du
groupe ; il ne faut pas que le fermier utilise le groupe uniquement pour
cette raison, en dehors des heures de pompage (le groupe s'use, alors qu'il n'y
a pas de pompage et donc pas de redevance pour le renouvellement) ; par
contre, pendant les heures de pompage, le fermier peut fournir de
l'électricité (c'est même mieux pour le groupe qui
fonctionne à plus forte charge) ,
Les compteurs qui seront utilisés par le fermier
devront être préalablement agréés par la commune ou
par toute autorité désignée par elle.
Ce point est important : l'ensemble des recettes et
les redevances étant assis sur des volumes mesurés par des
compteurs, il faut être strict sur la qualité et l'entretien de
ceux-ci.
Le fermier effectue une fois par semaine, le matin avant le
démarrage de la pompe, une mesure de niveau de l'eau dans le forage
à l'aide d'une sonde électrique. Ces données sont
transmises avec le rapport annuel d'activités.
Le fermier fait réaliser chaque année une
analyse physico-chimique ; les résultats de cette analyse sont
joints à son rapport annuel d'activités. Le fermier s'assure de
la bonne qualité bactériologique de l'eau distribuée.
Le fermier devra aviser sans délai la commune de toute
interruption du service pendant plus de 24 heures consécutives et
exposer par écrit les raisons de cette interruption.
Le fermier devra communiquer à la commune des comptes
rendus mensuels, techniques et financiers sous forme de tableaux, en sorte que
la commune puisse effectuer tous les contrôles nécessaires.
Les comptes rendus techniques devront obligatoirement contenir
:
· les volumes prélevés, produits,
distribués, vendus,
· le personnel affecté au service,
· le rendement du réseau, le débit moyen
de pompage, la consommation moyenne du groupe (carburant, lubrifiants), le
nombre d'heures de fonctionnement du groupe pendant la période et depuis
sa mise en service,
· les entretiens courants réalisés et les
comptes-rendus de visite et d'intervention de réparation,
· les grosses réparations effectuées ou
prévues,
· les travaux de renouvellement effectués et
à effectuer sur financement du compte de renouvellement et
d'extension.
Les comptes rendus financiers devront préciser :
· le détail des dépenses et leur
évolution par rapport au mois précédant,
· le détail des recettes de l'exploitation pour
les branchements particuliers et par borne fontaine et leur évolution
par rapport au mois précédent,
· le détail des sommes versées au titre
des différentes redevances avec les reçus correspondants.
Le fermier devra établir une fiche
récapitulative mensuelle, technique et financière, selon le
modèle qui lui sera remis par la commune. Cette fiche sera
envoyée au Service Technique de la commune avant le cinquième
jour du mois suivant le mois considéré.
Les fiches mensuelles constituent l'élément
de base pour le contrôle du fermier ; la commune doit être
vigilante sur la bonne tenue de ces fiches et leur transmission en temps et en
heure.
Chaque année, le fermier est tenu d'établir et
d'adresser les états de gestion suivants à la commune avant la
fin du premier trimestre du nouvel exercice :
· un rapport annuel d'activités technique et
financier sur les résultats de l'exercice écoulé. Ce
document est accompagné du compte d'exploitation présenté
conformément au modèle joint en annexe 3,
· un programme d'activités prévisionnel
annuel, comportant notamment les volumes des ventes envisagés,
argumenté et accompagné d'un compte d'exploitation
prévisionnel,
· le cas échéant, une proposition de
programme d'investissement (renouvellement, extensions,...) à financer
par le fonds de renouvellement et d'extensions.
Les contrats divers passés par le fermier avec des
prestataires dans le cadre de l'exécution du présent contrat
devront comporter une clause réservant à la commune la
faculté de se substituer au fermier en cas de déchéance ou
en fin de contrat.
Cette disposition permet à la commune de
poursuivre plus facilement le service de l'eau en cas de défaillance du
fermier.
Article 6 - Obligations générales des
parties
Les parties contractantes ne peuvent de leur propre initiative
modifier les caractéristiques techniques des installations ni
opérer d'aménagement sans l'accord préalable de
l'autre.
CHAPITRE III - EXPLOITATION DU SERVICE
Article 7 - Propriété des ouvrages et
des équipements
Les ouvrages et équipements détaillés en
annexe 1 sont propriété de la commune. Les infrastructures et
matériels financés grâce au fonds de renouvellement et
d'extensions ou sur les propres fonds du fermier deviennent
propriété de la commune.
Il faut que le fermier sache que s'il réalise des
extensions sur ses propres fonds, il n'en est cependant pas
propriétaire.
Article 8 - Fonctionnement du
service
Le fermier est tenu d'assurer la distribution continue de
l'eau aux bornes fontaines de .... h à .... h et ce, sept (7) jours sur
sept (7).
Les dispositions concernant les horaires d'ouverture des
BF sont définies site par site en concertation entre la commune et le
fermier.
Le fermier n'aura la faculté d'interrompre 1e service
de l'eau qu'en cas de nécessité absolue. Les interruptions
devront être portées préalablement à la connaissance
de la commune.
Article 9 - Régime des branchements
particuliers
Toute personne physique ou morale pourra demander un
branchement particulier.
L'autorisation sera accordée par le fermier et la
commune, après l'avis technique du Service Technique Communal. Il ne
devra en particulier pas entraîner une dégradation des conditions
de fourniture d'eau aux points de distribution existants.
Le coût du raccordement au réseau et le
branchement seront à la charge du demandeur.
Le coût du compteur sera financé par le
fermier.
Le raccordement au réseau et la pose du compteur
devront être faits sous la responsabilité du fermier.
Un contrat d'abonnement est signé entre le demandeur et
le fermier suivant le modèle fourni par la commune.
La facturation aux branchements particuliers sera
mensuelle.
Le fermier pourra suspendre la fourniture à un
branchement particulier en cas de non paiement des factures et selon les
modalités prévues dans le contrat d'abonnement.
La facturation mensuelle est demandée pour qu'elle
corresponde au rythme des fiches de suivi mensuelles. Le fermier choisit le
mode recouvrement des factures. La commune ne peut s'opposer à la
coupure de l'eau au branchement particulier en cas de non paiement ; par
contre, elle peut arbitrer un litige entre fermier et titulaires de
branchements particuliers (en particulier sur les volumes réellement
distribués au branchement en cas de problèmes éventuels de
compteur par exemple).
CHAPITRE IV - TARIFS ET DISPOSITION
FINANCIERES
Article 11 - Prix de vente de l'eau
Le prix de vente de l'eau est fixé comme suit :
· Vente aux bornes-fontaines :
.... FCFA la bassine de 35 litres
.... FCFA le bidon ou le seau de 20 litres
.... FCFA le fût de 220 litres
Des prix de vente pour d'autres volumes peuvent
être définis suivant le type de récipients utilisés.
Une attention particulière doit être portée au
démarrage de l'exploitation sur la définition la plus
précise des récipients utilisés et le prix de vente
correspondant ; ce point est souvent à l'origine de conflits entre
usagers et fontainiers sur les AEV existantes. Une concertation
préalable entre le fermier et les usagers sur ce point peut être
utile.
· Vente aux branchements particuliers :
.... FCFA le mètre cube
Le prix de vente aux branchements particuliers doit
être au moins égal à celui pratiqué aux bornes-
fontaines : si le tarif aux branchements particuliers est plus bas que
celui pratiqués aux bornes fontaines, il existe une possibilité
de revente à partir de ces branchements au détriment de la vente
aux bornes- fontaines, donc de baisse des revenus des fontainiers et un
désintérêt de ces derniers pour cette
activité.
De toute manière, le niveau de service fourni par
les branchements particuliers (eau à domicile 24h/24) étant
supérieur à celui fourni par les bornes fontaines, il n'est pas
illogique que les tarifs y soient supérieurs.
Tous les usagers doivent payer l'eau ; pour les
branchements particuliers des services publics (écoles, centres de
santé, arrondissements, mairies, lieux de culte.....), des dispositions
particulières peuvent être prises d'un commun accord et
consignées par écrit mais le paiement de l'eau au volume doit
rester la règle. On constate en effet des problèmes
fréquents d'arriérés de paiement sur ce type de
branchement et il doit être clairement indiqué dans l'accord
écrit (la commune doit endosser cet accord) que le fermier peut, en cas
de non paiement, suspendre la fourniture d'eau à ces branchements.
Article 12 - Révision des prix et du montant
des redevances
Les tarifs de vente de l'eau peuvent être
révisés annuellement.
Une demande d'augmentation des tarifs peut être faite
par le fermier ou une baisse des tarifs par la commune ; ces demandes
doivent être basées sur des éléments objectifs
(augmentation ou baisse des charges ou des consommations).
Des simulations de comptes d'exploitation sur la base des
charges et consommations constatées permettront de vérifier la
pertinence de la demande de révision de prix. Pour les nouvelles AEV,
ces simulations sont faites au départ pour évaluer le prix de
vente de l'eau nécessaire pour couvrir les charges et assurer un revenu
minimal au fermier ; la première année d'exploitation permet
de vérifier si les hypothèses de consommation étaient
bonnes ; si les consommations constatées sont très
différentes de celles prises en compte dans le calcul initial, les prix
peuvent être révisés.
Le montant des redevances pourra aussi être
révisé annuellement en fonction des ventes réelles et des
renouvellements de matériel effectivement réalisés
après accord du Service Technique de la commune.
La révision du tarif doit être approuvée
par une décision du Conseil Communal.
Article 13- Répartition des produits de la
vente d'eau
Le fermier perçoit l'intégralité des
revenus de la vente de l'eau, quel que soit le volume vendu.
Le fermier assure à ses propres frais l'exploitation et
l'entretien du système de pompage et du réseau. En particulier,
il paie les fournitures et rémunère tout le personnel
nécessaire.
Le fermier est tenu de réparer le groupe
électrogène et la pompe à ses frais, tant que ceux-ci
n'auront pas atteint leur limite normale d'amortissement qui est fixée
à 12 000 heures de fonctionnement. Au-delà de cette
durée normale de service, il peut demander à la commune le
remplacement du groupe électrogène et de la pompe, qui sera
financé à partir du fonds de renouvellement et d'extensions.
Si le forage est correctement
réalisé, c'est-à-dire totalement exempt de venues de
sable, la durée de vie moyenne d'une pompe est supérieure
à 12 000 heures. Ce chiffre est cependant retenu pour tenir compte
du fait que les forages ne sont jamais parfaits. Par contre, si les venues de
sable sont significatives, la durée de vie de la pompe peut être
très largement inférieure à 12 000 heures ; dans
ce cas, et après un constat objectif de l'importance de la
présence de sable (une expertise extérieure peut être
demandée par la commune et/ou le fermier), le fermier est en droit de
demander le renouvellement de la pompe sur le fonds de renouvellement et
d'extensions en cas de problème avant l'échéance des
12 000 heures.
Enfin, le fermier ne peut demander ce renouvellement sur
le fonds de renouvellement et d'extensions si la pompe est hors d'usage suite
à un dénoyage lié à la non fonctionnalité ou
au débranchement du système de protection.
De plus, le fermier est tenu de verser les redevances
suivantes :
Redevance pour le fonds de renouvellement,
d'extensions et d'audit
Cette redevance est destinée à couvrir les
provisions pour :
· le renouvellement du groupe électrogène et
de la pompe,
· le renforcement des installations ou les extensions du
réseau destinés à améliorer le service et/ou
à en étendre l'accès à de nouveaux usagers
(construction de nouvelles bornes fontaines, extension de réseau, mise
en place de moyens d'exhaure plus puissants),
· la réalisation d'éventuels audits
financiers.
Le montant de la redevance pour le fonds de renouvellement et
d'extensions est fixé à ..... F CFA par m3 sur la
totalité des m3 produits.
Les sommes correspondantes sont déposées par le
fermier mensuellement au plus tard le 5 du mois suivant, sur le compte
n°................. ouvert à cet effet par la
commune auprès de la banque ......... à ................
Ce compte (compte Trésor Public ?) est
géré par la commune.
Une copie du récépissé de
dépôt sera remise sous 10 jours à la commune.
Redevance au budget
communal
Cette redevance est destinée à alimenter le budget
communal.
Le montant de la redevance au budget communal est fixé
à ..... F CFA par m3 sur la totalité des m3
produits.
Les sommes correspondantes sont déposées par le
fermier mensuellement au plus tard le 5 du mois suivant la fin du trimestre
correspondant, sur le compte n°................... ouvert
à cet effet par la commune dans les comptes du Trésor Public.
Une copie du récépissé de
dépôt sera remise sous 10 jours à la commune.
Revenu du fermier
Après versement des redevances prévues
ci-dessus, le solde du produit de la vente de l'eau est acquis au fermier.
Article 14 - Impôts et taxes
Le fermier devra acquitter dans les délais
légaux tous les impôts et taxes exigibles en rapport avec le
présent contrat et pendant toute sa durée.
Le problème d'application ou non de la TVA reste
à régler. Cependant, compte tenu des consommations unitaires
faibles pour chaque usager (de l'ordre de 5 à 15 litres par jour), on
peut considérer que l'ensemble des usagers a une consommation mensuelle
se situant en deçà de la limite de la tranche sociale de la
SONEB, laquelle est exonérée de TVA.
CHAPITRE V - CONTRÔLE ET
INFORMATION
Article 15 - Contrôle effectué par la
commune
Le contrôle des activités du fermier aussi bien
d'un point de vue technique que financier pourra à tout moment
être effectué par la commune.
Le fermier devra fournir, à la première demande
de la commune, toute justification concernant la bonne exécution de la
mission de service public qui lui a été confiée.
Article 16 - Information de la commune
Le fermier doit tenir informée la commune des
éventuelles difficultés rencontrées dans
l'exécution de son contrat.
CHAPITRE VI - MESURES DE SUBSTITUTION - PENALITES -
RESILIATION
Article 17 - Mesures de
substitution
En cas de défaillance du fermier et après une
simple mise en demeure non suivie d'effet, la commune pourra prendre toutes
mesures nécessaires pour faire fonctionner le service, aux frais du
fermier.
Elle pourra exploiter elle-même le réseau ou le
faire exploiter par un tiers.
Article 18 -
Pénalités
En cas d'interruption non justifiée du service
supérieure à 24 heures constatée, la commune aura la
faculté de prononcer des pénalités d'un montant
correspondant à 50 % des recettes globales de vente de l'eau
estimées pour la période d'interruption.
Ce montant peut être discuté mais il doit
être en proportion des recettes du fermier.
Article 19 - Résiliation
19.1 Résiliation par la commune
En cas de non-exécution par le fermier d'une seule des
clauses et conditions du présent contrat, la commune pourra, huit jours
après une mise en demeure restée sans effet, résilier le
présent contrat sans indemnité.
Sans que cette énumération soit limitative, le
contrat sera notamment de plein droit résilié par la commune dans
les cas suivants :
· Suspension pendant plus de 10 jours de la distribution
d'eau du fait de circonstances imputables au fermier,
· Défaut ou insuffisance d'entretien des ouvrages
dûment constaté,
· Faillite, redressement judiciaire ou liquidation du
fermier,
· Non paiement des redevances.
En cas de résiliation suite à une
défaillance du fermier, la caution reste acquise à la commune
sans préjudice de tous autres dus, droits et dommages et
intérêts dont la commune pourrait poursuivre le paiement.
19. 2 Résiliation par le fermier
En cas de non-exécution par la commune d'une seule des
clauses et conditions du présent contrat qui la concerne, le fermier
pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet,
résilier le présent contrat sans indemnités.
19. 3 Résiliation par chacune des
parties
En tout état de cause, chacune des parties aura la
faculté de résilier le présent contrat après avoir
notifié à l'autre un préavis de six mois. La partie qui
prend l'initiative de la rupture devra expliquer par écrit les motifs de
la résiliation du contrat.
CHAPITRE VII - FIN DU CONTRAT ET DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 20 - Retour des biens a la
commune
A la date d'expiration du contrat, le fermier est tenu de
retourner l'ensemble des biens mis à sa disposition par la commune, sans
frais, en état normal d'entretien et de fonctionnement.
Si aucune faute ne peut être mise à la charge du
fermier et si l'état des lieux en fin de contrat ne fait ressortir
aucune détérioration des équipements du fait du fermier
hormis le vieillissement et l'usure normale des installations, la commune
s'engage à lui restituer le montant de la caution.
Article 21 - Force majeure
En cas de force majeure, le fermier devra aviser la commune
par écrit dans les meilleurs délais. Si la commune ne conteste
pas le cas de force majeure évoqué par le fermier dans un
délai de quinze jours à compter de la réception de la
lettre de notification, le fermier sera libéré de ses obligations
jusqu'à ce que cette force majeure ait cessé.
En aucun cas, une défaillance des équipements
consécutive à un manque d'entretien du fermier ne sera
considérée comme un cas de force majeure
Article 22 - Election de domicile -
notifications
22.1 Pour les besoins des présentes
et de leurs suites, les parties font élection de domicile :
La commune de ....... : (adresse)
Le fermier : (adresse)
22.2 Toutes notifications ou injonctions au
titre du présent contrat seront valablement faites par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par lettre par
porteur avec remise contre récépissé aux adresses
ci-dessus.
Article 23 - Droit applicable et attribution de
juridiction
Le présent contrat et ses annexes sont soumis au droit
béninois qui sera seul applicable. A défaut de conciliation entre
1es parties, tous litiges auxquels le présent contrat pourra donner
lieu, notamment au sujet de sa validité, de son interprétation,
de son exécution ou de sa résiliation seront soumis aux tribunaux
compétents.
Fait à : ....................... le
.....................................
En deux exemplaires
Pour la commune Le Fermier
Le Maire
Fiches de suivi de la gestion des AEV
|
CAHIER DE SUIVI DE LA PRODUCTION AVEC BRANCHEMENT
SBEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
année
|
|
mois
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Date
|
Index compteur SBEE
|
Nombre DE kwh
|
Index compteur forage
|
m3 produits
|
Nombre de kwh facturés
|
Montant facturé
|
|
Début
|
Fin
|
Début
|
Fin
|
|
1
|
a
|
|
|
c
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.............
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.............
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
|
b
|
|
|
|
|
|
f
|
|
Total
|
|
|
b-a
|
|
|
d-c
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Logiciel de calcul de la
rentabilité des AEV
(Réalisation ANTEA 2009 pour la
DG-Eau)



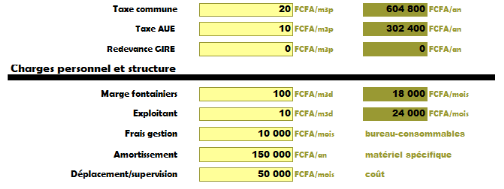
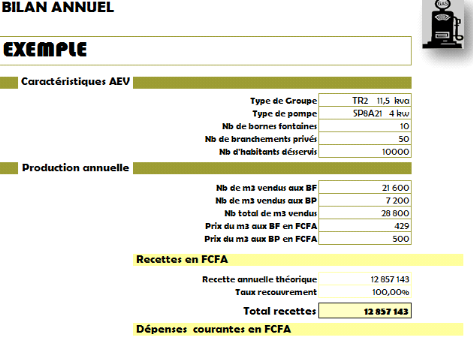
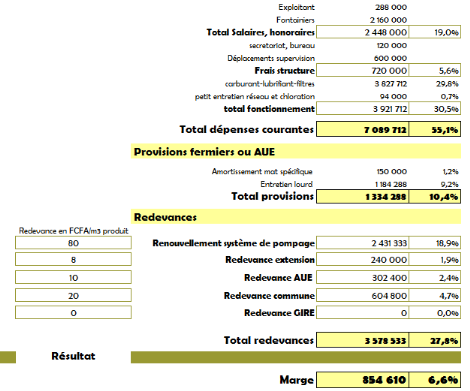
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT
2
AVANT PROPOS
3
DEDICACE
4
REMERCIEMENTS
5
SIGLES ET ACRONYMES
6
SOMMAIRE
8
LISTE DES FIGURES
10
LISTE DES PHOTOS
10
RESUME
11
ABSTRACT
12
INTRODUCTION
13
1ERE PARTIE : LES DONNEES GENERALES
15
CHAPITRE1 : PROBLEMATIQUE
15
I.1. Etude du contexte de l'étude
15
I.2. Etat des lieux de la situation problématique
18
I.3. Enoncé du problème
20
I.4. Description des dimensions du problème
20
I.5. Formulation des questions des recherche
21
CHAPITRE 2 : REVUE DE LITTERATURE ET CADRE DE
REFERENCE THEORIQUE DE L'ETUDE
22
II.1. Revue de litterature
22
II.2. Cadre de reference theorique de l'etude
23
II.2.1. La biogeographie du milieu
23
II.2.2. Le milieu naturel
23
II.2.2.1. Le relief
23
II.2.3. L'hydrographie et l'hydrologie
24
II.2.3.1- climat et hydrologie
24
II.2.3.2- précipitation et végétation
24
II. 3. Definition operationnelle des concepts
25
II.4. Hypotheses et objectifs de recherche
27
II.4.1. Hypotheses de recherche
27
II.4.2. Les variables
27
II.4.3. Les indicateurs
28
II.5. Les objectifs
29
II.5.1. Objectif général
29
II.5.2. Objectifs spécifiques
29
2E PARTIE : METHODOLOGIE ET ANALYSE DES
DONNEES
30
CHAPITRE 3 : CADRE D'ETUDE ET METHODOLOGIE DE
TRAVAIL
30
III.1. Cadre de l'étude
30
III.1.1.Présentation de la zone d'étude
30
III.2. Evolution démographique du département du
Couffo
32
III.3- Structure socio économique
33
III.4. Approche méthodologique
33
III.4.1. La recherche documentaire
34
III.4.2. Recherche sur le terrain
35
III.4.3. Le traitement des données
35
CHAPITRE 4- ANALYSE ET INTERPRETATION DES DONNEES
37
IV. Analyse des données
37
IV .1. Evaluation des AEV dans le département du Couffo
37
IV.1.1. Etat actuel des Adductions d'Eau Villageoise dans le
Couffo
37
IV.1.2. Evolution générale des AEV dans le
département du Couffo de 1990 à 2011
42
IV. 1.3- Analyse des problèmes liés au suivi
de la gestion des AEV
44
IV.1.3.1- Les documents de suivi prévus dans le guide
ImS AEV
45
IV.1.3.2. Constats sur la transmission et l'analyse des
documents de suivi
45
IV.1.3.3. Etat d'avancement du processus d'affermage
47
IV.1.3.4. Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces
(FFOM) de la mise en affermage des AEV dans le département du Couffo
49
IV.2. Présentation des résultats et
décisions
51
IV.2.1. Le processus de recrutement des fermiers
51
IV.2.1.1. L'appel à concurrence
51
IV.2.1.2. Mise en place de l'affermage d'AEV thermiques
anciennes non réhabilitées
52
IV.2.1.3. Non rentabilité structurelle de certaines AEV
52
IV.2.1.4. Fixation du prix de vente de l'eau et des redevances
sans réel calcul
53
IV.2.1.5. Consommations inférieures aux consommations
prévues
53
IV.2.1.5. Résistance voire blocage des anciens
gestionnaires des AEV
54
IV.2.1.6. Mauvaise base de calcul des redevances et/ou non
versement des redevances
54
IV.2.1.7. Compétences des fermiers et des
maintenanciers
55
IV.2.1.8. Quelques problèmes techniques
55
IV.2.1.9. La couverture des charges d'exploitation
56
Iv.3. Rôles et responsabilités des acteurs dans le
suivi de la gestion des AEV
57
IV.3.1. Le choix des options de gestion
59
IV.4. Recommandations
59
IV.4.1. Amélioration des conditions de mise en affermage
59
IV.4.2. Mise en affermage effectif des AEV non encore
affermées et amélioration de l'exécution des contrats
d'affermage actuels
60
IV.5. Présentation des critères de
vérification de l'hypothèse
66
IV.5.1. Confirmation et infirmation des hypothèses
66
CONCLUSION
68
BIBLIOGRAPHIE
71
ANNEXES
73

* 1 André ADOMOU 2008
« Décentralisation et Gouvernance de l'eau potable en milieu
rural au Bénin: cas de la commune de
Toffo »
* 2 Dans le principe de la
gestion communautaire par une AUE :
- l'AUE s'engageait à signer un contrat de maintenance
avec une entreprise agréée par la DGH ; - l'eau devait être
systématiquement vendue au volume, le prix de l'eau, fixé par
l'AUE, devant au minima couvrir les frais d'exploitation et de
renouvellement
* 3 Loi sur la
décentralisation N°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation
des communes en République du Bénin
* 4 Rapport sur l'Evaluation du
processus de professionnalisation de la gestion des AEV - Bénin,
FICHTNER , juin 2007
| 


