
UNIVERSITE D'ABOMEY CALAVI
*****************************
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines
(FLASH)
*****************************
Ecole Doctorale Pluridisciplinaire « Espaces, cultures
et
Développement »
**************************
DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES (DEA)
Filière : Gestion de l'Environnement
Spécialité : Environnement, santé
et développement
ASSAINISSEMENT ET SANTE DANS LA VILLE DE LOKOSSA
Présenté par
B. Fidèle C. MIKPONHOUE
Sous la direction de
Prof. Christophe S. HOUSSOU
& Prof. Euloge OGOUWALE
Professeur Titulaire à l'UAC
Maître de Conférences à l'UAC
Soutenu le 14 Mars 2013
|
Sommaire..................................................................................................................
|
2
|
|
Dédicace...................................................................................................................
|
3
|
|
Sigles et
abréviations.................................................................................................
|
4
|
|
Remerciements............................................................................................................
|
5
|
|
Résumé........................................................................................................................
|
6
|
|
Abstract......................................................................................................................
|
6
|
|
Introduction...............................................................................................................
|
7
|
|
Chapitre I : Revue de littérature,
problématique et démarche
méthodologique.................
|
9
|
|
1-1- Revue de
littérature..............................................................................................
|
9
|
|
1-2-
Problématique.....................................................................................................
|
12
|
|
1-3-
Hypothèses..........................................................................................................
|
14
|
|
1-4-Objectifs de
recherche...........................................................................................
|
14
|
|
1-5- Clarification des
concepts....................................................................................
|
15
|
|
1-6- Démarche
méthodologique...................................................................................
|
17
|
|
Chapitre II : Diagnostic des problèmes
d'assainissement de la ville de Lokossa................
|
22
|
|
2-1- Présentation du milieu
d'étude............................................................................
|
22
|
|
2-2- Situation de l'assainissement dans la ville de
Lokossa........................................
|
24
|
|
Chapitre III : Risques sanitaires liés aux
problèmes d'assainissement dans la ville de
Lokossa ....................................................................................................................
|
35
|
|
3-1-Principaux déterminants de la
santé.......................................................................
|
35
|
|
3-2- Eau, assainissement et santé des populations de la
ville de Lokossa.....................
|
37
|
|
3-2- Identification des risques sanitaires liés aux
problèmes d'assainissement de la ville de
Lokossa .................................................................................................................
|
41
|
|
Chapitre IV : Cadre Institutionnel, Mesures Et
Perspective........................................
|
43
|
|
4-1-Cadre institutionnel de
l'assainissement...............................................................
|
43
|
|
4-2- Mesures d'assainissement à promouvoir dans la
ville de Lokossa...........................
|
50
|
|
CONCLUSION ET
SUGGESTIONS...........................................................................
|
54
|
|
Perspectives pour la
thèse...........................................................................................
|
56
|
|
Bibliographie..............................................................................................................
|
61
|
|
Liste des tableaux, des figures et des
photos...............................................................
|
65
|
|
Questionnaire.............................................................................................................
|
66
|
|
Annexe.......................................................................................................................
|
70
|
|
Tables des
matières....................................................................................................
|
77
|
Dédicace
Sigles et abréviations
|
CBT
|
:
|
Compagnie Béninoise de Textile
|
|
CDQ
|
:
|
Comité de Développement de Quartier
|
|
CeRPA
|
:
|
Centre Régional de Promotion Agricole
|
|
CHD
|
:
|
Centre Hospitalier Départemental
|
|
DGAT
|
:
|
Département de Géographie et Aménagement du
Territoire
|
|
DBM
|
:
|
Déchets Biomédicaux
|
|
DDEPN
|
|
Direction Départementale de l'Environnement et de la
Protection de la Nature
|
|
DDHU
|
:
|
Direction Départementale de l'Habitat et de l'Urbanisme
|
|
DEA
|
:
|
Diplôme d'Etudes Approfondies
|
|
DSM
|
:
|
Déchets Solides Ménagers
|
|
DST
|
:
|
Direction des Services Techniques
|
|
EIE
|
:
|
Etude d'Impact Environnemental
|
|
FLASH
|
:
|
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines
|
|
FNDH
|
:
|
Forces Nouvelles pour un Développement Humain durable
|
|
GIZ
|
:
|
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(ex-Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - GTZ)
|
|
IEC
|
:
|
Information Education et Communication
|
|
INSAE
|
:
|
Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique
|
|
IRSP
|
:
|
Institut Régional de Santé Public
|
|
IUT
|
:
|
Institut Universitaire de Technologie
|
|
MEHU
|
:
|
Ministère de l'Environnement de l'Habitat et de
l'Urbanisme
|
|
MOS
|
:
|
Matrice d'Orientation Stratégique
|
|
OMD
|
:
|
Objectifs du Millénaire pour le Développement
|
|
OMS
|
:
|
Organisation Mondiale de la Santé
|
|
ONG
|
:
|
Organisation Non Gouvernementale
|
|
PADEAR
|
:
|
Projet d'assistance au Développement du secteur de
l'alimentation en eau potable et de l'assainissement en milieu rural
|
|
PAE
|
:
|
Plan d'Action Environnementale
|
|
PDC
|
:
|
Plan de Développement Communal
|
|
PHAC
|
:
|
Plan d'Hygiène et d'Assainissement Communal
|
|
PIP
|
:
|
Programme d'Investissement Public
|
|
RGPH
|
:
|
Recensement Général de la Population et de
l'Habitation
|
|
SBEE
|
:
|
Société Béninoise d'Energie Electrique
|
|
SEau
|
:
|
Service de l'Eau
|
|
SHAB
|
:
|
Service de l'Hygiène et de l'Assainissement de Base
|
|
SITEX
|
:
|
Société d'Industrie des Textiles
|
|
SNV
|
:
|
Société Néerlandaise des Volontaires /
Organisation Néerlandaise de Développement
|
|
SONEB
|
:
|
Société Nationale des Eaux du Bénin
|
|
UAC
|
:
|
Université d'Abomey Calavi
|
Remerciements
Au terme de la réalisation de ce mémoire, je tiens
à remercier :
- Monsieur le Professeur Christophe HOUSSOU, pour avoir
accepté de diriger ce mémoire malgré ses multiples
occupations. Ses observations et ses critiques constructives ne m'ont nullement
fait défaut. Qu'il reçoive ici, mes sincères et profonds
remerciements ;
- Monsieur le Professeur Euloge OGOUWALE, pour ses nombreux
conseils et ses remarques pertinents tout au long de ce travail ;
- Mes amis qui ont contribué à l'accomplissement
de ce travail.
A tous infiniment merci !
Résumé
La ville de Lokossa tout comme les grandes villes est
confrontée à des problèmes d'assainissement. La
présente étude analyse les problèmes de santé
liés à un mauvais assainissement de la ville de Lokossa.
La démarche méthodologique adoptée va de
la recherche documentaire à la collecte de données de terrain
à l'issue desquelles des données relatives aux modes de gestion
des déchets solides et liquides ménagers, aux conséquences
du manque d'assainissement sur la santé des populations ont
été collectées traités et analysées. Des
analyses bactériologiques des eaux de puits ont été
réalisées dans la ville de Lokossa.
Les résultats obtenus montrent que le taux de
couverture en latrine est de 20 % dans la ville de Lokossa. Seulement 4 % des
ordures ménagères sont collectées par la voirie et deux
ménages sur trois ne sont pas abonnés au réseau
d'adduction potable de la ville. Cette situation est responsable des maladies
dont souffrent les populations notamment le paludisme (75 % des cas
déclarés), les parasitoses intestinales et
gastro-entérites. L'amélioration de la politique d'assainissement
de la ville de Lokossa reste une option à envisager.
Mots clés : Ville de Lokossa,
assainissement, santé
Abstract
The city of Lokossa all as the big cities are confronted to
problems of purification. The present survey analyzes the problems of health
bound to a bad purification of the city of Lokossa.
The adopted methodological gait goes from the documentary
research to the collection of land data to the exit of which of the relative
data to the fashions of management of the domestic strong and liquid garbage,
to the consequences of the purification lack on the health of the populations
have been collected treaties and analyzed. Bacteriological analyses of the
waters of well have been achieved in the city of Lokossa.
The gotten results show that the rate of cover in latrine is
of 20% in the city of Lokossa. Only 4% of the domestic garbage are collected by
the road network and two households on three didn't subscribe to the network of
drinkable adduction of the city. This situation is responsible for the
illnesses of which endure the populations notably the malaria (75% of the
declared cases), the intestinal parasitizes and gastroenteritis. The
improvement of the politics of purification of the city of Lokossa remains an
option to consider.
Key words: City of Lokossa, purification,
health
INTRODUCTION
Avec la dégradation des ressources naturelles et du
cadre de vie, les problèmes environnementaux sont devenus une
préoccupation majeure pour tous les États du monde. Ainsi,
plusieurs sommets et conférences ont été organisés
au plan international notamment à Stockholm (Suède) en 1972,
à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992 et à Johannesburg
(Afrique du sud) en 2002. L'Afrique n'est pas restée en marge des
résolutions adoptées à l'issue de ces sommets et
conférences.
Cependant, dans les grandes villes africaines, plusieurs
facteurs rendent difficiles la maîtrise de la gestion de l'assainissement
urbain et l'accès à l'eau potable. La forte croissance
démographique, s'accompagne d'un développement spatial anarchique
qui échappe à tout contrôle des pouvoirs publics. Les
populations s'installent sans avoir la possibilité d'accéder aux
services urbains. Dans les zones d'habitat planifié ou
administré, les promoteurs immobiliers et les municipalités se
rejettent mutuellement la responsabilité de l'assainissement des eaux
usées et des mauvaises conditions d'accès à l'eau potable,
ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne les déchets solides (Ngnikam,
2007).
Ainsi un assainissement et une hygiène insuffisants
favorisent la transmission des germes pathogènes et 88 % des cas de
diarrhée sont directement liés à ces causes : parmi ces
cas de diarrhée se trouvent des maladies graves comme le choléra,
la fièvre typhoïde, les dysenteries qui sont toutes des maladies
hydriques liées à un cycle de transmission fécale-orale
(Prüss-Üstün et al, 2008).
Pour l'Organisation Mondiale de la Santé (2005), 2,6
milliards de personnes soit 42 % de la population mondiale n'ont pas eu
accès à des services d'assainissement de qualité en 2005.
Ces privations provoquent beaucoup de décès et expliquent au
moins 1,6 des 11 millions de décès d'enfants que l'on pourrait
éviter chaque année. Dans les pays en développement,
seulement 31 % des personnes résidant en milieu rural ont accès
à des installations sanitaires de qualité, contre 73 % des
citadins. En Afrique Subsaharienne, seuls 36 % de la population ont
accès à des installations sanitaires (OMS, 2005).
Cependant, l'insalubrité qui menace les villes moyennes
du Bénin et la ville de Lokossa en particulier incite à
entreprendre des études pour mieux comprendre cette situation. C'est ce
qui a motivé le choix de ce thème intitulé
Problématique de l'assainissement et de la santé dans la ville de
Lokossa.
La présente étude est répartie en quatre
(4) chapitres :
- le premier chapitre présente la revue de
littérature, la problématique et la démarche
méthodologique ;
- le deuxième chapitre aborde les problèmes
d'assainissement de la ville de Lokossa ;
- le troisième chapitre fait ressortir les risques
sanitaires liés aux problèmes d'assainissement dans la ville de
Lokossa ;
- le quatrième chapitre analyse le cadre
institutionnel de l'assainissement en milieu urbain et propose des mesures et
perspectives pour atténuer les problèmes d'assainissement dans la
ville de Lokossa.
CHAPITRE I :
REVUE DE LITTERATTURE, PROBLEMATIQUE, ET
DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Le présent chapitre est consacré à la
présentation du cadre théorique, et à la démarche
méthodologique.
1-1- Revue de littérature
Il existe une littérature bien fournie sur les
questions d'assainissement et de santé. La consultation de cette
documentation a permis de faire le point sur les différentes approches
dans le domaine de l'environnement en relation avec la santé publique.
Plusieurs auteurs et institutions ont pu dans leur ouvrages, établir un
lien entre la mauvaise gestion du milieu et les conséquences sanitaires
qui en découlent.
Selon la Banque Mondiale (2001), le développement
économique améliore considérablement la qualité de
vie dans les pays en développement produisant des gains incroyables,
sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Dans le
même temps, les facteurs environnementaux tels que la pollution de l'air
extérieur et dans les habitations, les maladies ainsi que l'exposition
aux produits chimiques toxiques menacent la santé de millions de
personnes et les ressources naturelles.
Abondant dans le même sens, Diabagaté (2007)
affirme que les conditions environnementales, économiques et
sociales du milieu urbain déterminent la santé des populations.
C'est pourquoi, à côté d'un modèle
biomédical, il importe de développer les interprétations
écologiques et environnementales de la santé et de se
libérer des perspectives étroitement sectorielles.
Jagland (2011), quant à lui décrit les liens
étroits qui existent entre environnement, santé et
pauvreté. Pour lui en effet, il apparaît de plus en plus
clairement que la pauvreté et la mauvaise santé sont les
principales causes de la dégradation environnementale, mais aussi que la
santé et le recul de la pauvreté dépendent d'un
environnement salubre.
Ce constat presque général dans la plupart des
villes des pays sous développés ne serait pas sans fondement. En
effet, le mode de vie et la pauvreté justifierait un temps soit peu le
comportement des hommes et des femmes vis à vis de l'environnement. A ce
propos, Coulibaly (2002) dégage que les conditions de vie des
habitants sont à la base de la dégradation de l'environnement
urbain à Gaya au Niger. Il partage ainsi l'assertion de l'OMS (1981) qui
faisait remarquer que les maladies transmissibles liées à l'eau
sont rares dans les pays développés ; les niveaux de
développement, la forte proportion des branchements individuels et les
réseaux d'assainissement à entraînement par eau ont
concouru à en faire disparaître les principales causes.
Par ailleurs, de nombreuses littératures sur la
question ont établi un lien direct entre un environnement malsain et la
santé des populations. L'évacuation inadéquate et
insalubre des déchets et en particulier d'excréta humains
infectés entraîne la contamination du sol et des sources d'eau
potable (OMS, 1992), et donc des maladies.
Affognon (1999), par exemple a étudié les
rapports qui existent entre les activités humaines et la pollution dans
le quartier Enagnon de Cotonou. Dans sa démarche, il dégage
l'impact de la pollution sur la vie des hommes et propose des solutions pour y
remédier.
Abondant dans le même sens, mais de façon
spécifique Odulami (1999), Migan (1993) et Assani (1995) ont
étudié la qualité des eaux dans certaines villes et sont
arrivés à la conclusion que les eaux des sources renferment des
rejets générés par les activités humaines et des
germes fécaux qui sont responsables de plusieurs maladies d'origine
hydrique telles que le choléra, la fièvre typhoïde, la
dysenterie, les gastro-entérites, les parasitoses intestinales.
Face à tous ces problèmes, il faut alors
repenser la question santé-environnement comme le montre si bien le
titre de l'ouvrage de Cassels et Janovski (1996) qu'il faut renforcer la
gestion des systèmes de santé dans les districts et les
provinces.
Il s'en suit alors que pour réduire les
déconvenues d'un environnement urbain malsain, le développement
de l'alimentation en eau et celui de l'assainissement doivent être
associé aux autres aspects du développement sanitaire (OMS,
1981).
Le MEHU (2001) à travers son Plan d'Action
Environnemental a compris que les effets quotidiens des pollutions,
résultent entre autres de la vieillesse des équipements sur la
santé humaine : maladies respiratoires, maladies liées
à une mauvaise hygiène hydrique. Dans le même ordre
d'idée, il montre que les déchets urbains ne sont «
gérés« que de façon médiocre surtout dans les
plus grandes villes. Les taux de gestion oscillent autour de 50 % pour tout le
Bénin soit 140 000 tonnes par an puisque que selon les estimations
70 à 75 % des déchets domestiques de la ville de Cotonou ne sont
pas collectées, même si, depuis quelques années,
grâce à la libération du secteur de la gestion des
déchets solides et des eaux usées, des entreprises privées
contribuent à une évacuation plus intensive et plus rapide des
déchets.
L'OMS (1994) à travers son conseil de concertation pour
l'approvisionnement en eau et l'assainissement déclare que l'absence
d'assainissement présente une grave menace de pollution pour les
ressources en eau et peut être considéré comme un
déni du droit fondamental de l'homme à la dignité. Par
cette affirmation, le conseil de concertation montre à quel point
l'homme pris dans son entièreté a droit à un cadre de vie
salubre et sain sans lequel il se trouve considérablement
diminué.
En grande partie, ce sont l'ignorance et la négligence
de certains citoyens qui mettent les secteurs urbains et périurbains des
cités béninoises dans un état d'insalubrité de plus
en plus accentué. Certains se soucient très peu du maintien de
leur cadre de vie dans un état de propreté acceptable.
Pour le MEHU (2001), une faible partie de ces déchets
(environ 15 %) est recyclée par le secteur informel, comme dans la
plupart des pays africains. Il reste cependant qu'une grosse quantité
est soit enfouie sur place, soit entassée dans les décharges
sauvages qui envahissent souvent les grandes artères routières au
grand mépris des règles d'hygiène
élémentaire ou encore sert souvent de remblai pour les voies
inondables lorsqu'elle n'est pas simplement rejetée dans les caniveaux
d'évacuation d'eaux pluviales. Le manque de moyens et l'incivisme quasi
généralisé des populations sont directement responsables
de cet état de fait. Cependant, le Bénin dispose d'un arsenal
juridique en matière d'environnement et de santé publique. Un
nombre important de textes réglementaires sont élaborés
et, mieux, des accords, traités et conventions internationaux ont
été signés et ratifiés. Tous ces textes aussi bien
nationaux qu'internationaux doivent contribuer à l'amélioration
de l'environnement. Malgré cet arsenal de textes, la gestion de
l'environnement connait encore un certain nombre de problèmes dont
notamment la faible culture juridique des populations qui entraînent
l'indifférence vis-à-vis des règles juridiques.
Pour combler ces insuffisances ci-dessus citées, le
Bénin s'est doté d'une Politique National de l'Assainissement qui
a pour objectif de promouvoir l'assainissement dans le but de rendre salubre le
cadre de vie des populations.
En somme, ces différentes recherches documentaires ont
été d'une grande utilité car elles ont permis de mieux
circonscrire le sujet. Mais force est de constater que la plupart des
études menées ne mettent pas l'accent sur les problèmes
environnementaux et les risques sanitaires liées à ces
problèmes dans les villes moyennes.
1-2-Problématique
En 2029, plus de 50 % de la population des pays en
développement habitera en zone urbaine. Si la tendance actuelle se
poursuit, la majeure partie de cette population vivra en ville, dans des
quartiers non desservis par les services de base comme l'eau potable et
assainissement (Seidl, 2009).
Ainsi les conditions environnementales dans lesquelles vivent
des centaines de millions de citadins dans le monde ont des conséquences
néfastes voire catastrophiques sur leur santé (Diabagaté,
2007).
Environ 2, 5 milliards de personne dans le monde souffrent du
manque d'accès à un assainissement de base (ONU, 2006).
Entre 2000 et 2003, 769 000 enfants sont
décédés chaque année de diarrhée en Afrique
Subsaharienne, soit plus de 2000 décès par jour (Houanou, 2008).
La Direction des Études Démographique (2006) a montré
qu'au Bénin, 14 % des enfants de 6 à 23 mois ont souffert de
diarrhée en 2006.
A l'origine de ces problèmes, l'insuffisance
d'observance des règles d'hygiène, les comportements
négatifs sur l'environnement comme la défécation dans les
champs, forêts, buissons, masses d'eau ou d'autres espaces ouverts, ou
l'élimination des matières fécales avec les déchets
ménagers solides qui rendent l'eau de boisson insalubre et en font un
vecteur de maladies hydriques (OMS, 2005).
Au niveau mondial, 1,2 milliards de personnes pratiquent la
défécation à ciel ouvert, 221 millions de personnes en
Afrique subsaharienne (Aubry, 2005). Au Bénin, à la fin de
l'année 2010, 41,9 % de la population béninoise avaient
accès aux ouvrages d'évacuation d'excréta mais
l'écart était important entre le milieu urbain (81,7 % de
couverture) et le milieu rural (15,9 %) (Suivi Emicov,
2010).
L'effet de contagion n'a pas épargné les villes
moyennes à l'instar de Lokossa qui a connu elle aussi l'influence de la
croissance humaine. D'après les statistiques du recensement
général de la population et de l'habitation en 2002, cette ville
comptait 36 954 habitants. Elle compte actuellement environ 46 354
habitants et cette population devrait passer à environ 77 226
habitants en 2025 selon les projections (INSAE, 2009).
Dans la ville de Lokossa, l'évolution de la population
n'est pas accompagnée d'un comportement susceptible de préserver
le cadre de vie. Quelques exemples dénotent cette affirmation. En effet,
les villes dans leur ensemble s'agrandissent sans un plan directeur
précis (Dossou-Yovo, 2001). De plus la réalité
sociologique qui caractérise ces populations est de pouvoir construire
sa propre demeure. En dehors de ces considérations, l'attitude
traditionnelle et le mode de vie des populations influencent la
rationalité dans la manière d'agir et les systèmes de
norme de gestion de l'environnement urbain.
Ces pesanteurs sont le reflet d'une série de
problèmes d'insalubrité dont l'homme se trouve à
l'origine. L'illustration est que, la plupart des concessions ne disposent pas
de lieu d'aisance convenable, les latrines traditionnelles qui sont construites
par endroit constituent au même titre que les douches et puits de
fortune, des gîtes larvaires (Allagbé, 2005).
En conséquence, la pollution qu'engendrent les
pratiques humaines sur le milieu urbain commence en revanche par créer
un environnement malsain qu'il importe d'assainir d'où
l'intérêt du thème : « assainissement et
santé dans la ville de Lokossa ».
La réflexion sur l'assainissement et la santé
dans les villes moyennes du Bénin vise ainsi à apporter une
lumière sur les questions suivantes : Quelles sont les
problèmes d'assainissement que rencontre la ville de Lokossa ?
Quels sont les impacts sur la santé des populations ? Quel est le
cadre institutionnel qui régit l'assainissement dans cette ville?
Quelles stratégies, mettre en place pour résoudre ces
problèmes?
1-3- Hypothèses
- La pollution de l'environnement dans la ville de Lokossa est
en majeure partie liée aux problèmes d'assainissement ;
- les problèmes d'assainissement ont des
conséquences sur la santé des populations;
- les mesures d'assainissement dans la ville de Lokossa
souffrent d'insuffisances.
1-4- Objectifs de recherche
Le présent travail vise d'une manière
générale à contribuer à une meilleure connaissance
des problèmes d'assainissement et leur effet sur la santé des
populations de la ville de Lokossa. Spécifiquement il s'agit
de :
- étudier les problèmes d'assainissement dans la
ville de Lokossa;
- identifier les risques sanitaires liées aux
problèmes d'assainissement de la ville de Lokossa ;
- proposer des stratégies pour un meilleur
assainissement de la ville de Lokossa.
Pour atteindre ces objectifs, une démarche
méthodologique a été adoptée. Mais avant, il
convient de clarifier quelques concepts afin de faciliter l'exploitation du
document.
1-5- Clarification des concepts
La formulation du sujet, objet de la présente
étude, fait appel à l'utilisation fréquente de certains
concepts qu'il convient de clarifier pour faciliter la compréhension de
ce travail.
- Assainissement
Selon le groupe de travail des Nations Unies sur l'eau (2008),
l'assainissement signifie l'accès et l'usage d'installations sanitaires
pour le traitement des excrétions et des eaux usées ainsi que
leurs services connexes, et ce, de manière à assurer le respect
de l'intimité et de la dignité des usagés, ainsi qu'un
environnement propre et sain pour tous.
Dans le cadre de cette étude, l'assainissement implique
le contrôle de l'approvisionnement public en eau, de l'évacuation
des excréta et des eaux usées, de l'élimination des
déchets et des vecteurs de maladies.
- Santé
Être en bonne santé, c'est être capable
d'optimiser son équilibre de vie en développant au maximum et
harmonieusement toutes ses ressources. Cela exige de vivre dans un cadre
facilitant son épanouissement en l'absence de tout facteur perturbateur,
cause de tension, d'agression usant son organisme, altérant ses
facultés de récupération, détruisant sa
résistance (N'Bessa, 2010).
La santé telle qu'elle est perçue dans cette
étude, se résume au bien être physique découlant de
l'assainissement du milieu urbain et de l'application des règles
d'hygiène de vie.
- Ville moyenne
Le concept de ville moyenne s'identifie au milieu urbain. Il
s'entend comme une zone hétérogène qui regroupe tout chef
lieu de commune ayant au moins 10 000 habitants et au moins une des
infrastructures ci-après : bureau de poste et
télécommunication, bureau de recette perception du trésor
public, système d'adduction d'eau (SONEB), électricité
(SBEE), centre de santé, collège d'enseignement
général avec le second cycle d'une part et tout arrondissement
ayant au moins quatre des infrastructures énumérées
ci-dessus et au moins 10 000 habitants d'autre part (INSAE, 2002).
Dans le contexte de l'étude, le concept ville moyenne
est attribué à l'arrondissement de Lokossa dont la population
s'évalue à environ 44 176 habitants (INSAE, 2010) et qui
dispose de bureau de poste et télécommunication, de bureau de
recette perception du trésor public, de système d'adduction d'eau
(SONEB), d'électricité (SBEE), d'un Hôpital de zone, d'au
moins 02 collèges d'enseignement général avec
2nd cycle.
- Pollution
Elle est la dégradation d'un milieu naturel par des
substances chimiques, des déchets industriels ou ménagers
(Larousse, 2010).
Dans le contexte de cette étude, la pollution se
réfère à la mauvaise gestion des déchets solides et
liquides issues des activités humaines et des ménages.
- Déchet
Selon le guide de l'environnement, le déchet est tout
résidu d'un processus de production, de transformation ou
d'utilisation.
Le concept de déchet dans cette étude
s'identifie aux ordures ménagères, aux eaux usées, aux
déchets biomédicaux, et aux matières hydro
fécales.
- Hygiène
L'hygiène est l'ensemble des conditions sanitaires d'un
lieu (Larousse, 2010). Dans le cadre de cette étude, elle résume
les attitudes adoptées par les populations pour rendre leur milieu
sain.
1-6- Démarche Méthodologique
La démarche méthodologique adoptée dans
le cadre de cette étude comporte deux volets : la collecte des
données et le traitement et l'analyse des données.
1-6-1- Collecte des données
La collecte des données dans le cadre de cette
étude regroupe les données utilisées, la recherche
documentaire, les enquêtes de terrain et les entretiens avec les
responsables à divers niveau de la ville.
1-6-2- Données
utilisées
Quatre types de données ont été
recueillis dans le cadre de ce travail de recherche. Il s'agit des
données:
- portant sur les modes de gestion des ordures
ménagères, des eaux usées et des déchets
biomédicaux;
- issues des analyses de laboratoires effectuées sur
les eaux de puits de la ville de Lokossa;
- relatives aux maladies liées aux problèmes
d'assainissement dans la ville;
- sur la perception qu'ont les populations de leurs
problèmes de santé.
1-6-3- Recherche documentaire
Elle a permis de recenser les travaux et études
relatifs au sujet et au milieu d'étude. Ainsi sont recensés, les
ouvrages et informations à travers les bibliothèques et les
centres de documentation de l'Université, des Ministères et des
Institutions concernées. Les types d'informations collectées sont
résumés dans le tableau I en Annexe. La bibliographie sur
internet a été aussi utilisée et a permis de consulter les
publications et des ouvrages généraux sur le thème.
1-6-4- Enquête de terrain
1-6-4-1- Echantillonnage
L'échantillon a été
déterminé par la méthode probabiliste et la technique de
choix aléatoire et proportionnellement à la taille des
ménages sur la base d'un certain nombre de critères. En effet,
les personnes interrogées ont au moins dix huit (18) ans et soixante 60
ans au plus. L'échantillon a été déterminé
à partir du nombre de ménages dans chaque quartier. La taille de
l'échantillon a été déterminée en suivant la
méthode de SCHWARTZ (2002). Elle a été calculée
avec un degré de confiance de 95 % et une marge d'erreur de plus ou
moins 5 %.
Avec : N = taille de l'échantillon par
arrondissement
Zá = écart fixé à 1,96
correspondant à un degré de confiance de 95 %
P = nombre de ménages du quartier / nombre
ménages de la ville
Q = 1 - P
d = marge d'erreur qui est égale à 5 %
En procédant ainsi par quartier, un taux de
d'échantillonnage de 15 % est appliqué au résultat pour
déterminer le nombre exact de ménages à enquêter par
arrondissement.
Le tableau I présente le nombre de ménages
enquêté par quartier de ville.
Tableau I : Ménages
enquêtés par quartiers
|
Quartiers
|
Population
|
Ménages
|
Echantillon
|
Personnes ressources
|
|
Tchicomè
|
7394
|
1607
|
35
|
10
|
|
Glo guincomè
|
9279
|
2017
|
42
|
|
Takon zongo
|
2119
|
461
|
12
|
|
Saguè zounhoué
|
4637
|
1008
|
24
|
|
Agnivedji
|
6182
|
1344
|
31
|
|
Ahouanmè dékanmè
|
4142
|
900
|
22
|
|
Adjacomè
|
628
|
137
|
4
|
|
Agonvè
|
4918
|
1069
|
25
|
|
Total
|
39299
|
8543
|
195
|
10
|
Sources : INSAE, 2010/ travaux de
terrain, 2011
Au total, 195 ménages ont été
visités dont 42 à Tchicomè, 42 à Glo
guincomè, 12 à Takon zongo, 24 à Saguè
zounhoué, 31 à Agnivèdji, 22 à Ahouanmè
dékanmè, 04 à Adjacomè et 25 à
Agonvè. Les entretiens quant à eux ont eu lieu avec 04
responsables de la mairie de Lokossa, 01 statisticien de l'Hôpital de
Zone, 04 responsables d'ONG de collecte d'ordures ménagères, un
représentant de la Direction Départementale de la Santé et
01responsable du Service de l'Eau soit au total 10 personnes ressources.
1-6-4-2- Techniques de collecte
Plusieurs techniques ont été utilisées
pour la collecte des données sur le terrain.
- Entretiens
Les entretiens ont été faits sur la base d'un
questionnaire. Ce dernier a été utilisé pour recueillir
les données quantitatives et qualitatives sur la gestion des ordures
ménagères, des eaux usées dans les ménages. Le
guide d'entretien quant à lui s'est adressé à tous les
acteurs locaux intervenant dans la gestion des problèmes
d'assainissement et de santé dans la ville de Lokossa.
- Observation
L'observation a permis de prendre connaissance de la
localisation et la caractérisation des dépôts d'ordures et
d'apprécier la proximité des sites de dépôt sauvage
d'ordures par rapport aux populations. Les résultats de ces observations
sont illustrés par des photos qui révèlent la
réalité du terrain.
- Analyse bactériologique des eaux de
puits
Pour l'analyse des eaux de puits, l'échantillonnage a
été un choix raisonné. A cet effet, les eaux de puits
ayant été analysés l'ont été dans les
ménages ayant été identifiés pour subir le
questionnaire et qui utilisent fréquemment ces puits pour les usages
courants. Au total 16 échantillons d'eaux de puits ont été
analysés à raison de 02 par quartier de ville.
1-6-5- Traitement des
données
Après avoir recueilli les données quantitatives
et qualitatives, il a été d'abord procédé
à leur dépouillement puis à leur traitement et analyse.
Les informations recueillies à partir des questionnaires ont
été traitées manuellement (dépouillement,
numérotation et codage) et avec le logiciel de calcul statistique Excel.
Les réponses aux questions fermées ont
été évaluées en considérant l'effectif total
de l'échantillon et l'information recherchée pour pouvoir
dégager les pourcentages. Quant aux questions ouvertes, un traitement du
contenu a été fait de chaque proposition.
Des analyses bactériologiques ont été
alors effectuées pour connaître la quantité de coliformes
fécaux contenus dans les eaux des puits échantillonnés sur
l'ensemble de la ville.
Plusieurs indices calculés ont permis d'évaluer
le niveau d'assainissement dans la ville de Lokossa. Ce sont :
- le taux de couverture en ouvrages d'assainissement
autonome notamment en latrines
Il est déterminé par le rapport du nombre de
ménages disposant de latrines sur le nombre total de ménages
estimés en 2010. Ce taux de couverture en latrines est obtenu à
partir du recensement exhaustif des ménages disposant et/ou utilisant
des latrines, organisé par la mairie avec l'appui technique de
l'équipe de MedA Conseils.
- Le taux d'accès aux ouvrages d'assainissement
autonome dans la ville, notamment des latrines
Celui-ci est déterminé par le rapport du nombre
de ménages utilisateurs de latrines pour l'évacuation de leurs
excréta sur le nombre total de ménages estimés en 2010
(21.764). Ce taux d'accès en latrines est obtenu à partir du
recensement exhaustif des ménages disposant et/ou utilisant de latrines,
organisé par la mairie avec l'appui technique de l'équipe de MedA
Conseils.
L'analyse diagnostique à l'aide du modèle Swot a
permis de mettre en évidence les forces, faiblesses, opportunités
et menaces au niveau du secteur de l'hygiène et de l'assainissement dans
la commune de Lokossa.
CHAPITRE II : DIAGNOSTIC DES PROBLÈMES
D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE LOKOSSA
Ce deuxième chapitre de l'étude aborde la
présentation du milieu d'étude et la situation de
l'assainissement dans la ville de Lokossa.
2-1- Présentation du milieu d'étude
La ville de Lokossa est située dans la commune de
Lokossa et plus précisément dans l'arrondissement de Lokossa.
Elle compte 08 quartiers répartis sur 9,35 km2. Ce sont les
quartiers : Tchicomè, Glo guincomè, Takon zongo,
Saguè Zounhoué, Agnivèdji, Ahouanmè
dékanmè, Adjacomè et Agonvè. La ville de Lokossa
est limitée au Nord par l'arrondissement de
Ouèdèmè, au Sud par la commune d'Athiémé,
à l'Est par l'arrondissement de Houin et à l'Ouest par le village
d'Atikpéta. Elle est localisée au Sud-Ouest de la commune de
Lokossa. Sa superficie représente 17,31 % de la superficie de
l'arrondissement de Lokossa (54 km²). La figure 1 présente les
situations géographique et administrative de la Ville de Lokossa.

Figure 1 : Situations géographique
et administrative de la ville de Lokossa
Le climat de la ville de Lokossa est un climat chaud
marqué par une humidité relativement élevée ;
les précipitations qu'on y observe sont relativement
modérées (900 à 1.100 mm), favorables aux inondations et
à la pollution environnementale en saison de pluie, surtout dans les
zones de terres noires ou à sols hydromorphes, comme c'est le cas de
l'arrondissement de Lokossa.
Les sols que l'on retrouve dans la ville de Lokossa sont de
type ferralitique et hydromorphe, le premier est facilement dégradable
si associé à de fortes pentes, tandis que le second reste
très propice à la stagnation des eaux pluviales et usées.
Ces caractéristiques pédologiques fragilisent l'équilibre
sanitaire de la population.
2-2- Situation de
l'assainissement dans la ville de Lokossa
2-2-1- Gestion des excrétas, eaux usées et
boues de vidange
Dans la ville de Lokossa, la couverture en latrines est
bien en dessous des attentes nationales. Moins de trente ménages sur
cent disposent d'une latrine pour l'évacuation des excrétas. Le
taux de couverture en est de 28 % à Lokossa centre (enquête de
terrain). La figure 2 présente le taux de couverture en latrines de la
ville de Lokossa.

Figure 2 : Couverture en latrines de la
ville de Lokossa
Le recensement exhaustif des dispositifs
améliorés d'évacuation des excréta et des eaux
usées réalisé par la Direction des Services Techniques
(DST) de la mairie dans la ville de Lokossa a permis de comptabiliser au total
2.467 ménages disposant de latrines pour 8.543 ménages que
comptait la ville en 2011. Dans la réalité des faits, un peu
moins d'un millier d'ouvrages supplémentaires sont implantés sur
le territoire communal sans vraiment servir. En effet, plus de 20 % des
ouvrages existant matériellement ne servent pas, soit pour interruption
prolongée de construction, soit parce qu'en mauvais état (DST,
Mairie Lokossa).
L'ampleur du besoin et l'acuité de la demande sont tels
que malgré ce faible taux de couverture, la proportion moyenne de
ménages utilisant des latrines est presque trois fois plus grande que
celle de ménages disposant de latrines. Le taux d'accès aux
latrines par les ménages est de 71 %. C'est la preuve de la forte
pression liée à l'usage des infrastructures d'évacuation
des excrétas. Ceci laisse supposer que près de 30 % des
ménages n'ont pas du tout accès aux latrines.
Les besoins en latrines familiales d'ici 2015, pour atteindre
l'Objectif n° 7 du Millénaire pour le Développement (OMD)
dans la commune de Lokossa (objectifs relatifs à la
réduction de moitié, de la proportion de ménages sans
accès à un système amélioré
d'assainissement), ont été évalués à 5.109
latrines, soit une moyenne de 1.022 latrines par an (Mairie Lokossa, 2010).
D'une façon générale, près de 83 %
des ménages ne disposant pas de latrines, utilisent comme lieux
d'aisance la brousse, le reste (17 %) utilise les latrines publiques, les
latrines des écoles, les abords des concessions, etc.
La situation de la gestion des eaux usées est moins
reluisante. Le recensement exhaustif réalisé a
révélé deux types de puits perdus dans la ville de
Lokossa : les puits perdus modernes (fosse partiellement
maçonnée, couverture en béton...) et les puits perdus
traditionnels qui sont en fait des trous creusés et fermés avec
une feuille de tôle ou des bois empêchant les animaux de venir se
baigner dans les eaux stagnantes. Sur cent ménages, moins de neuf
disposent d'un puits perdu, avec 6 % de couverture en puits perdus modernes et
2 % en puits perdus traditionnels. Le peu de puits perdus existant dans la
commune de Lokossa est essentiellement utilisé pour l'évacuation
des eaux de douche. Cependant, dans la majeure partie des cas, il s'agit de
puisards hors norme ou construits sur l'emprise des voies (photo 1). Il est
également observé le phénomène des connexions
illicites des ménages sur les canalisations publiques pour
l'évacuation des eaux usées de toute nature est également
très répandu.


1a
1b
Photo 1 : Puisards installés aux
abords d'une concession à Agonvè
Prises de vues :
Mikponhoué, avril 2011
La photo 1 présente une concession dont les
canalisations de rejets d'eau usées débouchent directement dans
la rue où est aménagé un trou couvert par une dalle (photo
1a) et un puisard en état de délabrement dans la rue (photo 1b).
L'enquête de terrain a révélé que
les abords des maisons sont les lieux prépondérants de rejet des
eaux de lessive (67 %), de vaisselle (65 %) et de cuisine (63 %). Quant aux
eaux de douche mal évacuées, elles stagnent aux alentours des
maisons dans la plupart des ménages sans puits perdus.
En ce qui concerne la gestion des boues de vidange, la commune
de Lokossa, malgré son statut de ville secondaire et sa forte
agglomération urbaine, ne dispose pas d'un service local de vidange des
fosses fonctionnel. L'unique camion vidangeur existant est en panne et
complètement amorti. De plus, le site utilisé pour le
déversement des boues de vidange n'est pas aménagé.
Pour répondre aux besoins des populations, un
mécanisme palliatif a été mis en place : la mairie se
réfère aux services d'une structure privée de vidange
située à Cotonou après un recensement de 20 fosses
pleines (car en deçà, le déplacement de
l'opérateur ne serait plus rentable). Cette structure réalise la
vidange des fosses au prix fixé et adopté en session communale
pour Lokossa (41.600 FCFA). Cependant, avant d'atteindre ce nombre de 20 fosses
pleines, les demandes durent plusieurs semaines si bien que les premiers
inscrits éprouvent d'énormes difficultés dans
l'exploitation de leurs fosses. Cet état de chose ne permet pas souvent
de satisfaire les demandes des populations dans la période requise et
suscite beaucoup de plaintes de la part de ces dernières. Certaines sont
obligées de recourir tout simplement aux vidangeurs manuels, au
mépris des risques encourus.
2-2-2- Gestion des déchets solides par les
ménages
Dans la ville de Lokossa, 40 % des ordures
ménagères sont déposées aux abords des concessions,
contre 11 % sur des dépotoirs sauvages (photo 2), 10 % dans la
brousse, 8 % dans la rue et 7 % pour les autres modes de rejet. A cela
s'ajoute l'enfouissement des ordures dans des trous à 20 % et un
léger taux de collecte par la `'voirie privée-ONG'' dans l'ordre
de 4 % (Mairie de Lokossa).

Photo 2 : Dépotoirs sauvages aux
abords d'une concession dans le quartier Tchicomè
Prise de vue :
Mikponhoué, avril 2011
Un regard sur cette photo montre les conditions de vie
insalubre créées par les dépotoirs sauvages dans la ville
de Lokossa et les risques sanitaires immédiats que cela pourrait
engendrer sur les ménages avoisinants.
En dépit du déversement des ordures aux abords
des concessions, la collecte des déchets solides par les structures de
collecte des ordures est un peu mieux observée, quoique la proportion
soit faible (seulement 12 % des enquêtés souscrivent à un
abonnement auprès de structures de collecte des ordures
ménagères). Mais l'invariant partout dans la ville de Lokossa est
que les abords des concessions est un lieu privilégié de rejet
des ordures ménagères.
En ce qui concerne le stockage des déchets, il se fait
souvent à domicile et à l'aide des récipients
usagés tels que les bidons coupés, les paniers, les sacs, etc.
qui servent de poubelles. Ailleurs, les ordures ménagères sont
mises en tas/trou dans la cour.
Dans la ville de Lokossa, il existe un système formel
de gestion des déchets solides ménagers. Un plan de zonage permet
de quadriller les 8 quartiers de ville en 7 zones. La gestion des ordures
ménagères dans chaque secteur délimité a
été confiée à au moins une des quatre structures de
collecte des ordures existantes.
Cependant, le système de gestion des ordures mis en
place ne fonctionne pas bien. Six zones sur sept n'ont pas de site de
décharge intermédiaire et le seul qui existe (Tchicomè)
n'est pas fréquemment utilisé. La photo 2 montre le site de
décharge intermédiaire de Tchicomè.

Photo 3 : Site de transit des ordures
ménagères de Tchicomè
Prise de vue :
Mikponhoué, avril 2011
La photo présente le site de transit des ordures
ménagères de Tchicomè. Le site semble abandonné
à cause de son éloignement par rapport aux autres quartiers de
villes. Parfois, les agents de pré-collecte doivent parcourir plusieurs
kilomètres (plus de 3 km) avec leurs charrettes avant de pouvoir
déposer les ordures sur le site. Les ordures ménagères
sont ainsi très souvent déversées sur d'autres sites
illégaux tels que les bas-fonds et autres lieux publics (ponts, abords
d'établissements scolaires, de maison etc.).
Il existe ainsi une certaine anarchie dans la
pré-collecte et le regroupement des ordures collectées.
Associés à cela, d'autres phénomènes comme les
abonnements parallèles de certains ménages qui conduisent aussi
au déversement des déchets en cours de route et hors du site de
regroupement, etc. Les structures de pré collecte n'ont aucune
obligation formelle avec l'administration communale et il n'y a pas de contrat
qui les lie; et aucune répression n'est faite pour les contrevenants.
2-2-3- Gestion des déchets solides au niveau des
institutions et des places publiques
La gestion des déchets diffère d'une institution
à une autre. Généralement, les établissements
scolaires disposent d'un tas d'ordures ou d'un trou dans lequel les ordures
sont jetées. Dans la majorité des cas, ces ordures sont
brûlées.
L'enlèvement des ordures dans le marché de la
ville de Lokossa se fait quant à elle par la mairie. En ce qui concerne
la gare routière, `'c'est l'agent d'entretien qui balaie le parc tous
les soirs'' et l'observation des lieux révèle que cette gare
présente des poches de saleté et les caniveaux (à ciel
ouvert) qui l'entourent sont remplis de déchets solides.
A l'exception de quelques entreprises qui se sont
abonnées aux structures de pré-collecte des ordures, le stockage
des ordures est fait dans des sachets plastiques ou jetées dans la
brousse par la grande majorité des bars/restaurants.
Les voies pavées et la place de l'indépendance
sont mises au propre par des groupements de femmes ayant un contrat avec la
mairie, de sorte qu'ils présentent un état plus ou moins salubre.
Au niveau des formations sanitaires, les déchets
solides produits sont récupérés à l'aide de
poubelles de couleur souvent noire disposées au niveau de chaque
division. Les poubelles, une fois remplies, sont vidées de leur contenu
dans des fosses de fortune ou aux alentours immédiats. Dans les deux
grandes formations sanitaires publiques de Lokossa Centre (CHD et Hôpital
de zone), la gestion de l'enlèvement des DSM est confiée aux
structures de collecte des ordures ménagères.
La gestion de des déchets biomédicaux concerne
la collecte séparative des différents types de déchets
biomédicaux dans des récipients adaptés à chaque
catégorie ainsi que leur destruction impérative et
sécurisée. Les dispositifs prévus pour la collecte
séparée des DBM existent au niveau des formations sanitaires
visitées mais les déchets biomédicaux (DBM) ne sont pas
détruits selon les normes. Une bonne partie de ces déchets est
tout simplement brûlée dans des fosses à ciel ouvert.
Pour éviter le mélange entre les
différentes catégories de DBM, le décret portant gestion
rationnelle des déchets biomédicaux en République du
Bénin a prévu en son article 18 une identification des poubelles
par leur couleur ou par leur étiquette visible selon le code de l'OMS.
Ces couleurs sont rarement utilisées ; c'est le cas du CHD
où les déchets infectieux qui doivent être collectés
dans les poubelles de couleur rouge sont plutôt
récupérés dans les poubelles de couleur verte. Les
poubelles de couleurs recommandées existent mais non adaptées
à la pratique selon certains membres du personnel médical. Ces
poubelles sont simplement rangées au magasin car n'étant pas
résistantes. De plus, le tri à la source souhaité n'est
pas toujours respecté ce qui fait que les non putrescibles (flacons) et
les objets tranchants se retrouvent ensemble (photo 4).

Photo 4 : DBM
incinérés sans tri (présence de flacons non
éliminés dans la cendre)
Prise de vue : Mairie
Lokossa, avril 2010
La photo montre la présence de reste de déchets
bio médicaux surtout de reste de flacons non éliminés
dans la cendre après incinération. Cela est dû à
l'état de l'incinérateur du CHD qui est dans un état de
délabrement avancé (cheminée défaillante ainsi que
les portes). Dans les autres formations périphériques, les
déchets liquides (liquides anatomiques) sont tout simplement enfouis
dans des fosses sans aucune mesure particulière de
sécurité. Quant aux déchets piquants, ils sont
entreposés dans des boîtes de sécurité et
acheminés vers le CHD ou l'Hôpital de zone.
Au niveau des centres de santé privés, à
l'exception de la clinique Padre Pio qui a déclaré envoyer ces
DBM à l'hôpital de zone pour incinération, aucun dispositif
normal n'est mis en place pour assurer la bonne gestion des DBM ainsi que les
DSM.
2-2-4- Gestion des déchets industriels
Les industries textiles au sein de la ville de Lokossa, sont
essentiellement la SITEX et la CBT. Des sources concordantes (populations
riveraines, service technique de la mairie), font état d'une
évacuation non règlementée des déchets liquides
industriels issus de ces usines. Des enquêtes, il ressort qu'ils sont
tout simplement rejetés dans la nature, dans les environs, avec pour
corollaire tous les désagréments que cela pourrait causer aux
populations riveraines en terme de pollution de l'eau de la nappe
phréatique par infiltration dans le sol.
2-2-5- Gestion des eaux pluviales
Dans la ville de Lokossa, la gestion des eaux pluviales est
confrontée à deux contraintes majeures à savoir : les
inondations et l'érosion du sol.
La figure 3 présente les équipements voirie et
ouvrage d'assainissement de la ville de Lokossa.

Figure 3 : Equipements, voirie et
assainissement de la ville de Lokossa
On remarque sur cette figure que le réseau de
collecteur dans la ville de Lokossa ne couvre pas toute la ville.
Les eaux usées et pluviales ne sont pas drainées
par absence de systèmes d'évacuation approprié. Les drains
et rigoles existant sont le lieu de dépôt d'ordures
ménagères. Ainsi, ces eaux s'évacuent de façon
anarchique le long des voies de dessertes et des rues accentuant
l'érosion des voies (Diabagaté, 2007).
Pour palier un tant soit peu à cette situation, des
travaux de pavage ont été réalisés au niveau du
réseau urbain structurant de la commune, essentiellement sur financement
du gouvernement par le Programme d'Investissement Public (PIP).Cependant, aucun
plan directeur d'évacuation des eaux pluviales n'existe pour la ville de
Lokossa.
CHAPITRE III : RISQUES SANITAIRES LIES AUX
PROBLEMES D'ASSAINISSEMENT DANS LA VILLE DE LOKOSSA
Ce chapitre dresse les principaux déterminants de la
santé, fait la classification des maladies liées aux
problèmes d'assainissement, évalue les risques sanitaires
liés aux problèmes d'assainissement. Ensuite il présente
la perception des populations sur les problèmes d'assainissement et la
capacité organisationnelle des acteurs.
3-1- Principaux déterminants de la
santé
Une politique de santé doit s'appuyer sur des preuves
scientifiques claires. À cet égard, la question des
déterminants sociaux est sans doute la plus complexe de toutes,
puisqu'elle concerne les conditions de vie des populations, ainsi que leur mode
de vie. Aujourd'hui, le réel impact des déterminants de la
santé est connu : l'absence de relations sociales, les mauvaises
conditions de vie, de travail, le chômage, la qualité de l'air,
... (Wilkinson et Marmot, 2004) sont reconnus comme ayant un réel impact
sur la santé. Disposer d'un environnement social favorable avec de
bonnes relations interpersonnelles à des effets positifs sur la
santé (Berkman et al 2000). Il faut aussi porter attention aux
déterminants liés à l'environnement physique tels que la
qualité de l'habitat, l'accessibilité aux espaces verts et aux
transports en commun, ....
Si les soins médicaux peuvent prolonger la vie et
améliorer le pronostic en cas de maladie grave, le contexte social et
environnemental qui inclue l'assainissement est un facteur qui s'avère
plus important pour la santé de la population dans son ensemble. Il
représente l'une des principales causes de maladies. La figure 4
présente les déterminants de la santé.

Figure 4 : Principaux
déterminants de santé (Dahlgren, 1995)
Dans la ville de Lokossa, les facteurs principaux
influençant la santé des populations sont les conditions
environnementales (à travers les problèmes d'assainissement),
socio économiques (à travers la capacité financière
des ménages à s'abonner aux ONG de collecte d'ordure
ménagère, à avoir accès à l'eau potable,
à disposer d'infrastructures d'assainissement), les conditions de vie
et les facteurs individuels de mode de vie.
Les conditions de vie du ménage regroupent un certain
nombre de biens dont dispose le ménage dans son unité
d'habitation et qui leur permet de satisfaire des besoins vitaux comme
l'approvisionnement en eau, les toilettes, les moyens
énergétiques, les moyens audiovisuels, les moyens de
déplacement, l'évacuation des ordures et eaux usées,
etc.(Enquêtes sur les migrations en milieu urbain, 2000).
L'attention se porte ici alors sur les facteurs
environnementaux et les conditions de vie des ménages. Les conditions
de vie observées dans les quartiers de ville de Lokossa (environnement
insalubre, inefficacité des systèmes de gestion des
déchets solides et ménagers) et les analyses des eaux de puits
effectués dans la ville de Lokossa démontrent l'impact saisissant
qu'ont ces facteurs environnementaux sur la bonne santé des populations
de la ville.
3-2- Eau, assainissement et santé des
populations de la ville de Lokossa
La maîtrise de l'eau est loin d'être une
réalité dans la commune de Lokossa. La fourniture d'eau potable
dans la ville de Lokossa se fait par la SONEB. La figure 5 illustre
l'évolution du nombre d'abonnés au réseau de la SONEB dans
la ville de Lokossa.

Figure 5 : Evolution du nombre de
ménages abonnés à la SONEB
Le nombre de ménages abonnés à la SONEB a
progressé avec un taux d'accroissement moyen de 2,8% entre 2005 et 2009.
Cependant ce chiffre représente juste 1/3 du nombre de ménages de
la ville. Une bonne partie des ménages non abonnés utilisent les
sources d'eau alternatives et principalement les eaux de puits.
L'enquête ménage réalisé a permis
d'identifier les différents usages faits de l'eau de la Soneb et des
eaux de puits dans la ville de Lokossa. Le tableau II présente les
différentes sources d'eau utilisées pour la consommation dans les
ménages
Tableau II : Sources d'eau
utilisées pour la consommation dans les ménages
|
Sources d'approvisionnement en eau
|
Total ménages enquêtés
|
|
SONEB
|
Puits
|
SONEB et Puits
|
|
Boisson
|
60 (31 %)
|
90 (46 %)
|
45 (23 %)
|
195 (100 %)
|
|
Cuisine
|
25 (20 %)
|
136 (62 %)
|
34(18 %)
|
195 (100 %)
|
Source : Travaux de
terrain, 2010
De l'analyse de ce tableau, il ressort que 31 % des
ménages enquêtés utilisent uniquement l'eau de la SONEB
pour la boisson, 46 % uniquement l'eau de puits et 23 % les deux sources d'eau
(eau de la SONEB et eau de puits) compte tenu des difficultés
d'approvisionnement. Cependant, pour la cuisine, 20 % des ménages
enquêtés utilisent l'eau de la SONEB contre 62 % pour l'eau de
puits et 18 % pour les ménages qui alternent l'utilisation des deux
sources d'eau.
Le tableau III présente quant à lui la
quantité de coliformes fécaux observée dans les eaux de
puits suite à des analyses effectuées dans seize (16)
ménages de la ville de Lokossa.
Tableau III : Quantités de
coliformes fécaux dans les puits échantillonnés
|
Germes
|
Quantité
|
Nombre de puits
|
Qualité de l'eau
|
|
Coliformes fécaux
|
1 à 10
|
05
|
Raisonnable
|
|
10 à 100
|
11
|
Suspecte
|
Source : Enquête de
terrain, 2012
L'observation des résultats issus de ces analyses
montre une forte présence de coliformes fécaux dans quinze (15)
échantillons d'eaux de puits avec des quantités de 82 UFC/ 100 ml
d'eau. Entre 1 à 10 UFC/ 100ml d'eau, l'eau est considéré
de qualité raisonnable. Aux delà, l'eau doit être
traitée car suspecte.
La présence de coliformes fécaux dans l'eau d'un
puits met en évidence une pollution d'origine fécale, humaine ou
animale, et la présence possible de pathogènes entériques.
La consommation des eaux de ces puits constitue donc un risque pour la
santé des populations. Les déterminants de la qualité des
eaux de puits dans la ville de Lokossa sont présentés dans
la figure 6.
|
Recueil Transport Stockage Manipulation de l'eau
pour consommation
|
|
Paramètres biologiques
|
|
Dépotoirs sauvages des ordures
|
|
|
|
|
|
|
|
Qualité de l'eau des puits
|
|
|
|
Paramètres physiques
|
|
|
|
Paramètres chimiques
|
Figure 6 : Déterminants de la
qualité de l'eau dans la ville de Lokossa
Source : MAKOUTODE, 1999
Cette figure indique les relations entre la qualité de
l'eau des puits (variable dépendante) et les déterminants
(variables indépendantes) qui influencent cette dernière dans la
ville de Lokossa. Les facteurs qui influencent la qualité biologique des
eaux de puits dans la ville de Lokossa sont essentiellement la mauvaise gestion
des déchets solides et liquides ménagers associée aux
paramètres physiques du milieu (qualité du sol,
inondation,...).
La précarité de l'accès à l'eau
potable reste un facteur déterminant pour la santé dans la ville
de Lokossa. Celle-ci constitue une menace pour la santé des populations
et ajoute une pression supplémentaire aux systèmes de
santé publique déjà fragiles. L'eau étant
considérée comme vecteurs de transmission, plusieurs maladies
sont répertoriées comme pathologies liées à l'eau
(tableau IV).
Tableau IV : Principales maladies
liées à l'eau selon l'OMS (1996)
|
Maladies
|
Cause et voie de transmission
|
|
Dysenterie amibienne ou bacillaire
|
Les protozoaires ou bactéries suivent la voie
fécale-orale par l'intermédiaire d'eau contaminée,
d'aliments, de contact de personne à personne.
|
|
Maladie diarrhéique
|
Des bactéries, virus et protozoaires divers suivent la
voie fécale-orale par l'intermédiaire d'eau contaminée,
d'aliments, de contact de personne à personne.
|
|
Choléra
|
Les bactéries suivent la voie fécale-orale par
l'intermédiaire d'eau contaminée, d'aliments, de contact de
personne à personne.
|
|
Hépatite A
|
Le virus suit la voie fécale-orale par
l'intermédiaire d'eau contaminée, d'aliments, de contact de
personne à personne.
|
|
Paratyphoïde et typhoïde
|
Les bactéries suivent la voie fécale-orale par
l'intermédiaire d'eau contaminée, d'aliments, de contact de
personne à personne.
|
|
Polio
|
Le virus suit la voie fécale-orale par
l'intermédiaire d'eau contaminée, d'aliments, de contact de
personne à personne.
|
|
Ascaridiase
|
Les oeufs fécondés sont transmis par les
fèces humaines. Les larves que contiennent les oeufs se
développent dans un sol chaud. Les humains ingèrent le sol que
contiennent les aliments. Les larves écloses pénètrent
dans la paroi intestinale, où elles parviennent à
maturité.
|
|
Draconculose (ver de
Guinée)
|
Le ver Dracunculus est ingéré par un
crustacé, le Cyclops. Quand des humains digèrent le Cyclops, les
larves du ver sont libérées dans l'estomac. Les larves
pénètrent dans la paroi intestinale, puis deviennent des vers qui
traversent les tissus. Au bout d'un an, le ver adulte atteint la surface de la
peau des extrémités inférieures. La femelle entre en
contact avec l'eau, puis décharge les larves dans l'eau.
|
|
Schistosomiase
(bilharzia)
|
Les oeufs du ver schistosome sont transportés par les
fèces humaines. Les oeufs éclosent au contact de l'eau,
libérant le parasite miracidium. Le parasite se loge dans un escargot
d'eau douce, dans lequel il se réplique. Il est libéré
dans l'eau, puis pénètre dans la peau de l'homme et, quelques
secondes après, dans les vaisseaux sanguins. Au bout de 30 à 45
jours, miracidium devient un ver, qui peut pondre de 200 à 2.000 oeufs
par jour pendant une moyenne de 5 ans.
|
|
Dengue
|
Le virus est prélevé par un moustique sur un humain
ou un animal infecté. Ledit virus incube pendant 8 à 12 jours et
se réplique. Quand le moustique prélève ensuite du sang,
il injecte alors le virus dans le sang d'un humain.
|
|
Filariose (y compris
éléphantiasis)
|
Les larves du ver sont ingérées par un moustique et
se développent. Quand le moustique infecté pique un humain, les
larves pénètrent dans la blessure et atteignent les ganglions
lymphatiques, où elles se reproduisent.
|
|
Paludisme
|
Les protozoaires se développent dans l'intestin d'un
moustique et sont transmis par sa salive chaque fois qu'il
prélève du sang. Les parasites sont alors transportés par
le sang jusqu'au foie de l'homme, qu'ils envahissent et où ils se
reproduisent.
|
Source : OMS, 1996
La recrudescence des maladies diarrhéiques et maladies
à transmission vectorielle dans la ville de Lokossa est la
résultante des problèmes d'assainissement observés dans
les ménages et des difficultés d'approvisionnement en eau potable
pour la consommation.
3-3-Identification des risques sanitaires liés
aux problèmes d'assainissement de la ville de Lokossa
3-3-1-Principales maladies liées aux
problèmes d'assainissement
Les habitudes acquises, les moyens financiers limités
des populations à construire des latrines amènent les habitants
à déféquer dans la nature. La présence d'eau
permanente, les fosses septiques et les puisards mal façonnés ou
défectueux, les mauvaises conditions d'hygiène favorisent la
prolifération des gîtes larvaires causant d'énormes
problèmes de santé dont les plus importants sont : le paludisme,
les affections intestinales et gastroentérites.
La figure 7 présente l'évolution des cas de
paludisme et des affections intestinales et gastroentérites sur
l'année 2010 dans la ville de Lokossa.
PIGE : Parasitoses Intestinales et
Gastro-Entérites

Figure 7 : Proportion des
différentes affections
A la lecture de cette figure, on constate que le paludisme est
la maladie la plus fréquente. Sur un total de 100 consultations pour des
maladies liées à l'eau, l'on détecte environ 75 cas de
paludisme.
Quant aux parasitoses intestinales et gastro-entérites
le taux est de 21 % des cas de consultation. Toutes les catégories de
maladies autres que le paludisme et les parasitoses intestinales et
gastro-entérites représente 4 % des cas de consultation.
La situation de l'assainissement reste donc inquiétante
dans la ville. Il apparaît en revanche que les populations ont une claire
conscience des dangers qui les guettent. En effet, sur 100 ménages
enquêtés, 95 ménages associent clairement d'une part ces
maladies et l'insalubrité du cadre de vie et d'autre part, la
dégradation du cadre de vie et le défaut d'ouvrages
d'assainissement. En plus ces maladies empêchent une frange importante
active de travailler.
La ville de Lokossa est dotée d'un Centre Hospitalier
Départemental (CHD) et elle dispose en outre d'un Centre Communal de
Santé. Toutefois, l'on note une floraison de centres de santé
privés due parfois à l'éloignement des formations
publiques de santé, et dont les modalités d'installation de
même que les conditions hygiéniques sont relativement
douteuses.
3-3-2- Connaissances, attitudes et perception des
populations sur les problèmes d'assainissement et de santé
L'analyse des données obtenues dans le cadre des
pratiques d'hygiène, connaissances et perceptions des communautés
révèle que les raisons majeures ayant amené certains
ménages à construire des latrines sont, entre autres :
-la conviction que la défécation à l'air
libre constitue une pollution de l'environnement ;
-la volonté d'assainir leur milieu de vie ;
-la pression de l'urbanisation et la nécessité
de l'occupation de l'espace ;
-l'opportunité de l'appui technique et financier de
certains projets de développement (ONG internationales, etc.).
Parmi ceux qui n'ont pas de latrines, c'est surtout les moyens
financiers et la disponibilité de la brousse qui sont
évoqués comme facteurs limitant. Cependant, presque tous ces
ménages (99 %) reconnaissent l'utilité et la
nécessité de disposer d'une latrine. Mieux, 98 % des
ménages ont estimé que l'on peut prévenir certaines
maladies en construisant des latrines, ce qui suppose une certaine prise de
conscience de la portée hygiénique des latrines familiales.
Loin d'être une norme sociale, la pratique de la
défécation dans la brousse à Lokossa répond
plutôt à une demande sociale qui n'exprime pas forcément
les aspirations des ménages en matière d'hygiène et
d'assainissement. Compte tenu du niveau de prospérité des
ménages dans l'agglomération urbaine, et du fait qu'il y a eu des
interventions subventionnées antérieures, les acteurs sociaux ne
disposant pas de latrines, sont plutôt dans une situation d'attentisme,
espérant de la commune de Lokossa un quelconque appui (don en nature,
appui financier, recherche de partenaires, etc.) pour une dotation en latrines
familiales.
Une certaine conscientisation au niveau des populations de
Lokossa, de la logique selon laquelle `'un milieu sain est un facteur
probant de bien-être des ménages'' existe. En effet, 97 %
des ménages enquêtés pensent qu'une mauvaise gestion des
ordures ménagères peut être source de maladies.
Paradoxalement à cela, les résultats révèlent une
mauvaise gestion des ordures ménagères et l'inobservation de
règles d'hygiène. Cela porterait à croire qu'un
système coercitif de contrôle formel pour contraindre les
ménages à adopter des mesures d'hygiène serait
nécessaire.
CHAPITRE IV : CADRE INSTITUTIONNEL, MESURES ET
PERSPECTIVE
Ce dernier chapitre présente le cadre institutionnel
et les mesures et perceptives pour l'assainissement de la ville de Lokossa.
4-1-Cadre institutionnel de l'assainissement
4-1-1-Cadre institutionnel au Bénin
Le cadre institutionnel ici fait beaucoup plus
référence aux mandats des différentes institutions et
acteurs opérationnels impliqués dans la gestion des
déchets et dans l'assainissement urbain. Ces mandats sont plus
développés dans le Décret 2003-332 portant gestion des
déchets en République du Bénin.
-Gouvernement
Au terme du Décret qui vient d'être cité,
le Gouvernement :
- réglemente les modalités et les techniques de
gestion des déchets,
- impose la gestion des déchets, résultant de la
mise sur le marché de biens, de matières premières ou de
produits, au responsable de leur production, de leur importation ou de leur
commercialisation,
- interdit la détention des déchets
au-delà d'un terme ou d'une quantité déterminée,
- autorise le recours à l'expropriation pour cause
d'utilité publique, des biens immeubles nécessaires à
l'implantation d'installations de gestion de déchets ou à la
remise en état de sites.
-Ministère de l'Environnement et de la
Protection de la Nature
Créé par le Décret 2006-460 du 7
septembre 2006, le Ministère de l'Environnement et de la Protection de
la Nature (MEPN) est chargé entre autres de définir et de mettre
en oeuvre la politique de l'Etat en matière d'environnement et de la
protection de la nature. Il tient les rôles de promotion d'un meilleur
cadre de vie, tant au milieu urbain que rural. D'après les dispositions
du Décret n°2003-332 portant gestion des déchets en
République du Bénin, il est chargé de :
- promouvoir la recherche, le développement et
l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles,
- réglementer la production de déchets,
notamment par la fixation d'objectifs
quantitatifs ou par toute disposition visant à
favoriser l'utilisation des déchets
comme matières premières d'un processus de
consommation déterminé,
- imposer aux entreprises la réalisation de plans
pluriannuels de prévention, le secteur de l'assainissement étant
l'une des prérogatives du MEPN.
-Agence Béninoise pour l'Environnement
Créée par décret 95-47 du 20
février 1995 et placée sous la tutelle du Ministère
chargé de l'Environnement, elle est chargée de mettre en oeuvre
(avec toutes les institutions nationales compétentes) la politique
nationale en matière d'environnement. Elle veille à
l'intégration de l'environnement dans les programmes, les plans et les
projets en vue d'un développement durable au Bénin. C'est une
institution d'exécution technique de la politique de la
législation environnementale ou plus précisément de la
réalisation des programmes et de la réglementation nationale ou
départementale élaborée par la Direction de
l'Environnement.
-Ministère de la Santé
Le Ministère de la Santé est chargé de la
mise en oeuvre des récents changements de politique pour une
amélioration des services d'assainissement. La politique du Bénin
en matière d'assainissement, préparée conjointement par
les Ministères de la Santé et de l'Environnement, porte sur les
lignes directrices de la stratégie à mettre en oeuvre.
Au niveau du processus de développement des composantes
de politiques relatives tant à la gestion et à
l'élimination des déchets qu'au niveau de l'hygiène du
milieu, le degré d'implication du Ministère de la santé
est important. Selon les attributions qui lui reviennent à travers le
Décret portant son organisation et son fonctionnement, le
Ministère de la Santé, par l'entremise de sa direction de
l'Hygiène et de l'Assainissement de base et de ses directions
départementales, est impliqué dans les travaux d'assainissement
de base, la promotion des technologies d'assainissement à faible
coût et l'éducation en matière d'hygiène du
milieu.
-Ministère de la Décentralisation, de la
Gouvernance Locale de l'Administration et de l'Aménagement du
Territoire
C'est ce Ministère qui assure l'administration des
circonscriptions et la tutelle des collectivités territoriales, dont il
garantit le fonctionnement normal. Par rapport à la
décentralisation et aux dispositions contenues dans le Décret
n° 2003-333, cité plus haut, cette attribution révèle
un intérêt particulier. Les collectivités territoriales
sont désormais chargées de l'observation et de
l'évaluation permanente de la satisfaction des besoins des populations.
Elles apportent à terme, à travers l'action de leurs services
techniques, une assistance aux communautés, aux ONG et aux associations
d'usagers en matière d'amélioration de l'environnement urbain et
de la gestion des déchets.
-Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat de la
Réforme Foncière et de la
Lutte contre l'Erosion
côtière
Il intervient dans l'assainissement par sa Direction de
l'Urbanisme et de l'Assainissement. Cette Direction réalise des travaux
de voirie et intervient auprès des communes dans le cadre de la
destruction des dépotoirs sauvages d'ordures. A côté de ces
structures ministérielles, nous avons deux sociétés qui
interviennent dans le secteur de l'environnement.
-Agence d'Exécution des Travaux Urbains (AGETUR
SA)
Régie au départ par la loi de 1901 sur les
associations, l'AGETUR est aujourd'hui une société anonyme. Elle
assure, pour le compte de l'Etat, des communes et des partenaires au
développement etc., la maîtrise d'ouvrage
délégué des travaux d'infrastructure pouvant inclure la
construction et la gestion de décharges contrôlées des
déchets.
-Société d'Etudes Régionales de
l'Habitat et de l'Aménagement Urbain (SERHAU-SA)
La SERHAU-SA est une société anonyme avec
conseil d'administration. Elle assure les diverses missions ci-dessous :
- fournir des prestations d'assistance, de conseil et
d'études dans le domaine du
développement urbain, de la gestion des services
urbains et de l'habitat,
- recevoir mandat ou délégation de maître
d'ouvrages publics (Etat et collectivités locales) pour faire
exécuter par des tiers toutes fournitures de biens, de services ou de
prestations d'études. En recevant mandat ou délégation de
maître d'ouvrages publics, la SERHAU a réalisé plusieurs
types d'études incluant notamment la gestion des déchets pour le
compte de l'Etat ou des collectivités locales (municipalités et
communes).
-Autres organes institutionnels du secteur
En dehors des départements ministériels,
d'autres institutions tiennent des rôles non négligeables dans le
développement du secteur de l'assainissement et de la gestion des
déchets au Bénin. Ces institutions sont :
- les communes, qui ; au terme du chapitre III de la Loi
n°97-029 du 15 janvier
1999, disposent des compétences entre autres en
matière d'environnement, d'hygiène et de salubrité. Au
sein des communes, c'est le service technique
qui se voit confier la gestion des déchets,
- les Organisations Non Gouvernementales (ONG) :
organisées en Collectif
National des ONG de Gestion de l'Environnement et de
l'Assainissement (CONOGEDA), elles contribuent à l'assainissement des
habitats par la pré collecte, la collecte et la valorisation des
déchets solides,
- Les Entreprises privées qui assurent le transport des
déchets et la gestion des
décharges contrôlées.
- Les partenaires techniques et financiers qui apportent une
assistance technique et financière aux acteurs nationaux à
travers la mise en oeuvre des projets et des
recherches.
Bref, ces institutions de l'Etat et les structures locales ont
des fonctions de définition des politiques, des orientations, de
planification, de contrôle et de suivi des programmes et projets relatifs
à la gestion des déchets en général.
4-1-2-Capacités organisationnelle et
institutionnelle des acteurs dans la ville de Lokossa
4-1-2-1- Structures de collecte d'ordures
ménagères
Du point de vue rentabilité, la redevance mensuelle que
paient les abonnés varie de 500 F CFA à 1.000 F CFA. Selon les
structures de collecte d'ordures ménagères, le taux de
recouvrement est de l'ordre de 70 % chez les ménages abonnés. Au
niveau structurel, on note la vétusté des charrettes et la
quasi-inexistence d'équipements de protection pour les charretiers.
S'agissant de la collaboration avec la mairie, elle se résume uniquement
au suivi des activités, les structures de pré-collecte n'ont pas
d'obligation contractuelle avec l'administration communale.
4-1-2-2- Groupement de femmes balayeuses
Dans la ville, les groupements de femmes sont en partenariat
avec la Mairie avec des contrats dont les montants varient entre 6.000 et
70.000 F CFA par mois.
Ces groupements en plus d'être intéressés
par la Mairie, bénéficient de lots d'équipements
octroyés par la Mairie et leurs activités sur le terrain sont
planifiées et suivies.
Cependant, on peut noter une démotivation des membres
de certains groupements liés à l'incivisme des populations et
à l'inactivité de la Mairie face au rejet quotidien des ordures
ménagères et des eaux usées dans des espaces publics mis
au propre par eux.
4-1-2-3- Artisans maçons
Par le biais de la Mairie, des maçons ont
été formés par le PADEAR/GTZ en 2007 sur les modes de
construction de différents types de latrines (VIP, mozambique, dalle San
Plat, etc.) et équipés en matériels nécessaires
à la réalisation des latrines (truelles, moules, mètres,
etc.). Des sessions de renforcement de capacité ont été
faites par d'autres structures telles que Protos et SNV, etc. Ces artisans
formés développent des contacts avec les agents d'hygiène,
les relais communautaires et des élus locaux ; cependant ils
estiment être sous utilisés et que le marché de
réalisation de latrines est peu dynamique.
4-1-2-4-Appui des services déconcentrés
et des partenaires techniques et financiers
Le SHAB, le SEau, la DDHU sont disponibles pour fournir des
conseils aux acteurs de l'administration de Lokossa en leur qualité de
maîtres d'ouvrage, assumer leur fonction régalienne de
vérification de la conformité des interventions avec la
stratégie nationale et de suivi du secteur. Cependant, aucune relation
particulière ou de complicité quelconque n'est
développée.
Quant aux partenaires techniques et financiers, plusieurs sont
actifs dans la commune de Lokossa, notamment la GIZ, l'ONG Belge Protos, la SNV
Bénin, Plan Bénin.... Ils contribuent dans ce sens à la
construction d'infrastructures d'assainissement et d'approvisionnement en eau
potable, à l'appui dans la gestion de ces ouvrages.
4-1-2-5- Exercice de la compétence communale
Dans la commune de Lokossa, l'exercice de la compétence
communale en matière d'assainissement est assumé de deux
manières: l'amélioration du cadre institutionnel local et la
création de services techniques accompagnée de l'affectation des
ressources y afférentes.
Les changements intervenus sur le cadre institutionnel local
portent essentiellement sur la prise d'arrêtés communaux sur
l'hygiène et l'assainissement. Un premier arrêté portant
autorisation d'institution de construction de latrines familiales dans la ville
de Lokossa a été pris sous n°96/ 017/CC-L en date du 29
janvier 2010 (DST Mairie Lokossa, 2010). Il est venu institutionnaliser
l'obligation pour chaque concession de disposer d'au moins une latrine. Cet
engagement a été encore confirmé par la prise d'un autre
arrêté communal trois mois plus tard, cette fois-ci sous le
n°96/025/CC-L et portant autorisation de la mise en place d'un fonds pour
la réalisation de latrines dans les ménages de la ville de
Lokossa en date du 30 mars 2010 (DST Mairie de Lokossa, 2010).
4-2- Mesures d'assainissement à promouvoir dans
la ville de Lokossa
En premier lieu, il faut rappeler qu'il s'agit de faire
évoluer ou changer des comportements relatifs au propre et au sale.
Aussi, toute politique visant à modifier les comportements doit
s'inscrire dans le long terme. Par ailleurs, toute modification d'habitude
aussi construit suppose que les populations comprennent les raisons et mesurent
l'intérêt du changement proposé. A ce titre, les campagnes
d'IEC (Information Education et Communication) ont montré leurs limites.
Les promoteurs des campagnes de sensibilisation l'ont compris puisque,
aujourd'hui, ils s'adressent préférentiellement à deux
publics cibles :
- les femmes qui, en tant que mères ou futures
mères, peuvent transmettre à leurs enfants de nouvelles
pratiques,
- les enfants scolarisés prêts à
acquérir et à intégrer des connaissances nouvelles
Par le biais de l'école.
4-2-1-Mesures concernant les déchets
ménagers
L'enfouissement des déchets reste la solution la plus
abordable pour des populations dépourvues de moyens techniques et
financiers. Il est assez courant que les déchets ménagers soient
utilisés pour fumer les jardins. Cette pratique peut être
maintenue sous réserve de leur enfouissement dès leur
dépôt sur le jardin. L'incinération, autre technique
simple, dépend de la nature des déchets et de la climatologie
locale.
Un site unique de dépôt peut être
envisagé avec un traitement sommaire des déchets
déposés soit par un recouvrement périodique, soit par une
incinération
entretenue en permanence. Sa localisation doit être
soigneusement choisie pour éviter la pollution de l'environnement.
La distance aux habitations doit aussi prise en compte.
Il va de soi que des solutions plus performantes sont à
utiliser, dès que la commune dispose de moyens plus
conséquents.
4-2-2-Mesures concernant la gestion des excrétas
L'amélioration des latrines existantes est une autre
piste à suivre. L'effet d'exemple des latrines améliorées
(en particulier à fosse ventilée) installées dans les
bâtiments publics, tout particulièrement les écoles, est
certain. Plus que le discours de santé et d'hygiène, c'est
souvent l'argument de confort (intimité, suppression des odeurs et des
mouches) qui déclenche la volonté de changement et les
investissements d'amélioration. Le tableau suivant présente les
types de latrines à promouvoir.
|
Caractéristiques de la zone
|
Type de technologies d'assainissement
|
Caractéristiques de la technologie
|
Coût de la technologie
|
Avantages
|
Inconvénients
|
|
Localités de terres de barres avec des nappes profondes
à très profondes (supérieures > 10 m)
|
Tous les types d'ouvrages d'assainissement,
Priorité : latrines de type Mozambique ou de type
CREPA
|
Latrines VIP de type circulaire;
Dalle reposant sur un soubassement en maçonnerie de 80 cm
de profondeur
Profondeur minimale de l'ouvrage : 4m
Superstructure en matériaux locaux ou définitifs
|
48 000 à 50 000 FCFA (profondeur minimale de 4 m
avec superstructure paille ou claies)
|
Moindre coût et à la portée des revenus des
populations ;
Très peu de technicité pour la
réalisation
|
Latrine non durable : Si le trou est rempli, on le ferme et
on creuse un autre mais la dalle est récupérable
|
|
Localité à sols indurés, difficiles à
creuser ou en zones à terre hydromorphe
|
Latrines d'assainissement écologique (ECOSAN)
|
Ouvrages à double fosses par cabine avec cheminée
de ventilation
Profondeur : 0, 75 m
Séparation de l'urine des fèces
Plaques chauffantes à l'arrière
|
Coût moyen 300 000 FCFA (matériaux
définitifs) ;
|
Vidange manuelle ; réutilisation agricole des
excréta hygiénisés comme fertilisants)
Ouvrage durable ;
|
Obligation de pose de la toiture ;
Jet de cendre ou de sciure dans la fosse à chaque
visite ;
Une forte technicité dans sa réalisation
|
|
Toilettes modernes à fosse septique
|
Fosse décalée par rapport à la
superstructure;
Chasse manuelle avec de quantité d'eau;
Fosses à deux ou trois compartiments débouchant
sur un puits d'infiltration
|
550 000 FCFA (matériaux définitifs)
|
Ouvrage à longue durée de vie du fait de la
digestion et de la décantation de la boue avant le rejet du
surnageant dans un puits d'infiltration;
|
Disponibilité de l'eau
Cuvette peu économique
Coût récurrent de vidange
Société de vidange n'existe pas dans la ville
Une forte technicité dans sa réalisation
|
Tableau V : Types de latrines à
promouvoir
Source : Enquête de
terrain, 2010
Si l'on tient compte des coûts, c'est surtout les
latrines de types Mozambique ou CREPA qui sont les plus accessibles
financièrement cependant elles sont quasi inexistantes dans la ville de
Lokossa et semble plus adaptées au milieu rural. Il en est de même
pour les latrines ECOSAN. Celles adaptées au besoin de modernité
et de confort de la ville sont les toilettes modernes à fosses septique
qui sont très couteuses et nécessite une forte consommation
d'eau. Mais du point de vue environnemental, ces trois types de latrine sont
recommandés.
4-2-3-Mesures d'accès à l'eau potable et
protection de la ressource
Il faut continuer les programmes d'accès à l'eau
potable et les accompagner de campagnes de sensibilisation sur la mise à
disposition et la protection de la ressource : mode de stockage et de
prélèvement de l'eau à domicile, aménagement des
points d'eau et maintien de leur propreté, gestion de la ressource et
des eaux usées...
Là aussi, ces « bonnes pratiques » peuvent
s'apprendre à l'école autour de la gestion du point d'eau
installé.
4-2-4-Pratiques d'hygiène
Les messages d'hygiène n'ont de chance d'être
intégrés dans de nouvelles pratiques que s'ils sont
répétés régulièrement. Des
évaluations à périodicité fixe sont à
conduire pour connaître leur impact. On insistera sur le lavage des
corps, celui du visage des enfants, le lavage des mains après
défécation ou tout contact avec des selles et avant la prise des
repas, la propreté de l'habitat, des ustensiles de cuisine et des
vêtements. On insistera sur l'enfouissement des selles, en particulier
celles des bébés et des enfants qui n'utilisent pas les latrines
ou qui ne se rendent pas sur l'aire de défécation.
CONCLUSION ET SUGGESTIONS
L'amélioration des conditions de vie en milieu urbain
est l'une des conditions sine qua non pour approcher le développement
durable. Autrement dit, l'homme doit être placé au centre du
développement. De ce point de vue la santé, qui se situe en amont
et en aval de la recherche de solution pour le mieux être, doit
être la chose la mieux partagée.
L'étude sur l'assainissement et la santé dans
les villes moyennes du Bénin, a permis de se rendre compte que la
santé de milliers d'hommes est souvent menacée par le mauvais
entretien de leur cadre de vie. Elle a en effet permis dans le cadre
spécifique de la ville de Lokossa d'apprécier l'état
d'insalubrité dans lequel vivent quotidiennement les populations, le
mode de gestions des déchets solides et liquides. Et le constat est que
le taux de couverture en latrine de la ville est de 28 % et d'une façon
générale, 71 % des ménages de la ville utilisent ces
latrines d'où un fort taux de pression. De plus, seulement 4 % des
ordures ménagères sont collectés par la voirie, le reste
est jeté aux abords des concessions et dans les lieux publics. Les
conséquences qui en résultent sur le plan sanitaire sont non
négligeables avec près de 75 % de cas de paludisme sur les
pathologies hospitalisées à l'Hôpital de Zone en 2010.
Il en est ressorti que l'environnement urbain se
dégrade avec l'augmentation de la population qui induit une extension
non souvent maîtrisée de la ville. La conséquence de cette
dégradation se manifeste par la mauvaise gestion des ordures, des eaux
usées, des excréta; lesquels deviennent les principaux facteurs
de pollution de l'environnement et par ricochet entame cruellement la
santé des populations par la pollution des sources d'eau, la
multiplication des germes parasitaires et pathogènes.
Les ménages enquêtés sont conscients de
l'ampleur des conséquences sur l'environnement, la santé et le
cadre de vie due à la mauvaise gestion et au non traitement des eaux
usées. Les solutions préconisées vont des fosses septiques
modernes aux stations d'épuration des eaux usées par voie
naturelle.
Cependant, le choix du meilleur système de gestion des
eaux usées passe par la connaissance des paramètres
socioculturels, économiques et environnementaux dans lequel il sera
installé. La participation des ménages, principaux
bénéficiaires, est une nécessité.
L'étude a permis de relever leur volonté
réelle à adhérer et à contribuer
financièrement, matériellement, en main d'oeuvre à la mise
en place de nouveaux systèmes plus performants. La capitalisation des
ressources humaines, matérielles et financières endogènes
est donc possible à condition que :
-des campagnes de sensibilisation, d'information et de
formation des ménages en matière d'hygiène et de risques
sanitaires dues aux eaux usées soient effectuées ; on pourrait
mettre à contribution des canaux tels que la télévision,
les radios, les écoles, etc.,... ;
-l'implication des ménages dans tout le processus de
mise en oeuvre des projets d'assainissement du cadre de vie, depuis la phase de
réflexion jusqu'à l'exécution;
-la prise en compte de leurs avis sous forme d'organisation de
la gestion des systèmes envisagés dans la ville afin d'en assurer
l'efficacité et la pérennité des systèmes.
Perspective pour la thèse
Thème : Gestion territoriale des
déchets ménagers urbains au Bénin : étude des
cas des villes de Lokossa et de Cotonou
Depuis maintenant plusieurs années, la gestion des
déchets ménagers doit faire face à des difficultés
liées à l'implantation d'équipements de traitement qui
suscitent des conflits de manière systématique. De ce fait, la
dimension sociale est devenue le point d'achoppement de cette politique
publique longtemps appréhendée à travers des aspects
techniques (Rocher, 2006).
Cette situation se complique encore à cause de
l'urbanisation rapide et galopante que connaît le continent africain,
avec un taux de croissance démographique d'environ 5 % par an (Onibokun,
2001). Cette urbanisation incontrôlée, selon le rapport
d'activités du Relais pour le développement Urbain
Participé (RUP, 2003), pose des problèmes en ce qui concerne
l'assainissement et la salubrité qui, pour être
tous deux effectifs, nécessitent une bonne
gestion des déchets urbains.
L'insuffisance des services existants d'assainissement et une
forte poussée démographique résultent en une
dégradation environnementale et une menace réelle pour la
santé publique. Des services adéquats d'alimentation en eau et
d'assainissement environnemental sont une nécessité pour soutenir
la stabilité urbaine, favoriser l'équilibre social, la croissance
économique, le développement et l'amélioration des
services publics dans les centres urbains. Cependant, aux cours des
dernières décennies, l'approvisionnement en eau potable
était la priorité du moment. Aujourd'hui, 2.5 milliards de
personnes, soit environ 40 % de la population mondiale, vivent sans
installations sanitaires de base.
Le Bénin fait de nombreux efforts pour résorber
le problème, sans toutefois aboutir à des résultats
globalement satisfaisants. Le taux d'évacuation des déchets
solides ménagers pour tout le Bénin est de 17 % avec 39 % en
milieu urbain et 3 % en milieu rural (EMICOV, 2010).
Selon les résultats du troisième recensement
général de la population et de l'habitat, 78 % de la population
Cotonou rejetaient ses déchets dans la nature ou simplement au dehors de
la maison. La synthèse de plusieurs études concernant notamment
les métropoles urbaines, montre que la pré collecte est
assurée à moins de 50 %, la collecte à moins de 20 % et
l'élimination adéquate à moins de 1 % (Houndantodé,
2012).
Cependant, les modes de gestion des déchets solides
ménagers et des risques inhérents divergent d'une ville à
une autre. A ce sujet, plusieurs interrogations méritent d'être
posées et pour lesquelles les recherches futures tenteront d'apporter
des réponses.
Quelles sont les pratiques liées à la gestion
des DSM dans ces villes du Bénin?
Quelles sont les stratégies utilisées dans le
processus de collecte et de traitement des DSM dans ces villes du Bénin?
Quelle est la situation géographique des sites de
pré collecte et de collecte par rapport aux densités de
population?
Quelles sont les risques liés à ces gestions des
DSM?
Hypothèses de recherche
- De mauvaises pratiques et attitudes subsistent dans la
gestion des DSM dans les villes de Lokossa et de Cotonou.
- Les processus de collecte des DSM dans les villes de Lokossa
et de Cotonou présentent des failles.
- Les sites de décharges formels et informels sont
très proches des densités de population.
Objectif général
L'objectif global vise à étudier les
problèmes liés à la gestion territoriale des
déchets ménagers urbains dans les villes de Lokossa et de Cotonou
en mettant l'accent sur les risques qui y sont liés.
Objectifs spécifiques
- Analyser les représentations et pratiques populaires
concernant les déchets solides ménagers dans les villes de
Lokossa et de Cotonou.
- Etudier les stratégies utilisées dans la
collecte des DSM dans ces villes.
- Spatialiser les sites de pré collecte et de collecte
par rapport aux densités de population.
Approche méthodologique
La démarche méthodologique que nous allons
adopter sera en fonction de chaque objectif et comportera les étapes
suivantes : la recherche documentaire, les travaux de terrain, puis le
traitement et l'analyse des données.
- Méthode relative à l'objectif
1 : Analyser les représentations et pratiques populaires
concernant les déchets solides ménagers dans les villes de
Lokossa et de Cotonou.
ü Matériel
- Questionnaire et guide d'entretien ;
- Appareil photo numérique ;
- Grille d'observation.
Méthode de collecte
Enquête par questionnaire et par entretien. Elle
permettra d'identifier les habitudes socioculturelles des populations dans la
gestion des DSM.
Méthode de traitement
Le dépouillement des fiches d'enquête se fera de
façon manuelle. Toutes les données recueillies seront
encodées. Les diagrammes et courbes seront réalisés avec
le logiciel Excel, les tableaux avec le logiciel Word pour
représenter les données quantitatives. A partir de là, des
analyses seront faites.
- Méthode relative à l'objectif
2 : Etudier les stratégies utilisées dans la
collecte des DSM dans ces villes.
ü Matériel
- Fiches d'enquête et d'entretien ;
- Appareil photo numérique;
Méthode de collecte
- Enquête par questionnaire et par entretien. Elle
permettra d'une part, de mieux cerner les stratégies mises en place par
les autorités locales dans la gestion des DSM et d'autre part
d'évaluer leur fonctionnalité et leur efficacité.
Méthode de traitement
Le dépouillement des fiches d'enquête et
d'entretien sera fait de façon manuelle. Toutes les données
recueillies seront encodées. Les diagrammes et courbes seront
réalisés avec le logiciel Excel, les tableaux avec le logiciel
Word pour représenter les données quantitatives. Des
indicateurs de performances et ceux liées à la qualité et
au fonctionnement des ouvrages d'assainissement collectifs seront
calculés. Une analyse suivra.
- Méthode relative à l'objectif
3 : Spatialiser les sites de pré collecte et de collecte
par rapport aux densités de population.
ü Matériel
- GPS pour l'enregistrement des coordonnées
géographiques ;
- Carnet de terrain pour prendre des notes
- Appareil photo numérique.
Méthode de collecte
Les coordonnées géographiques des sites de
décharges formelles et informelles, les sites de pré-collecte et
de collecte seront recueillies avec l'aide d'un GPS.
Méthode de traitement
Toutes les coordonnées recueillies des enquêtes
seront encodées intégrées à des cartes de
densité des populations des deux villes afin d'évaluer la
proximité des décharges par rapport aux poches de populations.
Résultats attendus
Au terme de cette étude, les résultats auxquels
nous parviendrons sont :
- Les représentations et pratiques populaires concernant
les déchets solides ménagers dans les villes de Lokossa et de
Cotonou sont connues.
- Les stratégies utilisées dans la collecte des DSM
dans ces villes sont étudiées.
- La spatialisation des sites de pré collecte et de
collecte par rapport aux densités de population est faite.
Bibliographie
1- ADAMA H. (2001) : La gestion
des ordures ménagères dans la ville de Garoua au Cameroun,
Mémoire de DEA, FLASH, UAC, 50 p.
2- AFFOGNON A. (1993) : Activités
humaines et pollution dans le quartier Enagnon, ex-Akpakpa Dodomey de
Cotonou : étude socio-environnementale, mémoire de
maîtrise de géographie, UAC, 83 p.
3- ALLAGBE H. (2005) : Impacts des
inondations sur la santé des populations dans l'arrondissement de
Godomey (Commune d'Abomey-Calavi), mémoire de maîtrise, UAC/FLASH,
75p.
4- AUJOULAT L. P. (1963) :
Santé et développement en Afrique, A. Colin, Paris, 285 p.
5- AUBRY P. (2005) : Les maladies
liées à l'eau. 429p.
6- ASSANI KP. A. (1995) : Qualité
et gestion de l'eau de boisson à Grand-Popo, Mémoire de
maîtrise, Institut Régional de Santé Public, Cotonou, 129
p.
7- DIABAGATÉ S. (2007) :
Assainissement et gestion des ordures ménagères dans la
commune d'Abobo : Cas du village d'AboboBaoulé. Mémoire de
maîtrise. IGT. 98 p.
8- DOSSOU-YOVO O. A. (2001) : Contribution
à la gestion participative et à l'aménagement des zones
inondables à Cotonou.
9- BERKMAN LF et al. (2000)
: From social integration to health - Durkheim in the new millennium.
Social Science & Medicine 51: 843-857p.
10- BOKO M. (1998) : Climats et
Communautés rurales du Bénin : rythmes climatiques et
rythmes de développement, thèse d'Etat es-lettres, volume 1,
Dijon, 282 p.
11- CASSELS A., JANOVSKY K. (1996) :
Renforcer la gestion des systèmes de santé dans les districts et
les provinces, Paris, 27 p.
12- ESCOURROU G. (1990) : Le climat et
la ville, Masson, Paris, 173 p.
13- EMICOV (2010) : Suivi des
indicateurs, INSAE.
14- FERNANDEZ I.
(1997) : Participation communautaire à la gestion des
ordures ménagères dans la ville de Cotonou, mémoire de
maîtrise, IRSP, Cotonou, 52 p.
15- HOUNDANTODÉ J. (2012) :
Gestion des déchets solides municipaux: où en est l'Afrique ?
http://www.africatime.com/Benin/nouvelle.asp?no_nouvelle=678618&no_categorie
Consulté le 11/10/12
16- INSAE (2000) : Enquête sur les
migrations en milieu urbain. Cotonou.
17- INSAE (2003) : Troisième
Recensement général de la population et de l'habitat 2002
(RGPH3), INSAE. Cotonou.
18- INSAE (2010) : Projection de la
population, INSAE. Cotonou.
19- JAGLAND Th. : Tout se tient.
http://www.ourplanet.com/imgversn/122/french/jagland.html
[consulté le 15/1/11]
20- KIKI MIGAN E.L.V. (1993): La
problématique de gestion des déchets dans les mégapoles
africaines et perspectives d'avenir (Cas de la ville de Cotonou en 1993),
Thèse de doctorat, FSS Cotonou, 90 p.
21-LAROUSSE (2010) : Le petit Larousse
illustré, dictionnaire français, France, version
électronique.
22- MAHMAN Coulibaly A. (2002) :
Environnement et santé publique à Gaya (Niger),
Mémoire de maîtrise de géographie, UNB, 98 p.
23- Martin Seidl (2009) : Eau et
assainissement dans les pays en voie de développement, CEREVE.
24- MEHU (2001) : Plan d'Action
Environnemental du Bénin première version révisée,
MEHU, Cotonou, 170 p.
25- MEPN (2007) : Rapport national sur
l'environnement marin et côtier du Bénin, Cotonou, 68 p.
26- Ministère de la Justice et de la
Législation (1987) : Code de l'hygiène publique,
Cotonou, 27p.
27- N'BESSA B. (1997) : Porto-Novo et
Cotonou (Bénin) : origine et évolution d'un doublet urbain
Thèse de Doctorat d'Etat es-lettres de Géographie,
Université de Bordeaux Valence, 456 p.
28- N'BESSA B. (2010) : Environnement et
santé, cours de DEA, Université d'Abomey
Calavi
29- N'DOLEMBAYE J.M. (2006) :
Environnement et santé dans la ville de N'Djamena : cas du
VIème et VIIème arrondissement,
mémoire de maîtrise, UAC/FLASH, 70p.
30- NGNIKAM E. et Al. (2007) : Eau,
Assainissement et impact sur la santé étude de cas d'un
écosystème urbain à Yaoundé. Laboratoire
Environnement et Sciences de l'Eau, Ecole Nationale Supérieure
Polytechnique, 13 p.
31- Onibokun A. (2001) : La gestion des
déchets urbains, des solutions pour l'Afrique, Economie et
développement, Abuja, Nigéria.
32- ODOULAMI L. (1999) :
Approvisionnement en eau potable dans les grandes villes du Bénin.
Quelles politiques pour l'avenir? Cas de Cotonou, Porto Novo et Parakou,
mémoire DEA, FLASH, UAC, 55 p.
33- OMS (1981) : Eau potable et
assainissement 1981-1990 : vers une meilleure santé, Genève,
59p.
34- OMS (1984) : La gestion des
déchets dangereux, Genève, 101p.
35- OMS (1991) : L'hygiène de
l'environnement dans l'aménagement urbain, Genève, 78p.
36- OMS (1992) : Assainissement
approprié pour les communautés à très faibles
revenus, volume 1, Genève.
37- OMS (2005) : Journée mondiale
de l'eau, célébration de la décennie internationale
d'action. L'eau source de vie. Genève, Suisse.
38- PRÜSS- ÜSTUN et
Al. (2008): Better health: costs, benefits and sustainability of
interventions to protect and promote health. Geneva: World Health Organization
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/saferwater/en/index.html,
[consulté le 10/09/11].
39- ROCHER L. (2006) : Gestion territoriale
des déchets ménagers et participation publique, Université
François Rabelais-Tours, 447p.
40- SEIDL M. (2009) : Eau et
assainissement dans les pays en voie de développement, cours Master,
CEREVE.
41- WILKINSON R. & MARMOT M.
(2004) : Les déterminants sociaux de la
santé : les faits - 2ème édition -OMS Europe,
Copenhague.
Liste des tableaux
|
Tableau I : Ménages
enquêtés par quartiers
|
19
|
|
Tableau II : Sources d'eau
utilisées pour la consommation dans les ménages
|
38
|
|
Tableau III : Quantités de
coliformes fécaux dans les puits échantillonnés
|
38
|
|
Tableau IV : Principales maladies
liées à l'eau selon l'OMS (1996)
|
40
|
|
Tableau V : Types de latrines à
promouvoir
|
52
|
Liste des figures
|
Figure 1 : Situations
géographique et administrative de la ville de Lokossa
|
23
|
|
Figure 2 : Couverture en latrines de la
ville de Lokossa
|
24
|
|
Figure 3 : Equipements, voirie et
assainissement de la ville de Lokossa
|
33
|
|
Figure 4 : Principaux
déterminants de santé (Dahlgren, 1995)
|
36
|
|
Figure 5 : Evolution du nombre de
ménages abonnés à la SONEB
|
37
|
|
Figure 6 : Déterminants de la
qualité de l'eau dans la ville de Lokossa
|
39
|
|
Figure 7 : Proportion des
différentes affections
|
41
|
Liste des photos
|
Photo 1 : Puisards installés aux
abords d'une concession à Agonvè
|
26
|
|
Photo 2 : Dépotoirs sauvages aux
abords d'une concession dans le quartier Tchicomè
|
28
|
|
Photo 3 : Site de transit des ordures
ménagères de Tchicomè
|
29
|
Photo 4 : DBM incinérés sans tri (présence de flacons
non éliminés dans la cendre)
|
34
|
QUESTIONNAIRE RELATIF A L'ASSAINISSEMENT ET A LA
SANTE DANS LA VILLE DE LOKOSSA
IDENTIFICATION DE L'ENQUETE
Quartier de ville :
Nom :
Prénom (s) :
Taille du ménage :
Profession :
Adresse :
OBJECTIF 1 : DETERMINER LES SOURCES ET LES CAUSES
DE POLLUTION DANS LA VILLE DE LOKOSSA
Q1-Etes-vous abonné à une ONG de
collecte d'ordures ménagères ?
-oui
-non
Si non comment gérez-vous les ordures
ménagères ?
-enfouissement (dans un trou qu'on ferme)
-incinération
-dépotoirs derrière la maison ou à
côté
-autres (préciser)
Q2-Où mettez-vous les eaux
usées ?
-dans la nature
-dans les collecteurs d'eaux usées (puisard)
Q3-Votre maison dispose t- elle de latrine ?
-oui
-non
OBJECTIF 2 : Identification des risques sanitaires
liés aux problèmes d'assainissement de la ville de
Lokossa
Q1- Quelle eau utilisez-vous pour la
boisson ?
-eau de la Soneb
-eau de puits
-autres (préciser)
Q2-Quelle eau utilisez-vous pour la
cuisine ?
-eau de robinet
-eau de puits
-autres (préciser)
Q3- Quelles sont les maladies les plus courantes dans
votre ménage ?
-
-
-
Q4- Quels sont les maladies liées à
l'eau que vous rencontrez ?
-
-
-
Q5- Quels sont les mesures que vous prenez pour
prévenir ces maladies ?
-paludisme :
-diarrhées :
-fièvres typhoïdes :
-infections respiratoires :
Q6-Quelles mesures prenez-vous quand un cas de maladie
se déclare ?
-vous allez dans un centre de santé
- utilisation des pratiques traditionnelles (tisane)
-automédication
-autres (préciser)
Q7-Où vous procurez-vous vos
médicaments ?
-à la pharmacie
-chez les vendeuses ambulantes
-autres (préciser)
GUIDE D'ENTRETIEN A L'ENDROIT DES ELUS, AGENTS
COMMUNAUX ET RESPONSABLES D'ONG DE COLLECTE D'ORDURES MENAGERES
OBJECTIF 1 : DETERMINER LES SOURCES ET LES CAUSES
DE POLLUTION DANS LA VILLE DE LOKOSSA
IDENTIFICATION DE L'ENQUETE
Nom :
Prénom (s) :
Profession :
Adresse :
Q1 : Quels sont les problèmes
environnementaux qui touchent votre commune ?
-
-
Q2 : Quelles sont les causes de ses
problèmes ?
-
-
Q1 : Comment procédez vous pour
réduire les problèmes d'assainissement et de santé de
votre commune ?
-
-
Q2: Les méthodes employées sont-elles
efficaces ?
-oui
-non
Si non, pourquoi (les raisons) ?
-
-
Q3 : Associez-vous la population à vos
initiatives d'assainissement de la commune ?
-oui
-non
Q4 : Est-ce que des mesures sont prises pour
prévenir les risques sanitaires dus aux problèmes
d'assainissement ?
-non
-oui
Si oui, lesquelles ?
-
-
OBJECTIF 2 : Risques sanitaires liés aux
problèmes d'assainissement de la ville
Q1-Quelles sont les épidémies les plus
courantes dans la ville de Lokossa ?
-
-
Q2-Quelles sont celles qui sont liées à
un problème d'assainissement ?
-
-
-
Q3-Quelles sont les mesures préventives prises
pour palier à ces problèmes ?
-
Annexes
Annexe 1
Tableau I : Synthèse de la
recherche documentaire
|
Centres visités
|
Documents exploités
|
Informations collectées
|
|
INSAE (Institut National de la Statistique et de l'Analyse
Économique)
|
-Annuaire statistiques du RGPH 3, Cahier des villages et
quartiers de ville du Mono
|
Évolution des effectifs de la population de la commune
de Lokossa et de la ville de Lokossa
|
|
Ministère de la santé
|
-Annuaires statistiques sanitaires 2009
-Mémoires
|
-Activités d'assainissement de base au Bénin,
ressources sanitaires de la ville de Lokossa, surveillance
épidémiologique
-Informations sur les maladies hydriques et leur
manifestation
|
|
Mairie de Lokossa
|
PDC de Lokossa
|
-Situation géographique de la commune de Lokossa
-Cadre d'étude
|
|
Ministère de l'environnement de l'habitat et de
l'urbanisme
|
Mémoires de Maîtrise, mémoires de DEA,
thèses de Doctorat
|
-Méthodologie de rédaction d'un mémoire,
revue de littérature sur l'assainissement et les modes de gestion des
déchets
|
Source : Travaux de terrain, 2010
Tableau II : Répartition du
personnel dans les structures communales
|
Domaines
|
Services correspondants au niveau communal
|
Effectif total du personnel
|
Dont par catégorie
|
Répartition par sexe
|
|
|
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
H
|
F
|
|
Education
|
cs
|
14
|
4
|
6
|
3
|
1
|
|
9
|
5
|
|
Santé
|
HZ
|
77
|
11
|
24
|
7
|
30
|
5
|
32
|
45
|
|
Hydraulique
|
|
10
|
3
|
2
|
1
|
3
|
1
|
9
|
1
|
|
Voirie urbaine
|
DDTPT
|
13
|
4
|
2
|
3
|
3
|
1
|
11
|
2
|
|
Pistes rurales
|
DDTPT
|
13
|
4
|
2
|
3
|
3
|
1
|
10
|
3
|
|
Agriculture
|
RCPA
|
24
|
5
|
10
|
7
|
2
|
0
|
19
|
5
|
|
Elevage
|
RCPA
|
5
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4
|
1
|
|
Pêche
|
RCPA
|
7
|
1
|
2
|
4
|
0
|
0
|
6
|
1
|
|
Environnement et ressources naturelles
|
DDHU
|
4
|
1
|
2
|
0
|
1
|
0
|
4
|
0
|
|
Culture, sport et loisirs
|
DDJSL
|
8
|
1
|
1
|
2
|
4
|
0
|
8
|
0
|
|
Sécurité
|
Police
|
27
|
1
|
7
|
16
|
3
|
0
|
26
|
1
|
|
Fiscalité
|
RFU
|
4
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
|
Budget et finances
|
|
6
|
4
|
2
|
0
|
0
|
0
|
4
|
2
|
Tableau III : Modèle
représentatif de l'assainissement dans la ville de Lokossa
Thématiques
|
Forces
|
Faiblesses
|
Opportunités
|
Menaces
|
|
Gestion des excrétas (latrines)
|
- Existence d'un fonds communal de promotion des latrines
familiales dans la ville de Lokossa
- Prise de conscience de la nécessité de disposer
de latrines par les communautés
- Existence d'une direction des services techniques
opérationnelle et qualifiée
|
- Faible couverture en latrines familiales
- Système de vidange des fosses non fonctionnel
- Faible niveau de participation des communautés
- Mauvaise répartition des latrines dans les
établissements scolaires
- Mauvais entretien des latrines existantes
|
- Présence de partenaires (PROTOS & PADEAR) actifs
dans la réalisation de latrines de démonstration et la
sensibilisation
- Existence de radios de proximité à large
audience (passage de messages d'IEC)
|
- Faible cadre synergique entre les divers acteurs intervenant
- Possibilité limitée de subvention en masse de
latrines familiales du fait du cadre institutionnel
|
|
Gestion des déchets solides ménagers
|
- Pro activité du service communal face aux cas
signalés
- Disponibilité de matériels et équipements
communaux pour l'assainissement de la ville
- Existence d'ONG de collecte des ordures
- Site de décharge final identifié
- Existence de groupements de femmes actifs pour l'entretien
des lieux publics
|
- Service en charge de l'environnement peu
étoffé
- Mauvaise organisation du système de collecte des ordures
ménagères
- Manque de points de regroupement
- Découragement des abonnés aux structures de
pré-collecte
|
- Existence du Fonds National de Lutte pour l'Environnement
- Existence de radio communautaire pour les actions d'IEC
- Initiative du Groupement Intercommunal du Mono (GI-Mono)
(possibilité de financement de micro projets)
|
-
|
|
Evacuation des Eaux pluviales
|
- Existence d'un réseau d'évacuation des eaux de
pluie
- Entretien régulier des caniveaux (au moins deux fois par
an)
- Disponibilité d'une étude de
référence sur les caractéristiques des voies et pistes de
desserte de la commune
|
-Insuffisance d'ouvrages d'évacuation des eaux de
pluie
- Mauvais usage des caniveaux par les populations (connexions
illicites, rejet des déchets solides, etc.)
- Absence d'un plan directeur d'évacuation des eaux de
pluie
|
- Collaboration effective de la DDHU
|
- Erosion en pleine évolution des sols
Proportion de sols hydromorphes non négligeable
|
|
Gestion des Eaux usées
|
-
|
- Faible proportion de puits perdus
- Inexistence d'une organisation de la commune pour la gestion
des eaux usées
- Faible niveau de prise de conscience des populations
- Faible volonté des communautés à investir
|
- Existence de radios de proximité à large audience
(passage de messages d'IEC)
- Existence d'agents d'hygiène, de relais communautaires
et maçons actifs dans le secteur, sur le territoire communal
|
-
|
|
Gestion des déchets
Biomédicaux
|
-
|
- Insuffisance de dispositifs d'élimination des
déchets biomédicaux
- Pas vraiment une priorité communale
|
Néant
|
-
|
Annexe 2
Objectifs du Millénaire pour le
Développement
Objectif 1. Eradiquer l'extrême
pauvreté et la faim.
Cible 1. Réduire de
moitié, entre 1990 et 2015, la proportion des personnes dont le revenu
est de moins d'un dollar par jour.
Cible 2. Réduire de
moitié entre 1990 et 2015, la proportion des personnes qui souffrent de
la faim.
Objectif 2. Réaliser
l'éducation primaire pour tous.
Cible 3. S'assurer que vers 2015,
les enfants du monde entier, garçons et filles, pourront suivre un
cursus complet de cycle primaire.
Objectif 3. Promouvoir
l'égalité de sexe et donner des pouvoirs aux femmes.
Cible 4. Eliminer la
disparité de sexe dans l'éducation primaire et secondaire, de
préférence pour 2005, et à tous les niveaux
d'éducation en 2015 au plus tard.
Objectif 4. Réduire la
mortalité infantile.
Cible 5. Réduire de deux
tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de
cinq ans.
Objectif 5. Améliorer la santé
maternelle
Cible 6. Réduire de trois
quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle.
Objectif 6. Combattre le VIH/SIDA, la malaria
et autres endémies.
Cible 7. Avoir arrêté
et commencé le recul de la diffusion du VIH/SIDA à l'horizon
2015.
Cible 8. Vers 2015, avoir
arrêté et commencé à renverser l'incidence de la
malaria et autres endémies majeures.
Objectif 7. Assurer la durabilité
écologique.
Cible 9. Intégrer les
principes de développement durable dans les politiques et les programmes
des pays et inverser les pertes de ressources écologiques.
Cible 10. Réduire de
moitié à l'horizon 2015 la proportion de personnes sans
accès durable à l'eau potable.
Cible 11. Vers 2020, avoir
apporté une amélioration significative dans la vie d'au moins 100
millions d'habitants des taudis.
Objectif 8. Développer un Partenariat
Global pour le Développement.
Cible 12. Poursuivre le
développement d'un système plus ouvert, réglementé,
prévisible et non discriminatoire d'échange commercial et
financier.
Cible 13. Satisfaire les besoins
spéciaux des pays les moins avancés.
Cible 14. Répondre aux
besoins spéciaux des pays enclavés et des Etats insulaires en
voie de développement.
Cible 15. Traiter de manière
globale les problèmes des dettes des pays en voie de
développement par des mesures nationales et internationales afin de
rendre soutenable à long terme le poids de la dette.
Cible 16. En coopération avec
les pays en voie de développement, développer et exécuter
des stratégies pour le travail décent et productif des jeunes.
Cible 17. En coopération avec
les sociétés pharmaceutiques, donner l'accès aux
médicaments essentiels à un coût abordable dans les pays en
voie de développement.
Cible 18. En coopération avec
le secteur privé, rendre disponible les avantages des nouvelles
technologies, surtout dans le domaine de l'information et des
communications.
Annexe 3
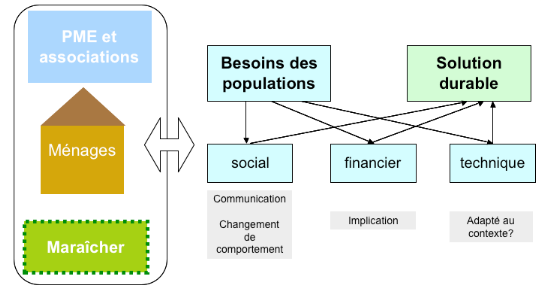

Figure 1: Les défis du projet Ecosan
aux niveaux social, financier et technique


Figure 2 : Le cycle Ecosan
Sommaire......................................................................................................................
|
2
|
|
Dédicace.......................................................................................................................
|
3
|
|
Sigles Et
Abréviations...................................................................................................
|
4
|
|
Remerciements..............................................................................................................
|
5
|
|
Résumé.........................................................................................................................
|
6
|
|
Abstract.........................................................................................................................
|
6
|
|
Introduction...................................................................................................................
|
7
|
|
Chapitre I : Revue de littérature,
problématique et démarche
méthodologique...............
|
9
|
|
1-1- Revue de
littérature................................................................................................
|
9
|
|
1-2-
Problématique.......................................................................................................
|
12
|
|
1-3-
Hypothèses...........................................................................................................
|
14
|
|
1-4-Objectifs de
recherche...........................................................................................
|
14
|
|
1-5- Clarification des
concepts....................................................................................
|
15
|
|
1-6- Démarche
méthodologique...................................................................................
|
17
|
1-6-1- Collecte des
données........................................................................................
|
17
|
1-6-2- Données
utilisées..............................................................................................
|
17
|
|
1-6-3- Recherche
documentaire..................................................................................
|
18
|
1-6-4- Enquête de
terrain................................................................................................
|
18
|
1-6-4-1-
Echantillonnage................................................................................................
|
18
|
|
1-6-4-2- Techniques de
collecte..................................................................................
|
19
|
1-6-5- Traitement des
données....................................................................................
|
20
|
|
Chapitre II : Diagnostic des problèmes
d'assainissement de la ville de Lokossa...........
|
22
|
|
2-1- Présentation du milieu
d'étude............................................................................
|
22
|
|
2-2- Situation de l'assainissement dans la ville de
Lokossa........................................
|
24
|
2-2-1- Gestion des excréta, eaux usées et boues de
vidange.......................................
|
24
|
|
2-2-2- Gestion des déchets solides par les
ménages...................................................
|
27
|
|
2-2-3- Gestion des déchets solides au niveau des
institutions et des places publiques
|
30
|
|
2-2-4- Gestion des déchets
industriels........................................................................
|
32
|
|
2-2-5- Gestion des eaux
pluviales..............................................................................
|
32
|
|
Chapitre III : Risques sanitaires liés aux
problèmes d'assainissement dans la ville de
Lokossa ....................................................................................................................
|
35
|
|
3-1-Principaux déterminants de la
santé.......................................................................
|
35
|
|
3-2- Eau, assainissement et santé des populations de la
ville de Lokossa.....................
|
37
|
|
3-2- Identification des risques sanitaires liés aux
problèmes d'assainissement de la ville de
Lokossa .................................................................................................................
|
41
|
|
3-2-1- Principales maladies liées aux problèmes
d'assainissement ............................
|
41
|
3-2-2- Connaissances, attitudes et perception des populations sur les
problèmes d'assainissement et de
santé.......................................................................................
|
42
|
|
Chapitre IV : Cadre Institutionnel, Mesures Et
Perspective........................................
|
43
|
|
4-1-Cadre institutionnel de
l'assainissement...............................................................
4-1-1- Cadre institutionnel au
Bénin...........................................................................
4-1-2- Capacités organisationnelle et institutionnelle
des acteurs dans la ville de Lokossa
|
43
43
48
|
|
4-1-2-1-Structures de collecte d'ordures
ménagères....................................................
4-1-2-2-Groupement de femmes
balayeuses.............................................................
4-1-2-3-Artisans
maçons............................................................................................
4-1-2-4-Appui des services déconcentrés et des
partenaires techniques et financiers
4-1-2-5- Exercice de la compétence
communale.............................................................
|
48
48
49
49
49
|
|
4-2- Mesures d'assainissement à promouvoir dans la
ville de Lokossa...........................
|
50
|
|
4-2-1- Mesures concernant les déchets
ménagers...........................................................
|
50
|
|
4-2-2- Mesures concernant la gestion des
excrétas.........................................................
|
51
|
|
4-2-3- Mesures d'accès à l'eau potable et
protection de la ressource.............................
|
53
|
|
4-2-4- Pratiques
d'hygiène............................................................................................
|
53
|
|
CONCLUSION ET
SUGGESTIONS...........................................................................
|
54
|
|
Perspectives pour la
thèse...........................................................................................
|
56
|
|
Bibliographie..............................................................................................................
|
61
|
|
Liste des tableaux, des figures et des
photos...............................................................
|
65
|
|
Questionnaire.............................................................................................................
|
66
|
|
Annexe.......................................................................................................................
|
70
|
|
Tables des
matières....................................................................................................
|
77
|



