|

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
INTRODUCTION GENERALE :
La multiplication des conférences internationales sur
l'eau depuis près de trente ans et
1
l'engagement récent de la communauté
internationale à diminuer d'ici 2015 le nombre de
personnes dans le monde n'ayant pas un accès
sûr à l'eau potable et à un système
d'assainissement basique, témoignent d'une prise de
conscience du rôle fondamental que joue
l'accès à l'eau potable et à
l'assainissement dans le développement d'un territoire et d'une
société. Les chiffres, fréquemment
cités, sont à la mesure des enjeux, avant tout humain : 1,2
milliard de personnes n'ont pas accès à une
source d'eau potable, 2,9 milliards n'ont pas
d'installations sanitaires convenables et 4 milliards ne
disposent pas d'égouts. Plus de 4
milliards de cas de maladies d'origine hydrique chaque
année causent 2,2 millions de morts,
en majorité des enfants de moins de 5ans (soit
près de 15% des causes de mortalité des
2
enfants de moins de 5ans des pays en
développement) .Au delà des enjeux sanitaires et
humains, l'accès à l'eau potable est une des
conditions préalables à la réalisation des autres
objectifs du millénaire : éducation pour tous,
développement économique, etc. Si aujourd'hui
la majeure partie des populations n'ayant pas
d'accès à l'eau est rurale, l'urbanisation
explosive et continue depuis 30ans se traduit par la
prolifération de quartiers précaires en
marge des villes, non desservis par les infrastructures urbaines.
Les recherches portant sur la thématique
générale de la gestion de l'eau au
Sénégal,
mobilisent plusieurs approches : une approche technique qui
vise à élaborer des solutions
alternatives à faible coût, une approche
sociologique centrée sur les pratiques culturelles liées
à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement,
une approche socio-urbaine qui analyse le
lien avec les territoires urbains ou ruraux, une approche
économique qui englobe les modèles
de financement des services, l'étude de la demande,
l'étude des coûts et l'étude de la
tarification.
1
Les objectifs du millénaire pour l'accès à
l'eau potable ont été énoncés en 2000 (à New
York) puis complétés
par les objectifs concernant l'assainissement en 2002
(à Johannesbourg) pour constituer aujourd'hui la cible
N°10 de l'Objectif du millénaire N°7 : assurer
un environnement durable.
2
Le terme global de pays en développement (PED)
recouvre aujourd'hui des aux réalités économiques
très
différentes. Pour conserver une validité et
rassembler un grand nombre d'Etats, ce terme doit désormais
être
entendu selon une compréhension plus restreinte, mettant
l'accent sur la distinction qu'il établit par rapport aux
pays du Nord.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
1

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Face à la question de l'accès à l'eau
potable pour tous, les réponses de la communauté
internationale depuis 30 ans se sont centrées sur deux
problèmes : trouver des financements et
proposer des modèles économiques permettant
d'améliorer l'efficacité des services, les deux
dimensions étant étroitement liées.
Le partenariat public privé (PPP), supposé amener
efficacité et financement, a notamment fait l'objet d'un
engouement sans précédent dans les
années 1990, engouement à la hauteur des
déceptions qu'il a suscité dès le début des
années
2000. Aujourd'hui, la question du financement de
l'accès pour tous comme celle du choix
d'un mode de gestion durable et de la tarification,
reste ouverte, offrant un vaste champ de
recherches pour proposer des modèles innovants.
La population mondiale atteindra 7milliards d'ici 2011. On estime
88 % de l'augmentation de
la population s'effectuera en milieu urbain d'ici 2015 et
la totalité à partir de 2015. Les
services urbains au Sénégal sont en crise et
n'assurent pas la desserte en eau et assainissement
dans de larges quartiers, souvent périurbains, où
vivent des populations à faible revenu. Ces
quartiers rassemblent parfois jusqu'à 40 % de la
population, mais restent en marge de la ville,
sur le plan social, politique et économique. Longtemps
ignorés du pouvoir politique, ils sont
les premières cibles et l'engagement international
qui vise à réduire la pauvreté. Toutefois,
même si la volonté politique existe,
l'intégration des quartiers défavorisés à la
ville par
connexion à ses réseaux principaux se heurte
à des difficultés à la fois financières et
organisationnelles.
Le premier élément de crise est financier. Si la
situation est à moduler en fonction des régions
et des contextes, l'élément financier reste
comme le premier obstacle. Qui va payer et pour
3
quel service ? L'épuisement des sources classiques
de financement que sont le tarif et la
subvention publique (limitée en raison d'un
surendettement de l'Etat) conduit à une
internationalisation de la gestion des services d'eau et
d'assainissement, et à l'intervention de
deux nouveaux acteurs : les institutions financières
internationales, qui vont exercer un rôle
moteur dans la production de modèles, et les
opérateurs privés, qui investissent de manière
importante dans les années 1990.
Un deuxième élément de crise se rajoute
à partir de 2000, c'est une crise « des modèles ».
Dans la situation initiale, l'Etat assumait le service,
en ignorant la plupart du temps les
quartiers précaires (bidonvilles, périurbains
ou centraux) pour des raisons financières. Les
3
Le tarif payé par le nouvel usager et les
usagers déjà connectés se révèle
insuffisant en période
d'investissements massifs, car une augmentation des tarifs
se heurte à la fois à la solvabilité de certaines
catégories pauvres et à une contrainte de
solidarité des catégories d'usagers plus riches.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
2

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
réformes des années 1990, sous l'impulsion de
la Banque Mondiale, font apparaître de
nouveaux acteurs : les opérateurs privés et les
communautés d'usagers.
Le problème qui se pose aujourd'hui est celui d'un
modèle assurant à l'accès à tous, alliant
une exigence d'efficacité - en des temps où la
subvention publique se raréfie - et d'équité -
afin d'étendre le service à des usagers peu
solvables. La question de la prise en charge des
quartiers défavorisés doit ainsi devenir une
question centrale dans la discussion des modèles.
Pour le chercheur en économie, la crise des
services d'eau au Sénégal ouvre une série de
problématiques, qui tournent autour de l'analyse et de la
production d'un modèle. L'Etat rend
compte de la diversité et de la complexité
des enjeux dans le secteur des services d'eau et
d'assainissement : s'y jouent à la fois une dimension
territoriale, une dimension économique
(choix du mode de gestion, publique ou privée) et une
dimension participative (définition du
rôle des usagers). Autant de dimensions qui renvoient
à la fois à des questions de recherche :
Quels sont les moyens d'assurer un service d'eau satisfaisant aux
plus pauvres ? Est-il réaliste
de défendre une politique de service universel
? Peut-on envisager au contraire une
différenciation du service en fonction de la demande
locale de chaque quartier ?
Un objectif social de desserte des populations
pauvres est-il contradictoire avec la
participation du privé international ? Quelles incitations
sont mises en place pour soutenir cet
effort ? Qui finance l'accès au réseau, le secteur
public ou l'opérateur privé ?
Quels partenariats existent-ils avec d'autres acteurs que le
secteur privé international ?
Comment les péréquations s'organisent-elles
entre les différentes catégories d'usagers entre
les différentes régions du
Sénégal ? Est-il possible d'élargir le
périmètre actuel géré par le
secteur privé à d'autres centres urbains ?
Si les dernières années ont été
marquées par des prises de position radicale, il semble que l'on
parvienne aujourd'hui à des compromis plus
équilibrés.
Dans ce débat, le PPP au Sénégal semble
particulièrement instructif. Tout d'abord, le service
public d'eau est assuré depuis 1996 par un contrat
de PPP, associant l'Etat sénégalais, la
SONES (Société publique de patrimoine) et la
SDE(Société privée). Un consensus existe au
sein de la communauté internationale pour
considérer ce partenariat comme un succès et le
contrat arrivant à échéance en
2006 a été prolongé pour une durée de
cinq ans.
Géographiquement, ce contrat couvre la ville de
Dakar ainsi que 55 autres centres urbains,
soit 42% de la population du Sénégal
(Trémolet 2004). Cette couverture large autorise des
péréquations financières importantes
entre secteur géographique ainsi qu'entre catégories
d'usagers (ménages, industriels, administrations,
maraîchers)
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
3

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
De plus, depuis 2003, le secteur de l'eau a atteint
l'équilibre financier. Le Sénégal a ainsi fait
le choix de limiter les subventions publiques de l'Etat et
de financer les investissements par
une augmentation des tarifs de l'eau.
Enfin, l'accès à l'eau des plus pauvres est
une priorité de l'agenda. Ainsi le PEPAM
(Programme d'Eau Potable et d'Assainissement du
Millénaire), document définissant la
stratégie du Sénégal à l'horizon
2015, prévoit que 1,65 million de personnes supplémentaires
soient raccordés au réseau tout en
améliorant l'efficacité des programmes de branchement
sociaux et réservant en priorité l'accès de
l'aide publique à ces ménages.
4
Face à quelques échecs retentissants , le
modèle PPP promu les services au Sénégal a
déjà
largement évolué depuis 1996 et se trouve
aujourd'hui à un tournant : il doit se renouveler en
profondeur pour être durable. La desserte en eau des
populations défavorisées exige en effet
un partenariat fort avec les solutions publiques : une
volonté politique qui se traduit par des
formes nouvelles de financement et de gestion.
Le mémoire se concentre sur la problématique d'un
partenariat entre acteurs publics et privés
dans le secteur de l'eau au Sénégal. L'objectif est
de proposer une vision du partenariat public
privé pour la gestion des services d'eau dans ce contexte,
en accordant une place centrale à la
desserte des populations pauvres.
Cette proposition se heurte à deux écueils. Le
premier est de se laisser entraîner dans un débat
passionné sur la légitimité du secteur
privé à intervenir dans la fourniture d'un service dit
« d'intérêt général » :
virulence des discussions et simplifications arbitraires
caractérisent en
général les controverses sur le privé
et l'eau. Notre propos dans ce mémoire n'est ni de
soutenir ni de contester l'implication du secteur
privé dans la gestion des services publics.
Considérant que le PPP est désormais, de
fait, ancré dans la réalité, nous analysons des
expériences concrètes afin de contribuer
à un débat plus ouvert sur la répartition des
rôles
entre les autorités publiques, le secteur privé et
la société civile. Le second écueil est celui du
dogmatisme : après avoir dénoncé les
discours simplifiés en 1996 qui visaient à transposer le
Sénégal des modèles européens,
nous semble essentielle de souligner l'importance des
4
Le terme d'échec mérite d'être
relativisé. D'une part, certains échecs commerciaux ou
contractuels ont été
exclusivement médiatisés et ont souffert de
fortes imprécisions et amalgames des journalises dans la
narration
des événements, jetant le discrédit sur la
participation du secteur privé en général. D'autre part,
les difficultés de
certains pays ont engendré des commentaires sur
l'échec de la participation du secteur privé, alors même
que des
de contrats continuent parfaitement.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
4

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
spécificités dans la mise en place d'un
modèle de rentabilité des services d'eau. Elaboré
à
partir de l'observation de plusieurs expériences pilotes.
L'objectif principal de cette étude consiste en une
étude de la contribution du partenariat
public privé dans le secteur de l'eau afin d'identifier
les voies et moyens permettant :
- de mieux optimiser les ressources allouées dans le
secteur de l'eau au Sénégal ;
- de mieux diminuer les pertes en distribution dues à un
mauvais état du réseau ;
- de gérer ces ressources avec efficacité et
équité pour en faire bénéficier le plus
grand
nombre d'abonnés.
A la fin de notre étude, nous saurons
répondre s'il sera nécessaire d'agir ou non sur les
variables macroéconomiques de la rentabilité du PPP
comme facteurs déterminants.
La question qui se pose est de savoir à partir de cette
relation si nous pouvons trouver que la
rentabilité du partenariat est expliquée
ou non par les investissements, les pertes en
distribution et le nombre d'abonnés.
Nous considérons comme hypothèse un effet
positif des investissements et le nombre
d'abonnés et un effet négatif des pertes en
distribution.
L'étude se propose de vérifier si la
contribution de ces facteurs de rentabilité du PPP est
positive ou non. L'analyse repose sur l'écriture d'un
modèle économétrique liant ces facteurs
et le taux de rendement du PPP.
A partir de la question soulevée - comment le PPP
peut-il assurer la desserte des quartiers
pauvres ?- Notre travail consistera à conjuguer
les différentes approches pour mieux
comprendre la dynamique qui se joue aujourd'hui dans un certain
nombres de contrats de type
PPP. Il nous semblera ainsi nécessaire de conjuguer
une approche théorique qui permet de
dégager les principaux points à approfondir
et une démarche empirique qui fournit les
éléments de compréhension de la dynamique
actuelle.
A partir delà, nous mobiliserons la
littérature économique portant sur l'organisation afin
d'approfondir ces trois dimensions de la gouvernance
des services d'eau, dans un
environnement risqué et incertain. La
littérature rattachée aux théories des contrats
fournira
des informations particulièrement adaptées pour
analyser les dimensions contractuelles et
institutionnelles de la relation opérateur- Etat : y
seront discutés des modèles d'incitations et
les structures de pilotage de contrats. Les
développements récents de la théorie
économique
des conventions, situés à la frontière entre
l'économie et la sociologie fournissent des modèles
permettant de comprendre les différents degrés
de participation des usagers. Ces approches
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
5

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
constitueront le cadre théorique du mémoire, qui
explique l'articulation et le couplage entre
les dimensions contractuelles, institutionnelles et
participatives pour introduire la notion de
cohérence d'un modèle économétrique.
L'architecture du mémoire suit les différentes
étapes de la méthodologie. Passer d'une
recherche qui suit plusieurs pistes convergentes à une
présentation linéaire oblige à faire des
choix de présentation. Dans la mesure où la
problématique est posée de manière très
générale,
nous avons choisi de commencer par présenter les
spécificités des services d'eau au Sénégal
avant de présenter les modèles comme autant de
réponses innovantes possibles.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
6

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Chapitre I : Partenariat Public Privé dans la
distribution d'eau potable : un état des lieux
Un défi majeur se pose aux pays africains en voie
de développement : faire face à une
croissance démographique élevée et
à ses conséquences urbaines, au moment où leurs
performances économiques ne sont pas des meilleurs.
Comment assurer des services urbains
de base à une population croissant rapidement et ayant peu
de moyens ? Là se situe l'enjeu.
Au lendemain des indépendances, les pays africains
ont favorisé la naissance d'un secteur
public marchand, en créant des sociétés
d'Etat ou des organismes publics chargés de gérer la
fourniture de ces services (électricité,
téléphone, eau). L'exemple du service public de l'eau
au Sénégal est assez éloquent de ce pont de
vue.
Le Sénégal compte une population de 11
millions d'habitants dont 2,75 millions résident à
Dakar, la capitale, qui connaît un taux d'augmentation de
sa population de 7% par an.
En 1994, la demande totale théorique d'eau potable
de la région de Dakar est estimée à
3
3
/jour, ce traduit un déficit de 82 000 m /jour
estimé trois ans après à 100 000 m /jour.
Les investissements d'infrastructures et les mesures
d'accompagnement pour résoudre ce
problème s'avère coûteux pour l'Etat :
prés de 235 millions de dollars sont nécessaires pour
ramener ce déficit de 100 000 m /jour à
30 000 m /jour en attendant une solution plus
radicale, dite solution à long terme.
Dans un contexte de crédits budgétaires
déclinants et de limitation de l'endettement de l'Etat,
les regards du Sénégal se sont tournés
vers les partenaires au développement. Ces derniers
sous la houlette de la banque mondiale l'ont encouragé
à trouver des solutions idoines. Elles
militent en faveur de l'instauration de liens
renforcés entre la conception, la réalisation et
l'exploitation d'une infrastructure de service public
s'inspirant à l'origine du « modèle
français » de la gestion
déléguée, reconnue depuis une trentaine
d'années. A l'Etat, il est
recommandé qu'il se cantonne davantage dans un
rôle de facilitation, de coordination et de
protection de l'intérêt public et se faire
moins souvent acteur direct. Au secteur privé, il est
requis son apport de compétence en gestion
et sa participation plus importante au
financement des services d'infrastructures.
Ces remarques introductives tracent l'organisation de ce
chapitre qui : donne un aperçu de
l'économie du partenariat public/privé et sur
le choix du Sénégal entre les différentes
formules de gestion déléguée du service
public de l'eau, met l'accent sur le nouveau cadre
230 000 m /jour contre un volume d'eau potable disponible pour
y faire face de 128 000 m
3
3
3
3
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
7

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
mis en oeuvre pour impliquer le partenariat privé
mais également pour doter la société
publique des moyens nécessaires à
l'exécution de ses missions, permet de mettre en exergue
les obligations contractuelles et les engagements des
acteurs, met en évidence les risques
identifiés dans le PPP du secteur de l'eau au
Sénégal, donne un aperçu sur les réalisations du
PPP et met enfin l'accent sur la politique de la tarification.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
8

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
I - La régulation par un contrat de
gestion déléguée
Dans cette section consacrée à l'étude
de la régulation par un contrat de gestion
déléguée,
deux sous sections vont être considérés
: la source d'inspiration et le financement des
infrastructures de développement.
I1
- La source d'inspiration
La réforme institutionnelle dans le secteur de l'eau au
Sénégal s'est inspiré de ce qu'il est
convenu d'appeler le « modèle français »
de gestion déléguée des services publics.
e e
Il faut remonter au 17 ou 18 siècle pour constater
l'expérimentation de ce modèle qui a pris
racines dans l'antiquité gréco-latine. Le 19
siècle a vu son affirmation avec le recours à la
concession tant pour les chemins de fer que pour
tous les équipements urbains : eau,
assainissement, éclairage, transport, etc.
Depuis une trentaine d'années, la gestion
déléguée a connu un essor à travers les
activités
comme la construction et l'exploitation d'autoroutes, de
parking, de système de chauffage
urbain. Le succès des groupes français dans des
consultations internationales a aussi contribué
à la reconnaissance de ce que la Banque mondiale
qualifie de « modèle français » de la
gestion déléguée. Lorrain [1995],
parlant des origines de ce modèle et de la culture qui le
sous- tend, prévient qu'elle ne se trouve pas dans la
littérature économique. Selon lui, ce qui
peut être qualifié aujourd'hui de modèle
avec un coté stable et reproductible, est le produit
d'une histoire de longue période ; il s'est
élaboré graduellement à partir de quelques principes
et surtout en fonction du problème qu'il fallait
résoudre.
Les principes de ce modèle s'appellent
coopération, équilibre financier, souplesse
institutionnelle. Ils découlent de deux constructions
juridiques : d'un coté le corps de doctrine
qui définit le service public local, de l'autre,
le droit des contrats qui relient les autorités
organisatrices aux exploitants des réseaux.
Enfin, le même auteur soutien que, dans ce
modèle, il y a plus de pragmatisme que de
doctrine, plus de problèmes concrets que de
théorie, ce qui n'exclut pas tout de même certains
raisonnements économiques qui ressortent d'une autre
tradition que ceux de l'économie
politique classique.
Modèle pragmatique, technique, politique plutôt
qu'économique, il n'est pas le fruit d'une
théorie générale explicite des liens
collectifs ni de la théorie générale.
Historiquement, c'est à propos du recours à
l'entreprise dans les grands travaux de l'Etat que
ce modèle s'est profilé. Il est à
noter que Lorrain [1995], citant les travaux Verin (1989)
souligne que « la question de savoir si l'on obtiendra le
meilleur service au meilleur coût en
ème
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
9

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
e
recourant au privé plutôt qu'au public est
clairement posée en France, dès le début du 17
siècle ».
En faite de modèle, il s'agit plutôt
d'une expérience diversifiée car les solutions
expérimentées sont très variées
au niveau : de leur contenu (conception, construction,
exploitation) ou de leur objet (service ou infrastructure support
d'un service), de la nature des
autorités concédantes (Etat, communes) et des
différents types de concessionnaires qui
peuvent être publics, privés ou mixtes.
Cette expérience diversifiée a connu des
réussites éclatantes par exemple dans l'eau, mais
également quelques échecs riches
d'enseignements. Dans tous les cas, les explications se
situent à deux niveaux prédominants qui
conditionnent le succès des expériences : de
l'établissement d'un partenariat durable entre le
concédant et le concessionnaire et du partage
équilibré des risques et des résultats en
fonction de la nature des projets et de leur équilibre
économique et financier.
L'autre facteur décisif réside dans le
choix du concessionnaire parmi des groupes
expérimentés ayant une surface technique et
financière suffisante leur permettant réellement
d'assurer des risques et de constituer des partenaires durables.
Les relations définies entre les partenaires engagent
l'avenir ; de ce fait elles doivent s'inscrire
dans le cadre de dispositions contractuelles qui, elles
mêmes, constituent un code de bonne
conduite entre les deux parties de manière à
asseoir des relations de confiance sur le long
terme.
Martinand [1995] relève que deux écueils sont
à éviter. Le premier est une concession
financière non viable, ce qui apparaît dès
les premières années : cela n'est positif ni pour le
concessionnaire ni pour le concédant public qui en
subit les conséquences politiques. Le
second est une concession dégageant avant le terme des
bénéfices excessifs, ce qui n'est pas
non plus souhaitable pour le concédant pour des raisons
politiques et par conséquent pour le
concessionnaire si les engagements initiaux ne sont pas
respectés.
Toute la difficulté pour éviter ces écueils
réside dans les aléas de ce type de partenariat sur le
long terme : faire des prévisions exactes à cette
échéance est difficile.
Pour quelles raisons recourt-on à la gestion
déléguée, autrement dit pourquoi un partenariat ?
La réponse à cette question relève du
domaine des options de politiques économiques : le
partage des rôles entre le public et le privé.
Les partisans de la gestion déléguée
trouvent que l'Etat moderne doit éviter de se mêler de
tout à tort et à travers, se recentrer sur
l'essentiel, faire régresser sa bureaucratie tout en jouant
le rôle fort qui doit être le sien avec une
administration solide : un Etat garant de l'intérêt
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
10

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
général. C'est, selon Martinand [1995], un
Etat qui doit, au-delà des fonctions régaliennes
traditionnelles (justice, police, défense), susciter
et favoriser le partenariat entre les acteurs
économiques et sociaux (qu'ils soient publics ou
privés) et les pouvoirs publics. Il s'agit pour
lui d'organiser des modes d'interactions contractuels entre
la sphère publique et la société
civile.
Dans ce cadre, la gestion des services publics doit,
pour l'essentiel, être confiée à des
opérateurs juridiquement distincts de la puissance
publique, qu'ils soient des entreprises
privées ou mixtes, dans certains cas, publiques.
L'analyse de l'économie du PPP revêt des
enjeux certains. Si elle relève de l'opposition
classique entre les tenants du « tout Etat » et
les avocats du « tout privé », elle est de nos
jours rendue féconde par les partisans de la
recherche d'un équilibre entre les interventions
publiques et privées, une forme de libéralisme
tempéré.
En effet, une vision trop dichotomique des deux univers
de l'économie publique et d
l'économie privée peut conduire à
l'inefficacité. Il faudrait dès lors déplacer l'analyse
vers les
modalités de coopération entre le public et
le privé. C'est à ce niveau qu'il faut placer et
comprendre ce qui est actuellement qualifié de
« modèle français »de gestion des
infrastructures.
Ceux qui ont réfléchi à ce modèle
préviennent qu'il est un modèle de fait. Il n'est pas le fruit
d'une théorie générale explicite des biens
collectifs ni de la théorie économique en générale.
Modèle pragmatique, technique politique plutôt
qu'économique.
I 2- Le financement des infrastructures de
développement
En consacrant son rapport annuel sur le
développement économique dans le monde aux
rapports entre infrastructure et développement, la Banque
mondiale a donné un signal fort sur
la capacité de ce modèle à s'exporter. Les
changements institutionnels mis en oeuvre ça et là
dans le secteur de l'eau en Afrique (Cote d'Ivoire,
Guinée, Sénégal, etc.). Ce rapport souligne
que la qualité d'une infrastructure aide à
comprendre pourquoi un pays réussit alors qu'un
autre échoue à diversifier sa production,
à développer ses échanges, à
maîtriser sa
démographie, à faire reculer la
pauvreté ou à assainir l'environnement. Une bonne
infrastructure augmente la productivité, réduit les
coûts de production et stimule la croissance
économique. En effet, selon le même rapport, une
augmentation du capital d'infrastructure de
1% correspond à une augmentation du produit
intérieur brut (PIB) de 1%.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
11

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Aujourd'hui, la Banque mondiale constate que l'insuffisance
de l'entretien représente un
échec presque universel (et coûteux) des prestations
de services d'infrastructure dans les pays
en développement. Cela explique par
exemple qu'en Afrique, les services
d'approvisionnement en eau fournissent en moyenne 70
% de leur production aux
consommateurs, quand des pratiques optimales leur permettraient
d'obtenir 85 %.
Au Sénégal, l'option de l'Etat est claire. Il
s'agit de rompre avec la politique de subvention et
de mettre l'accent sur la mise en place d'infrastructures
restructurantes. Cela nécessite de gros
moyens financiers et c'est là qu'il faudrait trouver les
raisons du PPP.
En effet, les pouvoirs publics se demandent comment utiliser au
mieux leurs rares ressources
budgétaires et/ou d'emprunts publics : faut-il
financer seuls un nombre limité de projets à
bonne rentabilité globale, mais à
rentabilité financière insuffisante pour le secteur
privé, ou
aider un nombre accru de tels projets, pour les rendre
éligible au financement privé ?
Cette deuxième voie conduit à diverses formes de
PPP.
Le partenariat est nécessaire parce qu'il y a des
limites au financement complètement privé
tenant à la rentabilité financière
insuffisante ou au risque trop élevé de certains
équipements
publics. Il apparaît actuellement comme le seul
moyen de combler l'écart existant entre les
besoins énormes d'investissements publics et les
ressources budgétaires et d'emprunts publics
limités dont disposent les Etats.
Le PPP comporte aussi de nombreux avantages autres que financiers
et notamment : il permet
de recourir à une gestion de type privé des
services industriels et commerciaux, souvent plus
efficace qu'une gestion publique de ces activités, il
permet de faire payer l'usager plutôt que
le contribuable actuel ou des générations
futures et enfin il permet aux pouvoirs publics de
garder, néanmoins, un certain contrôle sur des
aspects qui relèvent de leur responsabilité, tout
en déléguant au secteur privé les
compétences qu'ils souhaitent lui confier, ce découpage se
faisant à la carte et nécessitant des changements
institutionnels.
II- L'instauration du PPP dans le service de
l'eau
Au lendemain des indépendances, le service public
de l'eau était assuré au Sénégal par la
Compagnie générale des eaux du
Sénégal filiale de la Compagnie générale des
eaux de
France. La CGE Sénégal était une
société d'économie mixte. 1968, elle sera
nationalisée,
suite à un différend entre elle et les
autorités sénégalaises au sujet du projet d'adduction
d'eau
à partir du Lac de Guiers, investissement dont la CGE
française ne voulait pas entendre parler.
Il faut noter que les événements de 1968, au cours
desquels la plate forme de l'UNTS (Union
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
12

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
nationale des travailleurs du Sénégal) avait
exigé la nationalisation de la CGE du Sénégal, ont
précipité également cette rupture. Une
société nationale d'exploitation des eaux (SONEES)
fut créée et assure le service public
de l'eau. Plus de trente ans après, la question
d'investissement se repose : comment à partir du
Lac de Guiers résoudre le problème de
l'approvisionnement en eau de la capitale et de ses environs qui
enregistrent un déficit de100
3
000 m /jour ?
Afin de réaliser ces projets et résoudre les
difficultés auxquelles était confronté le secteur, le
Gouvernement du Sénégal, décida, sous
la pression, des bailleurs de fonds, d'engager une
réforme du secteur de l'hydraulique urbaine.
II 1- Les raisons de la réforme
institutionnelle
Plus que le bilan mitigé de la SONEES, c'est le
coût de renouvellement et d'extension de
l'infrastructure qui se pose à l'Etat. Près de 250
millions de dollars sont requis, alors l'Etat est
sous ajustement structure et, par conséquent, doit lutter
contre l'accroissement des déficits et
des dettes publiques, sans compter la montée des budgets
sociaux. Se pose alors la question de
la dénationalisation ou privatisation de la SONEES.
En 1992, une étude sur l'efficacité de la
SONEES est menée à la demande de l'Etat. Elle a
5
abouti à l'identification d'un ensemble de cibles
stratégiques au niveau organisationnel et
6
institutionnel .
De cette étude, il ressort que dans le cadre
préexistant, à savoir l'Etat concédant et la
SONEES concessionnaire de l'ensemble du service public de
production et de distribution
d'eau potable en zone urbaine et périurbaine, seul
le tiers des cibles ci-dessus énumérées
étaient ou pouvaient être atteintes. Les cibles
essentielles, tels que l'autonomie de l'opérateur
et le respect des obligations de l'Etat, n'étaient
toujours pas atteintes.
La modification du cadre institutionnel a donc été
envisagée avec intervention d'une structure
privée pour permettre au secteur de retrouver
une croissance et une rentabilité qui
apporteraient une meilleure qualité du service public de
l'eau potable et de l'assainissement,
une extension plus rapide de ce service dans les
quartiers non desservis, une meilleure
5
Organisationnel : amélioration de la gestion technique, de
la gestion des abonnés, de la gestion financière et des
ressources humaines.
6
Institutionnel : respect des obligations de l'Etat, de
l'autonomie de l'opérateur, une tarification appropriée et
programmation cohérente des investissements.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
13

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
maîtrise du coût de ce service, ainsi que
l'assurance et l'accroissement des rentrées fiscales
régulières pour l'Etat.
Il a donc fallu s'interroger sur le mode d'intervention de la
structure privée.
II 2- L'organisation institutionnelle mise en
place
Les différents schémas envisagés dans ce
type de situation sont communément regroupés sous
l'appellation de contrat de « délégation
de service public ».On entend par délégation de
service public, l'ensemble des hypothèses dans les
quelles une collectivité publique s'en
remet à une tierce personne pour exécuter un
service public à sa place.
Si l'on exclut les simples contrats d'assistance technique ou de
gestion de société, les contrats
de délégation de service public sont : la
gérance, la régie intéressée, l'affermage et les
contrats
innommés. La caractéristique première de ces
options contractuelles est que la propriété reste
publique et l'exploitation privée.
Les critères de choix entre ces contrats dépendent
de divers paramètres tels que la volonté de
désengagement de la collectivité publique et
sa volonté de faire assumer à l'opérateur un
risque plus ou moins important. En effet, dans les contrats de
régie intéressée ou de gérance,
la collectivité publique reste fortement impliquée
tandis que l'opérateur privé en revanche ne
supporte pas de véritable risque de gestion. Les
besoins en investissements du secteur eu
égard aux moyens dont dispose l'Etat ou la
collectivité publique. Dans les schémas de
gérance, régie intéressée et
affermage, l'entreprise privé n'effectue aucun investissement. Par
conséquent, en cas de besoins importants en
investissements nouveaux, la concession est plus
appropriée.
Le choix du Sénégal entre les
différentes formules énoncées ci-dessus a
été guidé par un
facteur technique lié à l'atteinte des objectifs
qui ressortent des cibles stratégiques évoquées
plus haut ainsi par un facteur politique lié à une
volonté de maintenir un certain contrôle sur le
secteur. Il était en effet probable que
l'opérateur privé serait un étranger et il aurait
pu être
politiquement très difficile de justifier le
basculement de l'ensemble du service public et de
patrimoine entre les mains d'une structure
étrangère.
Du large éventail de formules de partenariat secteur
public secteur privé en matière de gestion
déléguée de services d'infrastructure,
le Sénégal a choisi en 1995 l'affermage qui est un
contrat par lequel une personne publique charge une
personne généralement privée, de
l'exploitation d'un service public et lui remet
simultanément les ouvrages nécessaires à cette
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
14

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
exploitation, la personne privée assurant
l'exploitation sous sa responsabilité et versant, en
contrepartie des ouvrages qui lui sont remis, une redevance
à la personne publique.
Cette option a rencontré l'adhésion des bailleurs
de fonds qui ont accepté de financier 90 %
des 235 millions de dollars représentant
le coût du projet de renforcement de
l'approvisionnement en eau de Dakar. Ils ont cependant
exigé que les 10 % restant soient
autofinancés par la Société d'Etat sous
forme d'un prêt commercial à lever auprès du marché
financier national ou régional.
En 1996, l'opérateur privé retenu après un
appel d'offres international est un groupe constitué
de SAUR international (filiale du groupe
français Bouygues) et de GTHE (Société
sénégalaise). Leur partenariat a abouti
à la création de la Sénégalaise des eaux
(SDE) qui
prend en charge l'exploitation du service de l'eau et
verse des redevances à la Société
nationale des eaux du Sénégal (SONES) qui
est une société de patrimoine. Un contrat
d'affermage lie ces deux sociétés et l'Etat.
Graphique 1. 1 : les acteurs du sous secteur de l'eau
potable
Source : établi par l'auteur
Le premier contrat est un contrat de concession qui lie
l'Etat et la SONES. L'Etat est en
charge des orientations générales de la
politique de l'eau au Sénégal et garant de la
transparence des décisions. La SONES a un rôle
de reporting de l'action de la SDE auprès de
l'Etat, d'approbation de plans triennaux
d'investissement et de maîtrise d'ouvrage des
nouveaux investissements. Ce contrat de concession est
complété par un contrat de plan, signé
entre l'Etat et la SONES qui définit de
façon plus détaillée la programmation des
investissements.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
15

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Le deuxième contrat est un contrat d'affermage, qui
lie l'Etat, la SONES et la SDE. Ce
contrat a une durée relativement courte de 10 ans,
prolongeable 5 ans et est complété par un
contrat de performance, établi pour une durée de 3
ans qui définit des objectifs quantitatifs en
terme techniques et financiers.
La réforme du secteur de l'eau au Sénégal
n'est pas une nouveauté en Afrique subsaharienne.
Il faudrait noter que les expériences de la Cote d'Ivoire
et de la Guinée sont les plus anciennes
et dégagent un bilan que la part des observateurs
qualifient de positif, même si le cas de la
Guinée suscite plus de prudence.
En Cote d'Ivoire, la SODECI, entreprise privée
à capitaux détenus à 52% par des
intérêts
nationaux, à 46 % par la SAUR,
société française de distribution d'eau et 2% par
un fond
d'investissement public, à la concession du service
d'approvisionnement en eau en milieu
urbain. Installée au moment de l'indépendance de la
Cote d'Ivoire, la SAUR qui deviendra la
SODECI a bénéficié de contrat
d'affermage et de gérance avant d'être actuellement
concessionnaire. Elle apparaît comme un exemple de
réussite d'une entreprise privée assurant
un service public en Afrique si l'on en juge par la
qualité de service, la cotation de ses titres à
la bourse d'Abidjan, les dividendes distribués
à ses actionnaires et enfin le fait qu'elle
s'acquitte régulièrement des impôts.
La Guinée a un schéma institutionnel
différent de la Cote d'Ivoire. Le schéma adopté
consacre une société de patrimoine : la
société nationale des eaux de Guinée (SONEG) et une
Société d'économie mixte la SEEG
(Société d'exploitation des eaux de Guinée) qui a
en
charge l'exploitation des réseaux que lui confie la
SONEG selon un contrat d'affermage de
dix ans à compter de 1989. Cette dernière
supervise l'activité de la SEEG selon des
procédures définies de manières
contractuelles.
Le choix institutionnel du Sénégal présente
la même ossature que celui de la Guinée à savoir
l'option de l'affermage. Toutefois au niveau du partage
des responsabilités entre les acteurs
que sont l'Etat, la société publique et le
partenaire privé (le fermier), le choix du Sénégal se
différencie sensiblement de celui de la Guinée.
C'est ainsi qu'au Sénégal les obligations qui
pèsent sur le fermier vont au-delà de
l'habituel en la matière et sortent du stricto sensu des
contrats d'affermage en mettant à la charge de ce dernier
un certain nombre d'obligations en
matière de travaux.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
16

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
III- Les obligations contractuelles et les
engagements
Comme indiqué ci - dessus, la réforme
institutionnelle du secteur a abouti à la privatisation de
la SONEES et à la création d'une
société de patrimoine (SONES) et d'une
société
d'exploitation (SDE). Dans le Contrat d'affermage, signé
entre l'Etat et ces deux sociétés, il
est indiqué les obligations de chaque partie.
III 1 - La société de patrimoine
En ce qui concerne les investissements, il est bien
stipulé dans le contrat d'affermage : « la
SONES s'engage à réaliser, dans les
conditions précisées, les investissements nécessaires
pour le renouvellement et l'extension de l'infrastructure en
fonction de la politique de gestion
des ressources en eau, et de la définition de la politique
tarifaire, développée par le Ministère
chargé de l'Hydraulique ».
La réalisation de ces investissements devra cependant
être programmée dans le plan directeur
de l'hydraulique urbaine, et basée sur la politique et les
possibilités financières du secteur.
Ce plan directeur de l'hydraulique urbaine est
préparé par la SONES en concertation avec la
société d'exploitation (SDE), et soumis
pour l'approbation au Ministère chargé de
l'hydraulique et au Ministère chargé des Finances.
La SONES devra obtenir l'approbation de
ce plan avant la fin du mois de juin de l'année en cours.
Une fois le plan directeur approuvé,
la SONES devra proposer un programme triennal glissant
d'investissements compatibles avec
l'équilibre financier du secteur, qui sera
intégré dans une convention programme
d'investissements. Pour la SONES, comme pour la SDE
chaque convention programme,
surtout en ce qui concerne le moyen terme doit
être établi en distinguant : les travaux de
renouvellement, les travaux neufs d'extension et
de renforcement et les travaux
d 'établissement des branchements.
Pour les travaux prévus dans le programme
d'investissements, la SONES devra trouver le
financement, elle devra surtout constituer un fond (fond
propre) pour le renouvellement de
l'infrastructure. Cependant ce fond ne devra pas être
utilisé pour le renouvellement du réseau
de distribution, qui est du ressort de la société
d'exploitation.
III 2 - La société d'exploitation
Selon les termes du contrat d'affermage, les
investissements pour le renouvellement et la
réhabilitation du réseau de distribution et
des branchements sont du ressort de la société
d'exploitation (SDE).
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
17

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Ainsi la SDE est tenue d'assurer les investissements
nécessaires pour le renouvellement du
matériel d'exploitation, des canalisations, des
branchements et des équipements électriques et
électromagnétiques (d'une valeur maximale CAF
Dakar de 15 millions de francs CFA).
Pour tous ces renouvellements, des obligations ont
été définies dans le contrat de performance
en termes de kilomètres de canalisations, de
nombres de branchements et de compteurs à
poser.
Des différends existent souvent, ceux ci portent sur la
prise en charge du renouvellement, qui
de la SDE ou de la SONES doit faire les investissements
? La SDE essaye toujours de
surestimer le coût des renouvellements à faire, car
quand les investissements sont supérieurs à
15 millions FCFA, c'est du ressort de la SONES.
Il faut surtout souligner qu'en ce qui concerne les
investissements de son ressort, la SDE pour
des raisons de calculs de profits, n'engage pas non plus
facilement des financements et préfère
toujours ( même si cela doit prendre beaucoup de
temps ) se lancer dans une discussion
interminable avec la SONES.
Au-delà de cela, certains investissements ne sont
pas toujours effectués, surtout en ce qui
concerne les entretiens des ouvrages et la
préservation des ressources en eau. Les entretiens
des infrastructures constituent un élément
vital pour assurer une bonne qualité de service et
une meilleure préservation des ressources. Cependant la
SDE est beaucoup plus intéressée par
le recouvrement des factures.
III 3 - L'Etat
Les obligations de l'Etat ont été aussi bien
définies dans le processus. Elles concernent
notamment le paiement régulier des factures d'eau de
l'administration et aussi le réajustement
des tarifs suivant les besoins pour assurer
l'équilibre financier de la SONES. Pour
l'exploitation (SDE) l'ajustement tarifaire se fait
annuellement par indexation comme prévu
par le contrat d'affermage.
S'il est vrai que les parties co-contractantes doivent
avoir à l'oeil les accords signés, il faut
néanmoins reconnaître qu'on ne peut tout
prévoir et un contrat, si il est rédigé soit-il, ne peut
jamais couvrir tous les risques.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
18

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
IV -Les risques identifiés dans le
partenariat public privé
Nous avons identifié deux types de risques dans
l'expérience en cours au Sénégal. Ceux liés
à
l'attitude des parties face aux contrats et ceux
liés à l'inscription de ces contrats dans une
certaine durée.
IV 1 - L'attitude des parties face aux contrats
Les contrats (de concession, d'affermage et de performance)
campent bien les obligations de
chaque partie. Le contrat d'affermage, qui définit plus
particulièrement les relations entre les
partenaires public ou privé, prévoit des
procédures de sanctions en cas de non-exécution de
ces obligations par l'une des parties, mais est-ce suffisant et
dissuasif ?
IV 1-1- La perte de vue des contrats
En cas de problème, il est possible que les parties, par
méconnaissance des contrats, cherchent
des solutions sans se référer à
ceux-ci. Il n'est pas certain que la solution retenue soit
conforme aux stipulations contractuelles. Le cas s'est produit
s'agissant du reversement de la
TVA sur l'eau. La SONES et la SDE en ont fait tous les deux leur
affaire et prorata de leurs
encaissements assis sur le prix de l'eau facturé
aux abonnés. Or une lecture du contrat
d'affermage montre que c'est au fermier de collecter et de
reverser pour le compte de l'Etat
tous les impôts et taxes assis sur l'eau et qui sont
à la marge des usagers.
IV1-2
- Le risque de coalition
Le contrat d'affermage étant triparties, il y a des
risques de coalition de deux parties contre
une. L'Etat et la SONES peuvent prendre une position contre le
fermier en considérant qu'ils
ont une communauté d'intérêt en tant
que secteur public. A l'inverse, l'Etat peut interférer
dans la relation SONES/SDE et plaider pour le
fermier au lieu d'arbitrer en toute
indépendance.
IV1-3
-Le Non-respect des engagements contractuels des partenaires
Ceci induit des risques d'exploitation dont l'ampleur peut
compromettre la réussite du
partenariat et de la réforme.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
19

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
a)- Le risque de non performance du partenaire
privé
Un mauvais recouvrement de la facturation des
abonnés toutes catégories confondues peut
résulter du manque de performance de la SDE et constituer
un enjeux financier important en
même temps que de réduire les performances
techniques. Le professionnalisme du partenaire
privé, la SAUR, devrait réduire ce risque
sans l'éliminer car il est lié à deux autres
risques
dépendant de la SONES et surtout de l'Etat.
b)- Le risque de non-respect des obligations de la SONES
La SONES est une entité distincte de l'Etat
dotée de moyens financiers (fonds propres,
recettes courantes et emprunts) pour réaliser ses propres
obligations conditionnant la réussite
de la réforme. Du respect de ses obligations
dépendra le respect des performances techniques
et commerciales de la SDE. En effet, les performances
contractuelles du fermier dépendent
largement de la qualité de l'infrastructure qu'il
exploite. L'exigence de résultat qui pèse sur
lui n'aura de véritable mesure que par la qualité
des moyens mis à sa disposition, le reste sera
complété par son savoir-faire.
c)- Le risque de non-paiement de l'Etat
Au niveau préventif, les différents contrats en
cours contiennent des stipulations destinées à
améliorer le paiement de l'Etat de ses factures d'eau :
crédit client de 4 mois, mise en place de
procédure de certification et de liquidation
des factures de l'administration et ses
démembrements et enfin mise en oeuvre d'un plan
destiné à réduire les pertes et gaspillages
d'eau. Au niveau curatif, le contrat d'affermage reconnaît
expressément au fermier le droit de
suspendre la fourniture d'eau à l'Etat.
Il faudra du temps avant de classer l'Etat parmi les
bons ou les mauvais payeurs, certains
risques ne s'appréciant que dans la durée.
IV 2- Les risques liés à
l'inscription des contrats dans la durée :
Le contrat d'affermage a durée
déterminée et longue; cela présente des risques
tant pour le
fermier que pour l'autorité affermante
déléguée. Mais c'est précisément la
répartition des
risques qui crée le PPP.
Dans le système de l'affermage mis en place au
Sénégal, les risques pèsent sur tous les
partenaires.
IV 2-1- Le risque de marché
On désigne par ce terme les écarts
éventuels entre les prévisions ayant servi de base
à
l'examen de la viabilité financière et
économique du service à satisfaire et la demande réelle
à
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
20

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
satisfaire. Au Sénégal, ce risque se
présente plutôt en terme de capacité, de volonté de
payer
des clients et d'un correct recouvrement des coûts, car la
demande insatisfaite est importante.
En est-il de même pour la demande insolvable ?
IV 2-2- Le risque de dépassement des
coûts d'exploitation
Ce risque est laissé à la charge du partenaire
privé ; toutefois il est réduit grâce à la mise en
place d'une formule d'indexation tarifaire. De ce fait,
le partenaire privé, au travers du
consommateur final, assume l'essentiel du risque car il y
a un niveau de prix qui sera
socialement et politiquement difficile à accepter pour les
populations.
IV 2-3- Les risques liés au contrôle de
l'exploitation
Les contrats de concessions et d'affermage autorisent
le partenaire public (SONES) à
contrôler l'opérateur privé (SDE) au triple
plan de la gestion technique, commerciale et de la
qualité de l'eau. Les risques à ce niveau sont de
deux ordres :
a)- L'opacité des systèmes
d'information entre les partenaires
Dans sa phase active, le partenariat repose sur des
échanges d'informations entre les acteurs.
Le fermier est tenu en particulier de produire des
informations fiables et exhaustives à
l'autorité affermante déléguée
à des fins de contrôle et d'évaluation de la bonne marche
du
service affermé. Dans l'expérience en cours,
beaucoup de difficultés ont surgi au départ dans
l'organisation des procédures de transmissions de
l'information de la SDE vers la SONES.
Aux réticences de la SDE qui assimile le
contrôle à un « marquage à la culotte »,
s'ajoute
aussi la démarche tendance autoritaire de la SONES.
b)- Le manque de confiance entre les partenaires
L'expérience du partenaire SONES/SDE relève un
climat de méfiance entre les parties. Il est
difficile de situer l'origine de cette situation tant elle a
été soudaine. Tout porte à croire que
les deux partenaires n'ont pas cherché à se
laisser un temps d'observation et d'adaptation.
Chaque société a précipité les
changements de mentalité nécessaires au sein de ses
employés
en les sensibilisant sur la portée des missions
assignées et la ferme volonté de ne pas échouer.
Cette situation a conduit un déficit de communication qui
a engendré des rapports lâches entre
les partenaires. Les circuits d'informations entre la SONES et la
SDE sont devenus plus longs
parce que les supports sont soumis à une sorte de «
comité de censure » avant leur envoi au
partenaire. Cela a entraîné une sorte de repli sur
soi de chaque entité et de ses employés, ce
qui ne simplifie pas les relations de proximité qui sont
vites assimilées à de la délation.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
21

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
L'organisation du jeu n'explique-t-elle pas quelque part le
comportement des acteurs. Or à ce
jeu personne n'est gagnant. D'importantes
réalisations doivent être faites pour asseoir la
confiance.
V/- Les Réalisations
Il ne faut pas oublier qu'en 2002, 24 % des habitants
de Dakar et 43 % des habitants des
autres centres urbains n'avaient pas accès à ce
type de branchement. Pour ceux-ci, le PEPAM
(Programme d'Eau Potable et d'Assainissement du
Millénaire) fixe des objectifs ambitieux à
l'horizon 2015. Il vise à desservir 1,64 million de
personnes supplémentaires, dont une grande
partie n'est pas capable d'assurer le financement de l'extension
du réseau. C'est pour cela que
la facilitation de l'accès au service est un enjeu majeur
de la prochaine décennie.
Au Sénégal, il existe essentiellement deux modes
d'adduction d'eau potable répondant à des
normes de qualité sanitaires satisfaisantes :
l'alimentation au domicile par branchement
particulier et la fourniture d'eau à des bornes fontaines
collectives.
V 1- Les branchements particuliers
L'objectif affiché par l'Etat sénégalais
est d'offrir sur le long terme la possibilité à chaque
ménage de disposer d'un branchement particulier,
c'est-à-dire d'un branchement amenant
l'eau au sein de l'habitation. La démarche standard est
que le futur abonné, qui ne dispose pas
encore d'un tel branchement, finance les frais liés
à la fourniture et à la pose de celui-ci. Dans
le cas du Sénégal, dès le démarrage
des projets sectoriels dans le domaine de l'eau, la finalité
de desserte des plus pauvres a été
fixée comme une priorité. De nombreux ménages ne
disposent pas des ressources financières suffisantes
pour payer le branchement (dont le coût
est en moyenne de 100 000 à 200 000 FCFA).
Pour permettre l'accès au réseau à ces
populations relativement pauvres, un programme de
branchements sociaux a été mis en place.
Techniquement, il n'existe aucune différence entre un
branchement normal et un branchement
social : le diamètre du branchement est identique, le
matériau est le même et la méthode de
pose ne varie pas. La seule différence est donc
financière. Si un ménage remplit les conditions
d'accès au programme, il bénéficie
gratuitement de la connexion au réseau.
Cette politique a pris de l'ampleur à partir des
années 2000. Ceci s'explique moins par des
raisons politiques que par une disponibilité de
financements offerts par les bailleurs de fonds,
qui ont été orientés prioritairement
vers cette politique d'accès. Le coût moyen d'un
branchement social est estimé à environ 100
000 FCFA. Sur la période 1996-2005, la
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
22

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
réalisation d'environ 105 000 branchements a donc
représenté un coût global de 11 milliards
FCFA, supporté quasi-intégralement par des
financements extérieurs.
Graphique 1. 2 : Nombres de branchements sociaux
réalisés et projetés de 1996 à 2011.
V 2- L'extension des bornes fontaines
Les bornes-fontaines sont des points d'eau situés
sur l'espace public et auprès desquels les
populations non raccordées viennent directement
s'approvisionner. Leur gérant peut être un
employé de la société de distribution
d'eau, un travailleur indépendant, un délégué
d'une
association d'usagers ou encore un représentant
d'ONG. Il est soit rémunéré par un salaire
fixe soit par un salaire variable correspondant entre la
différence entre le prix payé à
l'opérateur et le prix facturé au client final.
Les bornes-fontaines ne constituent pas un mode
d'approvisionnent marginal. En 2002, on
estimait que 18 % de la population de la zone couverte par la
SONES/SDE s'approvisionnait
auprès de ces bornes (PELT 2004). A la fin de
l'année 2004, on recensait 3 688
bornes-fontaines pour un volume total facturé
d'environ 5 % (rapport SONES 2005). La
consommation par personne s'établissait ainsi à
environ 17 l/j/pers.
Tableau n°1.1 : Comparaison du service
rendu par les bornes-fontaines et les branchements
particuliers. (Annexe)
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
23

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
VI- La politique de tarification
Au Sénégal, le choix s'est porté pour
les abonnés domestiques sur une tarification en trois
tranches (tranche sociale, tranche pleine et tranche
dissuasive) pour lesquelles le tarif varie
dans un rapport de un à quatre. Les abonnés
non domestiques (administrations, industries)
payent un tarif correspondant au tarif de la tranche dissuasive,
car ils sont considérés comme
ayant un pouvoir d'achat suffisant pour pouvoir financer
l'eau à un prix supérieur. L'eau
distribuée par les bornes-fontaines est vendue
à un prix intermédiaire entre le tarif de la
tranche social et de la tranche pleine. Enfin, les
maraîchers, qui utilisent l'eau à des fins
d'irrigation, bénéficient d'un tarif faible lorsque
leur consommation ne dépasse pas un quota
Q, puis d'une tarification croissante dans le but d'encourager
une économie de la ressource.
Tableau n°1.2 : grille tarifaire (annexe)
A la signature du contrat, l'autorité
concédante souhaitait que l'opérateur privé apporte
sa
compétence pour améliorer deux facteurs
clés de la distribution d'eau : le taux de
recouvrement des factures et les pertes en réseau
. L'opérateur privé est donc rémunéré
en
fonction d'un prix par m3, appelé prix exploitant P e.
Le prix exploitant est réévalué chaque
année en fonction de la structure de coût de
l'exploitant, afin de couvrir ses frais de gestion,
de personnel, les investissements à sa charge ainsi
qu'une marge bénéficiaire. On parle de
structure tarifaire cost-plus. La différence entre
le prix moyen P m et le prix exploitant est
reversé d'une part à l'ONAS, en charge de
l'assainissement lorsque le secteur bénéficie de
l'assainissement collectif, et d'autre part à la SONES.
Celle-ci, grâce à ce prix patrimoine Pp
finance les dépenses d'investissements, de personnel ainsi
que le recouvrement des emprunts.
7
8
Sur les secteurs assainis, on a donc : Pmoyen
assainis : Pmoyen = P e + P p.
= P + P + P
e p
ONAS, et sur les secteurs non
On constate que le prix patrimoine s'est fortement
apprécié dans la période 1997-2004 (+ 33
%) tandis que le prix fermier a connu une hausse plus
modérée de 8 %.
7
Le taux de recouvrement ou taux de collecte est
défini comme le rapport du montant perçu au titre des
factures d'eau sur le montant émis. Ce taux est souvent
crucial pour l'équilibre financier du secteur et sa valeur
varie fortement selon les pays. Ainsi, la NCWSC à
Nairobi rapporte un taux de collecte de 63 % et celui de la
ville de Dar es-Salaam est même inférieur
à 60 %, ce qui ampute grandement le budget de ces compagnies
publiques (Trémolet 2005).
8
d'eau produit. Les raisons de perte sont multiples : fuites,
compteurs déficients, branchements clandestins.
Le taux de perte du réseau est défini comme le
rapport entre le volume d'eau perdu dans le réseau et le volume
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
24

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Source : SONES
Graphique 1. 3 : Evolution des prix entre 1997 et 2004
La rémunération des parties se veut
doublement incitative. D'une part, la rémunération est
proportionnelle au volume produit, ce qui incite les deux
parties à accroître la production.
D'autre part, l'opérateur privé est
intéressé aux deux objectifs que l'autorité
concédante lui a
fixé, le taux de fuite dans le réseau et le taux de
facturation. La formule de rémunération de la
SDE est donc la suivante :
RémunérationSDE
Avec
= Vol
produit
[P . + P
e e
moyen. ( )]
r
e
e : rendement contractuel défini dans le contrat9
:rr endement réel constaté10
La première partie de cette formule Vol produit
. P e. e correspond à la formule classique de
rémunération d'un affermage qui est proportionnelle
au volume livré et au prix exploitant.
La deuxième partie de la formule P
moyen
( ) correspond au risque porté parr?
r
e
l'opérateur privé s'il n'atteint pas ses
objectifs en terme technique (taux de fuite) et
commercial (taux de facturation). De son côté,
la rémunération de la SONES, société de
9
Le rendement contractuel correspond au produit de
l'efficacité technique (ETC) et de l'efficacité commerciale
(ECC) définis dans le contrat avec :
ETC : efficacité technique (soit 1 moins le taux de perte
du réseau) définie dans le contrat,
ECC : efficacité commerciale (ou taux de facturation)
définie dans le contrat.
10
commerciale (ECR) réalisés l'année n avec :
ETR : efficacité technique réelle constatée,
ECR : efficacité commerciale réelle
constatée
Le rendement réel constaté correspond au
produit de l'efficacité technique (ETR) et de
l'efficacité
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
25

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
patrimoine, ne dépend pas de la performance technique et
commerciale de l'opérateur privé.
Elle est déterminée par la différence entre
le prix moyen et le prix fermier.
RémunérationSONES
= Vol
produit (P
moyen - P )
e
e
Les deux paramètres sur lesquels la SONES peut
intervenir sont le volume produit, qui
dépend des investissements réalisés pour
accroître la production et le prix moyen, qui est fixé
par la SONES en accord avec le ministère de
l'Hydraulique. Cette formule de rémunération
est remarquablement équilibrée. En effet, elle
lie de façon claire les risques financiers et les
objectifs de chaque partie, ce qui est une
règle de base de l'ingénierie contractuelle.
Explicitons cela par un exemple concret :
Tableau n°1.3 : Conséquences
tarifaires pour la SONES et la SDE dans différents cas-types
(annexes)
Le choix d'une grille tarifaire identique sur le plan
national et à blocs croissants implique
deux péréquations que nous allons
détailler ci-dessous : une péréquation spatiale et
une
péréquation entre usagers du service d'eau.
VI 1- Une tarification identique sur tout le
périmètre affermé
Le choix politique et technique d'appliquer une
tarification unique sur tout le périmètre
affermé induit des péréquations spatiales.
En effet, les coûts diffèrent d'une ville à l'autre en
fonction des caractéristiques de production et de
distribution.
Les recettes diffèrent également en
fonction du type de consommation (industriels,
maraîchers, usagers domestiques) et de leur niveau de
consommation.
En effet, il est très complexe d'isoler pour
chaque secteur de distribution les coûts
directement ou indirectement imputables à la desserte de
ce centre. Certains actifs sont utilisés
en commun par plusieurs centres, d'autres sont
spécifiques. La comptabilité de la SONES et
11
de la SDE ne permet pas cette analyse fine pour le moment . En
revanche, il est possible de
connaître le montant moyen du m3 facturé au
niveau de chaque centre et d'en déduire les
différences de recette selon les centres.
11
Dans le cas du Sénégal, il est
particulièrement difficile de savoir si les coûts sont plus ou
moins importants à
Dakar par rapport aux autres centres urbains. En effet,
deux effets produisent un effet contraire. Pour la
production et l'acheminement de l'eau, les coûts
sont bien supérieurs à Dakar car l'eau est pompée
au lac de
Guiers situé à près de 300 km de
Dakar. En revanche, concernant les coûts de distribution, la
densité d'abonné
est plus élevée à Dakar et par effet
d'échelle, les coûts liés à l'amortissement du
réseau et à la gestion sont
inférieurs.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
26

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Source : SONES
Graphique 1. 4 : Prix moyen du m selon le secteur
géographique
Au centre de Dakar, le montant facturé par m3 est
environ 28 % plus élevé que le montant
moyen sur l'ensemble du périmètre. Tous les
autres centres ont un prix inférieur au prix
moyen et bénéficient donc de subventions
croisées provenant du secteur de Dakar.
3
Source : SDE
Graphique 1. 5 : Ecarts financiers entre la ville de
Dakar et les autres centres du Sénégal
En raisonnant en termes de montants financiers, le centre
de Dakar génère environ 4,4
milliards FCFA de recettes supplémentaires qui
bénéficient à 60 % à la banlieue de Dakar et
à 40 % aux autres centres urbains du
Sénégal. Le système financier en place induit donc une
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
27

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
redistribution représentant un montant non
négligeable entre la capitale et les autres centres
urbains.
VI 2- La tarification différenciée
selon les usagers et leur consommation
Tous les usagers ne payent pas l'eau le même prix.
Si le coût moyen de l'eau est de 419
12
FCFA , il est facturé en moyenne à 268
FCFA aux maraîchers, 372 FCFA aux usagers
domestiques et 639 FCFA aux usagers non domestiques. Ces
différences de prix impliquent
que des transferts financiers internes ont lieu entre
classes d'usagers. Certaines catégories
payent davantage et subventionnent les autres
catégories. Si l'existence de ces transferts est
largement reconnue, aucune étude à notre
connaissance ne les a quantifiés. Le service est
offert à des prix différents en fonction de
la capacité des usagers à payer (niveau de
facturation supérieur pour les industriels)
ou de choix politique (tarifs fortement
subventionnés pour les maraîchers).
Le premier constat est qu'une seule classe d'usager est
contributrice nette au système. Il s'agit
des usagers non domestiques (administrations, industries,
écoles) qui consomment 27 % du
volume global et assurent 41 % des recettes. Les principaux
bénéficiaires sont les usagers
domestiques qui sont les plus gros consommateurs avec 62 % du
volume global et qui
Source : données SDE pour la période 2005-2006
Graphique 1. 6 : Part des recettes et des consommations
selon la classe d'usager
12
Données 2005-2006 en montant HT.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
28

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
financent le service à hauteur de 53 %. Partant de ce
constat, on s'intéresse maintenant aux
flux financiers entre classes d'usagers. En 2006, le chiffre
d'affaire lié aux factures d'eau est
13
estimé à 45 milliards FCFA .
Le montant des transferts compté positivement pour les
bénéficiaires et négativement pour les
contributeurs est de 6 milliards FCFA soit 13 % du total.
Source : données SDE
Graphique 1. 7 : Représentation
agrégée des flux financiers entre les différentes classes
d'utilisateurs
Si cette figure quantifie les effets redistributifs d'une
tarification différente par classes
d'usager, elle ne permet pas d'évaluer les
péréquations réalisées au sein de chaque classe du
3
fait de la tarification par bloc croissant. Ainsi, si le
prix moyen du m payé par l'usager
domestique est de 372 FCFA, le tarif social n'est que de 179 FCFA
contre 620 FCFA pour la
tranche dissuasive.
Ce que l'on considère ici sont les transferts
entre tranches de consommation au sein d'une
même classe d'usagers et non les transferts entre usagers.
En effet, un ménage qui consomme
3
un volume supérieur à 20 m par mois,
bénéficie d'une « subvention » pour les dix premiers
3
m qui sont facturés au prix de la tranche
sociale et d'une « pénalité » pour le volume
3
consommé supérieur à 20 m . Il est
donc à la fois bénéficiaire et contributeur du
système
tarifaire. Il n'en reste pas moins que l'on peut faire
l'hypothèse en première approximation
13
Données SDE.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
29

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
14
que les ménages ont « un comportement
économiquement rationnel » . Ils accorderont une
attention d'autant plus importante à leur consommation
d'eau que leurs revenus sont faibles.
Si l'on détaille les transferts au sein de la classe des
usagers, on obtient le résultat suivant :
Source : données SDE
Graphique 1. 8 : Représentation
détaillée des flux financiers au sien de la classe des usagers
domestiques
Les usagers domestiques sont bénéficiaires nets des
redistributions. La représentation détaillée
des flux permet de préciser qui sont les
réels bénéficiaires. En effet, les tarifs de la
tranche
normale et de la tranche dissuasive sont supérieurs
au tarif moyen et le véritable transfert
s'opère vers la tranche sociale. Ainsi, en plus
des 3,8 milliards de FCFA issus de la
péréquation avec les usagers non
domestiques, les bénéficiaires de la tranche sociale
bénéficient de 5 milliards FCFA de
péréquations au sein des usagers domestiques. Au total,
ces transferts au profit de la tranche sociale totalisent
donc plus de 20 % du produit de la
vente d'eau.
14
Par " économiquement rationnel ", on entend que les
usagers sont conscients qu'ils sont facturés au volume et
que donc le montant de leur facture augmente avec le volume
utilisé.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
30

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Des péréquations s'opèrent
également au sein de la classe des maraîchers mais
l'ampleur
financière des transferts est anecdotique.
VII- Un modèle spécifique au
milieu rural
La gestion en milieu rural ne peut être
considérée comme une gestion en milieu urbaine « en
miniature ». En effet, des problèmes de
gestion spécifiques se posent dans le cadre de
communautés rurales et le modèle de gestion doit
être adapté à ces spécificités.
Tableau n°1.4 : Comparaison entre types de
gestion en milieux rural et urbain. (Annexe)
VII 1- Comment accroître
l'efficacité d'une gestion locale ?
Le milieu rural était le grand oublié de la
réforme du secteur de l'eau en 1996 au Sénégal. Le
programme Regefor (Réforme de la gestion des
forages), mis en place en 1999 grâce à un
financement AFD(Agence Française de
Développement), avait pour but d'expérimenter un
nouveau mode de gestion en milieu rural. Il s'appuie sur les
communautés et vise à ce que les
coûts d'exploitation et de maintenance soient
couverts par les usagers du service. Depuis
1999, ce programme touche une centaine de forages sur les mille
que compte le secteur rural
au Sénégal.
Le secteur privé local informel joue ainsi un
rôle très important dans la gestion de l'eau en
milieu rural. C'est sur le gérant, non
déclaré et faisant donc partie du secteur informel, que
s'appuie l'ASUFOR pour le service d'eau et il doit
être capable à ce titre de tenir une
comptabilité simple et de recouvrer les factures.
Globalement le prix de l'eau est moins élevé qu'en
milieu urbain (entre 200 et 250 FCFA le
3
m contre 431 FCFA). Ce prix est déterminé
par l'ASUFOR (Association d'usagers de
forages) elle-même. En revanche, au sein de
chaque village, le prix de l'eau est
systématiquement plus élevé aux
bornes-fontaines par rapport aux prix pratiqués pour les
branchements particuliers. Le surcoût peut aller de
30 à 300 FCFA par m3. A ce titre, le
système tel qu'il est mis en oeuvre n'est pas
particulièrement favorable aux populations les
plus pauvres ou les plus éloignées du
réseau.
VII 2- Les modèles de gestion urbaine et
rurale peuvent-ils converger ?
On pourrait craindre que le choix de deux modes de gestion
différents dans le secteur urbain
et rural conduise à un système à deux
vitesses. Les habitants des zones urbaines payent plus
cher mais disposent majoritairement à domicile d'une
eau en grande quantité. Les habitants
des zones urbaines payent moins cher un service moins performant
majoritairement fourni par
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
31

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
des bornes-fontaines en plus faible quantité. Or, les
petits centres ruraux sont appelés à croître
et atteindre une taille critique qui justifierait une
évolution du système de gestion. Les acteurs
du secteur de l'eau sont bien conscients du défi
à relever pour ces centres « semi urbains ».
L'un des axes de réflexion concerne le
développement et la professionnalisation du secteur
15
privé local afin de rendre deux services : la
gestion des ouvrages
16
forages .
et la maintenance des
Sur une centaine de forages, c'est l'entreprise Equip plus qui
réalise ce travail. Il serait donc
possible de réfléchir à un
modèle incluant le secteur privé local ou national pour
assurer la
maintenance. Les compétences techniques existent au
Sénégal mais il reste à démontrer la
viabilité financière de ces contrats en
établissant des 'business plans' solides. En effet, pour
l'instant, la maintenance souffre d'un déficit d'image et
le secteur privé n'est pas poussé à s'y
engager. Un autre axe de réflexion concerne le
contexte juridique. Le contexte actuel ne
permet pas au gérant privé de disposer
d'un contrat définissant ses obligations et les
conditions de sa rémunération. L'accord est oral et
donc sujet à une remise en cause en cas de
différend. Ceci représente un frein important
au développement des tâches assumées par le
secteur privé local. Dans le même mouvement
de responsabilisation de l'échelon local, une
décentralisation des responsabilités (en laissant
par exemple le choix des investissements au
niveau local, financé par une dotation de
l'Etat) au niveau des communautés rurales
accroîtrait leur implication dans le service et la
recherche de solutions adaptées au contexte
local. L'Etat conserverait ses fonctions régaliennes
de préservation de la ressource et de
définition des normes de qualité du service.
Le Sénégal a emboîté le pas
à la Cote d'Ivoire, la Guinée et la Gambie en
matière de
délégation de gestion de service
d'infrastructure. Cette expérience, qui met en relation la
SONES et la SDE, suscite, beaucoup d'espoir. Il faut la placer
dans une stratégie plus globale
de développement après la décennie de
l'ajustement structurel qui vise à faire reculer la
pauvreté et à améliorer l'environnement.
15
Gestion des ouvrages (distribution de l'eau, facturation).
Le système actuel n'autorise pas un gérant à
assurer la gestion de plusieurs forages. Or, pour des
centres urbains proches et des gérants compétents, des
économies d'échelle et un gain en savoir-faire
technique pourraient être acquis en permettant la gestion conjointe
de plusieurs forages.
16
Maintenance des forages. Officiellement, cette charge est
assumée par la DEM, qui n'a pas les moyens
humains et financiers pour entretenir plus de mille forages.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
32

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Cette monographie du secteur de l'eau au
Sénégal a permis de montrer qu'une coopération
efficace est possible entre secteur public, secteur
privé international et secteur privé local, à
condition de définir clairement les conditions
d'intervention de chaque acteur. Ainsi, le
premier a fait la preuve de sa capacité à lever des
fonds et réaliser des investissements sur le
réseau. Il a également su mettre en oeuvre, par
une politique tarifaire et de raccordement au
réseau, une action en faveur de la desserte des
plus pauvres. Le deuxième a consacré ses
efforts à l'amélioration des performances
techniques et commerciales du réseau. Le troisième,
présent mais encore trop timidement en secteur
rural, nécessite d'être encouragé afin
d'accroître sa compétence et ses
capacités de gestion, et devenir à terme un interlocuteur
fiable pour la gestion des réseaux de petits centres
urbains.
Le prochain chapitre nous permettra de modéliser
les interactions entre mode de gestion et
coûts des services d'eau afin de comparer leurs
performances.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
33

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Chapitre II: Partenariat Public Privé dans la
distribution d'eau potable : une analyse
économique
La régulation du monopole occupe une place importante dans
la littérature sur l'organisation
industrielle. Les travaux les plus anciens (Dupuit, 1849 ;
Hotelling, 1938 ; Vickey, 1948)
proposent une tarification au coût marginal permettant de
produire les quantités optimales au
sens de Pareto. Mais la présence de rendements
d'échelle croissants et la nécessité de
transferts monétaires engendrent des distorsions
économiques. L'objectif de premier rang est
jugé inaccessible ou trop coûteux. D'autres
systèmes de tarification ont alors été
proposés
pour des entreprises publiques régulées par l'Etat
et contraintes à l'équilibre budgétaire
(Ramsey, 1927 ; Boiteux, 1956).
La théorie de la régulation incitative
s'intéresse au monopole naturel en prenant en compte
les problèmes d'asymétries d'information.
L'entreprise a une information privée qu'elle
utilise à des fins stratégiques. Le modèle
Baron et Myerson (1982) étudie ce cas dans le cadre
du paradigme principal- agent où, pour
résoudre le problème de sélection adverse, le
17
régulateur définit un mécanisme
révélateur des coûts de l'entreprise . Les contrats
incitatifs
reposent sur un arbitrage entre efficacité et extraction
de rente. Une tarification Cost plus (ou
contrat de remboursement des coûts) permet de
contrôler les profits de l'entreprise mais ne
l'incite pas à réduire ses coûts. Au
contraire une tarification Price cap (de prix plafond) incite
l'entreprise à faire des économies afin
d'accroître ses profits qui ne sont pas réglementés. Les
problèmes de régulation et de
tarification des monopoles naturels sont difficilement
18
dissociables de l'analyse de leur performance . Les
services d'eau sont considérés comme
des monopoles naturels locaux. Leurs
caractéristiques, et leurs modes de gestion et de
régulation spécifiques font d'eux des cas
d'études très intéressants. L'article pionnier de
17
Le modèle de Laffont et Tirole (1986) traite un
cas plus général où s'ajoute un problème de
risque moral
(l'entreprise ne fait pas l'effort maximal pour réduire
ses coûts) mais où le régulateur peut observer ex
post (par
des audits) les informations sur les coûts qu'il ne
connaissait pas ex ante.
18
éviter le gaspillage de la ressource de
façon à ce qu'elle soit allouée aux usagers pour
lesquels sa valeur est la
grande ; 2) l'efficacité productive est processus
dynamique qui dépend des efforts d'adaptation de l'exploitation
(réhabilitation et développement des
infrastructures, formation de la main d'oeuvre, investissement en recherche
et développement, etc.) pour baisser les coûts de
production. 3) Boyer, Patry et Tremblay (1999) définissent une
autre notion d'efficacité dans le cadre de la gestion des
services d'eau qu'il nomme l'èco-efficacité et qui repose
sur l'idée de développement durable.
Les critères pour évaluer la performance des
entreprises sont : 1) l'efficacité allocative (statique) consiste
à
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
34

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Wolak (1994) étudie le secteur de la distribution
d'eau potable en Californie à partir d'un
modèle d'information privée sur les coûts. Il
montre en particulier que l'estimation des coûts
est meilleure que dans un modèle avec information
complète. Récemment Brocas et al. (2006)
reprennent ce modèle de régulation, dérivent
les solutions optimales d'une régulation rate of
return, et évaluent le coût des
asymétries d'informations. Garcia et Thomas (2003) simulent
les contrats optimaux de délégation des services
d'eau en France et mesurent les distorsions
dues aux asymétries d'information en termes de volumes
d'eau produits.
Les services d'eau peuvent être gérés
directement par L'Etat ou bien faire l'objet d'une
délégation de service public. Lorsque
l'exploitation est déléguée, l'Etat cherche à
réduire la
marge de l'entreprise tout en l'incitant à
fournir le meilleur service. Pour ces raisons, la
procédure de délégation passe par un appel
d'offres. Depuis Demsetz (1968), la concurrence
pour le marché est préconisée comme
complément voire substitut de la régulation du
monopole. Riordan et Sappington (1987) modélisent la
procédure optimale d'attribution de la
concession d'un monopole lorsqu'il y a incertitude et information
complète sur les coûts. Plus
récemment, Mougeot et Naegelen (2005) reformulent
cette théorie en faisant le lien entre
régulation du monopole à la
Baron-Myerson et procédure de mise en concurrence pour le
marché.
Notre travail s'inscrit dans ce cadre en caractérisant le
mécanisme incitatif optimal lorsque la
gestion est déléguée, équivalent
à un mécanisme optimal d'attribution du monopole.
La possibilité de choisir son mode de gestion et les
différences de prix constatées ont donné
matière à de nombreux débats dans les
milieux politiques et spécialisées sur l'organisation des
services. Seulement quelques études ont tenté
d'expliquer le choix de mode gestion des
services d'eau et son impact sur les prix. Sage (1999)
montre que le mode de gestion
n'explique pas à lui seul les différences de prix
de l'eau et la comparaison directe des prix ne
peut être satisfaisante. Ménard et Saussier
(2000) analysent le choix de mode de gestion à
partir de la théorie des coûts de
transaction. Ils montrent que ce choix est guidé par des
décisions économiques plus que par des
facteurs politiques. Aucun avantage absolu d'un
mode de gestion sur l'autre n'est mis en évidence
et la performance dépend de son bon
ajustement aux caractéristiques de la transaction.
Glachant et Miessner (2003) cherchent à
identifier l'influence des facteurs organisationnels sur les prix
des services d'eau.
19
19
On parle de rente informationnelle car elle est liée au
déficit d'information de l'Etat sur l'entreprise et / ou sur
le réseau. Le problème existe également
dans le cas d'une gestion directe où les services techniques
de la
commune peuvent dissimuler, sciemment ou non, au conseil
municipal certaines informations ou certaines de
leurs actions sur le plan de production afin de profiter de rente
de situation.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
35

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Les résultats montrent que la délégation et
l'intercommunalité entraînent des prix élevés
à la
fois pour l'Alimentation en Eau Potable (AEP) et
l'assainissement, mais cela peut être nuancé
par les conditions d'exploitation initiales et des
qualités de service différentes. Carpentier et
al. (2005) proposent d'évaluer les effets du mode de
gestion sur le prix de l'eau. La méthode
des effets de traitement leur permet d'identifier la composante
des écarts de prix qui est due à
des effets non observés, selon le mode de gestion.
Il est montré que l'écart de prix est
expliqué en partie par des conditions d'exploitation
différentes, ce qui justifierait les prix plus
élevés observés en gestion
déléguée.
Notre objectif est d'étudier les interactions entre
mode de gestion et coûts d'exploitation du
service d'eau. L'Etat qui est responsable de l'organisation des
services d'eau a deux options :
il peut gérer lui-même le service ou bien en confier
l'exploitation à une entreprise extérieure.
Dans chaque situation, il y a un bien-être
de l'Etat différent qui dépend des coûts
d'exploitation différent. Nous modélisons le choix
de mode de gestion à partir de la différence
de bien-être social. Dans le cas d'une gestion
directe des services, l'Etat est supposé
maximiser le surplus des usagers, net des coûts
d'exploitation, sous contrainte d'équilibre
budgétaire. Pour la gestion déléguée,
un modèle avec information privée sur les coûts (Baron
et Myerson, 1982) est considéré.
Notre étude économique sera organisée de la
façon suivante :
La section 1 spécifie d'abord le réseau et
la technologie du service d'eau et ensuite la
représentation économique de la fonction de
coût variable. Nous décrivons enfin le modèle
économique du choix de mode de gestion du service dans la
deuxième section.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
36

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
I- La technologie et les coûts du service
Cette section a pour objet de procéder a
une analyse de la technologie et les coûts
d'exploitation, il comporte dès lors deux sous
sections : le réseau et la technologie et la
représentation économique du coût
I 1- Le réseau et la technologie
Le secteur de l'eau se présente comme un
marché de nature monopolistique au moins pour
20
une partie de ses activités . L'AEP (Alimentation en Eau
Potable) peut être séparée en deux
activités : la production d'eau potable proprement
dite et la distribution de cette eau vers
différentes catégories d'usagers. La
distribution de l'eau potable engendre des coûts fixes
importants. La spécificité des actifs donne
à ces coûts fixes un caractère irréversible.
Par
ailleurs, l'eau est un produit lourd dont le transport est
coûteux et le stockage difficile, et les
exigences de qualité nécessitent une certaine
proximité entre les lieux de production et de
consommation.
Les coûts d'exploitation du service sont donc
engendrés par toutes les opérations ayant trait à
la desserte en eau potable depuis le
prélèvement dans le milieu naturel jusqu'au robinet de
l'usager. L'eau potable est produite à partir
d'eaux brutes souterraines ou de surface. L'eau
issue d'une nappe souterraine engendre des coûts
plus importants de forage et de pompage
alors que les coûts de traitement sont d'ordinaire plus
conséquents pour les eaux de surface.
Par ailleurs, les coûts variables peuvent être
également très différents lors de la phase de
distribution, car ils dépendent de façon cruciale
de la taille des zones desservies, leur densité
en population et la topographie.
Une partie du volume d'eau mis en distribution dans le
réseau n'atteint pas sa destination
finale, principalement à cause de pertes dues
à des ruptures de conduites ou des joints
21
fuyants . Cette spécificité doit être
prise en compte car les coûts de production et de
distribution dépendent fortement de l'état du
réseau. Le rendement de réseau calculé comme
le ratio du volume facturé aux usagers et du
volume mis en distribution est un indicateur
important pour les ingénieurs et une variable de
décision cruciale pour les gestionnaires du
20
Le secteur de l'eau possède des
caractéristiques similaires à celle d'autres
activités industrielles en réseau
(électricité, télécommunication,
transports) : structure monopolistique du marché,
prédominance de l'opérateur
historique, obligation de service public Mais en
dépit de ces caractéristiques communes, il existe
des
différences importantes entre les secteurs :
progrès technologiques, conditions de demande, globalisation des
marchés (franchissement transfrontalier dans
le secteur des transports, présence de grands
groupes
transnationaux dans le secteur de l'eau et
l'électricité par exemple), certains segments de
l'industrie sont des
monopoles naturels et d'autres plus concurrentiels etc.
21
localisables et donc rapidement réparées.
Lors de l'étape de production, les conduites de transfert
étant peu nombreuses, les fuites sont facilement
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
37

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
service. Garcia et Thomas (2001) soulignent l'existence
d'économies de coût substantielles
selon que l'exploitation choisit d'accroître la
production d'eau potable tout en maintenant
l'état du réseau inchangé ou bien de
réparer les fuites sans extraire davantage d'eau. Par
ailleurs, Garcia et Thomas (2003) montrent qu'en raison de la non
observabilité des coûts de
production d'eau potable et de maintenance du réseau de
distribution lorsque l'Etat délègue
l'exploitation du service public à un opérateur
privé, elle doit autoriser ce dernier à produire
un niveau de pertes d'eau supérieur au niveau optimal
d'information complète.
I2- La représentation économique
du coût
La représentation économique du dans le
secteur de l'eau au Sénégal reste confrontée
à de
nombreuses études de coût et de demande.
I2-1
- La fonction de coût
La modélisation et l'estimation de fonction de
coût ainsi que l'étude de l'effet du type de
propriété (public ou privé) des
services d'eau sur leur efficacité sont des sujets qui ont
été
traités par un certain nombre d'articles de
recherche empirique depuis plusieurs années.
Estache et Rossi (2002) présentent les estimations
de frontières de coûts dans le but de
mesurer l'efficacité productive des compagnies
publiques et privées chargées de la
distribution de l'eau potable dans la région d'Asie et du
Pacifique. Par ailleurs, Saal et Parker
(2000) étudient l'impact de la
privatisation et de la régulation économique et
environnementale sur la performance économique des
services d'eau en Grande-Bretagne à
partir d'une fonction de coût translog multi- produits.
Les études réalisées sur le sujet et la
description de la technologie nous permettent d'identifier
plusieurs déterminants importants des coûts
d'exploitation :
· Le volume d'eau vendu (Q) ;
· Les prix des facteurs de production (w) ;
· Des caractéristiques techniques (CAR) :
-le nombre d'abonnés desservis (A) et la longueur
du réseau (R), ou leur ratio
(Dens) ;
- le taux de rendement (rdt) ou l'indice linéaire de
pertes en distribution (B) ;
-l'origine des eaux brutes (EB) ;
- la topographie de la zone de distribution (Topo) ;
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
38

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
-le type de traitement de potabilisation (Trait).
La fonction de coût variable conditionnelle de court terme
peut s'écrire de la façon suivante :
CV= (Q, w, CAR),
(1)
où CV représente les coûts variables
(minimum). Nous avons choisi d'étudier une fonction de
coût variable (de court terme) plutôt qu'une
fonction de coût total (de long terme) pour
plusieurs raisons. D'abord, une fonction de coût variable
contient la même information que le
processus de production d'origine. Par
conséquent, une fonction de coût total faisant
l'hypothèse que tous les facteurs (y compris le capital)
peuvent s'ajuster instantanément serait
une mauvaise spécification. Enfin, nous souhaitons
minimiser l'impact de la différence de
coût du capital entre les contrats d'affermage et la
gestion publique.
I2-2
- Le coût et la demande
A partir de l'équation (1), on peut réécrire
la fonction de coût variable du service de la façon
suivante :
CV _ CV (L, _, _ c),
(2)
où CV représente les coûts variables du
service. L est le vecteur des variables explicatives
des coûts variables. Il comprend Q le volume d'eau
vendu, w le vecteur de prix des inputs et
CAR le vecteur des caractéristiques techniques
du service. Toutes ces variables sont
parfaitement observables par l'Etat et
l'économètre. _ représente l'efficacité
productive de
l'exploitation du service et _ c une erreur
traduisant l'existence d'aléas non observés sur les
coûts. _ est une variable aléatoire
non observée quelque soit le mode de gestion et reflète
l'information privée de l'exploitation dans le cas d'une
gestion déléguée. Notons CF les coûts
fixes du service qui sont considérés comme
exogènes et sont supposés ne pas dépendre du
22
mode de gestion
. Le coût total de production est la somme des coûts
variables et des coûts
fixes : CF + CV.
22
Les coûts fixes sont majoritaires supportés par
l'Etat dans la gestion directe et par le régulateur dans la gestion
déléguée. Dans certains cas d'affermage
avec clauses concessives, une partie de ces coûts est
transférée à
l'opérateur chargé de l'exploitation du service.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
39

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
La fonction de demande des usagers du service s'écrit P
(Q, _ d) où P est le prix unitaire du
service et _ d une perturbation aléatoire de la
demande. Notons S le surplus brut espéré des
usagers :
S _ S (Q)=E [ Q_ P (Q, _ ) dQ]
d
+_
(3)
II- Le choix de mode de gestion
L'Etat peut choisir soit de gérer directement le service
d'eau (indice '0') soit de déléguer son
exploitation à une entreprise spécialisée
(indice '1'). Si le service est géré par l'Etat (gestion
0
publique), les coûts sont notés CV et si le
service est délégué (gestion privée), les
coûts sont
1
notés CV . Nous supposons que l'Etat ou le
régulateur choisit le mode gestion qui lui procure
le plus haut niveau d'utilité.
II 1- La gestion publique
En 1968, après nationalisation du service public,
l'exploitation du service de l'eau potable a
été confiée à une
société publique, la Société Nationale
d'Exploitation des Eaux du Sénégal
(SONEES). Dans ce nouveau schéma, l'Etat du
Sénégal a en charge les investissements
d'extension et de renouvellement du matériel et des
ouvrages.
Cette nationalisation donnait à la SONEES la concession
du service public en lui conférant
en plus de la responsabilité de l'exploitation,
celle de la planification et de la maîtrise
d'ouvrage des travaux d'extension de l'infrastructure, de
production et de distribution.
Si on note _ o le profit de la SONEES et T la partie
fixe du tarif pour le service.
Dans le cas d'une gestion publique, l'Etat cherche à
maximiser le bien- être social espéré (le
surplus des usagers net des coûts espérés en
gestion directe) sous contrainte budgétaire :
Max S (Q)- E [CV 0 (L, _, _ c) + CF],
Q
telle que l'espérance de profit de la SONEES ne soit pas
négative :
(4)
_ o_E [T+ P (Q, _ d) Q- CV 0 (L, _, _ )
- CF] _0.
c
(5)
Ce qui revient à maximiser :
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
40

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
W o=S (Q)- E [CV 0 (L, _, _ c) + CF] -
__ o,
(6)
avec _ représentant le coût de la contrainte
budgétaire du service. La solution de la
maximisation de l'expression (6), est le prix optimal qui est un
prix Ramsey-Boiteux pour une
23
régulation Cost of service :
[P o-( CV 0 Q)] P o = (_
1+ _) (1 ff)
P o-( CV 0 Q) = P o [(_
1+ _) (1 ff)]
P -oP o [(_ 1+ _) (1 ff)] = ( CV
0 Q)
P o [1- (_ 1+ _) (1 ff)] = ( CV 0 Q)
Po = [( CV 0 Q)] [ff (1+ _)/ ff (1+ _)-
_]
(7)
où ff i=E [(dQ dP) (Q P)] est
l'élasticité de la demande des usagers du service.
Cette formule est la définition classique de l'indice de
Lerner qui dépend de l'élasticité de la
demande ff et du coût de la contrainte de
budget _ du service, autrement dit les
caractéristiques techniques.
II 2 - La gestion privée
L'opérateur privé professionnel de l'eau
désigné comme partenaire stratégique du secteur de
l'eau est la SAUR, filiale du groupe français Bouygues.
Lors de l'appel d'offre international
de sélection de la société privée
devant reprendre l'exploitation du service de l'eau, la SAUR
s'est alliée à la société
sénégalaise GTHE (Grands travaux d'hydraulique et d'entretien)
pour
soumissionner. Le schéma de privatisation du service
public de l'eau au Sénégal s'est fondé
sur l'affermage. Aux termes du contrat d'affermage du service
public de la production et de la
distribution de l'eau potable en zone urbaine, l'Etat a
confié à la SDE le droit exclusif de
produire et distribuer l'eau sur toute l'étendue du
territoire. Outre les obligations relatives à
bonne exploitation du service public, le contrat met
également à la charge du fermier un
23
Voire Laffont et Tirole (1993), p.31
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
41

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
certain nombre d'obligations en matière de travaux. La SDE
transfert une partie des revenus à
la SONES pour la réalisation des investissements. Ce
contrat est tripartie et, bien que l'Etat
soit l'autorité affermante, le contrôle de
l'exploitation est assuré par la SONES selon les
termes du contrat de concession de travaux publics
et de gestion du patrimoine de
l'hydraulique urbaine. Ainsi, elle joue le rôle d'une
agence de régulation publique.
Si l'on note r (Q), le montant de la redevance versée
à l'agence de régulation. Il est fixé en
fonction du volume d'eau vendu r (Q) = Q (Pmoyen - P e) e.
Le profit espéré de l'entreprise privée
s'écrit de la manière suivante :
_ 1 = E [T+ P (Q, _ d) Q- CV 1 (L, _, _
)- CF- r (Q)].
c
(8)
Les consommateurs maximisent leur bien-être. Le surplus
espéré des consommateurs s'écrit :
S (Q)=E [ Q_ P (Q, _ ) dQ]
d
+_
L'agence de régulation est censée maximiser la
somme du surplus des usagers et le profit de
entreprise.
Dans le cas d'une gestion déléguée,
les préférences du régulateur sont
représentées par une
somme pondérée du surplus net
espéré (U) des usagers et du profit espéré
(Re) tiré de
l'exploitation du service, fi le coefficient de
pondération. Nous suivons l'approche de Baron et
Myerson (1982) qui supposent que le surplus des usagers est
préféré au profit de l'entreprise
(fi _] 1/2, 1]). Le fi représente
l'importance que l'Etat accorde aux surplus des
consommateurs.
La SDE a une information privée sur son
efficacité productive ou son type _ i. Nous
supposons que _ i est défini par la distribution F (.),
de densité f (.), sur l'intervalle
[_, _*], où _ caractérise une grande
efficacité et _* une faible efficacité. La distribution est
connue de la SONES.
Le revenu de la SONES est donné par la formule suivante.
Re= E [r (Q) - ta]
(9)
où ta représente la taxe d'assainissement.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
42

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Soit w [0,1] est la part du profit de l'entreprise
autorisée à l'expatriation et (1-w) la part du
profit utilisé au Sénégal. Car il y a
l'entreprise GTHE chargée de certains investissements,
surtout en ce qui concerne les entretiens des ouvrages.
L'objectif de l'autorité tutelle est donc de maximiser la
somme pondérée suivante :
W1 = fi U + (1- fi) (1-w) _1
(10)
Où
U = S (Q) - E [P (Q, _ d) Q - T] + Re
(11)
Et
_ 1 = E [T+ P (Q, _ d) Q- CV 1 (L, _, _
c)- CF] - E[r (Q)].
Donc
U = S (Q) - _ 1 - E [CV 1 (L, _, _ c) +
CF] - E (ta)
W1 = fi U + (1- fi) (1-w) _1
= fi [S (Q) - _ 1 - E [CV 1 (L, _, _ c)
+ CF] - E (ta)] + (1- fi) (1-w) _1
= fi [S (Q) - E [CV 1 (L, _, _ c) + CF] - E (ta)]
- fi _ 1 + (1- fi) (1-w) _1
= fi [S (Q) - E [CV 1 (L, _, _ c) + CF] - E (ta)] -
2fi _ 1 + _ 1 - w _ 1 + fiw _1
= fi [S (Q) - E [CV 1 (L, _, _ c) + CF] - E (ta)] -
fi _ 1 (2 - 1/fi + w/fi - w)
= fi [S (Q) - E [CV 1 (L, _, _ c) + CF] - E (ta) -
((2fi - 1)/fi + w (1- fi)/fi) _ 1]
Le bien être collectif s'écrit finalement :
W1 = fi [S (Q) - E [CV 1 (L, _, _ c) +
CF] - E (ta) - ffi _ 1]
(12)
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
43

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
où ffi = ((2fi - 1)/fi + w (1- fi)/fi)
Cette fonction de bien être (gestion
déléguée) est à différencier à celle
en gestion directe parce
que nous constatons l'apparition d'une variable la taxe
d'assainissement et seul le coefficient
associé au profit doit être interprété
différemment. Remarquons aussi que les expressions du
bien être dépendent crucialement des coûts
engendrés lors l'exploitation du service.
Puisque le paramètre d'efficacité _ i n'est
pas observée par l'Etat, il maximise l'expression
(12) sous la contrainte de participation (_ (_) _ 0, ,_) et la
contrainte d'incitation (_ (_,
· ) _ _ (_*, _), ,_, ,_*, où _* n'est
pas le vrai type de l'exploitant). Le mécanisme
révélateur optimal donne le prix Baron-Myerson :
P 1-( CV 1 Q)= ffi [F (_ i) f (_
i)] [ CV 1 _ i Q]
P1 = ffi [F (_ i) f (_ )] [ CV 1 _
Q] + ( CV 1 Q)
i
i
(13)
où F et f représentent respectivement la fonction
de distribution cumulative et la fonction de
densité de _ i qui sont connues de l'Etat. Si l'Etat
organise une enchère pour attribuer le droit
de service la demande en eau portable pour le service
dans le cas où l'entreprise a une
information privée sur ses coûts, on
obtient le prix Baron-Myerson pour l'entreprise
24
sélectionnée, voir Mougeot et Naegelen (2005) .
La différence prix- coût marginal dépend du
paramètre _, du volume d'eau potable vendu
(dépendant lui-même du paramètre _ 25)
, des
caractéristiques locales du service, de celles du contrat
et son environnement.
II 3- Le choix
Le choix de l'Etat sur le mode de gestion du service d'eau
peut être décrit par un modèle à
régimes (switching model) et fonction
critère (ou équation de sélection) à la Lee
(1978).
Comme Huang et al. (2002), nos équations de
régime sont des fonctions de coût. On
considère que l'Etat préfère la gestion
privée à la gestion publique de son service d'eau si :
24
Le optimal défini par Mougeot et Naegelen (2005) est
différent du nôtre parce qu'il intègre un coût social
des
fonds public, que le régulateur est supposé
utilitariste et que le coût marginal est supposé constant.
25
l'exploitation. Dans le modèle plus complexe de
Garcia et Thomas (2003), les volumes d'eau vendu et les
volumes d'eau perdu font partie du contrat.
Le principe du mécanisme révélateur est
de faire dépendre les termes du contrat de l'information
privée de
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
44

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
1
W
0
- W > k
(14)
Ce qui signifie qu'il choisit la gestion privée si la
différence en bien être social associé à ce
choix est supérieure à une valeur de
réserve non observée. La valeur de réserve k peut
être
interprétée comme la prédisposition de
l'Etat à privatiser son service d'eau potable, et peut
ainsi être positive ou négative. On suppose que k
est fonction de la quantité d'eau vendue Q et
de caractéristiques du service CAR :
k = fi 1+fi Q+fi CAR+
2
3
(15)
où est une erreur capturant des facteurs
aléatoires non observables.
Le choix de mode de gestion du service dépend de la
différence du bien être social et donc de
la différence de coût selon le mode de gestion : W
1 - W 0 = fi 0 +- 1 (CV 1- CV
0), où CV 0 et
CV 1 sont définis par l'équation (2)
et dépendent entre autres de l'efficacité productive _ non
observée spécifique au service et
d'aléa non observés _ c. Ainsi, on peut écrire
l'équation de
sélection de la façon suivante :
1 0
I* = W - W - k
I* = fi 0 + - 1 (CV 1- CV 0) - fi 1 -
fi 2 Q - fi 3 CAR -
I* = fi 0 - fi 1 + - 1 (CV 1- CV 0) -
fi 2 Q - fi 3 CAR -
donc
I* = - 0+ - (CV 1- CV 0) + - Q+ -
CAR-
1
2
3
(16)
où - 0= fi 0 - fi 1, - 2 = - fi 2 et - 3 = - fi 3.
En particulier, si I* >0 alors l'Etat choit de privatiser
l'exploitation de son service d'eau.
La performance relative des modes de gestion des
services publics de l'eau est une
préoccupation centrale des Etats mais
également un thème de recherche important chez les
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
45

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
économistes. Cependant, les travaux sur le
secteur de l'eau proposent souvent des
méthodologies qui ne prennent pas en compte
simultanément les choix des Etats et leurs
impacts sur les coûts et les prix de l'eau, et aboutissent
à des résultats contradictoires. Dans ce
chapitre nous avons étudié les interactions
entre le mode de gestion et de régulation des
services d'eau potable au Sénégal et leurs
coûts d'exploitation. Nous avons essayé ensuite de
mettre en évidence les facteurs expliquant les rendements
et la performance du secteur.
Nous avons développé un modèle de
sélection sur les deux modes de gestion (régimes) : la
gestion publique et la gestion privée. Notre
modèle théorique montre que le choix de l'Etat
dépend de la différence de coûts
d'exploitation selon le mode de gestion et des
caractéristiques du service.
Dans le prochain chapitre nous présenterons une
méthodologie économétrique utilisée pour
évaluer la rentabilité du PPP avec des
données annuelles de l'ensemble des centres urbains du
Sénégal.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
46

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Chapitre III: Une modélisation
économétrique de la
rentabilité du Partenariat Public Privé
dans la
distribution d'eau potable
La définition du terme économétrie a
évolué depuis l'émergence de cette discipline dans les
années 1930. A l'origine, elle représentait une
voie de formalisation de l'économie par l'usage
de mathématiques, probabilités et statistiques. La
formalisation présente des avantages et des
inconvénients : elle permet d'établir des
arguments précis et rapidement compréhensibles
grâce à une absence d'ambiguïté. En
revanche, elle fait aussi apparaître le domaine plus
abstrait et accroît les barrières à
l'entrée pour les néophytes. Par ailleurs, elle peut
entraîner la
théorie dans des directions où des
théorèmes peuvent être établis, et ainsi
éviter des problèmes
économiques importants mais dont la formalisation se
révèle plus ardue.
L'économétrie appliquée utilise, quant
à elle, les développements théoriques pour analyser des
cas concrets afin d'obtenir des recommandations politiques,
de tester la théorie économique
ou de suggérer de nouvelles manières
d'améliorer cette dernière. Au vu de la rapidité
des
développements, il est essentiel pour toute personne
qui s'intéresse aux études économiques
de pouvoir en comprendre les forces et faiblesses
car des méthodes économétriques
appliquées à mauvais escient entraînent
souvent des résultats sans fondements.
Notre étude économétrique repose sur des
données sénégalaises concernant un échantillon de
services d'alimentation en eau potable en gestion privée.
Le programme de maximisation du
bien-être social est établi pour chaque mode de
gestion. Ce choix est déterminé par les coûts
d'exploitation du service et d'autres considérations
techniques.
Nous aborderons ce chapitre à partir de trois
sections, la première sera consacrée à la
construction du modèle. La deuxième section
présentera les tests et enfin dans la troisième
section quelques recommandations seront exposées.
I- La construction du modèle
Dans le cadre de l'économétrie, nous pouvons
considérer qu'un modèle consiste en une
représentation formalisée d'un
phénomène sous forme d'équation dont les variables
sont des
grandeurs économiques. En effet, les variables dans
notre analyse seront : le rendement, les
dépenses d'exploitation, les investissements, le nombre
d'abonnés desservis et l'indice linéaire
de perte en distribution.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
47

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
I 1- La spécification du modèle
Nous considérons un modèle à la
Saal-Parker (2000) que nous simplifions en rajoutant les
dépenses d'exploitation.
Considérons la fonction suivante définissant
les variables explicatives de la fonction de
rendement du secteur de l'eau au Sénégal de la
manière suivante :
Ren = Ren (DE, I, CAR)
(1)
Parmi les variables CAR, nous prenons deux variables
importantes pour la spécification du
modèle : le nombre d'abonnés desservis et les
pertes en distribution.
A partir de l'équation (1), on peut écrire
la fonction de rendement du service de la façon
suivante :
Ren = Ren (DE, I, A, B)
(2)
Avec ;
Ren = rendement ;
I = investissements ;
A = nombre d'abonnés desservis ;
B = les pertes en distribution.
L'équation (2) peut se réécrire sous la
forme suivante :
a0
a1 a2
a3
a4
Ren = e DE I A B
(3)
Nous avons un modèle simple en fonction des
dépenses d'exploitation, des investissements, le
nombre d'abonnés desservis et les pertes en distribution
par rapport aux paramètres a 1, a 2, a3
et a 4.
Les variables :
Les DE : les dépenses d'exploitation sont supposées
influencer positivement sur la fonction de
rendement et sur le choix de mode de gestion.
Les I : les investissements sont supposés avoir une
influence positive sur le rendement.
Le A : du fait de richesse et de la diversité de l'analyse
économique, le nombre d'abonnés a
un impact significatif sur la rentabilité du partenariat.
Le B : les pertes en distribution sont supposées avoir une
influence négative sur le rendement.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
48
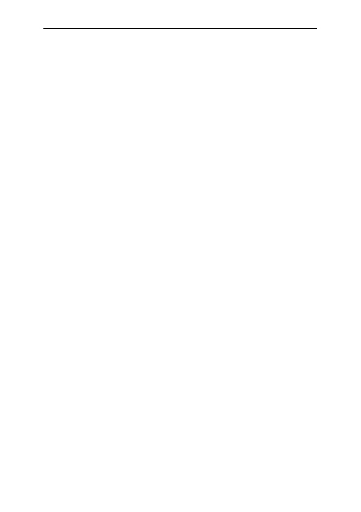
Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Les paramètres :
a 1 représente l'élasticité par rapport aux
dépenses d'exploitation a 1 = ( Ren DE).
a 2 représente l'élasticité par rapport aux
investissements a 1 = ( Ren I).
a 3 représente l'élasticité de
densité d'usagers a 3 = ( Ren A).
a 4 représente l'élasticité par rapport aux
pertes a 4 = ( Ren B).
Les hypothèses :
En principe, si les dépenses d'exploitation
augmentent, les coûts augmentent. Une
augmentation des dépenses engendre une hausse du
surplus des usagers qui à son tour
augmente le rendement. Par conséquent a 1 >0.
Une augmentation des investissements entraîne une hausse du
rendement a 2 > 0.
Si le nombre d'abonnés s'accroît, le bien-être
augmente proportionnellement donc a 3 > 0.
Si les pertes augmentent, le rendement diminue par
conséquent a 4 < 0.
· t est le terme d'erreur vérifiant les
hypothèses habituelles :
E ( t_ ) = 0, V (_ t) = . 2 et COV (_ t, _ s) = 0.
Nous distinguons pour la spécification un
modèle en série chronologique. Les variables
endogènes (Ren) et celles des variables
exogènes (DE, I, A et B) représentent des
phénomènes observés à l'intervalle
de temps réguliers (annuels) de 1996 à 2006 pour le
partenaire privé.
Le modèle s'écrit alors :
logRen t = a + a logDE + a logI + a logA + a logB + _
0
1
t
2
t
3
t
4
t
(4)
t varie de 1996 à 2006.
I 2- La description des données
Nous avons une base donnée à notre
disposition (voir annexe). Il s'agit de services de
distribution d'eau potable au Sénégal (urbain)
délégué à une entreprise privée sous
contrat
d'affermage (SDE).
Les données couvrent la période 1996-2006 et
sont principalement issues des rapports
réalisées par l'unité de coordination
du projet eau à long terme (PELT) et par la SONES à
partir des comptes-rendus techniques et financiers
établis annuellement. Ces rapports
contiennent des informations sur les
dépenses en facteurs de production, sur les
investissements des renseignements techniques sur le
réseau, ainsi que des données sur les
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
49

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
volumes d'eau etc. Une partie des données provient
également de l'ANDS, du ministère de
l'hydraulique.
Dans notre modèle, nous utiliserons également
des variables techniques comme le nombre
d'abonnés (A), représentant la taille du
réseau. L'indice linéaire de pertes en distribution (B)
est le volume des pertes (volume d'eau mis en
distribution - volume d'eau comptabilisé)
rapporter à la longueur des canalisations permet de savoir
l'état physique du réseau.
I 3- Les graphiques
L'économétrie n'est pas seulement un
système de validation, mais également un outil
d'analyse. Avec le logiciel Eviews,
l'économétrie apporte une aide à la
modélisation, à la
réflexion théorique ou à l'action
économique par la mise en évidence entre des variables
économiques, par la prévision qui est
utilisée par les entreprises afin d'anticiper et
éventuellement de réagir à l'environnement
économique.
Nous allons d'abord représenter les graphiques des
évolutions respectives de la variable à
expliquer, des variables explicatives en logarithme et le
graphique comparatif de toutes les
variables.
4.40
4.35
4.30
4.25
4.20
4.15
96 97 98 99 00 01 02
03 04 05 06
LNREN
Graphique 3. 1 : Graphique du LNRen
La variable LNREN suit une évolution croissante
globalement sur toute notre durée d'étude.
A partir de 1996 nous constatons une forte
croissance du rendement coïncidant avec
l'instauration du partenariat public privé dans le secteur
de l'eau. Nous remarquons aussi une
légère diminution du rendement à partir de
1999 qui se justifie par les différends qui existaient
souvent entre la SONES et la SDE. Après cette
période le secteur de l'eau a connu forte
expansion parce que le taux de rendement n'a cessé
d'augmenter.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
50
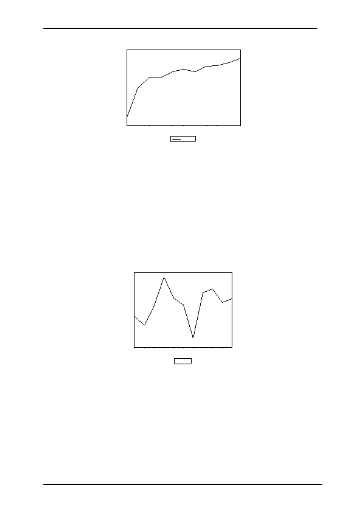
Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
17.4
17.2
17.0
16.8
16.6
16.4
16.2
16.0
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
LNDE
Graphique 3. 2 : Graphique du LNDE
L'évolution du LNDE reflète une
évolution des dépenses d'exploitation, globalement sur
toute la période même si nous pouvons noter des
légères diminutions dans les intervalles 98-
99 et 2001-2002. Nous pourrions toujours évoquer le
contexte des différends qui existaient
entre la SDE et la SONES.
L'évolution globale se justifie par le fait que le
Sénégal a compris très tôt l'importance du
secteur de l'eau dans l'activité économique. Cela
se justifie aussi par le fait que l'Etat ne peut
supporter plus les dépenses d'exploitations. Nous
remarquons que sur toute notre période
d'étude, l'entreprise privée assure de façon
satisfaisante les dépenses d'exploitations.
18.0
17.5
17.0
16.5
16.0
15.5
15.0
14.5
96 97 98 99 00
01
LNI
02
03
04
05
06
Graphique 3. 3 : Graphique du LNI
L'évolution de la variable LNI est par contre
irrégulière avec des hauts et des bas sur toute
notre durée d'étude même s'il faut
constater des périodes défavorables ; comme c'est le cas
des années 1996 et 1997 coïncidant avec
l'instauration du partenariat public privé dans le
secteur de l'eau. Au contraire après l'instauration du
partenariat public privé a été une période
dans laquelle le partenariat a fourni de gros efforts dans les
investissements, mais aussi avec
l'apparition de nouveaux projets comme le PELT,le PSE
etc. Après cette période de forte
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
51

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
croissance du secteur, les investissements diminuent
à cause des
différends existaient
souvent, ceux ci portent sur la prise en charge du
renouvellement, qui de la SDE ou de la
SONES doit faire les investissements ? La SDE essaye
toujours de surestimer le coût des
renouvellements à faire. Il faut surtout souligner qu'en
ce qui concerne les investissements de
son ressort, la SDE pour des raisons de calculs de profits,
n'engage pas non plus facilement
des financements et préfère toujours (
même si cela doit prendre beaucoup de temps ) se
lancer dans une discussion interminable avec la SONES. Ce
qui fait que le partenariat
constituait un engouement à la hauteur des
déceptions qu'il a suscité dès le début des
années
2000.
L'année 2002 a surtout constitué une
année d'amélioration de la qualité du service dans
le
contexte d'une maximisation du bien-être social soutenue
par le gouvernement. On se rappelle
au cours de l'année 2002 une marche de l'ASCOSEN
(Association des consommateurs du
Sénégal) à laquelle avait
participé des parlementaires, où les consommateurs
réclamaient
entre autres l'amélioration de la qualité du
service à la SDE. Cela a permis de renforcer la
confiance des bailleurs de fonds internationaux.
13.0
12.9
12.8
12.7
12.6
12.5
12.4
12.3
96 97 98 99 00 01 02 03
04 05 06
LA
Graphique 3. 4 : Graphique du LNA
Le nombre d'abonnés desservis a connu une
croissance régulière sur toute notre période
d'étude. Cette situation s'explique par une population
globale qui ne cesse d'augmenter et par
les efforts consentis par le gouvernement pour l'accès
à l'eau.
Cette croissance s'est traduite par la mise en place de 140 000
nouveaux raccordements à des
tarifs subventionnés pour les familles pauvres, ainsi que
de 400 bornes-fontaines publiques.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
52

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
17.20
17.15
17.10
17.05
17.00
16.95
16.90
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
LNB
Graphique 3. 5: Graphique du LNB
L'observation du graphe montre une évolution
irrégulière du LNB même si nous pouvons
noter des décroissances dans les intervalles
1996-1998 et 2000-2003 durant lesquelles nous
remarquons une diminution des pertes d'eau du
service qui se traduit donc par une
augmentation de la performance. Ces baisses peuvent s'expliquer
pour deux raisons : pour la
première nous pourrions évoquer la nouvelle
organisation institutionnelle mise en place et
pour la deuxième est causée par les financements
de gros investissements avec l'installation
des nouveaux équipements pour répondre aux besoins
des consommateurs.
Nous remarquons une augmentation des pertes en
distribution dans l'intervalle 1998-2000,
nous pourrions toujours évoquer le contexte des
différends qui existaient entre la société de
patrimoine et la société d'exploitation.
18
16
14
12
10
8
6
4
96 97 98 99 00 01 02
04 05 06
LNREN
LNDE
LNI
03
LNA
LNB
Graphique 3. 6: Evolution comparée des LNREN, LDE,
LNI, LNA et LNB
Nous remarquons que l'évolution du REN s'apparente
à celles des autres variables. Nous
pourrions tenter de dire avant l'estimation que
l'évolution des variables explicatives influence
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
53

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
celle du REN ou que l'inverse serait envisagé. Ce
qui pourrait penser à l'existence d'une
relation entre les variables.
Nous allons effectuer un certain nombre de tests
économétriques basés sur les approches de la
stationnarité et de la cointégration.
II - La stationnarité et la
cointégration du modèle
Avant le traitement d'une série chronologique, il
convient d'en étudier les caractéristiques
stochastiques. Si ces caractéristiques
c'est-à-dire son espérance et sa variance se trouvent
modifiées dans le temps, la série chronologique est
considérée comme non stationnaire ; dans
le cas d'un processus stochastique invariant, la série
temporelle est alors stationnaire.
II 1- La stationnarité : tests de racine
unitaire
Les tests de Dickey-Fuller permettent non seulement de
détecter l'existence d'une tendance
(Tests de racine unitaire, Unit Root test) mais aussi de
déterminer la bonne manière de
stationnariser une chronique. Pour ce faire, deux types de
processus sont distingués :
- les processus TS (Trend Stationary) qui
représentent une non-statinnarité de type
déterministe ;
- les processus DS (Differency Stationary) pour les processus non
stationnaires aléatoires.
Les modèles servant de base à la construction de
ces tests sont au nombre de trois. Le principe
des tests est simple : si l'hypothèse H 0 : / 1 = 1 est
retenue dans l'un de ces trois modèles, le
processus est alors non stationnaire.
[1] x t = / x
[2] x t = / x
[3] x t = / x
1 t1
1 t1
1 t1
+ _ t Modèle autorégressif d'ordre 1.
+ 0 + _ t Modèle autorégressif avec constante.
+ b t + c + _ Modèle autorégressif avec tendance.
t
Si l'hypothèse H0 est vérifiée, La
chronique x t n'est pas stationnaire quelque soit le modèle
retenu.
Dans le dernier modèle [3], incluant une constante et un
trend, si on accepte H 1 : / 1 < 1 et si le
coefficient b est significativement différent de 0, alors
le processus est un processus TS ; on
peut le rendre stationnaire en calculant les
résidus par rapport à la tendance estimée par les
moindres carrés ordinaires.
Sous H0, les règles habituelles de
l'inférence statiques ne peuvent pas être appliquées
pour
tester cette hypothèse, en particulier la
distribution de Student du paramètre / 1 ; Dickey et
Fuller ont donc étudié la distribution asymptotique
de l'estimateur / 1 sous l'hypothèse H0.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
54

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Les résultats de l'affichage pour les séries
; c'est-à-dire la variable expliquée LogRen et les
quatre variables explicatives logDE, logI, logA et logB
sont reproduits sur les figures en
annexe.
- La variable expliquée : logRen
Les résultats du test d'ADF sur logRen au tableau n°1
ont donné : la valeur empirique (ADF
Test Statistic 2.050157) est supérieure à la valeur
critique de 5 % = -1.9791, alors on accepte
l'hypothèse H0 d'une série non stationnaire, donc
il y'a racine unitaire.
D (logRen t) = (a-1) logRen t1 + ut
D (logRen t) = 0.004551logRent1
(0.002220)
t = -1.9791
-Nous pouvons essayer avec la
première différence pour le logRen t.
Le tableau n°2 du test racine unitaire de la
variable D (logRen t (-1)) a donné les résultats
suivants : la valeur empirique (ADF Test Statistic -4.012390) est
inférieur à la valeur critique
de 5 % = -1.9835, alors on rejette l'hypothèse H0
et on accepte H1 : donc notre variable
expliquée logRen t est intégrée d'ordre 1.
- Pour la variable explicative : logDE
Le tableau n°3 : correspond aux résultats sur l'ADF
du logDE.
La valeur empirique (ADF Test Statistic 2.008629) de la
variable explicative logDE est
supérieur à la valeur critique de 5 % =
-1.9791, alors on accepte l'hypothèse H 0 d'une série
non stationnaire, donc il y'a racine unitaire.
D (logDE t) = (a-1) logDE t1 + ut
D (logDE t) = 0.006349logDEt1
(0.003161)
t = -1.9791
-Essayer avec la première
différence pour le logDE.
Le tableau n°4 du test racine unitaire de la
variable D (logDE (-1)) a fourni les résultats
suivants : maintenant la valeur empirique (ADF Test
Statistic -5.605488) est inférieur à la
valeur critique de 5 % = -1.9835, alors on rejette
l'hypothèse H 0 et on accepte H 1 : donc notre
variable explicative logDE est intégrée d'ordre 1.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
55

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
- Pour la variable explicative : logI
Tableau n°5 : Test racine unitaire de la variable LogI
Puisque la valeur empirique (ADF Test Statistic 0.342958) est
supérieure à la valeur critique
de 5 % = -1.9791, alors on accepte l'hypothèse H0
d'une série non stationnaire, donc il y'a
racine unitaire c'est-à-dire : H 0 : (a 1) = 0
D (logI t) = (a-1) logI t1 + ut
D (logI t) = 0.007153logIt1
(0.020856)
t = -1.9791
-Nous pouvons essayer avec la
première différence pour le logI.
Tableau n°6 : Test racine unitaire de la variable D (logI
(-1))
Maintenant la valeur empirique (ADF Test Statistic
-2.116382) est inférieur à la valeur
critique de 5 % = -1.9835, alors on rejette
l'hypothèse H 0 et on accepte H 1 : donc notre
variable explicative logI est intégrée d'ordre 1.
- Pour la variable explicative : logA
Tableau n°7 : Test racine unitaire de la variable LogA
Puisque la valeur empirique (ADF Test Statistic 0.750446) est
supérieure à la valeur critique
de 5 % = -3.2195, alors on accepte l'hypothèse H0
d'une série non stationnaire, donc il y'a
racine unitaire c'est-à-dire : H 0 : (a 1) = 0
D (logA t) = (a-1) logA t1 + ut
D (logA t) = - 0.016060 logAt1
(0.270753)
t = 0.750446
-Essayer avec la première
différence pour le logA.
Tableau n°8 : Test racine unitaire de la variable D (logA
(-1))
Maintenant la valeur empirique (ADF Test Statistic
-7.005135) est inférieur à la valeur
critique de 5 % = -3.2695, alors on rejette
l'hypothèse H 0 et on accepte H 1 : donc notre
variable explicative logA est intégrée d'ordre 1.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
56

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
- Pour la variable explicative : logB
Les résultats du test d'ADF sur logB au tableau
n°9 ont donné : la valeur empirique (ADF
Test Statistic -0.536797) est supérieure à la
valeur critique de 5 % = -1.9791, alors on accepte
l'hypothèse H0 d'une série non stationnaire, donc
il y'a racine unitaire.
D (logB t) = (a-1) logB t1 + ut
D (logB t) = -0.000790logBt1
(0.001471)
t = -1.9791
-Nous pouvons essayer avec la
première différence pour le logB.
Tableau n°10 : Test racine unitaire de la variable D (logB
(-1))
Maintenant la valeur empirique (ADF Test Statistic
-3.367100) est inférieur à la valeur
critique de 5 % = -1.9835, alors on rejette
l'hypothèse H 0 et on accepte H 1 : donc notre
variable explicative logB est intégrée d'ordre 1.
On peut conclure que pour toutes les variables, on
accepte l'hypothèse H 1 d'une série
stationnaire d'ordre 1. Comme on travaille sur des variables
stationnaires on doit donc vérifier
qu'elles sont cointégrées, c'est l'objet des tests
de Cointégration.
II 2- La cointégration
La théorie de la cointégration permet de
préciser les conditions dans lesquelles il est légitime
de travailler sur des séries non stationnaires; Nos
tests de racine unitaire des variables
indiquent qu'elles sont intégrées d'ordre 1. Donc
on peut faire le test de cointégration d'Engle
et Granger (1987).
- Test de cointégration d'Engle et Granger
Le test Engle-Granger consiste à déterminer
l'ordre d'intégration des résidus, donc c'est un
test de racine unitaire, mais un test particulier
puisqu'il porte sur les résidus. Les valeurs
critiques de ce test ne sont plus celles que l'on a
vues précédemment mais celle que l'on
c
trouve dans une table établie par M Kinnon.
Le test est indiqué par le tableau n°11. Les tests de
Dickey-Fuller Augmenté (ADF) effectués
ont permis de trouver que les résidus ne possèdent
pas de racine unitaire. Cela veut dire qu'il
y a stationnarité, donc les variables sont
cointégrées. L'hypothèse de cointégration est
acceptée. Car la valeur de l'ADF (-3,010349) est
inférieure à -1,9890 (valeur critique au seuil
de 5 %).
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
57

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
-Test de causalité de Granger
Nous allons procéder à présent à
un test de causalité de Granger. Théoriquement, il
s'agit
d'étudier les relations causales entre nos variables
économiques pour une mise en place d'une
politique optimisée. Car c'est important de
connaître le sens de la causalité et de mettre en
évidence une liaison entre les variables.
Selon Granger, une série cause une autre
série si la connaissance du passé de la première
améliore la prévision de la seconde afin de
connaître au préalable la nature des relations
existantes entre nos variables et le sens de la causalité.
Dans notre modèle, nous avons proposé
que ce sont les dépenses d'exploitation, les
investissements, le nombre d'abonnés et les pertes
en distribution influencent la rentabilité.
Mais est ce que le contraire serait aussi vrai ?
Au niveau de la théorie, nous avons
présenté le raisonnement permettant d'expliquer ce
phénomène. Nous nous proposons ici d'opérer
ce test pour répondre à notre interrogation.
Concertant ce test, si la probabilité est
supérieur à 5 %, nous acceptons l'hypothèse nulle,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de causalité. Sinon il
y en a. Nous pouvons noter les résultats qui
sont donnés par le tableau n°12.
Sa lecture fait remarquer LNDE ne cause pas LNREN
puisque la probabilité (0.69904) est
supérieure à 5 %. Inversement, LNREN ne cause pas
LNDE puisque la probabilité est égale à
0.32785 est supérieure à 5 %.
La variable LNI au sens de Granger ne cause pas LNREN parce que
la probabilité est égale à
0.91768 est supérieure à 5 %. L'inverse n'est pas
vérifié parce que LNREN ne cause pas LNI
car la probabilité est supérieure à 5 %.
LNA ne cause pas LNREN car la probabilité est
supérieure à 5 % inversement LNREN ne
cause pas LNA pour la même raison.
La variable LNB ne cause pas LNREN, inversement aussi LNREN ne
cause pas LNB pour les
mêmes raisons.
Pour les variables LNDE et LNI aucune d'elle ne cause
l'autre car les probabilités sont
supérieures à 5 %.
Entre LNDE et LNA nous avons la variable LNA cause LNDE car la
probabilité 0.03166 est
inférieure à 5 % et LNDE ne cause pas LNA parce la
probabilité est supérieure à 5 %.
Pour les variables LNDE et LNB, il n'y a pas une
relation de causalité parce que les
probabilités sont supérieures à 5 %.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
58

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Pour les variables LNA, LNI et LNB aucune d'elle ne cause l'autre
parce que les probabilités
sont supérieures à 5 %.
Même si le test de causalité de Granger n'est pas
obligatoire pour notre test de cointégration,
il reste néanmoins révélateur de la nature
de la relation entre les variables.
- Estimation par MCO
Nous procéderons ensuite à la première
étape de la cointégration de Engle et Granger, qui
applique les MCO à une régression statique
liant la fonction de rendement et des variables
explicatives qui déterminent son comportement. Nous
proposons que la relation statique de
long terme fournie par la théorie est une
composition linéaire des transformations
logarithmiques des variables choisies. Ces transformations
permettent d'éviter les effets de
grandeurs puis de faciliter les interprétations avec les
élasticités entre les variables expliquée
et explicatives.
Les résultats sont disponibles dans le tableau n°13.
2
Le coefficient R indique une qualité de l'ajustement de
99,1764. C'est-à-dire que le modèle
s'explique à 99,1764 % de la variation totale du
rendement. L'ajustement est plus que
satisfaisant.
Du point de vue économique, tous les paramètres ont
des signes attendus. L'hypothèse que les
coefficients (a 1, a 2 et a 3) sont positifs est
vérifiée. De même l'hypothèse a 4 négatif
est vérifiée.
En effet, a 1 = 0.087131 veut dire une augmentation de
10 % des dépenses d'exploitation
entraîne une hausse de 0,87131 % du rendement.
a2
= 0.000281 signifie une hausse de 10 % des
investissements se traduit par une
augmentation de 0,00281 % de la rentabilité du secteur.
a3
= 0.118686 veut dire une augmentation de 10 % du nombre
d'abonnés entraîne une
augmentation du rendement de 1,18686 %.
a4
= -0.244177 signifie une de 10 % des pertes en distribution se
traduit par une diminution du
rendement de 2,44177 %.
Nous remarquons que la variable dépenses d'exploitation a
une influence significative sur la
variable du rendement puisque sa probabilité
associée est inférieure à 5 % (constatons que son
t statistique est supérieur à 1.96). Par contre
celle des investissements n'est pas significative
car sa probabilité critique associée est
supérieure à 5 % et le t statistique est inférieur
à 1,96.
Pour les variables nombre d'abonnés et pertes en
distribution ont un impact significatif sur la
rentabilité du secteur parce que leurs probabilités
associées sont à supérieures à5 %.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
59

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Pour finaliser la première étape du test de
cointégration concernant l'approche de Engle et
Granger (1987). Nous avons obtenu la stationnarité des
résidus de la régression de l'équation
et les variables sont non stationnaires et
cointégrées.
La dernière étape estime une version
dynamique de notre modèle pour vérifier les effets
à
court terme de nos variables sur le rendement d'où le
modèle suivant.
Modèle à correction d'erreur
D'après le théorème de
représentation de Granger, tout système
cointégré, implique
l'existence d'un mécanisme à correction d'erreur
qui empêche les variables de trop s'écarter
de leur équilibre à long terme. Si la
cointégration permet de préciser la réalité et la
nature des
divergences entre deux séries théoriquement
liées entre elles et à modéliser le comportement
de ces variables, le modèle à correction
d'erreur permet d'en expliquer et d'en déduire le
mécanisme. De façon générale, nous
pouvons de manière simple écrire le modèle à
correction
d'erreur. Nous avons déjà effectué par
la MCO la relation de long de terme. Nous allons
définir l'opérateur D = X t- X t-1 ce qui nous
permet de déterminer
DLNREN = LNREN t - LNREN t-1 pour les autres nous
ferons une analogie. Enfin nous
pourrons écrire notre modèle à correction
d'erreur que nous allons estimer par la MCO.
DLNREN = a 0 + a 1DLNDE + a 2DLNI + a 3DLNA + a 4DLNB + a _ (-1)
+ ffi t (5)
5 t
a 5 est le coefficient force de rappel vers l'équilibre.
Il doit être significativement négatif. Les
résultats sont confinés dans le tableau n° 14.
2
La qualité de l'estimation du modèle semble bonne
au regard du coefficient R = 95,1089% et
de la statistique de Fisher (7.778133).
Nous avons a 0 et a 1 qui sont positifs. Par contre a 2, a 3,
a 4 et a 5 sont négatifs. Les coefficients
a2, a 3 et a 4 indiquent que dans le modèle
à court terme les investissements, le nombre
d'abonnés et les pertes en distribution ont un
effet négatif sur le rendement du secteur. Par
contre le a 1 positif signifie qu'à court terme
les dépenses d'exploitation a une influence
positive sur le rendement.
Le coefficient a 5 (force de rappel vers l'équilibre) est
le coefficient de correction d'erreur. Il
doit être négatif ; dans le cas contraire il
convient de rejeter une spécification du type ECM
(modèle à correction d'erreur). En effet, le
mécanisme de correction d'erreur (rattrapage qui
permet qui permet de tendre vers la relation de long
terme) irait alors en sens contraire et
s'éloignerait de la cible de long terme.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
60

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
On constate que le coefficient associé à la force
de rappel est négatif (-0.210047) et confirme
l'existence d'une relation de long terme entre le
rendement et les variables explicatives. La
valeur de ce paramètre indique, en outre qu'en cas
de déséquilibre de court terme, le REN
semble revenir plus lentement de son sentier
d'équilibre. Il y a un mécanisme à correction
d'erreurs qui empêche les variables de trop
s'écarter de leur équilibre à long terme.
Après l'estimation du modèle à correction
d'erreur, nous effectuons les tests suivants.
- Test d'autocorrélation :
Nous considérons ici le test de multiplicateur de Lagrange
(LM test). Pour ce test à k degré de
2 2
liberté si Obs. R < K
0,05 ;k
alors l'hypothèse H 0 d'autocorrélation est
acceptée. Sinon il y a
absence d'autocorrélation.
Il vient :
2 2
0,05 ;k donc nous rejetons H 0 C'est-à-dire que les
erreurs ne sont pas
autocorrélées (Tableau n°14).
-Test de stabilité :
Pour savoir si les coefficients trouvés lors de notre
régression de l'équation sont stables durant
notre période, nous effectuons un test
d'homogénéité ou test de Ramsey. Par ce test nous
pouvons savoir si la nature de la relation entre le REN
et ces variables explicatives est la
même.
Pour cela, si la probabilité est supérieure
à 5 %, l'hypothèse de stabilité est acceptée.
Sinon
c'est la non stabilité.
Ramsey RESET Test:
Obs. R = 0.592811 > K
F-statistic
Log likelihood ratio
0.855785
3.918197
Probability 0.490466
Probability 0.140985
Les deux probabilités sont supérieures à 5
%, le modèle est bien spécifié.
8
4
0
-4
-8
2001
2002
2003
CUSUM
2004
2005
2006
5% Significance
Graphique 3. 7: Test Cusum
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
61
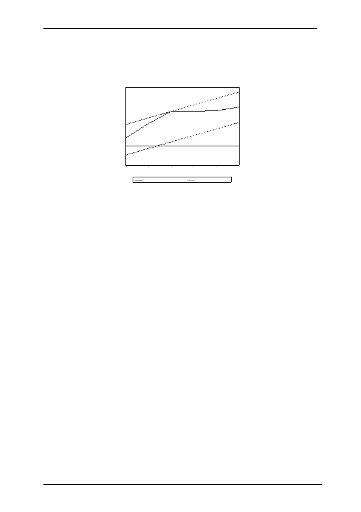
Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
La courbe ne coupe pas le corridor : le modèle à
correction d'erreur est structurellement
stable.
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
2001
2002
2003
2004
CUSUM of Squares
2005
5% Significance
2006
Graphique 3. 8: Test Cusum carré
Le modèle à correction d'erreur est ponctuellement
instable.
La zone d'instabilité est la période 2003
Pour stabiliser le modèle à correction d'erreur, on
utilise une variable indicatrice cusum1.
On pose :
Cusum1 = 1 en 2003
Cusum1 = 0 ailleurs
L'estimation du modèle à correction d'erreur avec
la variable indicatrice cusum1 est donné
par le tableau n°17.
Les tests Cusum st Cusum carré permettent d'accepter
l'hypothèse de stabilité car la
probabilité est supérieure à 5% (0.4328).
III- Quelques recommandations
Ces recommandations s'adressent aux acteurs du secteur de l'eau.
Elles ont pour objectif de
créer un environnement propice pour les plus
démunis de l'accès à l'eau potable, pour jeter
les bases d'une performance durable du partenariat public et
privé. Pour cela, nous prenons en
compte l'ensemble des processus de développement du
secteur dans toute sa complexité.
Elles tiennent compte des considérations tirées des
études empiriques, théoriques de l'analyse
économétrique. Les éléments
les plus importants sur lesquels vont s'appuyer ces
recommandations sont les résultats obtenus. Les
résultats de notre étude ont permis de savoir
que les dépenses d'exploitation et les pertes
en distribution exercent une influence
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
62

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
respectivement positive et négative à court terme
et à long terme sur le rendement. L'examen
de ces recommandations met l'accent sur les cadres d'action
et stratégies que les acteurs du
secteur c'est-à-dire l'Etat, la SONES et la SDE
devraient mettre en oeuvre et adopter pour
stimuler la croissance du secteur.
· Il semble important de procéder à
une réévaluation des programmes, des projets et
des alternatives qui avaient été
élaboré par l'expertise locale pour répondre au
défit
de l'accès universel à l'eau potable et de
l'utilisation de l'eau comme vecteur de
développement économique et social.
· Des recherches sont nécessaires pour
construire des dynamiques de changement de
comportements dans le sens d'une gestion plus rigoureuse des
ressources en eau.
· Il est important d'étudier les conditions
sociales et économiques qui permettent aux
populations les plus pauvres d'exercer pleinement le droit
à l'eau potable.
· Les études sont nécessaires pour
mesurer les impacts socioéconomiques de la
privatisation de l'eau sur une plus large échelle
et sur un nombre plus élevé
d'indicateurs.
· Les alternatives à la privatisation
devraient résulter de démarches participatives
impliquant les populations les plus pauvres, l'expertise locale,
la société civile et les
partenaires au développement.
Toutes ces recommandations peuvent être liées
mais chacune peut revêtir des interventions
bien spécifiques. Elles ne doivent pas être
les seules à entreprendre pour une meilleure
rentabilité du PPP. C'est pourquoi ces
interprétations et recommandations doivent être
analysées avec mesure car elles ne s'imposent pas comme
définitives.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
63

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
CONCLUSION
La performance relative des modes de gestion des
services publics de l'eau est une
préoccupation des pouvoirs publics mais également
un thème de recherche important chez les
économistes. Cependant, les travaux sur le
secteur de l'eau proposent souvent des
méthodologies qui ne prennent pas en compte
simultanément le choix de l'Etat et leurs
impacts sur les coûts et les prix de l'eau. Dans notre
travail, nous avons étudié les interactions
entre le mode d'organisation et de régulation des
services d'eau potable et leurs coûts
d'exploitation. Notre modèle théorique montre que
le choix de l'Etat dépend de la différence
de coûts d'exploitation selon le mode de gestion et les
caractéristiques du service. Nous avons
modélisé par ailleurs le mode de tarification
correspondant à un prix Ramsey-Boiteux en
gestion publique et un prix Baron-Myerson en gestion
privée.
Nous avons présenté une étude
économétrique sur la rentabilité du choix de l'Etat qui
est la
gestion déléguée. L'objectif était
d'évaluer la rentabilité du partenariat c'est-à-dire
étudier
l'effet des facteurs qui influencent la rentabilité du
secteur.
Nous avons appliqué pour cela la cointégration et
le modèle à correction d'erreur pour étudier
la relation de cause à effet entre la rentabilité
et ces facteurs après spécification du modèle de
base. En effet la méthodologie adaptée est une
approche en trois étapes :
-
-
-
La première étape consiste à
vérifier les propriétés des séries
chronologiques de la
rentabilité et de ces facteurs à l'aide des tests
de racine unitaire de Dickey-Fuller.
La deuxième étape utilise la théorie
de la cointégration développée par Engle et
Granger pour examiner les relations à long terme
entre la rentabilité du PPP et ces
facteurs et l'estimation par la méthode des moindres
carrés ordinaires.
Enfin, dans la troisième étape, le test de
causalité de Granger et l'estimation par
modèle à correction d'erreur sont effectués
pour déterminer la direction de la causalité
entre les variables.
Le recours à ces différentes stratégies nous
a permis d'obtenir les résultats suivants :
-
-
-
les variables ne sont pas stationnaires ;
les variables sont cointégrées ;
les variables dépenses d'exploitation, investissements,
nombres d'abonnés et pertes en
distribution au sens de Granger ne causent pas le rendement. Ce
dernier ne cause pas
les variables explicatives. Entre dépenses
d'exploitation et nombres d'abonnés, nous
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
64

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
-
-
remarquons que ce sont les premières qui causent
les secondes. Par contre l'inverse
n'est pas vrai ;
aussi bien à court terme qu'à court terme
les dépenses d'exploitation ont des effets
positifs, à court terme toutes les variables explicatives
ont un impact significatif sur le
rendement sauf la variable pertes en distribution ;
il existe une relation de corrélation de long terme
entre le rendement et les variables
explicatives. La valeur du paramètre de correction
d'erreurs indique, en outre qu'en
cas de déséquilibre de court terme, le REN semble
revenir de son sentier d'équilibre
par un mécanisme qui empêche les variables de trop
s'écarter de leur équilibre à long
terme.
Ces résultats nous ont permis de confirmer notre
hypothèse de recherche et de conclure que la
contribution de ces facteurs est positive, réelle et
existante appuyant les résultats obtenus aux
plans théorique et empirique. Donc une politique
visant à accroître l'accès à l'eau potable
surtout pour les plus pauvres aura une influence favorable
à la rentabilité du PPP sur le long
terme. Par ailleurs, des rendements de densité
d'usagers croissants indiquent que le
branchement de nouveaux usagers peut être
effectué avec un bénéfice pour la SDE puisque
les coûts variables moyens décroissent.
Comme toute oeuvre humaine, il comporte des limites et des
manquements. Nous laisserons le
soin aux lecteurs de faire leurs propres appréciations.
Justement à propos de ces limites, elles sont dues aux
obstacles et difficultés de recherche que
sont le problème de documentation, l'accès
aux données, la méthode, le modèle, la non
maîtrise de l'anglais pour lire les documents
écrits avec cette langue et d'autres outils aux
quels nous n'avons pas pu disposer. Il y a aussi notre limite de
non maîtrise totale du logiciel
Latex avec lequel qu'en même nous avons
rédigé ce mémoire.
Nous obtiendrons des résultats plus satisfaisants et
meilleurs si dans le cadre d'une autre
étude, nous arrivions à régler tous ces
problèmes.
Aussi il serait intéressant d'incorporer d'autres
variables ou de retrancher l'une ou l'autre
pour vraiment capter l'impact réel de telle ou telle autre
variable.
Nous pourrons également adopter d'autres approches
et méthodes économétriques pour
évaluer l'effet de ces variables sur le PPP dans
nos recherches futures. Par exemple au lieu
d'étudier seulement les dépenses d'exploitation et
le nombre d'abonnés il serait possible pour
nous de considérer les dépenses
d'électricité, les dépenses de traitement (pour
potabiliser
l'eau extraite) et d'analyse (pour contrôler la
qualité de l'eau potable), un ensemble de coûts
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
65

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
(assez hétérogène), le nombre de
branchements domestiques facturés et le nombre de bornes
fontaines actifs et d'évaluer leur contribution au PPP.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
66

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Bibliographie :
[1] ARKU, F. (2000), « The effectiveness of participatory
and demand. Responsive Approach
to Rural Water supply an Management in Sub- Saharan Africa
», communication au collogue
University of Guelph Rural studies annual conference,
Guelph, Ontario, Canada.
[2] BARON, C. et ISLA, A. (2003), « Marchandisation de l'eau
et convention d'accessibilité
à la ressource. Le cas des métropoles d'Afrique
Sub-saharienne », communication au collogue
convention et institution, Paris, 11-13 décembre.
[3] BARON, D. P., et MYERSON, R. B. (1982), « Regulating a
Monopolist with Unknown
Costs », Econometrica, 50(4), 911-930.
[4] BHATTACHARYYA, A., HARRIS, T. R., NARAYANAN, R., et RAFFIEE,
K. (1995),
« Specification and Estimation of the Effect of Ownership on
the Economic Efficiency of the
Water Utilities », Regional Science and Urban
Economic, 25, 759-784.
[5] BOTTON, S., BRAILOWSKY, A., et MATTHIEUSENT, S.
(2004), « les véritables
obstacles à l'accès universel au service d'eau dans
les pays émergents' ».
[6] BOUMAHDI, R., et THOMAS, A. (1992), « Estimation
des modèles à deux Régimes
avec des donnés de Panel », Annales d'Economie et
de Statistique, 28, 125-142.
[7] BOYER, M., PATRY, M., et TREMBLAY, P. (1999), «
La gestion Déléguée : les
enjeux », Rapport CIRANO 1999RP-11, Montréal.
[8] BREUIL, L. et NAKHLA, M. (2003a), «
L'internationalisation de la gestion des services
d'eau : quel modèle de régulation des
services d'eau dans les pays en développement ? »
Politique et Management Public, vol. 21, p. 27-52.
[9] BREUIL, L. et NAKHLA, M. (2003b), « Réformes des
services publiques locaux dans les
grandes villes des pays émergents : quel(s)
modèle(s) pour quels objectifs ? », communication
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
67

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
au collogue Une génération de réformes
en management public : et après ? Strasbourg 24-25
novembre.
[10] BROCAS, I., CHAN, K., et PERRIGNE, I (2006), «
Regulation under Asymmetric
Information in Water Utilities », American Economic
Review: Papers and Proceedings,
96(2), 62-66.
[11] BROCAS, I., K. CHAN, et I. PERRIGNE (2006):
"Regulation under Asymmetric
Information in Water Utilities," American Economic review:
Papers and Proceedings, 96(2),
62-66.
[12] BROCKLEHURST, C. et JANSSENS, J. (2004),
« Innovative contrats, Sound
relationships: Urbain Water Sector in Senegal »,
WSSB Discussion Paper Series, Paper n°1,
janvier.
[13] CANNEVA, G. (2003), « Le suivi des
Délégations de Service Public d'Eau et
d'Assainissement : Quels Outils pour quelles
Régulation ? », Mémoire de DEA, Université
Paris X-Nanterre.
[14] CARPENTIER, A., NAUGES, C., REYNAUD, A., et THOMAS, A.
(2005), « Effets de
la Délégation sur le Prix de l'Eau Potable en
France : Une Analyse à partir de la Littérature
sur les effets de traitement », Cahier LERNA numéro
05.12. 176, Economie et Prévision.
[15] CHAMPETIER, S. et COLLIGNON, B. (2003), « Que les
sans-pain ne soient pas sans
eau ! Partenariat public- privé-ONG pour l'accès
à l'eau potable des populations démunies »,
ENDA, Etudes et recherche n°203, 110p.
[16] CHRISTENSEN, L. R., D. W. JORGENSON, et L. J. LAU (1971):
"Conjugate Duality
and the Transcendental Logarithmic Production Function,"
Econometrica, 39(4), 255-2556.
[17] COASE, RH (1937), « The nature of the firm »,
Economica, vol. 4, p. 386-405.
[18] COLLIGNON, B. et VEZINA, M. (2000), « Independent Water
and sanitation Providers
in African Cities », rapport, wsp.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
68

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
[19] CRAIN, W. M., et ZARDKOOHI, A. (1978), « A Test of the
Property-Rights Theory of
the Firm: Water Utilities in the United States »,
Journal of Law and Economics, 21(2), 395-
408.
[20] DEBOMY, S. (2005), « Pro-poor subsidies for
water connections in West Africa »,
Water Supply & Sanitation Working Notes, Note
n°4, janvier.
[21] DEMSETZ, H. (1968): "Why Regulate Utilities?," journal
of law and Economics, 11(1),
55-65.
[22] DIEWERT, W. E., et T. J. WALES (1987): "Flexible
Functional Forms and Global
Curvature Condition," Econometrica, 55(1), 43-68.
[23] DUBOSC, A. (2001), « La participation du public dans
les processus de décision liées à
l'eau », rapport, Agent de l'eau Seine Normandie.
[24] DUMEZ, H. et JEUNEMAITRE, A. (2003), « Combinaison
harmonieuse des vertus du
public et du privé, ou mélange des genres ? Les
partenariats public- privé nouveaux venus du
management public », politiques et management
public, vol. 21 (4), p. 1-14.
[25] ERNST & YOUNG HSD-Aquanet (1996): "Intervention sur les
contrats d'affermage et
de concession," Atelier sur la pérennisation de
la réforme du secteur de l'hydraulique
urbaine, Mbour, 26-28 mars.
[26] ESTACHE, A., et M. A. ROSSI (2002): "How Different Is the
Efficiency of Public and
Private Water Companies in Asia?," World Bank Economic
Review, 16(1), 139-148.
[27] FEIGENBAUM, S., et TEEPLES, R. (1983), « Public Versus
Private Water Delivery: a
Hedonic Cost Approach », Review of economics and
Statistics, 64, 672-678.
[28] GARCIA, S., THOMAS, A. (2001), « The Structure
of Municipal Water supply Cost:
Application to a Panel of French Local Communities
», Journal of Productivity Analysis,
16(1), 5-29.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
69

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
[29] GLACHANT, M., et MIESSNER, F. (2003), « Analyse
Econométrique de l'Effet du
Mode d'Organisation sur le Prix des Services de l'Eau et de
l'Assainissement dans le Bassin
Seine Normandie », Document de travail CERNA.
[30] GRAE (2004), « Accès à l'eau
et l'assainissement : pas d'initiative locale sans
décentralisation des décisions et des
financements », rapport, Groupe de Réflexion Africain
pour l'Eau.
[31] GUERIN-SCHNEIDER, L., et NAKHLA, M. (2003), « Les
Indicateurs de Performance :
Une Evolution Clef dans la Gestion et la
Régulation des Services d'Eau et
d'Assainissement », Flux, 52/53, 56-68.
[32] HAUSMAN, J. (1978): "Specification Tests in
Econometrics," Econometrica, 46(6),
1251-1271.
[33] HECKMAN, J. J. (1976): "The Common Structure of Statistical
Models of Truncation,
Sample Selection, and Limited Dependant Variables and
a simple Estimator for Such
models," Annals of Economic and Social Measurement, 5,
475-492.
[34] HOTELLING, H. (1938): "The General Welfare in Relation to
Problems of Taxation and
of Railway and Utility Rates," Econometrica, 6(3),
242-269.
[35] HUANG, M. Y., C. J. HUANG, et T. T. FU (2002): "Cultivation
Arrangements and the
cost Efficiency of Rice Farming in Taiwan," Journal of
productivity Analysis, 18(3), 223-239.
[36] IFEN. (2001), « Eau Potable : Diversité
des ServicesGrand Ecart des Prix », Les
donnés de l'environnement-eau, n°65.
[37] LAFFONT, J.-J., et J. TIROLE (1986): "Using Cost
Observation to Regulate Firms,"
Journal of Political Economy, 93(3), 614-641.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
70

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
[38] LEE, L. F. (1978): "Unionism and Wage Rates: A
Simultaneous Equations model with
Qualitative and Limited Dependent Variables,"
International Economic Review, 19(2), 415-
433.
[39] LORRAIN, D. (1995): "Gestion urbaine de l'eau," Paris,
Economica.
[40] MARTINAND, C. (1995): "L'expérience
française du financement privé des
équipements publics," Paris, Edition DAEI.
[41] MENARD, C., et SAUSSIER, S. (2000), «
Contractual Choice and Performance: the
Case of Water Supply in France », Revue d'Economie
Industrielle, 92, 385-404.
[42] MOUGOET, M., et F. NAEGELEN (2005) : « La
concurrence pour le marché, »Revue
d'Economie Publique, 115(6), 739-778.
[43] NDAW, M. (2005), « Réforme du secteur de
l'hydraulique au Sénégal : pièce maîtresse
vers la réalisation des objectifs du millénaire
pour le développement », Etude de cas, 30p.
[44] PAGAN, A. (1984), « Econometrics Issues in the
Analysis of Regression with General
Regressors », International Economic Review, 25(1),
221-247.
[45] RAMSEY, F. P. (1927), « A Contribution to the
Theory of Taxation », Economic
Journal, 37, 47-61.
[46] RELLANO, M. (2003), Panel Data Econometrics.
Advanced Texts in Econometrics.
Oxford University Press Inc., New York.
[47] REPUBLIQUE DU SENEGAL. (1996), « Contrat d'affermage et
contrat de performance
entre la société nationale des eaux du
Sénégal et la société d'exploitation ».
[48] REPUBLIQUE DU SENEGAL. (2005), « PEPAM 2015
», Document de programme,
mars. 24p.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
71

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
[49] REPUBLIQUE DU SENEGAL. (2006), « Réforme
de seconde génération du sous
secteur de l'hydraulique urbaine ».
[50] REYNAUD, A., et THOMAS, A. (2005), « Demande
Domestique en eau et choix de
Délégation : le cas Français »,
Revue Economique, 56(5), 1145-1168.
[51] SAAL, D. S., et PARKER, D. (2000), « The Impact of
Privatization and Regulation on
the Water and Sewerage Industry in England and Wales: A Translog
Cost Function Model »,
Managerial and Decision Economics, 21(6), 253-268.
[52] SAGE, E. (1999), « La Concurrence par
comparaison : Théorie et Applications. Une
Proposition pour le Secteur de l'Eau en France »,
Thèse de Doctorat, Université Paris IX-
Dauphine.
[53] SMETS, H. (2004), « The cost of meeting the
Johannesburg targets for drinking Water »,
rapport Académie de l'Eau.
[54] SONES. « Gestion des abonnés de la SDE
», Rapport de contrôle de l'activité,
Année
2004,2005.
[55] TAVERNIER, Y. (2001), « Le Financement et
la Gestion de l'Eau », Rapport
d'Information, n°3081, Assemblée Nationale.
[56] TEEPLES, R., et GLYER, D. (1987), « Cost of Water
Delivery Systems : Specification
and Ownership Effects », Review of Economics and
Statistics, 69, 399-407.
[57] TRIMOLET, S. (2005), « Case study on Senegal's water
and sanitation Sector Economic
Regulation », octobre, 89p.
[58] UNESCO, VEOLIAWATER, et PS-EAU (2004), Eau,
Assainissement et développement
durable. Paris.
[59] VICKEY, W. (1948), « Some Objections to
Marginal- Cost Pricing », Journal of
Political Economy, 56,218-238.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
72

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
[60] WOLAK, F. A. (1994), « An Econometric Analysis
of the Asymmetric Information,
Regulator-Utility Interaction », Annales d'Economie et
de Statistique, 34, 13-69.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
73

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Webographie:
· Banque Mondiale
www.worldbank.org/watsan
· Association Africaine de l'Eau
www.uade.org
· Water Utility Partnership
www.wupafrica.org
· Conseil Mondial de l'Eau
www.worldwatercouncil.org
· International Water Association
www.iwahq.org.uk
· Assainissement www.reseaucrepa.org
· Académie de l'Eau
www.academie-eau.org
· Programme Solidarité Eau
www.pseau.org
· Sénégalaise Des Eaux
www.sde.org
· Société Nationale des Eaux du
Sénégal www.sones.org
· Agence Nationale de la Statistique et de la
Démographie www.ansd.org
· Quelques sites de recherches
www.jstor.org www.nber.org www.inf.org
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
74
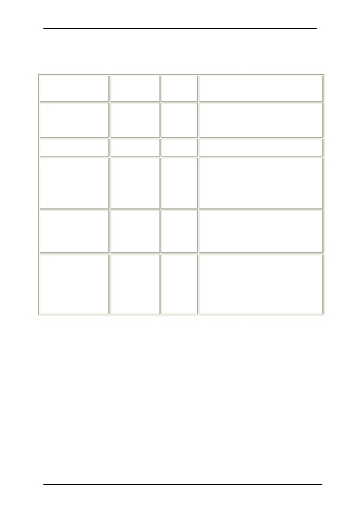
Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
ANNEXES :
Critères
Branchement
particulier
Borne-
fontaine
Commentaire
Qualité de service
La qualité de service est supérieure
pour un branchement particulier : pas
de déplacement jusqu'à la
d'attente.
BF, pas
+
-
Qualité de l'eau
=
=
La qualité de l'eau est identique pour
les deux types d'accès au réseau.
Les investissements rapportés au
consommateur sont plus faibles pour
une BF (250 000 FCFA pour 200
usagers contre 100 000 FCFA pour 10
usagers dans le cas d'un branchement
particulier).
3
Le prix du m de la tranche sociale est
3
inférieur au prix du m pour les BF. De
plus, il faut ajouter la rémunération du
fontainier ce qui peut porter le coût à
3
Le paiement du service à la BF se fait
quotidiennement, tandis que la facture
700 voire 1000 FCFA le m
du branchement
bimensuelle. Les
particulier
populations
est
aux
-
+
Investissements
nécessaires
3
Prix au m
+
-
Adaptation
de
la
-
+
facturation au revenu
disponible
revenus irréguliers rencontrent parfois
des difficultés pour les rassembler la
somme nécessaire.
Source : tableau établi par l'auteur
Tableau 1. 1: Comparaison du service rendu par les
bornes-fontaines et les branchements particuliers.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
75
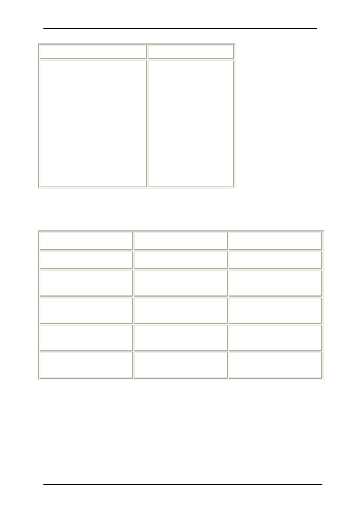
Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Catégorie
Abonnés domestiques :
3
Tranche sociale (<10m /mois)
3
Tranche pleine (10 à 20m /mois)
3
Tranche dissuasive (>20m /mois)
Abonnés non domestiques
Bornes fontaines
Maraîchers :
< quota Q
Compris entre Q et 2*Q
> 2*Q
Source : SONES
Tableau 1. 2 : grille tarifaire
3
Total TTC en FCFA/m
191,32
629,88
788,67
788,67
322,31
131,37
507,84
788,67
Cas-type
Le volume produit augmente
de 10%
L'objectif d'efficacité
technique n'est pas atteint à
5% prés
L'objectif d'efficacité
commerciale est dépassé de
1%
Le prix exploitant (Pe) est
réévalue de 1% et le prix
moyen reste stable
Le prix exploitant (Pe) reste
stable et le prix moyen
augmente de 3%
Source : tableau établi par l'auteur
Conséquences pour la
SONES
La rémunération augmente
de 10%
La rémunération de la
SONES n'est pas modifiée
La rémunération de la
SONES n'est pas modifiée
La rémunération de la
SONES est amputée
de1%.Volproduit.Pmoyen
L'intégralité du bénéfice
supplémentaire est reversée à
la SONES
Conséquences pour la SDE
La rémunération augmente
de 10%
La rémunération de la SDE
est amputée d'un montant de
5%.Volproduit.Pmoyen
La rémunération de la SDE
est augmentée d'un montant
de 1%.Vol produit.Pmoyen
La rémunération de la SDE
augmente 1%
La rémunération de la SDE
reste stable
Tableau 1. 3 : Conséquences tarifaires pour la
SONES et la SDE dans différents cas-types
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
76
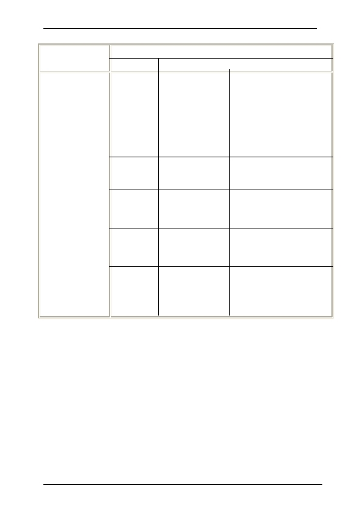
Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Points communs
· Principe de
paiement du service
de l'eau
· Couverture
des coûts
d'exploitation
· Participation
du secteur privé
· Séparation
entre les entités en
charge de la gestion
et celles en charge
des investissements
et de fixation du
niveau des prix
Contact avec
L'abonné
Milieu rural
Contact direct avec le
gestionnaire
Différences
Milieu urbain
Contact avec les releveurs de
la SDE
Niveau
Technique
Limité : gestion d'un
seul forage
Elevé : gestion de stations de
traitements, de pompage et
d'un nombre élevé d'abonnés
Mode
d'approv.
Principalement puits
et bornes-fontaines
Principalement branchements
domestiques
Niveau des
prix
Possibilité
d'action
collective
Bas, couvrant
uniquement les frais
d'exploitation
Oui, car la population
est plutôt homogène
et stable
Péréquation
Financière
Limitées, du fait du
faible nombre
d'usagers
Elevé, couvrant les frais
d'exploitation et
d'investissement
Plus difficile car la population
n'est parfois que de passage et
la solidarité au sien du quartier
est plus faible
Relativement importantes du
fait du nombre important
d'abonnés ayant des niveaux
revenus et de consommation
différents.
Source : tableau établi par l'auteur
Tableau 1. 4: Comparaison entre types de gestion en
milieux rural et urbain.
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
77

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
ADF Test Statistic
2.050157
1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
-2.8622
-1.9791
-1.6337
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit
root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNREN)
Method: Least Squares
Date: 07/12/08 Time: 12:24
Sample(adjusted): 1997 2006
Included observations: 10 after adjusting endpoints
Variable
LNREN(-1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Coefficient
0.004551
-0.014705
-0.014705
0.030358
0.008294
21.28449
Std. Error
0.002220
t-Statistic
2.050157
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat
Prob.
0.0706
0.019984
0.030137
-4.056898
-4.026639
1.190561
Tableau 3. 1: Test racine unitaire de la variable LogRen
ADF Test Statistic
-4.012390
1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
-2.9075
-1.9835
-1.6357
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit
root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNREN,2)
Method: Least Squares
Date: 07/12/08 Time: 12:31
Sample(adjusted): 1998 2006
Included observations: 9 after adjusting endpoints
Variable
D(LNREN(-1))
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Coefficient
-0.734439
0.639479
0.639479
0.020159
0.003251
22.89655
Std. Error
0.183043
t-Statistic
-4.012390
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat
Prob.
0.0039
-0.009285
0.033574
-4.865901
-4.843987
2.123733
Tableau 3. 2: Test racine unitaire de la variable D
(logRent (-1))
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
78
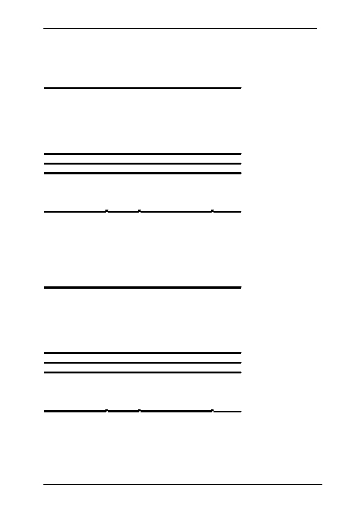
Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
ADF Test Statistic
2.008629
1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
-2.8622
-1.9791
-1.6337
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit
root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNDE)
Method: Least Squares
Date: 07/12/08 Time: 12:35
Sample(adjusted): 1997 2006
Included observations: 10 after adjusting endpoints
Variable
LNDE(-1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Coefficient
0.006349
-0.021391
-0.021391
0.168934
0.256847
4.119904
Std. Error
0.003161
t-Statistic
2.008629
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat
Prob.
0.0755
0.109782
0.167155
-0.623981
-0.593722
0.848538
Tableau 3. 3: Test racine unitaire de la variable logDE
ADF Test Statistic
-5.605488
1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
-2.9075
-1.9835
-1.6357
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit
root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNDE,2)
Method: Least Squares
Date: 07/12/08 Time: 12:41
Sample(adjusted): 1998 2006
Included observations: 9 after adjusting endpoints
Variable
D(LNDE(-1))
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Coefficient
-0.684315
0.772118
0.772118
0.073808
0.043581
11.21616
Std. Error
0.122079
t-Statistic
-5.605488
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat
Prob.
0.0005
-0.051110
0.154614
-2.270257
-2.248343
2.700948
Tableau 3. 4: Test racine unitaire de la variable D
(logDE (-1))
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
79
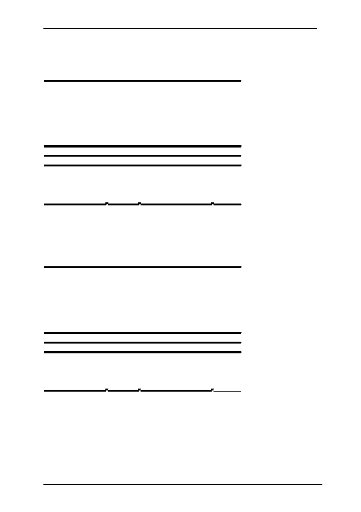
Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
ADF Test Statistic
0.342958
1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
-2.8622
-1.9791
-1.6337
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit
root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNII)
Method: Least Squares
Date: 07/12/08 Time: 12:45
Sample(adjusted): 1997 2006
Included observations: 10 after adjusting endpoints
Variable
LNII(-1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Coefficient
0.007153
-0.004304
-0.004304
0.985498
8.740857
-13.51650
Std. Error
0.020856
t-Statistic
0.342958
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat
Prob.
0.7395
0.123165
0.983384
2.903300
2.933559
1.445007
Tableau 3. 5: Test racine unitaire de la variable LogI
ADF Test Statistic
-2.116382
1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
-2.9075
-1.9835
-1.6357
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit
root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNII,2)
Method: Least Squares
Date: 07/12/08 Time: 12:52
Sample(adjusted): 1998 2006
Included observations: 9 after adjusting endpoints
Variable
D(LNII(-1))
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Coefficient
-1.585441
0.300911
0.300911
1.004424
8.070944
-12.28015
Std. Error
0.749128
t-Statistic
-2.116382
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat
Prob.
0.0672
0.340716
1.201299
2.951145
2.973059
1.282952
Tableau 3. 6: Test racine unitaire de la variable D (logI
(-1))
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
80

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
ADF Test Statistic
0.750446
1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
-4.3260
-3.2195
-2.7557
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit
root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNA)
Method: Least Squares
Date: 07/11/08 Time: 02:30
Sample(adjusted): 1997 2006
Included observations: 10 after adjusting endpoints
Variable
LNA(-1)
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Coefficient
0.016060
-0.144332
0.065767
-0.051013
0.011379
0.001036
31.68595
3.742036
Std. Error
0.021401
0.270753
t-Statistic
0.750446
-0.533075
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
Prob.
0.4745
0.6085
0.058836
0.011100
-5.937191
-5.876674
0.563170
0.474477
Tableau 3. 7: Test racine unitaire de la variable LogA
ADF Test Statistic
-7.005135
1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
-4.4613
-3.2695
-2.7822
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit
root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNA,2)
Method: Least Squares
Date: 07/11/08 Time: 02:32
Sample(adjusted): 1998 2006
Included observations: 9 after adjusting endpoints
Variable
D(LNA(-1))
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Coefficient
-1.742039
0.102810
0.875160
0.857326
0.008248
0.000476
31.54059
1.596363
Std. Error
0.248680
0.014811
t-Statistic
-7.005135
6.941412
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
Prob.
0.0002
0.0002
0.000859
0.021836
-6.564576
-6.520749
49.07192
0.000211
Tableau 3. 8: Test racine unitaire de la variable D (logA
(-1))
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
81

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
ADF Test Statistic
-0.536797
1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
-2.8622
-1.9791
-1.6337
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit
root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNB)
Method: Least Squares
Date: 07/12/08 Time: 13:12
Sample(adjusted): 1997 2006
Included observations: 10 after adjusting endpoints
Variable
LNB(-1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Coefficient
-0.000790
0.001095
0.001095
0.079317
0.056621
11.68045
Std. Error
0.001471
t-Statistic
-0.536797
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat
Prob.
0.6044
-0.013232
0.079360
-2.136090
-2.105832
2.113147
Tableau 3. 9: Test racine unitaire de la variable LogB
ADF Test Statistic
-3.367100
1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
-2.9075
-1.9835
-1.6357
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit
root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNB,2)
Method: Least Squares
Date: 07/12/08 Time: 13:18
Sample(adjusted): 1998 2006
Included observations: 9 after adjusting endpoints
Variable
D(LNB(-1))
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Coefficient
-1.101707
0.581120
0.581120
0.078693
0.049541
10.63939
Std. Error
0.327198
t-Statistic
-3.367100
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat
Prob.
0.0098
0.012819
0.121588
-2.142086
-2.120172
2.204593
Tableau 3. 10: Test racine unitaire de la variable D
(logB (-1))
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
82

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
ADF Test Statistic
-3.010349
1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
-2.9677
-1.9890
-1.6382
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit
root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RES)
Method: Least Squares
Date: 07/12/08 Time: 13:32
Sample(adjusted): 1999 2006
Included observations: 8 after adjusting endpoints
Variable
RES(-1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Coefficient
-1.090973
0.523940
0.523940
0.006880
0.000331
29.01627
Std. Error
0.362408
t-Statistic
-3.010349
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat
Prob.
0.0197
0.002835
0.009971
-7.004068
-6.994138
1.506120
Tableau 3. 11: Test racine unitaire sur les
résidus
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 07/12/08 Time: 13:40
Sample: 1996 2006
Lags: 2
Null Hypothesis:
LNDE does not Granger Cause LNREN
LNREN does not Granger Cause LNDE
LNI does not Granger Cause LNREN
LNREN does not Granger Cause LNI
LNA does not Granger Cause LNREN
LNREN does not Granger Cause LNA
LNB does not Granger Cause LNREN
LNREN does not Granger Cause LNB
LNI does not Granger Cause LNDE
LNDE does not Granger Cause LNI
LNA does not Granger Cause LNDE
LNDE does not Granger Cause LNA
LNB does not Granger Cause LNDE
LNDE does not Granger Cause LNB
LNA does not Granger Cause LNI
LNI does not Granger Cause LNA
LNB does not Granger Cause LNI
LNI does not Granger Cause LNB
LNB does not Granger Cause LNA
LNA does not Granger Cause LNB
Obs
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
F-Statistic
0.39209
1.49295
0.08777
0.61071
2.01366
0.16445
3.95594
0.97926
0.35712
0.92157
9.24085
0.71030
2.06018
0.36290
3.34791
3.64426
0.18282
0.01205
0.57305
1.94492
Probability
0.69904
0.32785
0.91768
0.58687
0.24830
0.85382
0.11276
0.45065
0.71994
0.46863
0.03166
0.54454
0.24264
0.71642
0.13986
0.12556
0.83951
0.98806
0.60418
0.25703
Tableau 3. 12: Test de causalité de Engle et
Granger
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
83
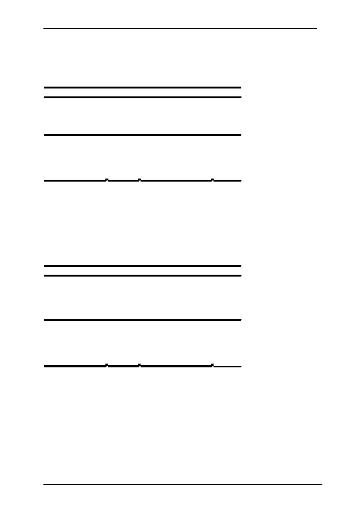
Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Dependent Variable: LNREN
Method: Least Squares
Date: 07/12/08 Time: 15:24
Sample: 1996 2006
Included observations: 11
Variable
C
LNDE
LNII
LNA
LNB
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Coefficient
5.509039
0.087131
0.000281
0.118686
-0.244177
0.991764
0.986274
0.007204
0.000311
41.99001
2.394691
Std. Error
0.881700
0.016865
0.003501
0.025097
0.044040
t-Statistic
6.248199
5.166210
0.080358
4.729070
-5.544435
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
Prob.
0.0008
0.0021
0.9386
0.0032
0.0015
4.330245
0.061488
-6.725456
-6.544595
180.6344
0.000002
Tableau 3. 13: Estimation par la méthode des
moindres carrés ordinaires
Dependent Variable: D(LNREN)
Method: Least Squares
Date: 07/13/08 Time: 16:26
Sample(adjusted): 1999 2006
Included observations: 8 after adjusting endpoints
Variable
C
RES(-1)
D(LNDE)
D(LNII)
D(LNA)
D(LNB)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Coefficient
0.030942
-0.210047
0.072502
-0.000924
-0.375851
-0.252560
0.951089
0.828812
0.007669
0.000118
33.15873
1.752961
Std. Error
0.021750
0.582078
0.059456
0.003272
0.372018
0.045959
t-Statistic
1.422645
-0.360857
1.219421
-0.282241
-1.010303
-5.495314
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
Prob.
0.2908
0.7528
0.3470
0.8043
0.4187
0.0316
0.010005
0.018534
-6.789682
-6.730100
7.778133
0.117829
Tableau 3. 14: Modèle à correction d'erreur
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
84
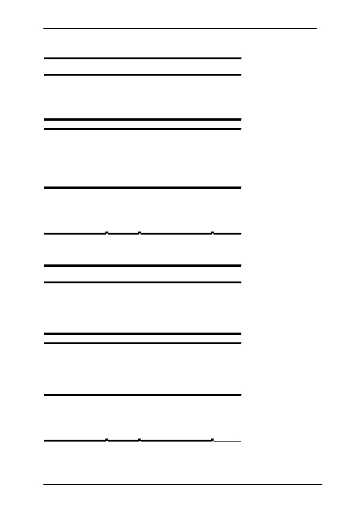
Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared
Test Equation:
0.035256
0.592811
Probability
Probability
0.966505
0.743486
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 07/14/08 Time: 16:02
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable
C
RES
LNDE
LNII
LNA
LNB
RESID(-1)
RESID(-2)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Coefficient
0.449482
0.048920
9.91E-05
0.000164
-0.004203
-0.023498
-0.444931
-0.178810
0.065868
-6.473057
0.010452
0.000109
38.16553
2.242450
Std. Error
2.608181
2.164578
0.295567
0.009579
0.254113
0.116074
2.273714
1.945154
t-Statistic
0.172335
0.022600
0.000335
0.017172
-0.016539
-0.202438
-0.195685
-0.091926
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
Prob.
0.8914
0.9856
0.9998
0.9891
0.9895
0.8728
0.8770
0.9416
2.09E-16
0.003823
-6.703450
-6.528139
0.010073
0.999978
Tableau 3. 15: Test d'autocorrélation sur la MCO
Ramsey RESET Test:
F-statistic
Log likelihood ratio
Test Equation:
0.855785
3.918197
Probability
Probability
0.490466
0.140985
Dependent Variable: LNREN
Method: Least Squares
Date: 07/14/08 Time: 17:06
Sample: 1996 2006
Included observations: 11
Variable
C
LNDE
LNII
LNA
LNB
FITTED^2
FITTED^3
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Coefficient
4235.142
90.69281
0.292333
123.6983
-254.3581
-240.0189
18.45075
0.994232
0.985581
0.007383
0.000218
43.94911
2.014662
Std. Error
4551.147
97.24101
0.312001
132.4867
272.5580
259.8098
20.15713
t-Statistic
0.930566
0.932660
0.936960
0.933666
-0.933226
-0.923826
0.915346
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
Prob.
0.4048
0.4038
0.4018
0.4033
0.4035
0.4079
0.4118
4.330245
0.061488
-6.718020
-6.464813
114.9193
0.000198
Tableau 3. 16: Test de stabilité de Ramsey
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
85
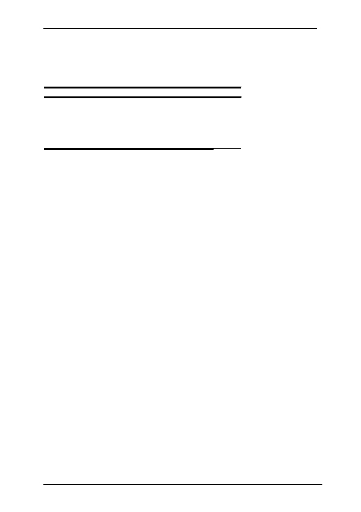
Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Dependent Variable: D(LNREN)
Method: Least Squares
Date: 07/14/08 Time: 17:57
Sample(adjusted): 1999 2006
Included observations: 8 after adjusting endpoints
Variable
C
RES(-1)
D(LNDE)
D(LNII)
D(LNA)
D(LNB)
CUSUM
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Coefficient
0.013927
0.367992
0.101610
-0.002572
-0.061631
-0.266040
-0.014821
0.980673
0.864709
0.006817
4.65E-05
36.87267
2.284484
Std. Error
0.023727
0.697177
0.057856
0.003200
0.416989
0.042285
0.011980
t-Statistic
0.586979
0.527832
1.756268
-0.803952
-0.147800
-6.291584
-1.237204
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
Prob.
0.6621
0.6908
0.3295
0.5689
0.9066
0.1003
0.4328
0.010005
0.018534
-7.468167
-7.398655
8.456741
0.257328
Tableau 3. 17: ECM avec la variable cusum1
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
86

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
INDICATEURS
Population
Nombre de branchements domestiques faturés(BP)
% Population desservie par les branchements
Nombres de bornes fontaines actifs(BF)
% Population desservie par les bornes fontaines
Total population desservie(BP+BP)
% de Population totale desservie
Nombre de branchements sociaux realises
Nombre de branchements ordinaries realises
Nombre de bornes fontaines realises
Nombre d'abonnés
Qualité bactériologique:Nbre d'échantillon
conforme
Volume d'eau produit par le secteur
Volume d'eau vendu par le secteur
Rendement de réseau
Longueur de réseau
Nombre d'heures de services continu par jour
Nombre d'employés Société d'Exploitation
Nombre d'employés Société de Patrimoine
Facture mensuelle pour consummation de 5 m3
Investissement SONES(Fonds publics)
Dont bailleurs de fonds(prêt)
Dont bailleurs de fonds(equity)
Don't fonds propres SONES
Investissement SDE(Fonds privés)
Total Investissement secteur
Chiffre d'affaire du secteur
Redevances SONES
Dépenses d'exploitation SDE
Cash Flow SONES
Trésorerie SONES
Unité
Millions
U
%
U
%
U
%
U
U
U
U
%
3
m /j
3
m /j
%
Km
16
U
U
F CFA
Milliers F CFA
Milliers F CFA
Milliers F CFA
Milliers F CFA
Milliers F CFA
Milliers F CFA
Milliers F CFA
Milliers F CFA
1996
3,52
217156
58,0
2755
23,5
2,87
81,5
3299
2293
241671
96,0
270274
178466
66,0
6000
16
1330
70
804
1997
3,64
222456
57,4
2854
23,5
2,95
81,0
8212
3982
254847
95,0
263890
190538
72,2
6085
16
1316
80
829
1998
3,73
230668
58,1
3031
24,4
3,08
82,5
4273
3598
177
268152
95,4
263648
196184
74,4
6196
16
1257
81
853
1999
3,82
244596
60,2
3223
25,3
3,27
85,5
9575
3383
192
286815
96,7
269390
198654
73,7
6333
18
1218
80
876
2000
3,92
251900
60,4
3250
24,9
3,34
85,3
6831
3610
27
298737
97,5
292373
215729
73,8
6514
20
1183
81
910
2001
4,02
264161
61,8
3396
25,3
3,50
87,1
20048
2888
146
327501
97,9
294729
229048
77,7
6664
20
1168
78
947
11809913 51064020 17850608 12137017
4360864
7449050
0,00
2128000
12332833
0,00
2747000
2972139
0,00
2005000
5584821
0,00
2558000
8419000
8419000
4587095
5588000
5588000
13937913 53811020 19855608 14695017
25287000 26770000 28173000 31715000 34291000
7534921 8400236 10237768 12024714 12264761
Milliers F CFA 10213411 17210754 21692785 21512210
24041715 25076158
Milliers F CFA
Milliers F CFA
4664544
2990003
1758435
1553294
4267942
2351550
4872012
4839891
6114504
4842337
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
87
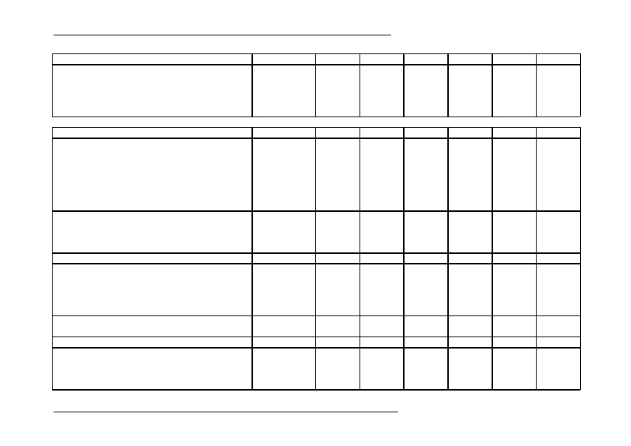
Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Résultat Net SONES
Tarif moyen TTC
Tarif moyen hors taxes
Prix SDE
Prix SONES
3
Prix ONAS (base m assainissement)
INDICATEURS
Population
Nombre de branchements domestiques faturés(BP)
% Population desservie par les branchements
Nombres de bornes fontaines actifs(BF)
% Population desservie par les bornes fontaines
Total population desservie(BP+BP)
% de Population totale desservie
Nombre de branchements sociaux realises
Nombre de branchements ordinaries realises
Nombre de bornes fontaines realises
Nombre d'abonnés
Qualité bactériologique:Nbre d'échantillon
conforme
Volume d'eau produit par le secteur
Volume d'eau vendu par le secteur
Rendement de réseau
Longueur de réseau
Nombre d'heures de services continu par jour
Nombre d'employés Société d'Exploitation
Nombre d'employés Société de Patrimoine
Facture mensuelle pour consummation de 5 m3
Investissement SONES(Fonds publics)
Dont bailleurs de fonds(prêt)
Dont bailleurs de fonds(equity)
Don't fonds propres SONES
Milliers F CFA
F/m
F/m
F/m
F/m
F/m
3
3
3
3
3
-1285920
Unité
Millions
U
%
U
%
U
%
U
U
U
U
%
3
m /j
3
m /j
%
Km
16
U
U
F CFA
Milliers F CFA
Milliers F CFA
Milliers F CFA
Milliers F CFA
2002
4,14
296698
67,4
3554
24,9
3,82
92,3
14569
3741
158
338893
97,1
306618
240648
78,5
6835
20
1155
80
882
708536
3154916
0
-824761
395,87
365,92
239,54
110,29
28,49
2003
4,3
312493
68,3
3583
24,2
3,98
92,5
15279
4306
35
363228
98,0
311526
249024
79,9
6996
20
1160
80
957
-3000432
414,24
375,76
239,54
110,29
28,49
2004
4,41
332,049
70,8
3688
24,3
4,12
95,0
14237
5375
0
381436
97,7
324583
260099
80,1
7159
20
16,61
957
-1208560
430,24
393,29
234,51
135,75
36,54
2005
4,52
357861
74,4
3710
23,8
4,44
98,2
21635
3853
0
412304
95,5
341599
273701
80,1
7323
23
11,55
957
-2026483
446,40
409,10
242,79
144,10
41,00
2006
4,63
374368
76,0
3717
23,3
4,60
99,3
11284
5892
0
427802
97,6
354022
285205
80,6
7500
24
1148
957
-1430831
456,10
412,00
246,00
143,00
44,32
2007
4,75
24
21557163 27483824 14267012 16242243 20014376
3883965
1000000
15079880
0
3395649
2284766
6554706
1114864
6056606
1714034
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
88

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Investissement SDE(Fonds privés)
Total Investissement secteur
Chiffre d'affaire du secteur
Redevances SONES
Dépenses d'exploitation SDE
Cash Flow SONES
Trésorerie SONES
Résultat Net SONES
Tarif moyen TTC
Tarif moyen hors taxes
Prix SDE
Prix SONES
3
Prix ONAS (base m assainissement)
Milliers F CFA
Milliers F CFA
2324000
3032536
3855000
2869700
2025000
2885086
2863229
25412163 30293524 16292012 19127328 22877605
Milliers F CFA 35912000 39483000 40817000 43605206
Milliers F CFA 12688738 13666474 14232029 15347168
15721962 17801000
Milliers F CFA 24075667 26707269 26967744 28309000
30678000
Milliers F CFA
Milliers F CFA
Milliers F CFA
F/m
F/m
F/m
F/m
F/m
3
3
3
3
3
6982931
2335269
-486874
460,30
414,73
251,00
141,00
45,23
7829432
3220283
384050
480,49
432,70
257,70
143,92
41,15
7923282
6231841
563885
485,55
434,69
257,51
146,51
40,8
9506603
6829579
483,04
433,59
260,21
142,74
40,55
10113597 11673291
512,98
559,20
279,20
174,49
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
89

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Liste des tableaux
Tableau 1. 1: Comparaison du service rendu par les
bornes-fontaines et les branchements
particuliers................................................................................................................................
75
Tableau 1. 2 : grille
tarifaire.....................................................................................................
76
Tableau 1. 3 : Conséquences tarifaires pour la SONES et la
SDE dans différents cas-types.. 76
Tableau 1. 4: Comparaison entre types de gestion en milieux rural
et urbain. ........................ 77
Tableau 3. 1: Test racine unitaire de la variable
LogRen......................................................... 78
Tableau 3. 2: Test racine unitaire de la variable D (logRent
(-1)) ........................................... 78
Tableau 3. 3: Test racine unitaire de la variable
logDE........................................................... 79
Tableau 3. 4: Test racine unitaire de la variable D (logDE (-1))
............................................. 79
Tableau 3. 5: Test racine unitaire de la variable
LogI.............................................................. 80
Tableau 3. 6: Test racine unitaire de la variable D (logI (-1))
................................................. 80
Tableau 3. 7: Test racine unitaire de la variable LogA
............................................................ 81
Tableau 3. 8: Test racine unitaire de la variable D (logA
(-1))................................................ 81
Tableau 3. 9: Test racine unitaire de la variable LogB
............................................................ 82
Tableau 3. 10: Test racine unitaire de la variable D (logB (-1))
.............................................. 82
Tableau 3. 11: Test racine unitaire sur les résidus
................................................................... 83
Tableau 3. 12: Test de causalité de Engle et Granger
.............................................................. 83
Tableau 3. 13: Estimation par la méthode des moindres
carrés ordinaires............................. 84
Tableau 3. 14: Modèle à correction
d'erreur............................................................................
84
Tableau 3. 15: Test d'autocorrélation sur la
MCO................................................................... 85
Tableau 3. 16: Test de stabilité de
Ramsey..............................................................................
85
Tableau 3. 17: ECM avec la variable
cusum1..........................................................................
86
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
90

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Table des Graphiques
Graphique 1. 1 : les acteurs du sous secteur de l'eau potable
.................................................. 15
Graphique 1. 3 : Evolution des prix entre 1997 et 2004
.......................................................... 25
3
Graphique 1. 4 : Prix moyen du m selon le secteur
géographique.......................................... 27
Graphique 1. 5 : Ecarts financiers entre la ville de Dakar et les
autres centres du Sénégal..... 27
Graphique 1. 6 : Part des recettes et des consommations selon la
classe d'usager.................. 28
Graphique 1. 7 : Représentation agrégée des
flux financiers entre les différentes classes
d'utilisateurs.............................................................................................................................
29
Graphique 1. 8 : Représentation détaillée
des flux financiers au sien de la classe des usagers
domestiques..............................................................................................................................
30
Graphique 3. 1 : Graphique du LNRen
....................................................................................
50
Graphique 3. 2 : Graphique du LNDE
.....................................................................................
51
Graphique 3. 3 : Graphique du LNI
.........................................................................................
51
Graphique 3. 4 : Graphique du
LNA........................................................................................
52
Graphique 3. 5: Graphique du
LNB.........................................................................................
53
Graphique 3. 6: Evolution comparée des LNREN, LDE, LNI,
LNA et LNB ......................... 53
Graphique 3. 7: Test
Cusum....................................................................................................
61
Graphique 3. 8: Test Cusum
carré............................................................................................
62
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
91

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
Table des Matières
INTRODUCTION GENERALE :
.............................................................................................
1
Chapitre I : Partenariat Public Privé dans la distribution
d'eau potable : Etat des lieux ........... 7
I/ - La régulation par un contrat de gestion
déléguée.............................................................
9
I1 - La source d'inspiration
.................................................................................................
9
I 2- Le financement des infrastructures de développement
............................................... 11
II/- L'instauration du PPP dans le service de l'eau
.............................................................. 12
II 1- Les raisons de la réforme
institutionnelle..................................................................
13
II 2- L'organisation institutionnelle mise en place
............................................................ 14
III/- Les obligations contractuelles et les engagements
...................................................... 17
III 1 - La société de patrimoine
..........................................................................................
17
III 2 - La société d'exploitation
.........................................................................................
17
III 3 -
L'Etat......................................................................................................................
18
IV/ - Les risques identifiés dans le partenariat public
privé................................................. 19
IV 1 - L'attitude des parties face aux contrats
................................................................... 19
IV 1-1- La perte de vue des contrats
:.............................................................................
19
IV1-2
IV1-3
- Le risque de coalition
:......................................................................................
19
-Le Non-respect des engagements contractuels des partenaires :
Ceci induit des
risques d'exploitation dont l'ampleur peut compromettre la
réussite du partenariat et
de la
réforme.................................................................................................................
19
IV 2- Les risques liés à l'inscription des
contrats dans la durée :.................................... 20
IV 2-1- Le risque de marché :
.........................................................................................
20
IV 2-2- Le risque de dépassement des coûts
d'exploitation : ......................................... 21
IV 2-3- Les risques liés au contrôle de
l'exploitation :................................................... 21
V/- Les Réalisations
.............................................................................................................
22
V1- Les branchements particuliers :
.................................................................................
22
V 2- L'extension des bornes
fontaines...............................................................................
23
VI- La politique de
tarification.............................................................................................
24
VI 1- Une tarification identique sur tout le
périmètre affermé
:........................................ 26
VI 2- La tarification différenciée selon les
usagers et leur consommation : ..................... 28
VII/- Un modèle spécifique au milieu rural
......................................................................... 31
VII 1- Comment accroître l'efficacité d'une gestion
locale ?............................................ 31
VII 2- Les modèles de gestion urbaine et rurale
peuvent-ils ............................................. 31
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
92

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au
Sénégal.
converger ?
.......................................................................................................................
31
Chapitre II: Partenariat Public Privé dans la distribution
d'eau potable : une analyse
économique
..............................................................................................................................
34
I/-La technologie et les coûts du service
..............................................................................
37
I1- Le réseau et la
technologie..........................................................................................
37
I2- La représentation économique du
coût.......................................................................
38
I2-1
I2-2
- La fonction de coût
...............................................................................................
38
- Le coût et la demande
...........................................................................................
39
II/- Le choix de mode de
gestion..........................................................................................
40
II 1- La gestion publique
:..................................................................................................
40
II 2 - La gestion privée
:.....................................................................................................
41
II 3- Le choix :
...................................................................................................................
44
Chapitre III: Une modélisation économétrique
de la rentabilité du Partenariat Public Privé
dans la distribution d'eau
potable.............................................................................................
47
I/- La construction du modèle
..............................................................................................
47
I 1- La spécification du modèle
.........................................................................................
48
I 2- La description des données
.........................................................................................
49
I 3- Les
graphiques.............................................................................................................
50
II / - La stationnarité et la cointégration du
modèle ............................................................. 54
II 1- La stationnarité : tests de racine
unitaire.................................................................... 54
II 2- La cointégration
.........................................................................................................
57
III/- Quelques
recommandations..........................................................................................
62
CONCLUSION
........................................................................................................................
64
Bibliographie
:..........................................................................................................................
66
Webographie:
...........................................................................................................................
74
ANNEXES :
.............................................................................................................................
75
Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et
Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB
93
| 


