|
MÉMOIRE
MASTER II Management de la qualité
Unité Formation Recherche
Institut d'Administration des entreprises
METZ
Les impacts de la robotisation sur l'industrie.
Ludovic
HERGOTT

Tuteur académique : Omar BENTAHAR Tuteur d'entreprise :
Martin SCHISSLER Jury : Omar BENTAHAR, Houssam TAZI Date de la soutenance : 17
septembre 2018
Page 2 sur 111
Résumé
La robotisation est une technologie qui participe activement
à la modification du travail. Elle joue un nouveau rôle et permet
à la fois de répondre à différents enjeux. Nous
nous proposons de répondre à travers ce mémoire : comment
intégrer au mieux la robotisation en prenant compte les effets
potentiels de cette technologie sur l'industrie, en y évoquant à
la fois les impacts économiques sociaux et environnementaux. Pour se
faire une analyse approfondie de la littérature a été
mené afin d'en cerner les principes et hypothèses conduites par
les chercheurs. Cette étude sera confrontée à
l'expérience du réel en y analysant une industrie automobile qui
est le secteur industriel disposant du parc robotique le plus important. Seize
entretiens semi-directifs ont été menés sur un
échantillon issu de différentes catégories
socioprofessionnelles, ce qui permet d'établir des constats
intéressants et de proposer des pistes d'accompagnement à ce
changement, complémentaire de l'apport théorique initial.
Abstract
Robotization is a technology that actively participates in the
modification of work. It plays a new role and allows both to answer different
issues. We propose to answer through this thesis: how best to integrate
robotization by taking into account the potential effects of this technology on
the industry, by evoking both social and environmental economic impacts. To do
a thorough analysis of the literature was conducted to identify the principles
and assumptions led by researchers. This study will be confronted with the
experience of reality by analyzing an automobile industry which is the
industrial sector with the largest robotic fleet. Sixteen semi-structured
interviews were conducted on a sample from different socio-professional
categories, which makes it possible to draw up interesting observations and to
suggest ways of supporting this change, complementary to the initial
theoretical contribution.
Remerciements.
Je tiens à remercier dans un premier temps
l'Université de Lorraine et son établissement IAE de Metz ainsi
que toutes les personnes du corps professoral et ses intervenants pour m'avoir
enseigné les connaissances fondamentales du domaine de la qualité
et du management et de façon plus particulière à :
Mr. BENTAHAR Omar : Responsable
pédagogique pour m'avoir guidé dans l'élaboration du
présent mémoire.
Mr. SCHISSLER : tuteur de formation, pour son
soutien au quotidien, son expertise et pour avoir parfaitement tenu son
rôle de tuteur.
A l'entreprise Faurecia Hambach Automotive Exteriors pour
m'avoir accordé leur confiance lors de mon admission en tant
qu'alternant mais également tout au long de mon projet.
Je remercie également les services de production,
logistique, administratif, maintenance ainsi que le personnel ayant
participé aux projets en amenant une expérience
complémentaire dans ma démarche, notamment à ceux qui ont
participé aux entretiens me permettant d'avoir une analyse approfondie
vis-à-vis de ma problématique.
Je n'oublie pas tous les partenaires avec lesquels j'ai pu
collaborer tout au long de mon alternance sans qui, ce projet de recherche
n'aurait pas abouti.
Page 3 sur 111
A tous, merci pour le temps que vous m'avez accordé dans
l'élaboration de ma recherche.
SOMMAIRE
Page 4 sur 111
1. Introduction 5
PARTIE THÉORIQUE 13
2. La robotisation au coeur d'une nouvelle
révolution industrielle. 14
3. Les enjeux de la robotisation dans l'industrie.
16
4. Les apports positifs de la robotisation dans
l'industrie 22
5. Les problèmes soulevés par la
robotisation 31
6. Pistes de solutions apportées par la
théorie 42
7. L'apport de la théorie dans la
problématique 48
PARTIE EMPIRIQUE 49
8. Contexte de l'étude empirique
50
9. Méthodologie de recherche 57
10. Résultats de l'étude :
61
11. Les problèmes soulevés dans
l'entreprise Faurecia 66
12. Les solutions pour pallier aux problèmes
soulevés dans l'entreprise. 71
CONCLUSION 77
ANNEXES 82
Bibliographie 104
Table des illustrations 111
Page 5 sur 111
1. Introduction
Lorsque nous entendons le mot « robot », notre
imaginaire nous renvoie généralement à une vision de
compagnon servile, androïde ou encore ennemi de l'homme. Nous imaginons
moins les robots qui peuplent notre quotidien et qui améliorent notre
vie personnelle et professionnelle. Ces derniers visibles ou non, sont
constitués d'une nouvelle forme de connaissance : l'intelligence
artificielle.
En observant notre quotidien, nous constatons que les robots
sont partout et prennent de plus en plus de place dans nos vies. Ce n'est plus
un mythe et on constate qu'il a émergé en peu de temps, une forme
de réalité sociale suscitant autant de fascination que
d'inquiétudes. (Schweitzer, Puig-Verges, 2018).
Le domaine du travail, par son histoire, tend à
évoluer et intègre de plus en plus cette nouvelle technologie
robotique. Le monde industriel a profondément changé depuis ces
dernières années : l'évolution des marchés et la
mondialisation impacte les entreprises. Pour répondre aux
critères normatifs, à une clientèle exigeante, les
entreprises utilisent désormais ces nouveaux alliés robotiques
car leur évolution à son stade actuel permet de répondre
à de nombreux enjeux.
1.1 L'évolution de la
robotisation
La technologie de robotisation puise ses origines dans la
science-fiction, plus particulièrement dans la cinématographie,
mais est devenue depuis une réalité pour chacun d'entre nous.
Avant les robots, il y avait les automates, c'est à dire des dispositifs
capable d'agir uniquement selon un programme mais n'ayant aucune
capacité de réaction envers leur environnement. C'est en 1920 que
le terme robot apparaît pour la première fois, lors d'une
pièce de théâtre (Rossum's Universal Robots) mise en
scène par Karel Capek où les hommes et les robots (appelés
Robota dans la pièce, signifiant «corvée» en
Tchèque) cohabitent mais dès le début ces robots
considérés comme des «esclaves de métal» sont
destinés à réaliser des tâches ingrates, et
finissent par se rebeller contre les humains. Ainsi c'est la première
mise en scène évoquant la peur de l'homme envers les robots.
Page 6 sur 111
De nos jours le robot est défini comme un
système intelligent qui perçoit son environnement à
travers des capteurs et qui crée son propre modèle du monde
(Kuipers, 2017). Burton, et al. (2017) ajoutent qu'ils ont la capacité
à réaliser exactement ce qui a été instruit par
l'humain mais dont la résultante n'est pas toujours certaine car ces
derniers sont dotés d'un sens de réaction algorithmique
extrêmement rapide rendant la compréhension de l'acheminement des
étapes de l'algorithme très difficile. La HAX (le plus grand
accélérateur du monde) complète la définition comme
« un objet pouvant s'adapter à son environnement de
façon autonome que ce soit à travers ses mouvements ou ses
décisions». Cependant il n'est pas doté d'un sens
moral, éthique ou d'une capacité déterminée ce qui
pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour son environnement
(Burton, et al. 2017). Dans l'industrie automobile ils effectuent
désormais des tâches de plus en plus variées, tel que
assemblage de composants à la chaîne, la vérification de la
conformité des pièces, l'acheminement par convoyage des
pièces, la mise à disposition des produits sur la ligne
(systèmes de logistique AGV) ou encore l'élimination des
rebuts.
Les robots bénéficient au moins de l'un des
attributs suivants (Becker, 2012) :
l Equipé d'un corps transportant l'ensemble du
matériel informatique
l Alimentation électrique et/ou hydraulique,
pneumatique
l Dispose de moteurs permettant à l'ensemble de se
déplacer
l Perçoit son environnement par le biais de capteurs.
l Capable d'interagir ou de modifier son environnement avec
intelligence.
l Agit suivant un comportement intelligent en imitant le
comportement humain (on parle alors d'androïde) ou animal (bioide).
l Se mouvoir sans l'intervention humaine, de manière
autonome
Le robot est donc un système doté
d'intelligence artificielle, issu d'algorithmes introduits par l'homme, capable
de générer leurs propres objectifs et interaction en fonction de
la situation (Kuipers, 2017). La plus perfectionnée de ces intelligences
peut même être capable de prendre ses propres décisions sans
avoir besoin d'une intervention humaine.
Page 7 sur 111
Il existe différents types de catégories de robot,
notons par exemple :
l Mobiles : Se déplacent dans son environnement, ex :
drones,
l Domestiques : Utilisés pour réaliser des
tâches du quotidien, ex : robots aspirateurs.
l Industriels : Utilisés pour réaliser des
tâches industrielles de manière automatique, programmable,
polyvalente et autonome (objet de l'étude).
l collaboratifs (cobots) : Les hommes et les robots
réalisent des tâches en coactivité permettant
d'améliorer les conditions de travail de l'homme, sans le remplacer.
l Anthropomorphiques-Humanoïdes : Robots ressemblant
à l'homme (bipédie, présence de bras, d'une tête)
l Bioides : Robots ressemblant à la faune
sauvage...
L'automate est quant à lui un système capable de
réaliser des tâches induites par l'homme par le biais d'un
algorithme dont les conditions initiales et terminales ne peuvent être
modifiées par une forme d'intelligence artificielle (Kuipers, 2017). Ils
ne sont pas capables de réagir à leur environnement et
n'exécutent qu'une suite de tâches bien définies, sous
forme de syntaxe informatique, leur programmation étant donc très
primaire. La frontière entre l'automate et le robot est donc
l'intelligence artificielle. Ainsi, la robotique et l'intelligence artificielle
se rapprochent et convergent vers un mouvement technique et social qui impacte
une grande partie des secteurs d'activité actuels. (Schweitzer,
Puig-Verge, 2018)
Au quotidien nous utilisons de plus en plus ces
systèmes doté d'intelligence artificielle : traducteurs,
correcteurs orthographiques, assistants smartphones, etc., et il est
intéressant de savoir que ces machines peuvent développer une
forme de libre arbitre. Le meilleur exemple réside dans la voiture
autonome qui est capable en cas d'urgence de prendre des décisions
permettant d'éviter ou de limiter les conséquences des situations
graves. Nous constatons alors à tous niveaux (industriels, domestiques,
etc..) une migration des « robots d'interventions (exécution de
taches par imitation de l'homme) à une robotique
d'évaluation/action-décision » (Schweitzer,
Puig-Verges, 2018, p 292). Nous parlons plutôt de « processus et
d'attitudes évolutives définies par auto-apprentissage
» (Dolbeau-Bandin, 2016, p.128). La principale composante de cette
évolution étant l'intelligence artificielle.
Page 8 sur 111
1.2 Le concept de l'intelligence
artificielle
L'intelligence artificielle est le cerveau même de ces
machines de nouvelle génération et sont programmées
initialement par des ingénieurs et technicien permettant aux machines de
disposer d'un savoir préétabli (Ruskper, 2017). La voiture
autonome est par exemple en capacité de définir les
priorités de conduite (vitesses, distances, réactions, etc.)
selon les données programmées initialement.
La puissance de calcul des processeurs et autres composants
électroniques n'est plus l'unique facteur pour que le robot soit capable
de s'adapter à son environnement. Cela dépend d'une nouvelle
forme d'intelligence robotique conçue sur le modèle
d'intelligence en essaim (en référence aux insectes) (De Lacoste,
2017). Ce concept met en avant l'idée que les liaisons entre plusieurs
robots peuvent converger vers un « modèle global, complexe et
évolutif susceptible d'agir en collectif » introduisant alors
le modèle « d'intelligence collective ». (Schweitzer,
Puig-Verges, 2018, p 292).
Le Cunn (2015), spécialiste en intelligence
artificielle et directeur du secteur recherche et développement de
l'intelligence artificielle chez Facebook, décrit cette intelligence
comme la capacité du robot à constituer un ensemble d'actions
telle que les reconnaissances d'images, l'assemblage de pièces, la
conversation, etc. Cette dernière a également la capacité
de résoudre les problèmes en utilisant une méthodologie de
résolution propre à l'homme en s'inspirant de concepts et
schémas de fonctionnement humain. (Ganascia, 2017). Elle permet
également d'identifier et de résoudre les problèmes de
traitement de l'information. Ces problèmes peuvent être d'ordre
quantitatif : un trop grand nombre d'informations rend le traitement trop long,
fastidieux voire impossible dans les délais demandés (Marr, 1977)
et sous-entend un besoin d'algorithmes qui permet une extrapolation des
données des tendances (Federica Minichiello 2017).
Page 9 sur 111
1.2.1 Psychologie des robots.
Dans les années 50, le célèbre Alan
Turing réalise le test portant son nom dont l'objectif est de
déterminer la présence d'une intelligence dans une machine. Il
existe deux catégories distinctes : l'intelligence faible (la moins
évoluée, proche de l'automate : basé sur un apprentissage
fondé sur un système de règles et comportements ou
algorithmes) et l'intelligence artificielle forte (la plus
évoluée, proche du robot autonome basée sur un
système d'apprentissage de réseau neuronal - profond).
L'apprentissage des robots mène sur une voie de
recherche nouvelle provenant de trois facteurs de développement
différents (voir fig.1 (Gonzalez et Carlos, 2016)).

Figure 1 : Gonzalez, Carlos M.Machine Design. Dec 2016,
Vol. 88 Issue 12, p241
L'apprentissage automatique (machine
learning): Les ingénieurs instaurent un programme de base
comportant des données issues du monde humain sur lequel apprenant son
contenu le robot acquiert une « capacité de
généralisation ». (Federica Minichiello 2017 p.2).
Celui-ci permet au robot d'apprendre en fonction de son environnement et de
l'observation des comportements aux alentours. (Schweitzer, 2010).
1 Mis en forme et traduit par l'auteur, à
partir du document original.
Page 10 sur 111
L'apprentissage profond (Deep Learning) : La
machine acquiert elle-même du contenu grâce à un
réseau de neurones artificiels et s'inspire du cerveau humain, «
qui hiérarchise les unités de l'information, les ordonne des
plus simples aux plus complexes en toute autonomie et qui peut ainsi «
apprendre ». La difficulté principale pour la machine réside
dans l'apprentissage non supervisé, la connaissance que seul un
être vivant sait traduire de l'observation du monde ou, tout simplement,
de l'imprévu » (Federica Minichiello 2017 p.2).
Ainsi nous pouvons distinguer deux formes :
? L'intelligence artificielle faible :
Comparable à un automate, ne réalise qu'une simulation du
comportement humain.
? L'intelligence artificielle forte : C'est
une évolution des concepts et permet au robot d'avoir une conscience
d'elle-même.
Ainsi ces facteurs d'intelligence caractérisent le
robot et sa singularité qui le « rendent unique », il est la
combinaison de quatre capacités (Gelin et Guilhem, 2016, p.8) :
1. La polyvalence du système.
2. La capacité d'interaction avec l'homme.
3. Son degré d'autonomie décisionnelle (adaptation
face à une situation).
4. Son aptitude d'apprentissage. (intelligence artificielle)
Pour l'industrie automobile, l'exemple le plus concret
réside dans la voiture autonome. Ces voitures de haute technologie sont
munies d'intelligence artificielle forte permettant en cas d'urgence de prendre
leurs propres décisions, permettant de minimiser la gravité d'un
accident. Cette décision initialement programmée par des
ingénieurs n'est pas figée et peut évoluer en fonction de
son environnement et de ses expériences passées.
Page 11 sur 111
1.3 Les enjeux de demain
Pour garantir sa pérennité dans le temps,
l'entreprise doit respecter l'équilibre des secteurs de
l'économie, de l'environnement et social (Puesh, 2015). La robotisation
est l'une des innovations majeures de notre époque et se voit
l'être pour les années à venir (Attali, 2007). Elle permet
de développer le caractère « durable » de l'entreprise.
Mais il est important de l'utiliser de manière équitable. La
modernisation paraît être un axe prioritaire des entreprises
automobile qui veulent être plus compétitives et plus attractives
pour une clientèle recherchant l'originalité et la
customisation.
D'après l'université d'Oxford, plus de
47% des métiers aux Etats-Unis seront robotisés
d'ici 2025. Cette technologie offre de grandes opportunités
économiques. Elle est donc destinée à prendre une place de
plus en plus importante dans notre société et
particulièrement dans l'industrie automobile. Il est intéressant
de noter que la multiplicité de pratiques et la capacité infinie
de programmation permettent d'intégrer cette technologie à de
nombreux secteurs : automobile, aérospatial, agroalimentaire,
biotechnologie, chimie, électronique, plasturgie, recherche
&développement, métallurgie... Cette évolution
interroge, par sa nouveauté, mais également pour des questions
éthique et morale. Elle pousse à se demander s'il est
envisageable de confier du travail à une machine alors que ce même
travail était réalisé jusqu'alors par l'homme. On remarque
une forte tendance à la crainte sociale car l'homme et la machine sont
désormais intimement liés, l'un peut remplacer l'autre. L'un
peut-il être dépendant de l'autre ? Le destin de ce monde
industriel semble tout tracé mais il est encore temps pour se poser les
bonnes questions et essayer de comprendre cette nouvelle mutation pour pouvoir
anticiper d'éventuelles dérives.
Page 12 sur 111
Dans ce mémoire de recherche, nous utiliserons et
étudierons la littérature proposée et nous
compléterons ces recherches à l'aide d'exemples concrets
d'entreprises industrielles et celles du monde automobile qui est l'un des
secteurs les plus robotisés.
Schweitzer et. Puig-Verges (2018, p 293) indiquent dans leur
article « On a longtemps considéré que l'espace de choix
du robot se réduisait à quelques options en raison des limites de
leur autonomie ; avec l'augmentation de cette capacité, la
possibilité des tâches susceptibles d'être accomplies
augmente comme l'imprévisibilité des conséquences de leurs
résultats. » d'autant plus que les robots dépendent
fortement du milieu dans lequel il opère : « le robot
industriel évolue dans un milieu conçu et organisé pour le
rendement » (Dolbeau-Bandin, 2016, p.128) ce qui nous amène
à nous réfléchir sur la problématique suivante
:
Comment intégrer au mieux la robotisation dans
l'industrie en prenant compte les effets potentiels de cette technologie?
Il s'agira alors de déterminer les effets de la robotisation
sur la performance de l'entreprise, les obstacles à surmonter et les
moyens d'intégrer au mieux cette technologie, pour optimiser son
efficacité.
1.4 Structuration du mémoire
:
Ce mémoire sera structuré en trois grandes
parties : la première partie théorique permettra, grâce
à une analyse approfondie de la littérature de comprendre les
différents aspects et les effets de cette technologie sur le
fonctionnement de l'entreprise. La seconde partie, empirique, permet
grâce à une recherche établie sur l'expérimentation
terrain de déterminer si les concepts clés
déterminés en première partie s'appliquent dans le cadre
d'une industrie automobile. Pour y répondre, le mémoire sera
conduit par 16 entretiens semi-directifs. Nous disposerons d'une vision
approfondie sur le sujet en y évoquant des conclusions originales sur la
robotisation et ses effets sur l'industrie. Enfin, la dernière partie :
conclusion générale replace les résultats, les grandes
tendances, les défis et enjeux qui découlent de l'analyse de ce
mémoire.
PARTIE
Page 13 sur 111
THÉORIQUE
Page 14 sur 111
La partie théorique a pour objectif d'étudier la
littérature et de déterminer les différents concepts de la
robotisation ainsi que les idées de certains chercheurs qui ont eu
l'occasion d'étudier en relation avec la problématique du
mémoire. Elle apporte donc une justification scientifique des
éléments étudiés.
2. La robotisation au coeur d'une nouvelle
révolution industrielle.
L'entreprise a connu différents stades
d'évolution. La première révolution industrielle provenait
essentiellement des métiers manuels et agricoles. A cette époque,
les machines étaient déjà élément
d'inquiétudes chez les travailleurs (Ostergaard, 2018). Quelques
années plus tard ce fût un enjeu majeur pour le président
des états unis John Fitzgerald Kennedy : « le plus grand
défi des années 1960 est de maintenir le plein emploi au moment
où l'automatisation remplace l'homme ».
Aujourd'hui, devant parvenir à maximiser la
rentabilité de ses produits, l'entreprise recherche de nouveaux moyens
permettant d'agir sur les paramètres internes de son fonctionnement.
L'industrie se modernise et vit avec son temps, il en est de même de la
façon de travailler, on parle d'évolution du travail. Il est vrai
que nous entendons de plus en plus parler de fin du salariat, revenu universel
et entreprise 4.0. Le travail, défini comme la façon dont nous
nous organisons pour réaliser une valeur ajoutée (Ruskpin, 2017),
a profondément changé durant ces derniers siècles. Notons
par ailleurs que les mots «entreprises» ou
«salariés» sont des notions assez récentes.
Face à la vitesse à laquelle consommateurs et
marchés évoluent, les entreprises doivent repenser leurs
modèles de production et sans perdre de temps face à une
concurrence rude qui tend à se digitaliser davantage et à
travailler sur le concept de l'industrie 4.0.
Page 15 sur 111
2.1 L'industrie 4.0
Dans leur article, Xu, L. et al. (2018) décrivent
l'industrie 4.0 comme étant la quatrième révolution
industrielle. Ils représentent l'orientation des entreprises vers les
technologies de robotisation et digitalisation, incluant par exemple : «
les systèmes cyber-physiques (CPS), l'Internet des objets (IoT) et
l'informatique en nuage2 » (Xu, L. et al. 2018, p.2)
On constate que cette orientation permet de standardiser
l'entreprise. C'est une nouvelle forme de langage. Ils indiquent dans le
même article que : « L'industrie 4.0 a le potentiel de devenir
la langue de production mondiale. Chaque processus utilisé dans un
système Industrie 4.0 intègre des technologies existantes et
éprouvées avec de nouvelles technologies et applications pour
résoudre les problèmes de fabrication.»(GTAI, 2014, p.
29533).
Aujourd'hui, les machines sont connectées en tant que
communauté collaborative. Une telle évolution nécessite
l'utilisation d'outils de prédiction préalable, afin que les
données puissent être systématiquement traitées en
informations, pour expliquer les incertitudes, et ainsi prendre des
décisions plus « éclairées
».4
Mais le concept de l'industrie 4.0 ne se limite pas uniquement
aux robots et à l'automatisation intelligente, mais de tout son
processus de fabrication permettant de produire avec une qualité
constante et une réduction des coûts ce qui rend les produits plus
attractifs pour les consommateurs dans le cas où ces entreprises
prennent en compte les enjeux économiques,
2 «as the cyber physical systems (CPS),
Internet of Things (IoT) and cloud computing» Xu, L. D., Xu, E. L., &
Li, L. (2018). Industry 4.0: state of the art and future trends.
International Journal of Production Research, 56(8),
2941-2962. P2
3Industry 4.0 has the potential of becoming the
global language of production. Each process used in an Industry 4.0 system
integrates existing and proven technologies with new technologies and
applications to address manufacturing problems
4Today, in an Industry 4.0 factory, machines are
connected as a collaborative community. Such evolution requires the utilization
of advance- prediction tools, so that data can be systematically processed into
information to explain uncertainties, and thereby make more
«informed» decisions.
Page 16 sur 111
sociaux et écologiques pour garantir une
pérennité dans le temps (Ostergaard, 2018). C'est alors
qu'apparait une nécessité de développement
équitable des trois piliers fondamentaux : économique,
écologique, social de la robotisation (Puesch, 2015).
3. Les enjeux de la robotisation dans l'industrie.
3.1 Le concept du développement durable
Le développement durable est une notion qui apparait
pour la première fois en 1987 dans le rapport de Brundtland, il est
question de définir génériquement le développement
durable comme un « développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs
» (Rapport Brundtland, 1987).
3.1.1 Schéma de Brundtland
Instaurer une nouvelle technologie ou développer celle
existante devrait être pensé en respectant l'équité
des trois zones du schéma de Brundtland :

Figure 2 : Beitone, A. (2013). Chapitre 6 -
Économie et sociologie du développement. Dans Economie,
sociologie
et histoire du monde contemporain (pp. 283).
Page 17 sur 111
Ce schéma met en évidence les interactions
sociales, environnementales et économiques ainsi que leurs
conséquences en cas d'inégalité et la perte du
caractère « durable ». Cela permet de justifier que seule la
combinaison équitable des trois zones permet d'obtenir un
développement durable de l'organisme dans lequel une robotisation serait
développée. Il est important de préciser que ces enjeux
doivent être complémentaires et ne peuvent faire l'objet d'une
seule priorisation. Développer de manière asymétrique les
axes du schéma dirige l'entreprise vers des inégalités
d'enjeux.
Or, la robotique est une technologie utilisatrice importante
d'énergie et de matériaux que certains pays utilisent de
manière disproportionnée. Mais la Terre ne peut fournir autant de
ressources pour continuer à développer ces pays et ceux en voie
de développement industriel avec le même niveau d'énergie
et de ressources (Nair, 2011). L'entreprise doit s'inscrire dans une
démarche de développement durable afin de répondre
à la fois aux enjeux économiques tout en étant socialement
équitable et être tolérable environnementalement (Puesh,
2015).
Elle ne doit donc pas être dans la recherche du profit
en délaissant les aspects sociaux et environnementaux car ces derniers
font partie du cadre de cette même entreprise. (Badredine et Djaouahdou
2017).
Page 18 sur 111
3.2 L'enjeu environnemental de la robotisation
:
Les entreprises sont de plus en plus concernées par
l'environnement et investissent dans la recherche et développement en
prenant compte de l'aspect environnemental. Ce postulat, décrit par
Simon (2017) dans sa note pour les Échos, nous donne les
différents enjeux environnementaux, développement des
énergies renouvelables à la place des énergies fossiles,
prise en compte du changement climatique, protection de l'environnement
grâce au déploiement de nouvelles technologies intelligentes, tel
que les robots avec analyse de la consommation ou encore avancée sur les
standards écologiques. Ce sont autant de points qu'il est important
à prendre en considération lorsque l'entreprise souhaite
intégrer ces nouveaux robots dans sa sphère industrielle pour
conserver son leadership.
Grâce au développement exponentiel des
technologies, on remarque une amélioration des robots avec une
intégration de capteurs intelligents. Ils permettent l'optimisation de
certains traitements de la consommation d'énergie et donnent des
informations sur leurs utilisations. Ainsi le robot est capable de d'adapter
son usage énergétique en fonction des circonstances et des
situations dans lesquelles il se situe. Il est important de garder un
même niveau d'équité pour répondre à ces
critères. Walker et Wendy Philips (2006) proposent par exemple un
développement économique et social soumis à des
contraintes afin de minimiser les impacts négatifs sur
l'environnement.
L'investissement pour la mise en place d'un robot industriel
est amorti sur 2 ans après son intégration dans l'entreprise
(Bugmann et al. 2011), mais les robots industriels consomment beaucoup
d'électricité : les principaux coûts de la robotisation une
fois en place (en fonctionnement normal) sont liés à
l'utilisation d'énergie.
Sa consommation journalière est estimée à
150KWh, soit trois fois plus que celle d'un foyer en Europe et onze fois plus
qu'un foyer en Asie. (Bugmann et al. 2011). Cependant, il est
intéressant de constater que les coûts journaliers d'un robot aux
Etats-Unis sont estimés à 0,3US$ de l'heure (0,26€ /h), soit
50 fois inférieur comparé à ceux d'un ouvrier (Potter R.,
2004)), mais l'utilisation de la ressource énergétique,
même à bas coût ne peut pas être
négligée. (Bugmann et al. 2011).
Page 19 sur 111
3.3 L'enjeu social de la
robotisation:
Cet enjeu se traduit par le respect de plusieurs
critères faisant actuellement l'objet de nombreux débats. Il est
notamment question de respecter le partage des ressources financières
issues des robots qui réalisaient jusqu'alors les tâches
précédemment effectuées par l'Homme afin de réduire
les inégalités.
Les robots génèrent un bénéfice et
réduisent les coûts généraux de fonctionnement
d'entreprise. Ces bénéfices devraient être partagés
pour éviter le phénomène d'inégalité sociale
(Schweitzer, Puig-Verges, 2008).
L'enjeu du respect des conditions de travail intervient
également dans cet axe. Les entreprises peuvent désormais
effectuer des tâches lourdes et pénibles tout en respectant les
normes de sécurité associées en se délestant de
nombreuses contraintes physiques. Elles peuvent désormais agir sur de
nombreux paramètres de production sans interférer sur les
conditions de travail de l'homme. Cependant cet enjeu d'attribution des
tâches ne doit pas interférer avec l'attribution des
métiers. Ainsi, l'entreprise doit trouver le juste équilibre
entre respect des conditions de travail, d'hygiène de vie et la prise en
compte des attentes de leurs salariés.
Les enjeux sociaux de la robotisation feront l'objet de
développement plus détaillés dans la suite de ce
mémoire.
3.4 L'enjeu économique :
L'enjeu économique est capital pour une entreprise.
Elle doit être capable de développer sa performance
économique en prenant en compte les enjeux environnementaux et sociaux.
Face à la concurrence et au marché de plus en plus strict sur le
produit, elle doit répondre aux objectifs de qualité (coût,
délais, satisfaction client) pour rester compétitive
(Gillet-Goinard et Seno, 2016). Le cahier des charges lié au produit
devient de plus en plus strict et demande à l'entreprise de s'adapter
à ces besoins. La montée en gamme, les exigences strictes du
monde automobile et la croissance de la sphère technologique
dépassent les compétences humaines. La
Page 20 sur 111
performance de l'Homme ne permet plus de répondre
à elle seule aux exigences des clients. Pour répondre dans les
délais imposés, s'adapter aux contraintes technologiques et
s'assurer de la conformité du produit, les entreprises doivent prendre
en considération la possibilité qu'offre la robotisation. Dans la
sphère automobile elle augmente à elle seule d'au moins 30% par
an à l'échelle mondiale Attali, J. (2007).
Amazon, géant de la vente a investi près de
$700M en 2012 sur sa branche Amazon Robotics afin de robotiser sa chaine
logistique et gestion des colis. Cette même entreprise développe
en parallèle un système de reconnaissance visuelle des produits
et de caisse robotisée afin de maximiser la performance
économique de ses magasins de demain.
L'ensemble de ces enjeux dépendent de la politique de
l'entreprise, de ses dirigeant et de ses ambitions, mais dépendent
également du pays dans lequel plusieurs règles viennent
interférer avec ces décisions, nous parlons ainsi d'une
géopolitique de la Robotique (Ruskin, 2017).
3.5 Géopolitique de la
robotique
La robotique touche différents secteurs, les plus
connus étant le domaine de l'industrie, la santé, transport,
défense mais il est intéressant de noter que les pays se
spécialisent dans des développements particuliers de
robotisation.
La France est l'un des pays européens les moins
robotisés et a été classée selon la
Fédération internationale de la robotique (IFR) au
18ème rang, bien loin de son voisin allemand
(3ème). L'industrie française dispose d'un parc de
32.000 robots actifs (2016). Ce chiffre peut paraître élevé
mais il est cinq fois plus bas qu'en Allemagne, premier producteur de robots en
Europe. Cependant on constate une originalité dans les statistiques
provenant du World Robotics Report : alors que la France occupe la
18ème place dans la robotisation globale, elle est l'un des
pays les plus robotisés dans le domaine de l'industrie automobile et
occupe la 2ème place en Europe (WRR, 2016). On note ainsi une
augmentation de 22% du parc robotique automobile durant l'année 2016
pour atteindre 1400 unités. La France est également douée
dans l'expertise et les connaissances liées à cette
technologie.
Page 21 sur 111
Nos voisins allemands disposent actuellement d'une culture et
d'une vision vis-à-vis de la robotisation différente de nous.
«Regarder de près le cas de l'Allemagne s'avère
particulièrement intéressant, car cette économie est une
plus grosse utilisatrice de robots que les Etats-Unis, et c'est
également un pays producteur.» (Chavagneux, 2017, p 96).
D'autant plus que le marché automobile y est le plus
développé avec un parc de constructeurs étonnant.
Aux Etats-Unis, ces robots intelligents trouvent leur domaine
dans la recherche, plus particulièrement dans l'aérospatial avec
notamment le robot Curiosity qui explore depuis 2012 la planète Mars.
Mais nous pouvons également constater que le domaine de la
défense dispose d'une avancée majeure dans cette robotisation.
Drones et androïdes servent à surveiller ou à combattre
à distance. Selon le cabinet WinterGreen Research, le marché du
robot défense (bulls, robots tout terrain de transport
d'équipement militaires), va tripler d'ici 2021.
Enfin, le Japon, considéré comme le pays de la
robotique (Ruskin, 2017), développe la recherche de robotique
améliorant le quotidien. Cette observation est justifiée par la
population japonaise, étant la plus âgée au monde.
On note une disparité au niveau des pays. Par exemple,
dans l'Union Européenne, on constate un écart important entre la
France et l'Allemagne; Selon Ulmer (2017, p.18), « En Allemagne, les
technologies de l'industrie 4.0 sont intégrées dans les cursus de
formation depuis deux ou trois ans, ce qui n'est que très modestement le
cas dans l'hexagone. Ce point de la formation est pourtant central, tant les
inquiétudes face à la robotisation des emplois sont importantes.
Il y a une tendance encore trop forte de nos politiques publiques à se
concentrer sur les aspects techniques et à minimiser les changements
requis en termes de compétences, mais aussi d'organisation du travail.
». L'auteur nous oriente fortement vers la formation et les
compétences des individus, qui ne font pas l'objet de la
stratégie politique française actuelle. Ce constat est
également soutenu par Arthus (2017), qui nous indique que la France
possède deux fois moins de robots industriels que nos voisins allemands
par salarié, ce qui implique que la France investissent dans de vieilles
machines.
Par conséquent les enjeux de la robotique et son
ampleur varient selon les pays et montre que la culture donne une perception
différente face à la robotisation. Ces pays peuvent donc apporter
des effets positifs ou négatifs différents en fonction de leur
histoire.
Page 22 sur 111
4. Les apports positifs de la robotisation dans
l'industrie
Nous allons à présent mettre en évidence
les apports positifs de la robotisation dans l'industrie. Nous
décomposerons notre analyse suivant les trois facettes indissociables du
développement durable, au service de l'entreprise : l'environnement,
l'aspect social et la performance économique.
Dans cette révolution industrielle, les robots
pourraient réaliser les tâches dites ingrates en libérant
les hommes des tâches répétitives et dangereuses. De fait,
cela permettrait de transformer notre rapport au travail en créant les
emplois de demain et des métiers qui mobilisent nos capacités
cognitives ou créatives. « Cette proximité avec l'homme
ouvre pour la robotique un champ nouveau, celui de l'observation et de
l'interaction avec l'homme et ce, à différentes étapes de
son cursus existentiel » (Schweitzer et Puig-Verges p.292).
4.1 L'aspect économique :
La robotisation agit sur le triangle de la qualité :
respect des coûts, des délais et de la satisfaction
clientèle. Elle permet de répondre aux enjeux économiques
des secteurs d'activités humaines et industrielles (Puesh, 2015 ;
Bairoch, 2017). Développer la technique par la robotique permet
indubitablement de développer la performance de l'entreprise. Le
scientifique Kociemba (2012, p.16) définit les différentes
valeurs ajoutées qu'apporte la robotisation dans l'industrie.
«Le système robotisé doit pouvoir
suivre et contrôler la variabilité des pièces et des
processus. Pour obtenir des résultats robustes et précis, le
système robotisé doit être pourvu de fonctions complexes et
nombreuses, telles que» :
l Le contrôle de force,
l La compensation active (compliance),
l L'usinage adaptatif,
l L'usinage en boucle fermée,
l Le calibrage,
l
Page 23 sur 111
Le capteur laser,
l Le système de vision,
l La vérification exploratoire (probing),
etc.
La robotisation est une réduction indéniable
des différents coûts économique, dont celui de la main
d'oeuvre qui est une charge importante sur les entreprises. En effet, l'impact
économique du robot réside dans son prix d'achat, d'utilisation,
de maintenance et de fin de vie en garantissant une disponibilité et un
maximum de capacité (Urso, 1998). Cette vision pourrait être
similaire au cycle de vie du produit. Or il est constaté que la charge
est plus rapidement rentabilisée avec la mise en place d'un tel
système dans l'industrie. La qualité du produit étant
conduite par la satisfaction du client, l'entreprise constate une hausse des
critères «qualité» dans le cahier des charges
fonctionnel, ce phénomène est d'autant plus justifié dans
le monde très strict de l'automobile. Pour répondre à
cette demande et exigences du client ou réglementaires, la robotisation
permet une montée globale de la qualité et de la cohérence
du produit.
La cadence de production pose également plusieurs
questions, l'humain se fatigue et peut se blesser ou perdre l'attention en
fonction de la pénibilité de la tâche à
réaliser. Intuitivement on constate une baisse de cadence lié
à cette perte de vigilance. Le robot permet de pallier ce
problème en n'ayant pas ces contraintes physiques et permet même
de les dépasser en proposant des performances de production plus
élevées. La cadence requiert un niveau de concentration
élevé et demande à l'individu de concentrer ses
performances cognitives vers un même point d'émergence. Il est peu
probable qu'une personne soit capable de réaliser plusieurs tâches
à la fois en gardant une cadence similaire et un niveau de vigilance
élevé. Associer le robot à ces tâches permet de
réaliser des productions et changements beaucoup plus rapides (Edip,
2017).
L'entreprise est en quête du zéro défaut.
Pour y parvenir, celle-ci doit maîtriser sa ligne de production et
être en situation de qualité totale. On constate une demande aux
opérateurs d'être garants de la qualité fournie aux
différentes étapes du processus de fabrication, et de
réaliser des contrôles réguliers de pièces. Mais ce
point pose actuellement question : Nous entrons dans le domaine de
compétence propre dudit salarié réalisant le
contrôle. Cette variable peut aussi dépendre du niveau de
compétence de la personne, mais également de l'état
physico-psychique dans lequel les individus se trouvent. Peuvent-ils juger de
la conformité d'une pièce
Page 24 sur 111
en se référant uniquement à la vue ? Un
intérimaire aurait-il le même avis de conformité qu'une
personne plus expérimentée ?
L'intérêt que portent les entreprises pour la
robotisation permet de ne plus porter un avis subjectif sur l'état de
conformité d'une pièce et permet également de traiter le
phénomène de masse d'information qu'il serait impossible (en
respectant les temps de cycle) d'obtenir avec un travail réalisé
par l'homme. Le robot, dispose d'une base de données limitée
uniquement à sa capacité de stockage (étant de nos jour
proche de l'infini), et peut déterminer en fonction de plusieurs
critères (couleur, texture, dimensions...) la conformité d'une
pièce et par le biais de son intelligence artificielle décider
des conduites à tenir pour pallier le défaut constaté
(Edip, 2017).
Voici certains des avantages de l'acquisition de
systèmes de finition robotisés :
l Une réduction directe du coût de la main-d'oeuvre
;
l Une amélioration de la qualité et de la
cohérence en éliminant la subjectivité inhérente
à l'humain ;
l Une ergonomie et une sécurité
améliorées ;
l Une augmentation du débit ;
l La capacité à gérer plusieurs types de
pièces, avec des changements rapides ;
l La réduction des coûts des consommables
(pouvant aller jusqu'à 75%) ;
l L'inspection et la validation automatisées ;
l L'usinage de nouvelles pièces facilité.
La robotisation apporte son lot indéniable
d'amélioration dans un organisme, c'est généralement cet
enjeu économique qui fait de la robotisation une source de choix pour
les industriels, mais d'autres aspects viennent compléter cette liste
positive.
Page 25 sur 111
4.2 L'aspect Environnemental
L'enjeu de la robotisation dans cet axe est de
déterminer quels seraient les impacts sur l'environnement en
étudiant d'un côté le cycle de vie du robot (avec toutes
les phases : du puisement des ressource pour la fabrication, au recyclage du
système et les ressources économisées grâce au
déploiement de telles technologies, baisse du temps de travail, du
nombre de salariés impactant une chute des transports avec diminution
des consommations en carburant...). L'axe écologique n'est que rarement
prioritaire pour les entreprises et passe en second ou troisième
position est n'est alors qu'anecdotique dans la sphère environnementale
alors que cette dernière présente des atouts et avantages
certains (Gremillet, 2012).
La robotique industrielle dispose d'une forte valeur
ajoutée environnementale : « efficacité
énergétique, réduction des besoins en matières et
des rebuts, etc. Mais ce n'est pas son but premier. On s'approche d'objectifs
environnementaux avec la promesse des véhicules autonomes de
réduire les émissions de CO2 en optimisant les flux et la
mobilité urbaine. L'horizon est de dix à quinze ans »
(Simon, 2017, Les Échos). Dans cette note, on
s'aperçoit que l'aspect des robots écologiques n'est que
très peu développée dans le monde alors qu'ils disposent
d'un potentiel technologique, environnemental et économique
important.
En développant les robots et leurs domaines
d'expertise, ces derniers donnent accès à de nouvelles techniques
accordant le recyclage de certaines ressources issues de rebuts, jusqu'alors
non traitées, telles que la détection de certains plastiques des
processus de production automobile grâce aux capteurs spectroscopiques
(Bugmann et al. 2011).
Bugmann et al. (2011, p.2) se sont concentrés sur les
solutions qu'apporte la robotique dans le milieu environnemental. Les
principaux bénéfices sont, selon eux, les suivants :
? Une réduction des déchets industriels par une
meilleure production de pièces.
? De nouvelles méthodes de production permettant de
générer des sous-produits moins polluants.
? La capacité de réparer certains produits
irréparables jusqu'alors. L'auteur prend pour exemple la capacité
des robots de manipuler des composants de petite taille
(téléphones portables, ordinateurs...).
Page 26 sur 111
? Leurs technologies d'intelligence artificielle permettant de
gérer la consommation d'énergie des systèmes (mise en
veille anticipée, arrêt machine...).
? La possibilité de réduire les coûts
liés aux transports des individus, notamment par la possibilité
d'être actionnés / commandés à distance.
? Grâce aux nombreux capteurs, l'établissement
d'une surveillance de la qualité de l'environnement local (eau / air)
permettant d'améliorer les conditions de travail des individus aux
alentours et d'agir en conséquence sur d'éventuels polluants.
? Une utilisation logique, prédictive des ressources et
flux logistiques minimisant les déplacements / utilisations de
ressources nécessaires.
C'est ainsi que la considération à juste titre
de l'aspect environnemental permet d'accroître la performance de
l'entreprise, en lui accordant également une image d'entreprise
écologique dont les retombées positives peuvent être
nettement supérieures aux attentes initiales.
4.3 L'aspect Social.
Robotiser l'industrie ne signifie pas forcément
remplacer l'homme par un robot : l'exemple le plus concret concerne le «
Cobot » ou autrement dit le robot collaboratif. Ruskin (2017)
précise que ces derniers sont destinés à alléger ou
assister le travail des hommes, et non à les remplacer. Il est
intéressant de constater qu'une nouvelle pensée émerge
parmi tous ces témoignages et permettent de montrer qu'une certaine
forme de bénéfice pourrait impacter les conditions de travail des
différents salariés du monde industriel.
Une étude menée en Allemagne permet de mettre en
évidence des conclusions fortes sur l'impact de la robotisation sur les
emplois : «Selon l'International Federation of Robotics, le monde
compte en 2017 deux millions de robots industriels en activité, un
doublement depuis 2010.» (Chavagneux, 2017, p.1). Elle cherche alors
à démontrer si en Allemagne la robotisation a dès lors un
fort impact sur l'emploi, sachant que c'est le pays européen ayant le
plus grand parc robotique et étant l'un des plus grands producteurs
surtout dans le domaine automobile.
Page 27 sur 111
L'étude permet de mettre en évidence des
«conclusions plutôt originales» (Chavagneux, 2017,
p.1). Alors que nous avions vu précédemment le cas
américain qui montrait l'impact négatif, celle-ci permet d'en
tirer d'autres conclusions :
La première conclusion est d'affirmer que «La
robotisation de l'industrie allemande n'a aucun effet sur l'emploi
global.» Il est important de noter que l'étude précise
«l'emploi global». (Chavagneux, 2017, p.1). En
effet ce postulat est intimement lié avec la deuxième conclusion
: «ce non-effet global résulte d'un basculement des emplois de
l'industrie vers les autres secteurs.». Elle permet alors de mettre
en évidence la convergence des emplois : «un robot de plus
entraîne deux emplois de moins dans l'industrie
manufacturière.»(Chavagneux, 2017, p.1). Ces
données sont alors précisées avec l'étude
menée sur une période de 20 ans (de 1994 à 2014) donnant
ainsi une information sur le nombre d'emplois disparu (275 000) pour donner
suite à une instauration de robots, soit une baisse de 23% dans le
secteur. Mais cette même étude permet de constater que
«ces pertes ont été compensées par des
créations dans les autres secteurs» (Chavagneux,
2017, p.1).
L'étude ne recherche pas uniquement à
déterminer l'impact de la robotisation sur le transfert de l'emploi mais
recherche également à comprendre le parcours des salariés
et concluent sur un autre fait étonnant : «ceux qui travaillent
dans les secteurs les plus exposés à la robotisation ont une
probabilité plus importante d'être en emploi que les autres. Et il
y a même une grande chance pour qu'ils aient conservé leur emploi
dans leur usine d'origine» (Chavagneux, 2017, p.1). Cette
information permet d'appréhender une autre approche de la robotisation,
différente de celle qui est considéré comme destructrice
d'emploi, mais plutôt permettant de transférer l'emploi vers
d'autres secteurs plus innovants.
Cependant, ces constats doivent être nuancés
notamment en France, car ils supposent que les compétences des
salariés suivent sinon ils seront dépassés et ne pourront
pas s'adapter. Des nouveaux métiers apparaissent suivant le concept de
destruction créatrice mis en évidence par Schumpeter, ce concept
indique qu'une suppression d'emploi n'est pas fatale : elle permet d'en
créer d'autres et parfois beaucoup plus bénéfique pour
l'individu.
Page 28 sur 111
4.3.1 Principe de destruction créatrice : Le
concept de Schumpeter
Le principe de destruction - création de Schumpeter et
son concept de « destruction créatrice » (Schumpeter,
1942) sont des notions qui nuancent la suppression d'emploi. Selon l'auteur, p
106, « L'ouverture de nouveaux marchés nationaux ou
extérieurs et le développement des organisations productives,
f...], constituent d'autres exemples du même processus de mutation
industrielle - si l'on me passe cette expression biologique - qui
révolutionne incessamment de l'intérieur la structure
économique, en détruisant continuellement ses
éléments vieillis et en créant continuellement des
éléments neufs. Ce processus de Destruction Créatrice
constitue la donnée fondamentale du capitalisme : c'est en elle que
consiste, en dernière analyse, le capitalisme et toute entreprise
capitaliste doit, bon gré mal gré, s'y adapter. ».
Schumpeter part du constat que toute innovation économique dans un
secteur s'accompagne d'une destruction des structures antérieures.
On constate que cette technologie aide les entreprises
à créer de nouveaux emplois dans des zones géographiques
différentes. Le cas de La Rust Belt, aux Etats unis en est un bon
exemple avec la perte de nombreux emplois transférés vers la
Silicon Valley générant des pertes locales mais une hausse
d'emplois nets. (Ostergaard, 2018). Pour accéder à ces emplois
délocalisés, il est important pour le salarié de monter en
compétence et se former dans de nouvelles structures permettant
l'adéquation aux nouveaux objectifs d'entreprise.
4.3.2 La montée en compétence des
salariés.
La hausse en compétence technique de nos machines et le
développement de cette nouvelle forme de travail issue de l'intelligence
artificielle permet d'améliorer de manière significative les
compétences des salariés et à tous les niveaux (Popper,
2017).
Thibault Bidet-Mayer, responsable de projet du think tank La
fabrique de l'industrie indique que tous les salariés devront à
terme savoir programmer car l'évolution du travail va faire disparaitre
les tâches exécutives. Ceci implique une restructuration de
l'organisation de l'entreprise vers des modèles plus autonomes et
donnant plus de responsabilités aux employés (Popper, 2017).
Page 29 sur 111
Pour répondre à cet enjeu de montée en
compétence la formation est donc essentielle et plusieurs solutions sont
disponible telles que la formation en continue des salariés (Popper,
2017). Les entreprises ont correctement cerné ce besoin et investissent
de plus en plus dans la formation de ses employés. C'est notamment le
cas du groupe Schmidt, qui à développé la digitalisation
et la formation de ses salariés à hauteur de 6% de la masse
salariale (Popper, 2017). Ce besoin de « monter en compétence
» est devenu essentiel car il permet également de répondre
au besoin des générations dont le rapport au travail change, on
parle désormais de choc des générations.
4.3.3 Un choc de
génération.
Désormais les salariés, et en particulier les
nouvelles générations, ne cherchent pas uniquement à
obtenir un emploi, ils cherchent également un travail qui ait un sens.
Lyons et Kuron (2014) définissent une génération comme un
« groupe de personnes nés dans le même contexte
historique et socio-culturel, qui éprouvent les mêmes
expériences formatrices et développent des points communs
unificateurs en conséquence.5 »
La génération « Y »,
c'est-à-dire ceux qui sont nés à la fin des années
1970 début des années 1980, jusqu'à la fin des
années 1990 Lyons & Kuron, (2014, p.1426) s'inscrivent
particulièrement dans ce constat et c'est cette génération
qui pénètre actuellement le marché du travail, d'où
l'intérêt de prendre en référence cette
génération « Y ».
Le bureau australien de statistiques (Australian Bureau of
Statistics [ABS], (2013) ajoute que cette génération « Y
» recherche un meilleur équilibre de vie avec des
préoccupations liées à
5 `group of individuals born within the same
historical and socio-cultural context, who experience the same formative
experiences and develop unifying commonalities as a result' (Lyons & Kuron,
2014, p. S140)
6those born between the late 1970s to
early 1980s and the late 1990s', Lyons & Kuron, 2014, p.
S142)
Page 30 sur 111
la sécurité de l'emploi, avec un rapprochement
envers les technologies, une meilleure éducation et souhaitent
être mobile.
Winter et al. (2016) complètent que les
générations « Y » exposées au monde digital et
constamment soutenu par leurs parents et professeurs ont eu une influence
significative sur l'aspect social ce qui permet d'expliquer pourquoi cette
génération est en constante recherche de communication. Ce point
de vue est notamment développé par Myers & Sadaghini, (2010,
p.229) : la « communication avec les superviseurs doit être plus
fréquent, plus positif, et plus affirmatif que cela n'a
été le cas avec les employés des générations
précédentes. ». La vision de la robotisation et des
nouvelles technologies associées peut alors être dépendante
de l'identité de génération (Joshi et al., 2010). La
compréhension de la génération est donc centrale pour
déterminer la façon de manager la génération
concernée et des valeurs du travail (Cogin, 2012).

Figure 3 : Valeur du travail des
générations Y (Richard P. Winter p.2005)
Dans ce principe, les entreprises ne peuvent plus se contenter
à donner des tâches à effectuer en échange d'un
salaire mais au contraire cherchent à montrer comment chaque
employé participe à son échelle, au développement
de l'entreprise. La robotisation permet à son échelle de
remplacer l'homme dans ses travaux les plus pénibles. Mais face à
ce lot d'apport
Page 31 sur 111
positif, la robotisation peut être source de
problème, surtout lorsque celle-ci est mal accompagnée par
l'ensemble des parties prenantes du projet de robotisation. Comment attribuer
à ces individus, et ceux des nouvelles générations, un
travail qui ait un sens, alors que des métiers dont la communication
joue un rôle fondamental disparaissent ? Nous allons donc
déterminer les principaux problèmes de la robotisation ainsi que
les actions à mettre en oeuvre pour l'accompagner dans les meilleures
conditions pour faire de cette technologie un véritable allié.
5. Les problèmes soulevés par la
robotisation
Comme constaté l'industrie change et connaît une
expansion en acquisition de robots. L'intérêt de cette partie est
d'exposer les limites de cette robotisation et de comprendre quels sont les
risques pour l'industrie. Il est fréquent de voir dans la
littérature une crainte générale liée à
cette technologie menant vers des impacts nuisibles pour la
société, mais quels sont ces impacts tant redoutés ?
Lecoz (2016) identifie les principaux problèmes de la
robotisation auxquels les entreprises sont aujourd'hui confrontées :
· L'absence de réglementation
· La non acceptation sociale des robots par une crainte
de la hausse du chômage, le phénomène de résistance
au changement apparaît dans cette situation.
· Les coûts liés au développement,
à l'intégration et à l'amélioration de cette
technologie qui sont extrêmement importants.
· Une précision insuffisante pour certaines
applications telles que la reconnaissance d'objets,
· Des problèmes liés à la
sécurité des données récoltées notamment
avec leur utilisation et leur analyse.
· Un coût économique important, lié
à la maintenance et l'obsolescence des systèmes Une absence de
réglementation rendant la maitrise réglementaire de cette
technologie difficile.
Page 32 sur 111
5.1 Des problèmes liés à une
non-acceptation sociale.
Il est évident que sous la masse des témoignages
recueillis dans les différents ouvrages c'est cet aspect qui fait le
plus parler de lui. L'aspect social est directement impacté par cette
montée technologique et a tendance à faire peur aux
salariés. On constate également une anxiété
quantitative relative aux pertes d'emplois potentiels lié au
développement de la robotisation. Cependant cette peur est
récurrente et prend déjà effet dès les
premières révolutions industrielles (Mokyr et al. 2015).
Le concept de Schumpeter précédemment
défini permet de constater l'apparition de nouveaux emplois suite
à une destruction. Une condition est requise pour l'accès
à ces nouveaux métiers crées : il faut que les
compétences suivent. Cependant de nombreuses études montrent que
la France est en retard en matière de formation et de montée en
compétences.
5.1.1 Un retard Français : d'où vient
ce retard ?
Etant plus associé à un problème social
qu'économique, les entreprises françaises disposent de profits,
marges et autres crédits disponible suffisant afin d'accompagner ce
changement (Arthus, 2017). Les principaux facteurs et autres études
statistiques permettent de montrer que le degré de robotisation est
étroitement lié au facteur de compétence des individus
actifs, ce qui entrave la modernisation.
Les entreprises ne modernisent plus leurs moyens de production
car elles ne disposent plus ou pas de main d'oeuvre qualifiée pour
l'utilisation de ces technologies et elles savent qu'il est de plus en plus
difficile de trouver du personnel capable de les utiliser (Arthus, 2017). Ainsi
l'auteur explique que la robotisation constitue un facteur de risque en France
car lié à un manque de compétence. Ceci implique une
implantation de machines et autres technologies non maîtrisé.
Page 33 sur 111
5.1.2 Le manque de
compétences.
Dans le domaine automobile, il y a un constat alarmant : une
pénurie de compétences et d'ingénieurs qualifiés.
Ce constat est source d'inquiétudes pour les industries, notamment des
industries automobile qui doivent répondre à des défis de
plus en plus difficile et subissent une pression face à une demande
clientèle importante, le cas de la voiture customisées
étant le meilleur exemple. (Bys, 2017). Ce constat est d'autant plus
vrai qu'il s'inscrit dans un contexte de pénurie mondiale d'individus
qualifiés.
En effet, différents chercheurs s'accordent sur le fait
que la robotisation n'est pas source de destruction de l'emploi à elle
seule, mais montrent un constat plus centralisé sur le manque de
compétences de la population française. Patrick Artus s'accorde
sur la pensée de Schumpeter en partant sur le principe que la
robotisation peut détruire un emploi localement mais rend l'entreprise
plus efficace en générant d'autres emplois et dans un
troisième temps crée des emplois localement. Il part donc sur le
constat que la robotisation crée de manière globale des emplois.
L'idée de l'économiste n'est pas de se focaliser sur la
robotisation mais sur ces emplois dont la France n'a pas les compétences
pour réagir. Cela impacte également la vision de l'entreprise
automobile et sa capacité à faire fonctionner et superviser ces
nouvelles machines et technologies dans un environnement strict (Bys, 2017).
|
Dans une note adressée au think tank
Génération Libre ayant pour sujet la robotisation et l'emploi,
Patrick Artus indique : « Le problème est que la France est un
pays cher et non spécialisé. Si l'on enlève
l'aéronautique, la pharmacie et le luxe, elle présente le
même niveau de gamme que l'Espagne, avec les coûts salariaux
de
|
|
Figure 4 : Compétence en numéracie des
différents pays selon l'enquête de l'OCDE - Source journal
LeMonde
|
l'Allemagne. C'est pour cela qu'il est impératif de
monter en gamme et de robotiser ». La France
Page 34 sur 111
ne dispose que de très peu de compétences et ce
constat est un frein à cette adaptation. Ces résultats ont
été mesurés par une enquête PIAAC prenant pour
références des domaines scientifiques (mathématiques,
technologies, compréhension...). La France se situe en bas du
classement, loin derrière le Japon et des pays de l'Europe du Nord ou
encore de son voisin Allemand.
Ce besoin de montée en compétence est
également soutenu par l'économiste Gilbert Cette dans sa note
rédigée pour le site Telos : « [...] il faudra que les
travailleurs, quel que soit leur âge, mettent constamment à jour
leurs compétences, car leur emploi va continuer à évoluer
en fonction des avancées technologiques ».
Kelly (2012), ajoute que les individus ne seront plus
rémunérés qu'uniquement à la hauteur de leurs
compétences mais plus particulièrement en fonction de
l'efficacité que le salarié travaille avec les robots.
5.1.3 La sécurité au travail : les
risques inhérents au robot.
La mise en place de robots en industrie n'est pas
forcément synonyme de zéro risque. Différents cas nous
permettent de constater que des accidents graves, voire mortels, sont survenus
dans des industries automobiles impliquant un robot. Un cas d'accident mortel
est par ailleurs survenu sur le site d'un célèbre constructeur
allemand durant l'année 2015. Dans ce cas, l'investigation permet
néanmoins de conclure à une erreur humaine et non imputable au
robot (par dysfonctionnement). Ce type d'accident relance les débats
concernant la robotisation et des risques associés, notamment par la
robotisation croissante des entreprises.
L'erreur humaine est la source initiale des accidents par un
manque d'attention, une mauvaise programmation initiale, le non-respect des
consignes ... mais l'entreprise doit mettre tous les moyens en oeuvre pour
garantir la sécurité et l'intégrité de son
personnel même en situation dégradée. Dans ce cas, comment
parvient-elle à se robotiser quand des risques probables-graves peuvent
survenir dans ses locaux ?
Les entreprises ayant choisi de développer ces moyens
de productions doivent garantir des moyens surmendisionné pour assurer
la sécurité des personnes cohabitant dans les lieux de
Page 35 sur 111
travaux robotisés. De nombreuses entreprises n'osent
pas franchir le pas en robotisant leurs lignes de production car il y a une
absence évidente en termes de réglementation et de
responsabilité. Ces absences constituent un frein au
développement des entreprises dans cette technologie.
5.1.4 L'absence de réglementation
française.
Des chercheurs, et juristes, tel que Bensoussan(2015),
souhaitent intégrer un droit des robots, qui diffère selon la
fonction de ces derniers. Ces spécialistes déterminent que les
robots disposant d'une autonomie décisionnelle et les plus
sophistiqués ne peuvent pas dépendre du droit des biens. Ce point
fait débat car dans le cas d'un accident mortel entre un robot et un
humain, comment déterminer la responsabilité de cet acte ?
Est-elle transférée à l'inventeur, à
l'ingénieur, au technicien, ou au robot lui-même ? A l'instar du
droit de l'homme, existe-t-il alors le droit du robot ? Seul le les drones
(arrêtés de 2012) et des véhicules autonomes (loi n°
2015-992 du 17 août 2015) disposent d'un cadre juridique
spécifique.
En France, il faudra légiférer, dans le cas
d'une interaction entre le robot et l'homme, car celle-ci sort du cadre des
réglementations (sécurité machine). Le statut juridique
actuel des robots n'étant pas défini, il est important de
déterminer la responsabilité du système lorsque la vie de
l'Homme est en danger, mais également dans sa vie quotidienne. Gelin et
Guilhem (2016, p.139) indiquent que les « fabricants, vendeurs,
acheteurs et utilisateurs de robots doivent réfléchir ensemble
à nos responsabilités » envers les robots.
Le Japon étant l'un des pays les plus
développé en termes de robotisation dispose déjà
d'une charte éthique relative au robot inspiré des trois lois de
la robotisation d'Isaac Asimov. Cette charte existe également dans
d'autres pays comme les Etats-Unis, la Corée du Sud ou le Danemark.
Page 36 sur 111
5.1.5 Les trois lois d'Isaac Asimov
:
Ces trois règles ont été
rédigées par Asimov (1950, p.40) et se décrivent comme
suit (traduit de l'anglais7) :
1. Un robot ne peut pas blesser un être humain ou, par son
inaction, permettre à un être humain de se blesser.
2. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les
êtres humains, sauf si de tels ordres entreraient en conflit avec la
Première Loi.
3. Un robot doit protéger sa propre existence tant que
cette protection n'est pas en conflit avec la Première ou la
Deuxième Loi.
Ces lois rédigées bien en amont du
développement actuel des robots montrent que certains usages vont
à l'encontre de ces règles. Notons par exemple l'aspect
«défense» de ces robots. Ce point fut également l'objet
d'une lettre rédigée en 2015 par plus de mille scientifiques et
chercheurs en intelligence artificielle et des risques associés. A ce
jour, seuls les robots militaires sont régis par le droit international
humanitaire.
5.1.6 L'acceptation sociale : La perte de
l'emploi.
Ce thème constitue surement l'axe social le plus
exposé : «La robotisation n'est pas anecdotique, elle a des
effets sur le marché de l'emploi.» (Chavagneux, 2017). Lorsque
l'on se renseigne sur la robotisation en entreprise de nombreux cas lient
instinctivement robotisation à perte d'emploi. « Une
étude réalisée aux Etats-Unis montrait que chaque robot
supplémentaire réduisait l'emploi total de 3 à 6
unités. » (Chavagneux, 2017).
7 A robot may not injure a human being or, through inaction,
allow a human being to come to harm.
A robot must obey the orders given it by human beings except
where such orders would conflict with the First Law. A robot must protect its
own existence as long as such protection does not conflict with the First or
Second Laws.
Page 37 sur 111
Les chercheurs Frey et Osborne (2017). p.268 indiquent :
« Nous distinguons les professions à risque
élevé, moyen et faible selon leur probabilité
d'informatisation. Nous n'essayons pas d'estimer le nombre d'emplois qui seront
réellement automatisés et nous nous concentrerons sur
l'automatisation potentielle des emplois sur un nombre
indéterminé d'années. Selon nos estimations, environ 47%
de l'emploi américain total est dans la catégorie à haut
risque. Nous nous référons à ces emplois à risque,
c'est-à-dire que les emplois que nous prévoyons pourraient
être automatisés relativement bientôt, peut-être au
cours de la prochaine décennie ou deux8. »
D'autres chercheurs ont réalisé la même
étude dans d'autres pays et selon Le Ru (2016) p2 : « 42 % des
emplois seraient ainsi menacés en France, 49 % au japon et 54 % dans
l'union européenne ». Cependant, pour Arntz et al, (2016),
leur constat porte à 9% pour les Etats unis et autres pays
développés. Certains économistes Français
constatent une disparition nette de 2,5 emplois dans l'industrie après
implantation d'un robot, mais une création de 2,5 emplois dans les
services. (Arthus, 2017). La perte de l'emploi est une question avec une
incertitude forte. Le constat reste le même et suit le concept de
Schumpeter, mais requiert obligatoirement le développement des
salariés vers de nouvelles compétences et nouveaux services, qui
peut parfois diriger une entreprise vers un phénomène de
résistance de ceux qui ne souhaitent pas se diriger vers un autre
métier.
8We distinguish between high, medium and low
risk occupations, depending on their probability of computerisation. We make no
attempt to estimate the number of jobs that will actually be automated, and
focus on potential job automatability over some unspecified number of years.
According to our estimates around 47% of total US employment is in the high
risk category. We refer to these as jobs at risk - i.e. jobs we expect could be
automated relatively soon, perhaps over the next decade or two.
5.1.7 La résistance au
changement.
Page 38 sur 111
Instaurer un parc robotisé dans une entreprise pourrait
donc créer des conflits sociaux mais on peut légitimement se
poser la question s'il n'y a pas une forme de résistance au changement
envers cette nouvelle technologie qui apparaît.
Peiperl (2005 , p348) décrit le changement comme
étant des «réponses actives ou passives de la part d'une
personne ou d'un groupe qui s'opposent à un changement particulier,
à un programme de changements ou à des changements en
général9. » Lawrence, P. R. (1969) ajoute
que la résistance ne se fait uniquement au niveau technologique mais
plus particulièrement au niveau social et cette résistance
fluctue en fonction des relations internes entre salariés. La
résistance est souvent perçue par les cadres managers comme
l'ennemi du changement (Waddell et Sohal, 1998).
De nombreuses variables sociales sont donc exposées et
liées à des facteurs rationnels ou non, sur des facteurs
politiques et managériaux et il s'avère difficile de les
maîtriser. Ce courant de pensée est très répandu
dans la résistance au changement, et la littérature en fait foi.
On peut donc légitimement se poser la question si ce
phénomène impacte la robotisation car cette technologie s'inscrit
dans ce phénomène.
9 »active or passive responses on the part of a
person or group that militate against a particular change, a program of
changes, or change in general.» Peiperl 2005 p. 348
Page 39 sur 111
5.2 Les coûts liés à la mise en place
d'un parc robotique. 5.2.1 Un coût important
Bien que la mise en place d'un robot dans l'industrie paraisse
anecdotique compte tenu du retour sur investissement, la partie la plus
chère réside dans les coûts des systèmes en
périphérie (automates, intelligences artificielles,
ordinateurs...) et la recherche et développement de ce robot. C'est
généralement cette partie qui est décisive dans la
décision de mise en place d'un robot dans l'industrie. Développer
une telle technologie dans l'industrie automobile requiert l'élaboration
de nouveaux plans, nouvelles structures, et dans la majorité des cas
nécessite des devis sur mesure pour répondre à la
complexité du système. Toutes les entreprises ne peuvent pas
acquérir des robots car même si ces derniers restent
compétitifs, ils nécessitent un apport de base important pour les
plus petits organismes. On note cependant un cout nettement moins important
pour les robots collaboratifs permettant de diminuer les impacts des
coûts de périphérie, d'intégration et de
maintenance. Par exemple, cette technologie n'a pas besoin de tous les
systèmes de protection et donc des éléments et
programmations associées.

Figure 5: Les couts des solutions robotiques (source :
humarobotics.com
https://www.humarobotics.com/mesurer-cout-integration-un-cobot/)
Page 40 sur 111
5.2.2 La complexité du système et des
tâches à réaliser.
Le robot peut être constitué de plusieurs
ensembles dépendant des besoins techniques dans lequel il opère.
Désormais les robots industriels automobiles ne se limitent plus aux
simples bras reliés à des consoles intelligentes, ils sont
également dotés d'une multitude de capteurs, préhenseurs,
et autres systèmes de gestion, qui augmente considérablement le
prix d'achat du robot. (Slepov, 2016).
Ces robots étant de plus en plus imposants ne peuvent
être installés sur les structures classiques des bâtiments :
une étude doit être menée pour garantir la capacité
du bâtiment à supporter le poids de l'ensemble du robot, ce qui
ajoute des coûts supplémentaire à la facture de mise en
place robotique. (Slepov, 2016).
Mais il est également important de noter que dans le
stade actuel de la robotisation, les robots ne sont pas autant versatiles que
l'homme. Plus la tâche à réaliser est complexe et
nécessite différents outils, plus le robot sera cher. Ce qui
conduit également à l'importance de la programmation et du temps
nécessaire à l'automaticien pour rendre opérationnel ce
robot. L'achat initial du robot ne suffit pas, il faut également prendre
en compte toute cette phase de programmation du système. Bien que de
plus en plus intelligent, l'évolution actuelle des robots de l'industrie
automobile nécessite encore une connaissance extrêmement pointue
dans la programmation des automates pour pallier à l'ensemble des
problèmes techniques éventuels.
5.2.3 Des problèmes techniques : pannes,
erreurs, optimisation.
Les robots sont constitués d'un ensemble de composants
mécaniques, électriques, pneumatique mais également d'une
multitude d'organes de sécurité qui ne sont pas à l'abri
de défaillances. Les robots ne sont pas à l'abri de pannes et les
coûts de maintenance peuvent être élevés.
Ces robots munis d'algorithme et d'intelligence de plus en
plus sophistiqué requiert une série de mise à jour pour
garantir la compatibilité hardware et software. Dans les cas les plus
graves, l'entreprise risque de faire face à une série d'erreurs
de gestion de données pouvant aller à la perte totale des
données.
Page 41 sur 111
Slepov (2016) prend pour exemple un capteur robot, dans une
utilisation industriel automobile ces derniers sont utiles pour
déterminer la présence de défaut sur pièce
(présence d'impureté, discontinuité de la couleur...),
mais ces mêmes capteurs peuvent être très vite source de
nombreux défauts. En effet, il y a nécessité d'avoir des
conditions de lumière idéale car les caméras de sont pas
comme les yeux humains : trop ou peu de lumière rend le système
de détection inutilisable.
5.2.4 L'attractivité du produit
:
On remarque une nouvelle demande des consommateurs avec un
retour de la touche humaine, qui donne le sentiment de connexion avec les
autres que la robotisation est dans l'incapabilité de faire, ce qui sera
d'autant plus l'enjeu de l'industrie 5.0, c'est-à-dire l'industrie
réalisant un produit à fort valeur ajoutée disposant de
cette touche humaine lors de la fabrication du bien. (Ostergaard, 2018).
5.3 Les robots : une menace potentielle pour
l'Environnement.
Les robots utilisent d'importants matériaux et
énergies à différents stade de leur cycle de vie. Ce point
est très peu présenté dans les études concernant
les problèmes de la robotisation car les recherches se focalisent sur
les impacts économiques et sociaux. Van Wynsberghe et Donhauser, (2017)
parlent de « lacunes massives » dans la littérature des
études d'impact de la robotisation sur l'environnement. Pourtant le
problème environnemental devrait être traité avec la
même criticité que les points sociaux ou économiques.
(Rupert, 2016). Le développement de ces technologies robotique
nécessite la multiplication des composants électroniques (tel que
les microprocesseurs) et de ce fait l'utilisation des ressources. De plus, en
améliorant les performances de ces robots, ces derniers
nécessiteront beaucoup plus d'énergie (Rupert, 2016). Slepov 2016
invite à repenser aux différentes énergies
nécessaires pour l'utilisation d'un robot dans l'industrie automobile :
utilisation d'électricité mais également d'air pour les
différents capteurs de préhension ainsi que tout
l'équipement nécessaire pour l'utilisation de cette
énergie.
Heureusement les différents points limitant les
bénéfices de la robotisation trouvent leurs solutions par des
actions parfois simple à mettre en place et peu coûteuse.
Page 42 sur 111
Nous allons désormais voir quelles seraient les pistes
de solutions qu'apportent les différents chercheurs pour pouvoir
analyser ces données et les exposer de manière
synthétique.
6. Pistes de solutions apportées par la
théorie 6.1 La perte de l'emploi.
La crainte de l'évaporation de l'emploi n'est pas
nouvelle et est récurrente dans l'histoire du travail. Cependant, elle
est à chaque fois démentie par l'observation de
l'évolution économique. Ce constat a notamment été
mis en avant par Sauvy (1980) en donnant le terme de déversement. Dans
son article, l'auteur prend pour exemple la suppression du métier de
porteur d'eau à Paris dans le début du 20éme
siècle. Il constate que de nouveaux emplois ont été
créés par l'installation de canalisations et que désormais
personne ne regrette la disparition du travail de porteur d'eau. Ce principe
est également le même pour un nombre important d'autres
métiers. Il faut donc creuser le lien entre robotisation et
création/destruction d'emplois. Certains le voient positivement,
d'autres négativement. Les gains en productivité permettent de
baisser les coûts ce qui augmente le volume de vente, donc de produire
plus et par conséquent d'embaucher.
La perte de l'emploi n'est donc pas une fin en soi, cela
permet de débloquer des investissements et créer de nouveaux
emplois qui peuvent être plus gratifiant et plus
rémunérateur pour l'individu (Sauvy 1980 ; Schumpeter). Le
gouvernement français, sur son site dédié aux
stratégies indique les principaux domaines de création d'emplois
lié à la robotisation :
? la recherche et développement. ? la conception, la
production. ? la maintenance d'automates. ? la commercialisation.
Le constat mène sur un transfert de l'emploi dont la
clef réside dans la formation et la montée en compétence
des personnes directement impactées. Mais ces nouveaux emplois sont
créés dans des industries nouvelles où robots et humain
collaborent. Pour pouvoir répondre au besoin émotionnel, de
nouveaux chercheurs développent les robots sociaux.
Page 43 sur 111
6.2 Les robots sociaux.
Pour certains chercheurs, dont Piçarra et Giger (2018),
dans les années à venir les sociétés auront
à disposition des robots sociaux qui sont destinés à
interagir, collaborer et travailler avec les individus en prenant
également en compte l'aspect socio-affectif pour maximiser la
communication et minimiser le sentiment machine et développant chez
l'Homme une forme empathie artificielle. (Tisseron, 2016). Ce dernier est
qualifié comme émotionnel car il évoque des états
émotionnels et affectifs grâce à des comportements, gestes,
paroles et d'en susciter chez les Hommes. (Baddoura et Venture, 2016).
Park (2014) ajoute que certains de ces robots sociaux sont
déjà présent dans notre sphère quotidienne tel que
les assistants téléphoniques (Google, Amazon, Siri...) et
prennent déjà l'aspect émotionnel de l'individu en compte.
Dumonchel et Diamano (2016) indiquaient dans leur article que ces robots
sociaux « sont capable d'accueillir les demandes et répondre
aux expressions affectives propres aux besoins particuliers de leurs
interlocuteurs humains » (p. 220).
Ainsi, en considérant que ces robots de nouvelles
générations soient capables de remplacer l'humain tout en gardant
une dimension sociale, la question du droit du robot reste sur table, surtout
en France. On note cependant l'existence à l'échelle
européenne de l'adoption le 16 Février 2017 de la
Résolution et des Recommandations destinées à la
Commission Européenne des règles du droit civile de la robotique
dont l'objet est de considérer les robots au statut de « personnes
électroniques » et donc soumises au droit civil. (Schweitzer,
Puig-Verges, 2018). Mais ces robots sociaux peinent à faire
l'unanimité envers les individus, dont une forme de résistance
persiste, pour la comprendre et l'accompagner, les industries doivent savoir en
tirer parti.
Page 44 sur 111
6.3 Tirer parti de la résistance au
changement
Hultman, (1979) affirme que «malheureusement, lorsque
le mot résistance est mentionné, nous avons tendance à lui
attribuer des connotations négatives. C'est une idée fausse. Il y
a plusieurs fois où la résistance est la réponse la plus
efficace disponible10».
L'auteur explique que la résistance permet d'orienter
l'entreprise vers une stabilité. C'est justement cette stabilité
que recherche les entreprises lorsqu'elles instaurent un parc robotisé.
La résistance au changement peut même s'avérer primordiale
dans cette situation. Lorsque nous parlons de résistance au changement,
nous pouvons imaginer l'insatisfaction des salariés menacés par
les robots mais cette résistance peut être parfaitement
légitime et peut aboutir sur un consensus dont les résultantes
s'avèrent être plus bénéfiques. L'auteur ajoute que
les personnes ne résistent pas au changement, dans sa définition
première, mais plutôt aux incertitudes et aux résultats
provenant du changement : Comment garantir que ces derniers puissent
bénéficier d'une montée en compétence ou d'un
transfert d'emploi lorsqu'un robot les remplace ? Ils développent alors
une approche par les risques et analysent une situation potentielle de perte
d'emploi suite à l'instauration du robot.
Bien au-delà de ces principes, des recherches
effectuées permettent de décrire que la résistance, en
soi, est source d'information et permet d'être utile pour apprendre
à développer de manière plus efficace une organisation
(Beer et Eisenstat, 1996).
PardodelVal et Martínez Fuentes, (2003)
décrivent parfaitement cette situation : «Sans aucun doute, la
résistance au changement est un sujet clé dans la gestion du
changement et devrait être sérieusement considérée
pour aider l'organisation à réaliser les avantages de la
transformation.» En d'autres termes il ne faut pas subir la
résistance au changement envers la robotisation, mais l'accompagner pour
en tirer les pleins bénéfices et trouver les solutions les plus
adaptés à la situation.
10 «Unfortunately, when the
wordresistanceismentioned, we tend to ascribenegative connotations to it. This
isamisconception. There are many times whenresistanceis the most effective
responseavailable» Manuela PardodelVal, Clara Martínez
Fuentes, (2003) p73
Page 45 sur 111
Un management du changement bien mené est synonyme d'un
leadership efficace au sein de la société, mais également
que cette gouvernance se transmet efficacement au sein de l'organisation par le
biais d'une définition claire de l'origine du changement, et de ce vers
quoi l'entreprise tend à mener. Le premier point positif du management
du changement repose donc sur le fait qu'il oblige l'entreprise à se
structurer avant même d'initier cette démarche, et à
adopter une transparence totale afin de faire adhérer un maximum de
personnes à ce changement.
En plus de ce leadership, l'entreprise sera également
amenée à améliorer sa communication en interne. Comme le
définissent Bamford et Daniel (2005) dans leurs recherches, communiquer
la vision du changement avant toute démarche de robotisation est une
nécessité. Une communication réussie est un changement
réussi. (Bamford & Daniel, 2005, P. 402). Il est intéressant
de constater que la génération « Y » définie
précédemment, est la génération dont la
résistance au changement est la plus faible.
Finalement, le changement pour la robotisation est source de
motivation car il permet aux salariés de développer de nouvelles
compétences et d'acquérir de nouveaux savoirs faires.
6.4 La montée en compétence et la
montée en gamme des métiers
Différents économistes et chercheurs s'accordent
sur le fait qu'une montée en gamme des métiers est une piste de
résolution des problèmes liés à l'implantation de
cette technologie dans les industries en France (Arthus, 2017). Ainsi, l'une
des solutions présentée est la montée en gamme par la
création de services d'élite. Les constructeurs automobiles
savent désormais qu'il est nécessaire d'obtenir des individus
orientés dans la résolution de problèmes et utilisation
des nouvelles technologies (Bys, 2017). Ils souhaitent des individus pouvant
s'adapter à l'évolution de cette technologie et misent
désormais sur la formation de leur personnel (Bys, 2017).
D'après Gilbert Cette, (2017), il paraît
important d'accompagner l'émergence d'un travail indépendant
hautement qualifié. Il explique qu'il est nécessaire de
s'émanciper des contraintes réglementaires empêchant ces
transformations tout en permettant la montée en compétence des
Page 46 sur 111
individus concernés. Il évoque par exemple une
souplesse réglementaire permettant de faire bénéficier les
travailleurs indépendants des mêmes droits sociaux que les
salariés d'entreprise.
6.5 Le besoin de renouvellement
L'investissement massif pouvant être source de
contraintes pour le déploiement de robots, le gouvernement
français permet aux entreprises depuis 2010 de déduire des
impôts liés au résultat, 40% de la valeur d'acquisition des
équipements industriels acquis grâce au dispositif de
suramortissement.
6.6 La taxation de la robotique
Dans les cas où les solutions proposées telles
que la montée en compétences, l'ajout de robot collaboratif sans
supprimer les emplois ou autre n'auraient pas d'effet, certains chercheurs et
d'autres grand industriel (Bill Gates, Marc Zuckerberg) ou homme politique
(Benoit Hamont) proposent de mettre en place un système de taxation sur
les robots.
Même si cette idée n'est pas nouvelle (une
idée de taxation similaire était proposée dès le
19ème siècle sur le travail mécanique), elle
s'est développée et concrétisée ces
dernières années au Parlement européen (Michelon, 2017).
Cette idée consiste à taxer les robots de manière
équivalente aux humains pour garantir un financement des politiques
sociales. Selon Benoit Hamon, promoteur de cette taxation, lorsqu'un robot
remplace un salarié, ils génèrent plus de
bénéfices aux actionnaires, au capital. Ils proposent donc de
considérer le robot comme un employé et d'y appliquer les
mêmes charges, cotisation que connaissent les salariés.
Page 47 sur 111
6.7 Des éco-robots.
Etant utilisateur de ressources, les robots peuvent être
fabriqués à partir de matériaux et composants qui ne
présentent pas les mêmes impacts sur l'environnement que les
matériaux plus traditionnels Van Wynsberghe, A., & Donhauser, J.
(2017).
De plus, les robots peuvent jouer un rôle
bénéfique sur l'environnement en prenant compte les enjeux. Pour
accompagner au mieux l'intégration de ces robots dans l'industrie, il
est important de prendre en considération l'ensemble des étapes
de cycle de vide de ce robots, à savoir : sa phase de conception, de
production, d'utilisation et d'élimination - recyclage. (Van Wynsberghe
2016). Les robots possèdent une multitude d'aide pour lutter contre les
impacts négatifs environnementaux : ils aident à cibler la
pollution grâce à de nombreuses données pouvant être
recueillies.
6.8 Des solutions économiques, et un pays
tourné vers la robotique
La robotisation coûte de moins en moins cher aux
entreprises. En 10 ans le cout aurait diminué de 40 % (Agromedia, 2015).
Si l'acquisition d'un tel système peut être encore
élevé pour certaines entreprises (particulièrement pour
les TPE / PME), le retour sur investissement est désormais
inférieur à 2 ans et cette acquisition permet de réduire
de 30% les coûts liés à la maintenance et a l'exploitation
du système.
La France veut moderniser son image et souhaite devenir leader
dans la robotique. Nous l'avons vu précédemment, la France est
à la traine dans ce domaine. C'est pourquoi elle a lancé le plan
de France Robots Initiatives permettant de développer cet axe. Cela
consiste à débloquer des fonds et aides de financement. De plus
la France lance en 2013 le concept du START PME permettant aux PME le
développement des solutions robotiques si cette technologie est
adaptée aux tâches à réaliser. En 2014, la France
met en place le fond de Robolution Capital, dédié à la
robotique de service. Ce fond est constitué de 80 millions d'euros. Dans
la même année des prêts ont été mis en place
afin d'accompagner les petites entreprises à investir dans cette
technologie.
Page 48 sur 111
7. L'apport de la théorie dans la
problématique
La partie théorique nous amène à
préparer le terrain de la partie empirique. La littérature est
riche en information et nous donne de nombreuses pistes de réflexion. La
robotisation est une source de développement et de performance de
l'entreprise : on y constate de nombreux aspects positifs touchant à la
fois l'aspect économique, social et environnemental. Elle permet aux
entreprises de se moderniser en permettant le développement de son
organisme. Cependant ces apports bénéfiques sont souvent
contrastés avec les obstacles. Dans certains cas la robotisation
supprime les emplois, il le transfert vers d'autres secteurs, ou elle permet de
créer des emplois supplémentaires. Nous constatons ainsi que la
robotisation est une variable sur lesquelles certaines entreprises s'axent,
certaines réussissent, d'autres échouent.
Ce présent mémoire a également
exposé de manière synthétique les pistes permettant
d'accompagner efficacement l'implantation de robot dans l'industrie en
répondant aux exigences de chacun. Nous verrons dans la partie empirique
la vision d'une entreprise automobile sur ce sujet notamment grâce
à un projet de grande envergure qu'est la modernisation d'un
véhicule par l'implantation de nombreuses machines robotisées.
Nous verrons dans quelle mesure ces observations théoriques
correspondent à la robotisation plus spécifique d'une entreprise
dans le secteur automobile. C'est l'objet de l'étude empirique qui
poursuit ce mémoire à présent.
PARTIE
Page 49 sur 111
EMPIRIQUE
Page 50 sur 111
8. Contexte de l'étude empirique
L'étude porte sur le site automobile appartenant
à la société Daimler (Smart - Mercedes). Nous
étudierons plus précisément la «Smartville»
située en France, dans le village de Hambach. Ce site est
structuré autour du concept de la Smart dans lequel clients et
fournisseurs travaillent au même endroit. Ce véhicule se veut
être au plus près du client et propose un large choix de
customisation de son modèle (choix des couleurs principales et
secondaire, des motifs, de la puissance du moteur, de la finition, etc.).
Une partie de l'étude porte sur un équipementier
partenaire du projet, l'entreprise Faurecia. Cet équipementier
automobile français est présent partout dans le monde et
possède plusieurs pôles d'activités : (intérieurs et
extérieur de véhicule, extérieurs de véhicules,
recherche et développement, contrôles d'émissions de
véhicules...). Le site est spécialisé dans la fabrication
des pièces en thermoplastique du véhicule Smart et le livre en
juste en séquence (la commande déclenche la production de
pièces) son client.
Le projet de modernisation du véhicule
(également appelé Facelift) consiste à produire l'ensemble
des nouvelles pièces en thermoplastique de la nouvelle version du
véhicule Smart Fortwo. L'entreprise décide de robotiser la
nouvelle ligne d'assemblage du véhicule afin d'améliorer la
productivité et répondre au cahier des charges.
Page 51 sur 111
8.1 Structure de l'entreprise :
L'entreprise est structurée autour de quatre grands
pôles de production également appelés unités
autonome de production (UAP) qui sont respectivement :
UAP Injection: Cette étape correspond
à l'injection de granulés plastiques (matières
premières) dans des presses donnant la forme des différentes
pièces à l'aide des moules. Dans ce secteur, l'entreprise compte
12 presses à injecter robotisées simple pour un effectif de 64
personnes réparties sur 3 équipes. Les travaux
réalisés par les opérateurs consistent à effectuer
des finitions ou assemblages de pièces. Les opérateurs
récupèrent les pièces injectées et les positionnent
sur des convoyeurs qui les amènent vers le prochain processus : la
peinture.
UAP Peinture : Le processus peinture consiste
à cuire la pièce puis la mettre en couleur et la vernir suivant
la forme des pièces injectées, de manière totalement
robotisée. Une fois mise en peinture et vernies, ces pièces se
dirigent vers le secteur de l'assemblage.
UAP Assemblage : Cette étape consiste
à assembler les pièces en y mettant les composants annexes (vis,
fixations, joints...) ; cette partie est essentiellement réalisée
par des opérateurs de production.
UAP Logistique : Ce pôle consiste
à assurer la livraison des pièces et matières aux
différentes UAP. Etant donné que le site est directement
implanté sur le site de son client les livraisons des différentes
pièces vendues sont transférées directement par une
structure, robotisée HRL.
Page 52 sur 111
8.2 Constats dans l'entreprise.
Les projets sont définis selon la politique de
l'entreprise dont les critères principaux étant
? La conformité de la prestation vis-à-vis du
client (interne/externe). ? La maitrise des coûts directs et
indirects.
? Le respect des délais imposés.
? Diagnostic QSE d'après le référentiel
interne Faurecia.
Il est important que les projets puissent répondre
également à l'amélioration de deux exigences de
l'entreprise :
La plus importante et fondamentale : l'exigence
morale. Elle représente l'amélioration continue des
conditions de travail et de la préservation de l'environnement afin
d'exercer son métier dans des conditions décentes, respectueuses
des opérateurs, des espèces vivantes tout en maîtrisant les
risques pouvant nuire à l'opérateur et à
l'environnement.
La seconde, l'exigence économique. Il
est important de rappeler que les mauvaises conditions de travail, les
accidents, la dégradation de la santé des salariés ou la
détérioration de l'environnement et de son
écosystème sont inacceptables et engendrent de fait, un
surcoût économique important.
Réunir ces deux exigences permet à l'entreprise
Faurecia de démontrer son engagement en matière de
qualité, sécurité et environnement envers ses
salariés. S'assurer du bien être de son personnel dans un
environnement sain augmente l'engagement et l'efficacité dans les
opérations réalisées et par conséquent soutient la
performance de l'entreprise.
Page 53 sur 111
8.3 Les accidents du travail et cotisations dans
l'entreprise.
La sécurité des salariés est la
première priorité de l'entreprise, bien au-dessus de l'aspect
économique. Le site de Hambach connait, par son historique,
différents pics d'accidents de travail :
Accident de l'entreprise Faurecia
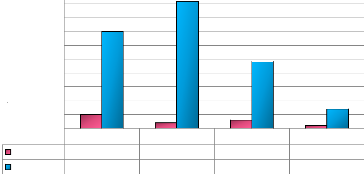
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
intérimaire
CDI
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
5
|
2
|
3
|
1
|
|
35
|
46
|
24
|
7
|
Nombre d'accident
5
35
2
3
24
1
7
Figure 6 : Répartition des accidents Faurecia
(réalisé par l'auteur)
Une part non négligeable de ces accidents repose sur le
comportement à risque des employés. Parallèlement, la
politique du groupe vise à déployer de plus en plus de robots sur
les sites. Notons par ailleurs la présence d'un nombre important
d'intérimaires sur le site. Ces derniers sont nombreux (30% de
l'effectif total) mais comme le montre le graphique (1) ils représentent
une part beaucoup plus faible des accidents du travail.
En étudiant de plus près les différents
secteurs de l'usine, il en ressort une part non négligeable d'accidents
aux endroits où la main d'oeuvre humaine est la plus élevé
(assemblage et injection en tête de Pareto). En 2018, une partie de la
ligne d'Assemblage se verra robotisé (ligne pare choc avant)
réduisant l'effectif de 7 personnes à 4.
Différents constats expliquent le pic d'accidents de
l'année 2016 :
? La précédente direction (< 2017)
concentrée sur des enjeux économiques.
? Une hausse du nombre d'intérimaires.
? Des personnes inexpérimentées.
? Le comportement de certains individus (non-respect de
règles élémentaires).
Localisation des accidents par UAP sur 3 ans
|
Nombre d'accidents
|
2016 2017 2018
|
|
20
15
10
5
0
|
|
|
|
Assemblage Injection Peinture Logistique Maintenance
Laboratoire Supports
|
Page 54 sur 111
Figure 7 : Localisation des accidants sur les trois
dernières années (réalisé par l'auteur)
Page 55 sur 111
Ces accidents motivent de plus en plus l'intérêt
de trouver des solutions à long terme pour tendre vers le « 0
» accident, d'autant plus qu'une majorité des accidents proviennent
de la manutention manuelle des pièces. L'intérêt de la
robotisation est de plus en plus élevé.
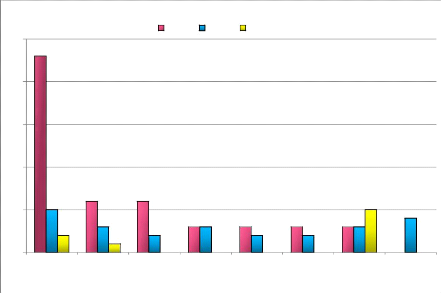
Suivi des accidents sur 3 ans
2016 2017 2018
Nombre d'accidents
0
0
Autre Gestes et
Effondrements
postures et aux chutes
d'objets
5
5
23
6 6
4
3
3 3 3 3 3
3
2
2
2 2
1
0 0 0 0
Manutention manuelle
Machines et aux outils
Manutention mécanique
Circulations et aux
déplacements
Chute de plain-pied
25
20
15
10
5
0
Figure 8 : Suivi des accidents sur 3 ans dans
l'entreprise Faurecia (réalisé par l'auteur)
En plus d'être inacceptables, ces accidents
coûtent extrêmement cher à l'entreprise. Régi par la
réglementation française et la Caisse d'Assurance Retraite et de
la Santé au Travail Alsace-Moselle (CARSAT), chaque accident du travail
ou maladie professionnelle fait l'objet d'une compensation financière de
l'organisme, dépendante de la caractérisation de l'arrêt de
travail et du taux de cotisation. L'investissement dans des robots industriels
de nouvelle génération pourrait permettre de supprimer les
travaux à risque et garantir une intégrité physique et
morale des salariés tout en minimisant le risque d'accident au
travail.
De manière annuelle, l'entreprise doit verser, selon
les catégories « encadrement » ou « employé
», un montant s'établissant en fonction des résultats des
trois années précédentes (sans compter l'année
n-1). On constate en toute logique un taux de cotisation proche de 0 pour les
salariés faisant partie de l'encadrement (tous ceux n'ayant pas
d'activité directe dans les unités de production). Aucun de ces
métiers n'est destiné à être remplacé dans
les années à venir, ces métiers dits « supports
» requièrent un certain niveau de compétence des individus
et l'industrie automobile est en recherche constante de profils types.
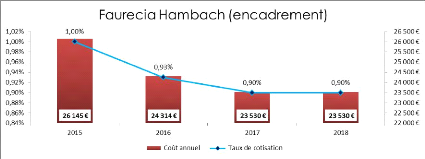
Figure 9 : Cotisations encadrement.
(Réalisé par l'auteur)
Dans la deuxième situation, l'entreprise paye
annuellement les frais liés aux accidents du travail dans les
unités de production avec un coût annuel d'environ 200.000€
(coûts très élevés notamment liés aux mauvais
résultats de l'année 2016).
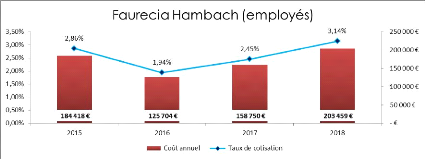
Page 56 sur 111
Figure 10 : Cotisation employés.
(Réalisé par l'auteur)
Page 57 sur 111
La robotisation constitue donc une évolution
particulièrement attractive pour l'entreprise. Et elle a
déjà débuté. Mais quels sont
précisément les bénéfices escomptés et les
craintes soulevées par ce changement majeur ? C'est à ces
questions qu'il convient de répondre à présent, à
travers une enquête terrain.
8.4 Objectif de l'étude
empirique
L'analyse de la littérature permet de déterminer
les différents enjeux de la robotisation, tant au niveau de ses
bénéfices pour l'entreprise que des obstacles qu'elle
entraîne. Nous constatons ainsi que la mise en place de cette technologie
joue sur les différents leviers de l'entreprise. La partie empirique
nous aide désormais à expérimenter les faits
étudiés théoriquement par l'expérimentation et
l'observation du terrain. Par le biais de cette analyse, nous pourrons
vérifier si cette technologie apporte son lot de bénéfice
ou si au contraire d'éventuels problèmes sont soulevés.
Nous verrons également comment l'entreprise réagit pour parvenir
à dépasser ces limites.
9. Méthodologie de recherche
9.1 Cadre
Épistémologique
Il existe différents cadres
épistémologiques. Ces derniers nous permettent de construire des
connaissances. Dans les sciences sociales on distingue quatre grands cadres
épistémologiques (Avenier et Schmitt, 2007) :
1) Le cadre positiviste
2) Le cadre réaliste-critique
3) Le cadre constructiviste pragmatique
4) Le cadre interprétativiste
Page 58 sur 111
Dans ces différents cadres, le but de la connaissance
n'est pas le même (Avenier, & Schmitt, 2007). Le cadre positiviste
nous amène à rechercher : on se base de fait pour trouver des
corrélations. Le réaliste critique amène le chercheur
à découvrir les provenances issues de ces corrélations en
essayant de comprendre leur provenance.
Le constructiviste pragmatique essaye d'organiser
l'expérience du réel : comment nous comprenons à travers
notre expérience le fonctionnement du réel. On ne connaît
que notre expérience de ce dernier, ce que l'on perçoit à
travers ses sens. Pour les constructivistes, le réel est
constitué d'interprétations qui se construisent grâce aux
interactions (GirodSéville, Perret 1999). Cela s'apparente donc à
une méthodologie des connaissances constructibles (Le Moigne, 1995). Le
constructiviste pragmatique signifie que les connaissances
développées seront mises à l'épreuve dans l'action
sur le terrain. C'est la relation forte entre la théorie et la
pratique.
Dans notre étude nous nous concentrerons sur les
représentations que se constituent les acteurs par rapport à la
robotisation qui concerne leur entreprise. Par conséquent, il ne s'agit
pas d'étudier les faits en tant que tels (cadre positiviste), bien que
des données objectives soient nécessaires pour contextualiser
notre étude et en comprendre les résultats. Il ne s'agit pas
davantage d'étudier des corrélations objectivées en tant
que telles. Nous cherchons, en revanche, à identifier les constructions
que se font les salariés des changements induits par la robotisation et
les effets générés : les bénéfices
ressentis, les espoirs, les craintes, les propositions de solution. Dans la
mesure où nous n'irons pas jusqu'à interpréter ces
représentations, à en déceler les fondements
psychologiques, sociologiques, collectifs ou individuels, nous n'entrerons pas
dans un cadre interprétatif à proprement parler. Notre choix
d'étude se portera donc sur une approche constructiviste, riche en
enseignements.
9.2 Choix de l'outil d'enquête : le guide
d'entretien.
Permettant de confirmer ou d'infirmer certaines
hypothèses et de répondre à la problématique du
présent mémoire, nous réaliserons plusieurs entretiens
semi-directifs s'adressant aux personnes issues du monde industriel. Afin
d'obtenir une vision juste et représentative de l'ensemble du personnel
d'entreprise, le guide d'entretien s'adressera à seize
Page 59 sur 111
personnes issues de différentes catégories
socioprofessionnelles. Cette démarche permet de comprendre, à
différents niveaux hiérarchiques, les différents points de
vue sur le sujet.
9.3 Réalisation de
l'enquête
Les entretiens semi-directifs mettent en avant
différentes opinions sur un sujet qui ouvre à la discussion
où une réponse binaire ne permettrait pas de récolter ces
précieuses informations. Les personnes interrogées proviennent de
différents secteurs géographiques, sont d'âges
différents, et ont une expérience plus ou moins importante dans
le monde industriel.
Le questionnaire utilisé pour réaliser
l'entretien contient six questions à thèmes permettant
d'étudier certains points précis issus de la
problématique. Il y a également des sous-questions afin de
relancer l'audité sur certains points particuliers.
L'étape initiale consiste à déterminer un
échantillon hétérogène sous forme de liste des
personnes souhaitées, permettant d'effectuer une prise de contact rapide
et d'obtenir une étude élargie à l'ensemble des
catégories professionnelles. Ainsi, une demande par courriel,
téléphone ou physique a été réalisée.
La majorité des personnes ont répondu favorablement à la
demande, montrant un réel intérêt pour cette
problématique.
Dès lors, une phase explicative s'est
déroulée. Ont été mentionnés : l'objectif de
l'entretien, la problématique du mémoire, les cibles de ces
entretiens, la récolte d'informations. Il convenait aussi de mettre
l'individu en confiance en présentant les modalités de
l'entretien tel que la nécessité d'une disponibilité
minimale d'une heure. Avant le début de l'entretien, les personnes ont
été questionnées s'ils souhaitaient garder le statut
d'anonyme ou non, permettant dans certains cas de libérer la parole.
L'ensemble de ces témoignages ont eu lieu en face
à face dans des salles de réunion prévues à cet
effet. Ces témoignages sont enregistrés de manière audio
afin de garantir l'exactitude des propos tenus par l'audité lors de la
retranscription dans ce mémoire des idées sous forme de verbatim.
Lorsque l'entretien se termine, après avoir remercié
l'audité, un exemplaire numérique du présent
mémoire a été proposé lorsque celui-ci sera
disponible.
Page 60 sur 111
Une fois les données recueillies, une étape
visant à analyser les entretiens a été effectuée :
l'objectif étant de faire ressortir d'éventuelles similitudes,
des faits récurrents ou au contraire des informations nouvelles et
pertinentes, par un système de mot clés et des techniques
d'analyse d'entretiens. Cette approche a donné une représentation
de la pensée des individus dans le contexte de l'étude.
9.4 Méthodologie Qualitative
Dans le cadre de la recherche de ce mémoire, nous avons
la possibilité d'utiliser différentes approches de
méthodologie de recherche. L'approche qualitative, qui privilégie
l'investigation de manière profonde et méticuleuse permet de
récolter les informations riches et porteuses de sens dans un domaine
mal connu.
Plutôt dire que la robotisation est un
phénomène récent, qui a été
étudié de façon objective, dans ses conséquences
à l'échelle d'une entreprise, mais très peu au niveau du
vécu des salariés qui doivent s'y adapter. Or, comme l'ont
montré les travaux cités dans la partie théoriques, la
conduite du changement et la réussite du changement sont fondamentales
pour intégrer positivement la robotisation au fonctionnement de
l'entreprise. Dès lors, l'approche qualitative semble s'imposer pour
conduire notre étude.
La première étape consiste à
déterminer le monde de récolte d'information dans l'industrie
dans laquelle nous allons étudier la robotisation. Nous choisissons
d'opter pour des entretiens semi-directifs auprès d'individus issus de
différentes catégories socioprofessionnelles. Cette étape
débute par une planification des thèmes de l'évaluation
ainsi que la détermination des problèmes potentiels
exposés par la littérature.
Dans cette optique, l'objectif est, d'abord, d'identifier le
but des entretiens pour en déterminer les questions clés.
Ensuite, il est essentiel de décider par quel cheminement
procéder à cette récolte d'informations afin de
répondre à la problématique présentée dans
cette étude sur la robotique industrielle. Nous souhaitons ainsi
comprendre l'environnement interne et externe dans lequel nous allons
recueillir ces données en réalisant une évaluation du
contexte interne / externe.
Page 61 sur 111
La seconde étape consiste à combler les
informations manquantes, lacunes des données à disposition en
sélectionnant les problèmes. En fonction des données
disponibles nous axons les questions selon la pertinence des données
voulues / recueillies. Cela nous permet de confirmer que notre collecte de
données prévue sera suffisante et répondant aux objectifs
préalablement définis.
L'étape suivante concerne l'approche. Il s'agit de
déterminer les individus qui feront l'objet de notre recherche suivant
notre méthode et autres sources disponibles. L'objectif est de cibler
des individus de catégories sociales différentes pour obtenir des
valeurs d'intérêt différentes et confronter des
idées (ex : une personne âgée aura-t-elle le même
point de vue qu'une personne jeune ?).
10. Résultats de l'étude :
Elle porte sur un échantillon de 14 individus issus de
l'entreprise Faurecia et complété par 2 professionnels de
l'industrie de l'extérieur. Ils ont été
sélectionnés suivant un principe d'équité
socioprofessionnelle en prenant compte de leur positionnement dans l'entreprise
et des secteurs de production.
10.1 La vision de la robotisation des individus de
l'entreprise :
Le premier objectif de l'étude empirique est de
déterminer la vision globale qu'ont les individus sur la robotisation.
Sur la totalité des 16 entretiens le constat est nuancé : les
personnes interrogées ne disposent pas d'un avis ferme sur le sujet en
définissant la robotisation comme étant positive ou
négative dans l'entreprise Faurecia.
Elle met en évidence certains points, dont des
résultats originaux. Les différents thèmes qui suivent
respectent l'ordre de la partie théorique afin de déterminer
rapidement les différences ou la confortation des idées
décrites dans la partie théorique. Nous débuterons la
partie empirique par une détermination des individus des aspects
positifs de la robotisation afin de déterminer les leviers de
performance, puis nous verrons les problèmes soulevés par ces
derniers et les différentes techniques pour les pallier.
Page 62 sur 111
10.2 Les aspects positifs : Les leviers de
performance. 10.2.1 L'aspect qualité :
Pour la totalité des audités, la robotisation
constitue indubitablement un levier de performance notamment dans le domaine de
la production influençant favorablement la productivité de
l'entreprise.
Arnaud Trimborn, expert Injection et programmateur indique :
« Je constate la régularité, la
répétabilité et la précision de ces robots,
toujours en terme qualitatif. Cela permet de respecter la cadence
imposée par notre client. ». Éric Barbier, responsable
laboratoire ajoute : « Le robot va être répétable,
la qualité devient toujours de plus en plus sévère, les
clients sont de plus en plus sevrés en qualité et il devient de
plus en plus dur de repérer ces défauts etc. Le robot est plus
performant sur cette analyse. ».
La robotisation dans l'automobile et plus
particulièrement chez Faurecia tend à être l'avenir. Le
client impose à l'entreprise de plus en plus de contraintes et un temps
de livraison de plus en plus court. L'investissement déployé par
l'organisme dans ce secteur est de plus en plus important. Faurecia,
étant de plus un grand équipementier français, souhaite
développer cette culture de modernisation par la robotisation sur ses
sites et les incite à prendre le pas pour développer la
qualité de ses produits et donc étroitement la relation client -
fournisseur.
Patrick Koeller, PDG de l'entreprise Faurecia,
décrivait son point de vue vis-à-vis de la performance des robots
dans une interview pour Les Echos : « Les robots nous
permettent d'être plus compétitifs et il y a des effets
intéressant lorsque vous regardez la géopolitique, il y a
quelques années nous transférions nos outils de production vers
les pays à bas cout en particulier dans les pays de l'est ou au sud de
l'Europe, en Afrique du nord. Aujourd'hui avec ces outils digitaux, avec cette
transformation digitale, on est capable de conserver dans des pays à
haut cout une activité industrielle. Pour une usine Faurecia
donnée, moins d'emplois, c'est vrai mais une pérennité
réelle de nos infrastructures industrielles ».
En janvier 2018, le groupe Faurecia lance même un
concours de grande envergure pour développer ce point : le groupe
demande à l'ensemble de ses sites de déterminer le besoin et
les
Page 63 sur 111
projets impliquant un robot. Les meilleurs projets
sélectionnés se verront octroyés par Faurecia, aux frais
du siège, un pactole complet permettant de robotiser le projet.
Nouredine Bagbiegue, consultant projet d'usine ajoute : «
Il parait désormais certain que les grands groupes d'aujourd'hui,
dont Faurecia, tendent à se robotiser un maximum, même pour les
clients et les investisseurs. Je pense que ces derniers auront plus de
confiance à nous attribuer de nouveaux projets car ces robots ont fait
leurs preuves et nous permettent de nous spécialiser et de nous axer sur
des projets jusqu'alors impossibles : par manque de compétence, de
personnel, ou tout simplement de temps. D'autant plus que le groupe nous donne
les moyens aujourd'hui et s'axe dans une démarche
d'amélioration continue.».
Le monde automobile est strict et demande une maitrise
complète de son processus de fabrication. La norme IATF 16949,
dédiée au monde automobile et aéronautique, en fait foi.
Du fait de la complexité des véhicules d'aujourd'hui, d'une
multitude de personnalisation du produit et de la hausse des contraintes, la
robotisation (collaborative ou totale) paraît être le choix vers
lequel se tourne l'entreprise pour répondre au cahier des charges de son
client. Le projet du Facelift montre que la robotisation de 70% des postes de
travail sur la nouvelle ligne d'assemblage permet le respect du tact-time
imposé par le client.
La performance du processus est accrue lorsque celle-ci est
robotisée. En effet, réalisée par des gestes précis
et répétable les robots permettent d'améliorer la
rapidité de production des pièces. Ce point a notamment
été constaté dans l'entreprise avec la robotisation par
découpe laser de parties issues de la carrosserie pare-chocs avant.
Pour Eric Barbier, responsable Laboratoire et
développement : « Certains postes ont fait l'objet de
robotisation car on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux incomplets.
C'était difficile pour quelqu'un d'être vigilant pendant tout un
poste, de voir chaque fois un incomplet à des endroits différents
et donc il y avait des cellules qui examinaient la conformité des
pièces et les pièces étaient directement envoyés
dans des containers ».
La rapidité du traitement de l'information est
également un point qui revient fréquemment dans les
différents entretiens menés, Martin Schissler, responsable
informatique hygiène et environnement indique que « devant la
masse d'informations que doivent gérer les
Page 64 sur 111
entreprises d'aujourd'hui, il est évident que la
robotisation dotée d'une intelligence artificielle propulsée par
la rapidité des processeurs d'aujourd'hui, permet un puissant traitement
de l'information et tirer ses ressources dans des bases de données.
». Le traitement de l'information et la réaction en fonction
du résultat obtenu permettent d'accélérer les prises de
décisions.
De manière générale, l'ensemble des
individus s'accordent sur le fait que la robotisation constitue un levier de
performance dans la qualité avec l'amélioration des processus de
fabrication. Nous retrouvons de plus, dans la quasi-totalité des
entretiens, les mots clés suivants : «
répétabilité, capabilité, gains de temps ».
Mais il est intéressant de constater que les individus s'axent
intuitivement vers l'aspect social.
10.2.2 L'aspect social :
Ce point fait moins l'unanimité : seuls 40% des
personnes voient de manière spontanée et autonome les aspects
positifs de la robotisation sur la dimension sociale. Sur ces 40%, l'ensemble
des individus prennent l'aspect « travailler dans un lieu
sécurisé » comme élément prioritaire de cette
technologie. En effet, et conformément à l'analyse
théorique, la robotisation permet de minimiser les travaux
pénibles et donc d'impacter favorablement le nombre d'accidents et
risques associés. Anne-Sophie Mougel animatrice Hygiène,
Sécurité et Environnement informe : « La robotisation a
déjà permis de démontrer à notre site une
réduction évidente des accidents et des troubles
musculo-squelettiques liés à la manutention de pièces. Les
personnes travaillaient dans des zones non ergonomiques, parfois même
côtés rouge ou noire (les pires cotations ergonomiques
nécessitant un plan d'action immédiat). Une des solutions les
plus efficaces et des plus radicales est de robotiser ces tâches
dangereuses pour l'Homme. Cette solution a déjà été
choisie pour le projet du Facelift car nous ne pouvions pas respecter les
normes ergonomiques pour certains postes de travail. » Cette
idée est de plus complétée par la vision de Martin
Schissler, « Les accidents du travail et les maladies professionnelles
représentent un coût extrêmement important pour une
entreprise, quel que soit sa taille. Il n'est pas envisageable que les
personnes travaillent dans des conditions dangereuses pour leur santé,
nous tenons à l'intégrité physique de notre personnel. La
robotisation est un pas de plus vers la sécurité et le respect
des conditions de travail de notre personnel ». Les données
permettent effectivement de constater que la première cause de maladie
professionnelle chez
Page 65 sur 111
Faurecia est issue des troubles musculo-squelettiques
provenant essentiellement des UAP d'injection et d'assemblage.
Dès lors l'entretien découle sur les secteurs
susceptible d'être entièrement robotisé et le constat est
unanime : la quasi-totalité des personnes nous indiquent qu'elles
verraient le secteur de l'injection et de l'assemblage entièrement
robotisé.
Paradoxalement, ce sont également ces secteurs qui
embauchent le plus de personnes (contrats à durée
indéterminé et intérimaires). Selon Jordan Martellota,
technicien méthode assemblage : « Je suis sûr qu'un jour
les secteurs de l'assemblage et de l'injection seront à terme
entièrement robotisés ces deux secteurs représentent des
difficultés pour l'opérateur. A l'assemblage comme à
l'injection, l'opérateur manie différentes pièces de
toutes tailles et de tout poids. Il piétine beaucoup sur place, ce qui
n'est pas bon pour la santé. De plus, on travaille dans la
précision : manipuler de petites pièces toute la journée
dans tous les sens sur toute une vie, vous récolterez dans le pire des
cas des troubles musculo-squelettiques. ».
La manipulation et la précision requises pour la
production des pièces génèrent en effet une cotation
ergonomique défavorable. Rendre un poste ergonomique pour l'Homme
requiert parfois un investissement extrêmement important et
peut-être dans certains cas insuffisant pour répondre aux
critères favorables. De nombreux projets existants et toujours en cours
au sein du site de Hambach pour rendre ergonomique des postes de travail
utilisé par l'homme en font foi. Certains projets échouent,
vouloir améliorer un système défaillant pour le rendre
ergonomiquement plus acceptable mènera indubitablement l'entreprise vers
de nouveaux problèmes.
Ce cas a notamment été expérimenté
par l'entreprise dans le secteur de la peinture pièce et de la zone de
changement de Skid (structure portant les pièces en thermoplastique
produites). Ce poste longtemps coté noir ergonomiquement a fait l'objet
de nombreuses modifications plus ou moins onéreuses. L'entreprise a
désormais choisi de constituer un groupe de travail afin d'en
déterminer les solutions. Ne pouvant y intégrer un robot autonome
sur cette ligne pour des soucis techniques (l'intervention humaine d'un
opérateur qualifié étant obligatoire pour
déterminer la séquence en fonction de la production), nous avons
décidé de mettre en place un système robotisé
permettant d'assister l'opérateur pour le chargement et le
déchargement de ces supports.
Page 66 sur 111
Ce projet a été immédiatement
accepté par le groupe et l'investissement a été
validé par le groupe permettant à la fois d'accéder aux
bénéfices du robot et de la technicité de
l'opérateur.
10.2.3 L'aspect environnemental.
La robotisation apporte également ses points positifs
dans l'entreprise Faurecia, elle permet de réduire le bilan CO2 de
l'entreprise. Anne-Sophie Mougel indique « les robots ont un impact
nettement moins important sur l'environnement qu'un individu, hormis dans leur
rares cas de maintenance corrective (génération d'huile...)
» Le coût de consommation électrique d'un robot est
estimé à 0,15€ / Kwh. Pour une utilisation de 300 jours par
an, de façon continue (24h/24) soit 7200 heures, la facture est
estimé à 600€ pour les plus petits et jusqu'à
2000€ pour les plus imposants. Le recours à cette technologie
permet d'optimiser les ressources et d'améliorer les performances
technologiques. Le site de Faurecia s'inscrit également dans une
démarche énergétique et environnementale en y
déployant respectivement les normes ISO 50001 (management de
l'énergie) et 14001 (management de l'environnement). De ce fait, elle
réalise mensuellement des revues énergétiques et
environnementales permettant d'analyser les consommations de l'entreprise et
d'y développer des actions amélioratives.
Mais l'ensemble de ces points positifs sont également
nuancés dans l'entreprises par des problèmes potentiels, nous
allons désormais voir dans la suite de l'étude ce que les
entretiens ont permis de soulever et de voir si des solutions sont existantes
pour y pallier.
11. Les problèmes soulevés dans
l'entreprise Faurecia 11.1 La performance qualité :
La robotisation permet de développer la performance
industrielle de l'entreprise mais cette technologie munie d'une multitude
d'atouts pose également des problèmes et peut freiner sa
performance. En étudiant Faurecia, il s'avère que les coûts
liés à la robotisation en cas de défaillance peuvent
être élevés.
La provenance des pièces issues d'un seul fabricant, la
difficulté d'obtention des pièces ou les pièces caduques
peuvent faire repenser l'ensemble d'une zone de production. Mais le
Page 67 sur 111
point le plus critique réside parfois dans la
durée de maintenance de ces robots. La monté en informatique
embarqué, la complexité des systèmes électriques,
mécaniques, pneumatiques, rendent les opérations de maintenance
de plus en plus complexes et de plus en plus longues avec parfois des
diagnostics compliqués. La hantise du site de Hambach serait de mettre
à l'arrêt son client par l'incapacité de produire des
pièces liées à une panne robot.
Une information originale est également fournie par
Patrick Hug, responsable du centre de recherche et développement
d'Arcelor Mittal : « Il faut réellement faire attention
à ce point, les robots ont une extraordinaire capacité et un
défaut fondamental : c'est qu'ils font juste. [...] Quand on fait des
gestes justes on a plus la moindre capacité de se développer.
». Ce point est alors très surprenant, ce qui faisait la force
du système est vu par certains comme un défaut majeur : la
justesse de ce dernier. Tandis que les robots font justes, les hommes eux font
des erreurs. « Un cerveau humain c'est fait pour se tromper en
permanence et pour pouvoir ajuster ses réponses de façon
heuristique et créative et pouvoir assembler un comportement très
adapté avec des décisions qui étaient fausses. [...],
ce qui va faire la force de l'humain c'est sa capacité à se
tromper. L'essentiel des découvertes humaines sont des erreurs
d'interprétation. Partout où ces tâches seront
robotisées, il faut que cela laisse un espace pour l'homme et son
imaginaire. ». Robotiser entièrement les lignes peut
s'avérer contreproductif en retirant cette part d'erreur. Les projets
d'entreprises proviennent généralement d'erreurs humaines
permettant l'amélioration des processus de fabrication, les
données des plans d'action de l'entreprise en font foi. Ce cas a
notamment été décrit par Anne-Sophie Mougel : «
il n'est pas rare que certaines erreurs des opérateurs (j'entends de
manière involontaire) aient permis de déceler des erreurs dans
notre façon de procéder, et en analysant les lieux et en y
préparant les actions adéquates, on à améliorer la
performance du poste. ».
Ainsi, au-delà des aspects pécuniaires que
peuvent avoir les entreprises face à la maintenance des systèmes
robotisés, elles doivent prendre conscience également que les
robots ont la capacité de reproduire exactement (dans les conditions
normales d'utilisation) ce qui est demandé en éliminant le
facteur d'erreur. Or, l'histoire de la recherche faisant foi, l'erreur permet
de progresser et d'obtenir de nouvelles perspectives d'amélioration. La
robotique permet d'accroitre les performances de l'entreprise quand cette
dernière est capable de l'intégrer au mieux en tenant compte des
facteurs susmentionnés. Mais ce point est fortement nuancé par
Page 68 sur 111
Martin Schissler : « Je ne crois plus au modèle de
l'apprentissage par l'erreur, c'est dépassé. Dans l'industrie
automobile nous n'avons pas le droit à l'erreur, cela coûterai
beaucoup trop cher»
Nous allons désormais mentionner les aspects sociaux
qui ont été mentionnés dans l'étude du site
Faurecia.
11.2 L'aspect social et
sécuritaire.
L'étude théorique nous montre que la
robotisation peut dans certains cas être source de destructions d'emploi
: ceux qui sont généralement répétitifs, dangereux
pour l'homme ou pour répondre aux critères et orientations
stratégiques économiques de l'entreprise. Le projet du facelift
va réduire le nombre de salariés sur certaines lignes. Ces
salariés sont essentiellement intérimaires. Cette question de
destruction d'emploi divise les individus.
Pour certains cette destruction ne sera pas comblée par
la création de nouveaux emplois chez Faurecia. Cet axe est notamment
défendu par Arnaud Trimborn, expert Injection et programmateur machine
Faurecia : « Si ce n'est pas compensé par des aides pour
d'autres emplois, s'il n'y a pas une loi qui impose un reversement des gains
lors de l'implantation des robots pour favoriser d'autres emplois, c'est
destructif. De toute manière, même si nous obtenons de nouveaux
emplois sur notre ligne d'assemblage, je pense que le nombre sera nettement
inférieur à ceux qui disparaîtront avec cette nouvelle
technologie. ». Il complète : « Nous sommes des
êtres sociaux, et travailler avec très peu de monde, on sait tous
vers quoi cela mène : dépression et vous perdrez votre
intérêt et votre motivation à travailler dans cette
entreprise. Nous avons besoin de ce lien social ».
Jean-Sébastien Fafournoux, représentant du
personnel nous donne sa vision concernant ce point : « Si on estime
qu'un opérateur est uniquement employé,
rémunéré pour faire une tâche de production en 8
heures de temps sans penser son travail, en se mettant à la place d'une
entreprise, oui le robot sera rentable, il ne tombe pas malade, ne
négocie pas d'augmentations de salaire, de coefficient, et on peut le
faire travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y a pas photo. En
revanche, si on souhaite qu'il y ait une émancipation de l'humain et que
dans une entreprise il y ait un minimum de lien social pour que les gens
puissent améliorer leurs
Page 69 sur 111
conditions de travail, améliorer leurs postes de
travail, si on supprime l'humain et qu'on le remplace par des robots, ce
phénomène n'existera plus. Même s'il faudra des techniciens
pour régler ces robots, les dépanner et faire le service
après-vente. On sera dans une déshumanisation. On sait
également que le secteur automobile est l'acteur majoritaire dans la
robotisation des lignes de production. L'Assemblage est le secteur qui se
développera le plus dans cette technologie et il n'est pas improbable
que dans les années à venir les conclusions faites aujourd'hui se
réalisent pour de vrai et il est important de réfléchir en
amont pour diminuer au maximum les risques liés à cette
technologie. ». Il est intéressant de constater que le mot
clé « lien » est très présent dans les
entretiens, presque systématique des discours. Ce mot permet de
comprendre le besoin des personnes envers ce lien social en entreprise et qu'il
est difficile d'imaginer de travailler seul en compagnie des robots.
Dans l'entreprise Faurecia, les valeurs humaines sont
très présentes et s'axent autour d'une culture d'entreprise :
Beins Faurecia. Ces principes prônent des valeurs d'entraide, de
créativité et d'autonomie. Cela explique une certaine
difficulté d'acceptation sociale face à ces robots industriels.
La peur de la perte de l'emploi n'est pas alors le premier point
évoqué contrairement à ce qui a pu être
établi via les recherches théoriques. Pour Bruno Bondu : «
j'aurais du mal à déterminer si je souhaiterais travailler
seul munie d'une équipe de robots, ou ne pas travailler du tout et
rechercher un emploi dans une entreprise classique, mais dans le cas de notre
projet du facelift on en est encore loin ».
Un autre constat, plus original encore, est décrit par
Éric Barbier : « Un point particulier attire mon attention, et
cela me fait peur même au niveau personnel, c'est la surveillance et le
flicage au travail. Par exemple, imaginons qu'il y ait un être humain en
même temps que le robot, ce dernier va emmagasiner une énorme
masse de données, qui peuvent ensuite être utilisées pour
dire : « Ce salarié, il est quand même moins performant que
les autres, là il va 2 secondes moins vite, là il fait ça
comme ça etc.» et donc en analysant ces données recueillies,
on peut arriver à justifier que tel salarié est moins
compétitif qu'un autre. C'est vraiment comparable aux réseaux
sociaux, si quelqu'un s'accapare des données personnelles et les croise,
celui qui les étudie, peut dire « cette personne là
j'arriverai à lui vendre mon produit, à lui faire croire ceci ou
cela, car j'ai remarqué que dans sa personnalité il a tendance
à ... « dans ce cas-là ce n'est pas honnête.
»
Page 70 sur 111
11.3 Des risques pour la
sécurité.
Travailler avec des robots n'est pas dépourvu de risque
pour la santé. Même si ces cas sont extrêmement rares,
l'analyse des risques doit le mentionner. En étant de plus en plus
perfectionnés ces robots sont pourvus d'une multitude d'outils et autres
composants permettant d'effectuer des tâches complexes. Ainsi, la
présence d'outils dangereux dans les zones robots peut avoir des effets
graves sur la santé : magnétisme, faisceau laser, vitesse, ligne
de tir etc. sont des points qui nécessitent une analyse approfondie. Le
projet du Facelift se verra doté d'une zone robotisé de
découpe laser. Cette découpe sera réalisée par un
laser de catégorie 4 (soit le plus puissant et dangereux existant). Les
robots permettent de réaliser des opérations dangereuses dans un
environnement maitrisé, la zone peinture de l'entreprise est le parfait
exemple. Martin Schissler indique : « Cet environnement est vu de
l'extérieur par nos employés. Ils l'estiment
sécurisée car il n'y a pas de problème visible de
l'extérieur de la cabine, mais ils oublient que c'est un robot qui est
dans un environnement agressif et pas un homme. S'ils pénètrent
dans cet environnement agressif sans le respect des consignes de
sécurité cela peut être extrêmement dangereux.
». Les robots peuvent ainsi donner un sentiment de
sécurité qui peut être dangereux.
Développer la robotisation permet en effet de limiter
les travaux à risques et les sources de pénibilité, mais
il est vrai que dans certaines configurations, ces systèmes peuvent
également être source de danger pour l'homme. Heureusement, le
site de Faurecia n'a pas eu à faire à un accident de ce type.
Mais ces différents points affectant l'aspect social et la
sécurité du salarié risquent de créer une forme de
résistance, nous nous proposons de poser la question de la
résistance au changement aux personnes interrogées.
11.4 Le phénomène de résistance
au changement
Dix personnes interrogés sur la résistance au
changement voient effectivement ce phénomène dans l'entreprise.
Les mots clés « peur » « remplacement » «
syndicats » « culture » reviennent souvent dans les propos
tenus. Éric Barbier, déclare ainsi : « Oui, je pense que
c'est le cas, en tout cas chez les allemands cette technologie, c'est culturel.
Les Allemands aiment bien la mécanique et tout ce qui touche les
machines, c'est les rois de la machine à outils dans le monde et c'est
grâce à tout ça qu'ils ont une balance à
l'exportation positive. Je pense que par
Page 71 sur 111
notre culture on aura toujours tendance à avoir
peur face à ces nouvelles technologies car certains métiers
seront amenés à disparaître. » Mais ce constat
est nuancé par Martin Schissler : « dans notre entreprise les
employés n'ont pas réellement de résistance car ils
comprennent que ces robots apportent une amélioration des conditions de
travail, ce sont essentiellement les intérimaires qui sont
impactés par un non renouvellement de contrat »
Pour Patrick Hug : « C'est une crainte fondée
car il y a une disposition du monde actuellement énormément de
personnes qui n'ont pas forcément eu l'accès à une
éducation d'abstraction suffisante. ».
Mais alors quelles sont les solutions que Faurecia peut - met
en oeuvre pour y remédier ? 12. Les solutions pour pallier aux
problèmes soulevés dans l'entreprise.
L'objectif de cette partie est d'exposer les recommandations
que certains chercheurs et professionnels de l'entreprise Faurecia peuvent
apporter à l'entreprise dans son contexte de modernisation du
véhicule Smart afin d'accompagner au maximum cette technologie.
12.1 L'aspect économique.
Le coût de cette technologie peut s'avérer
être un frein pour l'entreprise mais des solutions ont été
exposées permettant de répondre au mieux à ces limites. Un
service de maintenance adapté et formé aux nouvelles technologies
permet de limiter les frais liés aux pannes des systèmes. La
présence d'un automaticien spécialisé permet de pallier
aux problèmes récurrents dont la solution ne nécessite
plus l'intervention systématique du fournisseur du robot.
Martin Schissler indique « nous sommes passé
à la deuxième génération de robot, on a
divisé par dix le nombre de pannes et ces derniers sont capable
d'alerter nos services avant même que la panne ne se produise
».
Dans les situations les plus graves, il y a un risque
d'arrêt client qui peut coûter très cher à
l'entreprise, sachant que Faurecia Hambach est située sur le site de son
client unique. Arnaud Dubourdieu, responsable Qualité, nous informe
qu'un arrêt client reviendrait économiquement « à
3000€ pour 10 minutes d'arrêt du client, sans compter les frais
annexes ». Pour pallier ce
Page 72 sur 111
problème lié à l'arrêt client par
un robot ou une défaillance système, l'entreprise met en place
dans les postes les plus critiques un système de « back-up ».
Pour Sébastien Dosne, méthodiste maintenance, « ces
back-ups sont primordiaux dans notre entreprise, si un robot est
défaillant, dans les meilleurs cas nous pourrions le remettre sur pied
dans des délais n'impactant pas notre client ». Faurecia
dispose en effet d'un stock tampon, dans une structure logistique
entièrement robotisée permettant notamment de fournir pendant
quelques heures le client si des soucis apparaissent (cas de pannes,
grèves, problème matière, défaillance
matière ...). Cependant, ce système ne garantit pas une livraison
client si la panne survient pendant plusieurs heures. C'est ainsi que pour
Sébastien Dosne : « Une solution réside dans nos postes
back-up, surtout à l'avenir de la robotisation, ces petits postes
permettent de réagir en mode dégradé et un
opérateur peut garantir pendant tout le poste une production de
pièces nécessaire pour livrer le client. ». En
réfléchissant à cette réponse et en investiguant de
plus près l'organisation d'entreprise, cette solution pourrait permettre
en même temps de déplacer les emplois vers des métiers
disposant d'une plus grande flexibilité. Il ajoute : « On
pourrait croire que l'entreprise aurait choisi d'implanter des robots autonomes
back-up mais cet axe n'est pas envisagé, la politique d'entreprise, la
complexité de nos processus et la nécessité de dialogue
avec le client fait que l'homme est, et sera la meilleure solution dans nos
locaux. ».
12.2 L'aspect Social :
Pour certains, la solution se trouve dans la durée de
travail adaptée à la modernisation de la ligne, Arnaud Trimborn
propose par exemple de « Travailler moins. C'est à dire
travailler et être capable de dire à nos salariés de
l'injection : travailler sur une plus courte période pour pouvoir avoir
une vie plus enrichissante. Travailler moins ne signifie pas être moins
productif, cela signifie juste de mieux répartir les tâches.
Former mieux les gens pour qu'ils soient plus performants à
dépanner des robots, à les reprogrammer [...]. Dans ce que je
constate actuellement, la solution c'est de répartir le travail sur
plusieurs personnes. ».
D'autres voient en la formation un axe de résolution :
« Si le robot devient monteur ajusteur, on n'aura plus besoin de
monteur ajusteur. Mais pour créer ces robots il faudra cette
connaissance pour réaliser l'architecture même du robot. Je pense
que ça va créer des métiers
Page 73 sur 111
qui demandent plus d'autonomie et de
responsabilité, d'initiative, de réflexion et créatif.
Moins répétitif, plus créatif. » Eric
Barbier.
Pour d'autres encore, l'Homme n'aura aucun moyen de
contrôle sur cette technologie. Par exemple, Patrick Hug considère
qu'il est illusoire de penser maitriser cette technologie mais qu'il faudrait
repositionner sa vision et ses questions sur le but même du travail :
« Dans un aspect systémique, cette technologie qu'on a produit
à l'origine est plus forte que nous, c'est comme l'économie, elle
nous surpasse, elle est au-delà de nous, c'est nous qui l'avons mise en
place et elle nous échappe. Je pense qu'il est illusoire de l'imaginer
canalisée. La seule chose c'est de dire maintenant que cela existe,
comment arrivons-nous à trouver notre place dans ce système ?
Pour certains individus, cela ne posera jamais de difficultés mais je ne
sais pas s'il y aura de la place pour tout le monde à tout moment.
Certains seront à l'aise dans les éléments sociaux culture
qui sont les leurs, d'autres non, seront en crainte. La meilleure façon
pour que les humains soient à l'aise c'est que les robots
libèrent l'homme des contingences pour libérer son imaginaire. Si
on n'était pas obligé de travailler que ferions-nous ? A quoi
sert de gagner l'argent ? ». L'une des solutions résiderait
dans la montée en compétence des salariés.
12.3 La montée en
compétence.
La prise en compte de la nécessité de
montée en compétence des salariés est un point qui est
particulièrement pris au sérieux dans l'entreprise. Une structure
de e-learning entièrement dédiée aux formations est mise
en place. Le groupe Faurecia investi de plus en plus dans ces plateformes de
formation digitalisées et font appel à des prestataires externe
de service digital tel que Klaxoon, solution dédiée exclusivement
à la réalisation de formations et réunions
digitalisées. Dans ces formations on y trouve un éventail complet
de thèmes touchant à la fois productivité,
économie, gestion, management. La formation sur la
«résistance au changement » est présentée en
interne. Ce thème est connu de l'entreprise, et la formation
digitalisée en E-learning en fait foi. Dans cette formation,
l'entreprise propose aux individus « d'apprendre à
désapprendre » en mettant de côté leurs anciennes
pratiques car l'entreprise considère que la juxtaposition de processus
anciens et nouveaux est impossible. Ces cours sont évalués,
permettant d'octroyer un grade et un rang interne.
13 Comparaisons entre les solutions empiriques et
théoriques
Ce tableau a pour objectif de présenter de manière
synthétique l'ensemble des pistes de solutions proposé dans la
partie théorique et étudiée sur le terrain.
Problèmes Solutions théoriques Solutions
empiriques
|
La robotisation
industrielle
supprime
les
emplois
|
· Les emplois sont déplacés ou de nouveaux
emplois sont créés. Permet de débloquer des fonds
d'investissement.
· Rend l'entreprise plus
efficace et permet
d'embaucher de manière
globale.
|
· Réalisation de formations internes permettant
la montée en compétence du personnel (formation de 3 techniciens
devenus régleurs robots).
· Permet de maintenir les infrastructures dans les pays
à haut cout.
· Impacte essentiellement les intérimaires
|
|
L'acceptation
sociale
|
· Création de robots sociaux permettant de
prendre en compte les émotions des individus.
· Taxation de la robotique.
|
· Prendre en considération les attentes des
employés.
· Etre à l'écoute.
· Analyse de ce facteur dans les nouveaux projets
|
|
La
sécurité
menacée
|
· Mise en place d'un droit des robots avec cadre
juridique spécifique. Charte éthique basée sur le concept
d'Asimov. La sécurité aide à la réalisation
d'opérations dangereuses.
|
· Etre vigilent sur l'image sécuritaire que
donnent les robots aux salariés. Les robots travaillent dans un
environnement agressif non adapté pour l'homme. Réaliser des
formations et sensibilisations.
|
|
Page 74 sur 111
Résistance au changement
|
· L'accompagner, en tirer parti : la voir comme
positive, mène vers une stabilité, un consensus. Les
salariés ont une approche par les risques.
|
· Faible résistance du personnel de
Faurecia : ils acceptent la
technologie car elle
améliore les conditions de travail.
· Réaliser de la communication avec l'ensemble
des salariés en prenant compte de leurs attentes. Faire des formations
sur les enjeux de demain et les faire « apprendre à
désapprendre ».
|
|
Coût important
· Aide
financière garantie par
l'état. retour sur
investissement de cette technologie
important.
· Diminution de 40% en 10 ans du prix de la robotique.
|
· Aide du groupe au déploiement de cette
technologie.
· Retour sur investissement important. Estimé
à 2 ans.
|
|
Problèmes techniques
|
· Des coûts liés à la maintenance
réduits.
· Des technologies plus fiables.
|
· Diminution par 10 du nombre de pannes lié au robot
grâce aux nouvelles générations.
· Permet d'informer les services de l'entreprise avant
même que la panne ne se produise.
· Une simplicité de remplacement des robots :
présences de robots back-up
|
|
·
Permet de répondre aux critères du
Attractivité du
· Donne une
image de cahier des charges du client Smart.
produit modernité à l'entreprise.
· Prix de production
Page 75 sur 111
· Cadence et reproductibilité assurée
|
Menace pour l'environnement
|
· Une consommation d'énergie moins importante qu'une
consommation humaine.
|
· Consommation et cout (0,15€ / kwh) des robots
faible.
· Précision de l'utilisation des ressources
· Meilleure gestion des
consommations des
matières premières
· ISO 14001 / 50001
|
|
Le manque de compétences
· Faire monter en compétence par des formations
régulières des employés pour les faire accéder
à de nouveaux métiers
|
· Disponibilité d'une structure en e-learning
permettant la formation et la monté en compétence des
employés de l'entreprise.
· Formation des employés sur les nouvelles
technologies
|
|
Page 76 sur 111
Page 77 sur 111
CONCLUSION
Page 78 sur 111
13. Conclusion
Grâce à l'avancée technologique, au
perfectionnement des robots et de l'ère numérique de plus en plus
d'emplois, y compris ceux qualifiés sont désormais en partie
réalisable par des robots. Ce mémoire a eu pour objectif de
déterminer les impacts de la robotisation dans l'industrie et plus
particulièrement dans la sphère automobile en y
établissant un état des lieux sur les effets potentiels de la
robotisation sur un organisme industriel. L'étude empirique dans
l'entreprise Faurecia révèle que différentes observations
de la partie théorique sont transposables au site. L'audition des
individus issus des différentes zones de l'entreprise et de
catégories socioprofessionnelles différentes permet
d'établir des constats intéressants.
Tout d'abord, peu importe le rang social, on constate que les
peurs et les problèmes soulevés semblent être les
mêmes : une personne au statut cadre, ressent les mêmes peurs qu'un
salarié de production. Ce constat intéressant permet après
analyse de retrouver les mêmes mots clés « disparition »
« perte emploi » « impuissance » dans la majorité
des cas évoquant les problèmes de cette technologie.
L'étude théorique nous révèle grâce à
l'étude de la littérature les différents points de vue des
chercheurs concernant la robotisation. Ainsi, ils nous donnent les principaux
avantages de la robotisation qui ont été confirmés dans
l'entreprise Faurecia. Bien qu'ils soient généralement d'ordre
économique, on ressent une nouvelle direction vers les avantages sociaux
et écologiques.
Les chercheurs s'accordent sur la nécessité de
montée en compétence du personnel, la protection de
l'environnement, l'optimisation des ressources etc., car ces derniers points
sont les nouveaux enjeux des entreprises qui souhaitent atteindre la
sphère durable de leur développement et c'est par ce biais
qu'elles doivent penser la robotique industrielle. L'étude de
l'entreprise Faurecia s'accorde encore une fois sur ce principe : un
investissement important dans les formations du personnel, des structures de
e-learning dédiées aux enjeux de demain, un investissement massif
dans la robotique, la prise en compte des enjeux environnementaux et
énergétiques avec la volonté de répondre aux
exigences normatives.
L'industrie automobile est le secteur qui dispose du parc
robotique le plus important. L'étude théorique a
été conduite en maximisant les recherches sur l'entreprise
automobile mais a été complété par l'industrie dans
sa globalité car des lacunes, particulièrement dans la
sphère
Page 79 sur 111
environnementale se fait ressentir. Ainsi, nous ne pourrions
attribuer à la robotisation qu'une multitude d'effets positifs, cette
technologie à son stade actuel présente des problèmes dans
notre société. Nous constatons que la robotique est
généralement choisie pour cause évidente économique
délaissant à la fois la sphère sociale et
environnementale. Ces lacunes se font ressentir également dans
l'entreprise Faurecia car très peu de personnes mentionnent la
sphère environnementale de la robotisation alors que la prise de ce
facteur permet de tirer un maximum de bénéfices tel que l'image
d'une entreprise moderne et responsable. Les principaux défauts
imputés à la robotisation paraissent être les mêmes :
la destruction et la peur du remplacement. Il est vrai que dans l'entreprise
Faurecia un nombre important de tâches pourraient être
robotisées, mais il faut nuancer ce constat : dans un premier temps ces
tâches sont généralement réalisées par des
intérimaires et ce sont ces tâches qui présentent le plus
grand risque de danger de trouble musculo-squelettique. L'étude des
données internes liées aux accidents du travail montre les
principales sources d'accident qui sont en grande partie imputable au poste de
travail et au comportement à risque des individus.
Il ne faut pas conclure que la robotisation va détruire
massivement les emplois à moyen terme : ce mémoire n'a pas pour
objectif de dissuader l'entreprise à implanter la robotisation, bien au
contraire, de nombreux chercheurs sont optimistes quant à l'utilisation
de robots au profit l'amélioration notable des conditions de travail, de
l'amélioration de la performance industrielle et des impacts
environnementaux positifs. Il paraît évident que les robots seront
un moteur de la future économie mondiale tant que les problèmes
soulevés par cette technologie sont résolus et
accompagnés.
13.1 Discussion, validité et qualité
des résultats.
Cette étude ajoute aux travaux existant une part de
visibilité des effets de la robotique dans l'industrie et plus
particulièrement dans la sphère automobile. Elle apporte un
complément d'analyse en prenant compte les aspects économiques,
sociaux et environnementaux. Elle met en égalité ces trois
aspects en y recherchant un maximum d'informations dans la littérature
et sur l'expérience vécue sur le terrain. Certains
résultats confirment les hypothèses fournies par la
littérature : la robotisation modifie notre vision du travail et a un
impact sur celui-ci.
Page 80 sur 111
La tendance à l'utilisation accrue de la robotique dans
l'industrie, en particulier automobile se poursuivra. Mais la façon dont
l'accompagnement de cette implantation est d'une importance cruciale : elle
doit se dérouler de manière responsable, en privilégiant
le respect des valeurs sociétales économiques et
environnementale, ce qui exige de développer et de mettre en oeuvre des
pratiques optimales, telle que la montée en compétence des
individus.
À cette fin, nous avons cherché montrer l'impact
de la robotique sur l'aspect social en expliquant pourquoi c'est cet axe qui
porte le plus souvent à contrainte en entreprise; et suggérer des
pistes. Ce faisant, nous avons fourni des ressources qui, nous
l'espérons, faciliteront et guideront des analyses plus pointues des
défis potentiels que peuvent présenter les nouvelles technologies
robotiques environnementales.
13.2 Limite de l'étude :
Ce mémoire a été constitué en
utilisant de nombreuses ressources littéraires. Nous pouvons poser une
première objection quant à la représentativité des
documents étudiés : de nombreux articles proviennent de pays
étrangers alors que nous faisons part de l'impact de la culture sur la
vision de la robotisation, il est alors important de rester prudent avec la
vision de certains chercheurs et cas présentés qui peuvent
parfois être lié à une culture particulière.
Cependant ces visions au-delà de nos frontières permettent d'en
tirer un maximum de bénéfices en y prenant exemple sur les cas
qui fonctionnent, d'autant plus que la France ne réside pas dans les
pays les plus robotisés. Les pistes proposées dans ce
mémoire permettent donc d'avoir des pistes de réflexions sur
lesquelles d'autres analyses plus orientés sur la culture
Française pourraient confirmer nos hypothèses.
On peut également poser une deuxième objection
quant au nombre restreint d'étude concernant les impacts sur la
robotisation industrielle automobile alors que c'est cette même industrie
qui possède le parc robotique le plus important. L'étude
généralisée des impacts de la robotisation permet
néanmoins d'en tirer des conclusions sur des entreprises
différentes facilement transposables au monde automobile. De plus cette
étude permet alors de compléter la littérature en exposant
la vision d'une entreprise automobile sur ce secteur.
Page 81 sur 111
13.3 Ouverture
La robotisation n'est pas uniquement une question
d'évolution technologique, elle apporte son lot d'effets dans notre
organisation du travail. Le cout moyen d'un robot a fortement diminué
ces dernières années permettant aux petites et moyennes
entreprises d'avoir accès à cette évolution technologique.
Le questionnement de ce mémoire pourra être
généralisé à l'ensemble des organismes de demain.
Cette technologie n'est plus uniquement présente dans les industries
manufacturières et automobiles mais peut être
généralisée à l'ensemble des secteurs, tel que ceux
des services. Il ne faut pas craindre l'émergence de métiers qui
sont capturés par des robots dès lors que ces métiers
libèrent les personnes vers des options de développement
créatif. Les robots libèrent l'homme des contingences et
libère son imaginaire. Si nous n'étions pas obligés de
travailler que ferions-nous ?
|
Nous pouvons alors nous poser la question si nous nous dirigeons
vers la fin du travail ? Peut-on dire que les générations futures
travailleront moins pour vivre plus ?
|
Page 82 sur 111
ANNEXES
Page 83 sur 111
Entretiens : 16 entretiens ont été
réalisés : L'ensemble des entretiens ne seront pas
retranscrits dans un souci de temps disponible pour l'élaboration de ce
mémoire. Parmi l'ensemble des 16 entretiens, 4 ont été
entièrement retranscrits et ont été choisis en fonction de
la catégorie socioprofessionnelle, du contenu et conclusions originales
que peuvent porter les entretiens.
Faurecia Hambach
BAGBIEGUE Noureddine - Projets d'entreprise
BARBIER Éric - Responsable laboratoire et
développement
BONDU Bruno - Technicien qualité
DECHOUX Isabelle - Direction
DOSNE Sébastien - Méthodiste assemblage
FAFOURNOUX Jean Sébastien - Technicien
logistique - Représentant du personnel
KOENING Dominique - Régleur moule
MARTELLOTA Jordan - Technicien assemblage
MOUGEL Anne-Sophie - Animatrice Hygiène,
sécurité et environnement
POINSIGNON Fabienne - Superviseur laboratoire
SCHISSLER Martin - Responsable informatique, hygiène,
sécurité et environnement
LAGUNA Vincent - Qualité injection
TRIMBORN Arnaud - Expert injection,
programmateur robots presses
ULRICH Vincent - Technicien qualité
Externe :
HUG Patrick-Responsable Recherche et
développement Arcelor Mittal - Maizières WALTER Fanny -
Ingénieur qualité Steelcase - Sarrebourg
Page 84 sur 111
Arnaud Trimborn
Quelle est votre vision vis-à-vis de la
robotisation ?
Pour moi, le robot et l'automate sont deux notions
différentes. Comparons ces deux points à l'humain, cela
reviendrait à dire que le robot serait le cerveau, et l'automate le
bras.
«Pour moi la robotisation c'est un plus pour
l'entreprise, mais c'est également un coût. Je constate que
lorsqu'il y a un amortissement long on ne met pas en place un robot car ces
derniers coûtent cher, pour moi cette vision est erronée car ces
robots sont multitâches, je pense à mon sens, dans les entreprises
que j'ai vu qui possède beaucoup de robot et peu de personnel, c'est des
entreprises performantes. Ces entreprises sont issues du domaine
métallurgie, sidérurgie et automobile. Essentiellement dans la
fabrication des moules et injection de pièces.
Les apports positifs d'une robotisation ?
Je constate la régularité, la
répétabilité et la précision de ces robots,
toujours en terme qualitatif. Cela permet de respecter la cadence
imposée par notre client. On élimine des tâches pour
certains ouvriers, mais finalement ces tâches sont souvent
répétitives. Cependant en termes de sécurité, je
pense que c'est identique. J'ai des difficultés à croire que les
accidents avec les robots n'existent pas, pour moi il risque d'y avoir autant
d'accident dès lors qu'il y a interaction entre les robots et les
hommes, parfois je constate que c'est vraiment dangereux. On n'est pas à
l'abri de bugs et de collision (programmation). D'ailleurs ces accidents
n'engagent pas toujours la sécurité des employés mais
peuvent être de réelles pertes économiques.
Page 85 sur 111
Que voyez-vous comme limites ?
Si ce n'est pas compensé par des aides pour d'autres
emplois, s'il n'y a pas une loi qui impose un reversement des gains lors de
l'implantation des robots pour favoriser d'autres emplois, c'est destructif. De
toute manière même si nous obtenons de nouveaux emplois sur notre
ligne d'assemblage, je pense que le nombre sera nettement inférieur
à ceux qui disparaîtront avec cette nouvelle technologie.
L'aspect qualité : Je pense que l'erreur sera toujours
humaine, même si on laisse une autonomie ou un pouvoir décisionnel
à ce robot, l'erreur initiale sera induite à l'homme. Issue d'une
mauvaise programmation initiale, c'est toujours l'humain qui aura oublié
quelque chose ; Plus vous avez de données d'entrée dans un robot,
plus ce robot est nourri d'expérience et moins il y aura d'erreurs, dans
mon cas je constate, mis à part quelques défauts
électroniques lié à la conception de certains composants,
des erreurs, mais ces erreurs proviennent de l'homme.
Après coup, cela peut être sécurisant de
se dire qu'un système est plus intelligent que nous, plus intelligent
qu'une seule personne, ou une petite équipe. Je pense que ce
système dépasse l'humain à un moment car c'est la mise en
collectivité de toutes ces données, toutes ces connaissances
qu'une seule personne ou une petite équipe de personne ne peut pas
contenir. Forcément cela va dépasser les hommes et ce n'est pas
parce que ces derniers jugent que la notion de bien et de mal. Le robot ne
dispose pas de ces notions fondamentales d'éthique de bien et de mal
sauf si l'homme détermine les règles en place. Malheureusement
rien ne nous assure que ces robots ne soient pas capables de déroger
à ces règles là et par leur pouvoir décisionnel
décider d'eux même des suites à réaliser. S'il est
capable de déroger à ces règles, je pense aussi car c'est
l'homme qui a souhaité qu'il se fasse dépasser.
Je pense que l'avenir va dépendre de l'intention des
personnes développant ces nouvelles technologies. Dans l'industrie, si
ce n'est qu'une intention économique alors on va droit dans le mur et il
faudra s'attendre à de nombreux conflits sociaux, on pourrait imaginer
Mai 68. Mais si cette technologie est utilisée pour développer la
compétence du personnel et assurer de meilleures conditions de travail,
alors nos enfants auront un bel avenir devant eux. Cela va beaucoup
dépendre de la morale des gens qui mettront cette technologie en place
qui prédominera, et non les robots.
Page 86 sur 111
Nous sommes des êtres sociaux, et travailler avec
très peu de monde, on sait tous vers quoi cela mène :
dépression et vous perdrez votre intérêt et votre
motivation à travailler dans cette entreprise.
Quelles seraient vos propositions ?
Travailler moins. C'est à dire travailler et être
capable de dire à nos salariés à l'injection : travailler
sur une plus courte période pour pouvoir avoir une vie plus
enrichissante. Travailler moins ne signifie pas être moins productif,
cela signifie juste de mieux répartir les tâches. Former mieux les
gens pour qu'ils soient plus performants à dépanner des robots,
à les reprogrammer. Certes on peut imaginer un robot en réparant
un autre, ou en programmant un nouveau à la place de l'homme/ Mais nous
n'y sommes pas encore. Dans ce que je constate actuellement, la solution c'est
de répartir le travail sur plusieurs personnes.
Ce n'est pas les robots qui décident, et tant que
l'homme aura ce pouvoir de décision il orientera vers quel aspect
(positif ou négatif) cette technologie tendra. Si l'homme a des
intentions criminelles, les dirigeants qui ont le pouvoir, le mot d'ordre vers
d'autre nation, le robot prendront le pas et suivront,
Page 87 sur 111
Jean Sebastien Fafournoux
Méthode logistique depuis 1998 dans l'entreprise.
J'exerce dans l'implantation et l'optimisation de la logistique, Je suis
également délégué du personnel et membre titulaire
du comité d'entreprise. Je suis également membre du CHSCT, (4eme
mandat) et secrétaire adjoint de ce dernier.
Quelle est votre vision vis-à-vis de la
robotisation ?
A titre personnel, je pense que ce serait une bonne
idée car cette technologie permettrait de supprimer des travaux
pénibles à titre syndical, ça peut aider l'humain si cela
ne supprime pas l'emploi en permettant de soulager les tâches mais que
l'opérateur garde le pilotage de la tâche, alors oui. J'ai peur
qu'on arrive vers une dérive qui va vers une évolution telle de
cette technologie qu'on permet la robotisation à outrance et qu'on ait
plus besoin de l'humain en production pour faire des tâches manuelles
voir même intellectuel. Dans certains pays comme le japon, les
hôpitaux sont déjà capables de remplacer l'humain pour
porter les patients. Cela permettrait aussi d'éviter les travaux de nuit
qui génèrent selon moi beaucoup de conflit, on sait très
bien que c'est un facteur aggravant, cancérigène pour l'humain,
et je ne suis pas sûr que travailler la nuit pour fabriquer des Smart
soit la meilleure chose à faire, ça ne fait que
dérégler le cycle de l'Homme.
Aujourd'hui je n'ai pas assez de recul pour affirmer ou non si
ces robots vont détruire les emplois ou ça va le moderniser, cela
va demander une adaptation, de nouvelles connaissances pour que les personnes
puissent maitriser, coordonner ces robots. La question sera de se demander
comment remplacer finalement ces métiers perdus.
D'après moi il y a une sphère de métier
facilement robotisable, dont les tâches sont répétitives ou
liées à des cadences de production. Si techniquement c'est
réalisable, il faudra veiller à que ce soit également
moralement acceptable.
Page 88 sur 111
Si on estime qu'un opérateur est uniquement
employé, rémunéré pour faire une tâche de
production en 8 heures de temps sans penser son travail, en se mettant à
la place d'une entreprise, oui le robot sera rentable, il ne tombe pas malade,
ne négocie pas d'augmentations de salaire, de coefficient, et on peut le
faire travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y a pas photo. En
revanche si on souhaite qu'il y ait une émancipation de l'humain et que
dans une entreprise il y ait un minimum de lien social pour que les gens
puissent améliorer leurs conditions de travail, améliorer leurs
postes de travail, si on supprime l'humain et qu'on le remplace par des robots,
ce phénomène n'existera plus. Même s'il faudra des
techniciens pour régler ces robots, les dépanner et faire le
service après-vente. On sera dans une déshumanisation.
On sait également que le secteur automobile est
l'acteur majoritaire dans la robotisation des lignes de production.
L'assemblage est le secteur qui se développera le plus dans cette
technologie et il n'est pas improbable que dans les années à
venir les conclusions faites aujourd'hui se réalisent pour de vrai et il
est important de réfléchir en amont pour diminuer au maximum les
risques liés à cette technologie.
Quelles seraient ces risques, limites ?
Les robots sont finalement dotés d'une intelligence
artificielle, un processeur, et avec l'évolution de l'informatique, les
processeurs calculent de plus en plus vite. Actuellement les chercheurs
n'arrivent plus à déterminer l'acheminement des étapes
logiques d'un robot. Pour réaliser une tâche précise il va
réaliser une multitude de tâches en amont dont il est le seul
à connaitre le chemin. J'ai peur qu'à terme on n'a plus de moyen
de contrôle sur ces robots. Il y a donc un risque de perte de maitrise
global. C'est difficile de déterminer les risques à l'état
actuel car il n'y a pas de connaissances précises à ce sujet.
Page 89 sur 111
Éric Barbier
Je suis scientifique, j'ai un doctorat en matériaux et
j'ai travaillé pour la première fois dans un laboratoire de
recherche et développement de la peinture et j'ai par la suite
travaillé chez un équipementier automobile pour définir
les chaînes peinture. Puis me voilà chez Faurecia, à son
époque sous dynamite Nobel (1997) pour m'occuper de l'ensemble du
développement peinture. J'ai donc eu l'occasion de m'occuper de toute la
partie développement peinture, injection et laboratoire.
Ma rencontre avec des robots, les premiers que j'ai vu
réellement dans le domaine du travail est en peinture. Quand je suis
arrivé il y avait beaucoup de chaine peinture réalisé par
des peintres qui étaient dans la chaîne, qui peignait les
pièces manuellement, ils avaient une gestuelle et réalisaient
tout le temps les mêmes gestes tout le long de la journée, ils
étaient équipés de combinaisons, de masques,
c'était dur.
Et puis petit à petit sont arrivé les
chaînes automatisées, au début là où j'ai
rencontré mes premiers robots c'était au flammage pour activer la
surface du polypropylène, dans cette situation nous avions besoin de
mettre en place ces robots 6 axes bourrés de capteurs qui
déplacent le pistolet suivant une certaine distance et vitesse en
fonction de la pièce rencontrée.
Quelle est votre vision vis-à-vis de la
robotisation ?
Ma vision par rapport à la robotisation est que cette
technologie a connue plusieurs phases, et on est en plein dedans. Elle a connu
plusieurs stades, selon moi l'automatisation fût le 1er stade, nous
sommes aux prémices de la robotisation et elle sera et restera dans
l'avenir. Il y a toujours eu des robots / automates pour réaliser les
soudures du véhicule. Dans l'automobile il y a beaucoup de robots, dans
l'industrie de manière générale ça s'est
robotisé assez rapidement, ces robots de mouvements, de gestes, pour
avoir de la précision et de la répétabilité. A
l'avenir cela va évoluer parce qu'on va avoir à faire à
des cobots, cette collaboration entre le robot et l'être humain. Pour
l'instant nous avons à faire à ces robots et l'humain reste en
retrait de ces robots pour des questions de sécurité, il y a des
barrières immatérielles de sécurité pour que le
robot s'arrête dès qu'il y a un être humain dans son
voisinage, a l'avenir il va y avoir plus d'interaction entre le robot et
l'être humain, qui vont aider l'humain dans sa tâche, qui vont
le
Page 90 sur 111
soulager pour essayer d'éviter des maladies de type TMS
(troubles musculo squelettiques) des choses comme ça.
Cette technologie va aider l'homme mais ne le remplacera
pas ?
Cela peut le remplacer, mais peut être à la
marge, en tout cas si effectivement il le remplace je pense que ce sera sur des
tâches éprouvantes qui ne sont pas censés être faite
par des humains, 5 jours sur 7 pendant toute une vie. Le robot c'est fait pour
aider, soulager. Mais également pour des questions qualité en
termes de répétabilité, fiabilité de
l'opération etc.
D'après vous quelles sont les points positifs
de robotisation d'une production industrielle ?
Concrètement, cela permet d'éviter que les
êtres humains soient exposés, on peut imaginer envoyer ces robots
dans des atmosphères qui ne sont pas bonne pour les êtres humains
ou dans la sidérurgie, les gens étaient exposés à
des températures très hautes, c'était dangereux pour avoir
le ruisseau de métal fondu, il pouvait avoir des projections de
métal en fusion. Faire travailler des robots c'est des questions de
sécurité, pour éviter également toute cette
gestuelle, mais également pour la qualité. Le Robot va être
répétable, la qualité devient toujours de plus en plus
sévère, les clients sont de plus en plus sevrés en
qualité et il devient de plus en plus dur de repérer ces
défauts etc. Le robot est plus performant sur cette analyse.
Parmi les UAP Faurecia, lesquelles voyez-vous
robotisés ?
Toutes. L'injection, la peinture, l'assemblage. A l'injection
on peut imaginer que ça soit robotisé. Bon effectivement j'ai
encore du mal à imaginer un robot qui ait l'apparence d'un humain dans
nos chaînes de production (rire). Certains postes ont fait l'objet de
robotisation car on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux incomplets,
c'était difficile pour quelqu'un d'être vigilant pendant tout un
poste, de voir chaque fois un incomplet à des endroits différents
et donc il y avait des cellules qui examinaient la conformité des
pièces et étaient directement envoyés dans des containers.
On peut alors imaginer qu'il y a des contrôles qualité fait par
des contrôles qualité. On dispose également d'un HRL, cette
structure entièrement intelligente permettant de transporter des
pièces et permettant de chercher des pièces en FIFO, en
Page 91 sur 111
déterminant sa trajectoire en fonction de
l'encombrement des allées dans laquelle il n'y a pas de demande. Notre
structure définie elle-même ses ordres de priorité etc.
Cette zone n'aurait pas pu être réalisée par une
chaîne logistique traditionnelle de type caristes, et a été
robotisé dès le début en 1997. Mais cette technologie a
été développée. On peut également imaginer
le laquage en imaginant remplacer notre parc d'automates par des robots
intelligents capable de regarder les pièces et détecter les
défauts avant même que ces dernières poursuivent leur cycle
habituel de production. Vous n'imaginez pas le gain de temps et d'argent que
l'on peut faire. Actuellement le contrôle de pièce est
réalisé par une personne, de manière systématique
dont le jugement de l'opérateur fait foi. Il faudrait vraiment mettre en
place ces robots qui détectent. J'y vois finalement beaucoup d'avantage,
le traitement de l'information de masse étant l'une également.
D'après vous quelles seraient les limites
?
Les limites seraient d'avoir moins d'emplois plus de
chômage. Parce Que le robot ne remplacerait beaucoup trop de personne.
Car dans le modèle économique mis en place actuellement, le robot
serait utilisé uniquement pour réaliser un peu plus de
bénéfices pour les entreprises et il n'y aurait aucune
contrepartie pour les remplacements des personnes par des robots. On peut
imaginer, si on va très loin qu'il y aurait une masse de chômeurs
assez importante et des robots qui les remplacent, qui coûteraient au
début un investissement mais qui ne coûteraient plus grand chose
par la suite et qui seraient beaucoup plus, économiquement rentable
qu'une personne.
Même en cas de panne ?
En cas de panne, on imaginerait même un robot qui en
répare un autre. De manière générale les gens vont
réaliser un calcul à un moment donné et vont se dire :
«voilà là j'ai autant de chance d'avoir des pièces
mauvaises qui sont considérées par l'opérateur comme
bonne, avec le robot je n'ai pas ce risque», Je pense que les industriels
vont rapidement faire tout un calcul et conclure sur le prix d'achat d'un robot
à long terme, «j'ai tant de maintenance par an, une personne
coûte autant etc.», et ne vont remplacer que lorsque ce sera
économiquement rentable. Le risque évident que je perçois
c'est de se débarrasser entièrement de l'être humain. Je
pense qu'aujourd'hui c'est le monde de la finance qui gouverne et de
façon très dure, c'est probable que ce soit l'issue de cette
technologie dans notre société.
Page 92 sur 111
Que voyez-vous comme autre facteur limitant ?
Un point particulier attire mon attention, et cela me fait
peur même au niveau personnel, c'est la surveillance et le flicage au
travail. Par exemple imaginons qu'il y ait un être humain en même
temps que le robot, ce dernier va emmagasiner une énorme masse de
donnée, qui peuvent ensuite être utilisées pour dire «
Ce salarié, il est quand même moins performant que les autres,
là il va 2 secondes moins vite, là il fait ça comme
ça etc.» et donc en analysant ces données recueillies on
peut arriver à justifier que tel salarié est moins
compétitif qu'un autre.
C'est vraiment comparable aux réseaux sociaux, si
quelqu'un s'accapare des données personnelles et les croises, qui les
étudies, peut dire « cette personne là j'arriverai à
lui vendre mon produit, à lui faire croire ceci ou cela, car j'ai
remarqué que dans sa personnalité il a tendance à ...
« dans ce cas-là ce n'est pas honnête. On parle donc de ces
«Big Data» qui peuvent être utilisée à des fins
positives qui peuvent servir à éliminer des rebuts ou des
défauts dans le processus de fabrication mais il y a également
des datas qui peuvent être utilisés à l'encontre du
salarié. Cela dépendra vraiment de son utilisation et de
l'organisme dans lequel ces données seront recueillies. Il peut y avoir
dans l'entreprise des personnes qui l'utilisent à des fins
négatives (flicage, sanctions, ...) plutôt qu'à des fins
positives en se disant «bah tiens, ici je remarque qu'il y a des lacunes,
on va accompagner ce salarié en lui proposant des formations»,
ça peut être utilisé comme tel, enfin j'y crois.
Une certaine forme de résistance au changement
?
Oui, je pense que c'est le cas en tout cas chez les allemands
c'est culturel. Les allemands aiment bien la mécanique et tout ce qui
touche les machines, c'est les rois de la machine à outils dans le monde
et c'est grâce à tout ça qu'ils ont une balance à
l'exportation positive. Je pense que par notre culture on aura toujours
tendance à avoir peur face à ces nouvelles technologies car
certains métiers seront amenés à disparaître.
Quels types de métiers ?
Dans l'industrie c'est toujours les métiers les plus
faciles à remplacer car les tâches ne sont pas très
compliquées ; enfin compliqué au point de vue physique il faut
une bonne vue, une
Page 93 sur 111
bonne attention pour tenir pendant un poste complet le
contrôle des pièces et voir tous les défauts qui peuvent
être très difficile à voir mais après ce sont des
tâches facilement remplaçables par des robots car il y a des
jugements qui sont plus facile à faire que d'autres. Je pense que les
niveaux les plus «bas» tel que les opérateurs de production
à la chaîne qui seront remplacé et aussi les niveaux les
plus bas en employés aussi, ceux qui ont le moins de décisions
à prendre, les choses comme ça. Je dirai qu'il va falloir
s'adapter mais dans les métiers dits plus créatifs ce sera plus
difficile de remplacer les robots. De toute façon c'est pas dans
l'industrie qu'il y aura le plus de problème selon moi, c'est dans les
services, dans les banques et les assurances, ou en remplace les gens qui sont
appelés en anglais : «front office» qui sont en contact avec
la clientèle, tout ça c'est de plus en plus remplacé par
des robots avec les banques qui sont sur internet, par téléphone,
tout ce qui est dématérialisé, on constate une hausse de
cette robotisation, c'est des voix, des logiciels intelligents qui comprennent
quand même toute une panoplie de base de demande , pour l'instant ils ne
sont utilisés qu'à des fins rudimentaires pour savoir par exemple
combien il reste sur son compte, si il est débiteur, créditeur,
si tel retrait a été fait, tout ça c'est des choses
simples mais plus ça va , plus ils vont être utilisés car
ils disposent de base de données immenses à leur disposition et
peuvent avoir recours très rapidement et peuvent donner des
réponses beaucoup plus rapidement qu'un conseiller clientèle,
c'est surtout au niveau du service que ce changement va s'effectuer, tout comme
cela s'est constaté au domaine de l'agriculture, au début c'est
surtout l'agriculture qui a souffert . Puis vient les mines et la
sidérurgie. Prenons exemple avec Watson et IBM, qui a fait un robot pour
remplacer les conseiller clientèle, qui est implanté au
crédit mutuel CIC, pour le moment sans remplacement de personnel mais ce
n'est pas un pied passé dans la porte. Les gens se disent en ce moment
«oui, on a eu peur que Watson nous remplace» mais les gens ne sont
pas remplacés et sont très content de cet assistant puisqu'il
n'est pas en Front office mais en back office et est là pour aider les
gens. Pour le moment c'est un aide leur permettant de consulter les
informations dans sa base de données, il est très rapide et a
accès à des textes, sur l'assurance vie, des questions
compliqués, lui est capable en peu de temps avec des mots clés de
trouver la réponse facilement. Pour le moment c'est qu'une aide mais qui
dit que dans 10 ans cela ne deviendra pas le remplacement définitif.
Page 94 sur 111
Quelles seraient vos propositions pour accompagner cette
technologie ?
Au départ, si on ne souhaite pas que ces personnes, il
va falloir quand même des gens pour fabriquer ces robots, il va falloir
des logiciels pour créer des algorithmes pour traiter les bases de
données. Certes, une fois que le robot donne ces données il faut
quelqu'un qui traite ces données, quoique peut être qu'un autre
robot le fera (rires), mais une fois que c'est traité, il faut quelqu'un
qui le regarde pour l'interpréter. Il va y avoir l'émergence de
nouveaux métiers et il faut s'y préparer, il faut les formations
; au départ si on veut, il faut avoir des formations adaptées
pour pouvoir s'installer au mieux dans les nouveaux métiers que la
robotisation va créer. Si le robot devient monteur ajusteur, on aura
plus besoin de monteur ajusteur, mais pour créer ces robots il faudra
cette connaissance pour réaliser l'architecture même du robot. Je
pense que ça va créer des métiers qui demandent plus
d'autonomie et de responsabilité, d'initiative, de réflexion et
créatif. Moins répétitif, plus créatif (rire). Cela
passera par de la formation puis de manière politique il faudra rester
vigilent que tout ce bénéfice dégagé par ces robots
n'aille pas que vers un tout petit nombre de personne, une caste que se les
approprie mais que cela reste bénéfique pour l'ensemble de la
société et que les emplois qui vont être perdus, la perte
soit partagée et que le bénéfice arrive à payer la
perte de ces emplois.
Une petite phrase pour conclure : L'homme au service du
robot, vous y croyez ?
Cela voudrait dire que l'homme est inférieur au robot.
Cela voudrait dire que l'homme est capable de créer un être
supérieur à lui, finalement l'homme aurait créé son
dieu.
Page 95 sur 111
Patrick HUG
J'arrive en fin de carrière, je suis bientôt
à la retraite et je dirige un très gros département de
recherche et développement chez Arcelor Mittal depuis toujours. J'ai
toujours dirigé des secteurs de recherche, ça peut fluctuer selon
les niveaux, entre 60 et 100 personne, parfois même plus que cela. J'ai
toujours eu un pied dans le management et l'autre dans la science. Par plaisir
personnel je me suis intéressé très tôt aux
neurosciences, ce qui m'a amené à réfléchir aux
biais de décisions, les prises de décision les aspects
négociation et la conduite des hommes pour aller vers la performance.
Quelle est votre vision de la robotisation en industrie
?
Elle est inéluctable, aujourd'hui je ne connais pas de
grand groupe qui ne se pose pas la question de savoir quelle va être leur
positionnement personnel et stratégique et concurrentiel par rapport
à l'entrée des robots dans l'entreprise. Certaines entreprises
sont terriblement bien implantées en matière de robot, comme le
monde automobile, le monde d'Arcelor Mittal l'est aussi en grande partie et se
pose bien sûr d'autres questions de la robotisation que celle des gestes
intelligents pour remplacer les hommes en termes de pénibilité du
travail, de zone dangereuse, de gestes précis à réaliser.
En termes de communication également, nous somme capable aujourd'hui de
réaliser des opérations à distance, je pense que cela va
changer réellement le modèle actuel. Mais il faut faire
attention, ce n'est pas que les robots, c'est surtout l'intelligence
artificielle qui permet d'interconnecter un certain nombre d'objets comme les
modèles virtuels. Cela va être aussi un changement de
modèle dans tout ce qui touche les big data et autres choses, sur
lesquels il y a probablement des espoirs qui sont terriblement fondés
dans les big data que sont les espoirs de corrélation, c'est à
dire de creuser des données comme l'a fait Google et autres en ce moment
pour trouver des informations en imaginant que l'on puisse faire des
économies de la phénoménologie scientifique.
La robotisation est jusqu'à présent est une
robotisation simple algorithme, simple sur la répétabilité
de syntaxe.
Page 96 sur 111
Quelles sont les points positifs d'une robotisation
d'industrie selon vous ?
Nous ne sommes pas encore dans un univers robotique, c'est
à dire qu'à titre personnel je n'ai pas une grande importance
dans ce domaine. Comme beaucoup de personne qui observe ce
phénomène sociologique, du monde du travail et dont la
façon que ce monde va bouger, et être impacté par cela,
l'idée est de savoir si on remplace des emplois ou si on déplace
des emplois ? C'est à dire que jusqu'à présent et dans
l'histoire de l'humanité, les gains de productivité ont toujours
servi au capital et aux individus on a nettement plus de congés, de
repos que n'en n'avait nos anciens, on a une espérance plus longue que
n'en avait nos anciens, on a une capacité de se faire soigner
très supérieure à ce qu'avait nos anciens. On peut
regarder aujourd'hui la robotisation comme étant la capacité de
pouvoir remplacer l'humain dans un certain nombre de tâche
répétitives, barbantes, dangereuses. Il faudrait peut-être
repositionner les besoins d'un individu en matière de curiosité,
de développement de compétences en matière de choix de ses
propres options, il y a un certain nombre de travaux, pour savoir quelle
était la véritable valorisation des travaux tels qu'ils sont
réalisés aujourd'hui. La pensée de certaines personnes
dirait que quand un employé travaille sur une chaîne de production
il est excessivement difficile d'être heureux. Alors s'il est difficile
d'être heureux 43 ans de sa vie sur une chaîne de production,
saluons les robots qui un moment donné va faire ce boulot. La question
de fond c'est comment allons-nous occuper l'humain. Il est fort probable qu'un
certain nombre de travaux disparaissent, on voit de façon plus simple
des gens qui veulent plus tondre la pelouse. On voit une émergence de
ces nouvelles technologies. L'évolution se fait comme elle doit se faire
sans finalité. A l'hôpital les travaux d'infirmiers ou
d'aide-soignant sera remplacé par des robots qu'on voit de plus en plus,
des robots intelligents et pourquoi pas ces robots intelligents pourraient
donner des médicaments. Cela va remplacer un certain nombre de
tâche sur lequel il est possible que la valeur ajoutée humaine
soit faible, et qu'actuellement l'humain lui-même est utilisé
comme un robot avec des procédures fixes et de choses comme ça.
Considéré comme un robot ce qui peut être expliqué
pourquoi il est si difficile pour certains d'imaginer le plaisir que l'on
pourrait trouver au travail quand on occupe ces fonctions-là. Etat
d'âme que n'auront pas les robots.
Page 97 sur 111
En quoi cela déplace les champs de métiers
?
Les métiers qui vont être pris par des robots va
laisser l'humain en réflexion sur quel genre de place créative il
va occuper. On pourrait presque considérer que le véritable
bonheur de l'homme se trouve dans la capacité de mobiliser ses fonctions
imaginatives, son imaginaire et d'ailleurs on constate à quel point
c'est réalisé avec du virtuel 3D. C'est comme dans le temps le
tracteur a libéré du cheval, la machine à laver
libère, mais la question est de savoir que fait-on du temps
libéré ? Et comment on e réalise dans le temps
libéré ?Alors il y a peut-être des opportunités pour
l'humanité, en utilisant le temps libéré pour
améliorer l'humanité entre les individus, le soin qu'ils prennent
les uns des autres ou faire de ce temps libéré un temps
d'isolement. Imaginez qu'une partie de ce temps libéré,
peut-être que les infirmiers de demain, libéré d'un certain
nombre de tâche, par exemple les robots s'occupant de la distribution des
médicaments, pourront passer plus de temps dans le relationnel avec les
malades. On sent qu'aujourd'hui il y a une souffrance des malades et du
personnel soignant dans l'incapacité d'avoir une incapacité
d'avoir des gestes mécanisés, par rapport à ce qu'on
considère comme besoin fondamental qu'est être en relation. Alors
si les robots s'occupent de cela, et qu'on ouvre de plus en plus les
métiers vers les services, parce qu'il est possible de le faire alors on
est dans une voie qui est tout à fait intéressante. Les
métiers ne remplaceront pas les métiers créatifs, et ne
remplaceront pas les métiers qui tissent le lien car celui-ci est
systémique. Aujourd'hui nous savons qu'une trentaine de pourcent de
personne de plus de soixante années vivent seul, radicalement seul,
aujourd'hui il y a beaucoup d'animaux de compagnie qui servent de substitut aux
relations humaines qu'on ne peut pas avoir, il est possible qu'à un
moment donné nous serons capables de causer avec un robot, on aura
l'impression, l'illusion.
La résistance au changement ?
C'est une crainte fondée car il y a disposition du
monde actuellement énormément de personne qui n'ont pas
forcément eu l'accès à une éducation d'abstraction
suffisante. Aujourd'hui on peut faire le même rapprochement avec ce qui
était l'âge d'or de l'humanité avant le
développement de l'agriculture. Avant le développement de
l'agriculture, les volumes de boîte crânienne de l'humain, et ce
qu'on imagine être des compétences cognitives de survie dans la
nature, la compétence qui s'appelle survivre, ce que fait les animaux
mais également l'humain
Page 98 sur 111
c'est une compétence extraordinairement riche, ce qui
avait requis un volume de boîte crânien un peu supérieure
à ce qu'on trouve aujourd'hui. On estime qu'avec le développement
de l'agriculture il s'est passé deux phénomènes, le
premier, l'humanité a commencé à exploser avant
l'humanité était parcellaire sur la planète, très
peu d'humains. Des familles humaines rencontraient rarement à
l'échelle d'une vie une autre famille humaine. On était dans un
contexte d'isolement et de développement dans une sphère
réduite. Ensuite l'agriculture se développe va amener une
première forme d'esclavage d'un point de vue consenti des hommes/
Même pour ceux qui n'étaient plus tout à fait en situation
de survie dans la nature, les animaux eux-mêmes ont accepté eux
même sans comprendre ce qu'ils se passait l'action de domestication,
Depuis cinq à six mille an on trouve une espèce de courant
très fort de séparation des métiers, de
spécialisation des métiers de stratification des métiers,
et cela va se trouver encore pendant longtemps. Je comprends qu'un certain
nombre de personnes aient peur car il y va y avoir un tri dans ces
métiers. Quand vous avez aujourd'hui des gens qui travaillent dans des
chaînes de tri sur des vêtements de type Emmaüs, les gens avec
des gestes extrêmement rapides vont réaliser un premier tri. C'est
sûr que pour être heureux dans ce travail il faut expliquer la
valeur sociétale et personne qui est derrière et d'avoir une
hygiène salariale qui leur permet de vivre de ce qu'elles font. Vous
avez ces personnes-là, leur poser des questions et vous constatez
qu'elles ont beaucoup de difficultés dans le monde industriel ou
commercial tel qu'il est construit aujourd'hui ou de trouver leur place. On
n'en voudra pas dans un métier d'assistant de direction, ce sont des
métiers de niches, mais il y en a beaucoup des métiers comme
ça. Et d'un seul coup on va dire qu'on va installer sur cette ligne
là un robot, avec un oeil intelligent, plus performant que l'oeil
humain, capable de percevoir les fibres synthétiques du textile et avec
un bras extrêmement rapide capable d'effectuer la tâche. Les
personnes qui sont là peuvent se poser à juste titre la question
: qu'est-ce que je deviens ? Et toutes les personnes qui se sont à un
moment donné installé dans un métier dans une fonction,
dans une habitude de vie vont systématiquement se poser la question de
qu'est-ce qu'on devient ? Si on n'est pas capable d'apporter des
réponses à la question : qu'est-ce que je deviens ? On peut
comprendre effectivement cette résistance au changement. Il va falloir
imaginer des emplois. Je ne suis absolument pas persuadé, bien au
contraire que l'ensemble des métiers soit résous par des
robots.
Page 99 sur 111
Votre point de vue vis-à-vis de la performance
qualité ?
Il faut réellement faire attention à ce point,
les robots ont une extraordinaire capacité et un défaut
fondamental : c'est qu'ils font juste. Prenons par exemple la terre, le
véritable moteur de l'évolution dans le vivant, ce sont les
défauts de réplication de l'ADN. Quand on fait des gestes justes
on a plus la moindre capacité de se développer. Il faut bien
comprendre ce point. Dit autrement je ne pense pas qu'il y aura une
compétition entre le robot et l'homme. Le robot est fait pour faire des
choses justes pour être plus précis qu'éventuellement une
main, pour voir dans une longueur d'onde qu'on ne voit pas, pour assimiler plus
vite l'information, on ne peut pas lutter contre les processeurs et leurs
capacités de calculs. Un cerveau humain c'est fait pour se tromper en
permanence et pour pouvoir ajuster ses réponses de façon
heuristique et créatives et pouvoir assembler un comportement
très adapté avec des décisions qui étaient fausses.
Moi ce que j'essaie de pousser beaucoup dans l'entreprise et je pense qu'il a
des biais dans nos démarches qualité, il y en a beaucoup
d'ailleurs dans la démarche qualité mais, en fait qu'est-ce qu'on
fait de nos erreurs ? Nos erreurs sont extraordinairement fécondes et
dans beaucoup de métiers, ce qui va faire la force de l'humain c'est sa
capacité à se tromper. L'essentiel des découvertes
humaines sont des erreurs d'interprétation. Je souhaite découvrir
la route des indes mais en réalité je découvre
l'Amérique. Partout où ou ces tâches seront
robotisés il faut que cela laisse un espace pour l'homme et leur
imaginaire.
Parlez-moi de votre point de vue sur l'intelligence
artificielle
De nos jours il y a pas mal de questions concernant ce point.
L'Homme construit cette intelligence. La façon qu'a l'intelligence
artificielle dans le Deep Learning, qui est capable de se faire un
modèle, nous décidons que ceci est un lapin car il bouge comme
ça, a des yeux comme ça et des oreilles comme ça, le robot
va décider que ceci est un lapin avec un autre critère qu'est le
nôtre, il va y avoir d'autres intelligences qui vont se mettre en place
et on estime, c'est même déjà le cas, qu'un robot constitue
un autre robot. Aucun humain aujourd'hui n'est capable de faire un processeur,
c'est un robot qui le crée. On va demander à un robot de faire
des morceaux de robot et il n'y a pas de raisons spéciales qu'à
un moment donné avec des algorithmes qui nous échappent qu'un
robot puisse faire un robot plus performant que lui-même et qui a son
tour en
Page 100 sur 111
fasse un plus performant etc., C'est un courant de
pensée qui dit qu'à un moment donné le robot prendra la
main sur le monde et qui nous accepterons comme animaux de compagnie.
Possible ?
Il faudra un paquet de temps pour que cela advienne. Je ne
sais même pas si c'est possible. Pour que cela soit possible il faudra
qu'on introduise la fonction d'erreur dans le robot. Le cerveau humain a
derrière eux 2,5 milliard d'année d'évolution et
d'adaptation et les robots peuvent aller plus vite et en quelques
décennies rattraper ce retard. Mais il faudra introduire s'ils veulent
se rapprocher d'une intelligence humaine, l'émotion, l'erreur etc. Dans
un monde planétaire qui bouge ne pas se tromper c'est mourir. Ne pas se
tromper cela veut dire ne pas provoquer l'émergence d'une anomalie qui
pourrait me servir pour pouvoir mieux m'adapter dans mon monde. On peut avoir
le même raisonnement dans l'entreprise et en particulier dans le
management de la qualité. Quand on regarde un moment donné ou
sont les erreurs. Quand une entreprise se positionne par rapport à ses
concurrents où sont les vrais leviers de la différentiation de la
concurrence ? On a les mêmes machines que les concurrents, on a les
mêmes méthodes des concurrents, les mêmes circuits
d'embauches des concurrents, les mêmes clients, les mêmes
contraintes légales alors qu'est ce qui peut faire une différence
significative entre moi dans mon organisation et mes concurrents ? Il y a
quelque chose de vaporeux et vague qui s'appelle la culture, mais que mettre
dans cette culture ? Immanquablement l'adaptation à un monde qui bouge
et je vais observer les erreurs qui se produisent dans mon organisation. Et je
vais pallier ces erreurs. Car ce sont mes lieux d'apprentissage et de
différentiation. Car tout ce qui écrase les erreurs ou qui les
considère comme des fautes et pas des erreurs et sur lesquelles les
personnes vont se justifier etc., la question est : en quoi l'erreur me
renseigne sur le monde, en quoi la façon de la traiter va me rendre plus
puissant après l'avoir traité qu'avant ? Je soupçonne que
tant qu'on aura cette capacité à l'échelle de l'humain on
aura un avantage contre n'importe quel robot.
Une entreprise peut survivre sans la robotisation
?
Cela dépend desquelles et de ce qu'on met dans le mot
robotisation. Je pense qu'il existera des entreprises de soins, de service, ou
sa relation aux personnes qui se feront avec des retards de robotisation.
Peut-elle survivre sans robotisation ? Cela viendra partout, c'est une tendance
lourde des puissances du monde, la révolution de la puce au silicium qui
a commencé
Page 101 sur 111
après la seconde guerre mondiale et en particulier
l'invention du transistor qui a changé les choses puis les processeurs.
C'est inéluctable, irréversible et envahissant, les vrais
puissants changements du monde ne sont que là. Prenez par exemple
l'épigénétique ; aujourd'hui par la robotisation on est
capable de décrypter le génome humain et son
épigénome en l'espace de quelques poignées de minutes,
ça coute mille euros et cela tiens sur la table. Ce faisant, ceci
existant ceci ouvre un champ absolu de recherche, ce que e crois c'est que le
développement de cette robotisation va nous amener à gagner
très vite la connaissance sur le monde et va changer radicalement la
façon dont la planète va se faire : dans un siècle on ne
se soignera plus de la même façon, il y aura peut-être du
transhumanisme à travers des pièces pour quelqu'un qui est
paralysé du bas du corps, avoir la possibilité un jour de lui
greffer un processeur qui par la pensée lui permettrait de retrouver une
mobilité, cela viendra et se fera, cela va envahir tous les secteurs.
Cette technologie s'accompagne toute seule, je pense que beaucoup de choses
échappent à l'humain, l'humain l'a produit mais lui
échappe. On ne peut rien faire sur ça.
Que proposeriez-vous pour ne pas la subir ?
Dans un aspect systémique cette technologie qu'on a
produit à l'origine est plus forte que nous, c'est comme
l'économie, elle nous surpasse, elle est haut delà de nous, c'est
nous qui l'avons mise en place et nous échappe. Je pense qu'il est
illusoire de l'imaginer canalisée. La seule chose c'est de dire
maintenant que cela existe, comment arrivons-nous à trouver notre place
dans ce système ? Pour certains individus, cela ne posera jamais de
difficultés mais je ne sais pas s'il y aura de la place pour tout le
monde à tout moment. Certains seront à l'aise dans les
éléments sociaux culture qui sont les leurs, d'autres non, qui
seront en crainte. A quoi sert de gagner l'argent ? Imaginons par exemple les
entretiens des routes se ferait par des robots et les problèmes
d'inondation qu'on connait aujourd'hui qui sont aussi en partie liée
à des hommes ne faisant plus le travail car cela coute cher, on
préfère déplacer le problème vers les assurances,
imaginons qu'a un moment donné que les machines de la DDE viennent et
réalisent des curages
etc. si nous ne changeons pas notre
modèle économique, il va y avoir des personne perdues, et on va
se poser des questions comment va-t-on redistribuer ces richesses aux personnes
? N'aura de sens à l'échelle des personnes que si ces
dernières savent ce qu'ils vont faire et organisent leur vie ? Il y a
une forme d'angoisse des personnes qui partent à la retraite, c'est pour
ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui une fois sont à
la retraite disparaissent, qui s'appelle
Page 102 sur 111
comment je vais occuper mon temps, ce n'est pas un
problème de ressource financière et d'accès au bien de
consommation, c'est quel sens et qu'est-ce que je fais de ma vie ? L'absence de
travail individuel parce que pris en charge par des robots va questionner.
Finalement distribuer un salaire universel règle les problèmes
d'aujourd'hui mais pas ceux de demain, cela ne règle pas les questions
de fond, du bien être en soi. Il y a beaucoup de choses qui vont s'auto
réguler.
Les robots auraient pris la main sur la terre, et l'humain
aurai disparu, moi ce que je pense c'est que ce sont des scénarios que
l'on voit souvent dans les films de science-fiction, mais je trouve que ces
films sont les plus juste en matière d'anticipation. Il n'y a pas de
raison de s'inquiéter , quel que soit les bifurcations qui vont
être prises ce que je pense c'est que la robotisation va interroger les
humaines que nous sommes dans les choix personnels et le conditionnement
socioculturel qui sont les nôtres les modèles qu'on prend pour
vrai d'organisation du social et du vivant va questionner l'ensemble car d'une
part on va atteindre des zones de crises et cela va je pense ouvrir le champ
à des nouveaux moyens d'investigation, on va connaitre beaucoup mieux la
matière, la mécanique quantique, les vérités de
l'univers, on va rentrer un peu plus dans le vivant, dans le
génétique , dans la façon dont tout cela se combine, et on
aura la possibilité d'accéder à des énergies
définitives. On entend souvent l'énergie est rare, ce n'est pas
vrai, c'est ce qu'il y a de plus rependu dans l'univers. Ce sont les
conversions d'énergie que l'on ne sait pas faire. La robotisation pourra
nous donner accès à ces connaissances-là. Ce temps libre
libéré par les robots amène le monde à
réfléchir autrement grâce à ce temps libre. La
robotisation et l'informatique a permis en moins de 17 ans on est passé
de la victoire du décodage du génome humain a la production en
masse de ce dernier, ce qui libère des laboratoires entiers, qui
crée des métiers nouveaux, qui ouvre des champs extraordinaires
pour soigner des maladies qu'on n'imaginait même pas qu'elles soient
soignables, je pense aux cancers, à la sclérose en plaque. Tous
ces modèles vont bouger, la seule structure qu'on a aujourd'hui est la
structure par l'emploi rémunéré. Le simple accès au
travail rémunéré n'est pas suffisant pour se sentir
heureux, il faut avoir une sensation d'utilité, de
réalisation.
Tout se repensera tout seul, on imagine qu'on aura les
commandes des choses mais ce n'est pas le cas. Il faut comprendre que ces
phénomènes ne sont pas maitrisables. On aimera bien
contrôler mais il faut se souvenir qu'on a très peu de points de
fonctionnement pour contrôler un
Page 103 sur 111
système. C'est comme les tornades ou les grosses
pluies, il faut qu'on apprenne à vivre avec mais vous ne pouvez pas
empêcher une tornade de se faire, comme vous ne pourrez pas
empêcher la robotisation. C'est terminé. Le simple fait qu'on en
parle c'est terminé. Elle vit à son propre rythme. On peut mettre
autant de barrières qu'on voudrait, et de principes écrits, c'est
fini. On peut éventuellement l'arrêter dans notre pays, elle ne se
fera pas là, mais elle se fera ailleurs. Et c'est un frein pour notre
modèle économique qui est prévalent, ne pas le faire c'est
une erreur, une faute. Cela s'appelle la mémétique, vous ne
pouvez pas l'empêcher. Vouloir l'empêcher c'est vouloir
l'amplifier.
La robotisation ne sera pas simple pour tous les individus,
pour moi inclus. La seule chose que je dis, j'ai plutôt confiance, je
pense qu'on peut avoir un retour à la nature. C'est à nous
d'enchanter et d'humaniser les choses. On est en droit d'exister, d'être.
Je trouve qu'il y a une fécondité dans l'erreur et qu'il y a
très peu de fécondité dans la réussite, on a besoin
de la réussite, massivement de la réussite pour nous endormir, et
nous rendre confortable et trouver les énergies pour pouvoir faire
quelque chose de nos erreurs. C'est à nous d'humaniser un robot.
Page 104 sur 111
Bibliographie
Références Français :
1. Attali, J. (2007). L'avenir du travail. Fayard.
2. Avenier, M. J., & Schmitt, C. (2007). La construction de
savoirs pour l'action (pp. 140-170). le Harmattan.
3. Badredine S, Djaouahdou R. Normes d'audit : de la
responsabilité sociale au développement durable. Une simple
adaptation ou une nouvelle dimension ; 2017
4. Bairoch, P. (2017). Révolution industrielle et
sous-développement (Vol. 9). Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
5. Barry Eichengreen (2018) La robotisation révèle
la faiblesse des compétences en France. Innovation &
Société.
6. Becker, J. (2012). L'écologie prospective de la
robotique. Tracés. Revue de sciences humaines, (22), 125-137.
7. Beitone, Alain. « Chapitre 6 - Économie et
sociologie du développement », Économie, sociologie et
histoire du monde contemporain. Armand Colin, 2013, pp. 283-336.
8. Carole Ulmer (2017) Industrie 4.0 : Vers une approche
globale. Confrontation Europe.
9. Catherine Simon (2017) Des robots pour la planète, Les
échos.
10. Charreire, S., & Huault, I. (2001). Le constructivisme
dans la pratique de recherche: une évaluation à partir de seize
thèses de doctorat. Finance contrôle stratégie, 4(3),
31-55.
11. Chavagneux, C. (2017). Allemagne: les robots
détruisent-ils des emplois?. Alternatives économiques, (11),
96-96.
12. Christophe Bys (2017) : Ingénierie automobile... le
changement est en route
13. De Lacoste, A (2017. Le seigneur des robots
14. Edip, A (2017) Les robots, une chance pour l'homme ?
15. Federica Minichiello (2017) Machines, données et
apprentissage : relations et enjeux.
16. Ganascia JG. Le mythe de la Singularité. Faut-il
craindre l'Intelligence Artificielle ? L'Ame Machine Paris: Seuil; 2017.
17. Gillet-Goinard, F., & Seno, B. (2016). La boîte
à outils du responsable qualité-3e éd. Dunod.
18. Girod-Séville M., Perret V. [1999] « Fondements
épistémologiques de la recherche », chapitre 1, in R.A.
Thiétart et coll., Méthodes de recherche en management, Dunod, p.
13-33
19.
Page 105 sur 111
Kociemba, P. L. (2012). La valeur ajoutée (en termes de
qualité, de sécurité...) de la robotique dans l'industrie
aéronautique. In Annales des Mines-Réalités industrielles
(No. 1, pp. 15-18). Eska.
20. Le Moigne J.L. [1990], «Épistémologies
constructivistes et sciences de l'organisation », in A.C. Martinet
(Coord.) Épistémologies et sciences de gestion, Économica,
chapitre 3, p. 81-141.
21. Le Moigne J.L. [1995], Les épistémologies
constructivistes, PUF
22. Le Ru, N. (2016). L'effet de l'automatisation sur
l'emploi: ce qu'on sait et ce qu'on ignore. La note d'Analyse de France
Stratégie.
23. Michelon, V (2017) Quelle est donc cette «taxe
robots» proposée par Benoît Hamon ?
24. Ostergaard E (2018) Comment la robotisation peut
améliorer les emplois Les Échos
25. Patrick Arthus (2017) propos recueillis par Solène
Davesne et Pascal gateaud « La France a un gigantesque problème de
compétences »
www.usinenouvelle.com
26. Perres, C., & Kechichian, A. (2012). L'application
robotisée de peintures dans l'industrie automobile. In Annales des
Mines-Réalités industrielles (No. 1, pp. 19-23). ESKA.
27. Popper, L (2017) La montée en compétences,
une conséquence de la robotisation industrielle.
28. Puech, M. (2015). Développement durable: un avenir
à faire soi-même. Le Pommier.
29. Rodolphe Gelin, Olivier Guilhem (2016) Le robot est-il
l'avenir de l'Homme ?
30. Sauvy, Alfred (1980), La Machine et le chômage,
Dunod
31. Schweitzer MG, Puig-Verges N. Des automates intelligents
à la robotique humanoïde. Penser, représenter,
éprouver, 27e Congrès de l'Information Psychiatrique
32. Schweitzer MG. Interaction et empathie. Des
reformulations nécessaires avec la robotique développementale.
Séminaire du GRECC; 2010
33. Schweitzer, M. G., & Puig-Verges, N. (2018, March).
La Robotique développementale et l'Intelligence artificielle
conduiront-elles à l'émergence de nouvelles valeurs pour
l'homme?. In Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique (Vol.
176, No. 3, pp. 291-295). Elsevier Masson.
34. Tisseron. S, (2016) LE JOUR OU MON ROBOT M'AIMERA-Vers
l'empathie artificielle
35. Ulmer, C. (2017). Industrie 4.0: vers une approche
globale. Confrontations Europe: la revue, (116), 11.
36. Urso, M. (1998). Décrivez les avantages et les
désavantages de la robotisation et d'automatisation.
Page 106 sur 111
Références Anglais :
37. Arntz, Melanie, Terry Gregory and Ulrich Zierahn (2016):
«The risk of automation for jobs in OECD countries: a comparative
analysis», OECD Social, Employment and Migration working Papers, n°
189, May.
38. Asimov, Isaac (1950). "Runaround". I, Robot (The Isaac
Asimov). New York City: Doubleday. p. 40
39. Australian Bureau of Statistics. (2013). Young adults:
Then and now. Australian social trends
40. Bamford, D., & Daniel, S. (2005). A case study of
change management effectiveness within the NHS. Journal of Change Management,
5(4), 391-406.
41. Beer, M., & Eisenstat, R. A. (1996). Developing an
organization capable of implementing strategy and learning. Human relations,
49(5), 597-619.
42. Burton, E., Goldsmith, J., Koenig, S., Kuipers, B.,
Mattei, N. and Walsh, T. Ethical considerations in artificial intelligence
courses.
43. Cogin, J. (2012). Are generational differences in work
values fact or fiction? Multi-country evidence and implications. The
International Journal of Human Resource Management, 23, 2268- 2294.
44. D. Gremillet, W. Puech, V. Garçon, T. Boulinier
& Y. Le Maho. (2012) Robots in Ecology - Welcome to the Machine Open
Journal of Ecology.
45. Deming D. (2015), « The growing importance of social
skills in the labor market », Harvard university and NBER,
46. Dianne Waddell, Amrik S. Sohal, (1998) "Resistance: a
constructive tool for change management", Management Decision, Vol. 36 Issue:
8, pp.543-548,
47. Dr Rupert Read (2016), Rise of the robots will harm
the Earth as well as humans
48. Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of
employment: how susceptible are jobs to computerisation? Technological
forecasting and social change, 114, 254-280.
49. Funk, M. Ethic Theory Moral Prac (2016)
50. Gonzalez, Carlos M. What's the difference between
industrial robots? Machine Design. Dec 2016, Vol. 88 Issue 12, p24
51. Guido Bugmann Mel Siegel & Rachel Burcin (2011): A
role for robotics in sustainable development?
52. Hultman, K. E. (1979). The Path of Least Resistance.
Preparing Employees for Change.
53. Joshi, A., Dencker, J. C., Franz, G., & Martocchio,
J. J. (2010). Unpacking generational identities in organizations. Academy of
Management Review, 35, 392-414.
54.
Page 107 sur 111
Kelly, K. (2012). Better than Human: Why robots will - and
must - take our jobs.
55. Lawrence, P. R. (1969). How to deal with resistance to
change. Harvard Business Review, 47(1), 4-6.
56. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep
learning. nature, 521(7553), 436
57. Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. (2015).
Cyber-physical systems architecture for industry 4.0-based manufacturing
systems. Manufacturing Letters, 3, 18-23
58. Lyons, S., & Kuron, L. (2014). Generational
differences in the workplace: A review of the evidence and directions for
future research. Journal of Organizational Behavior, 35, S139-S157.
59. Manuela Pardo del Val, Clara Martínez Fuentes,
(2003) "Resistance to change: a literature review and empirical study",
Management Decision, Vol. 41 Issue: 2, pp.148-155,
60. Marr, D. (1977). Artificial intelligence--a personal
view. Artificial Intelligence, 9(1), 37-48.
61. Mokyr, Joel, Chris Vickers et Nicolas L. Ziebarth (2015)
: « The History of technological anxiety and the future of economic
growth: Is this time different? », Journal of Economic Perspective, Vol.
29, No. 3, Summer, pp. 31-50.
62. Myers, K. K., & Sadaghiani, K. (2010). Millennials in
the workplace: A communication perspective on millennials' organizational
relationships and performance. Journal of Business Psychology, 25, 225-238
63. Nair C. (2011) Consumptionomics: Asia's Role in Reshaping
Capitalism and Saving the Planet. Willey.
64. Park, T. (2014). How we'll stereotype our robot
coworkers. Harvard Business Review.
65. Peiperl, M. (2005). Resistance to change. In N.Nicholson,
P. G. Audia, & M. M. Pillutula (Eds.), The Blackwell encyclopedia of
management (2nd ed., pp. 348-349) - Organizational behavior. Oxford:
Blackwell.
66. Piçarra, N., & Giger, J. C. (2018). Predicting
intention to work with social robots at anticipation stage: Assessing the role
of behavioral desire and anticipated emotions. Computers in Human Behavior, 86,
129-146.
67. Potter R. (2004) How to Compete with Offshore Low Labor
Costs: Employ Highly Skilled Labor at 30 Cents per Hour. (Robots 2004)
68. Ritta Baddoura & Gentiane Venture This (2015) : Robot
is Sociable: Close-up on the Gestures and Measured Motion of a Human Responding
to a Proactive Robot
69. Robot, U. K. (2001). History of Robotic. Retrieved from
the World Wide Web on, 9(16), 2002.
70. Schumpeter, J. A. (1939). Business cycles (Vol. 1, pp.
161-74). New York: McGraw-Hill.
71. Van Wynsberghe, A., & Donhauser, J. (2017). The
Dawning of the Ethics of Environmental Robots. Science and engineering
ethics, 1-24.
72.
Page 108 sur 111
Walker, H., & Phillips, W. (2008). Sustainable
procurement: emerging issues. International Journal of Procurement Management,
2(1), 41-61.
73. Winter, Richard P.; Jackson, Brent A. International
Journal of Human Resource Management. Oct2016, Vol. 27 Issue 17, p1997-2015.
19p
74. Xu, L. D., Xu, E. L., & Li, L. (2018). Industry 4.0:
state of the art and future trends. International Journal of Production
Research, 56(8), 2941-2962.
Table des matières
Résumé 2
Remerciements. 3
1. Introduction 5
1.1 L'évolution de la robotisation 5
1.2 Le concept de l'intelligence artificielle 8
1.3 Les enjeux de demain 11
1.4 Structuration du mémoire : 12
PARTIE THÉORIQUE 13
2. La robotisation au coeur d'une nouvelle
révolution industrielle. 14
2.1 L'industrie 4.0 15
3. Les enjeux de la robotisation dans l'industrie.
16
3.1 Le concept du développement durable 16
3.2 L'enjeu environnemental de la robotisation : 18
3.3 L'enjeu social de la robotisation: 19
3.4 L'enjeu économique : 19
Page 109 sur 111
3.5 Géopolitique de la robotique 20
4. Les apports positifs de la robotisation dans
l'industrie 22
4.1 L'aspect économique : 22
4.2 L'aspect Environnemental 25
4.3 L'aspect Social. 26
5. Les problèmes soulevés par la
robotisation 31
5.1 Des problèmes liés à une
non-acceptation sociale. 32
5.2 Les coûts liés à la mise en
place d'un parc robotique 39
5.3 Les robots : une menace potentielle pour
l'Environnement. 41
6. Pistes de solutions apportées par la
théorie 42
6.1 La perte de l'emploi. 42
6.2 Les robots sociaux. 43
6.3 Tirer parti de la résistance au changement 44
6.4 La montée en compétence et la montée en
gamme des métiers 45
6.5 Le besoin de renouvellement 46
6.6 La taxation de la robotique 46
6.7 Des éco-robots. 47
6.8 Des solutions économiques, et un pays tourné
vers la robotique 47
7. L'apport de la théorie dans la
problématique 48
PARTIE EMPIRIQUE 49
8. Contexte de l'étude empirique 50
8.1 Structure de l'entreprise : 51
8.2 Constats dans l'entreprise. 52
8.3 Les accidents du travail et cotisations dans l'entreprise.
53
8.4 Objectif de l'étude empirique 57
9. Méthodologie de recherche 57
9.1 Cadre Épistémologique 57
9.2 Choix de l'outil d'enquête : le guide d'entretien.
58
9.3 Réalisation de l'enquête 59
9.4 Méthodologie Qualitative 60
10. Résultats de l'étude : 61
10.1 La vision de la robotisation des individus de
l'entreprise : 61
10.2 Les aspects positifs : Les leviers de performance. 62
11. Les problèmes soulevés dans l'entreprise
Faurecia 66
11.1 La performance qualité : 66
11.2 L'aspect social et sécuritaire. 68
11.3 Des risques pour la sécurité 70
11.4 Le phénomène de résistance au
changement 70
12. Les solutions pour pallier aux problèmes
soulevés dans l'entreprise. 71
12.1 L'aspect économique. 71
12.2 L'aspect Social : 72
12.3 La montée en compétence. 73
Page 110 sur 111
CONCLUSION 77
Page 111 sur 111
13.1 Discussion, validité et qualité des
résultats. 79
13.2 Limite de l'étude : 80
13.3 Ouverture 81
ANNEXES 82
Bibliographie 104
Table des illustrations 111
Table des illustrations
Figure 1 : Gonzalez, Carlos M.Machine Design. Dec 2016, Vol. 88
Issue 12, p24 9
Figure 2 : Beitone, A. (2013). Chapitre 6 - Économie et
sociologie du développement.
Dans Economie, sociologie et histoire du monde contemporain
(pp. 283). 16
Figure 3 : Valeur du travail des générations Y
(Richard P. Winter p.2005) 30
Figure 4 : Compétence en numéracie des
différents pays selon l'enquête de l'OCDE -
Source journal LeMonde 33
Figure 5: Les couts des solutions robotiques (source :
humarobotics.com 39
Figure 6 : Répartition des accidents Faurecia
(réalisé par l'auteur) 53
Figure 7 : Localisation des accidants sur les trois
dernières années (réalisé par l'auteur) 54 Figure 8
: Suivi des accidents sur 3 ans dans l'entreprise Faurecia
(réalisé par l'auteur) . 55
Figure 9 : Cotisations encadrement. (Réalisé par
l'auteur) 56
Figure 10 : Cotisation employés. (Réalisé
par l'auteur) 56
| 


