|
|
Université Felix Houphoüet Boigny
d'Abidjan Cocody
|
|
|
UFR : Sciences de l'Homme et de la
Société Cote attribuée par la
bibliothèque
Année académique
2009-2010
Mémoire de Maîtrise
Option : Physique
ETUDE DES MILIEUX LAGUNAIRES ET PERI
LAGUNAIRES : CAS DES BAIES DE COCODY
ET DU BANCO DE 1955-2010
Présenté et soutenu par :
N'DOMAN Venceslas N'Chot Paul Richard
Directeur de mémoire : Docteur KRA Yao
2
DEDICACE
Au créateur du ciel et la terre, à la famille
N'DOMAN, pour leur affection, leur soutien.
3
Résumé
Cette maitrise intitulée « Etude des
milieux lagunaires et péri-lagunaires : cas des baies de Cocody et de
Banco 1955-2010 », présente une cartographie des
atteintes subies par ces baies et montre que le développement
socio-économique à une incidence négative sur les baies.
Pour mieux appréhender l'ensablement, la propagation de groupements de
végétaux et la dégradation des baies, nous nous sommes
fixés les objectifs suivants : analyser l'évolution des baies,
décrire l'organisation des différents géons
rencontrés et identifier les facteurs de comblements pour en
établir l'impact sur la population et sur l'environnement pour une
meilleure prise en compte des problèmes relatifs aux baies lagunaires.
Afin de répondre aux objectifs, nous avons utilisé les photos
satellites pour étudier le comblement et la méthode globale et
intégrée pour l'étude de la végétation. Les
résultats obtenus montrent que les baies se dégradent à un
rythme accéléré et les surfaces gagnées sur l'eau
sont colonisées par des herbacés.
Mots clés : Abidjan, lagune Ebrié, baie,
ensablement, pollution
4
TABLE DE MATIERE
DEDICACE 2
TABLE DES MATIERES 4
AVANT PROPOS .7
LISTE DES FIGURES 8
LISTE DES PHOTOS 9
LISTE DES TABLEAUX 10
LISTE DES ABREVIATIONS 11
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION GENERALE ET
METHODOLOGIE 12
INTRODUCTION 13
I-REVUE DE LITTERATURE ..14
1-La définition des milieux lagunaires ..14
2-L'ensablement 15
|
3-La pollution
II-PROBLEMATIQUE
|
16
17
|
|
CHAPITRE I : COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES
|
...20
|
|
I-LA COLLECTE DES DONNEES
|
20
|
|
1-La connaissance des milieux
|
20
|
|
2-Les documents écrits
|
20
|
|
II-LE TRAITEMENT DES DONNEES
|
21
|
|
1-Le traitement informatique
|
21
|
|
2-Mesure de la dynamique du plan d'eau
|
.21
|
|
CHAPITRE II : PRESENTATION DU CADRE GEOGRAPHIQUE
|
..23
|
|
I- TRAITS PHYSIQUES DU CHAMP D'ETUDE
|
...23
|
|
1-La géologie
|
23
|
|
2-La topographie et la géomorphologie
|
.23
|
|
3-Le climat et la végétation
|
24
|
|
4-La pédologie
|
25
|
25
25
25
26
26
27
27
29
5
II-LES TRAITS HUMAINS DE LA ZONE D'ETUDE .
1-Le peuplement et la population .
2-Les activités économiques ....
III-PRESENTATION DES SITES D'ETUDE
1-Le système lagunaire Ebrié
2-La baie de cocody
3-La baie du Banco
DEUXIEME PARTIE : ETUDE DE LA BAIE DE COCODY ET DE LA BAIE DU
BANCO
CHAPITRE I : ETUDE DE LA ZONE PERILAGUNAIRE DES BAIES DE
COCODY ET
30
DU BANCO
I- LES CARACTERISTIQUES MORPHOMETRIQUES DES BAIES DE COCODY
ET DU
30
30
34
39
1-Analyse topographique des berges de la baie de Cocody
2-Analyse topographique des berges de la baie du Banco
Conclusion ..
CHAPITRE II-LES CARACTERISTIQUES DU PLAN D'EAU
DES BAIES DE COCODY
40 40 40 42 44 44 46
48
49
ET DU BANCO
I-LE PLAN D'EAU DE LA BAIE DE COCODY
1-Séquences physionomiques du plan d'eau
2-La dynamique du comblement de la baie de Cocody entre1955-2010
II-L'ETAT DU PLAN D'EAU DE LA BAIE DU BANCO
1- Séquences physionomiques du plan d'eau
2-La dynamique du comblement de la baie du Banco entre 1955-2010
Conclusion
CHAPITRE III : LES MILIEUX DES BAIES DE COCODY ET DU BANCO
I-LES MILIEUX DE LA ZONE PERILAGUNAIRE DE LA BAIE DE COCODY ET
LEUR
49
49
53
ORGANISATION
1- Forêt dégradée sur sol sablo argileux
géon 1et 2
2-Végétation buissonnante sur sol sableux
géon 3 et 4
55
55
56
57
58
60
62
63
6
II-LES MILIEUX DE LA ZONE LAGUNAIRE DE LA BAIE DE COCODY
1- Les groupements de végétaux sur sable
2-Les milieux sur sol hydromorphe
III- LES MILIEUX DE LA ZONE LAGUNAIRE DE LA BAIE DU BANCO
1- Les groupements de végétaux sur sable
2-Les milieux sur sol hydromorphe géon 3 .
Conclusion ...
CHAPITRE IV-ETATS DE DEGRADATION DES BAIES : CAUSES ET
CONSEQUENCES
I-LES CAUSES ET CONSEQUENCES DE LA DEGRADATION DES BAIES DE
63
63
65
67
68
70
71 73 73 73
COCODY ET DU BANCO
1-L'urbanisation incontrôlée
2- Le manque d'équipements d'assainissement
3- Un réseau d'assainissement défaillant
4-La pollution
5-L'hydrodynamisme
6-Les activités économiques
II-LES CONSEQUENCES DE LA DEGRADATION DES BAIES
1-Les conséquences environnementales
2-Les conséquences de la dégradation des baies sur
la santé des populations
III-LES ACTIONS ENTREPRISES PAR L'ETAT
IVOIRIEN POUR DEPOLLUER LES
75
75
76
77
78
80
83
BAIES
1-Les initiatives antérieures à 2010 .
2-Le plan d'urgence des infrastructures urbaines
Conclusion
CONCLUSION ..
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
7
AVANT PROPOS
Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un programme de
recherche entrepris par le LAMINAT visant à faire l'inventaire des
paysages pour évaluer l'impact du développement
démographique et industriel de la ville d'Abidjan sur les baies
lagunaires.
Nous tenons à remercier le Docteur KRA Yao pour avoir
accepté d'encadrer ce mémoire et pour nous avoir
encouragés tout au long de cette étude. Nous remercions
également le Professeur HAUHOUOT Célestin pour avoir
initié l'UETIG qui a permis de me perfectionner en cartographie
numérique et pour m'avoir octroyé un stage au LATIG.
Cette étude a également reçu le soutien
du Docteur Eugène et du doctorant ASSOUMAN. Nous vous
réitérons nos sincères remerciements pour vos conseils.
Nous remercions AMAFFON Donald, N'DOMAN Junior, KONAN Asher,
YAO Anorld pour nous avoir accompagné lors de nos enquêtes de
terrain.
Toute notre sympathie et notre gratitude s'adressent
également à nos ami(e)s et collègues ESSAN Jean Baptiste,
LOGLO Clotaire, ELLOH Kablan, N'CHO Roméo, TIOTTE Ben, N'CHO Lionel,
ABBE Natasha, KOUAMENAN Priscille pour nous avoir si amicalement soutenus au
cours de la préparation de ce mémoire.
8
LISTE DES FIGURES
24 26 28 30 33 35 37
40
41
43
44
45 47 67 71
Figure 1 : Carte des altitudes du pourtour des baies de Cocody
et du Banco ..
Figure 2 : L'ensemble lagunaire ivoirien et son contexte
géologique
Figure 3 : Présentation des zones d'étude dans
le système lagunaire Ebrié
Figure 4 : Profil topographique de la berge Est de la baie de
Cocody .
Figure 5 : Profil topographique de la berge Est de la baie du
Banco
Figure 6 : Profil topographique de la berge Ouest de la baie
de Cocody
Figure 7 : Profil topographique de la berge Ouest de la baie
du Banco
Figure 8 : La baie de Cocody en 1955 .
Figure 9 : La baie de Cocody en 2010
Figure 10 : Colmatage de la baie de Cocody entre 1955-2010
Figure 11 : La baie du Banco en 1955
Figure 12 : La baie du Banco en 2010
Figure 13 Colmatage de la baie du Banco entre 1955-2010
Figure 14 : Occupation du sol dans le pourtour des baies de
Cocody et du Banco .
Figure 15 : Carte du modèle simplifié de la
circulation en lagune Ebrié
9
LISTE DES PHOTOS
49
50
51
52
52
53
54
54
Photo 1 : Vue générale de la baie de Cocody
Photo 2 : Géon 1 baie de Cocody
...
Photo 3 : Termitière grise
Photo 4 : Géon 2 baie de Cocody
Photo 5 : Litière incomplètement
carbonisée et des néophytions en arrière-plan
Photo 6 : Géon 3 baie de Cocody
Photo 7 : Fosse du géon 3 baie de Cocody
Photo 8 : Géon 4 baie de Cocody
Photo 9 : Cultures maraîchères et gramens en
avant plan et prophyse et kortodon en arrière-
55
56
57
57
58
60
61
61
63
65
66
66
67
67
68
69 69 72 72 72 72 74
plan
Photo 10 : Géon 5 baie de Cocody ..
Photo 11 : Géon 6 baie de Cocody ..
Photo 12 : Vue générale de la partie
comblée la baie du Banco
Photo 13 : Géon 1 de la baie du Banco
Photo 14 : Géon 2 de la baie du Banco
Photo 15 : Géon 3 de la baie du Banco
Photo 16 : Rhyzophora
Photo 17 : Reptation du talus jonchant le Lycée
Technique
Photo 18 : Glissement de terrain sur le versant de la
vallée d'Attécoubé
Photo 19 : Emissaire d'eaux pluviales dégradées
avant sa réhabilitation vers la caserne d'Agban
Photo 20 : Le thalweg de la vallée
d'Attécoubé
Photo 21 : Inondation du carrefour de l'Indénié
par les eaux pluviales
Photo 22 : Déchets flottants sur les eaux usées
carrefour de l'Indénié baie de Cocody
Photo 23 : Dépôts d'ordures sur le versant de la
vallée d'Attécoubé
Photo 24 : Déchets flottant sur la baie du Banco et
l'acadja en arrière-plan
Photo 25 : Décharge d'ordures sur la partie
comblée de la baie du Banco
Photo 26 : Culture de fleurs sur les berges de la baie de
Cocody
Photo 27 : Dépôts de ballots de sachets
plastiques sur la baie du Banco
Photo 28 : Construction d'une usine de chaussures sur la baie
du Banco
Photo 29 : Dépôts de véhicules usagers sur
la baie du Banco ..
Photo 30 : Des pêcheurs sur la baie du Banco
76
Photo 31 : Construction d'un bassin de rétention des
eaux de ruissellement
10
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1-Evolution de la superficie en hectare des baies de
Cocody et Banco entre 1955-
18 31 33 35 37 42 46
2004 ..
Tableau 2 : Tableau morphométrique de la
toposéquence de la baie de Cocody
Tableau 3 : Tableau morphométrique de la berge Est de
la baie de Banco
Tableau 4 : Tableau morphométrique de la berge Ouest de
la baie de Cocody .
Tableau 5 : Tableau morphométrique de la berge Ouest de
la baie de Banco
Tableau 6 : Evolution de la superficie de la baie de Cocody
entre 1955-2010 (en hectares)
Tableau 7 : Evolution de la superficie de la baie du Banco
entre 1955-2010 (en hectares)
11
LISTE DES ABREVIATIONS
ASECNA : Agence pour la Sécurité et la
Navigation Aérienne
CCF : Centre Culturel Français
CIAPOL : Centre d'Ivoirien Anti-Pollution
CNTIG : Centre National de Télédétection
et d'Information Géographique
IGT : Institut de Géographie Tropicale
IRD : Institut de Recherche et de Développement
Ha : Hectare
Hbts : Habitants
Km : Kilomètre
LAMINAT : Laboratoire des Milieux Naturels
PUIUR : Plan d'Urgence des Infrastructures Urbaines
SODEFOR : Société de développement de la
forêt
RCA : Rythme de comblement annuel
TEG : Taux d'évolution globale
12
PREMIERE PARTIE :
PRESENTATION GENERALE ET
METHODOLOGIE
13
INTRODUCTION
Les milieux lagunaires représentent 13 % de l'ensemble
des côtes du globe et se répartissent autour des différents
continents Tastet et al. (1994) citant (LANKFORD, 1977 ; NICHOELS
SALLEN, 1981 ; BIDET et al. 1982). En Côte d'Ivoire, ces milieux
s'étendent de la frontière ghanéenne à Fresco. Les
milieux naturels associés à cet ensemble lagunaire sont
aujourd'hui fortement dégradés à cause de la pression
humaine qui s'exerce sur ces milieux depuis des décennies. Bien que les
différents transferts successifs du développement urbain,
économique, politique, portuaire et industriel dominant de Grand-Bassam
à Bingerville ont participé à la
détérioration de cet écosystème. Les
premières atteintes physiques sur ces milieux ont été
perceptibles à partir des années 1970 P.Pottier et al
(2008). Le développement de l'agglomération d'Abidjan due
à l'ouverture du canal de Vridi en 1951 a provoqué une pression
humaine autour des baies, a eu une influence considérable sur l'espace
et crée des problèmes environnementaux qui sont encore
d'actualité. Ainsi notre thème intitulé : ETUDE
DES MILIEUX LAGUNAIRES ET PERI LAGUNAIRES : CAS DES BAIES DU BANCO ET DE COCODY
DE 1955-2010 montre que les autorités prêtent une
attention particulière à l'environnement et au cadre de vie des
populations. Cette présente étude va donc s'intéresser au
degré de comblement des baies, à sa situation environnementale et
aux différents problèmes qui minent ces milieux.
Cependant plusieurs spécialistes des questions
environnementales dont Anoh Paul (2001), Affian K. (2003), relayés par
la presse nationale, et des sites internet ont attiré l'attention des
autorités. Cet épineux problème qui défigure la
perle des lagunes sans qu'aucune mesure concrète ne soit entreprise pour
remédier à ce problème.
Ces différentes études nous ont permis de
prendre connaissance des différents problèmes qui minent ces
milieux et nous ont orientés sur la démarche à suivre.
Après la synthèse des ouvrages bibliographiques
relatifs à ce phénomène, nous allons localiser nos
différents sites d'étude dans le paysage abidjanais.
14
I- REVUE DE LITTERATURE
1 - La définition des milieux
l Les milieux lagunaires
Bertrand MILLET (1985) dit que les milieux lagunaires dans
leur immense diversité, ne font l'objet que de définitions
très générales, fondées sur quelques aspects
morphologiques communs et la permanence de certaines conditions dynamiques sur
tous les continents.
Les deux définitions suivantes apparaissent bien
représentatives de toutes les réflexions d'un grand nombre
d'auteurs :
"Une lagune : une dépression côtière
située au-dessous du niveau moyen des océans, ayant une
communication permanente ou temporaire avec la mer, mais isolée de
celle-ci par un cordon ou tout autre type de barrière littorale"
(D'après LANKFORD R.R., 1976).
"Un milieu lagunaire : un environnement dynamique particulier,
où différentes énergies interfèrent pour apporter
et répartir des sédiments terrigènes et marins. Le lieu
d'interférence de ces énergies avec le sédiment intervient
dans une tranche d'eau peu profonde qui se trouve partiellement fermée
par un cordon littoral, et ayant une communication
éphémère ou restreinte avec la mer à travers une
passe"(D'après PHLEGER F.B., 1960).
Si la "barrière littorale" est constituée d'une
bande de sédiments communiquant régulièrement avec la mer
au niveau de quelques "passes" (appelées aussi "graus" - "exutoires" ou
"émissaires") dont l'existence est conditionnée par le transit
sédimentaire le long du littoral. On parlera de "bassins lagunaires"
proprement dits, ou bien "d'étangs littoraux" (LEVY A.,1971) dans le cas
où les communications avec la mer sont plus épisodiques et
liées aux actions conjuguées des vents et des marées, ou
marées-tempêtes.
Cependant, la notion de "lagune" stricto sensu est donc
toujours associée à un type de relation avec la mer (lagunes
paraliques), par l'intermédiaire d'une "barrière" littorale
(appelée également "seuil" - "flèchet' - "cordon" - ou
"lido") dont la morphologie, déterminant le régime hydrologique
de ces milieux, est un des facteurs les plus importants qui conditionnent la
nomenclature lagunaire (SEYLER P, 1980).
Selon Jean-Pierre TASTET et al. (1994) la lagune
Ebrié n'échappe ni à ces définitions, ni à
ces origines :
- elle occupe un ensemble de dépressions d'origine
fluviale, dont le tracé est parfois guidé par la structure
tectonique du substrat continental ;
- elle est séparée du golfe de Guinée
par une barrière sédimentaire constituée de cordons
sableux parallèles d'âge holocène ;
15
- elle est en relation permanente avec l'océan depuis
1950 par le canal artificiel de Vridi et en relation
éphémère par la passe de Grand-Bassam, ré-ouverte
en 1987 alors qu'elle était fermée depuis 1972. Auparavant, cette
embouchure naturelle était en général ouverte chaque
année en période de crue et se refermait plus ou moins
régulièrement en étiage ;
- elle reçoit du continent trois fleuves (la
Comoé, la Mé et Agnéby), de petites rivières
côtières et des précipitations des bas plateaux.
l Les milieux de sédimentation
J.HERVIEW (1968), affirme qu'outre l'origine des
matériaux et l'agent de transport, il est nécessaire de prendre
en considération le «paysage », ce qu'à
l'échelle géologique on appelle parfois les milieux
générateurs. Ainsi à un milieu donné, doit
correspondre un ou plusieurs types de sédiments.
Bertrand MILLET (1985) dit que l'évolution
morphologique actuelle de ces milieux lagunaires semble plutôt être
conditionnée par un équilibre entre les deux dynamiques
principales qui s'y affrontent. A savoir : les processus de
sédimentation et les processus d'érosion, soit marins, soit
continentaux ; selon les régimes d'écoulement des eaux
continentales et des marées, ainsi que les influences des vagues et
courants littoraux.
2. L'ensablement
Jean-Pierre TASTET et al. (1994) affirme que les
sables proviennent directement des formations sableuses encaissantes (hauts
plateaux du Continental terminal, bas plateaux antéholocènes ou
cordons sableux holocènes), soit par remaniement à partir des
berges, soit par apport des rivières. Dans ce dernier cas, les
sédiments sableux à sablo-silteux se propagent dans la lagune.
C'est le cas, de l'Agnéby et des petits marigots qui débouchent
dans le fond des baies de la rive nord de la lagune Ébrié. Dans
le cas des baies de Cocody et du Banco, seule la rivière Banco
débouche encore sur la baie du Banco alors que la rivière
débouchant sur la baie de Cocody a quasiment disparu à cause des
émissaires d'évacuation des eaux de ruissellement et des eaux
usées.
E. ROOSE (2000) met en relation la pression
démographique et la dégradation du milieu, car il pense que
l'urbanisation crée des conditions favorables aux ruissellements.
ANOH P. (2001) ne dit pas le contraire. Pour lui, le
phénomène de colmatage des baies tire essentiellement son origine
des apports des eaux de ruissellement qui drainent vers les baies, des
quantités importantes de sables et de boues en provenance de
l'agglomération d'Abidjan.
16
P. POTTIER et al (2008) ne manquent pas de souligner que le
boom démographique dû à l'ouverture du canal de Vridi en
1951 est à mettre en corrélation avec l'urbanisation non
maitrisée qui s'en est suivie. La ville s'est agrandie sans les
équipements nécessaires à la préservation de
l'environnement. Sous l'effet de la pression humaine, les berges ont
été colonisées par des habitats précaires rendant
ces milieux très insalubres.
Selon les mêmes auteurs, des raisons hydrodynamiques
liées à la faiblesse des échanges entre les baies et le
canal lagunaire principal ne favorisent pas l'évacuation du sable.
A. LANUSSE (1987) citant (Lasserre, 1979 ; Durand et al.1982)
souligne que par leur situation géographique, aux confins des milieux
continentaux et marins, les lagunes côtières constituent des sites
privilégiés d'implantation et de développement des
activités humaines. Les pressions anthropiques qui s'y exercent alors
sont généralement très diverses, voire antagonistes
(pêche, agriculture, aménagement portuaire, pollution).Sous la
croissance démographique et le développement industriel, les
agressions polluantes des rejets urbains, industriels et agricoles tendent
à s'accroître d'année en année, mettant en
péril l'exceptionnelle productivité de ces
écosystèmes. Le milieu lagunaire devient le réceptacle
obligé de l'ensemble des déchets générés par
les activités humaines.
3-La Pollution
P. DUFFOUR et al (1994) affirment que la lagune Ebrié
est essentiellement touchée par trois types de pollutions. Ce sont : la
pollution chimique, la pollution organique et la pollution microbienne. Ceux-ci
ont cité Broche et Peshet (1983) qui ont constaté que le
développement des cultures agro-industrielles dans le bassin versant de
la lagune Ebrié avait un impact sur la qualité de ses eaux. Et
que les industries situées dans la zone d'Abidjan rejettent en lagune
plusieurs substances toxiques.
Aussi selon NEDECO (1981), cité par Dufour et al.
(op.cit), les rejets organiques de la population d'Abidjan aboutissent en
lagune par le réseau d'égouts, par les ruissellements, ou par
vidange de fosses septiques et latrines, entrainaient quant à eux une
charge quotidienne de 32 tonnes de demande biologique en oxygène.
Les travaux menés très tôt par Pages
(1975), ont souligné les niveaux inquiétants de la contamination
bactérienne des eaux lagunaires d'Abidjan. Ces premières
observations ont ensuite été confirmées par Lanusse
(1987), puis par Kouassi et al.(1990). Il ressort de ces analyses que,
les eaux de lagune Ebrié du secteur de la capitale économique
ivoirienne sont 500 fois plus chargées en E. coli et 70 fois plus
entérocoques que celles d'une zone estuarienne de
référence.
17
Par ailleurs, Affian (2003), souligne que la forte variation
des paramètres physico-chimiques au passage de l'étiage à
l'état de la crue et vice versa, constituait une condition propice
à la précipitation des métaux tels que le cuivre, le zinc,
qui peuvent s'incorporer plus tard aux sédiments pour en accroitre leur
niveau de pollution.
Plus récemment, Yao K. et al (2008) affirme
que les teneurs en plomb, cuivre et zinc de la fraction fine de sédiment
(< 63ìm) de la partie estuarienne de la lagune Ebrié ont
augmenté d'un facteur de 1,12, 1,44 et 1,92 respectivement, au cours de
ces deux dernières décennies. Cette croissance de la
contamination métallique est due à l'intensification des
activités urbaines, industrielles et agricoles.
II-PROBLEMATIQUE
L'agglomération d'Abidjan a connu une croissance
spectaculaire après le percement du canal de Vridi. En 1950, la
population abidjanaise était évaluée à 65000
habitants et repartie sur les communes du Plateau, de Treichville et
d'Adjamé. Son développement accéléré et
l'importance relative de sa croissance ont cumulé en 1973, 39% de la
population de la Côte d'Ivoire soit 790 000 habitants (Antoine et
al. 1987). En 2010, la population abidjanaise est
évaluée à plus de 5,6 millions d'habitants
accompagnée d'une croissance de l'espace urbain estimée à
3000 ha de surface (P. Pottier et al 2008). Les grands travaux
d'aménagement urbain entrepris dans les années 1970 ont
décimé la forêt dont les derniers témoins de son
existence sont les forêts du Banco et d'Adiopodoumé. A cela
s'ajoute l'impact des différentes opérations immobilières
entreprises un peu partout dans la ville. Les lotissements sauvages,
l'accroissement des activités qu'elles soient industrielles ou
ménagères.
Aussi, l'importance grandissante de la capitale
économique n'est pas sans conséquences sur l'environnement
aquatique. En effet, l'espace lagunaire et la circulation des eaux sont
modifiés par les grands travaux urbains. La qualité des eaux est
directement concernée par les rejets industriels et les apports d'eaux
usées. Ces travaux publics ont entraîné la modification des
rives, via la construction des voies de circulation, d'ouvrages
d'assainissement, de bâtiments et de logements.
En plus, les rives des baies urbaines sont de plus en plus
bétonnées. La transformation des berges a des
répercussions sur l'écosystème avec des modifications
locales de l'hydrodynamique et de la capacité biotique (Durand et al
1994).
18
Par ailleurs, la croissance de la population a
occasionné l'intensification des activités. Ces activités
ont provoqué l'augmentation de la quantité des déchets
rejetés dans la lagune. En effet, les études menées par le
CIAPOL en 1980 montrent que les rejets d'effluents organiques sont de l'ordre
de 30 g par jour (Dembélé O. 2001). La teneur de la charge
polluante mesurée dans les baies est fonction des types
d'activités qui ont lieu dans le pourtour des baies (Yao K. et al
2008).
Enfin, les études menées (ANOH Paul, 2001 ;
Patrick POTTIER et al ; 2008) montrent que les baies de la lagune
Ebrié ont perdu une partie de leurs surfaces si bien qu'elles
présentent de nouveaux visages (tableau 1).
Tableau 1-Evolution de la superficie en hectare du plan d'eau
des baies de Cocody et Banco entre 1955-2004
Années
|
1955
|
1970
|
1988
|
1998
|
2004
|
Banco
|
424.4
|
348.1
|
335.7
|
332.8
|
330.7
|
Cocody
|
195.5
|
161.1
|
152.1
|
146.5
|
139.4
|
|
Source : Anoh P. 2001, A. Kangah 2008, d'après
photo-interprétation
De tout ce qui précède, il s'agit pour nous
d'apprécier leur état actuel. En effet, le plan d'eau des baies
de Cocody et du Banco se colmate et une végétation s'est
développée sur les surfaces perdues. Autrement dit, la question
se pose de savoir si les baies de Cocody et du Banco ont connu une
évolution après les études menées par Anoh.
Quelle est la dynamique des baies de Cocody et du Banco ?
Comment s'organise l'occupation du sol dans le pourtour
lagunaire ?
Afin de répondre aux questions, nous nous sommes
fixés les objectifs suivants :
l Objectif général
L'objectif de cette étude est de contribuer à
la connaissance des problèmes auxquels sont confrontées les baies
urbaines pour une amélioration de l'environnement humain et naturel. En
effet, la croissance démographique et des activités
socio-économiques ont eu un impact sur le milieu naturel. Ainsi, notre
cadre de vie est affecté par des odeurs nauséabondes et par des
maladies parasitaires.
19
Pour mieux appréhender cette étude, nous nous
sommes assignés deux objectifs spécifiques.
l Objectifs spécifiques
Deux objectifs spécifiques sont affectés à
cette étude :
- Cartographier et mesurer la dynamique du plan d'eau des baies ;
-Identifier et décrire les milieux spécifiques aux baies.
? Hypothèses
De ces deux objectifs découlent les hypothèses
suivantes :
-Le plan d'eau des baies du Banco et Cocody sont en phase de
colmatage continu ; -Les unités végétales
spécifiques se développent sur les parties colmatées.
Dans le but d'atteindre nos objectifs et de vérifier nos
hypothèses de recherche, nous avons utilisé sur une
méthodologie que nous allons expliquer et présenter nos zones
d'études.
20
CHAPITRE I : COLLECTE ET TRAITEMENTS DES DONNEES
I-LA COLLECTE DES DONNEES
1-La connaissance des milieux
Afin de connaitre la configuration topographique des sites
étudiés et le sens des dynamiques, nous avons d'abord
procédé à une étude morphométrique des
baies.
L'étude morphométrique a consisté
à faire un levé topographique. Il s'agit de mesurer la
toposéquence par segment de 20 m. La mesure de pente est
effectuée à l'aide d'un clisimétre dont la valeur sera
donnée en pourcentage. Toutes les mesures obtenues sont
consignées sur une fiche morphométrique.
Vu l'emprise du bâti, une carte topographique du
pourtour des baies de Cocody et du Banco à l'échelle 1/20 000 a
été utilisé pour tracer le profil topographique de la
berge Ouest de la baie Cocody et des berges Est et Ouest de la baie du
Banco.
S'agissant de la structuration des milieux, des points
d'observation de la végétation dotés de fosses
pédologiques ont été disposées le long des berges.
Pour étudier cette végétation, nous nous sommes servis de
la méthode globale et intégrée pour réaliser une
étude statique. Cette étude a été
réalisée selon le degré d'hydromorphie de ces milieux.
Elle a consisté à faire l'examen du manteau
végétal, des arbres et des autres plantes qui recouvrent le sol.
Nous nous sommes par la suite intéressés à la description
du sol. Cette description a portée sur sa couleur, le degré
d'hydromorphie et les éléments granulométriques. Les
parties comblées des fonds de baies ont également fait l'objet de
la même opération.
Enfin, nous avons recensé aux activités humaines
susceptibles d'avoir un impact sur les baies.
2-Les documents écrits
Il s'agit de faire un inventaire de tous les documents
relatifs à ce sujet. Pour cela nous nous sommes inspirés de
toutes les publications susceptibles d'apporter une plus-value à notre
enquête. Pour mener à bien cette étude, les données
ont été recueillies dans des bibliothèques et des services
spécialisés.
La bibliothèque de l'IGT a été le cadre
de consultation de mémoires de maitrise et de thèses pour nous
familiariser avec la méthodologie de recherche. Pour les ouvrages
généraux et spécialisés nous nous sommes rendus sur
le site internet de l'IRD et au CCF.
21
II-LE TRAITEMENT DES DONNEES 1-Le traitement informatique
Pour mesurer l'évolution du plan d'eau des baies, nous
avons réalisé une étude diachronique. L'image satellite
2010 google earth et les données représentant l'état des
baies en 1955. Ces images ont été
géoréférencées, c'est-à-dire
délimité la zone d'étude par des coordonnées
géographiques. Cette conformité permettra de superposer les
photographies. Pour assurer cette superposition, les différentes couches
d'informations géographiques doivent avoir le même système
projection. La projection cartographique utilisée est le WGS 1984 UTM
zone 30 N. Le géoréférencement des images nécessite
le choix de quatre points d'ancrage remarquable permettant d'avoir une marge
d'erreur proche de zéro. Le fichier obtenu a été converti
en fichier TIFF.
Le logiciel ARCGIS a été utilisé pour le
calage des photographies satellites à l'aide de la carte topographique
et pour la digitalisation des contours des baies. Le calage a permis de mettre
les images à la même échelle afin de réaliser une
analyse spatiale des sites étudiés. Les résultats obtenus
ont permis de calculer les superficies des baies à ces
différentes dates. Une carte présenta le modèle
numérique du terrain (MNT) a été réalisée
par ce même logiciel par l'intermédiaire de son extension 3D
Analyst.
Le logiciel Adobe illustrator a été utilisé
pour la mise à jour des cartes. 2-Mesure de la dynamique du plan
d'eau
Elle concerne les opérations de géotraitements
sur une ou plusieurs bases de données. Ces traitements ont pour but de
rechercher des informations pour produire de nouvelles données. Les
calculs statistiques effectués ont porté sur les superficies. Ces
taux permettent de cerner l'évolution des baies à
différentes dates.
Le taux d'évolution global permet d'estimer
l'accroissement global des superficies des baies entre 1955-2010. Il s'obtient
par la formule suivante :
22
(SP2 - SP1) * 100
Tx =
SP1
Tx : taux d'évolution global , SP1 : superficie
à la date 1 , SP2 : superficie à la date 2.
Si Tx est positif, il traduit une extension de la baie. Si Tx
est négatif, cela exprime un recul de la baie.
A partir des superficies perdues, nous avons calculé le
rythme de comblement annuel des baies. Nous avons utilisé une
règle de trois.

RCA : rythme de comblement annuel , SP : superficie perdue
entre D2 et D1 , D1 : la date 1 , D2 : la date 2
D2-D1 SP
1 AN RCA
Cette méthodologie a été utilisée
pour apprécier la régression du plan d'eau des baies de Cocody et
du Banco et pour décrire la végétation recouvrant ces
baies.
23
CHAPITRE II : PRESENTATION DU CADRE GEOGRAPHIQUE
I-LES TRAITS PHYSIQUES DU CHAMP D'ETUDE
1-La géologie
La Côte d'Ivoire est formée de deux unités
de surfaces très inégales : un socle ancien qui couvre 97,5 % du
pays et un bassin sédimentaire secondaire et tertiaire qui forme une
mince frange littorale 2.5%. Le socle appartient au vieux bouclier
précambrien de l'Afrique de l'ouest. Les études
géochronologiques ont permis de distinguer un Archéen daté
de 3 000 à 2 300 millions d'années correspondant au cycle
orogénique dit Libérien et un Protérozoïque
inférieur et moyen ou Birrimien s.l. daté de 2 300 à 1 500
millions d'années et correspondant au cycle orogénique dit
éburnéen. Les formations libériennes affleurent dans
l'ouest du pays ; le Birrimien, lui, occupe la presque totalité du
territoire. Le bassin sédimentaire côtier, d'une superficie de 8
000 km2, ne représente que 2,5 % du territoire. Il se
présente sous la forme d'un croissant allongé qui épouse
un rentrant du golfe de Guinée, de part et d'autre d'Abidjan. Recouvrant
une zone de schistes et de granites éburnéens, il est
traversé d'Ouest en Est par une faille très importante qui a
reçu le nom « d'accident majeur de Côte d'ivoire ».
Cette faille sépare deux zones bien distinctes : au nord, une zone
où la couverture très faible atteint rarement 300 m
d'épaisseur ; au sud, un bassin profond dont le socle à la
verticale de la côte atteint 4 à 5 000 m de profondeur. Au nord de
l'accident, les sédiments, très peu épais, appartiennent
au Mio-pliocène continental. Au sud de l'accident, les parties profondes
ne sont connues que par des forages. L'histoire géologique du bassin
débute par le dépôt sur le socle antécambrien d'une
série continentale représentant la base du Crétacé
ou même le Jurassique supérieur et se termine par le
dépôt des formations plioquaternaires (Spengler et Delteil,
1966).
2 - La topographie et la géomorphologie
Au Nord des lagunes, s'étendent les formations
tabulaires argilo-sableuses du continental terminal, désignées
sous le nom de Hauts-plateaux, dont quelques rares témoins sont
conservés dans les îles.
Cet accident divise le bassin sédimentaire en deux
parties, un compartiment nord où le socle est peu profond (1.70 m. sous
Abidjan) et un compartiment sud dont la subsidence est certaine jusqu'au
Miocène au moins.
Le rejet de la faille majeure atteint 3 500 m vers Abidjan.
Cet accident n'est pas unique et il s'agit en fait d'un ensemble de
compartiments séparés par des failles de direction Nord-Sud.
24
Ces compartiments ont pu jouer de façon
indépendante au cours des âges (Spengler et Delteil, 1966).
Du point de vue géomorphologique, le continental
terminal constitue au Nord des lagunes, de hauts plateaux dont l'altitude varie
de 40 à 100 m. Entaillés par des vallées profondes, ces
plateaux sont limités par une véritable falaise sur la côte
nord des lagunes (fig. 1). (Spengler et Delteil 1966)
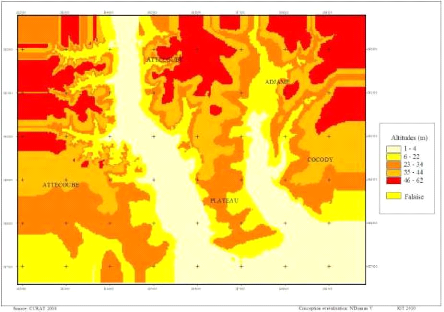
Figure 1 : Carte des altitudes du pourtour des baies de Cocody et
du Banco
3-Le climat et la végétation
La zone d'Abidjan appartient au domaine climatique
guinéen caractérisé par deux saisons des pluies, une
grande centrée sur juin et une petite plus courte, centrée sur
octobre. Ces saisons sont séparées par des épisodes non
pluvieux. La pluviométrie annuelle comprise entre 1 500 et 2 500 mm/an
(YAO Brou 2008) varie le long du littoral de la Côte d'Ivoire. La moyenne
annuelle de la température est de 26°C. Le déficit hydrique
est de l'ordre de 250 mm à 400 mm et l'évapotranspiration est de
1200 mm à 1300 mm (Bilé Eugène 2005). L'humidité
relative est constante toute l'année avec une moyenne de 80 à 85
%. Ce climat est
25
favorable au développement de la forêt dense
sempervirente de type équatorial (ADJANOHOUN, 1965 ; ADJANOHOUN et
GUILLAUMET, 1971).
4-La pédologie
Les sols sont essentiellement des sols ferralitiques fortement
désaturés. Ce sont des sols remaniés et appauvris issus de
la sédimentation de la plate-forme éburnéenne au
quaternaire, au tertiaire et au secondaire. Cette sédimentation est
faite de sédiments côtiers tout le long du littoral et de
sédiments argileux et sableux au nord des lagunes, avec des ilots de
grés ferrugineux et de graviers à certains endroits (Bilé
Eugène 2005). Des conditions édaphiques particulières
permettent le développement de formations hydromorphes (forêt
marécageuse et mangrove), respectivement dans les dépressions
humides, le bord des lagunes saumâtres ou des savanes littorales incluses
sur les cordons marins holocènes. Ces éléments naturels
favorisent l'altération des roches et l'élaboration des sols. La
masse des précipitations ne donnent lieu qu'à un
écoulement assez faible (ROUGERIE, 1960).
II-LES TRAITS HUMAINS DU CHAMP D'ETUDE 1-Le peuplement et la
population
La population d'Abidjan était estimée à
5.6 millions en 2010. Cette population est composite du fait du
caractère particulier de la ville d'Abidjan, capitale économique,
coeur de l'appareil politique et administratif de la Côte d'Ivoire qui a
attiré de nombreuses populations nationales et étrangères.
Cette migration a occasionné un peuplement rapide de la région,
qui initialement est la zone d'accueil des Ebrié et des Akyé
(Akan lagunaires) arrivés de l'actuel Ghana aux 17 siècles pour
s'établir dans cette région sur les bords de la lagune.
Aujourd'hui, l'on rencontre dans cette région toutes les ethnies de la
Côte d'Ivoire et toutes les nationalités étrangères
vivantes dans le pays.
Les Ebrié tout comme les Akyé, ont pu conserver
certains de leurs villages : Locodjoro, M'Badon, Agban, Anono,
Blokosso...(Ebrié) et Akeikoi, Agbékoi, Andokoi... (Akyé)
où ils pratiquent et observent encore les règles et leurs
coutumes sous le strict respect des lois et des règlements de la
République. Ces populations restent les maîtres des terres que
l'Etat reconnait aux communautés villageoises.
2-Les activités économiques
Les Ebrié ont une tradition de pêcheurs mais ils
pratiquent l'agriculture tout comme les Akyé et les populations
allochtones. Les techniques culturales sont traditionnelles :
26
Cultures itinérantes sur brulis avec des techniques
rudimentaires (manioc, banane plantain, cultures maraichères...) et des
cultures commerciales (Palmier à huile, cocoteraie, café,
cacao...) s'étendent sur plusieurs superficies. Outre l'agriculture et
la pêche, les autres activités économiques sont celles des
secteurs industriels, portuaires, commerciales et des services. Abidjan abrite
l'essentiel de l'appareil productif.
III-PRESENTATION DES SITES D'ETUDE
1-Le système lagunaire Ebrié
Les sites étudiés appartiennent au
système lagunaire Ebrié. Ce système forme un espace de
contact original entre l'océan et le continent, dont l'image est
indissociable aujourd'hui de celle du littoral de Côte d'Ivoire. Il
occupe en effet toute la partie orientale du pays, sur une distance de
près 300 km d'Est en Ouest et une surface de 1200 km2 et plus
de 1500 km de rivages (fig. 2).
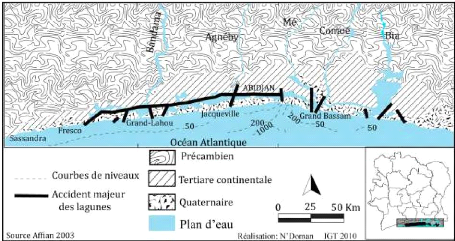
Figure 2 : L'ensemble lagunaire ivoirien et son contexte
géologique
Cet ensemble s'est formé à la faveur d'une
succession de dépressions lagunaires guidées par une structure
tectonique dont la faille des lagunes est l'accident majeur, à la fois
par sa disposition Est-Ouest et son rejet de 3 500 m par endroits (Tastet et
Guiral, 1994). Les eaux lagunaires sont séparées du golfe de
Guinée par un ensemble de cordons dunaires récents formés
à l'holocène, il y a moins de 10 000 ans. Cet ensemble lagunaire
est principalement
27
alimenté en eaux continentales par les fleuves du
Bandama dans sa partie Ouest et du Comoé dans sa partie Est.
L'ensemble associe plusieurs lagunes remarquables, toutes en
communications. Le canal d'Assagny relie la lagune de Grand Lahou (210
km2) ouverte à l'océan par l'embouchure du Bandama et
la lagune Ebrié (523km2), qui elle-même est ouverte aux
eaux marines par le canal de Vridi. Dans cette partie, la lagune Ebrié
est reliée par un canal naturel aux lagunes Aghien-Potou (43
km2), puis par le Comoé et le canal d'Assinie à la
lagune Aby et son prolongement aux lagunes Tendo et Ehy (425 km2).
Elles sont alimentées par le Bia et ouverte à l'océan
à Assinie Mafia. (Patrick Pottier et al 2008).
La lagune Ébrié possède de nombreuses
baies plus fréquentes sur sa rive nord que sur sa rive sud (VARLET,
1971). Elles représentent près du cinquième de la surface
du plan d'eau, soit 99 km2 sur 523 km2. Elles sont moins
importantes dans le tiers central du système lagunaire.
La zone urbaine lagunaire est limitée à l'Est
par la baie de Bingerville et à l'Ouest par la baie
d'Adiopodoumé. Mais les baies qui attirent notre attention sont celles
du Banco et de Cocody situées au coeur d'Abidjan (fig.3). Ces baies par
leurs positions figurent parmi celles qui présentent le plus d'atteintes
physiques.
2-La baie de Cocody
Située entre les communes de Cocody et du Plateau, la
baie de Cocody a pour coordonnées géographiques 5°20 de
latitude Nord et -4°01 de longitude Ouest. Elle est aussi limitée
au nord par la commune d'Adjamé, à l'Ouest par celle de Cocody et
à l'Est par la commune du Plateau.
3-La baie du Banco
La baie de banco a pour coordonnées
géographiques 5°21 de latitude Nord et -4°02 de longitude
Ouest. Elle est limitée par la commune d'Attécoubé sur sa
berge Nord -Ouest et la commune du Plateau au Sud-Ouest. Elle est aussi
limitée sur sa berge Est par la commune d'Attécoubé. Elle
est bordée par de nombreux quartiers tels que Bolibana, Mossikro, et le
village de Locodjro.
Après avoir présenté nos zones
d'étude, la seconde partie se propose dans une étude descriptive,
de mettre en évidence l'évolution du plan d'eau des baies de
Cocody et du Banco et d'étudier les principales caractéristiques
de la végétation.
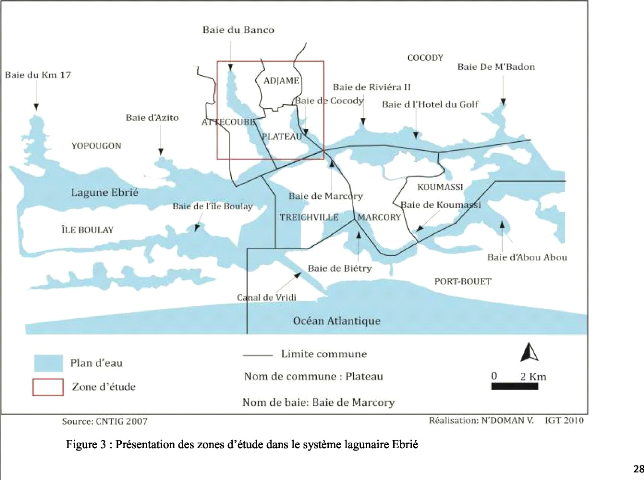
Rdlisa414,ri; N'DOMAN Y InT 201 a
Source: C[ T[G 2007
28
A
Plan d'eau
0 2 Km
Limite commune Nom de commune Plateau
None de haie; Baie de Marcory
Baie du Banco
COCODY
Baie De Isr arion
Baie du Km 17
Baie de Riviera []
Cocodyi Baie d 1.1-Eotel du Golf
Bale d'Azito
YOPOUGON
Lag-tine Ebrié
Este de l'i[e Iiou];iy
P'
TI,E BOULAYdie
illakriapipir
vommisr---Tar
Baie d'Abou Abou
PORT (c)GUET
Océan Atlantique
Figure 3 : Présentation des zones d'étude dans le
système lagunaire Ebrié
29
PARTIE II : ETUDE LA BAIE DE
COCODY ET DE LA BAIE DU
BANCO
30
CHAPITRE I : LA ZONE PERILAGUNAIRE DE LA BAIE DE COCODY ET DE LA
BAIE DU BANCO
Afin d'étudier la configuration topographique des
berges de la baie de Cocody et de la baie du Banco, nous avons effectué
des levés topographiques sur chacune des berges de ces baies.
I-LES CARACTERISTIQUES MORPHOMETRIQUES DE LA BAIE DE COCODY ET
DE LA BAIE DU BANCO
1-Analyse topographique des berges de la baie de Cocody
1-1-Morphométrie de la berge Ouest
Le levé topographique de la berge Est de la baie de
Cocody dont les résultats sont contenus dans l'annexe 2, nous a permis
de réaliser le profil suivant (fig. 4) et l'interprétation qui en
découle dans le tableau ci-dessous (tableau 2). La séquence
étudiée a une longueur de 270 m avec une dénivelée
de 17.99 m et une pente faible de 6.66% (tableau 2 et fig. 4). Elle se
subdivise en 7 facettes composées d'un infraèdre, d'un
métaèdre inférieure, d'un métaèdre moyen,
d'un métaèdre supérieur, d'un ectaèdre,
ectasupraèdre et d'un supraèdre (tableau 2).

H(m)
Source : Nos enquêtes terrain 2010
Figure 4 : Profil topographique de la berge Ouest de la baie de
Cocody
Les résultats issus de l'analyse des facettes
topographiques sont contenus dans le tableau 2
31
Tableau 2 : Tableau morphométrique de la
toposéquence de la berge Ouest baie de Cocody
|
Facettes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Infraèdre
|
Métaèdre inférieur
|
Métaèdre moyen
|
Métaèdre supérieur
|
Ectaèdre
|
Ecta- supraèdre
|
Supraèdre
|
|
Caractéristiques
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Développement (m)
|
60
|
130
|
24
|
18
|
22
|
8
|
8
|
|
Pente (%)
|
1
|
3.15
|
4.2
|
36.58
|
13.3
|
18.8
|
12.5
|
|
Dénivélée
|
0.4
|
4.1
|
1
|
6.58
|
2.92
|
1.5
|
1.49
|
|
Extension
|
14.8
|
45.94
|
8.88
|
6.66
|
8.14
|
2.96
|
2.96
|
|
Dynamique
|
Accumulative
|
Accumulative
|
Accumulative
|
Concave
|
Rectiligne
|
Rectiligne
|
Rectiligne
|
Source : Nos enquêtes terrain 2010
a- Le sommet Le sommet est composé d'une seule partie,
-Le supraèdre : Avec une pente moyenne de 12.5 %, il
s'étend sur 8m avec une dénivellation de 1.49 m. La pente est
évaluée à 12.5% pour une extension de 2.96%. Ayant une
forme rectiligne et inclinée sous l'effet de l'érosion, il porte
les stigmates de l'implantation humaine tels que les gravats et des
détritus d'origines végétales.
b- Le versant
Le versant s'étend sur 54 m et se subdivise en 3
parties : un ectasupraèdre, un éctaèdre et le
métaèdre supérieur.
-L'ectasupraèdre : Il s'étend sur 8 m avec une
dénivelée de 1.5 m. Sa pente est évaluée à
18.8% et son extension est de 2.96%. Il est peu abrupt avec une forme
rectiligne. On trouve aussi à sa surface des débris
végétaux et est recouvert d'une végétation
herbacée.
-L'éctaèdre : Il s'étend sur 22 m avec
une pente de 13.3% pour une dénivelée de 2.92 m et une extension
de 8.14%. C'est la zone de contact entre la végétation
herbacée et la partie défrichée. Elle a une surface
rectiligne et inclinée.
-Le métaèdre supérieur se
développe sur 24 m avec une dénivellation de 6.58 m pour une
pente de 36.58%, il a une extension de 6.66%. C'est la partie inclinée
et la pente la plus
élevée de notre toposéquence. Sa surface a
été totalement défrichée et sa forme est
convexe.
32
c- Le bas-fond
Le bas-fond est la partie la plus longue de notre
toposéquence avec une longueur de 172m. Elle se subdivise en 3 parties
dont :
- Le métaèdre moyen : Il se développe sur
24m avec une dénivelée de 1 m, la pente quant à elle est
évaluée à 4.2% et son extension est de 8.88%. C'est une
surface légèrement inclinée qui se situe au bas de la
pente et présentant une forme concave. Cette partie a été
également défrichée.
-Le métaèdre inférieur avec une
dénivelée de 4.1m, sa pente est évaluée à
3.15% et s'étend sur 20% de notre toposéquence. C'est un milieu
plus ou moins monotone présentant une surface ondulée à
cause des cultures maraichères. Il abrite des végétaux
recolonisant les finages déjà exploités.
-L'infraèdre s'étend sur 40 m avec une
dénivellation de 0.4 m, la pente est évaluée à 1%
et s'étend sur 14.8% de notre toposéquence. C'est un milieu
mouvant car elle est le milieu d'accumulation des produits de l'érosion.
C'est le siège des cultures maraichères mais au contact de la
lagune, la végétation d'herbacée devient plus compacte et
plus dense.
Pour une meilleure mise en évidence des formes
topographiques qui entourent les baies, nous avons réalisé des
profils topographiques à l'aide d'une carte topographique.
1-2-Morphométrie de la berge Est
La séquence étudiée a une orientation
NO-SE et s'étend sur 1420 m, de la commune du Plateau à la baie
de Cocody. La coupe transversale est rectiligne et discontinue (fig.5). Sur
cette coupe, on distingue un plateau composé de 6 facettes ; un talus
composé de 2 facettes et une plaine composée d'une facette
(tableau 3).
.

33
Source : Nos enquêtes terrain 2010
Figure 5 : Profil topographique de la berge Est de la baie de
Cocody
Les résultats issus de l'analyse des facettes
topographiques sont contenus dans le tableau 3.
Tableau 3 : Tableau morphométrique du pourtour Est de la
baie de Cocody
|
Facettes
Caractéristiques
|
Supraèdre Ecta
supraèdre
|
Ectaèdre
|
Ectaèdre-
métaèdrique
|
Métaèdre supérieur
|
Métaèdre Métaèdre
moyen inférieur
|
Métaèdre- infraédrique
|
Infraèdre
|
|
Développement
(m)
|
160
|
100
|
80
|
160 80 130
|
320
|
30
|
320
|
|
Pente (%)
|
1.88
|
4
|
2.5
|
7.15
|
0
|
6.15
|
8.13
|
3.33
|
0
|
|
Dénivelé (m)
|
3
|
4
|
8
|
12
|
0
|
8
|
26
|
1
|
0
|
|
Extension (%)
|
11.42
|
7.04
|
5.63
|
25.42
|
5.63
|
9.15
|
22.54
|
2.11
|
22.54
|
|
Dynamique
|
Rectiligne
|
Rectiligne
|
Concave
|
Rectiligne
|
Rectiligne
|
convexe
|
Rectiligne
|
concave
|
Rectiligne
|
Source : Nos enquêtes terrain 2010
a- Le sommet
Le sommet est essentiellement composé du
supraèdre.
-Le supraèdre : Avec une pente faible de 1.88%, il
s'étend sur 160 m avec une dénivelée de 3 m pour une
extension de 11.42%. Il a une forme rectiligne et légèrement
inclinée.
b- 34
Le versant Le versant s'étend sur 770 m et peut être
divisé en 6 parties
-L'ectasupraèdre s'étend sur 100m avec une
dénivelée de 4m. Sa pente est évaluée à 4%
et son extension est de 7.04%. Il a une forme rectiligne.
-L'éctaèdre s'étend sur 80 m, sa
dénivelée est de 2 m avec une pente 2.5%. Son extension est de
5.64 %. Il a une forme concave qui constitue un replat.
-L'ectaèdre métaèdrique : Son
développement est de 160 m, sa dénivelée est de 12 m pour
une pente de 7.5%. Son extension est de 11.42% et le versant a une forme
rectiligne et inclinée.
-Le métaèdre supérieur s'étend sur 80
m. Sa pente et sa dénivelée sont respectivement égale
à 0. Et son extension est de 5.63% et il a une forme rectiligne.
-Le métaèdre moyen se développe sur 130 m
avec une pente de 6.15% et une dénivelée 8 m. Il s'étend
sur 9.15% et a une forme convexe.
-Le métaèdre inférieur avec une
dénivelée de 26 m pour une pente évaluée à
8%, s'étend sur 22.54% de notre coupe. Il a une forme rectiligne et
inclinée.
c- Le bas-fond Le bas-fond s'étend sur 350 m et est
divisé en trois parties.
-L'infraèdre métaèdrique se développe
sur 30 m avec une pente de 3.33%, sa dénivelée est estimée
à 1 m pour une extension de 2.11%. Il a une forme recto-concave et est
traversée par une voie expresse.
-L'infraèdre se développe sur 320 m pour une pente
et une dénivelée nulle. Il correspond à 22.54% de la coupe
topographique. Il a une forme rectiligne.
2-Analyse topographique des berges de la baie du Banco 2-1-
Morphométrie de la berge Ouest
La coupe transversale est rectiligne et descend progressivement
vers la baie du Banco (fig. 6). Sur cette coupe, on distingue un plateau
composé de 6 facettes, un talus composé d'une facette et une
plaine composée d'une facette.
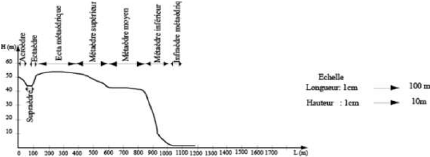
35
Source : Nos enquêtes terrain 2010
Figure 6 : Profil topographique de la berge Ouest de la baie du
Banco
Les résultats issus de l'analyse des facettes
topographiques sont contenus dans le tableau 4. Tableau 4 : Tableau
morphométrique du pourtour Ouest de la baie de Banco
|
Facettes
Caractéristiques
|
Acroèdre
|
Supraèdre
|
Ectaèdre
|
Ectaèdre-
métaèdrique
|
Métaèdre supérieur
|
Métaèdre Métaèdre
moyen inférieur
|
Métaèdre-infraédrique
|
|
Développement
(m)
|
50
|
50
|
30 300
|
190
|
200
|
130
|
150
|
|
Pente (%)
|
12.5
|
0
|
26.66
|
0.33
|
5.26
|
0.5
|
24.61
|
6
|
|
Dénivélée
|
6
|
0
|
8
|
1
|
10
|
1
|
32
|
9
|
|
Extension
|
4.2
|
4.2
|
2.5
|
25.42
|
16.9
|
16.9
|
11.01
|
12.71
|
|
Dynamique
|
Convexe
|
Rectiligne
|
Rectiligne
|
convexe
|
Recto-
concave
|
Rectiligne
|
Rectiligne
|
concave
|
Source : Nos enquêtes terrain 2010
a- Le sommet
Le sommet peut être subdivisé en trois parties dont
un acroèdre, un supraèdre, et un éctaèdre.
-L'acroèdre : Partie supérieure du sommet, il se
développe sur 50 m avec une pente faible de 12.5%. Sa
dénivelée est de 6m pour une extension de 4,2%; il a une forme
convexe : c'est versant d'un vallon
36
-Le supraèdre s'étend sur 50 m avec une
dénivelé, une pente est évaluée à 0 et son
extension est de 4.2%. Il a une forme rectiligne. C'est le fond de la
vallée.
-L'éctaèdre s'étend sur 30 m sa
dénivelée est de 8 m avec une pente moyenne 26.66%, son extension
est de 2.5%. Il a une forme rectiligne légèrement
inclinée.
-L'ectaèdre métaèdrique : Son
développement est de 300m, sa dénivelée est de1 m pour une
pente presque nulle de 0.33%, son extension est de 25.42 % et il a une forme
rectiligne et faiblement inclinée.
b- Le versant
Le versant est subdivisé en trois parties que sont le
métaèdre supérieur, le métaèdre moyen et le
métaèdre inférieur.
-Le métaèdre supérieur s'étend sur
190 m, sa pente est évaluée à 5.26% et sa
dénivelée est égale à 10 m, son extension est de
16.1%. Il a une forme rectiligne et inclinée.
-Le métaèdre moyen se développe sur 200 m
avec une pente presque nulle est de 0.5% et une dénivelée 1 m et
s'étend sur 16.9%. Il a une forme rectiligne.
-Le métaèdre inférieur avec une
dénivelée de 32 m, sa pente est évaluée à
24.61% et s'étend sur 11.01% de notre coupe. Il a une forme rectiligne
et fortement inclinée qui peut être décrite comme une
corniche.
c- Le bas-fond
Le bas-fond est composé de deux parties que sont
l'infraèdre métaèdrique et l'infraèdre.
-L'infraèdre métaèdrique se développe
sur 100 m avec une pente de 4%, sa dénivelée est estimée 4
m pour une extension de 5.88%. Il a une forme recto-concave et est
traversée par une voie expresse.
-L'infraèdre se développe sur 200m pour une pente
et une dénivelée nulle. Il correspond à 11.76% de la coupe
topographique et a une forme rectiligne.
37
2-2-Morphométrie de la berge Est
La coupe transversale est rectiligne et présente des
ondulations par endroit (fig. 7). Elle descend progressivement vers la baie du
Banco. Sur cette coupe, on distingue un plateau composé de 6 facettes,
un talus composé d'une facette et une plaine composée d'une
facette.

Source : Nos enquêtes terrain 2010
Figure 7 : Profil topographique de la berge Est de la baie du
Banco
Les résultats issus de l'analyse des facettes
topographiques sont contenus dans le tableau 5. Tableau 5 : Tableau
morphométrique du pourtour Est de la baie de Banco

Source : Nos enquêtes terrain 2010
a- Le sommet
Le sommet qu'on peut subdiviser en six parties, s'étend
sur 530 m.
-L'acroèdre supérieur : Avec une pente de 6%, il se
développe sur 100 m. Sa dénivelée est de 6m pour une
extension de 5.3%; il a une forme rectiligne.
38
-L'acroèdre moyen s'étend sur 100 m avec une
dénivelée de 4m et une pente est évaluée à
4% et son extension est de 9.4%. Il a une forme convexe.
-L'acroèdre inférieur s'étend sur 90 m. Sa
dénivelée est de 2 m avec une pente moyenne 1.88%, son extension
est de 8.8%. Il a une forme concave.
-Le supraèdre : Son développement est de 110m, la
dénivelée et la pente sont nulles. Son extension est de 7.64 % et
il a une forme rectiligne : c'est un replat.
-L'ectaèdre s'étend sur 50 m avec une pente de 4%,
sa dénivelée est 2 m pour une extension 10%. Il a une forme
rectiligne.
-L'ectaèdre métaèdrique se développe
sur 80 m, la pente et la dénivelée sont égales à 0.
Il a une forme rectiligne.
b- Le versant
Le versant a une longueur de 393 m et est divisé en 3
parties.
-Le métaèdre supérieur s'étend sur
50 m, sa pente est évaluée à 4% et sa
dénivelée est égale à 3 m, son extension est de
7.64% et il a une forme rectiligne et inclinée.
-Le métaèdre moyen se développe sur 300 m
avec une pente est de 1% et une dénivelée presque nulle 0.3 m. Il
s'étend sur 17.64% et il a une forme recto-convexe.
-Le métaèdre inférieur : avec une
dénivelée de 43 m sa pente est évaluée à
13.43% et s'étend sur 18.88% de notre coupe. Il a une forme rectiligne
et fortement inclinée qui peut être décrite comme une
corniche.
c- Le bas-fond
Le bas-fond comprend 2 parties et s'étend sur 400m
-L'infraèdre métaèdrique se développe
sur 50 m avec une pente de 6%, sa dénivelée est estimée 4
m pour une extension de 7.64%. Il a une forme recto-concave et est
traversée par une voie expresse.
-L'infraèdre se développe sur 350 m pour une pente
et une dénivelée nulle, correspond à 20.58% de la coupe
topographique. Il a une forme rectiligne.
39
Conclusion
D'une manière générale, la morphologie du
relief est moins élevée aux alentours de la baie de Cocody et est
plus marquée sur les berges de la baie du Banco. Ces baies sont
bordées de pentes raides sur ses côtes Est et Ouest sauf au
contact du chenal d'eaux usées de la baie de Cocody et à
l'embouchure de la rivière Banco. Mais, ces falaises mortes ont
été ramollies lors des différents travaux
d'aménagement de l'espace urbain. Aujourd'hui, ces escarpements sont
plus marqués sur la berge Est de la baie de Cocody et sur la berge Ouest
au Banco. On observe des ruptures de pente avec des dénivellations
oscillant entre 10 et 40 mètres.
.
CHAPITRE II-CARACTERISTIQUES DU PLAN D'EAU DES BAIES
DE
COCODY ET DU BANCO
Pour mieux appréhender l'état des baies de Cocody
et du Banco, une étude diachronique a été
réalisée sur ces baies.
I-L'ETAT DU PLAN D'EAU DE LA BAIE DE COCODY ENTRE 1955-2010
1-Séquences physionomiques du plan d'eau
1-1-La baie de Cocody en 1955
La figure ci-dessous montre l'état du plan d'eau de la
baie de Cocody en 1955 (fig. 8). A l'origine, cette baie était
bordée par une forêt de type équatorial. En 1955, elle
avait une superficie de 178.1 ha. Elle s'étendait sur 2.53 km de long
pour 911 mètres de large.

PLATEAU
ADJAME
COCODY
Source : Anoh, Kangah 2008 Réalisation N'Doman IGT 2010
40
Figure 8 : Le plan d'eau de la baie de Cocody en 1955

COCODY
PLATEAU
1-2-La baie de Cocody en 2010
L'interprétation ci-dessous montre l'état du
plan d'eau de la baie de Cocody le 28 janvier 2010 (fig 9). Aujourd'hui, elle
est presque arrivée au niveau du stade FHB avec des dépôts
de vases qui affleurent par endroits. On remarque aussi une extension de la
surface du café de Rome vers la tête de la baie. Les mesures
faites sur la surface du plan d'eau indiquent que le plan d'eau occupe une
superficie de 110.5 ha. Elle a une longueur de 1.7 Km pour une largeur de 847
m.
ADJAME

Source : Google earth 2010 Réalisation N'Doman IGT 2010
41
Figure 9 : Le plan d'eau de la baie de Cocody en 2010
42
2-La dynamique du comblement de 1955-2010
Le résultat de la superposition des photos satellites
de 1955-2010 (fig 10) et les chiffres du tableau permettent d'apprécier
le rythme de retrait des eaux de la baie de Cocody entre 1955-2010 (tableau 8).
On constate que le plan d'eau de la baie de Cocody a reculé et la berge
Ouest est plus ensablée que celle de l'Est.
Entre 1955 et 2010, la superficie du plan d'eau est
passée de 178.1 ha à 110.5 ha. Sur cette période, la baie
de Cocody a perdu 67.6 ha de sa superficie soit 37.95% de la superficie de
départ. Son plan d'eau a aussi reculé de 830 m sur sa longueur et
64 m de sa largeur. On remarque que la superficie du plan d'eau de la baie de
Cocody est en constante régression. On estime que la baie de Cocody perd
1.23 ha de sa superficie par année soit 0.69%. A ce rythme de
comblement, la baie de Cocody aura perdu la moitié de son plan d'eau en
2029 et aura disparu vers l'An 2101. Ainsi, depuis 1955, la terre continue de
gagner des surfaces sur la lagune. Les espaces libérés par l'eau
sont disposées en lambeaux et sont aujourd'hui perceptibles depuis le
Café de Rome jusqu'au stade Félix Houphouët Boigny.
Au vue de ces chiffres, nous pouvons affirmer que la baie de
Cocody s'ensable. Et ce phénomène est plus perceptible ces
dernières années. La baie de Cocody se colmate à un rythme
relativement rapide.
Après avoir observé ce phénomène sur
la baie de Cocody, qu'en est-il pour la baie du Banco ?
Tableau 6 : Evolution de la superficie de la baie de Cocody entre
1955-2010 (en hectares)
|
Années
|
Superficie
de la
baie 1955
en (ha)
|
Superficie
de la
baie 2010
en (ha)
|
Superficie
perdues entre
1955-2010 en
(ha)
|
TEG (%)
entre 1955-2010
|
RCA
(ha)
|
|
Cocody
|
178.1
|
110.5
|
67.6
|
-37.95
|
1.23
|
Source : Nos enquêtes terrain 2010

ADJAME
COCODY
PLATEAU
Source : Anoh, Kangah 2008, google earth 2010 Réalisation
N'Doman IGT 2010
43
Figure 10 : Colmatage du plan d'eau de la baie de Cocody entre
1955-2010
44
II-L' ETAT DU PLAN D'EAU DE LA BAIE DU BANCO ENTRE 1955-2010 1-
Séquence physionomique du plan d'eau
1-1-La baie du Banco en 1955
La figure ci-dessous présente l'interprétation
(fig 11) et l'étendue de la baie du Banco en 1955. A cette date, elle
s'étendait sur 390.7 ha et était bordée d'une forêt
tropicale. Elle s'étendait sur 5.35 Km de long pour 1.13 Km de large.
|
ATTECOUBE
ATTECOUBE
PLATEAU
|
Source : Anoh, Kangah 2008 Réalisation N'Doman IGT 2010
Figure 11 : Le plan d'eau de la baie de Cocody en 1955
45
1-2-La baie du Banco en 2010
La figure ci-dessous montre l'état du plan d'eau de la
baie du Banco le 28 janvier 2010 (fig 12). Les berges de cette baie sont
soumises à une forte pression anthropique. Elle mesure 4.92 km de long
et 965 m de large.

ATTECOUBE
PLATEAU
ATTECOUBE
Source : Google earth 2010 Réalisation N'Doman IGT 2010
Figure 12 : Le plan d'eau de la baie de Cocody en 2010
46
2-La dynamique du comblement entre 1955 et 2010
Le résultat de la superposition des photos satellites
de 1955-2010 (fig 13) et les chiffres du tableau permettent d'apprécier
le rythme de retrait des eaux de la baie du Banco entre 1955-2010 (tableau 7).
On constate que le plan d'eau de la baie du banco recule et que l'engraissement
gagne les deux berges.
Entre 1955 et 2010, la superficie du plan d'eau est
passée de 390.7 ha à 287.5 ha. Sur cette période, la baie
du banco a perdu 103.2 ha de sa superficie de 1955, soit une régression
globale de 26.41%. Son plan d'eau a aussi reculé 430 m sur sa longueur
et 170 m de sa largeur. On estime que la baie du Banco perd 1.87 ha de sa
superficie par année soit 0.48%. Au vue de ces chiffres, nous pouvons
affirmer que la baie du Banco s'ensable à un rythme relativement
important. En effet, la baie du Banco aura perdu la moitié de son plan
d'eau soit 195.35 ha en 2061 et aura disparu vers l'An 2165. Ainsi entre
1955-2010, la terre continue de manière constante de gagner des surfaces
sur la lagune. Les espaces libérés par l'eau sont
disposées en lambeaux et sont aujourd'hui perceptibles aux
débouchés des canaux d'évacuation et le long des quartiers
et des villages qui bordent cette baie.
Tableau 7 : Evolution de la superficie de la baie du Banco entre
1955-2010 (en hectares)
|
Superficie
de la
|
Superficies de la baie
|
Superficies
perdues entre
|
TEG (%)
|
|
|
Années
|
baie 1955
|
(ha) en
|
1955 -2010 en
|
1955-2010
|
RCA en (ha)
|
|
en (ha)
|
2010
|
(ha)
|
|
|
|
Banco
|
390.7
|
287.5
|
103.2
|
-26.41
|
1.87
|
Source : Nos enquêtes terrain 2010

ATTECOUBE PLATEAU
ATTECOUBE
47
Figure 13 : Colmatage du plan d'eau de la baie du Banco entre
1955-2010
48
Conclusion
Si l'on tient compte du TEG de la baie de Cocody de -37.95% et
de -26.41% pour la baie du Banco, nous pouvons affirmer que la baie de Cocody
et celle du Banco s'ensablent à un rythme relativement important. Mais
ce phénomène est plus perceptible sur la baie de Cocody. Au vue
de la variation négative du plan d'eau, on peut affirmer que la baie de
Cocody s'ensable plus rapidement même si la baie du Banco a plus perdu en
superficie que celle de Cocody sur cette période. Ce fait peut
être imputé à la rivière Banco qui charrie les
sédiments vers la baie.
L'ensablement de ces baies a libéré beaucoup
d'espace provoquant la naissance de nouveaux milieux. L'accroissement de ces
groupements de végétations est lié au degré
d'hydromorphie de ce milieu.
CHAPITRE III : LES MILIEUX DES BAIES DE COCODY ET DU
BANCO
I-LES MILIEUX DE LA ZONE PERILAGUNAIRE DE LA BAIE DE COCODY ET
LEUR ORGANISATION
La végétation qui s'est développée
sur la partie comblée de la Baie de Cocody est composé dans son
ensemble d'herbacé. Elle est pauvre en arbres et on note la
présence d'ilots bananiers par endroit (photo 1).
|
La végétation essentiellement composée
d'herbacée s'est développée dans ce
marécage
|
49
Photo 1 : Vue partielle de la baie de Cocody (cliché :
N'Doman V.2010)
1- Forêt dégradée sur sol sablo argileux du
géon 1 et 2 1-1-Description du géon 1
Le géon 1 se trouve au sommet de la falaise (photo 2). Il
se compose d'une variété de végétaux (annexe 2). On
note une strate arbustive et une strate herbacée.

50
Photo 2 : Géon 1 baie de Cocody (cliché :
N'Doman V.2010)
Le premier géon se compose de bananiers par endroits et
d'arbustes. La strate herbacée est constituée d'herbes, de
chromolaina (Sékou Touré) et d'herbacées rampantes
à forte densité. On note la présence de termitière
grise (photo 3).

51
Photo 3 : Termitière grise (cliché : N'Doman
V.2010)
Au sommet de la falaise, le sol peut être
subdivisé en 6 strates.
La première strate est épaisse de 3cm. On
distingue une mince couche de grains de quartz enrobés d'une pellicule
humifère, sous une végétation d'herbacée touffue,
avec des débris organiques et plastiques ; on passe très
rapidement à l'horizon suivant.
La seconde strate qui s'étend sur 10cm est
composé d'un horizon brun plus ou moins foncé, et humifère
suivant l'état de dégradation de la végétation
naturelle ; très sablo-argileux, a structure particulaire ; les
radicelles très denses n'arrivent même pas à empêcher
le sable de couler dans la fosse. Les grains de quartz très grossiers
sont assez peu liés par les matières organiques composées
de débris organiques et plastiques.
La troisième couche argilo-sableuse qui a une couleur
brune s'étend sur 17 cm. Cette couleur est influencée par de la
matière organique. Elle comporte un système racinaire dense et
porte des traces de débris plastiques.
Sur 30cm, on trouve un horizon ocre présentant des
faces géométriques lors des prélèvements fait
l'aide à de l'herminette. Elle est caractérisée par
l'absence de racinaire du système.
La dernière strate s'étend sur 40 cm. C'est un
horizon qui a une couleur rouge. Et comme la précédente, se
caractérise par l'absence de racinaire du système.
1-2-Description du géon 2
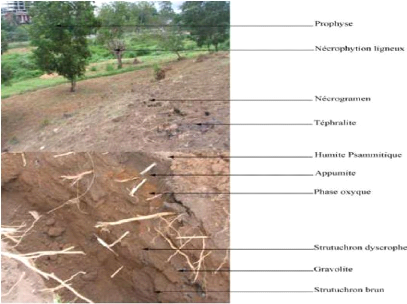
Photo 4 : Géon 2 baie de Cocody (cliché :
N'Doman V.2010)
Le géon 2 est un milieu ouvert dominé par
l'aréophyse à plus de 85% (photo 4). Il porte les stigmates de
l'implantation humaine (annexe 3). Car la plupart des prophyses ont
été plantés par l'homme et le récent
défrichement permet d'affirmer que l'homme y mène une
activité intense (photo 5).
|
Ces résidus montrent l'intensité des
activités humaines sur les berges de la baie de Cocody.
|
52
Photo 5 : Litière incomplètement carbonisée
et des néophytions en arrière-plan (cliché : N'Doman
V.2010)
53
Le sol de ce versant peut être divisé en 4
strates. Ce sont l'humite psammitique, l'appumite, le structuchron dyscrophe,
et le structuchon brun. On peut y trouver des cailloux de grès
ferrugineux (diamètre de 5 à 15 cm). La présence d'oxyde
de ferralitique peut être associée à la dalle de fer
trouvée un peu plus bas.
2-végétation buissonnante sur sol sableux
géon 3 et 4
2-1-Description du géon 3
Ce géon (Photo 6) se singularise par une
végétation buissonnante essentiellement dominée par les
nanophytions et les pénéphytions et les gramens (annexe 4).
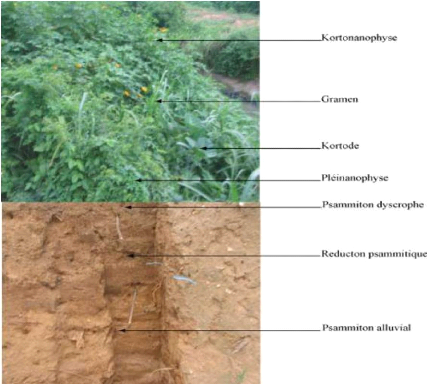
Photo 6 : Géon 3 baie de Cocody (cliché :
N'Doman V.2010)
C'est un milieu en reconstitution car il correspond à
une jachère. Cette fosse a une profondeur de 115 cm. La présence
de psammiton éluvial (photo7) montre que ce milieu est milieu mouvant
c'est-à-dire un milieu en perpétuel renouvellement. Aussi, cet
horizon présente une
couleur ocre -grise témoignant de la faible teneur de la
matière organique. Au contact de la nappe, on a une couleur grise
foncé à texture limoneuse : la mélanumite.
|
L'eau apparait après la découverte de la
mélanumite
|
54
Photo 7 : Fosse du géon 3 baie de Cocody
(cliché : N'Doman V.2010)
2-2-Description du géon 4
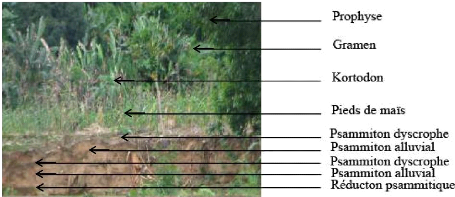
Photo 8 : Géon 4 baie de Cocody (cliché :
N'Doman V.2010)
Cet ensemble est essentiellement composé des pieds de
maïs (photo 8), de bananiers, de gramens, d'une végétation
buissonnante. Mais la surface est surtout utilisée pour les cultures
maraîchères (photo 9). Ces espaces mis en valeur sont des milieux
riches car le retrait de l'eau favorise des dépôts
d'éléments nutritifs permettant le développement des
cultures (annexe 5). Ici, le sol ne présente aucune cohérence. Le
passage d'une strate à l'autre ne
présente aucune trace d'évolution
pédogénétique. En effet, les différents horizons
correspondent aux dépôts sédimentaires engendrés par
l'érosion.
|
Des cultures maraichères sont cultivées sur les
surfaces gagnées par la terre.
|
55
Photo 9 : Cultures maraîchères et gramens en avant
plan et prophyse et kortodon en arrière-plan (cliché :
N'Doman V.2010)
II-LES MILIEUX DE LA ZONE LAGUNAIRE DE LA BAIE DE COCODY 1-Les
groupements de végétaux sur sables
Ce géon correspond au levé de berge. Cet
ensemble est essentiellement composé de deux strates : une strate
arborescente représentant moins de 1% de ce paysage. Ce sont des
prophyses monoïdes dans la plupart des cas. Et une strate herbeuse,
composée de gramons pouvant atteindre une hauteur de 1.2m et des
pénéphytions (photo 10). Ces deux groupements de
végétaux représentent 80 à 90% de cette
végétation.
Son sol est identique à celui du géon 3 à
la différence qu'ici l'eau se trouve à environ 40 cm de
profondeur.
|
La surface comblée est un cadre favorable au
développement des gramens et les pénéphytions
|
56
Photo 10 : Géon 5 baie de Cocody (cliché :
N'Doman V.2010)
2-La végétation sur sol hydromorphe
Au niveau de ce géon (photo 11), le recouvrement
herbacé est très vaste et couvre la majeure partie de la surface.
Certains gramens atteignent 1.5m de hauteur sur la berge Est. C'est une
végétation ouverte unistratifiée dont le recouvrement
s'intensifie lorsqu'on se rapproche du plan d'eau. Cependant, on note la
présence de nombreux lots de Kortodons (bananiers) et de kortode
crassulescente sur toute l'étendue de cette de surface. Ils ont
généralement poussés en touffes ce qui leur donne un
aspect discontinu sur tout le long de cette surface. Quand l'on avance à
l'intérieur de ce milieu, on observe la présence isolée de
quelques pieds de mil. La présence de ceux-ci dans ce milieu prend en
compte leur capacité de propagation. Ici, on peut aisément
retenir deux modes de dissémination passive qui sont
l'anémochorie et l'hydrochorie. Cependant, le mode de
dissémination le plus probable est l'hydrochorie.
Il existe aussi une strate arbustive mais celle-ci n'est pas
représentative. Le prophyse monoïde dominant est
l'indépendance ou le parasolier. La caractéristique principale de
ce milieu est hydromorphie. L'eau se trouve à fleur de sol.

Photo 11 : Géon 6 baie de Cocody (cliché :
N'Doman V.2010)
III- LES MILIEUX DE LA ZONE LAGUNAIRE DE LA BAIE DU
BANCO
D'une manière générale, la strate
arbustive n'est pas riche par contre le recouvrement herbacée
très vaste, couvre une grande partie de la surface et s'intensifie
lorsqu'on se rapproche du plan d'eau (Photo 12).
|
Cette photo présente le développement de la
végétation sur la partie comblée
|
57
Photo 12 : Vue partielle de la partie comblée la baie
du Banco (cliché : N'Doman V.2010)
58
1-Les groupements de végétaux sur sables
1-1 Description du géon 1
Nos premiers relevés ont été
effectués à 10 m de l'autoroute du Nord sur la berge Est (photo
13), la végétation de cette partie de la baie se présente
sur deux facettes : une facette anthropique et une facette naturelle (annexe
6).

Photo 13 : Géon 1 de la baie du Banco (cliché :
N'Doman V.2010)
La facette naturelle peut être divisée en deux
strates : une strate supérieure et une strate inférieure.
La strate supérieure est essentiellement constituée
de paliphyse pour la plupart des arbres
59
fruitiers comme le manguier et le pommier, de monophyse comme
le cocotier et le palmier, des kortodon et des gramon.
La strate inférieure est composée de gramen qui
regroupe de l'ensemble des végétaux herbacés, des
pénéphytions comme le chromoclaïna plus connue sous le nom
de Sékou Touré. Les éléments qui composent le sol
de cette partie de la baie se répartissent sur 3 niveaux. Pour une
épaisseur de 9 cm, la première couche est essentiellement
composée de sables fins où l'on peut percevoir un intense
système racinaire.
La deuxième couche s'étend sur 10 cm, c'est une
couche d'argile plastique faiblement humide avec un faible système
racinaire et des débris végétaux.
La troisième couche a une épaisseur de 4 cm et
un mélange d'argile, de sables, de matières organiques et de
toutes sortes de débris.
La dernière couche s'étend sur 5 cm et contient de
l'argile et du sable.
1-2-Description du géon 2
Le géon 2 se trouve dans la partie centrale de la zone
comblée. Les pénéphytions et les kortodon sont discontinus
sur toute l'étendue de cette surface (annexe 7). Le caractère
discontinu montre que ces espèces naissent de manière
spontanée. Ici, la formation végétale dominante est le
gramen. Il couvre la majeure partie de cette surface. Il a une structure
gazonnante qui s'intensifie à l'approche du plan d'eau. Sur cette partie
de la baie, le sol est plus consolidé et peut être
subdivisée en cinq couches (photo 14). Ici, la présence de
Reducton à la troisième et à la cinquième couche de
terre est due à une accumulation des sédiments charriés
par les eaux de ruissellement.

60
Photo 14 : Géon 2 de la baie du Banco (cliché :
N'Doman V.2010) 2-Les végétaux sur sol hydromorphe
géon 3
Au contact du plan d'eau, sur une zone délimitée
par la vase, on observe une stratification arborée et une stratification
herbeuse (annexe 8). La strate arboré, homogène, peu
élevé et dense avec un sous-bois qui n'est pas riche en grandes
herbes et dominées par des racines échasses. La strate arbustive,
essentiellement composée de roseaux, est une caractéristique des
mangroves (photo 16). Ils sont d'autant plus nombreux que le niveau
d'engorgement du sol est important. Le sol troué de flaque d'eau est
couvert de débris végétaux et plastiques et de salade
d'eau douce avec une strate herbeuse pouvant atteindre 90 cm (photo 15).

61
|
Photo 15 : Géon 3 de la baie du Banco (cliché
: N'Doman V.2010)
|
|
|
La présence de Rhyzophora racemosa montre le
développement d'une mangrove sur la surface comblée
|
|
Photo 16 : Rhyzophora racemosa (cliché : N'Doman
V.2010)
|
|
62
Conclusion
Bien que les baies de Cocody et du Banco ne soient pas en
communication, il faut noter la similarité des sédiments et de
certains végétaux qui composent ces baies. Hormis le
développement des cultures maraichères et floristiques qui se
développent sur leurs berges, la strate herbeuse couvre la majeure
partie de la surface. Mais, il faut noter que la couche herbeuse
présente une physionomie différente selon la baie et le
degré d'hydromorphie. Ainsi sur la baie du Banco, les gramens ont une
structure gazonnante alors que sur la baie de Cocody, les gramens ont un aspect
vernissant à feuilles longues et étroites. C'est une
végétation ouverte pouvant présenter deux strates dont le
recouvrement s'intensifie au contact du plan d'eau. Si les
végétaux herbacés se rencontrent à l'état
spontané, il faut noter que la présence de certains arbres
fruitiers comme le manguier dans ces zones n'est pas le fait du hasard. Ils ont
été soumis à la dissémination passive par
l'hydrochorie du fait des eaux ruissellements. Nous observons la
présence de palétuvier sur les berges Ouest et Est de la baie du
Banco et dans la partie centrale de la baie de Cocody montre que la mangrove
tente de coloniser ce milieu qui est propice à son développement.
Des conditions édaphiques particulières permettent le
développement de formations hydromorphes.
Le sol de ces baies sont essentiellement composés de
psammiton. Les sédiments convoyés ont une texture variable depuis
l'argile plastique, jusqu'au sable fin ou grossier graveleux.
Ces baies présentent des signes de dégradation.
Quelles en sont les causes ? Et quelles en sont les conséquences ?
|
Photo 17 : Reptation du talus jonchant versant du Lycée
Technique (cliché : N'Doman V.2010)
|
3
|
CHAPITRE III : LA DEGRADATION DES BAIES : CAUSES
ET
CONSEQUENCES
I-LES CAUSES DE LA DEGRADATION DES BAIES DE COCODY ET BANCO 1-
L'urbanisation incontrôlée
L'agglomération d'Abidjan a connu une croissance
spectaculaire depuis les années 1950. Alors qu'elle comptait 48000
habitants au recensement de 1946, sa population a atteint 350 000 habitants en
1965, a dépassé le million d'habitants en 1975 pour ensuite
poursuivre sa progression à un taux de croissance annuel estimé
à 10% jusqu'au début des années 1980 P. Pottier et al
(2008). Aujourd'hui, l'essor démographique s'est infléchi
atteignant 3 à 6 % l'an et la population urbaine est estimée
à plus de 5,6 millions d'habitants. C'est le miracle économique
ivoirien qui a orienté un flux migratoire en provenance de toutes les
régions encore très agricoles et aussi la population des pays de
l'Afrique de l'Ouest et au-delà (on estimait à 50 000 le nombre
de français résidant en Côte d'Ivoire en 1983). A la suite
du déplacement massif de la population française du aux
événements de Novembre 2004, la population française est
estimée à 15000 hbts.
La ville d'Abidjan concentre aujourd'hui plus de 20% de la
population du pays. Elle a enregistré depuis trente ans un accroissement
continu équivalent à 100 000 habitants l'an. Cet essor est
accompagné d'une croissance de l'espace urbain qui est passée
successivement de 3000 ha de surface en 1965, à 8000 ha en 1975 et
à plus de 60 000 ha en 2005. En effet, nous avons observé
l'accroissement des surfaces bâties (fig 14). L'observation des photos
satellites ont permis de remarquer l'agrandissement des quartiers
précaires sur les versants et les interfluves au niveau du zoo d'Abidjan
et de nouvelles maisons à proximité d'une vallée non loin
de Coco-Service entre 2002 et 2010. En plus, l'interprétation des photos
satellites de Google earth sur cette période, ont montré une
augmentation du nombre de maison construites sur l'interfluve qui supplante la
berge Est de la baie du Banco.
Aussi, remarque-t-on une reptation non loin du monument des
Martyrs, sur la falaise jonchant le lycée Technique d'Abidjan Cocody
(Photo 17).
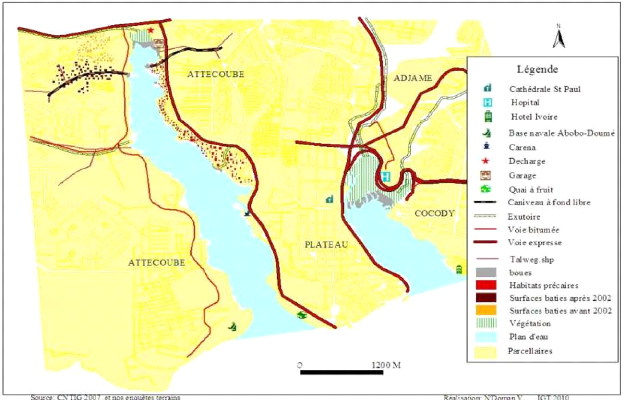
64
Figure 14 : Occupation du Sol dans le pourtour des baies de
Cocody et du Banco
Cette reptation est causée par les populations
environnantes qui ont des activités agricoles qui fragilisent la
falaise. Ce phénomène est aussi perceptible sur les versants de
la vallée d'Attécoubé derrière le sanctuaire
Mariale. Cette vallée étant en communication avec la baie du
Banco (Photo 18), les sédiments provenant de ces versants y sont
charriés.

Les matériaux issus de la dégradation de ces
versants sont directement acheminés vers les baies de Cocody et du
Banco.
65
Photo 18 : Glissement de terrain sur le versant de la
vallée d'Attécoubé-Gbébouto (Cliché :
N'Doman V.2010)
Enfin, les terrassements effectués dans les quartiers
de Cocody peuvent être mis en corrélation avec l'ensablement des
baies. En effet, les équipements tels que les caniveaux et les
égouts etc. n'ont pas suivis l'évolution de la ville d'Abidjan.
Développer dans un contexte qui reste malgré tout celui d'un pays
en développement manquant cruellement de moyens financiers
nécessaires pour endiguer une croissance exceptionnelle par son ampleur,
la ville d'Abidjan s'est construite sans les équipements indispensables
(P. Pottier et al, 2008).
2-Le manque d'équipements d'assainissement
Une analyse de la nature des dépôts qui composent
les espaces gagnés par la terre dans les différentes baies,
permet d'affirmer que les sédiments qui obstruent les baies urbaines de
la lagune Ebrié sont des sables et des boues en provenance de
l'agglomération d'Abidjan et des falaises environnantes. Ces
sédiments sont entrainés dans les baies par les émissaires
d'eaux pluviales qui aboutissent pour la plupart dans les baies urbaines. Ce
sont les eaux pluviales (1900 mm par an) et les eaux de ruissèlement qui
contribuent le plus à l'engraissement des baies. En effet, on rencontre
encore dans la ville d'Abidjan de nombreux caniveaux non cimentés, c'est
le cas de l'exutoire qui est situé le long de la route Abobo-Zoo
66
dont l'extrémité est située
derrière le quartier Plateau-Dokoui. Quand ceux-ci sont cimentés,
on rencontre une dégradation avancée des émissaires dont
les plus marquants sont situés au niveau du quartier HMA, au niveau du
camp de Gendarmerie Agban (Photo 19) et derrière le district de Police
d'Adjamé.

Photo 19 : Emissaire d'eaux pluviales dégradées
avant sa réhabilitation vers la caserne d'Agban (cliché :
N'Doman V.2010)
Photo 20 : Le thalweg de la vallée
d'Attécoubé (cliché : N'Doman V. 2010)
La dégradation des caniveaux et les caniveaux
à fond libre favorisent l'ensablement des baies de Cocody photo 19 et
Banco photo 20.
Au niveau, du caniveau qui part des Deux plateaux passant par
Cocody Danga, la construction de la digue située derrière la
cité SODEFOR a permis d'atténuer ce phénomène.
Mais, la composition argilo sableuse de la falaise de la berge occidentale
favorise encore le phénomène à cause des pratiques
culturales. Outre cela, l'on peut ajouter l'ampleur des fossés
creusé par l'érosion du aux eaux de ruissellement (Photo 18 et
20) et du phénomène de reptation donne une idée de
l'ensablement aux débouchés des émissaires. La pression
qu'exerce la ville sur son environnement, est par conséquent partout
préoccupante. Elle devient exceptionnelle sur les berges qui sont
concernées par la pollution. Elle est particulièrement sujette
aux pressions humaines les plus dégradantes (habitats précaires,
latrines, dépôts d'ordures et émissaires naturels et
industriels charriant les eaux usées) étant donné que la
règle la plus fréquente étant le rejet dans le milieu
naturel en occurrence la lagune.
3- Un réseau d'assainissement défaillant
L'ampleur et la rapidité du développement urbain
de la Côte d'Ivoire, conjugués aux manques de moyens financiers,
ont eu un impact alarmant sur l'assainissement et du traitement des
déchets. Compte tenu d'un taux raccordement des égouts qui ne
dépasse pas aujourd'hui 40%, alors qu'il était de 45 % en 1990,
on peut donc estimer à 2.5 millions d'hbts la population d'Abidjan dont
les eaux usées échappent au réseau collectif. Le
réseau d'équipement individuel ne dépassant sans doute que
de très peu 20% (données INS 1998), il est probable qu'encore 40%
des eaux usées des ménages d'Abidjan finissent dans les rues, les
caniveaux, et la nature.
Ce réseau de collecte des eaux usées est ancien,
limité, est basé sur un collecteur de base et des collecteurs
secondaires qui sont eux même générateurs de nuisances sur
la lagune (Photo 21). Si la fonction du collecteur de base est en effet
d'évacuer les déchets solides pour les dissoudre directement en
mer, il n'en est pas de même des collecteurs secondaires qui
débouchent directement en lagune (Dembélé et Botty 2001)
(photo 22).
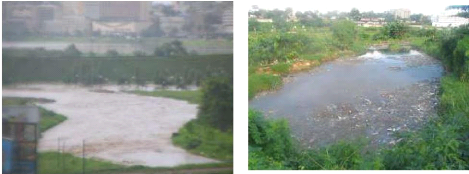
Photo 21 : Inondation du carrefour de l'Indénié
par les eaux pluviales (cliché : N'Doman V.2010)
L'ensablement des émissaires du carrefour de
l'Indénié dû à l'ensablement de la baie de Cocody
gène l'écoulement des eaux pluviales vers la lagune.
Photo 22 : Déchets flottants sur les eaux usées
carrefour de l'Indénié baie de Cocody (cliché :
N'Doman V.2010)
67
Les ordures rejetées dans les rues se retrouvent
dans les baies par le biais des émissaires.
En outre, le collecteur principal, faute de débit
adéquat ne fonctionnent pas correctement, les déchets autant
solides que liquides sont directement acheminés en lagune sans
bénéficier d'un traitement d'épuration efficace. Cette
carence d'équipement ne concerne pas seulement les rejets industriels,
mais également ceux de l'industrie et de grands équipements comme
la polyclinique PISAM déverseraient une partie de leurs déchets
liquides et solides directement en lagune (Agbadou 2000).
Dans le domaine de ramassage des déchets et des ordures
ménagères, la carence est également constatée.
Ainsi, on observe des dépôts sauvages d'ordures un peu partout
dans la ville. A Attécoubé, les populations qui ont élu
domiciles sur les flancs du versant, l'utilisent comme décharge (photo
23). Selon un rapport de la direction du cadre de vie 2001, la production des
déchets ménagers estimée à près de 2
millions de tonne ne serait collectée que pour 50% environ, alors qu'en
1988, 70% des ménages urbains voyaient leurs ordures ramassées
par un camion (Pottier et al 2008). Les pluies et les eaux de ruissellement,
évacuent les déchets et les rejets divers de l'ensemble de
l'agglomération d'Abidjan jonchant le sol ou s'accumulant au grès
des dépôts improvisés. Leur charge se trouve par ailleurs
accentuée par les matériaux facilement mobilisés, compte
tenu de la mise à nu des sols ferralitique liés à la
croissance urbaine.
|
Les populations riveraines déposent leurs ordures
sur les versants de la vallée d'Attécoubé qui est en
communication directe avec la baie du Banco.
|
68
Photo 23 : Dépôts d'ordures sur le versant de la
vallée d'Attécoubé (cliché : N'Doman
V.2010)
4-La pollution
Les pratiques quotidiennes des populations qui habitent les
rives de la lagune Ebrié constituent une menace grave au maintien de la
bonne qualité environnementale. La pression humaine renforcée sur
ces berges est en effet accompagnée d'une dégradation du milieu
et
d'une souillure qui en dit long sur l'abandon des valeurs de la
propreté dans les grandes villes comme Abidjan et sur la dérive
des comportements individuels dans le domaine (Photo 25).

69
Photo 24 : Décharge d'ordures sur la berge Ouest de Photo
25 : Déchets flottant dans la baie du
la baie du Banco avant sa délocalisation Banco et l'acadja
en arrière-plan
(cliché : N'Doman 2010) (cliché : N'Doman
2010)
Cette décharge et les ordures flottantes sur le plan
d'eau constituent des sources de pollution
La déviance est également collective car le
développement spontané des berges de lagune s'est fait sans
régulation à l'image de la ville d'Abidjan. Cette question de
l'absence d'une gestion de l'urbanisme est ici plus préoccupante que
dans bien d'autres secteurs de la ville d'Abidjan, car le contact d'un milieu
aussi fragile et remarquable que celui de la lagune Ebrié demande encore
plus attention (Photo 24 et 25). Il faut constater qu'à l'échelle
de l'agglomération, la politique des aménageurs au moment du
premier boom immobilier de 1970 d'Abidjan a été de
considérer comme un avantage du site. C'est-à-dire un espace
périphérique et un milieu mécaniquement susceptible qui
peuvent résoudre les problèmes d'évacuations des eaux
usées (Dembélé et Botty, 2001). Les méthodes n'ont
peu évoluées, si on se réfère ensuite au choix qui
a été fait ensuite d'orienter les rejets vers la mer,
considéré après la lagune comme le nouvel absorbeur des
effluents dont on ne sait quoi faire. Le récent épisode du Probo
koala navire Russe battant pavillon panaméen a en effet
été à l'origine d'une grave pollution chimique à
Abidjan. En 2006, 400 tonnes de déchets toxiques contenant
70
un mélange de pétrole, de sulfure
d'oxygène, phénols, soude caustique et acide ont
été nuitamment et en toute quiétude
déversées dans seize sites d'Abidjan notamment (la
décharge d'Akouédo, la station de dépotage d'eaux
usées du Plateau Dokoui, le village de Djibi, les canalisations de la
zone du canal de Vridi...). Il s'en est suivi une grave intoxication ou par
contact direct de plus de 9 5000 victimes officiellement reconnus et la mort de
12 personnes. La lagune Ebrié a été touchée par
cette catastrophe environnementale. La cellule opérationnelle de
coordination du plan national de lutte contre les déchets toxiques mises
en place par le Premier ministre en septembre 2006 reconnaissant que «
dès les premiers jours du déversement des déchets
toxiques, une mortalité exceptionnelle des poissons a été
constatée sur le plan d'eau lagunaire » (Primature 2006). Des
inquiétudes ont également porté sur les
conséquences des pollutions des sédiments et des nappes
phréatiques, sans que des analyses puissent toutefois les
confirmées.
Des raisons hydrodynamiques liées à la faiblesse
du courant dans les zones confinées et assez peu profondes, notamment au
contact des berges, et plus généralement, à la faiblesse
des échanges entre les baies et le chenal principal permettent
d'expliquer cette dégradation.
5-L'hydrodynamisme
La complexité du courant de la lagune associé
à la configuration du plan d'eau et notamment à l'existence de
ses baies, mais également à la morphologie des fonds provoquent
la naissance de trois types de courant. Les courants de flot et de jusant
agissent différemment selon les sites. L'énergie du courant de
marée baisse et ne réussit pas à pénétrer
à l'intérieur des baies. Il s'ensuit un mauvais échanges
avec le chenal principal, ce qui permet de penser que les polluants qui
acheminés dans ces baies par le biais d'égouts,
d'émissaires et de système de rejet de déchets
industrielles restent, pour l'essentiel, à l'intérieur sans
pouvoir en être évacués. C'est la raison pour laquelle,
également, les baies sont soumises à l'ensablement. De
façon générale, les courants aussi bien de jusant que de
flot sont plus intenses dans le chenal principal. Sur la base des informations
acquises à partir des mesures de courant en se fondant sur le fait que
les courants de surface sont très influencés par le vent,
l'existence de courant alternatif et des giratoires au sein des baies sont
attestés (fig 15). Ce contexte hydrodynamique montre que tous les
facteurs sont réunis pour que l'on retrouve dans la lagune des polluants
issus des activités humaines (fortes industrialisations, manque de
station d'épuration, rejets directs des eaux usées...), mais
également des produits d'altération des roches (minéraux
et métaux) qui sont transportés par les cours d'eau. En effet, la
forte
71
pluviométrie rencontré en Côte d'ivoire,
le nombre élevé de cours d'eau dénombrés, la
diversité des formations aussi bien du socle que du bassin
sédimentaire et enfin la qualité de la végétation
apparaissent comme des facteurs favorables à l'altération des
roches et au lessivage de sol ferralitique. Cette érosion s'accompagne
ensuite largement du transport des matériaux jusque dans le
système lagunaire (Affian 2003).
D'un point de vue plus général, portant sur tous
les espaces proches du plan d'eau Ebrié à Abidjan, le
ruissellement est favorisé par le niveau de précipitations (1900
mm par an) et la configuration du site, composé de talwegs nombreux qui
communiquent avec la lagune. Les résidus non traités des
productions et des consommations d'une population de plus en plus nombreuse s'y
retrouvent donc transportés par autant d'émissaires naturels
venant se déverser dans la lagune.

2008
IGT 2008
Figure 15 : Carte du modèle simplifié de la
circulation en Lagune Ebrié 6-Les activités économiques
Si la culture floristique et la cueillette sont les
activités dominantes sur la baie de Cocody (Photo 26), cela n'est pas le
cas sur la baie du Banco. En effet, outre les lavandiers du Banco (fanico), des
activités de nettoyage et de récupération de sachets
plastiques se sont développées sur les berges de cette baie
(Photo 27). Ainsi, les acteurs de ce secteur collectent
72
les déchets plastiques dans les poubelles et les caniveaux
pour ensuite les convoyé vers la baie Banco pour le nettoyage.

Photo 26 : Culture de fleurs sur les berges de Photo 27 :
Dépôts de ballots de sachets
la baie de Cocody (cliché : N'Doman 2011)
plastiques sur la baie du Banco (cliché :
N'Doman 2011)
Outre cela, l'espace qui autrefois abritait une
décharge a été aménagé pour accueillir une
usine de fabrication de chaussures en peau de boeuf (Photo 28). Les
opérations entreprises pour l'aménagement de cet espace ont
détruit une partie de la végétation sur la berge Est.
Finalement, le site de la baie du Banco tend à se
transformer en dépotoir de camions usagers (Photo 29) ;
l'activité humaine s'y matérialise par l'implantation de
ferraille, c'est également une zone d'incinération de pneus et de
pâturage de boeuf.

Photo 28 : Construction d'une usine de Photo 29 :
Dépôts de véhicules usagers sur la
chaussures sur la baie du Banco (cliché : baie du
Banco (cliché : N'Doman 2011)
N'Doman 2011)
Ces photos illustrent les différentes mutations qui
ont lieu sur les berges, des baies de Cocody et du Banco
73
II-LES CONSEQUENCES DE LA DEGRADATION DES BAIES DE COCODY
ET
DU BANCO
1-Les conséquences sur l'environnement
Ces eaux sont de plus en plus polluées par les
déchets solides et liquides qui y sont déversés
quotidiennement par les industries et les ménages sans traitement
préalable. Le niveau de pollution ne fait que s'accentuer face à
la croissance urbaine et à la non maitrise de la gestion de
l'environnement à Abidjan, d'où de graves menaces est sur la
qualité des eaux indéniable.
Ainsi, l'écoulement constant des déchets solides
et liquides vers les baies provoquent des odeurs nauséabondes et
occasionnent la prolifération des moustiques et des mouches. A ces
nuisances, s'ajoutent la prolifération des végétaux
aquatiques envahissants qui depuis le milieu des années 1980 recouvrent
le plan d'eau de façon saisonnière. Ces végétaux
empêchent la pêche et transport lagunaire.
Pour finir, les surfaces gagnées par le sable sur l'eau
constituent aujourd'hui de véritables constructions humaines. En plus,
la population environnante remblaie les berges à l'aide de pierres et de
sables. Ces espaces qui étaient autrefois impropres à
l'implantation d'habitations sont depuis les années 1970
colonisés par la population qui utilisent la lagune comme un
dépotoir.
2-Les conséquences sur la santé des
populations
Depuis de nombreuses années, l'état sanitaire de
l'agglomération d'Abidjan dans son ensemble et de celui de la lagune
Ebrié en particulier continue de se dégrader lentement. Les
conséquences sur la santé humaines, des niveaux de pollution
exceptionnellement élevées, dans certains secteurs de la lagune
Ebrié ne sont plus à démontrer : infections respiratoires
aigües (Koné et al. 2006), fièvre typhoïde
(Kouma et al.1979), transmission de salmonelloses (Iwuji, 1976),
choléra. Les diarrhées cholériques et infections
cholériformes (Dosso et al, 1984) ; qui viennent s'ajouter
à la prolifération des mouches et des moustiques vecteurs de
paludisme ; de diarrhée et de démangeaisons du corps (Koné
et al, op.cit), ou encore aux odeurs nauséabondes et
pestilentielles des eaux lagunaires.
Les eaux eutrophisées et dégradées se
sont appauvries, les populations benthiques étant en certains endroits
limitées aux oligochaètes pacdimélania anrita et
tympanotonus fasciatus,
deux espèces dont la présence est
considérée symptomatique d'un état de pollution (Zabi,
1982). D'un point de vue global, la ressource halieutique s'est en grande
partie tarie, la pêche devenant ainsi moins productive et s'accompagnant
de l'appauvrissement financier et alimentaire des populations riveraines de la
lagune. La pollution excessive a amené les autorités ivoiriennes
à interdire la pêche dans certaines zones du plan d'eau afin de
préserver la santé des populations riveraines. Les baies sont les
zones les plus visées par cette mesure. On continue cependant à
rencontrer fréquemment des pêcheurs clandestins (photo 30) qui
ignorent sans doute les dangers qu'ils font courir à la population en
lui proposant des produits extrait de ces espaces. Des aménagements de
pêches (acadja) sont quelquefois implantés non loin des berges qui
constituent les secteurs les plus riches des plans d'eau. Les baies servent de
nourriceries à un nombre important de poissons et de crustacés.
Dans le cas des baies lagunaires Ebrié, ces zones représentent
également le débouché du réseau de collecte des
eaux usées ; ce qui rend dangereux la consommation de tout être
aquatique qui y vit.
|
Les produits issus de
ces pêches sont
dangereux
pour la
population
|
74
Photo 30 : Des pêcheurs sur la baie du Banco
(cliché : N'Doman V.2010)
Enfin, la lagune a perdu son image symbolique et son
rôle social. Considéré comme le lieu de résidence
des génies protecteurs, ces eaux ont perdu leurs pouvoirs de
guérison. Les pratiques de loisirs, compétition de nations et de
pirogues qui s'y exerçaient, ont disparu ce qui a fait dire en 2007 au
Ministre de l'environnement que « Abidjan autrefois perles des lagunes,
fait aujourd'hui honte à regarder » (Ahizi 2007) et au
Président Laurent GBAGBO de regretter que « la lagune où il
se baignait il y a 45 ans est devenue impropre » (AFP, novembre 2007,
propos recueillis lors de la quinzaine nationale de l'environnement). Les
berges sont devenues
75
impraticables, jonchés d'ordures parmi lesquelles on
peut trouver des seringues et autres déchets biomédicaux.
Face à la dégradation du plan d'eau lagunaire,
l'Etat a pris certaines mesures pour venir à bout de ce
phénomène.
III-LES ACTIONS ENTREPRISES PAR L'ETAT IVOIRIEN POUR
DEPOLLUER
LES BAIES
1-Les initiatives antérieures à 2010
Plusieurs actions ont été prises afin d'avancer
sur le chemin d'une meilleure prise en compte des questions environnementales
en Côte d'Ivoire, plus particulièrement de celle en relation avec
la protection des milieux lagunaires à Abidjan. A la fin des
années 1980, les autorités avaient entrepris un vaste programme
destiné à résoudre les problèmes d'assainissement.
Financée avec l'aide de la Banque mondiale, pour un montant de 22
millions de dollars, la construction d'un système global
d'assainissement est malheureusement partielle et techniquement limitée.
Sans doute plus important, c'est sur le plan juridique que cette question a
très nettement avancé à partir du début des
années 1990. Le droit de l'environnement en Côte d'Ivoire
était auparavant très limité et totalement inadapté
à la situation économique du pays. Par l'adoption de la loi
n° 96-766 du 7 octobre 1996 portant sur le code de l'environnement, La
Côte d'Ivoire s'est ainsi dotée d'un véritable outil
juridique de référence. Plusieurs décrets fondamentaux ont
rapidement suivi et notamment n°97-678 du 3 décembre 1997 portant
« protection de l'environnement lagunaire et marin ». Pourtant, si ce
nouveau cadre législatif apparait comme complet et pertinent, force et
de constater que sa mise en application reste particulièrement
difficile. Cette législation est aujourd'hui peu respectée, par
le manque de moyens institutionnels, financiers, humains et techniques. Ainsi,
le problème de la pollution de la lagune d'Abidjan demeure au point de
rester l'une des 7 priorités du ministère de l'environnement. Le
problème reste donc aujourd'hui entier, pas moins de 2.207 milliards de
FCFA étant nécessaires sur 25 ans, selon lui, pour bâtir
des ouvrages d'assainissement et de drainage afin de « régler et
d'améliorer tout déversement dans le milieu lagunaire »P.
Pottier et al (2008).
2-Le plan d'urgence des infrastructures urbaines
La décennie de crise qu'a connue la Côte
d'Ivoire, a fortement éprouvé l'économie ivoirienne.
Toutes les ressources disponibles ont été mobilisées pour
la sortie de crise au détriment des infrastructures de bases qui
étaient dans un état de dégradation avancé. Ainsi
en 2010, le gouvernement ivoirien avec l'aide de la banque de la mondiale a mis
en place le PUIUR. Après l'interruption des travaux dus à la
crise post-électorale, les travaux ont repris avec la
réhabilitation des exutoires du bassin Gourou qui se trouve sur l'axe
Zoo d'Abidjan-carrefour de l'Indénié. Toutes les zones
dégradées ont été réhabilitées. Les
travaux se poursuivent et les responsables des travaux ont entrepris d'agrandir
les exutoires au niveau du carrefour de l'Indénié et de la
création de deux bassins de rétention l'un au niveau du quartier
Washington et l'autre derrière le district de police d'Adjamé.
Comme l'indique leur nom, ces bassins ont pour rôle de ralentir le
débit des eaux s'écoulant vers la baie (Photo 31).
An niveau de la baie du Banco, les fortes pluies qui se sont
abattues sur Abidjan et qui ont fait sortir la rivière banco de son lit,
ont poussé le Ministère de l'environnement à entreprendre
des travaux d'ouverture du lit de la rivière Banco au contact de la baie
du Banco. A la suite de ces travaux, le ministère de l'environnement a
décidé d'assainir cette baie en la débarrassant du
dépotoir d'ordures qui y était implanté.
|
Ce bassin est construit dans le but de
réduire de
débit des eaux de
ruissellent se déversant dans la baie
de
Cocody en saisons pluvieuses
|
76
Photo 31 : Construction d'un bassin de rétention des eaux
de ruissellement derrière le district de police d'Adjamé
(cliché : N'DOMAN V. 2011)
77
Conclusion
Le développement socio-économique impulsé
par l'ouverture du canal de Vridi en 1951, a provoqué une croissance
rapide des surfaces bâties. Ainsi la crise du logement et la
paupérisation d'une frange de la population a occasionné le
développement des constructions anarchiques des quartiers
précaires sur les flancs de collines. Cette situation
corrélée par le manque d'équipements d'assainissement et
la faiblesse des courants au sein des baies a accéléré la
dégradation des baies.
78
CONCLUSION
Dans cette étude, l'objectif est d'apprécier
l'état actuel des baies de Cocody et du Banco. Cette recherche a permis
de mesurer et de cartographier processus de comblement. Elle a aussi
consisté à identifier et décrire le type de
végétation qui s'est développée sur les parties
comblées.
En effet, l'interprétation de la photo satellite 2010,
et du traitement de la photo aérienne prise en 1955 couvrant les baies
de Cocody et du Banco, ont montré un recul du plan d'eau dans ces baies.
Les espaces gagnés sur l'eau représentent sur la période
1955-2010, sont de 67.6 ha pour la baie de Cocody soit une régression de
37.94 % et de 103.2 ha pour la baie du Banco soit une régression de
26.41 %. L'ensablement de ces baies est dû aux apports de
sédiments composés essentiellement de sables et de boues qui se
déversent dans ces baies par l'entremise des émissaires d'eaux
usées et des eaux pluviales. Les surfaces perdues sont plus importantes
sur la baie du Banco parce qu'elle est alimentée par la rivière
Banco, et celle-ci est en communication directe avec la vallée
d'Attécoubé et présente le grand nombre de
débouchés d'émissaires sur ces berges plus
fréquentes sur la berge orientale. Ces surfaces gagnées sur
l'eau, riches en matières organiques, en sables et en boues sont des
milieux propices à la propagation de groupements de
végétaux. Les végétaux herbacés sont les
plus représentatifs sur l'ensemble des deux baies et leur regroupement
s'intensifie à l'approche du plan d'eau .Aussi, on observe une
prolifération des roseaux sur la berge Ouest de la baie du Banco et sur
la baie de Cocody. Si l'on remonte à 1955, début des atteintes
physiques sur ces milieux, l'on peut aisément affirmer que cette
végétation est spécifique aux baies de Cocody et de Banco.
Car le sud ivoirien était occupé par la forêt dense
sempervirente de type équatorial (ADJANOHOUN, 1965 ; ADJANOHOUN et
GUILLAUMET, 1971). On distingue trois types de pollution : la pollution
chimique dont l'origine est attribuée aux exploitations agricoles
proches d'Abidjan et à certaines industries de la capitale. La pollution
organique provenant des réseaux d'égouts et des industries
agro-alimentaires et enfin de la pollution microbienne qu'on attribue aux eaux
pluviales qui charrient vers le plan d'eau toutes sortes de bactéries
témoins de contamination fécale. La pollution a fait perdre
à la lagune sont pouvoir d'auto-épurateur du fait des
écoulements continus des eaux de ruissellement et des eaux
usées.
Ces menaces mettent en péril les baies de Cocody et du
Banco. Depuis des décennies, les baies continuent de perdre leurs
surfaces du fait de l'ensablement et la qualité de ces eaux
79
laissent à désirer. Il est impérieux que
les décrets signés par le gouvernement ivoirien connaissent un
début d'application. Aussi, comme l'a souligné (Anoh P. 2001), il
faudrait réhabiliter les canalisations et les stations
d'épuration existantes et songer à la construction de nouvelles
stations d'épurations, de caniveaux bétonnés et digue pour
la régulation du débit des eaux pluviales. Encourager la
création des fosses septiques dans les constructions individuelles et
promouvoir un système de contrôle de la pollution pour les
industries. Pour les industries les plus polluantes, il faut exiger des bacs de
décantation pour les recueillir les polluants dangereux et l'application
de la loi du pollueur payeur pour les contraindre à traiter leurs
déchets avant leur évacuation dans le milieu naturel.
Vu le nombre important des baies sur la lagune Ebrié et
le développement de ses berges, il est nécessaire d'effectuer une
étude approfondie et multidisciplinaire pour évaluer l'impact de
l'anthropisation sur le court, le moyen et le long terme qui permettra
d'intégrer les milieux naturels au développement urbain.
80
BIBLIOGRAPHIES
ADJANOHOUN 1965, Comparaison entre
végétations de savanes côtières de la Côte
d'Ivoire et du Dahomey, annales Univ Abidjan Cocody p.41-60
AFFIAN K., 2003.Approche environnementale d'un
écosystème lagunaire microdital (La lagune Ebrié en
Côte d'Ivoire), par des études géochimiques,
bathymétriques et hydrologiques : participation du SIG et la
télédétection, thèse de doctorat en sciences
naturelles n°380, Univ de Cocody, 225p.
AGBADOU C., 2000. Les pollutions en Lagune
Ebrié-Les baies de l'agglomération Abidjanaise,
maîtrise de Géographie, Univ de Cocody Abidjan 89p.
ANOH K. P., 2001. « La lagune Ebrié de 1955
à 1998 : Pollutions des eaux et encombrements des baies urbaines de
l'agglomération d'Abidjan », Géotrope, n°1, PUCI
p.62-78
ASSEMIEN P. FILLERON J-C, MARTIN L., TASTET J-P 1970. Le
quaternaire de la zone littorale de la Côte d'Ivoire, ORSTOM fonds
documentaires, ORSTOM Abidjan, p.305-319
BEAUDOU Alain G., Philippe de BLIC, Yvon CHATELIN, Jean COLLINET,
Jean-Charles DUBRESSO A., ANTOIN P et MANOU-SAVIN A., 1987.- Abidjan,
côté cours. Karthala-ORSTOM, 277 p.
FILLERON, Jean Louis GUILLAUMET, Francis KAHN, Koli Bi ZUELI,
Jean-François RICHARD 1977. Recherche d'un langage
transdisciplinaire pour l'étude du milieu naturel, Travaux et
documents ORSTOM n°91, ORSTOM, Paris, 153 p.
BIDET J-C ET AL 1982. L'approche géologique de
l'environnement lagunaire Cifeg édition, 103 rue Lille
75057.Paris
BILE Eugène, 2005. Dynamique de l'occupation du sol
dans l'agglomération d'Abidjan de 1970 à 1989 : Analyse
géographique et constitution d'une base de données SIG,
maîtrise de Géographie, Univ Cocody Abidjan, 115p.
BROSHE J. et PESCHET J-L .1983 « Enquête sur la
pollution actuelle et potentielles en Côte d'Ivoire »in DURFOUR
P. et CHANTRAINE J-M, réseau nationale de la qualité des eaux
marines lagunaires en Côte d'Ivoire, Paris, ORSTOM ET Ministère de
l'équipement, 451p
Commission européenne, 2006.Profil environnemental
de la Côte d'Ivoire, Rapport final rédigé par B.HALLE
et V.BRUZON 128p.
81
DEMBELE O., Botty Bi T. C., 2001. «L'impact
environnemental de l'émissaire en mer à Port Boüet
», Géotrope n°1, PUCI, p.79-91
DE SPENGLER (A.) et DELTEIL (J.R.), 1966. - Le bassin
secondaire et tertiaire de Côte d'Ivoire. 112 : les bassins
sédimentaires de littoral africain. Ass. Swv. Géol. A&.
Paris : 99113.
DONGO K, 2001. Etude de l'évolution du système
d'assainissement « eaux usées de la ville d'Abidjan » DEA
sciences de la terre, Univ Abidjan Cocody, 81p.
DUFOUR P.et SLEPOUKHA M., 1975. «L'oxygène
dissous en lagune . Influence de l'Hydroclimat et des pollutions »
Documents scientifiques du CRO, 6(2) p.75-118
DUFOUR P., KOUASSI A.M. ET LANUSSE A., 1994. «Les
pollutions », DURAND J-P, DUFOUR P., GUIRAL D. ET ZABI S. G. F.,
Environnement et ressources aquatiques de la Côte d'Ivoire-Les
milieux lagunaires, Paris, ORSTOM, tome 2 p.309-333
DURAND J-P 1994, « L'homme et la lagune » DURAND J-P,
DUFOUR P., GUIRAL D. ET ZABI S. G. F., Environnement et ressources
aquatiques de la Côte d'Ivoire-Les milieux lagunaires, Paris,
ORSTOM, tome 2 p.529-543
ELDIN 1971, Le milieu naturel de la Côte d'Ivoire, Le
climat, mémoire ORSTOM, Paris,
P.109-155
HERVIEW J. 1968.Contribution à l'étude de
l'alluvionnement en milieu tropical, mémoire ORSTOM n°24,
ORSTOM Paris, P.454
HYDRO-R&D, 2004. Dépollution des baies
lagunaires d'Abidjan. Aménagement de la baie de Cocody
Louvain-Belgique, rapport du Ministère de l'Environnement de
Côte d'Ivoire, 47P.
IWUJI S.1976, Les infections intestinales à
salmonelloses en zone lagunaires rurale, thèse de doctorat de
médecine, Univ Abidjan Cocody, n°79
KOUASSI A.M., GUIRAL D. ET DOSSO M. 1990 « Variations
saisonnières de la contamination microbienne de la zone urbaine d'une
lagune tropicale estuarienne. Cas de la ville d'Abidjan (Côte d'Ivoire)
», Revue Hydrobiologie Tropicale, n°23-3, ORSTO-IRD, Paris
P.181-194
LANKFORD R., 1977 Coastal of Mexico. Their origin and
classification p.182-215
LANUSSE Alain 1987. Contamination microbienne d'une lagune
tropicale lagune Ebrié Côte d'Ivoire Influence et
Hydroclimat, Thèse de doctorat Univ de Provence, 180 p.
82
LEVY.A. 1971. Eaux saumâtres et milieux margino
littoraux, Revue de géographie physique et géologie
dynamique, Paris, Vol. XIII ; Fac 3, P.269-278
MARCHAND M. et MARTIN J-L.1985. «
Détermination de la pollution chimique, Hydrocarbure,
organochlorés et métaux dans la lagune (Côte d'Ivoire) par
étude des sédiments » Océanographie tropicale,
n°20, ORSTOM-IRD, Paris, p.1-90
MILLET B. 1985. Hydrochimie et Hydrologie d'un milieu
lagunaire tropical : Le lac Togo, collection études et
thèses, ORSTOM Paris 1986, 230p.
NEDECO, 1981.Assainissement et drainage de la ville
d'Abidjan, Côte d'Ivoire, Setu
NICHOLS et ALLEN, 1981, Sedimentary process in lagoon, in
coastal lagoon, research present and future
PAGES J. 1975 «Etude de la pollution
bactérienne de la lagune Ebrié » documents
scientifiques du CRO Abidjan, 11 (2), p.79-107
POTTIER P., AFFIAN K., M'BOUA V., ANOH P., KRA Yao, A. KANGAH,
Marc ROBIN «La lagune Ebrié à l'épreuve de la
pression anthropique » La géographie du littoral p. 165184
PHLEGER F.B., Ecology and distribution of foraminifera J.hopkin
(Ed) 297 p.
RICHARD Jean-François, Francis KAHN, Yvon CHATELIN 1977.
Vocabulaire pour l'étude du milieu naturel (tropiques humides).
Cahiers ORSTOM, vol. XV ORSTOM, Abidjan, p.4362
ROOSE Eric, 2000, La Gestion Conservatoire de l'Eau et de la
fertilité des Sols (GCES), une stratégie nouvelle pour faire face
à un double défi du 21siècle : la pression
démographique et l'environnement rural Centre IRD, B.P. 64501, F
34394 Montpellier, France. Fax : (33).467.41.62.94 : Email :
roose@mpl.ird.fi p.10-18
ROOSE Eric 1971, Sol du bassin sédimentaire de la
Côte d'Ivoire, Le milieu naturel de la Côte d'Ivoire,
p.51-93
SEYLER P. 1980 Les milieux lagunaires et environnement non
carbonaté DEA ; ENS. ULM
83
TASTET J-P., P. GUIRAL 1994, Géologie et
Sédimentologie, Environnement et ressources halieutiques de la
Côte d'Ivoire, tome 2, p.35-58
YAO Brou Télésphore 2008, La
végétation du littoral ivoirien, La géographie du
littoral, p 23-36
YAO Koffi, SORO Métongo, Albert TROKOUREY, Bokro YOBOU,
Assement of sediments contamination by havy metals in tropical lagoon urban
area (Ebrié lagoon) European journal of scientific research,
p.280-289
84
ANNEXES
Annexe 1 : Fiche morphométrique de la
toposéquence de la baie de Cocody
|
Distances
(m)
|
Distances
Cumulées
(m)
|
Pentes
(%)
|
Dénivelées
|
Dénivelées
cumulées
|
Observations
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17.99
|
Goudron
|
|
6
|
6
|
-10
|
0.6
|
17.39
|
Jachères herbeuses,
débris humains,
jeunes
pousses
|
|
1.3
|
7.3
|
0
|
0
|
17.39
|
|
2.2
|
9.5
|
-28
|
0.62
|
16.77
|
|
2
|
11.5
|
-40
|
0.8
|
15.97
|
|
3.8
|
15.3
|
-18
|
0.68
|
15.29
|
|
7.3
|
22.6
|
-14
|
1.02
|
14.27
|
|
6.6
|
28.6
|
-5
|
0.33
|
13.94
|
|
10.32
|
38.92
|
-18
|
1.87
|
12.07
|
Défrichement
|
|
2.84
|
41.76
|
-28
|
0 ,8
|
11.27
|
|
10.6
|
52.36
|
-45
|
4.77
|
6.5
|
|
6.75
|
59.11
|
-13
|
0.88
|
5.62
|
|
8.9
|
68.01
|
-8
|
0.71
|
4.91
|
|
5
|
73
|
-2
|
0.1
|
4.81
|
|
3
|
76.04
|
0
|
0
|
4.81
|
Caniveaux
|
|
20
|
116.04
|
5
|
1
|
3.81
|
Jachères herbeuses,
pieds de Mais,
Bananiers,
Palmiers
à huiles
|
|
20
|
136.04
|
4
|
0.8
|
3.01
|
|
20
|
156.04
|
4
|
0.8
|
2.21
|
|
25.4
|
181.41
|
2
|
0.5
|
1.71
|
|
15.6
|
197.6
|
3
|
0.47
|
1.24
|
|
20
|
217.6
|
3
|
0.6
|
0.64
|
|
13
|
230.6
|
2
|
0.24
|
0.4
|
|
20
|
250.6
|
2
|
0.4
|
0
|
|
20
|
270.6
|
0
|
0
|
0
|
Marécages
|
Source : Nos enquêtes terrains 2010
85
Annexe 2 : Description du géon 1 baie de
Cocody
|
Hoplexols
|
Hauteurs
|
Matériaux et variantes
|
|
H+3
|
120- 300cm
|
Kortodon3%, Nanophyse 10%, Nanophytion7%,cauligé
7%,kortonanophyse3%,aréophyse 70%
|
|
H+2
|
20-120cm
|
Gramon 7%, Gramen 80%,pénéphytion basitone
3%,aréophyse 10%
|
|
H+1
|
0-2Ocm
|
Phorophytion kortodé 20%, Néophytion 25%, Gramen
35%, pleiokortode5%, Nérophytion foliacé 15, microzoolite 1%
|
|
H-1
|
0-3cm
|
Grumorhyse 10%, Humite psammitique 60%, Débris humains
15%, Radicelle 13%, Hydrophyse 2%
|
|
H-2
|
0-13 cm
|
Appumite 80%, Débris humains 10%, Radicelle 7%,
Hydrophyse 3%
|
|
H-3
|
13-30cm
|
Structuchron dyscrophe 90%, Radicelle 5%, Débris
humains 3%, Hydrophyse 2%.
|
|
H-4
|
30-60cm
|
Structuchon rouge en auglucode 98%, hydrophyse 2%
|
|
H-5
|
60-100cm
|
Structuchon rouge 98%, hydrophyse 2%
|
Source : Nos enquêtes terrains 2010
86
Annexe 3 : Description du géon 2 baie de
Cocody
|
Hoplexols
|
Epaisseur
|
Matériaux et variantes
|
|
H+3
|
5 m
|
Prophyse orthotrope 1%, Nécrostyliagé 1%,
Aréophyse stomaphique 93 %
|
|
H+2
|
1-4m
|
Dendrigé 5%, Nécrodendrigé 3%
aréopphyse stomaphique 90%, Styliagé 2%
|
|
H+1
|
0-1m
|
Syliagé traumatique 1%, Nécrotétphralite
1%,
Nécrophytion gramené 10%,
néophytion
2%,aréophyse 86%
|
|
H-1
|
0-3 cm
|
Humite 90%,Radicelle 9%,hydrophyse 1%
|
|
H-2
|
3-10cm
|
Appumite sableux 90% Radicelle 5% Zoolite 2%, Hydrophyse 3%
|
|
H-3
|
10-30 cm
|
Strutuchron dyscrophe 90 %, Radicelle 3% , Zoolite 4%,
Hyrophyse 3%,Grès 2%
|
|
H-4
|
30-60 cm
|
Structuchron anglucode 90%, Phase oxyque 5%, grés 10%,
Zoolite 1%, Hydrophyse 4%
|
|
H-5
|
60cm-1m
|
Structuchon brun 90 %, phase oxyque 2 %,
cuirasse 1%, Régolite élasmoclastique
3%,
Hydrolyse 4%
|
Source : Nos enquêtes terrains 2010
87
Annexe 4 : Description du géon 3 baie de
Cocody
|
Hoplexols
|
Epaisseurs
|
Matériaux et Variantes
|
|
H+2
|
1-2m
|
Nanophytion 15%,Kortode 4%,Gramon 10%
,Kortonanophyse 30%,Aréophyse 41%
|
|
H+1
|
0-1m
|
Nanophyse 15%, Cauligé 10%,Pléionanophyse
30%,Gramen 10%,Pénéphytion
10%,Aréophyse
15% ,Phorophytion kortodé 10%
|
|
H-1
|
0-5cm
|
Psammiton alluvial 99%, Hydrophyse 1%
|
|
H-2
|
5-32cm
|
Psammiton dyscrophe 90%, Grumorhyse 7%,
Hydrophyse1%
|
|
H-3
|
32-42cm
|
Psami reducton 90%,gravelon 7%, Hydrophyse 1%
|
|
H-4
|
42-91cm
|
Psammiton alluvial 90%, Gravelon 7%,Hydrophyse 3%
|
|
H-5
|
91-115cm
|
Mélanumite 90%, Hydrophyse 7%,Gravelon 3%
|
Source : Nos enquêtes terrains 2010
88
Annexe 5 : Description du géon 4 baie de
Cocody
|
Hoplexols
|
Epaisseurs
|
Matériaux et Variantes
|
|
H+3
|
5 m
|
Paliphyse hermicloïde 1%, pénéprophyse 1%,
Aréophyse 98%
|
|
H+2
|
1-4m
|
Dendrigés 7%, Kortodon 10%, Pieds de maïs 15%,
Penéphytion 7%Aréophyse 61%
|
|
H+1
|
0-1m
|
Gramen 10% ; Nécrophytion gramené 7%,
Nécronécrumite 1%,Pénéphytion
1%,Néophytion
7%,Néophytion graméné 10%,
cultures
maraichères 20%,Aréophyse 44%
|
|
H-1
|
0-12cm
|
Psammiton dyscrophe 92%,Gravelon 5%, Débris 2%,
Hydrophyse 1%
|
|
H-2
|
12-40cm
|
Psammiton aluvial 90%, Gravelons 7%, Débris
2%,Hydrophyse 1%
|
|
H-3
|
40-50cm
|
Psammiton dyscrophe 80%, Reducton
psammitique 15%, Gravelon 3%, Hydrophyse 2%
|
|
H-4
|
50-80cm
|
Psammiton alluvial 90%, Gravelon 7% , Hydrophyse 2%
|
|
H-5
|
80-100 cm
|
Psammiton dyscrophe 60%, Psammiton colluvial 39%, hydrophyse
1%
|
Source : Nos enquêtes terrains 2010
89
Annexe 6 : Description du géon 1 baie du
banco
|
Hoplexols
|
Epaisseurs
|
Matériaux et variantes
|
|
H+4
|
3-5m
|
Paliphyse 1%, monophyse 1%, Kortodon 3%
aréophyse
95%
|
|
H+3
|
1-3m
|
Styliagé 1%,Stypiagié 1%, Kortodon
1%
Pléiokortode 2%, Pénéphytion 10%, Gramon
30%,
Gramen 50%, Aréophyse 7%
|
|
H+2
|
50 cm-1m
|
Stylagié 1%, Stypiagié1%,
Pénéphytion
basitone 4%, Pléiokotorde 30%,Gramen 64%
|
|
H+1
|
0-50cm
|
Nécrophytion gramené 10%,Epilte
mastocline 7%,
Néophytion 20%,Pléikotorde
23%,Gramen 50%
|
|
H-1
|
0-9 cm
|
Psammiton éluvial 84%, Mélanumite 10
%,
Rhysophyse 3%, Hydrophyse 3%
|
|
H-2
|
9-15cm
|
Reducton 90%, Débris végétaux
3%
Rhysophyse 1 % Hydrophyse 2%
|
|
H-3
|
15-19cm
|
Psammiton dyscrophe 90%, Débris
végétaux
2%, Rhysophyse 1%, Hydrophyse 7%
|
|
H-4
|
19-24 cm
|
Rédupsammiton 90%, Hydrophyse 10%
|
Source : Nos enquêtes terrains 2010
90
Annexe 7 : Description du géon 2 baie du
banco
|
Hoplexols
|
Epaisseurs
|
Matériaux et variantes
|
|
H+3
|
1-3m
|
Kortodon Crassulescente 10%, Kortodon
10%, Aréophyse
90%
|
|
H+2
|
50cm-1 m
|
Pénéphytion 5% et Pénéphytion
5%
Pénéphytion basitone 3%, Kortode
crassulescente 1%,
Kortode 1%, Aréophyse
90%
|
|
H+1
|
0-50 cm
|
Gramen 10%, Nécrokortode 2%,
Nécrogramen 7%,
Gramen dromoïde 81%
|
|
H-1
|
0-2cm
|
Mélanumite 90%, Hydrophyse 2%,
Radicelle 7%
|
|
H-2
|
2cm-6cm
|
Psammiton éluvial 96%, Hydrophyse 2%,
Radicelle 2%
|
|
H-3
|
6-14cm
|
Reducton 95%, Hydrophyse 3%
|
|
H-4
|
14-22 cm
|
Reducton psammitique 95%, Hydrophyse
5%
|
|
H-5
|
22-24 cm
|
Reducton 90%, Hydrophyse 10%
|
Source : Nos enquêtes terrains 2010
91
Annexe 8 : Description du géon 3 baie du
banco
|
Hoplexols
|
Epaisseurs
|
Matériaux et variantes
|
|
H+3
|
3-5m
|
Prophyse 2%, Palyphyse sphénocloïde
7%,
Sytlagié 9%, Aréophyse 81%
|
|
H+2
|
50cm-2 m
|
Stylagié 10%, Dendrigé 15%,
Hypsorhysagé
25%, Gramon 40%, Aréophyse 10%
|
|
H+1
|
0-50 cm
|
Hypsorhysagé 25%, Gramen 50 %,
Nécrogramen 15%
Nécrophytion foliacé 5%,
Hydrophyse 7%, Aréophyse 3%
|
|
H-1
|
0-6 cm
|
Psammiton éluvial 90%, Hydrophyse 10%
|
|
H-2
|
6-10 cm
|
Psammiton dyscrophe 80%, Hydrophyse 20%
|
Source : Nos enquêtes terrains 2010
Annexe 9 : Description du géon 4 baie du banco
|
Hoplexols
|
Epaisseurs
|
Matériaux et variantes
|
|
H+3
|
3-5 m
|
Monophyse 10%, Prophyse 7%, Aréophyse 93%
|
|
H+2
|
1-3m
|
Styliagé 10%, Stylagié 7%,
pénéphytions 5%,
Aréophyse 82%
|
|
H+1
|
0-1m
|
Styliagé 5%, Stylagié 2%, Kortodon 2%,
Pénéphytion 15%, Gramen 30%, Aréophyse
46%
|
|
H-1
|
0
|
Hydrophyse 100%
|
Source : Nos enquêtes terrains 2010
Annexe 10 : Tableau récapitulatif de l'évolution
des baies de Cocody et du Banco entre
1955-2010
|
Baies
lagunaires
|
1955
|
2010
|
Evolution 1955-2010
|
RCA en ha
|
|
Superficie en ha
|
Superficie en
ha
|
Superficie
perdue en
ha
|
Taux d'évolution
globale (%)
|
|
Cocody
|
178.1
|
110.5
|
67.6
|
-37.94
|
1.23
|
|
Banco
|
390.7
|
287.5
|
103.2
|
-26.41
|
1.87
|
Source : Nos enquêtes terrains 2010
92
| 


