|
_
Année : 2018
|
|
N° d'ordre...............
|
MEMOIRE
Pour l'obtention du diplôme de master Recherche
Domaine : Sciences de
l'éducation
Option : Didactique des disciplines et
évaluation
Spécialité :Didactique de
l'Education Physique et Sportive
Présente et soutenu publiquement
Par
MOUKOUMBI MABIKA Ghislain Aymard
Titulaire du Certificat d'Aptitude au Professorat d'Education
Physique et Sportive
Octobre 2004
TITRE :
Effets de L'ALTERNANCE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET
SPORTIVES SUR L'ESTIME DE SOI ET LE PLAISIR EN EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
DANS LES LYCEES DU CONGO : CAS DES ELEVES DE LA PREMIERE
SCIENTIFIQUE.
Directeur de Mémoire
Aristide EWAMELA,Maître des
Conférences, Université Marien NGOUABI, République du
Congo
JURY :
Président : Gertrude NDEKO,
Professeur Titulaire, Université Marien NGOUABI, République du
Congo
Examinateur : Paul MIAMBOULA,
Maître des conférences, Université Marien NGOUABI,
République du Congo
Rapporteur : Aristide EWAMELA,
Maître des Conférences,Université Marien NGOUABI,
République du Congo
DEDICACE
A
- mon père Alphonse MOUKOUMBI YOBA ;
- ma mère Agnès MOUTSATSI ;
- mon épouse Alida Naicha MOUNKASSA MOUEME ;
- mes enfants, MOUKOUMBI KHEÏLA Louisan, Ephraïm,
Ludhe, et Gloire ;
- mes soeurs ; frères; Oncles et Tantes...
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier premièrement, le
Professeur Aristide EWAMELA pour avoir accepté de diriger ce travail.
Les conseils, le soutien, l'attention, la patience et surtout la grande
disponibilité dont il a fait preuve m'ont permis de réaliser ce
travail dans les meilleures conditions.
Toute ma reconnaissance au Professeur Samuel MAWETE, pour ses
sages conseils etses orientations.
Mes sincères remerciements s'adressent également
aux Professeurs et Docteurs intervenants de la Chaires UNESCO, pour les
encadrements, leurs conseils et leurs encouragements.
Mes remerciements s'adressent également aux membres du
jury, Madame Gertrude NDEKO, Professeur Titulaire et à Monsieur Paul
MIAMBOULA, Maitre des Conférences à l'Université Marien,
pour la disponibilité et surtout leurs judicieux conseils, qui ont
contribué à alimenter ma réflexion.
J'exprime ma profonde gratitude au Dr Hubert César
M'VIRI, Messieurs Floriant KOULENGANA, Eric MOUKOUYOU, Simplice MOUANDA
MAYOUKOU, Michel BAZABA KAYILOU, pour leurs aide et pour avoir impacter ce
travail et pour leurs multiples contributions tout au long de cette
étude;
Merci aux élèves et personnel du lycée
d'excellence de Mbounda de Dolisie et du lycée de la
Réconciliation de MFILOU qui ont participé à cette
étude.
Toute ma gratitude à Monsieur Serge Wilfrid MBOUMA,
Directeur de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), à
mes collègues de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports et
à mes collègues de promotion à la chaire UNESCO pour leurs
soutiens et encouragements.
Enfin, toute ma gratitude à toutes celles et tous ceux
qui m'ont apporté de près ou de loin leur soutien multiforme et
toutes formes de prières positive.
SOMMAIRE
|
Introduction
|
..............................................................................
|
1
|
|
Partie 1 :
|
Cadre
théorique...........................................................
|
7
|
|
Chapitre I :
|
Champ conceptuel, théories et
références.............................
|
7
|
|
Chapitre II :
|
Revue de la littérature ou état de la
question..........................
|
30
|
|
Partie II :
|
Cadre
Opératoire.........................................................
|
36
|
|
Chapitre III :
|
Méthodologie..............................................................
|
36
|
|
Chapitre IV :
|
Présentation, Analyse et Interprétation des
Résultats...............
|
41
|
|
Conclusion.........................................................................................
|
61
|
|
Références..........................................................................................
|
63
|
|
Table des Matières
..............................................................................
|
69
|
|
Annexes.............................................................................................
|
72
|
LISTE DES ABREVIATIONS
|
ACP :
|
Analyse en Composante Principale
|
|
|
APS :
|
Activité Physique et Sportive
|
|
|
APSA :
|
Activité Physique, Sportive et Artistique
|
|
|
CDS :
|
Concept de soi
|
|
|
CFA :
|
Communauté financière africaine
|
|
|
EPS :
|
Education Physique et Sportive
|
|
|
GE :
|
Groupe Expérimental
|
|
|
GT :
|
Groupe Témoin
|
|
|
PACE:
|
Physical Activity Enjoyment Scale
|
|
|
PE:
|
Professeur d'Ecole
|
|
|
STAPS :
|
Sciences et Techniques des Activités Physiqueset
Sportives
|
|
|
UNESCO :
|
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et
la Culture
|
|
LISTE DES TABLEAUX
|
Tableau IV.1 :
|
Description de l'alternance et du plaisir ressenti par les
sujets GE et GT au cours des cycles de gymnastique, de volleyball et de saut en
longueur sous forme de moyenne et écart type (  #177;) ; #177;) ;
|
............42
|
|
Tableau IV.2 :
|
Estime de soi générale, valeur physique,
condition physique, endurance et compétence sportive des filles et
garçons GE et GT sous forme de moyenne et écart type (  #177;) ; #177;) ;
|
............43
|
|
Tableau IV. 3 :
|
Corrélations entre l'alternance des formes d'APS, les
valeurs de l'estime de soi des filles GE et GT et le plaisir ressenti par
elles au cours des cycles d'EPS ;
|
............44
|
|
Tableau IV.4 :
|
Corrélations entre l'alternance des formes d'APS, les
valeurs de l'estime de soi des filles GE et GT et le plaisir ressenti par
elles au cours des cycles d'EPS ;
|
............45
|
|
Tableau IV.5 :
|
Corrélations entre l'alternance des formes d'APS, les
valeurs de l'estime de soi des filles et garçons GE et GT et le
plaisir ressenti par eux durant les cycles d'EPS.
|
............46
|
LISTE DES FIGURES
|
Figure1 :
|
Les sources du plaisir en EPS
|
.........................................21
|
|
Figure 2 :
|
Répartition des variables en deux facteurs
|
...........................................47
|
INTRODUCTION
- Contexte
L'école est le lieu privilégié
où le jeune et l'adolescent peuvent acquérir la culture du
goût à l'effort et de la prise en charge de leur bien-être.
A l'ère du « tout, tout de suite », de la vitesse, de la
performance immédiate, l'effort n'est pas une valeur en vogue. Il a
été rapporté à cet effet que dans notre
société de loisirs, il n'est pas toujours facile de transmettre
à nos jeunes le sens du travail, la capacité à
s'élever, le goût de l'effort (Delignières et Méard,
2000, p.77-90).Comme le dit le vieil adage « Mens sana in corporesano
» ou « être en forme par l'activité physique pour
être performant dans la vie » semble très
négligé si l'on regarde l'évolution du style de vie
contemporain.
A l'école il y a un sens donné au
processus d'enseignement/apprentissage pour améliorer la conduite
motrice de l'élève. Il est généralement
établit à ce propos que pour favoriser les apprentissages des
élèves, il faut prendre en compte les élèves
réguliers, leurs motifs d'agir et le sens qu'ils donnent à leurs
actions dans les activités scolaires (Delignières et Garsault,
1995, chap 4). L'idée selon laquelle « l'enfant apprend en se
confrontant à des problèmes qui ont du sens pour lui »
semble aujourd'hui partagée (Amade-Escot et Marsenach, 1995).
Par ailleurs, pour organiser les conditions
d'apprentissage des élèves, il convient de se demander non
seulement comment les élèves apprennent, mais aussi pourquoi ils
apprennent. En EPS, il s'agit ainsi de questionner la nature de
l'activité adaptative des élèves, en se centrant non plus
sur « les aspects immédiatement observables des actions » mais
sur les motifs d'agir des élèves qui donnent du sens à
leur conduite (Amade et Marsenach, 1995).
L'Education Physique et Sportive consistant en
l'enseignement d'exercices physiques et corporels et de certaines disciplines
sportives dans le cadre des institutions scolaires et universitaires est la
seule discipline qui intègre la dimension corporelle du sujet qui
privilégie cette entrée dans l'action (Caumel, 2000) et
développe des compétences spécifiques dans le domaine
personnel des Activités Physiques et Sportives (A.P.S.) (Famose et
Guerin 2002).
L'Education Physique et Sportive axée sur les
contenus d'apprentissage moteur, nécessite l'instauration d'un climat de
confiance et de respect réciproque dans les rapports entre
élèves et élèves / professeur. Ainsi, travailler en
groupe est source de motivation dans la mesure où le groupe par sa
dynamique, permet à chaque membre de s'exprimer sans peine et ni
frustration. Le travail moteur par groupe nécessite une organisation de
la classe. L'organisation de la classe d'EPS est étroitement liée
à un regroupement institutionnalisé d'élèves en
fonction de différents paramètres. On peut citer entre autres le
niveau scolaire, l'âge, etc.), ce qui explique le caractère rigide
de la classe. Cette rigidité de la classe est tributaire de
l'hétérogénéité qui pose aux professeurs
d'importants problèmes au plan de l'enseignement (Seners, 1993). Un
groupement s'effectue selon le critère décisif d'un groupe pour
atteindre le but commun (Sherif, 1969, pp.157-172) qui est loin d'être
systématiquement présent dans la classe ou même dans les
divers regroupements auxquels procède l'enseignant. En effet, tout acte
qui consiste, pour l'enseignant, à rassembler géographiquement
des élèves, ne peut être assimilé à la
formation d'un groupe et encore moins d'une équipe.
Les groupements favorisent la socialisation des
élèves. Deux chercheurs Meard et Bertone cité par Leca
(2009) ont en effet rapporté que le groupe dans tout milieu
éducatif constitue le mode de fonctionnement idéal pour toute
acquisition de savoir. A cela, s'est posé le problème du «
groupe » dans les Activités Physiques Sportives et Artistiques
(APSA) par exemple, de sa nature, et de sa constitution, qui pourrait permettre
d'optimiser les apprentissages.
Face à cela, Parlebas (1981) a
énoncé huit groupes/familles d' APSA, notamment : les
Activités Physiques de Pleine Nature (marche, vélo, ...), les
Activités Physiques Athlétiques (courses, sauts, lancers) , les
Activités Physiques Artistiques (danse, art du cirque, ...), les
Activités Physiques Aquatiques (Natation, Kanoe Kayak, Water-polo, ...),
les Activités Physiques Gymniques (Gymnastique au sol, Gymnastique
aérobic, ...), les Activités Physiques d'opposition combat (judo,
lutte, boxe, ...), les Activités Physiques d'opposition duelle (Tennis,
Badminton, ...), les Activités Physiques d'opposition et de
coopération (Baskatball, Football, Handball, Volley-ball, Rugby,...).
Tenant compte de la diversité culturelle, des prescriptions de la charte
internationale de l'UNESCO pour des jeux et sports traditionnels
prévenant l'hégémonie sportive, Ewamela et coll.
(2013 ; p.145-150) ont identifié chez les Ngalas du Congo :
une activité de combat (MPONGO), trois activités artistiques
(EKONGO, IMBONGA et NDZANGO), une activité d'opposition duelle
(MAMPAKA), une activité collective (EKIENGA). Ces auteurs ont
également identifié la logique interne de chacune des
activités sus-citées.
Les formes de groupements doivent être
alternées dans un projet pédagogique d'EPS pour des raisons
éducatives, pédagogiques (apprentissage moteur). Le projet
pédagogique s'inscrit dans la planification qui consiste à
établir un besoin, puis déterminer le meilleur moyen possible de
la satisfaire, ceci dans un cadre stratégique d'identifier et de
déterminer quels en seront les principes de mise en oeuvre (Pradere et
Tricot, 2012). La planification obéit à la logique verticale
(répondre aux exigences de la noosphère dans l'élaboration
du plan d'activités physique enseignables dans un établissement
scolaire) et la logique horizontale (élaborer le projet disciplinaire en
tenant compte des différentes ressources, de la relation entre les
objectifs, les situations d'apprentissages, les unités
d'apprentissage).
Cette logique horizontale de la planification des APSA de
façon alternative en EPS associée à la
transversalité de compétences suscite le développement des
qualités de force (Entsiro et coll., 2016 ; p.44-52) et imprime le
dynamisme de la motivation. Le principal facteur sous-tendant l'adhésion
prolongée à une pratique est le sentiment de plaisir que cette
APS procure aux individus. Il y a là un enjeu important, notamment au
regard des objectifs de préparation à la vie d'adulte
récemment affichés en EPS» (Delignières et Perez,
1998, p7-18). Pour des fins d'apprentissage, l'enseignant d'EPS intervient
constamment sur les éléments de la situation vécue par le
sujet, et a donc le pouvoir de susciter, ou de ne pas susciter, le plaisir
ressenti par les élèves participant à la leçon
qu'il a conduit. Par ailleurs, l'alternance des regroupements est susceptible
d'améliorer l'estime de soi et d'atténuer l'émotion. En
considération de ce qui précède, une attention
particulière mérite d'être soutenue vers l'alternance des
APS sur l'estime de soi et le plaisir en EPS ressenti par les
lycéens.
- Problématique
En éducation physique et sportive (EPS),
« le plaisir constitue un état émotionnel
agréable, une réponse affective positive vis-à-vis de la
pratique sportive. Cet état émotionnel est la résultante
de multiples affectes, déterminés par divers
éléments de la situation vécue par le sujet. C'est
grâce au plaisir pris, aux efforts consentis, aux progrès
réalisés que les jeunes en formation comprennent les
bénéfices d'une participation à une activité
physique régulière tout au long de la vie. Le plaisir est la
résultante de l'alternance (Leca, 2009). En EPS, l'alternance est
effective dans la planification des APS et celle des situations
d'apprentissage. En effet, le projet pédagogique d'EPS constitue un plan
cohérent et transversal d'Activités Physiques et Sportives
faisant l'objet d'une mise en oeuvre dans une période scolaire en vue
d'atteindre les finalités de cette discipline, entre autres : la
gestion de la vie physique, l'éducation à la santé,
à la sécurité, à la citoyenneté, à la
responsabilité, à l'autonomie, à l'environnement, au
développement durable, au développement organique foncier et
moteur (Ewamela, 2005 ; p.14-15). Entsiro et coll. (2016 ; p.52), ont
rapporté que le développement des habiletés motrices au
cours d'un continuum d'apprentissage est lié au projet
pédagogique transversal. Ces auteurs ont précisé qu'un
projet pédagogique transversal est caractérisé par les
critères de conception, notamment : les installations sportives
scolaires, le matériel didactique, la logique intra et inter APS et du
principe de la transversalité des acquis en EPS. Ils ont ajouté
que la pratique alternée des APS implique le développement, la
fixation et le réinvestissement d'une habileté motrice tout au
long du continuum d'apprentissage.
Cependant, l'EPS est une discipline de faible valeur
sociale en milieu scolaire congolais. Cela est le reflet de l'organisation du
secondaire deuxième degré avec des séries qui sont
caractérisées par des matières spécifiques aux
coefficients plus élevés comparativement aux matières de
développement des compétences méthodologiques et sociales.
Il convient également de signaler les représentations sociales
des métiers en laissant pour compte le secteur de l'activité
physique bien qu'il soit indispensable au bien-être social. Cette faible
valeur sociale est renforcée par les projets pédagogiques qui ne
sont constitués que des disciplines athlétiques et de la
gymnastique dans les deux cycles du secondaire (Entsiro, 2018, p.82-103 ;
Mviri, 2018 ; p.118-119). Cela constitue une monotonie des APS
susceptibles d'induire un manque de plaisir chez les lycéens congolais
et suscite une interrogation à travers la question de recherche que nous
nous sommes posée.
- Question de recherche
La question de recherche est la suivante :
L'alternance des formes d'APS influe-t-elle sur l'estime de soi et le plaisir
en Education Physique et Sportive chez les lycéens Congolais?
- Hypothèse de recherche
Pour répondre à la préoccupation
sus énumérée, nous avons formulé l'hypothèse
suivante : L'alternance des formes d'APS induirait une amélioration
de l'estime de soi et du plaisir en Education Physique et sportive chez les
lycéens Congolais.
- Démarche méthodologique
Cette étude expérimentale s'adresse aux
élèves de la première scientifique du lycée
d'excellence de MBOUNDA (Dolisie) et à ceux du lycée de la
réconciliation de Mfilou (Brazzaville). Les deux cent trente et un (231)
participants ont été sélectionnés parmi les
élèves de deux établissements publics d'enseignement
général de deux grandes villes du Congo Brazzaville. Un
échantillon des élèves dans chaque lycée sera
tiré d'une manière non probabiliste. Deux groupes seront
formés à savoir : le groupe expérimental
constitué des élèves du lycée d'excellence de
MBOUNDA et un groupe témoin comprenant les élèves du
lycée de la réconciliation de Brazzaville. Nous soumettrons
à cet effet trois types de questionnaires afin de mesurer l'estime de
soi, le plaisir dans la pratique des APS et enfin l'évaluation sur
l'alternance des disciplines en éducation physique. Ces questionnaires
seront adressés aux deux groupes d'élèves de
l'étude (groupe expérimental et groupe témoin). Une
analyse statistique sera effectuée pour vérifier
l'hypothèse de recherche.
Outre la question de recherche, l'hypothèse et la
démarche méthodologie adoptées, il convient de
présenter les objectifs de l'étude.
- Objectifs de l'étude
Par la réalisation de la présente étude,
les objectifs spécifiques suivants ont été
fixés:
- évaluer l'estime de soi des élèves au
cours des activités physiques et sportives ;
- évaluer le plaisir pendant un projet
pédagogique requérant les regroupements en fonction des
APS ;
- identifier l'influence de l'alternance des APS sur les
élèves en Education Physique et Sportive.
- Intérêt du sujet
L'intérêt de cette étude est
d'amener les acteurs de l'EPS à prendre conscience de l'importance de
l'alternance des formes d'APS sur l'estime de soi et de susciter le plaisir des
élèves en Education Physique et Sportive. Elle se propose donc
une compréhension des conditions favorables d'améliorer les
performances dans le domaine des activités physiques et sportives.
Spécifiquement, elle vise à établir l'efficacité de
la planification pédagogique et de la programmation des activités
physiques et sportives en EPS.
- Délimitation du sujet
Cette étude explore les concepts (estime de
soi, plaisir en EPS et l'alternance des formes des APS) afin de permettre aux
enseignants à s'investir d'avantage en alternant les moyens de l'EPS
pour des raisons éducatives, par nécessité
pédagogique et motivationnel des apprenants dans le domaine des sciences
de l'éducation tenant compte du contexte de la pratique des
activités physiques et sportives dans les lycées du Congo. En
effet, elle se contentera principalement d'évaluer l'estime de soi et le
plaisir qu'éprouvent les élèves dans l'alternance de forme
de groupement des APS en éducation physique et sportive. Pour cela, elle
se limitera à étudier la possibilité d'inciter
l'enseignant d'EPS de prendre conscience sur l'importance de l'alternance des
Activités Physiques et Sportives dans le choix des tâches et
activités en EPS.
- Annonce des parties et chapitres
Après avoir indiqué la question de recherche,
l'hypothèse, et les objectifs de recherche et le cadre théorique
dans lequel s'inscrira ce travail, nous subdiviserons le document en deux
parties principales :
- la première partie situera le cadre théorique
de notre recherche : elle se proposera de revisiter la littérature
afférente sur l'alternance, l'estime de soi et le plaisir en EPS, et se
consacrera également aux travaux ayant exploré la question y
afférente dans les formes de groupement des activités physiques
et sportives d'une part, sur l'estime de soi et le plaisir qu'éprouvent
les apprenants dans la pratique des activités d'autre part ;
- la deuxième partie exposera notre démarche
méthodologique.
L'étude par sa mise en regard des apports, des
contributions aux différents objectifs poursuivis et la pertinence des
résultats obtenus ouvrira des applications pratiques en EPS. Elle
débouchera sur les perspectives de recherche et les suggestions
susceptibles d'améliorer la pratique de l'APS en EPS dans nos
lycées.
PARTIE I : Cadre Théorique
Chapitre I : Champ conceptuel et théories de
références
La présente étude est amorcée par
la clarification de trois concepts, à savoir : l'estime de soi, le
plaisir et le concept de l'alternance des APS sont des aspects primordiaux dans
la scolarité d'un apprenant, et donc un axe intéressant pour
notre recherche. Elle se focalise sur ces trois notions dans notre travail, en
faisant le lien avec l'éducation physique et sportive.
I.I.Définition des concepts
I.I.1. L'Estime de Soi
La vie humaine varie en fonction de l'estimation de la
valeur socio-affective autodéterminée de l'individu. Ainsi, si le
concept de soi est avant tout descriptif, l'estime de soi est principalement
affective. Coopersmith (1994) la définit comme «
l'évaluation que l'individu fait et qu'il entretient habituellement :
elle exprime une attitude d'approbation ou de désapprobation et indique
le degré selon lequel il se croît lui-même capable,
important, en pleine réussite et digne. En bref, l'estime de soi est un
jugement personnel de mérite qui s'exprime dans les attitudes que
l'individu véhicule vers les autres par des communications verbales et
par d'autres comportements expressifs ». Cette définition fait
référence à une image de soi-même plus ou moins
positive selon les différentes descriptions que l'individu
élabore à son égard.
La distinction entre le concept de soi (CDS) et
l'estime de soi a longtemps fait débat. Toutefois, il semble,
aujourd'hui, qu'une large majorité des chercheurs s'accordent sur les
différences qui existent entre ces deux construits. Les perceptions de
soi sont des jugements de nature évaluative concernant les
capacités et aptitudes que l'individu possède dans
différents domaines du CDS (« je suis un bon élève
», « j'ai de bonnes notes en français ») alors que
l'estime de soi est une évaluation affective de soi-même qui est
de manière générale plus globale et qui renvoie à
la manière dont les individus se sentent vis-à-vis
d'eux-mêmes (je suis malheureux de n'être pas meilleur
athlète) (Boleda et coll., 2004). Shavelson et coll. (1982 ;
p.3-17) ont fait remarquer que l'estime de soi est un composant global du CDS
qui apparaît au sommet du modèle hiérarchique. Ce composant
est spécialement prévu pour refléter des perceptions de
soi larges et générales qui ne sont pas attachées à
des domaines particuliers. Ce construit global au sommet de la
hiérarchie peut être inféré sur la base de
réponses à une échelle d'estime de soi relativement
unidimensionnelle et globale comme l'instrument proposé par (Shevlin et
coll., 1995 ; p.707-710) ou des échelles d'estime de soi qui font
partie de la plupart des instruments du concept de soi multidimensionnel
(Guérin et coll, 2004, pp 26 ; 19-38).
L'estime de soi est donc une variable globale, relative
à un niveau supérieur dans la hiérarchie du concept de soi
que ne le sont l'efficacité personnelle et le concept de soi. Puisque
la même personne peut avoir un concept de soi positif dans un domaine
(scolaire) et un concept de soi négatif dans un autre (social), une
mesure globale unique de l'estime de soi ne peut décrire de
manière adéquate le concept de soi dans différents
domaines. Ainsi, l'estime de soi a été critiquée comme
diminuant le pouvoir explicatif sur le comportement ; certains chercheurs
soutiennent même que l'estime de soi n'est pas un construit
particulièrement utile (Guérin et coll, 2001) et soulignent
l'intérêt d'utiliser des composants spécifiques du CDS plus
appropriés à un contexte (Harter, 1990 pp87-116). Sur cette base,
plusieurs théoriciens ont noté que les croyances sur soi
académique constituent une source d'influence potentiellement plus forte
sur la réussite à l'école que les croyances sur soi plus
générales comme l'estime de soi (Guérin, et coll, 2004, pp
19-38).
I.1.1. Définition originelle de l'estime de soi
et son évolution
Le concept de l'estime de soi, souvent assimilé
à l'amour-propre et au narcissisme, avait pris une connotation
péjorative puisque constamment associé à la vanité
et à la culpabilité. L'estime de soi est le regard que l'on porte
sur soi, la façon dont on se perçoit ou dont on s'évalue.
Elle est donc basée sur un sentiment vis-à-vis de soi-même
: je m'aime plus ou moins, je me vois et me traite alors en conséquence.
Notre amour propre dépend principalement de la façon dont nous
avons été aimés et estimés étant enfants.
Larivey (2002) a présenté l'estime de soi comme le
résultat d'une auto-évaluation, d'un baromètre
révélant dans quelle mesure nous vivons en concordance avec nos
valeurs. L'estime de soi représente donc combien je me considère
valable. Autrement dit, l'estime de soi est un sentiment qui met en valeur
l'ensemble de nos traits physiques, mentaux et spirituels, constituant la
personnalité. Celui-ci peut changer avec le temps, car vers l'âge
de cinq ou six ans, l'enfant commence à avoir une notion de comment les
autres le perçoivent. Il est essentiel de préserver une bonne
estime de soi, puisqu'elle a tendance à se constituer comme un
symptôme répété dans beaucoup de problèmes
comportementaux. C'est ainsi que certains psychologues décrivent
l'estime de soi comme la fonction de l'organisme qui permet l'autoprotection et
l'épanouissement personnel, le manque d'estime de soi faisant du tort
à la santé, aux relations sociales et à la
productivité.
Mais l'intérêt porté par les
scientifiques sur l'estime de soi ne date pas d'aujourd'hui. Ce concept fut
défini et analysé par Battle (1991) en terme anglais de «
self-estim » (estime de soi) en le mettant au coeur de la personne pour
ainsi relever qu'il s'agit du rapport entre les réussites et les
aspirations, entre les résultats et les échecs des tâches
à accomplir. Il décrit l'estime de soi comme la « conscience
de la valeur du moi » qui s'explique d'après un autre rapport : le
soi réel / le soi idéal. Plus le rapport est
équilibré, plus l'individu s'oriente vers une estime de soi
favorable. Donc l'estime de soi pourrait découler de plusieurs
paramètres : en obtenant des réussites, en limitant les exigences
ou en harmonisant le rapport entre les deux.
En 1902, Cooley l'a décrit quant à lui
comme une construction sociale : l'estime de soi est définie socialement
et serait façonnée par un ensemble d'interactions de l'individu
(les pensées, le jugement, les actes, etc.). D'après lui c'est le
regard des autres qui permettra à l'individu de comprendre ce que les
autres pensent de lui, tel un miroir, partie intégrante de la perception
de soi.
En 1943, Maslow a identifié en l'estime de soi un
besoin fondamental intégré dans sa pyramide. Il en ressort
là aussi un élément clé : on ne peut pas se lancer
dans un projet de vie sans répondre au préalable au besoin
d'estime de soi.
En 1995, Martinot propose une autre définition de
l'estime de soi : « Ensemble des éléments qui nous
définissent, composé des attitudes, des croyances et des
sentiments que les individus ont d'eux-mêmes ». Cette
définition s'oriente davantage sur le sujet, tout en considérant
l'aspect sociétal qui ressort des attitudes. Selon Laporte (1997),
l'estime de soi renvoie à la valeur que l'on s'attribue soi-même
dans les multiples sphères de notre vie et à notre sentiment de
dignité : digne d'être aimé, de réussir, de
grandir...etc. André (2005, pp26-30) définit l'estime de soi
comme un élément essentiel de la personnalité,
située au carrefour des trois composantes fondamentales du Soi :
comportementale, cognitive et émotionnelle. Elle comprend des aspects
comportementaux (en influençant nos capacités à passer
à l'acte et en se nourrissant de nos succès) et cognitifs (elle
est étroitement liée au regard que nous portons sur
nous-mêmes). Enfin, selon lui, l'estime de soi reste pour une grande
partie de l'ordre de l'affectif du fait qu'elle dépend de notre humeur,
qu'elle influence de manière importante en retour.
En résumé l'estime de soi est un concept
étendu et relativement difficile à définir, cependant nous
pouvons dire à l'heure actuelle que l'estime de soi résulte d'une
construction psychique ainsi que d'une activité cognitive et sociale.
Son élaboration s'exerce tout au long de la vie de l'individu.
I.1.2. Comment se construit l'estime de
soi
Si l'objectif éducatif est d'augmenter l'estime
de soi des élèves, une compréhension claire des processus
qui la détermine est indispensable. D'où l'importance capitale
d'avoir une théorie qui identifie clairement ses déterminants et
ces implications potentielles.
I.1.2.1. Le développement de l'estime de soi
Le lien corps et esprit s'inscrit dans une approche
biologique dans la mesure où la personne dispose d'un héritage de
caractère légués à lui par des parents et est
capable de modifier son appréciation globale, ses dimensions physiques
(force, vitesse, endurance, capacité compétitive, ...). Selon
Battle (1993) et Roy et coll. pp813-820 (1995), l'estime de soi subit
dès la naissance, une influence biologique de par sa composante
génétique. Steffenhagen et coll. (1990) abondent dans le
même sens en disant que « l'humain est essentiellement un organisme
biologique (soi physique) avec certains besoins. Ces besoins se
complètent à travers des relations sociales ».
L'estime de soi se développe donc graduellement
au fur et à mesure qu'une personne atteint sa maturité et
interagit avec les autres (Battle, 1993). Cet auteur a notifié qu'une
perception individuelle du soi se développe graduellement et devient
plus différenciée quand il/elle atteint une maturité et
qu'il/elle interagit avec d'autres personnes signifiantes. Cependant, l'estime
de soi se stabilise vers le milieu de l'adolescence. En effet, l'estime de soi
réfère à la perception qu'un individu possède de sa
propre valeur. La perception de sa propre valeur, lorsqu'elle établit,
tend à être relativement stable et résistante aux
changements Battle (op. cit.).
L'estime de soi subit à la fois une influence
génétique et sociale. En fait, le développement de
l'estime de soi représente une expérience subjective. Elle
devient l'expression de l'assurance avec laquelle un individu croit en ses
capacités de réussite, en sa valeur sociale et personnelle, qui
se traduit aussi bien verbalement que par des comportements significatifs. Une
personne adopte donc une attitude positive ou négative envers
elle-même et cette attitude se construit dans différents domaines
d'activité: vie familiale, sociale et professionnelle et par la
perception générale de soi (Coopersmith, 1994).
L.1.2.2. Développement de l'estime de soi chez
l'enfant
La construction de l'estime de soi chez l'enfant prend
corps dans l'imaginaire des parents avant qu'il naisse. L'enfant est
fantasmé, des qualités lui sont attribuées et on
l'insère dans les nouveaux projets de la famille. Les aspirations ainsi
portées sur le bébé créent les premiers enjeux
interactionnels, base de l'élaboration de l'estime de soi. L'impact de
la qualité des relations mère-enfant est alors très
important induit un attachement précoce entre les deux qui influence
pendant longtemps l'estime de soi de l'enfant. La théorie de
l'attachement de Bowlby (1982) expose la construction d'un modèle
intérieur au cours des premiers liens sociaux que le bébé
fonde avec sa mère, son père ou toute autre personne suffisamment
proche de lui. Le nourrisson s'imprègne des caractéristiques de
son milieu et les intègre. Le début de sa vie psychique est ainsi
organisé d'après ce modèle interne grâce auquel il
peut traiter les informations et y répondre. Les travaux de Cassidy,
pp58 (1988) confirment ce lien étroit entre la qualité de
l'attachement précoce à la mère et l'estime de soi de
l'enfant.
Le regard des parents renvoie une image à
l'enfant qu'il va petit à petit intégrer en lui, en se
constituant une image plus ou moins bonne. C'est à partir de 8 ans que
l'enfant apprend progressivement à se baser sur les résultats de
ses propres actions (Perlow, 1992, pp106). Les recherches démontrent
que les premières relations que le bébé, puis le jeune
enfant entretient avec son entourage influencent cette élaboration de
l'estime de soi. Il faut cependant un acte gratuit au départ, une
portion d'estime accordée à l'enfant sans qu'il fasse quoi que ce
soit pour le mériter (Goumaz, 1991). Cet amour inconditionnel dès
le commencement de la vie de l'enfant pose les bases de sa future estime de
soi. A son tour, Winnicott (1969) met l'accent sur l'impact de la
qualité des interactions mère-enfant sur cette construction. Un
développement sain serait favorisé par l'action d'une mère
« suffisamment bonne », répondant rapidement et de
façon adaptée aux besoins de l'enfant.
De son côté, Harter (1999, pp87-116)
insiste sur l'aspect fondamental de l'approbation dont l'enfant a pour
encourager certains de ses comportements en tant que source d'informations
adéquate de réalisation de ses performances. Ces stimulations
positives jouent donc deux rôles : ils apportent de l'encouragement et de
l'affection, tout en favorisant les processus d'indépendance et de
maîtrise personnelle.
En grandissant, l'enfant va intérioriser un
système de buts à atteindre, ou de règles. Au fur et
à mesure qu'il intègre ces normes, la dépendance à
un processus externe va diminuer, et les renforcements positifs de ce
système ne joueront plus un rôle développemental,
même si l'enfant en aura toujours besoin. L'enfant arrive peu à
peu à mettre en relation l'importance donnée à certains
domaines et l'évaluation de soi-même. L'estime de soi est alors
influencée par la façon dont l'enfant, puis l'adolescent
reconnaît ses compétences dans des secteurs où la
réussite est fondamentale (Cassidy, 1988 pp58).
I.1.2.3. Différences entre garçons et
filles au niveau de l'estime de soi
Depuis ces dernières décennies, les
standards concernant les caractéristiques corporelles désirables
telles que la minceur sont devenus incroyablement irréalistes et
exigeant pour les femmes. Si l'on considère la plupart des magazines
féminins contemporains, on s'aperçoit que les standards sont pour
elles à la fois paradoxal et contraignant. Tous ces magazines insistent
de manière répétée sur le fait: (a) qu'elles
doivent très fortement faire attention à leur apparence (cheveux,
visage silhouette et particulièrement à leur poids) (b) mais en
même temps elles doivent cuisiner une grande variété de
nourriture riche pour elle-même et leurs familles. De plus, ces articles
insistent de manière constante sur le fait qu'elles peuvent modifier
leur propre apparence afin d'approcher les stéréotypes culturels
de beauté, souvent en utilisant des crèmes amaigrissantes, des
cosmétiques invasifs, etc (Ninot et coll., 2000, pp35-48).
Bien que les médias soulignent aussi de
manière croissante l'importance de l'apparence pour les hommes, il
semble qu'ils aient plus de latitude dans leurs standards d'apparence. De plus,
pour eux, il n'y a pas la centration singulière sur l'apparence comme
étant la voie pour l'acceptation et l'estime de soi que l'on trouve pour
les femmes. Pour les hommes, l'intelligence, la compétence au travail,
l'habileté sportive, la richesse et le pouvoir sont d'autres voies pour
une évaluation positive aux yeux des autres aussi bien qu'à ses
propres yeux. Il existe une diminution forte dans l'estime de soi des filles en
fonction de l'âge et à l'inverse une stabilité plus grande
chez les garçons. De tels résultats ont été
trouvés chez les jeunes des pays anglo-saxons.
Les différences garçons-filles dans
l'estime de soi s'accroissent en effet fortement en fonction de l'âge.
Débutant au collège, puis au lycée et finissant à
l'université, l'estime de soi est constamment inférieure pour les
filles lorsqu'on la compare à celle des garçons. Ce qui est
intéressant c'est que cette diminution de l'estime de soi avec le
développement, est parallèle à la trajectoire de
diminution de l'apparence physique perçue. (Ninot et coll, 2000,
pp35-53). Les données scientifiques révèlent en effet que
pour les filles, les perceptions d'apparence physique déclinent
pratiquement avec le niveau de classe, tandis qu'il n'y a pas une telle chute
pour les garçons. Dans l'enfance moyenne, les filles et les
garçons se perçoivent à peu près également
sur la dimension apparence physique, mais à la fin du lycée, les
scores des filles sont très inférieurs à ceux des
garçons. Les perceptions décroissantes de l'apparence physique
chez les filles paraissent ainsi contribuer à la diminution de leur
estime de soi. Une telle évolution vers le bas de l'estime de soi chez
les filles s'explique par la difficulté de plus en plus grande pour elle
de coïncider avec les stéréotypes culturels d'apparence
physique dont les contraintes paraissent augmenter pendant le cours du
développement (Ninot et coll, 2000, pp35-53).
I.1.3. Estime de soi et compétence
perçue
L'apparence physique semble être une des causes
principales de l'estime de soi de même que la compétence
perçue n'en joue pas moins un rôle important. La compétence
perçue contribue certes à l'estime de soi mais nettement moins
que l'apparence d'autant plus que la relation est médiatisée par
l'importance perçue du domaine dans lequel on se sent compétent.
En effet, les élèves se centrent principalement sur les domaines
qui sont importants pour eux, c'est-à-dire ceux où ils
désirent réussir. Ainsi, si on se perçoit comme
compétent dans les domaines où l'on aspire à exceller on
aura une haute estime de soi. A l'inverse, si l'on est loin de son idéal
en ne réussissant pas dans les domaines où l'on aspire à
être compétent, il en résultera une basse estime de soi
(Ninot et coll., 2000, pp35-53).
I.1.4. La fonction de l'estime de soi
Les théories actuelles considèrent
l'estime de soi comme une mesure ou une jauge psychologique qui aide les
personnes à enregistrer la qualité de leurs relations avec les
autres. Les sentiments d'estime de soi d'une personne sont un indicateur ou un
marqueur subjectif interne du degré selon lequel elle se sent incluse
versus exclus par les autres personnes (le statut d'inclusion d'une personne).
Ces approches théoriques se sont basées sur la supposition que
les êtres humains possèdent un besoin puissant de former et de
maintenir au moins à un minimum une quantité de relations
interpersonnelles durables, positives, et significatives. Elles indiquent que
les sentiments d'estime de soi fluctuent vers le haut ou vers le bas en
fonction de la manière dont la personne ressent qu'elle est
acceptée ou rejetée.
Les indices qui connotent l'acceptation induisent une
haute estime de soi tandis que ceux qui indiquent un rejet la diminuent.
Lorsque de tels indices ne sont pas présents, la personne
n'éprouvera aucun sentiment de valeur de soi (bien que de tels
sentiments puissent survenir en privé si la personne se rappelle
où imagine des événements d'acceptation et de rejet).
Ainsi l'estime de soi peut être considérée comme un
résumé des événements survenant dans
l'environnement social (Ninot et coll., op. cit.). Ceux qui affectent l'estime
de soi sont précisément ceux qui influencent l'acceptation de la
personne par les autres personnes.
L'estime de soi est blessée plus souvent par
l'échec, la critique, le rejet, etc. - des événements qui
ont des implications pour l'acceptation des autres vis-à-vis de nous.
Elle s'élève lorsque nous réussissons, nous sommes
louangés, où nous expérimentons l'amour d'un autre - tous
des événements qui sont associés avec une acceptation
élevée. Ce mécanisme psychologique faits trois choses.
D'abord, il enregistre continuellement dans l'environnement social les indices
qui indiquent la possibilité d'exclusion sociale. Les personnes sont
très sensibles aux indications que les autres ne les aiment pas, les
désapprouvent, où les rejettent. Ensuite, il alerte la personne
lorsque de tels indices sont détectés. Comme beaucoup d'autres
«systèmes d'alerte», il s'appuie sur les émotions pour
faire ceci, attirant l'attention de la personne grâce aux émotions
négatives qui sont associés aux menaces sur l'estime de soi.
Troisièmement, il motive les comportements qui diminuent la
probabilité d'exclusion (Ninot et coll., 2000, pp35-48).
I.1.4.1. L'estime de soi est un jugement
évaluatif
L'estime de soi reflète le discrédit ou
le crédit perçue entre le soi réel et un état de
soi idéal. Une des réponses les plus fondamentales à tout
objet est l'évaluation. Les jugements évaluatifs reflètent
le degré selon lequel nous répondons aux choses comme
étant bonne ou mauvaise, aimable ou détestable, positive ou
négative, etc. De tels jugements sont extrêmement importants pour
distinguer les objets, les personnes, les idées, les choses, où
les endroits. Lorsque les réponses évaluatives sont
associées à son propre soi, on parle d'estime de soi. L'estime de
soi est une réponse évaluative envers le soi. Cette
réponse évaluative implique des jugements de bon - mauvais (Ninot
et coll., op. cit.).
I.1.4.2. Motivation et estime de soi : le motif de
valorisation de soi
La recherche la plus récente sur le soi a mis
en évidence quatre catégories générales de motifs
qui sont : 1) la connaissance du soi, 2) la valorisation de soi, 3) la
vérification de soi, et 4) le perfectionnement de soi.
La connaissance de soi fait schématiquement
référence au désir d'avoir des preuves certaines et
précises sur ses propres traits, habiletés et des preuves qui
confirment ses propres évaluations de soi. La valorisation de soi fait
référence au désir d'obtenir des feed-back positifs sur
soi et inclue à la fois des impulsions auto protectrices
déclenchées par des expériences négatives ou
menaçantes et la pulsion d'avoir un sens positif du soi. Le motif de
vérification de soi correspond à un besoin de consistance de soi.
Swann (1987, pp1038-1051) a étudié comment les personnes avec des
vues très négatives d'elles-mêmes répondent à
des feed-back positifs et flatteurs. Cet auteur a observé la
préférence des personnes de voir leurs vues de soi peu flatteuses
confirmées plutôt que de recevoir une gratification ou une
approbation sociale qui les déstabilise. Enfin, le motif de
perfectionnement du soi fait référence au désir de
s'approcher au plus près de ce qu'on aimerait idéalement
être.
Les biais d'auto complaisance évoqués
antérieurement correspondent essentiellement au motif de valorisation de
soi. Les élèves se doivent de préserver leur estime de soi
lorsqu'ils sont régulièrement exposés au regard et au
jugement d'autrui mais surtout régulièrement confrontés
à l'échec. C'est même là une condition sine qua non
s'ils veulent espérer évoluer et progresser sereinement. Comme
cela a été souligné précédemment, le motif
de valorisation de soi peut se subdiviser en deux
sous-catégories :
- dans la première, les personnes pensent,
agissent et se perçoivent de telle sorte que l'estime de soi soit
maximisée. La première tendance a été
appelée valorisation de soi ;
- dans la seconde catégorie, les
stratégies consistent à penser, à agir et à se
percevoir de telle sorte que des menaces négatives sur l'estime de soi
soient minimisées. Il s'agit là des tendances auto protectrices
qui sont déclenchées lorsque des expériences
négatives ou potentiellement menaçantes pour l'estime de soi sont
présentes. Cette seconde tendance est liée à la protection
de soi. Bien que sur certains aspects, les stratégies au service de la
valorisation de soi et celles au service de la protection de soi semblent
être similaires, elles diffèrent néanmoins selon un certain
nombre de points importants (Ninot et coll., op. cit.).
I.1.4.3. L'importance de l'estime de soi en
éducation physique
La bonne estime de soi est un facteur influant de la
réussite scolaire. Cependant, le développement de l'estime de soi
chez l'enfant est un but essentiel de tous les programmes d'éducation.
En effet, les conceptions de soi de réussite scolaire peuvent influencer
la réussite en agissant sur la motivation (Biddle et Goudas, 1994,
pp135-144). De ce fait, la notion d'estime de soi prend aujourd'hui une place
importante dans la scolarité. Mais qu'en est-il dans le domaine de
l'éducation physique ? « Il est désormais admis que le
domaine corporel participe à la construction et à la
structuration de l'estime globale de soi (Biddle et Goudas, op.cit) et plus
particulièrement chez les adolescents (Harter, 1999 ; Ninot, 2000,
p. 18). Il s'agit donc de voir quelles dimensions de l'estime de soi sont
liées à l'Education physique. D'une manière
générale, chez l'enfant, les dimensions qui composent l'estime de
soi sont : l'aspect physique, la réussite scolaire, les
compétences athlétiques, la conformité comportementale et
la popularité (André, 2005). La dimension liée aux
compétences athlétiques constitue l'aspect intéressant
dans l'activité physique qui a une influence sur l'estime de soi (Biddle
et Goudas, op. cit.).
La perception du corps a une importance dans la
construction de l'estime de soi en Education Physique et Sportive et en
Psychologie du sport. Il s'agit d'une conception positive de soi serait
porteuse d'une dynamique de succès (Martinot, 1995). La
littérature récente fait de ce concept une variable
déterminante au niveau de l'engagement d'un sujet dans une pratique
physique (Ninot et coll., 2000, pp35-48). Les travaux ces auteurs ont mis en
évidence que le développement de la valeur physique perçue
contribuait au renforcement de l'estime de soi et qu'un certain niveau de
confiance en soi était requis pour maintenir l'engagement d'un sujet
dans une pratique physique.
L'estime de soi est liée à la
motivation. Les recherches qui ont fait le lien entre pratique sportive et
estime de soi s'accordent donc à dire que cette dernière
influence, sans conteste, la motivation et donc la performance des sujets.
Selon Martinot (1995 ; p. 486) « à compétence
égale, pour améliorer ses performances, ce que l'on croit
être capable de faire semble aussi important que ce que l'on est capable
de faire ». Une étude de Sonstroem basée sur l'estimation ou
habileté physique perçue qu'il définit « comme une
variable mentale contenant affect et cognition permet de relier le domaine
physique avec l'état psychologique d'estime de soi ». Sonstroem
cité par Nonot et coll. (2000 ; p. 20) a établi le lien
entre la participation à l'exercice et l'estime de soi. Ainsi, le
modèle présenté par Sonstroem propose que la
compétence sportive perçue engendre un plus fort
intérêt pour les activités physiques (Ninot et coll.,
op.cit.). Ces auteurs ont ensuite relevé que l'estime de soi est un
facteur important dans la performance sportive et dans l'implication et la
participation aux activités sportives. Ils ont enfin souligné que
l'estime de soi peut se modifier au gré des situations dans lesquelles
se trouvent les sujets.
I.1.4.4. Différence entre Estime de soi et
concept de soi
La question de la distinction conceptuelle entre les
notions de concept de soi et d'estime de soi a généré un
grand débat. Shavelson et coll. (1982, pp3-17) ont à ce sujet
souligné les confusions qui entouraient ces deux termes ;
résultats d'un manque de clarification conceptuelle et empirique. Il
semble qu'il y ait maintenant un accord assez large entre les chercheurs sur
les différences qui existent entre ces deux construits. Le concept de
soi dont les perceptions de compétence font partie renferme des
jugements de nature plus cognitive et évaluative sur les
habiletés et les aptitudes personnelles que l'on possède dans des
domaines particuliers (la croyance que l'on est capable d'apprendre à
faire de l'équitation, que l'on peut bien jouer au football ou encore
que l'on peut se faire des amis). En revanche, l'estime de soi est une
évaluation de soi-même plus globale qui provoque des
réactions de nature plus affective (un élève se sent
honteux vis-à-vis de lui-même parce qu'en cafouillant dans une
partie de football il est apparu comme incompétent). Le sentiment
individuel de valeur personnelle ou d'estime de soi, est dans une certaine
mesure dépendant de l'importance que revêt pour la personne chacun
des composants descriptifs du concept de soi dans différents domaines
(Rosenberg, 1979).
Le concept de soi se repose sur des évaluations
cognitives de la compétence dans certains domaines (« je suis bon
en gymnastique ») et non une mesure générale de l'estime de
soi qui concerne la manière dont les individus peuvent se sentir
vis-à-vis d'eux-mêmes (« je suis heureux de la façon
dont je suis »). L'estime de soi est essentiellement la dimension
évaluative et affective du concept de soi. Tout élément
d'informations sur le soi peut être incorporé dans le concept de
soi. Il affecte seulement l'estime de soi une fois qu'il prend un jugement de
valeur : est-ce bon ou mauvais ? Si une haute estime de soi signifie penser du
bien de soi-même, ceci peut inclure une confiance en soi saine et une
appréciation appropriée de ses propres accomplissements et
habiletés authentiques. Elle peut aussi exagérer ou distordre
largement la vérité. Une haute estime de soi peut signifier
être vaniteux, et caustique, arrogant, et narcissique. Le trait commun
est de penser du bien de soi-même - indépendamment que ceci soit
justifié ou non. (Rosenberg, 1979).
I.1.4.5. Le Concept de soi physique
Le concept de soi physique qui constitue l'une des
dimensions du concept de soi global se différencie lui aussi en
plusieurs sous-domaines. La version la plus actuelle des différentes
facettes du concept de soi physique est celle de Marsh (1998, pp237-257). Elle
distingue neuf dimensions spécifiques : Santé, Coordination,
Activité physique, Adiposité, Compétence sportive,
Apparence physique, Force, Souplesse, Endurance, et deux composants
évaluatifs/ affectifs globaux: Satisfaction physique globale et Estime
de soi globale (Famose, 2001 ; Famose et Guérin, 2002,). Les
différentes dimensions du concept de soi physique, ont été
validées par Guérin et coll. (2004, pp19-38) en Français,
le questionnaire de description de soi physique qui permet d'évaluer
comment chacun se situe sur l'ensemble de ces dimensions (Force, Embonpoint,
Activité physique, Endurance, Compétence sportive, Souplesse,
Coordination, Apparence physique, Santé, Concept de soi physique global,
Estime de soi). (Famose, 2001).
I.2. Le Concept de Plaisir
En Education Physique et Sportive (EPS), la
thématique du plaisir en est à ses balbutiements même si le
plaisir tout au long du XXème siècle a
accompagné clandestinement son évolution. Georges Sand (1991),
écrivait dans la comtesse de RlIdolsladt : «Laissez-moi fuir la
menteuse et criminelle illusion du bonheur. Donnez-moi du travail, de la
fatigue, de la douleur et de l'enthousiasme! ». Une interrogation sur le
lien possible entre le travail, la fatigue, la douleur et paradoxalement,
l'enthousiasme. La réflexion sur le travail hardent pour être
heureux, génère l'enthousiasme de continuer et donc le
« plaisir » (Csikszentmihalyi, 2004). Un état
psychologique de bien être est un ensemble d'émotions positives
déclenché par une pratique des APSA individuelles ou collectives
en EPS.
I.2.1. Définitions et conceptualisations du
plaisir
I.2.1.1. Définition
générale
Le plaisir constitue un état de contentement
que crée chez quelqu'un la satisfaction d'une tendance, d'un besoin,
d'un désir. Il s'agit d'un état affectif éminemment
subjectif, car éprouvé par le sujet. Cet état est
manifeste lors de l'accomplissement des besoins primaires et de la pratique de
l'activité physique. Cela est perceptible chez le très jeune
enfant qui prend simplement du plaisir à être en mouvement,
à éprouver ses sens ou à utiliser son corps pour
être cause de quelque chose (jeu d'exercice).
I.2.1.2. Définition du plaisir en
EPS
En éducation physique et sportive, « le
plaisir est généralement défini comme un état
émotionnel agréable, une réponse affective positive
vis-à-vis de la pratique sportive (Delignières et Perez, 1998, pp
7-18). Cet état émotionnel est la résultante de multiples
affects, déterminés par divers éléments de la
situation vécue par le sujet. Scanlan et Lewthwaite (1986, p25-35) ont
proposé de classer ces éléments selon deux axes :
- le premier rendant compte de leur caractère
intrinsèque ou extrinsèque. Les éléments
intrinsèques sont directement liés à la pratique de
l'activité, c'est-à-dire qu'ils sont générés
par l'interaction entre le sujet et la tâche. Dans ce cadre, le sentiment
de compétence constitue un exemple d'élément
intrinsèque lié à l'accomplissement, et l'excitation
liée à la prise de risque constitue plutôt un
élément intrinsèque non lié à
l'accomplissement. Les éléments extrinsèques renvoient
à des facteurs environnementaux: dans ce cadre, les feedbacks positifs
que le sujet reçoit à travers sa performance sont un exemple
d'éléments extrinsèques liés à
l'accomplissement, et la satisfaction des besoins d'affiliation constitue
plutôt un élément extrinsèque non lié
à l'accomplissement ;
- le second tenant compte de leur relation à
l'accomplissement.
I.2.2. Relation avec les interventions de
l'enseignant
L'enseignant d'EPS intervient constamment sur les
éléments de la situation vécue par le sujet ». Elle a
donc le pouvoir de susciter ou de ne pas susciter le plaisir ressenti par les
élèves participant à la leçon qu'il conduit. La
notion de plaisir devant son émergence au domaine de la psychologie de
la motivation détermine la compétence. La notion de besoin de
compétence mise de l'avant stipule que les individus cherchent
continuellement à améliorer leurs performances ainsi qu'à
maîtriser leurs actions (Vescio et coll., 2002, p47-52).
I.2.3. Considérations générales
sur le plaisir et les plaisirs en éducation physique
Le plaisir est une réalité
familière. Au-delà du mot, il semble intéressant de
s'intéresser au processus de plaisir aboutissant à des ressentis
plaisants, agréables, bref, des ressentis de plaisir. Ce processus est
commun aux animaux, aux humains et donc aux élèves à
l'Ecole. Il accompagne les phénomènes d'adaptation et l'on peut
même dire qu'il est l'indicateur d'une adaptation réussie. Un
individu s'adapte à l'aide d'apprentissages qui ont presque toujours une
dimension corporelle. Cette dimension corporelle est particulièrement
développée en Education Physique où se déroule
toute une batterie d'apprentissages. Tout cours d'EPS est donc un moment
propice pour qu'y soient générés des plaisirs et aussi des
déplaisirs. Il ne faut jamais oublier que plaisir et déplaisir
sont les deux faces indissociables d'un même processus. Le
plaisir-déplaisir qui colore
agréablement-désagréablement tout état psychique
conscient est instable, fugace, réversible. Mais le plaisir étant
une source puissante de motivation, il peut être tentant pour les
pédagogues de vouloir en instrumentaliser l'usage (Delignières et
coll., 2000, p77-90).
I.2.3.1. Approche du Plaisir en EPS
Le discours sur le plaisir en EPS s'offre aux
multiples voies d'investigations tant en fonction des sources que du ressenti.
Afin de mieux cerner les enjeux et de présenter une
problématisation des déterminants du plaisir en EPS, il serait
nécessaire de s'intéresser à son rôle dans le cadre
d`une discipline scolaire. En effet, pourquoi accorder autant d'importance
à la question du plaisir en EPS ? Porterait-il des bienfaits aux
élèves dans le cadre d'autres disciplines scolaires et à
la nature de ses déterminants ? Les " déclencheurs " du
plaisir de l'élève en EPS sont-ils généraux,
inhérent à toutes les activités (la fameuse volonté
de développer une approche à caractère ludique) et
à la nature de certaines activités ? Ces "
déclencheurs " du plaisir de l'élève en EPS ne
relèvent-ils pas davantage d'une « mécanique » plus
contextuelle liée à l'expérience que revêt pour
l'élève l'engagement dans telle ou telle APSA ? (interaction
élève / activité) ? Peut-on généraliser les
sources de plaisir en EPS de la 6ème à la terminale sans prendre
en compte l'histoire des expériences corporelles de chacun d'eux ? De
cette interrogation, il ressort une des raisons qui donnent à cette
source de plaisir un statut particulièrement important en EPS. Il a
été rapporté à ce sujet que le plaisir
éprouvé lors de la réussite en EPS participe d'une
certaine manière à la construction identitaire de l'adolescent
dans son rapport à l'activité physique, mais plus encore dans son
rapport à l'activité corporelle, et très certainement
à la place de cette dernière dans son schéma de
personnalité (Famose, 2002).
I.2.3.2. Nature des critères
d'évaluation en rapport avec le plaisir
Nature des critères d'évaluation est un
élément clef vis-à-vis de la problématique du
plaisir en EPS. Aux côtés du caractère émotionnel et
affectif que peut revêtir l'acte d'apprentissage ? Il paraît
incontournable d'envisager une seconde problématique si l'on souhaite
éclairer les mécanismes du plaisir chez les élèves
en EPS : celle relative aux conceptions et mises en oeuvre de
l'évaluation. Il nous semble effectivement, que la nature des
critères et le niveau des exigences qui en découle pour
l'évaluation des acquisitions de l'élève dans le cadre des
épreuves certificatives, qu'ils soient choisis (épreuves
certificatives élaborés par les équipes en
collège), ou imposés par les fiches du Baccalauréat pour
le lycée, peut parfois altérer non seulement la reconnaissance de
l'engagement de l'élève dans le processus d'apprentissage, mais
également la validation d'authentiques transformations du point de vue
des acquisitions attendues en EPS (Rosenberg, 1979).
L'évaluation consiste à mesurer les
progrès de l'élève qui dépendent du plaisir
ressenti au cours de l'apprentissage en raison d'un choix d'indicateur
inapproprié pour rendre compte de ce qui a été
transformé en une unité effective d'apprentissage. Cependant, une
évaluation axée exclusivement sur la performance réduit le
niveau d'engagement de l'élève. Il a été
rapporté à cet effet que dans le pire des cas parfois, les cadres
évaluatifs auxquels les enseignants sont tenus de se
référer (barème de performance) condamnent même
certains élèves à ne pas réussir malgré
toute la qualité et la persévérance de leur engagement
dans le cycle d'enseignement (les aptitudes à l'effort sont une source
d'hétérogénéité génétique)
(Ninot, 2000, p53). Ainsi de telles expériences de pratique physique
peuvent laisser des impressions très négatives chez
l'élève en raison du sentiment de ne pas être en mesure de
répondre à ce qui est attendu à l'école et ce en
dépit d'un réel effort en vue de mobiliser au maximum ses
ressources.
I.2.3.3. Le plaisir et la motivation
Le plaisir qu'éprouve l'élève
dans l'apprentissage moteur traduit la motivation intrinsèque qui
correspond à la relation positive engendrée par l'interaction du
sujet à la tâche. Wankel et Kreisel (1985, p51-65) ont
montré que les sources de plaisir intrinsèques telles que
l'amélioration de ses habiletés (le progrès) et la
maîtrise de la tâche sont prépondérantes chez des
enfants âgés de 7 à 14 ans dans les trois pratiques
sportives suivantes (football, hockey et base-ball). Par ailleurs, le plaisir
peut aussi être étudié en tenant compte du contexte et des
feed-back positifs (encouragements...). A la motivation intrinsèque,
s'ajoute la motivation extrinsèque ressortie dans la théorie de
l'autodétermination représente la motivation (Deci et Ryan, 1991,
p237-288).
I.2.3.4. Le Plaisir en EPS
Jeu
Défi
Se sentir reconnu
Nouveauté
Se sentir intégré
Plaisir en EPS
Risque
Se sentir libre
Se sentir compétent
Figue 1 : les sources du plaisir en EPS (Leca 2009)
La réussite de l'enseignement est
déterminée par les conditions favorables à
l'activité ludique des enfants et des adolescents en EPS et le respect
des exigences de l'apprentissage. Cela engendre le plaisir des
élèves qui est source d'évolution. En effet, les
élèves prennent du plaisir à progresser si leurs buts sont
orientés vers la tâche, d'où l'importance d'un climat
motivationnel de maîtrise en EPS (Haye, 2004). Biddle et coll. 2003,
p687-701) ont montré que l'adoption de buts de maîtrise et/ou la
perception du climat de la classe comme orienté vers la maîtrise
de la pratique accroît le plaisir éprouvé. Les enfants et
les adolescents ont un fort besoin de liberté. Par ailleurs, les
études ont montré que le sentiment d'autodétermination
était une source d'affects positifs (Deci et Ryan, 2002). Le plaisir
lié au sentiment de liberté peut s'épanouir avec
l'«évasion » des dimensions temporelles, matérielles,
spatiales, groupales, institutionnelles habituellement associées
l'École. Le plaisir en EPS, c'est également se sentir
intégré au sein d'un groupe, reconnu par les autres, participer
à un projet commun, « être avec les copains » (Haye,
2004).
I.3. Concept de l'alternance
I.3.1. Définition du concept
alternance
L'alternance peut être définie comme la
pédagogie de la confrontation. Elle nécessite une mise en
cohérence forte et affirmée des périodes d'alternance,
ainsi qu'une démarche pédagogique particulière. Dans la
plupart des cas, il s'agit de penser à un apprentissage partant de
l'expérience et non de concepts théoriques, afin d'exploiter les
situations de travail comme autant de problèmes à
résoudre. En bonne logique, la recherche d'une cohérence du
dispositif au regard des objectifs de formation affichés devrait
conduire à privilégier un dispositif pédagogique,
s'articulant autour d'une mise en cohérence des savoirs à partir
de l'analyse d'une situation professionnelle, plutôt qu'une organisation
pédagogique centrée sur un découpage disciplinaire des
contenus de formation. (Maubant P 1997, p.141)
D'un point de vue pédagogique, l'alternance est
définie, selon Christian Lenoir, « comme un processus d'association
à parité stipulant que la formation professionnelle
alternée se fonde sur une pédagogie particulière
permettant d'utiliser l'expérience en milieu professionnel. Une seconde
la complète en considérant qu'« une formation en alternance
se caractérise par un projet pédagogique global reposant sur des
procédures organisationnelles permettant d'articuler l'action des deux
pôles formateurs que sont l'entreprise et l'établissement de
formation. Son développement s'effectue dans une logique de
coresponsabilité (Gimonet, 2008, p.148).
L'alternance implique donc nécessairement une
interaction entre l'enseignant et l'apprenant avec une relation
fréquente pour définir et contractualiser les progressions, le
suivi et l'évaluation des tâches. (Eberhard et coll., 2013,
p142).
I.3.2. Approches théoriques de la
pédagogie de l'alternance
La pédagogie par alternance est une
pédagogie qui utilise l'expérience et les savoir-faire acquis en
milieu éducatif, afin de donner du sens à la formation des
apprenants. Cette pédagogie spécifique qui définit des
objectifs et une progression dans l'acquisition des connaissances en même
temps qu'une répartition des responsabilités.
I.3.2.1. Enseigner l'EPS à l'école et
l'analyse des savoirs
Pour comprendre ce que le sujet doit apprendre pour
faire « classe en EPS » suppose de définir au préalable
les contours de l'enseignement de cette discipline à l'école.
Longtemps il a été considéré qu'il suffisait pour
enseigner l'EPS à l'école de savoir enseigner les
Activités Physiques Sportives Artistiques (APSA) tout en adaptant les
contenus d'enseignement aux caractéristiques des élèves de
ce niveau de la scolarité. De ce point de vue les enseignants des STAPS
se considéraient comme légitimes pour concevoir et intervenir
dans la formation, en adaptant les principes de l'EPS au collège et
lycée à ceux des élèves un peu plus jeunes. C'est
oublier qu'un enseignant doit inscrire cet enseignement au sein d'un emploi du
temps composé des autres enseignements disciplinaires et des multiples
activités qui constituent le métier. En clair, cet enseignement
disciplinaire doit être pensé dans le cadre de la polyvalence,
caractéristique fondamentale dont plusieurs études ont
dessiné les incidences sur les modes d'entrée dans l'exercice du
métier (Prairat, 2001, p20-22).
Enseigner cette discipline, comme toute discipline est
une activité complexe en ce sens qu'elle sollicite de multiples
paramètres et convoque de nombreuses ressources. Elle est une
activité multifinalisée dont les différents organisateurs
peuvent engendrer des conflits de critères (Goigoux 2007, p47-70). En
établir une cartographie stricte semble impossible tant par ailleurs
sont nombreuses les conceptions même de ce que devrait être un
« bon enseignement de l'EPS ».
En second lieu cette discipline repose sur une gestion
des interactions entre élèves plus complexe. En effet, à
la différence du travail en classe les élèves se
déplacent, bougent, parlent, s'interpellent des interactions
différentes, souvent chargées émotionnellement car
engageant la personnalité dans son ensemble. Ces modalités
entrent en tension avec les règles habituelles de prise de parole au
sein de la classe.
Enfin la discipline suppose une gestion du
matériel. Si tout enseignement nécessite un matériel
spécifique, celui de l'EPS parfois lourd, encombrant impose une
anticipation fine dans sa préparation, son installation, son rangement.
Il s'agit d'un matériel que l'on manipule nécessitant parfois de
penser la séance avec un matériel défaillant, voir absent
ou obsolète. Une gestion approximative de celui-ci peut entraver le bon
déroulement de la séance et nuire à l'engagement dans la
tâche de l'élève et au progrès. Amade-Escot (2003) a
souligné le rôle de l'agencement du milieu (dont le
matériel) dans les régulations des enseignants en cours de
séance, montre combien cette dimension est importante et propre à
la discipline.
Cet ensemble de caractéristiques
spécifiques amènent souvent les enseignants à
considérer l'EPS comme un « enseignement fragilisant »
(Blanchouin 2013) et pose alors de façon sensible la question de sa mise
en oeuvre par des enseignants débutants. Alors que ceux-ci sont
confrontés aux premières expériences de la gestion de la
classe, ces caractéristiques peuvent apparaître comme doublement
déstabilisantes et susceptibles de remettre en cause une «
maîtrise du groupe classe » naissante, balbutiante. Comment ces
caractéristiques sont-elles perçues, appréhendées
et vécues ? Pour cela il est nécessaire de s'appuyer sur les
études qui cherchent à décrire les préoccupations
des enseignants débutants.
I.3.2.2. Apprendre à faire classe d'EPS par
alternance
Selon l'étude réalisée par
Goigoux et all (2007, p47-70), une approche ergonomique de l'analyse de
l'activité enseignante, étudient les apprentissages
professionnels des enseignants dans le cadre de la formation en alternance.
Dans une modalité de l'alternance relativement proche de celle
instaurée par la réforme de 2012, les auteurs identifient les
transformations qu'opèrent les enseignants débutants dans la
conduite des enseignements au cours de l'année de formation. Ils
s'appuient pour cela sur des entretiens menés à différents
moments de l'année. Ils ont alors pu mettre en évidence des
similitudes dans les trajectoires des professeurs stagiaires, les
déterminants des processus de transformation, en même temps que
des variations de profils. Une première similitude renvoie à
l'élaboration par l'enseignant stagiaire d'une conception fonctionnelle
de la gestion de classe. « Progressivement ils appréhendent le
déroulement de la journée scolaire comme un temps de vie
partagée avec un groupe d'enfants, qui n'est pas homogène, qui
n'est pas d'humeur égale, qui n'est pas forcément
intéressé par les activités scolaires et qu'il faut savoir
« occuper ». Les auteurs mettent également en
évidence l'évolution des conceptions des apprentissages scolaires
au cours des traitements des dilemmes. Les enseignants stagiaires
réinterrogent ainsi la prescription selon laquelle « il faut que
les élèves soient actifs », ils apprennent à faire
confiance à leurs perceptions des situations dans lesquelles ils se
débattent. A trop vouloir rendre ses élèves actifs, elle
n'a pas su les occuper ». (Blanchouin, 2013)
I.3.2.3. Didactique de l'alternance
L'alternance peut être considérer comme
une pédagogie de la confrontation (Granato et all 2013, p315-340). Elle
nécessite une mise en cohérence forte et affirmée des
périodes d'alternance, ainsi qu'une démarche pédagogique
particulière. En effet, la recherche d'une cohérence du
dispositif au regard des objectifs de formation affichés devrait
conduire à privilégier un dispositif pédagogique,
s'articulant autour d'une mise en cohérence des savoirs à partir
de l'analyse d'une situation professionnelle, plutôt qu'une organisation
pédagogique centrée sur un découpage disciplinaire des
contenus de formation. L'alternance apprécie la cohérence entre
les savoirs et leur progression en milieu de l'apprentissage. Au fil des
décennies, les formations par alternance se sont largement
développées et leur impact va bien au-delà des formations
à visée professionnelle. Le versant pédagogique de
l'alternance, les finalités qu'on lui accorde, ne sont pas les sujets
dont on parle le plus et de nombreux professionnels s'accordent pour
démontrer que ce système de formation ne donne pas toujours les
résultats escomptés. De grandes différences existent entre
le monde de l'école et celui du travail qui ne sont pas régis par
les mêmes règles et ne présentent pas les mêmes
enjeux. La négociation entre les différents partenaires est
difficile, ainsi que leurs objectifs sont divergents. L'alternance est donc
conçue de façon schématique, les conceptions de
l'apprentissage diffèrent selon les formateurs, le stage peut
représenter pour certains professionnels
l'application des théories (Granato et coll., 2013, p315-340)
1. Participation des filles et garçons au cours
d'EPS
Les recherches sur l'enseignement de
l'éducation physique ont mis en évidence deux types de
conclusions scientifiques décrivant les comportements des
élèves : celles sur la façon dont ils occupent leur temps
et celles sur les réponses émises
Ce qui ressort avant tout des travaux sur le temps
d'apprentissage, c'est le faible pourcentage de temps (environ 30%) que les
élèves consacrent réellement à l'engagement dans
les activités motrices pendant les cours, et celui, à peine
inférieur, pendant lequel ils attendent, c'est-à-dire pendant
lequel ils ne font rien qui puisse contribuer à l'atteinte des buts de
la leçon. (Fagairette 2004, p161-173).
Les élèves consacrent également
une grande partie de leur temps à exécuter des tâches
d'organisation telles que prendre les présences, s'organiser pour
pratiquer, diviser les équipes, etc. De même, ils passent un temps
important à recevoir des informations. Il convient enfin de distinguer
dans le temps que les élèves consacrent à l'engagement
dans des comportements moteurs, l'engagement actif et l'engagement productif.
Dans le premier, peu importe la qualité des réponses des
élèves, dans le second en revanche, les élèves sont
engagés dans des activités directement reliées aux
objectifs d'apprentissage. Or, les recherches montrent que ce dernier temps
d'engagement n'occupe que 10 à 20% du temps total passé en cours
par les élèves. (Fagairette 2004, p161-173).
2. Les performances des filles et des
garçons
Les conclusions de nombreuses recherches aboutissent
à l'idée selon laquelle les garçons progressent davantage
que les filles en EPS. Ces dernières ont, par ailleurs, de moins bons
résultats aux examens que les garçons (Lenskyj1994, p97-115).
Anderssen (2005, p119-129), à partir d'une
enquête conséquente destinée à explorer et
comprendre les attitudes des élèves face à l'EPS, leurs
intérêts, leurs représentations, leurs motivations, etc., a
pu montrer que les variables en lien avec les résultats en EPS
correspondent à celles qui sont généralement
avancées pour éclairer les résultats dans d'autres
disciplines : sexe, âge, etc.
Elle précise toutefois qu'il existe un certain
nombre de variables remarquables spécifiques telles que la taille, le
poids, les pratiques sportives, etc. Son étude « pointe notamment
les relations déterminantes des pratiques sportives extrascolaires des
élèves avec les résultats en EPS mais les distingue aussi
dans leurs formes, leurs modalités, leurs intensités »
(Anderssen 2005, p. 82).
Mais alors que les garçons obtiennent une
moyenne comprise entre 14 et 14,6 quelles que soient les séries, les
filles des séries non scientifiques présentent des
résultats beaucoup plus modestes. De fait, les écarts entre les
filles issues des différentes séries sont considérables.
Aussi, pour Vigneron, la question de l'accession à un patrimoine,
à une culture sportive éloignée du champ social des filles
des milieux défavorisés est-elle primordiale.
L'existence d'un curriculum caché en EPS
pourrait, d'après Vigneron, expliquer, dans une certaine mesure, les
mauvais résultats des filles ; en mettant en exergue certains aspects du
sports : collectif, viril, engagé, mais pour certains
élèves seulement, les enseignants contribueraient, à leur
corps défendant sans doute, à la fabrication des
différences entre les performances des filles et des garçons en
EPS. (Fagairette 2004, p161-173).
Nous retiendrons notamment l'idée selon
laquelle, si l'école n'est pas seule responsable des écarts de
résultats, et si les collèges et les lycées ne forgent ni
les représentations ni les raisons d'agir des élèves, ils
sont malgré tout responsables de la manière dont le savoir se
construit à partir de ce socle. Ces travaux finalement nous invitent
à porter sur les performances des filles et des garçons, et plus
généralement sur leur activité, un regard susceptible
d'englober leurs représentations, leurs motifs d'agir mais aussi ce qui
est attendu d'eux ; ce qui suggère par conséquent
également de s'interroger sur les choix et les pratiques enseignantes.
(Fagairette 2004, p161-173).propose de ce point de vue plusieurs pistes
d'investigation: les pratiques pédagogiques des enseignants, leurs
procédures d'évaluation, leurs représentations, leurs
préjugés, les effets d'attente ou encore leur propre rapport au
savoir sportif transmis.
I.II. Théories de référence
I.II.1 La motivation
« La motivation en contexte scolaire est un
état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu'un
élève a de lui-même et de son environnement et qui l'incite
à choisir une activité, à s'y engager et à
persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre un but
» (Viau, 2009).
« La motivation est l'expression de toute gamme
d'émotions combinant les facteurs de plaisir et d'activation de notre
énergie ».
I.II.2. La théorie de
l'autodétermination
Nous avons choisi la théorie de
l'autodétermination de Deci et Ryan (1991, p237-288) et le modèle
hiérarchique de la motivation intrinsèque et extrinsèque
de Vallerand (1997, p271-360) parce qu'ils permettent de prendre en compte
plusieurs éléments de la motivation et qu'i1s ont
démontré un pouvoir de prédiction de la persistance de
l'adhésion à une activité. Nos intentions de recherche se
situant dans le développement de la pratique régulière et
alterné des activités physiques. Il nous semble
intéressant d'utiliser la théorie de l'autodétermination
et le modèle hiérarchique de Vallerand (1997, p271-360) pour
mieux comprendre la motivation des adolescentes dans le but de proposer des
pistes de solution au faible taux des cours alterné d'éducation
physique. De plus, tel que le proposent Hegger et Chatzisarantis, (2007) cette
théorie et ce modèle semblent très pertinents pour
l'étude sur l'effet de l'alternance des APS des élèves en
éducation physique.
La théorie de l'autodétermination,
élaborée par Deci et Ryan dans les années 80, cherche
à expliquer la dynamique motivationnelle qui pousse un individu à
s'engager ou non dans une activité. Elle stipule que l'être humain
cherche la satisfaction de trois besoins fondamentaux: un besoin de
compétence, un besoin d'autonomie et un besoin d'appartenance sociale
(Deci et Ryan, 1985a, 1991, 2000, 2002). Les auteurs proposent trois types de
motivation qui se retrouvent sur un continuum de motivation et en
déterminent le niveau d'autodétermination. De plus, le
modèle de Vallerand propose une taxonomie tripartite pour la motivation
intrinsèque et extrinsèque.
I.II.3. La motivation produit des conséquences
importantes
Selon ce modèle (Vallerand 1997, p271-360), la
motivation a des conséquences d'ordre cognitif, affectif et
comportemental. D'un point de vue cognitif, il faut noter que la motivation
autodéterminée provoquerait une meilleure attention, une
meilleure concentration et une meilleure compréhension. Du
côté de l'affectif, la motivation autodéterminée
provoquerait plus de satisfaction, de plaisir et d'intérêt. Enfin,
il serait raisonnable d'attribuer à la motivation
autodéterminée des conséquences d'ordres comportementaux
tels que les meilleures performances, la persévérance dans
l'activité et une plus grande intensité investie dans la
tâche. Cependant, cette relation de causalité serait aussi vraie,
mais inversée pour une motivation non-autodéterminée. La
motivation extrinsèque de même que l'amotivation provoqueraient
des effets négatifs d'ordre cognitif, affectif et comportemental.
En somme, plusieurs éléments composent
la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan (1985a, 1991,
p237-288) et le modèle hiérarchique de la motivation
intrinsèque et extrinsèque de Vallerand (1997, p271-360). Lors de
l'analyse de la motivation, il est nécessaire de prendre en compte les
trois types de motivation (motivation intrinsèque, motivation
extrinsèque et (l'amotivation) ainsi que les trois sous
catégories de la motivation intrinsèque (motivations
intrinsèques à la connaissance, à l'accomplissement,
à la stimulation), les trois régulations de la motivation
extrinsèque (les régulations externe, introjectée et
identifiée). Les trois types de motivation peuvent être
présents à chacun des niveaux de motivation (situationnelle,
contextuelle et globale) qui se composent de facteurs spécifiques
(facteurs situationnels, contextuels et globaux) qui sont eux-mêmes
modulés par des médiateurs psychologiques (la perception de
compétences, la perception d'autonomie et la perception d'appartenance
sociale). C'est par l'influence de tous ces éléments que la
motivation doit être comprise comme un phénomène dynamique
qui évolue positivement ou négativement sous l'influence de
plusieurs variables reliées à l'environnement de l'individu.
C'est pour leur exhaustivité et leur
capacité de prendre en compte plusieurs variables que la théorie
de l'autodétermination de Deci et Ryan (1985a, 1991, p237-288) et le
modèle hiérarchique de la motivation intrinsèque et
extrinsèque de Vallerand (1997, p271-360) ont été
fréquemment utilisés pour soutenir les études sur la
motivation en contexte scolaire, sportif et de loisir (Beauchamps, Halliwell,
Fournier et Koestner, 1996, p157-170; Biddle et Brooke, 1992; Thompson et
Wankel, 1980, p436-443). Leur utilisation constitue une base solide pour
inspirer les outils d'observation de cette recherche et obtenir une perspective
multidimensionnelle de la motivation des élèves en contexte des
cours d'éducation physique.
Chapitre II : Revue de la littérature
II.1. Travaux sur l'estime de soi
Dans les travaux de Marsh et Parker (1984, p213-231),
ils ont proposé le modèle du «cadre de
référence». L'idée principale est que les
élèves ou les jeunes sportifs, à l'intérieur de
leur école, de leur club ou de leur groupe de référence,
comparent leurs habiletés scolaires ou sportives avec celle des autres
élèves, et qu'ils utilisent cette information relative comme une
base pour former leur propre concept de soi. En s'appuyant sur ces
suppositions, Marsh (1987, p17-19) a défini ce qu'il a appelé
l'effet «gros poisson-petit bassin» (...). Cet effet signifie que
«... lorsque des élèves, sont également capables, se
comparent eux-mêmes avec des élèves plus capables, ils ont
des habiletés scolaires perçues plus faibles et des concepts de
Soi scolaires plus bas ; et ils ont des habiletés scolaires
perçues supérieures et un concept de Soi académique
supérieur lorsqu'ils se comparent avec des élèves moins
capables ». Le processus de comparaison sociale est très complexe
étant donné que, dans les situations scolaires, les comparaisons
sociales comprennent à la fois des comparaisons au groupe classe
à des sous-groupes particuliers (par exemple, les garçons ou les
filles) et des comparaisons avec un individu particulier.
Par conséquent, un élève peut se
percevoir lui-même comme étant un des plus mauvais
élèves de sa classe (comparaison de groupe), très loin du
meilleur élève qui pratique en club (comparaison individuelle
ascendante), mais se penser plus performant que son meilleur ami en classe,
avec lequel il préfère se comparer (comparaison individuelle
descendante). Dans cet exemple particulier, les comparaisons au groupe et
à un individu particulier peuvent avoir des effets opposés au
niveau du concept de soi scolaire ou physique. Cependant les effets ne sont pas
obligés d'aller toujours en sens contraire. Ils peuvent s'additionner
pour augmenter ou diminuer le concept de soi. Pour avoir une meilleure
compréhension de la manière dont le processus de comparaison
sociale affecte le concept de soi des élèves, il est important de
considérer à la fois les comparaisons de groupe et les
comparaisons individuelles dans les situations de la vie réelle. Ce
n'est pas en examinant seulement l'effet de la position relative des
élèves entre eux à l'intérieur de la classe, ni en
étudiant exclusivement l'effet de comparaison individuelle ascendante ou
descendante, que l'on peut comprendre la complexité des comparaisons
sociales. Plusieurs recherches ont eu pour objectif de vérifier
expérimentalement la portée de ces idées dans le domaine
de l'EPS. Etant donné leur importance vis-à-vis de l'intervention
en EPS, nous leur consacrons ci-dessous un large développement.
Marsh et Peart (1988, p390-407) ont mené une
recherche en vue d'étudier les effets différentiels de deux
programmes d'éducation physique sur le développement de la
condition physique réelle des élèves et sur leur
connaissance de soi générale et physique. Chaque programme avait
un contexte de présentation de la tâche différent (climat
motivationnel) : l'un avec une orientation compétitive et l'autre avec
une orientation coopérative. Dire que le contexte de présentation
de la tâche spécifique à chaque programme est soit
compétitif soit coopératif signifie que l'on veut induire une
structure de but motivationnel différente dans les deux programmes. La
structure de but est compétitive lorsque les élèves ne
peuvent atteindre leurs propres buts qu'en faisant en sorte que les autres
échouent à atteindre les leurs (c'est-à-dire qu'il y a des
vainqueurs et des perdants), tandis qu'elle est coopérative lorsque les
élèves peuvent atteindre leurs propres buts individuels seulement
en travaillant en coopération avec d'autres qui doivent aussi atteindre
leur propres buts. Les interventions ont été
réalisées sur des filles réparties en binôme et
placées en compétition intergroupes. Dans le programme
coopératif, les tâches sélectionnées exigeaient la
coopération de deux filles, tandis que les tâches du programme
compétitif pouvaient être accomplies individuellement. Ces deux
groupes différaient surtout par les consignes verbales fournies par les
enseignants, ce qui entraînait un contexte de présentation de la
tâche (ou climat motivationnel) nettement différent pour les deux
groupes. Dans le programme coopératif, tous les élèves
étaient encouragés à travers des commentaires tels que
«vous avez très bien abordés cet exercice » ou «
rappelez-vous que l'objectif est de progresser dans le temps ». L'accent
était ainsi placé sur le progrès et la coopération
pour parvenir à celui-ci. Dans le programme compétitif, vaincre
et être le meilleur du groupe était souligné à
travers des commentaires tels que, «regardez comme Marie fait bien. Elle
est un mile devant vous, allez » ou « quel groupe est en train de
gagner aujourd'hui?» ou «regardez si vous pouvez battre le groupe 4
aujourd'hui».
Les résultats de cette recherche ont
montré que les deux programmes d'enseignement (indépendamment de
leur caractéristique coopérative ou compétitive) ont
augmenté objectivement la condition physique réelle des filles,
c'est-à-dire qu'ils ont affecté substantiellement la condition
réelle. Aucune différence n'a été constatée
entre les deux groupes coopératif et compétitif ce qui signifie
que leur effet est identique vis-à-vis de la performance objective. Il
n'en est pas de même concernant le concept de soi. Malgré des
progrès objectifs similaires pour les deux groupes seuls le groupe
coopératif a augmenté de manière sensible son concept de
soi. Le groupe compétitif enregistre une diminution importante de
celui-ci. Par ailleurs, seul le concept de soi d'habileté physique
progresse ce qui signifie que l'intervention a eu plus d'effet sur le concept
de soi d'habileté physique que sur les autres échelles du concept
de soi. L'intervention a eu un effet dans une moindre mesure, sur les concepts
de soi d'apparence physique.
II.2. Travaux sur le Plaisir
Dans le champ de l'éducation physique et
sportive, des recherches ont porté sur le plaisir perçu
(Delignières et Perez, 1998, p7-18) et ont conduit à la
validation d'un outil d'évaluation. À cet effet, plusieurs
ouvrages d'EPS abordent la question du plaisir (Delignières et Garsault,
1996, pp155-162), deux autres sont plus orientés autour du champ des
émotions (Ria, et coll, 2005). Selon Delignières et Garsault,
les chercheurs sont loin de pouvoir fournir aux praticiens des principes
d'action avérés. Un approfondissement de la recherche sur le
plaisir est indispensable, notamment en fonction de publics spécifiques
(les filles, les adolescents en difficulté), et de contextes
particuliers (notamment les cours d'Education Physique et Sportive).
L'approche expérimentale du concept de plaisir,
l'étude de ses conditions d'émergence, des variables susceptibles
de l'optimiser nécessitent la construction préliminaire d'outils
spécifiques, et notamment la mise au point d'un outil de mesure du
plaisir ressenti par les sujets lors de la pratique. Or une revue de la
littérature montre que la plupart des chercheurs ayant tenté de
mesurer le plaisir ont eu recours à des procédures aux
propriétés métriques limitées. On peut citer par
exemple Harter (1978) mesurant le plaisir des sujets par des "scores de
sourire", déterminés selon une échelle en quatre points
(0: pas de sourire, 1: léger sourire, 2: large sourire, 3: éclats
de rire). Dans le domaine des activités sportives, de nombreux auteurs
se sont contentés d'une évaluation à partir d'un ou deux
items du type "j'ai eu beaucoup de plaisir à pratiquer cette
activité", les sujets se voyant proposer 5 ou 7 niveaux de
réponse (Scanlan et Lewthwaite, 1986; Wankel et Kreisel, 1985; Wankel et
Sefton, 1989).
Les travaux de Delignières et Perez (1998,
p7-18) qui ont élaboré et validé un questionnaire
destiné à l'évaluation du plaisir dans la pratique de
l'activité physique. Lors de cette étude réalisée
avec des collégiens et correspondant à une adaptation de la PACE
(Physical Activity EnjoymentScale) crée par Kendzierski et DeCarlo
(1991, p50-64), la corrélation entre l'orientation motivationnelle de
maîtrise et le plaisir perçu a été soulignée.
L'outil ainsi élaboré a été validé et permet
d'évaluer le plaisir ressenti par les élèves à la
suite du cycle.
Deci et Ryan (1985), pour leur part, ont avancé
l'hypothèse que les activités physiques et sportives seraient
pratiquées a priori pour des motifs intrinsèques. Selon eux,
l'attrait de l'action et le simple plaisir qu'elles procurent seraient à
la base de la propension des individus à les pratiquer. De plus, ils
soutiennent que ces activités répondraient à un
désir d'autodétermination et d'interaction sociale. Le besoin
d'autodétermination est ici considéré comme le besoin de
choisir librement ses activités selon ses propres besoins et
préférences. Ce besoin s'accompagnerait d'une perception
d'autonomie, de contrôle et de plaisir.
Deci et Ryan notent: qu'en tenant compte des changements
observables dans le domaine sportif, ils estiment que l'accent mis sur l'aspect
compétitif soumettrait progressivement les individus à des
pressions extrinsèques; si bien que les sources de motivations
extrinsèques prendraient une place grandissante. Ils attribuent des
motivations intrinsèques et extrinsèques au plaisir. À
l'instar de la théorie du besoin de compétence, ces derniers
considèrent que le sport satisferait un besoin d'améliorer
continuellement ses habiletés afin de se sentir compétent. Ils
précisent également que les rétroactions négatives
constructives peuvent s'avérer favorables dans la mesure où elles
sont mises au profit du développement des compétences.
Selon Csikzentmihalyi (2004), ils considèrent
qu'un individu peut faire l'expérience du plaisir uniquement lorsque ses
perceptions de compétence personnelle et d'autodétermination
restent intactes, qu'elles soient perçues consciemment ou non; par
ailleurs, ils soutiennent que ces deux éléments sont attribuables
à l'implication sportive et feraient naître le plaisir. À
la suite de leur étude empirique, ils ont proposé un
modèle théorique du plaisir représenté par un
schéma à deux dimensions croisées, chacune d'elles
constituant un continuum entre deux pôles. Ce modèle comporte
ainsi quatre quadrants, soit l'accomplissement intrinsèque,
l'accomplissement extrinsèque, le non -accomplissement
intrinsèque ainsi que le non-accomplissement extrinsèque. Chaque
quadrant comporte des sources de plaisir distinctes et possède ses
propres particularités.
II.3. Travaux de Thépaut sur l'Alternance des
APS
Apprendre à faire classe dans une formation en
alternance en prenant son activité professionnelle comme objet
d'étude suppose un « va et vient » permanent entre le
système tâche-activités-pratiques de l'élève
et le système tâche-activités-pratiques.
Dans ce cadre, l'analyse des apprentissages
professionnels et l'étude des préparations écrites de
séance mettent en évidence la multiplicité et
complexité de la tâche du PE (Professeur d'Ecole) débutant.
Placé dans l'obligation institutionnelle d'enseigner l'EPS, les PE
stagiaires, nous l'avons vu, assument leur mission, nouvelle pour eux, avec
plus ou moins de réussite. Les conditions de leur développement
reposent sur la relation activités-savoir ce que montre cette
étude, une appropriation des « savoirs pour enseigner » (Altet
1996).
Cette étude s'attache à décrire
et comprendre les apprentissages professionnels en formation par alternance,
des PE stagiaires lorsqu'ils enseignent l'EPS. Elle vise à cerner les
savoirs mobilisés pour concevoir et mettre en oeuvre cet enseignement.
Cette étude appuie sur l'analyse des préparations écrites
de séances et leurs bilans, comme révélateur des
modalités mises en oeuvre pour « ériger le lieu et le moment
de l'EPS en un <<espace-temps>> de travail » (Blanchouin
2013).
Cette étude a pu élaborer quatre profils
différents correspondants à quatre modalités de conception
de complexité accrue : d'une représentation de l'enseignement de
l'EPS comme exclusivement une mise en activité des élèves
à une conception et prise en compte d'un ensemble de procédures
visant à mettre les élèves en apprentissage en s'appuyant
sur un contrat didactique et pédagogique clair. Amener les PE
stagiaires, issus d'origines, de cursus universitaires très
variés, et parfois pour certains d'entre eux, très
éloignés d'une culture corporelle leur permettant de percevoir
plus aisément les enjeux et conditions de mise en apprentissage dans les
pratiques sportives nécessite une analyse du système
emboîté tâche-activités-pratiques de
l'élève et de l'enseignant.
Les éléments d'analyse produits avec les
PE amènent alors à percevoir les limites de la formation
disciplinaire dispensée lors de la formation initiale. En effet, sans un
approfondissement des connaissances sur les « savoirs à enseigner
», dont les PE perçoivent alors leurs propres limites, il leur est
difficile de s'engager plus en avant dans la mise en oeuvre d'un enseignement
de l'EPS instituant le temps et l'espace des cours d'EPS autour de contrats
didactiques clairs. Ce dernier constat fonde l'importance d'une formation
continue durant les premières années d'exercice du
métier.
Aussi, selon les travaux de Blanchouin (2013), qui
décrit avec précision les spécificités de cet
enseignement en regard des autres disciplines de l'école. Cette
étude qui aborde les PE sous l'angle de la polyvalence et ne sont plus
considérés comme des « non spécialistes » offre
l'avantage de prendre en compte cet enseignement pour ce qu'il est. C'est en
effet un argument souvent avancé pour expliquer et justifier un horaire
global inférieur au cadre réglementaire ; le sentiment
d'incompétence ressenti par le PE non spécialiste, sentiment
d'incompétence. Il implique souvent un trajet pour s'y rendre, autorise
les déplacements des élèves en cours d'activité.
Par ailleurs l'espace d'activité pose des problèmes de
repérage à la fois matériel et symbolique dans la mesure
où très souvent il n'est pas perçu par les
élèves comme un « lieu où l'on travaille » mais
plutôt comme un espace où l'on joue (cour de
récréation, gymnase, stade...). Il est alors nécessaire
selon l'auteur d'instituer l'espace comme « lieu de travail ».
II.4. Synthèse des travaux
Au regard de la revue de littérature, le sujet
a fait l'objet de plusieurs investigations. Les documents consultés ont
tous souligné que les élèves ont besoin d'un sursaut
pédagogique afin améliorer leurs apprentissage.
Les travaux de Marsh et Parker, mettent l'accent sur
un modèle proposé sur l'évaluation du concept de soi, et
si les différentes expériences vécues infirment ou
renforcent l'estime de soi. Ces travaux permettent d'une part de valider
empiriquement le caractère multidimensionnel des réponses au
concept de soi et d'autre part de vérifier que la valeur physique est
fortement corrélée avec le concept de soi d'habileté
physique et non avec les autres domaines du concept de soi. Par ailleurs, un
programme d'intervention conçu pour influencer le concept de soi
d'habileté physique, via une augmentation de la valeur physique
réelle des élèves, a un effet important sur le concept de
soi d'habileté physique et non sur les autres domaines du concept de
soi. Mais la découverte majeure est que les programmes
d'éducation physique orientés coopérativement semblent
être, comme prédit, plus bénéfiques pour les filles
de cet âge que les programmes orientés compétitivement
(vers la comparaison sociale).
Les travaux Delignières et Perez, sur le
plaisir se construiraient subjectivement à travers l'expérience
sportive, d'où les auteurs (Delignières et Perez), le
considèrent comme un processus. Ses effets se manifesteraient de
manière immédiate, c'est-à-dire au cours de l'action. Les
facteurs intrinsèques tels que la maîtrise de la tâche ou
les progrès personnels qui apportent la contribution la plus
significative au plaisir des pratiquants.
Selon les travaux de Thépaul cité par
Altet (1996), cette étude s'attache à décrire et
comprendre les apprentissages professionnels en formation par alternance, des
PE stagiaires lorsqu'ils enseignent l'EPS. Elle vise à cerner les
savoirs mobilisés pour concevoir et mettre en oeuvre cet enseignement.
En effet, sans un approfondissement des connaissances sur les « savoirs
à enseigner », dont les PE perçoivent alors leurs propres
limites, il leur est difficile de s'engager plus en avant dans la mise en
oeuvre d'un enseignement de l'EPS instituant le temps et l'espace des cours
d'EPS autour de contrats didactiques clairs sur l'alternance des APS en
éducation physique et sportive.
La synthèse de la documentation laisse
présager qu'il existe un lien significatif entre ces concepts. Suite aux
résultats controversés entre les travaux sur la relation entre
l'estime de soi et plaisir ainsi que le concept de l'alternance, des analyses
complémentaires viendront documenter cet aspect à partir des
données de la présente étude. Le prochain chapitre
présente les critères de sélection des instruments de
mesure, la méthodologie d'analyse et le choix des sujets participant
à la recherche afin de mettre à l'épreuve
l'hypothèse.
PARTIE II : Cadre Opératoire
Chapitre III : Méthodologie
Après avoir mis en exergue les aspects
conceptuels, il s'agit à cette étape de se positionner d'un point
de vue méthodologique. Du point de vue Méthodologique, les zones
de prédilection ayant constituées le champ d'investigation sont
les établissements scolaires, à savoir :
- le lycée d'Excellence de MBOUNDA, dont les
sujets ont constitué le groupe expérimental. Ce lycée est
un établissement d'enseignement général possédant
les équipements sportifs de qualité situé à
Dolisie, troisième ville de la république du Congo;
- le lycée de la Réconciliation dans
lequel fréquentaient les sujets du groupe témoin. Il s'agit
également d'un lycée d'enseignement général
situé dans le 7ème arrondissement MFILOU NGAMABA de
Brazzaville.
Dans ces établissements d'enseignement
général, le travail a consisté à soumettre les
questionnaires aux élèves des classes de premières
scientifiques (C et D) dont l'échantillon est constitué de cent
vingt-trois (123) répondants potentiels.
Ce chapitre présente et justifie donc les choix
méthodologiques concernant l'approche, le milieu d'étude, la
population, l'échantillon, les outils, la procédure et l'analyse
statistique. De même, il fait aussi le choix de la méthode des
outils de collecte et analyse des données.
III.1. Méthodologie suivie
La méthodologie suivie s'est appesantie sur
l'organisation des cycles de gymnastique, volley-ball et de saut en longueur.
Elle a concerné les élèves du lycée d'Excellence de
MBOUNDA et du lycée de la Réconciliation de MFILOU.
Deux groupes d'élèves ont été
constitués, à savoir :
· un groupe expérimental, composé des
élèves du lycée d'Excellence de DOLISIE (73
élèves),
· un groupe témoin, composé des
élèves du lycée de la Réconciliation de MFILOU (50
élèves).
Les élèves du groupe
expérimental et ceux du groupe témoin ont reçu pour les
besoins de la recherche, trois types de questionnaires, à savoir :
- un questionnaire sur l'alternance des APS au cours d'EPS;
- un questionnaire sur l'estime de soi des
élèves aux cours d'EPS ;
- un autre sur le plaisir approuvé dans la
pratique des cours en EPS.
Le premier questionnaire mis à la disposition
des élèves a été essentiellement consacré
à la confirmation sur ce que ces élèves sentent lorsque
les cycles des Activités Physiques Sportives et Artistiques sont
alternés. Puis s'en ai suivi la deuxième partie, concernant les
questionnaires sur le plaisir et sur l'estime de soi. Ces questionnaires ont
été présenté, afin d'évaluer la
considération et la confiance que les élèves se donnent
grâce aux choix de ces activités.
Cette démarche a permis de déterminer
deux critères qui constituent l'objet de notre étude :
évaluer l'influence de l'alternance des activités des
élèves et par la suite, mesurer l'estime de soi et le plaisir
qu'approuvent les élèves pendant les cours d'éducation
physique et sportive sur la programmation des activités sportives
retenues.
III.2. Opérationnalisation de
l'étude
III.2.1 champ d'investigation
Cette étude a été
réalisée au lycée d'Excellence de MBOUNDA (dans DOLISIE
qui est la troisième ville de la République du Congo) et au
lycée de la Réconciliation de l'arrondissement 7 Mfilou de
Brazzaville. Le choix de ces établissements comme champs d'investigation
de notre étude se justifie par la présence d'une plate-forme
ayant plusieurs terrains conçu sur le béton avec des limites
peintes et visibles. Toutefois, le choix des élèves du
lycée d'excellence de MBOUNDA comme groupe expérimental, se
justifie aussi par leurs caractère obligatoire de participé aux
cours d'EPS, leurs conditions et l'espace de vie, les contraintes et l'exigence
aux résultats scolaire en fin d'année. L'expérimentation
s'est déroulée du 12 Mars au 22 Mai 2018, période à
laquelle les élèves ont été disponibles.
III.3. Population et échantillon
III.3.1. Population d'enquête
Il s'agit de l'ensemble des personnes
impliquées dans une étude et qui sont susceptibles de fournir des
informations utiles à l'étude. Pour notre étude, nous
avons eu comme population, les élèves de l'enseignement
général du deuxième cycle secondaire de la
république du Congo. La population de l'étude a été
constituée des élèves de deux lycées :
- quatre-vingt (80) élèves du lycée
d'Excellence de MBOUNDA de première C et D constituant le groupe
expérimental pour les raisons évoquées en amant ;
- cent cinquante (150) élèves du
lycée de la Réconciliation de l'arrondissement 7 Mfilou de
Brazzaville constituant le groupe témoin.
III.3.2. Echantillon
Après avoir identifié la population
cible de notre étude, le mode non probabiliste a été
utilisé. A ce propos, les critères d'inclusion ont
été les suivants :
-jouir d'un bon état physique
conformément aux renseignements généraux des
élèves consignés dans les documents
pédago-administratifs des enseignants ;
-être élève en classe de première
scientifique (C et/ou D) ;
-être régulièrement inscrit aux
établissements retenus pour l'étude.
Critère d'exclusion
-élève ayant un passé sportif dans un
club et disposant d'une licence sportive,
- élève n'ayant pas participé à
toutes les leçons d'apprentissage au cours d'EPS.
Compte tenu des critères
sus-énumérés, l'étude a porté sur :
· soixante-treize (73) sujets du groupe
expérimental (le lycée d'excellence de Mbouda) dont trente
(30) filles et quarante-trois (43) garçons ;
· cinquante (50) sujets du groupe témoin (le
lycée de la Réconciliation de Mfilou) dont vingt (20) filles et
trente (30) garçons.
III.4. Instruments de collecte et d'analyse des
données
III.4.1. Instrument de collecte des
données
L'enquête d'opinion au moyen des
questionnaires a permis de mieux appréhender les différents
aspects abordés dans l'étude. Par ailleurs, elle a permis de
recueillir des informations sur l'implication des élèves des
classes de premières scientifiques sur leurs participations au cours
d'Education Physique et Sportive. De plus elle a servi à la collecte des
données de l'étude. Pour vérifier l'hypothèse,
trois types de questionnaire ont été utilisés à
savoir :
· le questionnaire d'évaluation sur l'influence de
l'alternance des APS ;
· le questionnaire d'évaluation de l'estime de soi
;
· le questionnaire d'évaluation sur le plaisir en
EPS.
III.4.1.1. Les Questionnaires
Les questionnaires adressés aux
élèves ont été laissés en dépôt
sous la responsabilité du chef de département d'EPS de
l'établissement. La collecte de toutes ces données s'est faite
pendant trois (3) semaines pour les élèves du lycée
d'excellence de Dolisie et pendant sept (7) jours pour ceux du lycée de
Mfilou (Brazzaville). Toute en exhortant les répondants à une
bonne collaboration, l'anonymat et la confidentialité leur ont
été garantis.
Les contenus de ces questionnaires étaient
basés sur différents centres d'intérêt, tenant
compte des trois concepts clé de notre thème de recherche
évoqué précédemment. Il s'est agi :
· pour l'évaluation de l'alternance des APS d'un
questionnaire comprenant les questions ouvertes, des questions fermées
et des questions à choix multiples ;
· pour l'évaluation de l'estime de soi de
l'échelle de Likert à 6 niveaux d'approbation de chaque item
(pas du tout d'accord, très peu d'accord, un peu d'accord, assez
d'accord, beaucoup d'accord et tout à fait d'accord) ;
· pour l'évaluation du plaisir, de
l'échelle de Likert à 7 niveaux d'approbation de chaque item
(absolument pas d'accord, pas d'accord, plutôt pas d'accord, je ne sais
pas, plutôt d'accord, d'accord, absolument d'accord).
Variable étudiées
a- Variables dépendantes
Il a s'agi de l'implication et de ce que les
élèves éprouvent aux cours d'éducation physique et
sportive, notamment :
- plaisir éprouvé par les élèves
dans les APS
- l'estime de soi sur l'aperçu qu'ont les
élèves sur les cours d'EPS ;
b- Indépendante
Il s'agit de celle qui n'a pu influencer
l'étude, à savoir :
- l'alternance des cours d'EPS afin de sortir de la monotonie
des programmes des cours d'EPS.
Pour des raisons d'ordre temporel dues au calendrier
académique 2017-2018, nous n'avons pas fait de pré-enquête
pour le questionnaire sur l'alternance. Néanmoins après son
élaboration, le questionnaire sur l'alternance aux cours d'EPS a
été retouché avant d'être administré. Les
questionnaires d'évaluation de l'estime de soi (Vallières et
coll, 1990 ; p305-316) a déjà fait l'objet d'une validation
par Ewamela et coll. (2016 ; p.237) tandis que celui du plaisir a
été validé en contexte francophone par Déligniers
et coll. (1998 ; p.17).
1- Cotation :
Le dépouillement a été fait à base
de cotation dépendant du questionnaire et du type de question. A ce
sujet, pour le questionnaire de l'évaluation:
- de l'alternance, notamment les questions
fermées :
- la réponse négative a donné droit
à 0 points ;
- la réponse affirmative a donné droit à
1 point ;
- les questions ouvertes, la cotation variait de 1 à 5
points en fonction du degré de véracité et de
prépondérance de la réponse ;
- les questions à choix multiples, la cotation
dépendait également du degré de véracité et
de prépondérance de la réponse ;
- de l'estime de soi, la cotation variait de 1 à
6 selon le niveau d'approbation de l'item ;
-du plaisir, la cotation variait de :
- 1 à 7 selon le niveau d'approbation de l'item de
forme affirmative ;
- 7 à 1 selon le niveau d'approbation de l'item de
forme négative.
III.4.2. Analyse des données
Les données traitées selon la
statistique descriptive au moyen du logiciel Excel pour le calcul de la
moyenne et écart type. Aucune variable n'a vérifié la
normalité de la distribution des données et
l'homogénéité des variances. D'où les tests
statistiques utilisés ont été non paramétriques. A
cet effet, le test de Mann Withney a été utilisé pour
comparer les différentes variables entre les filles d'une part et les
garçons d'autre part. Le test de Kruskall Wallis a été
utilisé pour comparer les moyennes des quatre modalités
d'administration des questionnaires. Après que ce test ait
été significatif, le test post-hoc a été
utilisé pour identifier les différences bilatérales. Une
analyse de corrélation de Pearson a été utilisée
pour déterminer les corrélations entre les variables de
l'étude chez les filles d'une part et d'autre part chez les
garçons.
Pour bien comprendre le phénomène
étudié à travers les instruments de mesure qui
présentaient plusieurs variables recueillies auprès des
élèves des deux établissements, une Analyse en Composante
Principale (ACP) a été utilisée. Cette analyse a permis de
regrouper toutes les variables de l'étude en deux facteurs pour une
bonne compréhension. Le niveau de significativité et celui de
confiance, dans cette étude, ont été fixés
respectivement à á = 0,95 (soit 95%) et 1 - á = 0,05 (soit
5%). Le logiciel IBM SPSS Statistic version 22 (IBM Corporation, USA) a
été utilisé pour toutes les analyses statistiques).
III.II.3.3 Difficultés
rencontrées
En matière de recherche scientifique, il n'y a
pas de travaux sans contrainte. Car la recherche est un sacerdoce, qui ne
manque pas de difficultés et faits imprévisibles. Toutefois,
quelques difficultés majeures peuvent être soulignées,
entre autres:
- le faible temps octroyé aux étudiants
chercheurs à la chaire UNESCO afin de conclure une année
académique et les séminaires ;
- le non rapprochement de l'agenda de l'enseignement
supérieur et celui de l'enseignement primaire et secondaire pour une
population cible de recherche.
Chapitre IV : Présentation, analyse et
interprétation des résultats
IV.1. Alternance des formes d'APS et
plaisir
L'alternance des APS, le plaisir en gymnastique, le
plaisir au volleyball, le plaisir au saut en longueur des sujets des groupes
expérimental (GE) et témoin (GT) des deux sexes ont
été présentés dans le tableau IV.1 sous forme de
moyenne et écart type (  #177;). #177;).
Tableau IV.1 :Description de l'alternance et du
plaisir ressenti par les sujets GE et GT au cours des cycles de gymnastique, de
volleyball et de saut en longueur sous forme de moyenne et écart type
(  #177;) #177;)
|
GE
|
|
GT
|
t
|
p
|
Appréciation
|
|
Filles
|
(n = 30)
|
|
(n = 20)
|
|
|
|
|
Alternance des APS
|
38,93 #177; 0,64***
|
|
36,70 #177; 1,52
|
6,13
|
0,0001
|
S
|
|
Plaisir en Gymnastique
|
67,27 #177; 3,63
|
|
66,10 #177; 3,48
|
1,57
|
0,872
|
NS
|
|
Plaisir au Volleyball
|
57,23 #177; 1,48*
|
|
56,05 #177;2,31
|
2,02
|
0,858
|
NS
|
|
Plaisir au Saut en Longueur
|
58,10 #177; 1,79
|
|
57,65 #177; 2,66
|
0,66
|
0,913
|
NS
|
|
Garçons
|
(n = 43)
|
|
(n = 30)
|
|
|
|
|
Alternance des APS
|
37,12 #177; 0,45
|
|
37,06 #177; 1,23
|
0,21
|
0,084
|
NS
|
|
Plaisir en Gymnastique
|
62,37 #177; 1,00
|
|
62,20 #177; 2,61
|
0,39
|
0,911
|
NS
|
|
Plaisir au Volleyball
|
62,19 #177; 3,43
|
|
60,73 #177; 3,13
|
1,88
|
0,685
|
NS
|
|
Plaisir au Saut en Longueur
|
53,84 #177; 2,54***
|
|
49,63 #177; 1,68
|
10
|
0,0001
|
S
|
|
NS : Différence non significative
* : Différence significative (p<0,05)
*** : Différence hautement significative
(p<0,001)
|
|
Source : Résultats enquête Moukoumbi
(2019)
L'analyse de ce tableau IV.1 indique que les deux
groupes ne présentent pas entre elles de liaison significative. Par
contre on obtient une corrélation hautement significative (p<0,001),
en alternance des APS chez les filles du groupe expérimental. Toutefois,
l'analyse de variance met en évidence un effet hautement significatif du
facteur plaisir au saut en longueur (p<0,001), au niveau des garçons
du groupe expérimental.
En outre, les résultats ont permis de montrer des
différences non significatives chez les filles et garçons du
groupe témoin.
IV.2. Estime de soi
Le tableau IV.2 présente également sous
forme de moyenne et écart type (  #177;), l'estime de soi générale, la valeur physique, la
condition physique, l'endurance et la compétence sportive des sujets des
groupes expérimental (GE) et témoin (GT) des deux sexes ont
été présentés dans le tableau IV.2. #177;), l'estime de soi générale, la valeur physique, la
condition physique, l'endurance et la compétence sportive des sujets des
groupes expérimental (GE) et témoin (GT) des deux sexes ont
été présentés dans le tableau IV.2.
Tableau IV.2 :Estime de soi
générale, valeur physique, condition physique, endurance et
compétence sportive des filles et garçons GE et GT sous forme de
moyenne et écart type (  #177;) #177;)
|
GE
|
|
GT
|
t
|
P
|
Appréciation
|
|
Filles
|
(n = 30)
|
|
(n = 20)
|
|
|
|
|
Estime de soi général
|
24,20 #177; 0,76***
|
|
22,85 #177; 0,49
|
7,63
|
0,0001
|
S
|
|
Valeur Physique
|
18,93 #177; 0,94
|
|
17,85 #177; 1,09
|
3,62
|
0,857
|
NS
|
|
Condition Physique
|
9,93 #177; 0,58*
|
|
8,05 #177;0,22
|
16,10
|
0,023
|
S
|
|
Endurance
|
17,03 #177; 0,18
|
|
13,15 #177; 0,49
|
33,91
|
0,968
|
NS
|
|
Compétence Sportive
|
17,01#177;0,45
|
|
15,85#177;0,49
|
8,90
|
0,841
|
NS
|
|
Garçons
|
(n = 43)
|
|
(n = 30)
|
|
|
|
|
Estime de soi général
|
27,06#177;1,14
|
|
24,03#177;0,32
|
16,52
|
0,950
|
NS
|
|
Valeur Physique
|
20,70#177;1,30
|
|
20,57#177;1,28
|
0,42
|
0,700
|
NS
|
|
Condition Physique
|
12,07#177;0,34
|
|
11,03#177;0,32
|
13,31
|
0,879
|
NS
|
|
Endurance
|
18,91#177;0,61***
|
|
14,97#177;0,18
|
39,93
|
0,0001
|
S
|
|
Compétence Sportive
|
23,93#177;0,34
|
|
21,07#177;0,37
|
33,58
|
0,612
|
NS
|
|
NS : Différence non significative
* : Différence significative (p<0,05)
*** : Différence hautement significative
(p<0,001)
Source : Résultats enquête Moukoumbi
(2019
|
|
La lecture du tableau IV.2 indique que le groupe
expérimental présente les différences hautement
significatives à p<0,001, en estime de soi chez les filles et en
endurance chez les garçons. Par contre on obtient uneanalyse de variance
des différences non significatives chez les filles et garçons du
groupe témoin. Toutefois, l'analyse des variantes met en évidence
un effet de l'activité sur la condition physique des filles du groupe
expérimental, présentant une différence significative
(p<0,05).
IV.3. Corrélations alternance des formes d'APS,
estime de soi et plaisir chez les filles GE et GT
Les corrélations entre l'alternance des formes d'APS,
les valeurs de l'estime de soi des filles GE et GT et le plaisir ressenti par
elles au cours des cycles d'EPS ont été consignées dans
le tableau IV.3.
Tableau IV. 3. : Corrélations entre l'alternance
des formes d'APS, les valeurs de l'estime de soi des filles GE et GT et le
plaisir ressenti par elles au cours des cycles d'EPS
|
Alternance
|
Plsr Gym
|
Plsr VB
|
Plsr SL
|
Compt sport
|
Cond phys
|
Endur
|
Est Soi Gle
|
|
Alternance
|
r
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
p
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plaisir Gym
|
r
|
0,216
|
|
|
|
|
|
|
|
|
p
|
0,131
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plaisir VB
|
r
|
0,293*
|
0,212
|
|
|
|
|
|
|
|
p
|
0,039
|
0,139
|
|
|
|
|
|
|
|
Plaisir SL
|
r
|
-0,115
|
-0,205
|
-0,333*
|
|
|
|
|
|
|
p
|
0,425
|
0,154
|
0,018
|
|
|
|
|
|
|
Compt sport
|
r
|
0,627**
|
-0,002
|
0,153
|
0,079
|
|
|
|
|
|
p
|
0,000
|
0,992
|
0,287
|
0,588
|
|
|
|
|
|
Cond Phys
|
r
|
0,656**
|
0,146
|
0,266
|
0,115
|
0,639**
|
|
|
|
|
p
|
0,000
|
0,310
|
0,062
|
0,427
|
0,000
|
|
|
|
|
Endurance
|
r
|
0,660**
|
0,166
|
0,303*
|
0,096
|
0,760**
|
0,909**
|
|
|
|
p
|
0,000
|
0,249
|
0,032
|
0,506
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
Est Soi Gle
|
r
|
0,167
|
0,006
|
-0,059
|
0,152
|
0,421**
|
0,277
|
0,348*
|
|
|
p
|
0,246
|
0,966
|
0,685
|
0,292
|
0,002
|
0,051
|
0,013
|
|
|
Valeur Phys
|
r
|
0,317*
|
0,015
|
-0,141
|
0,192
|
0,369**
|
0,424**
|
0,472**
|
0,087
|
|
p
|
0,025
|
0,917
|
0,329
|
0,182
|
0,008
|
0,002
|
0,001
|
0,550
|
* : Différence significative à p <
0,05 ;
** : Différence significative à p <
0,001
Source : Résultats enquête Moukoumbi
(2019)
Il ressort de l'analyse du tableau IV.3 que chez les filles,
il y a des corrélations entre l'alternance, le plaisir et l'estime de
soi. L'alternance est fortement corrélée à l'endurance.
Par ailleurs, le plaisir ressenti en gymnastique est proportionnellement
corrélé avec celui du volleyball, avec la condition physique,
l'endurance, l'estime de soi générale et la valeur physique. Il
s'est dégagé une différence significative entre ces
corrélations en faveur de celle de l'alternance avec le plaisir ressenti
au volleyball et la valeur physique (p<0,05), de celle de l'alternance avec
la compétence sportive, la condition physique et l'endurance
(p<0,01).
IV.4. Corrélations alternance des formes d'APS,
estime de soi et plaisir chez les garçons GE et GT
Les corrélations entre l'alternance des formes d'APS,
les valeurs de l'estime de soi des garçons GE et GT et le plaisir
ressenti par eux lors des cycles d'EPS ont été
consignées dans le tableau IV.4.
Tableau IV.4 : Corrélations entre
l'alternance des formes d'APS, les valeurs de l'estime de soi des filles GE
et GT et le plaisir ressenti par elles au cours des cycles d'EPS
|
Altern
|
Plsr Gym
|
Plsr VB
|
Plsr SL
|
Compt sport
|
Cond Phys
|
Endur
|
Est Soi Gle
|
|
Alternan
|
r
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
p
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plsr Gym
|
r
|
0,231*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
p
|
0,049
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plsr VB
|
r
|
0,033
|
-0,211
|
|
|
|
|
|
|
|
p
|
0,780
|
0,074
|
|
|
|
|
|
|
|
Plsr SL
|
r
|
0,119
|
-0,082
|
0,311**
|
|
|
|
|
|
|
p
|
0,317
|
0,491
|
0,007
|
|
|
|
|
|
|
Compt sport
|
r
|
-0,037
|
0,044
|
0,225
|
0,644**
|
|
|
|
|
|
p
|
0,759
|
0,712
|
0,055
|
0,000
|
|
|
|
|
|
Cond Phys
|
r
|
0,200
|
-0,027
|
0,158
|
0,636**
|
0,711**
|
|
|
|
|
p
|
0,089
|
0,820
|
0,182
|
0,0001
|
0,0001
|
|
|
|
|
Endurance
|
r
|
-0,033
|
0,056
|
0,205
|
0,622**
|
0,971**
|
0,742**
|
|
|
|
p
|
0,785
|
0,640
|
0,082
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
|
|
|
Est Soi Gle
|
r
|
0,023
|
-0,037
|
0,288*
|
0,699**
|
0,831**
|
0,706**
|
0,851**
|
|
|
p
|
0,847
|
0,754
|
0,013
|
0,000
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
|
|
Valeur Phys
|
r
|
-0,095
|
-0,339**
|
0,233*
|
0,251*
|
0,049
|
0,066
|
0,040
|
0,248*
|
|
p
|
0,423
|
0,003
|
0,048
|
0,032
|
0,682
|
0,577
|
0,735
|
0,035
|
* : Différence significative à p <
0,05 ;
** : Différence significative à p <
0,001
Source : Résultats enquête Moukoumbi
(2019)
Les valeurs consignées dans le tableau IV.4
renseignent que chez les garçons, l'alternance influe significativement
plus sur le plaisir ressenti en gymnastique et suivi de la condition physique,
du plaisir ressenti au saut en longueur, du plaisir ressenti au volleyball et
en fin de l'estime de soi général (p<0,05).
Par contre l'alternance est inversement proportionnelle
à la compétence sportive, à l'endurance et à la
valeur physique.
IV.5. Corrélations alternance des formes d'APS,
estime de soi et plaisir chez les filles et garçons GE et GT
Les corrélations entre l'alternance des formes d'APS,
les valeurs de l'estime de soi des filles et garçons GE et GT et le
plaisir ressenti par eux durant les cycles d'EPS ont été
consignées dans le tableau IV.5.
Tableau IV.5 : Corrélations entre
l'alternance des formes d'APS, les valeurs de l'estime de soi des filles et
garçons GE et GT et le plaisir ressenti par eux durant les cycles
d'EPS
|
Alternan
|
Plsr Gym
|
Plsr VB
|
Plsr SL
|
Compt Sport
|
Cond Phys
|
Endur
|
Est Soi Gle
|
|
Altern
|
r
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
p
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plsr Gym
|
r
|
0,393**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
p
|
0,0001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plsr VB
|
r
|
-0,150
|
-0,423**
|
|
|
|
|
|
|
|
p
|
0,098
|
0,0001
|
|
|
|
|
|
|
|
Plsr SL
|
r
|
0,273**
|
0,399**
|
-0,376**
|
|
|
|
|
|
|
p
|
0,002
|
0,0001
|
0,0001
|
|
|
|
|
|
|
Compt Sport
|
r
|
-0,278**
|
-0,588**
|
0,655**
|
-0,541**
|
|
|
|
|
|
p
|
0,002
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
|
|
|
|
|
Cond Phys
|
r
|
-0,044
|
-0,492**
|
0,608**
|
-0,466**
|
0,893**
|
|
|
|
|
p
|
0,629
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
|
|
|
|
Endur
|
r
|
0,127
|
-0,185*
|
0,421**
|
-0,018
|
0,681**
|
0,746**
|
|
|
|
p
|
0,162
|
0,041
|
0,0001
|
0,843
|
0,0001
|
0,0001
|
|
|
|
Est Soi Gle
|
r
|
-0,131
|
-0,364**
|
0,477**
|
-0,110
|
0,734**
|
0,676**
|
0,725**
|
|
|
p
|
0,148
|
0,0001
|
0,0001
|
0,228
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
|
|
Valeur Phys
|
r
|
-0,163
|
-0,498**
|
0,498**
|
-0,356**
|
0,642**
|
0,643**
|
0,406**
|
0,484**
|
|
p
|
0,071
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
* : Différence significative à p <
0,05 ;
** : Différence significative à p <
0,001
Source : Résultats enquête Moukoumbi
(2019)
Les résultats obtenus ont permis d'indiquer
l'alternance de APS a un impact beaucoup plus important sur le plaisir ressenti
en gymnastique comparativement à celui ressenti au saut en longueur et
sur l'endurance (p<0,01).
Cependant, l'alternance est inversement
corrélée au plaisir ressenti au volleyball, à la
compétence sportive, à la condition physique, à l'estime
de soi générale et à la valeur physique.
La figure 2 : représente la
répartition des variables à l'issue de l'analyse de la composante
principale.

Figure 2 :Répartition des variables en deux
facteurs
Source : Résultats enquête Moukoumbi
(2019)
Cette figure illustre que les deux groupes
(expérimental et témoin) présentent une différence
significative. Le tracé des composantes dans l'espace a
démontré une corrélation significative de l'alternance
avec le plaisir ressenti au saut en longueur et an gymnastique. Par contre,
l'alternance est faiblement corrélée avec l'endurance. Par
ailleurs, il n'y a pas de relation entre l'alternance et l'estime de soi
général. De plus, l'alternance est inversement proportionnelle
à la condition physique, au plaisir au volleyball, à la
compétence sportive et à la valeur physique.
IV.2. Discussion
Le présent travail a été
réalisé dans le dessein d'examiner les effets de l'alternance des
Activités Physiques et Sportives (APS) sur l'estime de soi et le plaisir
des élèves en EPS dans les classes de premières
scientifiques. Au début, nous avons pensé que l'alternance des
formes d'APS induirait une amélioration de l'estime de soi et du plaisir
chez les élèves en Education Physique et Sportive. Cette
pensée préliminaire à cette étude a
constitué l'hypothèse de recherche.
La vérification de cette hypothèse a
nécessité l'utilisation d'une étude transversale,
comparée au moyen des questionnaires basés sur différents
centres d'intérêt, tenant compte des trois concepts clé de
notre thème de recherche évoqué
précédemment. Il s'est agi :
· pour l'évaluation de l'alternance des APS d'un
questionnaire comprenant les questions ouvertes, des questions fermées
et des questions à choix multiples ;
· pour l'évaluation de l'estime de soi de
l'échelle de Likert à 6 niveaux d'approbation de chaque item (pas
du tout d'accord, très peu d'accord, un peu d'accord, assez d'accord,
beaucoup d'accord et tout à fait d'accord) ;
· pour l'évaluation du plaisir, de
l'échelle de Likert à 7 niveaux d'approbation de chaque item
(absolument pas d'accord, pas d'accord, plutôt pas d'accord, je ne sais
pas, plutôt d'accord, d'accord, absolument d'accord).
L'étude transversale a été
choisie pour éviter la perte des sujets qui affecte souvent
l'échantillon. Par ailleurs, le questionnaire constituant un moyen
d'investigation actuel et valide en Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives (STAPS) en général et en didactique des
Activités Physiques et Sportives en particulier. Au regard de ce qui
précède, les résultats auxquels nous sommes parvenus sont
d'intérêt considérable.
Les projets pédagogiques inscrits dans la planification
requièrent l'alternance des cycles des Activités Physiques
Sportives et Artistiques (APSA). L'organisation desdits cycles de façon
alternée met un terme à la monotonie et suscite l'engagement des
élèves. Les résultats de cette étude indiquent que
les filles du groupe expérimental (GE) évoquent une valeur de
l'alternance significativement plus élevée comparativement
à celles du groupe témoin (GT) (38,93 #177; 0,64 Vs 36,70 #177;
1,52 ; p<0,001) (tableau IV.1). Ces résultats s'expliquent par
le principe de la forme globale du projet pédagogique qui stipule
l'élaboration d'un plan d'action cohérent et transversal d'APSA
à organiser pendant l'année scolaire dans l'établissement
fréquenté par les sujets du groupe expérimental. Il a
été rapporté à ce sujet que le projet
pédagogique global reposant sur des procédures organisationnelles
permettant d'articuler l'action d'intervention pédagogique en utilisant
les APSA dans l'établissement de formation. Son développement
s'effectue dans une logique de coresponsabilité (Gimonet, 2008,
p.148).
La coresponsabilité s'est traduite dans
l'établissement fréquenté par les sujets GE par l'action
collective de l'élaboration du projet pédagogique des enseignants
y exerçant en respectant les principes de la logique cohérente et
horizontale de la planification en EPS en alternant les cycles par familles et
de la transversalité de compétences dans le continuum
d'apprentissage. Entsiro (2016 ; p.41) a relevé que le projet
pédagogique est un ensemble articulé d'objectifs et de moyens
destinés à les atteindre. Pour l'enseignant, c'est un extrait du
projet pédagogique de l'établissement qui lui confère
différentes APS à enseigner au cours de l'année. C'est une
organisation dans le temps (mois, trimestre ; année scolaire) et
dans l'espace (territoire pédagogique et par l'utilisation rationnelle
des installations et du matériel didactique. Ainsi, le projet
pédagogique est déterminé par les infrastructures, le
matériel disponible, le nombre d'enseignants en poste dans
l'établissement du groupe expérimental et surtout de la
connaissance que ces enseignants ont des APS, de la logique intra et inter APS
et du principe de la transversalité des acquis en EPS. La pratique des
APS implique le développement, la fixation et le réinvestissement
d'une habileté motrice (Entsiro, 2016 ; p.41).
L'alternance implique donc nécessairement une
interaction entre l'enseignant et l'apprenant avec une relation
fréquente pour définir et contractualiser les progressions, le
suivi et l'évaluation des tâches (Eberhard et coll., 2013 ;
pp42). La pédagogie par alternance est une pédagogie qui utilise
l'expérience et les savoir-faire acquis en milieu éducatif, afin
de donner du sens à la formation des apprenants. Cette pédagogie
spécifique qui définit des objectifs et une progression dans
l'acquisition des connaissances en même temps qu'une répartition
des responsabilités.
La valeur significativement plus élevée de
l'alternance évoquée par les filles du GE peut être
attribuée au savoir-faire des enseignants en matière de
planification et d'organisation des APSA qui dénote l'acquisition de
compétences associées au principe de gestion dans les classes en
EPS par eux au cours de la formation initiale dont les capacités ont
été renforcées par la participation aux séminaires.
En effet, ces enseignants ont dû organiser des classes en stage en
apprenant à alterner les APSA (Goigoux et coll. 2007), ont
rapporté que dans une modalité de l'alternance relativement
proche de celle instaurée par la réforme, les enseignants dans la
conduite des enseignements au cours de l'année de formation
opèrent les transformations. Ces auteurs s'appuient pour cela sur des
entretiens menés à différents moments de l'année.
Ils ont alors pu mettre en évidence des similitudes dans les
trajectoires des professeurs stagiaires, les déterminants des processus
de transformation, en même temps que des variations de profils. Une
première similitude renvoie à l'élaboration par
l'enseignant stagiaire d'une conception fonctionnelle de la gestion de classe.
« Progressivement ils appréhendent le déroulement de la
journée scolaire comme un temps de vie partagée avec un groupe
d'enfants, qui n'est pas homogène, qui n'est pas d'humeur égale,
qui n'est pas forcément intéressé par les activités
scolaires et qu'il faut savoir « occuper ».
Les auteurs mettent également en
évidence l'évolution des conceptions des apprentissages scolaires
au cours des traitements des dilemmes. Les enseignants stagiaires
réinterrogent ainsi la prescription selon laquelle « il faut que
les élèves soient actifs », ils apprennent à faire
confiance à leurs perceptions des situations dans lesquelles ils se
débattent. A trop vouloir rendre ses élèves actifs, elle
n'a pas su les occuper » (Blanchouin, 2013).
Par contre, il n'y a pas de différence significative
entre les avis des filles des groupes (GE et GT) en ce qui concerne le plaisir
ressenti dans chaque cycle d'EPS, à savoir la gymnastique, le volleyball
et le saut en longueur (tableau IV.1).
S'agissant des garçons, aucune différence
significative n'est remarquable entre la perception de l'alternance, le plaisir
ressent durant les cycles de Gymnastique et de volleyball
révélés par les GE et GT.
Cependant, le plaisir ressentit au cours du cycle de saut en
longueur par les garçons GE est significativement plus important
comparativement à l'avis de leurs homologues du GT de même sexe
(53,84 #177; 2,54 Vs 49,63 #177; 1,68 ; p<0,001) (tableau IV.1). Ces
résultats traduisent la satisfaction d'une tendance, d'un besoin, d'un
désir créant chez ces garçons du groupe
expérimental un état de contentement lié au plaisir.Il
s'agit d'un état affectif qui se manifeste lors de l'accomplissement de
la pratique de l'activité physique. Cela est perceptible chez le
très jeune enfant qui prend simplement du plaisir à être en
mouvement, à éprouver ses sens ou à utiliser son corps
pour être cause de quelque chose (jeu d'exercice). En effet, en Education
physique et sportive, « le plaisir est généralement
défini comme un état émotionnel agréable, une
réponse affective positive vis-à-vis de la pratique sportive
(Delignières et Perez, 1998 ; p7-18). Cet état
émotionnel est la résultante de multiples affects,
déterminés par divers éléments de la situation
vécue par le sujet. Scalan et Lewthwaite (1986 ; p25-35) ont
proposé de classer ces éléments selon deux axes : 1)-
le premier rendant compte de leur caractère intrinsèque ou
extrinsèque. Les éléments intrinsèques sont
directement liés à la pratique de l'activité,
c'est-à-dire qu'ils sont générés par l'interaction
entre le sujet et la tâche. Dans ce cadre, le sentiment de
compétence constitue un exemple d'élément
intrinsèque lié à l'accomplissement, et l'excitation
liée à la prise de risque constitue plutôt un
élément intrinsèque non lié à
l'accomplissement. Les éléments extrinsèques renvoient
à des facteurs environnementaux: dans ce cadre, les feedbacks positifs
que le sujet reçoit à travers sa performance sont un exemple
d'éléments extrinsèques liés à
l'accomplissement, et la satisfaction des besoins d'affiliation constitue
plutôt un élément extrinsèque non lié
à l'accomplissement, 2)-le second tenant compte de leur relation
à l'accomplissement.
La plus grande valeur du plaisir ressenti au saut en longueur
par les garçons du groupe expérimental peut être
attribuée aux éléments de la situation vécue par
eux sur lesquels l'enseignant de leur classe intervient constamment. Cette
situation vécue a le pouvoir de susciter le plaisir ressenti par les
élèves participant à la leçon conduite par
l'enseignant surtout lorsque le plaisir détermine la compétence.
Vescio et coll., (2002 ; p47-52) ont à ce propos notifié que
la notion de besoin de compétence mise de l'avant stipule que les
individus cherchent continuellement à améliorer leurs
performances ainsi qu'à maîtriser leurs actions.
Cette plus grande valeur du plaisir ressenti au saut en
longueur par les garçons du groupe expérimental est lié au
processus de plaisir aboutissant à des ressentis plaisants,
agréables, bref, des ressentis de plaisir qui est commun aux animaux,
aux humains et donc aux élèves à l'Ecole. Il accompagne
les phénomènes d'adaptation et l'on peut même dire qu'il
est l'indicateur d'une adaptation réussie. Un individu s'adapte à
l'aide d'apprentissages qui ont presque toujours une dimension corporelle.
Cette dimension corporelle est particulièrement développée
en Education Physique où se déroule toute une batterie
d'apprentissages. Tout cours d'EPS est donc un moment propice pour qu'y soient
générés des plaisirs et aussi des déplaisirs. Il ne
faut jamais oublier que plaisir et déplaisir sont les deux faces
indissociables d'un même processus. Le plaisir-déplaisir qui
colore agréablement-désagréablement tout état
psychique conscient est instable, fugace, réversible. Mais le plaisir
étant une source puissante de motivation, il peut être tentant
pour les pédagogues de vouloir en instrumentaliser l'usage
(Delignières et coll., 2000, p77-90).
La plus grande valeur du plaisir ressenti au saut en
longueur par les garçons du groupe expérimental est
associée à son rôle dans le cadre de l'EPS. En effet, les
déclencheurs du plaisir de l'élève en EPS
sont généraux, inhérent à toutes les
activités (la fameuse volonté de développer une approche
à caractère ludique) et à la nature de certaines
activités. Ces " déclencheurs " du plaisir de
l'élève en EPS ne relèvent pas davantage d'une «
mécanique » plus contextuelle liée à
l'expérience que revêt pour l'élève l'engagement
dans telle ou telle APSA (interaction élève / activité).
On peut alors généraliser les sources de plaisir en EPS de la
6ème à la terminale sans prendre en compte l'histoire des
expériences corporelles de chacun d'eux. De ce fait, il ressort une des
raisons qui donnent à cette source de plaisir un statut
particulièrement important en EPS. Il a été
rapporté à ce sujet que le plaisir éprouvé lors de
la réussite en EPS participe d'une certaine manière à la
construction identitaire de l'adolescent dans son rapport à
l'activité physique, mais plus encore dans son rapport à
l'activité corporelle, et très certainement à la place de
cette dernière dans son schéma de personnalité (Famose,
2002, ed).
La plus grande valeur du plaisir ressenti au saut en
longueur par les garçons du groupe expérimental est due aux
mécanismes du plaisir chez les élèves en EPS en rapport
avec les conceptions et mises en oeuvre de l'évaluation qui consiste
à mesurer les progrès de l'élève qui
dépendent du plaisir ressenti au cours de l'apprentissage en raison d'un
choix d'indicateur inapproprié pour rendre compte de ce qui a
été transformé en une unité effective
d'apprentissage.
La plus grande valeur du plaisir ressenti au saut en
longueur par les garçons du groupe expérimental peut
également s'expliquer par le plaisir qu'éprouve
l'élève dans l'apprentissage moteur traduit par la motivation
intrinsèque qui correspond à la relation positive
engendrée par l'interaction de ces élèves aux tâches
d'apprentissage de cette APSA. Wankel et Kreisel (1985 ; p51-64) ont en
effet montré que les sources de plaisir intrinsèques telles que
l'amélioration de ses habiletés (le progrès) et la
maîtrise de la tâche sont prépondérantes chez des
enfants âgés de 7 à 14 ans dans les trois pratiques
sportives suivantes (football, hockey et base-ball). Par ailleurs, le plaisir
peut aussi être étudié en tenant compte du contexte et des
feed-back positifs (encouragements...). A la motivation intrinsèque,
s'ajoute la motivation extrinsèque ressortie dans la théorie de
l'autodétermination représente la motivation (Deci et Ryan,
1991 ; p237-288).
La motivation est déterminée par
plusieurs paramètres dont l'estimation de la propre valeur par le sujet
suite à sa forme, à ses capacités diverses et à ses
relations avec son environnement physique et social traduit par l'estime de
soi. Les résultats auxquels nous sommes parvenus indiquent que la valeur
de l'estime de soi général est significativement plus
évoquée par les filles du groupe expérimental (GE) que
celle du groupe témoin (GT) (24,20 #177; 0,76 vs 22,85 #177; 0,49 ;
p<0,001) (tableau IV.2). Cela peut s'expliquer par l'alternance des APSA
dans leur continuum. L'alternance peut être à ce sujet
considérer comme une pédagogie de la confrontation (Granato et
coll., 2013 ; p109-131). Elle nécessite une mise en
cohérence forte et affirmée des périodes d'alternance,
ainsi qu'une démarche pédagogique particulière. En effet,
la recherche d'une cohérence du dispositif au regard des objectifs de
formation affichés devrait conduire à privilégier un
dispositif pédagogique, s'articulant autour d'une mise en
cohérence des savoirs à partir de l'analyse d'une situation
professionnelle, plutôt qu'une organisation pédagogique
centrée sur un découpage disciplinaire des contenus de formation.
L'alternance apprécie la cohérence entre les savoirs et leur
progression en milieu de l'apprentissage. Au fil des décennies, les
formations par alternance se sont largement développées et leur
impact va bien au-delà des formations à visée
professionnelle. Le versant pédagogique de l'alternance, les
finalités qu'on lui accorde, ne sont pas les sujets dont on parle le
plus et de nombreux professionnels s'accordent pour démontrer que ce
système de formation ne donne pas toujours les résultats
escomptés. De grandes différences existent entre le monde de
l'école et celui du travail qui ne sont pas régis par les
mêmes règles et ne présentent pas les mêmes enjeux.
La négociation entre les différents partenaires est difficile,
ainsi que leurs objectifs sont divergents. L'alternance est donc conçue
de façon schématique, les conceptions de l'apprentissage
diffèrent selon les formateurs, le stage peut représenter pour
certains professionnels I 'application des théories (Granato et coll
2013 ; p315-340)
La valeur de l'estime de soi général est
significativement plus évoquée par les filles du groupe
expérimental est liée au progrès dans les apprentissages
des APSA alternées dans ce continuum. Cela est associé à
l'intérêt qu'elles accordent auxdits apprentissage. Anderssen
(2005 ; p82) a montrer que les variables motivationnelles en lien avec les
résultats en EPS. Elle précise en effet qu'il existe un certain
nombre de variables remarquables spécifiques telles que la taille, le
poids, les pratiques sportives, les caractéristiques de l'effort
physique (formes, modalités, intensités).
La valeur de l'estime de soi général est
significativement plus évoquée par les filles du groupe
expérimental dénote la motivation en contexte scolaire qui est
un état dynamique tirant ses origines dans les perceptions qu'un
élève a de lui-même et de son environnement et qui l'incite
à choisir une activité, à s'y engager et à
persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre un but
» (Viau, 2009). La motivation étant l'expression de toute gamme
d'émotions combine les facteurs de plaisir et d'activation de notre
énergie (Deci et Ryan, 1991 ; Vallerand, 1997). Ces auteurs
expliquent cela par le pouvoir de prédiction de la persistance de
l'adhésion à une activité d'apprentissage en relation
toujours avec l'alternance des formes d'APSA. Hegger et Chatzisarantis, (2007)
ont souligné la pertinence du modèle de l'alternance des formes
d'APSA et ses effets sur la motivation en EPS. Ces résultats renforce
l'hypothèse de la satisfaction de trois besoins fondamentaux : un
besoin de compétence, un besoin d'autonomie et un besoin d'appartenance
sociale (Deci et Ryan, 2000, 2002).
Cette valeur de l'estime de soi général est
significativement plus évoquée par les filles du groupe
expérimental est tributaire du traitement de l'information favorable au
progrès pendant l'apprentissage moteur dans un continuum alternat les
APSA. Vallerand (1997) a fait remarquer à cet effet que la motivation a
des conséquences d'ordre cognitif, affectif et comportemental. D'un
point de vue cognitif, il faut noter que la motivation
autodéterminée provoquerait une meilleure attention, une
meilleure concentration et une meilleure compréhension. Du
côté de l'affectif, la motivation autodéterminée
provoquerait plus de satisfaction, de plaisir et d'intérêt. Enfin,
il serait raisonnable d'attribuer à la motivation
autodéterminée des conséquences d'ordres comportementaux
tels que les meilleures performances, la persévérance dans
l'activité et une plus grande intensité investie dans la
tâche.
S'agissant des garçons, aucune
différence significative n'est remarquable entre la perception de
l'estime de soi, la valeur physique, la condition physique
révélée par les GE et GT.
Cependant, l'endurance révélée
par les garçons GE est significativement plus important comparativement
à l'avis de leurs homologue GT de même sexe (18,91#177;0,61Vs
14,97#177;0,18 ; p<0,001) (tableau V.2). Cette plus grande valeur de
l'estimation de l'endurance par ces garçons du groupe
expérimental traduit la formation du concept de soi en utilisant
l'information sur leurs habiletés scolaires ou sportives (Marsh et
Parker, 1984 ; p213-231). Marsh (1987 ; P17-19) a exprimé cela
par l'effet «gros poisson-petit bassin» (...). Cet effet signifie que
«... lorsque des élèves, sont également capables, se
comparent eux-mêmes avec des élèves plus capables, ils ont
des habiletés scolaires perçues plus faibles et des concepts de
Soi scolaires plus bas ; et ils ont des habiletés scolaires
perçues supérieures et un concept de Soi académique
supérieur lorsqu'ils se comparent avec des élèves moins
capables ». Le processus de comparaison sociale est très complexe
étant donné que, dans les situations scolaires, les comparaisons
sociales comprennent à la fois des comparaisons au groupe classe
à des sous-groupes particuliers (par exemple, les garçons ou les
filles) et des comparaisons avec un individu particulier.
Cette plus grande valeur de l'estimation de
l'endurance par ces garçons du groupe expérimental est
liée à la perception que ces garçons ont de leur
capacité de réaliser des performances optimales dans un continuum
d'alternance des APSA dans lequel a existé une activité
d'opposition et de coopération à savoir le volleyball. Marsh et
Peart (1988 ; p390-407) ont montré que dans le programme
coopératif, tous les élèves étaient
encouragés à travers des commentaires tels que «vous avez
très bien abordés cet exercice » ou « rappelez-vous que
l'objectif est de progresser dans le temps ». L'accent était ainsi
placé sur le progrès et la coopération pour parvenir
à celui-ci. Dans le programme compétitif, vaincre et être
le meilleur du groupe était souligné à travers des
commentaires tels que, «regardez comme Marie fait bien. Elle est un mile
devant vous, allez » ou « quel groupe est en train de gagner
aujourd'hui?» ou «regardez si vous pouvez battre le groupe 4
aujourd'hui».
La compétence sportive ne présente pas de
différence significative entre les garçons des deux groupes.
Toutefois, la valeur de la compétence sportive des garçons du GE
est nettement plus grande que celle de leurs homologues GT. Cela permet de dire
d'avantage que l'estime de soi est alors influencée par la façon
dont ces garçons reconnaissent leurs compétences dans des
secteurs où la réussite est fondamentale. Biddle et coll
(1994 ; p135-144) ont rapporté à ce sujet que la bonne
estime de soi est un facteur influant de la réussite scolaire. Le
développement de l'estime de soi chez l'élève constitue
alors une intention éducative dans les programmes d'EPS, les conceptions
de soi de réussite scolaire pouvant influencer la réussite en
agissant sur la motivation dans la pratique des APSA.
Les valeurs plaisir ressenti par les filles en
gymnastique et au volleyball sont corrélées à l'alternance
des formes d'APSA (r=+0,216 et r=+0,293 ; respectivement) (tableau IV.3).
Cette corrélation du plaisir et la pratique de ces APSA est liée
aux émotions positives (Ria, et coll., 2005). La réussite des
éléments gymniques de la difficulté C comme le saut de
mains, le pont, l'Appui tendu renversé (ATR) tenu, la roulade
arrière piquée, des smashs et contre au volleyball par les filles
induit les émotions positives dont la gestion adéquate suscite du
plaisir. La corrélation entre l'apprentissage du volleyball et le
plaisir est plus importante à celle de l'apprentissage la gymnastique et
le plaisir. Cela renforce l'hypothèse de l'influence de la
coopération sur les éléments de la motivation ainsi que
nous l'avons expliqué antérieurement.
Les valeurs de l'estime de soi des filles,
notamment : l'estime de soi générale, la valeur physique, la
condition physique, l'endurance et la compétence sportive sont toutes
corrélées à l'alternance des formes d'APSA (r=+0,167,
r=+0,317, r=+0,656, r=+0,660 et r=+0,627 ; respectivement) (tableau IV.3.
Ces résultats s'explique par le caractère multidimensionnel des
réponses au concept de soi et d'autre part de vérifier que la
valeur physique est fortement corrélée avec le concept de soi
d'habileté physique et non avec les autres domaines du concept de
soi.
Toutefois, il s'est dégagé une
différence significative entre ces corrélations en faveur de
celle de l'alternance avec le plaisir ressenti au volleyball et la valeur
physique (p<0,05), de celle de l'alternance avec la compétence
sportive, la condition physique et l'endurance (p<0,01). Ces
résultats renforcent l'hypothèse de l'apprentissage par
alternance des APSA. En effet, apprendre à faire classe dans une
formation en alternance en prenant son activité professionnelle comme
objet d'étude suppose un « va et vient » permanent entre le
système tâche-activités-pratiques de l'élève
et le système tâche-activités-pratiques. Dans ce cadre,
l'analyse des apprentissages professionnels et l'étude des
préparations écrites de séance mettent en évidence
la multiplicité et complexité de la tâche du PE (Professeur
d'Ecole) débutant. Placé dans l'obligation institutionnelle
d'enseigner l'EPS, les PE stagiaires, nous l'avons vu, assument leur mission,
nouvelle pour eux, avec plus ou moins de réussite. Les conditions de
leur développement reposent sur la relation activités-savoir ce
que montre cette étude, une appropriation des « savoirs pour
enseigner » (Altet 1996).
Eu égard de ce qui précède, il faut
éviter la juxtaposition des APSA qui est le fait de ne pas alterner les
APSA. Le fait de ne pas alterner les APS dans le menu des cours
d'éducation physique et sportive (EPS), démotive certains
élèves et les pousse à s'absenter
délibérément des cours d'EPS comme le prouve une
étude menée par Mviri (2018, p.122) sur la planification des
activités physiques et sportives dont les résultats nous
indiquaient que seuls neuf (9) APS sur dix-huit (18) étaient
majoritairement programmées dans les lycées de Brazzaville
à savoir : la course de vitesse, le football, la gymnastique, le
saut en longueur, la course d'endurance, le saut en hauteur, la course de
haies, le handball, le triple saut. Le judo, la course de résistance, le
saut à la perche, le lancer de javelot, le volleyball, la natation, le
lancer de disque, le basketball et la boxe quoiqu'étant au programme
(INRAP, 2005), certaines APS n'étaient pas programmées par les
enseignants questionnés, d'autres étaient programmées mais
pas enseignées et ceci conduisait à une amotivation des
élèves au cours d'EPS d'où le phénomène
d'absentéisme en EPS.
Comme chez les filles, les valeurs de plaisir
ressenti par les garçons en gymnastique et au volleyball auxquelles
s'ajoute celle du saut en longueur sont corrélées à
l'alternance des formes d'APSA (r=+0,216, r=+0,216 et r=+0,293 ;
respectivement) (tableau IV.4). Cette corrélation du plaisir et la
pratique de ces APSA est tributaire des effets de l'alternance des formes
d'APSA sur le plaisir. Kendzierski et DeCarlo (1991 ; p50-64) en effet
soulignée la corrélation entre l'orientation motivationnelle de
maîtrise des pratiques sportives scolaires et le plaisir perçu.
Deci et Ryan (1985), pour leur part, ont avancé l'hypothèse que
les activités physiques et sportives seraient pratiquées a priori
pour des motifs intrinsèques. Selon eux, l'attrait de l'action et le
simple plaisir qu'elles procurent seraient à la base de la propension
des individus à les pratiquer. De plus, ils soutiennent que ces
activités répondraient à un désir
d'autodétermination et d'interaction sociale. Le besoin
d'autodétermination est ici considéré comme le besoin de
choisir librement ses activités selon ses propres besoins et
préférences. Ce besoin s'accompagnerait d'une perception
d'autonomie, de contrôle et de plaisir. Deci et Ryan (op. cit.) ont
également noté qu'en tenant compte des changements observables
dans le domaine sportif, ils estiment que l'accent mis sur l'aspect
compétitif soumettrait progressivement les individus à des
pressions extrinsèques; si bien que les sources de motivations
extrinsèques prendraient une place grandissante. Ils attribuent des
motivations intrinsèques et extrinsèques au plaisir. À
l'instar de la théorie du besoin de compétence, ces derniers
considèrent que le sport satisferait un besoin d'améliorer
continuellement ses habiletés afin de se sentir compétent. Ils
précisent également que les rétroactions négatives
constructives peuvent s'avérer favorables dans la mesure où elles
sont mises au profit du développement des compétences.
La corrélation entre l'alternance des formes
d'APSA et le plaisir ressenti en gymnastique est supérieure à
celles de ladite alternance et d'autres APSA comme le volleyball et le saut en
longueur. Cela est dû à la capacité de force usuelle en
gymnastique masculine en relation avec le taux élevé
d'androgènes dans la testostérone. En effet, ces garçons
pubères peuvent avoir une teneur assez importante de testostérone
qui leur confère la force indispensable dans la réalisation des
éléments gymniques indiqués pour leur sexe, entre
autres : le saut périlleux, le salto en position groupé.
Fourny et coll. (2000 ; p.58) a énoncé que dans un programme
masculin au sol, les mouvements doivent faire ressortir la force, la souplesse
et l'agilité du gymnaste pour exploiter toute la surface disponible.
Ces résultats indiquent également des
corrélations entre l'alternance des formes d'APSA et l'estime de soi
générale et la condition physique (r=+0,023, r=+0,200 et
r=+0,023) chez les garçons. Ces corrélations entre l'alternance
des formes d'APSA et l'estime de soi générale et la condition
physique sont attribuables à l'influence du continuum d'apprentissage
sur l'estime de soi. En effet, un programme d'intervention conçu pour
influencer le concept de soi d'habileté physique, via une augmentation
de la valeur physique réelle des élèves, a un effet
important sur le concept de soi d'habileté physique et non sur les
autres domaines du concept de soi. Les programmes d'éducation physique
orientés coopérativement responsables de la dynamique de l'estime
de soi.
L'alternance des formes d'APSA est fortement
corrélée au plaisir ressenti en gymnastique et saut en longueur
et inversement proportionnelle au volleyball dans l'ensemble (r=+0,393,
r=+0,273 et r=-0,150) (tableauIV.5). Les fortes corrélations entre les
formes d'APSA et le plaisir ressenti en gymnastique et saut en longueur sont
liées à la perception de la compétence. Csikzentmihalyi
(2004) ont en effet considéré qu'un individu peut faire
l'expérience du plaisir uniquement lorsque ses perceptions de
compétence personnelle et d'autodétermination restent intactes,
qu'elles soient perçues consciemment ou non; par ailleurs, ils
soutiennent que ces deux éléments sont attribuables à
l'implication sportive et feraient naître le plaisir. À la suite
de leur étude empirique, ils ont proposé un modèle
théorique du plaisir représenté par un schéma
à deux dimensions croisées, chacune d'elles constituant un
continuum entre deux pôles. Ce modèle comporte ainsi quatre
quadrants, soit l'accomplissement intrinsèque, l'accomplissement
extrinsèque, le non -accomplissement intrinsèque ainsi que le
non-accomplissement extrinsèque. Chaque quadrant comporte des sources de
plaisir distinctes et possède ses propres particularités.
Ceci montre que le contenu de la consigne n'est pas neutre
et peut agir sur les perceptions des élèves. Ces perceptions
peuvent aussi s'ancrer progressivement sous l'influence de l'enseignant qui
provoque le renforcement chez les garçons du groupe expérimental
contrairement à ceux du groupe témoin. Nous pouvons penser
dès lors que cette adhésion chez les élèves pourra
provoquer plus tard une différence de motivation, d'engagement et de
performance entre les garçons des deux groupes comme certaines
études le montrent (Vigneron, 2004 ; p125-162).
A l'inverse, l'alternance des formes d'APSA est
inversement proportionnelle à la compétence sportive, l'endurance
et la valeur physique chez les garçons (r=-0,037, r=-0,033 et
r=-0,095). Ces résultats sont liés à l'évaluation
portant exclusivement sur la performance qui induit le désengagement des
élèves dans l'apprentissage moteur. Il a été
rapporté à ce propos qu'une évaluation axée
exclusivement sur la performance réduit le niveau d'engagement de
l'élève. Il a été rapporté à cet
effet que dans le pire des cas parfois, les cadres évaluatifs auxquels
les enseignants sont tenus de se référer (barème de
performance) condamnent même certains élèves à ne
pas réussir malgré toute la qualité et la
persévérance de leur engagement dans le cycle d'enseignement (les
aptitudes à l'effort sont une source
d'hétérogénéité génétique)
(Ninot, 2000).Ainsi de telles expériences de pratique physique peuvent
laisser des impressions très négatives chez l'élève
en raison du sentiment de ne pas être en mesure de répondre
à ce qui est attendu à l'école et ce en dépit d'un
réel effort en vue de mobiliser au maximum ses ressources.
Les corrélations entre l'alternance des formes
d'APSA des sujets GE et GT sont significativement différentes. On peut
expliquer cela par la construction subjective du plaisir à travers
l'expérience. Les travaux Delignières et Perez (op. cit.) sur le
plaisir se construirait subjectivement à travers l'expérience
sportive, d'où les auteurs (Delignières et Perez), le
considèrent comme un processus. Ses effets se manifesteraient de
manière immédiate, c'est-à-dire au cours de l'action. Les
facteurs intrinsèques tels que la maîtrise de la tâche ou
les progrès personnels qui apportent la contribution la plus
significative au plaisir des pratiquants.
Ces résultats sont tributaires des conditions
d'apprentissage moteur des sujet GE où ils ont des installations
sportives et du matériel didactique adéquat. En effet, la
réussite de l'enseignement est déterminée par les
conditions favorables à l'activité ludique des enfants et des
adolescents en EPS et le respect des exigences de l'apprentissage. Cela
engendre le plaisir des élèves qui est source d'évolution.
En effet, les élèves prennent du plaisir à progresser si
leurs buts sont orientés vers la tâche, d'où l'importance
d'un climat motivationnel de maîtrise en EPS (Haye, 2004). Biddle et
coll. (2003 ; p687-701) ont montré que l'adoption de buts de
maîtrise et/ou la perception du climat de la classe comme orienté
vers la maîtrise de la pratique accroît le plaisir
éprouvé. Les enfants et les adolescents ont un fort besoin de
liberté. Par ailleurs, les études ont montré que le
sentiment d'autodétermination était une source d'affects positifs
(Deci et Ryan, 2002 ; op cit). Le plaisir lié au sentiment de
liberté peut s'épanouir avec l'«évasion » des
dimensions temporelles, matérielles, spatiales, groupales,
institutionnelles habituellement associées l'École. Le plaisir en
EPS, c'est également se sentir intégré au sein d'un
groupe, reconnu par les autres, participer à un projet commun, «
être avec les copains » (Haye, 2004).
La figure 2 illustre une influence de l'alternance des
formes des APSA sur le plaisir ressenti en gymnastique et au saut en longueur.
Cette illustration est liée à l'importance de l'apprentissage par
alternance. En effet, Thépaul cité par Altet (1996) a
notifié que les savoirs mobilisés dans l'enseignement
améliore l'engagement des élèves. En effet, sans un
approfondissement des connaissances sur les « savoirs à enseigner
», dont les PE perçoivent alors leurs propres limites, il leur est
difficile de s'engager plus en avant dans la mise en oeuvre d'un enseignement
de l'EPS instituant le temps et l'espace des cours d'EPS autour de contrats
didactiques clairs sur l'alternance des APS en éducation physique et
sportive.
En somme, ce travail laisse présager qu'il existe
un lien très significatif entre l'alternance des formes d'APSA et le
plaisir et significatif entre ces formes d'alternance d'APSA et l'estime de
soi. Suite aux résultats montrant un lien beaucoup plus important les
formes d'APSA et le plaisir, des analyses profondes sont indispensables.
IV.4. Suggestions
L'intérêt des recherches sur la
problématique de la motivation est de plus en plus important dans la
communauté scientifique dans la mesure où il doit avoir des
retombées sur l'intervention pédagogique et l'apprentissage
moteur. Les recherches qui s'appuient sur le modèle de
l'auto-détermination et le modèle hiérarchique de la
motivation intrinsèque et extrinsèque sont encore amenées
à se multiplier à l'avenir dans le champ des APSA et de
l'Education Physique et Sportive.
Au terme de ce travail, nous avons formulé les
suggestions à l'endroit :
-des Ministères en charge de l'éducation
d'équiper les établissements scolaires en matériel
didactique adéquat et suffisant pour l'intervention pédagogique
en EPS ;
-de la Direction des Activités
Pédagogiques (DAP) de la Direction Générale de l'Education
Physique et du Sport Scolaire et Universitaire (DGEPSSU) par
l'intermédiaire de ses services d'instituer l'organisation des
séminaires dans les établissements (inspections sectoriels) et
dans les départements pour favoriser l'alternance des APSA dans le
domaine de l'enseignement d'éducation physique et sportive pour ainsi
inculquer les nouveaux planification et planning des cours au Congo pour
permettre aux élèves de bénéficier d'un
enseignement efficace, efficient et équitable ;
- des superviseurs pédagogiques de conjuguer les
efforts en aidant les enseignants à effectuer une planification en EPS
obéissant à la logique cohérente et respectueuse de
l'alternance des APSA et de la transversalité.
Conclusion
Ce travail a été réalisé
dans le but d'examiner les effets de l'alternance des formes d'Activités
Physiques Sportives et Artistiques (APSA) sur l'estime de soi et le plaisir des
élèves en EPS dans les classes de premières scientifiques.
Au début, nous avons formulé l'hypothèse que l'alternance
des formes d'APS induirait une amélioration de l'estime de soi et du
plaisir chez les élèves en Education Physique et Sportive.
Les résultats obtenus ont permis de montrer
que l'alternance des APS a un impact beaucoup plus important sur le plaisir
ressenti en gymnastique comparativement à celui ressenti au saut en
longueur et sur l'endurance. Cependant, l'alternance des APS au cours d'EPS
est inversement corrélée au plaisir ressenti au volleyball,
à la compétence sportive, à la condition physique,
à l'estime de soi générale et à la valeur physique.
Par ailleurs les sujets des deux groupes
(expérimental et témoin) ont présenté une
différence significative sur l'alternance, l'estime de soi et le
plaisir. A cet effet, les filles du groupe expérimental décrivent
significativement l'alternance des APS comparativement à celles du
groupe témoin. De plus, il a été constaté des
scores d'estime de soi des garçons du groupe expérimental
supérieurs à ceux du groupe témoin.
Ces résultats ont démontré la
corrélation plus importante entre l'alternance des formes d'APSA et le
plaisir ressenti au volleyball chez les filles du groupe expérimental
que celles du groupe témoin tandis qu'il y a eu une forte
corrélation entre cette alternance et le plaisir ressenti en gymnastique
et au saut en longueur chez les garçons du groupe expérimental
par rapport à ceux du groupe témoin. Il en est de même pour
la corrélation entre l'alternance des formes d'APSA et les indicateurs
de l'estime de soi, notamment : l'estime de soi générale,
l'endurance et la valeur physique, la compétence sportive et condition
physique chez les filles d'une part, l'estime de soi générale et
la condition physique chez les garçons d'autre part.
Le tracé des composantes dans l'espace a
démontré une corrélation significative de l'alternance
avec le plaisir ressenti au saut en longueur et en gymnastique. Par contre,
l'alternance est faiblement corrélée avec l'endurance. Par
ailleurs, il n'y a pas de relation entre l'alternance et l'estime de soi
général. De plus, l'alternance est inversement proportionnelle
à la condition physique, au plaisir au volleyball, à la
compétence sportive et à la valeur physique.
A la lumière de ces résultats,
l'hypothèse de cette étude a été
vérifiée. Une attention particulière mérite
d'être orientée vers de nouveaux axes à explorer, entre
autres :
· les formes de regroupement et le plaisir,
· les modèles d'apprentissage et le plaisir,
· les facteurs écologiques déterminant et
le plaisir,
· la paramétrisation d'effort et le plaisir.
REFERENCES
1- Altet, M. (1996). Les compétences
de l'enseignant professionnel. Entre savoirs, schèmes d'action et
adaptation : le savoir analyser, in L. Paquay, M. Altet, E. Charlier, P.
Perrenoud, Former des enseignants professionnels. Quelles stratégies ?
Quelles compétences ?, Bruxelles : De boeck.
2- Amade-Escot, C. (2003). Didactique de
l'éducation physique. Etat des recherches, Paris, Eds Revue EP&S.
3- Amade-Escot, C. et Marsenach, J. (1995).
Didactique de l'éducation physique et sportive, Grenoble,
4- Anderssen, N., Wold, B. et Torsheim, T.
(2005). «Tracking of Physical Activity in Adolescence».
ResearchQuarterly for Exercise and Sport, vol. 76, no 2, p. 119-129.
5- Andre, C. (2005) L'estime de soi,
recherche en soins infirmiers, n°82, France, p 26-30
6- Anzieu, D. et Martin, I.-Y. (1968). La
dynamique des groupes restreints. Paris : PUF.
7- Battle, J. (1991). Self-esteem research: A
summary of relevant findings. Edmonton, Alberta: James Battle and Associates.
8- Battle, J. (1993). Misconceptions
regarding self-esteem. Edmonton, Alberta: James Battle and Associates.
9- Beauchamps, P.H., Halliwell, W.R., Fournier, J.F.
et Koestner, R. (1996).«Effects of cognitive-behavioral
psychological skills training on the motivation, preparation, and putting
performance of novice golfers». The Sport Psychologist, vol. 10, p.
157-170.
10- Beicht U. et. Eberhard V. (2013a), «
Bedeutung der Teilnahme an teilqualifizierendenBildungsgängen und
Maßnahmen am Übergang von der Schule zurBerufsausbildung », in
BIBB :DatenreportzumBerufsbildungsbericht 2015. Bonn, p. 100-109
11- Beicht U., et Eberhard V. (2013), «
ErgebnisseempirischerAnalysenzumÜbergangssystem auf Basis der
12- Biddle, S. et Goudas, M; (1994). Sport,
activité physique et santé chez l'enfant. Enfance, 2 3, 135-144.
13- Biddle, S., et Brook, R. (1992).
«Intrinsic versus extrinsic motivational orientation in physical education
and sport». British Journal of Educational Psychology, vol. 62, p.
247-256.
14- Biddle, S., Sallis, J.F., et Calvill, N.
(1998). «Young and active? Policy framework for young people and
health-enhancing physical activity». London: Health Education Authority.
15- Biddle, SJ.H., et Wang, C.KJ. (2003).
«Motivation and self-perception profiles and links with physical activity
in adolescent girls». Journal of adolescence, vol. 26, p. 687-701.
16- Blanchouin, A. (2013). Former les
professeurs d'école au temps et à l'espace de l'EPS.
http://ife.enslyon.fr/publications/edition-electronique/recherche-et-formation/R&F-Recits-d-experience-ABlanchouin.pdf.
17- Boleda, S., Famose et Peres (2004).
Formation du concept de soi physique: intervention en EPS sur les cadres de
reference. Thèse de Doctorat en STAPS. Université Paris-sud
11.
18- Bowlby J. (1982) Attachment and loss. Vol
1 : Attachment (2nd ed.) New York : Basic Books (originally published in 1969)
19- Brière, N.M., Vallerand, RJ., Blais,
MÉR.' et Pelletier, L.G. (1995). «Développement et
validation d'une mesure de motivation intrinsèque, extrinsèque et
d'amotivation en contexte sportif: L'Échelle de motivation dans les
sports (EMS)>>. International Journal ofSport Psychology, vol. 26, p.
465-489.
20- Bucheton D. (2005) Les gestes
professionnels : entre routines, événements et ajustements, La
lettre de l'AIRF, 36-1, 19-20.
21- Cassidy J. (1988) Child-Mother Attachment
and the self in six-year olds. Child Development, 58 ( 1)
22- Caumel, J.G. (2000). Contribution
à une épistémologie de l'Education Physique Scolaire,
http://these.univ-lyon2.fr/these
2000/JgCaumel/these_back.html.
23- Cholvy, F. (2015). L'influence des formes
de groupements sur les apprentissages moteurs des élèves en EPS
dans le cadre de l'activité d'acrosport avec une classe de
6ème. Education 2015 <Dumas 01192932>
24- Clotilde Osadczuk, Julie Pironom, Jacques Fiard,
et Didier Jourdan (2012). Education physique et santé à
l'école primaire : évaluation de l'outil »Sport,
santé et plaisir».Rapport de Recherche., pp.198.
25- Cooley C.H. (1902) Human nature and the
social order. New York : Charles Scribner's Sons
26- Coopersmith S. (1994) Inventaire d'estime
de soi, forme scolaire, ECPA.
27- Csikzentmihalyi, M. (2004). Vivre. La
psychologie du bonheur. Paris: Robert Laffont.
28- Deci, E.L., et Ryan, R.IVI.
(1991).«A Motivational approach to self: Integration in
personality», In R. Dienstbier, Nebraska symposium on motivation:
Perspectives on motivation. University of Nebraska Press, vol. 38, p.
237-288.
29- Deci, E.L., et Ryan, R.M.
(1985).Intrinsic motivation and self-regulation in human behavior. New
York: Plenum Press.
30- Deci, E.L., et Ryan, R.M.
(2000).«The «What» and «Why» of goal pursuit:
Human needs and self-determination of behavior». PsychologicalInquiry,
vol. 11, no 4, p.227-68.
31- Deci, E.L., et Ryan, R.M.
(2002).«Handbook of self-determination Research». Rochester,
l'JY: University of Rochester Press.
32- Delignères, D. et Duret, P(1995)
« Lexique thématique en STAPS », in VIGOT, Paris, 2
33- Delignières D, et Garsault
Ch(1995). , Apprentissages et utilité sociale : que pourrait-on
apprendre en EPS ? in Dossiers EPS n° 29 A quoi sert l'Education Physique
et Sportive ? chap 4 : Le plaisir en éducation physique et sportive
34- Delignières D. et Méard,J-A
(2000) « Donner aux élèves le goût de
l'effort », in L'effort,.), Paris, Revue EPS, , p.77-90)
35- Delignières, D. et Garsault, C.
(1996). Apprentissages et utilité sociale: que pourrait-on
apprendre en EPS? In A quoi sert l'Education Physique et Sportive?
(coordonné par B.X. René), pp. 155-162. Edition Revue EPS, Paris.
36- Delignières, D. et Perez, S.
(1998). Le plaisir perçu dans la pratique des APS :
Élaboration d'un outil d'évaluation. Revue S.T.A.P.S., n°45,
p 7-18.
37- Duclos G., Laporte D., et Ross J. (1995)
L'estime de soi de nos adolescents. Guide pratique à l'intention des
parents. Montréal, Éditions de l'Hôpital Sainte Justine
Echelle de Rathus (1973)
38- Eberhard V., Beicht U. Krewerth A. et Ulrich J. G.
(2013), PerspektivenbeimÜbergangSchule -Berufsausbildung:
MethodikundersteErgebnisseaus der BIBB-Übergangsstudie 2011, Bonn,
BundesinstitutfürBerufsbildung (WissenschaftlicheDiskussionspapiere
142).
39- Entsiro, F., Ibata, A, Nsompi, F., Magnima, J. et
Alongo I.R.G (2016). Effets du projet pédagogique transversale
sur le développement de la force des membres supérieurs et de la
force -vitesse des membres inférieurs chez les lycéens Congolais
de Brazzaville. Cahiers Africains de Recherche en Education n°10 (N°1
STAPS), PP. 39 - 53
40- Ewamela A., ItouaOkemba,.LembeG.,Ibata A., Nsompi
F.,Oniangue R., N'fa I YindMushid et Bongbele J., (2013) Logiques
internes des APT, Ngala de la République du Congo, Revue du centre de
recherche de l'Université Pédagogie Nationale 2013, n°0540
pp. 139 à 153,
41- Ewamela, A. (2005). Enseignement de l'EPS
en ambiance chaude et humide : Perturbations physiologiques et
modèles de remédiation. Thèse de Doctorat unique en
Sciences de l'Education. ENS-Chaire UNESCO en Sciences de l'Education pour
l'Afrique Central. Université Marien NGOUABI, Brazzaville, n°4
42- Ewamela, A.,Mandoumou, P., Kena Lubika A., Moboza
Ndongo, E., Bongbele, J. (2016), Influence of self-Esteen inthe with
drawal EPS Students from catholic schools of humanities in Kinshasa. ADV. PHY.
Edu. 6:235-245
43- Falgairette, G., Deflandre, A., et Gavarry, O.
(2004). «Activité physique habituelle, influence du sexe
et des facteurs environnementaux». Science et Sports, vol. 19, p.161-173.
44- Famose J.P (2002), Apprentissage moteur
et motivation, conférence à l'académie Poitier, ,
http://www.ac_poitier.fr/epspeda/famose/condition.htm
45- Famose J-P. et Guerin F., (2002) «
La connaissance de soi en psychologie de l'EPS », Ed. Armand Colin,
Collections dynamiques.
46- Famose, J-P. (2001). La motivation en
éducation physique et en sport. Paris: éditions Armand Colin.
47- Fourny D., Fradette B., Gounalle J., Magnenot F.,
Villeneuve A. M., Dalgle J. et Lacate J.F., (2000). Encyclopedie
visuelle des sports. Montréas Minerva 372 p.
48- García, A Marín, M. et
Bohórquez, M. (2012) Autoestima como variable psicosocial
predictora de la actividad física en personas mayores. Revista de
Psicología del Deporte, 21(1),195-200.),
49- Garcia, A.W., Broda, M., Frenn, M., Coviak, c.,
Pender, NJ., et Ronis, D.L. (1995).«Gender and development
differences in exercise beliefs among youth and prediction of their exercise
behavior». Journal ofschool health, vol. 65, p. 213219.
50- Gimonet J.-C. (2008), Réussir et
comprendre la pédagogie de l'alternance des maisons familiales rurales,
L'Harmattan, p. 148-206
51- Goigoux, R. (2007). Un modèle
d'analyse de l'activité des enseignants. Education et Didactique, 1 (3),
47-70.
52- González, J. (2003). Actividad
física, deporte y vida: beneficios, perjuicios y sentido de la actividad
física y del deporte. Cuerpo y espíritu. Bibao:
FundaciónOreki, p. 64 17(1), 59-65.
53- Goumaz G. (1991)
Enseignant-Enseigné : une estime réciproque. Genève,
Éditions des Sables
54- Granato M., et Kroll S. (2013), «
Alternance en Allemagne : différenciation de la formation sans
différenciation des diplômes ? », Cahiers de la recherche sur
l'éducation et les savoirs, hors-série, n° 4, « Les
"petits" diplômes professionnels en France et en Europe », p.
109-131.
55- Granato M., et Ulrich, J. G. (2013),
« Die Reformierbarkeit des Zugangs in duale
BerufsausbildungimSpannungsfeldinstitutionellerWidersprüche », Revue
Suisse de sociologie, XXXIX, Issue II, p. 315-340.
56- Gregory H.H. (1991) Therapy for
elementary school-age children. Seminars in Speech and Language, 12.
57- Guérin, F., Marsh, H.W., et Famose, J-P.
(2001). Concept de soi physique: Validation française du PSDQ
de Marsh. Actes du congrès de l'ACAPS, Valence.
58- Guérin, F., Marsh, H.W., et Famose, J-P.
(2004). Generalizability of the PSDQ and its relations to physical
fitness: The European French connection. Journal of Sport and Exercise
Psychology, 26, 19-38.
59- Harter S. (1978)Effectance motivation
reconsidered toward a developmental model. Human Development Contents, vol 21,
n°1.
60- Harter S. (1990) Self and identity
development. In S.Feldman et G.G. Elliott (Eds), At the treshold : the
developing adolescent. Cambridge, M.A. : Harvard University Press.
61- Harter, S. (1978). Pleasure derived from
optimal challenge and the effects of receiving grades on children's difficulty
level choices. Child Development, 49, 788-799.
62- Harter, S. (1999). Causes and
consequences of low self-esteem in children and adolescents. In R.F. Baumeister
(Ed.), Self-esteem. The puzzle of low self-regard (pp.87-116). New York: Plenum
Press.
63- Haye G. (2004). Présentation du
tutorat scientifique du groupe plaisir de l'AEEPS. Revue Hyper Eps n°222.
64- Haye G. (2004). Compte rendu
d'étape du groupe « plaisir », revue Hyper EPS n°224,
65- Hegger, M.., et Chatzisarantis, N.L.D.
(2007).Intrinsic motivation and self-determination in exercise and
sport. Champaign: Human Kinetics.
66- Henriques, G. R., & Calhoun, L.G.
(1999).Gender and ethnic differences in the relationship between body
esteem and self-esteem. J Psychology, Jul; 133:357-68.
67- Kendzierski, D. et DeCarlo, K.J.
(1991).Physical Activity Enjoyment Scale: Two validation studies.
Journal of Sport and Exercise Psychology, 13, 50-64.
68- Laporte D. (1997) Pour favoriser l'estime
de soi des tout-petits, Montréal, Éditions de l'Hôpital
Sainte Justine
69- Larivey M. (2002) : L'estime de soi.
Collection La lettre du psy, Vol 6, n°3.
70- Lavie, F. et Gagnaire, P (2014), Plaisir
et processus éducatif en EPS. Une pédagogie de la mobilisation.
Ed. AE-EPS,.
71- Leca, R. (2009). Le plaisir en EPS.
http://www.culturestaps.com.
Meard.J. et Bertone.S, in « L'autonomie de l'élève et
l'intégration des règles en EPS », PUF.
72- Lenskyj, H. (1994). La femme, le sport et
l'activité physique. Sport Canada: Centre de documentation pour le
sport, 51p. Li, F. 1999. «The exercise motivation scale: It's multifaceted
structure and constructs validity». Journal ofApplied Sport Psychology,
vol. 11, p. 97-115.
73- Marsh, H.W et Peart, N.D, (1988),
Competitive and Cooperative Physical Fitness Training Programs for Girls :
Effects on Physical Fitness and Multidimensionnal Self-Concepts, Journal of
Sport and exercise psychology 10, 390 - 407.
74- Marsh, H.W. (1987). The hierarchical
structure of self-concept and the application of hierarchical confirmation
factor analysis. Journal of Educational Measurement, 24, 17-19.
75- Marsh, H.W. (1998). Age and Gender
Effects in Physical Self-Concepts for Adolescent Elite Athletes and
Nonathletes: A multicohort-Miltioccasion Design. Journal of Sport and Exercise
Psychology, 20, 237-259.
76- Marsh, H.W. et Parker, J.W., (1984),
Determinants of students self-concept: Is it better to be a relatively large
fish in a small pond even if you don't learn to swim as well ? Journal of
personality and social psychology, 47, 213 - 231.
77- Martinot, D. (1995). Le Soi : Les
approches psychosociales. Presses Universitaires de Grenoble. p486
78- Maslow A. (1943) A theory of human
motivation, Psychological Review, vol 50, 370-96.
79- Maubant P. (1997) « Pour une
didactique et des pédagogies de l'alternance», n°154,
p.141.
80- Mviri, H.C., (2018), problématique
de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les
etablissements secondaires et supérieur de Brazzaville : Formation,
Planification et Absenteime. Thèse de doctorat unique à l'ENS
(chaîre UNESCO). p118-119
81- Ninot G., Delinieres D., Fortes M., et Matkowski
S. (2000), Evaluation de l'Estime de Soi dans le domaine corporel,
Rev. STAPS, , 53 : 35-48
82- Parlebas P., (1981), Lexique
commenté en sciences de l'action motrice. Paris INSEP
83- Pereira, B., Pereira, M. & Correia, S.
(2008).Exercício físico e autoestima em idosos. Estudos
de Psicologia do Exercício e Saúde, 1, 51-61.
84- Perlow, M. (1992). Validity and
reliability of the PSES. Western Journa/ of Nursing Research, 14(2), 201-210.
106
85- Perlow, M. (1992). Validity and
reliability of the PSES. Western Journa/ of Nursing Research, 14(2),
201-210.
86- Pradére, F., et Tricot, A., (2002)
Comment concevoir un enseignement ? Bruxelles : De Boeck.
87- Prairat E., et Rétornaz A. (2001)
La polyvalence en débat. Les Cahiers pédagogiques 397/398, p.
20-22.
88- Ria L. et Récopé M. (2005),
Les émotions comme ressort de l'action. In L. RIA, (Dir), Les
émotions, Collection pour l'Action, Ed. Revue EPS,
89- Rosenberg, M. (1979). Conceiving the
self. New York: Basic Books.
90- Roy, M. A., Neale, C., et Kendler, K.
(1995). The genetic epidemiology of self-esteem. Bristih Journal of
Psychiatry, 166, 813-820.
91- Scalan, T.K. et Lewthwaite, R.
(1986).Social psychological aspects of competition for male youth
sport participants: IV. Predictors of enjoyment. Journal of Sport Psychology,
8, 25-35.
92- Seners, P. (1993) « la leçon
d'EPS », Paris : Vigot
93- Shavelson, R.J., et Bolus, R. (1982).
Self-concept: The interplay of theory and methods. Journal of Educational
Psychology, 74, 3-17.
94- Sherif, M. (1969). « Comment
associer l'étude sur le terrain el l'expérimentation Je
laboratoire dans la recherche sai les petits groupes ? ». In Lemaine G. et
Lemaine J.-M. (coord.). Psychologie sociale et expérimentation.
Mouton/Bordas, Paris : pp. 157-172.
95- Shevlin, M. E., Bunting. B., et Lewis, C.
(1995). Confirmatory factor analysis of the Rosenberg self-esteem
scale. Psychological reports, 76, 707-710.
96- Steffenhagen, R. A. (1990). Self-esteem
therapy. New York: Praeger.
97- Swann, W.B. (1987). Identity negociation:
where two roads meet. Journal of Personality et Social Psychology, 53,
1038-1051.
98- Teixeira, C., Nunes, F., Ribeiro, F.,
Ibarzábal, F. & Raposo, J. (2016).Ativi-dade física,
autoestima e depressão em idosos. Cuadernos de psicología del
deporte, 16(3), 55-66.
99- Thompson, C.E., et Wankel, L.M. (1980).
«The effect of perceived activity choice upon frequency of exercise
behavior». Journal ofApplied Social Psychology, vol. 10, p.436-443.
100- Vallerand, RJ. (1997). «Toward a
hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation», In M.P. Zanna/
Advances in Experimental Social Psychology, New York: Academic Press, vol. 29,
p. 271-360,
101- Vallerand, RJ., et Grouzet, F.I 1.E.
(2001). «Pour un modèle hiérarchique de la
motivation intrinsèque et extrinsèque dans les pratiques
sportives et l'activité physique». In F. Cury, P. Sarrazin et J.P
Famosse (Eds), Théories de la motivation et pratiques sportives:
états de recherche. Paris: Presse Universitaires de France, p.57-95.
102- Vallerand, RJ., Pelletier, L.G., Blais, M.R.,
Brière, N.M., Sénécal C, et Vallière, E.F.
(1993). «On the assessment of intrinsic, extrinsic and
amotivation in education: Evidence on the concurrent and construct validity of
the Academie Motivation scale». Educational and PsychologicalMeasurement,
vol. 53, p. 159-172.
103- Vallières, E. F., et Vallerand, R. J.
(1990). Traduction et validation canadienne-française de
l'échelle de l'estime de soi de Rosenberg. International Journal of
Psychology, 25, 305-316.
104- Vescio, J.A., et Crosswhite, JJ. (2002).
«Sharing good practices: Teenage girls, sport, and physical
activity». /CHPERD-SD journal, vol. 38, no 3 (summer), p. 47-52.
105- Viau, R. (2009) La motivation en
contexte scolaire. Bruxelles : De Boeck.
106- Vigneron C. (2004). Une improbable
réussite des filles en EPS : l'exemple des sports collectifs. In G.
Cogérino (sous la direction). Filles et garçons en EPS.
Collection « Recherche et formation », Edition Revue EPS, 125-162.
107- Wankel, L.M. et Kreisel, P.S.J.
(1985).Factors underlying enjoyment of youth sports: Sport and age
comparison. Journal of Sport Psychology, 7, 51-64.
108- Wankel, L.M. et Sefton, J.M. (1989).A
season-long investigation of fun in youth sports. Journal of Sport and Exercise
Psychology, 11, 355-366.
109- Winnicott D. (1969) De la
pédiatrie à la psychanalyse. Payot.
Table des Matières
|
Dédicace
....................................................................
|
i
|
|
Remerciements
............................................................
|
ii
|
|
Liste des abréviations et sigle
...........................................
|
iii
|
|
Liste des tableaux
.........................................................
|
iv
|
|
Liste des
figures ...........................................................
|
v
|
|
Sommaire...................................................................
|
vii
|
|
Introduction
...............................................................
|
1
|
|
1.
|
Contexte
....................................................................
|
1
|
|
2.
|
Problématique
.............................................................
|
3
|
|
a.
|
Question de recherche
....................................................
|
4
|
|
b.
|
Hypothèse de recherche
...................................................
|
4
|
|
c.
|
Démarche méthodologique
...............................................
|
4
|
|
3.
|
Objectif de l'étude
.........................................................
|
5
|
|
4.
|
Intérêt du sujet
.............................................................
|
5
|
|
5.
|
Délimitation du sujet
......................................................
|
5
|
|
6.
|
Annonce des parties et chapitres
........................................
|
6
|
|
Partie I :
|
Cadre théorique
..........................................................
|
7
|
|
Chapitre I :
|
Champ conceptuel et théories de
références ........................
|
7
|
|
I.I
|
Définition des
concepts ...................................................
|
7
|
|
I.I.1.
|
L'Estime de
soi.............................................................
|
7
|
|
I.1.1.
|
Définition originale de l'estime de soi et son
évolution...............
|
8
|
|
I.1.2.
|
Comment se construit l'estime de
soi....................................
|
10
|
|
I.1.2.1.
|
Le développement de l'estime de
soi....................................
|
10
|
|
I.1.2.2.
|
Développement de l'estime de soi chef
l'enfant.......................
|
10
|
|
I.1.2.3.
|
Différence entre garçons et filles au niveau de
l'estime de soi.......
|
12
|
|
I.1.3.
|
Estime de soi et compétence
perçue.....................................
|
13
|
|
1.1.4.
|
La fonction de l'estime de
soi............................................
|
13
|
|
I.1.4.1.
|
L'estime de soi est un jugement
évaluatif..............................
|
14
|
|
I.1.4.2.
|
Motivation et estime de soi : le motif de valorisation de
soi.........
|
14
|
|
I.1.4.3.
|
L'importance de l'estime de soi en éducation
physique..............
|
15
|
|
I.1.4.4.
|
Différence entre estime de soi et concept de
soi.......................
|
16
|
|
I.1.4.5.
|
Le concept de soi physique
...............................................
|
17
|
|
I.2.
|
Le concept de
plaisir......................................................
|
18
|
|
I.2.1.
|
Définitions et conceptualisation du plaisir
.............................
|
18
|
|
I.2.1.1.
|
Définition
générale.........................................................
|
18
|
|
I.2.1.2.
|
Définition du plaisir en EPS
..............................................
|
18
|
|
I.2.2.
|
Relation avec les interventions de l'enseignant
.......................
|
19
|
|
I.2.3.
|
Considérations générales sur le plaisir et
les plaisirs en éducation
physique.....................................................................
|
19
|
|
I.2.3.1.
|
Approche du Plaisir en EPS
..............................................
|
19
|
|
I.2.3.2.
|
Nature des critères d'évaluation en rapport avec le
plaisir............
|
20
|
|
I.2.3.2.
|
Le plaisir et la motivation
.................................................
|
21
|
|
I.2.3.4.
|
Le plaisir en EPS
..........................................................
|
21
|
|
I.3.
|
Concept de l'alternance
..................................................
|
22
|
|
I.3.1.
|
Définition du concept alternance
........................................
|
22
|
|
I.3.2.
|
Approches théoriques de la pédagogie
..................................
|
23
|
|
I.3.2.1.
|
Enseigner l'EPS à l'école et l'analyse des savoirs
....................
|
23
|
|
I.3.2.2.
|
Apprendre à faire classe d'EPS par alternance
........................
|
24
|
|
I.3.2.3.
|
Didactique et l'alternance
.................................................
|
25
|
|
1.
|
Participation des filles et garçons au cours d'EPS
.....................
|
25
|
|
2.
|
Les performances des filles et des garçons
............................
|
26
|
|
I.II.
|
Théorie de référence
......................................................
|
28
|
|
I.II.1.
|
La motivation
..............................................................
|
28
|
|
I.II.2.
|
La théorie de l'autodétermination
.......................................
|
28
|
|
I.II.3.
|
La motivation produit des conséquences
importances.................
|
28
|
|
Chapitre II :
|
Revue de la littérature
...................................................
|
30
|
|
II.1.
|
Travaux sur l'estime de soi
...............................................
|
30
|
|
II.2.
|
Travaux sur le plaisir
......................................................
|
32
|
|
II.3.
|
Travaux de Thépaut sur l'alternance des APS
.........................
|
33
|
|
II.4.
|
Synthèse des travaux
......................................................
|
34
|
|
Partie II :
|
Cadre Opératoire
........................................................
|
36
|
|
Chapitre III :
|
Méthodologie
...............................................................
|
36
|
|
III.1
|
Méthodologie suivie
.......................................................
|
36
|
|
III.2.
|
Opérationnalisation de l'étude
...........................................
|
37
|
|
III.2.1.
|
Champ d'investigation
....................................................
|
37
|
|
III.3.
|
Population et échantillon
.................................................
|
37
|
|
III.3.1.
|
Population d'enquête
......................................................
|
37
|
|
III.3.2.
|
Echantillon
..................................................................
|
38
|
|
Critère
d'inclusion..........................................................
|
38
|
|
Critère d'exclusion
........................................................
|
38
|
|
III.4.
|
Instruments de collecte et d'analyse des données
.....................
|
38
|
|
III.4.1.
|
Instrument de collecte des données
......................................
|
38
|
|
III.4.1.1.
|
Les questionnaires
.........................................................
|
38
|
|
Variable étudiées
...........................................................
|
39
|
|
a-
|
Variables dépendantes
.....................................................
|
39
|
|
b-
|
Indépendante
...............................................................
|
39
|
|
1.
|
Cotation
.....................................................................
|
40
|
|
III.4.2.
|
Analyse des données
......................................................
|
40
|
|
III.II.3.3
|
Difficultés rencontrées
....................................................
|
41
|
|
Chapitre IV :
|
Présentation, analyse et interprétation des
résultats .............
|
42
|
|
IV.
|
Alternance des formes d'APS et
plaisir.................................
|
42
|
|
IV.2.
|
Estime de soi
...............................................................
|
42
|
|
IV.3.
|
Corrélation alternance des formes d'APS, estime de soi et
plaisir chez les filles GE et GT
..................................................
|
43
|
|
IV.4.
|
Corrélations alternances des formes d'APS, estime de soi
et le plaisir chez les garçons GE et GT
.......................................
|
44
|
|
IV.5.
|
Corrélations alternance des formes d'APS, estime de soi et
plaisir chez les filles et garçons GE et GT
......................................
|
46
|
|
IV.2.
|
Discussion
..................................................................
|
48
|
|
IV.4
|
Suggestions
................................................................
|
60
|
|
Conclusion
.................................................................
|
61
|
|
Références
..................................................................
|
63
|
|
Table des matières
.........................................................
|
69
|
|
Annexes
.....................................................................
|
72
|
ANNEXES
ANNEXE 1
Tableau 1 : Analyse de variance entre les différentes
variables de l'étude
|
ANOVA
|
|
Somme des carrés
|
ddl
|
Carré moyen
|
F
|
Sig.
|
|
Alternance
|
Intergroupes
|
93,130
|
3
|
31,043
|
34,614
|
,000
|
|
Intragroupes
|
106,724
|
119
|
,897
|
|
|
|
Total
|
199,854
|
122
|
|
|
|
|
Plaisir Gym
|
Intergroupes
|
816,912
|
3
|
272,304
|
1,410
|
,243
|
|
Intragroupes
|
22984,503
|
119
|
193,147
|
|
|
|
Total
|
23801,415
|
122
|
|
|
|
|
Plaisir VB
|
Intergroupes
|
899,489
|
3
|
299,830
|
1,619
|
,189
|
|
Intragroupes
|
22039,259
|
119
|
185,204
|
|
|
|
Total
|
22938,748
|
122
|
|
|
|
|
Plaisir SL
|
Intergroupes
|
1841,980
|
3
|
613,993
|
2,519
|
,061
|
|
Intragroupes
|
29008,752
|
119
|
243,771
|
|
|
|
Total
|
30850,732
|
122
|
|
|
|
|
Compétence sportive
|
Intergroupes
|
562,633
|
3
|
187,544
|
3,768
|
,013
|
|
Intragroupes
|
5923,285
|
119
|
49,776
|
|
|
|
Total
|
6485,919
|
122
|
|
|
|
|
Condition physique
|
Intergroupes
|
79,236
|
3
|
26,412
|
1,198
|
,313
|
|
Intragroupes
|
2622,634
|
119
|
22,039
|
|
|
|
Total
|
2701,870
|
122
|
|
|
|
|
Endurance
|
Intergroupes
|
68,583
|
3
|
22,861
|
1,112
|
,347
|
|
Intragroupes
|
2445,580
|
119
|
20,551
|
|
|
|
Total
|
2514,163
|
122
|
|
|
|
|
Estime de soi Général
|
Intergroupes
|
99,043
|
3
|
33,014
|
2,431
|
,069
|
|
Intragroupes
|
1616,274
|
119
|
13,582
|
|
|
|
Total
|
1715,317
|
122
|
|
|
|
|
Valeur Physique
|
Intergroupes
|
203,916
|
3
|
67,972
|
2,279
|
,083
|
|
Intragroupes
|
3548,832
|
119
|
29,822
|
|
|
|
Total
|
3752,748
|
122
|
|
|
|
Tableau 2 : Test d'homogénéité des
variances dans ANOVA des différentes variables de l'étude
|
Test d'homogénéité des
variances
|
|
Statistique de Levene
|
ddl1
|
ddl2
|
Sig.
|
|
Alternance
|
11,199
|
3
|
119
|
,000
|
|
Plaisir Gym
|
1,310
|
3
|
119
|
,274
|
|
Plaisir VB
|
,160
|
3
|
119
|
,923
|
|
Plaisir SL
|
,799
|
3
|
119
|
,497
|
|
Compétence sportive
|
2,828
|
3
|
119
|
,042
|
|
Condition physique
|
8,029
|
3
|
119
|
,000
|
|
Endurance
|
2,033
|
3
|
119
|
,113
|
|
Estime de soi Général
|
2,790
|
3
|
119
|
,044
|
|
Valeur Physique
|
1,486
|
3
|
119
|
,222
|
Figure 1 : Répartition des individus en deux facteurs
sur l'analyse en composante principale des
valeurs étudié
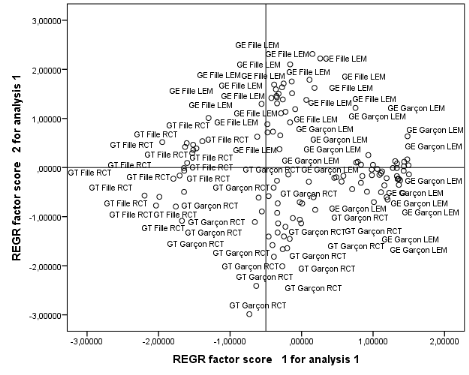
ANNEXE 2
ANNEXE 2 : Questionnaires

QUESTIONNAIRE
Nous vous prions de bien vouloir répondre à
toutes les questions avec le plus grand soin, pour que notre étude soit
complète. Les informations recueillies serviront strictement dans le
cadre de la recherche scientifique en cours. Votre anonymat sera bien entendu
préserver. Nous vous remercions de votre aide.
1- Age :_______________
2- Sexe : Homme Femme
3- Situation professionnelle par statut des
parents:............................................................
4- Que pensez-vous de la contribution du cours d'EPS au cour
de votre formation......................
.........................................................................................................................
5- Que pensez-vous de la pratique de plusieurs sports au cours
d'EPS.....................................
6-
.........................................................................................................................
7- Quelle pratique sportive vous semble la plus difficile en
EPS..................................................................
8-
.........................................................................................................................
9- Quel type d'activités préfères-tu en
EPS parmi celles citées ci-dessous? (Coche 1 seul
|
Indicateurs
|
filles
|
garçons
|
|
Les sports collectives (football, volley-ball, basket-ball,
handball, rugby)
|
|
|
|
Les activités gymniques
|
|
|
|
Les activités de pleine nature (course d'orientation,
escalade)
|
|
|
|
Les sports de raquette (tennis, tennis de table, badminton)
|
|
|
|
Les activités athlétiques (lancer de disque,
endurance, course de haies)
|
|
|
10- Quelle activité aimes-tu le moins en
EPS ?...............................................................................................
.........................................................................................................................
11- Pour quelles raisons aimes-tu le moins cette
activité?...........................................................................
.........................................................................................................................
12- Dis ce que t(apporte l'EPS en faisant le choix des
indicateurs ci-dessous.
|
Indicateurs
|
filles
|
garçons
|
|
Apprendre avec le professeur et les camarades
|
|
|
|
Etre en bonne santé, se muscler, garder la forme
|
|
|
|
Etre motivé
|
|
|
|
Faire du sport
|
|
|
|
Se mesurer aux autres dans les sports collectifs
|
|
|
|
Bouger son corps, se dépenser
|
|
|
|
Se sentir bien, avoir du plaisir, pratiquer le sport pour les
loisirs
|
|
|
|
Aucune réponse
|
|
|
13- Est-ce que certaines activités d'EPS te font
peur ? Oui Non
14- Si oui, lesquelles et pourquoi ?
...........................................................................................................................
.............................................................................................................................
15- Quel jugement faites-vous de ces séances de cours
d'EPS
Transmet le goût de pratiquer Plaisir
Contact avec les autres Négatif
Crée la différence entre hommes et filles
Motivant
16- Classe les matières des cours faites en classe par
ordre de préférence.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
17- Pourquoi cette position pour
l'EPS.................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
18- De ces mots, choisi le mot que tu souhaiterais entendre en
EPS
Réussite Effort Emotion
Organisation Evaluation
Amusement Performance
Observation Respiration
Etirement Regroupement Plaisir
Récupération
19- Quel est votre attitude après un cours d'EPS
Prendre du plaisir Rester en bonne santé
Se défouler Acquérir des connaissances
Acquérir les techniques Avoir un bon corps
Mieux connaître les autres
Préparer à un métier futur
Perdre du temps à faire des efforts inutiles
20- La durée d'une heure de cours d'EPS,
est-elle comment pour vous?
Suffisante Insuffisante Pas du
tout
21- Si les cours d'EPS n'étaient pas obligatoires, y
viendriez-vous
Je ne sais pas Jamais Rarement
Assez souvent A toutes les séances
22-
Pourquoi ?...........................................................................................................................................................................................................................................................................
23- Etes-vous satisfaits de ce que votre enseignant vous fait
faire aux cous d'EPS
Oui Non
24-
Pourquoi ?..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
25- Pendant le déroulement des cours d'EPS, le
professeur vous fait travailler, filles et les garçons
ensemble ?
Jamais séparés Assez rarement
séparés Assez régulièrement
séparés
Avec activités parfois différentes
Assez souvent séparés Toujours séparés
26- Pourquoi ?
............................................................................................................
27- Quels sont les activités que vous souhaitez faire
pendant vos cours d'EPS ?..........................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
28- Pensez-vous que ces cours d'EPS doivent se dérouler
avec les filles et les garçons ensemble
Toujours De temps en temps
jamais Sans réponse
29- Pourquoi ?
.............................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
30- Que ce que vous ressentez en pratiquant ces
activités cours d'EPS
Prendre du plaisir Rester en bonne santé
Me défoulé
Acquérir des connaissances Avoir un bon
corps Mieux connaître les autres
Perdre du temps à faire des efforts inutiles
Nous sommes bien regrouper
31- Fais le choix d'un mot qui justifiera votre sensation au
cours d'EPS
Plaisir Motivation Regroupement
Défoulement
Ambiance Effort
32- Quelle différence faites-vous entre la pratique de
l'EPS et l'APS.... ........................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
33- Maintenant que vous êtes à la fin, classe ces
activités vues par ordre de préférence :
Gymnastique ; Basketball ; Course
d'endurance vitesse ; Volleyball ; Saut en longueur ;
Lancer de Poids
1....................................................................................
2....................................................................................
3....................................................................................
4....................................................................................
5....................................................................................
6....................................................................................

QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DE L'ESTIME DE SOI EN
EPS
Nous vous prions de bien vouloir répondre à
toutes les questions avec le plus grand soin, pour que notre étude soit
complète. Les informations recueillies serviront strictement dans le
cadre de la recherche scientifique en cours. Votre anonymat sera bien entendu
préserver. Nous vous remercions de votre aide.
INFORMATION CONCERNANT LE REPONDANT
1- Nom du lycée |___|___|___|___|___|___|___|___|
2- Age : _______________
3- Sexe : Homme Femme
4- Situation professionnelle en statut des
parents:.........................................................
A-ESTIME DE SOI GENERAL :
|
N°
|
Appréciations - Opinion -
Proposée
|
Pas du tout
|
Très peu
|
Un peu
|
Assez
|
Beaucoup
|
Tout à fait
|
|
1
|
J'ai un corps agréable à regarder
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Je suis bien dans mon corps
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
J'ai une bonne opinion de moi
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Je voudrais rester tel que je suis
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Je me trouve moche
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
J'ai souvent hante de moi
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Personne ne me trouve beau ou belle
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Il y a des tas de choses en moi que j'aimerais changer
|
|
|
|
|
|
|
B-VALEUR PHYSIQUE :
|
N°
|
Appréciation
Opinion proposée
|
Pas du tout
|
Très peu
|
Un peu
|
Assez
|
Beaucoup
|
Tout à fait
|
|
1
|
Je suis fier de mes possibilités physiques
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Je suis content de ce que je peux faire physiquement
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Je suis satisfait de mes capacités physiques
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Je suis confiant vis-à-vis de ma valeur physique
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Je n'aime pas beaucoup mon apparence physique
|
|
|
|
|
|
|
C-CONDITION PHYSIQUE :
C.1-FORCE :
|
N°
|
Appréciation
Opinion proposée
|
Pas du tout
|
Très peu
|
Un peu
|
Assez
|
Beaucoup
|
Tout à fait
|
|
1
|
Je pense être plus fort que la moyenne
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Face à des situations exigeant la force, je suis le
premier à proposer mes services
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Je serais bon dans les épreuves de force
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Je suis musculairement moins fort que la plupart des gens de
mon âge
|
|
|
|
|
|
|
C.2 ENDURANCE :
|
N°
|
Appréciation
Opinion proposée
|
Pas du tout
|
Très peu
|
Un peu
|
Assez
|
Beaucoup
|
Tout à fait
|
|
1
|
Je serais bon dans les épreuves d'endurance
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Je pense pouvoir courir pendant longtemps sans être
fatigué
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Je pourrais courir 5km sans m'arrêter
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Je ne suis pas très bon dans les activités
d'endurance telles que la course
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Je ne peux pas courir pendant longtemps sans m'arrêter
|
|
|
|
|
|
|
D-COMPETENCES SPORTIVES :
|
N°
|
Appréciation
Opinion proposée
|
Pas du tout
|
Très peu
|
Un peu
|
Assez
|
Beaucoup
|
Tout à fait
|
|
1
|
Je trouve que je suis bon dans tous les sports
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Je trouve la plupart des sports faciles
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Je réussis bien en sport
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Je suis agile et adroit quand je fais du sport
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Je me débrouille dans tous les sports
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Je regrette souvent ce que je fais en sport
|
|
|
|
|
|
|

QUESTIONNAIRE D'EVALUATION SUR LE PLAISIR EN
EPS
Nous vous prions de bien vouloir répondre à
toutes les questions avec le plus grand soin, pour que notre étude soit
complète. Les informations recueillies serviront strictement dans le
cadre de la recherche scientifique en cours. Votre anonymat sera bien entendu
préserver. Nous vous remercions de votre aide.
A- INFORMATION CONCERNANT LE REPONDANT
1. Nom du lycée |___|___|___|___|___|___|___|___|
2. Age : _______________
3. Sexe : Homme Femme
4. Situation professionnelle en statut des
parents:.........................................................
B- ACTIVITE A SUIVRE :
|
N°
|
Appréciations
Opinion proposée
|
Absolument pas d'accord
|
Pas d'accord
|
Plutôt pas d'accord,
|
Je ne sais pas,
|
Plutôt d'accord
|
D'accord
|
Absolument d'accord)
|
|
1. Ce cycle était très plaisant
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Ce cycle était triste
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Ce cycle m'a apporté beaucoup de choses
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Ce cycle m'a changé les idées
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Ce cycle n'était pas amusant
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Durant ce cycle, j'ai vraiment eu l'impression de
réaliser quelque chose
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. J'ai trouvé que ce cycle était agréable
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. J'ai trouvé que c'était un cycle dynamique
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. J'ai trouvé que c'était un cycle très
excitant
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. J'aurais préféré faire autre chose
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Je n'ai pas aimé ce cycle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESUME
La présente étude a pour objectif
d'évaluer les effets de l'alternance des formes d'APSA sur l'estime de
soi et le plaisir des élèves des classes de première
scientifique. A cet effet, 123 élèves répartis en deux
groupes : 73 élèves (30 filles et 43 garçons) du
lycée de l'excellence de DOLISIE, élèves constituant le
groupe expérimental (GE) ont été soumis à un
continuum d'APSA lié à l'alternance desdites activités et
50 élèves (20 filles et 30 garçons) du lycée de la
Réconciliationde MFILOUdu groupetémoin dont le continuum
d'apprentissagea été de type
|
|
traditionnel. Ils ont tous répondus au questionnaire de
l'alternance et de l'estime de soi en une modalité, au questionnaire
sur le plaisir en trois modalités. Les moyennes ont été
comparées au moyen du test de student, et le test de Pearson a servi
d'établir la corrélation entre l'alternance des formes d'APSA,
l'estime de soi et le plaisir. Les résultats obtenus ont permis de
montrer une évocation significativement plus importante de l'alternance
des filles GE comparativement aux filles GT (38,83#177;0,64 Vs 36,70#177;1,52),
un plaisir significativement plus grand du plaisir ressenti au saut en longueur
chez les garçons GE par rapport aux GT (53,84#177;2,54 Vs
49,63#177;1,68), une forte valeur d'estime de soi générale des
filles GE que celle des filles GT (24,20#177;0,76 Vs 22,85#177;0,49) et une
grande opinion relative à l'endurance des garçons GE par rapport
aux GT (18,91#177;0,61 Vs 14,97#177;0,18). Ces résultats ont
également démontré des corrélations entre
l'alternance des formes d'APSA et le plaisir ressenti en gymnastique
(r=+0,216), au volleyball (r=+0,293), la compétence sportive (r=+0,627),
la condition physique (r=+0,656), l'endurance (r=+0,660), l'estime de soi
générale (r=+0,167) et la valeur physique (r=+0,317) chez le
filles d'une part et des corrélations entre l'alternance des formes
d'APSA et le plaisir ressenti en gymnastique (r=+0,231), au volleyball
(r=+0,033), au saut (r=+0,119), la condition physique (r=+0,200) et l'estime de
soi générale (r=+0,023) chez le garçons d'autre part. Ces
résultats montrent l'influence de l'alternance des formes d'APSA sur le
plaisir ressenti en EPS et l'estime de soi.
Mots clés : Effets de
L'alternance des APS, estime de soi, plaisir en EPS
|
|
SUMMARY
The present study aims to evaluate the effects of the
alternation of the forms of APSA on the regard of oneself and the pleasure of
the pupils of the classes of first scientist. To this end, 123 pupils divided
into two groups:73 pupils (30 girls and 43 boys) of the college of the
excellence of DOLISIE pupils setting up the experimental group (GE) were
subjected to a continuum of APSA related to alternation of the aforesaid
activities and 50 pupils (20 girls and 30 boys) of the college of the
Reconciliation of MFILOU of the reference group whose continuum of training was
of type traditional. They have all answered the questionnaire of the
alternation and the regard of oneself of a method, with the questionnaire on
the pleasure in three methods. The averages were compared by means of the
test student, and the chi-square test was used for to establish the correlation
between the alternation of the forms of APSA, the regard of oneself and the
pleasure. The results obtained made it possible to show an evocation
significantly more significant of the alternation of the girls GE compared to
the girls WP (38,83#177;0,64 Vs. 36,70#177;1,52), a larger pleasure
significantly of the pleasure felt with the long jump among boys GE compared to
the WP (53,84#177;2,54 vs. 49,63#177;1,68), a strong value of regard of oneself
general of the girls GE that that of the girls WP (24,20#177;0,76 vs.
22,85#177;0,49) and a great opinion relating to the endurance of the boys GE
compared to the WP (18,91#177;0,61 vs. 14,97#177;0,18). These results also
showed correlations between the alternation of the forms of APSA and the
pleasure felt in gymnastics (r=+0,216), with volley ball (r=+0,293), sporting
competence (r=+0,627), the physical condition (r=+0,656), the endurance
(r=+0,660), the regard of oneself general (r=+0,167) and the physical value
(r=+0,317) in the girls on the one hand and of the correlations between the
alternation of the forms of APSA and the pleasure felt in gymnastics
(r=+0,231), with volley ball (r=+0,033), the jump (r=+0,119), the physical
condition (r=+0,200) and estimates it self-general (r=+0,023) among boys These
results show the influence of the alternation of the forms of APSA on the
pleasure felt in EPS and the regard of oneself.
Key words: Effects of the alternation of
the APS, estimates self, pleasure in EPS
|
|
|



