|
Mars 2018
UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIVERSITY OF YAOUNDÉ I
|
|
CENTRE DE RECHERCHE ET DE
FORMATION DOCTORALE EN
SCIENCES
HUMAINES
SOCIALES ET EDUCATIVES
|
|
POST GRADUATE SCHOOL FOR
SOCIAL
AND EDUCATIONAL SCIENCES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNITÉ DE RECHERCHE ET DE FORMATION
DOCTORALE
DE SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
|
DOCTORAL RESEARCH UNIT FOR
SOCIAL
SCIENCES
|
|
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
|
|
DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JEUX D'ARGENT ET CHANGEMENT SOCIAL À
YAOUNDÉ
|
Mémoire rédigé et
présenté en vue de l'obtention du Master en
Sociologie,
Spécialisation : Urbanité et
Ruralité
Par
Badel ESSALA
Licencié en Sociologie
Sous la direction de
Pierre MBOUOMBOUO, Ph.D
Maître de Recherche
II
SOMMAIRE
SOMMAIRE i
REMERCIEMENTS iv
LISTE DES ILLUSTRATIONS v
LISTES DES SIGLES ET DES ACRONYMES vi
RÉSUMÉ vii
ABSTRACT viii
INTRODUCTION 1
CHAPITRE I : PANORAMA DES JEUX À YAOUNDÉ ET
DESCRIPTION DU
PHÉNOMÈNE 24
CHAPITRE II : MÉCANISMES D'ENRÔLEMENT ET DE
PARTICIPATION DES
ACTEURS AUX JEUX D'ARGENT 63
I. LES MASS-MÉDIAS ET LEUR RÔLE DANS
L'INCITATION DES INDIVIDUS
AUX JEUX D'ARGENT 65
II. MOBILITÉ SOCIALE ET QUÊTE D'ANCRAGE ET
D'AUTONOMIE DES
ACTEURS À TRAVERS LES JEUX D'ARGENT 73
CHAPITRE III : AMPLIFICATION DES PRATIQUES DE JEUX
D'ARGENT ET
CHANGEMENT SOCIAL 89
I. LES TRANSFORMATIONS SOCIALES ENGENDRÉES PAR LA
PRATIQUE DES
JEUX D'ARGENT SUR LA SOCIÉTÉ URBAINE À
YAOUNDÉ 89
II. LES NON-DITS DE LA PROLIFÉRATION DES JEUX D'ARGENT
À YAOUNDÉ 105
CONCLUSION 109
BIBLIOGRAPHIE 117
ANNEXES 123
TABLE DES MATIÈRES 134
III
DÉDICACE
À monsieur Louis ESSA'ALA AMOUGOU, de regretté
mémoire.
iv
REMERCIEMENTS
C'est dans l'esprit d'Albert JACQUARD, ce
célèbre scientifique français qui écrit : «
le savoir pour moi est une longue promenade. Qu'importe le temps,
l'essentiel pour moi est de marcher ». Que j'ai marché durant
ces longues années, parfois égaré ou retardé pour
plusieurs raisons, j'ai persisté et, aujourd'hui que mon travail arrive
à sa fin, qu'il me soit permis de remercier toutes les personnes qui
m'ont apporté leur soutien durant cette aventure humaine et
scientifique.
Ma gratitude s'exprime d'abord envers le professeur P.
MBOUOMBOUO, qui a su encadrer mes premiers pas dans la Sociologie urbaine. Sa
rigueur scientifique, ses conseils judicieux et ses suggestions ont
contribué non seulement à la réalisation de ce travail,
mais aussi à la formation de ma personnalité.
Mes remerciements s'adressent ensuite au professeur J. NZHIE
ENGONO, Chef du département de Sociologie de l'Université de
Yaoundé 1, au professeur A. LEKA ESSOMBA, au professeur S. ELLA ELLA et
à tous les autres enseignants du même département pour
l'intérêt qu'ils portent à la formation. Ils ont tous
contribué au façonnement de ma culture scientifique.
Ma reconnaissance va également à l'endroit de
monsieur A. MBA MBA et monsieur J. ELLA ELLA, respectivement chef de service
des jeux au Ministère de l'Administration Territoriale et de la
Décentralisation et chef de service des aménagements des parcs
à la direction du développement des loisirs du Ministère
du tourisme et des loisirs, pour leur facilitation de la recherche documentaire
en matière de jeux au Cameroun.
Un hommage appuyé et empreint d'une profonde gratitude
à mes parents J. MBIDA OBAMA et J. MAÏNAWE qui en plus de
m'encourager sans cesse, n'ont ménagé aucun effort financier
jusqu'ici pour soutenir mon parcours académique.
J'ai beaucoup de déférence pour mes
frères et soeurs E. NDIKWA, M. ATANGANA, H. BELINGA, F. ABENG, I.
KOLFAYE, R. FOE et W. NSENG. Pour mon oncle J.P WOUMO, mes tantes C.
DAÏAWE et E. ABOGDA. Plus particulièrement, pour ma cousine M.
FAÏDA HOBDI et pour mes amis O. MBANG, L. GUEHOADA, Y. ABOUBAKAR, C.
DEUGOUÉ, à qui je dis sincèrement merci pour leur soutien
moral et logistique, sans lequel ce travail n'aurait pu être
réalisé.
Enfin, je remercie tous les joueurs, les parieurs et croupiers
des quartiers Mvog-Ada, Ékounou, Ngoa-Ekelle et du marché Mokolo
qui ont accepté de m'accorder une entrevue afin de fournir des
informations essentielles à la réalisation de ce travail.
V
LISTE DES ILLUSTRATIONS
I- TABLEAUX
Tableau 1 : Échantillonnage de la population des joueurs
d'argent interviewés 16
Tableau 2 : Classification des jeux d'argent présents
à Yaoundé 25
Tableau 3 : Les facteurs d'appréciation des jeux d'argent
69
Tableau 4 : Répartition des joueurs selon ce qui les
motive à jouer 76
Tableau 5 : Origine des sommes d'argent consacrées aux
jeux 81
Tableau 6 : Répartition des joueurs selon la
justification de leur addiction aux jeux d'argent et
aux difficultés d'arrêter de jouer 91
Tableau 7 : Budgétisation des jeux et rapport aux gains
des joueurs 101
Tableau 8 : Les enquêtés se prononcent sur
l'existence de solidarité dans les lieux de jeux
d'argent 104
II- FIGURES
Figure 1 : Les différentes perceptions du jeu selon les
enquêtés 57
Figure 2 : Les facteurs ayant influencé l'adhésion
des individus aux jeux d'argent 64
Figure 3 : Distribution des enquêtés selon leurs
revenus moyens mensuels 84
Figure 4 : Corrélations entre la fréquence aux
jeux d'argent et le niveau de dépendance 90
III- PHOTOGRAPHIES
Photographie 1 : Écran affichant des numéros
gagnants à la loterie numérique 28
Photographie 2 : Bâtiment abritant la Direction
Générale du PMUC à Yaoundé 30
Photographie 3 : Un édifice abritant une salle de jeux
à Mvog-Mbi 31
Photographie 4 : Local faisant office de Visio club à
Mokolo 32
Photographie 5 : Une partie de « ndjambo-baby-foot » au
marché Mokolo 34
Photographie 6 : Des pratiquants du « bonus Win »
à la devanture d'une boutique à Ékounou
36
Photographie 7 : L'environnement et l'attitude des parieurs en
salle 45
Photographie 8 : Kiosques à PMU à proximité
d'un établissement scolaire 47
Photographie 9 : Une partie de « ndjambo-Ludo »
Photographie 10 : Une partie de
« ndjambo- 49
Photographie 11 : Affiche publicitaire promouvant la loterie
67
Photographie 12 : Une attitude des fonctionnaires de police
joueurs d'argent 87
vi
LISTES DES SIGLES ET DES ACRONYMES
ARJEL Autorité de Régulation
des Jeux en Ligne
CFA Communauté Financière
Africaine
CNPS Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale
CRTV Cameroon Radio
Télévision
|
DDL H.S
|
Direction du Développement des Loisirs Hypothèses
Secondaires
|
INSERM Institut National de Santé et
de Recherche Médicale
INTERNET International Network
LONACAM Loterie Nationale du Cameroun
LOTELEC Loterie Electronique du Cameroun
MINATD Ministère de l'Administration
Territoriale et de la
Décentralisation
MINFI Ministère des Finances
MINTOUL Ministère du Tourisme et des
Loisirs
PMU Pari Mutuel Urbain
|
PMUC Q.S
|
Pari Mutuel Urbain Camerounais Questions Secondaires
|
SMIG Salaire Minimum Inter Garanti
VII
RÉSUMÉ
Les jeux d'argent sont des pratiques anciennes dans les
sociétés humaines, dont l'expansion peut être située
à partir de la révolution industrielle qu'a connue l'Europe
à la fin du XVIIIe siècle. Bien qu'elle soit
relativement récente en Afrique, cette industrie est aujourd'hui en
pleine essor dans les métropoles camerounaises. La présente
étude qui porte sur les jeux d'argent et le changement social a
été motivée par le constat de l'ampleur que prend chaque
jour ce phénomène dans nos villes à travers ses multiples
manifestations. Cette recherche pose en réalité, la question sur
le devenir des pays qui exposent leurs habitants à la
déchéance, aux mécanismes de la pauvreté et
à différentes formes de déviances. Ainsi, le
problème qui émerge est celui du sens attribué aux jeux
d'argent par les acteurs sociaux de la ville de Yaoundé, en tenant
compte du fait que leur participation à ces jeux peut être par
plusieurs variables sociales qui s'interprètent : il s'agit notamment de
celles qui leurs attribuent l'éclosion à une certaine chance,
à une distraction. Ou encore, de celles qui font appel à des
motivations plus profondes comme celles qui animent les naïfs, les
désespérés ou les paresseux en quête de gain
providentiel. La question principale de la recherche est celle de savoir :
quels sont les nouveaux comportements induis par la prolifération des
jeux d'argent à Yaoundé ? Quant à l'hypothèse
principale, elle stipule que : la prolifération des pratiques de jeux
d'argent dans la ville de Yaoundé, génère dans
l'imaginaire collectif, l'esprit de lucre, l'appât du gain facile, et
l'illusion de l'enrichissement rapide. Deux grilles d'analyses
théoriques ont guidé la recherche : il s'agit de la matrice
constructiviste et de la sociologie dynamiste et critique, qui ont permis de
comprendre les modalités à partir desquelles les individus
élaborent leurs mécanismes et schèmes pour se construire
une perspective dans la vie sociale. Cette étude s'est servie d'un
échantillonnage non probabiliste pour mener l'enquête de terrain,
où le choix des enquêtés s'est fait in situ ;
à travers différents quartiers de la ville. La collecte des
données a donc mobilisé les techniques suivantes : l'observation
directe, la recherche documentaire, l'entretien semi directif et le
questionnaire. Les résultats de cette étude mettent en relief,
les représentations dans différentes pratiques ludiques des
individus, tout en évaluant de façon assez critique leurs impact
sur la société camerounaise en général, et la
jeunesse en particulier, qui a tendance à se lancer sur les pistes de la
facilité et du gain rapide. Avec pour conséquences, le risque
pour ces joueurs de s'immerger dans la dépendance aux jeux, la
délinquance, le défaitisme, l'incertitude etc.
Mots clés : Jeu d'argent, Changement
social.
VIII
ABSTRACT
Gambling are old practices in human societies, and their
expansion has been lasting since the industrial revolution that Europe
experienced in the late XVIIIe century. Although, relatively new in
Africa, this industry is now booming in Cameroonian cities. the study of
gambling and social change has been motivated by the observations of the
greatness that take this phenomenon in are cities thought its multiples
manifestations. This research shows, the question of the becoming of the
countries which expose their citizens to failure, to mechanisms of poverty and
different forms of deviations. Therefore, the problem who emerge is that
attributed to gambling by the social actors of the town of Yaoundé,
taking fact of their participation to these games by many social variables
which can be interpreted: it means those which attributes them the eclosion of
a certain chance, or certain distraction. or furthermore, that which calls
motivations which calls motivations which are deeper like that which animes the
ignorant, desperate or lazy persons targeting a providential gain. The
principal question of the research is knowing: which are the new behavior
induct by the proliferation of gambling in Yaoundé? for the principal
hypothesis, it says that: the proliferation of practices of gambling in the
city of Yaoundé generated in the society, spirit of lucratively, search
of easy money, and illusion of rapid enrichment. Two, analytical theories led
to guide research which the matrix constructivist and the sociological dynamist
and critic approach, we permitted to understand the modalities of which the
individuals labored their mechanisms and scheme to construct a perspective in
their social lives. these sturdies served as unprovability tester to guide the
research on the field, or the choice of town. The collection of data then
mobilized different techniques: direct observation, documentary research, semi
directive discussion and the questionnaire. The results of these study put in
relief, the representations in different stage practices at individuals while
evaluating their impact on the Cameroonian society in general, and the youth,
which has the tendency to research on ways to rapid gain. with consequence, the
risk for these players to immerge in dependency, to germs delinquency? failure
unsureness etc.
Keys words: Gambling, Social change.
INTRODUCTION
1 La capacité de chaque
société à produire ses propres orientations sociales et
culturelles à partir de son activité et de donner un sens
à ses pratiques. TOURAINE, A. 1974, Pour la Sociologie, Paris,
Seuil, p.59.
2
1. Contexte justificatif du choix du
thème
À partir de l'historicité1 ;
caractéristique des sociétés humaines, les hommes ont
toujours su modifier les matériaux ou les règles, donnant
prétexte à leurs jeux ou paris. Ces réaménagements
permanents dans leurs activités s'arriment aux « dynamiques
sociales » G. BALANDIER (1986), qui se révèlent dans notre
société engagée dans un élan de transformation de
la vie publique, par un processus d'adaptation de nouvelles manières
d'être, d'agir et de sentir à l'ère du temps. C'est ainsi
que chaque jour qui passe, des mécanismes plus perfectionnés
apparaissent et de façon graduelle, l'automatisation s'installe. Il en
résulte des mutations profondes dans tous les domaines
d'activités. Dans le rayon culturel par exemple, les pratiques ludiques
ont subi une nette progression, les jeux de divertissement traditionnels
tendent à la disparition ; seuls les jeux d'enfants semblent avoir
gardé leur caractère désintéressé, tandis
que les jeux d'adultes se sont scindés en deux catégories
majeures : le sport dont « l'agôn » ou compétition est
la qualité principale et les jeux d'argent rythmés par «
1'aléa », connaissent depuis quelques années un
succès croissant R. CAILLOIS (1958).
Au Cameroun, depuis la libéralisation de
l'économie et la publication du décret no 92/050/PM du 17
février 1992 portant régime des jeux, les métropoles ont
vu sortir de terre une multitude d'opérateurs de jeux d'argent. Ceux-ci,
dont l'offre est variée, semblent au fil du temps se mettre à
hauteur de la demande dans un marché jusqu'alors officiellement couvert
par la fameuse LONACAM, et ce, malgré les pratiques clandestines de jeux
résumées sous le vocable de « ndjambo », même si
la notion désigne aussi une forme officielle de jeux d'argent
prônée par les sociétés de jeux. De la publication
de ce décret à nos jours, il est largement constaté que
les occasions de proposer le jeu sont légion. Dans une ville comme
Yaoundé, l'on serait même tenté avec A. COTTA (1993), de
parler d'un envahissement de la société par le jeu.
C'est-à-dire une société où les individus de tout
âge confondu participent à différents types de jeux, une
société où la propension aux activités ludiques est
perçue sous l'angle de la conséquence directe de la banalisation
des jeux d'argent et de leur acceptation comme des formes de divertissement.
Mieux encore, en s'accordant avec J-P. MARTIGNONI (2000 :195), « les
jeux sont devenus un passe-temps populaire parmi les fonctionnaires, les jeunes
ou les chômeurs ». C'est de cette manière que, ce qui
semblait jusque-là être une
3
réalité relativement stable, s'est
progressivement transformé en questionnements, voire en un
phénomène social.
« Jeux d'argent et changement social à
Yaoundé » est le thème du présent travail.
Élaborée autour du diptyque jeux d'argent et changement social,
cette thématique renvoie à une nouvelle approche sociologique
enrichissante, qui émerge de la quête d'une culture de gain
d'argent sujet à plusieurs facteurs sociaux. Il s'agit d'une sorte de
rénovation dans laquelle les jeux d'argent occupent une place de choix
dans une société qui devient de plus en plus basée sur le
plaisir, l'intérêt et l'immédiateté. Parce qu'en
réalité, les thématiques du ludique au Cameroun d'une
façon générale sont abordées sous l'angle de
l'impact socioculturel des structures de loisir modernes dans les grandes
métropoles. Rarement, les préoccupations de l'invention du
quotidien sont abordées en relation avec les lieux ludiques,
reléguant ainsi au second plan les phénomènes qui
relèvent du « banal » et qui suscitent l'adhésion
massive des individus aux modèles de « pratique de la ville »
M. BERTRAND (1978).
Il est donc question dans ce travail, de parler des logiques
de socialisation des jeux d'argent par les acteurs sociaux de la ville de
Yaoundé, suivant 1'idée qu'il serait possible de prospérer
voire de s'enrichir non pas en travaillant, mais en jouant. Et cela se produit
lorsque les voies habituelles de promotion financière sont plus ou moins
bloquées ou ne sont pas du tout aisées. Les jeux d'argent
deviennent pour ainsi dire un phénomène social à partir
duquel se construit une nouvelle forme d'urbanité au sein des
populations de cette ville, d'autant qu'elles leur accordent une place
importante dans sa dynamique quotidienne.
Cette étude a une ambition limitée. Elle ne
cherche pas à faire la sociologie de « tout ce qui se passe
dans la ville » Y. GRAFMEYER (1994 :5) ; au contraire, elle entend se
focaliser sur le phénomène des jeux d'argent en tant que produit
socioculturel, donnant l'illusion de combler un « manque à gagner
». Et dans le même temps, il est catalyseur du changement social
qui, depuis l'école de Chicago, a toujours été un centre
d'intérêt de la Sociologie urbaine.
4
2. Problème de recherche
Les deux décennies qui ont suivi l'indépendance
du Cameroun ont été marquées par la
prospérité économique. À cette époque, le
pays, « avec ses énormes potentialités naturelles (...),
se situait au 5e rang mondial des producteurs de cacao et au
2e rang des exportateurs de café » C. MALLIAT (1996
:165). Plus encore, au milieu des années 1970, il accède au club
des pays exportateurs de pétrole. C'est l'avènement de la crise
économique au cours des années 1980 qui vient rompre cet
équilibre. En effet, selon ABUI MAMA (1996 :168), « en 1985, le
Cameroun subit une importante perte de recettes à cause de la chute
brutale des coûts des produits de base » sur le marché
international. Les dirigeants camerounais pourtant optimistes au début
de la crise, sont par la suite contraints d'adhérer au programme
d'ajustement structurel proposé par le Fond Monétaire
International. Cependant, les conditionnalités imposées par cette
institution vont entraîner des conséquences néfastes pour
les populations. Entre autres, le désengagement de l'État dans
plusieurs secteurs d'activités, la baisse des salaires dans la fonction
publique, la privatisation de plusieurs sociétés avec pour
corolaire la compression de bon nombre de travailleurs. La dévaluation
du franc CFA et la flambée des prix des produits, même ceux dits
de première nécessité sont venues accentuer la
pauvreté au sein des ménages.
C'est dans ce contexte de récession économique
que les jeux d'argent qui n'existaient que de façon timide vont
proliférer dans les villes camerounaises et plus particulièrement
à Yaoundé. Nous pouvons citer entre autres, la
société Foot pool, qui exerçait dans les paris sportifs
avant l'arrivée en 1994 du PMUC. Cette entreprise qui
précède l'arrivée en 1998 de LOTELEC, va aussitôt
s'imposer comme le principal opérateur des jeux d'argent en raison de sa
puissance financière et managériale2. Si bien que dans
la même période, on assiste à une multiplication des salles
de jeux à l'instar de la chaîne « campéro » et
des bars qui totalisent à la fin de l'année 1994 plus de 1900
machines à sous MOTAZE AKAM (1998 :7). Et à grand renfort de
publicité, les promoteurs de ces différents jeux vont faire
miroiter aux populations les opportunités de gagner beaucoup d'argent en
misant des sommes minables. Faisant face à des conditions de vie de plus
en plus difficiles, de nombreux yaoundéens vont succomber
à ces opérations de charme pour devenir des adeptes des jeux
d'argent.
2 Jeune Afrique., 2015, Les nouveaux maîtres
du jeu, 56e année, no 2862 du 15 au 21
novembre, p.p. 24-33.
5
Partant, le problème qui émerge de la
présente étude relève du sens attribué à ces
jeux par les acteurs sociaux de la ville de Yaoundé, en tenant compte du
fait que leurs pratiques ludiques peuvent être influencées par
plusieurs variables sociales qui s'interprètent. Il s'agit notamment de
celles qui leur attribuent l'éclosion à une certaine chance,
à une distraction, ou encore, de celles qui font appel à des
motivations plus profondes comme celles qui animent les naïfs, les
désespérés et les paresseux en quête d'argent. Tout
au moins, il est question d'interroger l'émergence d'une nouvelle
civilisation, d'un nouvel itinéraire qui, de plus en plus, semble
être significatif de promotion financière chez les populations
urbaines à travers un phénomène qui fait l'objet d'une
étrange actualité dans la ville de Yaoundé.
3. Problématique
Le 11 novembre 1993, l'État du Cameroun a signé
un protocole d'accord avec la société Pari Mutuel Urbain
Camerounais. Ce texte était relatif au projet d'installation d'un
réseau de collecte des paris sur les courses de chevaux sur l'ensemble
du territoire national. Suite à ce contrat, le PMUC est arrivé au
pays le 27 janvier 1994, quinze jours seulement après la
dévaluation du franc CFA. Les responsables de cette entreprise
étaient alors conscients du climat économique camerounais.
Décrivant ce contexte de morosité, le Directeur
Général du PMUC de l'époque déclarait lors de la
réunion du 18 Mai 1996 avec les délégués du
personnel que « le PMUC s'est installé au Cameroun dans un
contexte de crise économique aigue ». Face à une
population éprouvant de plus en plus des difficultés à
gagner la vie par les créneaux ordinaires du travail, ces jeux vont donc
apparaître comme un moyen de spéculations boursières et
partant, d'amélioration des conditions de vie des individus en faisant
miroiter le gain facile.
Outre les paris licites proposés par le PMUC et
d'autres opérateurs, on observe paradoxalement un détournement de
toutes sortes de jeux dans les quartiers populaires : le bonneteau ou «
three cards », les dés, le damier, le Ludo etc., sont à leur
tour érigés en des activités lucratives auxquelles les uns
et les autres participent au point de ne plus se contrôler. Ils y
consacrent temps et argent. Et pour mieux les accrocher, les promoteurs de ces
jeux entretiennent l'illusion qui fait qu'avec la médiatisation des
gains de quelques millions décrochés par certains, chaque joueur
garde l'espoir que son tour arrivera un jour. Cette espérance de gain
les incite alors à participer régulièrement à ces
jeux et par là, à augmenter les sommes misées. Un
phénomène qui n'est pas passé inaperçu à
certains arbitres des faits sociaux.
6
P. NDEDI PENDA, dans « L'ami du peuple », livraison
no 001 du 8 octobre 1991, titrait dans sa une : interdits en 1978
par Ahidjo, la mafia revient au galop ! L'auteur écrit : «
Selon les informations publiées par des confrères de « la
lettre du continent », no 146 du 27 août 1991, les jeux
de hasard interdits par Ahidjo en 1978 sont de retour ! Aujourd'hui, le milieu
des gangsters est à nos portes et notre jeunesse sacrifiée
à l'autel des sous ». D'après ce quotidien, cette
interdiction visait entre autres à protéger la jeunesse de la
drogue et de la perversion qui accompagnent souvent la pratique de ces jeux. En
revanche, si les jeux d'argent se bâtissent une image d'attraction des
acteurs qui partiraient de l'extrême pauvreté à la plus
grande richesse ostentatoire, « on sait désormais que cette
forme de jeux ne vise qu'à plumer davantage les camerounais »
selon J.P. ONANA (2003 :3).
Cette observation est reprise par l'hebdomadaire « Aurore
Plus » dans un article paru le 31 mars 2004, où en une de ce
journal, on peut lire : Jeux de hasard, les escrocs ont envahi le Cameroun. Le
journal poursuit en affirmant que « Lorsque les camerounais jouent
pour perdre, les autorités ne contrôlent plus rien. Les escrocs
notoires ont envahi la scène pour dépouiller davantage les
camerounais ». Autant dire que, si ces jeux sont des lieux où
l'on s'appauvrit parce que ça brasse beaucoup d'argent, ils apparaissent
à V. NGA NDONGO, dans un entretien accordé au journal «
Cameroon Tribune » paru le 27 août 2003, comme :
Des déviances, des pratiques marginales, occultes
qui sont le fait d'initiation d'individus aux comportements douteux dans la
société ; certains sont des lieux de blanchiment de l'argent
sale, d'autres participent de l'exploitation de cette mentalité
primitive résiduelle. V. NGA NDONGO (2003 : 18).
En réalité, nul ne saurait aujourd'hui douter du
fait que la frénésie du jeu s'est emparée des camerounais.
Ces derniers seraient prêts à miser tout à la vue de menus
gains toujours incertains qu'on leur fait miroiter. C'est ainsi que les
retombées de ces mises englouties au jeu, vont d'abord se ressentir au
sein de leurs familles respectives : on assiste çà et là,
à quelques ruptures dans les ménages, on a droit à
quelques procès pour dettes impayées, on s'endette un peu plus,
mais on garde l'espoir qu'au prochain tour, on aura bien sa chance. J.P. ONANA
(idem), ajoute qu'à travers les jeux d'argent :
3 Lire ; V. NGA NDONGO, Violence,
délinquance et insécurité à
Yaoundé, (information générale), rapport
d'étude, Yaoundé, 2000, p.7.
7
Des fortunes ont fondu et des chefs de famille
méchamment mordus par le virus du jeu, ont tout sacrifié pour
l'illusion de la fortune. Des ménages se sont brisés et des
familles disloquées du fait des paris qui font oublier jusqu'à la
responsabilité du chef de famille.
Abondant dans le même sens, J.L. NDJOU'OU AKONO (1999
:134), va plus loin dans ses analyses. Pour ce chercheur, depuis que les jeux
d'argent prolifèrent dans nos villes, « certains camerounais
ont baissé les bras, se sont exclus du chantier de la construction
nationale ». Une réalité qui laisse percevoir à
quel point ces formes de pratiques ludiques traduisent l'émergence d'un
relent de crédulité, de défaitisme et de paresse à
l'endroit de ceux qui s'y adonnent.
Toutes ces constatations alarmistes qui présentent les
jeux d'argent comme une pratique « dangereuse », loin de les
discréditer, émettent des réserves quant aux
dérives qu'ils pourraient engendrer sur le plan social. Cette
appréhension a d'ailleurs fait l'objet de controverses entre les
députés camerounais lors de l'amendement de l'article 44 du
projet de loi de 2015 intitulé : « De la contribution du secteur
des jeux à la solidarité et à l'action sanitaire et
sociale ». L'hebdomadaire « La Nouvelle Expression » du 1er
juillet 2015 rapporte que la loi en question fut qualifiée de « loi
immorale » par une partie des députés. Celle-ci leur a paru
imprécise, notamment en ce qui concerne la protection des mineurs, mais
elle a été également vue comme un moyen de promotion de la
feymania3. Ces observations nous situent donc au coeur de ce qui
fonde la préoccupation de ce travail à savoir ; les
conséquences qu'auraient le temps et l'argent que les uns et les autres
consacrent à ces jeux.
Si l'analyse des discours sur les jeux d'argent atteste qu'au
Cameroun, cette question reste un sujet épineux qui mérite
d'être étudié sous ses formes les plus variées, elle
ouvre ainsi la voie à plusieurs interrogations. En effet, le laxisme
dont font preuve les pouvoirs publics en matière d'encadrement des
pratiques de jeux d'argent ne rend-t-il pas l'État complice des
coûts sociaux conséquents de la prolifération de ces formes
de « loisirs » ? La société camerounaise, minée
par les problèmes de sous-emploi ne contribue-t-elle pas au
8
renforcement de la vulnérabilité des individus
au « ndjambo » ? Quelle facture sociale la pratique de ces jeux
impute-t-elle à la société urbaine à Yaoundé
?
Après avoir construit la problématique, il
revient de poser un certain nombre de questions qui orienteront la recherche.
Il s'agit de la question principale et des questions de recherche.
4. Questions de recherche
La construction d'un objet d'étude passe
nécessairement par la conception d'un ensemble de questionnements. Point
de départ de l'enquête, ces questions sont corrélées
à des hypothèses qui participent à la délimitation
du champ d'analyse.
4.1. Question principale
Pour M. BEAUD (1996), une question principale est une question
qui sert de fil conducteur pour le chercheur. Elle doit être
précise, cruciale et centrale par rapport au thème choisi. Cette
question vise non seulement à décrire le phénomène
à étudier, mais aussi à le faire comprendre. Dans le cadre
de la présente étude, la question principale est la suivante :
Quels sont les nouveaux comportements induis par la
prolifération des jeux d'argent à Yaoundé ?
De cette question principale, découlent trois questions de
recherche.
4.2. Questions de recherche
Q.S.1 Quels sont les facteurs explicatifs de
l'enrôlement des citadins dans les jeux d'argent ?
Q.S..2 Quel est le rapport entre la
mobilité sociale des individus et leur participation à
différents types de jeux d'argent ?
Q.S.3 Quelle est l'étendue des
transformations sociales engendrées par la pratique des jeux d'argent
sur la société urbaine yaoundéenne ?
Ces questions de recherche permettent de dégager les
hypothèses.
9
5. Hypothèses de recherche
D'après M. GRAWITZ (1993 :322), l'hypothèse se
définit comme « une proposition de réponse à la
question posée. Elle tend à formuler une relation entre des faits
significatifs (...) elle doit être vérifiable de façon
empirique ou logique ». Pour conduire la présente
étude, il est dégagé ici deux catégories
d'hypothèses, dont l'une est principale et trois autres sont
secondaires.
5.1. Hypothèse principale
L'hypothèse principale se formule comme suit : la
prolifération des pratiques de jeux d'argent dans la ville de
Yaoundé, génère dans l'imaginaire collectif, l'esprit de
lucre, l'appât du gain facile, et l'illusion de l'enrichissement
rapide.
Cette hypothèse principale, comme son nom l'indique,
est assez globalisante. À ce titre, elle demande à être
spécifiée à travers des hypothèses
sous-jacentes.
5.2. Hypothèses de recherche
H.S.1 Les publicités de jeux et les
médias de masse agissent de façon diligente dans la persuasion du
sens commun. En brandissant l'illusion d'un bonheur rêvé par un
simple coup de chance, ces facteurs contribuent à rallier plusieurs
« incertains » aux pratiques de jeux d'argent.
H.S.2 Les difficultés d'insertions
socioprofessionnelles, la proximité des lieux de jeux aux individus et
l'insatisfaction des salariés quant à leurs revenus,
développent un instinct de vulnérabilité à l'argent
chez les yaoundéens pour qui, le jeu apparaît comme une
solution rapide et efficiente à leurs gênes.
H.S.3 La prolifération des jeux
d'argent en cours à Yaoundé, engendre d'une
dégénérescence sociale à travers la
dépendance aux jeux, délinquance, le défaitisme, la
déchéance sociale du joueur etc.
6. Objectifs visés par la recherche
Selon J. DEWEY (1983 :133), « avoir un objectif,
c'est avoir l'intention de faire quelque chose à la lumière de
cette intention ». En souscrivant à la pensée de cet
auteur, le présent travail vise deux objectifs spécifiques
à savoir : un objectif heuristique, qui apporte une contribution
théorique et conceptuelle à la connaissance de ce sujet, et un
objectif pragmatique, dont la finalité est d'aider à
l'éclairage des interventions des politiques et des
10
acteurs sociaux dans la prise des décisions. Celles-ci
devant protéger les joueurs en minorant les risques d'addiction avec ses
conséquences sur leur vie physique, sociale et financière.
Sur le plan scientifique, ce travail suggère
l'invention d'une approche de décryptage d'un phénomène
dont les usages donnent naissance à des problèmes concrets au
sein de la société urbaine, notamment par rapport au travail et
dans la gestion de ressources financières familiales. Le dessein
pragmatique quant à lui est d'inspirer et d'amener les politiques
à se pencher sur les priorités, c'est-à-dire les
modalités de participation des individus aux jeux d'argent. Celles-ci
affectent le système de valeur, la conscience collective, les
aspirations et les normes à différents niveaux de la vie des
acteurs sociaux.
Les objectifs susmentionnés donnent un aperçu de
l'intérêt multidimensionnel de la recherche.
7. Intérêts de la recherche
Le présent travail présente un double
intérêt : un intérêt social et un
intérêt sociologique. Sur le plan social, cette recherche se
rapporte aux joueurs. Elle consiste à les interpeler sur les risques de
leurs pratiques ludiques, pouvant déboucher sur des addictions et
conduire à leur totale aliénation, surtout lorsque ces jeux
tendent à s'ériger en idéaux de promotion
financière. Pour ce qui est de l'intérêt sociologique, ce
travail suggère une implication plus accentuée des pouvoirs
publics, des opérateurs de jeux, des politiques et de la
société civile en matière de sensibilisation, de
prévention et d'encadrement des pratiques excessives de jeux d'argent ;
lesquelles pratiques mènent parfois aux drames, dans le cas des
conduites addictives.
Après avoir élucidé
l'intérêt de la recherche, la définition d'une
méthodologie s'avère nécessaire.
8. Méthodologie de la recherche
La méthodologie désigne «
l'activité critique qui s'applique aux divers produits de la recherche
(...) la méthodologie s'applique à tous les types de recherches
qu'il s'agisse des études quantitatives ou qualitatives, des travaux
à orientation théoriques ou des études sociographiques
» R. BOUDON et F. BOURRICAUD (1982 :369). Son
opérationnalisation dans une recherche ne se fait pas de façon
inopinée ; elle tient compte au préalable d'un cadre
théorique qui occupe une place de choix.
11
8.1. Cadre théorique
La recherche en sciences sociales se construit dans un cadre
conceptuel qui repose sur une ou plusieurs théories. Pour analyser et
interpréter les faits, deux théories sont convoquées dans
ce travail : il s'agit de la matrice constructiviste et de la sociologie
dynamiste et critique.
8.1.1. La matrice constructiviste
La matrice constructiviste est une approche théorique
né du constructivisme développé par J. PIAGET (1964), qui
suppose que, les connaissances de chaque sujet ne sont pas une simple «
copie » de la réalité, mais une « construction »
de celle-ci. C'est-à-dire que, les réalités sociales
doivent s'appréhender comme des construits historiques et quotidiens des
individus en interaction. Ici, le réel existant et connaissant n'est pas
une donnée spontanée, mais relève des constructions
cognitivement construites auxquelles participent des groupes sociaux. Comme le
précise G. BACHELARD (1984 :14), « rien ne va de soi. Rien
n'est donné. Tout est construit ». Ce qui signifie de
façon prosaïque, que ce sont les individus qui construisent le
réel en le confrontant.
Mis à contribution dans cette étude, la matrice
constructiviste permet d'appréhender la prolifération des jeux
d'argent à Yaoundé, non pas comme un accident de l'histoire, ni
d'une nécessité fonctionnelle, mais plutôt, comme une
production consciente ou inconsciente, socialement instrumentalisée des
acteurs sociaux en quête d'argent. Cette approche théorique
caractérise bien la propension au « gain facile » qui anime
bon nombre d'individus à Yaoundé, tant-ils en viennent à
transformer leurs pratiques ludiques en des activités mercantiles en
rapport avec un environnement social jugé défavorable. Davantage,
cette théorie permettra à ce travail d'analyser les pratiques de
jeux d'argent quotidiennes, en tant « qu'ensemble de pratiques
socialement produites, matériellement codifiées et symboliquement
objectivées » A. MBEMBE cité par D.A.F. LEKA ESSOMBA
(2001). Ce modèle théorique, proche des préoccupations des
habitants de Yaoundé à partir duquel ils construisent leur
urbanité est mis à contribution dans l'argumentaire
développé sur les schèmes opératoires mis en place
par ces populations urbaines de Yaoundé, pour s'enrichir à partir
de leurs jeux.
Cette exigence fait donc intervenir l'approche dynamiste et
critique de la sociologie.
12
8.1.2. L'approche dynamiste et critique
La sociologie dynamiste et critique est issue de
l'école générative, née pendant la période
des années soixante. Les promoteurs de cette théorie sont : G.
GURVITCH, A. TOURAINE, C. RIVIERE, G. BALANDIER etc. L'école dynamiste
et critique optait pour objectif selon lequel ; tout chercheur est investi
d'une attitude critique en rupture avec les catégories de l'ordre
social. Cette théorie met au centre de sa réflexion,
l'étude des changements, des mutations, du devenir des
sociétés. Toutefois, la thèse développée par
G. BALANDIER, est celle qui nous intéresse dans le cadre de cette
étude.
Selon G. BALANDIER (1971), la réalité sociale
n'est jamais donnée à l'observation première ou
superficielle. Les sociétés étant
caractérisées par une certaine « hypocrisie », toute
analyse sociologique mérite d'être réalisée à
deux niveaux au moins : le niveau patent et le niveau latent. Bien plus, le
sociologue doit considérer que le sens profond et réel de son
objet d'étude ne peut être conquis qu'à travers un
dépassement, voire une remise en cause de l'aspect officiel. Celui-ci ne
constitue qu'un voile d'occultation de l'aspect caché et plus
révélateur de la dynamique sociale. Les courants dynamistes et
critiques qui s'enracinent dans la sociologie des profondeurs mettent au centre
de leur réflexion l'étude des changements, des mutations, des
mouvements sociaux et du devenir des sociétés influencées
par des dynamiques multiformes.
Dans cette étude l'approche dynamiste aidera à
appréhender la pratique des jeux d'argent beaucoup plus sous l'angle des
transformations qui ont cours au sein de la société. Elle
permettra de voir de quelle manière différents mécanismes
influent sur l'enrôlement des acteurs dans ces jeux et aussi, comment
face à la libéralisation de ces pratiques et aux
difficultés d'ordre économique, les individus développent
des rationalités de gains à partir de leurs jeux.
L'approche critique quant à elle, se justifie par son
principe de lire la réalité à deux niveaux. De ce fait,
elle recommande au chercheur de se méfier du discours des acteurs ou
tout au plus, de partir de ce discours pour déceler après
critique et déconstruction, le sens profond de leurs agirs. À
travers cette seconde approche, il sera démontré comme l'a
souligné G. BALANDIER (1971 :9), « à quel degré
les configurations sont mouvantes ; constamment en voie de se refaire et de
déterminer leur sens ». En d'autres termes, cette approche
aidera à révéler les « écrans
déformateurs » J. ZIEGLER (1981 :13), des
représentations que les pratiques de jeux d'argent imposent
officiellement.
13
La sollicitation de ces grilles d'analyse théorique se
fera à titre complémentaire, de telle manière que chaque
modèle complète les insuffisances de l'autre. Le cadre
théorique conceptuel de la recherche étant ainsi
présenté, il incombe de présenter dans le point suivant,
les techniques et outils de collecte des données.
8.2. Techniques et outils de collecte des données
La collecte des données constitue une étape
majeure du processus de la recherche. Elle lui donne une valeur empirique,
caractérisée par sa double dimension : théorique et
pratique. Dans le cadre de ce travail, les techniques de collectes
convoquées sont classiques en sciences sociales. Il s'agit de celles qui
font appel à l'observation directe, à la recherche documentaire,
à l'entretien et au questionnaire. Ces techniques de collecte mises en
oeuvre correspondent à un dessein de réquisition
systématique des faits correspondants à l'objet d'étude
à savoir : le recueil des informations sur la pratique des jeux
d'argent, les motivations des joueurs et les changements sociaux
observés à différents niveaux de participation des
acteurs. Davantage, elles permettent à ce travail d'avoir une
orientation qualitative, laquelle se sert aussi des éléments
quantitatifs pour étayer les arguments.
Avant de solliciter ces techniques de collecte, il serait
judicieux de définir le cadre géographique de l'étude et
l'échantillon de la population étudiée.
8.2.1. Délimitation du champ d'investigation
Sur le plan géographique, Yaoundé est l'espace
urbain retenu pour mener la présente étude. Le choix de ce site
n'est pas fortuit. De prime à bord, il tient du fait que pour les
sociologues contemporains, cette ville peut être considérée
comme un laboratoire social du Cameroun, comme l'a été la ville
de Chicago aux États Unis à la fin du XIXe
siècle. À ce titre, on peut souhaiter que le terrain
yaoundéen contribue à renouveler les questions que les
sciences sociales se posent aujourd'hui en Afrique, d'où cet appel
lancé par A. FRANQUEVILLE (1984), qui soulignait déjà
l'urgence de « construire une capitale » qui servirait de vitrine en
Afrique centrale.
Sur le plan sociologique, Yaoundé se caractérise
par la multi culturalité de sa population qui revêt les traits
d'une configuration hétérogène, où les individus
s'accommodent à des pratiques communes. Pour ainsi dire, cette ville
constitue « un véritable foyer de production de nouvelles
mentalités, de nouveaux imaginaires, et surtout un laboratoire de
nouvelles formes de pratiques sociales » S.P AWONDO (2006 :15), et
à
14
l'ordre de ces nouvelles pratiques, les jeux d'argent occupent
une place de choix. C'est donc dire qu'à Yaoundé, la pratique des
jeux d'argent est intense. Les machines à sous, les salles de jeux et
les tripots de rues abondent dans tous les quartiers de la ville. On les
rencontre principalement dans les quartiers comme Biyem-Assi, Madagascar,
Mimboman, Melen, Mvog-Mbi, au lieu dit : « campéro », etc.
Dans ces quartiers, les salles de jeux renferment plusieurs types d'appareils
modernes : écrans plasma, terminaux, ordinateurs, machines à sous
etc.
Ces jeux ne se pratiquent pas seulement dans les salles. On
les rencontre aussi dans les rues, les pleins airs et les marchés,
où ils constituent la préoccupation de plusieurs individus. Mais
dans le cadre de cette recherche, la collecte des données s'est
centrée sur des points privilégiés et préalablement
circonscrits. Le champ d'action s'est surtout ordonné dans les
localités suivantes : Ékounou, Mvog-Ada, Mokolo et Ngoa-Ekelle.
Ces quatre localités où l'on a prélevé
l'échantillon ont été privilégiées pour
plusieurs raisons. D'une part, en sollicitant les appuis d'A. ARBORIO et de P.
FOURNIER (1999 :12), il apparaît qu'« une activité
particulière, des pratiques ou un mode de vie commun permettent de
délimiter un groupe à prendre pour objet d'étude
». Ce qui signifie que dans les quartiers populaires
sus-cités, on observe une relative prépondérance des
pratiques de jeux d'argent et des structures abritant ces jeux, en comparaison
à ceux dits résidentiels. Ce sont des « quartiers difficiles
» où vivent de nombreux « incertains »,
c'est-à-dire des personnes désespérées,
fragilisées par la pauvreté matérielle et
financière, cherchant par tous les moyens à s'extirper de
celle-ci. Ce qui les rend particulièrement vulnérables aux jeux
d'argent.
D'autre part, ces sites donnent au chercheur la latitude de
rencontrer tous les types de jeux qui font l'objet de la présente
étude à savoir : le PMUC, le pari foot, le poker, les machines
à sous, les « ndjambo Ludo, Songo, Carte, dés,
flipper, baby-foot etc. ». On y trouve également toutes les
tranches d'âge et les différents sous-groupes de la population
tels que les commerçants, les élèves et étudiants,
les fonctionnaires et les personnes oisives.
La délimitation du cadre géographique de
l'étude fait place au choix des personnes enquêtées.
15
8.2.2. Échantillonnage
D'après R. GHUIGLIONE et B. MATALON (2001 :29), «
il est très rare qu'on puisse étudier de façon
exhaustive une population ». Autrement dit, d'interroger tous les
membres d'une société dans le cadre d'une recherche. Ce serait si
long et si couteux, que c'est pratiquement impossible. Vu cette grande
difficulté, le chercheur est amené à procéder
à un échantillonnage. Échantillonner c'est «
choisir un nombre limité d'individus, d'objets ou
d'évènements dont l'observation permet de tirer des conclusions
applicables à la population entière à l'intérieur
de laquelle le choix a été fait » G. De LANDSHEERE
(1982 :382). Pour aboutir à des résultats au terme de la
recherche, c'est la technique d'échantillonnage non-probabiliste qui a
émergé du processus de sélection des individus devant
participer à l'enquête.
Ce choix s'est imposé autant par contrainte du fait de
l'inexistence d'une base de sondage sur la population des joueurs d'argent
à Yaoundé, que par le fait que le présent travail
s'intéresse à une partie peu visible de la population des
pratiquants de ces jeux dans cette même ville. Ces raisons nous ont
donné la possibilité d'aller à la rencontre des joueurs de
façon aléatoire en les interceptant dans les salles de jeux, les
bars, les tripots de rues et autres lieux de rassemblement où leur
sélection s'est faite in situ. Cette technique est apparue
comme le moyen le plus efficace pour atteindre les objectifs du travail de
terrain à savoir, contacter un maximum de joueurs sur la base d'une
participation libre et volontaire.
Les caractéristiques de l'échantillon sont
présentées dans le tableau qui va suivre.
16
Tableau 1 : Échantillonnage de la
population des joueurs d'argent interviewés
|
Variables
|
Joueurs
|
Effectifs
|
Proportions (%)
|
|
Sexe
|
Hommes
|
105
|
80.76
|
|
Femmes
|
25
|
19.23
|
|
Moins de 20 ans
|
14
|
10.76
|
|
Tranches d'âge
|
21 - 29 ans
|
55
|
42.30
|
|
30 - 39 ans
|
38
|
29.23
|
|
40 - 49 ans
|
15
|
11.53
|
|
50 ans et plus
|
8
|
6.15
|
|
Célibataires
|
74
|
56.92
|
|
Statut matrimonial
|
Mariés
|
32
|
24.62
|
|
Divorcés
|
24
|
18.46
|
|
Commerçants
|
30
|
23.07
|
|
Occupation
|
Désoeuvrés
|
55
|
42.30
|
|
principale
|
Elèves/étudiants
|
25
|
19.23
|
|
Fonctionnaires/salariés
|
20
|
15.38
|
|
Total
|
|
130
|
100
|
Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain)
Du tableau précédent, il ressort que les hommes
sont les plus nombreux à s'adonner aux jeux d'argent que les femmes.
Parmi les sujets enquêtés, on dénombre cent cinq hommes
contre seulement vingt-cinq femmes. Cette prévalence masculine
amène à poser la question de savoir pourquoi le nombre de femmes
est-il si réduit ? Alors qu'on sait que celles-ci, tout comme les
hommes, aiment bien jouer.
L'une des réponses à ce questionnement se
dégage de l'environnement dans lequel se pratiquent les jeux d'argent.
Le fait que ces jeux se trouvent dans les casinos, les bars, les Visio club et
les rues, amène souvent de nombreuses femmes à s'abstenir de
jouer parce qu'elles sont victimes de pressions sociales. C'est du moins ce que
pense une enquêtée, J. ATEBA, gérante d'une salle de jeux
au quartier Ékounou, lorsqu'elle affirme que :
17
Nos clients sont en majorité des hommes. Les salles
de jeux sont en effet des lieux de débauches et de dépravations
telles que : bagarres, injures, vols
etc. il y a certaines personnes
qui, malgré les interdictions de consommer de l'alcool et de fumer
à l'intérieur de la salle, ne font qu'à leur guise,
d'autant plus qu'on n'a pas d'agent de sécurité ici. Donc pour
qu'une femme supporte cet environnement, il faut qu'elle soit vraiment
rusée !
C'est dire autrement, que la société qualifie de
« vulgaire » toute fille qui fréquente pareils milieux. Une
autre raison qui explique la rareté des sujets féminins est
relative à la qualité même du jeu. En effet, les jeux
d'argent contrairement aux autres jeux, nécessitent des sommes
importantes : il faut mettre de l'argent en jeu, alors que les chances de
gagner sont très réduites, ce que semblent redouter les filles.
Un argument qui converge avec O. NEWMAN (1973) pour qui, les femmes sont moins
enclines à s'adonner à un jeu pour gagner de l'argent en
introduisant par exemple une pièce de monnaie dans une machine à
sous, ou encore en pariant sur les évènements.
S'agissant des tranches d'âges des sujets
enquêtés, la classe la plus dominante est celle qui se situe entre
vingt et un et vingt-neuf ans, avec un effectif de cinquante-cinq personnes.
Elle est suivie de celle qui se situe entre trente et trente-neuf ans, qui
compte trente-huit individus. La classe d'âge comprise entre quarante et
quarante-neuf ans en compte quinze. Les enquêtés sont donc
relativement jeunes. Bien que bon nombre d'entre eux n'aient pas encore de
situation financière stable, ils sont déjà en mesure de
s'insérer dans les circuits de production et peuvent d'ores et
déjà s'autonomiser. Les jeunes de moins de vingt ans, d'un nombre
de quatorze, sont minoritaires. Cela tient du fait qu'il leur manque souvent
des moyens financiers, alors que les jeux d'argent nécessitent un
certain budget. Par contre, les gens âgés de plus de cinquante
ans, trouvent peu d'intérêts aux jeux d'argent. Ce sont des
adultes qui, à défaut de s'y être impliqué plus
tôt, ont une considération péjorative de ces jeux, car pour
eux, cette activité peut s'arrimer à un passe-temps.
Pour ce qui est du statut matrimonial des
enquêtés, 75.38 % de célibataires et de divorcés
s'intéressent aux jeux d'argent. Ce qui signifie que le fait
d'être « irresponsable », ou exempt de charges familiales
amène les individus en quête de gain providentiel à
s'adonner plus facilement aux jeux d'argent. Chez les hommes mariés,
d'une proportion de 24.62 % possédant un revenu faible ou moyen, leur
participation au jeu dans la recherche du gain
18
marque dans une certaine mesure, une confirmation des
rôles sociaux qui veulent que ce soit l'homme en tant que chef du
ménage, qui apporte des ressources financières au foyer,
même s'il existe des femmes qui soutiennent des familles.
Une autre tendance qui se dégage des participants aux
jeux d'argent dans la ville de Yaoundé est que cette pratique concerne
la quasi-totalité des couches sociales de la population. En effet, les
points de jeux abondent d'adolescents, d'élèves et
étudiants. Ceux-ci, en général, fréquentent ces
lieux pour des raisons de crises identitaires liées à la
proximité de ces points de jeux à leur environnement scolaire.
À ceux-là, viennent s'ajouter les chômeurs, les
désoeuvrés, les commerçants ambulants et autres «
débrouillards », donc des personnes sans emploi fixe,
exerçant un petit métier occultant quelque fois la misère.
C'est ce qui fait dire à J.P ONANA (ibid.), qu'« au Cameroun,
les statistiques montrent que ce sont les couches les plus
défavorisées (pauvres), qui comptent le plus d'adeptes ».
Ces jeux deviennent pour ces derniers, des refuges sociaux qui permettent
non seulement à celui qui les pratique de fuir les dures
réalités de la vie en ville, mais aussi de se créer un
monde imaginaire, lui donnant une illusion de satisfaction financière et
de bonheur. Parmi ces joueurs, on rencontre aussi des fonctionnaires, des
salariés du secteur public et privé, certes en nombre
réduit, mais à prendre avec beaucoup de considérations.
Pour réaliser la collecte des données, les
techniques suivantes ont été mobilisées :
8.2.3. L'observation directe
À l'origine, l'observation directe était une
technique d'investigation utilisée en Anthropologie. Elle participait
à la « mise en évidence des cultures et des «
routines sociales » V. NGA NDONGO (1999 :300). C'est une technique de
collecte qui permet au chercheur d'être en contact direct avec la
réalité qu'il veut étudier. Selon G. MACE et F.
PETRY (2000 :92), « L'observation directe consiste pour un chercheur
à observer directement son objet d'étude ou le milieu dans lequel
le phénomène se produit afin d'en extraire les renseignements
pertinents à sa recherche ». À travers cette technique
de collecte, le chercheur est présent sur le lieu des faits qui ont
éveillé sa curiosité au moment de leur manifestation, et
sans s'adresser aux sujets concernés, il procède directement au
recueil des informations.
Dans ce travail, l'observation directe a favorisé le
recueil d'un ensemble d'informations dont les individus n'avaient pas assez
conscience. Il s'est agi de scruter la localisation des points de jeux sur
l'espace public, les heures d'affluences dans ces lieux, le
19
contenu des discussions entre les joueurs et tout autre
phénomène en relation avec la pratique de ces jeux.
8.2.4. La recherche documentaire
La recherche documentaire est par définition
conçue comme « une observation médiatisée par les
documents » V. NGA NDONGO (1999 :283). Le document étant
perçu ici comme « tout élément matériel ou
immatériel qui a un rapport avec l'activité des hommes vivants en
société et qui, de ce fait, constitue une source d'information
sur les phénomènes sociaux » P. BOURDIEU (1968 :35).
Dans ce travail, la recherche documentaire a permis de tirer des documents de
diverses natures, l'attention a beaucoup plus été portée
sur l'exploitation des ouvrages, des thèses, des mémoires, des
articles scientifiques et des journaux ayant un rapport avec le sujet.
Davantage, il était question de porter un regard sur les messages
diffusés par voie formelle à travers les publicités et les
émissions radiodiffusées et télédiffusées
qui parlent des jeux d'argent.
8.2.5. L'entretien semi-directif
En Sociologie, l'entretien est utilisé comme le moyen
privilégié pour recueillir les aspects qualitatifs et subjectifs
de la vie sociale. D'après M. GRAWITZ (1990 :744), l'entretien
semi-directif est « une communication orale ayant pour but de
transmettre des informations de l'enquêté à
l'enquêteur ». Cette technique de collecte distingue
l'entretien directif de l'entretien non directif, et selon que le contenu est
ou non structuré par l'enquêteur, la participation de
l'enquêté est active. Le choix motivé de ce type
d'entretien est qu'il peut admettre des questions formulées ou non
formulées à l'avance, des questions ouvertes et des questions
fermées, ce qui garantit une certaine marge de liberté aux
enquêtés.
Dans cette étude, les entretiens ont été
effectués avec des personnes dites ressources résidant à
Yaoundé, lesquelles se déclinent d'une part en douze
gérants de structures de jeux et trois responsables exerçant dans
les administrations publiques impliquées chacun à leur
manière dans la gestion des jeux d'argent. Il s'agit entre autres, du
Chef de service des jeux du MINATD, du Chef de service de l'aménagement
des parcs à la direction du développement des loisirs du MINTOUL
et du Chef de bureau des émissions fiscales à la commune
d'arrondissement de Yaoundé IVe. Ces entretiens nous ont
permis d'avoir une idée plus construite du sens attribué aux jeux
par ces différents acteurs sociaux. Ils ont été conduits
et enregistrés par des notes manuscrites, suivant la
préférence des personnes interviewées, plutôt
J. HUIZINGA, historien néerlandais et
spécialiste de l'histoire culturelle a notamment travaillé sur
l'histoire des émotions. Il considère le jeu comme :
20
qu'un enregistrement magnétophonique. Pour faciliter
l'analyse des données lors du dépouillement, nous avons
exploité des grandes lignes extraites de leurs discours.
8.2.6. Le questionnaire
Le questionnaire est présenté par VERKEVISSEUR
et al. (1993 :146), comme « un outil de collecte des
données par lequel des questions écrites sont
présentées aux répondants qui y répondent
également par écrit ». C'est un outil de quantification
qui a permis non seulement de mesurer autant que faire se peut, les
informations sur la connaissance des jeux et leur pratique ; mais
d'appréhender le changement social à différents niveaux de
participation des acteurs impliqués. L'enquête en elle-même
s'est déroulée de la période allant du 8 novembre au 17
décembre 2016. Au cours de cette période, cent trente
questionnaires valides sur les cent cinquante distribués ont pu
être collectés (voir annexe 2). C'est sur eux que repose le corpus
principal du présent travail.
9. Mise au point conceptuelle
E. DURKHEIM (1958 :21) pense que « les mots de la
langue usuelle comme concepts qu'ils expriment sont toujours ambiguës et
le savant qui les emploierait tel qu'il les reçoit de l'usage sans leur
faire subir d'autres élaborations s'exposerait aux plus graves
confusions ». Vu cette précision, le chercheur a
intérêt à définir ses concepts pour être
sûr de les utiliser dans le même sens que ses lecteurs. Pour donc
souscrire à cette exigence, il est nécessaire de clarifier les
concepts de « jeu d'argent » et de « changement social
».
9.1. Jeu d'argent
La littérature scientifique n'apporte presque pas de
définition au concept de « jeu d'argent ». La raison est que
la plupart des travaux effectués dans ce champ font
référence au concept de « jeu de hasard », concept qui
connote non seulement des contingences de rationalités abstraites pour
constituer un objet d'étude, mais surtout, parce que le présent
travail se centre sur des jeux où les individus misent et perdent avec
l'espoir de gagner plus d'argent dans l'avenir. Toutefois, il est
nécessaire ici de faire le point sur les différentes approches
définitionnelles du concept de « jeu de hasard »
proposées par les auteurs, afin d'appréhender le concept de
« jeu d'argent » dans cette étude.
21
Une action libre, sentie comme fictive et située en
dehors de la vie courante, capable néanmoins d'absorber totalement le
joueur ; une action dénuée de tout intérêt
matériel et de toute utilité qui s'accomplit en un temps et dans
un espace expressément circonscrit. J. HUIZINGA (1951 :34-35).
Dans cette définition, l'auteur sépare le jeu de
l'activité réelle, du « monde habituel » et le valorise
en le considérant comme moteur de l'évolution des civilisations.
Contrairement à J. HUIZINGA, R. CAILLOIS parle entre autres de
l'aléa, au sujet des jeux où l'argent est présent. Selon
lui, dans ce type de jeux :
Le rôle de l'argent est d'autant plus
considérable que la part du hasard est plus grande et par
conséquent la défense du joueur plus faible. Car, l'aléa
n'a pas pour fonction de faire gagner de l'argent aux plus intelligents, mais
tout au contraire d'abolir les supériorités naturelles ou
acquises des individus, afin de mettre chacun sur un pied
d'égalité absolue devant le verdict aveugle de la chance. R.
CAILLOIS (1969 :58).
Par la suite, il établit une classification qu'il
considérait manquante dans les travaux de J. HUIZINGA. Dans cette
répartition, il propose une division en quatre rubriques principales,
selon que dans les jeux considérés prédomine le rôle
de la compétition, du hasard, du simulacre ou du vertige. Il les appelle
respectivement : Agôn, Aléa, Mimicry, et Ilinx. Bien que ces
catégories ne soient pas exclusives, les jeux basés sur
l'aléa laissent entrevoir les jeux de hasard comme des
évènements aléatoires, qui se définissent en
opposition avec les activités de loisir. Cela revient à dire que,
gagner ou perdre à un jeu de hasard ne dépend pas de
l'habileté du joueur ou de certaines stratégies de jeu, mais
dépend volontiers de la chance. Dans ce type de jeu, écrit C.
BEART (1960 :18), « on ne cherche pas à éliminer
l'injustice du hasard mais c'est l'arbitraire même de celui-ci qui
constitue le ressort unique du jeu ».
C'est pourquoi G. FERRÉOL (2002 :150), définit
le jeu de hasard comme « une action de loisir soumise à des
règles conventionnelles, comportant gagnants et perdants et dans
laquelle n'intervient ni calcul, ni habileté du joueur ». Par
jeu de hasard, G. FERRÉOL sous-entend donc toute activité
organisée par un système de règles définissant un
succès et un échec, un gain et une perte. Suivant cette approche,
le législateur camerounais par le truchement de la loi no
89/26/89 délibérée et adoptée en
plénière le 29 novembre 1989, dans
22
son article 2 statue que « sont
considérés comme jeux de hasard, ceux qui procurent un gain en
argent ou en nature et dans lesquels la chance prédomine sur l'adresse
». En analysant ces définitions, on voit émerger trois
éléments qui permettent de caractériser un jeu d'argent :
il doit être investi d'un enjeu, d'une possibilité de gain ou de
perte et de la présence même accessoire du hasard.
Le « jeu d'argent » s'appréhende donc dans ce
travail, comme la pratique d'une activité ludique associée
à un intéressement financier à l'issue de la partie. Ici,
chaque joueur engage un certain montant financier dans le jeu qui sera tout ou
partie perdue, ou qui sera augmenté en cas de gain.
9.2. Changement social
Le changement social est un phénomène collectif
qui affecte une collectivité ou un secteur important de la
collectivité. C'est un phénomène qui touche à la
fois l'univers mental et les conditions de vies de plusieurs individus ou
encore la structure ; c'est-à-dire les composantes de l'organisation
sociale. Le changement social est indissociable du temps, dans la mesure
où on l'apprécie et on le mesure par rapport à un point de
référence situé dans le passé. Il est permanant,
tant il est vrai que les transformations qu'il engendre durent. Pour certains
auteurs comme G. BALANDIER, la Sociologie s'intéresse plus aux
changements exogènes, « du dehors », qui apparaissent sous
l'angle de l'acculturation et de la dépendance à travers le
développement d'une contre acculturation qu'il appelle « le
travail de la société sur elle-même » G.
BALANDIER (1977 :233) : c'est-à-dire des sociétés en voie
de se faire, portant constamment en elles le débat et l'incertitude.
En s'inspirant de cette approche, nous adhérons
à la pensée de G. ROCHER (1968 :22), selon laquelle le changement
social désigne « toute transformation observable et
vérifiable dans le temps qui affecte d'une manière qui ne soit
pas provisoire ou éphémère la structure ou le
fonctionnement d'une collectivité et qui modifie le cours de son
histoire ». Dans le cadre des jeux d'argent étudiés
dans ce travail, ce qui change n'est pas comme on le pense un peu
hâtivement les règles, mais c'est la nature même du jeu. En
effet, d'une façon générale, la mercantilisassions des
pratiques ludiques à Yaoundé a entrainé une transformation
dans le quotidien des populations qui, à partir de cette
activité, ont fondé une idéologie de promotion
financière. Cette réinvention n'est pas sans conséquences
: elle affecte non seulement l'organisation des entités sociales comme
la famille, mais aussi la société à
23
travers l'émergence
d'épiphénomènes parallèles ainsi que l'abandon du
travail et du sens de l'effort.
10. Organisation du mémoire
Pour comprendre ce que signifie « jeux d'argent et
changement social à Yaoundé », la
présente étude s'articule autour de trois chapitres. Ces
chapitres ne sont ni chronologiques, ni thématiques mais suivent les
trajectoires de mobilisation des différents acteurs sociaux du jeu
impliqués. Le premier chapitre intitulé : panorama des jeux
à Yaoundé et description du phénomène,
présente dans ses différentes sections ; une typologie des jeux,
la localisation de ces pratiques dans les secteurs urbains de la ville de
Yaoundé, ainsi que les logiques attribuées à ces jeux par
les différents protagonistes. Le second chapitre intitulé :
mécanismes d'enrôlement et de participation des acteurs aux jeux
d'argent, s'intéresse à une approche des médias et de la
mobilité sociale pour comprendre le recours au jeu d'argent chez les
personnes désoeuvrées, les commerçants et les
salariés des secteurs public et privé.
Quant au troisième chapitre formulé sous le
thème : amplification des pratiques de jeux d'argent et changement
social, il est au coeur de l'analyse du changement social dont le jeu en est un
facteur. Ce chapitre met en lumière l'impact du jeu sur la vie familiale
et sociale du joueur, mais davantage sur la société urbaine. Un
examen critique et global de l'engouement manifesté autour de ce
phénomène dresse un aperçu d'une société
camerounaise en proie à la déliquescence de ses citoyens. Le
mémoire s'achève par une conclusion générale.
Celle-ci rappelle les différentes étapes parcourues au cours de
la recherche, les difficultés rencontrées, les résultats
obtenus et les perspectives qui s'ouvrent dans ce champ de réflexion.
24
CHAPITRE I : PANORAMA DES JEUX À YAOUNDÉ
ET
DESCRIPTION DU PHÉNOMÈNE
I. ESQUISSE D'UNE TYPOLOGIE DES JEUX
À première vue, la variété de jeux
rencontrés en parcourant la ville de Yaoundé fait
désespérer face à l'idée de découvrir un
principe de classification qui permettrait de les repartir dans des
catégories distinctes. Étant donné que chaque jeu a un but
précis et des caractéristiques propres, il convient d'en dresser
une typologie. Cette typologie de jeux s'inspire de celle
présentée pour la première fois par R. CAILLOIS (1958),
qui distingue deux catégories à savoir : les jeux de hasard et
les jeux d'adresse. D'après cet auteur, les jeux de hasard regroupent
l'ensemble des jeux qui ne font pas appel aux habiletés des joueurs.
Autrement dit, les personnes qui y participent ont les mêmes
probabilités de gagner ou de perdre, l'unique variable qui
détermine leur performance étant le hasard. C'est par exemple le
cas du Lotto, des paris sportifs et hippiques, du bingo, ou encore de la
roulette Y. CHANTAL et J. VALLERAND (1996). Quant aux jeux d'adresse, ils
regroupent l'ensemble des jeux qui reposent à la fois sur le hasard et
sur les habiletés des participants. Dans ce type de jeux, les
protagonistes n'ont pas les mêmes probabilités de gagner ou de
perdre, puisque leurs habiletés ont un impact sur leurs gains ou sur
leurs pertes. C'est notamment le cas du black jack, du flipper, des jeux
vidéo et dans une certaine mesure, du poker Y. CHANTAL et J. VALLERAND
(idem). Le dénominateur commun aux différents jeux dans chacune
de ces deux catégories demeure le fait que ce sont des jeux où
l'argent est présent.
Les observations faites dans les secteurs urbains de la ville
de Yaoundé, ont donc révélé l'existence de deux
catégories de jeux d'argent que sont : les jeux d'argent
légalisés, qui sont autorisés et promus par des
entreprises ou des maisons de jeux. Leur exploitation se fait par l'obtention
d'un contrat de concession délivré par le MINATD, après
avis du MINFI. Ce sont entre autres les casinos, les PMU, les loteries et les
tombolas, les machines à sous, etc. On distingue comme deuxième
catégorie, les jeux d'argent clandestins, qui ne sont pas officiellement
autorisés et règlementés. Cette catégorie
intègre certains appareils électroniques,
électromagnétiques et bien d'autres matériels non
déclarés, mais destinés à la pratique de ces jeux.
Il en est de même, de certains jeux de société comme les
billes, la carte, les dés, le Ludo, le Songo etc., où
les individus misent discrètement des sommes d'argent dans l'espoir de
gagner davantage. Dans cette deuxième catégorie, les promoteurs
de ces différents jeux évoluent dans l'informel ou le souterrain
urbain et échappent de ce fait au fisc.
25
Dans chacune des catégories mentionnées supra,
les différents jeux pratiqués font plus ou moins appel aux
habiletés des joueurs, nécessitent un investissement en argent et
sont plus ou moins productifs. Le tableau ci-dessous présente ces
différentes catégories de jeux d'argent.
Tableau 2 : Classification des jeux d'argent
présents à Yaoundé
|
Catégories de
jeux d'argent
|
Types de jeux pratiqués
|
Organisation matérielle
des jeux
|
Lieux de pratique
des jeux
|
|
Les Jeux
d'argent
légalisés
|
- Roulette, black jack,
craps, baccara,
- Billard,
- PMU,
- Loteries, tombolas,
- Poker,
- Baby-foot, Flipper,
Jeux vidéo.
|
- Jetons, pièces de
monnaie,
- Appareils
électromagnétiques
- Boules,
- Catalogue
d'informations,
- Terminaux, etc.
|
- Casinos,
- Salles de
jeux,
- Tripots de
rues,
- Sites de jeux
sur internet.
|
|
Les jeux d'argent
clandestins
|
- Bonus Win,
- Playstation,
- Bonneteau ou three
cards,
- Billes, Carte, dés,
Ludo, Songo, etc.
|
- Cartes, dés, pions,
- Tableaux, pièces de
monnaie,
- Appareils
électroniques et
électromagnétiques
- Manettes, etc.
|
- Bars,
- Boutiques,
- Marchés,
- Maisons
abandonnées
- Pleins airs,
etc.
|
Source : Badel ESSALA, (en enquête de terrain).
Il convient de préciser que ces catégories de
jeux ne sont pas exclusives. Par exemple, certains jeux comme le poker ou le
baby-foot, peuvent appartenir à la fois à la catégorie des
jeux d'argent légalisés et à celle des jeux d'argent
clandestins, selon que leur promoteur soit en conformité ou pas avec la
fiscalité en la matière. Essayons tout de même de
présenter les particularités de certains de ces jeux.
26
1. Les jeux d'argent légalisés
Des addictions aux enjeux multiformes que suscitent les jeux
d'argent, L'État camerounais depuis l'année 1970 a
légiféré afin que l'exploitation de ces jeux soit
encadrée et garantisse une certaine cohérence. Ainsi, trois lois
dont : la loi no 70/LF/12 du 9 novembre 1970, abrogée par la
loi no 79/9 du 30 juin 1979 et son décret d'application
no 81/497 du 23 novembre 1981, la loi no 89/026 du 29
décembre 1989 et son décret d'application no 92/050/PM du 17
février 1992 sont intervenues pour règlementer la pratique des
jeux où l'argent est présent. Deux catégories sont ainsi
définies : les jeux de divertissement et les « jeux de hasard
», donc les jeux d'argent. Jusqu'à la loi de 1989, seuls les jeux
de divertissement étaient licites, tandis que la pratique des «
jeux de hasard » restait prohibée, exception faite des casinos, des
loteries et des tombolas restés exclus du champ d'application de cette
loi. Cependant, conformément à la prise en compte des
intérêts touristiques et économiques, le décret de
1992 va aboutir à la libéralisation des « jeux de hasard
». C'est dans cette veine que l'on retrouve :
1.1. Les casinos et les types de jeux autorisés
Les casinos sont compris comme des cercles ludiques et
touristiques où se pratiquent un certain type de jeux d'argent. Au
Cameroun, l'article 27 de la loi no 92/050/PM du 17 février
1992 définit le casino comme un établissement pouvant comporter
trois activités distinctes à savoir : le spectacle, la
restauration et le jeu. La plupart des métropoles camerounaises abritent
un grand nombre de casinos y compris la ville de Yaoundé ; capitale
politique. Pourtant, seuls sept bénéficient d'un contrat de
concession et sont officiellement reconnus. Parmi ceux-ci, on compte deux dans
la ville : il s'agit du casino « El Blanco » situé au Hilton
Hôtel et du casino « Golden city » au Mérina
Hôtel, selon les informations obtenues au service des jeux du MINATD.
Dans ces établissements possédant plus de quinze machines
à sous, la pratique des jeux n'est possible qu'en argent comptant, plus
précisément à l'aide de jetons ou de plaques fournis par
le casino qui dispose d'un bureau de change acceptant toutes les devises. Au
casino, sont pratiqués les jeux suivants :
a) Les « machines à sous ». Ce sont des
appareils électroniques qui procurent un gain numéraire ; le
poker en constitue le principal jeu. Ces appareils sont composés
d'éléments indispensables tels qu'une entrée de
pièces, un système d'affichage du jeu, un moteur aléatoire
et d'un bac à pièces (sortie d'argent).
27
b) Les jeux de « contrepartie ». Ce sont des jeux
de cartes numéraires où les joueurs sont disposés sur deux
tableaux et peuvent miser indifféremment sur l'un ou sur l'autre
tableau. Dans le même temps, le banquier joue contre les deux tableaux et
prend une troisième carte en fonction d'un tableau de tirage. Parmi ces
jeux, on distingue : la boule vingt-trois, la roulette américaine, la
roulette anglaise, le trente et quarante, le black jack, le craps et le Punto
banco.
c) Les jeux de « cercle ». Ce sont aussi des jeux
de cartes qui donnent la possibilité au joueur de pouvoir doubler
systématiquement sa mise. Parmi ces jeux, on a : le baccara, le chemin
de fer, la banque ouverte et l'écarté.
Dans ces jeux, les joueurs ont une certaine marge de
liberté en ce sens qu'ils peuvent s'associer dans une main (mise minimum
demandée à deux associés), racheter une main (passer quand
le banquier décide d'arrêter de miser et d'encaisser ses gains) ou
jouer debout sans participer directement à la partie. Loin d'être
exhaustive, la liste des jeux sus-énumérés ne constitue
qu'une partie de tout ce que l'on peut rencontrer dans un casino. Certains
types de jeux rentrant dans la catégorie des jeux en ligne sont aussi
présents.
1.2. Les jeux en ligne
Les jeux en ligne s'appréhendent comme l'ensemble des
pratiques ludiques à but lucratif où la mise et la lecture des
résultats se font en ligne à travers l'outil internet, la
télévision ou la radio. Le plus souvent, il s'agit des jeux de
pronostics où les gagnants peuvent émerger d'un tirage au sort ou
de la validité de leurs prédictions. Ces jeux sont dictés
par « l'aléa », c'est à-dire qu'ils ne font aucunement
appel aux qualités physiques et intellectuelles du joueur, mais reposent
en grande partie sur le hasard. Parmi ces jeux, figurent :
1.2.1. La loterie
La loterie est un jeu d'argent qui consiste à tirer au
sort des numéros désignant des gagnants parmi les joueurs ayant
payé une mise de départ, ce qui leur donne droit à des
lots en nature (objets de valeur) ou en espèces (argent). On distingue
deux types de loteries à savoir : les jeux de tirage et les jeux de
grattage. Les jeux de tirage sont des loteries sous forme électronique
encore appelés « kendo » où quatre-vingts boules sont
introduites dans une machine paramétrée sur la base d'algorithmes
complexes. Cette machine offre des tirages à des intervalles de temps
réguliers, de telle sorte qu'elle peut accorder
régulièrement de
28
nombreux petits gains ou encore peut procurer de gros gains,
mais à des intervalles de temps plus espacés ; ce qui rend alors
difficile d'évaluer le moment de l'octroi d'un gain. L'image ci-dessous
présente ce type de loterie.
Photographie 1 : Écran affichant des
numéros gagnants à la loterie numérique

Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
Cet écran présente un tableau numérique
de vingt numéros gagnants. Il est commandé par un logiciel
informatique et offre un nombre illimité de tirages une fois qu'il est
mis en marche. Ce jeu où la mise minimale est de deux cents francs et a
la particularité de ruiner rapidement les joueurs, qui font fi du
principe d'indépendance des tours inhérent à ce jeu, au
profit de leurs illusions de contrôle du jeu R. CAILLOIS (1958).
Les jeux de grattage, quant à eux, sont des loteries
qui s'apparentent aux tombolas. Ce sont des loteries nationales où le
principe consiste à se procurer un ticket auprès d'une
institution agréée. Une fois en possession du ticket, le joueur
n'a plus qu'à gratter le verso où il découvre d'imminents
lots. Les jeux de grattage, depuis la faillite des entreprises LONACAM, LOTELEC
et de CASCH TV, ont presque tous disparu du paysage des jeux d'argent dans la
ville de Yaoundé au profit des loteries numériques
instantanées précédemment citées.
À côté des loteries, les PMU se comptent
aussi parmi les jeux d'argent légaux.
4 Entendu comme preneur de paris licites, est une
personne morale permettant de miser de l'argent sur des
évènements le plus souvent sportifs. Au Cameroun, les plus actifs
sont : 1XBET, Bwin,
goal.com, Betclic.
29
1.2.2. Les paris sur les
évènements
Les paris sur les évènements sont des jeux
où les individus misent sur un résultat opposant des
athlètes en concurrence au cours d'une compétition. Ils incluent
toutes les rencontres opposants deux équipes (match de football, rugby,
basketball, handball, hockey, etc.). Ou deux individus (match de tennis, boxe,
escrime etc.) ou plus de deux individus (une épreuve de cyclisme,
d'athlétisme, de biathlon etc.). En général, ces paris
font principalement référence aux pronostics sur les
résultats des courses de chevaux et des rencontres sportives connus
respectivement sous les termes de « paris mutuels » et de «
paris sportifs ». Dans ce jeu, le parieur joue contre le «
bookmaker4» qui attribue une « cote » ou un
coefficient à la probabilité qu'un évènement
survienne ou non. Parier consiste alors à miser une somme d'argent sur
un des résultats possibles d'un évènement sportif avec la
possibilité de remporter des gains en cas de validité des
pronostics.
Il y a quelques années encore au Cameroun et dans la
ville de Yaoundé en particulier, le PMUC était le seul
organisateur de ces jeux de probabilité, du fait de la forte
présence de ses kiosques sur les trottoirs urbains. Cette
prédiction monnayée sur les résultats de courses de
chevaux était alors considérée comme un jeu de personnes
âgées. Mais aujourd'hui, il n'épargne aucune strate de la
population. Le football étant un appât pour plusieurs personnes,
au PMUC, on parie désormais sur le football : c'est le
phénomène « pari foot ». Ainsi, les paris sportifs sont
fortement représentés à Yaoundé, étant
donné qu'on dénombre une demi-douzaine d'opérateurs
exerçant dans ce domaine. Ce sont entre autres le PMUC, PREMIER BET,
ROISBET, SUPER GOAL, SPORT FOR AFRICA et MOBIGAME.
Dans ce jeu, les règles sont contenues dans une charte
distribuée gratuitement dans les kiosques. Il est requis de se procurer
une nouvelle fiche chaque fois que les matchs de différents championnats
ont lieu. Tout est dans la somme d'argent que l'on mise en fonction des moyens
dont on dispose et la « cote » des équipes sur lesquelles on
parie. Les joueurs peuvent miser sur autant d'équipes que leurs moyens
permettent ; le seul risque étant de perdre la totalité de son
gain probable lorsque ne serait-ce qu'un seul résultat des matchs
pronostiqués s'avère erroné. Ces jeux qui combinent
à la fois l'obsession pour les matchs de football et la
possibilité de remporter de l'argent sont particulièrement
appréciés par les populations de la ville de Yaoundé.
30
L'image ci-dessous présente l'édifice abritant
un établissement de jeux d'argent homologué dans la ville de
Yaoundé.
Photographie 2 : Bâtiment abritant la
Direction Générale du PMUC à Yaoundé

Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
La présence de cet établissement de jeux
d'argent au lieu dit « Avenue des banques », n'est pas fortuite.
À plusieurs niveaux, cette présence est significative. D'une
part, cela doit au fait que l'occupation de l'espace constitue la base de
l'économie urbaine. En cela, le PMUC, à l'image d'une institution
à capitaux publics, dispose d'une direction en plein centre urbain
où il récompense ses « millionnaires ». Il s'affirme
par là comme un acteur économique crédible et indigne de
toute suspicion de ruine ou de déstabilisation financière, morale
et sociale d'un nombre important de personnes. D'autre part, cette
proximité serait beaucoup plus perçue comme une stratégie
visant à attirer des personnes au sortir des banques environnantes,
à venir tenter la chance au jeu sous le prétexte de multiplier la
somme dont-telles disposent.
Ce dispositif n'est pas l'apanage du seul PMUC. On le retrouve
aussi chez d'autres opérateurs de jeux tel que présenté
sur l'image suivante :
31
Photographie 3 : Un édifice abritant une
salle de jeux à Mvog-Mbi
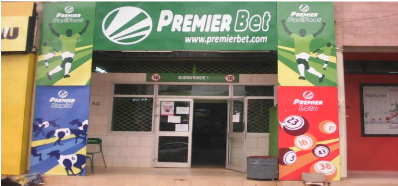
Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
Cette photographie présente l'une des nombreuses salles
de jeux appartenant à l'entreprise de paris sportifs PREMIER BET
à Mvog-Mbi, dont le siège social se trouve au quartier Mvog-Ada.
Le choix de ce quartier dit « populaire » par les promoteurs de cette
maison de jeu n'est pas aussi un fait du hasard. Il tient compte de son
environnement structurel et social. En réalité, on retrouve dans
ce périmètre un poste de police, des agences bancaires, des
micros-finances, des magasins, des stationnements, des marchés et
supermarchés où s'opère une intense activité
financière par des populations aux diverses trajectoires urbaines
(fonctionnaires, commerçants, travailleurs du secteur informel,
désoeuvrés, etc.). La salle de jeu se présente à
cet effet comme un espace de séduction des sensibilités où
les adeptes du gain facile, peuvent aisément participer à leur
manière à la vie urbaine. Il en est de même pour les
usagers qui, en se rendant à leur lieu de service ou activité,
seraient tentés d'y faire un tour afin de valider quelques tickets pour
essayer d'accroître leur capital.
Cette configuration se rapproche de celle que l'on attribue
à l'image présentée dans les lignes qui suivent.
32
Photographie 4 : Local faisant office de Visio
club à Mokolo

Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
À la différence des images
précédentes, ce Visio club estampillé ROISBET se situe
à Mokolo, un quartier fortement peuplé et réputé
non seulement pour l'intense activité économique pratiquée
par les populations, mais surtout comme étant un site
privilégié des délinquances sociales comme la consommation
de la drogue et de stupéfiants, vols etc. À côté de
ces épiphénomènes, les pratiques de jeux d'argent
prolifèrent aussi. C'est ainsi qu'au cours de notre enquête, l'on
a pu observer que les fréquentations dans cette salle qui sous peu
s'apparente à un marché, sont dans une proportion large le fait
de personnes désoeuvrées, des commerçants ambulants, des
transporteurs à moto, et bien d'autres. Ils y viennent pour passer un
moment de détente, et bien évidement pour gagner de l'argent. Ce
lieu attire aussi les mineurs qui sont curieux de savoir ce qui se passe
à l'intérieur.
C'est dire en somme, que les images présentées
sont celles des entreprises qui proposent des jeux de pronostics et de paris
que nous avons appelé jeux en ligne. Une autre catégorie de jeux
d'argent autorisés émerge à présent, il s'agit des
machines à sous.
33
1.3. Les machines à sous
Les machines à sous sont des appareils
électromagnétiques de jeux d'argent qui ne demandent aucune
habileté ou stratégie particulière pour s'en servir. C'est
l'introduction d'une pièce d'argent dans l'orifice de l'appareil qui
donne droit à un jeu. Les machines à sous offrent des jeux qui se
pratiquent en groupe ou de façon solitaire. Dans ce type de jeu, la
finalité n'est pas toujours d'escompter un gain quelconque en argent,
mais aussi le divertissement. C'est la raison pour laquelle dans certains de
ces jeux, on observe un détournement par les pratiquants, qui les
transforment volontiers en de jeux d'argent en initiant des mises. Celles-ci se
soldent soit par des gains chez certains, soit par des pertes chez d'autres.
Parmi ces jeux, on distingue : le baby-foot, le flipper et les jeux
vidéo.
1.3.1. Le baby-foot
Le baby-foot est un jeu qui est en principe destiné aux
enfants, bien qu'il ne soit pas rare de rencontrer des adultes qui s'y
intéressent. Ce jeu s'apparente beaucoup au football et cela s'explique
par le fait qu'ils possèdent presque le même « système
de jeu ». Plusieurs personnes peuvent le pratiquer à la fois, il
suffit d'introduire une pièce de cent francs dans l'orifice de
l'appareil pour obtenir sept boules qui constituent une partie de jeu. À
l'image du football, le gagnant est celui qui aura marqué plus de buts
dans le camp de son adversaire. Cependant, les parties de baby-foot sont assez
passionnantes, c'est pourquoi elles s'érigent en de véritables
défis entre joueurs ; ils n'hésitent plus à y mettre de
l'argent sous forme de mises, dans le but de stimuler l'enjeu. Cet argent est
rendu à un tiers qui fait office d'arbitre et est tenu de
prélever un pourcentage sur ces mises et de restituer le reliquat au
joueur ou à l'équipe qui aura remporté la partie.
L'image suivante présente ce type de jeu :
34
Photographie 5 : Une partie de «
ndjambo-baby-foot » au marché Mokolo

Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
En observant cette image, on peut se rendre compte de toute
l'attention portée au jeu aussi bien par les joueurs eux-mêmes que
par les spectateurs agglutinés tout autour. Une manière de
reconnaitre avec M. MAFFESSOLI (1979 :53), que l'activité ludique se
manifeste dans « le spectacle et la communion ». Car,
même les jeux « les plus solitaires ont besoin, au plus haut
point, de spectateurs pour se réaliser pleinement ». Mais
comme il est de notoriété que « les camerounais ne font rien
pour rien » selon une expression communément utilisée
à Yaoundé, il va de soi que cet attroupement de personnes n'est
motivé que par des intérêts financiers autour de ces tables
de jeux. Dans ce type de jeu, l'argent se branle sous anonymat et de
façon si discrète qu'il faut faire preuve d'un sens
élevé d'observation, pour s'en rendre compte. En dehors du
baby-foot, les yaoundéens s'adonnent aussi au flipper et aux
jeux vidéo.
1.3.2. Le flipper et les jeux vidéo
Pareillement au baby-foot, le flipper ou billard
électrique est un jeu d'arcade à monnayeur, dont le principe est
de marquer des points en dirigeant une ou plusieurs billes métalliques
sur un plateau de jeu séparé par une vitre. Pour participer
à ce jeu, il faut préalablement introduire une pièce de
cent francs dans l'orifice de l'appareil. L'argent ainsi mis en jeu accorde au
joueur des jeux dont le nombre varie en fonction des tableaux. Ce jeu se
pratique seul et recommande beaucoup d'attention et de concentration. Dans ce
jeu, aucun geste maladroit ne peut être rattrapé. S. TURKE (1986
:61), disait à ce propos qu'« il suffit d'être inattentif
pendant une fraction de seconde pour être mis hors-jeu ». C'est
pourquoi le joueur de flipper reste toujours debout, il contrôle les
mouvements de la boule engagée en
35
agissant sur les manettes ; les points s'accumulent sur le
tableau placé en face de lui. Chaque tableau a un quota de points qu'il
faut atteindre pour remporter la partie. Le flipper est notamment
présent dans les bars, où certains individus en consommant de
l'alcool sont en quête de sensations et aiment se livrer à ce jeu
d'adresse.
Aussi, faut-il le rappeler, le flipper fonctionne dans la
même configuration que les jeux vidéo autrefois appelés
« taper-tapé ». Ces appareils géants, bien
qu'étant moins visibles aujourd'hui dans les boutiques et les salles de
jeux des quartiers populaires, nécessitent une pièce de cinquante
francs pour débuter une partie. Ayant la particularité de se
distinguer par leur dynamique compétitive, ces jeux illustrent les
schèmes de combats, d'aventures, de guerres ou d'arts martiaux. Ils
constituent un défi pour le joueur, qui doit faire usage de ses divers
talents pour surpasser un ou plusieurs adversaires. Pratiqués en groupe,
les jeux vidéo sont appréhendés comme des jeux d'argent
parce que non seulement le joueur paye son jeu auprès du croupier, mais
aussi, peut perdre lorsqu'il mise avec ses pairs dans le but d'évaluer
ses habiletés ou de stimuler l'enjeu.
En somme, il est important de rappeler que l'exploitation d'un
établissement de jeux dans le contexte camerounais, est
subordonnée à l'obtention d'un contrat de concession. Celui-ci
définit la nature des jeux autorisés et le fonctionnement dudit
établissement. Par ailleurs, l'importation des machines et tous les
autres matériels destinés à ces jeux doit être au
préalable soumis à l'approbation du Ministre du commerce sur
présentation du contrat de concession. Ainsi, le requérant, ses
principaux partenaires commerciaux et leurs ayants droits économiques
doivent disposer de moyens financiers suffisants, jouir d'une bonne
réputation et offrir la garantie d'une activité économique
irréprochable. En exploitant les jeux de façon licite, les
promoteurs doivent entre autres, veiller au respect des prescriptions du cahier
de charges attaché à leur contrat de concession, veiller à
l'application des standards et normes de sécurité, de confort et
de salubrité dans les établissements, s'astreindre de tout
blanchiment d'argent et de toute publicité outrageuse en matière
de jeux et loteries5.
Au détour de ces jeux d'argent légalisés
qui disposent de locaux, d'une image de marque de l'entreprise promotrice, d'un
règlement intérieur et des appareils de jeux homologués,
on observe paradoxalement un détournement de certains jeux de
société et de jeux traditionnels par les acteurs de la ville de
Yaoundé dans les secteurs urbains où ils se pratiquent,
d'où l'émergence des formes clandestines de jeux d'argent.
5 Cf. article 249 alinéas 1 de la loi
no 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal.
36
2. Les jeux d'argent clandestins
Les jeux d'argent clandestins sont compris comme l'ensemble de
pratiques ludiques qui incluent tous les jeux non règlementés
officiellement, ainsi que ceux qui échappent au contrôle et
à la fiscalité de l'État. Dans cette catégorie, se
range le « bonus Win », la Playstation, le bonneteau ou Three cards,
le Ludo, le Damier et le Songo pour ne citer que ceux-là.
2.1. Le « bonus Win »
Symboles des développements technologiques
récents, les « Bonus Win » sont des machines à sous ou
appareils électromagnétiques munis d'un orifice à
pièces d'argent, d'un cerveau purement électronique et d'un
tableau sur lequel apparaissent des images. En référence à
un champ essentiellement virtuel, ces jeux conçus sur le modèle
des loteries numériques s'apparentent beaucoup au poker. Ils
n'impliquent ni habiletés, ni capacités techniques et
stratégiques du joueur. Dans leur principe, le joueur introduit une
pièce de cent franc dans l'orifice de l'appareil, puis actionne les
manettes pour faire le choix d'un logo qu'il présume être
tiré au sort et valide son jeu. Le résultat apparaît du
même coup. Quand on gagne, la machine paye directement. Et en cas
d'échec, un voyant lumineux placé sur le tableau vous invite
à tenter de nouveau la chance. On peut observer ces jeux sur l'image
suivante :
Photographie 6 : Des pratiquants du « bonus
Win » à la devanture d'une boutique à Ékounou
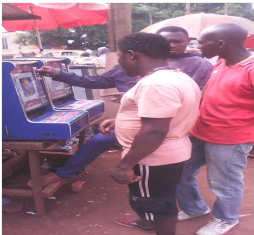
Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
37
Cette image mette en scène des joueurs qui introduisent
des pièces d'argent dans des machines à sous pour en multiplier.
Par le biais du conseil d'un pair, ils tentent la chance de remporter un gain
de douze mille francs, la somme maximale que cet appareil peut payer pour un
jeu.
Ces appareils rentrent dans la catégorie des jeux
d'argent clandestins, du fait que leurs modalités d'usages font preuve
d'une anomie et se confrontent aux résistances dans la fiscalité
de la part de leurs détenteurs. Les propos de l'enquêté F.
BILOKO, propriétaire d'une dizaine de ces appareils
électromagnétiques répartis dans les quartiers de la
ville, en disent davantage. Selon lui :
Avec ces appareils tu gagnes à 100 % ! Non
seulement ça ne prend pas de carburant, mais aussi, quand tu sais
jongler avec la mairie, même les taxes là tu ne payes pas (...)
c'est l'argent qui entre seulement.
En réalité, le fait que ces jeux soient
récents dans notre société pose le problème de leur
statut. La loi règlementant les jeux au Cameroun ne précise pas
la nature et les conditions d'exploitation pour cette catégorie
d'appareils, et même le code général des impôts
n'évoque aucune taxe imputable à ces jeux ; ce qui laisse libre
cours aux promoteurs d'en faire leur usage, et à certains agents
véreux des recettes et des finances d'en initier un « marché
noir ».
En outre, le fait que ce type de jeu ne se pratique qu'en
monnaie réelle pose un sérieux problème dans
l'économie urbaine. Parce que dans la ville de Yaoundé, les
pièces de monnaie en circulation se font de plus en plus rares. Puis
qu'elles servent d'instruments de jeu, les promoteurs de ces machines les
captent et les monopolisent pour en avoir suffisamment. Ce qui n'exclue donc
pas l'hypothèse selon laquelle ces pièces de monnaie sont
certainement stocker dans ces appareils, au moment où leur besoin se
fait ressentir par la population.
2.2. La Playstation
La « PlayStation » est une console de jeux
vidéo de cinquième génération. Elle se
présente sous la forme d'une machine miniaturisée, munie de deux
manettes et couplée à un écran téléviseur
qui met en scène des parties de football, d'aventures, de combats, etc.
À la base, ce jeu importé d'Europe a été
conçu pour le divertissement à domicile. C'est pour cette
38
raison qu'il n'est ni assujetti à une quelconque taxe,
ni soumis à une règlementation formelle. Cependant, certains
individus dans leur inventivité quotidienne, l'ont transformé en
jeu d'argent en le transportant dans des salles et autres lieux de
rassemblement pour en faire un marché. Pour y participer, il faut
s'acquitter d'une somme de cinquante francs auprès du gérant
appelé dans ces milieux « katika » et obtenir un temps de jeu
de cinq minutes. En réalité, les détenteurs de
Playstations ont compris que ces jeux étaient beaucoup
appréciés par les adolescents, en particulier les
élèves. Ainsi, hall, chambres à coucher et même
domiciles privés se trouvant aux alentours des établissements
scolaires sont transformés en salles de jeux. Ces jeux évoluent
dans la clandestinité, sous couvert d'un divertissement non lucratif.
Les élèves se rendent à ces endroits,
où ils passent des journées entières à miser entre
eux sur l'issue des parties. Boycottant les cours, ils investissent leur argent
de poche et de transport dans ces jeux, quand ils n'ont pas misé celui
destiné à la scolarité. Quelques fois, ils se voient
contraints de soutirer l'argent des parents pour s'investir dans ces jeux, de
vendre aux enchères leurs fournitures scolaires, d'hypothéquer
leurs chaussures, leur cartable ou tout autre objet de valeur quand ils sont
déjà ruinés. De ce fait, ils rentrent à la maison
à des heures tardives. C'est dire qu'au-delà du simple
divertissement, la Playstation est devenue instrument qui fait brasser beaucoup
d'argent et constitue un manque à gagner pour le fisc. Dans le
même temps, ce jeu s'affirme comme un facteur de la délinquance
juvénile à Yaoundé, au même titre que les jeux
d'argent les plus en vue comme le poker et les paris sportifs.
2.3. Le bonneteau ou « Three cards »
Bien qu'étant peu visible sur les trottoirs urbains
à Yaoundé, le bonneteau ou « three cards » est un jeu
d'argent, un véritable jeu de dupe de l'ordre de l'escroquerie
proposé à la sauvette dans les marchés et autres lieux
publics. Pour être pratiqué, ce jeu nécessite plusieurs
acteurs : un manipulateur ou maître du jeu, plusieurs larrons ou
complices, des badauds naïfs et joueurs. C'est un jeu qui évolue
sur l'éphémère ; rien ne semble l'inscrire dans la
durabilité au regard de l'organisation matérielle qu'il
nécessite : trois cartes (deux de couleurs noirs et une de couleur
rouge), ou encore trois boites d'allumette, dont l'une pleine et deux autres
vides, un banc ou un gros carton pouvant servir de table. Pour rythmer la
partie, le manipulateur répète à plusieurs reprises :
« Faites vos jeux ! Faites vos jeux ! Où est la reine ? », et
dans le même temps, il procède à plusieurs tours où
la carte recherchée est facilement suivie. Au cours ces simulations, les
complices misent et gagnent afin de mettre les badauds en confiance ; mais
dès lors que ces derniers payent leur mise, le maître du jeu
modifie la manipulation des cartes. Il ne laisse plus la carte de couleur rouge
s'échapper en
39
premier, mais celle de couleur noire ; ce qui semble alors
impossible à la victime. Cependant, il peut offrir quelques gains
faciles à la victime afin de la mettre en confiance pour qu'il parie
gros.
Formellement interdits à travers l'article 249
alinéas 1 du code pénal, les Three cards continuent de se
pratiquer clandestinement. On les voit nuitamment, lors des foires
promotionnelles comme « Promote » et « Ya-FE », ou encore
aux alentours du stade omnisport de Yaoundé et à
l'intérieur dans les gradins, pendant le déroulement des
rencontres sportives de football. Cette localisation périodique ne vise
qu'à échapper à vigilance des autorités
policières qui, en ces occasions-là, sont beaucoup plus
préoccupées par des questions de maintien de l'ordre public.
2.4. Les jeux de la société d'en bas
Les jeux de la société d'en bas,
réinventés sous le vocable « ndjambo », sont à
la base des jeux traditionnels qui ne sont généralement pas
régis par une réglementation formelle. Autrement dit, leur
pratique n'obéit qu'aux seuls principes préétablis par les
acteurs eux-mêmes. Ces jeux véhiculent une certaine dimension
culturelle en référence à un champ essentiellement
ludique. Dans la plupart des cas, ce sont des jeux intellectuels qui font appel
à la réflexion, à l'adresse et à l'observation
selon qu'ils nécessitent un support de cartes, de dés, de billes,
etc. En milieu urbain, ces jeux transcendent leur dimension de gratuité
pour s'ériger en des pratiques lucratives. En réalité, la
monétarisation de ces jeux par les adeptes eux-mêmes, leur donne
l'impression d'une certaine mobilité dans la mesure où au terme
d'une partie, le temps consacré au jeu devrait être
récompensé par d'éventuels gains. Ceci est d'autant plus
pertinent que l'on entend souvent dire à Yaoundé, que « le
temps c'est de l'argent ! ». Dans cette configuration, on s'imagine moins
participer à un jeu sans qu'il y ait un véritable enjeu
financier, l'argent apparaissant comme la principale motivation sans laquelle
jouer serait une perte de temps.
C'est ainsi qu'au Ludo, au Damier, aux Billes ou à la
Carte, le montant des mises est préalablement fixé par les
joueurs eux-mêmes. Selon qu'il s'agisse du plus chanceux, du plus malin
ou du plus habile, le vainqueur bénéficie d'une rançon qui
correspond à l'ensemble des mises des autres participants. Chaque joueur
est alors tenu de déclarer la somme d'argent dont il dispose avant de
s'engager, d'autant plus qu'il n'y a ni temps imparti au jeu, ni
désertion : c'est la loi « du tout ou rien ! »,
c'est-à-dire la ruine totale du joueur. Le jeu ne prend fin que lorsque
la totalité des participants a entièrement été
dépossédée au profit d'un gagnant.
40
En somme, il faut reconnaître que la typologie des jeux
d'argent présentée ici est loin d'épuiser la question
à ce niveau, car de nombreuses activités ludiques que nous
n'avons pas citées peuvent apparaître ubiquitaires, et peuvent
avoir en partage bon nombre de caractéristiques figurants dans une
catégorie distinguée. Il en existe même qui sont difficiles
à classifier de façon rigoureuse. Dans l'ensemble, qu'il s'agisse
des jeux d'argent légalisés ou des jeux clandestins, leur
pratique comporte d'importants risques sociaux, de santé, de
délinquance y compris de blanchiment d'argent. L'État camerounais
ayant pris conscience de cela, a légiféré afin que leur
pratique soit encadrée et garantisse une certaine cohérence (voir
annexe 6).
À présent, il est important d'infiltrer les
secteurs urbains dans lesquels se pratiquent les jeux d'argent afin d'en
extraire les informations sur ce qui est produit dans ces lieux.
II. LOCALISATION DES PRATIQUES DE JEUX D'ARGENT À
YAOUNDÉ : UNE VISIBILITÉ MANIFESTE ET STRATÉGIQUE
CONSTRUITE PAR LES
PROMOTEURS
Les jeux d'argent sont de plus en plus présents dans
notre société, où ils bénéficient d'une
large visibilité. Les invitations à y participer parviennent par
toute une série de canaux, entre autres les panneaux d'affichages, les
journaux, la radio, la télévision, internet, et parfois
même de façon non-sollicitée à travers les messages
des opérateurs de téléphonie mobile. Ainsi, deux types de
cadres intéressent la présente étude : un cadre clos,
c'est-à-dire un lieu aménagé pour l'activité qui
inclut les casinos, les Visio club et autres salles de jeux, et un cadre
ouvert, notamment la rue et les tripots que l'on appréhende sur les
espaces publics. Il convient donc de faire une description des usages dans ces
milieux, tant il est vrai que B. VALETTE (2011), soutient que la description ne
sert pas seulement à montrer le réel, mais aussi à
décrire le monde visible en livrant des informations sur l'espace
extérieur ou intérieur d'un lieu.
En observant la disposition des points de jeux dans la ville,
il va de soi qu'elle obéit d'abord à une logique mercantiliste
construite par leurs promoteurs (Voir images 2, 3 et 4). Cette disposition
outrepasse quelques fois la sensibilité de certains milieux environnants
ainsi que les risques d'attraction que peuvent exercer ces lieux à
l'endroit des populations. Parallèlement, le fait que certains types de
jeux comme la Carte et les dés soient pratiqués dans les
chantiers et maisons abandonnées, trahit une volonté des acteurs
d'entretenir un
41
certain mystère autour de la pratique de ces jeux dans
ces milieux. Car, en s'accordant avec P. SANSOT (1998 :38), « pour
distinguer sérieusement des lieux réels, ne faut-il pas d'abord
chercher ce qui les distinguent, se demander de quels prolongements oniriques
ils sont capables ? ». C'est dire en substance que les deux cadres
symboliques de la manifestation des pratiques ludiques identifiés,
inclinent à la recherche de quels « prolongements oniriques »
ils sont frappés.
1. Essai de description de la pratique des jeux d'argent
dans les espaces clos
Loin d'être neutre, le décor d'un lieu
destiné à la pratique des jeux d'argent est porteur de sens tant
au niveau individuel qu'au niveau social. Il se manifeste à travers le
comportement du joueur qui varie selon qu'il entre dans une salle de jeu ou
qu'il en ressorte. Les espaces clos sont en effet de véritables champs
de valeurs qui fondent une communion, un sentiment d'attachement essentiel qui
lient les individus autour de leur jeu, leur machine ou appareil. Ces espaces
sont en effet conçus de manière à susciter chez le joueur
l'envie de jouer et un état d'esprit de dépendance selon les
types de jeux pratiqués. Tel est le cas aux casinos que l'on retrouve
dans la plupart des grands hôtels de la ville de Yaoundé.
1.1. Le casino : propension à la dépendance
et stigmatisation du lieu
Si les casinos présents dans les hôtels de la
place sont réputés être des lieux réservés
à une certaine élite, c'est d'abord parce que leur localisation
est significative à plusieurs niveaux. Dans un sens, elle conforte le
citoyen ordinaire à l'idée que ce lieu est destiné aux
touristes, aux couches les plus nanties en quête de sensation et de
gains. D'autre part, en tant que structure incorporée dans un
Hôtel, le casino encouragerait la consommation dans un
établissement à vocation commerciale ; et donc forcément,
un tel lieu ne saurait être attractif pour les couches moyennes de la
population dans le contexte des villes africaines.
Ainsi, pour avoir travaillé comme croupier et donneur
de cartes au « Black Jack » dans les casinos du Nevada aux Etats
Unis, pour développer sa connaissance du monde du jeu, E. GOFFMAN
(1984), définit le casino comme un lieu de 1'action où chacun
peut tenter sa chance. Pour cet auteur, le terme « action »
sous-entend la prise d'un risque. Le jeu est donc une action, puisque le joueur
mise un enjeu et peut soit gagner soit tout perdre ; la perte correspond au
risque. En effet, le casino est un cadre construit pour faire rêver
l'individu et le transporter vers un monde coupé de la
réalité à partir du principe « d'isolement » et
de « conditionnement » qui le contraignent à une action que le
monde extérieur de la routine quotidienne lui interdit. Les portes sont
verrouillées, l'absence d'horloge et d'éclairage par la
42
lumière du jour. Bref, tout est mis en place pour
supprimer le moindre repère qui ramènerait le joueur vers la
réalité extérieure. Ce conditionnement lui fait perdre
conscience de toute réalité en dehors du jeu, pour l'enfoncer
dans une sorte de brouillard où le seul repère qu'il conserve est
le jeu.
Plus encore, du fait que l'argent soit remplacé par les
jetons au casino, le joueur accorde moins de valeur vénale
à cette monnaie ludique qu'il a propension à dilapider plus
rapidement, car il a moins tendance à voir qu'il perd. Dans une ambiance
rythmée par le caractère lumineux des machines sur lesquelles
s'affichent les jackpots, les mélodies triomphantes, assorties
du bruit des pièces qui tombent, le casino concrétise pour le
joueur perdant, la sensation d'être un gagnant. Si ce lieu offre au
joueur la possibilité de vivre et d'exprimer des réactions vives
telles que : joie et exultation face à un gain, tristesse après
une perte, impatience, anticipation, croyance que tout est possible et
ambivalence des joueurs qui passent toujours tout près de gagner, il est
évident qu'à tort, certains individus à Yaoundé,
pensent que les jeux au casino sont chers.
Les classes populaires stigmatisent en fait, les
dépenses dans un casino. Ceux-ci sont étiquetés de «
jeux VIP », donc réservés aux plus nantis, comme l'affirme
l'enquêté T. KEMTA, un agent d'entretien qui préfère
plutôt fréquenter les Visio club :
Je ne suis jamais entré dans les casinos luxueux
qui se trouvent dans les grands hôtels là, encore moins dans ceux
qui sont au carrefour intendance et à l'avenue Kennedy ! La raison est
que d'une part, il faut y aller avec beaucoup d'argent (vingt-cinq mille
francs) au minimum. Mais je n'aime pas surtout ces lieux parce que ce sont des
cercles de Feymens et d'escrocs. Il semble que tu peux jouer là-bas et
perdre même cinq cent mille, la seule motivation qu'on te donne c'est une
pauvre bouteille de whisky, qui coûte à peine dix mille francs
(...)
Il y a donc de la part des joueurs, un véritable
processus de labellisation et de stigmatisation qui singularise un certain type
de jeux de par les lieux où ils se pratiquent. Pourtant au casino, la
mise à la roulette commence à partir de cinq cents francs. Les
machines
43
à sous ont des mises de cent francs, nous confiait un
croupier rencontré au casino « Golden City ».
Par ailleurs, on peut aussi lire dans les propos de cet
enquêté, à l'image de bon nombre de joueurs, une certaine
naïveté dans le choix des milieux de fréquentations et de
pratiques de jeux d'argent. En effet, nul ne peut douter du fait
qu'aujourd'hui, les « bandits manchots »6 prolifèrent
même dans les quartiers les plus populaires. On retrouve parfois aux
commandes de ces « structures du pauvre », les mêmes promoteurs
qui opèrent dans les casinos pour les touristes fortunés.
À titre d'exemple, Michel Tomi, cet homme d'affaires Français qui
exploite les grands casinos et Fortune's club à Douala, est aussi
présent dans les PMU, qui sont vus comme des jeux pour les couches
modestes de la population. Dans le même ordre d'idées, le groupe
« Feutheu » fait le chemin inverse. Il s'est enrichi à travers
les salles de jeux populaires, et se lance maintenant dans l'hôtellerie
et les casinos de luxe, dans les villes de Yaoundé et Douala.
Excepté les casinos, les jeux d'argent se pratiquent aussi
dans les bars.
1.2. Les jeux d'argent dans les bars
À Yaoundé, les bars, les cafés et les
bistrots ne sont pas des lieux réservés à la seule
consommation de boissons. La consommation des jeux est aussi légion. Le
plus souvent, ces lieux disposent d'antichambres abritant des appareils de jeux
et machines à sous de tout genre. Pour ceux qui se retrouvent dans ces
endroits, les pratiques de poker, de billard, de flipper, de bonus Win, de la
roulette, etc., sont monnaie courante. À l'intérieur de ces
salles, on rencontre des croupiers communément appelés «
katikas », reconnaissables par leur sac de pièces en
bandoulière. Ils ont pour mission d'échanger les billets en
pièces de monnaie appelées « kobo ». Ce sont de
véritables « arbitres », toujours disponibles à
conseiller le meilleur tableau au joueur. S'ils sont eux-mêmes les
premiers joueurs, leurs gains et leurs pertes ne sont orientés que vers
l'attrait d'autres joueurs.
Seulement, pour ces individus qui pensent avoir trouvé
un créneau lucratif au bar, on gagne rarement et même presque
jamais ; ce qui n'empêche pour autant pas, les accrocs de l'argent
facilement gagné de jouer de plus bel au point parfois de perdre
l'intégralité d'un salaire durement gagné. Et même,
lorsque par occasion, il arrive à un joueur de gagner une
6 Expression employée au sens figuré
dans les milieux de jeux d'argent comme les casinos et salles de jeux pour
désigner soit les machines, soit les promoteurs, parce que face à
ces jeux, on a plus de chance d'être dépouillé que de faire
fortune.
44
« Royal flush » à quatre cent mille francs au
poker, celui-ci à la demande du croupier, devra passer
ultérieurement pour rentrer en possession de son dû. C'est une
stratégie malicieuse qui vise à amener le joueur à
reconvertir cette dette dans le jeu, étant donné que les bars
réunissent d'importants facteurs gagnants pour la dépendance tels
que : l'environnement festif, l'accessibilité des machines et la
consommation d'alcool qui favorisent en quelque sorte une plus grande
régularité au jeu chez les pratiquants.
1.3. Les jeux d'argent dans les salles
Au moment où l'on assiste à une décrue du
cinéma dans la ville de Yaoundé, on observe paradoxalement un
essor relatif des salles de jeux et des Visio club dans les quartiers
populaires S.P AWONDO (2006 :51). À travers le « cinéma
» qu'elles projettent, ces structures deviennent pour ainsi dire, un outil
au service du besoin de satisfaction des imaginaires dans la
société. Dans ces lieux, la recherche du gain et l'idée de
se refaire financièrement suite aux pertes justifient en quelques sortes
la présence des joueurs. En réalité, les Visio club sont
à la fois des salles de visualisation d'évènements
sportifs et des salles de jeux de pronostics (paris sportifs, loteries
numériques etc.). Dans ces enceintes, les paris sont pratiqués de
façon différée et de façon directe. Les paris en
différé sont des jeux où les parieurs pronostiquent avant
le début d'un évènement. Une fois commencé, les
paris en différé en ligne d'un même évènement
disparaissent instantanément des sites des « bookmakers »,
pour laisser place aux paris en direct.
Dans ce jeu, les « cotes » présentées
ont la particularité d'évoluer de manière incessante, en
réaction aux évènements qui se produisent pendant la
rencontre. Ce sont des jeux « short odd » qui ne nécessitent
qu'un lapse de temps entre le dépôt de la mise et l'obtention du
résultat. C'est ainsi qu'au Visio club, les parieurs se montrent souvent
très attentifs à l'évolution des évènements
qui s'affichent continuellement sur les écrans. Ces
évènements qui s'altèrent toutes les trois minutes, ont la
particularité de faire varier le comportement du joueur d'un pari
à un autre. Celui-ci commence par développer « une intention
» de jouer, puis élabore une « stratégie » de jeu
avant de passer à « l'action » : la validation des pronostics
proprement dite. Ce cheminement permet d'observer qu'au cours d'un jeu le
parieur expérimente plusieurs sensations dans un intervalle de temps
court, qui le tiennent en haleine. Ce sont généralement les
émotions, le suspense, l'incertitude, la peur et l'espérance. Ce
comportement des joueurs en salle peut être perçu sur l'image
suivante :
45
Photographie 7 : L'environnement et l'attitude
des parieurs en salle

Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
Sur cette image, on peut voir des jeunes figés sur des
écrans de téléviseurs placés en face d'eux. Ils
sont imperturbables, hors de tout contact avec l'extérieur. Une
concentration qui est perçue comme la censure d'un investissement
consenti, et dont on attend un retour sur investissement.
Par ailleurs, l'appréhension des salles de jeux
diffère selon qu'on est pratiquant du jeu ou croupier. Les joueurs s'y
rendent généralement pour se distraire et bien sûr pour
gagner de l'argent : ils sont dans leur monde du divertissement, hors de la
réalité quotidienne. Tandis que les croupiers y sont pour faire
gagner l'entreprise, ils sont dans leur monde du travail, dans leur
réalité quotidienne. Leurs visions du lieu semblent donc
opposées, voire incompatibles ; d'où l'acharnement
mêlé à quelques violences souvent observés entre
parieurs et croupiers au prétexte d'un « mauvais remboursement
», d'une erreur de saisie lors de la validation d'un pronostic, ou lorsque
le système de retransmission des évènements connait des
perturbations sur le réseau. Ce dernier aspect s'illustre à
travers l'écran placé à gauche de l'image ; qui est
momentanément crypté.
En général, les Visio club sont habilités
à établir des connexions entre les jeux à
l'intérieur de l'établissement et les tripots de rues.
46
2. Présentation du phénomène des jeux
d'argent sur l'espace public
La dimension urbaine et sociale d'une ville prend lieu dans
les espaces publics qui, dans leur diversité s'expriment au nom de
l'urbanité. Du fait de sa proximité avec les acteurs sociaux, la
rue à travers les kiosques à jeux qui longent les artères,
les carrefours et les marchés, à travers les regroupements
populaires de joueurs dans les cases abandonnées, les salons de
coiffures et autres lieux publics se déclinent dans une certaine mesure,
comme le cadre par excellence d'expression et de production de la vie
quotidienne. Elle peut être un objet essentiel et digne
d'intérêt à l'étude des pratiques du quotidien dans
le sens où elle favorise une lecture de la société ;
notamment de l'univers des jeux d'argent qui la compose dans sa sphère
urbaine. Selon H. BLOCH et ALT (2002 :62), la rue est un « large
espace de vie et d'activités caractérisée par la
débrouille, la misère, la violence, le danger et l'anonymat
».
Mettre en évidence cet univers singulier de l'existence
sociale, c'est donc explorer avec P. MBOUOMBOUO (2005), ce « trottoir
social » qui tient lieu de cadre par excellence de la manifestation des
pratiques ludiques, à partir d'une observation qui vise à
« faire venir au grand jour ce qui existe déjà, ce que
nos habitudes de penser nous empêchent de voir, et qui pourtant est
largement vécu dans la vie courante » M. MAFFESOLT (1998 :16).
Dans ce sens, les kiosques à PMU, les pleins airs, les cases
abandonnées où se retrouvent souvent les adeptes du «
ndjambo » représentent un support de recherche pertinent à
la conquête des faits sociaux tels que les pratiques ludiques
étudiées dans ce travail.
2.1. Les jeux d'argent dans les tripots de rues.
À Yaoundé, les secteurs urbains où se
retrouvent les joueurs d'argent sont à priori des lieux de
convivialité et de socialité où s'expriment et
s'expérimentent des liens de solidarité interpersonnelles et
collectives partagées entre acteurs sociaux autour d'un idéal
commun : « tenter sa chance ». Dans ces lieux, on se côtoie
plus facilement et sans vice de civilités, on s'adresse la parole, on
engage des causeries où les échanges sont essentiellement
centrés sur l'actualité des matchs de football, des derniers
numéros tirés à la loterie, sur les probabilités de
réussite d'un évènement ou sur le montant des mises dans
certains jeux. C'est ainsi qu'on a pu relever que ces acteurs essayent de
s'approprier autant que faire se peut, des moyens d'expressions accessibles et
propres à ces milieux. De leurs échanges, émergent des
thermes comme « ndjambo », « katikas », « tatami
», « mises », « tocards », « favoris »,
« cotes », « bookmaker », etc.
47
Ces codes linguistiques s'accompagnent souvent d'une langue de
jeu dans la communication, où sont poncées des phrases comme
celles-ci : « Gars tu vois la malchance, je viens de lost 150 kolos
à cause de United ! » ; « C'est show sur moi ! Le libanais
doit me donner quelque chose aujourd'hui, parce que le nguémé
veut ma mort... » ; « Les gars je suis là pour vous ! Celui
qui est chaud came take les hights combinaisons... ». Voilà en
quelques sortes le genre de discours qui est donné partout où se
retrouvent les individus autour des kiosques à jeux dans la ville de
Yaoundé. En devenant un outil de communication dans les milieux de jeux,
le camfranglais tend donc à être considéré
comme une illustration de plus en plus évidente de la culture des jeunes
dans ces milieux. Pourrait-on dire avec J.M ELA (1994 :27), qu' « ils
se donnent leur vocabulaire et leur grammaire pour produire du sens »
à leurs pratiques ludiques.
Au-delà de ces discours, il apparaît que les
lieux où se pratiquent ces jeux constituent aussi de véritables
enjeux dans la quête de promotion financière pour toutes les
catégories d'acteurs qui sont présents. Les images qui vont
suivre présentent une esquisse de localisation des jeux d'argent dans
les espaces ouverts de la ville de Yaoundé :
Photographie 8 : Kiosques à PMU à
proximité d'un établissement scolaire

Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
La présence de ces kiosques à jeux d'argent
longeant la clôture d'un établissement d'enseignement secondaire
n'est pas fortuite. Cette zone est très fréquentée par les
élèves, les étudiants, les agents des forces de l'ordre et
commerçants de tout genre. Les promoteurs de ces jeux voient en cela une
aubaine économique aux dépens des conséquences sociales
qu'elle pourrait engendrer.
48
I. NANA, âgé de 17 ans est élève en
classe de quatrième année d'électricité
d'équipement au collège d'enseignement technique industriel et
commercial de Ngoa-Ekelle. Cet élève que nous avons
appréhendé aux alentours de ce kiosque a accepté de
participer à l'enquête. Il disait s'intéresser aux PMU
parce que :
Le plus important dans la vie n'est pas toujours d'avoir
fait trop d'études. Tu peux avoir de gros diplômes mais sans
argent, tu n'es rien. La preuve est là ! On voit les étudiants de
l'université, ceux de l'école normale et même certains
hommes en tenue qu'on admire pourtant en train de jouer ici tous les
jours.
La proximité d'une structure de jeu à un
établissement scolaire présente donc le risque d'influencer les
jeunes à se lancer dans cette activité, avec toutes les
déviances qu'elle comporte. Illustration en date du 24 février
2017, où une vague d'arrestations a été
opérée dans ce même établissement scolaire par les
éléments du commissariat du cinquième arrondissement.
D'après les médias nationaux et les témoignages de
certains élèves approchés par nous, il s'avère
qu'une quinzaine d'élèves interpelés, ont
été surpris en train de jouer des dés au sein de
l'établissement. L'un d'entre eux, en possession de vingt-trois paquets
de drogue, a été transféré au tribunal de
première instance, puis déféré à la prison
centrale de Yaoundé le lendemain.
Les images qui vont suivre présentent une autre facette
de la manifestation de ces jeux dans certains secteurs urbains de la ville de
Yaoundé.
49
Photographie 9 : Une partie de «
ndjambo-Ludo » Photographie 10 : Une partie de «
ndjambo-
à la devanture d'un dépôt de boissons
à Melen Songo » dans un dépôt de bois à
Ékié

Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain). Source : Badel
ESSALA, (enquête de terrain).
Les images précédentes mettent en scène
des adultes qui misent des sommes d'argent en pratiquant de part et d'autre, le
Ludo et le Songo, déguisés en de simples jeux de
société dans différents lieux public. Ici, les joueurs se
recrutent parmi les commerçants eux-mêmes, les clients des bars
environnants et d'autres curieux adeptes de ces jeux. Certains personnages
debout font office de « katikas », donc tiennent les mises des
participants et récompensent les gagnants. Dans ces jeux se mêlent
entre autres la ruse, la malice, la tricherie, la raillerie et bien
évidemment la dépossession du joueur. Parce que n'étant
pas limités dans le temps, le Ludo, le Songo ou même la
Carte, ont la particularité de captiver toute l'attention de ceux qui
s'y adonnent, au point parfois d'oublier l'essentiel à savoir leur
travail, quand ils n'ont pas misé l'argent impartit à leur fonds
de commerce.
En somme, il faut noter que le secteur des jeux d'argent
à Yaoundé, est gangrené par de nombreux maux ; dont le
choix de la clandestinité de quelques opérateurs ainsi que la
mercantilisation observée dans les pratiques ludiques les plus banales
dans les secteurs urbains. À ceux-là viennent s'ajouter
l'implantation inappropriée des points de jeux sur les espaces publics,
ou encore le non-respect de l'interdiction des jeux aux mineurs et aux agents
des forces de maintien de l'ordre en uniforme. Comment comprendre en effet le
mutisme des pouvoirs publics face à la présence de certains
points de jeux longeant les clôtures des
50
établissements secondaires et universitaires au
quartier Ngoa-Ekelle ? Des kiosques à PMU implantés à
proximité des bâtiments abritant les administrations publiques et
militaires dans la ville, ou encore des lieux de culte et le centre de
détention à Yaoundé ?
En réalité au Cameroun, nombreux sont les textes
règlementant l'ouverture et la fréquentation des salles de jeux
qui sont passés inaperçus. À titre d'exemple, l'article 50
de la loi no 92/050/PM du 17 février 1992 qui fixe les
modalités de fréquentation des salles de jeux est passé
sous silence. Il en est de même de la décision no
58/CAB/DPAV/SCC du 18 octobre 1995 portant interdiction d'exploitation
cinématographique en Visio club, restée inappliquée.
Disons plutôt que l'implantation quasi anarchique des tripots de rues et
salles de jeux, ainsi que leur fréquentation populaire dans les
quartiers échappe même aux autorités publiques. Celles-ci
ne semblent s'occuper que de la « récolte » des droits de
fiscalités imputables à ses structures. C'est ainsi qu'il faut
peut-être interpréter cette « liberté
buissonnière des pratiques » chère à M. De
CERTEAU (1990 :14), dans la prolifération des jeux d'argent à
Yaoundé.
Des cas similaires sont observés dans ce qu'on qualifie
ici d'officialisation de la clandestinité de certains jeux par les
autorités communales et policières. Le fait que certaines taxes
soient prélevées de façon informelle par des agents
véreux des impôts et des mairies auprès de certaines
structures de jeux entraine un manque à gagner dans le trésor
public, nous confiait le responsable en la matière à la commune
d'arrondissement de Yaoundé quatrième. De même, l'on
observe que de plus en plus, les agents des forces de maintien de l'ordre
sensés réguler ce secteur d'activité, côtoient au
même titre que la population, ces milieux de jeux à la recherche
du bonheur. Ils y vivent les mêmes émotions et du coup, se font
complices et acteurs d'épiphénomènes tels que :
alcoolisme, trafic de drogue, violence et agression qui accompagnent souvent de
la pratique de ces jeux.
À présent, il est question de
s'intéresser aux différents acteurs sociaux des jeux d'argent
dans la ville de Yaoundé et au sens qu'ils attribuent à cette
pratique. En effet, le rapport des yaoundéens aux jeux d'argent
montre que ce phénomène n'est pas figé, mais plutôt,
qu'il est socialement marqué et largement tributaire de
représentations et de perceptions que les citadins développent
sur ce fait. Pour se faire, deux questionnements émergent : qui sont les
protagonistes des jeux d'argent dans la ville de Yaoundé ? Quels sens
attribuent-ils à cette activité ? La réponse à ces
questions appelle à une analyse sociologique
51
des faits explicatifs et à la signification sociale que
chacun de ces acteurs attribuent aux jeux d'argent.
III. PERCEPTIONS ET STRATÉGIES D'ACTIONS
MERCANTILISTES DES ACTEURS À TRAVERS L'ARÈNE DU JEU
À l'entame de cette partie, il est judicieux de
présenter les différents acteurs sociaux du jeu avant de
définir par la suite, les logiques qu'ils attribuent à ces
pratiques. De ce fait, les protagonistes des jeux d'argent dans la ville de
Yaoundé, se déclinent sous trois registres parmi lesquels on
distingue : l'acteur institutionnel qu'est l'État, donc les pouvoirs
publics. Celui-ci, dans son principe, a la responsabilité de
définir la politique du jeu et les mesures d'encadrement de ces
activités. Il agit alors en infléchissant sur les
décisions prises en fonction de ses propres avantages, des
intérêts des promoteurs et ceux des bénéficiaires
(les joueurs). Le deuxième registre est celui des détenteurs de
structures. Pour ceux-ci, les jeux d'argent constituent une entreprise comme
toute autre, elle doit être rentable c'est la raison pour laquelle les
promoteurs de jeux mettent en oeuvre des stratégies managériales
pour attirer la clientèle et maximiser leur profit. Enfin, le
troisième registre implique les joueurs, pour qui le jeu d'argent est
d'abord une activité ludique qui passionne, mieux encore un loisir,
facteur d'enjeux économiques importants.
Quant au concept de logique, il renvoie aux formes de
rationalités, de représentations ou de perceptions que les
acteurs se font des pratiques ludiques qui sont légion dans notre
société. La logique du jeu s'apparente ici à une
réalité mouvante, effervescente et dynamique. Il s'agit
par-là, de comprendre une pensée sociale en mouvement, produisant
un contenu cognitif et menant à des comportements et à des
actions de la part des acteurs vis-à-vis de ces jeux. La logique entre
donc en droite ligne avec les manières d'interpréter et de penser
la réalité quotidienne à partir du jeu, dans un contexte
où prédominent certains aspects économiques sur les
aspects culturels.
1. L'acteur institutionnel : les pouvoirs publics et la
politique du jeu
Si les pouvoirs publics constituent l'outil de contrôle
et de promotion du jeu, c'est d'abord parce qu'ils sont l'un des garants de la
moralité publique et ils doivent parallèlement jouer un
rôle déterminant de par leurs qualités de
législateur et de percepteur dans l'épanouissement
économique des industriels du jeu. À ce titre, au Cameroun, les
jeux d'argent sont régulés au niveau central par le MINATD, le
MINFI et le MINTOUL. À
52
l'échelle des collectivités, ce sont
respectivement les services du gouverneur, du préfet et des communes
d'arrondissements qui sont assujettis à ce rôle. Dans ce contexte,
de nombreux acteurs s'interrogent sur la responsabilité de l'État
dont l'implication dans ces jeux laisse entrevoir des zones d'ombres au regard
de l'ambigüité du rôle qu'il est tenu de jouer dans ce
système. En effet, d'après les informations collectées
auprès du chef de service de l'aménagement des parcs du MINTOUL
:
Le ministère est chargé d'organiser et de
coordonner les jeux de diversement à but non lucratifs (...) À
l'instar du championnat national de Damme et de scrabble organisé chaque
année, nous sommes disposés à soutenir toutes autres
initiatives allant dans le sens de la promotion des activités ludiques
culturelles et traditionnelles sur toute l'étendue du territoire
national. Car, ces jeux sont aussi destinés à promouvoir
l'activité touristique dans notre pays.
À en croire ces propos, un contraste émerge
quand on sait combien même ces jeux dit de divertissement ont depuis
longtemps transcendé leur dimension de gratuité pour
s'ériger en des jeux d'argent pour les citadins des quartiers
populaires. En réalité, nul ne peut douter du fait que le secteur
des jeux constitue aujourd'hui une industrie bien organisée. Elle est
tellement florissante qu'il serait maladroit de continuer à la classer
dans la catégorie des loisirs improductifs. Le rôle du loisir,
avec ce que certains nomment « les industries culturelles »
J.P WARNIER (1999 :88), est devenu déterminant dans la question
économique ; la preuve en est que nos trottoirs, nos rues et
marchés sont inondés de gadgets, d'effigies et d'autres appareils
électroniques de jeux d'argent. De même, les reformes en cours
dans la législation en matière de jeux et loteries viennent
confirmer s'il en était encore besoin, la dimension économique
considérable à ces jeux.
C'est dire qu'économiquement parlant, la politique du
jeu mis en place par les pouvoirs publics a toujours progressé au fur et
à mesure que les institutions ont voulu en tirer profit. T. JEFFERSON
disait des jeux d'argent qu'ils étaient « a wonderful thing »,
c'est-à-dire une chose merveilleuse ou « un impôt indolore
» qu'il comparait à une taxe payée
53
selon l'envie de chacun et sans aucune obligation, parce
qu'ils rapportent de l'argent à l'État. Un argent que les
citoyens sont contents de dépenser, puis qu'ils le font en s'amusant T.
CLOTFELTER (1989). Ces formes de jeux seraient alors un moyen
déguisé pour le gouvernement de gagner de l'argent même
quand il serait impossible de créer un nouvel impôt. Cela
présage que ces jeux représentent une source potentielle de
revenus financiers importants pour les pouvoirs publics.
Dans cette veine, le code général des
impôts camerounais définit les modalités de contribution du
secteur des jeux d'argent et de divertissement à l'économie. Dans
son article 207, cette loi assujettie à la taxe toute personne physique
ou morale qui exploite sur le territoire national à titre principal ou
accessoire les jeux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont
fondés sur l'espérance d'un gain en nature ou en argent,
susceptibles d'être acquis par la voie du sort ou d'une autre
façon. Il en est de même pour ceux qui sont destinés
à procurer un simple divertissement. Ceci étant, chaque
opérateur devra verser au compte du trésor public le montant
inscrit dans son cahier de charge. Quant aux dispositions spécifiques
relatives aux jeux de divertissement et aux machines à sous
placés sous le contrôle des communes d'arrondissement, l'article
217 de la même loi fixe la liquidation de la taxe, quel que soit le
régime d'imposition de la manière suivante :
a) Première catégorie : baby-foot, vingt mille
francs par appareil et par an.
b) Deuxième catégorie : flipper et jeux
vidéo, quarante mille francs par appareil et par an.
c) Troisième catégorie : machines à sous,
cent mille francs par machine et par an.
Tous ces montants sont majorés de 10 % au titre des
centimes perçus au profit de la commune du lieu d'exploitation. De toute
évidence, il est établi que le secteur des jeux d'argent est
« porteur » et que les revenus générés, au lieu
d'être laissés à la portée de n'importe quel
individu ou groupe dans une économie, sont captés par les
pouvoirs publics pour servir à certains droits de la population à
travers la politique de l'action sociale inscrite dans le cahier de charge des
détenteurs de structures de jeux.
Outre les bénéfices économiques
prélevés sous forme de taxe, la stratégie de l'État
vise aussi à appréhender les retombées sociales du jeu
sous forme de sponsoring saupoudré dans des opérations
très diverses : manifestations culturelles, sportives et humanitaires
ainsi que le soutien économique de certains secteurs d'activités
comme l'imprimerie, la presse, l'audiovisuel etc. Aussi, les nombreuses
personnes employées dans ce secteur représentent
déjà un groupe d'intérêt pour le gouvernement dans
sa politique de lutte contre le chômage en
54
milieu urbain. C'est du moins ce que nous enseignent les
propos de monsieur A. MBA MBA, chef de service des jeux au MINATD, lors de
l'entretien réalisé en novembre 2016 qui affirme que :
La politique d'emploi est inscrite dans le cahier de
charge des opérateurs de jeux à travers ce qu'on appelle l'action
sociale. À cet effet, le gouvernement s'attèle à ce que
ces emplois ne soient pas que de simples tremplins. Les inspecteurs du travail
sont là pour s'assurer que tous les employés dans ce secteur
bénéficient de garanties sociales en les affiliant à la
CNPS.
Des éclaircis qui semblent aller en harmonie avec ceux
de madame S. NOUADE, agent commerciale au PMUC qui en toute
sérénité déclare :
Je travaille dans cette société (PMUC)
depuis bientôt 9 ans ! Voyez-vous, je sors chaque matin et j'ai un
salaire chaque fin de mois hormis mes petits avantages de service (...) Je ne
me plains pas en tout cas, d'autant plus que mon activité me permet
d'épauler financièrement mon mari dans certaines charges
ménagères.
Eu égard à cette affirmation, on peut dire que
le secteur des jeux d'argent à travers certaines entreprises est
pourvoyeur d'emplois au Cameroun.
Sur le plan politique, depuis la défunte LONACAM, une
société de jeux d'argent prônée par l'État
camerounais dans les années 1970, l'État a cédé son
monopole d'organisateur du jeu aux sociétés privées en vue
de tenir son rôle de régulateur dans ce secteur. Les
sociétés privées ont eu dès lors la latitude
d'organiser ou d'exploiter les activités relatives aux jeux d'argent.
Ces entreprises ne sont autres que des partenaires de l'État et souvent
autonomes dans leur fonctionnement, bien qu'étant toujours au service
des citoyens. Comme conditions essentielles pour le fonctionnement harmonieux
de cette activité sur le
55
territoire national, le MINATD, autorité de tutelle,
est alors chargé sur le plan politique de traiter chaque année le
nombre de demandes d'agrément d'établissements de jeux, le nombre
d'établissements de jeux agréés et le nombre
d'établissements de jeux contrôlés. Ces mesures impliquent
les normes pour la transparence dans le traitement des jeux, le paiement rapide
des gains, la recherche permanente et le maintien de la confiance entre les
joueurs7.
2. Les promoteurs de structures de jeux et la
stratégie de l'action sociale
Dans un jeu qui mobilise plus d'un participant, il y a
forcément un ou plusieurs gagnants et des perdants. Pour ce qui est des
jeux d'argent promus par les structures normatives, l'organisateur du jeu peut
être considéré comme un participant à part
entière ; le joueur joue contre lui : c'est le principe du jeu
commercial opposé au jeu social. Voués à produire des
bénéfices à l'entreprise, les jeux d'argent sont
élaborés de façon qu'à long terme, les pertes des
joueurs surpassent leurs gains. Ce qui revient à dire de façon
rationnelle que les joueurs devraient être amenés à
éviter ce type de jeux, puisqu'en moyenne, ils perdront de l'argent R.
LADOUCEUR et al (2000).
D'un regard avisé, les sociétés de jeux
d'argent au Cameroun sont peu perçues comme des entreprises soumises aux
mêmes règles de gestion que les entreprises ordinaires pour
être performantes. Au contraire, on les appréhende comme des
entreprises mécènes et non assujetties à des principes
orthodoxes de gestion dont le but premier est la recherche des
bénéfices et des performances toujours plus croissantes. Cette
logique capitaliste tient compte de la nécessité d'introduire
l'action sociale, une « politique d'entraide » ou d'assistance par
les sociétés de jeux dans leurs activités. L'action
sociale en relation avec les entreprises de jeux d'argent a trait à une
politique de solidarité menée à l'externe. Elle est
à distinguer des actions sociales collectives menées dans le
cadre d'un mouvement social, de celles mises en oeuvre par certaines personnes
ou organisations dont ce n'est pas le rôle premier. Cette
stratégie d'action sociale qui se décline en la redistribution de
gains fortement médiatisés, en du sponsoring
d'évènements, des parrainages, des dons et oeuvres sociales n'est
pas souvent désintéressée ; elle vise à accroitre
la performance et l'image de marque des sociétés de jeux.
À titre illustratif, « Cameroon Tribune »
dans sa parution no 11009/7208-41e année du 11
janvier 2016, dans les pages 24 et 25, consacre un publireportage
intitulé « la carte citoyenne du PMUC en 2015 ». Le journal
évoque entre autres, le sponsoring du grand prix
7 Cf. Schéma directeur des services centraux du
MINATD, cadre de référence statistique (2013-2017), p.10.
56
cycliste Chantal Biya, la remise d'une somme de quarante-cinq
millions de francs au MINATD, en guise de l'effort de guerre le 22 Mai à
Yaoundé. Le 14 juillet de la même année, l'entreprise a
offert des denrées alimentaires à hauteur d'un million cinq cent
mille francs à l'Institut camerounais de l'enfance à Maroua.
À partir de cette présentation, on peut se demander quel est le
rôle des entreprises de jeux d'argent dans la lutte contre la
pauvreté. L'entreprise cherchant en permanence la rentabilité et
le profit, peut-elle développer des actions économiques sans
réel gain de rentabilité ?
Il s'agit en effet, d'appuyer les bonnes causes pour
influencer les décisions d'achat. Autrement dit, d'asseoir un rôle
social pour s'attirer la sympathie de la population, entretenir la
clientèle et d'attirer de nouveaux clients afin de mieux vendre ses
produits. Bref, de mener une communication sociale qui permet de rassurer les
clients, les pouvoirs publics, les partenaires, le personnel et d'avoir un
retour sur investissement. Cette vitrine du jeu renvoyant une image positive
à l'opinion publique est d'autant plus nécessaire que le PMUC est
au coeur du juteux marché des jeux d'argent quand même il fait
l'objet de multiples dénonciations, notamment de l'adaptation du
régime fiscal, de l'opacité des règles juridiques
réglementant ces jeux à l'ambiguïté des relations
avec les représentants du pouvoir. Ainsi, le régime fiscal «
sur-mesure » des industriels du jeu est pour le juriste M. KAMTO,
cité par X DURANG (2003 :392), « des veines ouvertes d'une
économie exsangue qui giclent loin outre-mer ce qui reste de nos CFA
». Une observation qui met en lumière une autre
réalité plus souterraine des enjeux financiers autour des jeux
d'argent promues par les entreprises privées dans notre
société (voir appendice).
3. Les joueurs et la logique d'un « loisir lucratif
»
La pratique des jeux d'argent par les acteurs sociaux de la
ville de Yaoundé serait sous-tendue par le fait que ces jeux
véhiculent un sentiment de passion pour les PMU, et que par ailleurs,
ils représentent un espoir de gagner de l'argent. Y. CHANTAL et al.
(1994), sont les premiers chercheurs à avoir élaboré
une structure théorique pour représenter l'ensemble des
motivations qui poussent les êtres humains à s'adonner à un
jeu d'argent. De leurs analyses, il ressort que les émotions fortes,
l'argent, les rencontres sociales et la fuite devant des conditions de vie
difficiles figurent parmi les mobiles les plus fréquemment
évoqués. Ainsi que l'affirme S.P. AWONDO (2006 :66),
57
Les paris sur les courses de chevaux tout comme le Loto
constitue un semi loisir porteur de sens, dans la mesure où les acteurs
s'y appliquent avec une charge symbolique considérable, qui se lit dans
la volonté de faire des profits et ainsi sortir de la
précarité.
Cet aspect de la chose peut être vu dans une
répartition des personnes enquêtées, qui pour des
prétextes bien que divers, misent dans les jeux avec en fond de toile la
quête de rentabilité de gain.
Figure 1 : Les différentes perceptions du
jeu selon les enquêtés
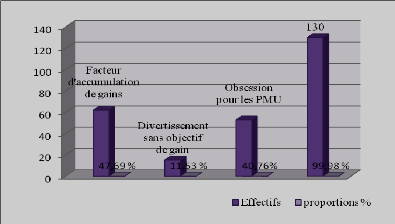
Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
Les données consignées dans cette figure mettent
en évidence les faits suivants : 47.69 % de joueurs avouent participer
à différents jeux pour un intérêt pécuniaire
grandissant. Le jeu représente pour eux un moyen de lutte contre la
pauvreté économique, tel qu'un argent gagné leur permettra
de se sentir reconnu, d'améliorer l'estime d'eux-mêmes ou encore
de s'offrir un luxe. À côté de ceux-ci, 11.53 %
d'enquêtés associent leurs pratiques ludiques à un loisir,
un divertissement sans objectif de gain. Mieux encore, les jeux d'argent
représentent pour eux un passe-temps qui s'exprime et
s'expérimente dans les lieux où ils se pratiquent. En effet, si
certains considèrent le jeu comme un mécanisme financier, il ne
faut pas non plus
58
sous-estimer son caractère culturel, qui se transmet
entre les membres d'une même famille ou d'une société
à travers ces jeux.
En revanche, une proportion de 40.76 % de joueurs attribue
leurs pratiques ludiques à une obsession qu'ils associent dans leur
majorité, aux paris mutuels et sportifs. Cette supposée obsession
en elle-même trahit une certaine hypocrisie des enquêtés qui
se manifeste par une volonté de cacher leurs motivations vénales
à ces jeux. Ce fait est d'autant plus compréhensible, quand on
connait les conséquences malheureuses occasionnées par ces jeux
dans la vie de certains joueurs, du fait d'avoir hypothéqué tout
ou une bonne partie de leurs économies. À cela, vient s'ajouter
leur obstination à se refaire dans un jeu ou les gains sont rares.
C'est dire ici que, l'association entre la fonction ludique du
jeu et sa dimension économique voit émerger la place qu'occupe
l'argent bien au-delà du jeu, mais davantage dans la vie quotidienne. En
réalité, en plus de sa fonction monétaire, il est possible
de lui attribuer une fonction symbolique, car, autant il permet aux individus
de réaliser leurs désirs, que sa possession passe pour un signe
de prestige. L'argent est aussi un facteur de libération du fait qu'en
sa possession, l'homme peut s'acheter ce qu'il souhaite, satisfaire ses besoins
et peut se sentir épanoui au sens d'A. DE LA HOUGUE (2002). Il permet
donc aux individus de mettre en avant un écran constitué de
signes extérieurs de richesses pour entretenir de l'aisance et de la
réussite. Mais une fois investi dans un jeu, l'argent apparaît
comme un « renouveau urbain » même si le concept se
réfère d'abord à la notion d'urbanisme, il ne saurait
cependant ignorer la réinvention de la vie sociale dans les pratiques
ludiques quotidiennes des acteurs sociaux chez qui, il se dégage deux
principales tendances : il y a certains qui jouent pour remporter de modestes
sommes afin d'améliorer un peu leur quotidien, tandis que d'autres
visent plutôt le « gros lot » et aspirent à un statut
social plus élevé.
Dans l'un comme l'autre cas, l'argent anime distinctement
l'échange et le contrat ludique, il est le but du jeu et son pouvoir
mérite d'être pris en considération chez l'acteur pour qui
la participation à une activité ludique devient essentiellement
guidée par des contraintes et récompenses matérielles.
Cette posture capitaliste qui dicte l'affiliation de l'acteur social à
un jeu peut s'entendre ici comme la logique d'un « loisir lucratif »
: c'est-à-dire un comportement, une manière de penser, de sentir
et d'agir qui fait prévaloir le gain à toute adhésion
à une activité ludique. Pour être plus précis, il
est question pour l'acteur
59
social de ne participer à un jeu qu'avec la seule
intention de gagner plus d'argent. Comme pour dire que, la récompense
monétaire est le motif principal pour lequel plusieurs personnes
s'adonnent aux jeux d'argent dans la ville de Yaoundé.
Ainsi, le joueur dont le comportement est motivé dans
un jeu va se sentir en quelque sorte forcé de jouer parce que cela lui
permet de satisfaire à certaines pulsions. Il ne tient pas compte de
l'imprévisibilité dans les résultats inhérents
à ces jeux. Bien au contraire, il surévalue ses «
compétences » à les prédire parce que son
comportement n'a pour tête de file que l'argent. Dans ce sillage, on
observe le cas de certains joueurs qui, pour une mise de deux ou trois cents
francs au pari-foot, imaginent des combinaisons où ils aspirent à
gagner des centaines, voire des millions de francs dans une stratégie
qui consiste à parier sur les « tocards », c'est-à-dire
des concurrents jugés perdants à l'avance par les «
bookmakers », mais ayant des « cotes » plus
élevées. Un dessein qui s'illustre à travers l'influence
des essais mathématiques sur le jeu théorisé par L.
BACHELIER (1993 :38), qui pense qu'à la loterie où sont souvent
présentées de très fortes sommes, mais avec de faibles
probabilités de gains, certains joueurs misent sur «
l'espérance » et la « cupidité ». C'est dans ce
sens que jouer strictement dans le but de faire fortune est une illusion.
Toutefois, si les jeux d'argent offrent effectivement la
possibilité d'obtenir en quelques minutes un montant considérable
qui autrement demanderait du temps et beaucoup d'efforts, il ne faut cependant
pas condamner ces activités uniquement parce qu'elles permettent de
s'enrichir rapidement I. PARADIS et J.P COURTEAU (2003), car le rêve et
le fantasme ne sont pas nécessairement nocifs. Ils donnent surtout la
chance aux individus de quitter la routine et les contraintes habituelles. Mis
à part les joueurs, il se trouve une autre catégorie d'acteurs de
ces jeux, ce sont entre autres les « katikas » et les
intermédiaires.
4. Les « katikas » et leur concours dans les
pratiques de jeux d'argent Habituellement, en se rendant dans les
milieux de jeux clandestins, on s'aperçoit de la présence de
certains individus aux allures de non joueurs postés à ces
endroits à longueur de journée. Bien qu'étant
dissimulés dans la masse, ils sont au coeur du jeu. Les « katikas
» sont des personnes qui jouissent d'abord d'une certaine
notoriété, à défaut d'être craints dans les
secteurs urbains où sont pratiqués certains jeux illégaux
comme la carte et les dés. Ils jouent à la fois plusieurs
rôles : ils sont arbitres du jeu du fait qu'ils détiennent les
mises des différents participants, et sont chargés de
récompenser les gagnants après prélèvement de leur
côte part.
60
Dans le même temps, ce sont de véritables
maquettistes qui quelques fois, font varier le montant des mises après
avoir sonder la capacité financière des joueurs
présents.
Dans les lieux de pratique du « ndjambo » comme les
chantiers, les cases abandonnées ou dans les hangars vulgairement
appelés « tatamis », les « katikas » jouent aussi un
rôle de sentinelle contre les autorités répressives en vue
de favoriser l'évasion des joueurs. En cas de patrouille ou de
présence suspecte, des codes langagiers sont ainsi définis et
assimilés par chacun des joueurs. On peut entendre çà et
là des phrases comme celles-ci : « sauve qui peux ! » ; «
le niais ! » etc., données comme un signal pour
échapper aux forces de maintien de l'ordre.
Pour tout dire, le concept de « katika » est pluriel
et le rôle de cette catégorie d'acteur dans la pratique des jeux
d'argent varie en fonction de la nature de jeu, car, faut-il le rappeler, ce
terme est aussi employé pour désigner tout gérant d'un jeu
d'argent, fut-t-il légalisé, auprès duquel s'effectuent
toutes transactions de participation aux jeux et de récompenses des
gagnants.
5. Les intermédiaires et leur rôle dans
la facilitation des casinos et des PMU
En approchant un casino ou un kiosque à pari mutuel ou
sportif à Yaoundé, il n'est pas rare qu'on se face interpeller
par certains individus postés aux alentours. Ce sont des
intermédiaires du jeu ou « appacheurs », pour emprunter une
expression communément utilisée à Yaoundé,
c'est-à-dire des personnes qui se passent pour des consultants ou
experts, dont le but est d'aider ceux qui ont les moyens financiers
nécessaires de mises à gagner davantage. Ces individus consacrent
beaucoup de temps à la lecture des journaux et catalogues qui livrent
des informations sur l'actualité dans différents jeux ou encore
dans les sites des « bookmakers », à étudier les
probabilités de réussite des évènements. Ils
proposent alors, disent-ils, des combinaisons gagnantes contre
récompense à ceux qui viennent jouer. C'est du moins, ce
qu'attestent les propos de l'enquêté D. ZANGA, un
intermédiaire de paris sportifs appréhendé à
proximité d'un kiosque à Ngoa-Ekelle, quand il affirme que :
61
Je suis un professionnel du pari foot, que je pratique
depuis 2010. À travers mes recherches et mes expériences, j'ai
acquis une parfaite maîtrise du système dans ce jeu. Mon objectif
est d'aider les gens à gagner ou à minimiser leurs pertes. Je
suis par ailleurs, fondateur et administrateur d'un groupe « whatsApp
» dénommé « pronosûres », entendu comme
« Pronostics sûres ». Dans ce groupe, quand je suis
sollicité pour proposer des paris gagnants aux joueurs, le contrat est
qu'il faut me faire un transfert de crédit ou d'argent en fonction du
montant gagné !
Il en est de même pour cet informateur, monsieur S.
OKALA, un sergent-chef de l'armée à la retraite, adepte du PMUC
et constamment présent à la poste centrale, pour qui :
Les gens pensent qu'on gagne au PMUC par hasard, pourtant,
c'est toute une école ! Moi j'ai une bonne lecture de ce jeu et on me
connait ici pour ça. Je me souviens que l'an dernier, j'ai aidé
un monsieur à jouer et il a gagné un tiercé de près
de six cent mille francs. Mais comme les gens sont ingrats, je n'ai eu que
vingt mille francs là-dedans.
Ces propos témoignent à suffisance toute
l'importance attachée à ces pratiques de jeux, aussi bien par les
joueurs que les intermédiaires, où chacun semble trouver plus ou
moins satisfaction. Mais pour ce qui est des intermédiaires dans les
casinos et notamment au casino « El Blanco » où nous avons
enquêtés, il s'est avéré que certains parmi les
« appacheurs » trouvés sur place, seraient des mercenaires
dudit casino. Leur rôle serait en fait d'amener ceux qui les consultent
à perdre en les faisant miser beaucoup d'argent dans un jeu à
travers de fausses combinaisons ou pronostics qu'ils leur proposent, ainsi, de
faire gagner l'entreprise. Une impression justifiée par le fait que ces
gens, en plus de côtoyer les dirigeants et le personnel, ont une totale
liberté d'accès au casino et aux machines à sous.
Ces observations viennent en quelques sortes, apporter une
vision plus éclairée du rôle joué par une
catégorie d'acteurs tapis dans l'ombre autour des pratiques de jeux
d'argent dans la ville de Yaoundé, où ces intermédiaires
des jeux se comptent par centaine. Toujours
62
disponibles à proposer leurs services, on les identifie
au moyen de la paperasse de journaux et anciens catalogues qu'ils tiennent
à la main. Leurs sites privilégiés sont le centre urbain
(avenue Kennedy, marché central, poste centrale, avenue des banques
etc.). On les retrouve également à Mokolo, au lieu dit «
ancienne gare routière » et dans certains lieux
périphériques où les kiosques à jeux sont
implantés, ce qui laisse donc percevoir que, le métier
d'intermédiaire ou « d'appacheur » à Yaoundé
n'est plus l'apanage des seuls services administratifs. Il s'est
désormais transporté dans divers autres secteurs
d'activités, en l'occurrence les jeux d'argent.
De ce qui précède, on constate que ce sont les
acteurs sociaux qui produisent le sens qu'ils donnent à leurs pratiques
ludiques. Les pouvoirs publics considèrent les jeux d'argent comme des
vecteurs d'une économie aussi fondamentale que n'importe quel autre
secteur. Les promoteurs de structures quant à eux leurs assignent le
sens d'une entreprise, tandis que les joueurs les voient comme une aubaine
d'accumulation financière ou d'enrichissement. Toutefois, ce qu'il
faudrait beaucoup plus noter ici est que, ces individus qui hypothèquent
leur argent dans des jeux ne sont pas que de simples consommateurs passifs d'un
marché. Tout au contraire, ils apparaissent comme des sujets sociaux
actifs d'une activité ludico-culturelle qui repose en grande partie sur
des fantasmes et illusions autour du gain.
Le chapitre qui s'achève a permis d'articuler plusieurs
arguments qui donnent un aperçu du panorama des jeux d'argent
pratiqués dans la ville de Yaoundé. Il était question de
montrer la diversité des activités ludiques en insistant sur le
caractère instrumentaliste, productif ou mercantiliste de ces jeux par
les acteurs sociaux. Il ressort donc que ces jeux entre autres les casinos, le
poker, les paris sportifs et hippiques, les dés, la Carte ou le Ludo,
sont des activités représentatives à plusieurs niveaux de
certaines dichotomies culturelles et d'enjeux économiques chez les
pratiquants.
63
CHAPITRE II
MÉCANISMES D'ENRÔLEMENT ET DE
PARTICIPATION DES
ACTEURS AUX JEUX D'ARGENT
Le but visé dans ce chapitre est de comprendre
davantage dans le contexte actuel, marqué par la multiplication des
offres de jeux, la diversité des canaux d'atteinte des populations cible
et la montée de nouvelles stratégies d'accumulation de ressources
financières, comment de nombreuses personnes s'invitent aux pratiques de
jeux d'argent. D'une part, il s'agit d'une approche des médias ; dont
l'objectif est d'analyser l'interaction entre les éléments
exogènes comme les publicités de jeux diffusées dans les
canaux tels que les affiches, la télévision, la radio et
internet. Ces médias ne sont pas sans incidence sur les manières
d'être, de sentir et d'agir des auditeurs. Aux dires de T. ANATRELLA
(1998 :95), les médias ne sont que « les
révélateurs des courants d'idées et des
représentations dans une société. Ils ne sont cependant
pas neutres car ils peuvent les amplifier ou en valoriser certaines au
détriment d'autres ». C'est pourquoi un décryptage
même partiel du contenu médiatique diffusé dans les
émissions consacrées aux jeux d'argent, permettra de comprendre
comment les médias favorisent la maturation des habitudes de jeux chez
certains individus, par l'influence et la manière dont ils se
servent.
D'autre part, l'analyse se penche sur la mobilité
sociale des acteurs comme facteur contraignant du recours au jeu, dans une
ville marquée par la rareté d'emplois, l'insatisfaction des
salariés quant à leurs revenus et le goût poussé de
certains individus pour le gain facile. Mettre en évidence ces facteurs
consiste en prime, à dresser un modèle théorique
conceptuel, qui permettra de repartir les enquêtés suivant les
différents canaux à travers lesquels ils se sont invités
aux pratiques de jeux d'argent, en rapport à leurs différentes
trajectoires urbaines.
64
Figure 2 : Les facteurs ayant influencé
l'adhésion des individus aux jeux d'argent

Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
Ce graphique montre que 7.69 % de personnes se sont
initiés à la pratique des jeux d'argent à la suite d'une
exposition publicitaire sur les affiches publiques que l'on retrouve dans les
artères de la ville de Yaoundé. Celles-ci présentent
souvent la simplicité des règles de jeux et l'illusion d'un gain
à travers lequel la vie du joueur serait améliorée. Ces
panneaux publicitaires du jeu sont visibles aussi bien au centre urbain que
dans les périphéries et quartiers populaires, où les
individus de diverses couches sociales de la population à leurs vu,
seraient tentés de s'initier au jeu et d'aspirer à un gain
important.
Par la suite, une compilation de 36.91 % de joueurs affirme
que les expositions publicitaires de jeux diffusées dans les
médias de masse comme la télévision et la radio ont
été le médium de leur premier contact avec les jeux
d'argent. En réalité, ces émissions ne sont autres que des
opérations de charme où il est souvent présenté
l'actualité dans différents jeux, quand il ne s'agit pas de
récompenser des gagnants. Ces derniers, à travers leurs
témoignages, invitent d'autres individus à tenter à leur
tour la chance de décrocher un gain considérable. Les
médias véhiculent donc un discours très positif sur le jeu
et renforcent dans le même temps, les espérances des joueurs en
gain d'argent. À cette proportion d'enrôlés, viennent
s'ajouter 11.53 % de personnes qui se sont invités au jeu par le canal
d'internet, où des sites et
65
formules de jeux virtuels sont proposés à ceux
qui sont connectés. Ce facteur s'arrime avec les développements
technologiques en plein essor dans notre société et impacte
beaucoup plus les jeunes, en proie à la modernité.
Par contre, un total de 43.83 % de personnes
enquêtées affirment avoir été enrôlé
dans les jeux d'argent du fait de l'influence de la mobilité sociale ;
dont la proximité physique des lieux de jeux à leur environnement
social et par leurs habitudes de fréquentation des cercles de jeux. S'il
est établi que l'implantation des salles de jeux et tripots de rues
à Yaoundé relève d'une construction cognitivement
construite des promoteurs de ces jeux en quête de clientèle, il va
de soi qu'elle impacte sur les populations voisines à ces structures, en
s'imposant comme un nouvel itinéraire ou un besoin moral à
satisfaire. Nous analyserons ces facteurs en deuxième ressort. Quel est
donc l'impact des médias sur la contrainte de jeu des acteurs ?
I. LES MASS-MÉDIAS ET LEUR RÔLE DANS
L'INCITATION DES INDIVIDUS AUX JEUX D'ARGENT
Depuis l'adoption par l'assemblée nationale du projet
de loi no 90/052 du 19 décembre 1990 relatif à la
liberté de la communication sociale, le paysage camerounais en
général et la ville de Yaoundé en particulier, a
été investi tour à tour par les magazines et les journaux
privés de tous bords. À ceux-là, viennent s'ajouter les
fréquences de radio et les chaines de télévision
indépendantes. En dehors des médias susmentionnés, il y a
aussi internet, qui est un réseau de communication couplé aux
ordinateurs à travers des connexions spécifiques. Ce nouvel outil
de communication a l'avantage de ne connaître aucune barrière
régionale ni linguistique, l'accès aux informations de toutes
sortes est donné à tous ceux qui peuvent s'y connecter.
C'est ainsi que dans certaines fréquences de radio et
chaines de télévision, il existe des tranches d'antennes
consacrées à la publicité ou à la promotion des
jeux comme les loteries, les tombolas ou encore les paris hippiques et
sportifs. Les mêmes structurations sont observées sur l'outil
internet, avec la particularité que toutes les informations qui s'y
trouvent sont regroupées, détaillées, actualisées
et parfois instantanées suivant les sites auxquelles l'on est
connecté. Ces émissions s'accompagnent d'une audience
particulière de la part des populations de la ville de Yaoundé,
d'autant plus qu'elles sont souvent diffusées à des heures
66
de grande écoute et ont dans certains cas,
été le facteur d'enrôlement des joueurs dans certains
jeux.
1. La publicisation des jeux d'argent : un pouvoir de
coercition du joueur
Selon R. LEDUC (1974 :2), la publicité est «
l'ensemble des moyens destinés à informer le public et à
le convaincre d'acheter le produit ou un service ». En effet, si l'on
pense qu'il est possible de choisir d'être indifférent à la
publicité, il faut se dire qu'il n'y a pas de publicité sans
capital. Dans ses analyses, R. ROCHEFORD (1995), explique que les publicitaires
et les hommes de marketing s'appuient toujours sur des approches psychologiques
et sociologiques pour convaincre les individus et créer des biens de
consommation correspondants à leurs désirs. Et selon que la
publicité est de nature insidieuse, incitative ou encore est
vouée à l'apprentissage et à l'initiation à un jeu,
les publicitaires prennent toujours en considération l'influence du
groupe pour conditionner le choix de chacun : « du loto, du loto,
vivez la vie du loto ! » ; « ce vendredi, jouez au Banko 2
et gagnez quarante millions de francs CFA au PMUC. PMUC, un jour vous aussi
vous allez gagner gros ! ». Peut-on entendre si souvent dans les
spots publicitaires diffusés sur les antennes
radiotélévisées de la CRTV, de la FM 94, de Canal 2
international, de Magic FM, d'amplitude FM, pour ne citer que celles-là,
après la lecture des éditions de journaux. Ou encore on peut les
lire sur les panneaux d'affichages dans les artères de la ville de
Yaoundé.
En ce sens, la publicité apparaît comme un
phénomène coercitif que l'acteur social intériorise, elle
développe un mensonge accentué sur un discours optimiste, portant
sur l'illusion d'un bonheur rêvé tel que par un simple coup de
chance, on peut parvenir à obtenir ce par quoi, même le travail
demanderait beaucoup plus de temps. La publicité a aussi une fonction de
légitimation puisqu'elle impose un certain nombre de valeurs, qui
donnent à la société une représentation
d'elle-même. Son efficacité est argumentée par le fait que
les images et les slogans qu'elle diffuse suscitent la convoitise ou
créent la frustration chez certains individus. Ce symbole d'une chose en
son absence est pour l'acteur social qui l'écoute ou la regarde, le
signal d'un manque à combler, d'un vide dont il faut satisfaire
l'assouvissement ; amenant ainsi à conclure avec J. BROCHAND (2001 :3),
que :
67
La publicité est une technique facilitant soit la
propagation de certaines idées, soit les rapports d'ordre
économique entre certains hommes qui ont une marchandise ou un service
à offrir à d'autres hommes susceptibles d'utiliser cette
marchandise ou ce service.
En ce sens, il n'est donc plus étonnant de trouver dans
l'imaginaire des populations de Yaoundé et des joueurs d'argent en
particulier, des traces de cette influence sans que ceux-ci aient la force de
les discuter ou de les critiquer. Cette modification de leur comportement se
manifeste dans leur conduite ou encore leurs aspirations. C'est ainsi que les
publicités du Lotto ou du PMUC, contraignent plusieurs individus
à s'y abonner en raison du fait qu'elles les persuadent qu'ils ont plus
de chance, plus de compétences et de connaissances du jeu. Illustration
est faite sur l'image suivante, d'une publicité de jeu non
médiatisée.
Photographie 11 : Affiche publicitaire
promouvant la loterie

Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
En s'appesantissant sur le contenu de ces images, on
s'aperçoit qu'elles sont conçues pour véhiculer à
la fois l'illusion du gagnant et inviter les personnes à
développer une orientation positive envers la loterie. Ces images
mettent en avant l'existence d'une forte probabilité que la vie du
joueur sera améliorée grâce au jeu. Par conséquent,
elles stimulent les acteurs à la pratique par le biais de certains
facteurs qui contribuent entre autres : à l'association entre la
simplicité des règles et faire confiance à ses
compétences, à l'association entre la présence d'argent,
le gain et l'investissement continu dans le jeu. Plus encore, elles
intègrent les biais émotionnels, la fabrique de mythes, les
pensées erronées, les probabilités réelles de
succès et l'illusion de mobilité sociale. Vu sous cet angle, la
publicité
68
joue un rôle de catalyseur au jeu chez les individus
dans la mesure où elle incite même les plus sceptiques à
s'y adonner.
Les publicitaires du jeu s'appuient donc sur certains
médias de masse comme la télévision pour véhiculer
leurs messages.
2. La télévision et son pouvoir de
séduction du joueur
À travers les jeux de vitrines comme : Banko 2, Le
magazine hippique, Super Loto, Super Cagnotte 4 etc., diffusés sur les
antennes télévisées de la CRTV ou de Canal 2
international, la télévision véhicule une culture
d'adhésion populaire qui passe de l'imaginaire au concret en robotisant
les comportements des acteurs sociaux. D'un point de vue plus large, il faut
s'interroger avec Z. BAUMAN (2005 :221), sur « le véritable
impact de la télévision sur nos façons d'agir et de penser
». En effet, dans ces émissions où il est
généralement question de tirages à la loterie où de
récompenses des gagnants, on peut dire que la télévision
rend ses téléspectateurs émotionnellement
vulnérables. C'est un univers dans lequel se meuvent les besoins des
individus au motif que l'argent se substitue au spirituel, au social et au
culturel. Elle devient ainsi, une spatialité ontologique qui fait de
l'homme un aliéné du jeu, un prisonnier de son regard
quantifiant, un être réduit à la sensation et à
l'expression d'un besoin.
La télévision standardise aussi les modes de
pensées, détruit la véritable personnalité et le
bon vouloir des téléspectateurs. Tel est le cas de cet
informateur G. MBANGA, instituteur vacataire, qui relatait les circonstances
à travers lesquelles il s'est initié aux jeux d'argent.
L'économie de ses propos révèlent que :
Il y'a quelques années encore, ces jeux ne
m'intéressaient pas du tout. J'ai commencé à parier sur
les courses du PMUC le jour où j'ai vu remettre un chèque de huit
millions de francs à un gagnant ! C'était au cours de
l'émission tamtam week-end, qui passe tous les dimanches vers 14 heures
à la CRTV. C'est ce jour-là que je me suis dit pourquoi pas moi ?
C'est donc comme cela que je me suis jeté dedans.
Ce diktat de la télévision est renforcé
par la recherche de spéculations sur le jeu en permanence. En
réalité, les émissions télévisées sur
les jeux d'argent sont à la recherche de sensations, avec une
information qui occupera une place bien trop importante dans la
69
conscience du joueur. C'est dire qu'obnubilés par la
présence de ces jeux, la télévision contribue à la
dépossession des joueurs avec ou sans leur aval. Sa pression les
désoriente et une fois dépossédés, leur libre
arbitre les convertit à la société dans laquelle elle veut
les faire vivre. Car, elle les abreuve d'images et d'imaginations parfois
fictives et à travers lesquelles ces individus vivent dans l'espoir
d'assouvir leurs besoins au moyen de l'information qui est
véhiculée. La télévision est aussi un facteur de
neutralisation des acteurs sociaux dans la mesure où, elle dramatise et
accentue les évènements qu'elle met en scène. Ici,
l'attrait qu'elle exerce sur les joueurs et les non joueurs est bien
supérieur à tout autre média. Car, la stimulation à
la fois visuelle et auditive qu'elle suscite, laisse entrevoir une
volonté d'expérimentation du jeu chez le
téléspectateur.
Dans le tableau qui va suivre, il est présenté
de façon plus détaillée, les facteurs
d'appréciation des jeux d'argent, dont les préférences aux
jeux des acteurs sont quelques fois fonction de l'effet médiatique des
émissions télévisées qui se rapportent à ces
jeux.
Tableau 3 : Les facteurs d'appréciation
des jeux d'argent
|
Préférences aux
jeux
d'argent
|
Effectifs
|
Proportions (%)
|
|
Jeux au casino
|
7
|
5.38
|
|
Poker et machines à sous
|
28
|
21.53
|
|
PMU (loteries, tombolas, paris
sportifs et hippiques)
|
73
|
56.15
|
|
Flipper, baby-foot, jeux vidéo
|
12
|
9.23
|
|
Bonneteau, Ludo, cartes, dés
etc.
|
10
|
7.69
|
|
Total
|
130
|
99.98
|
Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
70
Les données consignées dans ce tableau
permettent d'établir les faits suivants : tous les sujets
interrogés s'intéressent aux jeux d'argent, leur participation
est de 100 %. Mais parmi eux, on observe que le choix du type de jeu est
fonction de l'effet publicitaire que suscitent certains jeux
télédiffusés. Celui-ci entraine une volonté
d'expérimentation des PMU dans la mesure où les loteries, les
tombolas, les paris hippiques et sportifs sont les jeux les plus
sollicités. Ils représentent 56.15 % de l'effectif total. Ce
pourcentage est nettement supérieur à celui des autres jeux.
Comment peut-on expliquer cette prévalence ?
En effet, les PMU sont des jeux très prisés pour
plusieurs raisons : d'abord, ils sont plus récents et plus
médiatisés. Et comme tel, ils suscitent au sein de la population
un effet de curiosité à vouloir expérimenter, à
côté des autres jeux qui sont plus anciens et ne disposant pas
d'espace publicitaire à la télévision. L'exemple d'un
autre informateur nommé N. ABANDA, 57 ans, mécanicien à
Ékounou, nous-en dit davantage sur l'effet de la
télévision dans son incitation aux pratiques de jeux d'argent
quand il dit que :
J'ai abandonné le poker il y'a très
longtemps ! C'est vers les années 1998 que je me suis initié au
PMUC. Et depuis 2012, je joue aussi au pari foot parce que dans ces jeux, on
peut regarder en direct à la télévision, les courses sur
l'hippodrome et les matchs des grands championnats européens et avoir
même les pronostics des consultants.
Dans les propos d'un autre joueur d'argent V. MESSEBA,
étudiant, on peut lire en substance l'impact de la
télévision dans ses préférences aux jeux d'argent.
Ce dernier s'exprime en ces termes :
J'aime le damier, que je joue d'ailleurs au quartier avec
des amis. Mais quand il faut chercher le « bon argent », je joue
beaucoup plus au pari foot. En fait, je suis d'abord un fan de football ; et
parce que dans ce jeu, tu valides ton ticket et tu as la possibilité de
regarder les matchs à la télévision. Je pense que ce jeu
au moins est transparent !
71
C'est pour dire que, les formes d'appréciation de ces
jeux sont répandues et qu'ils font désormais partie
intégrante de la vie quotidienne de plusieurs individus. Ceux-ci dans
leur majorité, sont des téléspectateurs de chaînes
sportives des bouquets « canal + », où les championnats et
leagues Européennes font grand échos tous les week-ends. La
télédiffusion des évènements ayant une relation
étroite avec les jeux a donc un impact avéré sur leur
pratique par les habitants de la ville de Yaoundé. Les
préférences des acteurs pour les autres types de jeux sont moins
en rapport avec l'effet médiatique, parce qu'ils ne sont pas assez
publicisés à la télévision. D'une part, leurs
pratiques s'arriment à des facteurs de rentabilité de gain dans
les passe-temps populaires. Et par ailleurs, leur rejet émane de
l'élitisme de certains milieux de jeux. Car les jeux de cartes, de
dés de Ludo etc., sont pour la majorité des prétendants au
million, des jeux qui ne « payent pas assez ». Tandis que les casinos
sont des milieux qui véhiculent des préjugés mafieux pour
certains, au contraire des PMU qui disposent d'espaces publicitaires dans les
médias, et donc plus accessibles.
Toutefois, si la télévision est une usine de
rêve ou encore une fabrique de fantasmes pour les joueurs, qu'en est-il
de la radio ?
3. La radio et son impact sur le comportement du joueur
La radio est le canal qui a toujours eu la capacité
d'atteindre le public, ses messages sont instantanément reçus et
atteignent la population partout où elle se trouve. C'est un
média qui participe à la stimulation des envies de jeux chez les
auditeurs, du fait qu'il révèle une tendance constante à
suivre ce qui est produit. À travers son transistor à faible
coût, l'utilisateur peut facilement avoir un lien direct avec
l'actualité sur les évènements sportifs, les
résultats des courses, les numéros tirés à la
loterie ou encore des « jackpots » mis en jeu. Tout comme la
télévision, la radio est un modérateur du pouvoir
d'enrôlement des individus aux pratiques de jeux d'argent, du fait de ses
nombreuses présentations et publicités de jeux qu'elle diffuse
à longueur de journée, à un public issu de nombreuses
couches sociales.
Ainsi, au cours des entretiens, plusieurs
enquêtés ont affirmé s'être invités dans les
jeux de PMU et loterie, du fait de programmes radiophoniques en modulation de
fréquence parlant de ces jeux. Parce que ne disposant pas d'un poste
téléviseur dans leur domicile ou lieu de service, leur poste
radio est l'instrument à travers lequel ils restent connectés
à l'actualité.
72
Nonobstant les jeux d'argent publicisés à la
radio et à la télévision, les invitations à
participer à ces jeux parviennent aussi par le canal de l'internet.
4. Internet et la promotion des jeux d'argent en ligne
Internet, nouveau média, propose une nouvelle forme de
jeu d'argent, le jeu virtuel. En effet au Cameroun, l'existence des sites de
jeux tels que :
www.pmuc.com,
www.premierbet.com et
www.supergoal.com,
permettent de jouer en investissant un argent virtuel. Dans ces sites, le
pouvoir de la publicité et du marketing qui présentent les jeux
d'argent en ligne comme accessibles et excitants, donnent à de nombreux
adeptes la possibilité de jouer ou de parier tous les jours et 24 heures
sur 24. Ici, on retrouve généralement des casinos et hippodromes
qui fonctionnent sur le même mode que les casinos et les PMU
réels. On y joue avec de 1'argent qui, même converti en monnaie
virtuelle garde sa valeur monétaire. Avec le jeu en ligne, le joueur
peut gagner ou perdre de l'argent depuis son domicile ; à partir d'un
téléphone multimédia ou d'un ordinateur connecté au
réseau internet.
Dans ces sites de jeux, il est souvent proposé au
joueur des jeux gratuits, des jeux bonus et des essais, qui lui permettraient
d'évaluer son potentiel de chance et sa capacité à gagner
de l'argent une fois que cette phase préliminaire est achevée.
Cette formule intéresse beaucoup de jeunes, qui s'arriment plus
rapidement à la modernité et à l'usage de l'outil
informatique dans notre société. Cependant, le
développement des jeux en ligne et l'accès des populations au
réseau internet étant encore récent et relativement peu
répandu dans notre société, il va sans dire qu'internet a
un impact limité sur l'enrôlement des joueurs par rapport aux
autres médias.
Pour tout dire, les mass-médias ne sont pas neutres
dans l'enrôlement des individus aux pratiques de jeux d'argent dans la
ville de Yaoundé. À travers leur cheminement, F. BALLE (2000
:113), affirme que « les médias cherchent le
profit : ils voudraient que tout se vende, que tout s'achète. Pour
atteindre leurs objectifs, ils s'emploient à répondre aux
attentes de leurs clients, et cherchent avant tout à plaire et à
séduire ». C'est dire en d'autres termes, qu'il y a une double
action des médias face aux jeux d'argent : ils ont pour
thématique préférée l'illusion et le rêve, et
le jeu comme simple sujet d'information.
Tout compte fait, si certains joueurs d'argent sont
influencés par les médias, c'est d'abord parce que ces derniers
se prêtent à ce jeu d'exposition. L'influence des médias
dépend aussi « de ce que les gens en font, de ce qu'ils en
attendent, (...), de ce qu'ils croient en obtenir » F. BALLE (1980
:589). Car d'où vient-il que les autres camerounais, exposés
à
73
ces mêmes programmes, ne viennent pas à s'adonner
à certains jeux par regain d'intérêts financiers ? C'est
aussi la preuve que ces publicités et programmes bien que
suggestifs, « sont diversement puissants, selon les époques ou
selon les publics » F. BALLE (idem, 1980.). Parfois, ces
programmes coïncident avec les aspirations intrinsèques ou
réelles des individus. Ce volet fait intervenir l'étude de la
mobilité ; c'est-à-dire le rapport entre la position
occupée par les acteurs dans la hiérarchie sociale et leurs
contraintes aux jeux d'argent.
II. MOBILITÉ SOCIALE ET QUÊTE D'ANCRAGE ET
D'AUTONOMIE DES ACTEURS À TRAVERS LES JEUX D'ARGENT
Cette section se propose d'analyser la pratique des jeux
à Yaoundé, comme un modèle de quête d'argent mis en
place par les populations urbaines, dans des circonstances
déterminées. Son objectif est de cerner à la fois les
itinéraires individuels et collectifs des yaoundéens en
quête de gains providentiels. Dans cette analyse, la mobilité
s'appréhende non pas comme une mobilité à caractère
physique des acteurs, mais se pose comme un examen microsociologique des
mobilités à savoir, le statut des acteurs dans la
hiérarchie sociale. Son but est de comprendre de quelle manière
le jeu devient un recours chez les personnes en proie à
l'uniformité sociale, à la concupiscence inassouvie et en
quête de refuges sociaux. La pertinence de ce registre se trouve dans les
logiques et pratiques des acteurs individuels et collectifs pour
s'insérer dans la ville, de même que sa restitution repose sur la
prise en compte des principaux cycles qui rythment les temps urbains à
savoir : la fréquentation des milieux de jeux, l'occupation permanente
et la montée des nouveaux modèles d'accumulation.
1. Fréquentation des milieux de jeux et
apprentissage social chez les désoeuvrés Parce que les
jeux d'argent impliquent des personnes initiées et des personnes
à initier, certains individus commencent souvent à les pratiquer
parce qu'ils s'invitent régulièrement dans les cercles de jeux
pour se « distraire » en compagnie des autres. Comme le dit-on
souvent « l'appétit vient en mangeant », il va de soi qu'ils
éprouvent au fil du temps, assez de difficultés à garder
leur posture de spectateur pour se convertir en de joueurs. À travers le
processus de socialisation qui consiste pour un individu d'intérioriser
les normes et valeurs de sa société d'appartenance, ces individus
intègrent un ensemble de connaissances communément
partagées et s'invitent plus ou moins consciemment dans ces jeux. C'est
ce qui ressort des propos d'A. BINELLI, un commerçant ambulant qui se
prononce sur son enrôlement dans les PMU dans les termes suivants :
74
Avant, je venais ici (salle de jeu) pour me reposer un peu
et perdre du temps en regardant les matchs ! Mais tellement je voyais les gens
gagner au pari foot et au kéno, j'ai été excité
à l'idée que moi aussi la chance pouvait me sourire. C'est donc
comme ça que je me suis rapproché d'un ami que j'ai
rencontré ici, pour qu'il m'apprenne à faire des
combinaisons.
À l'analyse de ces propos, l'on se rend compte que les
espaces de jeux ont pour fonction de forger la socialisation de celui qui les
côtoie. En quelque sorte, ils constituent une seconde famille où
peuvent se nouer des filiations, des liens de familiarité et de
solidarité ; ils jouent aussi le rôle d'une formation sociale qui
génère du lien social F. BAILLET (2001 :163). Cet auteur fait
bien de le souligner car, dans notre contexte, la coutume du parrainage par un
ou plusieurs membres contribue à insérer le nouvel
adhérent ou pratiquant, tout en assurant la cohésion de la
communauté associative. C'est ainsi qu'une tendance se dégage :
beaucoup de désoeuvrés fréquentent à longueur de
journées les milieux de jeux. Ces personnes occupent une proportion de
42.30 % de l'effectif des enquêtés (Voir le tableau 1).
D'une manière générale, les
désoeuvrés sont des personnes en manque d'occupation, qui ont
assez de temps libre et ne savent parfois où aller. Pour ainsi dire, de
nombreux citadins en situation de chômage ou ceux en provenance des
campagnes vers la ville, en la faveur de l'exode rurale et à la
recherche d'une « vie meilleure » selon les mots du chanteur
André Marie TALA, ont eu le désir de découvrir de nouveaux
horizons en arrivant à Yaoundé. N'ayant pas eu la
possibilité de s'insérer dans les circuits d'emplois
salariés ou s'obstinant à se lancer dans un secteur informel
déjà harassant et saturé, vont opter pour le choix du gain
facile. En l'occurrence, ils choisissent de fréquenter les cercles de
jeux d'argent à la recherche d'une « intégration urbaine
». Dans ce sillage, il apparaît d'emblée, que l'influence
sociale revêt une importance majeure dans l'initiation des individus
à la pratique de ces jeux.
Parce que dans les secteurs urbains où se pratiquent
les jeux d'argent, certains individus sont enclins à prendre position
sur ce phénomène en fonction des positions de leur entourage.
L'influence du pair joue ici un rôle capital dans l'enrôlement du
joueur et affecte surtout les femmes de joueurs à la maison.
Initialement, nombreuses parmi elles sont souvent indécises à
l'idée de se rendre dans un casino ou une salle pour jouer. Mais par
l'effet de contamination des habitudes de jeux de leur entourage, elles auront
de ces jeux une idée
75
appréciative par la suite. À l'image de madame
P. NTAMACK, une invétérée du PMUC qui déclare que
:
Je suis accrochée à ce jeu jusqu'à la
mort ! D'ailleurs, c'est mon mari qui m'a poussé à jouer parce
qu'à chaque fois qu'il rentrait avec un catalogue, il me demandait de
lire et de l'aider à choisir les numéros d'éventuels
chevaux gagnants. Quelques rare fois ça marchait et petit à
petit, j'ai aussi prise goût. Il y avait même des moments où
on se rendait ensemble dans un casino, où il jouait et je l'observais
(...)
Cette déclaration permet donc de constater que la
tendance à l'uniformisation dans les manières d'être,
d'agir et de sentir dans les lieux où se pratiquent les jeux d'argent ne
découle pas de l'instinct ou de pulsions spontanées, mais
plutôt d'un ensemble de pressions « invisibles » qui peuvent se
matérialiser de plusieurs façons. Car, d'après G.N FISCHER
(1987 :57), « l'étude des phénomènes sociaux se
caractérise d'emblée par la tendance des systèmes à
l'intégration et par la capacité des individus à
incorporer les éléments dominants dans une culture ».
Un ensemble de faits qui amène alors à s'interroger sur la
question de savoir qu'est ce qui peut objectivement traduire la présence
massive des personnes oisives dans les lieux de jeux d'argent ?
En réalité, la fréquentation des cercles
de jeux et leur pratique par les personnes en manque d'occupation peut dans un
premier temps, s'interpréter comme le recours à un sentiment de
compensation d'échec à l'intérieur d'un système de
hiérarchie lié au mérite. Du fait qu'ils n'aient pas pu
s'insérer dans une échelle plus confortable dans la
société urbaine, ces personnes désoeuvrées se
retrouvent très souvent préoccupées par leur sort. Elles
s'invitent alors dans les salles de jeux, dans l'espoir permanant
d'améliorer leur situation financière. Une idée qui fait
dire à R. BRENNER et G. BRENNER (1993 :8), que « Dans un
système compétitif, l'envie et la frustration des
laissés-pour-compte trouve un exutoire dans les jeux de hasard ».
Une idée qui est d'autant plus fondée quand on sait qu'en
situation défavorable, le risque devient permanent, chacun compte sur sa
chance pour tirer son épingle du jeu, quitte à mettre ses
économies en danger si l'enjeu en vaut la peine.
76
Deuxièmement, on peut admettre que les attroupements
observés dans les lieux de jeux majoritairement peuplés des
personnes oisives, résultent quelque part d'un sentiment partagé
d'être exclus d'un système qui permet à ceux qui ont
réussi leur intégration de mener une vie confortable. Elles
s'invitent alors dans ces lieux à la recherche de ce qu'ils n'ont pas
obtenu par les voies normales de promotions professionnelles et
financières. C'est en cela que leur recours au jeu d'argent peut
être un adjuvant idéal dans ce que J.M. ZAMBO BELINGA (2003 :573),
qualifie de « quête de notabilité sociale ».
C'est-à-dire qu'ici, la fréquentation des milieux de jeux peut
être instrumentalisée dans la recherche et même la
consolidation de ce que les yaoundéens appellent
prosaïquement « le positionnement », donc la reconnaissance
sociale. Cet aspect de la chose est vu dans le tableau qui va suivre.
Tableau 4 : Répartition des joueurs selon
ce qui les motive à jouer
|
Motivations aux jeux d'argent
|
Effectifs
|
Proportions (%)
|
|
Petits gains réguliers
|
40
|
30.76
|
|
Désir de recouvrir ses pertes
|
22
|
16.92
|
|
Espoir d'un gain important
|
68
|
52.30
|
|
Total
|
130
|
99.98
|
Source : (Badel ESSALA, (enquête de terrain).
Du tableau ci-dessus, on constate que 30.76 % d'individus se
perpétuent dans les jeux d'argent malgré le fait qu'ils gagnent
des sommes dérisoires. Ces gains équivalent plus ou moins aux
sommes régulièrement investies, parce qu'ils combinent leurs
mises de deux façons : il y'a d'un côté, un ou plusieurs
tickets visant le jackpot pour un gain important. Et d'autre part, des
tickets dits de « récupération » cumulant de minables
gains probables, ce qui les met en confiance pour poursuivre leur jeu et
d'aspirer à un gain important à l'avenir.
Ensuite, une proportion de 16.92 % de personnes jouent parce
qu'elles espèrent récupérer l'argent perdu. Il faut
comprendre de part cette représentativité, que le souvenir d'un
gain reste souvent plus présent dans la mémoire du joueur que
celui d'une perte.
77
Les premières fois qu'une personne joue, elle peut
gagner parfois même des sommes importantes, cette première phase
est appelée la « chance du débutant ». Et lorsque le
joueur commence à enregistrer des pertes, c'est le souvenir de ses gains
antérieurs qui le motive à jouer davantage. En fin, 52.30 % de
joueurs pratiquent ces jeux dans l'espoir de gagner un gain important. Cette
catégorie de joueurs est celle de ceux qui militent en faveur de la
« cotisation », en vue d'un gain fut-t-il tard. Cela voudrait
signifier que le jeu est une activité permanente à laquelle on
dépense beaucoup d'argent, quelle que soit la charge familiale.
À travers ces différentes proportions dans les
motivations à la pratique des jeux d'argent, il ressort que le poids de
cette pratique populaire n'est pas exempt de sens. Et comme site de flexion, ce
phénomène pourrait participer à des « tactiques
» traduisant le combat des populations, luttant pour améliorer leur
niveau de vie en usant des armes non conventionnelles, le jeu et le hasard. Il
en est des jeux comme le poker, le pari foot, le PMUC ou le Loto qui
fonctionnent aujourd'hui comme un exécutoire pour les masses de
populations qui ne rêvent de s'autodéterminer que par la chance,
dans une société qui semble ne plus leur offrir d'autres
alternatives.
Quelles fonctions remplissent donc ces salles de jeux et
tripots de rues pour les citadins ? Les salles de jeux sont d'abord une
réponse à la crise actuelle multiforme. L'une des
premières motivations des joueurs réside en effet, dans la
recherche de bénéfices temporels immédiats, voire
miraculeux à savoir : gagner des centaines de milles, voire des
centaines de millions en misant deux à trois cents francs. Face au
désarroi ambiant, aux multiples incertitudes et souffrances qui les
accompagnent, nombre d'individus se réfugient dans les salles de jeux
pour que soit solutionné leur infortune et leur kyrielle de souffrances.
Ces lieux exutoires constituent des territoires positifs, libérateurs et
protecteurs de l'insécurité, des contraintes, des
problèmes, de la pesanteur et du désespoir du dehors.
Le cas de l'enquêté A. MBARGA, 28 ans, un «
débrouillard », appréhendé dans une salle de jeux en
est une illustration. Pour cet individu ;
Le pari foot est un jeu qui m'aide franchement au niveau
des finances. Il y a des mois où je peux gagner vingt ou trente mille
francs (...) Avec cet argent, mon loyer est assuré ! Mais mon
véritable objectif dans ce jeu c'est de gagner au moins un million cinq
cent mille et fuir ce pays pour tenter une aventure au Maghreb ou en Afrique de
l'ouest.
78
Une ambition qui semble aller de pair avec l'idée du
jeu que se fait un autre joueur d'argent, X. EKANI, 34 ans et licencié
en Droit mais sans emploi. Selon lui,
Les jeux d'argent prolifèrent à
Yaoundé parce que la corruption a amplifié le chômage des
jeunes ! Imaginez-vous quelqu'un qui, après ses études ne trouve
pas du travail et dépasse même l'âge des concours (...) Vous
savez, Dieu n'oublie personne. Nous autres on vient encore ici pour tenter la
chance de gagner quelque chose qui peut nous produire un bon capital.
Dans cette perspective, on peut ainsi évoquer
l'idée du retour sur le pratiquant du jeu d'argent en assumant les
rapports d'une Sociologie de l'innovation, qui s'élabore à partir
des stratégies de quête d'argent dans des pratiques peu
orthodoxes. Ce dynamisme manifesté par une convergence des acteurs vers
les lieux de jeux se reflète à travers leur « sens pratique
» P. BOURDIEU (1980), de la vie quotidienne et de l'indigence à
laquelle ils font face. Car ces personnes en tant que oisives, ont logiquement
des problèmes financiers et sont particulièrement attentives au
marketing du jeu, surtout quand on ne cesse de brandir à la semaine,
« d'heureux millionnaires » dans les médias. Quand elles
« se battent » sans aucun espoir de voir leur condition changer, ce
type d'opportunités leur offre l'espoir de gagner de l'argent rapidement
sans aucune mesure avec les faibles revenus rapportés par la «
débrouillardise » chez certains.
C'est dire en somme, que l'oisiveté est un facteur qui
contribue à la prolifération des jeux d'argent à
Yaoundé. Ce contexte d'immobilité qui accroît les
contraintes et les incertitudes des acteurs, leur impose un aménagement
constant de leurs trajectoires urbaines. À ce moment, le jeu nourrit en
eux l'espoir d'améliorer leur situation ou encore, de combler un manque
à gagner. Une idée qui s'arrime à la perspective de la
« fuite devant des conditions de vie difficiles »
élaborée par Y. CHANTAL et al., cité par M.
DI GASPERO (2012 :54-55), tant il advient que certains individus concilient la
fonction ludique du jeu à celle d'une solution miracle à leur
gêne financière. C'est pourquoi disent-ils des joueurs, que le jeu
« constitue un moyen efficace pour leur permettre de parvenir à
leurs fins ».
79
Toutefois, il convient de rappeler que, ne choisissent de
fréquenter les lieux de jeux d'argent à la recherche du bonheur,
que ceux qui se laissent tenter par le chemin de la facilité et de
l'incertitude. Ou encore par les mythes qui laissent entendre que par cette
pratique, l'on peut parvenir à l'enrichissement. Car il existe aussi
d'autres individus oisifs, qui ne choisissent pas de fréquenter les
salles de jeux pour parvenir à une quelconque aisance financière.
C'est dire autrement, que le contexte des jeux d'argent à Yaoundé
avec la fréquentation populaire des cercles de jeux par les populations
a d'abord trouvé sur place un terrain favorable chez certains individus
à la propension au gain facile. Leur prolifération a plutôt
favorisé une visibilité notoire de la situation qui
prévalait déjà, et n'a été qu'un tremplin
pour officialiser et trouver une excuse pour d'autres.
2. Proximité des lieux de jeux et construction
d'illusions du gain chez les commerçants
Un autre mécanisme à travers lequel certains
yaoundéens s'invitent souvent aux pratiques de jeux d'argent
est la proximité des lieux de jeux à leur environnement social.
Selon l'échantillon prélevé, 23.07 % des
enquêtés (voir figure 2), affirment que la proximité des
points de jeux à leur environnement social les amène à s'y
intéresser. En réalité, la pertinence sociale de la
proximité physique est un sujet d'interrogation ancien en sciences
sociales ; les travaux de G. SIMMEL et des sociologues de Chicago, ceux d'E.
GOFFMAN peuvent encore nous rappeler ce que la proximité physique
apporte à la relation sociale. Dans cette étude, le rapport de la
proximité physique des points de jeux aux populations dans les secteurs
urbains est appréhendé à la fois comme une donnée
matérielle et conceptuelle, subjective et socialement construite. Ainsi,
nous verrons comment dans les marchés, les gares routières et les
carrefours qui sont des lieux de forte concentration des populations,
l'accointance des lieux de jeux est un élément incitatif.
Ainsi, au marché Mokolo où nous avons
enquêté, plus d'une dizaine de points de jeux (salles de jeux,
tatamis, tripots etc.) sur un rayon d'environ cinq cents mètres
ont pu être repérés. Cette concentration relativement forte
des points de provision de ces jeux exerce non seulement un pouvoir de
centralité dans l'approvisionnement des individus en besoin de jeu, mais
s'impose surtout comme un nouvel itinéraire et un besoin moral à
satisfaire. En effet, pour participer aux jeux d'argent, les joueurs ont besoin
soit des cartes, de dés, d'une salle de jeu, d'un espace-poker, d'un
journal du PMUC ou du pari foot. Il se trouve que tous ces matériaux et
structures soient présents dans les marchés, les carrefours et
les gares routières, près des commerçants, ce qui les fait
difficilement s'abstenir d'y risquer leur argent. Un
80
informateur nommé F. KOUATCHOU, âgé de 39
ans et libraire au marché de Mokolo, évoquait l'impact de la
proximité de ces structures sur ses habitudes de jeux en ces termes :
Un bon parieur ne reste jamais sans son ticket, car on ne
sait jamais ! La chance que nous avons ici est qu'on a un kiosque juste en
face, comme vous pouvez l'apercevoir (...) On peut donc jouer en temps opportun
et sans problème. Par contre le dimanche, j'ai particulièrement
des difficultés à valider mes tickets parce que ma maison est un
peu loin du carrefour.
Une autre raison qui pousse souvent les commerçants
à participer aux jeux d'argent est la possession fréquente de
moyens financiers. Certains boutiquiers, transporteurs à moto ou encore
des vendeurs à la sauvette manifestent souvent leurs envies de jeu parce
qu'ils possèdent régulièrement des pièces d'argent
sur eux. Ce sont des sommes qu'ils estiment dérisoires et de ce fait, ne
menacent pas de déstabiliser leur activité. Cette
appréhension est d'autant plus compréhensible tant il est vrai
qu'à Yaoundé, la proximité des lieux de jeux aux
commerçants converge avec l'accessibilité de ces jeux.
L'accessibilité en relation avec la pratique des jeux
renvoie ici au coût du jeu. Pour y participer en effet, les joueurs
doivent hypothéquer un montant qui varie entre deux cents et quatre
cents francs auprès du croupier ou de la structure, ou encore des sommes
à hauteur de cinq cents francs pour ce qui est des jeux comme la Carte,
le Ludo, les dés ou des paris entre les joueurs sur un
évènement quelconque. La relative modicité de ces sommes
d'argent permet d'affirmer sans risque d'erreur, que les jeux d'argent sont
accessibles non seulement aux commerçants, mais à toutes les
couches sociales de la population urbaine. Une observation qui devient encore
plus pertinente lorsqu'on découvre que la majorité des
enquêtés, soit 74.61 % affirment qu'ils sont eux-mêmes
responsables du financement de leurs jeux. Le reste étant aidé
soit par leurs camarades, soit par leurs parents (ce qui est un peu rare).
Le tableau suivant présente cette situation.
81
Tableau 5 : Origine des sommes d'argent
consacrées aux jeux
|
Source de financement des
jeux
|
Effectifs
|
Proportions (%)
|
|
Parents
|
5
|
3.84
|
|
Camarades/Amis
|
8
|
6.15
|
|
Joueur lui-même
|
97
|
74.61
|
|
Abstention
|
20
|
15.38
|
|
Total
|
130
|
99.98
|
Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
Ces jeux qui donnent donc la possibilité au joueur de
remporter d'importants gains contre une faible mise font par ricochet
émerger trois moments déterminants dans la « carrière
» du joueur. Il s'agit entre autres des gains, des pertes et du
désespoir. Comme nous le rapportait l'informateur L. ABDOU, cordonnier
et joueur de Carte appréhendé à Mokolo, expliquant son
accoutumance aux jeux d'argent à travers ces propos :
Il y'a tout le temps des gens parmi lesquels mes amis du
marché ici qui jouent à la Carte sous ce hangar (...) J'ai
été tenté à l'idée de les rejoindre parce
qu'ils me disaient qu'ils y gagnent pas mal d'argent ! J'ai commencé par
être un simple spectateur et par la suite, j'ai pris goût au jeu.
Je dois vous avouer que mes deux premières semaines ont
particulièrement été fructueuses, car je rentrais en
moyenne avec quatre mille francs par jour, cela me permettait de
résoudre mes petits problèmes.
82
À la question de savoir si c'était la chance du
débutant, l'enquêté répond en ces termes :
« J'avais le sentiment d'être devenu un expert à la
Carte, puisque je gagnais régulièrement en ne misant que cent ou
deux cents francs. Mais au vu de mes gains, j'en suis venu à miser une
somme de dix mille francs ! ». Forcément, il lui est donc
arrivé de perdre. Car, comme le conclut l'enquêté
lui-même, « il faut savoir que c'est aussi ça le ndjambo
! Gagner c'est bien mais après, il faut cotiser pour les autres
».
En effet, dans un premier temps, il peut arriver qu'au
début du jeu, le joueur accumule une série de succès, tant
il bénéficie soit de nombreux petits gains ou encore d'un gain
important. À ce moment, tout va bien pour lui à tel point qu'il
commence à surévaluer ses chances de gains et met à la
disposition du jeu des sommes plus élevées. Le jeu lui apporte
des sensations et comble ses désirs. Mais après l'euphorie,
apparaît l'affliction : c'est la phase des pertes. Le joueur enregistre
une succession de revers, il joue mais c'est sans succès prolifique.
Parce qu'il veut regagner l'argent engloutit dans le jeu, il devient
irrésistiblement attiré par le jeu à quoi il consacre
beaucoup de temps. Le jeu prend alors les proportions d'une réelle
obsession au point où l'argent si souvent initialement destiné
à d'autres fins comme la scolarité, la nourriture ou les soins de
santé se retrouve dilapidé. Et lorsque l'espoir du gain devient
déraisonnable, il rentre dans une phase de désespoir : il devient
extenué et souffrant. D'après M. VALEUR et al (2000
:52-53), « le suicide, l'incarcération et l'appel à
l'aide semblent être ses seuls options ». Car, face aux
difficultés qui s'accumulent pour lui, il continue de penser que seul le
jeu pourra l'aider à s'en sortir. Il joue alors machinalement, avec un
fond d'espoir de gagner.
En revanche, si la plupart des commerçants
entourés par les points de jeux dans les marchés, les
stationnements et les gares routières estiment qu'un tel investissement
est justifié au regard de la faiblesse des mises et les importantes
sommes d'argent proposées, il est certain que les jeux d'argent soient
nuisibles au commerce et à la prospérité. Selon R. BRENNER
et G. BRENNER (idem, p.17) :
Les loteries ont soutiré de manière injuste
et frauduleuse d'importantes sommes d'argent aux enfants et aux domestiques de
plusieurs gentilshommes, marchands ou commerçants (...) et elles ont
mené plusieurs familles à la ruine et à la
pauvreté.
83
Ce point de vue laisse percevoir que la présence des
lieux de jeux d'argent dans les marchés et autres lieux de
rassemblements populaires est un fait particulièrement grave pour les
commerçants. En réalité, loin de satisfaire à leurs
besoins d'acquérir plus d'argent, cette pratique symbolise plutôt
la paupérisation, la ruine soudaine et la destruction des familles,
quand elle n'a pas conduit au suicide.
3. Conscription aux jeux d'argent : entre verrouillage du
dedans et libération des passions du dehors chez les
salariés
Comme le soulignait A. CAMUS cité par A. FRANQUEVILLE
(1984 :10), « une manière commode de faire connaissance d'une
ville est de chercher comment on y travaille, comment on y aime et comment on y
meurt ». Sans suivre à la lettre cette réflexion, nous
souhaitons apporter dans cette section, une présentation des
activités telles qu'elles se déploient dans la ville de
Yaoundé, dans l'intention d'établir un rapport avec les pratiques
ludiques des citadins. Cette exigence de travail s'avère d'autant plus
importante que dans toutes les catégories socioprofessionnelles et
secteurs d'activités, la pratique des jeux d'argent est un fait. En
milieu urbain, le recours à ces formes de pratiques ludique
dépend d'abord de la capacité financière des acteurs, en
rapport avec leurs obligations sociales ou le degré de
réalisation de leurs besoins. Ce cheminement peut se résumer dans
le schéma ci-après : Activité principale ? Revenus moyens
mensuels ? Aspirations sociales ? Jeux pratiqués. Ce schéma
résume le cycle qui conduit au jeu et est déterminé par la
variable de revenus financiers des individus à partir de leur
activité principale.
En effet, dans une ville comme Yaoundé, les pratiques
ludiques se réinventent et prolifèrent au quotidien.
Parallèlement, les revenus des joueurs ainsi que leurs aspirations
sociales varient. Si l'on se pose donc la question de savoir quelle relation
directe lie : l'activité économique ? les revenus financiers des
joueurs ? les aspirations et le jeu pratiqué, la réponse à
ce questionnement peut être appréhendée dans l'analyse des
revenus financiers des joueurs qui va suivre.
84
Figure 3 : Distribution des
enquêtés selon leurs revenus moyens mensuels
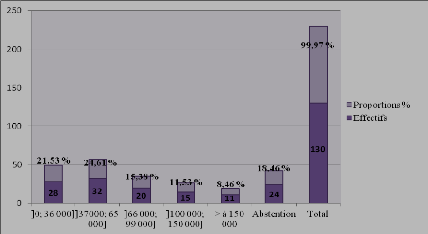
Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
Les données consignées dans ce graphique
permettent de constater que 21.53 % des enquêtés perçoivent
un dû mensuel inférieur ou égal à trente-six mille
francs. Cette catégorie d'acteurs est constituée d'adolescents
joueurs, d'élèves, des étudiants et dans certains cas, des
désoeuvrés. Ensuite, 24.61 % de joueurs exercent une
activité rémunératrice de revenus financiers à
hauteur de soixante-cinq mille francs. À ceux-là, viennent
s'ajouter 15.38 % d'individus qui gagnent moins de cent mille francs mensuels.
Ce sont pour la plupart, des personnes exerçant un petit métier
ou encore des « débrouillards », donc des personnes sans
emploi fixe pour qui le jeu constitue un enjeu de compensation aux ressources
financières déjà insuffisantes, qu'ils obtiennent à
partir de leur activité principale.
Plus encore, une proportion de 11.53 % d'enquêtés
ont des revenus compris entre cent et cent cinquante mille francs ; 8.46 %
d'entre eux gagnent plus de cent cinquante mille francs. Ceux-là se
comptent parmi les entrepreneurs privés, les fonctionnaires et les
personnes exerçant une activité économique stable. Leur
jeu peut être associé à une activité secondaire ou
encore, comme un moyen pour eux d'arrondir les fins de mois. En outre, 18,46 %
d'enquêtés n'ont pas répondu à cette question. Au
cours de nos investigations, il nous a été rapporté par
d'autres joueurs, que ces personnes se comptent aussi bien parmi les
travailleurs salariés que les chômeurs. Sans vouloir recourir
à de quelconques substitutions, cette variable
85
a été conservée. Comment donc expliquer
ce regain d'intérêts pour des pratiques ludiques à but
lucratif chez des personnes plus ou moins intégrées dans les
secteurs de production ?
En réalité, dans la ville de Yaoundé, la
montée de l'individualisme et la promotion de nouveaux territoires
d'accumulation de gains providentiels sont à la source des mobilisations
collectives autour des jeux. Autrement dit, c'est la dépréciation
de la valeur travail au profit d'une « économie-ndjambo » qui
prend cours avec l'avènement d'une nouvelle rationalité qui
coïncide avec un accroissement plus ou moins décomplexé des
revenus financiers chez les travailleurs. Dès lors, une notion
émerge : celle de SMIG ou minimum vital qui est explicitement introduite
dans le statut de tous les employés, quelle que soit la tranche
d'activité exercée. En réalité, au Cameroun,
malgré la publication du décret no 2014/2217/PM du 24
juillet 2014 portant revalorisation du SMIG qui dans la foulée, est
passé de vingt-huit mille deux cent seize à trente-six mille deux
cent soixante-dix francs, il n'en demeure pas moins vrai que ce pays bien
qu'étant la « locomotive » en Afrique centrale, dispose de
l'un des SMIG les plus faibles parmi les pays de la
sous-région8.
Étant donné qu'« on n'a pas
assisté à des hausses fortes de revenus, et cela est aussi vrai
des revenus des fonctionnaires, des salariés du secteur formel »
N. RIBAUD (1991 :78), il va de soi que, malgré les souffrances
endurées par les travailleurs pendant leur occupation, on comprend que
la notion de minimum vital se trouve toujours placée au centre des
préoccupations salariales. Les propos suivants d'un
enquêté, D. NJENG, âgé de 32 ans et
préposé des douanes appuient ce constat. Selon lui :
Vous pensez qu'être fonctionnaire met quelqu'un
à l'abri du besoin ? Croyez-moi, la fonction publique ne donne rien
(...) moi par exemple, je suis sur avance de solde depuis sept mois ! Avec une
femme et trois enfants à la maison, ce n'est pas du tout facile. Je
cherche comme ça les voies et moyens de racolage de sous pour pouvoir
gérer ma petite famille.
À travers ces déclarations, on comprend que le
jeu d'argent n'épargne aucune catégorie socioprofessionnelle de
la population urbaine à Yaoundé. Cela peut laisser voir que le
travail ne paye plus. Un agent de sécurité gagnant par exemple un
salaire de quarante-cinq mille francs est en voie de se poser des questions,
qui inexorablement aboutiront aux
8 Cf. http: www.cameroon
voice.com/news/article-news.
86
conclusions que ; seul l'investissement au jeu et la course
vers les jackpots sont désormais rentables. Le Loto, le PMUC et
le pari foot viennent renforcer cette vision qui tend à
dévaloriser, à négliger et à mépriser la
valeur du travail. Dès lors, pour ces individus qui ne pensent
qu'à survivre, les jeux deviennent des valeurs refuges : pourquoi donc
s'émouvoir à travailler dix années durant, pour accumuler
une somme d'argent que l'on peut gagner en une journée, simplement en
trouvant l'ordre d'arrivée à la course des chevaux ?
Disons plutôt que, la pratique des jeux d'argent dans
cette catégorie de la population urbaine n'est qu'une suite des
« procédures de la créativité quotidienne »
M. De CERTEAU (1990 :39), de ces gens qui pour la plupart, vivent au jour
le jour en « prenant la vie comme elle vient » selon une expression
du sens commun à Yaoundé. Un comportement qui pose ainsi que le
fait remarquer J.M ELA (1998 :46), « les fondements d'une autre
économie en rupture avec la rationalité marchande qui enferme les
millions d'hommes et de femmes dans le dénuement et la
précarité ».
Au-delà de l'aspect économique inhérent
aux pratiques de jeux d'argent, c'est aussi la dépravation d'un
système de valeurs qui prend cours chez les salariés, qui se
voient contraints de recourir à des stratégies dites «
banales » ; en l'occurrence la pratique des jeux d'argent pour assurer un
certain équilibre financier. Si bien que dans l'opinion publique,
d'aucuns parlent même d'une « morale qui a foutue le camp ». En
réalité, l'insatisfaction des salariés quant à
leurs revenus avec le foisonnement des sociétés de jeux d'argent
dans les villes qui scandant au quotidien le bonheur rêvé, on voit
éclore dans cette catégorie de la population une « morale de
conscience » que M. WEBER (1963 :202-206), appelle « l'éthique
de la conviction », au détriment de « l'éthique de la
responsabilité ». Mieux encore, il peut s'agir d'une maxime du sens
commun qui prévaut que « tous les moyens sont bons quand ils sont
efficaces ». C'est pour cette raison qu'on peut aisément
appréhender les fonctionnaires et autres agents des secteurs publics et
privés dans les lieux de jeux à Yaoundé, comme l'indique
l'image suivante :
87
Photographie 12 : Une attitude des
fonctionnaires de police joueurs d'argent

Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
Sur l'image précédente, figure les agents des
forces de maintien de l'ordre en uniforme qui sont agglutinés devant un
kiosque de pari sportif à « Simbock », un quartier de
Yaoundé. Délaissant leur activité au profit du jeu, on
peut comprendre qu'en raison d'un accroissement plus ou moins
décomplexé des revenus de cette catégorie de travailleurs,
leur participation aux jeux d'argent est de fait légitime. Ils
s'investissent dans ces pratiques qui leur apparaissent volontiers comme un
moyen leur permettant d'arrondir leur budget ou de « joindre les deux
bouts ». Le jeu devient pour ainsi dire, une pratique ludique en situation
économique déterminée, c'est pourquoi dans une
étude menée sur la variable de fidélité aux
différents jeux de hasard, O. NEWMAN (1972), constate qu'une plus grande
proportion de salariés s'adonne aux jeux d'argent. Par
conséquent, on peut affirmer sans risque d'erreur que le goût du
jeu est avant tout un goût prolétaire chez les salariés.
De cette manière, nous avons pu observer que les «
hommes en tenue » un peu plus que toutes les autres catégories
socioprofessionnelles à Yaoundé, participent beaucoup aux jeux
d'argent. Ils misent généralement à la Carte, au Ludo ou
au damier etc., dans leurs lieux de services parce qu'ils affectionnent le
risque et ont souvent du temps libre en journée, pour ceux qui sont de
garde toute la nuit. Ce qui les met alors dans un état d'oisiveté
et du coup, à la recherche d'excitation et sensations. Davantage, ces
militaires, policiers et gendarmes jouent au poker, au PMUC ou au pari foot
dès la paie à la fin du mois dans l'espoir de gagner et
d'augmenter par-là, leurs revenus financiers. Dans les salles de jeux,
ils sont souvent
88
indexés d'être les auteurs des déviances
parallèles comme : bagarres, intimidations à l'arme, ivresse,
agressions verbales etc., quand ils s'aperçoivent qu'ils ont
été ruinés. Ces attitudes sont par conséquent, de
nature à inciter plusieurs jeunes à se lancer à leur tour
dans cette pratique, quand ils voient ceux qui de plus en plus, sont
considérés comme modèles dans notre société
afficher de tels comportements, tous vêtus de leur uniforme de
service.
Au terme de ce chapitre, il résulte que les personnes
les plus enclines à s'adonner aux jeux d'argent sont celles qui ont un
facile accès à leur forme de jeu préférée,
sont influencées par les publicités de jeux
médiatisées. Ces publicités vont parfois jusqu'à
leur présenter des modèles de réussite pour qu'ils
s'expriment à leur tour dans la réalité. Ces facteurs
touchent particulièrement les individus en manque d'occupation, ayant
perdu leur emploi, ceux à la retraite ou encore les paresseux en proie
à un gain providentiel. Ceux-ci sans émettre d'autres
hypothèses, risquent leur argent dans ces jeux parce qu'ils ont des
défis financiers à relever. On peut donc comprendre que l'effet
des médias et la mobilité des acteurs constituent des facteurs
déterminants, qui contribuent à propulser les jeux d'argent sur
le devant de la scène sociale en milieu urbain. Car à
Yaoundé, les individus ne sont plus seulement adeptes du jeu par passion
mais davantage, par nécessité économique. Cette posture
n'est pas sans conséquences sur la vie du joueur et les transformations
sociales qui s'opèrent dans son entourage.
89
CHAPITRE III
AMPLIFICATION DES PRATIQUES DE JEUX D'ARGENT
ET
CHANGEMENT SOCIAL
I. LES TRANSFORMATIONS SOCIALES ENGENDRÉES PAR
LA PRATIQUE DES JEUX D'ARGENT SUR LA SOCIÉTÉ URBAINE À
YAOUNDÉ
Dans son ouvrage intitulé : La Culture du nouveau
capitalisme, R. SENNETT (2006 :28), parle de la fragmentation des
institutions en s'appuyant sur « la thèse de la nouvelle page
», où il constate que la société a
évoluée à partir de la perte d'autorité des
institutions étatiques au profit des entreprises. Des changements ont
alors été notoires sur deux points principaux à savoir :
le travail et la consommation. Il est par conséquent intéressant
d'observer dans le cadre de cette étude, que la prolifération des
jeux d'argent à Yaoundé semble accompagner le changement de
perception et de valorisation du travail ; dans un contexte où perdus
dans une pensée à court terme, les individus sont aveuglés
dès qu'il s'agit de se projeter dans l'avenir, pour y voir les
défis qui devront être relevés. Ici, l'angoisse du futur
problème cède la place à la panique et la vie au jour le
jour, sans penser au lendemain permet de s'éloigner tant bien que mal
des préoccupations quotidiennes. Les individus ayant trouvé la
possibilité de s'en sortir dans le domaine ludique, l'on voit se
développer une sorte de nouveaux paradigmes de quête d'argent,
c'est à dire des formes prolifiques apparemment « faciles »
qui n'impliquent ni contraintes physique ou intellectuelle.
C'est dire que la pratique des jeux d'argent par les
populations de Yaoundé dépasse largement le seul cadre du
divertissement pour gagner tous les aspects de la vie quotidienne. Elle
possède aussi une capacité de nuisance sociale beaucoup moins
apparente, mais qui est à prendre avec beaucoup d'intérêts.
Dans cette section, il est question d'appréhender la
prépondérance de cet « aboutissant » sur les
entités sociales comme la famille et sur la société
urbaine prise de façon globale. Pour ce faire, il est judicieux de
s'appesantir un tant soit peu, sur la classification des jeux de R. CAILLOIS
(1969 :122), dans laquelle il définit pour chacune des rubriques, une
dérive potentielle qui peut s'exprimer dès lors que le jeu en
question perd sa deuxième qualité de « séparé
». Cette caractéristique est importante, tant il est vrai que si la
« séparation » entre le jeu et la réalité est
rompue, de nombreux vices humains sont ainsi libérées. On a : la
superstition pour un jeu basé sur l'aléa et
l'aliénation
90
pour un jeu basé sur le simulacre. Au centre de toutes
ces dérives, se trouve la problématique de la dépendance
au jeu dont il convient de faire une analyse.
1. Dépendance aux jeux d'argent et rapports
d'exclusion sociale
La dépendance au jeu est un état où
malgré une conscience plus ou moins aigue des problèmes
liés à cette pratique, l'individu n'est pas capable de
contrôler ses ardeurs. La dépendance au jeu touche les personnes
différemment. Certains joueurs la développent soudainement tandis
qu'elle se manifeste chez d'autres progressivement, à long terme. On la
retrouve également dans tous les groupes d'âge, groupes de
revenus, groupes d'emplois etc. Plusieurs raisons expliquent pourquoi la
dépendance au jeu se manifeste. Par exemple chez certains joueurs, elle
survient lorsque ceux-ci tentent de récupérer l'argent qu'ils ont
perdu. D'autres par contre, connaissent de nombreux stress dans leur vie
quotidienne que seul le jeu permet d'atténuer. Dans de tels cas, le jeu
devient un problème plus qu'une simple question d'argent en ce sens
qu'il touche tous les aspects de la vie du joueur, nuit à son travail,
à ses études ou à d'autres activités, il
entraîne des difficultés financières, des problèmes
en famille ou avec son entourage. Dès lors, une distinction doit
être faite entre une pratique du jeu occasionnelle, une pratique
régulière et une pratique excessive qui débouche sur des
comportements dépendants.
Figure 4 : Corrélations entre la
fréquence aux jeux d'argent et le niveau de dépendance
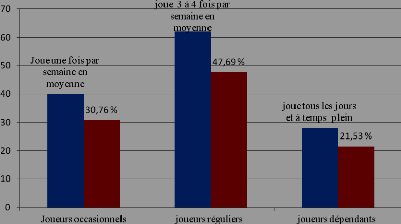
Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
91
Dans cette figure, on peut observer que 30.76 % de Joueurs
sont classés dans la catégorie des joueurs occasionnels. La
plupart de ces gens jouent socialement, en moyenne une fois par semaine et de
façon discontinue. Ils se procurent de temps en temps un ticket de
loterie ou se rendent par moment dans une salle de jeu, pour tenter la chance
de décrocher un gain : ce sont des joueurs sociaux pour qui le jeu garde
un caractère limité. À priori, ils ne le
considèrent pas tellement comme un mécanisme financier. Ensuite,
47.69 % d'enquêtés sont des joueurs « réguliers
». Ce type de personnes jouent constamment, environ trois à quatre
fois par semaine et de façon systématique. Le jeu
représente pour eux la principale forme de loisir, mais ne passe pas
avant la famille et le travail. Par contre, 21.53 % de Joueurs sont des joueurs
dépendants. Cette catégorie de joueurs à une
fréquence de participation quotidienne à ces jeux qu'ils
pratiquent même plusieurs fois par jour, en y consacrant tout leur temps
et une bonne partie de leurs avoirs. Ce sont des personnes qui gardent du jeu,
le souvenir d'un gain qui stimulerait davantage leur motivation à se
refaire, oubliant qu'une fois dans la spirale du jeu, l'obsession du gain se
transforme en besoin de récupérer les pertes engendrées
par un jeu régulier.
Pour mieux comprendre l'obsession des joueurs pour ce type de
jeux, il est intéressant d'observer le tableau qui va suivre, où
les enquêtés se prononcent sur leur addiction aux jeux
d'argent.
Tableau 6 : Répartition des joueurs
selon la justification de leur addiction aux jeux d'argent et aux
difficultés d'arrêter de jouer
|
Variables
|
Effectifs
|
Proportions (%)
|
|
J'ai essayé en vain
|
28
|
21.53
|
|
Je n'y ai jamais pensé
|
60
|
46.15
|
|
Aucune réponse
|
42
|
32.30
|
|
Total
|
130
|
99.98
|
Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
92
La tendance qui se dégage de ce tableau est que, la
même proportion de joueurs dépendants ; 21.53 % telle que vu dans
la figure précédente est celle des joueurs qui, malgré de
multiples efforts consentis pour arrêter de jouer, n'ont pas pu se passer
du jeu à long terme. Certains parmi eux affirment qu'ils ont quelquefois
rompu avec le jeu des mois durant, mais par la suite, ont renoué avec
ces pratiques parce que disent-ils, n'arrivaient plus à surmonter les
pressions internes et certaines difficultés financières. Ils sont
conscients des problèmes qu'apporte le jeu dans leur vie, ils veulent
s'en passer mais c'est sans succès. Aussi, 46.15 % de joueurs
n'envisagent pas encore de mettre fin à leurs jeux parce qu'ils n'ont du
jeu qu'une idée positive, celle de pouvoir les enrichir. Et comme ils
sont motivés par des gains réguliers, cette catégorie de
joueurs a peu conscience des conséquences négatives de cette
pratique sur leur vie familiale et sociale.
Parmi les enquêtés, 32.30 % n'ont pas
répondu à cette question. Ce non-dit trahit en quelque sorte,
leur incapacité de se passer du jeu parce qu'ils essayent
déjà de récupérer l'argent perdu. Ils sont dans une
phase initiale de la dépendance dont-t-ils en ont conscience, raison
pour laquelle ils refusent d'assumer publiquement leur statut de joueur
dépendant ; d'autant plus qu'on n'avoue pas facilement ce genre de
comportement. Inévitablement, le jeu engendre des conséquences
néfastes dans plusieurs aspects de leur vie. Parmi ces
conséquences, on voit émerger :
1.1. La détérioration du cadre de vie
familial du joueur et ses corolaires
Si la famille est considérée comme
l'élément clé de la structure de base de toute
unité sociale, c'est d'abord parce qu'elle constitue une force de
stabilité pour l'individu sur le plan social. C'est à travers
elle qu'il reçoit ses premières sanctions (positives ou
négatives). Raison pour laquelle en matière de pratique de jeux
d'argent, elle sera amenée à exercer une sorte de contrôle
social sur le joueur, afin que le jeu ne soit pour lui qu'un loisir. Le joueur
doit donc se livrer comme l'a prescrit J. DUMAZEDIER (1962), à ces jeux
après s'être dégagé de ses obligations familiales,
professionnelles et sociales. Ce qui semble pourtant ne pas être toujours
le cas dans une ville comme Yaoundé, où les jeux d'argent
apparaissent pour beaucoup, comme un moyen par lequel certains individus
veulent s'acquitter de leurs obligations familiales et professionnelles. C'est
pourquoi G. FOSTER cité pat R. BRENNER et G. BRENNER (idem, p. 69),
disait que :
93
L'homme qui s'en va sans déjeuner et prive ses
enfants de souliers pour pouvoir acheter chaque semaine son billet de loterie
n'est pas un bon à rien ; il est le Horatio Alger de son temps : il fait
ce qu'il estime le mieux pour améliorer sa situation (...) le sort
s'acharne contre lui, mais c'est le seul moyen qu'il connaisse pour
réussir.
Cette observation révèle en
réalité le comportement de plusieurs chefs de ménages
adeptes des jeux d'argent dans la ville de Yaoundé, dont la pratique du
jeu peut « déraper » de manière à ce qu'ils
subissent plus leur comportement qu'ils ne le contrôle. À ce
moment, le jeu prend la dimension d'un phénomène qui s'inspire
plus largement de références exogènes et souvent
dépourvues de tout contexte social. Il bouleverse un cadre de vie qui
s'était préalablement constitué et se manifeste par un
relâchement des liens familiaux et plus largement des liens sociaux avec
parfois une difficulté pour le joueur de réaliser les
transformations sociales qui s'opèrent dans son entourage. Une
informatrice, N. EMEYENE, agent commerciale à l'entreprise «
Roisbet » et fille d'un père joueur d'argent, ayant subi les affres
du jeu, les exprimaient en ces termes :
Quand papa a été licencié de la SOTUC
dans les années 92-93, nous sommes rentrés vivre au village,
à « Zamengoué » parce qu'il n'y avait plus d'argent
pour supporter la vie à Yaoundé. Arrivés là-bas, au
lieu qu'il se batte dans l'agriculture comme le faisaient ses frères, il
préférait plutôt passer toutes ses journées au
carrefour à jouer au PMUC, au Damier, au Songo etc., et à boire
le vin en compagnie de ses amis (...) Mais de retour à la maison en
soirée, il exigeait quelque chose à manger. Maman était
donc obligée de s'endetter, de faire les champs, le commerce, pour
s'occuper de nous !
94
Des cas similaires se comptent par centaine dans la ville de
Yaoundé, ce qui reste pourtant sans incidence sur le nombre d'adeptes de
ces jeux, qui ne cesse de croître chaque jour. C'est ainsi que pour les
femmes de joueurs, le tribut à payer est souvent très lourd :
elles se retrouvent à vivre dans un stress permanant, dans l'obligation
de travailler pour payer les dettes du mari, de mentir aux enfants etc. La
pratique du jeu conduit donc à la réduction du champ relationnel
du joueur. Ses liens familiaux s'amenuisent, fragilisant l'autorité
parentale et les modes de protection sociale. Parce qu'en
réalité, les hommes qui passent des journées
entières dans les lieux de jeux, ne peuvent veiller sur
l'éducation de leurs enfants, encore moins de leur apporter l'affection
paternelle. Quand ils ressortent dépossédés après
avoir joué, ils deviennent incapables d'assumer leurs
responsabilités basiques comme le paiement du loyer, l'alimentation, la
scolarisation, les soins médicaux etc. Le témoignage d'un autre
enquêté ; G. TCHAMI, âgé de 41 ans et transporteur
à moto au quartier Mvog-Ada, trahit le niveau de frustrations
occasionnées par le jeu dans sa vie conjugale en ces termes :
Quand ma femme vivait avec moi, je ne voyais pas vraiment
son importance (...) je passais la plus grande partie de mon temps dans les
salles de jeux, ce qu'elle ne supportait pas. J'ai tout fait pour changer mais
vous savez ? on ne fuit pas la machine (poker) ! C'est l'une des raisons pour
lesquelles elle a décidé de partir, d'autant plus que ces jeux me
ruinaient énormément.
C'est dire que certains joueurs, même s'ils sont
conscients des dégâts que peuvent engendrer la pratique des jeux
d'argent dans leur vie, n'abdiquent pour autant pas. Les déclarations de
l'enquêtée V. NDJOCK, soeur cadette d'un joueur
invétéré en disent davantage :
95
Mon grand frère est un accroc de tout ce qui
s'appelle jeu d'argent. Depuis des années, il joue au poker, à la
Carte, au PMUC, au pari foot etc. Quand il a besoin d'argent pour assouvir ses
pulsions de jeu, il est prêt à hypothéquer ou à
vendre n'importe quoi chez lui ! Et non seulement il déménage
chaque année pour des arriérés de loyer, mais il fait
constamment la cellule en raison du fait qu'il violente souvent des gens
après avoir perdu au jeu.
Les jeux d'argent sont parfois cruels et peuvent devenir le
théâtre de véritables drames. Les exemples mettant en
scène des comportements déviants de joueurs qui jouent leur
destin, éventuellement jusqu'au point de se suicider sont nombreux.
C'est ainsi que dans ces penchants cupides et avides des femmes joueuses, c'est
l'argent de la ration parfois mensuelle que l'on perd parce qu'elles
espèrent gagner le double, voir le triple de leurs avoirs lorsqu'elles
sont piquées par le virus du jeu. L'informateur A. MBEDE, « katika
» dans une salle de jeu d'un bar à Mvog-Ada, nous édifiait
sur le cas d'une gardienne de prison à la retraite. Celle-ci,
régulièrement après avoir perçu sa pension, arrive
dans la salle où elle joue et perd parfois la totalité de son
argent au poker. Ayant réalisé des emprunts auprès de sa
banque et au sein d'une association paroissiale dont elle est membre, elle se
retrouve aujourd'hui excommuniée à l'église. Et tout le
temps, elle fait pression sur ses enfants pour obtenir de quoi se nourrir et
payer ses dettes.
Du même informateur, on apprend un autre cas, celui de
V. KOUÉ, un garçon trentenaire, « débrouillard »
au quartier Odza. Commissionné par sa voisine pour lui acheter deux
bouteilles de gaz, il fait escale dans une salle de jeu où il perd la
totalité de l'argent, (quinze mille francs) dans une machine à
sous. Le « katika » de la salle se propose de lui restituer en
échange des bouteilles de gaz, la somme investie au jeu pour tenter de
nouveau sa chance. Après avoir tout perdu, il éteint son
téléphone et fugue vers le quartier Nkomo chez sa tante,
où il passera deux semaines loin de son domicile, le temps pour lui de
trouver l'argent nécessaire pour réparer le préjudice.
Un autre homme du même âge, manutentionnaire dans
un dépotoir de bois et habitant le quartier Ékié à
Yaoundé, se voit confier une importante somme d'argent par son
beau-frère, alors propriétaire du dépôt. Celui-ci
avait pour mission de se rendre à Ayos, une ville située à
cent quarante kilomètres de Yaoundé, pour acheter des chevrons
devant réapprovisionner le
96
dépôt. Malheureusement, cet argent finira dans
les machines à sous. Simulant une agression dans un premier temps
à son beau-frère, ce dernier tombé en faillite, restera
intransigeant et l'enverra finalement en prison.
Un autre exemple met en scène la famille Zoa au
quartier Effoulan en 2013. À l'occasion de l'organisation des
obsèques de leur mère décédée un mois
auparavant, une somme d'un million deux cent mille franc fut confiée
à Eric, son fils aîné. Ce dernier avait la charge d'acheter
le cercueil et les vêtements de la défunte, de payer les frais de
morgue ainsi que le corbillard devant transporter la dépouille de sa
mère jusqu'au village « Ngoazip », dans la région du
Sud. Malheureusement, sa condition de joueur a fini par remporter sur les
funérailles : cet argent sera entièrement dilapidé dans un
casino, deux jours avant la date prévue pour la levée de corps.
N'ayant rien dit à personne, Eric s'est enfuit et sa famille est sans
nouvelle de lui jusqu'à ce jour.
De cette manière, considérer les jeux d'argent
et les milieux où ils se pratiquent dans leur seul aspect ludique,
permet à dessein d'oublier les effets néfastes que leur obsession
impute au cadre de vie familial du joueur. Cette obsession qui sévit
particulièrement dans les couches populaires, les prive le plus souvent
des ressources financières généralement insuffisantes,
voire capture une partie de leur épargne. C'est ainsi que les mises de
quelques dizaines à de centaines de milliers de francs CFA au PMUC, au
Pari foot ou dans les machines à sous représentent
déjà des sommes importantes pour de nombreux joueurs issus des
couches modestes de la population. Ces économies systématiquement
englouties au jeu entraînent inévitablement des privations, des
humiliations, des dépossessions financières et les conduisent
à l'incapacité de subvenir à leurs besoins.
La pratique des jeux d'argent apparaît donc comme une
addiction à la source de plusieurs dérèglements, voire des
drames sociaux d'un nouveau type tels que : déstabilisation de
l'individu, délits pour se procurer de l'argent nécessaire pour
jouer, endettements, ruptures des liens familiaux, paupérisation etc.
1.2. De l'obsession du jeu à la
déchéance sociale du joueur
« Jouez votre passion ! » est un label
fréquemment utilisé par les promoteurs de jeux et les joueurs
dans les milieux de paris sportifs et hippiques de la ville de Yaoundé.
Cette formule appelant à une pratique émotionnelle,
incontrôlée et obsessionnelle du jeu fait en sorte que le joueur
se retrouve quelquefois socialement isolé et hors du temps de
référence qui rythme la société. Ici, le jeu est
traité comme une ivresse qui entraîne simultanément deux
97
types de destructions : la destruction morale et la
destruction sociale. En effet, lorsque l'obsession du jeu prend le
contrôle de la vie du joueur, elle provoque un type d'addiction sensitive
que l'on retrouve dans le comportement du drogué, mais à la seule
différence qu'il n'y a aucune ingestion de substance. Cette
frénésie du jeu se caractérise par un conflit de
personnalité en ce sens qu'elle place le joueur dans un état
d'étrangeté et 1'isole quelque temps de toute
préoccupation extérieure. Par la suite, elle se transforme en une
fascination qui abolit toute perception rationnelle de la
réalité, en plongeant le joueur dans une hibernation où la
seule chose qui trotte dans son esprit est de devenir millionnaire à
tout prix.
Les conséquences de cette déviation sont de plus
en plus perceptibles dans la ville de Yaoundé, où il n'est plus
rare de voir des gens au sortir des lieux de jeux, marcher en parlant à
eux même. Certains parmi les étudiants même en plein cours,
sont connectés aux sites
www.direct24.com,
www.livescores.com, ou
www.maxifoot.com, où
ils passent leur temps à vérifier si les équipes sur
lesquelles ils ont parié sont victorieuses. Ceux qui possèdent un
poste téléviseur à domicile, restent figés toute la
nuit devant l'écran à visionner les matchs de leurs
équipes favoris au détriment des cours reçus en
journée. Ce comportement peut être associé à un
mauvais rendement à l'école.
Pour les travailleurs, c'est l'intérêt du jeu qui
prime parfois sur l'activité et se manifeste entre autres par les
absences injustifiées, les retards au service, la baisse de rendement,
les abandons de service ou encore des détournements de fonds au profit
de la pratique de ces jeux. C'est fort de cela, qu'il est de plus en plus
fréquent d'assister à des querelles, voire des bagarres entre
propriétaires de moto-taxi et leurs employés pour des recettes
non versées, quand il ne s'agit pas de déposer une plainte dans
une brigade de gendarmerie ou un commissariat de la place pour abus de
confiance. C'est pour cette raison qu'E. DEVEREUX (1980 :807), affirme que :
Le parfait salarié de la classe moyenne peut perdre
son travail pour des raisons qui échappent en partie ou
entièrement à son contrôle (...) et le fait de s'être
adonné au jeu peut lui apparaître comme un effet secondaire qui
s'inscrit dans un enchaînement d'événements.
98
L'obsession du jeu peut donc être un fait
préjudiciable au service public et à la carrière
professionnelle de celui qui les pratique. Au sens d'E. BELMAS (2006 :60),
« la passion du jeu est la plus funeste dont on puisse être
possédée ». Elle devient encore plus inquiétante
dès lors que certains individus arrivent à dépenser plus
d'argent qu'ils n'avaient prévu, jouent pendant de longues
périodes ou encore ne peuvent arrêter de penser à jouer.
Dans de tels cas, F. De SALES, cité par O. THERIAULT (2013 :37), dit que
« le jeu n'est plus un divertissement, mais une occupation
». Chez ces individus pour qui tout leur temps semble dévolu
au « ndjambo », on dirait qu'ils font de la pratique des jeux
d'argent une profession. Et quand ils se retrouvent démunis, ils sont
disposés à des attitudes de parasitisme urbain, d'avidité,
de mendicité ou encore de filouterie. J. DUSAULX cité par O.
THÉRIAULT (idem, p.4), voit en ce type d'obsession : «
cupidité et paresse naturelle en l'homme, qui le poussent à
choisir l'alternative la plus aisée », dans la mesure
où les gens préfèrent risquer leur argent en se remettant
au sort plutôt qu'à leurs aptitudes et leurs talents.
Un autre dessous que suscite l'addiction aux jeux d'argent
émane des études scientifiques Européennes, qui ont
démontré qu'il existe des corrélations entre la croissance
de l'offre de jeux en général et les risques de
dépendance. D'après les rapports de l'INSERM (2008), et de
l'ARJEL (2011), en France, les machines à sous en particulier, en raison
de leurs caractéristiques d'accessibilité, de rapidité,
d'illusion d'adresse et de contrôle, favorisent l'émergence de
nouveaux territoires et de nouveaux comportements liés aux jeux. Ainsi,
en observant l'engouement populaire autour des jeux d'argent dans la ville de
Yaoundé, on pourrait dire que cette pratique participe à ruiner
les codes de moralité naguère en vigueur, qui mettaient en avant
l'idée d'enrichissement lent et par étapes, à travers
l'âge, le travail, l'épargne et l'investissement. Au profit de la
construction d'un destin qui repose désormais sur le pari, le rêve
et l'attente de l'hypothétique jour de chance chez les citadins.
1.3. Jeux d'argent et délinquance sociale
La délinquance est un élément
fréquemment retrouvé dans la pratique des jeux d'argent. Selon J.
HUIZINGA (1949 :60), « les jeux de hasard dans certains cas vont de
pair avec les comportements antisociaux ». En effet, dans les milieux
de jeux, certains fléaux tels que : le banditisme, l'ivrognerie, le
tabagisme etc., sont légion. En plus des scènes de pareilles
natures observées, certains enquêtés nous ont
témoigné qu'ils sont quelques fois eux-mêmes des acteurs,
témoins ou victimes de ces fléaux dans les lieux où se
pratiquent ces jeux.
99
Certains joueurs après avoir été
ruinés, n'hésitent parfois pas à mettre aux
enchères des articles et objets de valeurs en leur possession, parce
qu'ils veulent de l'argent pour poursuivre leur jeu. Un cas qui nous a
été rapporté par « Raphael », un
intermédiaire de jeu rencontré au casino « El Blanco »
du Hilton hôtel de Yaoundé, mettant en scène un agent
comptable. Ce dernier après avoir perdu une somme de près de deux
millions cinq cent mille francs au jeu, est sorti du casino pour mettre son
véhicule de marque « Toyota Avensis » aux enchères
à raison d'une somme de sept cent mille francs. Dans les salles de jeux
et Visio club à travers les quartiers de la ville de Yaoundé,
c'est la vente de téléphones portables, à vil prix qui est
désormais monnaie courante. De ce fait, il n'est plus rare qu'on assiste
à des cas de recel d'objets volés et revendus à la solde
dans les milieux de jeux d'argent.
Dans cet élan, les espaces de jeux se présentent
aussi comme des milieux suspects où peuvent se réfugier des
personnes à la moralité douteuse. En effet, comment comprendre
qu'à des heures tardives, on retrouve dans certaines salles de jeux et
coins de rue des individus en train de jouer ? Ce questionnement pose un double
problème : celui de la réinvention des pratiques dans les espaces
publics que souligne I. JOSEPH (1984 :40), lorsqu'il affirme que « la
seule qualité que les pratiques de l'espace public considèrent
comme pertinente c'est l'accessibilité ». Une raison qui
l'amène à conclure en ces termes, qu'« un espace public
est un espace où l'intrus est accepté » I. JOSEPH
(ibid.). Les cercles de jeux à Yaoundé, sont donc des
espaces d'anomie sociale qui créent une situation de délinquance
perpétuelle. Et dès lors, il n'est pas erroné de
décrire un tel environnement comme « un univers social
où la règle est de pratiquer tous les excès, étant
basiquement une inversion du monde » S. PEREIRA (2002 :80). Une
déviation sociale qui n'est pas sans compter sur l'émergence
d'une pensée à court terme dans l'imagerie populaire des
yaoundéens.
1.4. Jeux d'argent et émergence d'une pensée
à court terme
En observant le joueur yaoundéen dans sa
pratique, on peut s'apercevoir qu'avec les jeux d'argent, il n'y a pas de
planification possible à moyen terme. Pour le dire autrement, il s'agit
d'une « stylisation de l'existence » selon M. MAFESSOLI
(2004 :4), c'est-à-dire d'une logique existentielle propre à ces
acteurs ; elle tire ses fondements de l'instant présent et du
vécu quotidien. La pratique de ces jeux exclut donc toute
possibilité d'épargne du fait que l'argent gagné doit
être réinvesti dans sa totalité, consommé en quelque
sorte. Si l'on se sert des faits observés, la configuration des jeux
d'argent en elle-même n'est qu'une succession d'actions à court
terme : pronostic ? prise de risque ? validité du pronostic ?
récompense. Pas de planification possible, donc pas d'anticipation des
événements futurs. Ici,
100
l'appréhension laisse place à l'angoisse qui
enferme le joueur dans l'immédiateté à peine plus
rassurant, alors que l'épargne est l'outil permettant de répondre
à un désir bien pensé.
Ce court terme conduit le joueur dans un cercle vicieux
inextricable. Autant dire que, l'appât du gain facile endort l'esprit de
certains individus, les incitants à gagner de l'argent rapidement par
des voies moins difficiles et peu orthodoxes. C'est un désir
d'enrichissement par des voies peu scrupuleuses, outrepassant les règles
élémentaires de vigilance au moment où on vous prend tout
ce que vous possédez. Tel est le cas de l'informateur S. EBONGUE, neveu
d'un joueur d'argent, pour qui le jeu représente
désespérément un moyen de rachat d'une fin de
carrière. Ses propos se déclinent ainsi qu'il suit :
J'ai un oncle qui travaillait au cadastre à
Mbalmayo. À un an de sa retraite, il n'avait ni construit de maison, ni
situé ses enfants. Alors il s'en était remis bec et ongles au
PMUC. Son crédo étant que ,
· Dieu pourvoira ! Un jour,
il a gagné à peu près deux cent cinquante mille francs.
Malheureusement, après être rentré en possession de son
argent, il est allé miser à nouveau pour multiplier son gain. Il
a finalement tout perdu (...).
Ce témoignage met en évidence la logique
court-termiste qui sous-tend la pratique des jeux d'argent, où les
joueurs après avoir joué et gagné sont fascinés par
leur gain et projettent immédiatement un autre gain plus important. En
investissant à nouveau, ils en ressortent très souvent perdants.
Pour sa part, l'enquêté R. OKALA âgé de 28 ans et
sérigraphe à Mokolo, moins optimiste quant à sa
capacité à réaliser ses projets à partir des
revenus que lui procurent son activité, estime que :
La majorité des joueurs ici visent le gros lot et
ont des projets en tête au cas où ils venaient à gagner !
Moi par exemple, si gagne les deux millions qui sont sur ce ticket ,
·
je n'achète pas un terrain ? Je ne dote pas ma femme ?
101
De tels exemples montrent que les espaces de jeux d'argent
dans la ville de Yaoundé, sont devenus des lieux de planification et de
projection de la vie jouée à la réalité sociale. La
pratique de ces jeux façonne donc une logique court-termiste, où
l'on évolue désormais dans une configuration : Action--p
Réaction--p Résultat. Cela laisse voir au quotidien des
populations dans les lieux de jeux où le « souci de soi »
M. FOUCAULT (1986), fusionne avec l'activité ludique
pratiquée. En cela, les pratiquants du jeu, par la dramatisation de leur
condition et dans le plaisir qu'ils produisent, créent des «
horizons de refuges » qui participent à « recréer
l'espoir dans une société où tout semble perdu »
G.L, TAGUEM FAH (2001 :29).
1.5. Vers une société de consommation des
jeux d'argent à Yaoundé
Dans la pratique des jeux d'argent, il est important de
souligner que les joueurs ont toujours la propension à investir, puis
réinvestir, c'est-à-dire à « consommer » tout
l'argent de façon consciente ou inconsciente. Ces jeux légitiment
ainsi de l'argent gagné indûment, (sans réel travail) et
dépensé aussi rapidement qu'il a été gagné
par une consommation futile. Dès lors, nous pouvons noter que, la
pratique du « ndjambo » légitime un nouvel aspect à
savoir,
la consommation. Dans cette section, il est envisagé de
le démontrer à partir du contraste
existant entre les mises
investies par les joueurs et leurs gains après avoir joué. En
effet, en analysant le ratio entre les montants moyens des mises mensuelles et
les gains aux jeux des joueurs, il ressort que chez ces acteurs du jeu, les
dépenses sont budgétisées de façon
régulière même lorsqu'elles se soldent par des pertes.
Cette tendance est vue dans le tableau ci-dessous :
Tableau 7 : Budgétisation des jeux et
rapport aux gains des joueurs
|
Sommes inves-
ties par mois
(Frs)
|
[200 à 10.000[
|
[11.000 à 25.000[
|
[26.000 à
40.000 [
|
[41 à 60.000[
|
[60.000 et plus
|
|
Effectifs
|
35
|
48
|
24
|
15
|
8
|
|
Nombre de gains
> ou = aux mises
|
10
|
16
|
11
|
8
|
3
|
|
Proportion des
pertes (%)
|
71.42
|
66.66
|
54.16
|
46.66
|
37.5
|
Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
102
Les données consignées dans ce tableau
permettent de comprendre que l'investissement au jeu est un fait dans toutes
les tranches de revenus mensuel chez les joueurs. Cependant, force est de
constater que ces jeux ruinent particulièrement les « petits
parieurs », c'est-à-dire des personnes dont le montant moyen des
mises se situe entre deux cents francs et vingt-cinq mille francs par mois.
Ceux-là misent de petites sommes sur les concurrents jugés
perdants à l'avance, aux « cotes » plus élevées
et dont les probabilités de sortir gagnant sont réduites, ce qui
leur fait perdre dans la plupart des cas. Par contre les « gros parieurs
», ceux qui misent plus de vingt-cinq mille francs par mois, sont plus
enclins à gagner parce qu'ils hypothèquent d'importantes sommes
d'argent sur les concurrents jugés favoris mais ayant de faibles «
cotes ». En général, ils gagnent des sommes d'argent
relativement supérieures ou égales à l'ensemble de leurs
mises, bien que la proportion de pertes qui se dégage dans chaque
tranche d'investissement aux jeux dans ce tableau montre que les joueurs
gagnent difficilement.
S'il est donc établi que ces dépenses au jeu
s'effectuent de façon régulière dans toutes les
catégories de parieurs, tout porte à constater que malgré
le « je pense donc je suis » cher à R. DESCARTES, la pratique
du « ndjambo » a entrainé dans l'entendement des
yaoundéens, le « je mise donc je suis ! ». En
réalité, la société actuelle est envahie des
messages et des valeurs qui font passer la réflexion du travail et de
l'épargne financière, à des spéculations
boursières autour des jeux. Ce qui aboutit inévitablement
à des crises au sein des ménages, à
l'insécurité financière et matérielle qui ne
cessent de s'aggraver au sein des groupes vulnérables. Car, si à
la fin du mois l'on possède de l'argent avant ou après avoir
payé les biens de consommation incompressible (logement,
vêtements, nourriture), il est mieux vu par la société
actuelle de l'utiliser à des fins de consommation non vitale : le jeu en
l'occurrence.
À cet effet, la figure 3 et le tableau 7 sont
illustratifs si nous prenons le cas d'un salarié qui gagne cent
cinquante mille francs et qui joue en moyenne dix mille francs par semaine. Au
bout d'un mois, il dépense au moins quarante mille francs, qui
représentent pratiquement le quart de son salaire. À cette somme,
il faut ajouter l'argent qu'il débourse pour l'achat des journaux
pronostiqueurs. Or du tableau 7, il ressort que ; quel que soit le montant
investi au jeu, le joueur ne gagne presque jamais. Si ce salarié se
compte donc parmi les perdants, son budget mensuel sera de toute
évidence déséquilibré et
généralement, c'est celui du ménage qui en paye les frais.
Le conjoint ou les enfants subissent ainsi les conséquences de la
consommation du jeu dans la mesure où, il ne leur sera plus possible
dans certains cas de manger à leur faim, de régler les factures
d'eau et d'électricité ou encore des
103
frais de scolarité. Dans le cas d'espèce, nous
avons considéré un montant de mise hebdomadaire relativement bas
pour certains joueurs.
Un autre terme qui met en exergue la consommation des jeux est
« l'achat ». Le terme utilisé est le pouvoir d'achat et non le
pouvoir d'épargne. Le jeu à faible mise incite les
personnes à la pratique, à la consommation au point où
ceux-ci se perdent dans « la passion dévorante » R.
SENNETT (2006 :123). À ce moment, le jeu ne sera plus une consommation
en puissance, mais une consommation de puissance. Et dans cette mouvance,
il y a un réel décalage entre le désir et le besoin,
donc un phénomène de surconsommation ou de dépendance au
jeu. Cette dépendance submerge l'individu pour qui, l'investissement au
jeu devient son obsession, sa drogue. Or en entrant dans la dépendance
au jeu, l'overdose dévore le consommateur à petit feu. Pourquoi
donc investir vingt mille francs dans un jeu pour après entrer dans les
dettes ? Pourquoi risquer la moitié ou la totalité d'un salaire
dans une machine à sous, alors qu'on ne s'est pas acquitté de son
loyer ? Ce sont là des illustrations d'une consommation où les
gens qui disposent d'un peu d'argent, veulent en multiplier pour
accroître leur capital.
2. De la configuration du lien social à travers le
jeu
Au-delà de la recherche du gain qui demeure l'une des
premières motivations chez certains joueurs, le jeu est aussi un moyen
de se détendre, de se distraire, de passer un moment convivial dans une
ambiance feutrée et agréable, seul ou en groupe pour d'autres. Vu
sous cet angle, le jeu est destiné à soulager les émotions
négatives, les situations douloureuses ou difficiles, un état
dépressif ou simplement de palier à l'ennui. C'est ainsi que les
jeux d'argent pratiqués en groupe et dans des endroits
appropriés, relèvent désormais des modalités
d'appartenance à la ville de Yaoundé. Ils constituent un puissant
facteur de socialisation qui se structure chez les citadins selon des logiques
affinitaires et liés par des « pratiques, des sentiments, des
représentations, des intérêts » G. COURADE (1985
:105). Parce qu'en réalité, le fait de côtoyer le
même milieu, de partager les mêmes espérances, les
mêmes insuccès, angoisses, envies et attentes, rend les individus
solidaires autour d'une même passion.
Autrement dit, le « destin collectif » n'a d'autre
fonction que d'être un trait de cohésion sociale qui s'exprime
à travers une volonté manifeste et inclusive des individus, de
jouer en compagnie des autres. Ce contact avec l'altérité qui
génère des liens d'amitié, de solidarités et de
filiation entre les joueurs est vu dans le tableau qui va suivre.
104
Tableau 8 : Les enquêtés se
prononcent sur l'existence de solidarité dans les lieux de jeux
d'argent
|
Existe-t-il des élans de solidarité dans
les lieux de jeux d'argent ?
|
Effectifs
|
Proportions (%)
|
|
Oui
|
63
|
48.46
|
|
Non
|
22
|
16.92
|
|
Abstention
|
45
|
34.61
|
|
Total
|
130
|
99.99
|
Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain).
De ce qui précède, l'on constate que les
individus qui se retrouvent régulièrement dans une même
salle de jeu finissent souvent par être solidaires. 48.46 % des sujets
enquêtés pensent qu'il existe un élan de solidarité
entre les joueurs dans les lieux de jeux. Un élan de fraternité
qui a pu être observé par nous, où certains gagnants
n'hésitaient pas à accorder gratuitement un jeu ou un ticket
à leurs camarades. Cette disponibilité pour
l'altérité est perçue comme une attitude positive et reste
valorisée, tant elle permet au yaoundéen de se
construire un rapport avec la société dans laquelle il
évolue. C'est tout cet ensemble d'aspects socioculturels du jeu qui fait
dire à H. ERIK (1976 :69), que « nous ne considérons pas
les jeux comme un simple amusement mais comme un phénomène
politique, socioculturel et d'entente avec les autres », même
si certains enquêtés qualifient ces filiations «
d'amitiés de circonstance ».
Les lieux de jeux sont aussi des créateurs de formes
particulières de sociabilité et même de socialité
D.A.F LEKA ESSOMBA (2004). À y regarder de près, l'association du
jeu d'argent à un loisir dans ce cas particulier où
prédominent les arguments à caractère relationnel,
favorise au sein des espaces de jeux un « être-ensemble » qui
remémore le souvenir de la communauté F. TONNIES (1987). À
travers quelques caractéristiques liées au rassemblement, au
partage d'aspirations, d'images et de représentations, ces jeux
remplissent dans ce contexte une fonction génératrice du lien
social en se fondant sur l'image réelle d'une
105
société vivante. Bien qu'à certains
égards, l'arrivée des machines à sous, des tripots de rues
et autres terminaux à jeux d'argent dans nos villes nuance cette
affirmation.
II. LES NON-DITS DE LA PROLIFÉRATION DES JEUX
D'ARGENT À YAOUNDÉ
Habituellement, on attribue la pratique des jeux d'argent des
acteurs sociaux à des causes d'ordre économique et sociales. Dans
ce sens, ce phénomène peut s'entrevoir comme la dynamisation
d'une société dont ils sont le produit, du fait qu'ils
symbolisent de nos jours les facettes d'une capitale camerounaise en crise,
gangrénée par l'érosion des codes de moralité et la
déliquescence de ses citoyens. Une déliquescence qui n'a point
épargné le domaine ludique, dans une ville qui prend la forme
d'un « chaos social » en construction. Dans cette section, il est
question d'apporter une analyse critique de la manifestation du
phénomène des jeux d'argent, ayant accouché de profonds
changements en milieu urbain et s'étant accompagné d'un
verrouillage plus important des codes d'éthiques.
Ces mutations peuvent à juste titre se lire dans les
comportements des joueurs où l'on devrait désormais
intégrer l'esprit d'inventivité, qui constitue en filigrane et
selon la formule de J.M. ELA (1998), « les ruses de l'imaginaire »
pour ceux qui se déploient dans ces pratiques au quotidien dans leur
quête d'enrichissement. Cette logique capitaliste de la pratique du jeu
qui à la base se traduit par la croissance des choix libres,
dépasse désormais le seul cadre du divertissement pour gagner
d'autres aspects de la vie sociale. Les jeux d'argent pour ainsi dire,
deviennent une forme d'expression d'une nouvelle tendance ou d'une «
contre culture » qui apparaît lorsque les valeurs dites
traditionnelles de promotion financière semblent avoir atteint le point
de « saturation ». Une réplétion qui contraint les
individus à s'orienter vers des valeurs refuges qui s'inscrivent dans
l'idée d'un changement, d'un « nouveau style » qui
succède au style ancien. Il ne fonctionne pas comme un « mythe
fondateur », mais davantage comme un but à atteindre T.
ROSZACK (1970 :87).
Le phénomène des jeux d'argent s'inscrit donc
dans le contexte d'une société yaoundéenne, avec
pour indicateurs trois clés de lectures.
La première clé de lecture fait appel à
la rationalité du « défaitisme » dans laquelle immerge
la conscience collective à Yaoundé. Cet indicateur sou tend que
la capitale camerounaise est une ville en pleines mutations où les
références d'hier en matière de quête d'argent et de
réussite sociale ne sont plus les mêmes. Fort des multiples crises
auxquelles elle
106
fait face, la population de cette ville devient de plus en
plus marquée par une forte tentation à la réussite
à tous les prix, d'où cet engouement observé pour les jeux
d'argent, qui n'offrent pourtant qu'espoirs et illusions du gain. À
travers ce phénomène, Yaoundé s'illustre comme cette
société où les uns et les autres se sont résolument
engagés dans le culte de la facilité. Parce qu'en somme,
participer au « ndjambo » et parvenir à produire sa vie
à partir de cette activité est une manière d'abdiquer en
face de la difficulté que constitue le travail. De toute
évidence, un tel comportement rejoint un avatar de l'antique proverbe
latin qui convient à la plupart des joueurs, qui stipule que «
Primum vivere, deinde philosophari », ou encore comme l'a dit BRECHT
cité par R. BRENNER et G. BRENNER (idem, p. 133) : « d'abord
manger, l'éthique viendra plus tard ».
En effet, depuis que les jeux d'argent prolifèrent
à Yaoundé, le rapport à soi-même a changé
dans la conscience collective, « une part d'individualité qui
était cachée, contenue ou réprimée s'exprime plus
librement » J. DUMAZEDIER (1988 :69). Ce qui fait que les citadins en
proie à leur imagination, ont capturé le jeu pour en faire un
instrument d'expression peut-être du bien-être social. Car, dans
les lieux de jeux, le souci de soi est désormais une posture originale,
« une manière spécifique de se comporter par rapport
à l'environnement social » M. MAFESSOLI (1993 :96). Cet
imaginaire et cette créativité que l'on observe dans ces jeux
semblent aussi traduire le contexte d'une « société de
crédulité ».
La deuxième clé de lecture présente les
facettes d'une capitale camerounaise « crédule ». Elle
explique que la vulnérabilité des individus a atteint des
sommités élevées, où le désir de gagner de
l'argent sans effort semble de plus en plus s'émanciper à tel
point que, les populations de la ville de Yaoundé ne croient plus en
rien d'autre qu'à la chance et au hasard pour arriver à produire
leur existence. Parce qu'en effet, valider un pronostic, participer à la
loterie ou encore introduire une pièce dans une machine à sous
devient en quelques sortes acheter une histoire dont on est le héros :
c'est ainsi qu'on s'imagine heureux et riche, libre de toutes obligations et de
toutes les angoisses que supposent la nécessité de gagner sa vie
par des moyens plus contraignants.
Le joueur yaoundéen accepte en fait, le risque
de perdre la moitié ou la totalité de son argent en pariant qu'il
fera fortune par le jeu. Le pari étant lancé sans lucidité
et en toute inconscience. Cette conduite sociale s'inscrit dans une
économie du risque où l'individu met en jeu son avenir, jusqu'au
point d'hypothéquer ses biens les plus précieux, dans l'espoir de
constituer un pécule avec l'argent gagné au jeu.
107
Mais ce qu'il faudrait beaucoup plus noter c'est l'engouement
avec lequel les populations s'adonnent à ces jeux, auxquels nombreux
sont-ils de plus en plus à exprimer un besoin croissant de jouer. Et
puisqu'ils passent le plus souvent à quelques pas de la réussite,
ce « presque gain » leur sert de catalyseur au prochain jeu, qui
aboutira inexorablement au chemin de départ. Surtout quand on sait que
l'argent gagné sans réel effort est systématiquement
réinvesti au jeu.
Sans désavouer l'existence des gagnants aux jeux
d'argent, cette analyse s'interroge sur le fait que les jeux d'argent qui
peuvent être rangés dans la catégorie des
phénomènes qui rendent les individus paresseux, sont
paradoxalement encouragés dans un pays en voie de développement
ayant besoin de plus d'efforts, de travail, d'ingéniosité et
d'attitude citoyenne de la part des populations pour booster l'économie
de ses régions. Pour le dire autrement, on assiste aujourd'hui dans les
villes camerounaises, à l'image de la Grèce antique où le
jeu était utilisé pour éloigner le peuple des
préoccupations quotidiennes, à l'avènement d'une
société de l'oisiveté, dans un pays en voie de
développement E. NZINZOU (1970). Car, parce que les gens sont
désoeuvrés, insatisfaits de leurs revenus et se voient brandir de
nouvelles valeurs et modèles de réussite, le jeu leur permet de
meubler leur temps et d'agrémenter leur vie. Une analyse en profondeur
incline à une prise de conscience collective toujours grandissante
qu'est prolifération de ce phénomène dans nos villes.
En fin, la troisième clé de lecture plus
généralisante, atteste que la prolifération des jeux
d'argent en cours n'est que la traduction des relents d'une
société camerounaise qui a perdu ses repères et qui est en
quête de référents : c'est une société qui
devient quasiment « dépendante » vis-à-vis du «
ndjambo », parce que derrière l'investissement dans le jeu, c'est
le désespoir. Et les individus s'investissent tout de même dans ce
désespoir en se disant qu'il n'y a plus d'autres possibilités
pour s'en sortir. Ici, il faut pouvoir jouer et rejouer tout en se disant qu'on
aura essayé ne serait-ce que la dernière carte qui puisse
exister.
Ainsi, en voulant pallier à leurs insuffisances,
plusieurs individus vont se livrer aux jeux d'argent. Ce qui aboutit dans un
premier temps à une sorte d'insécurité familiale et
sociale, dans la mesure où l'appât pour toujours plus de gain se
transforme en addiction. Par la suite, ce sont leurs faibles économies
qui en pâtissent, leurs familles et leur entourage subissent les
conséquences. Car, en dépit des efforts consentis pour des
besoins d'épargne, des forces nouvelles (jeux d'argent) sont nées
pour niveler par le bas leurs revenus.
108
Plus que jamais à Yaoundé, on n'existe plus
socialement et même physiquement sans oser c'est-à-dire sans
miser, dans une ville en plein désarroi où le dénuement et
l'absence de perspective d'un grand nombre les amène à prendre
par la pratique des jeux d'argent, les distances à l'égard d'un
monde qui n'offre plus d'espoir de mobilité sociale suffisante. Pour
ainsi dire, au poker, au PMUC, au pari-foot ou à la loterie, beaucoup
d'individus jouent avec l'espoir de gagner au point où les sommes
d'argent susceptibles d'améliorer leur niveau de vie sont
systématiquement hypothéquées dans ces jeux qui ne leur
rapportent véritablement rien en retour. Ils se transforment volontiers,
en des poids pour leurs familles respectives et pour la société
qui ne pourront plus compter sur eux comme une main d'oeuvre susceptible
d'engager un certain nombre de travaux.
Somme toute, les jeux d'argent présentent une double
facette : d'une part, ils constituent un grand moyen de divertissement, de
libération et d'union au sein des populations qui les pratiquent. Par
ailleurs, ils entraînent des conséquences néfastes dans le
cadre de vie familiale du joueur et sur la société urbaine dans
les grandes villes. Il s'agit entre autres, de l'abandon du sens de l'effort,
de l'endettement, l'avidité, la filouterie, de la délinquance
etc. Ces derniers aspects déplorables, amènent à la
recherche de solutions adéquates et capables de résoudre ces
problèmes.
CONCLUSION
110
Parvenus au terme de la présente étude où
il était question d'analyser ce que nous avons nommé «
jeux d'argent et changement social à Yaoundé », il
s'est agi à partir de l'espace urbain yaoundéen,
d'esquisser une analyse des mutations sociales qui réfèrent aux
pratiques de jeux d'argent qui prennent de l'ampleur dans nos
métropoles. Dans le contexte camerounais actuel, une telle étude
s'est appuyée sur un double constat : d'entrée de jeu, il
s'avère que depuis près d'une décennie, autant que
définie par D.A.F. LEKA ESSOMBA (2001 :119), « la
société camerounaise se laisse percevoir comme un lieu de rupture
des « consensus » classiques ». Une rupture qui se range en
droite ligne avec la prolifération des jeux d'argent et qui symbolise
avec le même auteur, « l'obsession du gain facile »
qui anime bon nombre d'individus à Yaoundé. D'autre part,
l'étude a été motivée à partir des
observations faites sur les comportements des joueurs. Ces observations ont
révélé un état d'esprit, un imaginaire collectif et
symbolique visant un changement social régressif que J.P. ONANA ONOMO
(1990 :63), présente de la manière suivante :
Un changement social peut être régressif s'il
échappe au contrôle de ceux qui y sont intéressés,
il est d'autant plus régressif en Afrique si on le considère dans
le processus de développement, le milieu sociohistorique. En ce sens, la
dépendance est beaucoup plus un changement régressif qu'un
développement assisté. Elle est le développement du
sous-développement. Le développement dépendant est une
régression qui indique le comportement pathologique de l'individu qui
recule dans le temps à un stade moins développé de
l'organisation de sa personnalité en relation avec son milieu.
Pour ainsi dire, les jeux d'argent apparaissent comme une voie
idéale de régression, du fait qu'un argent hautement investi au
jeu et se soldant rapidement par une perte équivaut à une perte
de soi. Ce point de vue de J.P ONANA ONOMO peut bien traduire la dimension
d'une pratique invétérée du jeu qui aboutit
inévitablement à des comportements dépendants et à
l'impécuniosité chez les acteurs. Dans ce sens, les jeux d'argent
sont à l'origine d'un changement social qui donne l'illusion d'un
développement mais qui en réalité est une forme de mirage
qu'il s'est agi de présenter.
111
C'est dire que, le domaine de la recherche que nous avons
choisi est si vaste et complexe que cette étude ne constitue qu'une
modeste contribution à la Sociologie de Yaoundé et des villes
camerounaises en général. Réfléchir sur ce
phénomène signifiait deux choses : Primo, il
n'était pas question de montrer que la pratique des jeux d'argent est
une déviance, encore moins une délinquance urbaine des
populations de Yaoundé et celles des autres métropoles. C'est un
loisir socialement acceptable, qui n'est autre que le prétexte dont les
mauvaises moeurs ont fait l'objet de cette étude. Secundo, il
s'est agi d'appréhender les changements sociaux à
différents niveaux de participation des acteurs sociaux de la ville de
Yaoundé à ces jeux et sur la société urbaine prise
de manière globale.
Pour conduire la présente étude, deux
catégories d'hypothèses ont été
élaborées : il s'agit de l'hypothèse principale et des
hypothèses de recherche. L'hypothèse principale stipulait que :
la prolifération des pratiques de jeux d'argent dans la ville de
Yaoundé, génère dans l'imaginaire collectif, l'esprit de
lucre, l'appât du gain facile, et l'illusion de l'enrichissement
rapide.
Parvenus à ce stade de la recherche, nous pensons que
cette hypothèse est vérifiée ; en effet, en observant
qu'il existe dans la société plusieurs types de jeux, les
individus n'adhèrent volontiers, qu'à ceux qui sont susceptibles
de leur offrir la possibilité d'aspirer à une promotion
financière significative. Autrement dit, il s'agit d'une intention
inavouée de quête d'argent par un chemin moins contraignant, qui
se lit à travers l'engouement observé dans les cercles de jeux
à Yaoundé.
La première hypothèse de recherche posait que,
les publicités de jeux et les médias de masse agissent de
façon diligente dans la persuasion du sens commun. En brandissant
l'illusion d'un bonheur rêvé par un simple coup de chance, ces
facteurs contribuent à rallier plusieurs « incertains » aux
pratiques de jeux d'argent. Tout au long du développement du
présent travail, l'on a pu montrer en quoi la publicité et les
médias sont des modérateurs du pouvoir d'enrôlement des
acteurs sociaux. À travers les émissions, les slogans et
propagandes du jeu diffusés, ils contribuent à la construction et
au renforcement de « fausses croyances » au gain et de fait,
suscitent l'adhésion massive des individus. Cette hypothèse est
donc vérifiée.
112
La deuxième hypothèse de recherche stipulait que
: les difficultés d'insertions socioprofessionnelles, la
proximité des lieux de jeux et l'insatisfaction des salariés
quant à leurs revenus développent un instinct de
vulnérabilité à l'argent chez les yaoundéens
pour qui le jeu apparaît comme une solution rapide et efficiente
à leurs gênes. Cette hypothèse corrobore en
réalité le fait que dans chaque catégorie sociale, le
recours au jeu n'intervient que dans le souci de garder autant que possible,
l'espoir d'aspirer à une vie meilleure. Ou tout au moins, d'essayer
d'assurer un certain équilibre financier quotidien chez les acteurs
sociaux impliqués. Sans être assez prétentieux, nous
pensons que cette hypothèse à l'image des
précédentes est aussi vérifiée.
Quant à la troisième hypothèse de
recherche, elle présumait que : la prolifération des jeux
d'argent en cours à Yaoundé, engendre d'une
dégénérescence sociale à travers la
dépendance aux jeux, délinquance, le défaitisme, la
déchéance sociale du joueur etc.
Dans cette réflexion l'on a pu observer, qu'il s'agisse
de la chance ou des pertes aux jeux, le résultat reste le même. Le
jeu d'argent s'apparente à un « labyrinthe » où le
joueur éprouve des facilitées à développer des
comportements dépendants. Car une fois s'y étant mis, il
éprouvera des difficultés non seulement dans son cadre de vie
familial et professionnel, mais aura du mal à se passer du jeu pour
éventuellement s'engager sur une voie plus laborieuse dans sa
quête permanente d'argent. Toutes ces hypothèses sont donc
vérifiées.
Le présent travail s'est articulé sur trois
chapitres : il s'est agi d'emblée, de présenter la manifestation
du phénomène des jeux d'argent dans la ville de Yaoundé et
d'en dresser une typologie des jeux rencontrés. Le second chapitre s'est
penché sur les mécanismes d'enrôlement, ainsi que des
modalités de participation des différentes catégories
sociales de la population urbaine de Yaoundé dans ces jeux. Le chapitre
troisième pour sa part a mis en lumière les transformations
sociales en cours dans la ville de Yaoundé. Dans cette partie, il
était question d'analyser ce type de jeux comme des catalyseurs de la
dépendance, des ruptures familiales et sociales ainsi qu'un espace de
désengagement des individus vis-à-vis de la
société.
Pour la réalisation de ce travail, nous avons
concomitamment fait appel à la matrice constructiviste et à la
sociologie dynamiste et critique. Ces approches théoriques
convoquées à titre complémentaires ont permis de
comprendre non seulement les modalités à partir desquelles les
acteurs sociaux élaborent les mécanismes et schèmes pour
se construire une
113
perspective dans la vie sociale, mais davantage, ont
été d'un important apport dans la recherche
d'éléments d'analyses permettant de comprendre comment les jeux
d'argent deviennent un phénomène à partir duquel les
populations de la ville de Yaoundé construisent leur urbanité.
S'agissant de la collecte et de l'interprétation des
données, ce travail s'est servi d'entrée de jeu de l'observation
directe qui a constitué l'étape fondamentale de la recherche.
L'observation directe a permis de se confronter aux réalités
quotidiennes sur les lieux où se produisent les faits à savoir
les salles de jeux, les Visio club et les rues. Elle a donné à ce
travail un caractère scientifique, tant il est vrai qu'un
phénomène ne peut prendre une nature scientifique que s'il est
« conquis construit et constaté » G. BACHELARD (1984
:14). La recherche documentaire a favorisé le recueil d'informations
relatives à la question du jeu en général et des jeux
d'argent en particulier. Elle a permis d'avoir une idée plus construite
des concepts clés du thème à savoir, les « jeux
d'argent » et le « changement social », davantage, elle a
favorisé la synthèse des recherches antérieures sur le
sujet. Les entretiens notamment semi-directifs, ont facilité le recueil
d'un ensemble d'informations et points de vue dont sont dépositaires les
différents acteurs sociaux impliqués dans cette pratique à
Yaoundé.
En somme, les données utilisées dans le cadre de
ce travail sont multiples mais le corpus principal de la recherche repose sur
une enquête par questionnaire. L'enquête en elle-même s'est
déroulée principalement dans les quartiers Ékounou,
Mvog-Ada, Marché Mokolo et Ngoa-Ekelle où, à partir de la
technique d'échantillonnage non probabiliste, l'on a pu recueillir des
informations auprès de cent trente individus joueurs d'argent sans
distinction de sexe ni d'âge. Bien que réduit, cet
échantillon met en évidence les variables qui déterminent
de façon significative les modalités d'usages urbains des acteurs
sociaux en matière de jeux.
Au cours de la recherche, la collecte des données ne
s'est pas faite sans contraintes. Les biais auxquels nous avons
été confrontés sont liés aux refus, à
l'indisponibilité de certains enquêtés et au difficile
accès à la documentation. Sur le terrain, la première
difficulté a été la méfiance de certains
enquêtés qui se sont montrés réticents et furieux
devant le questionnaire. Ce qui fait que malgré toutes les explications
données au début de l'enquête, certains d'entre eux non
habitués à ce genre d'exercice, ont préféré
s'abstenir de répondre à certaines questions ou simplement ont
refusé de se soumettre à cet exercice. L'autre difficulté
rencontrée a été de pouvoir s'entretenir avec les
responsables de quatre structures de jeux à
114
savoir, le PMUC, Premier BET, et les directeurs des casinos
« el Blanco » et « golden city » de
Yaoundé.
Lorsque nous sommes allés dans leurs offices respectifs
pour prendre contact et éventuellement rendez-vous, leurs
secrétaires nous ont demandé d'adresser des demandes
écrites. Lesdites demandes sont restées lettres mortes plus d'un
mois après. Malgré plusieurs autres tentatives, les personnels
trouvés sur place n'hésitaient pas de prétexter
l'indisponibilité de leur patron, ce qui nous a contraints à
replier au niveau des salles de jeux, pour obtenir des entretiens avec les
gérants trouvés sur place. Les limites de cette étude se
situent donc d'abord au niveau de l'échantillon, qui « pourrait
ne pas être assez représentatif de la population
étudiée » VERKEVISSER et al. (1993 :202). En
ce qui concerne l'accessibilité à la documentation portant sur
les jeux d'argent, l'approvisionnement n'a pas été tout aussi
aisé. Dans les bibliothèques et centres de documentation, on
rencontre un nombre considérable d'ouvrages en Sociologie qui traitent
du jeu et du loisir en général, mais très peu d'ouvrages
et articles scientifiques sont consacrés aux jeux d'argent en
particulier. Tout compte fait, les documents exploités ont
été d'un apport considérable dans la recherche
documentaire.
En outre, autant il est difficile de faire «
métier de sociologue » P. BOURDIEU (1968), que mettre en
lumière les changements sociaux qui découlent de la
mercantilisassions des pratiques ludiques en milieu urbain n'est pas une
sinécure. Telle est la seconde difficulté à laquelle s'est
confronté ce travail. Néanmoins, nous nous sommes essayés
à partir des facteurs qui influencent le changement social tels que ;
l'impact des médias et le rôle de la mobilité sociale des
acteurs. Ces facteurs ont permis de mettre en lumière l'influence du
statut social des acteurs sociaux sur leur participation aux jeux d'argent. En
guise de synthèse, essayons tout de même d'appréhender les
différents changements sociaux qui s'opèrent à
Yaoundé, à travers ce phénomène. À l'image
de six questions majeures que se posent G. ROCHER (1968 :30-31), ces questions
se formulent ainsi qu'il suit :
À la question de savoir qu'est ce qui change dans notre
société ? Force est de constater que la société
camerounaise et la ville de Yaoundé en particulier est dynamique
à plusieurs niveaux. C'est pourquoi cette étude a choisi de
s'intéresser uniquement aux jeux qui s'accompagnent des transformations
dans la définition des stratégies de quête d'argent dans
l'imaginaire populaire. Le revers ici est que cette pratique entraine la
paupérisation, la déstabilisation des individus, des familiales
etc. Ensuite, l'on s'interrogerait sur le « comment » s'opère
ce changement ? À ce niveau, le changement à partir des
pratiques
115
ludiques des populations est continu. Il rencontre cependant
quelques résistances avec une intensité plus ou moins
significative des non joueurs. Ceux-ci plus réalistes de la
dépossession par le jeu, (bien que cette étude ne s'étant
pas intéressée à eux) semblent constituer le principal
obstacle de l'envahissement de la société yaoundéenne
par les jeux d'argent. Ce qui n'arrête pour autant pas certains
acteurs sociaux adeptes de ces pratiques.
À la question de savoir quel est le rythme du
changement ? Les observations révèlent qu'avant les années
deux mille et l'arrivée de la gamme des paris sur les matchs de football
et des loteries numériques instantanées, la mercantilisation des
jeux d'argent était moins perceptible avec le seul PMUC et les casinos.
Mais avec le foisonnement des sociétés de jeux dans les
métropoles camerounaises et la multiplication des offres de jeux au
public, le rythme du changement est accéléré :
désormais, il est beaucoup plus perceptible et plus rapide.
Plus encore, en s'interrogeant sur la question de savoir quels
sont les facteurs qui rythment le changement dans la pratique des jeux d'argent
? Cette étude a pu démontrer que les médias et la
mobilité sociale sont plus illustratifs. Car, on observe que chacun de
ces facteurs crée des conditions favorables à la propension de
certains camerounais aux jeux d'argent. Cependant, ils ne constituent pas les
seuls facteurs, il faudrait aussi noter l'appétit de certains individus
à l'enrichissement facile et rapide à travers ces jeux. En outre,
l'on chercherait à identifier les agents actifs dans ce changement ?
En effet, un regard porté sur l'échantillon
révèle que les pratiquants des jeux d'argent à
Yaoundé, sont dans une proportion relativement large, les jeunes. La
classe d'âge la plus nombreuse est celle qui se situe entre vingt et un
et vingt-neuf ans, avec un effectif de cinquante-cinq personnes. Elle est
immédiatement suivie par la classe d'âge qui va de trente à
trente-neuf ans, qui compte trente-huit individus. Ceux-ci semblent donc
être plus actifs dans le changement parce qu'ils sont plus nombreux. Dans
cette configuration, les principaux agents qui résistent au changement
semblent être les femmes et dans une certaine mesure l'entourage familial
du joueur qui est souvent hostile à ces jeux.
En fin, en posant la question de savoir s'il est possible de
voir le cours futur des jeux d'argent à Yaoundé ? Nous pensons
qu'il serait très osé d'essayer de prévoir l'avenir des
pratiques de jeux d'argent sur la société urbaine à
Yaoundé, à travers une étude aussi embryonnaire. Seules
les perspectives données par cette étude permettent de constater
que 21.53 % des joueurs interrogés sur la question de savoir s'ils
mettraient fin à leurs pratiques
116
ludiques, avouent qu'ils n'arrivent pas à s'en passer.
Tandis que 46.15 % d'entre eux n'y ont jamais pensé. À
ceux-là, viennent s'ajouter les 32.30 % de joueurs qui sont
restés sans réponse (voir tableau 6). Plus que jamais à
Yaoundé, la tendance penche vers une société de
consommation des jeux d'argent et un accroissement significatif de mauvaises
moeurs telles que : crises familiales, paraisse, délinquance,
paupérisation ou encore des tentatives de suicide.
Les résultats de cette étude mettent donc en
relief le caractère négatif de la pratique obsessionnelle des
jeux d'argent dans la société, afin d'amener ceux qui s'y livrent
à comprendre que loin de les enrichir, ces jeux les appauvrissent
plutôt. Pour que cela soit possible, les populations doivent être
suffisamment sensibilisées. C'est cette mission que ce travail s'est
proposé de faire non seulement pour les joueurs eux-mêmes, mais
aussi pour ceux qui sont susceptibles de le devenir. Par ailleurs, le drame est
ce que cette étude peut causer dans la conscience collective à
Yaoundé. En effet, au moment où plusieurs individus croient avoir
trouvé un nouvel itinéraire d'accumulation, une voie aisée
de promotion financière, cette recherche tente de dévoiler leurs
intentions, ou tout au moins leur capacité à construire
l'environnement socioculturel de leur génération. Mais loin de
vouer ces adeptes du PMUC, du pari foot, du poker, du black jack ou de la Carte
au découragement, il nous était simplement impossible de rester
muet face à un phénomène qui fait l'actualité dans
la capitale camerounaise.
Le fait que le changement social en lui-même soit un
concept de nature complexe, cette recherche a permis de saisir dans le
même temps, des processus sociaux intéressants. Pour ainsi dire,
trois spécialisations de la Sociologie à savoir : la Sociologie
Urbaine, la Sociologie du ludique et la Sociologie du quotidien émergent
de la présente étude. Elle devient de ce fait, une invitation
permanente à la recherche en termes de rapports aux pratiques ludiques
des populations urbaines. Car, malgré l'ampleur que prennent les jeux
d'argent au sein de notre société et les travaux de certains
chercheurs dans ce domaine, cette recherche est la première à
s'intéresser aux mutations sociales qui émergent de la pratique
des jeux d'argent au sein de la société urbaine à
Yaoundé. Considérant par la même occasion qu'elle contribue
à l'ouverture d'un nouveau champ de recherche dans la littérature
académique, nous souhaitons ainsi présenter des avenues de
recherches futures qui pourraient être empruntées par d'autres
chercheurs dans le domaine du ludique.
117
BIBLIOGRAPHIE
118
A- OUVRAGES GÉNÉRAUX
ANSART, P., et AKOUN, A., 1999,
Dictionnaire de la Sociologie, Paris, le Robert et le Seuil.
BALANDIER, G., 1986, Sens et puissance
: les dynamiques sociales, Paris, P.U.F.
BARDIN, L., 1980, L'analyse de contenu,
(2e éd), Paris, PUF.
BOUDON, R., 1979, La logique du social.
Introduction à l'analyse sociologique, Paris,
Hachette.
BOUDON, R., et BOURRICAUD, F.,
1982, Dictionnaire critique de la sociologie, paris,
P.U.F.
BOURDIEU, P., 1987, Choses dites,
collection « le sens commun », Paris, minuit.
CORCUFF, P., 1995, Les nouvelles
sociologies, Construction de la réalité sociale,
Paris, Nathan.
DURKHEIM, E., 1958, Les règles de
la méthode sociologique, nouvelle édition, Paris,
P.U.F.
FERRÉOL, G., 2002, Dictionnaire de
Sociologie, 3e édition, Paris, Armand Colin. NGA
NDONGO, V., 2003, Plaidoyer pour la Sociologie Africaine,
Yaoundé, P.U.Y.
ROCHER, G., 1968, L'idéologie du
changement social comme facteur de mutation, Montréal,
Édition Hurtubise.
TOURAINE, A., 1974, Pour la Sociologie,
Paris, Seuil.
BEART, C., 1960, Recherche des
éléments d'une sociologie des peuples Africains à partir
de leurs jeux, Paris, Présence Africaine.
119
B- OUVRAGES MÉTHODOLOGIQUES
ARBORIO, A., et FOURNIER, P.,
1999, L'enquête et ses méthodes : l'observation
directe (Collection Sciences sociales), Université Nathan.
BACHELARD, G., 1984, La formation de
l'esprit scientifique, Paris, P.U.F.
BEAUD, M., 1996, L'art de la
thèse, Paris, Éditions La Découverte.
BLANCHET, A., et al.,
1987, L'entretien dans les sciences sociales, Paris,
Dunod.
BOURDIEU, P., 1968, Le métier de
sociologue, 2e volume, Paris, Mouton.
FISCHER, G.N., 1987, Les concepts
fondamentaux de la Psychologie sociale, Paris, Dunod.
JODELET, D., 1984, Représentation
sociale : Phénomènes, concept et théorie, in S.,
Moscovici, (éd.), Psychologie sociale, Paris, P.U.F.
GHIGLIONE, R., et MATALON, B.,
2001, Les enquêtes sociologiques : théorie et
pratique, Paris, Armand Colin.
GRAWITZ, M., 1993, Méthodes des
sciences sociales, Paris, Dalloz.
MACE, G., et PETRY, F., 2000,
Guide d'élaboration d'un projet de recherche en sciences sociales,
Québec, Presse de l'Université de Laval.
ZIEGLER, J., 1980, Retournez les fusils !
Manuel de Sociologie d'opposition, Seuil.
C- OUVRAGES SPECIALISÉS
BACHELIER, L., 1993, Le jeu, la
chance et le hasard, sceaux, Éditions Jacques Gabay.
BALLE F., 1980, Médias et société,
Éditions Monchrestien, Précis Domat.
BALLE, F., 2000, Les médias,
Collection Dominos Flammarion.
120
BELMAS, E., 2006, Jouer autrefois :
Essai sur le jeu dans la France moderne
(XVIe-XVIIIe siècle),
Seyssel, champ Vallon.
BERTRAND, J., 1978, Pratique de la
ville, Collection Géographie, Paris, Masson. BETBEZE, J-P.,
1982, Loto, paris, que sais-je ? Paris,
P.U.F.
BRENNER, R., et BRENNER, G.,
1993, Spéculation et jeux de hasard : Une histoire de
l'homme par le jeu, Paris, P.U.F.
BROCHAND, B., et al.,
2001, Publicitor, Paris, Dalloz, 5e
Édition.
CAILLOIS, R., 1958, Les jeux et les
hommes, Paris, Gallimard.
COTTA, A., 1980, La société
ludique. La vie envahie par le jeu, Paris, Bernard Grasset.
CROZIER, M., 1986, Etat moderne,
Etat modeste. Stratégies pour un autre changement,
Paris, Fayard.
De CERTEAU, M., et al.,
1990, L'invention du quotidien. Arts de faire,
Paris, Folio « Essais ».
DUMAZEDIER, J., 1962, Vers une
civilisation du loisir ? Paris, Seuil.
ELA, J-M., 1998, Innovations sociales et
renaissance de l'Afrique noire : Les défis du « monde d'en
bas », Paris, l'Harmattan.
GOFFMAN, E., 1984, Les rites
d'interaction, Chapitre « les lieux de l'action »,
Édition de minuit.
GRAFMEYER, Y., 1994, Sociologie
Urbaine, Paris, Nathan.
HUIZINGA, J., 1951, Homo ludens : essai
sur la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard.
JOSEPH, I., 1984, Le passant
considérable. Essai sur la dispersion de l'espace public,
Librairie des Méridiens.
LEVENEUR, L., 2007, Les travestissements
des jeux télévisés, histoire et analyse d'un genre
protéiforme, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle.
121
MAFESSOLI, M., 2004, Le rythme de vie.
Variation sur l'imaginaire post-moderne, Paris, Édition table
ronde, collection « contre temps ».
MARTIGNONI-HUTIN, J-P., 2000,
Ethnosociologie des machines à sous. « Que le hasard vous serve
mais préparez-vous à l'accueillir », Paris,
1'Harmattan.
MEMMI, A., 1979, La dépendance,
Paris, Gallimard.
NZINZOU, E., 1970, Existe-il un
problème de loisir dans les pays en voie de développement dans
une civilisation de loisir ? Paris, Yersiers.
ROSZAK, T., 1970, Vers une contre
culture, Paris, Stock.
SANSOT, P., 1998, Du bon usage de la
lenteur, Paris, Payot.
SENNETT, R., 2006, La culture du nouveau
capitalisme, Paris, Albin Michel.
D- THÈSES ET MÉMOIRES
AWONDO AWONDO, S.P., 2006, Loisir et mode
au Cameroun. Analyse de la culture ludique à Yaoundé,
mémoire présenté en vue de l'obtention du
Diplôme de D.E.A en Sociologie, Université de Yaoundé 1.
DURANG, X., 2003, Vivre et exister
à Yaoundé : La construction des territoires
citadins, Thèse de Doctorat en Géographie et
aménagement, Université de Paris IV-Sorbonne.
LEKA ESSOMBA, D.A.F., 2004,
Urbanité et civilité au Cameroun : Analyse des formes de
socialités dans la rue à Yaoundé, mémoire de
D.E.A, Sociologie, Université de Yaoundé 1.
NDJOU'OU AKONO, J.L., 1999, Les non-dits
du PMUC au Cameroun, mémoire de Maitrise en Sociologie,
Université de Yaoundé 1.
ONANA ONOMO, J-P., 1990, Changement
social et éthique chrétienne au Cameroun, Thèse de
Doctorat Nouveau Régime de l'Université de Strasbourg II.
VERCHER, E., 1996, Un jeu d'argent hors
jeu, les jeux de casino : Figure du joueur, enjeux
économiques et espace social, mémoire de D.E.A en sciences
de l'information et de la communication, Université Lumière Lyon
II.
122
E- ARTICLES SCIENTIFIQUES ET JOURNAUX
CHANTAL, Y. et al.,
1994, Construction et validation de l'échelle de
motivations relatives aux jeux de hasard et d'argent, loisirs et
société, vol. 17, n°1, Printemps, p.p. 189-212.
DEREVENSKY, J. et al.,
2007, The effects of gambling divertissement on child and
adolescent gambling attitudes and behaviors. Rapport pour le fond
Québécois de la recherche sur la société et la
culture (FQRSC).
INSERM., 2008, Jeux de hasard et
d'argent. Contextes et addictions une expertise collective de l'INSERM,
dossier de presse, Paris.
JEUNE AFRIQUE., 2015, Les nouveaux
maîtres du jeu, 56e année, no 2862 du
15 au 21 novembre, p.p. 24-33.
LADOUCEUR, R., et al.,
2000, Le jeu pathologique, in Revue
Québécoise de Psychologie, p.p. 21-35.
MARTIGNONI-HUTIN, J.P., 2011, « Une
sociologie du gambling contemporain », in pouvoirs : Revue
Française d'études constitutionnelles et politiques, n°139,
les jeux d'argent, novembre, Éditions du Seuil, p.p. 51-64.
MBOUOMBOUO, P., 2005, « Usages et
détournements des trottoirs à Yaoundé : entre logiques
économico-sociales et marginalité urbaine », in
« C'est ma ville ! » De l'appropriation et du détournement
de l'espace public, Paris, l'Harmattan, p.p.247-259.
MOTAZE, AKAM, 1998, À quel jeu
joue le Cameroun ? in le Messager no 800, 12 aout 1998, p.7.
NGA NDONGO, V., 2003, « Jeux de
hasard : Qu'est ce qui fait courir les mordus ? » in Cameroon Tribune
no 7917/4206 du 27 Août, p.18.
ANNEXES
124
ANNEXE I
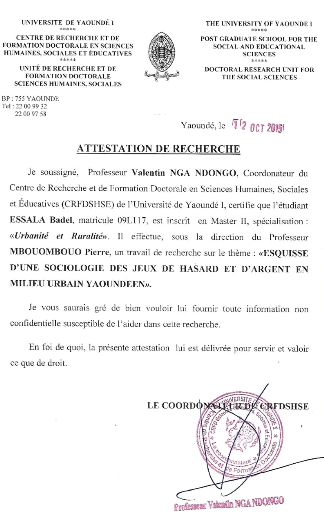
125
ANNEXE II
QUESTIONNAIRE SUR LES JEUX D'ARGENT ET LE
CHANGEMENT
SOCIAL
Bonjour Monsieur/Madame ! Je m'appelle Essala Badel, dans le
cadre de ma formation, j'entreprends en ce moment une recherche sur le
thème : « jeux d'argent et changement social à
Yaoundé ». J'aimerais obtenir de vous un certain nombre
d'informations relatives à la question. Ces informations ne serviront
que le seul but d'une formation académique anonyme.
I. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET PROFIL DE
L'ENQUETÉ
1- Nom :
2- Sexe :
3- Age :
4- Lieu de l'enquête : , date de l'enquête :
5- Situation matrimoniale : marié(e)
célibataire(e) divorcé(e) veuf(e)
6- Que faites-vous dans la vie ? (Cochez la case
correspondante).
Étudiant (e) Fonctionnaire Autre
Commerçant (e) Sans emploi
7- Avez-vous un revenu mensuel ? Si oui précisez l'un des
intervalles ci-dessous :
Ø 0 à 36.000 francs
Ø 37.000 - 65.000 francs
Ø 66.000 - 99.000 francs
Ø 100.000 - 150.000 francs
Ø Plus de 150.000 francs
126
II. CONNAISSANCE DES JEUX ET MÉCANISMES
D'ENRÔLEMENT DES JOUEURS
8- Quels types de jeux d'argent connaissez-vous ?
Ø Les jeux au casino,
Ø Le poker, machines à sous,
Ø Les paris sportifs, courses de chevaux, loteries,
tombolas,
Ø Le flipper, le babyfoot, les jeux vidéo,
Ø Le Ludo, dés, Carte, Dame, Bonneteau etc.
9- Auxquels préférez-vous jouer ? Pourquoi ?
10- À votre avis, quel sens peut-on attribuer aux jeux
d'argent ?
Ø Moyen de gagner beaucoup d'argent
Ø Divertissement sans objectif de gain
Ø Obsession pour les PMU
11- Qu'est-ce qui selon vous, peut amener une personne
à s'intéresser à ces jeux ? (Cochez la mention utile).
Ø Les publicités sur les affiches,
Ø Les émissions de jeux radiodiffusées,
Ø Les programmes télévisés portant
sur ces jeux,
Ø Les fréquentations régulières des
milieux de jeux,
Ø La proximité des points de jeux avec le
domicile/ le lieu de travail etc.
Autre .
127
19- Connaissez-vous des gens qui ont perdu beaucoup d'argent en
jouant ici ?
12- Depuis combien de temps pratiquez-vous ces jeux ?
13- Qu'est-ce qui vous motive à toujours participer
à ce type de jeux ?
Ø Les petits gains réguliers,
Ø L'espoir de gagner une importante somme d'argent,
Ø Le désir de récupérer l'argent
perdu dans le jeu,
14- Comment obtenez-vous de l'argent que vous misez dans ces
jeux ?
III. DÉPENDANCE AUX JEUX D'ARGENT ET CHANGEMENT
SOCIAL
15- Quelle est votre fréquence de participation à
ces jeux ? (Cochez la case correspondante).
Ø Rarement ; en moyenne une fois par semaine,
Ø De façon régulière ; trois
à quatre fois systématiquement par semaine,
Ø Tous les jours de la semaine et plusieurs fois par
jour,
Ø Autre (à préciser).
16- Pensez-vous pouvoir arrêter de jouer à ce jeu
si vous le désirez ?
17- Connaissez-vous des gens qui ont des conflits
résultant de ces jeux :
Ø En famille, En milieu professionnel,
Ø En communauté, En société,
Ø Autres
18- Connaissez-vous des personnes qui ont réussi
grâce aux jeux d'argent ?
128
20- Avez-vous des projets au cas où vous gagnerez
à ce jeu ?
Oui Non
Si oui, lesquels ?
21- Êtes-vous au courant de certains comportements
antisociaux en relation avec la
pratique des jeux d'argent ? Dites lesquels
22- Combien pouvez-vous miser dans ces jeux en moyenne par
mois ?
23- Combien obtenez-vous en moyenne en retour, après
avoir joué au bout d'un mois ?
24- Pensez-vous qu'il existe aussi des élans de
solidarité dans les lieux de jeux ?
Si oui, comment ?
Si non pourquoi ?
Je vous remercie.
129
ANNEXE III
GUIDE D'ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF POUR LES
GÉRANTS
D'ÉTABLISSEMENTS DE JEUX
Bonjour Monsieur/Madame ! Je m'appelle Essala Badel, dans le
cadre de ma formation, j'entreprends en ce moment une recherche sur le
thème : « jeux d'argent et changement social à
Yaoundé », j'aimerais obtenir de vous un certain nombre
d'informations relatives à la question. Ces informations ne serviront
que le seul but d'une formation académique anonyme.
Nom :
Profession :
1- Quelle impression vous donnent les recettes
financières enregistrées dans votre entreprise. En d'autres
termes, les jeux d'argent sont-ils un marché prolifique ?
2- De façon générale, quel est le profil
de votre clientèle ?
3- Quelles stratégies votre entreprise met en oeuvre
pour attirer sa clientèle ?
4- À votre avis, pourquoi les jeunes sont-ils nombreux
à s'adonner aux jeux d'argent ?
5- Quelles mesures mettez-vous en oeuvre pour prévenir
d'éventuelles conséquences du jeu sur le plan social ?
Je vous remercie.
130
ANNEXE IV
GUIDE D'ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF POUR PERSONNES RESSOURCES
DE
L'ADMINISTRATION
Bonjour Monsieur/Madame ! Je m'appelle Essala Badel, dans le
cadre de ma formation, j'entreprends en ce moment une recherche sur le
thème : « jeux d'argent et changement social à
Yaoundé », j'aimerais obtenir de vous un certain nombre
d'informations relatives à la question. Ces informations ne serviront
que le seul but d'une formation académique anonyme.
INFORMATIONS GÉNÉRALES DE
L'ENQUÊTÉ
Nom :
Profession :
Poste occupé :
1- Quelle lecture faites-vous du foisonnement des
opérateurs de jeux, qui se bousculent depuis quelques années aux
portes du Cameroun, en vue d'obtenir un contrat de concession pour
l'exploitation des activités dans les jeux d'argent ?
2- Les jeux d'argent sont-ils un secteur d'activité
bénéfique à l'État camerounais ?
3- Au regard de l'engouement populaire observé autour de
ces pratiques, en quel sens la prolifération des jeux d'argent peut-elle
devenir un danger pour la société ?
4- Au niveau de l'administration, quelles sont les solutions
envisageables pour réduire l'ampleur que prend ce
phénomène dans les villes camerounaises et principalement
à Yaoundé ?
Je vous remercie.
131
ANNEXE V
LISTE DES PERSONNES ENQUETÉES SUR LES JEUX
D'ARGENT ET LE
CHANGEMENT SOCIAL
La liste suivante de personnes enquêtées est loin
d'être exhaustive. Pour des raisons d'anonymat sur leur adresse, seuls
leurs noms, ainsi que le minimum d'informations qui y figurent ont
été rapportés par eux même lors du remplissage du
questionnaire et pendant les entretiens.
|
No
|
Nom
|
Sexe
|
Âge
|
Niveau
d'instruction
|
Profession
|
Lieux
d'enquête
|
Date de
l'enquête
|
|
1
|
Ateba
Josiane
|
F
|
30
|
Baccalauréat
|
Agent
commerciale
|
Ékounou
|
12/12/2016
|
|
2
|
Biloko
Francis
|
M
|
33
|
BEPC
|
Commerçant
|
Ékounou
|
12/12/2016
|
|
3
|
Kemta
Thomas
|
M
|
42
|
BEPC
|
Agent
d'entretien
|
Mokolo
|
11/11/2016
|
|
4
|
Nana
Ismaël
|
M
|
17
|
4e année E.E
|
Elève
|
Ngoa-Ekelle
|
10/12/2016
|
|
5
|
Ella Ella
Joel
|
M
|
29
|
Licence
|
CPJA
|
DDL-
MINTOUL
|
13/12/2016
|
|
6
|
Mba Mba
Alfred
|
M
|
55
|
Licence
|
Administrateur civil
|
Service des
jeux
MINATD
|
14/12/2016
|
|
7
|
Nouade
Solange
|
F
|
37
|
CAP
|
Agent
commerciale
|
Hippodrome
|
15/12/2016
|
|
8
|
Zanga
Donatien
|
M
|
25
|
Baccalauréat
|
Sans
profession
|
Ngoa-
Ekelle
|
10/12/2016
|
|
10
|
Mbanga
germain
|
M
|
37
|
Baccalauréat
|
Instituteur
vacataire
|
Mvog-Ada
|
3/12/2016
|
132
|
11
|
Abanda
Narcisse
|
M
|
57
|
-
|
Mécanicien
|
Ekounou
|
18/11/2016
|
|
12
|
Messeba
Vincent
|
M
|
21
|
Baccalauréat
|
Étudiant
|
Ékounou
|
18/11/2016
|
|
13
|
Binelli
Arthur
|
M
|
24
|
-
|
Commerçant
|
Ékounou
|
18/11/2016
|
|
14
|
Ntamack
pauline
|
F
|
45
|
-
|
Ménagère
|
Ékounou
|
18/11/2016
|
|
15
|
Mbarga
Armand
|
M
|
28
|
BEPC
|
Sans
profession
|
Mokolo
|
11/11/2016
|
|
16
|
Ekani
Xavier
|
M
|
34
|
Licence
|
Sans
profession
|
Mvog-Ada
|
3/12/2016
|
|
17
|
Kouatchou
François
|
M
|
39
|
Probatoire
A4
|
Libraire
|
Mokolo
|
11/11/2016
|
|
18
|
Abdou
Lomis
|
M
|
29
|
-
|
Cordonnier
|
Mokolo
|
12/11/2016
|
|
19
|
Njeng
David
|
M
|
32
|
Probatoire
|
Préposé des
douanes
|
Ékounou
|
18/11/2016
|
|
20
|
Emeyene
Nathalie
|
F
|
40
|
Bacc +2
|
Agent
commerciale
|
Ngoa-
Ekelle
|
10/12/2016
|
|
21
|
Ndjock
Victorine
|
F
|
27
|
Probatoire
A4
|
Préposée de
kiosque
|
Ngoa-Ekelle
|
10/12/2016
|
|
22
|
Mbede
Anatole
|
M
|
32
|
-
|
Gérant de salle de jeu
|
Mvog-Ada
|
3/12/2016
|
|
23
|
Ebongue
Samuel
|
M
|
35
|
Licencié
|
Sans
profession
|
Ngoa-
Ekelle
|
10/12/2016
|
|
24
|
Okala
Robert
|
M
|
28
|
CAP
|
Sérigraphe
|
Mokolo
|
12/11/2016
|
|
25
|
Tchami
guillaume
|
M
|
41
|
BEPC
|
Transporteur à
moto
|
Mvog-Ada
|
3/12/2016
|
133
ANNEXE VI
VERS LA CRÉATION D'UN MINISTÈRE EN CHARGE
DES JEUX D'ARGENT AU CAMEROUN

134
TABLE DES MATIÈRES
SOMMAIRE i
DÉDICACE Erreur ! Signet non
défini.
REMERCIEMENTS iv
LISTE DES ILLUSTRATIONS v
LISTES DES ABRÉVIATIONS ET DES ACRONYMES vi
RÉSUMÉ vii
ABSTRACT viii
INTRODUCTION 1
1. Contexte justificatif du choix du thème 2
2. Problème de recherche 4
3. Problématique 5
4. Questions de recherche 8
4.1. Question principale 8
4.2. Questions secondaires 8
5. Hypothèses de recherche 9
5.1. Hypothèse principale 9
5.2. Hypothèses secondaires 9
6. Objectifs visés par la recherche 9
7. Intérêts de la recherche 10
8. Méthodologie de la recherche 10
8.1. Cadre théorique 11
8.1.1. Le constructivisme 11
8.1.2. L'approche dynamiste et critique 12
8.2. Techniques et outils de collecte des données 13
8.2.1. Délimitation du champ d'investigation 13
8.2.2. Échantillonnage 15
8.2.3. L'observation directe 18
8.2.4. La recherche documentaire 19
8.2.5. L'entretien semi-directif 19
8.2.6. Le questionnaire 20
9. Mise au point conceptuelle 20
9.1. Jeu d'argent 20
135
9.2. Changement social 22
10. Organisation du mémoire 23
CHAPITRE I : PANORAMA DES JEUX À YAOUNDÉ ET
DESCRIPTION DU
PHÉNOMÈNE 24
I. ESQUISSE D'UNE TYPOLOGIE DES JEUX 24
1. Les jeux d'argent légalisés 26
1.1. Les casinos et les types de jeux autorisés 26
1.2. Les jeux en ligne 27
1.2.1. La loterie 27
1.2.2. Les paris sur les évènements 29
1.3. Les machines à sous 33
1.3.1. Le baby-foot 33
1.3.2. Le flipper et les jeux vidéo 34
2. Les jeux d'argent clandestins 36
2.1. Le « bonus Win » 36
2.2. La Playstation 37
2.3. Le bonneteau ou « Three cards » 38
2.4. Les jeux de la société d'en bas 39
II. LOCALISATION DES PRATIQUES DE JEUX D'ARGENT À
YAOUNDÉ : UNE VISIBILITÉ MANIFESTE ET STRATÉGIQUE
CONSTRUITE PAR LES PROMOTEURS
.40
1. Essai de description de la pratique des jeux d'argent dans
les espaces clos 41
1.1. Le casino : propension à la dépendance et
stigmatisation du lieu 41
1.2. Les jeux d'argent dans les bars 43
1.3. Les jeux d'argent dans les salles 44
2. Présentation du phénomène des jeux
d'argent sur l'espace public 46
2.1. Les jeux d'argent dans les tripots de rues. 46
III. PERCEPTIONS ET STRATÉGIES D'ACTIONS
MERCANTILISTES DES
ACTEURS À TRAVERS L'ARÈNE DU JEU 51
1. L'acteur institutionnel : les pouvoirs publics et la
politique du jeu 51
2. Les promoteurs de structures de jeux et la stratégie
de l'action sociale 55
3. Les joueurs et la logique d'un « loisir lucratif »
56
4. Les « katikas » et leur concours dans les pratiques
de jeux d'argent 59
5. Les intermédiaires et leur rôle dans la
facilitation des casinos et des PMU 60
136
CHAPITRE II : MÉCANISMES D'ENRÔLEMENT ET
DE PARTICIPATION DES
ACTEURS AUX JEUX D'ARGENT 63
I. LES MASS-MÉDIAS ET LEUR RÔLE DANS L'INCITATION
DES INDIVIDUS
AUX JEUX D'ARGENT 65
1. La publicisation des jeux d'argent : un pouvoir de coercition
du joueur 66
2. La télévision et son pouvoir de
séduction du joueur 68
3. La radio et son impact sur le comportement du joueur 71
4. Internet et la promotion des jeux d'argent en ligne 72
II. MOBILITÉ SOCIALE ET QUÊTE D'ANCRAGE ET
D'AUTONOMIE DES
ACTEURS À TRAVERS LES JEUX D'ARGENT 73
1. Fréquentation des milieux de jeux et apprentissage
social chez les désoeuvrés 73
2. Proximité des lieux de jeux et construction
d'illusions du gain chez les commerçants 79
les marchés, les
gares routières et les carrefours qui sont des lieux de forte
concentration des
populations, l'accointance des lieux de jeux est un
élément incitatif. 79
3. Conscription aux jeux d'argent : entre verrouillage du dedans
et libération des passions
du dehors chez les salariés 83
CHAPITRE III
:AMPLIFICATION DES PRATIQUES DE JEUX D'ARGENT ET
CHANGEMENT SOCIAL 89
I. LES TRANSFORMATIONS SOCIALES ENGENDRÉES PAR LA PRATIQUE
DES
JEUX D'ARGENT SUR LA SOCIÉTÉ URBAINE À
YAOUNDÉ 89
1. Dépendance aux jeux d'argent et rapports d'exclusion
sociale 90
1.1. La détérioration du cadre de vie familial du
joueur et ses corolaires 92
1.2. De l'obsession du jeu à la déchéance
sociale du joueur 96
1.3. Jeux d'argent et délinquance sociale 98
1.4. Jeux d'argent et émergence d'une pensée
à court terme 99
1.5. Vers une société de consommation des jeux
d'argent à Yaoundé 101
2. De la configuration du lien social à travers le jeu
103
II. LES NON-DITS DE LA PROLIFÉRATION DES JEUX D'ARGENT
À YAOUNDÉ 105
CONCLUSION 109
BIBLIOGRAPHIE 117
ANNEXES 123
TABLE DES MATIÈRES 134
|
|



