|

UNIVERSITE DE MAROUA
THE UNIVERSITY OF MAROUA
*******
ECOLE NORMALE SUPERIEURE
*******
*******
HIGHER TEATCHER'S TRAINING COLLEGE
*******
DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE
*******
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
*****
GEOGRAPHIE
DEGRADATION SPATIO-TEMPORELLE DES LIGNEUX
PERENNES
DANS LA LOCALITE DE HOUDOUVOU
(EXTRÊME-NORD CAMEROUN)
Mémoire présenté en vue de
l'obtention du diplôme de Master recherche Option : Géographie de
l'Environnement
Par :
DJAFNGA DABIDJOUM Maxime Licence en Géographie
19B0270N
Sous la direction de :
TEWECHE Abel
Chargé de Cours
Septembre 2021

DÉDICACE
À
Mes parents :
Issa DABIDJOUM et DAIDA Alice
ii
REMERCIEMENTS
Ce mémoire est le fruit des efforts et des
encouragements de personnes diverses qui n'ont ménagé aucun
effort pour que cela puisse se réaliser.
Mes remerciements vont premièrement à mon
directeur de mémoire le Dr. TEWECHE Abel qui, au-delà de toutes
ses occupations, a bien voulu diriger ce travail. Aussi, je lui adresse un
grand merci pour toute sa patience et son dévouement pour que ce travail
puisse porter ces fruits.
Mes remerciements vont aussi à l'endroit du Chef de
Département de Géographie de l'Ecole Normale Supérieure de
Maroua, Pr. WATANG ZIEBA Félix et aux enseignants, le Pr GONNE Bernard,
Pr. KOSSOUMNA LIBA'A Natali, Pr. BASKA TOUSSIA Daniel Valérie, Pr.
ELOUNDOU MESSI Paul Basile, Dr. GANOTA Boniface, Dr. MBANMEYH Marie Madeleine,
Dr ABDOURAMAN Tom et Mme.ANNAVAI Nathalie pour la formation, les conseils et
les éclaircissements tout au long de ma formation.
Mes remerciements vont aussi au délégué
départemental de l'Environnement, aux autorités des Eaux et
Forêts de la localité de Houdouvou, aux gardiens de la zone de
reboisement et au chef du village de la localité de Houdouvou, qui ont
facilité la collecte des données en donnant accès aux
informations, archives et documents utiles.
A mes camarades de promotion, merci pour vos encouragements
sans cesse pour la finalisation de cette étude. Je remercie
particulièrement Zieba Yves, Mboyelbo Fernand, Amiral Adil, qui m'ont
aidé dans les travaux d'enquêtes et de relevés sur le
terrain.
Je ne pourrais finir sans remercier ma famille pour leur
soutien moral, matériel et financier ainsi que tous ceux qui, de
près ou de loin, ont participé à l'élaboration de
ce mémoire.
III
RÉSUMÉ
A l'Extrême-Nord Cameroun comme dans le Sahel en
général, le problème de dégradation des ressources
ligneuses est d'actualité. L'objectif de ce travail est d'analyser la
dégradation spatio-temporelle des espèces ligneuses
pérennes. L'étude a porté sur la localité de
Houdouvou (Extrême-Nord Cameroun). L'exploitation des sources
d'information secondaires a été possible grâce au centre de
documentation de l'école normale supérieure de Maroua et
grâce aux sites spécialisés de recherche documentaires. Les
informations primaires ont été acquises par enquêtes par
questionnaires et par relevé botaniques. Au total, 120 personnes ont
été enquêtées et 36 placettes
réalisées dans des mailles disposées dans les zones de
reboisements, de cultures, d'habitations et dans les zones
dégradées. Une analyse diachronique a été faite sur
une période de 20 ans. Les enquêtes ethnobotaniques auprès
des personnes ressources ont permis d'analyser le processus de
dégradation. A l'issu de ces travaux, les résultats ont permis de
dénombrer 30 espèces pour 16 familles inventoriées dans
les zones quatre zones. Ces espèces sont constituées d'arbres et
d'arbustes pérennes comme Acacia Albida, Acacia nilotica, Anacardium
occidentale, Azadirachta indica, Colophospermum mopane. Les indices de
diversités floristiques (H'= 1,518, D =0,0327, EQ= 0,461), de
mortalités (13), de raréfaction (89), la densité des tiges
à l'hectare (195 tiges/ha) témoigne d'un état de
dégradation des ligneux pérennes. De plus, l'analyse diachronique
du couvert ligneux de 2001 et 2021 montre une réelle dégradation.
Les fortes variations pluviométriques et les activités
anthropiques sont les principaux facteurs responsables du processus de
dégradation des ligneux. Toutefois, des stratégies plus
ambitieuse et respectueuse de la nature sont indispensables pour une
utilisation durable des ligneux pérennes.
Mots clés : Dégradation,
ligneux pérennes, stratégie de restauration, Houdouvou,
Extrême-Nord Cameroun
ABSTRACT
In the Far North Cameroon as in the Sahel in general, the
problem of degradation of wood resources is topical. The objective of this work
is to analyze the spatio-temporal degradation of perennial woody species. The
study to be carried out on the locality of Houdouvou (Far-North Cameroon). The
use of secondary sources of information was made possible thanks to the
documentation center of the Maroua Higher Normal School and thanks to
specialized documentary research sites. Primary information was acquired by
questionnaires and botanical surveys. A total of 120 people were surveyed and
36 plots carried out in meshes laid out in areas of reforestation, crops,
housing and degraded areas. A diachronic analysis was made over a period of 20
years. Ethnobotanical surveys among resource persons made it possible to
analyze the degradation process. At the end of this work, the results made it
possible to count 30 species for 16 families inventoried in the four zones.
These species consist of perennial trees and shrubs such as Acacia Albida,
Acacia nilotica, Anacardium occidental, Azadirachta indica, Colophospermum
mopane. The indices of floristic diversity (H '= 1.518, D = 0.0327, EQ =
0.461), mortalities (13), rarefaction (89), the density of stems per hectare
(195 stems / ha) testifies to `a state of degradation of perennial woody
plants. In addition, the analysis of the woody cover for 2001 and 2021 shows
real degradation. The strong variations in rainfall and human activities are
the main factors responsible for the process of degradation of woody plants.
However, more ambitious and nature-friendly strategies are essential for a
sustainable use of perennial trees.
Keywords: Degradation, perennial species,
restoration strategy, Houdouvou, Far North Cameroon
iv
SOMMAIRE
DÉDICACE i
REMERCIEMENTS ii
RÉSUMÉ iii
ABSTRACT iii
SOMMAIRE iv
LISTE DES FIGURES v
LISTE DES TABLEAUX vii
LISTE DES PHOTOS viii
LISTE DES PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES ix
LISTE DES ENCADRES x
LISTES DES ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES
xi
INTRODUCTION GENERALE 1
Chapitre 1 : Etat des lieux des ligneux
pérennes 45
Chapitre 2. Processus de dégradation des
ligneux pérennes 73
Chapitre 3. Effets de la dégradation des
ligneux pérennes 104
Chapitre 4. Stratégie de gestion, de
pérennisation et perspective 132
Discussion des résultats 154
Conclusion générale et recommandation
157
Bibliographie 161
Annexes 166
Table des matières 175
V
LISTE DES FIGURES
Figure 1.Localisation de la zone d'étude 5
Figure 2. Localisation de Houdouvou 6
Figure 3. Dispositif d'échantillonnage : une maille de
neuf placettes. 36
Figure 4.Disposition des mailles dans la zone d'étude
37
Figure 5. Nombre d'individus par espèces 49
Figure 6. Nombre d'individus par placettes 51
Figure 7. Nombre d'individus par zone 52
Figure 8. Proportion des familles des espèces fortement
représentées 53
Figure 9. Proportion des familles des espèces
moyennement représentées 54
Figure 10. Proportion des familles des espèces
faiblement représentées 55
Figure 11. Etat des ligneux pérennes 59
Figure 12. Nombre des individus vivants par placette 59
Figure 13.Nombre des individus morts par placettes 60
Figure 14. Etat des individus vivants par placettes 61
Figure 15. Structure générale des ligneux
pérennes par classes de hauteur 62
Figure 16. Structure des ligneux pérennes par classes
de hauteur dans la zone de
reboisement 63
Figure 17. Structure des ligneux pérennes par classes
de hauteur dans les champs 64
Figure 18. Structure des ligneux pérennes par classes
de hauteur dans les champs 65
Figure 19. Structure des ligneux pérennes par classes
de hauteur dans les zones
dégradées 66
Figure 20. Circonférence générale
espèces ligneuses 67
Figure 21. Circonférence des espèces ligneuses
dans les zones de reboisement 68
Figure 22. Circonférence des espèces ligneuses
dans les zones de champs 69
Figure 23. Circonférence des espèces ligneuses
dans les zones d'habitation 70
Figure 24. Circonférence des espèces ligneuses
dans les zones dégradées 71
Figure 25. Etat du couvert ligneux en 2001 74
Figure 26. Etat du couvert ligneux en 2021 75
Figure 27.Dynamique du couvert végétal de la
localité de Houdouvou entre 2001 et
2021. 77
vi
Figure 28. Variabilité pluviométrique de 1990
à 2017 80
Figure 29. Nombre des individus élagué dans les
placettes 88
Figure 30. Mode de prélèvement des ligneux
pérennes 90
Figure 31. Mode de préparation des champs 92
Figure 32. Lieu de prélèvement des ligneux
pérennes 94
Figure 33. Principaux usages des ligneux pérennes 97
Figure 34. Processus de dégradation des ligneux
pérenne 102
Figure 35.Taux de mortalité par placette 105
Figure 36. Abondance relative par familles 110
Figure 37. Etat des ligneux pérennes 111
Figure 38. Degré de dégradation des ligneux
pérennes 112
Figure 39. Variation des températures de 2001 à
2010 116
Figure 40. Variation des températures de 2011 à
2017 117
Figure 41. Effets de la dégradation 122
Figure 42. Niveau des effets 122
Figure 43. Variation de la production agricole 123
Figure 44. Activités les plus pratiquées 129
Figure 45. Etat des personnes ayant une fois planté un
arbre 133
Figure 46. Mesures de pérennisation 134
Figure 47. Connaissance de loi sur les ligneux 135
Figure 48. Moyen d'accès aux ligneux 138
Figure 49. Personnes sensibilisées 141
Figure 50. Agents de sensibilisation et d'accompagnement
142
Figure 51. Mesures d'accompagnements 143
Figure 52. Bénéficiaires d'une mesure
d'accompagnement 143
vii
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1. Opérationnalisation du concept de
dégradation des ligneux pérennes 22
Tableau 2. Caractérisation de la
végétation ligneuse pérenne 27
Tableau 3. Diversité floristiques des ligneux
pérennes 46
Tableau 4. Liste des espèces arborées 47
Tableau 5. Liste des espèces arbustives 48
Tableau 6.Évolution spatiale des superficies reparties
en fonction des zones de
végétations identifiées dans la
localité de Houdouvou. 76
Tableau 7. Indice de diversité par placettes 81
Tableau 8. Indice de diversité par zones 83
Tableau 9. Densité par placette 84
Tableau 10. Densité par zones 85
Tableau 11. Densité des principales familles
d'espèces 86
Tableau 12. Sources d'accès au bois de chauffe 91
Tableau 13. Principales activités économique
95
Tableau 14. Taux de mortalité par zone 106
Tableau 15. Indice de raréfaction par espèces
107
Tableau 16. Indice de raréfaction par familles 108
Tableau 17. Abondance relative des espèces 109
Tableau 18.Fréquence des espèces pérennes
113
Tableau 19.Fréquence totale des espèces par
classe de pourcentage 114
Tableau 20. Changements observés 125
Tableau 21. Texte de lois sur la protection de la nature au
Cameroun 147
VIII
LISTE DES PHOTOS
Photo 1. Formation végétale claire 56
Photo 2. Formation végétale dense 57
Photo 3. Arbre en défoliation 79
Photo 4. Arbre élagué 89
Photo 5. Construction d'un hangar avec les ligneux
pérennes 98
Photo 6. Vaste espace dégradé 118
Photo 7. Mauvaise production agricole 124
Photo 8. Ressource de combustion alternative 127
Photo 9. Jeune plant d'Acacia raddiana planté. 133
Photo 10. Agent de contrôle 137
ix
LISTE DES PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES
Planche photographique 1. Mesure de relever
dendrométrique 28
Planche photographique 2. Entretiens et enquêtes 33
Planche photographique 3. Formations végétales
d'alignements 58
Planche photographique 4. Mode de préparation des
champs 93
Planche photographique 5. Clôture des champs avec des
ligneux pérennes 96
Planche photographique 6. Vente incontrôlée des
ligneux pérennes 100
Planche photographique 7. Vaste surface érodé
120
Planche photographique 8. Extension des surfaces de cultures
126
Planche photographique 9. Animaux à la recherche du
pâturage 130
Planche photographique 10. Formations végétales
d'alignements 139
X
LISTE DES ENCADRES
Encadré 1. Interview des gardiens de la zone de
reboisement 99
Encadré 2. Interview du chef du village de Houdouvou
101
Encadré 3. Moyens de gestion des eaux et forêts
136
xi
LISTES DES ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET
SIGLES
CAB : Central African Backbone
CIRAD : Centre de Coopération
Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
CO2 : Dioxyde de Carbone
ESA : Agence Spatiale Européenne
FAO : Organisation des nations Unis pour
l'alimentation et l'agriculture
GIC : Groupe d'Initiative Commune
GIZ : Deutsche Gesellschaft für
Zusammenarbeit
GPS : Global Positioning System
QCM : Questions à Choix Multiples
QGIS : Quantum Geographic Information
System
ICRAF : Centre international pour la
Recherche en Agronomie
MINEF : Ministère de l'Environnement
et des Forêts
MINFOF : Ministère des Forêts et
de la Faune
MINEP : Ministère de l'Environnement,
de la Protection de la Nature et du
Développement Durable
PM : Premier Ministre
PLASA : Planter Sans Arrosage
REDD+: Reducing Emissions from Deforestation
Degradation
SPSS: Statistical Package for the Social
Sciences
SODECOTON : Société de
Développement de Coton
UICN : Union Internationale pour la Conservation
de la Nature
1
INTRODUCTION GENERALE
1. Contexte de la recherche
Le Sahel est une entité biogéographique
définie en première instance par son climat tropical aride
à semi-aride, contrôlé par la mousson du golfe de
Guinée et l'Harmattan (alizé) saharien. Mais au cours du
quaternaire la végétation sahélienne a dû s'adapter
à des fluctuations climatiques entre les climats tropicaux humide et
aride, voire hyperaride. La distribution des précipitations au cours de
la saison des pluies et leur redistribution par ruissellement à la
surface des sols sont les facteurs prépondérants de la
diversité du couvert végétal et de sa production. Les
nuances du régime hydrique des sols qui résultent de
l'interaction entre la redistribution des eaux de pluie et la texture des sols,
sont à la base d'une forte différenciation des formations
végétales, en particulier de leur composante pérenne
arbres et arbustes alors que la composition des herbacées annuelles
varie largement d'une année à l'autre au gré de la
distribution des pluies dans l'espace et le temps.
Les espèces pérennes sont des espèces qui
vivent au moins deux ans. En botanique, une plante est pérenne lorsque
le végétal est vivace donc pérennant, vit plus de deux
années. La plante vivace est alors pérennante. Les plantes
pérennes se retrouvent dans la végétation
sahélienne et celle de la savane soudanienne (Ouédraogo et
al, 2009). La localité de l'Extrême-Nord du Cameroun qui
se situe en zone semi-aride est composée des espèces ligneuses
pérennes. Cependant ces espèces qui sont censées vivre
longtemps connaissent une dégradation du fait de son contexte climatique
rude de l'Extrême-Nord et des activités humaines. Bien même
que ces espèces soient souvent plantées par l'homme, elles
meurent souvent trop jeunes et ne parviennent pas à atteindre leur
degré maximum de maturation.
Dans les systèmes agraires du Sahel, les arbres ont une
importance capitale pour les populations. Ils leur procurent divers
bénéfices : aliments, médicaments traditionnels,
fourrages, bois de feu, bois d'oeuvre et de service. Au-delà de ce
rôle pour le bien-être de la population, les arbres sont reconnus
pour leur rôle fondamental dans le maintien de l'équilibre des
écosystèmes
2
L'Extrême-Nord Cameroun et plus
précisément la localité de Houdouvou se situe dans une
zone ou on observe une accentuation de la dégradation des ressources
ligneuses pérennes. La végétation de ce milieu est
confrontée à de nombreux problèmes liés aux
processus climatiques, édaphiques et anthropiques. Cette étude
s'inscrit dans une perspective de la dégradation des ligneux
pérennes en milieu semi-aride.
Si Abdel-kerim (2019) a permis d'expliquer la dynamique du
couvert végétal ligneux dans le terroir de Tetal au Tchad, cette
étude vise à mieux comprendre le phénomène dans un
contexte de dégradation des espèces ligneuses pérennes
dans la localité de Houdouvou, tout aussi important car elle va nous
permettre de nous interroger sur l'avenir des ligneux qui qui vivent plus de
deux ans dans des zones ou les conditions climatiques sont rude et dont la
durée de survie est en train de se dégradée en fonction du
temps. Elle permettra aussi de comprendre les acteurs impliqués dans
leurs mutations, d'analyser les enjeux de la dégradation de ces
ressources ligneuses dans un contexte soudano-sahélien, d'en
déduire les éventuels effets pour l'Homme et pour la nature. Une
meilleure compréhension de cette dynamique ligneuse permettrait ainsi
d'élaborer et de tester des méthodes et outils nécessaire
pour une gestion efficace et efficiente de la ressource ligneuse pérenne
en zone à stress hydrique, singulièrement dans la localité
de Houdouvou.
Les espèces ligneuses pérennes qui peuplent la
localité de Houdouvou se dégradent de plus en plus et d'autres
tendent à se raréfier dans l'espace et dans le temps. C'est dont
conscient de cette dynamique régressive que cette étude se
propose d'analyser la dégradation des ligneux pérennes.
Ainsi, elle consistera à faire un état des lieux
des ligneux pérennes en zone semi-aride à travers une analyse de
la diversité des espèces et une étude
dendrométrique de ces espèces. Il sera aussi question de
déterminer les facteurs à l'origine de l'altération des
ligneux pérennes et les marques spatio-temporelles de cette
dégradation. La proposition des moyens de pérennisation
constituera le dernier point de ce travail.
2. 3
Justification du choix du sujet
La première raison ayant conduite à choisir ce
sujet est l'exploitation constante des ligneux pérennes dans la
localité de Houdouvou et de la conséquence directe qu'elle
engendre. Il a été observé une réduction et une
disparition de nombreuses espèces ligneuses pérennes
(Combretum migranthum, Dalbrgia melanoxylon, Erophaca
baetica, Grewia villosa, Gymnosporia senegalensis,
Ozora insignis), une forte pression anthropique sur le couvert
végétal est également notée, ainsi que le
déracinement des arbres. Ces problèmes ont conduit à se
poser tant de question qu'il est nécessaire d'analyser afin de
comprendre : Quel est la place des ligneux pérennes dans le maintien de
l'environnement et dans la survie des populations riveraines ? Qu'est-ce qui
explique aujourd'hui, la réduction des essences ligneuses dotées
de la capacité de vivre plus longtemps que les autres espèces
végétales ? Les autorités locales applique-t-elles les
lois et code forestière ? Quelles mesures faudra-t-elles pour valoriser
ces espèces ?
La seconde raison porte sur le choix du domaine
d'étude. Il s'agit de mener une étude «
Biogéographique » en orientant le phénomène
d'étude dans la dynamique régressive de la
végétation ligneuse. Il est ainsi question de comprendre ce qui
se passe dans cette science biogéographique avec les ligneux en
général et les ligneux pérennes en particulier, de
comprendre à travers cette étude ses objectifs, ses objets
d'études, ses méthodes, ses champs d'études, ses auteurs,
ses théories ses interdisciplinarités avec les autres
sous-branches de la géographie et autres sciences et afin ses
particularités et les résultats. À cette fin donc, cette
étude porte sur la dégradation spatio-temporelle des ligneux
pérennes dans les terroirs de Houdouvou, arrondissement de Meri.
3. Délimitation du sujet
Afin de mieux circonscrire et localiser
géographiquement l'étude, il est question de faire une
délimitation thématique, spatiale et temporelle de ce
thème de recherche.
3.1. Délimitation thématique
La thématique étudiée se situe dans le
domaine physique de la géographie, particulièrement en
biogéographique. La biogéographie, par définition est
l'étude de la répartition actuelle ou passée des
êtres vivants animaux et végétaux et de l'organisation
4
de leurs communautés à la surface de la terre,
ainsi que des facteurs et modalités de leurs considérations
spatiales et fonctionnelles.
Il s'agit plus précisément de la
phytogéographie1 ou biogéographie
végétale qui est l'étude la répartition des plantes
et des formations végétales sur la terre, s'appuyant sur
l'association ou la communauté des organismes végétaux
(phytosociologie) et la végétation naturelle potentielle.
La main de l'homme associé aux conditions rudes du
climat contribue à la dégradation de l'environnement et par
ricochet à la destruction des ressources ligneuses dites
pérennes. Dans cette perspective, l'étude de la
végétation faite dans le cadre de cette thématique vise
à identifier, à caractériser et à évaluer le
niveau de dégradation des ligneux pérennes en zone semi-aride.
3.2. Délimitation spatiale
La recherche se déroule à l'Extrême-Nord
Cameroun, dans le département du Diamaré, dans une
périphérie de la ville de Maroua, chef-lieu de la région.
Il est située entre le 10ème et 11ème degré de
latitude Nord et le 14ème et 15ème degré de longitude Est
et est découpée en neuf communes. La zone est choisie sur la base
des critères suivants : zone présentent un déficit
hydrique, zone d'érosion des couvertures ligneuses, espace en pleine
mutation. Il s'agit plus précisément de la localité de
Houdouvou dans l'arrondissement de Meri. La figure 1 et 2 ci-dessous localise
la zone où l'étude est mené dans l'optique d'analyser les
implications de la dégradation des ligneux pérennes.
1 Science au croisement de la botanique et de la
géographie, qui étudie la répartition des
végétaux à la surface du globe et les causes de cette
répartition ainsi que les relations existantes entre les espèces
ou communautés végétale d'une part, et les
caractéristiques géographiques, et biologique d'autre part.

5
Figure 1.Localisation de la zone d'étude
6
La figure 1 donne une indication plus globale de la zone
d'étude dans le département du Diamaré et dans
l'arrondissement de Meri. La localisation de la zone d'étude avec les
unités d'occupations du sol est représentée dans la figure
1.

Figure 2. Localisation de Houdouvou
7
3.3. Délimitation temporelle
Le cadre spatial de la recherche ainsi délimité,
il importe par la suite de situer l'étude dans le temps. Pour une
meilleure analyse et une bonne explication de la dégradation
spatio-temporelle des espèces pérennes dans la localité de
Houdouvou, il s'est avéré impérieux pour nous de
délimiter ce travail dans l'intervalle 2001 à 2021.
La borne inférieure est représentée par
l'année 2001. Le choix de cette borne est fait par rapport aux facteurs
identifiés pour le cas de ce travail. 2001 est une date ou la
démographie n'était pas aussi importante que 2021 et donc la
pression sur les ligneux était moins grande.
La borne supérieure, 2021 renvoie à la
dernière des dates où le choix de ce sujet est fait et où
le couvert ligneux connait une dégradation par rapport à celle de
2001 et c'est surtout le moment où les menaces sur les ligneux
pérennes sont perçu en direct tant du côté des
riverains que du côté des autorités.
4. Revue de la littérature
La dégradation des espèces ligneuses dites
pérennes dans la localité de Houdouvou est le résultat des
facteurs d'origines naturelles et anthropiques. La dégradation de ces
ligneux a des conséquences sur la nature en générale et
sur les hommes en particulier. Dans cette optique, la revue faite dans le cadre
de ce travail est axée autour de la caractérisation des
formations végétales pérennes en zone semi-aride, des
facteurs de la dégradation du couvert ligneux, des conséquences
de la dégradation de la végétation pérenne et enfin
des stratégies de gestion et de préservation de la
végétation pérenne en zone semi-aride.
4.1. Caractérisation des formations
végétale pérenne en zone semi-aride
La caractérisation des ligneuses pérennes
analyses les différents ligneux pérennes à travers leurs
identifications, leurs structures, leurs localisations, leurs processus de
germinations et leurs évolutions.
Babacar, et al dans Flore et végétation de
la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul (Sénégal)
ont réalisé une étude entre 2010 et 2014 dans la
Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul (RSFG) abritant une faune
riche et variée ainsi qu'une flore diversifiée mais peu connue.
Cette étude est entreprise pour déterminer la structure de
8
la flore et de la végétation,
élément indispensable pour une bonne gestion des ressources de
cette réserve. L'étude floristique a montré que la flore
de cette réserve est riche de 100 espèces réparties en 82
genres et 42 familles parmi lesquelles, les Poaceae, les Fabaceae,
les Convolvulaceae et les Amaranthaceae sont les plus
diversifiées. Les Dicotylédones dominent cette flore. Les
Thérophytes constituent l'essentiel de la flore, suivis des
Phanérophytes.
Les plantes pérennes doivent faire face à un
défi commun : une longueur de cycle très importante combinant
âge d'évaluation et âge de reproduction. Cette
dernière pouvant représenter plus d'une décennie
(Catherine Bastien (2019). Chez les arbres forestiers et fruitiers, le fort
encombrement spatial et l'âge d'évaluation des critères
économiques de production limitent souvent les possibilités de
phénotypage et augmentent les coûts d'évaluation.
L'évolution des ligneux suivant un processus de
germination est étudiée par Ouedraogo et al; (2009).
Ainsi, il met en évidence le rôle que jouent les jeunes plants
dans l'établissement de la végétation adulte. Ils
déterminent par ce fait les stades de croissance où les plantes
les plus jeunes sont vulnérables, et la conquête des plantes
adultes dans le milieu. Ils établissent la théorie de la
sélection naturelle dans une logique d'adaptation des
végétaux dans leur écosystème. Dans le même
ordre d'idées, Jean Marie Fondoun dans Situation des Ressources
Génétiques Forestières du Nord Cameroun
préparé pour l'Atelier sous régional FAO/IPGRI/ICRAF sur
la conservation, la gestion, l'utilisation durable et la mise en valeur des
ressources génétiques forestières de la zone
sahélienne aborde plusieurs thèmes qui caractérisent la
région soudano-sahélienne.
Dans son article, il fait une description de la
végétation Camerounaise et celle de la savane soudanienne
(début de la plaine de la Bénoué au Sud de Maroua) en
particulier. Dans cette étude, il note que le couvert
végétal de cette zone est dominé par une forêt
sèche et éparse. La pression de l'agriculture a suffisamment
transformé le paysage en une savane plus ou moins arbustive
dominée par l'abondance de combretum et terminalia.
Les composantes de cette formation sont : Boswellia dalzielii, Commiphora
africana et les résineux Commiphora pedunculata, Dalbergia melanoxylon
aux
9
branches épineuses, Diospyros mespiliformis, Lannea
fructicosa et Lannea microcarpa. Dans la vallée de la plaine de la
Bénoué, avec un lac permanent et les surfaces inondables, on
rencontre une flore particulière dominée par Borassus
aethiopum. Il continue son analyse avec la caractérisation des
formations végétale de la savane sahélo-soudanienne (Sud
de Maroua jusqu'au bord du Lac Tchad). Il note ainsi une steppe épineuse
qui forme une broussaille d'épineux qui colonisent les sols calcaires
dont les principales espèces constitutives sont Acacia seyal,
Balanites aegyptiaca, Capparis sp. Combretum aculeatum, Ziziphus
abyssinica. Les prairies périodiquement inondables
déstabilisées par le pâturage intensif, les feux de brousse
et l'agriculture industrielle présentant un paysage boisé dont
les principales composantes colonisatrices des sols noirs argileux sont
Acacia seyal et quelques fois, Acacia nilotica var.
adansonii.
Couteron et al. (1992) dans une étude au
Nord-ouest du Burkina Faso montre la structure et l'état des peuplements
dans les hauts glacis gravillonnaires (fourrés tigrés), les bas
de glacis (savanes arbustives), les bas- fonds (forêt claire). Aussi, les
mesures des différentes variables d'état des peuplements montrent
que les densités d'arbres vivants ainsi que les taux de mortalité
sont variables selon les situations écologiques ; la
régénération, en revanche, en dépend moins
nettement et est relativement abondante. Dans le même ordre
d'idée, Oumar et al. (2014) dans une étude sur
l'état de la végétation ligneuse dans trois unités
d'utilisation des terres d'une zone agropastorale au Sénégal
(Région de Kaffrine) détectent la présence de 40
espèces ligneuses relevant de 33 genres et 21 familles avec une
proportion importante des espèces de la famille des Combretaceae.
Par ailleurs, les paramètres étudiés montrent une
nette différence entre ces entités témoignant de leur
hétérogénéité, mais avec un plus grand
niveau de stabilité du peuplement dans la forêt. Pour ces auteurs,
le peuplement est globalement jeune avec une importante proportion des
individus dans les premières classes de diamètre et de
hauteur.
Dans cette littérature, moules auteurs ont
identifié et caractérisé les formations ligneuses des
milieux sahéliens. Il s'agit précisément Acacia seyal,
Balanites aegyptiaca, Capparis sp. Combretum aculeatum, Ziziphus abyssinica.
Ce travail se propose de faire un état des lieux des ligneux
pérennes dans la localité de Houdouvou à
10
travers une classification des espèces arborées
et arbustives et une analyse dendrométrique de la répartition de
ces espèces.
4.2. Les facteurs de la dégradation du couvert
ligneux.
La dégradation des ligneux pérennes est la
résultante des facteurs d'origines naturelles et anthropiques. Ces
facteurs vont des fortes variabilités pluviométriques aux
activités humaines en passant par les défaillances
institutionnelles.
Téwéché et al. (2016), dans
l'ouvrage intitulé risque et catastrophes en zone
Soudano-Sahélienne du Cameroun : aléas,
vulnérabilités et résilience traitant de la dynamique
régressive de la végétation ligneuse dans la
réserve forestière de Zamay ressortent que la réserve
subie une régression. Cette régression est due à la
conjugaison des problèmes institutionnels et des facteurs naturels et
anthropiques. Dongmo (1996), Fotsing (1997) et Atangana (2002) vont dans le
même sens en présentent l'inventaire des espèces ligneuses
et la dynamique de la population dans la zone de production de bois de feu
à Maroua. Ils démontrent que plusieurs espèces ligneuses
sont en voie de disparition suite aux exploitations abusives et
incontrôlées des arbres.
Pour Timberlake (1985) et Pearce (1988), l'évolution
rapide et sans contrôle des territoires et la dégradation de
l'environnement est une conséquence logique de la croissance
démographique accélérée. Ces auteurs
démontrent qu'il y a trop d'hommes mais pas assez de nourriture ni de
matières premières. De même, Ramade (1994) considère
qu'il existe une relation quasi mécanique et linéaire entre la
dégradation de l'environnement et la croissance démographique.
Dans le rapport de la FAO (2010) « Foresterie urbaine et
périurbaine en Afrique. Quelles perspectives pour le bois-énergie
? » Document de travail sur la foresterie urbaine et périurbaine,
la problématique bois-énergie pour l'approvisionnement des villes
est traité et analyse ainsi les déterminent sociaux,
économiques, institutionnels et environnementaux du bois-énergie
urbain en Afrique. Ainsi, on note que le point commun entre la forêt de
la Matmora (Maroc), les galeries forestières du plateau des malgaches
(Madagascar), les côtes sèches et les systèmes
agroforestiers du Mali, est que ces forêts périurbaines
participent largement à l'approvisionnement en bois-énergie des
agglomérations et villes d'Afrique. Tous les écosystèmes
forestiers urbains et
11
périurbains d'Afrique sont soumis à une pression
d'intensité variable, mais en augmentation constante de la part des
populations citadines. Ce si s'explique par le phénomène de
l'exode rural et d'une démographie hors de contrôle associé
souvent à une gouvernance déficiente et qui provoque par ricochet
le développement anarchique des villes. Nonobstant, les espaces
naturels, même dégradés jouent alors un rôle
essentiel dans la fourniture de produits et commodités de
première nécessité.
De même Abdel-kerim (2019) traitant de la dynamique du
couvert végétal ligneux dans le terroir de Tetal au Tchad montre
que les activités humaines sont les principales causes de la
dégradation des ligneux. Dans la thématique relative aux facteurs
qui causent une mutation du couvert ligneux Badawé et Nisso (2016)
relèvent que les facteurs anthropiques à travers les effets de la
croissance démographique causent la dynamique du couvert
végétale. Ces effets se traduisent par l'augmentation des
demandes en bois de chauffe. En effet la savane de Zokolé constitue la
source de ravitaillement en bois de chauffe. Outre les effets
démographiques, ils ont relevé les effets des activités
agricoles. En effet les changements d'affectation et d'utilisation des terres,
l'extension des parcelles agricoles encouragée par la culture du coton
augmente le processus de dégradation du couvert végétal.
Pour ce qui est des facteurs institutionnels, on note en premiers ressort les
défaillances des institutions qui oeuvrent dans la protection des
arbres. Cette défaillance se traduit par une insuffisance de
contrôle de la part des administrations compétentes, par le manque
de personnel qualifié ainsi que des moyens matériels et
financiers. Le dernier facteur à relever concerne les facteurs naturels
notamment les fortes variations pluviométriques. Ainsi, le
déficit hydrique que connais la savane de Zokolé entraine la
modification du couvert végétal.
Cette revue dresse une liste des facteurs naturels et des
facteurs anthropiques à l'origine de la dégradation des ligneux.
Pour ce travail, il est question de montrer les implications de ces facteurs
dans la dégradation spatio-temporelle des ligneux pérennes dans
la localité de Houdouvou dans l'optique d'analyser le processus de
dégradation de ces espèces.
12
4.3. Conséquence de la dégradation de la
végétation pérenne
La dégradation des ligneux pérennes à des
conséquences sur l'environnement en général et sur les
hommes et leurs activités en particulier. L'augmentation des vagues de
sécheresses, des périodes de chaleur, la raréfaction du
nombre des ligneux, la perte des productions agricoles à travers la
baisse de la fertilité des sols sont là des conséquences
directes de la dégradation des ligneux pérennes.
Le rapport de la FAO (1947) sur la mort des forêts de
l'Afrique tropicale indique que l'Afrique tropicale tend vers la savanisation
générale. Du point de vue de l'économie forestière,
sur le plan régional et mondial, les conséquences en sont
sérieuses. L'Afrique, sauf dans les régions de forêt
équatoriale, est déjà importatrice de bois. Son
développement et l'accroissement de sa population ne pourront
qu'aggraver cette situation. Dans les pays à climat très sec, les
défrichements incontrôlés autour des centres habités
ont déjà abouti à raser complètement tous les
boisements, de sorte que les femmes sont parfois obligées d'aller
chercher des fagots de bois de feu à plusieurs heures de marche, ou de
les acheter très cher au marché. Les bois d'oeuvre manquent ; il
n'y a plus de bois droits, sauf dans des galeries forestières
très éloignées. Le problème du bois se pose partout
dans ces régions sèches et peuplées, et touche aussi bien
les populations locales que les services publics. Les sociétés
humaines ont peu à peu accru leurs impacts sur les
écosystèmes par leur essor technique et démographique, au
point que l'écroulement de civilisations florissantes a pu être
attribué, au moins pour partie, à la dégradation de leur
environnement (Diamond, 2005).
L'exploitation anarchique et mal maitrisée des terres a
des conséquences néfastes telles que les défrichements,
l'érosion, la baisse de fertilisation et la destruction d'une partie des
ressources naturelles (Le Thiec, 1996 : CIRAD, 1988). L'augmentation de la
population dans les communautés rurales se traduit par une pression
accrue sur l'environnement physique de la zone, notamment sur les formations
naturelles. Les conditions édaphiques étant peu favorables
à l'agriculture (présence des sols érodés,
appauvris et peu profonds sur cuirasse ferrugineuse) les paysans
n'hésitent pas à grignoter les terres marginales sous
végétation naturelle, (Diatta et al., 1994) ce qui
dégrade le sol par une érosion non contrôlée suite
à l'intensification des cultures de coton
13
et céréales (Boli et al., 1992). La
suppression de la couverture forestière en Afrique a des
conséquences sur le climat, la conservation des sols et les
réserves d'eau, qui sont infiniment plus grandes que partout ailleurs
dans le monde. Tout d'abord, comme il a été mentionné, il
s'agit d'un phénomène général qui affecte la
majeure partie de l'Afrique tropicale, c'est-à-dire qui atteint des
proportions l'élevant au niveau d'un facteur climatique
général
Les travaux de Ganota (2014) sur la dynamique des recrûs
ligneux dans les terroirs de Djaba, Sakdjé et Gamba dans la
périphérie ouest du parc national de la Bénoué
montrent que, les techniques culturales basées sur la pratique de
culture sur brulis ou de culture intensive, provoquent des effets
négatifs sur la dynamique de régénération des
ligneux. Malgré la forte capacité de
régénération de nombreuses espèces parmi lesquelles
Bridelia feruginea, Combretum collinum, Isoberlinia doka,
Piliostigma thonningii, Annona sengalensis, il a été
noté qu'autant ces pratiques culturales favorisent à travers la
préservation la survie de certaines espèces
socioéconomiques ; autant elles réduisent la densité de
régénération, la richesse et la diversité des
ligneux après la mise en culture.
Konan et al. (2015) dans Dynamisme de la structure
diamétrique du peuplement ligneux des différents biotopes de la
forêt classée de Yapo-Abbé, Sud de la Côte d'Ivoire
montrent que l'exploitation récurrente des espèces
végétales pour la production de bois d'oeuvre, l'artisanat et les
différentes constructions d'habitations des populations riveraines, le
déplacement des engins pendant le transport après la coupe des
arbres dans la forêt naturelle et l'installation des parcelles agricoles,
ont fortement perturbé la flore et la végétation ligneuses
de la forêt classée de Yapo-Abbé. Toutes ces actions
anthropiques y ont entraîné un appauvrissement du cortège
floristique ligneux. La perturbation de ce massif forestier a modifié la
flore ligneuse du biotope forêt naturelle, où Dacryodes
klaineana, Parinari excelsa et Parkia bicolor, trois espèces
dominantes, sont remplacées par Heritiera utilis (espèce
introduite) dans la zone reboisée et par Musanga cecropioides
dans les jachères.
Plit. (1983) indique que les conséquences
fâcheuses de la dégradation du milieu naturel se font
déjà ressentir dans diverses branches de l'économie. Parmi
les effets
14
directs nous pouvons citer : l'exploitation réduite des
forêts dont le potentiel productif a diminué et la baisse de la
valeur touristique des régions dans lesquelles les forêts ont
été dévastées. De plus cette dégradation de
la végétation a accéléré l'érosion du
sol en Afrique.
La littérature faite à ce niveau dresse les
éventuelles répercussions de la détérioration des
ressources ligneuses sur l'environnement et sur les hommes. Ce travail de
propose d'analyse les implications socio-économiques de la
dégradation des espèces pérennes afin de mettre sur pieds
des bases pour une préservation de cette ressource indispensable
à la vie des Hommes.
4.4. Stratégies de gestion et de
préservation de la végétation pérenne en zone
semi-aride
Afin de ralentir la dégradation des ligneux
pérennes et ces effets dans un contexte semi-aride, des
stratégies, politiques et moyens sont mises en oeuvres. Ces
stratégies vont de l'individuel au collectif en passant par le
politique.
Manceron (2011) relève que la plupart des discours
actuels sur les aires protégées évoquent la
nécessité de prendre en compte la périphérie dans
le cadre des actions de conservation. Dans un rapport de Cirad de juin 2004,
Binot (2004) évoque la gestion participative des ressources en Afrique
Centrale en parlant de la gestion concertée des ressources naturelles,
la prise en compte des périphéries d'aires
protégées pour une meilleure gestion des ligneux. Cet auteur
prend ainsi pour exemple le parc national de Zakouma au Tchad. Il propose aux
décideurs des outils d'aménagement (plans d'aménagement,
politiques de conservation) qui prennent en compte les stratégies de
subsistance des acteurs locaux.
Dans le mémoire de Master II recherche de Toumba Tizi
portant sur la gestion des ressources ligneuses et en eau en zone
sahélienne : cas de Mindif (Nord-Cameroun), 2010, il relève
de niveau de gestion : D'une part il y a ceux qui concourent à
l'augmentation de la quantité des ressources ligneuses par des actions
de suivi, de contrôle, de protection ou de reboisement. D'autre part ceux
qui exploitent ces ressources pour la satisfaction de leurs besoins.
15
Ainsi, les acteurs qui interviennent dans la protection et la
restauration des ressources ligneuses sont composés de l'Etat, de la
commune, de la SODECOTON et de la population locale. En ce qui concerne l'Etat,
c'est à travers la loi n°94/01 du 20 janvier portant régime
des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun qui insiste sur
la protection de la nature et de la biodiversité. La gestion est
assurée par les administrations chargées des forêts et de
la faune (article 35). Les droits d'usage sont reconnus aux populations
riveraines. Elles peuvent donc l'exploité pour une utilisation
personnelle. Les services de l'Etat qui interviennent comme acteur sont les
services déconcentrés du ministère des forêts et de
la faune. La commune de Mindif est un autre acteur de la gestion du couvert
végétal ligneux. Elle intervient par des actions de reboisement
et la principale espèce utilisée est l'Azadirachta
indica. Pour ce qui est de la Société de
Développement de Coton du Cameroun (SODECOTON), elle agit à
travers certains projets crée comme le DPGT puis l'ESA depuis 2005. ESA
mène des actions dont le but est la capitalisation des ressources
naturelles (sols, eaux, arbres) utile à la production agricole. Le
projet effectue des reboisements. Pour ce qui est de la population locale, elle
est considérée comme la principale bénéficiaire des
ressources ligneuses dans les zones rurales sahéliennes. Elle participe
à la gestion de ces ressources par des actions de reboisement.
Le Plan d'Action Mondial pour la conservation, l'utilisation
durable et la mise en valeur des ressources génétique
forestières (GPA-FGR) est un cadre stratégique basé sur
les résultats du rapport de l'Etat des ressources
génétiques forestières dans le monde, publié par la
FAO en juin 2014. Son but était d'étudier les ressources
génétiques des arbres, de développer des stratégies
et des approches pour leurs conservation et gestion durables, et pour
disséminer les connaissances et sensibiliser les organismes nationaux et
internationaux concernés. François Tardieu (2012) dans
Mécanismes d'adaptation des plantes aux changements climatiques propose
plusieurs stratégies pour permettre l'adaptation des plantes face aux
changements climatiques. Il propose ainsi une optimisation du cycle
végétatif car chez les plantes annuelles, la durée du
cycle va de quelques semaines à un an suivant les espèces, avec
une forte variabilité génétique à
l'intérieur de chaque espèce. Il faut aussi une optimisation des
échanges « eau - gaz carbonique », une optimisation du rapport
« reproduction/production » et une
16
optimisation de l'architecture de la plante. C'est dans le
même ordre d'idée que l'Association Vigne (Asvigne) propose la
méthode PLASA (Planter Sans Arrosage). Elle est une innovation technique
de plantation d'arbre au sahel qui consiste à faire de la frange
capillaire la source principale d'alimentation du plant en eau en saison
sèche et de l'arrosage anthropique un appoint.
Cette revue fait un état des lieux des
stratégies mises en place pour assurer une pérennisation de la
ressource ligneuse. Elle va permettre de se fixer afin de proposer des
stratégies plus innovantes capables de répondre aux besoins des
politiques en matière de préservation des ligneux.
5. Problématique
Suite à l'augmentation graduelle des contraintes
climatiques au cours de l'Holocène2 (Le Houérou,
1997), le Sahara est devenu un pôle d'aridité à
l'échelle planétaire (Ozenda, 1991). Ce changement s'est
accompagné de flux d'espèces végétales et animales,
mais aussi d'adaptations diverses et souvent spectaculaires qui font de la
faune et la flore sahariennes actuelles un enjeu de conservation biologique et
de développement humain durable important, bien que le nombre
d'espèces soit relativement faible (Ozenda, 1991).
Dans la majorité des régions semi-arides, le
couvert végétal ligneux naturel est inférieur à ce
qui peut être considéré comme couvert souhaitable. La
dégradation des écosystèmes arides est liée
classiquement à deux facteurs : les changements climatiques et les
activités humaines. Les premiers sont considérés comme
inéluctables à l'échelle du siècle. Cependant, la
végétation des zones arides est adaptée à ce type
de changements récurrents, et leurs effets sur la disparition
d'espèces sont généralement limités (Darkoh,
2003).
L'augmentation du prix des produits pétroliers ne fait
qu'accroitre l'utilisation des produits ligneux en Afrique. Dans les zones
desservies situées en deçà de 30 km du centre urbain, les
besoins en bois de chauffe de ce centre urbain ont initié la vente la
2 Holocène : Nom de l'ère
géologique qui représente les 11 000 dernières
années. Il correspond à la dernière partie de l'ère
quaternaire, période la plus récente dans l'échelle des
temps géologiques.
17
vente du bois énergie. Ce si est à l'origine
d'une surexploitation des ligneux pérennes et provoque par ricochet sa
dégradation. Les besoins en bois sont tels que les espèces de
reboisement en occurrence le Faidherbia albida et l'Azadirachta
indica n'échappent plus à la coupe (Toumba T., 2010). La
fragilité de l'écosystème associé à une
exploitation anarchique accélère la dégradation du couvert
ligneux. Cette érosion du couvert ligneux accélère le
ruissellement qui à son tour décape les sols agricoles, limites
l'infiltration et aggrave le problème de manque d'eau. Les contraintes
naturelles conjuguées aux affres des actions de l'homme limitent la
disponibilité des espèces pérennes et provoquent par
ricochet sa raréfaction.
Si beaucoup d'études ont été
consacrées à la dégradation des ressources ligneuses au
Cameroun en général et dans l'Extrême-Nord en particulier,
les données sur les mécanismes de dégradation des ligneux
pérennes dans un contexte climatique rude, et surtout sur les
indicateurs de cette dégradation restent éparses et leur
compréhension encore limitée.
Au cours de ces dernières années, les travaux
d'impacts des conditions naturels, principalement climatique sur les ressources
ligneuses ne cessent d'être menés. L'étude des couverts
ligneux se heurte à des problèmes écologiques,
climatiques, édaphiques et anthropiques. Cette recherche analyse le
processus d'érosion de la végétation pérenne en
zone semi-aride. Dans ce contexte, dans quelles conditions les espèces
qui parviennent à vivre longtemps évoluent-elles dans les zones
semi-arides ? Quelles sont les caractéristiques de ces espèces
ligneuses pérennes ? Quels sont les facteurs qui contribuent à la
dégradation de ces espèces ? Quel contrecoup subit la population
et l'environnement des zones semi-arides ? Quelles sont les conditions de
préservations et pérennisation des espèces ligneuses
pérennes dans ces zones à forte péjoration climatique ?
6. 18
Problème de recherche 6.1. Problème
générale
Les végétations pérennes de la
localité de Houdouvou subissent des contraintes d'ordres climatiques et
anthropiques. Ces contraintes conduisent à la dégradation des
ligneux pérennes dont il faut caractériser et analyser.
6.2. Problèmes spécifiques
Problème spécifique 1 :
L'état des lieux des ligneux pérennes de la
localité de Houdouvou reste à faire.
Problème spécifique 2 :
Les facteurs de la dégradation spatiale des espèces
ligneuses pérennes de la localité de Houdouvou sont connus mais
les indicateurs et le processus de cette dégradation n'ont pas
été suffisamment identifiés et
caractérisés.
Problème spécifique 3 :
Les marques de l'altération des ligneux pérennes sont connu mais
les effets socio-économiques et environnementaux sont à
présenter et à analyser.
Problème spécifique 4 :
Les conditions de préservation et les politiques
règlementaires de protection et de gestion des ligneux pérennes
en zone à stress hydrique sont à identifier et à
préconiser.
7. Question de recherche 7.1. Question
générale
Comment se caractérise la dégradation
spatio-temporelle des ligneux pérennes dans la localité de
Houdouvou ?
7.2. Question spécifique
Question spécifique 1 : Quel est
l'état des lieux des ligneux pérennes dans la localité
de
Houdouvou ?
Question spécifique 2 :
Comment les processus naturels et les actions anthropiques
contribuent-ils à la dégradation des ligneux pérennes ?
Question spécifique 3 : Dans
quelle mesure la dégradation des espèces ligneuses
pérennes à des effets sur l'environnement et les activités
humaines ?
19
Question spécifique 4 : Comment
peut-ont préservé à long terme les ligneux pérennes
dans la localité de Houdouvou ?
8. Objectif de recherche
8.1. Objectif général
Analyser le processus de dégradation des espèces
ligneuses pérennes dans la
localité de Houdouvou.
8.2. Objectif spécifique
Objectif spécifique 1 : Faire
ressortir toutes les espèces pérennes et leurs
caractéristiques.
Objectif spécifique 2 :
Déterminer les facteurs à l'origine de la
dégradation des ligneux pérennes.
Objectif spécifique 3 :
Déduire les contrecoups qui découlent de la
dégradation des ligneux pérennes.
Objectif spécifique 4 : Proposer
des solutions pour restreindre la dégradation des ligneux
pérennes dans la localité de Houdouvou.
9. Hypothèse de recherche
9.1. Hypothèse générale
Les conditions rudes du climat sahélien associées
aux actions anthropiques
favorisent la dégradation spatio-temporelle des ligneux
pérennes.
9.2. Hypothèse spécifique
Hypothèse spécifique 1 :
Plusieurs espèces ligneuses pérennes peuplent la
localité de
Houdouvou.
Hypothèse spécifique 2 :
Les activités humaines et les conditions rudes du climat
sont à l'origine de l'érosion des espèces ligneuses
pérennes.
Hypothèse spécifique 3 :
La détérioration des espèces ligneuses
pérennes est à l'origine de l'augmentation de la
sécheresse dans la zone et impact sur les activités des
hommes.
Hypothèse spécifique 4 :
Mettre sur pied de bonne politiques en matière de
protection des arbres peut endiguer ou freiner le processus de
dégradation des ligneux pérennes.
20
10. Cadre conceptuel et théorique
10.1. Cadre conceptuel
Dans le but de mieux cerner et de comprendre la
thématique abordée, il est judicieux de définir et de
donner le sens des mots clés de ce sujet : Dégradation
spatio-temporelle, ligneux pérennes.
Dégradation spatio-temporelle
Le dictionnaire Larousse défini la dégradation
comme l'action d'endommager quelque chose, de l'abîmé, de
l'altéré. Elle est aussi définie comme la
détérioration progressive d'une relation, d'une situation. En
écologie la dégradation est le remplacement d'une formation
végétale par une autre, généralement moins
diversifiée (par exemple d'une forêt par une garrigue ou par une
prairie, à la suite d'une exploitation intensive ou d'incendies
répétés).
Selon Yves Lacoste (2003), le concept de «
dégradation » vient d'un terme religieux signifiant que l'on est
privé d'un « grade ». D'après lui, en
géographie, le mot s'applique à la détérioration
d'un sol qui perd de sa fertilité sous l'effet de l'érosion ou du
lessivage. Ici, il s'agit donc de l'érosion hydrique causée par
le ruissellement qui emporte tous éléments utiles aux plantes.
Mais Roger Brunet (sous la direction, 2006) estime que la dégradation
« s'applique à un certain stade de l'évolution des sols. Ce
terme désigne également la transformation subie par certains
caractères ou constituants du sol. »
On peut donc dire que le terme de dégradation renvoie
dans son premier sens au processus de détérioration des sols.
Toutefois, on peut appliquer ce concept de dégradation à d'autres
domaines. Ici, il s'agit du couvert végétal. Dès lors, ce
terme est associé à cette notion de perte : perte d'une valeur,
d'une qualité ou d'une richesse. Concernant le couvert
végétal, la dégradation peut être comprise dans le
sens de fléchissement d'une ressource en l'occurrence la
végétation.
La dynamique spatio-temporelle peut être définie
comme l'évolution dans le temps et l'espace des surfaces
végétales, soit vers un stade de dégradation ou
d'amélioration, soit vers un état d'équilibre plus ou
moins stable. Elle rend compte de l'ensemble des variabilités
spatio-temporelles (Taibou et Seck, 2012).
21
Dans ce cas, la dégradation spatio-temporelle est
perçue comme une détérioration, une régression, au
plan quantitatif et qualitatif de la ressource végétale. Il
s'agit d'une perte de qualité et une diminution de la quantité
des ressources naturelles disponibles qui sont le plus souvent dues à
plusieurs facteurs qui sont d'ordre physique et anthropique. Le concept traduit
une altération, une modification du couvert végétal rendue
possible par une vulnérabilité persistante des conditions
climatiques. Dans le cadre de cette étude, la dégradation est la
diminution, l'altération voire la disparition des ligneux
pérennes.
Ligneux pérennes
Si le terme ligneux a été utilisé
dès 1781 par Jean-Jacques Rousseau, pour désigner ce qui a la
consistance du bois, un ligneux au sens botanique du terme est une plante
vasculaire dont le vaisseau qu'est le bois (conducteur de la sève brute
contenant l'eau et les sels minéraux puisés dans le sol) est
imprégné de lignine. La présence de la lignine et
l'existence de fibres ligneuses confèrent aux espèces dites
ligneuses une rigidité, à l'opposé des plantes
herbacées.
En botanique, une espèce est pérenne lorsque le
végétal est vivace donc pérennant, vit plus de deux
années. La plante vivace est alors pérennante. La
pérennité s'applique à de nombreux autres domaines mais,
par définition, tout ce qui est pérenne dure ou vit longtemps,
durablement, voire de façon permanente. Les arbres sont pérennes
par nature car leur développement prend de nombreuses années. En
définition large, ce qui est pérenne ne subit pas de
dégradation dans le temps dans des conditions environnementales normales
et s'il n'y a pas d'incident (le feu pour du bois par exemple) venant
contrecarrer la pérennité. L'érosion due au temps n'a pas
d'effet.
La plupart des arbres sont pérennes quand de nombreuses
herbacées ne le sont pas, étant plutôt des annuelles. Le
terme pérenne s'applique à un organisme complet, quand le terme
pérennant s'applique à un organe ou une partie du
végétal. Toutefois, un organisme pérenne peut avoir des
parties caduques, comme les feuilles.
Il convient d'approfondir certains points pour faire de la
description ci-dessus une définition formelle. Toutes les plantes
ligneuses pérennes, sont incluses dans le concept de ligneux;
l'association entre composantes ligneuses et non ligneuses peut être
un
22
arrangement spatial, une séquence dans le temps ou une
combinaison des deux le " ou " doit être entendu comme " et/ou ". (YOUNG,
1995)
Dans le cadre de notre étude, les espèces
pérennes sont des ligneux qui ont une durée de vie d'au moins
deux ans et ont ainsi la capacité de vivre pendant longtemps.
Opérationnalisation du concept de
dégradation des ligneux pérennes
Les concepts de dégradation spatio-temporelle des ligneux
pérennes définis ci-dessus sont opérationnalisés
dans le tableau 1.
Tableau 1. Opérationnalisation du concept de
dégradation des ligneux pérennes
|
Concept
|
Dimensions
|
Variables
|
Indicateurs
|
|
Dégradation spatio- temporelle des ligneux
pérennes
|
Naturelle
|
Variabilité pluviométrique
|
Baisse et augmentation des pluies au fil des années
|
|
T° relativement élevée
|
Maximum des températures
|
|
Dégradation de la qualité des sols
|
Niveau d'aridité des sols
|
|
Diminution de la masse
pédologique arable
|
Niveau Erosion hydrique
|
|
Niveau d'érosion éolienne
|
|
Anthropique
|
Dynamique démographique de la population
périurbaine
|
Augmentation des populations
|
|
Exploitation des terres pour les
activités agricoles et pour
l'élevage
|
Zone à production agricole, type d'agriculture
|
|
Zone de pâturage et d'élevage
|
|
Pratiques culturales
inappropriées
|
Labour non conventionnel
|
|
Prélèvement du bois pour les
activités des hommes
(utilisation domestique,
constructions des habitations)
|
Arbres abattu, brûlé, écorché,
taillé,
|
|
Zone de vente des bois et charbons
|
|
Construction en toit de paille
|
23
|
|
Acteurs
|
Cultivateurs, femmes,
éleveurs, Bûcherons
|
|
Spatiale
|
Types d'espèces
|
Liste des espèces
|
|
Essences prélevés
|
Nombre des individus
écorchés et élagués
|
|
Raréfaction des espèces
ligneuses
|
Densité des espèces, Indice de
raréfaction, Indice
de
régénération
|
|
Occupation de l'espace
|
Zone de culture, zone
dégradée, zone de pâturage
|
|
Spécifique
|
Espaces dénudés
|
Superficie des espaces nus
|
|
Espaces dégradés
|
Densité de peuplement, Indice de surface
terrière
|
|
Diminution des ligneux
|
Nombre d'arbre présent
|
|
Évolutions des superficies
|
Quantité de superficie
augmentée
|
|
Gestion
|
Individuelle
|
Plantation des arbres,
protection
|
|
Collective
|
Plantation des arbres,
protection, sensibilisation
|
|
Institutionnelle
|
Plantation des arbres,
protection, sensibilisation
|
10.2. Cadre théorique
Pour cette étude, trois principales théories ont
été évoquées. Il s'agit de la théorie de
la tragédie des biens communs de Garrett J. Hardin, de
la théorie du passager clandestin de Mancur Olson et la théorie
du Patch Dynamics de Thompson.
- La Théorie de la tragédie des biens
communs de Garrett J. Hardin
Garrett James Hardin, né le 21 avril 1915 à
Dallas, et mort le 14 septembre 2003 à Santa Barbara en Californie, est
essentiellement connu pour sa publication de 1968 intitulée
« The Tragedy of the Commons » (ou Tragédie des biens
communs).
24
Biologiste de profession, il reste une figure importante de
l'histoire des théories et des concepts économiques
contemporains. Il met en évidence la compétition qui se met en
place à partir du moment où des ressources naturelles
limitées en quantité sont placées dans un terrain «
commun ». Cette compétition sur le domaine commun mène
à la destruction des ressources communes à plus ou moins
court-terme.
La tragédie dont parle Hardin concerne les biens qui
n'ont été attribués à personne en particulier, ou
que personne ne s'est approprié. Si un bien est laissé sans
surveillance et à libre disposition de tout le monde, il risque de
souffrir de surexploitation et de s'épuiser. Bien que Hardin ait surtout
pensé aux ressources naturelles quand il a écrit son article,
cette tragédie concerne tous les biens possédant les deux
caractéristiques suivantes :
- Ce sont des biens dont il serait complexe ou coûteux
de les attribuer à quelqu'un
en particulier, ou d'en assurer la surveillance (par exemple
le fond des océans). - Ce sont des biens rivaux. Ce qui veut dire que si
je puise le pétrole au fond d'un
océan, au bout d'un certain temps, il n'en restera plus
pour les autres.
Nonobstant, quelques solutions sont présentées
par Hardin. Il s'agit de la nationalisation qui consiste à attribuer la
ressource à l'Etat qui disposera ainsi du choix de l'exploitation, de la
redistribution ou alors de la limitation de l'accès à la
ressource. Toute la responsabilité de la pérennité de la
ressource revient donc à l'Etat. Une autre solution concerne la
privatisation qui consiste à la mise en place d'un droit de
propriété pour une ou plusieurs personnes. Ces personnes ont
alors la responsabilité d'une utilisation intelligente de la ressource.
Elinor Olstorm, autre théoricienne des biens communs préconise la
gestion de la ressource par la communauté locale. Ainsi la
communauté locale doit alors mettre en place un accès
contrôlé à la ressource.
Cette théorie s'applique dans le cadre de notre
recherche dans la mesure où les espèces ligneuses pérennes
sont à la disposition des populations locales et comme tout le monde a
la possibilité d'y avoir accès, ils risqueraient de souffrir de
surexploitation et de s'épuiser.
25
- La théorie du passager clandestin de Mancur
Olson
Développé en économie, la
théorie du passager clandestin, traduit de anglais «
free-rider » désigne le comportement d'une personne ou d'un
organisme qui profite d'un avantage sans en payer le prix ou sans y avoir
investi des efforts particuliers. Dans les sciences sociales, le free-rider
problem (traduit en français par « problème du passager
clandestin ») est un type de défaillance du marché ou d'une
organisation qui se produit lorsque ceux qui bénéficient d'une
ressource ou d'un service (biens publics tels que routes ou hôpitaux
publics, biens de nature communale) ne le paient pas où le sous-paient.
Les passagers clandestins peuvent poser problème car sans payer ou en
sous-payant le bien (soit directement par des redevances, des cotisations ou
des péages, soit indirectement par des taxes), ils continuent à y
accéder ou à l'utiliser. Ainsi, le bien peut être
sous-produit, surutilisé ou dégradé.
Dans le cas de notre travail, cette théorie concerne
les personnes ou groupes de personnes qui exploitent les ressources ligneuses
sans payer ce service de la nature et la surexploite jusqu'à la
dégradation. Cette exploitation anarchique conduit à la
dégradation des ligneux pérennes.
La théorie Patch Dynamics du Concept de Pickett
et Thompson (1978)
Dans le but d'une meilleure compréhension des
réactions des populations et des écosystèmes après
des perturbations, Pickett et Thompson ont développé en 1978, la
théorie du « Patch Dynamics Concept ». Celle-ci vise à
comprendre et à décrire la dynamique naturelle des populations et
des écosystèmes après une perturbation d'origine naturelle
ou anthropique. Elle éclaire tout particulièrement sur les
stratégies de reproduction, dispersion et compétition chez des
espèces et des biocénoses. Cette théorie se fonde sur
trois notions de base qui en constituent l'ossature :
- La notion de « Patch", le patch étant un
élément du "pattern" paysager ; chaque tache constituant une
unité écologique fonctionnelle, plus ou moins stable ou
isolée, pour une certaine échelle temporelle et éco
paysagère ;
- La notion de perturbation écologique ; entendue comme
tous les évènements qui altèrent dans le temps et dans
l'espace les relations entre les organismes vivants et leurs habitats. La
perturbation d'un milieu terrestre est suivie d'une série de
26
séquences de recolonisation appelée succession
écologique caractérisée par un stade pionnier à
faible nombre d'espèces, puis de stades à plus grand nombre
d'espèces et enfin d'une diminution du nombre d'espèces quand le
site s'approche du stade climacique ;
- La notion de succession écologique qui décrit
le processus naturel d'évolution et développement de
l'écosystème d'un stade initial à un stade
théorique dit climacique. Suivant le type de perturbation
écologique ayant entrainé la formation d'un néo sol, on
peut distinguer la succession primaire de la succession secondaire. La
succession écologique est l'ensemble théorique des étapes
décrivant dans les trois dimensions et dans le temps un cycle
évolutif théorique et complet pour un lieu donné.
Cette théorie s'applique dans le cadre de cette
recherche dans la mesure où la localité de Houdouvou fait face
à plusieurs perturbations écologiques due aux variabilités
climatiques et anthropiques à travers les activités humaines qui
entraine la destruction des ligneux et par ricochet leur raréfaction.
11. Méthodologie
L'analyse du processus de dégradation des ligneux
pérennes dans la localité de Houdouvou nécessite une
méthode adéquate pour aboutir à des bons résultats.
La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude est
hypothético-déductive. Cette approche base son raisonnement sur
des hypothèses qui seront vérifiées par les
résultats. Pour ce faire, la méthodologie est organisée
sur des étapes comprenant la collecte et le traitement des
données.
11.1. Caractérisation des ligneux
pérennes
Pour la caractérisation des ligneux pérennes, la
norme DNCN (2009) utilisée pour la classification des types ligneux (TED
et GIZ, 2013) sera utilisée. Le tableau 2 indique les différentes
mesures pour la classification des ligneux pérennes.
27
Tableau 2. Caractérisation de la végétation
ligneuse pérenne

Les observations de terrains ont permis d'identifier deux
principaux types de formations pérennes. Il s'agit des arbres dont la
hauteur est supérieure à 7 m et des arbustes dont la hauteur est
inférieure ou égale à 7m. Cette classification a
été faite à base des matériels de collecte de
données.
11.2. Matériels de collecte des
données
A ce niveau, il s'agit des matériels de
dendrométrie, des outils d'identification botanique et enfin des outils
de collecte de données.
11.2.1. Matériel de
dendrométrie
Afin de déterminer la hauteur et la
circonférence des ligneux pérennes dans la localité de
Houdouvou, un certain nombre de matériels ont été
nécessaires afin de faire des relevés dendrométriques.
(Planche photographique 1)
- Un décamètre permettant de mesurer les
hauteurs et les diamètres des différentes espèces
inventoriées ;
- Une ficelle de 50 mètres et 300 mètres
permettant de dimensionner les placettes et les mailles
28
A
|
|
|
|
|
B
|
|
Long: 10°38'21»N Lat : 14°10'13»E Al
: 420.2m
|
Long : 10°38'31»N Lat :
14°10'23»E
|
Al: 420.2m
|
|
|
Photo A : Délimitation d'une placette
|
Photo B : Mesure de la circonférence à 1.30
m du sol
|
Source : Djafnga, 2021
Planche photographique 1. Mesure de relever
dendrométrique
La planche photographique 1 montre des étapes ayant
conduite à faire des relevés dendrométriques. La photo A
montre la délimitation des placettes avec un décamètre et
la photo B illustre la mesure de la circonférence d'un arbre dans une
placette.
- Un sous-main pour soutenir les fiches d'inventaire botanique
et d'enquête dans le village ;
- Un téléphone portage à pixel
élevé (Camon 12 pro) avec 32 méga de Pixel pour la
réalisation des photographies d'illustrations ;
- Un GPS pour relever les coordonnées
géographiques des photos prises sur le terrain et les coordonnées
des placettes réalisées ;
- Un sac constitué de papier format vide. Son
rôle sera de récolter les échantillons de feuilles, de
fleurs ou de fruits pour l'identification précise de l'essence ;
- Un GPS ou appareil téléphone avec application
GPS pour les coordonnées afin relever les coordonnées
géographiques des prises sur le terrain
29
11.2.2. Outils d'identification botanique
Il s'agit :
- De la carte de localisation de Houdouvou ; elle permet de
nous conduire sur le site d'étude sans avoir un guide ou renseignement
;
- Les images Google Earth, Earth explorer et Landsat de la
zone étudiée ; elles serviront à afficher l'image et
à expliquer le phénomène à étudier.
- Le livre guide Arbres et Arbustes du SAHEL leur
caractéristiques et leurs utilisations de Hans-Jûgen von Maydell
Giz 1990. Il sert à identifier les espèces et les noms et ceci
pour faire une liste des espèces et des familles dans chaque placette
afin d'effectuer des calculs botaniques.
11.2.3. Outils de collecte de données
? Fiches d'inventaires
Ces fiches comportent un certain nombre de variables dont les
descripteurs sont, entre autres : les espèces inventoriées, leurs
hauteur et diamètres, la géomorphologie du milieu, les facteurs
de dégradation. L'état des arbres (morts, vivants,
blésés), les mares, cours d'eau, le taux de recouvrement, la
régénération.
? Fiches d'enquêtes
Dans le cadre de ce travail de recherche, différentes
fiches d'enquêtes sont élaborées pour la collecte des
données liées à la dégradation de l'environnement
en général et aux activités socio-économiques des
populations. Il a été question de déterminer l'importance
socio-économique des ligneux pérennes pour les riverains de la
localité de Houdouvou et d'identifier les facteurs qui causent et
aggravent la dégradation spatio-temporelle des ligneux
pérennes.
? Guide d'entretiens
Dans le cas de cette étude, divers questionnaires sont
définis pour une interview avec les autorités administratives et
traditionnelles de la localité pour compléter les informations
qui sont collectés à travers les observations et les
enquêtes.
30
11.2.4. Matériels de
géo-référencement et d'identification des
placettes
- Un GPS pour la localisation des centres des placettes. La
cartographie des couverts étudiés a été
réalisée grâce aux relevés des points et limites au
GPS.
- Des cartes géo-référencées des
espaces boisés étudiés.
- Un décamètre de ruban 100 mètre pour
les mesures des côtés des placettes et les distances entre les
transects effectués.
11.3. La collecte des données
Le travail à ce niveau consiste à
présenter le processus de collecte des données secondaires et
primaires qui ont fait l'objet d'un traitement et d'une analyse.
11.3.1. Données secondaires
La collecte des données secondaires représente
la première phase de collecte de cette recherche. Elle a consisté
à s'approprier les travaux effectués, contenu dans les ouvrages,
les thèses, les mémoires, les articles, et les rapports. Elle a
également permis d'avoir une idée générale sur la
thématique étudiée, et de cerner ce qui a
été déjà fait. Cette collecte a été
structurée comme suit :
? La recherche documentaire sur internet
La recherche documentaire sur internet a permis de collecter
deux types de données. Il s'agit des données textuelles
(thèses, mémoires, articles, rapports) et les données
médias (images satellitaire Landsat). Ces données ont
été acquises sur Google et sur des sites
spécialisés dans les recherches documentaires comme Google
schoolar. L'acquisition des cartes et images satellitaires quant à elle
a été faite grâce au logiciel Google Earth.
? L'exploitation de la documentation
L'objectif premier ici a été d'identifier les
principaux oeuvres et documents traitant des sujets relatifs à la
dégradation des ligneux. Il s'agit des données concernant les
ouvrages, les thèses et mémoires, les articles, les rapports
d'activités, les bases de données SIG. L'exploitation de la
documentation ne s'est pas seulement focalisée sur les écrits
issus de la discipline, mais sur tous les aspects relatifs au sujet. Des
documents ont ainsi été consultés dans le centre de
documentation de l'Ecole Normale Supérieure
31
de l'Université de Maroua, dans la documentation du
département de sciences environnementales de l'Ecole Nationale
Supérieure Polytechnique de l'université de Maroua. Une fois
collectés, les différents documents ont été soumis
à une série d'analyses basées sur l'analyse de contenu.
Les résultats obtenus à travers cette opération d'analyse
de contenu ont permis de comprendre l'évolution des écrits
observés sur ladite thématique et de savoir où se situent
les manquements afin de nous situer à la suite de ces auteurs.
11.3.2. La collecte des données
primaires
Elles sont aussi relatives aux données floristiques
portant essentiellement sur les ligneux. Outre ces données, les
relevés de terrain au GPS pour la cartographie des zones à
couverture végétal et zones dégradées, la
géo localisation et de la caractérisation des pistes de passages,
la délimitation des espaces habités, des espaces
dégradés, et la localisation des placettes ayant servi pour les
relevés floristiques.
? L'échantillonnage
Avant de se lancer dans les différents types de
collectes, un travail d'échantillonnage a été
effectué. Ce travail d'échantillonnage a permis de
délimiter notre champ d'opération. L'échantillonnage
choisi dans le cadre de cette étude est l'échantillonnage
aléatoire simple. Il est basé sur le principe que tous les
éléments de la population ont une probabilité égale
de faire partie de l'échantillon. On parle d'échantillon car cela
ne représente qu'une partie du groupe de personnes (ou de la population
cible) dont l'opinion ou les comportements nous intéressent. Le nombre
des individus enquêté pour cette étude est de 120
personnes.
? Les entretiens
Au cours de cette recherche, les entretiens nous ont
donné l'occasion de contacter directement les personnes ressources qui,
de par leurs expériences, compétences ou responsabilités,
nous ont fourni des informations de diverses natures sur la dégradation
spatio-temporelle des ligneux pérennes dans la localité de
Houdouvou. Les questions ont été focalisées sur la
caractérisation du couvert végétal, sur les processus et
facteurs de leur dégradation et sur les moyens de pérennisation.
Ainsi, nous avons fait des entretiens avec le chef du village de la
localité de Houdouvou pour avoir des
32
informations sur les personnes qui dégradent le plus la
végétation, sur le niveau de dégradation des ligneux
pérennes. Des entretiens ont aussi été mené avec
les gardiens de la zone de reboisement, les autorités des eaux et
forêts et des responsables des structures de reboisement notamment le
chef du projet de reboisement de l'entreprise SOTCO chargé du
reboisement le tronçon de route Maroua- Meri et des structures
environnantes.
? Les enquêtes par questionnaires
Pour cette recherche, deux questionnaires (Annexes 1 et 2) ont
été administrés pour obtenir des données
quantitatives et qualitatives sur la dégradation spatio-temporelle des
ligneux pérennes dans la localité de Houdouvou. Les
questionnaires ont été administrés aux populations
riveraines. Ils sont adressés aux hommes et aux femmes. Au total, 120
personnes ont été enquêtées parmi lesquels 60 hommes
et 60 femmes. Cette égalité résulte du fait d'une
proportion aussi grande des hommes que des femmes dans la localité.
Ces questionnaires ont permis de mettre en relief le niveau de
bois prélevés, les types d'espèces et le milieu de
prélèvement. On s'est aussi s'intéressés à
la période de prélèvement, aux superficies des parcelles
exploitées pour l'agricultures, a la proportion des arbres et arbustes
coupés et élagués, aux types et nombre d'espèces
végétales abattus, à la source de leur feu de cuisine,
à la provenance des bois exploités et les types d'arbres
pérennes de la localité. En outre, les questions se sont
orientées vers ce qui augmente la dégradation des ligneux
pérennes, des activités les plus pratiquées, au rôle
des arbres coupés dans la localité, aux cultures qui
dégradent le plus la végétation ligneuse et aux techniques
de conservation des arbres. La planche photographique 2 montre des entretiens
et des enquêtes qui ont été faites à Houdouvou.

Long : 10°38'31»N Lat : 14°10'29» Al :
500m
Photo B : Enquête auprès d'un
riverain
Long : 10°38'61»N Lat : 14°10'43»E Al :
420.2m
Photo A : Entretien avec les gardiens de la zone de
reboisement
B
Long : 10°35'12»N Lat : 14°13'21»E Al:
432.2m Photo C : Entretient avec un agent des eaux et
forêts
A
C
33
Source : Djafnga, 2021
Planche photographique 2. Entretiens et enquêtes
34
La planche ci- dessus montre la collecte de données
primaires par entretiens et par questionnaires. Ainsi la photo A montre des
entretiens avec les gardiens de la zone de reboisement, la photo C, un
entretien avec une autorité des eaux et forêts et la photo B, une
enquête auprès d'un riverain de la localité.
? Les observations de terrain
Elles ont permis une fois sur le terrain de toucher la
réalité, de mieux comprendre les actions des hommes et de faire
ressortir leur implication dans la dégradation des espèces
ligneuses pérennes dans la localité de Houdouvou. Elles sont
d'une précieuse utilité dans l'évaluation des
activités que les hommes exercent sur les plantes. Elles ont
également aidé à mesurer les écarts entre la
réalité sur terrain et les hypothèses émises. En
outre, l'observation directe dans la zone d'étude nous a permis
d'apprécier le niveau de dégradation des ligneux pérennes.
La descente sur le terrain a approfondi notre connaissance sur la zone
d'étude, pour comprendre les différentes interactions
qu'entretiennent les groupes humains et les ressources ligneuses
pérennes.
? Inventaires des espèces
Les inventaires sont faits sur la base d'une fiche
élaborée en fonction du contexte des espaces exploités et
zones dégradées. Le dispositif de collecte des données est
constitué des placettes carrées de 30 m x 30 m
réalisés dans des mailles de 300m x 300m de manière
aléatoire, suivant diverses orientations dans le sens des quatre points
cardinaux. Pour étudier la distribution et l'abondance des
espèces, au total trente-six (36) placettes sont réalisées
dans les quatre zones de collecte (zone de reboisement, d'habitations, de
cultures et dégradées). Dans les différentes placettes,
toutes les espèces ligneuses pérennes qui peuplent la
localité ont été identifiées, les individus
dénombrés, les paramètres dendrométriques : la
circonférence des individus a été mesurés à
hauteur de poitrine à l'aide d'un mètre ruban de 5 m de longueur
et leur hauteur estimée. Les traces d'anthropisation à savoir les
individus morts, les souches des individus coupés totalement ou
partiellement, écorcés sont notées.
? Période de relevés
Les relevés botaniques effectués dans la
localité de Houdouvou se sont déroulés en juillet 2021. La
disponibilité des gardiens de la zone de reboisement nous a permis
35
d'être assisté et guidé, ce qui a
boosté la recherche. L'ensemble des relevés effectués ont
permis d'obtenir pour chaque observation, les paramètres ou indicateurs
relatifs à la composition floristique, la densité des peuplements
ligneux et l'indice de biodiversité, la structure des peuplements
(caractère dendrologique) et, son potentiel et sa dynamique
(mortalité, taux de couverture), la pression humaine (pastoralisme et
exploitation du bois, la qualité approximative des pâturages). Il
s'agit d'un ensemble de données cohérentes pour approcher les
tendances évolutives des surfaces concernées par l'étude
et pour juger de l'impact des actions de l'exploitation sur l'environnement.
? Phase de relevé
La fiche de relevés floristiques est
élaborée autour des éléments qui renseignent sur
les espèces en fonction du sol, de la pente, du relief, du type
végétal, sur les traces anthropiques et la surface de la maille.
Elle a permis de recueillir les indicateurs relatifs à la composition
spécifique, à la physionomie et au fonctionnement biologique des
ligneux. Elle a permis de caractériser
l'hétérogénéité et la diversité
spécifique des ligneux.
La fiche de relevés floristiques a été
élaborée afin de déterminer la répartition des
espèces ligneuses, pour comprendre leur mode d'adaptation en fonction
des sols, en fonction des types de formations végétales, les
savanes boisées (arborée et arbustives), les formations
isolées, les formations steppiques.
Ainsi, les données floristiques ont été
réalisées à travers des placettes délimitées
dans des mailles. La méthode de maille a été
empruntée à Boudet (1991), dans laquelle sont
délimitées des placettes suivant
l'homogénéité des strates (arbres et arbustes), sur la
base des entités représentatives. L'objectif est de
déterminer l'aire minimale de relevés floristiques. Au total,
quatre mailles de neuf placettes ont été faites ; chaque maille
mesure 300m de chaque côté, les placettes mesurent 30m de chaque
côté chacune. Les mailles ont été traversées
par quatre transects avec un point d'intersection au centre de la maille comme
l'illustre la figure 3.

36
Figure 3. Dispositif d'échantillonnage : une maille de
neuf placettes.
La figure ci-dessus montre le croquis des mailles qui ont
été posés dans la localité. Au total, quatre
mailles de neuf placettes ont été faites dans les quatre zones
identifiées de la localité. ; Chaque maille mesure 300m de chaque
côté, les placettes mesurent 30m de chaque côté
chacune également. Les mailles sont traversées par quatre
transects avec un point d'intersection au centre de la maille.
Les relevés ont été effectués dans
36 placettes, réparties dans quatre terroirs de la localité de
Houdouvou représentant les zones de reboisements, les zones de cultures,
les zones d'habitions et les zones dégradées, afin de
déterminer la composition floristique de ces lieux (figure 4).

37
Figure 4.Disposition des mailles dans la zone d'étude
38
12. Traitement et analyse des
données
Les instruments que nous avons cités plus haut nous ont
fourni des informations qualitatives et quantitatives qui sont,
traitées, analysées et classifiées manuellement sur Word ;
Excel ; et Qgis pour la réalisation des cartes. Cette opération a
consisté au dépouillement des questionnaires, au traitement des
données biogéographiques et cartographiques.
12.1. Traitement des données
qualitatives
Le traitement à ce niveau concerne les informations
qualitatives issues du terrain comme les enquêtes par questionnaire et
les interviews. Les informations assemblées, dérivant des
enquêtes de terrain ont été codifiées,
dépouillé et interprété. On a fait un
dépouillement informatisé grâce au logiciel SPSS. Les
interviews enregistrées grâce au magnétophone du
téléphone ont été retranscrits. De plus, les
données secondaires comme les documents textes ont été
saisi grâce au logiciel Word.
12.2. Traitement des données
quantitatives
Le traitement des données quantitatives a
nécessité : les logiciels de statistiques pour les données
quantitatives, Les données statistiques ont été
traités à base de Microsoft Excel pour produire des tableaux, des
figures, des graphiques. Les calculs des données chiffrées ont
été effectués à partir de l'application des
formules mathématiques. Le traitement quantitatif des informations a
permis faciliter la visualisation des données, on a ainsi donné
les tendances centrales comme les moyenne et élargie les perspectives
des formules botaniques. Ce qui nous a permis ainsi lire les informations par
les diagrammes à barres, les diagrammes angulaires, les histogrammes,
les graphiques chronologiques et les dendrogrammes.
12.3. Traitement et analyse cartographique
Le traitement des données cartographique a
consisté à réaliser premièrement une carte de
localisation de la zone d'étude et d'occupation du sol grâce au
logiciel QGIS 2.18. Ce même logiciel a permis de dresser une carte pour
une analyse diachronique de la végétation sur 20 ans. Le logiciel
Google Earth a permis d'obtenir des images satellites qui ont été
insérer dans le logiciel QGIS afin de délimiter la zone
d'étude et les différentes occupations du sol et Adobe
Illustrator a servi dans les travaux de finalisation.
39
12.4. Traitement et analyse des données
botaniques
Il s'agit ici des traitements et analyses liés aux
relevés botaniques. Une première observation des résultats
bruts permet d'établir la liste des espèces pérennes et de
les scinder en listes des arbres pérennes d'une part et d'arbustes
pérennes d'autres part. Le traitement des données proprement dit
concerne entre autres :
? Les analyses structurales
Cette analyse est basée sur deux calculs à
savoir : les calculs de hauteurs des espèces et les calculs de
diamètres. Ces calculs ont pour objectifs d'étudier la structure
horizontale et verticale des espèces pérennes disponibles dans la
localité en fonction des types de zones.
La structure horizontale est celle qui étudie la
répartition des individus et la manière dont ils occupent
l'espace. Elle est définie par la répartition des
végétaux suivant le plan horizontal (Gounot, 1969) et correspond
aux différents types de distribution des arbres en fonction de leur
répartition par unité de surface.
La structure horizontale permet enfin d'évaluer
l'abondance, la dominance et la fréquence relative tandis que la
structure verticale s'intéresse aux différentes strates d'une
formation végétale.
? L'analyse des indicateurs de dégradations
Il s'agit ici des éléments qui appuient
l'étude des structures afin d'identifier les lieux les plus
dégradés. Ils sont entre autres :
? La densité de peuplement
La densité d'un taxon végétal est le
nombre d'individus de ce taxon présents par unité de surface.
Elle représente aussi le nombre d'arbres sur pied ramené à
l'hectare. C'est un indicateur important de l'état d'un
écosystème. Il peut être avantageusement utilisé en
combinaison avec d'autres descripteurs tel la taille moyenne des individus ou
encore le recouvrement. La densité permet également de
définir les tendances à l'installation ou à la
raréfaction des individus des taxons pérennes et d'évaluer
ainsi les tendances évolutives (régénération,
dégradation) d'une formation végétale.
Les densités des espèces ont été
calculées par placette et par zone selon la formule suivante :

40
? Abondance relative
L'abondance relative est un descripteur de base de
l'état de la parcelle et un indice simple de la compétition
moyenne dans la formation. L'abondance relative d'un taxon exprime le nombre
d'individus de ce taxon comparé au nombre total d'individus dans
l'échantillon. Elle est donnée par la relation suivante :
Abondance relative= Nombre d'individus du
taxon / Nombre d'individus de
l'échantillon×100.

? Taux de mortalité
Pour l'analyse de nos données, on va aussi s'appesantir
sur le taux des espèces
morts.
Pour ce faire, on va avoir besoin des effectifs des individus
morts qu'on va multiplier par 100 et diviser par l'effectif total.
Taux de mortalité = effectif d'individus
morts x 100/ Effectif total

? Calcul des indices de diversité (Shannon,
Equitabilité, Simpson).
La diversité prend en compte non seulement le nombre
d'espèces, mais également la distribution des individus au sein
de ces espèces. L'indice de Shannon doit être associé
à l'indice de Simpson.
41
- Indice de Shannon (il s'exprime en bit)
L'indice de Shannon et Weaver (1949) est l'indice le plus
simple dans sa catégorie, et donc le plus largement utilisé. Plus
la valeur de l'indice H' est élevée, plus la diversité est
grande. Cet indice est calculé de la manière suivante :

Avec S = nombre total d'espèces
pi = (nj/N), fréquence relative des espèces
nj= fréquence relative de l'espèce j dans
l'unité d'échantillonnage
N = somme des fréquences relatives spécifiques
Plus la valeur de l'indice H' est élevée, plus la
diversité est grande.
Le seuil d'appréciation de l'indice de Shannon est le
suivant :
- si H< 3bit, la diversité floristique
est faible ;
- si 3 = H > 4bit, la diversité
floristique est moyenne ;
- si H = 4 bit, la diversité floristique
est forte.
- Indice de Simpson
L'indice de Simpson (1949) accorde plus d'importance aux
espèces les plus
fréquentes qu'à la richesse spécifique
totale. Il est donc plus sensible aux espèces les
plus fréquentes qu'à la richesse spécifique
totale (Magurran, 1988). L'indice de Simpson
est une formule permettant de calculer une probabilité,
soit la probabilité que deux
individus sélectionnés aléatoirement dans un
milieu donné soient de la même espèce. Il
est représenté par la formule suivante :

Avec i = 1...n, Pi = ni/N (ni= nombre de relevés dans
lequel, l'espèce i est présente ; N= nombre total de
relevés) ; D = Indice de Simpson.

Avec Pi = ni/N (ni= nombre de relevés dans lequel
l'espèce y est présente ; N= nombre total de relevés) ; D
= Indice de Simpson.
? Indice d'équitabilité de
Pielou
L'indice d'équitabilité s'exprime aussi en bit.
Il est compris entre 0 et 1 (Lacoste et Salanon, 2010). L'évaluation de
l'équitabilité est utile pour détecter les changements
d'origine anthropique. La mesure de l'équitabilité correspondant
à l'indice de Shannon-Weaver est réalisée selon la formule
suivante :

Avec :
E= équitabilité
S ou R= richesse floristique
H'= valeur de Shannon.
? Indice de raréfaction
Il se calcul suivant l'équation de Géhu &
Géhu (1980) :

Avec : RI= Indice de raréfaction
ni= Nombre de relevés dans lesquels l'espèce i est
présente
N= Nombre total de relevés.
Les espèces dont le RI ?80% sont
considérées comme des espèces très
fréquentes
dans la formation étudiée et celles où le RI
>80% sont des espèces rares.
42
? Indice de fréquence
43
L'analyse quantitative de la végétation tient
compte aussi de la fréquence des espèces. La fréquence de
l'espèce(s) est égale au rapport du nombre de relevés (n)
où l'espèce est présente sur le nombre total (N) de
relevés réalisés :
F(x) = n/N
Dans la plupart du temps, ce paramètre est
évalué en pourcentage :
F(x) = n × 100/N
13. Intérêt de la recherche
L'étude réalisée sur la
dégradation spatio-temporelle des espèces pérennes ne peut
être efficiente et efficace que lorsqu'elle permet de résoudre
objectivement les problématiques qui se présentent dans sa
thématique.
L'intérêt de cette recherche réside sur le
fait que les ligneux pérennes vivent longtemps, durablement, voire de
façon permanente. Cependant, les contraintes climatiques,
édaphiques et anthropiques causent leur dégradation et leur
raréfaction. Cette étude va ainsi permette d'analyser le
processus de cette dégradation afin de poser les jalons pour un
développement durable des ligneux pérennes dans le sahel en
général et dans la localité de Houdouvou en
particulier.
Au niveau académique, cette recherche va nous permettre
de prime abord d'obtenir le diplôme de master II en géographie
physique option environnement et d'avoir des connaissances plus approfondie
dans le domaine de la biogéographie, particulièrement en
botanique ;
L'intérêt scientifique de cette recherche vise la
connaissance des principales espèces pérennes qui peuplent la
localité de Houdouvou. Il s'agit aussi d'apporter une contribution
à la connaissance sur les différents problèmes que subit
les ressources ligneuses dans le septentrion afin d'apporter de l'eau dans le
moulin aux réflexions menées au sein de la communauté
scientifique en termes de dégradation du couvert ligneux pérenne.
Par ailleurs, la végétation étant une combinaison des
facteurs naturels et humains, cette étude peut permettre d'identifier
à l'échelle spécifique, les
44
caractéristiques d'une répartition
phytogéographique afin d'analyser leur vitesse de dégradation
dans l'espace et dans le temps.
Au niveau opérationnel, l'intérêt de cette
étude réside dans le fait de la détermination des facteurs
qui entrent dans la dégradation des ligneux pérennes en vue de
mettre sur pied des politiques plus efficaces en relation avec le contexte
local des habitants de la localité de Houdouvou. En adéquation
avec les politiques de préservation de l'environnement, les pouvoirs
décisionnaires devront sur la composition spécifique des ligneux
pérennes entreprendre des actions de reboisement, pour mieux organiser
la structure végétale de la localité.
Pour mener à terme ce travail, il est judicieux
d'axé notre réflexion autour de quatre principaux chapitres. Le
chapitre liminaire consistera à faire un état des mieux des
ligneux pérennes dans la localité de Houdouvou. Pour ce qui est
du deuxième chapitre il sera orienté vers l'analyse du processus
de dégradation proprement dit à travers les indicateurs naturels
et anthropiques du processus de dégradation. Le chapitre trois sera
axé sur l'analyse des effets socio-économiques et
environnementaux de la dégradation des ligneux pérennes.
L'analyse des politiques mise en place, l'évaluation de ces politiques,
et la proposition de nouvelles perspectives constituera le port étendard
du chapitre quatre.
45
Chapitre 1 : Etat des lieux des ligneux
pérennes
Introduction
La localité de Houdouvou est parsemée
d'espèces ligneuses dites pérennes. Ce
sont des espèces ayant la capacité de vivre
pendant plusieurs années avec au moins deux ans de vie. L'étude
floristique menée dans ladite localité montre une
répartition inégale des essences pérennes. Les formations
présentes sont calquées à l'image du climat et des
activités anthropiques qui y sont pratiquées. Ce chapitre fait un
état des lieux des ligneux pérennes du terroir de Houdouvou. Pour
mener à bien ce chapitre, les analyses vont s'articuler autour des
caractéristiques et richesses spécifiques des ligneux
pérennes, de l'analyse des abondances dominances des familles
d'espèces, des types de formations pérennes existantes, de
l'état biologique des espèces et enfin des
caractéristiques dendrométriques.
1.1. Caractéristiques floristiques et richesses
spécifiques des ligneux pérennes L'étude des
caractéristiques et des richesses des espèces consiste à
identifier
toutes les espèces pérennes de la
localité, à faire une classification en fonction de la taille des
formations végétales, du nombre d'individus par espèces,
par placettes et par zones. Les travaux de relevés botaniques ont permis
de faire ressortir une liste de 30 espèces réparties en 16
familles et 632 individus pour 36 placettes.
1.1.1. Composition floristique de toutes les
espèces identifiées
Les relevés botaniques faites dans les 36 placettes ont
permis de faire ressortir les
noms scientifiques des ligneux qui peuplent le terroir de
Houdouvou, les noms en peuls et en langue locales ont été acquis
auprès des riverains. Le tableau 3 dresse la liste totale des 30
espèces inventoriées dans toutes les placettes.
46
Tableau 3. Diversité floristiques des ligneux
pérennes
|
N°
|
Espèces
|
Nom en
Peul/fulfulde/Guizigua
|
Abréviation
|
|
1
|
Acacia Albida
|
Tchaski
|
AlAl
|
|
2
|
Acacia nilotica
|
|
AcNi
|
|
3
|
Acacia seyal
|
Bidehi, Boulbi, Bouldi
|
AcSe
|
|
4
|
Anacardium occidentale
|
Anacardium
|
AnOc
|
|
5
|
Azadirachta indica
|
Kaaki, Leeki, Nim/Neem
|
AzIn
|
|
6
|
Balanites aegyptiaca
|
Tane,Tanni
|
BaAe
|
|
7
|
Cissus quadrangularis
|
|
CiQu
|
|
8
|
Colophospermum mopane
|
Barkedji
|
CoMo
|
|
9
|
Combretum migranthum
|
Tchournenki
|
CoMi
|
|
10
|
Cobretum glutinosum
|
|
CoGl
|
|
11
|
Dalbrgia melanoxylon
|
|
DaMe
|
|
12
|
Diospyros mespiliformis
|
Pouri guelodji
|
DiMe
|
|
13
|
Eucalyptucus globulus
|
|
EuGl
|
|
14
|
Erophaca baetica
|
|
ErBa
|
|
15
|
Faidherbia albida
|
|
FeAl
|
|
16
|
Feretia apondanthera delle
|
Dogue
|
Fear
|
|
17
|
Ficus glucose
|
|
Figl
|
|
18
|
Ficus sycomores
|
Ibi
|
Fis
|
|
19
|
Geremia mollis jus
|
Tobol
|
Gro
|
|
20
|
Geremia villa
|
Belisoukour
|
GrVi
|
|
21
|
Gymnosporia senegalensis
|
Magabalak
|
GySe
|
|
22
|
Hyphaene thebaica
|
goriba
|
HyTh
|
|
23
|
Mangifera indica
|
mangoro
|
MgIn
|
|
24
|
Moringa aleifera
|
moringa
|
MoAl
|
|
25
|
Ozora insignis
|
Ngalbidje ladde
|
OzIn
|
|
26
|
Psidium guajava
|
Goyave
|
PsGu
|
|
27
|
Sclerocarya birrea
|
Yageui
|
ScBi
|
|
28
|
Tamarindus indica
|
Djabe
|
TaIn
|
|
29
|
Ziziphus mauritiana
|
Djabe, Djabi
|
ZiMa
|
|
30
|
Ziziphus spina-christi
|
Djabe
|
ZiSp
|
Source : Relevés
botaniques, 2021
Le tableau 3 dresse une liste des 30 ligneux pérennes
qui ont été identifiés dans la localité. Ces
ligneux ont leur identification en langue locale. Il s'agit du peul, fulfulde
et Guizigua. Ainsi, on retrouve des espèces comme Acacia Albida,
Acacia nilotica,
47
Anacardium occidentale, Azadirachta indica, Colophospermum
mopane, Feretia apondanthera delile, Gymnosporia senegalensis, Moringa
aleifera, Tamarindus indica, Ziziphus spina-christi. Arbres et arbustes
sont les principaux ligneux qui constituent le tableau 3.
1.1.2. Composition floristique arborée
Les données d'inventaires botaniques ont permis de
dresser une liste des ligneux
pérennes composée essentiellement d'arbres.
(Tableau 4) Tableau 4. Liste des espèces arborées
|
N°
|
Espèces
|
Nom en Peul
|
Abréviation
|
Nbre
Individus
|
|
1
|
Acacia Albida
|
Tchaski
|
AlAl
|
37
|
|
2
|
Acacia nilotica
|
|
AcNi
|
20
|
|
3
|
Acacia seyal
|
Bidehi, Boulbi, Bouldi
|
AcSe
|
31
|
|
4
|
Anacardium occidentale
|
Anacardium
|
AnOc
|
17
|
|
5
|
Azadirachta indica
|
Kaaki, Leeki, Nim/Neem
|
AzIn
|
157
|
|
6
|
Balanites aegyptiaca
|
Tane, Tanni
|
BaAe
|
6
|
|
7
|
Dalbrgia melanoxylon
|
|
DaMe
|
1
|
|
8
|
Eucalyptucus globulus
|
|
EuGl
|
36
|
|
9
|
Faidherbia albida
|
|
FeAl
|
64
|
|
10
|
Ficus glumosa
|
|
FiGL
|
1
|
|
11
|
Ficus sycomorus
|
Ibbi
|
FiSy
|
3
|
|
12
|
Grewia mollis juss
|
Tchoboli
|
GrMo
|
12
|
|
13
|
Grewia villosa
|
Belisoukour
|
GrVi
|
5
|
|
14
|
Hyphaene thebaica
|
goriba
|
HyTh
|
10
|
|
15
|
Mangifera indica
|
mangoro
|
MgIn
|
33
|
|
16
|
Moringa aleifera
|
moringa
|
MoAl
|
2
|
|
17
|
Psidium guajava
|
Goyave
|
PsGu
|
11
|
|
18
|
Sclerocarya birrea
|
Yageui
|
ScBi
|
18
|
|
19
|
Tamarindus indica
|
Djabe
|
TaIn
|
13
|
|
20
|
Ziziphus spina-christi
|
Djabe
|
ZiSp
|
10
|
|
Total
|
|
|
|
487
|
Source : Relevés botaniques,
2021
Les inventaires botaniques ont permis de faire sortir une
liste de 20 espèces arborées composée de 487 individus.
L'espèce arborée la plus représentée est
Azadirachta indica avec une proportion de 157 individus. Elle est
suivie du Faidherbia albida avec 64 individus, d'Acacia Albida avec 37
individus, d'Eucalyptucus globulus
48
avec 36 individus, du Mangifera indica avec 33
individus. Les arbres les moins représentés sont
constitués de Ficus sycomorus avec 3 individus, de Moringa
aleifera avec 2 individus, du Dalbrgia melanoxylon et du
Ficus glumosa avec chacun 1 individu.
1.1.3. Composition arbustive
Les ligneux pérennes de la localité de Houdouvou
sont constitués des espèces
arbustives comme représenté dans le tableau 5.
Tableau 5. Liste des espèces arbustives
|
N°
|
Espèces
|
Nom en Peul
|
Abréviation
|
Nbre
Individus
|
|
1
|
Acacia nilotica
|
|
AcNi
|
22
|
|
2
|
Cissus quadrangularis
|
|
CiQu
|
16
|
|
3
|
Colophospermum mopane
|
Barkedji
|
CoMo
|
36
|
|
4
|
Combretum migranthum
|
Tchournenki
|
CoMi
|
7
|
|
5
|
Cobretum glutinosum
|
|
CoGl
|
20
|
|
6
|
Ozora insignis
|
Ngalbidje ladde
|
OzIn
|
3
|
|
7
|
Diospyros mespiliformis
|
Pouri guelodji
|
DiMe
|
5
|
|
8
|
Erophaca baetica
|
|
ErBa
|
5
|
|
9
|
Feretia apondanthera delile
|
Dougoueï
|
FeAp
|
5
|
|
10
|
Gymnosporia senegalensis
|
Magabalak
|
GySe
|
3
|
|
11
|
Ziziphus mauritiana
|
Djabe, Djabi
|
ZiMa
|
23
|
|
Total
|
|
145
|
Source : Relevés botaniques,
2021
Le tableau 5 dresse le panorama de toutes les espèces
arbustives présentes dans le terroir de Houdouvou. Ainsi, l'espace
arbustive la plus représentée est Colophospermum mopane
avec une occurrence de 36 individus. La deuxième espèce est
Ziziphus mauritiana avec une occurrence de 23 individus. Elle est
suivie d'Acacia nilotica avec 22 individus, de Cobretum glutinosum
avec 20 individus. Les espèces les moins représentées
sont constituées de Feretia apondanthera delile et
Diospyros mespiliformis avec chacune 5 individus, de Ozora
insignis et du Gymnosporia senegalensis avec chacune 3
individus.
49
1.2. Nombres d'individus
L'étude du nombre d'individus dans le terroir de
Houdouvou est faite en fonction des principales espèces
inventoriées, des familles d'espèces, des placettes et des
principales zones.
? Nombre d'individus par espèces
L'étude du nombre des individus par espèce
consiste à faire ressortir une liste des principales espèces
inventoriées avec pour chaque espèces le nombre d'individus. Au
total, 30 espèces ont été identifiées dans les 36
placettes qui ont été faites. La figure ci-dessous illustre la
proportion des individus pour chaque espèce.
Acacia Albida Acacia nilotica Acacia seyal Anacardium
occidentale Azadirachta indica Balanites aegyptiaca Cissus quadrangularis
Colophospermum mopane Combretum migranthum Cobretum glutinosum Dalbrgia
melanoxylon Diospyros mespiliformis Eucalyptucus globulus Erophaca baetica
Faidherbia albida Feretia apondanthera delile Ficus glumosa Ficus sycomorus
Grewia mollis juss Grewia villosa Gymnosporia senegalensis Hyphaene thebaica
Mangifera indica Moringa aleifera Ozora insignis Psidium guajava Sclerocarya
birrea Tamarindus indica Ziziphus mauritiana Ziziphus spina-christi
ESPECES

NOMBRE DES INDIVIDUS
200
150
100
50
0
157
64
33
2 3 11 18 13 23 10
37 42 31
17
6 16
36
36
5
7 201 5
5 1 3 12 5 3 10
Source : Relevés botaniques,
2021
Figure 5. Nombre d'individus par espèces
La figure ci-dessus montre le nombre d'individus de chaque
espèce. Elle permet ainsi d'apprécier la distribution des ligneux
pérennes afin de voir l'espèce la plus dominante. Ainsi,
l'espèce Azadirachta indica est plus représentée
avec 157 individus. Elle est suivie du Faidherbia albida avec 64
individus, d'Acacia nilotica avec 42 individus, d'Acacia Albida avec
37 individus, de Colophospermum mopane et Eucalyptucus globulus
avec 36 individus chacune. Les espèces les moins
représentées sont Diospyros mespiliformis, Erophaca baetica
avec 5 individus chacune. Le Ficus sycomorus et Ozora
insignis ont 3 individus chacune. Les espèces n'ayant qu'un seul
individu sont composées de Dalbrgia melanoxylon et du Ficus
glumosa.
50
? Nombre d'individus par placette
Les relevés botaniques ont permis de dresser une liste
des individus qui s'y trouve en fonction des placettes. Au total, 362 individus
ont été inventoriés dans les 36 placettes. (Figure 6)

INDIVIDUS
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
14 14
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18
P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36
23
26
16
14
12
18
7 7
16
10 10
12
17
20
24
PLACETTTES
13
17
23
16
23
25
42
27
24
15
33
18
15
13
22
10
5
19
12
51
Source : Relevés botaniques,
2021
Figure 6. Nombre d'individus par placettes
52
L'analyse du nombre d'individus par placettes permet
d'observer que les placettes ayants les plus grands nombres d'individus sont
les placettes 23 avec 42 individus, 28 avec 33 individus, 25 avec 27 individus,
4 avec 26 individus, 23 avec 25 individus, 17 avec 27 individus. Les placettes
ayant moins d'individus sont les placettes 9, 10 avec 9 individus chacune et la
placette 34 avec seulement 5 individus.
? Nombre d'individus par zone
Les données botaniques ont été
collectées en fonction des principales zones géographiques qui se
trouvent dans la localité de Houdouvou. Au total, quatre principales
zones ont été identifiées. Il s'agit
précisément des zones de reboisement, des zones de cultures, des
zones d'habitation et des zones dégradées marquées par une
érosion de la végétation ligneuse pérenne. (Figure
7)
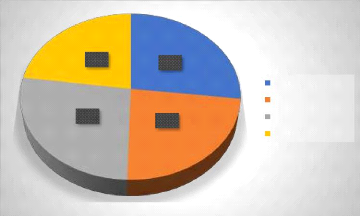
27%
23%
23%
27%
Zone de reboisement zone dégradé
Champs
Zone d'habitation
Source : Relevés
botaniques, 2021
Figure 7. Nombre d'individus par zone
La figure 6 montre la répartition des individus en
fonction des principales zones géographiques de la localité. On
observe ainsi que la zone ayant le plus grand nombre d'individus est la zone de
reboisement avec 27% des individus, soit 170 individus. La seconde zone ayant
le plus grand nombre d'individus est la zone des champs 27% soit 169 individus.
Les deux dernières zones sont les zones d'habitation et les zones
dégradées avec respectivement 149 et 144 individus.
53
1.3. Abondance dominance des familles
d'espèces
Chaque espèce de la localité appartient à
une famille. 16 principales familles ont
été inventoriées. L'analyse du nombre
d'individus par famille est faite en fonction du degré de
représentation. On a ainsi les familles fortement
représentées (figure 8), les familles moyennement
représentées et les familles faiblement
représentées.
o Proportion des familles fortement
représentées

Fabaceae Meliaceae Mimosaceae Anacardiaceae
17%
19%
39%
25%
Source : Relevés
botaniques, 2021
Figure 8. Proportion des familles des espèces fortement
représentées
La figure ci-dessus représente la proportion des
familles les plus représentées dans la localité de
Houdouvou. La famille la plus représentée est la famille des
Meliaceae avec 39% pour 158 individus. La deuxième famille la
plus représentée est celle des Fabaceae avec 25 % pour
102 individus. La troisième famille est celle des Anacardiaceae
avec 19% pour 74 individus et la dernière famille est celle des
Mimosaceae avec 17% pour 69 individus.
o Proportion des familles moyennement
représentées
La deuxième proportion des familles est celle des
familles moyennement représentées. (Figure 9)

Myrtaceae Tilaceae Rhamnaceae Combretaceae
21%
18%
31%
30%
54
Source : Relevés botaniques,
2021
Figure 9. Proportion des familles des espèces
moyennement représentées
L'analyse de la proportion des familles moyennement
représentées montre que la famille Tilaceae vient en
première position avec 31% pour 49 individus. La famille Myrtaceae
vient en deuxième place avec 30% pour 48 individus avant la famille
Rhamnaceae qui a 18 % avec 34 individus. La dernière famille
sur la liste est celle des Combretaceae avec 18% pour 18 individus.
o Proportion des familles faiblement
représentées
Les familles faiblement représentées viennent
en dernière position et sont constituées de : Vitaceae,
Arecaceae, Malvacées, Balanitaceae, Moracée, Caesalpiniaceae,
Celastraceae, Rubiaceae. La proportion de ces familles est
représentée dans la figure suivante.
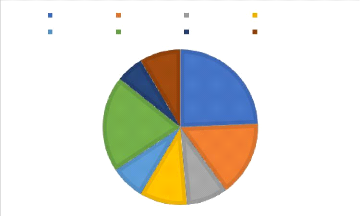
Vitaceae Arecaceae Malvacées Balanitaceae
Moracée Caesalpiniaceae Celastraceae Rubiaceae
20%
7%
6%
9%
10%
8%
24%
16%
55
Source : Relevés botaniques, juillet
2021
Figure 10. Proportion des familles des espèces
faiblement représentées
La figure ci-dessus illustre la proportion des familles les
moins représentées. Vitaceae avec 17 individus,
Arecaceae avec 11 individus, Malvacées avec 6
individus, Balanitaceae avec 7 individus, Moracée avec
5 individus, Caesalpiniaceae avec 14 individus, Celastraceae
avec 4 individus et enfin des Rubiaceae avec 6 individus.
1.4. Les types de formations végétales
présentes
Trois principales formations végétales ont
été retrouvées dans la localité de Houdouvou. Il
s'agit des formations végétales denses, des formations
végétales claires et des formations végétales
d'alignements. Ces caractéristiques ont été
déterminées grâce à la taille des espèces
végétales et grâce à la densité des
peuplements ligneux.
1.4.1. Formations végétales
claires
Une végétation est dite claire lorsqu'on
rencontre une absence du caractère sempervirent1 des
espèces végétales et où les espèces
végétales sont dispersées de manière discontinue.
(Photo1). Plusieurs ligneux pérennes composent ainsi les formations
végétales claires.
1 Expression latine qui signifie toujours
verdoyant. Il se dit de diverse espèces de plantes et
particulièrement de chèvrefeuilles qui portent les feuilles
pendant toute l'année.

Long : 10°38'12»N Lat : 14°10'13»E Al
: 453.1m
56
Source : Djafnga, 2021
Photo 1. Formation végétale claire
Marquée par une absence totale de sous-bois, la
photo 1 illustre une formation végétale claire dans la
localité de Houdouvou. On observe ainsi des arbustes et des arbres
disposés de manière ouverte. La strate herbacée est
très faible et quasi-inexistante. La végétation y est
structurée de telle sorte qu'on peut observer un ligneux à une
bonne distance.
1.4.2. Formations végétales
denses
Les formations denses dans le terroir de Houdouvou se retrouvent
dans la zone
de reboisement. Contrairement aux formations claires, les
formations denses sont composées des ligneux à formation
serrées.
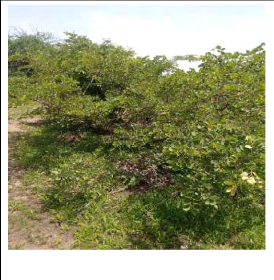
Long : 10°38'21»N Lat : 14°10'13»E
Al : 450.2m
57
Source : Djafnga, 2021
Photo 2. Formation végétale dense
La photo 2 montre une formation végétale
dense qui se trouve dans le terroir de Houdouvou. Les ligneux sont
disposés de manière serrée contrairement à la
formation claire. La hauteur de ligneux est plus importante par rapport aux
formations claires. Dans cette proportion des arbres, certains individus de la
même espèce présentent une succession de ligneux, où
l'on peut dénombrer 05 à 07 plantes, dans un espace réduit
de plus de 10 à 20 m2.
La caractéristique dense de la
végétation ligneuse varie considérablement en fonction de
la saison. Les facteurs climatiques et édaphiques contribuent
énormément à la modification de la physionomie des
ligneux. Ainsi les zones à forte érosion hydriques sont
dépourvues de formation dense. Les ligneux pérennes qui s'y
trouvent se dégradent très rapidement de manière
exponentielle.
1.4.3. Formations végétales
d'alignements.
Les formations végétales d'alignements se
retrouvent en bordure de route et de champs. Ces espèces sont
généralement plantées par les Hommes. (Planche
photographique 3)

A
B
58
Long : 10°38'31»N Lat : 14°10'29»E Al:500m
Photo A : Ligneux en bordure de route
|
Long : 10°38'33»N Lat : 14°10'39»E Al:503.1m
Photo B : Ligneux en bordure de champs
|
|
Source : Djafnga, 2021
Planche photographique 3. Formations végétales
d'alignements
La planche photographique ci-dessus illustre les
différentes formations végétales d'alignements qui se
retrouvent à Houdouvou. La photo A montre une formation à
dominance d Azadirachta indica qui se retrouvent en bordure de route. La photo
B quant à elle montre des ligneux pérennes qui servent à
délimiter des parcelles de cultures.
La localité de Houdouvou est composée de
plusieurs types formations pérennes. Il s'agit des formations
pérennes denses, claires et d'alignements. Les ligneux pérennes
qui composent ces formations sont soit vivants, morts où souffrants.
1.5. Etat biologique des ligneux
pérennes
L'état biologique des ligneux pérennes consiste
à faire ressortir la proportion des individus vivants, morts et
souffrants dans chaque placette. Les relevés botaniques ont permis de
faire un état des lieux de ces espèces. La proportion
générale des ligneux morts, vivants et souffrants est
représentée dans le graphique suivant :

NOMBRE DES INDIVIDUS
395
44
193
ESPÈCE VIVANTE
|
ESPÈCE MORTE ESPÈCE
SOUFFRANTE
ETAT DES ESPECES
|
|
59
Source : Relevés botaniques, juillet
2021
Figure 11. Etat des ligneux pérennes
L'état des espèces pérennes permet
d'observer que les espèces vivantes sont plus nombreuses que les
espèces mortes et souffrantes. Ainsi, les espèces vivantes se
trouvent au nombre de 395 individus tandis que les espèces mortes sont
au nombre de 44 individus. Les espèces souffrantes se trouvent au nombre
193. L'état biologique des ligneux pérennes peut aussi être
représenté en fonction des 36 placettes.
1.5.1. Nombre des ligneux vivants par
placettes
La disposition des 395 ligneux vivants peut être
appréciée en fonction des 36
placettes étudiées. (Figure 12)

INDIVIDUS VIVANTS
25
20
15
10
5
0
P1 P3 P5 P7 P9 P11 P13 P15 P17 P19 P21 P23 P25 P27 P29
P31 P33 P35
15 8 6
11 9 7 7 10
4 3
7 6 5 7 6
0
10 8
PLACETTES
18 19 22 20 18
14 16 13
12
23
13 13 11 13
7 5
19
10
Source : Relevés botaniques, juillet
2021
Figure 12. Nombre des individus vivants par placette
60
L'analyse du nombre des individus vivants par placette permet
d'observer une répartition inégale des ligneux vivants dans les
36 placettes. On observe ainsi que les placettes ayant le plus grand nombre des
individus vivants sont les placettes 28, 24, 25, 23, 22, 35. Les placettes
ayants des individus moyens sont les placettes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 36. Les
placettes ayant le moins d'individus sont les placettes 16, 10, 9, 2, 33 et 34.
Parmi les placettes ayants les plus grands nombre d'individus, la placette 28
dispose de 23 individus, la placette 24 de 22 individus, la placette 25 de 20
individus. Parmi les placettes dont les individus sont moyennement
représentés, la placette 3 dispose de 15 individus, la placette 4
de 11 et la placette 8 de 10 individus. En ce qui concerne les placettes
faiblement représentées, la placette 16 a 0 individu vivant, la
placette 10 à 3 et la placette 9 dispose de 4 individus vivants.
1.5.2. Nombre des ligneux morts par
placettes
Les travaux de relevés botaniques ont permis de
recenser 44 individus morts dans les 36 placettes comme l'illustre la figure
13.

INDIVIDUS MORTS
4
5
3
0
2
1
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
2
1
3
4
3
1
2
5
0 0 0 0
2
4
2
0
5
PLACETTES
0 0
3
0 0 0 0 0 0
2
0 0 0
1
3
0 0 0
1
Source : Relevés botaniques,
juillet 2021
Figure 13.Nombre des individus morts par placettes
Le nombre des individus morts dans les 36 placettes permet de
dénombrer 19 placettes qui n'ont pas d'individus morts contre 17
placettes ayant des individus morts. Ainsi, les placettes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 11, 15, 17, 20, 27, 31, 32 et 36 totalisent 44 individus morts alors que
les placettes 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30,
33, 34, 35 n'ont pas d'individus morts. Ainsi, les placettes ayants les plus
grands nombres d'individus morts sont les placettes 8 et 17 avec chacune 5
individus
61
morts. Les placettes 4 et 11 ont chacune 4 individus. Les
placettes 3, 5, 20 et 32 en ont chacune 3 individus morts.
1.5.3. Nombre des ligneux souffrants par
placettes
Plusieurs espèces souffrantes ont été
inventoriées dans les 36 placettes (Figure
14). Au total, 193 ligneux ont été relevés
en état de souffrance. Ces souffrances sont causées par les
contraintes environnementales et anthropiques.
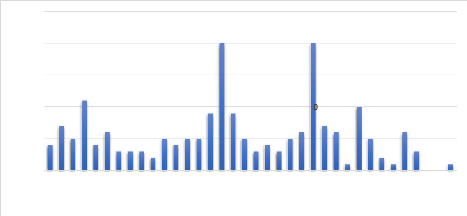
Individus souffrants
25
20
15
10
5
0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
4
7
5
11
4
6
3
3
3 2
5
4
5
5
9
20
9
5
Placettes
3
4
3
5 6
2
7 6
1
10
5
2 1
6
3
0 0 1
Source : Relevés botaniques, juillet
2021
Figure 14. Nombre des individus vivants par placettes
La figure ci-dessus illustre le nombre des individus
souffrants dans les 36 placettes de la localité de Houdouvou. La lecture
de cette figure montre la répartition inégale des ligneux
pérennes souffrantes dans les placettes. Ainsi, deux principales
placettes ont le nombre le plus élevé des ligneux souffrants. Il
s'agit des placettes 16 et 24 avec chacune 20 ligneux souffrants. La placette 4
a 11 individus, la placette 28 a 10 individus et la placette 15 en a 9. Les
placettes ayant moins d'individus souffrants sont les placettes 7, 8, 9, 19,
21, 33 avec chacune 3 individus souffrants. Les placettes 10 et 30 en ont 2
chacune et les placettes 27, 30, 36 ont chacune 1 individu souffrant. Les
placettes 34 et 35 n'ont aucun individu souffrant.
1.6. Caractéristiques dendrométriques des
espèces ligneuses
L'analyse dendrométrique des ligneux pérennes
permet de déterminer les structures des peuplements ligneux par classes
de hauteur et par classes de diamètre. La
62
détermination de ces caractéristiques sera faite
en fonction des principales zones de la localité. Il s'agit notamment
des caractéristiques dendrométriques des zones de reboisement,
des zones de zones de cultures, des zones d'habitations et des zones
dégradées.
1.6.1. Structure du peuplement ligneux par classes de
hauteur
L'étude de la structure dendrométrique des ligneux
pérennes sera faite en
fonction des principales classes de hauteur. Ces classes
seront ensuite étudiées en fonction des principales aires
géographiques du terroir.
? Structure générale des ligneux
pérennes par classes de hauteur
La répartition générale des ligneux
pérennes en fonction des hauteurs est représentée dans la
figure 15.
1M [1-10[ [10-20[ [20-PLUS[

NOMBRE DES INDIVIDUS
94
237
143
158
CLASSE DES HAUTEURS
Source : Relevés botaniques, juillet
2021
Figure 15. Structure générale des ligneux
pérennes par classes de hauteur
La figure 15 illustre la répartition
générale des ligneux pérennes par principale classe de
hauteur dans la localité de Houdouvou. On observe ainsi quatre
principales classes de hauteurs des ligneux pérennes. Les ligneux
compris entre 1 et 10 mètres de hauteur sont plus nombreux avec 237
individus. La deuxième classe la plus nombreuse concerne les ligneux
dont la hauteur est supérieure à 20 mètres avec 158
individus. Elle est suivie des ligneux dont la classe est comprise entre 10 et
20 mètres avec 237 individus. La dernière classe qui concerne les
ligneux dont la hauteur est inférieure à 1 mètre ne
totalise que 94 individus.
63
? Classe de hauteurs des zones de reboisement
Les ligneux pérennes arbres et arbustes des zones de
reboisement sont classés en fonction des principales classes de hauteur.
(Figure 16)
< 1M [1-10[ [10-20[ [20-PLUS[
CLASSE DE HAUTEURS DES LIGNEUX
77
INDIVIDUS
27
26
13
Source : Relevés botaniques, juillet
2021
Figure 16. Structure des ligneux pérennes par classes
de hauteur dans la zone de
reboisement
L'analyse de la figure qui illustre la disposition des
ligneux pérennes dans la zone de reboisement montre une inégale
répartition des ligneux pérennes. Les individus dont la hauteur
est comprise entre 1 et 10 mètres sont plus nombreux avec 77 individus.
Les individus dont la hauteur est comprise entre 10 et 20 mètres
viennent en deuxième place avec 27 individus devant les ligneux de moins
de 1 mètre avec 26 individus. Les ligneux de 1 à 10 mètres
de hauteur sont plus nombreux parce que les ligneux de cette zone sont
composés majoritairement des arbustes qui sont entre autre : Acacia
nilotica, Cissus quadrangularis, Colophospermum
mopane, Combretum migranthum, Diospyros mespiliformis,
Feretia apondanthera delile, Gymnosporia senegalensis. Les
ligneux de plus de 20 mètres sont moins nombreux parce que les grands
arbres sont rares dans les zones de reboisement.
? Classes de hauteur des zones de champs
La répartition des ligneux par classe de hauteur est
représentée dans la figure 17.
< 1M [1-10[ [10-20[ [20-PLUS[
CLASSE DES HAUTEURS
41
84
NOMBRE DES INDIVIDUS
17
7
64
Source : Relevés botaniques, juillet
2021
Figure 17. Structure des ligneux pérennes par classes
de hauteur dans les champs
La répartition des ligneux par classes de hauteur dans
les champs va de manière croissante. Les individus de moins de 1
mètre sont moins nombreux que les individus de plus de 20 mètres
de hauteur. Ainsi, les individus de moins de 1 mètre de hauteur se
trouvent au nombre de 7, ceux compris entre 1 et 10 mètres sont au
nombre de 17. Les individus de 10 à 20 mètres de hauteur sont au
nombre de 42. Les individus de plus de 20 mètres sont nombreux avec 84
individus. Les individus de plus de 20 mètres de hauteur sont plus
nombreux parce qu'ils sont composés à majorité de
Faidherbia albida qui sont des espèces qui poussent beaucoup en
hauteur et dont la coupe est interdite dans la localité. Par ailleurs,
la présence d'une proportion réduite des arbres de petite taille
s'explique par le fait que les populations coupent les arbres de petite taille
lors de la préparation des champs afin de leur faciliter l'utilisation
des sols.
? Classes de hauteur des zones d'habitations
Les relevés botaniques ont aussi été
effectués dans les zones d'habitations. Ce qui nous a permis de faire
une classification des ligneux en fonction des hauteurs. (Figure 18)
< 1M [1-10[ [10-20[ [20-PLUS[
CLASSE DES HAUTEUS
61
50
NOMBRE DES INDIVIDUS
48
5
65
Source : Relevés botaniques, juillet
2021
Figure 18. Structure des ligneux pérennes par classes
de hauteur dans les zones
d'habitations
La disposition des ligneux par classe des hauteurs dans les
zones d'habitations permet de remarquer que la classe de hauteur la plus
dominante est celle dont les individus sont compris entre 10 et 20
mètres avec 61 individus. La deuxième classe dominante est celle
de 1 à 10 mètres de hauteur avec 50 individus. La
troisième classe avec 48 individus concerne les ligneux dont la hauteur
est supérieure à 20 mètres. Les ligneux les moins nombreux
sont en dessous de 1 mètre avec 5 individus. Les ligneux de moins de 1
mètre sont moins nombreux parce que les activités anthropiques et
l'emprise du bâtit ne permet pas le développement en hauteur des
jeunes arbres.
? Classes de hauteur dans les zones dégradées
La dernière aire géographique où ont
été faits les relevés concerne les zones
dégradées où les effets de l'érosion et du
surpâturage sont très fulgurants. (Figure 19)
90
80
Nombre des individus
70
60
50
40
30
20
10
0
< 1m [1-10[ [10-20[ [20-Plus[
Classe des hauteurs
66
Source : Relevés botaniques, juillet
2021
Figure 19. Structure des ligneux pérennes par classes
de hauteur dans les zones
dégradées
La disposition des ligneux par classes de hauteur dans les
zones dégradées permet d'observer que les individus de petite
taille sont plus nombreux que les individus de grande taille. Ainsi la classe
la plus représentée est celle dont les individus sont compris
entre 1 et 10 mètres avec 79 individus. La deuxième classe la
plus dominante est celle des individus dont la hauteur est inférieure
à 1 mètre avec 52 individus. La troisième classe est celle
de 10 à 20 mètres avec 21 individus. La dernière est celle
des individus dont la hauteur est supérieure à 20 mètres
avec seulement 9 individus. La zone dégradée était
auparavant une zone de coupe intensive de bois. Cette coupe accrue explique la
rareté des ligneux de plus de 20 mètres de hauteur. De plus, les
effets accélérés de l'érosion hydrique
dégradent de plus en plus les ligneux dans cette zone. Le
phénomène de surpâturage avec les effets du broutage et du
piétinement ne permet pas un développement en hauteur des ligneux
pérennes dans les zones dégradées.
La disposition des ligneux en classe de hauteur dans le cadre
de ce travail a permis d'établir les principales zones où on
trouve les ligneux de grande taille et les zones où les ligneux ont des
petites tailles. Celle classification est aussi faite en fonction de la
circonférence des ligneux.
67
1.6.2. Classes des circonférences des
espèces
La deuxième partie de l'étude
dendrométrique des ligneux pérennes concerne la
détermination des classes de circonférences des
espèces. La détermination de ces classes sera faite en fonction
des principales zones géographiques de la localité de
Houdouvou.
? Classe générale des
circonférences
La classification générale de la
circonférence des ligneux pérennes dans la localité de
Houdouvou est représentée dans la figure suivante.
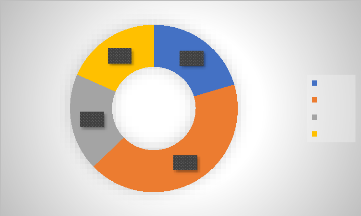
19%
18%
42%
21%
< 5cm [10-20[ [20-30[ [30-Plus[
Source : Relevés botaniques, juillet
2021
Figure 20. Circonférence générale
espèces ligneuses
Pour l'étude de la circonférence des ligneux
pérennes, quatre principales classes ont été
établies. La structure générale montre que la classe de
circonférence des ligneux la plus dominante est celle des
circonférences comprises entre 10 et 20 centimètres avec 42% pour
268 individus. La deuxième classe concerne celle des ligneux dont la
hauteur est inférieure à 5 centimètres avec 21 % pour 129
individus. La troisième classe se situe entre 20 et 30
centimètres avec 19% pour 119 individus. La dernière classe est
celle des individus de plus de 30 centimètres de hauteur avec 18% pour
116 individus. La disposition générale permet d'observer que les
ligneux pérennes de petite circonférence sont plus nombreux que
les ligneux de grande circonférence.
68
? Classes des circonférences des ligneux des zones
de reboisement.
L'analyse dendrométrique de la circonférence
des ligneux dans les zones de reboisement est illustrée dans la figure
ci-dessous.
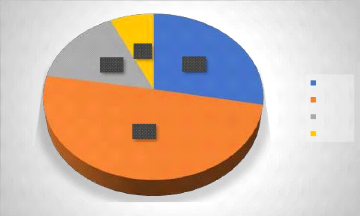
15%
50%
7%
28%
< 5cm [10-20[ [20-30[ [30-Plus[
Source : Relevés botaniques, juillet
2021
Figure 21. Circonférence des espèces ligneuses
dans les zones de reboisement
La figure illustre la circonférence des espèces
ligneuses dans les zones de reboisement. On relève ainsi que la classe
des circonférences la plus dominante est celle des ligneux dont le
diamètre est compris entre 10 et 20 centimètres. Elle est suivie
des ligneux dont la circonférence est inférieure à 5
centimètres. La troisième classe est celle des ligneux de 20
à 30 centimètres. La classe de circonférence ayant moins
de ligneux est celle des ligneux dont le diamètre est supérieur
à 30. Les ligneux de diamètre de 1 à 20 centimètres
sont plus nombreux parce que les espèces pérennes qui sont dans
la zone de reboisement sont majoritairement composées d'arbustes. La
raréfaction des grands arbres explique cette distribution. Les
relevés botaniques ont aussi été faits dans les zones de
cultures.
? Classes des circonférences des ligneux des
zones de champs
La distribution des circonférences dans les zones de
champs est disproportionnée. Cette distribution est illustrée
dans la figure 22.
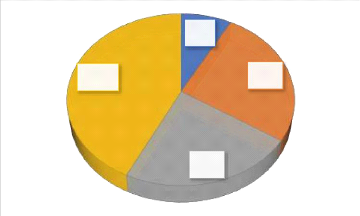
[30-Plus[
43%
< 5cm
8%
[20-30[
23%
[10-20[
26%
69
Source : Relevés botaniques, juillet
2021
Figure 22. Circonférence des espèces ligneuses
dans les zones de champs
La répartition des ligneux pérennes dans les
zones de cultures permet d'observer une proportion très grande des
ligneux dont la circonférence supérieure à 30
centimètres et une proportion très faible des ligneux dont la
circonférence est inférieure à 5 centimètres.
Ainsi, les ligneux de plus de 30 centimètres ont une proportion de 43%.
Ils sont suivis des ligneux de 20 à 30 centimètres avec 23%. La
troisième classe est celle des ligneux de plus de 10 à 20
centimètres avec 26%. La dernière classe est 8% avec les ligneux
de moins de 5 centimètres. Les ligneux pérennes des zones de
cultures ont des diamètres plus imposants que les ligneux des zones de
reboisement. En effet, les espèces des zones de cultures sont
composées des arbres contrairement aux espèces des zones de
reboisement qui sont composées majoritairement d'arbustes.
Faidherbia albida est l'espèce la plus dominante des zones de
cultures. Cet arbre à la capacité d'avoir une hauteur de 15
è 20 mètres de hauteur et par ricochet un diamètre
important.
? Classes des circonférences des ligneux des
zones d'habitations
Les ligneux pérennes ont été
retrouvés dans les zones d'habitation. La figure 23 montre la
distribution de ces ligneux par classe de circonférence dans cette
zone.

[20-30[
28%
[30-Plus[
20%
< 5cm
8%
[10-20[
44%
70
Source : Relevés botaniques, juillet
2021
Figure 23. Circonférence des espèces ligneuses
dans les zones d'habitations
L'analyse de la figure ci-dessus permet d'observer une
proportion très grande des ligneux dont la circonférence est
entre 10 et 20 centimètres et une proportion très faible des
ligneux dont la circonférence est inférieure à 5
centimètres. Ainsi, les ligneux de 10 à 20 centimètres ont
une proportion de 44%. Ils sont suivis des ligneux de 20 à 30
centimètres avec 28%. La troisième classe est celle des ligneux
de plus de 30 centimètres avec seulement 20%. La dernière classe
est 8% avec les ligneux de moins de 5 centimètres. Les arbres de petit
diamètre sont minoritaires parce que les hommes et les animaux
domestiques détruisent continuellement les arbres de petite taille. De
ce fait, ces petits arbres sont de plus en plus rares et cèdent ainsi la
place aux grands arbres. Cette zone est peuplée majoritairement
d'Azadirachta indica.
? Classes des circonférences des ligneux des
zones dégradées
Tout comme dans les zones d'habitations, des placettes ont
été faites dans les zones dégradées pour
étudier la dendrométrie de la végétation. Ainsi, la
figure ci-dessous illustre la circonférence des ligneux pérennes
en zone dégradée.
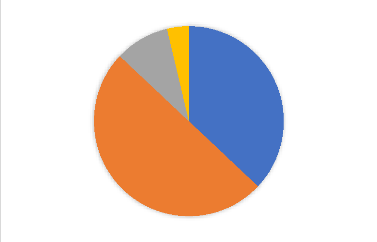
[10-20[
[20-30[
[30-Plus[
< 5cm
71
Source : Relevés botaniques, juillet
2021
Figure 24. Circonférence des espèces ligneuses
dans les zones dégradées
La figure 24 montre la distribution des classes de
circonférence des ligneux dans les zones dégradées. Cette
distribution montre une répartition disproportionnée des ligneux
pérennes. Les ligneux de 10 à 20 centimètres ont la
moitié du diamètre avec 50% des ligneux pérennes. Les
espèces de moins de 5 centimètres viennent en deuxième
position avec 37%. Les circonférences de 20 à 30
centimètres représentent 9% tandis que les ligneux de plus de 30
centimètres ont seulement 4%. Cette inégale répartition
des ligneux pérennes dans cette zone s'explique par le fait que cette
zone a été auparavant une zone d'exploitation intensive du bois
par les populations. Cette exploitation exacerbée du bois a conduit
à la raréfaction des arbres de grande taille et par ricochet des
ligneux de grande circonférence. De plus, la disparition des plantes a
favorisé l'accentuation du phénomène d'érosion dans
la zone. La conséquence qui découle de cette dégradation
est la végétation rabougrie composée des essences de
petite taille.
72
Conclusion
L'état des lieux de la végétation
pérenne dans la localité de Houdouvou a permis de faire ressortir
les caractéristiques floristiques, les richesses spécifiques, les
abondances dominances des familles d'espèces, les types de formations
pérennes, l'état biologique de ces formations et les
caractéristiques dendrométriques. Les travaux de relevés
botaniques ont permis de faire ressortir une liste de 30 espèces
réparties en 16 familles et 632 individus pour les 36 placettes. Les
formations végétales claires, denses et d'alignements ont
été identifiées et l'état biologique des ligneux
pérennes a fait ressortir les ligneux vivants (395), morts (44) et
souffrant (193). Pour faire une meilleure appréciation de la disposition
dendrométrique des ligneux en contexte de dégradation, il fallait
avoir une zone plus ou moins dégradées. La hauteur
générale des ligneux montre que les individus de moins de 1
mètres sont au nombre de 94, ceux de 1 à 10 sont au nombre de
237, ceux de 13 à 20 sont au nombre de 143 et ceux de plus de 20
mètres sont au nombre de 158. Pour ce qui est des diamètres, les
individus de diamètre inférieure à 5 centimètres
sont au nombre de 129, ceux de 10 à 20 sont au nombre de 268, ceux de 20
à 30 sont au nombre de 119 et ceux de plus de 30 centimètres sont
au nombre de 116. Nonobstant, plusieurs agents entre dans le processus de
dégradation de ces ligneux.
73
Chapitre 2. Processus de dégradation des ligneux
pérennes
Introduction
La dégradation des ressources naturelle est un
problème qui taraude de plus en
plus la communauté scientifique. Au sahel, les
écosystèmes offrent d'énormes potentialités en
produits forestiers ligneux et non ligneux. Malheureusement, la zone est
confrontée à un déficit pluviométrique
particulièrement sévère et à une forte croissance
démographique corrélée à une demande de plus en
plus élevée en terres agricoles. Ces conditions ont
entrainé une perte de biodiversité et des modifications de la
végétation. La ressource ligneuse n'est pas exempte de cette
dégradation. Les ligneux de type pérenne voient leurs
espérances de vie de plus en plus réduite de fait de plusieurs
facteurs. Localité à forte péjoration climatique, les
ligneux pérenne de la localité de Houdouvou connaissent une
dégradation accélérée dans l'espace et dans le
temps. De ce fait, plusieurs procédés interviennent dans la
dégradation de ces ligneux. L'analyse du processus de dégradation
des ligneux pérennes consistera à faire une étude
diachronique de la dégradation des ligneux entre 2001 et 2021, à
analyser le processus naturel de la dégradation et les processus
anthropiques.
2.1. Etat du couvert ligneux en 2001 et 2021
La végétation de la localité de Houdouvou a
subi plusieurs mutations qui ont
conduite à une évolution régressive. Un
feed-back de vingt ans permet de mieux apprécier le degré de
recouvrement de la végétation. Ainsi, on retrouve des zones
à végétation denses, faibles et des zones
déradées.
2.1.2. Etat du couvert ligneux en 2001
L'analyse diachronique du couvert ligneux entre 2001 et 2021
permet d'apprécier
d'un coup d'oeil le niveau de dégradation de la
végétation pérenne dans la localité de Houdouvou.
L'état du couvert du ligneux en 2001 est illustré dans la figure
25.

74
Figure 25. Etat du couvert ligneux en 2001
2.1.3. Etat du couvert ligneux en 2021
L'état des lieux du couvert ligneux en 2021 permet
d'observer plus clairement
le niveau d'érosion de la végétation
pérenne. Figure 26.
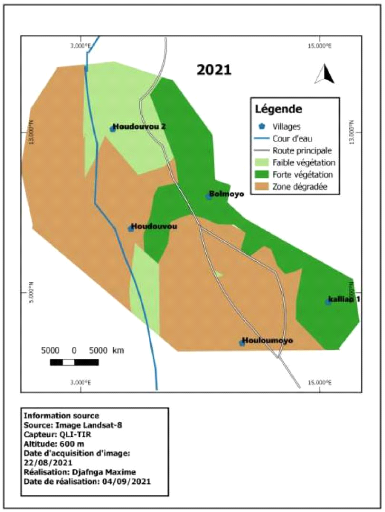
75
Figure 26. Etat du couvert ligneux en 2021
76
L'analyse diachronique du couvert ligneux de 2001 à
2021 permet d'observer une réelle dégradation spatiale du couvert
ligneux. L'analyse des deux cartes permet de voir une réelle
augmentation des zones dégradée (Figure 26), une diminution des
zones à forte et à faible végétation. La figure 25
quant à elle montre une faible proportion des zones
dégradées et un niveau important des zones à faible et
à forte végétation. Cet écart est expliqué
par des processus naturels et anthropiques.
Tableau 6.Évolution spatiale des superficies reparties
en fonction des zones de végétations identifiées dans la
localité de Houdouvou.
Classe de
Végétation
|
Superficie
en ha (2001)
|
Pourcentage
|
Superficie
en ha2021
|
Pourcentage
|
Ecart
|
Forte végétation
|
623
|
35,46
|
545
|
31,02
|
78
|
Faible végétation
|
520
|
29,60
|
465
|
26,47
|
55
|
Zone dégradée
|
614
|
34,95
|
747
|
42,52
|
-133
|
Total
|
1757
|
100
|
1757
|
100
|
0
|
|
Source : Analyses des images Landsat de 2001 et
2021.
L'analyse diachronique de l'occupation du sol en fonction de
la couverture végétale sur une échelle temporelle de 20
ans permet de mieux apprécier le niveau de dégradation de la
végétation. Le tableau 6 ci-dessus fait ressortir les
différentes superficies occupées par les fortes
végétations, les faibles végétations et les zones
sans végétation de l'année 2001 et 2021. Les surfaces de
fortes végétations occupaient en 2001, 623 hectares, soit 35, 46
% et en 2021, cette surface s'est réduite à 545 hectares soit 31,
02 % avec un écart de 78 hectares. Pour ce qui est des surfaces de
faibles végétations la superficie en 2001 était de 520
hectares soit 29, 60 % tandis que celle de 2021 était de 465 soit 26,
47% avec un écart de 55 hectares. Les zones dégradées en
2001 occupaient 614 hectares avec 34, 95 % et en 2021, ces zones occupaient 747
hectares soit 42, 52 % avec un écart de -133 hectares.
L'analyse de ces données permet d'observé que
les surfaces ce sont de plus en plus dégradées durant les
années. Les surfaces de fortes et faibles végétations ont
diminués au profit des surfaces dégradées. La figue 27
permet de mieux apprécier le niveau de cette dégradation.
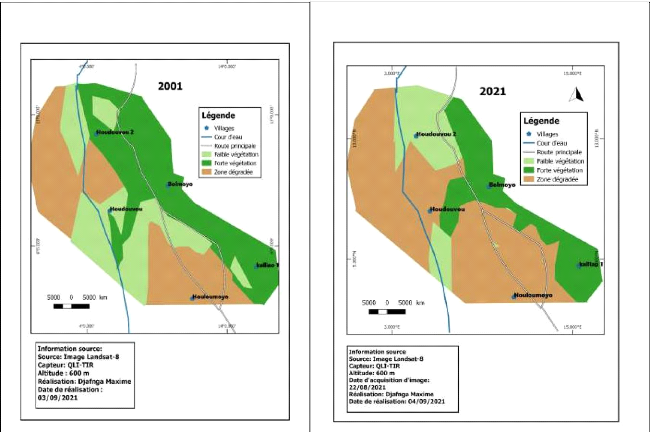
77
Figure 27.Dynamique du couvert végétal de la
localité de Houdouvou entre 2001 et 2021.
78
2.2. Processus naturel de la
dégradation
Un processus est dit naturel lorsqu'il est le produit de la
nature plutôt que celui des humains. Les mutations climatiques que
connaissent notre ère favorisent la destruction des ligneux. De plus, la
position géographique de la localité de Houdouvou lui
confère un caractère climatique rude qui n'est pas favorable
à l'augmentation des ligneux. En effet, cette localité se situe
dans la région sahélienne du Cameroun caractérisée
par un climat de type tropical semi-aride avec des précipitations
insuffisante et irrégulière et des températures
très élevés.
2.2.1. Insuffisance hydrique et variabilité
climatique importante ? Défoliation des ligneux
pérennes
Les arbres pérennes ont besoin d'eau pour se
développer et se garder en santé. Le manque d'eau a plusieurs
conséquences : réduction de la croissance,
dépérissement des pousses, diminution de la taille et du poids
des ligneux, réduction de la survie et de la croissance des arbres
(jeunes arbres), répercussions négatives sur la qualité
des fruits, carences nutritionnelles, augmentation des dommages. Le fait
d'avoir accès à de l'eau peut aider les arbres à continuer
à se développer au cours des périodes de sécheresse
et à accroître leur résistance aux facteurs de stress.
Ainsi, des ligneux pérennes sont en état de dessèchement
ou de défoliation (Photo 3) dans la localité de Houdouvou du fait
du manque d'eau. Les 36 placettes qui ont été faites ont permis
d'inventorier 44 ligneux morts. La photo 3 montre un ligneux qui subit les
conséquences du manque d'eau.
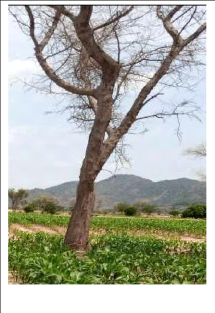
Long : 10°38'18»ELat :14°10'49»E Al
: 650m
79
Source : Djafnga, 2021
Photo 3. Arbre en défoliation
La photo ci-dessus montre un arbre qui a perdu toutes ces
feuilles pendant la saison sèche. Ainsi, en cas de sécheresse,
les arbres meurent à cause d'un dysfonctionnement hydraulique s'ils ne
s'adaptent pas. Pour s'adapter, la plante doit perdre ces feuilles, sinon elle
veut vivre plus longtemps. Ainsi, les baisses de pluies contribuent à la
dégradation des ligneux pérennes.
La sècheresse provoque une fermeture des
stomates1 des feuilles pour limiter la transpiration. Du même
coup, il n'y a plus d'entrée de CO2, plus de photosynthèse, la
croissance s'arrête. Pour entretenir ses cellules, l'arbre doit puiser
sur ses réserves. Une fois les stomates fermés, l'arbre entre
dans une période de survie difficile. Si la sècheresse persiste,
il continue à se déshydrater et fini par
s'asséché.
1 Structures qui assurent les échangent gazeux
au niveau des feuilles.
80
? Variabilité climatique persistante
Les modifications climatiques dans le monde vont de pair avec
les modifications des pluies dans l'espace et dans le temps. La
pluviométrie de Maroua en générale et celle Houdouvou est
très instable. Les données pluviométriques sur 27 ans
permettent de mieux apprécier la variation de pluie. (Figure 28)
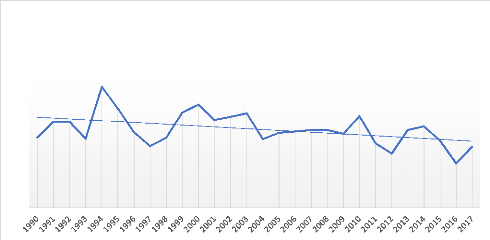
1400
1200
1000
400
800
600
200
0
NIVEAU DES PRECIPITATIONS
691,2
848,9
847,4 680,1
1193,8
978,3
743,9 606,4
689,1
940,8
1017,9
865,6
898,1
ANNEES
932,8
675,5
737,4
751,1
765,2
766,9
726,8
903,9
633,5 533
765,2
802,2 661,4
435,4
598,8
Source : Aéroport
international de Salak
Figure 28. Variabilité pluviométrique de 1990
à 2017
La figure ci-dessus illustre la distribution moyenne annuelle
des précipitations dans la localité de Maroua. Par extrapolation,
ces données peuvent être appliquées à la
localité de Houdouvou. Ces données sont réparties sur 27
ans allant de 1990 à 2017. On remarque ainsi que la tendance des
précipitations augmente et diminue en fonction des années. Ainsi,
l'année qui a connu une pluviométrie assez élevée
est 1994 avec une moyenne de 1993,8 mm tandis que l'année 2015 n'a que
435,4 soit une différence de 758,4 mm. Le diagramme montre clairement
que le niveau de précipitation est très variable. La diminution
des précipitations dans certaines années contribue largement
à la dégradation des espèces ligneuses pérennes
dans la localité de Houdouvou. La courbe générale des
tendances montre une baisse du niveau des pluies entre 1990 et 2017.
81
2.2.2. Indice de diversité des ligneux
pérenne
Pour une étude minutieuse du processus de
dégradation des ligneux pérenne, le
calcul des indices de diversités s'impose. Ainsi, pour
comparer la diversité des groupes floristiques par placettes, par zones
et par espèces (Annexe 6), les indices de Shannon et
d'équitabilité, les indices de Simpson ont été
calculés. Les résultats obtenus ont permis de déterminer
le degré de dégradation spécifique des ligneux
pérennes dans la localité de Houdouvou. (Tableau 7)
Tableau 7. Indice de diversité par placettes
Placettes
|
Richesse Spécifique
|
Pi
|
Pi2
|
log2Pi
|
-Pi*log2Pi
|
P1
|
14
|
0,022151899
|
0,00049071
|
-1,654589043
|
0,0366523
|
P2
|
14
|
0,022151899
|
0,00049071
|
-1,654589043
|
0,0366523
|
P3
|
23
|
0,036392405
|
0,00132441
|
-1,438989242
|
0,0523683
|
P4
|
26
|
0,041139241
|
0,00169244
|
-1,38574373
|
0,0570084
|
P5
|
16
|
0,025316456
|
0,00064092
|
-1,596597096
|
0,0404202
|
P6
|
14
|
0,022151899
|
0,00049071
|
-1,654589043
|
0,0366523
|
P7
|
12
|
0,018987342
|
0,00036052
|
-1,721535832
|
0,0326874
|
P8
|
18
|
0,028481013
|
0,00081117
|
-1,545444573
|
0,0440158
|
P9
|
7
|
0,011075949
|
0,00012268
|
-1,955619038
|
0,0216603
|
P10
|
7
|
0,011075949
|
0,00012268
|
-1,955619038
|
0,0216603
|
P11
|
16
|
0,025316456
|
0,00064092
|
-1,596597096
|
0,0404202
|
P12
|
10
|
0,015822785
|
0,00025036
|
-1,800717078
|
0,0284924
|
P13
|
10
|
0,015822785
|
0,00025036
|
-1,800717078
|
0,0284924
|
P14
|
12
|
0,018987342
|
0,00036052
|
-1,721535832
|
0,0326874
|
P15
|
17
|
0,026898734
|
0,00072354
|
-1,570268157
|
0,0422382
|
P16
|
20
|
0,03164557
|
0,00100144
|
-1,499687083
|
0,0474585
|
P17
|
24
|
0,037974684
|
0,00144208
|
-1,420505837
|
0,0539433
|
P18
|
13
|
0,02056962
|
0,00042311
|
-1,686773726
|
0,0346963
|
P19
|
17
|
0,026898734
|
0,00072354
|
-1,570268157
|
0,0422382
|
P20
|
23
|
0,036392405
|
0,00132441
|
-1,438989242
|
0,0523683
|
P21
|
16
|
0,025316456
|
0,00064092
|
-1,596597096
|
0,0404202
|
P22
|
23
|
0,036392405
|
0,00132441
|
-1,438989242
|
0,0523683
|
P23
|
25
|
0,039556962
|
0,00156475
|
-1,40277707
|
0,0554896
|
P24
|
42
|
0,066455696
|
0,00441636
|
-1,177467788
|
0,0782494
|
P25
|
27
|
0,042721519
|
0,00182513
|
-1,369353314
|
0,0585009
|
P26
|
24
|
0,037974684
|
0,00144208
|
-1,420505837
|
0,0539433
|
P27
|
15
|
0,023734177
|
0,00056331
|
-1,624625819
|
0,0385592
|
P28
|
33
|
0,05221519
|
0,00272643
|
-1,282203138
|
0,0669505
|
P29
|
18
|
0,028481013
|
0,00081117
|
-1,545444573
|
0,0440158
|
P30
|
15
|
0,023734177
|
0,00056331
|
-1,624625819
|
0,0385592
|
|
82
P31
13
|
0,02056962
|
0,00042311
|
-1,686773726
|
0,0346963
|
P32
|
22
|
0,034810127
|
0,00121174
|
-1,458294397
|
0,0507634
|
P33
|
10
|
0,015822785
|
0,00025036
|
-1,800717078
|
0,0284924
|
P34
|
5
|
0,007911392
|
6,259E-05
|
-2,101747074
|
0,0166277
|
P35
|
19
|
0,030063291
|
0,0009038
|
-1,521963477
|
0,0457552
|
P36
|
12
|
0,018987342
|
0,00036052
|
-1,721535832
|
0,0326874
|
TOTAL
|
632
|
1
|
1
|
0
|
0
|
Indice de Shannon H'=-?Pilog2Pi
|
1,51889135
|
|
|
|
|
Indice de Simpson D= ?iPi2
|
0,0327772
|
|
|
|
|
Equitabilité E=H'/ log2S
|
0,16325528
|
|
|
|
|
|
Source : Relevés
botaniques, juillet 2021
La diversité des espèces par placette dans la
localité de Houdouvou est faible car l'indice de Shannon H'= 1,51889135
correspond à la formule : H< 3bit lorsque la
diversité floristique est faible. Pour ce qui est de l'indice de
Simpson, elle permet dans notre cas étude d'apprécier la
probabilité de ne pas rencontrer deux individus de la même
espèce dans la placette. Plus la valeur tend vers 0, moins la
probabilité de rencontrer deux individus de la même espèce
est élevée. Dans notre cas, l'indice de Simpson est D =
0,0327772. Ce qui voudrait dire que le risque de rencontrer deux individus de
la même espèce dans une placette est réduit.
La valeur de l'équitabilité dans les placettes
est faible : EQ= 0,461068745. Ce qui signifie que l'ensemble des relevés
sont composés d'espèces à faible dominance ou rares, cette
faiblesse est causée par la dégradation. Cette rareté des
espèces est peut-être la preuve d'une forte anthropisation
observée dans la localité.
L'indice de diversité floristique permet
d'apprécier le niveau de diversité des espèces et leur
dégradation dans les zones échantillonnées. Cet indice a
fait l'objet de trois calculs : les indices de diversité par placettes
(Annexe 5), les indices de diversité par espèces (Annexe 6), et
les indices de diversités par zone (Tableau 8).
83
Tableau 8. Indice de diversité par zones
Zones
|
Individus
|
Pi
|
Pi2
|
log2Pi
|
-Pi*log2Pi
|
Zone de reboisement
|
144
|
0,227848101
|
0,05191476
|
-2,133855747
|
0,486195
|
zone dégradé
|
169
|
0,267405063
|
0,07150547
|
-1,902901312
|
0,5088454
|
Champs
|
149
|
0,235759494
|
0,05558254
|
-2,084612228
|
0,4914671
|
Zone d'habitation
|
170
|
0,268987342
|
0,07235419
|
-1,894389812
|
0,5095669
|
TOTAL
|
632
|
1
|
1
|
0
|
0
|
Indice de Shannon H'=-?Pilog2Pi
|
1,996074429
|
Indice de Simpson D= ?Pi2
|
0,251356954
|
Equitabilité E=H'/ log2S
|
0,21454444
|
|
Source : Relevés
botaniques, juillet 2021
L'indice de diversité de Shannon est égal
à H' = 1,996074429 bit. Cette valeur correspond
à la condition si H< 3bit. Cela traduit une diversité
floristique faible. Le calcul des indices de diversités de Shannon par
placettes (Annexe 5) et par espèces (Annexe 6), donne une vue globale de
cette diversité. Cependant, les calculs par zone permettent de mieux
apprécié les impacts de la pression sur les espèces
végétales. De façon globale cette diversité est
faible car H'<3bit. Il ressort de la lecture du tableau 8
que la majorité des espaces sont anthropisés et la zone de
reboisement est la moins anthropisés.
2.2.3. Les densités de peuplement des
espèces
Il est question ici de ressortir deux types de
densités : les densités selon les placettes et les
densités en fonction des zones de formations.
? Densités des peuplements selon les placettes
La densité est le rapport du nombre total des
espèces par la superficie. Dans le cadre de ce travail, les placettes
ont une superficie de 30m × 30m équivaut à 900m2, soit
0,09ha. Le tableau suivant montre les déférentes densités
en fonction des placettes.
84
Tableau 9. Densité par placette
|
|
Densités (Tiges/ha)
|
|
|
|
|
Densité moyenne
195 tiges/ha
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre des individu Ni
|
|
|
14
|
156
|
|
14
|
156
|
|
23
|
256
|
|
26
|
289
|
|
16
|
178
|
|
14
|
156
|
|
12
|
133
|
|
18
|
200
|
|
7
|
78
|
|
7
|
78
|
|
16
|
178
|
|
10
|
111
|
|
10
|
111
|
|
12
|
133
|
|
17
|
189
|
|
20
|
222
|
|
24
|
267
|
|
13
|
144
|
|
17
|
189
|
|
23
|
256
|
|
16
|
178
|
|
23
|
256
|
|
25
|
278
|
|
42
|
467
|
|
27
|
300
|
|
24
|
267
|
|
15
|
167
|
|
33
|
367
|
|
18
|
200
|
|
15
|
167
|
|
13
|
144
|
|
22
|
244
|
|
10
|
111
|
|
P34
5
56
P35
19
211
P36
12
133
TOTAL
632
2 528
La densité moyenne de l'ensemble des placettes
calculées est de 195 tiges par
hectares (tiges/ha). Les résultats issus de ce tableau
montrent clairement une
hétérogénéité entre les
différentes placettes avec pour borne minimale 56 tiges par
85
hectares (placette 34) ce qui traduit une faible
densité et la borne maximale de 467 tiges par hectares présent
dans la placette P24. L'interprétation qui découle de ces
résultats est qu'il y a plus de placettes aux densités faibles
que de placettes aux densités élevées. Ceci s'explique par
la dégradation des ligneux dans la localité de Houdouvou.
? Densités des peuplements par zone
Pour une analyse efficiente de la densité, il est
nécessaire de se baser sur une analyse par répartition zonale car
la simple densité par placette (Tableau 8) ne donne pas assez
d'indications. Le tableau 10 présente ainsi les densités par
zones.
Tableau 10. Densité par zones
Zones
|
Individus
|
Densités (Tiges/ha)
|
Zone de reboisement
|
144
|
1600
|
zone dégradé
|
169
|
1878
|
Champs
|
149
|
1656
|
Zone d'habitation
|
170
|
1889
|
TOTAL
|
632
|
7022
|
|
Source : Relevés
botaniques, juillet 2021
L'analyse de la densité des ligneux pérennes
par zone permet de relever que les ligneux sont plus denses dans les zones
dégradées et les zones d'habitations que dans les zones de
reboisement et les zones de champs. Les zones dégradées sont
composées des ligneux pérennes rabougrie à formation
ouverte alors que les zones de reboisement sont composées des ligneux
pérennes de taille moyenne à formation moins dense. La
densité des espèces par familles (Tableau 11) permet de mettre en
relief les familles d'espèces les moins denses et les plus
dégradées dans la localité.
86
Tableau 11. Densité des principales familles
d'espèces
Famille
|
Nombre des
individu Ni
|
Densités
(Tiges/ha)
|
Densité moyenne
|
Arecaceae
|
11
|
122
|
826 tiges/ha
|
Malvacées
|
6
|
67
|
|
69
|
767
|
|
102
|
1133
|
|
158
|
1756
|
|
7
|
78
|
|
5
|
56
|
|
48
|
533
|
|
49
|
544
|
|
74
|
822
|
|
14
|
156
|
|
4
|
44
|
|
28
|
311
|
|
6
|
67
|
|
34
|
378
|
|
17
|
189
|
|
632
|
7022
|
|
Source : Relevés
botaniques, juillet 2021
L'étude de la densité des familles
d'espèces permet de mieux expliquer le processus de dégradation
des ligneux pérennes afin de déterminer les familles les plus
denses et les familles les moins denses et en voie de dégradation et de
raréfaction. La lecture du tableau 11 montre ainsi que le processus de
dégradation des ligneux pérenne est plus
accéléré pour les ligneux de la famille des
Malvacées, Balanitaceae, Moracée, Celastraceae, Rubiaceae.
Les familles d'espèces ayant une bonnes densité sont :
Fabaceae, Meliaceae, Myrtaceae, Tilaceae, Anacardiaceae, Rhamnaceae.
Ainsi, si la dégradation suit sont cour normal, les ligneux
appartenant à ces 6 familles seront parmi les derniers à se
dégrader.
Le processus de dégradation des ligneux prennes
associe des facteurs naturels comme le niveau de précipitation avec des
fluctuations qui causent des sécheresses et des fortes
précipitations à l'origine de l'érosion hydrique. De plus,
la capacité de la plante à s'adapter dans ces conditions entre
dans le système de dégradation des ligneux
pérennes. Par ailleurs, il faut mettre en relation les
éléments a anthropiques pour mieux expliquer ce processus.
2.3. Processus anthropique de la dégradation
des ligneux pérenne
La dégradation des ligneux pérennes n'est pas
faite que par des éléments naturels, l'homme est devenu un acteur
qui occupe une place importante dans le processus de destruction des ligneux
pérennes. A l'ère de l'anthropocène1, les
actions de l'homme, notamment l'agriculture, l'urbanisation, l'emprise du
bâtit dégradent dans un court laps de temps de grande
quantité d'espaces. Le processus anthropique de la dégradation
des ligneux pérennes s'explique par un prélèvement de plus
en plus accru de la ressource végétale, par une croissance
exorbitante de la population et par les systèmes agricoles qui
prévaut à Houdouvou.
2.3.1. Prélèvement croissant des
ligneux
Le prélèvement croissant des ligneux est une
activité importante dans le processus de dégradation
spatio-temporelle des ligneux pérennes.
? Proportion des individus élagués
Les besoins de plus en plus criarde de bois d'oeuvres, de
bois de chauffages et de pâturages dans la localité de Houdouvou
accélèrent la main de l'homme sur les ressources pérennes.
Les gardiens de la zone de reboisement font remarqués que les
populations, notamment les femmes pénètrent dans la
réserve malgré les interdictions des autorités des eaux et
forêts. Les femmes y vont la nuit à l'insu des gardiens. Les
placettes (Figure 29) qui ont été faite dans cette zone montrent
les traces de ces femmes.
87
1Anthropocène : Nouvelle époque
géologique qui se caractérise par l'avènement des hommes
comme principale force de changement sur terre, surpassant les forces
géophysiques.
NOMBRE DES INDIVIDUS
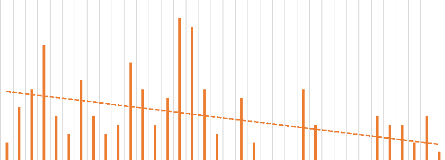
16
15
11
9
8
8
8
7
7
5
5
4
4
3
3
4
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
13
8
6
2
5
4
4
2
5
1
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
P9P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P20P21P22P23P24P25P26P27P28P29P30P31P32P33P34P35P36
PLACETTES
88
Source : Relevés botaniques,
juillet 2021
Figure 29. Nombre des individus élagué dans les
placettes
La figure ci-dessus montre le nombre des individus
élagués dans les différentes placettes. Les 18
premières placettes recensent le plus grand nombre des ligneux
élagués. Les actions de l'homme sont plus criardes à ce
niveau. Les 10 premières placettes ont été faites dans les
zones de reboisement. Les populations ont beaucoup élagué les
ligneux pour se procuré du bois de chauffe. Les placettes faites dans
les zones dégradées n'ont pas beaucoup de ligneux
élagué du fait de la raréfaction des ligneux. Le
prélèvement des ligneux se fait aussi dans les zones de cultures
(photo 4). En effet, les populations vont fréquent coupé les
branches dans les champs du fait de la raréfaction des ligneux. Les
champs sont devenues les lieux par excellence du prélèvement du
bois parce que les ligneux sont de plus en plus rares aux environs des lieux
d'habitations. De plus, il est plus facile de se procurer du bois dans les
champs car, ils sont loin du contrôle des autorités des eaux et
forêts. Au retour des champs, les femmes coupent les branches et tiges
des arbres et arbustes pour faire la cuisine. La photo suivante montre ainsi
les branches d'un arbre coupé par les cultivateurs.

Long : 10°38'12»E Lat :14°10'39»E Al
: 650m
89
Source : Djafnga, 2021
Photo 4. Arbre élagué
La photo ci-dessus montre un arbre dont toutes les
branches ont été élaguées. En effet, les riverains
de Houdouvou élaguent les arbres pour la cuisson des aliments, la vente
ou pour la construction du bâtit. La photo ci-dessus illustre ainsi le
processus de dégradation des ligneux pérennes.
? Mode de prélèvement des ligneux
pérennes
L'accès aux ressources ligneuses pérennes
à Houdouvou se fait par coupe en taillis, par dessouchage, par
ébranchage et par émondage. (Figure 30)
Mode de prélèvement
|
Coupe en taillis Déssouchage Ebranchage
Emondage
|
|
|
|
|
0 10 20 30 40 50 60 70
Nombre des individus
90
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 30. Mode de prélèvement des ligneux
pérennes
Les ligneux pérennes sont prélevés de
quatre manières. Ainsi, les paysans font plus recours à
l'ébranchage pour avoir accès aux ligneux. Sur 120 personnes
enquêtés, 60 coupent les branches des arbres, 24 enlèvent
jusqu'à la souche de l'arbre, 23 font une coupe en taillis et seulement
15 ont besoins de l'écorce des arbres.
? Source de bois de chauffe
Le contexte socio-économique de la localité de
Houdouvou ne permet pas aux populations d'avoir accès à d'autres
sources d'énergie pour la cuisson des aliments. En effet, le bois
énergie utilisé directement comme bois de chauffe ou
transformé en charbon constitue la principale source d'énergie
pour la cuisson des aliments dans les ménages. De plus, la demande en
bois du centre urbain accélère la pression sur les ligneux
pérennes a fait remarquer le chef de village. Pour avoir ainsi
accès aux ressources en bois de chauffe, les populations ramassent plus
les bois morts (Tableau 12) du fait des restrictions des autorités des
eaux et forêts.
91
Tableau 12. Sources d'accès au bois de chauffe
Moyen d'accès
|
Effectifs
|
Pourcentage
|
Pourcentage valide
|
Ramassage de bois mort
|
45
|
37,5
|
37,5
|
Coupe de bois vert
|
36
|
30,0
|
30,0
|
Emondage des arbres
|
24
|
20,0
|
20,0
|
Achat des arbres au marché
|
15
|
12,5
|
12,5
|
Total
|
120
|
100,0
|
100,0
|
|
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Le tableau ci-dessus illustre les moyens d'accès aux
bois de chauffe dans la localité de Houdouvou. Les enquêtes de
terrains ont permis de relever que le ramassage de bois mort est le principal
moyen pour avoir accès au bois de chauffe. Sur 120 personnes
enquêtées, 45 ramassent du bois mort pour la cuisson, 36 coupent
du bois vert, 24 utilisent les écorces des arbres et seulement 15
personnes achètent sur le marché. En effet, le ramassage de bois
mort est le principal moyen parce que les autorités des eaux et
forêt interdisent la coupe abusive du bois. Cependant, l'achat de bois au
marché occupe une faible proportion parce que la quasi-majorité
des paysans partent chercher du bois et d'autres vendent ces produits ligneux
aux personnes qui quittent de la ville de Maroua pour s'approvisionner en bois
de chauffe.
2.3.2. Les pratiques agricoles
L'agriculture est un élément qui agit
grandement dans la mutation du couvert végétal dans la
localité de Houdouvou. De par les modes de préparation des
champs, les cultures pratiquées et lieux par excellence de
prélèvement des ligneux, les zones de cultures se voient de plus
en plus vidés de leurs ressources ligneuses.
? Mode de préparation des champs
L'agriculture est une activité qui nécessite
des terres nues sans obstacles. De ce fait, l'abondance des ligneux sur un
espace agricole constitue un obstacle dans la pratique de l'agriculture. Pour y
remédier, les populations font recours à des techniques pour la
préparation des parcelles. (Figure 31)
72
80
Nombres de personnes
|
70 60 50 40
|
|
33
|
|
|
|
|
15
|
|
10
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Déssouchage Brulis
Défrichement
Mode de préparation
92
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 31. Mode de préparation des champs
La figure ci-dessus illustre les principaux modes de
préparation des champs avant les semis. Les ligneux,
généralement les petits arbustes sont dessouchés par les
agriculteurs, d'autres défrichent tout simplement et d'autre
brûles. Ainsi, 72 personnes sur 120 défrichent les champs avant de
semé, 33 procèdent par dessouchage et 15 brulent. Ces moyens de
préparation des champs favorisent la destruction de jeunes plans qui
veulent grandir dans les champs. De plus, les feuilles des grands arbres dans
les champs bloquent la croissance des cultures. Pour y remédier, les
cultivateurs élaguent les arbres (Planche photographique 4) pour
favoriser l'arrivée du soleil sur les jeunes plants.
Les techniques de défrichement sont sommaires et
occasionnent de véritables dégâts sur l'environnement.
L'installation d'un nouveau champ entraîne la destruction des arbres. Les
espèces jugées gênantes pour les cultures sont abattues,
séchées et brûlées. Les rejets de souches sont
arrachés chaque année lors de la préparation des champs,
ce qui finit par tuer l'arbre.

Long : 10°38'11»E Lat
:14°10'59»E Al : 540m Photo A. Arbre élagué
dans un champ
Long : 10°38'65»ELat :14°10'35»E Al
: 550m
Photo B. Eucalyptucus globulus
élagué
A
Long : 10°38'18»ELat :14°10'30»E Al
: 630m
Photo B. Arbre coupé dans un champ
C
B
93
Source : Djafnga, juillet
2021
Planche photographique 4. Mode de préparation des
champs
La planche ci-dessus illustre les modes de
préparation des champs dans la localité de Houdouvou. La photo A
montre les branches d'un arbre coupé pour favoriser la croissance des
jeunes plants. La photo B par contre montre un jeune arbre qui a
été coupé jusqu'au tronc et la photo C montre deux
Eucalyptus globulus coupés et dont les
94
tiges ont repoussé. Ces différentes
pratiques agricoles favorisent une forte érosion des ligneux.
En outre, les enquêtes de terrain ont permis de montrer
que le principal lieu d'approvisionnement en date reste et demeure les zones de
cultures. (Figure 32)
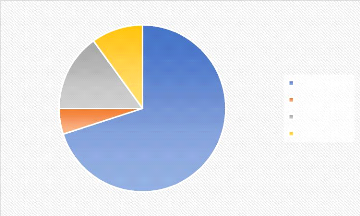
5%
15%
10%
70%
Champs Vergers
Espace reboisé Achat de bois
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 32. Lieu de prélèvement des ligneux
pérennes
La figue ci-dessus montre les principaux lieux
d'approvisionnement en bois de chauffe des populations de Houdouvou. Le premier
lieu concerne les champs avec 70%. Le deuxième lieu concerne les zones
de reboisement avec 15%, le troisième, l'achat du bois avec 10 % et
enfin les vergers avec seulement 5%. On remarque ainsi que l'activité
agricole contribue grandement dans le processus de l'érosion des ligneux
pérennes. De plus, l'agriculture occupe une place très importante
dans la localité car elle est l'activité économique la
plus pratiquées par les riverains. Les femmes en rentrent des champs
font des fagots de bois pour préparer à la maison.
Les principales activités dans la localité sont
l'agriculture, l'élevage, le commerce et la vente de bois. Parmi ces
activités, l'agriculture occupe une place de choix comme le montre le
tableau suivant.
95
Tableau 13. Principales activités économique
Activités économique
|
Effectifs
|
Pourcentage
|
Agriculture
|
75
|
62,5
|
Elevage
|
15
|
12,5
|
Commerce
|
15
|
12,5
|
Vente de bois et charbons
|
15
|
12,5
|
Total
|
120
|
100,0
|
|
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
La proportion qu'occupe l'agriculture dans la localité
de Houdouvou est très importante. Elle représente à plus
de 60 % de l'activité des populations locale. Pendant les saisons de
cultures, la quasi-totalité du village se retrouve dans les champs pour
travailler. L'élevage, le commerce, la vente de bois et du charbon
occupe la même proportion, soit 12.5%. Les ligneux de la localité
de Houdouvou sont utilisés pour satisfaire les besoins des
populations.
Dans le prisme des travaux champêtre, la clôture
des champs pour éviter la destruction des cultures nécessite la
coupe d'arbres. On assiste dans la localité à une augmentation de
la production de cultures maraîchères au cours de la saison
sèche. Traditionnellement, ces cultures sont protégées des
animaux, qui divaguent librement à cette époque de
l'année, par une clôture faite de branches d'arbres
épineux, ce qui augmente la pression qui existe sur la ressource
ligneuse. La même technique est appliquée pendant les saisons de
pluies pour protéger les cultures qui se trouvent aux alentours des
lieux d'habitations. (Planche photographique 5)

Long : 10°38'11»ELat :14°10'03»E Al
: 630m
Photo A. Clôture d'un champ et d'une
maison
Long : 10°38'13»ELat :14°10'05»E Al
: 630m
Photo B. Clôture d'un champ avec des
épines
B
A
96
Source : Djafnga, juillet
2021
Planche photographique 5. Clôture des champs avec des
ligneux pérennes
La planche ci-dessus montre les différentes
méthodes utilisées pour la clôture des parcelles de
cultures qui se trouvent à côté des lieux d'habitations.
Ainsi, la photo A montre des ligneux pérennes ayant servi à
clôturer une parcelle de culture et une maison et la photo B quand elle
illustre des épines issues des ligneux pérennes et qui servent
à clôturer une vaste parcelle de culture. La coupe des branches de
ces ligneux pour la clôture des champs favorise ainsi la
dégradation et la raréfaction des ligneux
pérennes.
97
En effet, les productions doivent être
protégées contre les animaux qui sont laissés en
liberté dans la localité. Traditionnellement, les paysans
érigent des haies mortes, c'est-à-dire des clôtures faites
de branches d'arbres épineux ou de résidus de culture. Ce type de
protection est d'une efficacité restreinte puisqu'il subit l'attaque des
termites et doit être reconstruit chaque année et aggrave ainsi le
processus de destruction des ligneux pérennes.
2.3.3. Importance socio-économique des ligneux
pérennes
Le rôle que joue les ligneux pérennes contribue
grandement dans leur processus de dégradation. En effet, les arbres
pérennes permettent la survie des populations à travers la
construction des habitats et la cuisson des aliments. Ces besoins augmentent la
demande des populations en bois de chauffe. Le figure 33 montre les principaux
usages des ligneux pérennes.
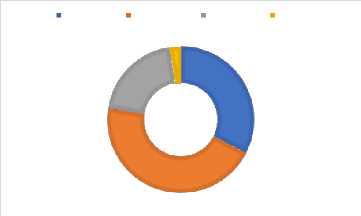
Pharmacopée Bois de chauffe Bois d'oeuvre
Fourrage
20%
45%
3%
32%
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 33. Principaux usages des ligneux pérennes
La figure 33 illustre les principaux usages des ligneux
pérennes par les populations riveraines. Ainsi, le principal usage des
ligneux pérenne est la cuisson des aliments avec une proportion de 45%.
Le bois d'oeuvre vient en troisième position avec 20% après les
utilisations pour besoin sanitaire ave 32%. Le fourrage occupe ainsi la
dernière place avec 3%. Ainsi, les besoins des populations en
énergie sont de plus en plus grandissante et par ricochet, la
dégradation des ligneux pérennes est
accélérée.
98
En outre, les populations font recours aux ligneux
pérennes pour la construction du toit des maisons ou pour la
construction des hangars comme le montre la photo suivante.

Long : 103827N Lat : 141024E Al : 460m
Source : Djafnga, 2021
Photo 5. Construction d'un hangar avec les ligneux
pérennes
La photo 5 montre un hangar construit avec des ligneux
pérennes. La construction d'un tel logis nécessite de couper les
branches d'arbres et souvent des troncs entiers pour les arbres de petite
circonférence. La coupe de ces arbres contribue à la
raréfaction de ces ligneux.
Nonobstant, l'utilisation anarchique et abusive des ligneux
pérennes dans la localité de Houdouvou est favorisée par
les limites de la législation en matière de protection des
ressources ligneuses.
99
2.4. Les défaillances administratives ?
Les limites administratives
La dégradation des ligneux pérennes est aussi
favorisée par un laxisme et un manque de civisme de certaine
autorités chargées de la protection des forêts. Les
interviews (Encadré 1) menées avec les personnes ressources de la
localité ont permis de déceler ces manquements.
Encadré 1. Interview des gardiens de la zone de
reboisement
On travaille beaucoup dans la zone de reboisement. Nous
protégeons la zone depuis sa création et nous n'avons pas
été payés depuis le 22 octobre 2019. La commune est
chargée de nous payer. On nous payait après un an un montant de
180 milles. Avant que la commune ne prenne le relai, le
délégué nous payait 30 milles FCFA chaque fin du mois.
Depuis que la commune a pris le relais, les choses ont changées. On
supporte juste avec. Les autres sont entrain de cultiver et nous on garde la
réserve pour ne rien avoir à la fin. Le 20 mars, nous avons
écrit au maire et il a refusé de prendre la lettre. Dans les
documents du projet, le budget est de 13 millions par an pour payer les
gardiens. Nous nous résignons à protéger la réserve
juste par amour, pour ne pas que toutes les espèces disparaissent.
Gardiens de la réserve
Les interviews avec les gardiens de la zone de reboisement
ont permis de déceler une défaillance du système de
gestion des ligneux après le projet de reboisement Sahel Vert dans la
localité. En effet, la gabegie financière de certaines
autorités les pousses à sous-payer les agents de contrôle
des ressources ligneuses dans la zone de reboisement. Cette exploitation
à pousser des gardiens à abandonner leur poste. Sont resté
que ceux de bonne foi. Ce manque de civisme cause une surveillance insuffisante
et la réserve et par ricochet la surexploitation des ligneux
pérennes par les populations riveraines.
De plus, le laxisme de certains agents de contrôle des
eaux et forêt favorise une coupe exagérée des ligneux
pérenne souligne le chef du village.
100
? Les limites de la législation
La réglementation en matière de protection des
ligneux pérennes dans la localité est souvent taillée sur
mesure en fonction des besoins individuel des agents. On observe ainsi des bois
en ventes à vue de profusion. (Planche photographique 6)

Long: 10°38'52»N Lat: 14°10'56»E Al:
461 m
Photo A. Vente en détail
A
Long : 10°38'70»N Lat : 14°10'63»E
Al : 561 m
Photo B. Vente en gros
B
Source : Djafnga, juillet
2021
Planche photographique 6. Vente incontrôlée des
ligneux pérennes
La planche photographique ci-dessus illustre les lieux de
vente de bois dans la localité de Houdouvou. La photo A montre des
ligneux attachés pour être vendu en détail tandis que la
photo B montre un grand tas de ligneux destiné à être vendu
en gros. Le payement d'un supplément d'argent permet aux paysans d'avoir
accès de manière illimité au bois. Cet accès
illimité cause la surexploitation des ligneux comme le montre la photo
B.
101
Encadré 2. Interview du chef du village de Houdouvou
La végétation dans mon village est devenue
rare, les Nîmes sont les nombreux. Les brousses sont de plus en plus
vides. Il faut s'enfoncer de plus en plus loin pour avoir du bois. Il y a un
agent des eaux et forêt qui reste sur les routes pour contrôler
ceux qui passent avec du bois et un autre se promène dans les brousses.
Cependant, ce sont ces mêmes agents qui vendent les bois. Si par exemple
une personne remet 200 FCFA, il a la possibilité de couper du bois
pendant une semaine. Si elle remet 500 FCFA, elle a la possibilité de
couper du bois pendant un mois. Si chaque personne donne 500 FCFA et coupe du
bois pendant un mois, il ne restera plus rien en brousse en fin d'année.
Ce sont ces agents qui ont vendu tous ces bois et causent la raréfaction
des arbres.
Chef du village
L'interview ci-dessus montre les réalités du
milieu et les défaillances du système mis en place pour la
protection des ligneux. L'amour de l'argent et la recherche du profit
individuel l'emporte sur la protection de l'environnement. L'incivisme de
certains agents cause une surexploitation des ligneux pérennes et de
facto sa dégradation. Les limites de cette législation
forestière entrent dans l'engrenage de la dégradation
spatio-temporelle des ligneux dits pérennes.
L'analyse du processus naturel et du processus anthropique de
la dégradation des ligneux pérennes permet de conclure que le
processus anthropique dégrade plus les ligneux pérennes que le
naturel. (Figure 34)


NOMBRE DES INDIVIDUS
30
21
69
BAISSE DES ARIDITÉ DU SOL
ACTIVITÉS
PLUIES HUMAINES
PROCESSUS DE DÉGRADATION
102
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 34. Processus de dégradation des ligneux
pérenne
La figure ci-dessus montre les principaux
éléments entrant dans la dégradation spatio-temporelle des
ligneux pérennes dans la localité de Houdouvou. Les deux premiers
éléments (Baisse des pluies et aride du sol) entrent dans le
processus naturel de la dégradation tandis que les activités
humaines se rangent dans le processus anthropique. On observe ainsi que ce sont
les activités humaines qui dégradent plus les ligneux
pérennes. De plus, la somme du pourcentage des deux
éléments du processus naturel (51) n'atteint pas celui du
processus anthropique (69). En effet, la forte croissance démographique
dans la localité s'accompagne d'une forte pression sur les ligneux
pérennes et entraine par ricochet sa dégradation.
103
Conclusion
Les ligneux pérennes de la localité de Houdouvou
sont dégradés par les affres
climatiques et les activités anthropiques. L'analyse
des variabilités pluviométrique, des indices de diversités
(Indice de Shannon H'= 1,518891351, Indice de Simpson D= 0,032777199166,
Equitabilité EQ = 0,16325528) et des densités (195 tiges/ha)
permet de confirmer la dégradation des ligneux pérennes. De plus,
la quantité de ligneux prélevé, les modes de
préparations des champs, les principales cultures pratiquées, le
degré d'occupation de l'espace par l'agriculture et les habitations
corrobore l'hypothèse de la dégradation spatio-temporelle des
ligneux pérennes par les activités humaines. Par ailleurs, les
défaillances de l'administration et les limites de la législation
aggravent et accélèrent le processus de dégradation qui
aura des conséquences environnementaux et socio-économiques dans
ladite localité.
104
Chapitre 3. Effets de la dégradation des ligneux
pérennes
Introduction
La perte de surface forestière dans le monde progresse
d'années en années,
notamment dans les régions tropicales. Le recul de
l'arbre et de la forêt en Afrique tropicale sèche est le plus
symbolique des phénomènes de désertification qui affectent
le Sahel depuis une bonne décennie. Chaque année, ce sont des
centaines de milliers d'hectares qui sont déboisés dans les zones
sahéliennes, La désertification et la déforestation sont
les principales conséquences de la destruction de ces surfaces
végétales. De même, la dégradation des ligneux
pérennes dans la localité de Houdouvou à des
conséquences directes sur la nature en générale et sur les
hommes et leurs activités en particulier. Etant un lieu
d'approvisionnement par excellence en bois, les ligneux pérennes de
cette localité son en raréfaction et les conséquences sont
perceptibles à plusieurs niveaux. . La survie biologique du Sahel est en
jeu, survie humaine et animale aussi bien que végétale.
L'objectif de ce chapitre est d'analyser les conséquences
environnementaux d'une part est les conséquences
socio-économiques de la dégradation des ligneux pérennes
d'autres part.
3.1. Les effets environnementaux de la
dégradation des ligneux pérennes
La dégradation des ligneux pérennes à des
conséquences directes sur les
composantes de l'environnement. Ces conséquences
s'observent au niveau de de l'augmentation du taux de mortalité des
ligneux pérennes, au niveau de la raréfaction des espèces
dans la localité. De plus, les zones dégradées se
multiplient de plus en plus et gagnent en superficie.
3.1.1. Diminution du nombre de ligneux dans la
localité
La conséquence directe de la dégradation des
ligneux pérennes est la diminution
du nombre des arbres dans la localité. La forte
pression des phénomènes naturels notamment la rareté des
pluies et l'abondance de la chaleur entrainent des graves conséquences
sur les ligneux pérennes comme la diminution du nombre des
espèces. En effet les espèces ne pouvant pas s'adapter aux
conditions hydriques entent en défoliation (photo 3), sèchent
parfois meurent complètement. Ce phénomène est observable
à travers les indices de mortalités des individus. (Figure 35)
? Indice de mortalité des espèces
pérennes
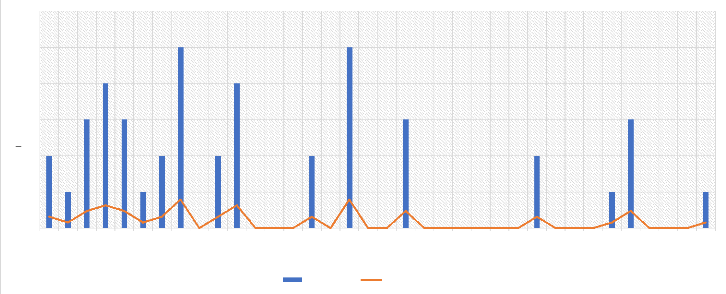
Individus mort
4
6
5
3
0
2
1
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18
P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36
Placettes
Arbres mort Taux de mortalité
105
Source : Relevés botaniques, juillet 2021
Figure 35.Taux de mortalité par placette
106
La figure ci-dessus montre le taux des arbres pérennes
morts dans la localité de Houdouvou. Ainsi, les 11 premières
placettes recensent la majorité des arbres morts dans la
localité. Ces placettes ont été faites dans la zone de
reboisement. Les placettes 19 à 27 ont été faites dans les
zones d'habitations. On ne retrouve pas beaucoup de ligneux morts parce qu'il y
une forte présence des hommes et qu'ils ont la possibilité de
couper les pérennes morts. Ainsi, la courbe du taux de mortalité
montre que la placette 8 et la placette 17 enregistre le plus grand taux de
mortalité. Ce taux est aussi élevé entre la placette 3 et
la placette 5. L'analyse de ce taux de mortalité permet de conclure que
les ligneux pérennes se raréfient grandement dans la
localité. L''analyse de ce taux par zone permet de mieux
appréhender le phénomène.
? Indice de mortalité des espèces
pérennes par zone
L'analyse du taux de mortalité par placette (figure
33) donne un aperçu général de la moralité des
ligneux pérennes. L'analyse du niveau de mortalité par zone donne
une répartition plus explicite de la mortalité des ligneux
pérennes. Tableau 14.
Tableau 14. Taux de mortalité par zone
Zone
|
Arbres
morts
|
Taux de
mortalité
|
Zone de reboisement
|
17
|
269%
|
zone dégradé
|
13
|
206%
|
Champs
|
8
|
127%
|
Zone d'habitation
|
6
|
79%
|
TOTAL
|
44
|
680%
|
|
Source : Relevés botaniques, juillet 2021
Le tableau ci-dessus montre le taux de mortalité des
ligneux pérennes en fonction des principales zones. Ainsi, la zone
où on rencontre beaucoup de ligneux morts est la zone de reboisement
avec 269%. Le deuxième lieu est la zone dégradée avec 206%
suivi de la zone des champs 127% et la zone d'habitation avec 79%. L'analyse du
taux de mortalité par zone confirme ainsi le fait que les ligneux morts
sont plus nombreux dans la zone de reboisement et moins nombreux dans les zones
d'habitations. La mortalité continue de ces ligneux conduits à la
raréfaction des espèces ligneuses pérennes.
? Indice de raréfaction des ligneux pérennes
La conséquence directement observable de la
dégradation des ligneux pérennes est la raréfaction des
ligneux. Cette raréfaction est observable en fonction des principales
107
espèces qu'on retrouve dans la localité. Le
tableau suivant montre les ligneux qui sont rares dans la localité.
Tableau 15. Indice de raréfaction par espèces
N°
|
Espèces
|
Indice de
raréfaction
|
Nombre
d'individus Non-
rare
|
Nombre
d'individus
rare
|
1
|
Acacia Albida
|
78
|
Non Rare
|
0
|
2
|
Acacia nilotica
|
86
|
0
|
Rare
|
3
|
Acacia seyal
|
72
|
Non Rare
|
0
|
4
|
Anacardium occidentale
|
94
|
0
|
Rare
|
5
|
Azadirachta indica
|
22
|
Non Rare
|
0
|
6
|
Balanites aegyptiaca
|
92
|
0
|
Rare
|
7
|
Cissus quadrangularis
|
86
|
0
|
Rare
|
8
|
Colophospermum mopane
|
86
|
0
|
Rare
|
9
|
Combretum migranthum
|
97
|
0
|
Rare
|
10
|
Cobretum glutinosum
|
89
|
0
|
Rare
|
11
|
Dalbrgia melanoxylon
|
97
|
0
|
Rare
|
12
|
Diospyros mespiliformis
|
97
|
0
|
Rare
|
13
|
Eucalyptucus globulus
|
89
|
0
|
Rare
|
14
|
Erophaca baetica
|
97
|
0
|
Rare
|
15
|
Faidherbia albida
|
72
|
Non Rare
|
0
|
16
|
Feretia apondanthera delile
|
97
|
0
|
Rare
|
17
|
Ficus glumosa
|
97
|
0
|
Rare
|
18
|
Ficus sycomorus
|
97
|
0
|
Rare
|
19
|
Grewia mollis juss
|
92
|
0
|
Rare
|
20
|
Grewia villosa
|
97
|
0
|
Rare
|
21
|
Gymnosporia senegalensis
|
97
|
0
|
Rare
|
22
|
Hyphaene thebaica
|
94
|
0
|
Rare
|
23
|
Mangifera indica
|
83
|
0
|
Rare
|
24
|
Moringa aleifera
|
97
|
0
|
Rare
|
25
|
Ozora insignis
|
97
|
0
|
Rare
|
26
|
Psidium guajava
|
94
|
0
|
Rare
|
27
|
Sclerocarya birrea
|
86
|
0
|
Rare
|
28
|
Tamarindus indica
|
89
|
0
|
Rare
|
29
|
Ziziphus mauritiana
|
86
|
0
|
Rare
|
30
|
Ziziphus spina-christi
|
94
|
0
|
Rare
|
Total
|
2 656
|
4
|
26
|
|
Source : Relevés botaniques, juillet 2021
Le tableau 15 indique les indices de raréfaction des
espèces présente dans la localité de Houdouvou. Les
espèces ayant des indices supérieures à 80 sont rares et
celles ayant des indices inférieures à 80 ne sont pas rares. Sur
30 individus, 26 sont
108
considérés comme rares et 4 ne sont pas rares.
Ainsi, Azadirachta indica, Acacia Albida, Acacia seyal et Faidherbia albida
sont considéré comme des espèces qui ne sont pas
rares. On constate ainsi que les espèces sont de plus en plus rares dans
la localité. L'indice de raréfaction des ligneux est
également étudiée en fonction des familles
d'espèces. (Tableau 16)
Tableau 16. Indice de raréfaction par familles
N°
|
Familles
|
Indice de
raréfaction
|
Individus
Non Rare
|
Individus Rare
|
1
|
Arecaceae
|
94%
|
0%
|
Rare
|
2
|
Malvacées
|
97%
|
0%
|
Rare
|
3
|
Mimosaceae
|
50%
|
Non Rare
|
0%
|
4
|
Fabaceae
|
53%
|
Non Rare
|
0%
|
5
|
Meliaceae
|
22%
|
Non Rare
|
0%
|
6
|
Balanitaceae
|
92%
|
0%
|
Rare
|
7
|
Moracée
|
94%
|
0%
|
Rare
|
8
|
Myrtaceae
|
83%
|
0%
|
Rare
|
9
|
Tilaceae
|
78%
|
Non Rare
|
0%
|
10
|
Anacardiaceae
|
61%
|
Non Rare
|
0%
|
11
|
Caesalpiniaceae
|
89%
|
0%
|
Rare
|
12
|
Celastraceae
|
97%
|
0%
|
Rare
|
13
|
Combretaceae
|
86%
|
0%
|
Rare
|
14
|
Rubiaceae
|
97%
|
0%
|
Rare
|
15
|
Rhamnaceae
|
81%
|
0%
|
Rare
|
16
|
Vitaceae
|
86%
|
0%
|
Rare
|
Total
|
1261%
|
5
|
11
|
|
Source : Relevés botaniques, juillet 2021
Le tableau ci-dessus analyse la raréfaction des
ligneux pérennes en fonction des principales familles d'espèces
qui ont été inventoriées. Sur 16 familles
d'espèces, cinq familles sont considérées comme
étant nombreuses car leurs indices de raréfaction sont
inférieurs à 80. Par ailleurs, 11 familles sont
considérées comme rares car leur indice est supérieur
à 80. Ainsi, la famille des Meliaceae (22), Mimosaceae (50),
Fabaceae (53) Anacardiaceae (61) et (Tilaceae) sont
considéré comme nombreuse dans la localité. Par contre, la
famille des Arecaceae, Malvacées,
Balanitaceae, Moracée, Myrtaceae,
Caesalpiniaceae, Celastraceae, Rubiaceae,
Rhamnaceae, Combretaceae, Rubiaceae, Rhamnaceae,
Vitaceae sont considérées comme rare.
109
? Abondance relative des espèces
L'analyse de l'abondance relative permet de déterminer
les espèces les plus abondantes dans la localité et les
espèces en voie de disparition. Le tableau 17 montre l'état
d'abondance des principales pérennes.
Tableau 17. Abondance relative des espèces
N°
|
Espèces
|
Nbre Individus
|
Abondance
relative
|
1
|
Acacia Albida
|
37
|
0,059
|
2
|
Acacia nilotica
|
42
|
0,066
|
3
|
Acacia seyal
|
31
|
0,049
|
4
|
Anacardium occidentale
|
17
|
0,027
|
5
|
Azadirachta indica
|
157
|
0,248
|
6
|
Balanites aegyptiaca
|
6
|
0,009
|
7
|
Cissus quadrangularis
|
16
|
0,025
|
8
|
Colophospermum mopane
|
36
|
0,057
|
9
|
Combretum migranthum
|
7
|
0,011
|
10
|
Cobretum glutinosum
|
20
|
0,032
|
11
|
Dalbrgia melanoxylon
|
1
|
0,002
|
12
|
Diospyros mespiliformis
|
5
|
0,008
|
13
|
Eucalyptucus globulus
|
36
|
0,057
|
14
|
Erophaca baetica
|
5
|
0,008
|
15
|
Faidherbia albida
|
64
|
0,101
|
16
|
Feretia apondanthera delile
|
5
|
0,008
|
17
|
Ficus glumosa
|
1
|
0,002
|
18
|
Ficus sycomorus
|
3
|
0,005
|
19
|
Grewia mollis juss
|
12
|
0,019
|
20
|
Grewia villosa
|
5
|
0,008
|
21
|
Gymnosporia senegalensis
|
3
|
0,005
|
22
|
Hyphaene thebaica
|
10
|
0,016
|
23
|
Mangifera indica
|
33
|
0,052
|
24
|
Moringa aleifera
|
2
|
0,003
|
25
|
Ozora insignis
|
3
|
0,005
|
26
|
Psidium guajava
|
11
|
0,017
|
27
|
Sclerocarya birrea
|
18
|
0,028
|
28
|
Tamarindus indica
|
13
|
0,021
|
29
|
Ziziphus mauritiana
|
23
|
0,036
|
30
|
Ziziphus spina-christi
|
10
|
0,016
|
Total
|
632
|
1
|
|
Source : Relevés botaniques, juillet 2021
110
Le tableau ci-dessus montre l'abondance en pourcentage des
principales espèces Dans la localité. Ce tableau permet de voir
qu'il y a que deux espèces qui sont abondantes dans la localité
de Houdouvou. Il s'agit d'Azadirachta indica avec 0,248 % et de
Faidherbia albida avec 0,101%. Tous les autres espèces ne sont
pas abondantes et se situe en dessous de 40%. Les espèces en voie de
disparition sont Ficus glumosa (0,002), Dalbrgia melanoxylon (0,002),
Moringa aleifera (0,003), Ozora insignis (0,003), Gymnosporia senegalensis
(0,005), Ficus sycomorus (0,005). Cette indice est aussi analyser en
fonction des principales familles d''espèces et permet de
déterminer les familles les moins abondantes dans la localité.
Figure 36.

Source : Relevés
botaniques, juillet 2021
Figure 36. Abondance relative par familles
L'analyse de l'abondance relative des familles
d'espèces permet de déceler deux familles dont le niveau
d'abondance est supérieur à 50 %. Il s'agit de Meliaceae
(0,25), Fabaceae (0,16). Deux familles comprises entre 40 et 50%.
Il s'agit Anacardiaceae (0,12) et Mimosaceae (0,11). Deux
familles comprises entre 30 et 40. Il s'agit de Tilaceae (0,08) et de
Myrtaceae (0,08). Dix familles dont l'abondance est inférieure
à 20 %. Ainsi, les familles d'espèces dans la localité de
Houdouvou ne sont pas abondantes, cet état traduit une
raréfaction des ligneux pérennes.
111
? Etat général de la végétation
pérenne
Les enquêtes de terrain menés ont permis d'avoir
une perception du niveau d'érosion des ligneux pérennes dans la
localité. Ils nous ont permis d'évaluer le niveau de la
végétation dans l'optique de voir si elles ont augmenté ou
diminué. La figure suivante montre clairement l'état des
végétaux pérennes à Houdouvou.

60
Nombres d'individus
50
40
30
20
10
0
70
En diminution En augmentation Sans Changement
Touché
Etat de la végétation
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 37. Etat des ligneux pérennes
La figure ci-dessus montre l'état de la
végétation pérenne dans la localité de Houdouvou.
Les enquêtes ont permis de relever que les ligneux pérennes sont
en diminution contrairement aux autres années. Ainsi sur 120 personnes
enquêtés, 66 pensent que les ligneux pérennes sont en
diminution, 21 pensent que c'est sans changement, 21 pensent que c'est
touché et seulement 12 pensent que c'est en augmentation. Les personnes
qui pensent que les ligneux sont en augmentation sont
généralement les jeunes et ceux qui n'ont pas durées dans
la localité. Les personnes âgées et celles ayant
durées dans la localité affirment sans ambages que les ligneux
pérennes sont en diminution.
Pair ailleurs, le degré de leur diminution a
été étudié pour voir la fréquence à
laquelle ces ligneux se dégradent. (Figure 38)
Dégré de diminution
|
Faible
Moyen
Fort
|
|
|
|
|
0 10 20 30 40 50
Nombre de personnes
112
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 38. Degré de dégradation des ligneux
pérennes
La figure 38 illustre la vitesse à laquelle les
ligneux pérennes diminuent. Ainsi, les enquêtes ont permis de voir
que le degré de diminution est fort. En effet, 45 personnes sur 120
pensent que les ligneux pérennes diminuent de manière forte, 39
pensent que le degré de diminution est moyen et 36 pensent que le
degré de diminution est faible. Ainsi, la conséquence directe de
la dégradation des ligneux pérenne est la diminution du nombre
d'espèces dans la localité. Cette raréfaction est à
l'origine de l'augmentation du nombre des espaces dégradées ainsi
des températures.
? Faible fréquences des ligneux
pérennes
L'effet direct de la dégradation des ligneux
pérennes est la faiblesse de la fréquence de ces ligneux. Les
indices de fréquence permettent d'apprécier le niveau
d'apparition des ligneux pérennes dans la localité. La
fréquence des principales espèces pérennes est
représentée dans le tableau 18.
113
Tableau 18.Fréquence des espèces pérennes
N°
|
Espèces
|
Nbre de
relevé
|
Fréquence
|
1
|
Acacia Albida
|
8
|
22,22
|
2
|
Acacia nilotica
|
5
|
13,89
|
3
|
Acacia seyal
|
10
|
27,78
|
4
|
Anacardium occidentale
|
2
|
5,56
|
5
|
Azadirachta indica
|
28
|
77,78
|
6
|
Balanites aegyptiaca
|
3
|
8,33
|
7
|
Cissus quadrangularis
|
5
|
13,89
|
8
|
Colophospermum mopane
|
5
|
13,89
|
9
|
Combretum migranthum
|
1
|
2,78
|
10
|
Cobretum glutinosum
|
4
|
11,11
|
11
|
Dalbrgia melanoxylon
|
1
|
2,78
|
12
|
Diospyros mespiliformis
|
1
|
2,78
|
13
|
Eucalyptucus globulus
|
4
|
11,11
|
14
|
Erophaca baetica
|
1
|
2,78
|
15
|
Faidherbia albida
|
10
|
27,78
|
16
|
Feretia apondanthera delile
|
1
|
2,78
|
17
|
Ficus glumosa
|
1
|
2,78
|
18
|
Ficus sycomorus
|
1
|
2,78
|
19
|
Grewia mollis juss
|
3
|
8,33
|
20
|
Grewia villosa
|
1
|
2,78
|
21
|
Gymnosporia senegalensis
|
1
|
2,78
|
22
|
Hyphaene thebaica
|
2
|
5,56
|
23
|
Mangifera indica
|
6
|
16,67
|
24
|
Moringa aleifera
|
1
|
2,78
|
25
|
Ozora insignis
|
1
|
2,78
|
26
|
Psidium guajava
|
2
|
5,56
|
27
|
Sclerocarya birrea
|
5
|
13,89
|
28
|
Tamarindus indica
|
4
|
11,11
|
29
|
Ziziphus mauritiana
|
5
|
13,89
|
30
|
Ziziphus spina-christi
|
2
|
5,56
|
Total
|
|
124
|
344,44
|
|
Source : Relevés
botaniques, juillet 2021
Le tableau ci-dessus montre le niveau de fréquence des
principales espèces inventoriées dans les 36 placettes des zones
de reboisements, des zones de cultures, des zones d'habitations et des zones
dégradées. La liste des 36 espèces permet
d'apprécier ainsi les fréquences des ligneux pérennes.
L'espèce ayant la plus grande fréquence dans la localité
est Azadirachta indica avec77.78%. Les espèces ayant les plus
petites
114
fréquences sont Combretum migranthum,
Dalbrgia melanoxylon, Diospyros mespiliformis, Erophaca
baetic, Feretia apondanthera delile, Ficus glumosa, Ficus sycomorus,
Grewia villosa, Gymnosporia senegalensis, Moringa
aleifera, Ozora insignis avec chacune 2,78%. Plusieurs seuils
permettent ainsi de classer la fréquence de ces espèces en
espèces de faibles ou de fortes fréquences. (Tableau 19)
La classification des espèces en groupe est la
résultante des typologies selon les proportions. Dans le cadre de notre
étude, il existe quatre (04) différents groupes d'espèces.
Cette classification explique en générale la typologie des
espèces pérennes en fonction des classes en pourcentage des
totales et dans la localité. Ainsi donc, on retrouve dans cette analyse
:
- Les espèces très rares dont les taux sont
compris entre]0 S 1[% ;
- Les espèces rares dont les taux varient de]1 - ? 5[%
;
- Les espèces moyennement fréquentes dont les taux
sont compris entre]5 - 10[%
- Les espèces très fréquentes dont le
taux sont compris entre]? 10[% ; sont illustrer dans les tableaux de lecture
ci-dessous.
Tableau 19.Fréquence totale des espèces par classe
de pourcentage
Espèces de
fréquence] ? 10 [% de total
|
Espèces de fréquence moyenne] 5 - 10[% de
total
|
Espèces de
fréquence rare
] 1 - ? 5[% de total
|
Espèces de
fréquence très
rare] 0 = 1[% de total
|
Acacia Albida
|
Anacardium occidentale
|
Combretum migranthum
|
|
Acacia nilotica
|
Balanites aegyptiaca
|
Dalbrgia melanoxylon
|
|
Acacia seyal
|
Grewia mollis juss
|
Diospyros mespiliformis
|
|
Azadirachta indica
|
Hyphaene thebaica
|
Erophaca baetica
|
|
|
115
Cissus
quadrangularis
|
Psidium guajava
|
Feretia
apondanthera delile
|
|
Colophospermum mopane
|
Ziziphus spina-christi
|
Ficus glumosa
|
|
Cobretum glutinosum
|
|
Ficus sycomorus
|
|
Eucalyptucus globulus
|
|
Grewia villosa
|
|
Faidherbia albida
|
|
Gymnosporia senegalensis
|
|
Mangifera indica
|
|
Moringa aleifera
|
|
Sclerocarya birrea
|
|
Ozora insignis
|
|
Tamarindus indica
|
|
|
|
Ziziphus mauritiana
|
|
|
|
|
Source : Relevés
botaniques, juillet 2021
L'analyse de la fréquence des principales
espèces en fonction des classes de pourcentage permet de faire ressortir
la classe des espèces ligneuses afin de de faire ressortir le niveau de
rareté des ligneux pérennes. On retrouve ainsi 13 espèces
de forte fréquence. Il s'agit Acacia Albida, Acacia nilotica, Acacia
seyal, Azadirachta indica, Cissus quadrangularis, Colophospermum mopane,
Cobretum glutinosum, Eucalyptucus globulus, Faidherbia albida, Mangifera
indica, Sclerocarya birrea, Tamarindus indica, Ziziphus mauritiana. En
outre, 6 espèces ont sont considérées ayant une
fréquence moyenne. Il s'agit ainsi Anacardium occidentale, Balanites
aegyptiaca, Grewia mollis juss, Hyphaene thebaica, Psidium guajava, Ziziphus
spina-christi. Par ailleurs, 11 espèces ont une fréquence
rare. Il s'agit de Combretum migranthum, Dalbrgia melanoxylon, Diospyros
mespiliformis, Erophaca baetica, Feretia apondanthera delile, Ficus glumosa,
Ficus sycomorus, Gymnosporia senegalensis, Moringa aleifera, Ozora
insignis.
L'analyse de la fréquence des ligneux pérennes
permet de montrer un état de raréfaction des ligneux dans la
localité de Houdouvou, car sur 30 espèces, seulement 13 sont
considérées comme fréquentes et 11 comme rares.
116
3.1.2. Forte variation du niveau des
températures
La dégradation des ligneux pérennes conduits
à de forte variation de température. Les données de
températures du département du Diamaré nous permettent
d'avoir par extrapolation les variations thermiques de la localité de
Houdouvou. L'analyse de variabilité thermique va se faire de 2001
à 2010 et de 2010 à 2017. La figure 37 montre les tendances des
températures de 2001 à 2010.
? Niveau de température de 2001 à 2010.
La figure 39 illustre les variations de températures
de 2001 à 2010 en fonction des températures annuelle, des
températures minimum et maximum.

Source : station Maroua- Salack, avril 2021
Figure 39. Variation des températures de 2001 à
2010
La comparaison des températures de 2001 à 2010
montre de forte instabilité des maximums et des minimums de
température. On observe ainsi une hausse des températures de 2001
à 2010. L'année 2001 a connu un maximum de 34.9 et celle de 2010,
35.7 tandis que le minimum de 2001 n'est que de 29,3, celui de 2010 est de
29,9. Les années 2001 et 2002 n'ont pas connu de forte variations car il
y pas eu beaucoup d'écart entre les températures minimales,
annuelles et maximales alors que les années de 2003 à 2010 ont
connu de forte variation de froid et de chaud. Les années 2011 et 2017
ont aussi connues de légère variation thermique. (Figure 40)
37,2
35,6 34,7 36,1 35,7 35,3 34,8
29,2 30,6
28,7 28,2 28,2 28,5 28,7
22,9 22,9 23,9
21 21,6 22,7
22
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Années
T° M maxi T°Mmuni T°M
annuelle
température °C
117
Source : station Maroua- Salack, avril 2021
Figure 40. Variation des températures de 2011 à
2017
La figure ci-dessus représente les données
thermiques des années de la période 2011-2017. On remarque dans
l'ensemble que les conditions de température sont moyennement
équitables. Cependant, la température moyenne maximale est
légèrement dépassée les 37,2°c. Il s'agit
notamment de l'année 2013.Tout comme la température moyenne
minimale, on constate la même remarque dans l'ensemble une faible
variation des températures sauf l'année 2016 qui a connu une
légère hausse qui avec 23,9°c. Tandis que la
température moyenne annuelle, les données thermiques de la
période 2011, 2012et 2016, la tendance dépasse 20°c. On
remarque ainsi une petite stabilité des températures à
partir de 2011.
Les activités humaines telles que l'utilisation de
combustibles fossiles, l'exploitation des forêts et l'élevage du
bétail exercent une influence croissante sur le climat et la
température de la terre. Le sol libère beaucoup de carbone ancien
dans les zones où de nombreux arbres ont été abattus. La
déforestation a un double effet négatif sur le changement.
Premièrement, parce que l'arbre qui a converti le CO2 en oxygène
a disparu. Deuxièmement, parce que le sol perd du carbone
séculaire lorsque l'utilisation des sols passe de la forêt
à l'agriculture.
En effet, les arbres pérennes contribuent grandement
à réguler le climat en absorbant le dioxyde de carbone (CO2) de
l'atmosphère. Lorsqu'ils sont abattus, cet effet positif est perdu et le
carbone stocké dans les arbres est libéré dans
l'atmosphère, aggravant l'effet de serre.
118
3.1.3. Extension des zones
dégradées
La deuxième conséquence qui découle de la
dégradation des ligneux pérennes est
l'extension des zones dégradées. En effet, la
forte exploitation des bois cause la multiplication des zones sans ligneux.
Cette absence de ligneux a pour effet direct l'accélération du
phénomène d'érosion dans la localité de
Houdouvou.
? Vaste superficie sans grands ligneux
La dégradation de la ligneuse pérenne laisse de
vastes superficies sans arbres comme le montre la photo suivante.
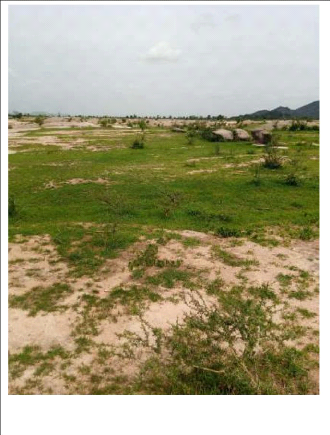
Long: 10°38'24»N Lat: 14°10'12»E Al:
530m
Source : Djafnga, 2021
Photo 6. Vaste espace dégradé
119
La photo ci-dessus montre une vaste étendue d'une
zone dégradée. On remarque sur cette image beaucoup d'hectare
sans une forte végétation ligneuse à part quelque arbuste
de moins de 1 mètre de hauteur. En effet, cette zone était
apurant rempli d'arbres. La forte demande en bois du centre urbain a conduit
à une exploitation anarchique et incontrôlé des ligneux. Le
résultat direct est la disparition des grands arbres et
l'impossibilité des jeunes plants de gagner en hauteur.
La disparition des ligneux dans cette zone à cause la
perte de la couverture pédologique est favorisée l'installation
d'une forte érosion. (Planche photographique 7).
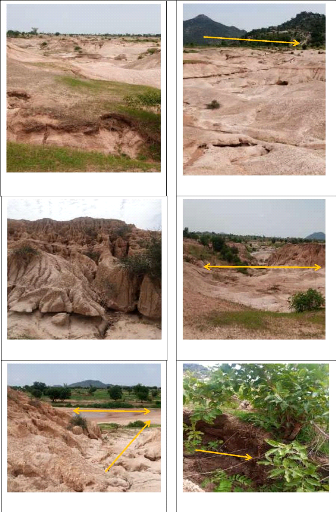
Long: 10°38'52»N Lat: 14°10'52»E Al:
500m
Photo A. Vaste étendue
érodée
Long: 10°38'32»N Lat: 14°10'22»E Al:
501m
Photo C. Modelé de l'érosion
Long: 10°38'22»N Lat: 14°10'63»E Al:
500m
Photo E. Sens d'écoulement des eaux
Long: 10°38'45»N Lat: 14°10'22»E Al:
503m
Photo B. Source de provenance des eaux
Long: 10°38'20»N Lat: 14°10'62»E Al:
511m
Photo D. Elargissement du lit du cours d'eau
Long: 10°38'36»N Lat: 14°10'42»E Al:
508m
Photo F. Processus de destruction d (un
ligneux
120
Source : Djafnga, juillet
2021
Planche photographique 7. Vaste surface érodé
121
La planche ci-dessus montre le système
érosif qui s'est mis en place dans la zone dégradée. La
disparition de la végétation a permis le drainage d'une masse
importante de sol et par ricochet, les sols se voient vidé de leurs
couches arables. Ainsi, la photo A montre le niveau d'étendu de la
végétation, la photo B montre le lieu de provenance des eaux car
les eaux qui érodent ces terres proviennent de la chaine de montage. La
photo C montre ainsi les formes de modelés issues de l'érosion.
La vitesse de destruction du sol a ainsi élargi les champs
d'écoulement de l'eau (Photo D). Le sens d'écoulement de l'eau
est venu rejoindre le mayo (Photo E). Le niveau d'évolution de
l'érosion affecte les petits arbustes de la zone dégradée
(Photo F).
L'érosion hydrique consiste en un enlèvement
des particules du sol, qui sont transportées plus loin en aval. Il
s'agit d'une forme de dégradation des sols, qui varie dans le temps et
dans l'espace. Cet ensemble de processus provient de l'interaction de facteurs
actifs, en particulier l'agressivité climatique passive, notamment la
texture du sol, la couverture végétale, la valeur de pente.
Dans la localité de Houdouvou, les cours d'eau qui
traversent cette zone sont à l'origine des mouvements de masse
observés pendant la saison de pluie. Conséquences, des particules
de terre sont régulièrement arrachées entrainant dans leur
chute des espèces végétales (Planche photographique 7).
3.2. Les effets sur les activités
humaines
La dégradation des ligneux pérennes à
beaucoup des effets sur les hommes et leurs activités. Ces
conséquences vont de la baisse de la production agricole à la
raréfaction des bois de chauffe et des bois d'oeuvre en passant la
raréfaction du pâturage et la raréfaction des surfaces
fertiles. Des enquêtes ont été mené pour avoir
l'avis des populations sur les effets de la dégradation des ligneux
pérennes (figure 41)
100
90
80
Nombre de personnes
70
60
50
40
30
20
10
0
Oui Non
Effes de la dégradation
122
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 41. Effets de la dégradation
Les enquêtes de terrains nous ont permis d'avoir les
avis des populations sur les conséquences de la dégradation des
ligneux pérennes dans la localité de Houdouvou. Ainsi, sur 120
personnes enquêtés, 87 pensent que la dégradation des
ligneux pérennes à des effets sur les activités des
hommes. Ces effets ont été classés en fonction de leur
degré d'importance comme la montre la figure 42.
Sans
importance
|
Peu important Assez important Très important Niveau des
effets
|
|

Nombre de personnes
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 42. Niveau des effets
Les conséquences socio-économiques de la
dégradation des ligneux pérennes dans la localité de
Houdouvou sont très importantes. La figure ci-dessus illustre le
123
niveau de ces effets. On observe ainsi que le niveau des
effets est très importants. Sur 120 personnes enquêtés, 69
pensent que la dégradation des ligneux pérenne à des
effets très important, 36 pensent que ces effets sont peu important, 33
pensent que ces effets sont assez importants et seulement 12 pensent que c'est
sans importance. Les effets de la dégradation de ces ressources
s'observent au niveau de la diminution de la production agricole.
3.2.1. Baisse accru des produits agricoles et extension
des zones de cultures
Les enquêtes avec les riverains ont permis de faire
ressortir les cultures dont la
production a baissé et augmenté dans la
localité. (Figure 43)
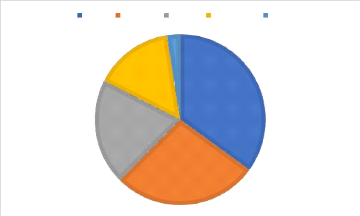
Coton Arachide Sorgho Maraichers Maïs
20%
15%
3%
27%
35%
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 43. Variation de la production agricole
La dégradation des ligneux pérennes a pour
conséquence la dégradation de la qualité du sol et par
ricochet la baisse de la production des cultures. Les enquêtes ont
été menées pour voir les cultures dont la production est
encore bonne. Ainsi, la culture dont la production n'a pas beaucoup
baissé est la culture de coton avec 35%/ Elle est suivie de la culture
des arachides avec 27%, de la culture du sorgho (20%), des cultures
maraichères (15%) et enfin de la culture du maïs (3%).
En effet, la dégradation des ligneux pérennes
à des impacts considérables sur la nature et la qualité du
sol. Les pertes de sol des terres agricoles peuvent avoir de graves
répercussions sur l'environnement en plus de réduire la
productivité des sols. La baisse
124
de productivité d'un sol attribuable à
l'érosion peut être importante. Cela peut découler tout
simplement de l'amincissement de la couche de sol sur la roche, ce qui
réduit le volume disponible pour les racines des végétaux.
Il est plus courant que les rendements culturaux soient réduits par la
perte d'éléments nutritifs des végétaux et que les
propriétés physiques du sol soient dégradées.
(Photo 7)

Long: 10°38'27»N Lat: 14°10'19»E Al:
600m
Source : Djafnga, juillet
2021
Photo 7. Mauvaise production agricole
La photo ci-dessus montre une mauvaise production
d'arachide sur un sol qui a perdu sa fertilité. Les enquêtes
menées auprès du propriétaire du champ font relever que la
production sur cette parcelle à baisser de près de la
moitié par rapport aux années antérieures.
Plusieurs changements ont été observés
dans la localité. Il s'agit notamment de l'extension des zones de
cultures, de la dégradation des ressources ligneuses, de la
raréfaction des surfaces fertiles (photo 7), de la diminution des
ligneux les plus utilisés et la multiplication des espaces
dégradées (Tableau 20).
125
Tableau 20. Changements observés
Changements observés
|
Effectifs
|
Pourcentage
|
Pourcentage valide
|
Pourcentage cumulé
|
Etalement des zones de cultures
|
45
|
37,5
|
37,5
|
37,5
|
Dégradation des ressources ligneuses
|
30
|
25,0
|
25,0
|
62,5
|
Raréfaction des surfaces fertiles
|
21
|
17,5
|
17,5
|
80,0
|
Diminution des ligneux les plus utilisé
|
9
|
7,5
|
7,5
|
87,5
|
Multiplication des espaces dégradés
|
15
|
12,5
|
12,5
|
100,0
|
Total
|
120
|
100,0
|
100,0
|
|
|
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Les principaux changements observés sont
reportés dans le tableau 17. Le changement le plus flagrant est
l'étalement des zones de cultures avec 37,5% et la dégradation
des ressources ligneuses avec 25%. Le troisième changement est la
raréfaction des surfaces fertiles avec 17,5%, la multiplication des
espaces dégradées avec 12,5 % et enfin la diminution des ligneux
les plus utilisés avec 7,5%.
Un ancien de la localité affirme que « pour
trouver du bois pour la cuisson des aliments, il faut s'enfoncé plus en
brousse et allé sur les montagnes car les arbres sont de plus en plus
rares dans le village. Les espaces de cultures ont augmenté avec la
forte croissance de la population »
Les surfaces de cultures augmentent de manière
grandissante du fait de la raréfaction des terres fertiles et la forte
demande de la population en produit agricole. Ces conséquences
proviennent lorsqu'il y a dégradation des ressources pérennes. En
effet, la terre végétale, qui est la couche du sol la plus
fertile, est la plus vulnérable à l'érosion et c'est elle
qui disparaît en premier lorsqu'il y pas des arbres pour les
protéger. Par ailleurs, les mécanismes d'érosion
éliminent de préférence la matière organique du
sol, l'argile et les substances limoneuses fines. L'association de perte de
terre végétale et de fractions plus fines du sol peut avoir de
graves conséquences sur les rendements culturaux. Dans la plupart des
cas, l'épandage supplémentaire d'engrais peut neutraliser les
conséquences de l'érosion sur la fertilité du sol, mais
cela représente une dépense supplémentaire pour
l'agriculteur. La planche photographique suivante montre dans
126
qu'elle mesure les zones de cultures ont augmenté dans la
localité au détriment des ligneux pérennes.

Long : 10°38'16»E Lat :14°10'44»E Al
: 650m
Photo B. Champs à perte de vue
Long: 10°38'32»N Lat: 14°10'22»E Al:
501m
Photo A. Multiplication des zones de
cultures
B
Long : 10°38'18»E Lat :14°10'32»E Al
: 620m
Photo C. Faible densité des ligneux dans la zone
de culture.
A
C
Source : Djafnga, juillet
2021
Planche photographique 8. Extension des surfaces de
cultures
127
La planche ci-dessus montre l'étalement des zones
de cultures dans la localité de Houdouvou au détriment des
ligneux pérennes. En effet, la photo A montre une multiplication des
zones de cultures allant des zones d'habitations jusqu'aux berges de la
rivière. La photo B montre des hectares de champs à perte de vue
et la photo C quant à elle montre des zones de cultures avec peu de
ligneux pérennes. Les baisses de production agricoles dû aux
baisses de la fertilité des sols provoqué par la
raréfaction des ligneux pérennes engendrent l'extension des zones
de cultures pour compenser le manque à gagner en production
agricole.
3.2.2. Raréfaction des bois d'oeuvres, bois de
chauffe et pharmacopées
La surexploitation des produits ligneux pérennes
à comme conséquences directe la raréfaction des
espèces utilisées dans la construction des habitats et dans la
cuisson des aliments. Dans les systèmes énergétiques
ruraux, le bois joue le rôle de combustible dans la satisfaction de
besoins énergétiques aussi essentiels que la cuisson des aliments
et le chauffage. Sa raréfaction se traduit pour des populations
très nombreuses par des difficultés accrues de subsistance et par
la rupture de leur système énergétique. Pour pallier
à ces manquements, les populations utilisent souvent les produits
ligneux non pérennes comme le montre la photo suivante.

Long: 10°38'27»E Lat: 14°10'23»N Al:
610m
Source : Djafnga, juillet
2021
Photo 8. Ressource de combustion alternative
128
La photo ci-dessus illustre des sources de production
alternative aux ligneux pérennes. On observe sur cette photo un fagot de
tige de coton dans le domicile d'un paysan de Houdouvou. La raréfaction
des ligneux pérennes conduits les populations,
généralement les femmes à recueillir les tiges de coton ou
de mil pour faire cuire les aliments. Cette photo montre une conséquence
directe de la dégradation des ligneux pérennes.
Le chef du village fait remarqué que « les
populations sont obligées de collecter les tiges de coton, de mil et
même les épis de maïs égrainé pour faire de la
cuisine parce qu'il y plus d'arbre dans le village ». En effet, la
biomasse dans sa forme solide traditionnelle (bois de feu et déchets
agricoles) représente une portion considérable et souvent
insuffisamment reconnue de l'approvisionnement énergétique total.
Le bois de feu seul couvre la majorité de la consommation
énergétique totale.
Les enquêtes de terrain ont montré que la
principale source de bois de chauffe est le ramassage de bois mort avec 37, 5
%. La coupe de bois vivante vient en second position (Tableau 10). Les
conséquences de la dégradation des ligneux pérennes ne
s'observent pas qu'au niveau de la raréfaction des bois de chauffes et
des bois d'oeuvres, elles s'observent aussi au niveau de la raréfaction
des ligneux utilisés dans le soin des habitants.
La contribution du bois de feu en tant que source
d'énergie ne se limite pas aux systèmes
énergétiques ruraux ou aux secteurs de subsistance. En effet, la
demande urbaine (Maroua) représente une part croissante de la
consommation de bois de feu tant du fait des migrations de ruraux qui
conservent un mode de vie de type rural que de la dépendance des
familles plus pauvres qui continuent à recourir au bois pour leurs
besoins domestiques.
Les entretiens avec les gardiens de la zone de reboisement
ont permis de savoir que plusieurs espèces étaient auparavant
utilisées pour soigner les individus ont disparu et deviennent de plus
en plus rare, ce qui complique lorsque qu'il faut soigner des personnes. Ainsi,
les effets de la dégradation s'observent au plan social avec la
raréfaction des bois d'oeuvre et de chauffe et au plan sanitaire avec la
raréfaction des
129
ligneux utilisés dans la pharmacopée. Ces
conséquences sont aussi observables sur le plan économique avec
la raréfaction du pâturage.
3.2.3. Raréfaction du pâturage
La raréfaction du pâturage est aussi une
conséquence de la dégradation des ligneux
pérennes. En effet, la raréfaction du
pâturage est causée par le surpâturage. Le surpâturage
peut être défini comme une action du cheptel modifiant les
potentialités d'une terre de parcours. La première manifestation
est la modification de la composition floristique. Les espèces
appétées, trop sollicitées, disparaissent au profit
d'espèces non appétées qui ont eu la possibilité de
se multiplier. Cette disparition peut être due à
l'épuisement du système racinaire. Les enquêtes
menées auprès des populations pour déterminer les
activités économiques les plus pratiquées place
l'élevage parmi les derniers des activités. (Figure 44)
80
70
Nombre des individus
60
50
40
30
20
10
0
Agriculture Elevage Commerce Vente de bois
et
charbons
Activités
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 44. Activités les plus pratiquées
La figure ci-dessus montre les activités
économiques les plus pratiquées dans la localité. La
première activité est dont l'agriculture (62,5%), la
deuxième est le commerce (16,6%), la troisième est la vente du
charbon avec 12,5 % et la dernière activité est l'élevage
avec 8,3%. On remarque ainsi que l'élevage vient en dernière
position avec seulement 8,3%. Cette faible proportion s'explique par le fait
que le
130
pâturage est de plus en plus rare dans la
localité, ce qui pousse les populations à se tourner plus vers
l'agriculture et le commerce.
L'autre manifestation du surpâturage est plus connue,
avec l'apparition des phénomènes d'érosion (planche
photographique 7), parfois spectaculaires qu'il entraîne. La
raréfaction du tapis herbacé, voire sa disparition, et le
piétinement favorisent l'érosion hydrique. Cette action est
particulièrement sensible en zone de relief, comme le montre la photo B
qui se trouve dans la zone dégradée et à forte
érosion hydrique. La planche photographique 9 montre de vastes zones
dégradées et des animaux à la recherche du
pâturage.

Photo A. Espèces appétées dans la
zone dégradée
Long: 10°38'20»N Lat: 14°10'62»E Al:
501m
A
Long: 10°38'22»N Lat: 14°10'66»E Al:
611m
Photo B. Troupeaux à la recherche du
pâturage dans la zone dégradée
B
Source : Djafnga, juillet
2021
Planche photographique 9. Animaux à la recherche du
pâturage
La planche photographique ci-dessus illustre le manque
criard du pâturage pour la nutrition du bétail. Ainsi, la photo A
montre une zone dégradée où il ne reste plus que les
espèces appétées et la photo B montre des moutons à
la recherche du pâturage
131
dans la zone dégradée. La dégradation
des ligneux pérennes entraine le phénomène
d'érosion (photo B) et par ricochet la disparition des couches arables
sur laquelle se développent les herbes indispensables à la
nutrition des animaux.
Conclusion
La désertification, aboutissement final d'un processus
dans lequel interviennent une trop forte pression démographique, la
destruction des zones écologiquement fragiles, la dégradation par
le surpâturage, la surexploitation et le déboisement. La
dégradation des ligneux pérennes a donc des conséquences
environnementales comme la raréfaction du nombre des ligneux,
l'extension des zones dégradées et l'accentuation du
phénomène d'érosion. Au niveau anthropique, les
conséquences s'observent au niveau de la baisse de la
productivité agricole, au niveau de la raréfaction des ligneux
utilisés dans la cuisson des aliments, au niveau du bois disponible pour
la construction des habitats et la pharmacopée. De plus, la
raréfaction du pâturage affecte grandement les éleveurs de
bétail. Cependant, des solutions sont mise en place par les populations
locale, l'Etat et les institutions pour résoudre le problème de
raréfaction des ligneux pérennes.
132
Chapitre 4. Stratégies de gestions, de
pérennisations et perspectives
Introduction
La dégradation spatio-temporelle des ligneux
pérennes à des effets considérables sur l'environnement et
les activités humaines. Face à cette situation, la recherche des
moyens de pérennisation est la condition sine qua none pour amortir les
effets de la dégradation de cette ressource indispensable à la
survie des hommes en générale et des habitants de la
localité de Houdouvou en particulier. Pour ce faire, des
stratégies ont été développé localement par
les populations riveraines dans l'optique de freiner la raréfaction des
ligneux pérennes. Aussi, les institutions étatique et
privée interviennent dans la promotion et la protection des ligneux
pérennes. Ce chapitre se propose ainsi de de mettre en relief les
différentes stratégies existantes dans la localité, de les
évaluer et de proposer des moyens pour une meilleure gestion des ligneux
pérennes.
4.1. Gestion locale et paysanne des ligneux
pérennes
Plusieurs moyens sont développés par les
populations locale dans le sens de la protection, de la promotion et de la
préservation des ligneux pérennes. La mise en place de ces moyens
passe par une prise de conscience. Ainsi, le principal moyen est la mise en sol
des plants.
4.1.1. Plantation des arbres
Le principal moyen utilisé par les populations de
localité de Houdouvou pour assurer une utilisation durable des ligneux
pérennes consiste à planter de nouveaux plants. Les
enquêtes de terrain ont été menées pour voir la
proportion des personnes qui ont au moins une fois planté un arbre
depuis qu'elles sont dans la localité. Les résultats de cette
enquête sont représentés dans la figure suivante.

Nombre des individus
40
80
70
60
50
30
20
10
0
Oui Non
Personnes ayant une fois planté un
arbre
133
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 45. Etat des personnes ayant une fois planté un
arbre
La figure ci-dessus montre le nombre des personnes ayant une
fois mis sur terre une plante dans la localité de Houdouvou. Les
enquêtes de terrain ont permis de monter qu'une bonne proportion de
personnes ont déjà planté des arbres. Ainsi, sur 120
personnes enquêtés, 75 ont déjà planté des
arbres et 45 ne l'ont pas encore fait. Ces arbres sont plantés dans les
lieux d'habitations, en bordure de routes, dans les écoles, dans les
champs et dans les zones de reboisements. La photo suivante montre une plante
qui a été mis en sol par les riverains.
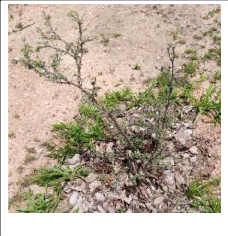
Long: 10°38'21»N Lat: 14°10'13»E Al:
420.2m
Source : Djafnga, 2021
Photo 9. Jeune plant d'Acacia raddiana planté.
134
Cette photo montre une plante d'acacia raddiana
planté dans la localité par les populations riveraines. On
observe ainsi que des moyens sont mis en place pour compenser le déficit
des ligneux pérennes.
En dehors des jeunes plants plantés, d'autres moyens
sont mis en place par les populations pour assurer la protection des ligneux
pérennes.
4.1.2. Mesure de pérennisation
Les enquêtes de terrain ont permis de mettre en relief
quatre principales mesure mise en place par les individus pour assurer la
durabilité des ligneux pérennes. Ces mesures vont de l'entretien
des arbres, de la limitation des zones de cultures à la plantation des
arbres et à la limitation des coupes. La figure 46 représente ces
principales mesures.
Mesure de pérennisation
|
Entretenir les arbres Limiter les zones de cultures Planter les
arbres Limiter les coupes
|
|
|
|
|
0 10 20 30 40 50
Infividus
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 46. Mesures de pérennisation
La principale mesure utilisée par la population
consiste en la limitation de la coupe des arbres pérennes. La
deuxième mesure consiste à planter les arbres, la
troisième à entretenir ces arbres et la quatrième consiste
à limiter les zones de cultures. Ainsi, sur 120 personnes
enquêtés, 45 personnes limitent les coupes d'arbres, 39 optent
pour planter les arbres, 25 personnes pour l'entretient des arbres et seulement
9 personnes pour la limitation des zones de cultures.
135
4.2. Gestion étatique et institutionnelle des
ligneux pérennes.
La gestion des ligneux pérennes dans la
localité de Houdouvou est assurée par l'Etat à travers ses
démembrements et par des institutions.
4.2.1. Gestion étatique des ligneux
pérennes
La gestion étatique des ligneux pérennes dans
la localité de Houdouvou passe par la sensibilisation et le
contrôle des ligneux pérennes, par l'existence des moyens
d'accès aux ligneux, par l'existence et le renforcement des
législations forestière et par l'augmentation des zones de
reboisement.
? Existence des restrictions judiciaires
Au niveau départemental du Ministère des
forêts et de la faune, la stratégie de pérennisation
adoptée est principalement centrée sur le contrôle et la
régulation des ressources ligneuses. Des lois sont mise en place dans ce
sens. Des enquêtes de terrains ont été menées pour
évaluer le niveau de connaissance de ces restrictions par les
populations riveraines. La figure montre la proportion des personnes ayant
conscience de l'existence des mesures pénale.

Non
15%
85%
Oui
Oui Non
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 47. Connaissance de loi sur les ligneux
La figure ci-dessus montre la proportion des riverains qui
savent que des lois existent dans le cadre de la protection des ligneux. Ainsi,
les personnes qui savent que ces lois existent représentent 85% tandis
que les personnes qui ignorent l'existence de
136
ces lois représentent 15%. Ce graphique montre ainsi
qu'une bonne majorité de la population sait qu'elle n'a pas le droit de
couper les arbres comme elles veulent. Les entretiens menés avec les
autorités des eaux et forêts ont permis de faire ressortir les
moyens utilisé dans la préservation des ligneux pérennes.
(Encadré 3)
Encadré 3. Moyens de gestion des eaux et forêts
Les populations n'ont pas le droit de couper abusivement les
ligneux. Elles peuvent élaguer les arbres, mais pas de manière
abusive. Elles doivent être assistées de professionnel pour ne pas
modifier le champ de gravité de l'arbre. Il y a aussi des
périodes bien déterminé pour élaguer les arbres.
C'est en saison sèche qu'on élague. S'ils sont
élagués en saison pluvieuse, ces arbres ont une grande
probabilité de mourir dans quatre ou cinq ans. Il est autorisé de
couper les arbres mais, il faut au préalable se procuré des
documents. Il faut un but précis, soit pour faire un champ ou pour
bâtir une maison. Concernant les champs, sauf les tiges d'avenir sont
autorisés à être coupé.
Agent 1
Pour couper un arbre, il faut se procuré des
documents. Cependant, il faut planter un autre arbre à la place et le
suivre. Il n'est pas question de planter un arbre et de la laisser sans
surveillance. Les agents passent chaque fois pour s'assurer de la suivie et de
l'évolution de l'arbre. Si on trouve une personne en train
d'élagué un arbre frais sans autorisation, on la pénalise
directement. Pour avoir une autorisation, il faut bien spécifier l'usage
qu'on veut faire de cet arbre avant d'avoir une autorisation.
Agent 2
L'encadré ci-dessus montre les différents moyens
utilisés par les agents des eaux et forêts pour la gestion des
ligneux pérennes. Ces agents sont situés dans des points
stratégiques du secteur. L'agent N°1 est situé à la
limite entre la ville de Maroua et le canton de Kalliao. L'agent 2 est
situé à la sortie de Houdouvou. Ces agents interviennent dans les
contrôles à l'entrée (photo 10) et à la sortie des
points stratégiques du canton.

Long: 14° 13'40» Lat: 10°35'50» Al:
4432, 3 m
137
Source : Djafnga, 2021
Photo 10. Agent de contrôle
La ci-dessus montre un agent des eaux et forêts en
exercice de ces fonctions à la sortie du canton de Kalliao. Il
contrôle ainsi les quantités de bois qui sortent de la
localité. Houdouvou étant un lieu par excellence
d'approvisionnement de la ville de Maroua en bois, ces agents sont
chargés de réguler le degré d'exploitation des ligneux
pérennes.
Par ailleurs, des enquêtes ont été
menées auprès des populations pour voir les principaux moyens
d'accès aux ressources ligneuses. Il faut ainsi avoir des autorisations
de la commune ou des autorités des eaux et forêts. La figure 48
représente les principaux moyens d'accès aux ligneux
pérennes.
60
Autorisation de la Autorisation des eaux et Sans
autorisation
commune forêts
138
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 48. Moyen d'accès aux ligneux
Les enquêtes de terrains ont permis de faire ressortir
les principaux moyens d'accès aux ligneux pérennes. Sur 120
personnes enquêtés, 51 personnes accèdent aux ligneux sans
autorisations, 48 personnes se procurent des autorisations des autorités
des eaux et forêts et 21 personnes se dirigent vers la commune. On
remarque ainsi que la majorité des personnes cherchent des autorisations
avant d'avoir accès aux ligneux pérennes.
? Extension des zones de reboisement
Des moyens ont été mis en place pour
créer et étendre les zones de reboisements dans la
localité. Les agents de l'environnement ont mis en place la zone de
reboisement à travers le projet sahel vert depuis 2013. Ainsi, le
premier site de reboisement à vue le jour en 2013, le deuxième
site en 2014. Au total 5 sites de 1250 ha ont vu le jour. La zone est
constituée des espèces naturelles et des espèces
plantées (planche photographique 10). Depuis l'ajout de ces nouvelles
espèces, la zone est considérée comme zone de
reboisement.
D'un point de vue opérationnel, le Gouvernement du
Cameroun a pendant les années 1970/80 initié et mis en oeuvre un
vaste programme de reboisement dénommé « Opération
Sahel vert », le but étant de maitriser l'avancée du
désert, de sensibiliser et d'éduquer les populations à des
gestes citoyens de préservation environnementale. Sa mise en oeuvre a
cependant souffert des conséquences de la crise économique
qu'a
139
connue le pays à partir de 1987. Cette opération
a été relancée dans la région de
l'Extrême-Nord en 2008 par le Ministère de l'Environnement et de
la Protection de la Nature (MINEP) à travers des activités de
reboisement financées par le budget d'investissement public de l'Etat du
Cameroun (BIP). Cette relance s'inscrivait dans la mise en application du
PAN/LCD (2006) dans le cadre du respect de l'engagement du Cameroun
vis-à-vis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification.
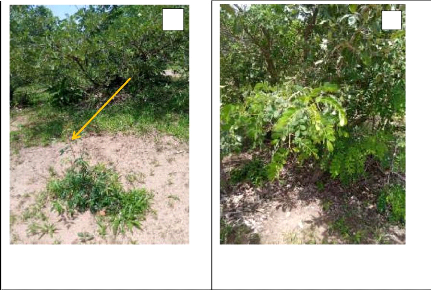
Long: 10°30'11»N Lat: 14°10'10»E
Al: 520.2m Photo A : Espèces pérennes reboisé
A
Long: 10°3031»N Lat: 14°10'23»E Al:
460.6m Photo B : Espèces non plantée dans la zone de
reboisement
B
Source : Djafnga, 2021
Planche photographique 10. Formations végétales
d'alignements
La planche photographique ci-dessus montre les
différents types d'espèces pérennes qui se trouvent dans
la zone de reboisement. On observe sur la photo A une plante (Azadirachta
indica) qui a été planté sous l'initiative du projet
sahel-vert dans la zone de reboisement. La photo B par contre montre une
espèce pérenne qui a poussée de manière naturelle
sans intervention humaine. Cette planche montre ainsi les actions menés
dans l'optique d'assurer une meilleure durée des ligneux
pérennes.
140
En, effet, l'élaboration et la mise en oeuvre des
Projets doivent s'arrimer aux cadres internationaux de validation des
résultats par l'harmonisation des indicateurs pertinents. La
réactualisation du Document de référence du Projet «
Opération Sahel vert » vise donc à prendre en compte les
dynamiques en cours susceptibles d'impacter la mise en oeuvre efficiente des
stratégies opérationnelles de lutte contre la
désertification et la dégradation des sols dans la zone
soudano-sahélienne.
Le rôle croissant de la diversité des acteurs de
la lutte contre la DDTS invite à redéfinir le cadre
réglementaire et juridique de leurs interventions en vue de veiller
à la préservation des intérêts des
communautés bénéficiaires. Le développement de
nouveaux mécanismes et dispositifs internationaux de préservation
environnementale implique à un niveau supérieur, des instances
supra nationales dans les politiques publiques. L'élaboration et la mise
en oeuvre des Projets doivent s'arrimer aux cadres internationaux de validation
des résultats par l'harmonisation des indicateurs pertinents. La
réactualisation du Document de référence du Projet «
Opération Sahel vert » vise donc à prendre en compte les
dynamiques en cours susceptibles d'impacter la mise en oeuvre efficiente des
stratégies opérationnelles de lutte contre la
désertification et la dégradation des sols dans la zone
soudano-sahélienne.
La méthodologie adoptée pour cette
réactualisation s'articule en cinq points:
- une revue documentaire conséquente sur les
différents domaines liés à la dégradation des
terres au Cameroun et aux Projets « Sahel vert » et «
Aménagement du Bassin Versant de la Bénoué » ;
- les entretiens avec les acteurs-clés du processus de
lutte contre la désertification ;
- l'analyse des données
géoréférencées existantes (données SIG,
Cartes, bases de données, etc.) ;
- l'organisation des missions de terrain en vue de confronter
la réalité aux données
géoréférencées existantes pour une orientation
judicieuse des interventions futures de l'Etat et de ses partenaires ;
- l'organisation de deux ateliers de validation du document
réactualisé.
141
A travers le présent document, le Gouvernement de la
République réitère sa ferme volonté d'oeuvrer
durablement à la restauration des terres dans les zones affectées
par la désertification en luttant contre la dégradation des
terres et en contribuant à l'augmentation de la fertilité des
sols. Ce but s'inscrit dans l'objectif global de lutte contre la
pauvreté et dont la vision est définie dans le Document de
Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE).
4.2.2. Gestion institutionnelle des ligneux
pérennes
Des institutions interviennent sur la nécessité
de la protection des ligneux pérennes à travers des campagnes de
sensibilisations et des mesures d'accompagnements.
? Sensibilisation et contrôle des ligneux
pérennes
L'action de sensibilisation de la population est avant toute
chose l'appel à la prise de connaissance à la participation du
reboisement mais surtout à la protection des espèces ligneuses
dans la localité. Les riverains pour le besoin de bois d'énergie,
champs agricole et jardin détruisent les arbres. Pour limiter cette
destruction, les agents de l'état et des ONG interviennent dans la
sensibilisation sur la nécessité de préserver les ligneux
pérennes. Des enquêtes ont été mené pour voir
le niveau des personnes qui ont été une fois sensibilisé
sur la préservation des ligneux. Figure 49.
120
100
80
60
40
20
Npmnre de personnes
0
Oui Non
Sensibilisation
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 49. Personnes sensibilisées
142
La figure ci-dessus montre le nombre personnes qui ont
été sensibilisé par un organe sur l'importance de la
préservation des ligneux pérennes. Ainsi, sur 120 personnes
enquêtées, 96 personnes ont été sensibilisées
et 24 n'ont pas été sensibilisées. Ce graphique montre une
proportion assez importante du niveau de gestion. Ces sensibilisations ont
été faites par des ONG, des GIC, des autorités des eaux et
forêts, des autorités traditionnelles et la commune. Figure 50.

23%
33%
17%
17%
10%
Communes ONG
GIC
Autorité tra
Eaux et forêts
ditionnelle
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 50. Agents de sensibilisation et d'accompagnement
La figure ci-dessus montre les différents agents qui
interviennent dans la sensibilisation dans la localité de Houdouvou. Les
autorités traditionnelles viennent en première position avec 33%,
la commune avec 23%, Les agents des eaux et forêts et les GIC avec 17 %
chacun et enfin les ONG avec 10%. On remarque ainsi que des institutions
interviennent aussi dans la protection des ligneux. Ces agents interviennent
avec des moyens d'accompagnement et de suivis. On y retrouve entre autre la
distribution des plants, le contrôle des ressources ligneuses et la
distribution des foyers améliorés. Figure 51.
90
80
70
60
50
40
30
20
Nombre de personnes
10
0
Distribution de plants Agent de contrôle Distribution de
foyers
améliorés
Mesures d'accompagnements
143
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 51. Mesures d'accompagnements
La figure ci-dessus montre les différentes mesures
mise en place pour assurer la préservation des ligneux pérennes.
La première mesure est la distribution des plants avec 65 %, la
deuxième mesure est le contrôle et le suivie avec 22,5 % et la
troisième mesure est la distribution des foyers améliorés
avec 12,5 %. On remarque ainsi que la principale mesure utilisée est la
distribution des plans.
Une grande majorité de la population à
bénéficier de ces mesures comme le montre la figure 52.
|
|
|
|
Bénéficiaires d'un accompagnement
|
Non
Oui
|
|
|
|
|
0 20 40 60 80 100
Nombre des individus
|
|
|
Source : Enquête de
terrain, juillet 2021
Figure 52. Bénéficiaires d'une mesure
d'accompagnement
144
Les enquêtes de terrains ont permis de montrer que 75,5
% des personnes enquêtées ont bénéficié des
mesures d'accompagnements et seulement 27,5 % des personnes n'ont pas
bénéficié des mesures d'accompagnements.
4.3. Evaluation des stratégies
utilisées
? Apport considérable dans la protection des
ligneux pérennes
La protection, la gestion et la conservation des ligneux
pérennes est la condition sine qua none pour favoriser une vie à
long terme des arbres dans la localité de Houdouvou. C'est dans cette
optique que des stratégies ont été mise en place au niveau
locale, institutionnel et étatique. Le niveau d'applicabilité de
ces mesures est appréciable tant au niveau local qu'au niveau
institutionnel et étatique.
Au niveau locale, il faut relever de prime abord un niveau
important de prise de conscience des populations en ce qui concerne les valeurs
écologiques et socio-économiques des ligneux pérennes car
sur 120 personnes enquêtés, 72,5% des personnes savent que la
dégradation des ligneux pérennes à des effets
néfastes. De plus, une grande proportion des riverains intervient dans
la plantation des ligneux pérennes dans la localité. De plus, la
majorité d'elles se procurent une autorisation (40%) avant d'avoir
accès aux ressources pérennes.
Au niveau institutionnel, on note une implication au travers
des projets de sensibilisation, de gestion, de suivi et de distribution des
plants. Ainsi, on note la présence des Organisations Non Gouvernementale
(ONG) et des Groupements d'Initiative Commune (GIC) qui oeuvrent de
manière considérable car sur 120 personnes
enquêtées, 80% ont déjà été
sensibilisées dans la protection des ligneux.
Au niveau étatique, la gestion des ligneux est plus
poussée car on relève une réelle implication des agents de
contrôles des eaux et forêts, des gardiens de la zone de
reboisement, des autorités traditionnelles, de la commune et du projet
de reboisement sahel vert. En effets, les agents des eaux et forêts sont
présents dans le village, dans les lieux d'exploitations abusive des
ligneux et dans les principales entrées de la localité
malgré les réticences rencontrées sur le terrain. Les
autorités traditionnelles jouent un rôle considérable dans
la sensibilisation et l'octroi des autorisations pour couper un
145
arbre. Elles sont souvent les auxiliaires entre les
autorités institutionnelles et les riverains. Les gardiens de la
réserve sont quant à eux les boucliers qui permettent aux ligneux
de la zone de reboisement de ne pas sombrer drastiquement dans la
dégradation car malgré les retards de paie, ils continuent de
garder la zone. Avec 1250 hectares de zones reboisées, le projet Sahel
vert à permit de maintenir une bonne diversité et densité
floristique dans la localité.
? Limite des stratégies
utilisées
L'Arbre en tant qu'être vivant à un rôle
écologique indéniable, mais dès lors qu'il se situe au
coeur d'un milieu à forte extension urbaine et démographique,
cela peut également lui conférer de multiples fonctions
socio-économiques. Dans le contexte de paupérisation accrue des
riverains de la localité de Houdouvou, l'adoption de ce principe est
encore incertaine, d'où la vulnérabilité permanente des
essences pérennes face aux multiples conséquences d'une gestion
peu étudiée.
Mis à part la nécessité d'avoir recours
à des méthodes d'intervention mieux conçues et plus
appropriées, on voit aussi que les incitations à planter faites
par les pouvoirs publics présentent un caractère trop ponctuel
sans se projeter dans un contexte de durabilité, ce qui les rend souvent
inefficaces. En effet, il faut relever un délaissement dans la
protection des ligneux pérennes dans la zone de reboisement dans la
mesures ou les gardiens ne reçoivent pratiquement plus ce qui est
fixé dans le cahier de charge du projet. La recherche permanente du
profit individuel prime sur le bien être individuel et la
conséquence directe est la dégradation des ligneux. De
même, l'amour de l'argent pousse les autorités de contrôles
des ligneux à délivrer des permis d'exploitation d'une semaine
pour une maudite somme de 200f et d'un mois pour une somme de 500F. A cette
allure, le phénomène de déforestation risquerait de se
pointer bien tôt.
Malgré l'implication considérable des riverains
dans la gestion des ligneux pérennes, on note une bonne part qui coupe
encore les arbres de manière irrégulière car 42, 7% de la
population accède sans autorisation aux ligneux.
Néanmoins, une véritable durabilité des
arbres pérennes requiert avant tout l'implication de la population
elle-même. Une interrelation doit s'établir entre ces deux
146
entités de telle sorte que les apports issus des
essences soient effectifs pour les habitants qui, parallèlement,
pourront alors être disposés à en devenir les principaux
gestionnaires.
Ainsi, c'est en favorisant le développement d'un
sentiment d'appropriation chez les citadins que les arbres pérennes
pourront vivre plus longtemps dans la localité, et en même temps,
il reste indispensable de promouvoir des actions sur le long terme,
basées sur la mise en relation des trois volets de développement
durable pour faire valoir le statut du patrimoine arboré pérenne.
Des lois doivent ainsi être renforcées, des stratégies
revues, améliorer et préconiser pour une meilleure
pérennisation des ligneux.
4.4. Renforcement de la législation
forestière et perspectives
Les textes de lois en matière des ressources sont un
maillon important dans la protection des ligneux pérennes. D'autres
mesures doivent y être ajoutés afin d'assurer une meilleure
gestion des ligneux pérennes
4.4.1. Renforcement de la législation
forestière
Les politiques de gestion concourent à
l'amélioration des conditions d'utilisations des ressources
forestières ligneuses. Elles s'appuient sur les réalités
socioculturelles, technoscientifiques et économiques. Le recul et la
disparition de même que la dégradation du massif ligneux est due
à l'absence d'une bonne gestion, le non-respect et application
sécuritaire, le faible appui institutionnel, la non budgétisation
(financement) et matériels, les actions anthropiques perpétuent
la dégradation de la ressource pérenne et constituent un obstacle
pour la gestion et conservation durable du couvert ligneux. Pour ce fait, il
nécessite une politique règlementaire juridique et un appui
institutionnel afin que les ligneux pérennes soient
protégée et conservée.
o Au Cameroun, c'est la Loi n°96/12 du 05 août
1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement qui la
réglemente. Dans son article 4, paragraphe d, elle donne une
définition du développement durable comme étant « le
mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de
développement des générations présentes sans
compromettre les capacités des générations futures
à répondre aux leurs ».
o La loi forestière de 1994 ne parle, quant à
elle, que de protection des forêts, charge qui incombe à
l'État. C'est d'ailleurs cette gestion centralisée des
147
ressources qui pose problème, car elle n'intègre
pas toutes les parties prenantes. Avec l'avancée remarquable du
processus REDD+ au Cameroun dans les années 2012 et 2013 et le souci
d'engager la société civile et les populations locales dans la
gestion durable des forêts, le Cameroun et bien d'autres pays de la
sous-région se sont engagés dans les processus de réforme
des lois. Cette dernière vise à améliorer le cadre
réglementaire pour une gestion durable des ressources. Le pays a donc
engagé depuis peu le processus de révision de sa loi
forestière datant de 1994, avec pour défis d'assurer la pleine
participation de tous les acteurs et d'intégrer les enjeux
émergents liés à la gestion des ressources
forestières et fauniques (UICN, 2014). Ainsi, la gestion
concertée des ressources impliquant la participation effective des
populations locales est le gage d'une gouvernance environnementale
améliorée.
Les différentes reformes en matières de lois
relatives à la protection de l'environnement ont commencés depuis
1994 et subissent des modifications jusqu'à nos jours. Le tableau
suivant donne le récapitulatif des différentes
réformes.
Tableau 21. Texte de lois sur la protection de la nature au
Cameroun
|
PERIODE
|
TEXTES D'APPLICATION
|
|
1995
|
-Décret N° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les
modalités d'application du régime de la faune
|
|
-2. Décret N° 95 / 531/PM du 23 août 1995
fixant les modalités d'application du régime des forêts
(MINEF)
|
|
1996
|
3. Décret N° 96/642/PM du 17 septembre 1996
Fixant l'assiette et les modalités de recouvrement des droits de
redevances et taxes relatifs à l'activité forestière
|
1998
|
4. Décret N° 98 /345 de la 21/12/98 portante
organisation du Ministère de l'environnement et des forêts
|
1999
|
5. Décret N° 99/781/PM du 13 octobre 1999 fixant
les modalités d'application de l'article 71(1) nouveau de la loi
n°94 /01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la
faune et de la pêche ;
|
|
148
|
2002
|
6. Arrêté N°0222/A/MINEF du 25 mai 2002
portant procédures d'élaboration, d'approbation, de suivi et de
contrôle de la mise en oeuvre des Plans d'Aménagement des
Forêts de production du domaine forestier permanent
|
2006
|
7. Instruction N° 1/MINEP/CAB du 19 avril 2006
prescrivant la lutte contre l'exploitation illégale des ressources
naturelles
|
2008
|
8. Arrêté N° 0315/MINEF fixant les
critères de présélection et les procédures de choix
des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière
|
|
9. Arrêté N° 0518/MINEF/CAB fixant les
modalités
d'attribution en priorité aux communautés
villageoises
riveraines de toutes forêts susceptibles d'être
érigée en forêts communautaires
|
|
Source : Gilles Herbert FOTSO.
Université de Douala - Master 2 Recherche 2012 adapté par
Djafnga
La multitude de ces réformes administratives montre la
volonté du gouvernement camerounais de protéger son patrimoine
naturel. On remarque ainsi que le premier décret avait pour but de fixer
les modalités d'application du régime de la faune et des
forêts alors que le décret de 2008 entre plus en détail car
il fixe les critères de présélection et les
procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation
forestière et les modalités d'attribution en priorité aux
communautés villageoises riveraines de toute forêts susceptibles
d'être érigée en forêts communautaires. On voit ainsi
la nécessité d'impliquée les populations locales dans la
promotion et la gestion des forêts communautaires.
Les politiques sectorielles relatives à la conservation
de la biodiversité et au développement durable
élaborées au Cameroun incluent principalement le régime
des forêts et de la faune (contenu dans la loi n° 94/01 du 20
janvier 1994) et ses divers décrets d'application, dont les objectifs
comprennent :
- La protection du patrimoine forestier et faunique de la
nation en participant à la conservation de l'environnement et à
la préservation de la biodiversité de façon durable, ainsi
qu'en renouvelant les ressources forestières et fauniques grâce
à une meilleure gestion ;
149
- L'approvisionnement régulier en produits forestiers
et fauniques de façon durable pour les générations
présentes et futures ;
- La participation des populations rurales, des partenaires et
des parties prenantes à la mise en oeuvre, notamment par le biais de la
propriété des forêts communautaires.
La mise en place de ces lois permet de limiter la
dégradation des ligneux pérennes. Toutefois, il faut allier ces
lois avec d'autres mesures plus intégrante afin de mettre sur pied un
système solide et plus innovateur dans le domaine de la protection des
ligneux pérennes. Les perspectives sont ainsi proposées dans
cette optique.
4.4.2. Perspective pour une gestion durable des ligneux
pérennes
Pour assurer une gestion plus efficiente et plus efficace des
ligneux pérennes, des stratégies doivent être revues et
adoptées au niveau de tous les acteurs (populations, institutions,
Etat). Ces stratégies doivent être orientées dans plusieurs
sens. Il faut ainsi :
1' Une gestion intégrée des ligneux
pérennes : Elle consiste à adopter une vision globale et
multifonctionnelle des ligneux pérennes. Elle recherche des voies
possibles qui soient à la fois écologiquement durable,
socialement équitable et économiquement viable. En effet, la
recherche d'une gestion ligneuse écologiquement durable consiste
à toujours mieux comprendre et utiliser les forces de la nature à
l'oeuvre. Ce critère requiert que toutes les décisions concernant
l'aménagement soient fondées sur une compréhension
actualisée et profonde des fonctions écologiques des ligneux.
1' Une gouvernance plus transparente et
équitable : La bonne gouvernance et la transparence sont des
préalables à une lutte efficace contre la pauvreté et
à une gestion durable des ligneux pérennes dans la
localité de Houdouvou. Les faiblesses et insuffisances du dispositif
institutionnel apparaissent aujourd'hui comme un des principaux écueils
à une bonne gouvernance. En effet, la volonté politique du
gouvernement, la participation effective des populations, la prise de
conscience du secteur privé, comme aussi l'engagement de la
communauté internationale, sont autant nécessaires pour rompre le
cercle vicieux où la pauvreté est à la fois cause et effet
de la dégradation de l'environnement en
150
générale et des ligneux pérennes en
particulier. Une bonne gouvernance dépend des acteurs locaux et des
groupes d'intérêt : il faut qu'ils jouent leur propre rôle
et se respectent les uns les autres.
? Une réduction de la
vulnérabilité des forêts des terres arides aux
événements naturels défavorables : Les
forêts des terres arides sont exposées à plusieurs
difficultés et dangers naturels : les inondations, la sécheresse,
les tempêtes de vent, les précipitations
irrégulières, le stress hydrique, etc. En raison de la pression
démographique sans cesse croissante, la demande est aujourd'hui
supérieure à la production forestière dans les zones
arides. La mise en valeur des forêts dans les zones arides doit donc
envisager l'adoption de mécanismes visant à diminuer la
vulnérabilité des forêts à ces facteurs.
? Une participation des communautés à la
surveillance et à la prévention des menaces pesant sur la
santé des forêts : Les institutions responsables de la
protection des forêts doivent collaborer avec d'autres parties prenantes,
tels que les bûcherons, les producteurs de charbon de bois, les
agriculteurs, les groupes de chasseurs et les éleveurs, pour
prévenir et maîtriser les maladies, les incendies et autres
menaces susceptibles de mettre en danger les forêts des terres arides.
Les populations susceptibles de prêter leur concours doivent être
clairement identifiées et des points focaux fiables doivent être
désignés, encouragés à entretenir un contact avec
le département des forêts et bénéficier de courtes
formations en complément d'autres activités ;
? Une application d'une approche adaptative de gestion
forestière : L'adaptation au changement climatique
nécessite d'adopter une approche de gestion souple, réactive et
préventive. La vigilance et la surveillance sont indispensables pour
déceler les effets du changement climatique sur les
écosystèmes forestiers et pour appliquer une gestion adaptative.
Des systèmes de surveillance fondés sur les conditions locales
doivent être établis dans les zones forestières de vaste
superficie.
? Promouvoir les ressources forestières
d'importance socio-économique : Les forêts ne sont pas
seulement une source de subsistance pour les populations rurales ; elles sont
également de plus en plus souvent une source de produits pour
151
les populations urbaines, qui sont tributaires de la
production des zones rurales à proximité des villes. La gestion
forestière doit faciliter l'accès aux nombreux avantages que
procurent les forêts et contribuer à leur durabilité ;
? Etablir un cadre juridique, politique et
institutionnel favorable à la gestion durable des forêts :
Etablir et appliquer de bonnes pratiques de gestion forestière
représente un grand défi dans la localité de Houdouvou. La
pauvreté tend à encourager les populations à adopter des
stratégies plus simples pour survivre. Les nouvelles règles sont
appliquées durant une certaine période, mais sont ensuite peu
à peu oubliées lorsque l'élan disparaît. La seule
solution consiste à examiner et à réviser en permanence
les lois, les réglementations et les engagements, ce qui est un outil
très important pour assurer le fonctionnement et le suivi des programmes
de gestion. Les obstacles linguistiques doivent être surmontés ;
pour cela, les administrations forestières et les ONG doivent
améliorer la communication avec les communautés locales en les
aidant à comprendre les documents et les procédures de base, en
les expliquant, en les commentant et en les traduisant dans les principales
langues locales.
? Utilisation de la méthode PLASA : La
Méthode PLASA repose sur 5 théories et utilise comme
ingrédients les matériaux disponibles dans la nature (cailloux,
pierres, gravier, sable, fumier, compost, eau). La première phase est le
captage de la frange capillaire. Elle est suivi la mise en place de trou en
forme d'entonnoir inversé et de l'épandage des terres riches et
humide. Les dernières phases concernent le revêtement et la prise
en charge. La méthode PLASA (Planter Sans Arrosage)
détaillée dans la les étapes suivantes :
Etape 1 : Capter la frange capillaire : La
frange capillaire est en géologie la zone de transition une zone
saturée et une zone non saturée. A ce niveau, l'opération
consiste à un trou qui atteint le niveau de cette frange capillaire afin
que le jeune plant puisse bénéficier du système naturel
d'arrosage. Son influence s'observe généralement à partir
de 15 à 20 cm au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la fin
de la saison des pluies (novembre à avril) et selon la nature du sol
(sols latéritiques, argileux, sablonneux...). Ce niveau se reconnait par
une sensation de fraîcheur au toucher de la terre qui sort du fond du
trou.
152
Etape 2 : Faire un trou adéquat : Pour
faire un bon trou, il doit être en forme d'entonnoir renversé afin
de réduire l'action des rayons solaires sur la frange capillaire ; car
un trou à large ouverture accueille plus de rayons solaires qu'un trou
à ouverture modérée.
Etape 3 : améliorer la qualité du
terreau : A ce niveau, l'opération consiste à trouver
une terre bénéfique à la plante car une terre riche en
éléments nutritifs (matière organique, compost, fumier
etc...) constitue une « alimentation riche et équilibrée
» pour une croissance normale et une bonne santé de la plante.
Etape 4 : Poser un revêtement à double
fonction : Le revêtement est posé sur les parois
supérieures du trou et au pied du plant afin de réduire le
processus de dessèchement dû à l'effet des rayons solaires
et au vent. On utilise à ce niveau pierres, cailloux et graviers comme
matériaux de revêtement eu égard aux
caractéristiques protectrices que renferment ces matériaux.
En outre ce revêtement crée un environnement peu
attractif aux termites comparativement au paillage dont l'inconvénient
est de favoriser la prolifération des termites.
Etape 5 : L'arrosage et la protection : Cette
étape est la dernière de la méthode PLASA. La
Méthode PLASA fait de la frange capillaire la source principale
d'alimentation en eau. Cependant, dès l'apparition des signes de
déshydratation du plant (feuilles fanées le matin, craquantes
avec perte d'éclat). L'arrosage se fait, lentement, longuement afin de
réussir l'infiltration de l'eau sous le plant.
La Méthode PLASA enregistre des gains en
économie d'eau et de temps : 1 litre d'eau par semaine par plant, une
fréquence d'arrosage allant de : 1 fois par semaine à 1 fois les
15 jours, 1 fois le mois, et, souvent à 0 arrosage durant la saison
sèche.
La mise en place de cette méthode dans la
localité de Tchéré serait d'une importance remarquable,
car les populations ne vont plus se peiner pour arroser à chaque fois
les plants et les plants auront des meilleures conditions pour se
développer.
La prise en compte de toutes ces stratégies pourrait
endiguer ou freiner la dégradation spatio-temporelle des ligneux
pérennes dans la localité de Houdouvou. Une gestion participative
et un développement durable impulsé par la base est une condition
nécessaire à la pérennisation des ligneux
pérennes.
153
Conclusion
En somme, ce chapitre était orienté vers l'analyse
des stratégies de gestion et de
protection des ligneux pérennes dans la localité
de Houdouvou, vers l'évaluation de ces stratégies et vers la
proposition des moyens de pérennisation. Il ressort de cette analyse que
plusieurs moyens existent au niveau local avec la plantation et l'entretien des
arbres, au niveau, institutionnel avec les campagnes de sensibilisation et de
distribution des plants et des foyers améliorer. Le niveau
étatique comprend les projets reboisements avec le projet «
Opération Sahel vert », les opérations de suivies et de
contrôles. Les stratégies mises en place par ces acteurs dans le
domaine de la protection des ligneux pérennes est appréciable,
mais beaucoup reste à faire au niveau de la transparence dans la gestion
et au niveau de l'éducation des populations dans la préservation
des ligneux pérennes.
154
Discussion des résultats
Cette étude rapporte sur la dégradation
spatio-temporelle des ligneux pérennes dans la localité de
Houdouvou (Extrême-Nord Cameroun). Les résultats issus de cette
analyse montrent une réelle dégradation des ligneux
pérennes. Les travaux ayants conduits à un état
général de la végétation ligneuse pérennes
ont fait ressortir une liste de 30 espèces réparties en 16
familles et 632 individus dans les 36 placettes. Au total, 20 ligneux
arborés et 11 ligneux arbustives ont été
identifiés. Des formations végétales denses, claires et
d'alignements ont été retrouvés. Quatre principales zones
se trouvent dans la localité de Houdouvou. Il s'agit des zones de
reboisements, des zones de cultures, des d'habitations et des zones
dégradées. L'état du couvert ligneux a permis de faire
ressortir des espèces vivantes (395), des espèces mortes (144) et
des espèces souffrantes (193). Par ailleurs, plusieurs paramètres
expliquent une réelle dégradation des ligneux pérennes.
Ainsi, la défoliation des espèces, les fortes variabilités
pluviométriques, les indices diversités des espèces
très faibles (H'= 1,51889135, D = 0,0327772), ainsi qu'une
densité faible des ligneux (195 tiges/ha) expliquent une
dégradation des espèces ligneuses pérennes. De même,
les activités humaines (prélèvement des ligneux, les
pratiques agricoles) et les défaillances institutionnelles participent
à cette dégradation.
De nombreuses études ont été
menées dans le cadre de la dynamique du couvert végétal,
notamment dans les Monts Mandara à l'Extrême-Nord Cameroun :
Téwéché en 2016 a étudié la dynamique de la
réserve de Zamay. Dans sa démarche il ressort que d'ici 50 ans la
réserve sera dégradée de 356 ha de 1965 à 2014.
Dans la plaine du Nord Cameroun, Aoudou traite le suivi de l'évolution
de la végétation ligneuse de la savane soudanienne dans la haute
vallée de la Bénoué au Nord-Cameroun et Ganota (2014)
étudie : la dynamique de la végétation ligneuse dans un
contexte de variabilité climatique dans les savanes soudaniennes sous
l'action des fronts pionniers : le cas du terroir de Sakdjé
(Nord-Cameroun). Ces différents auteurs ont un intérêt
particulier dans l'analyse de la dynamique régressive du couvert
végétal, leur impact et dégradation dans le Nord Cameroun
et dans l'Afrique. Toutefois, la question sur la dégradation des ligneux
pérennes demeure et reste à analyser selon la composition, la
superficie, la diversité, le temps, le contexte et la zone choisie.
C'est dans cette optique que la présente
155
recherche s'aligne aux auteurs précédant mais en
ramenant la thématique à une échelle de 20 ans et en
étudiant singulièrement les ligneux pérennes.
Timberlake (1985) et Pearce (1988), Diamond, (2005), montrent
que l'évolution rapide et sans contrôle des territoires et la
dégradation de l'environnement est une conséquence logique de la
croissance démographique accélérée. De plus
l'exploitation anarchique et mal maitrisée des terres a des
conséquences néfastes telles que les défrichements,
l'érosion, la baisse de fertilisation et la destruction d'une partie des
ressources naturelles. (Le Thiec, 1996). Le phénomène de
dégradation spatio-temporelle des ligneux pérennes dans la
localité de Houdouvou ces vingt dernières années se trouve
confirmé du fait de l'augmentation des surfaces dégradées,
de la raréfaction croissante des ligneux pérennes (2656), de la
mortalité des espèces et de la densité très faibles
des ligneux dans les différentes placettes (195 tiges/ha). Cette
étude permet ainsi d'approfondir les connaissances scientifiques sur la
dynamique régressive des ligneux, particulièrement des ligneux
pérennes. Elle permettra par ailleurs de mettre sur pied des politiques
décisionnelles plus réfléchies en prenant en compte tous
les paramètres qui entrent dans la dégradation des ligneux
pérennes.
La méthodologie utilisée dans l'analyse de la
dégradation des ligneux pérennes à données des
résultats pertinente et satisfaisante. Les cartes diachroniques et les
calculs des indices de diversité des espèces ont donné un
aperçu de la situation actuelle. Malgré la qualité et la
validité de la méthodologie et des résultats obtenus, un
élargissement du champ d'étude et l'intégration d'autres
paramètres d'analyses spatiales et statistiques donneraient encore plus
de résultats intéressants et ouvriraient des perspectives de
recherche plus grande.
Des limites à ce travail sont cependant à
prendre en compte. La principale limite concerne l'identification et la
classification des ligneux pérennes. Les documents d'identification
botanique à notre disposition ne recensaient pas toutes les
espèces qui se trouvent dans la localité. La seconde limite
réside dans les échantillons effectués sur les populations
représentatives. L'échantillon a été faite de
manière aléatoire. Ainsi, n'importe quels individus de la
population à la même probabilité d'être choisis que
n'importe quel autre.
156
En somme, les résultats obtenus des différentes
analyses sur la dégradation spatio-temporelle des ligneux
pérennes dans la localité de Houdouvou montre un aperçu du
niveau de dégradation des ligneux pérennes. Ces résultats
ont confirmés les facteurs naturels et anthropiques qui entrent dans la
dégradation des ligneux pérennes, ainsi que les effets
environnementaux et socio-économiques de cette dégradation. La
durabilité des ligneux pérennes doits passés par la mise
en place des politiques plus efficace et soucieuses de la nature et du
bien-être des populations. Un développement maitrisé et
durable s'impose.
157
Conclusion générale et recommandation
Parvenue au terme de ce travail ou il était question
d'étudier la dégradation spatio-temporelle des ligneux
pérennes dans la localité de Houdouvou, il ressort après
analyse que la dégradation de ligneux pérennes est un
phénomène réel et croissant. Ainsi, plusieurs
résultats ressortent de cette analyse et montre le niveau d'implication
de cette dégradation.
La situation des ligneux pérennes dans la bande
sahélienne lui confère une particularité dans sa
composition spécifique, dans la structure des unités
végétales, ainsi que dans le fonctionnement biologique des
espèces ligneuses. Le caractère naturel et anthropique de cette
formation végétale amène à s'interroger sur la
dynamique spécifique, sur les facteurs de leur croissance, sur les
effets de leurs destructions et sur les politiques à mettre en place
pour assurer une gestion durable de cette ressource pérenne.
L'état des lieux de la végétation
ligneuse pérenne a permis de faire ressortir une diversité des
espèces d'arbres parmi lesquels Faidherbia albida, Eucalyptucus
globulus, Mangifera indica, Moringa aleifera,
Dalbrgia melanoxylon, et d'arbustes comme Colophospermum
mopane, Ziziphus mauritiana, d'Acacia nilotica,
Cobretum glutinosum, Feretia apondanthera delile. Au total, 362
individus ont été inventoriés dans les 36 placettes. De
plus les formations végétales claires, denses et d'alignement ont
été retrouvés. L'état phrénologique des
espèces a montré des espèces vivantes (395), mortes (44)
et souffrantes (193). La distribution dendrométrique des ligneux
pérennes a été faite en fonction des principales zones
(reboisement, habitation, cultures, dégradées)
L'étude du processus de dégradation a permis de
faire une étude diachronique de la dégradation sur une
échelle de 20 ans. Le processus naturel de la dégradation a pour
principale facteur les fortes variabilités pluviométriques,
l'accentuation du phénomène d'érosion. Les indices de
diversité très faibles et la faible densité des ligneux
expliquent ce processus. Le processus anthropique intervient avec l'extension
croissante des surfaces agricoles qui dégradent les ligneux. Le
pâturage extrême, les modes extrêmes de
prélèvement des ligneux, l'utilisation du bois pour le chauffage
et la construction des habitats ont une place considérable dans le
processus de dégradation. De plus, les failles
158
du système institutionnel en place occupent une place
importante dans cette dégradation. Ainsi, le processus naturel
associé au processus anthropique à des conséquences
directes sur la nature en générale et sur les activités
humaines des riverains en particulier.
Les effets directs de cette dégradation sur
l'environnement se trouvent au niveau de la raréfaction croissante des
ligneux pérennes à travers les indices de de mortalités,
les indices de raréfactions et le calcul des abondances des
espèces. De plus, les fortes variations de températures et
l'extension des zones dégradées à travers le
phénomène de l'érosion font parties des
conséquences environnementales de la dégradation des ligneux. Au
niveau anthropique, on observe des baisses de la production agricole, une
raréfaction des surfaces fertiles, une raréfaction des bois de
chauffe, d'oeuvre et une raréfaction du pâturage. A contrario, la
mise en place des stratégies par les populations locales, les
institutions et l'état favorise dans une certaine mesure la
durabilité des ligneux pérennes.
Face à ce niveau de dégradation et de ces
corolaires, des stratégies ont été mises en place par les
populations locales et les institutions étatiques et privées.
C'est dans cette optique qu'on observe des zones de reboisement dans la
localité, la présence des agents de contrôle des eaux et
forêts, la mise en place des campagnes de distribution des plants, de
sensibilisation des populations sur la nécessité de
préservation des ligneux. Des stratégies ont été
aussi proposées dans l'optique d'une meilleure gestion des ligneux
pérennes. Ces stratégies consistent à une gestion
intégrées des ligneux pérennes, une gouvernance
transparente et plus équitable, une réduction de la
vulnérabilité des ligneux pérennes dans un contexte
sahélien, une participation intégrante des communautés
dans le processus de gestion des ligneux et à la mise en place d'un
cadre juridique, politique et institutionnel favorable à une gestion
durable des ligneux pérennes.
Les données obtenues à la fin de cette
étude permettent de dire que les ligneux pérennes de la
localité de Houdouvou connaissent une dynamique régressive. Cette
dégradation est perçue du point de vue spatial et temporel. Des
indicateurs performants (descripteurs pertinents et fiables) ont permis
d'évaluer avec précision l'état de ces espaces et des
ressources ligneuses. Au regard de ces résultats, il faut dire que les
ligneux pérennes de la localité vont se dégradé de
manière plus rapide et de manière croissante
159
si rien n'est fait dans le sens de leur réhabilitation.
Cette situation pourra alors accélérer le phénomène
des perturbations climatiques dans cette zone à écosystème
fragile.
« L'arbre, c'est la vie » dit un adage populaire
pour traduire l'importance de l'arbre dans la vie de l'homme et des
écosystèmes. Les arbres pérennes jouent un rôle
vital dans le maintien et la récupération de la fertilité
du sol, l'amélioration du microclimat pour la production des cultures,
la dépollution de l'air de notre atmosphère, la fourniture
d'ombrage et des abris pour les oiseaux et autres êtres vivants, la
réduction du ruissellement de l'eau du sol, augmentant ainsi
l'infiltration et la recharge des eaux souterraines. Ainsi donc c'est bien la
vie de l'arbre qu'il faut protéger pour protéger la vie des
humains. Au sahel en general et dans la localité de Houdouvou en
particulier, la disparition du couvert végétal, due à la
péjoration du climat, au surpâturage et aux besoins en bois de feu
et d'oeuvre pose de plus en plus la problématique du
développement durable et la fourniture des services environnementaux
vitaux. Elle pousse les femmes plus loin sur les pistes à la recherche
de bois de chauffe, rend difficile l'accès au fourrage.
Ainsi, pour une utilisation durable, rationnelle et
maitrisée des ligneux pérennes, il faut :
- Intensifier les campagnes de sensibilisation sur le danger
que représente la disparition des arbres pour leur vie et leur
environnement et au-delà pour toute la nation ;
- Promouvoir des études d'inventaires et
d'évaluation de la flore dans la localité ; - Impliquer la
population à la prise de décisions et à
l'élaboration des programmes d'activités ;
- Intensifier la formation des populations aux techniques de
coupe et de prélèvement d'écorce ;
- Impliquer les populations et plus particulièrement
les femmes dans l'identification et la solution aux problèmes de
dégradation des ressources végétales ;
- Évaluer en permanence le statut des espèces et
des écosystèmes naturels de manière à
prévenir leur disparition ;
160
- Appliquer avec plus de rigueur la législation des
lois interdisant les coupes abusives et mettre l'accent sur la conservation et
la protection de certaines espèces ayant des problèmes de
régénération ;
- Contrôler l'action des gestionnaires de la forêt
dans le but de s'assurer de l'exécution de leur rôle et renforcer
les mesures réglementaires conformément à la loi cadre de
l'environnement et au code forestier en vigueur ;
161
Bibliographie
? Dictionnaires
Brunet R, Ferras R, Théry H. (1992),
Les Mots de la géographie, dictionnaire critique.
Montpellier-Paris : Ed. RECLUS - La Documentation Française, (3e
édition), 520p.
George P. et Verger F. (2009).
Dictionnaire de la Géographie. Paris, PUF, 480
p.
Cordial Dico Français-Définition (2007).
"Dictionnaires français de définitions et de synonymes,
(c) Synapse
? Ouvrages
Bastien, C. (2019). Enseignement scientifique,
Ed. Bordas
Konan et al. (2015). Dynamisme de la
structure diamétrique du peuplement ligneux des différents
biotopes de la forêt classée de Yapo-Abbé, Sud de la
Côte d'Ivoire, Vol 94, 10.4314/jab.v94i1.10
Ouedraogo et al. (2009). Structure,
composition spécifique et diversité des ligneux dans deux zones
contrastées en zone Sahélienne du Burkina Faso.
https://doi.org/10.4000/vertigo.17282
? Article et revue
Babacar, F. et al. (2014). Flore et
végétation de la Réserve Spéciale de Faune de
Gueumbeul (Sénégal) (RSFG)
Coûteront et Al. (1992).
Pterocarpus lucens Lepr. dans la région de Banh (Nord-Ouest du
Burkina Faso, Afrique occidentale). Importance pastorale et état actuel
des peuplements. February Revue d'élevage et de Médecine
Vétérinaire des Pays Tropicaux Vol 45(2) : 179-190.DOI
:10.19182/remvt.8946
Darko. (2003). Dégradation des
ressources végétales au contact des activités humaines et
perspectives de conservation dans le massif de l'Aïr (Sahara, Niger),
https://doi.org/10.4000/vertigo.2224
162
Diamond, j. (2005). Effondrement. Comment les
sociétés décident de leur disparition ou de leur
survie. fr. Gallimard
Diarra et al. (2014). Dynamique de la
végétation ligneuse des espaces sylvo-pastoraux villageois mis en
défens dans le Sud du Bassin arachidier au Sénégaljanv. 1,
2014
https://doi.org/10.19182/bft2014.319.a20551
Oumar, S. (2014). Dynamique du peuplement
ligneux dans un parcours agrosylvopastoral du Sénégal
https://doi.org/10.4000/vertigo.14067,
2014
Tardieu, F. (2012). Les mécanismes
d'adaptation de la biodiversité aux changements climatiques et leurs
limites, institut de France, académique de sciences.
Timberlake, L. (1985). L'Afrique en crise :
les causes, les remèdes de la faillite environnementale. Ed Pearce,
? Ouvrage
Binot A et Joiris V., 2. (2007).
Règles d'accès et gestion des ressources pour les
acteurs des périphéries d'aires protégées : foncier
et conservations de la faune en Afrique subtropicale, Colloque international
« les frontières de la question foncière- At the
frontière of land iss. p. 17.
Ozenda, P. (1991). Flore et
végétation du Sahara. CNRS 3e édition, T.III, Paris,
660
p.
Plit, F. (1983). Le facteur Ulysse :
évaluer les visiteurs en milieu touristique. Éditions
Springer-Verlag.
Plit, F. (1993). La dégradation de la
végétation, l'érosion et la lutte pour protéger le
milieu naturel en Algérie et au Maroc. In : Méditerranée,
troisième série, tome 49, 31983. pp. 79-88. DOI :
https://doi.org/10.3406/medit.1983.2139
Ramade, f. (1994). Éléments
d'écologie : écologie fondamentale.
Téweche, A. (2016). «
Déclin du sorgho pluvial et émergence du maïs, du soja et du
niébe dans les systèmes productifs dans le Mayo-Tsanaga
(Extrême-Nord, Cameroun)
163
». In Felix Watang Zieba, Natali Kossoumna Liba'a,
Bernard Gonné, Pressions sur les territoires et les ressources
naturelles au Nord- Cameroun, clé, Yaoundé, p.88-106
? Mémoires
Betare Yona- Nam Gunte, B. (2020). Pression
démographique et dynamique spatio-temporelle de la réserve
forestière de Zamay : de 2016 à 2020 (Mémoire).
Université, Maroua.
Biana, B. (2020). Dynamique du couvert
ligneux dans la réserve forestière de la Semry a Maga
(extrême-nord Cameroun) : 2010 - 2020(Mémoire). Université,
Maroua.
Haman, A. (2020). Impact de l'exploitation
des produits forestiers non ligneux dans la plaine de Ndoukoula
(Extrême-Nord Cameroun) (Mémoire). Université, Maroua
Houngbo, E. (2008). Dynamique de
pauvreté et pratiques agricoles de conservation de l'environnement en
milieu rural africain : Le cas du plateau Adja au Sud-Benin. Sciences de
l'environnement. Université de Abomey-Calavi,
Mazzucato, V, Niemeijer, D.(sd). Le Sahel :
une dégradation des terres exagérée, un potentiel paysan
sous-estimé, Faculté d'Economie et de l'Administration
commerciale, Université Libre, De Boelelaan ;
Nisso, N. (2016), Dynamique du couvert ligneux
de la savane de Zokole (Mindif), (Mémoire). Université,
Maroua.
Onsala, P. (2013), dégradation et
gestion des ressources ligneuses en milieu sahélien : cas de Taïbon
(Extrême-Nord Cameroun) (Mémoire). Université, Maroua.
Tissidi, D. (2016). Caractérisation de la
végétation ligneuse dans la réserve de Kalfou
(Extrême-Nord Cameroun), (Mémoire). Université, Maroua.
Toumba, T. (2010). Gestion des ressources
ligneuses en eau en zone sahélienne : cas de Mindif (Nord-Cameroun)
(Mémoire). Université, Maroua
? Thèse
Balna, J. (2016). Exploitation
fourragère par les pasteurs Mbororo et émergence du foncier de
l'arbre dans les plaines de Mozogo et de Tolkomari à
l'Extrême-Nord du Cameroun, Thèse de Doctorat de
géographie, Université de Maroua, 357p.
Boulain, N. (2004). Effet des facteurs
climatiques et anthropiques dans l'évolution récente des
écosystèmes tropicaux : modélisation spatialisée du
bilan
164
hydrique d'un petit bassin versant sahélien.
Thèse de Doctorat, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI,
171p.
Froumsia Moksia, 2013. Impact des
activités anthropiques sur le couvert ligneux dans la réserve
forestière de Kalfou, Extrême-Nord Cameroun. Thèse de
Doctorat Ph.D, Université de Yaoundé I. 185 p.
Ganota, B. (2014). Dynamique des recrûs
ligneux dans les terroirs de Djaba, Sakdjé et Gamba dans la
périphérie Ouest du parc national de la Bénoué.
Ngaoundéré. Thèse de Doctorat PhD Université de
Ngaoundéré
Harmand, j. (1997). Rôle des
espèces ligneuses à croissance rapide dans le fonctionnement
biogéochimique de la jachère. Effets sur la restauration de la
fertilité des sols ferrugineux tropicaux (Bassin de la
Bénoué au Nord Cameroun). Thèse de doctorat de
l'Université de Paris VI en Biologie et Ecologie végétales
tropicales, 213p.
Manceron, S. (2011). Intervenir en
périphérie pour la conservation des aires protégées
: réexamen d'un postulat. La situation du Parc du W et des
éleveurs mobiles.. Nanterre : Université de Paris 10, 586 p.
Thèse de doctorat : Géographie : Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
Teweche, A. (2016). Dynamique des ressources
ligneuses dans les aires protégées des monts Mandara : le cas des
réserves forestières de Zamay et de Mayolouti
(Extrême-nord, Cameroun) Thèse de Doctorat de géographie,
Université de
Maroua, 444p
? Rapport
FAO. (2014). European Forestry Commission
Matters Follow-up to the decisions of the 37th Session of the European Forestry
Commission,
Fondoun, J. (1998). Situation des Ressources
Génétiques Forestières du Nord Cameroun. Communication
présentée pour l'Atelier sous régional FAO/IPGRI/ICRAF sur
la conservation, la gestion, l'utilisation durable et la mise en valeur des
ressources génétiques forestières de la zone
sahélienne à Ouagadougou le 22-24 sept 1998
Le Houérou, F. (1997). Journal des
Africanistes Année 1997 67-1 pp. 209-210
165
Fotsing, E. (2003). Etat de la réserve
forestière de Laf et des zones riveraines : orientations
d'aménagement et gestion de l'espace.
Drabo I, Issa A S, (2013).
Préservation de la biodiversité forestière et
lutte contre la désertification dans le nord du Cameroun. Rapport annuel
2013, ABIOGeT et l'Institut Agricole. p. 4
166
Annexes
Annexes 1 : Questionnaire destiné aux paysans de
Houdouvou
Questionnaire destiné aux paysans
Ce questionnaire a été élaboré
dans le but de récolter des informations pour le compte de notre
recherche sur la dégradation spatio-temporelle des espèces
pérennes dans la localité de Houdouvou (Extrême-Nord
Cameroun). Pour cela, nous vous rassurons de la confidentialité de vos
informations et ne serons utilisées qu'à des fins purement
scientifiques.
1. Identification de l'enquêté
|
1
|
Age ?
|
1-[15-20ans] 2-[21-30ans]
3-[31-40ans] 4-+40 ans
|
|
|
2
|
Sexe ?
|
1-Masculin 2-Feminin
|
|
|
3
|
Quelle est votre principale activité économique
?
|
1-Agriculture 2-Elevage
3-Commerce 4- Vente de bois et charbon
|
|
|
4
|
Quelle est votre religion ?
|
1-Chretien 2-Musulman
3Animiste 4-Autres
|
|
II-Les acteurs de la dégradation des ressources
ligneuses
|
5
|
Comment préparez-vous vos champs lors des semis ?
|
1-defichement 2-brulis
3-désouchage
|
|
|
6
|
Ou trouve-t-on les ligneux pérennes dans votre
localité ?
|
1-Dans les champs 2-Dans les vergers
4- Dans les lieux d'habitations 5-En bordure de route
|
|
|
7
|
Comment appréciez-vous la végétation
pérenne depuis votre installation dans le village ?
|
1- En diminution 3- En augmentation
2- En augmentation 4- Sans changement
5- Touché
|
|
|
8
|
Quel est le degré de sa diminution/dégradation ?
|
1- Forte 2- Moyenne
3-Faible
|
|
|
9 2
|
Selon vous, qu'est ce qui est à l'origine de la
dégradation des ligneux pérennes?
|
1- Baisse des pluies 2- Niveau
d'aridité des sols 3- Activité humaine
|
|
|
103
|
Avez-vous besoins d'autorisation pour accéder aux
ligneux pérennes ?
|
1-OUI 2-NON
|
|
|
11
|
Quelles sont vos sources d'approvisionnent en bois de chauffe
?
|
1-Ramassage de bois mort 2-Coupe de bois vert
3-Emondage des arbres
4- Achat des arbres au marché
|
|
167
124
|
Où prélevez-vous ces espèces?
|
1-Dans les champs
2-Dand les vergers
3-Dans les espaces reboisés 4-Les arbres d'alignement
|
|
|
135
|
Ces prélèvements dégradent-ils les ligneux
pérennes ?
|
1-Oui 2-Non
|
|
|
146
|
Si oui quels sont les changements observés dans le
village depuis votre arrivée ?
|
1- Augmentation des zones de culture
2- Diminution des ressources ligneuses
3- Difficultés d'accès aux terres fertiles
4- Raréfaction des espèces les plus
utilisées
5- Multiplication des espaces dégradés
|
|
|
157
|
Selon vous, qui participe le plus à la coupure des
arbres?
|
1-Cultivateurs 2- Eleveurs 3- Femmes 4- Bucherons
|
|
III- Utilisation des ligneux
|
16
|
Quels sont les différents usages des ligneux
pérennes que vous connaissez?
|
1-Pharmacopée 2-Bois de chauffe
3-bois d'ouvre 4-fourrage
|
|
|
17
|
Ces usages ont-ils des effets sur les ressources ligneuses de
la localité ?
|
1-Oui 2-Non
|
|
|
18
|
Si oui, ces usages ont elles des effets importants dans la
zone ?
|
1- Sans importance
2- Peu important
3- Assez important
4- Très important
|
|
|
19
|
Quel est le mode de prélèvement ?
|
1-Emondage 2-Ebranchage
3-Déssouchage 4. Coupe en taillis
|
|
|
20
|
égétation
Quelles sont les cultures qui dégradent le plus la
ligneuse ?
|
1- Culture de coton 2- Culture
d'arachide 3- Culture de sorgho 4-
Culture de
maraîchers
|
|
IV. Gestion des ligneux
|
21
|
Avez-vous déjà été
sensibilisé sur la gestion des ligneux ?
|
1. Oui 2. Non
|
|
|
22
|
Si oui par qui ?
|
1. Commune 2.ONG
3. GIC 4. Autorité traditionnelle 5.
Autres
|
|
|
23
|
Quelles sont les mesures qui vous ont été
proposées pour la gestion des ligneux dans la localité de
Mokong?
|
1. Limiter les coupes
2. Planter les arbres
|
|
168
|
|
3. Limiter les espaces de cultures
4. Entretenir les arbres de la localité
|
|
|
24
|
Comment accédez-vous aux ressources ligneuses dans
votre localité?
|
1-Autorisation de la commune 2-Autorisation des services des eaux
et forêts 3-Sans autorisation
|
|
|
25
|
Avez-vous déjà bénéficié d'un
accompagnement ?
|
1. Oui 2. Non
|
|
|
26
|
Si oui quel genre d'accompagnement ?
|
1. Distribution de plans
2. Agent de contrôle
3-Distribution des foyers améliorés
|
|
|
27
|
Avez-vous conscience de l'existence des lois pour la
protection des arbres ?
|
1-Oui 2-Non
|
|
Annexe N°2 : Guide d'entretien
GUIDE D'ENTRETIEN (Autorités
traditionnelles et locales)
1. Comment évaluez-vous le niveau de précipitation
ces dernières années ?
2. Comment a progressé l'occupation des espèces
dans la localité (les parcelles de cultures, les zones
d'habitations...?
3. A quoi sert les arbres pérennes (arbres des champs,
sur les espaces bâti, nu, dans les vergers...) dans la localité
?
4. Comment gérer vous les arbres dans la localité
? Ces arbres sont-ils naturels ou planté ?
5. Ces arbres permettent ils aux populations l'appropriation de
leur territoire ?
6. Existe-t-il des arbres à fonctions religieuses ou
culturelles ?
7. Quelles sont les zones agricoles, les zones de pâturage
et de vente de bois ?
8. Quelles sont les stratégies de pérennisation
des espèces pérennes ?
GUIDE D'ENTRETIEN (Autorités
administratives)
1. Quels sont les actions menées pour préserver
les arbres dans la localité ?
2. Quelles sont les politiques mises en place pour la
protection des ligneux pérennes dans la localité
169
Annexe 3 : Autorisation de recherche

170
Annexe 4 : Fiche de relever botaniques des états
des espèces
FICHE DE RELEVES FLORISTIQUES.
Date . / / Fiche N° . Maille N° .
placette N° .
Coordonnées géographiques . /
Type de
végétation .
Type de sols . Relief .
Traces anthropique . Autres .
|
Code des Espèces
|
Etat
|
Nbre de
tiges
= 5
d<10
|
Nbre de tiges en dessous de 1,3m du sol avec d=10
|
Hauteurs en m
|
Diamètre à 1,30m en
cm
|
Présence de trace
|
Nbre des indivi dus en régéné ration
|
1.
|
Vivant
|
Mort
|
Souffrant
|
|
|
<1 m
|
[1 -
10[
|
[10-
20[
|
[20 - plus[
|
< 5
cm
|
[10 -
20[
|
[20 -
30[
|
[30-
plus[
|
Émondage
|
Élagage
|
Pas de
Coupes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Annexe 4 : Tableau brut
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Espèces
|
P1
|
P2
|
P3
|
P4
|
P5
|
P6
|
P7
|
P8
|
P9
|
P10
|
P11
|
P12
|
P13
|
P14
|
P15
|
P16
|
P17
|
P18
|
P19
|
|
P20P21P22
|
|
P23
|
P24
|
P25
|
P26
|
P27
|
P28
|
P29
|
P30
|
P31
|
P32
|
P33
|
P34
|
P35
|
P36
|
Total
|
|
Acacia Albida
|
0
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
7
|
1
|
2
|
0
|
1
|
|
4
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
6
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0
|
0
|
37
|
|
Acacia nilotica
|
0
|
0
|
0
|
4
|
3
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
1
|
3
|
0
|
0
|
29
|
|
Acacia seyal
Anacardium
|
0
|
0
|
0
|
3
|
5
|
3
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
0
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
4
|
9
|
0
|
2
|
0
|
49
|
|
occidentale
Azadirachta indica
|
0
10
|
0
4
|
0
13
|
0
7
|
0
6
|
0
8
|
0
6
|
0
8
|
0
7
|
0
12
|
0
0
|
0
7
|
0
1
|
0
8
|
0
5
|
0
0
|
0
0
|
0
2
|
0
6
|
0
1
|
0
0
|
0
0
|
1
0
|
0
0
|
0
7
|
2
0
|
0
0
|
0
7
|
0
7
|
0
0
|
5
13
|
0
1
|
0
9
|
0
0
|
2
2
|
0
0
|
10
157
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balanites aegyptiaca
Cissus quadrangularis
|
0
0
|
4
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
2
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
6
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
1
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
1
|
4
0
|
0
0
|
0
1
|
0
0
|
0
0
|
1
7
|
0
0
|
3
0
|
1
1
|
1
1
|
0
|
0
4
|
0
0
|
17
21
|
|
Colophospermum
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
6
|
5
|
5
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27
|
|
mopane
Cobretum glutinosum
Combretum migranthum
|
5
0
|
4
0
|
14
0
|
5
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
1
|
0
0
|
0
0
|
0
3
|
1
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
29
4
|
|
Diospyros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mespiliformis
|
0
|
3
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
|
Dalbrgia melanoxylon
Eucalyptucus globulus
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
4
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
6
|
0
0
|
0
4
|
0
12
|
0
0
|
0
0
|
0
2
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
2
|
0
30
|
|
Diospyros
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
mespiliformis
Feretia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
apondanthera delle
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
|
Faiderbia albida
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15
|
7
|
6
|
0
|
1
|
4
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
5
|
9
|
52
|
|
Ficus sycomorus
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
1
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
1
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
3
|
3
2
|
0
0
|
0
0
|
4
|
9
|
|
Ficus glumosa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
15
|
|
Geremia mollis jus
|
0
0
|
0
0
|
0
2
|
3
0
|
5
0
|
5
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
13
|
|
Grewia villosa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gymnosporia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
2
0
171
172
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mimusops elengi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Moringa aleifera
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
173
Annexe 5 : Diversité floristique selon les
placettes
|
|
|
|
|
|
|
Placettes
|
Nombre des
|
Pi
|
Pi2
|
log2Pi
|
Pi*log2Pi
|
|
individu Ni
|
|
|
|
|
|
P1
|
14
|
0,022151899
|
0,00049071
|
-1,654589043
|
0,0366523
|
|
P2
|
14
|
0,022151899
|
0,00049071
|
-1,654589043
|
0,0366523
|
|
P3
|
23
|
0,036392405
|
0,00132441
|
-1,438989242
|
0,0523683
|
|
P4
|
26
|
0,041139241
|
0,00169244
|
-1,38574373
|
0,0570084
|
|
P5
|
16
|
0,025316456
|
0,00064092
|
-1,596597096
|
0,0404202
|
|
P6
|
14
|
0,022151899
|
0,00049071
|
-1,654589043
|
0,0366523
|
|
P7
|
12
|
0,018987342
|
0,00036052
|
-1,721535832
|
0,0326874
|
|
P8
|
18
|
0,028481013
|
0,00081117
|
-1,545444573
|
0,0440158
|
|
P9
|
7
|
0,011075949
|
0,00012268
|
-1,955619038
|
0,0216603
|
|
P10
|
7
|
0,011075949
|
0,00012268
|
-1,955619038
|
0,0216603
|
|
P11
|
16
|
0,025316456
|
0,00064092
|
-1,596597096
|
0,0404202
|
|
P12
|
10
|
0,015822785
|
0,00025036
|
-1,800717078
|
0,0284924
|
|
P13
|
10
|
0,015822785
|
0,00025036
|
-1,800717078
|
0,0284924
|
|
P14
|
12
|
0,018987342
|
0,00036052
|
-1,721535832
|
0,0326874
|
|
P15
|
17
|
0,026898734
|
0,00072354
|
-1,570268157
|
0,0422382
|
|
P16
|
20
|
0,03164557
|
0,00100144
|
-1,499687083
|
0,0474585
|
|
P17
|
24
|
0,037974684
|
0,00144208
|
-1,420505837
|
0,0539433
|
|
P18
|
13
|
0,02056962
|
0,00042311
|
-1,686773726
|
0,0346963
|
|
P19
|
17
|
0,026898734
|
0,00072354
|
-1,570268157
|
0,0422382
|
|
P20
|
23
|
0,036392405
|
0,00132441
|
-1,438989242
|
0,0523683
|
|
P21
|
16
|
0,025316456
|
0,00064092
|
-1,596597096
|
0,0404202
|
|
P22
|
23
|
0,036392405
|
0,00132441
|
-1,438989242
|
0,0523683
|
|
P23
|
25
|
0,039556962
|
0,00156475
|
-1,40277707
|
0,0554896
|
|
P24
|
42
|
0,066455696
|
0,00441636
|
-1,177467788
|
0,0782494
|
|
P25
|
27
|
0,042721519
|
0,00182513
|
-1,369353314
|
0,0585009
|
|
P26
|
24
|
0,037974684
|
0,00144208
|
-1,420505837
|
0,0539433
|
|
P27
|
15
|
0,023734177
|
0,00056331
|
-1,624625819
|
0,0385592
|
|
P28
|
33
|
0,05221519
|
0,00272643
|
-1,282203138
|
0,0669505
|
|
P29
|
18
|
0,028481013
|
0,00081117
|
-1,545444573
|
0,0440158
|
|
P30
|
15
|
0,023734177
|
0,00056331
|
-1,624625819
|
0,0385592
|
|
P31
|
13
|
0,02056962
|
0,00042311
|
-1,686773726
|
0,0346963
|
|
P32
|
22
|
0,034810127
|
0,00121174
|
-1,458294397
|
0,0507634
|
|
P33
|
10
|
0,015822785
|
0,00025036
|
-1,800717078
|
0,0284924
|
|
P34
|
5
|
0,007911392
|
6,259E-05
|
-2,101747074
|
0,0166277
|
|
P35
|
19
|
0,030063291
|
0,0009038
|
-1,521963477
|
0,0457552
|
|
P36
TOTAL
Indice de Shannon H'=-
?Pilog2Pi
|
12
632
|
0,018987342
1
|
0,00036052
1
|
-1,721535832
0
|
0,0326874
0
|
|
?iPi2
|
|
|
|
|
|
|
Indice de Simpson D=
|
|
|
|
|
|
Annexe N° 6 : Diversité floristique
en fonction des espèces rencontrées
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nbre
|
|
|
|
|
|
N°
|
Espèces
|
Individus
|
Pi
|
Pi2
|
log2Pi
|
Pi*logPi
|
|
1
|
Acacia Albida
|
37
|
0,058544304
|
0,00342744
|
-4,094327383
|
0,2396995
|
|
2
|
Acacia nilotica
|
42
|
0,066455696
|
0,00441636
|
-3,911463325
|
0,259939
|
|
3
|
Acacia seyal
|
31
|
0,049050633
|
0,00240596
|
-4,349584438
|
0,2133499
|
|
4
|
Anacardium occidentale
|
17
|
0,026898734
|
0,00072354
|
-5,216317907
|
0,1403123
|
|
5
|
Azadirachta indica
|
157
|
0,248417722
|
0,06171136
|
-2,009159999
|
0,4991109
|
|
6
|
Balanites aegyptiaca
|
6
|
0,009493671
|
9,013E-05
|
-6,718818247
|
0,0637862
|
|
7
|
Cissus quadrangularis
|
16
|
0,025316456
|
0,00064092
|
-5,303780748
|
0,1342729
|
|
8
|
Colophospermum mopane
|
36
|
0,056962025
|
0,00324467
|
-4,133855747
|
0,2354728
|
|
9
|
Combretum migranthum
|
7
|
0,011075949
|
0,00012268
|
-6,496425826
|
0,0719541
|
|
10
|
Cobretum glutinosum
|
20
|
0,03164557
|
0,00100144
|
-4,981852653
|
0,1576536
|
|
11
|
Dalbrgia melanoxylon
|
1
|
0,001582278
|
2,5036E-06
|
-9,303780748
|
0,0147212
|
|
12
|
Diospyros mespiliformis
|
5
|
0,007911392
|
6,259E-05
|
-6,981852653
|
0,0552362
|
|
13
|
Eucalyptucus globulus
|
36
|
0,056962025
|
0,00324467
|
-4,133855747
|
0,2354728
|
|
14
|
Erophaca baetica
|
5
|
0,007911392
|
6,259E-05
|
-6,981852653
|
0,0552362
|
|
15
|
Faidherbia albida
|
64
|
0,101265823
|
0,01025477
|
-3,303780748
|
0,3345601
|
|
16
|
Feretia apondanthera delile
|
5
|
0,007911392
|
6,259E-05
|
-6,981852653
|
0,0552362
|
|
17
|
Ficus glumosa
|
1
|
0,001582278
|
2,5036E-06
|
-9,303780748
|
0,0147212
|
|
18
|
Ficus sycomorus
|
3
|
0,004746835
|
2,2532E-05
|
-7,718818247
|
0,03664
|
|
19
|
Grewia mollis juss
|
12
|
0,018987342
|
0,00036052
|
-5,718818247
|
0,1085852
|
|
20
|
Grewia villosa
|
5
|
0,007911392
|
6,259E-05
|
-6,981852653
|
0,0552362
|
|
21
|
Gymnosporia senegalensis
|
3
|
0,004746835
|
2,2532E-05
|
-7,718818247
|
0,03664
|
|
22
|
Hyphaene thebaica
|
10
|
0,015822785
|
0,00025036
|
-5,981852653
|
0,0946496
|
|
23
|
Mangifera indica
|
33
|
0,05221519
|
0,00272643
|
-4,259386629
|
0,2224047
|
|
24
|
Moringa aleifera
|
2
|
0,003164557
|
1,0014E-05
|
-8,303780748
|
0,0262778
|
|
25
|
Ozora insignis
|
3
|
0,004746835
|
2,2532E-05
|
-7,718818247
|
0,03664
|
|
26
Psidium guajava
|
11
|
0,017405063
|
0,00030294
|
-5,84434913
|
|
|
27
Sclerocarya birrea
28
Tamarindus indica
|
18
13
|
0,028481013
0,02056962
|
0,00081117
0,00042311
|
-5,133855747
-5,60334103
|
|
|
29
Ziziphus mauritiana
|
23
|
0,036392405
|
0,00132441
|
-4,780218792
|
|
|
30
Ziziphus spina-christi
|
10
|
0,015822785
|
0,00025036
|
-5,981852653
|
|
0,1017213 0,1462174 0,1152586
0,1739637 0,0946496
0
174
175
Table des matières
DÉDICACE i
REMERCIEMENTS ii
RÉSUMÉ iii
ABSTRACT iii
SOMMAIRE iv
LISTE DES FIGURES v
LISTE DES TABLEAUX vii
LISTE DES PHOTOS viii
LISTE DES PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES ix
LISTE DES ENCADRES x
LISTES DES ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES xi
INTRODUCTION GENERALE 1
1. Contexte de la recherche 1
2. Justification du choix du sujet 3
3. Délimitation du sujet 3
3.1. Délimitation thématique 3
3.2. Délimitation spatiale 4
3.3. Délimitation temporelle 7
4. Revue de la littérature 7
4.1. Caractérisation des formations
végétale pérenne en zone semi-aride 7
4.2. Les facteurs de la dégradation du couvert ligneux.
10
4.3. Conséquence de la dégradation de la
végétation pérenne 12
4.4. Stratégies de gestion et de préservation de
la végétation pérenne en zone semi-aride 14
5. Problématique 16
6. Problème de recherche 18
6.1. Problème générale 18
6.2. Problèmes spécifiques 18
7. Question de recherche 18
7.1. Question générale 18
7.2. Question spécifique 18
8. Objectif de recherche 19
8.1. Objectif général 19
8.2. Objectif spécifique 19
9. 176
Hypothèse de recherche 19
9.1. Hypothèse générale 19
9.2. Hypothèse spécifique 19
10. Cadre conceptuel et théorique 20
10.1. Cadre conceptuel 20
10.2. Opérationnalisation du concept de
dégradation des ligneux pérennes 22
10.3. Cadre théorique 23
11. Méthodologie 26
11.1. Caractérisation des ligneux pérennes 26
11.2. Matériel de collecte des données 27
11.2.1. Matériel de dendrométrie 27
11.2.2. Outils d'identification botanique 29
11.2.3. Outils de collecte de données 29
11.2.4. Matériels de
géo-référencement et d'identification des placettes 30
11.3. La collecte des données 30
11.3.1. Données secondaires 30
11.3.2. La collecte des données primaires 31
12. Traitement et analyse des données 38
12.1. Traitement des données qualitatives 38
12.2. Traitement des données quantitatives 38
12.3. Traitement et analyse cartographique 38
12.4. Traitement et analyse des données botaniques 39
13. Intérêt de la recherche 43
Chapitre 1 : Etat des lieux des ligneux pérennes 45
Introduction 45
1.1. Caractéristiques floristiques et richesses
spécifiques des ligneux pérennes 45
1.1.1. Composition floristique de toutes les espèces
identifiées 45
1.1.2. Composition floristique arborée 47
1.1.3. Composition arbustive 48
1.2. Nombres d'individus 49
1.3. Abondance dominance des familles d'espèces 53
1.4. Les types de formations végétales
présente 55
1.4.1. Formations végétales claires 55
1.4.2. Formations végétales denses 56
1.4.3. Formation végétale d'alignement. 57
1.5. Etat biologique des ligneux pérennes 58
177
1.5.1. Etat des ligneux vivants par placette 59
1.5.2. Etat des ligneux morts par placette 60
1.5.3. Etat des ligneux souffrants par placette 61
1.6. Caractéristiques dendrométriques des
espèces ligneuses 61
1.6.1. Structure du peuplement ligneux par classes de hauteur
62
1.6.2. Classe des circonférences des espèces
67
Conclusion 72
Chapitre 2. Processus de dégradation des ligneux
pérennes 73
Introduction 73
2.1. Etat du couvert ligneux en 2001 et 2021 73
2.1.2. Etat du couvert ligneux en 2001 73
2.1.3. Etat du couvert ligneux en 2021 75
2.2. Processus naturel de la dégradation 78
2.2.1. Insuffisance hydrique et variabilité climatique
importante 78
2.2.2. Indice de diversité des ligneux pérenne
81
2.2.3. Les densités de peuplement des espèces
83
2.3. Processus anthropique de la dégradation des
ligneux pérenne 87
2.3.1. Prélèvement croissant des ligneux 87
2.3.2. Les pratiques agricoles 91
2.3.3. Importance socio-économique des ligneux
pérennes 97
2.4. Les défaillances administratives 99
Conclusion 103
Chapitre 3. Effets de la dégradation des ligneux
pérennes 104
Introduction 104
3.1. Les effets environnementaux de la dégradation des
ligneux pérennes 104
3.1.1. Diminution du nombre de ligneux dans la
localité 104
3.1.2. Forte variation thermique 116
3.1.3. Extension des zones dégradées 118
3.2. Les effets sur les activités humaines 121
3.2.1. Baisse accru des produits agricoles et extension des
zones de cultures 123
3.2.2. Raréfaction des bois d'oeuvres, bois de chauffe
et pharmacopées 127
3.2.3. Raréfaction du pâturage 129
Conclusion 131
Chapitre 4. Stratégie de gestion, de
pérennisation et perspective 132
Introduction 132
4.1. Gestion locale et paysanne des ligneux pérennes
132
178
4.1.1. Plantation des arbres 132
4.1.2. Mesure de pérennisation 134
4.2. Gestion étatique et institutionnelle des ligneux
pérennes. 135
4.2.1. Gestion étatique des ligneux pérennes
135
4.2.2. Gestion institutionnelle des ligneux pérennes
141
4.3. Evaluation des stratégies utilisées 144
4.4. Renforcement de la législation forestière
et perspectives 146
4.4.1. Renforcement de la législation
forestière 146
4.4.2. Perspective pour une gestion durable des ligneux
pérennes 149
Conclusion 153
Discussion des résultats 154
Conclusion générale et recommandation 157
Bibliographie 161
Annexes 166
Table des matières 175
| 


