|
AVERTISSEMENT
« L'Université de Yaoundé II ainsi
que l'Université de Rennes 1 n'entendent donner aucune approbation ni
improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions
doivent être considérées comme propres à l'auteur
».
DEDICACE
À ma mère
dont le courage et l'amour me
soutiennent encore
REMERCIEMENTS
Je me sais classé par ma conscience comme individu
lourdement "endetté" envers mon Directeur de Mémoire, mon Mentor,
Monsieur le Professeur Samuel FAMBON, pour ses précieux orientations et
conseils, sa rigueur et son sens pratique de la recherche. C'est pourquoi, je
lui témoigne l'expréssion de mes profonds et vifs
remerciements.
L'expression de ma gratitude est ensuite formulée
à l'endroit du corps enseignant de la Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion de l'Université de Yaoundé II, en
particulier aux professeurs qui, outre mon Directeur de Mémoire, ont
animé les cours pendant l'année académique 2014-2015, en
l'occurence Messieurs les Professeurs Jean-Marie GANKOU, Désiré
AVOM et Mme le Professeur Valerie ONGOLO ZOGO.
J'extériorise aussi ma reconnaissance du savoir
à l'égard des professeurs animateurs des Cours et
Conférences de l'Université de Rennes 1 en général,
en particulier aux enseignants qui sont intervenus dans le cadre du Master II
Ingénierie Economique et Financière, précisément
Messieurs les Professeurs Jean-Jacques DURAND, Jean-Christophe POUTINEAU et
Christophe TAVERA.
Je ne saurais intérioriser ma gratitude
vis-à-vis de la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) du Cameroun, de
son Personnel Administratif pour leur aide à la collecte des
données relatives à la dette extérieure durant le stage
effectué en août 2015.
A Monsieur le Docteur Marius BENDOMA, j'exprime mes
sincères remerciements pour sa disponibilité instantanée
à répondre à mes sollicitations.
L'acte de relecture de ce Mémoire,
exécuté par Monsieur Alexandre IROUME, dicte mon esprit à
l'associer à mes remerciements.
Je me sais redevable à d'anciens Diplômés
du Master Ingénierie Economique et Financière, en l'occurrence
Mlle Kelly SEGUEP, Monsieurs Hervé YAKAN, Martini MBOCK pour leurs
encouragements, leur soutien moral et leur collaboration; à tous je dis
Merci!
Que les Responsables du LAREM (Laboratoire de Recherche en
Economie Mathématique) de l'Université de Yaoundé II,
trouvent ici l'expression de ma reconnaissance.
Il va de soi que les membres de ma famille figurent parmi ceux
envers lesquels je suis le plus reconnaissant. Mes chers parents M. et Mme
NOUNAMO, M. et Mme KWUIMO, je vous serai éternellement reconnaissant
pour tous vos efforts et encouragements. Mes frères et soeurs (Cindy,
Estrella, Chris-Gérald), sans oublier Audrey, Gael, Julie, Yannick; je
vous remercie tous individuellement pour votre amour et votre réconfort
dans les moments de doute. Rien de tout cela n'aurait pu voir le jour sans vous
tous. Je tire la révérence à tous ceux qui de
près ou de loin m'ont apporté leur soutien et encouragements, et
que je n'ai pas pu citer ici. La liste ne pouvant être exhaustive, je les
remercie grandement.
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT
I
DEDICACE
II
REMERCIEMENTS
III
SOMMAIRE
IV
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
V
LISTE DES ILLUSTRATIONS ET GRAPHIQUES
VI
RESUME
VII
ABSTRACT
VIII
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE :
REVUE DE LA LITTERATURE ET EVOLUTION GLOBALE DE LA
DETTE EXTERIEURE ET DE LA FUITE DES CAPITAUX AU CAMEROUN
3
CHAPITRE 1 :
REVUE DE LA LITTERATURE SUR LA RELATION ENTRE LA
DETTE EXTERIEURE ET LA FUITE DES CAPITAUX
3
1. DETTE EXTERIEURE ET FUITE DES
CAPITAUX : REVUE DE LA LITTERATURE THEORIQUE
13
2. REVUE DE LA LITTÉRATURE EMPIRIQUE
SUR LA RELATION ENTRE LA DETTE EXTÉRIEURE ET LA FUITE DES CAPITAUX
19
CHAPITRE 2 :
EVOLUTION GLOBALE DE LA DETTE EXTERIEURE ET DE LA
FUITE DES CAPITAUX AU CAMEROUN
3
1. EVOLUTION GLOBALE DE LA DETTE EXTERIEURE
AU CAMEROUN
25
2. LA FUITE DES CAPITAUX AU CAMEROUN :
ANALYSE EN VALEUR ET EN POURCENTAGE DE LA DETTE EXTERIEURE
31
DEUXIEME PARTIE :
DETTE EXTERIEURE ET FUITE DES CAPITAUX AU
CAMEROUN : ANALYSE EMPIRIQUE
3
CHAPITRE 3 : APPROCHE METHODOLOGIQUE
43
1. SPÉCIFICATION DU
MODÈLE :
44
2. PROCÉDURE D'ESTIMATION DU
MODÈLE :
52
CHAPITRE 4 : RESULTATS ET RECOMMANDATIONS
58
1. PRÉSENTATION DES
RÉSULTATS
59
2. INTERPRETATIONS DES RESULTATS ET
RECOMMANDATIONS DE POLITIQUES ECONOMIQUES
66
CONCLUSION GENERALE
71
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
74
ANNEXES
80
TABLE DES MATIERES
86
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
AFD : Agence Française de
Développement
ANIF : Agence Nationale d'Investigation
Financière APD : Aide
Publique au Développement
BAD : Banque Africaine de Développement
BEAC : Banque des Etats de l'Afrique
Centrale BdP : Balance de Paiements
BRI : Banque des Règlements
Internationaux D: Contrat de
Désendettement et de Développement
CAA : Caisse Autonome d'Amortissement.
CEMAC : Communauté Economique
et Monétaire d'Afrique Centrale CIA :
Central Intelligence Agency
CONAC : Commission Nationale Anti-corruption
DET : Dette Extérieure
FASR : Facilité
d'Ajustement Structurel Renforcée
FCFA : Franc de la Coopération Financière
en Afrique FIDA : Fonds
International pour le Développement de l' Agriculture
FMI : Fond Monétaire International
FRPC : Facilité pour la
Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance
GAFI : Groupe d'Action Financière
IADM : Initiative d'allégement de
la Dette Multilatérale IDA :
International Development Association IDE :
Investissement Direct Etranger
IPPTE : Initiative d'allègement de la dette des
Pays Pauvres Très Endettés
OMD : Objectifs du Millénaire pour le
Développement
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OPEP : Organisation des Pays Exportateurs de
Pétrole PAS : Plans
d'Ajustement Structurel PIB : Produit
Intérieur Brut UEMOA :
Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
VA : Valeur Actualisée
LISTE DES ILLUSTRATIONS ET GRAPHIQUES
Tableau 1.1: Liens entre l'emprunt
étranger et la fuite des capitaux
Graphique 2.1 : Evolution du stock de la
dette extérieure du Cameroun.
Graphique 2.2 : Service de la dette en % des
recettes d'exportations
Graphique 2.3 : Evolution du ratio
service de la dette extérieure/ Recettes publiques
Graphique2.4 : Evolution de la fuite des
capitaux du Cameroun
Graphique 2.5 : Evolution de la fuite des
capitaux en pourcentage de la dette extérieure
Tableau 3.1 : Récapitulatif des
différents signes attendus des variables du modèle
Tableau 4.1 : Résultats des tests
de racine unitaire ADF et PP : Tableau
4.2 : Statistiques des tests de Wald
Tableau 4.3: Fuite des capitaux et dette
extérieure : élasticités de court terme
Tableau 4.4 : Fuite des capitaux et dette
extérieure : élasticités de long terme
Tableau 4.5 : Récapitulatif des
Tests de Diagnostic Graphique 4.1 :
Test de CUSUM Graphique 4.1 :
Test de CUSUM Carré
RESUME
Ce mémoire analyse la relation entre la dette
extérieure et la fuite des capitaux au Cameroun sur la période
1970-2010. Partant des limites de l'approche de cointégration de
Johansen, nous utilisons la méthodologie autorégressive à
retards échelonnés (ARDL) de cointégration de Pesaran et
al. (2001) pour déterminer le lien entre la dette extérieure et
la fuite des capitaux. Les données utilisées proviennent de la
Caisse Autonome d'Amortissement du Cameroun, du World Development Indicator de
la Banque Mondiale et de la base de Boyce et Ndikumana (2012). Nos
résultats montrent qu'à court terme, la hausse d'un dollar de la
dette extérieure entraine une augmentation de 54 centimes de la fuite
des capitaux; une situation qui diminue progressivement au fil du temps. En
outre, la fuite des capitaux du Cameroun est causée par l'aide publique
au développement, l'ouverture commerciale et la rente provenant des
ressources naturelles, en particulier la rente pétrolière.
Mots clés : dette
extérieure, fuite des capitaux, ARDL, Cameroun
ABSTRACT
This Master thesis analyses the relationship between external
debt and capital flight in Cameroon for the period 1970-2010. Based on the
limits of the approach of Johansen cointegration, we use the autoregressive
Distributed lag (ARDL) methodology of cointegration of Pesaran and al. (2001)
to determine the relationship between external debt and capital flight. The
data used come from the Autonomous Sinking Fund of Cameroon, World Development
Indicator of the World Bank and the base of Boyce and Ndikumana (2012). Our
results show that in the short term, the rise of a dollar in external debt
leads to an increase of 54 cents of capital flight; a situation which gradually
decreases over time. Moreover, the capital flight of Cameroon is caused by
official development assistance, trade openness and the rent from natural
resources, particularly oil rents.
Keywords: external debt, capital
flight, ARDL, Cameroon
INTRODUCTION GENERALE
La recherche du bien-être est une aspiration
profonde et constante de l'homme. Quelle que soit la région du monde
où ils appartiennent, les hommes imaginent et déploient les
efforts tendant à l'amélioration de leur cadre et de leur niveau
de vie.
Les pays développés et en développement
mettent en oeuvre et affinent de façon continue, des politiques et des
stratégies de croissance économique afin de réaliser cet
objectif.
Cependant, la rareté des ressources, en particulier
celle du facteur capital et la faible capacité d'absorption de ce
dernier du fait de l'accumulation insuffisante, amènent les pays en
développement (PED) à décupler des efforts pour
améliorer le niveau de vie de leurs habitants.
Ces deux groupes de pays entretiennent mutuellement des
courants d'échanges commerciaux et de relations multiples
(diplomatiques, économiques, financières, d'assistance
technique...). Ces relations font intervenir les Etats, les institutions
publiques et privées, commerciales et bancaires.
Les efforts de développement entrepris par les PED,
sont-ils faut-il l'avouer, fortement influencés par le comportement du
monde développé, nanti de puissants moyens techniques et
financiers. Le chemin parcouru par les PED est suffisamment long aujourd'hui
pour mesurer les progrès accomplis, et porter un jugement de valeur sur
telle politique mise en oeuvre et recenser les conditions et les moyens sur
lesquels il convient de mettre l'accent en vue d'une amélioration des
performances.
Dans ce contexte, la dette extérieure comme source de
financement des investissements des PED et l'amélioration des balances
de paiements desdits pays est nécessaire. En effet, le financement de la
croissance à l'aide d'emprunt étranger est une
nécessité pratiquée par les PED mais les modalités
et les conditions de ces emprunts sont diverses.
L'endettement agit sur le pays emprunteur par ses effets en
capital et en coût. Un endettement trop faible serait sans effet sur le
processus de développement. Un endettement trop fort, par la lourdeur de
la charge à rembourser, pourrait bloquer le processus de
développement et provoquer des sorties massives de capitaux.
C'est dans cette situation de sorties massives de capitaux que
se trouvent bon nombre de PED depuis plusieurs décennies. C'est sans
doute ce qui justifie la littérature florissante sur le
phénomène de fuite de capitaux. Ce phénomène frappe
avec une particulière gravité l'ensemble des Etats Africains au
Sud du Sahara en général, et en particulier ceux de la Zone Franc
et dont le Cameroun.
1. Contexte de
l'étude
L'endettement est un
phénomène universel que l'on retrouve dans tous les pays, en
particulier dans les pays en voie de développement (PED)
confrontés à une insuffisance de l'épargne interne.
L'endettement extérieur, qui constitue un appel aux capitaux
étrangers, sert d'appoint à cette épargne et permet de
financer les projets d'investissement nécessaires à la
croissance. La dette extérieure est donc censée jouer un
rôle de catalyseur dans la mutation structurelle des PED.
Dans cette optique, les emprunts étrangers sont apparus
comme un élément essentiel intégré au processus de
développement de ces économies. Toutefois, cet endettement
s'accompagne aussi de phénomènes négatifs tels que la
fuite des capitaux. Pour ces pays, ce phénomène représente
un réel frein à la croissance à travers son impact
négatif sur le niveau d'investissement des économies en
développement.
La fuite des capitaux est un concept économique qui
n'est pas récent. Si les premières réflexions pourraient
remonter à Smith (1776), c'est avec la crise d'endettement de certains
pays d'Amérique latine (Mexique et Argentine) dans les années 80
que l'attention pour la fuite des capitaux est devenue considérable.
Déclenchée en Août 82 par l'effondrement financier du
Mexique qui ne pouvait plus faire face à une dette extérieure de
80 milliards de dollars, cette crise d'endettement a entrainé dans son
sillage d'autres PED et dont le Cameroun (Touna Mama, 1996).
Une crise qui, à la base était une crise
d'endettement s'est vue intensifiée par le comportement des plus riches
résidents, qui, en investissant massivement dans des actifs
étrangers, ont entrainé un épisode de fuite massive des
capitaux. Comme solution à ce problème, le FMI1(*) et les Etats-Unis
d'Amérique ont imposé à ces pays une série de
réformes économiques à adopter afin d'être
admissibles à un allègement de leurs dettes. Ces réformes
inscrites dans le cadre du « Plan Brady 2(*)» avaient pour objectif de
ramener les capitaux sorties à travers des mesures telles que la
déréglementation des marchés financiers,
l'austérité budgétaire, la dépréciation de
la monnaie, la baisse des salaires et l'augmentation des taux
d'intérêt.
Même si le plan Brady a permis à certains de ces
pays d'Amérique latine de résoudre leurs problèmes de
dettes extérieures, à partir du milieu des années 90, de
nombreuses crises financières accompagnées d'épisode de
fuite de capitaux ont encore surgi dans certaines de ces économies.
Particulièrement la crise Mexicaine entre 1994 et 1995, ensuite celle du
Japon en 1997, suivie de la crise brésilienne en 1998.
Aujourd'hui encore, les problèmes de dette
extérieure et de fuite des capitaux se posent avec acuité et
touchent aussi bien les économies développées que les
économies en voie de développement. En Europe par exemple, elle a
davantage pris la forme de la crise de la dette et le cas de la Grèce
est assez parlant à ce sujet. En 2010, la dette Grecque s'élevait
à 300 milliards d'euros soit 130% du PIB avec une progression annuelle
de 12%, ce qui à l'évidence est insoutenable malgré les
multiples plans de relances proposés, qui n'apportent pas toujours de
solutions appropriées et acceptées par tous. Par ailleurs, nombre
de pays européens ont vu leur dette totale exploser au premier rang
desquels l'Irlande, avec 172 points de pourcentage de hausse par rapport au PIB
entre 2007 et 2014, suivie par Singapour (129%), le Portugal (100%)3(*). Ce qui permet de
reconsidérer fortement la vision des économistes classiques qui
voyaient dans la dette une entrave au développement économique.
De même, dans la zone euro, la récente crise de la dette publique
qui a éclaté juste après celle des
« Subprimes4(*) » des Etats-Unis d'Amérique a
entrainé la fuite des capitaux des pays du Sud5(*) de l'Europe vers ceux du
Nord6(*). Ainsi en trois
ans, 600 milliards d'euro ont été rapatriés d'Espagne et
d'Italie vers l'Allemagne et la France, qui à ce moment
représentaient des investissements plus sûrs.
En Afrique, d'après le dernier rapport de l'organisme
international Global Financial Integrity7(*) les flux financiers illicites sortant du continent ont
représenté au moins 29 milliards de dollars par an entre 1970 et
2008 (hors inflation). L'estimation de ces flux est encore plus forte pendant
la période 2001-2008, qui a été marquée par une
forte croissance, à cause de la hausse des prix des matières
premières. Cette estimation s'élève à près
de 54 milliards de dollars par an en moyenne durant cette période, et
même 90 milliards en 2007 et 2008.
Au Cameroun, l'encours de la dette publique est composé
au 30 juin 2015, de 72,5% de dette extérieure, soit 2767 milliards de
FCFA et 21,1% de dette intérieure correspondant à 1031 milliards
de FCFA. A cela s'ajoute les récentes crises sociales, notamment les
problèmes d'insécurité liés au groupe terroriste
Boko Haram, la crise centrafricaine et la crise d'Ebola et ses
répercussions.
Selon Ndikumana et Boyce (2013), l'Afrique est victime d'une
fuite de capitaux considérable à la fois en valeur absolue et en
proportion du PIB : plus de 700 milliards de dollars entre 1970 et 2008.
Ils estiment les pertes financières des 33 pays d'Afrique subsaharienne
à 944 milliards de dollars sur cette période de 39 ans. En
outre, dans une étude sur la fuite des capitaux des pays à
faible revenu et lourdement endettés d'Afrique subsaharienne sur la
période 1980-1991, Ajayi (1997) constate que la fuite des capitaux de
la période avoisine plus de 40% de la dette extérieure pour un
échantillon de 18 pays, et que le ratio était de 94% pour le
Nigeria et le Rwanda,74% pour le Kenya, et 60% pour le Soudan. Ils constatent
que les pays qui présentent la plus grande fuite de capitaux sont
souvent aussi les plus fortement endettés et caractérisent cette
situation de « problèmes jumeaux»8(*).
D'autres études à l'instar de celle de
Ndikumana et Boyce (2011), soulignent que trois pays de la Zone Franc (ZFA)
sont parmi les dix premiers pays d'Afrique subsaharienne possédant les
fuites des capitaux les plus élevées. C'est ainsi que la
Côte d'Ivoire occupe la 3ème position (45,4 milliards de dollars
soit 194,1% du PIB) ; le Cameroun la 7ème position (24 milliards de
dollars soit 102,8% du PIB) et le Congo la 8ème position (23,9
milliards de dollars soit 223,4% du PIB). Les chiffres précédents
montrent que les pays de la ZFA sont très affectés par le
phénomène de fuite massive de capitaux. Cet argument est
complété par Ndiaye (2012) pour qui, la zone CEMAC est la
région de la ZFA la plus affectée par la fuite massive des
capitaux (près de 81,5% de la fuite des capitaux de la ZFA, soit
environ 65,3 milliards de dollars en zone CEMAC contre environ 14,9 milliards
de dollars en zone UEMOA.
De tels résultats révèlent les deux
constats suivants : d'une part, si un pays appartient à la CEMAC,
alors il appartient à une zone géographique où l'ampleur
de la fuite des capitaux est très élevée. D'autre part, le
Cameroun est le pays de la zone CEMAC le plus affecté par le
phénomène de la fuite des capitaux.
Une difficulté
rencontrée avec l'analyse de la fuite des capitaux concerne sa
définition. Si l'on considère de façon
générale que la fuite des capitaux est la sortie des capitaux
d'un pays vers l'extérieur pour un motif ou un autre, dans la
littérature économique, « II n'y a aucun consensus sur
la définition de la fuite des capitaux ». Cette remarque,
faite par Hermes, Lensink et Murinde (2002a) et Macleod (2002),
révèle l'existence de diverses méthodes de mesure de la
fuite des capitaux. Plusieurs études suggèrent que la fuite des
capitaux doit être distinguée des sorties normales de capitaux
(Deppler et Williamson, 1987 ; Walter, 1987 ; Kindleberger, 1987) pendant que
d'autres auteurs comme Erbe (1985), la Banque Mondiale et Morgan Guaranty Trust
Company9(*), soutiennent que
la fuite des capitaux ne doit pas être distinguée des flux normaux
extérieurs de capitaux, et la définissent comme toutes les
sorties de capitaux privés de toute espèce qui aboutissent
à l'acquisition d'avoirs extérieurs par les résidents d'un
pays.
Au cours de notre analyse, aucune distinction ne sera faite
entre sorties normale et anormale de capitaux. Ainsi donc, nous
considèrerons la fuite des capitaux telle que définie par la
méthode résiduelle de la Banque Mondiale. Nous tiendrons aussi
compte des différents ajustements associés à cette
méthode notamment, l'ajustement aux falsifications des transactions
commerciales (Lessard et Williamson; 1987), l'ajustement aux fluctuations du
taux de change `-(
Boyce et Ndikumana, 2001) ainsi
que les ajustements aux annulations de dettes, aux envois de fonds
non-enregistrés et à l'inflation -(
Ndikumana et Boyce, 2010).
2. Problématique
La question de la fuite des capitaux des pays d'Afrique
Sub-Saharienne (ASS) a suscité une attention considérable dans la
littérature économique durant ces dernières
décennies. Ceci est particulièrement la conséquence des
travaux des chercheurs (Boyce et Ndikumana, 2001 ; Collier, Hoeffler et
Pattillo, 2004; Ndiaye, 2004) qui ont mis en exergue le fait que depuis
les années 1970, des sommes importantes sous forme de fuite des
capitaux sortent du continent africain, considéré comme
pauvre. Les études menées par Ndikumana et Boyce (2011),
BAD 10(*)et GFI11(*) (2013) ont mis en
évidence le fait que l'Afrique fournit plus de capitaux qu'il ne
reçoit du reste du Monde. Pourtant, les niveaux de dette insoutenables
atteints par la plupart des pays d'ASS durant les dernières
décennies peuvent être pointés du doigt comme l'une des
causes majeures de la faiblesse de la croissance économique de ces pays,
y compris le Cameroun.
En se concentrant sur la dette extérieure du Cameroun,
le constat qui se dégage est qu'elle a connu une progression remarquable
au fil des années. En effet, son encours total est passé de 260,3
millions de dollars en 1971 à 1 485 millions en 1980 et 2 674 millions
de dollars en 1981, représentant ainsi environ 10 fois le volume des
dettes de l'année 1971 (Fambon, 2002). Dans le même temps, la
fuite des capitaux de la région a suivi une tendance parallèle,
notamment depuis le début de l'exploitation pétrolière
dans le pays en 1978 (Bendoma, 2012).
Ainsi, en se penchant sur
le cas spécifique du Cameroun sur la période 1970-2010, notre
sujet répond aux interrogations suivantes :
Quelle est la relation entre la dette
extérieure et la fuite des capitaux au Cameroun ?
Cette question principale nous amène à poser les
deux questions subsidiaires ci-après :
-Quels sont les effets de la dette extérieure sur la
fuite des capitaux au Cameroun ?
-Quels sont les effets de la fuite des capitaux sur la dette
extérieure au Cameroun ?
Ces deux questions constituent la préoccupation de
notre étude en vue d'atteindre les objectifs que nous nous proposons
dans le cadre de ce travail.
3. Objectifs de
l'étude
L'objectif principal de notre travail est d'analyser la
relation entre la dette extérieure et la fuite des capitaux au Cameroun.
Il s'agit plus spécifiquement de déterminer :
· d'une part, les effets de la dette extérieure
sur la fuite des capitaux au Cameroun,
· d'autre part, les effets de la fuite des capitaux sur
la dette extérieure au Cameroun.
Ces objectifs constituent les phases de la recherche et
l'ossature du plan du travail choisi. Nous les développerons dans ce qui
suit en les rapportant des travaux antérieurs que nous jugeons les plus
pertinents eu égard aux buts de l'étude. Nous ne pouvons dresser
ici, un état de l'ensemble des travaux antérieurs, étant
donné la diversité des thèmes abordés qui, bien
qu'étant complémentaires, rendent difficile une
présentation homogène de cette recherche. Aussi
préférons-nous par soucis de clarté de l'exposé,
aborder progressivement la plus grande partie de ces travaux.
4. Hypothèses de
l'étude
Pour atteindre nos
objectifs, la formulation d'un certain nombre d'hypothèses est
indispensable :
Hypothèse 1 :
Une augmentation de la dette extérieure entraine un accroissement de la
fuite des capitaux au Cameroun.
Hypothèse 2 :
Un accroissement de la fuite des capitaux entraine une augmentation de la dette
extérieure au Cameroun.
L'articulation de la recherche autour de ces deux
hypothèses indique l'intérêt général de la
démarche.
5. Intérêt de
l'étude
Cette étude
présente non seulement un intérêt pratique, mais aussi
méthodologique.
Au plan pratique, il convient de noter au préalable
que, la communauté internationale dans son ensemble que l'on soit du
Nord ou du Sud est largement concernée et éprouvée
à l'heure actuelle par un phénomène, celui de
l'endettement qui alimente les débats dans les différentes
rencontres internationales et constitue davantage un grand sujet de
préoccupation lorsqu'on y mêle la fuite des capitaux. Cette
situation due à la conjonction de plusieurs facteurs est d'autant plus
crucial que la masse financière en jeu est colossale. Les montants en
cause, face aux difficultés des économies africaines,
amènent à s'interroger sur les voies de réduction
possibles de la fuite des capitaux d'une part, et, d'autre part, sur les moyens
de mieux gérer la dette extérieure.
Un sujet d'une telle importance et d'une si brûlante
actualité mérite à n'en pas douter un examen attentif.
Au plan méthodologique, cette étude tente de
contribuer à la littérature empirique en examinant pour le cas du
Cameroun, la relation entre la dette extérieure et la fuite des
capitaux, en utilisant l'approche autorégressive à retards
échelonnés (ARDL) de cointégration proposée par
Pesaran, Shin et Smith(2001)12(*). Cette approche a l'avantage d'établir
simultanément les dynamiques de court et de long terme entre les
variables du modèle sans se préoccuper de l'ordre
d'intégration des séries.
6. Bref aperçu
méthodologique
Afin d'atteindre nos objectifs, nous avons adopté une
approche méthodologique rigoureuse constituée de trois
étapes : la première étape consiste à
vérifier les propriétés des séries chronologiques
telles que la stationnarité et l'ordre d'intégration à
l'aide des tests de racine unitaire de Dickey-Fuller Augmenté (ADF) et
de Phillips-Perron (PP). La deuxième étape utilise la technique
de cointégration développée par Pesaran et al. (2001) pour
examiner la relation d'équilibre de long terme entre les variables
retenues dans notre modèle. La troisième étape consistera
à estimer les coefficients de court terme et de long terme afin
d'apprécier la relation entre la dette extérieure et la fuite des
capitaux au Cameroun. Notre analyse utilise des données des
séries temporelles allant de 1970 à 2010. Deux modèles
économétriques inspirés des travaux de Chipalkatti et
Rishi (2001) sont estimés dans cette étude.
7. Organisation du
travail
Une organisation équilibrée de ce travail impose
une structure en deux parties, recoupées en quatre chapitres :
la première partie comporte deux chapitres :
Le premier chapitre est axé sur la présentation
de quelques travaux théoriques et empiriques relatifs à l'analyse
de la relation entre la dette extérieure et la fuite des capitaux. Il
importe de noter que le débat sur l'endettement extérieur et sur
la fuite des capitaux pris séparément est riche en idées
et controverses et qu'une littérature abondante existe sur ces
différents aspects.
Le chapitre deux offre un panorama de l'évolution
globale de la dette extérieure et de la fuite des capitaux au Cameroun
sur la période de l'étude afin de mettre en relief les
montants de la fuite des capitaux selon les périodes marquantes
de l'histoire du Cameroun, et d'établir à priori des liens avec
la dette extérieure. Nous présenterons également dans ce
chapitre les mesures mises sur pied au Cameroun et sur le plan international
contre la fuite des capitaux.
la deuxième partie comporte également deux
chapitres :
Le troisième chapitre propose une ébauche
méthodologique ainsi que les différents variables
utilisées dans l'étude.
Le chapitre quatre procède à une
présentation et à une interprétation des principaux
résultats de la régression et des tests de nos modèles. En
outre, ce chapitre présente les recommandations de politique
économiques qui découlent directement des résultats
obtenus de l'analyse empirique.
PREMIERE PARTIE :
REVUE DE LA LITTERATURE ET EVOLUTION GLOBALE DE LA DETTE
EXTERIEURE ET DE LA FUITE DES CAPITAUX AU CAMEROUN
INTRODUCTION A LA PREMIERE PARTIE
L'occurrence simultanée de montants
élevés de dette extérieure et de fuites massive des
capitaux dans les pays d'Amérique Latine au début des
années 1980 a attiré l'attention des économistes durant
cette période (Pastor, 1990).
En effet, suite aux conditions économiques
défavorables dues à la crise de la dette des pays
latino-américains, s'est suivi de volumes élevés de
sorties de capitaux de la part des résidents de ces pays en direction
des pays développés afin d'éviter la perte de leurs
avoirs. C'est ainsi que la littérature sur la fuite des capitaux s'est
développée. Bien qu'elle ne fasse pas l'unanimité, cette
littérature repose essentiellement sur sa définition, la
problématique de sa mesure, ses déterminants, ainsi que ses
effets sur la croissance économique des pays en développement
(Fofack, 2008).
Lorsqu'on s'intéresse à la dette
extérieure et à la fuite des capitaux, on trouve une
littérature assez fournie. Cependant, l'effort de prolonger le
débat sur leurs liens reste très attendu. Il est
intéressant d'examiner la relation qui existe entre la dette
extérieure et la fuite des capitaux car au coeur de certains
débats économiques de l'heure (cas de la Grèce par
exemple).
Dans cette première partie, nous nous
intéressons au préalable à la revue de la
littérature aussi bien théorique qu'empirique (chapitre un).
Ensuite, des analyses descriptives sont proposées afin d'observer
clairement l'évolution de la dette extérieure et de la fuite
des capitaux, question d'évaluer à priori l'ampleur de ce
phénomène au Cameroun (chapitre deux).
Ainsi, l'objectif de cette première partie du travail
est de présenter la revue de la littérature inhérente
à la relation entre la dette extérieure et la fuite des capitaux
d'une part, et, d'autre part d'examiner (en nous appuyant sur des
données collectées sur la période 1970 à 2010) leur
évolution au Cameroun.
CHAPITRE 1 :
REVUE DE LA LITTERATURE SUR LA RELATION ENTRE LA DETTE
EXTERIEURE ET LA FUITE DES CAPITAUX
La relation entre la dette extérieure et la fuite des
capitaux a largement été débattue dans la
littérature économique. Les premières réflexions
remontent à Smith (1776) suite aux énormes progrès des
dettes en Europe. Mais c'est avec la crise d'endettement survenue dans les pays
d'Amérique latine au début des années 80 que les
économistes se sont particulièrement penchés sur la
question. Cette crise s'est manifestée par des fuites
massives de capitaux de la part des plus riches résidents; ce qui a
attiré l'attention des chercheurs qui ont proposé des
méthodes de mesure de la fuite des capitaux et évaluer ses effets
sur la croissance économique (Pastor, 1990).
Par la suite, dans les années 90, l'occurrence
simultanée des montants élevés de dette extérieure
et de fuite massive de capitaux a de nouveau suscité l'attention des
chercheurs. Leurs préoccupations étaient de savoir quel est le
lien entre la dette extérieure et la fuite des capitaux étant
donné que la fuite des capitaux était quantitativement importante
lorsque le niveau de l'endettement était élevé dans le
pays étudié (Boyce, 1992 ; Ajayi, 1995).
L'objet de ce premier chapitre est de faire une revue de la
littérature sur la relation entre la dette extérieure et la fuite
des capitaux. Dans la première partie, il est question de
présenter une revue de la littérature théorique des
effets de la dette extérieure sur la fuite des capitaux et vice versa.
La deuxième partie porte sur une revue de la littérature
empirique en distinguant les résultats obtenus sur des pays pris
individuellement de ceux portant sur des échantillons de plusieurs
pays.
1. DETTE EXTERIEURE ET FUITE DES
CAPITAUX : REVUE DE LA LITTERATURE THEORIQUE
La littérature théorique sur la relation entre
la dette extérieure et la fuite des capitaux dans les pays en
développement fait l'objet d'un grand nombre d'études, à
cause de ses conséquences en matière de réduction de la
pauvreté dans ces pays (Ndiaye, 2012).
De manière fondamentale, la théorie
keynésienne admet que la dette joue un rôle précieux pour
l'économie en raison de nouveaux investissements que l'endettement
suscite. Par le biais de l'effet multiplicateur, elle permet d'accroître
la demande globale et stimule la croissance13(*). Par conséquent, la dette extérieure,
comme source de financement des investissements des pays en
développement, est nécessaire.
En revanche, la théorie classique considère
l'endettement public comme inutile, sinon nocive à l'économie.
Considérant la conception de Smith (1776), le financement
extérieur est une source d'appauvrissement pour les pays car non
seulement la dette fait intervenir le paiement des intérêts, mais
aussi, cela pourrait engendrer des sorties de capitaux. C'est dans ce sens que
Smith (1776) affirme : « quand, à raison de la perception de
ces impôts, (...) tous ou la plus grande partie de ceux qui
font valoir de grands capitaux, viennent à être
continuellement exposés aux visites fâcheuses et aux
recherches vexatoires des collecteurs de l'impôt, cette disposition
à changer de résidence se réalise bientôt par une
émigration ».
Ainsi, Les classiques considèrent que les citoyens
voient dans la dette extérieure une augmentation des impôts dans
le futur (équivalence ricardienne14(*)), une hausse des taux d'imposition qui
décourage le travail comme le précise le raisonnement
développé par la courbe de Laffer15(*).
La littérature économique sur la relation entre
la dette extérieure et la fuite des capitaux dans les pays en
développement a connu une attention particulière suite à
la crise d'endettement survenue en Amérique latine dans les
années 80. De nombreuses études, à l'instar de Boyce
(1992), Hermes et Lensink (1992), Chipalkatti et Rishi (2001), Boyce et
Ndikumana (2001), Beja (2006) et Fofack (2009) montrent que la fuite des
capitaux est quantitativement importante lorsque le niveau de l'endettement est
élevé dans le pays.
Dans cette littérature, les liens entre les deux sont
analysés en utilisant un modèle de « porte
financière tournante »16(*). Brièvement, ce modèle postule des
liens directs et des liens indirects qui tendent à montrer que la dette
extérieure et la fuite des capitaux s'engendrent mutuellement. La
sous-section qui suit est consacrée à la présentation de
ces deux types de liens.
1.1. LIENS DIRECTS ENTRE LA
DETTE EXTERIEURE ET LA FUITE DES CAPITAUX
La
relation entre la dette extérieure et la fuite des capitaux a beaucoup
de facettes. Les auteurs comme Boyce (1992), Ajayi (1995) et Ndikumana et
Boyce (2013) ont distingué quatre types de liens possibles entre les
deux : la fuite des capitaux peut découler de la dette
extérieure; la dette extérieure peut accélérer
la fuite des capitaux; l'emprunt étranger peut être
poussé par la fuite des capitaux; enfin, la fuite des capitaux peut
accélérer la dette.
Ces
liens sont brièvement illustrés dans le tableau suivant :
Tableau 1.1: Liens entre l'emprunt
étranger et la fuite des capitaux
|
Dette
à Fuite des capitaux
|
Fuite
des capitaux à Dette
|
|
Motivation et financement
|
Fuite
des capitaux alimentée par la dette
|
Emprunt
étranger alimenté par la fuite des capitaux
|
|
Motivation uniquement
|
Fuite
des capitaux induite par la dette
|
Emprunt
étranger induit par la fuite des capitaux.
|
Source : Ndikumana et Boyce
(2013)
Dans
le premier cas, la causalité va de la dette extérieure à
la fuite des capitaux. Dans un premier temps, l'augmentation de la dette
extérieure provoquerait un effet d'éviction des capitaux
privés (Kindleberger, 1987). Dans un deuxième temps, c'est la
dette extérieure qui financerait directement la fuite des capitaux via
certains mécanismes illicites (Ndikumana et Boyce, 2003 ; 2013 ; Ndiaye,
2004).
1.1.1. Fuite des capitaux
induite par la dette extérieure
Dans ce cas, l'emprunt étranger conduit uniquement
à la fuite des capitaux, mais ne fournit pas les capitaux (Ndikumana et
Boyce, 2013). L'explication provient de l'impact anticipé de la dette.
En effet, l'entrée d'argent emprunté provoque à court
terme, une appréciation de la monnaie nationale. Par contre, sur le
long terme, à mesure que le stock de la dette s'accumule, la perspective
que le transfert net devienne négatif augmente elle aussi, induisant
in fine une dépréciation de la monnaie nationale.
En plaçant ses capitaux sur des comptes
offshores17(*) en monnaie
forte tandis que la valeur de la monnaie locale est artificiellement
gonflée, l'auteur de la fuite des capitaux se prémunit contre le
risque de change. Il pourrait également engranger un
bénéfice en cas de dévaluation de la monnaie.
Ce point de vue est appuyé par Conesa (1987) pour qui
les décaissements importants au titre de la dette extérieure dans
un pays fournit une pression à la hausse sur sa monnaie ; ce qui motive
les résidents à convertir leurs avoirs en dollar avant une
dévaluation attendue.
De même, l'endettement croissant peut éveiller
parmi les individus fortunés la crainte qu'une augmentation
d'impôts ou d'autres réglementations ne dévalorisent les
actifs détenus dans le pays, ce qui les incite à placer une
partie de leur argent à l'étranger (Ajayi, 1995). Par exemple,
une dette publique excessive serait de nature à créer chez les
investisseurs des anticipations d'une hausse explicite ou implicite de la
fiscalité comme moyen pour permettre à l'Etat de payer le service
de la dette. De telles anticipations aboutissent à une baisse du
rendement espéré du capital après taxe, se traduisant par
un découragement de l'initiative d'investir et peuvent être
à l'origine de fuite de capitaux privés.
Les capitaux quittent donc un pays en réponse à
des circonstances économiques qui en découlent directement
attribuables à la dette extérieure.
1.1.2. Fuite des capitaux
alimentée par la dette extérieure18(*)
Ici, c'est par exemple le cas lorsque les emprunts
contractés par les Gouvernements africains auprès des
créanciers étrangers financeraient l'accumulation d'avoirs
privés via certains mécanismes illicites : détournement de
fonds, dessous-de-table lors de la passation des marchés publics,
gonflement des prix d'achat, etc.). Ceux qui en bénéficient
placent ensuite tout ou une partie de ces fonds en lieu sûr à
l'étranger (Ndikumana et Boyce, 2013).
Des auteurs comme Henry(1986), Cuddington (1987) et Duwendag
(1989) appuient ce point de vue. Ils font remarquer que la dette
extérieure peut directement causer la fuite des capitaux en fournissant
aux dirigeants corrompus les ressources nécessaires à effectuer
cette fuite.
Parallèlement, la littérature suggère que
l'emprunt étranger peut être induit et alimenté par la
fuite des capitaux. Dans le premier cas, la fuite des capitaux crée un
besoin de fonds de remplacement, ce qui incite l'Etat à s'endetter
(Ajayi, 1992). Dans le second cas, les détenteurs d'actifs privés
commenceraient par déplacer les fonds vers une banque
étrangère, avant de réemprunter l'argent auprès des
cette même banque (Ndikumana et Boyce, 2011).
1.1.3. Emprunt
étranger induit par la fuite des capitaux
Une perspective différente de l'association entre la
dette extérieure et la fuite des capitaux relève que c'est la
fuite des capitaux qui conduit à l'emprunt étranger.
L'idée mis en exergue dans ce cas est que la fuite des capitaux
génère une demande de fonds de remplacement, lesquels fonds sont
empruntés auprès de prêteurs étrangers.
En effet, à la suite du capital qui a quitté le
pays, un écart doit-être comblé dans l'économie
nationale. Il apparaît donc une demande pour le remplacement des
ressources perdues à la fois par le gouvernement et le secteur
privé qui vont à la rencontre des créanciers
extérieurs pour des prêts. Boyce(1992) note que les
créanciers étrangers peuvent être disposés à
combler le vide créé par la fuite des capitaux s'ils
perçoivent un avantage comparatif (avantage entre le risque et
le rendement).
Ainsi, du côté de l'emprunteur, puisque
l'assiette de l'impôt est érodée par la fuite des
capitaux, les autorités africaines ont recours aux prêts
étrangers pour financer les dépenses. Du côté des
créanciers, la disposition à combler le vide créé
par la fuite des capitaux se fait en arbitrant entre le rendement et le
risque.
1.1.4. Emprunt
étranger alimenté par la fuite des capitaux
L'emprunt étranger alimente la fuite des capitaux
lorsque que ceux qui détiennent les actifs privés commencent par
déplacer leurs fonds sur un compte en banque offshore, avant de
réemprunter l'argent dans cette même banque (Ndikumana et Boyce,
2011). Cette manoeuvre que Naylor (1987) nomme prêt
« aller-retour » (« round-tripping »)
ou prêt « face-à-face »
(« back-to-back loan ») a été
utilisée pour la première fois par Meyer Lansky, trésorier
du syndicat du crime aux Etats-Unis dans les années 1930. Ce dernier
s'en servait pour blanchir de l'argent en Suisse, le but étant de
dissimuler l'origine des fonds afin de ne pas éveiller les
soupçons des autorités publiques. Les clients de Landsky en
tiraient eux aussi un bénéfice marginal et les
intérêts versés sur ces pseudo-prêts étaient
non-imposables (Naylor, 1987).
Néanmoins, dans les pays africains en
général, les prêts étrangers accordés
à des emprunteurs privés (avec garanties publiques) sont
relativement rares, si bien que ce phénomène serait moins
répandu que dans les pays d'Asie et d'Amérique Latine.
Une différence fondamentale existe entre les effets
directs et indirects de l'emprunt étranger sur la fuite des capitaux.
Cette différence réside dans le moment où ces effets se
matérialisent (Ndikumana et Boyce, 2013). En effet, si au cours d'une
année donnée, un pays augmente son stock de dette, en empruntant
moins que l'année précédente, alors la fuite des capitaux
alimentée par la dette diminuera. Par contre, la fuite des capitaux
induite par la dette s'intensifiera, puisque le stock de dette aura
augmenté.
En résumé, la littérature admet que la
dette extérieure peut directement être associée à la
fuite des capitaux de quatre manières différentes. Cependant, des
liens indirects entre les deux ont également été mis en
exergue. Ces liens indirects tiennent compte des conditions économiques
locales et du climat des affaires. Nous les présentons dans la
sous-section qui suit.
1.2. Liens indirects entre la
dette extérieure et la fuite des capitaux
Un autre aspect de la relation entre la dette
extérieure et la fuite des capitaux suggère des liens indirects
entre les deux concepts. La Banque Morgan Guaranty Trust Company (1986)
soutient que certains facteurs indirects comme un faible taux de croissance du
PIB, des taux de change surévalués et la pression fiscale dans
les économies en développement non seulement causent la fuite des
capitaux mais aussi engendrent une demande de crédit
étrangère.
Par exemple, la croissance du PIB réel domestique
est normalement perçue comme un baromètre de
l'économie. Il peut aussi être vu comme un indicateur favorable
du climat des affaires et de l'investissement domestique. A cet effet, un PIB
domestique élevé ou des taux de croissance positifs du PIB
peuvent contribuer à la réduction du stock de fuite des capitaux
et inversement.
Un scénario alternatif du lien est que
l'accroissement de la dette extérieure peut contribuer à
détériorer des conditions économiques locales qui se
traduisent en une plus grande fuite des capitaux (Ajayi, 1995). C'est le cas
où par exemple, la mauvaise gestion macroéconomique crée
un environnement risqué et incertain, et la fuite des capitaux est
une réponse à de telles conditions.
De même, les erreurs de politique, la recherche de
l'intérêt personnel, la faiblesse des institutions nationales dans
les économies en développement occasionnent la fuite des capitaux
et suscitent plus d'endettement extérieur comme le souligne Beja (2006).
Lorsque les structures et mécanismes de
contrôles administratifs et de réglementation prudentielle sont
faibles, fragiles ou manquants, l'argent emprunté à
l'étranger peut finir par être empoché par l'élite
nationale ou affecté dans des projets de développement
improductifs qui ne génèrent pas des devises pour financer le
service de la dette extérieure. Un tel raisonnement suggère une
corrélation positive entre la dette extérieure et la fuite des
capitaux, qui est très souvent relevée dans la
littérature.
Outre ces approches théoriques, la littérature
économique fait également état d'évidences
empiriques sur la relation entre la dette extérieure et la fuite des
capitaux. La section qui suit est consacrée à la revue de ces
évidences empiriques.
2. Revue de la littérature empirique sur la relation
entre la dette extérieure et la fuite des capitaux
La relation entre la dette extérieure et la fuite des
capitaux a fait l'objet de plusieurs travaux ces dernières
décennies. Bien que rares sont celles qui portent
spécifiquement sur le cas du Cameroun, cette relation a
été analysée aussi bien dans des études portant sur
un seul pays que dans celles portant sur des échantillons de plusieurs
pays.
2.1. Résultats obtenus
sur des pays pris individuellement
L'une des études pionnières dans ce sens est
celle de Boyce (1992), qui utilise des données en séries
temporelles, pour montrer les liens entre la dette extérieure et la
fuite des capitaux dans le cas des Philippines durant la période 1962
à 1986. Tout d'abord, cet auteur estime que la fuite des
capitaux dans ce pays s'élève à 13 milliards de dollars
(en dollars de 1986), ce qui représente les deux tiers de la dette
extérieure totale du pays. Ensuite, les résultats statistiques
lui révèlent que la dette extérieure et la fuite des
capitaux s'engendrent mutuellement: chaque dollar de dette extérieure
supplémentaire sur une année donnée est associé
à 54 centimes de fuite des capitaux sur cette même année.
Enfin, Boyce(1992) conclut qu'une simple « porte
tournante » sépare la dette et la fuite des capitaux aux
Philippines car une fraction substantielle des fonds empruntés ressort
rapidement du pays.
Ndikumana et Boyce(1998) dans leur étude sur les
emprunts extérieurs et la fuite des capitaux au Zaïre durant la
période 1968-1990 trouvent des résultats similaires. Ils estiment
à 12 milliards de dollars le montant des capitaux enfuis sur cette
période. Leur constat est que ce montant équivaut presqu'au total
de la dette extérieure dont a hérité le gouvernement qui a
succédé à Mobutu. En effet, durant les 32 ans de
règne de Mobutu (1965-1997), le pays a accumulé une dette
publique extérieure de 14 milliards de dollars. Dans le même
temps, la Banque mondiale19(*)(1992) rapporte que le revenu par habitant du
Zaïre a diminué de 2,2% de 1965 à 1990. En outre, Les
Nations Unies20(*)(1994)
estiment que dans les années 1980, 70 % de la population du pays
vivait dans la pauvreté absolue.
Nyoni (2000) dans son étude sur la dette
extérieure et la fuite des capitaux en Tanzanie sur la période de
1971-1993 ne trouvent pas de relation entre les deux. Dans son modèle,
seules les falsifications aux transactions commerciales, la
contrebande21(*) et la
corruption sont significatives et constituent des mécanismes importants
de la fuite des capitaux. Ainsi, il suggère que pour réduire la
fuite des capitaux, renforcer la qualité des institutions s'avère
primordial.
Les résultats obtenus dans l'étude de
Chipalkatti et Rishi(2001) dans le cas de l'Inde durant la période
1971-1997 valident l'hypothèse de la relation bidirectionnelle entre la
dette extérieure et la fuite des capitaux tant soutenue par Ajayi
(1995). Ces auteurs ont conclu que le cas de l'Inde est
caractérisé par le Financial Revolving Door Model
où la dette extérieure et la fuite des capitaux s'engendrent
mutuellement pour la provision de flux extérieurs de capitaux.
Par ailleurs, Les résultats obtenus dans l'étude
de Demir(2004) dans le cas de l'économie Turque durant la période
1974-2000 valident l'hypothèse de causalité bidirectionnelle
entre la dette extérieure et la fuite des capitaux. Il conclut que
chaque dollar entré en Turquie sous forme de prêts sur la
période a servi à financer 43 centimes de dollar d'actifs
privés turques à l'étranger.
Toutefois, des études portant sur des
échantillons de plusieurs pays ont également analysé la
relation entre la dette extérieure et la fuite des capitaux.
2.2. Résultats de
quelques études portant sur plusieurs pays
Tout d'abord, la Banque de France (1987) dans son étude
sur les sorties de capitaux en provenance de 31 PED, y compris tous les pays de
la zone Franc sur la période 1973 à 1987 constate que
l'endettement extérieur est source de fuite de capitaux dans plusieurs
de ces pays. Les résultats statistiques révèlent que les
sorties de capitaux, provenant de la ZFA, s'élèvent à 8,6
milliards de dollars; ce qui représente 28% de la dette
extérieure de cette zone.
Ajayi(1997), en analysant la relation entre la dette
extérieure et de la fuite des capitaux de 25 pays d'ASS à bas
revenus et lourdement endettés22(*) sur la période 1980 à 1993, ne trouve
pas de relation entre la dette extérieure et la fuite des capitaux. En
effet, les résultats auxquels il parvient ne fournissent aucune preuve
statistique de dette extérieure ayant conduit à la fuite des
capitaux ou de fuite des capitaux découlant de l'emprunt
étranger. Ajayi(1997) fait remarquer que même si ces
économies ont connu des périodes de fuites massives de capitaux,
ces fuites ne sont pas dues à la dette extérieure.
Boyce et Ndikumana(2001) analysent la relation entre les
emprunts extérieurs et la fuite des capitaux de 25 pays d'ASS à
faible revenus23(*) sur la
période 1970-1996. Ils constatent que la fuite des capitaux de ces pays
s'élevait à 193 milliards de dollars (et à 285 milliards
en incluant le produits des intérêts). En comparant ces chiffres
à 178 milliards de dettes extérieures contractés par ces
mêmes pays, ils concluent que l'Afrique est un
« créancier net vis-à-vis du reste »
du monde car les avoirs extérieurs nets dépassent largement
la dette extérieure.
Beja(2006) examine la relation entre la dette
extérieure et la fuite des capitaux pour quatre pays24(*) de l'Asie du Sud-Est durant la
période 1970-2002. En utilisant ce qu'il appelle le Financial
Revolving Door Model, l'auteur valide l'hypothèse de
causalité bidirectionnelle entre la dette extérieure et la fuite
des capitaux. Ses résultats montrent qu'au moins 52 centimes de dollar
de la dette extérieure se retrouvent sous forme de fuite de capitaux
chaque année et que chaque dollar de fuite de capitaux induit environ 68
centimes d'emprunt étranger la même année.
En outre, Beja(2007) analyse de nouveau cette relation sur la
période 1970-2002, en réduisant cette fois son analyse à
l'Indonésie et la Malaisie. Ils trouvent des résultats
similaires mais constate qu'environ 55 centimes de chaque dollar
emprunté finance la fuite des capitaux dans ces deux pays.
Ndikumana et Boyce (2013)25(*) dans leur étude sur l'endettement
extérieur et la fuite des capitaux de 33 pays africains sur la
période 1970 à 2008 montrent que les pays d'Afrique
Sub-Saharienne (ASS) subissent le phénomène de
« porte financière tournante », notamment
la causalité bidirectionnelle entre la dette extérieure et la
fuite des capitaux. Leurs résultats révèlent que pour
chaque dollar prêté à un de ces pays d'ASS, environ 60
centimes en ressortent sous forme de fuite de capitaux la même
année. De plus, ils montrent que chaque augmentation d'un dollar du
stock de la dette extérieure est associée à 2 à 4
centimes de fuite de capitaux supplémentaires sur les années
ultérieures.
Conclusion du chapitre
En définitive, à la lumière de la
précédente revue de la littérature, nous pouvons retenir
que les auteurs distinguent clairement quatre façons d'associer
directement la dette extérieure et la fuite des capitaux : La fuite des
capitaux peut découler de la dette extérieure; la dette
extérieure peut accélérer la fuite des capitaux;
l'emprunt à l'extérieur peut être poussé par la
fuite des capitaux; enfin, la fuite des capitaux peut accélérer
la dette. D'autres auteurs mettent en relation ces deux concepts
à travers l'environnement des affaires et les conditions
économiques locales. Au-delà de ces analyses théoriques,
les études empiriques montrent que l'augmentation de la dette
extérieure peut entrainer la fuite des capitaux et inversement. Bien que
certaines travaux (Ajayi, 1997 ; Nyoni, 2000) n'aient trouvé aucun
lien entre la dette extérieure et la fuite des capitaux, la plupart des
études (Boyce, 1992 ; Beja, 2006 ; Chipalkatti et Rishi, 2001)
confirme l'hypothèse de « porte financière
tournante » selon laquelle la dette extérieure et la
fuite des capitaux s'engendrent réciproquement.
Le caractère mitigé de ces résultats
nous amène à explorer la relation entre la dette
extérieure et la fuite des capitaux dans le cas particulier du Cameroun.
Cela pourrait contribuer à enrichir la littérature sur le sujet
étant donné la rareté des études spécifiques
à ce pays. Pour analyser cette relation, une méthodologie
appropriée est requise. Mais avant, il importe d'observer
l'évolution de la dette extérieure et de la fuite des capitaux au
Cameroun.
CHAPITRE 2 :
EVOLUTION GLOBALE DE LA DETTE EXTERIEURE ET DE LA FUITE DES
CAPITAUX AU CAMEROUN
Comme de nombreux pays en développement en
général et en Afrique Sub-Saharienne en particulier, le Cameroun
compte sur les entrées de devises pour financer son
développement. L'une des principales sources de devises au Cameroun est
l'emprunt étranger. C'est depuis 1970 que le Cameroun commence
véritablement à s'endetter auprès des institutions
financières internationales26(*).
Entre 1970 et 2010, la trajectoire de la courbe de la dette
extérieure du Cameroun apparaît erratique. Elle est
marquée par une forte croissance entre 1980 et 1997, suivie d'une
contraction importante depuis 2000 suite aux mécanismes
multilatéraux et bilatéraux d'allègement. De même,
les capitaux sortis sur cette période ont connu une tendance similaire,
bien que depuis 2002, elle connait une tendance à la baisse probablement
avec les mesures mises en place contre la fuite des capitaux.
Ce chapitre a pour objet de présenter
l'évolution globale de la dette extérieure et de la fuite des
capitaux au Cameroun sur la période 1970 à 2010. Structuré
en deux sections : la première offre une présentation de
l'évolution globale de la dette extérieure au Cameroun. Nous
suivrons tout d'abord l'évolution du stock de la dette et du service de
la dette et nous présenterons ensuite l'évolution de deux ratios
d'endettement afin d'apprécier la charge de la dette pour le pays. La
deuxième section est consacrée, dans un premier temps à
l'évolution de la fuite des capitaux en valeur et en pourcentage de la
dette extérieure. Dans un second temps, une synthèse des mesures
mises sur pied contre la fuite des capitaux au Cameroun et sur le plan
international est présentée.
1. EVOLUTION GLOBALE DE LA DETTE EXTERIEURE AU CAMEROUN
Dans cette section, nous présenterons successivement
l'évolution du stock de la dette extérieure, du service de la
dette extérieure ainsi que deux ratios d'endettement.
1.1. Evolution du stock de la
dette extérieure du Cameroun :
L'évolution globale de la dette extérieure du
Cameroun est marquée par une alternance de fortes hausses et baisses en
fonction des dates marquantes de son évolution. Nous avons
reporté ces dates en annexes (Tableau 2.1). Le graphique qui suit
présente l'évolution du stock de la dette extérieure du
pays.
Graphique 2.1 : Evolution du stock de la
dette extérieure du Cameroun

Source : conçu par
l'auteur à partir des données du WDI (2012).
En se focalisant sur la dette extérieure du Cameroun,
le constat qui se dégage est qu'elle a historiquement connu une
progression constante notamment avec plusieurs chocs d'endettement (Chauvin,
2012). Le premier choc découle d'une politique d'investissement active
inhérente à la mise en exploitation des ressources
pétrolières découvertes en 1977. Cependant, Jusqu'au
début des années 80, le Cameroun pratique une politique
d'endettement extérieur modérée (Fambon, 2002).
Le deuxième choc apparait en 1985 et c'est à
partir de cette date que l'accroissement de l'endettement extérieur du
pays devient considérable. Cet accroissement est dû à la
conjonction et la succession de plusieurs facteurs tels que la politique
budgétaire expansionniste27(*) mise en oeuvre depuis la fin des années 1970,
la détérioration des termes de l'échange28(*), la baisse des recettes
d'exportations29(*),
l'accumulation d'arriérés externes30(*); ce qui contraint le Cameroun
à faire davantage recours aux sources de financements extérieurs.
De ce fait, au début des années 1990, la dette extérieure
du Cameroun essentiellement publique est supérieure à 50% du
PIB (Chauvin, 2012).
La période de 1986-199431(*) met en exergue l'enjeu que représente le
secteur pétrolier pour la dynamique de la dette extérieure.
En effet, l'augmentation du cours du baril a permis au prix de pallier la
baisse des volumes qui a atteint son maximum en 1985, la dette reste stable. Or
dès 1989 à la suite de la baisse des prix, nous observons une
rapide augmentation du ratio dette extérieure/PIB (plus de 70 points de
pourcentage entre 1986 et 1994).
Le stock de la dette extérieure continue de
s'accroitre fortement entre 1993 et 1998 et le choc le plus marquant
apparaît en 1994 avec la dévaluation du franc CFA par rapport au
franc français. En effet, la dévaluation a
réévalué les dettes extérieures car la
quasi-totalité des prêts est libellée en devises. Suite
à cette dévaluation, la dette extérieure du Cameroun
dépassait 100% du PIB. En plus de la dévaluation de 1994, les
effets conjugués des nouveaux engagements32(*) de l'Etat et les retards de
paiement envers certains créanciers, notamment les pays non participants
au Club de Paris33(*) et
ceux du Club de Londres34(*) expliquent aussi l'accroissement du stock de la dette
extérieure du Cameroun à partir de 1993 (Fambon, 2002).
En décembre 2000, le Cameroun bénéficie
de la réduction de sa dette extérieure au titre de l'Initiative
Renforcée en faveur des PPTE35(*). Ceci est suivi d'un passage au Club de Paris et d'un
rééchelonnement/annulation de sa dette bilatérale aux
conditions de Cologne par décision des Conseils d'administration du FMI
et de la Banque mondiale. Ainsi, suite aux annulations de dette obtenues dans
le cadre de l'initiative IADM/PPTE, l'endettement extérieur du Cameroun
s'est fortement réduit ; il se situe à 13,51% du PIB en
201036(*).
En plus de l'IADM/PPTE, la baisse du niveau d'endettement
s'explique par les mesures mises en place entre la France et le Cameroun
à travers le programme D (Contrat de Désendettement et de
Développement). En effet, le D constitue pour le Cameroun le plus
important programme d'annulation et de reconversion de sa dette
extérieure. Au travers de ce mécanisme, la France a
décidé d'un effort bilatéral additionnel à
l'initiative multilatérale d'allègement de la dette des PPTE. En
pratique, le pays continue d'honorer sa dette mais, aussitôt le
remboursement constaté, la France reverse la somme correspondante sous
forme de dons pour qu'elle soit affectée à des programmes de
lutte contre la pauvreté sélectionnés d'un commun accord
avec le Cameroun37(*).
Les montants mobilisés sont considérables
avec 566 Milliards de F CFA mobilisés38(*), soit 863,6 millions d'euros pour la période
2006-2016. Le premier D a été signé le 22 juin 2006 pour
cinq années avec un montant de 352 milliards de F CFA, soit 537,6
millions d'euros. Contribuant à la réalisation des OMD, ces
financements ont été concentrés sur cinq secteurs
prioritaires : éducation de base, santé, agriculture et
développement rural, environnement et infrastructures urbaines et
routières. S'inscrivant dans la continuité du premier contrat, le
second D a été signé le 1er juillet 2011 pour un montant
de 214 milliards de F CFA, soit 326 millions d'euros. Couvrant la
période 2011-2016, il privilégie les secteurs de l'agriculture et
du développement rural, du développement urbain et de la
formation professionnelle. A côté de cette évolution du
stock de la dette extérieure, le service de cette dette a
également connu une tendance similaire.
1.2. Evolution du service de la
dette extérieure :
Par définition, le service de la dette (ou
remboursement) désigne le paiement des intérêts et
l'amortissement du principal aux échéances convenues39(*). En effet, les prêts
mobilisés donnent lieu à un remboursement et à une charge
d'intérêt qui constitue la rémunération du capital
prêté. Ce service de la dette dépend du recours à
l'endettement du pays et partant, de sa politique de gestion de la dette
extérieure.
Le tableau 2.1 contenu en annexes indique que le service
effectif de la dette a considérablement cru sur la période
étudiée. Le constat majeur est que le service effectif de la
dette extérieure se révèle grandissant à mesure que
la conjoncture économique se déprime. Il est passé de
45,7 en 1981 à 80.8 millions de F CFA en 198640(*), soit une augmentation
d'environ 43,42%. Le service de cette dette n'a cessé de croître
durant la période de crise au Cameroun (1986-1994), passant ainsi de
71,3 en 1987 à 153,7 milliards de F CFA en 1994, soit une augmentation
de 53,6%.
Suite à la dévaluation de 1994, la charge de la
dette continue d'augmenter considérablement se chiffrant à 255,4
milliards de FCFA en 1995. Le montant le plus élevé s'observe en
1997 soit 373,9 milliards de FCFA. Cet accroissement du service de la dette
s'explique par l'exécution par le Cameroun, à partir de 1997, de
la Facilité Ajustement Structurel Renforcé (FASR), soutenue par
le FMI, la Banque mondiale, l'Union Européenne et la BAD (Fambon, 2002).
Néanmoins, depuis 2000, le service de la dette extérieure n'a
cessé de décroître. Il est passé de 203,6 à
96,7 milliards de F CFA en 2009.
Le Cameroun a été déclaré
éligible à l'Initiative des PPTE par décision des Conseils
d'administration du FMI et de la Banque mondiale en date du 21 décembre
2000. Ceci en raison de sa dette jugée non soutenable et au regard de
ses performances économiques satisfaisantes durant les trois
années de la FASR (1997-2000) appuyée par le FMI et la Banque
mondiale (Fambon, 2002). Ainsi, dans le cadre de cette initiative, le Cameroun
a bénéficié de la remise du service de sa dette
extérieure d'un montant de 1,3 milliard de dollars, suivi d'un
rééchelonnement de sa dette bilatérale au Club de Paris
aux conditions fixées à Cologne.41(*)
Les développements précédents nous
permettent de dégager les grandes tendances de l'évolution de la
dette extérieure du Cameroun sur la période d'étude. Nous
présentons par la suite l'évolution de quelques ratios
d'endettement afin d'apprécier la charge de la dette du pays.
1.3 EVOLUTION DES RATIOS
D'ENDETTEMENT
Pour apprécier la charge de la dette d'un pays, on
utilise généralement un certain nombre de ratios. Ici, deux
ratios seront présentés : Le premier est le ratio service de
la dette42(*)/recettes d'exportations
et le second est le ratio service de la dette extérieure/budget.
1.3.1. Ratio service de la dette/recettes
d'exportations
Ce ratio permet de déterminer l'importance des recettes
d'exportations nécessaires pour assurer le remboursement tant du
principal que des intérêts. Son principal avantage est qu'il
constitue un indice de rigidité de la balance des paiements d'un pays en
courte période. Plus ce ratio est élevé, plus l'ajustement
est nécessaire pour compenser l'évolution défavorable. Le
graphique suivant présente son évolution au Cameroun sur la
période d'étude. Le ratio service de la dette
extérieure/recettes d'exportations est passé de 21,5% en 1982
à 30,2% en 198543(*). Ensuite de 30,7 % en 1987, avant de retomber
à 24,56% en 1993. Ensuite, il passe de 24,79% en 1999 à 19,13%
en 2005 avant de chuter à 3,4% en 2010.
Graphique 2.2 : Service de la dette en % des
recettes d'exportations
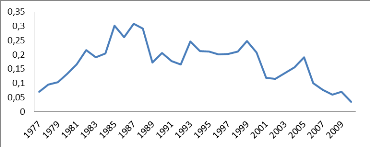 Source : Conçu par
l'auteur à partir des données du WDI(2012). Source : Conçu par
l'auteur à partir des données du WDI(2012).
Toutefois, étant donné qu'il s'agit simplement
d'un ratio de liquidité, sa valeur à elle seule ne permet pas
d'apprécier le poids de la charge de la dette pour le pays emprunteur.
Ainsi, il devient utile de lui adjoindre un autre ratio.
1.3.2. Ratio service
de la dette extérieure/Recettes budgétaires
Le graphique suivant présente l'évolution du ratio
service de la dette extérieure/Recettes Budgétaires.
Graphique 2.3 : Evolution du ratio service
de la dette extérieure/ Recettes budgétaires
 Source : conçu par l'auteur à partir
des données de la CAA(2015).
Source : conçu par l'auteur à partir
des données de la CAA(2015).
Le ratio service de la dette extérieure/recettes
publiques mesure la capacité du gouvernement à financer le
service de la dette au moyen de ses ressources propres. Ce ratio a connu une
évolution similaire au ratio précédent compte tenu de la
relation qui existe entre les recettes de l'Etat et le paiement du service de
la dette. Ce ratio, qui traduit le poids du paiement du service de la dette sur
les recettes propres de l'Etat, passe de 4,7%44(*) en 1982/83 à 14,77% en 1991/92 comme
l'illustre le graphique ci-dessus. IL a connu une forte augmentation en 1993/94
(40,08%), traduisant ainsi une charge de plus en plus lourde de la dette
extérieure sur le budget de l'Etat. Par la suite, il se situe à
44,11% en 1997/98. Depuis, 2000, ce ratio est en constante baisse et se situe
à 5,01% en 2009/10.
En résumé, nous notons que la dette
extérieure a connu une tendance erratique au cours de la période
d'étude. Cependant, cette évolution s'est accompagnée de
sorties massives de capitaux notamment marquée par plusieurs pics. La
section qui suit a but de présenter l'évolution de la fuite des
capitaux au Cameroun.
2. LA FUITE DES CAPITAUX AU CAMEROUN : ANALYSE EN VALEUR
ET EN POURCENTAGE DE LA DETTE EXTERIEURE
Le Cameroun est classé parmi les pays de la Zone Franc
qui enregistrent les plus importants volumes de fuite des capitaux. En effet,
les résultats de Boyce et Ndikumana (2012) sur la période
1970-2010 révèlent que trois pays de la Zone Franc sont
dans le top dix des pays d'Afrique Sub-Saharienne enregistrant les
fuites des capitaux les plus élevées:
3ème place pour la Côte d'Ivoire (56 milliards de
dollars soit 244,4% du PIB de 2010) ; 7ème place pour le
Gabon (25,5 milliards de dollars soit 192,9% du PIB de 2010);
10ème rang pour le Cameroun (20 milliards de dollars soit
89% du PIB de 2010).
L'objectif de cette partie est de présenter
l'évolution de la fuite des capitaux au Cameroun en valeur et en
pourcentage de la dette extérieure. Cette partie est
complétée par une brève présentation des mesures
mises sur pied contre la fuite des capitaux au Cameroun et sur le plan
international.
2.1. La fuite des capitaux au
Cameroun : analyse en valeur
Les valeurs de la fuite des capitaux réelle du Cameroun
sont tirées des travaux de Boyce et Ndikumana (2012) que nous avons
reportées en annexes (Tableau 2.2). En termes du montant de la fuite
des capitaux au cours de l'intégralité de cette
période, le Cameroun a enregistré un montant d'environ 20
millions de dollars. Le graphique suivant présente son évolution
sur la période d'étude.
Graphique 2.4: Evolution de la fuite des
capitaux du Cameroun
 Source : Boyce et Ndikumana (2012)
et construction de l'auteur. Source : Boyce et Ndikumana (2012)
et construction de l'auteur.
En observant le graphique précédent, le constat
qui se dégage est que l'évolution de la fuite des capitaux du
Cameroun sur la période 1970 à 2010 se caractérise par une
alternance des périodes de fortes hausses et de baisses. Enregistrant
des fuites négatives au début des années 1970, le premier
pic apparait en 197745(*)
(avec une valeur de 1359,7 millions de dollars). Cette année correspond
à la date de découverte et au début de l'exploitation
pétrolière au Cameroun. Le deuxième pic s'observe en 1984
(avec un montant de 2253,9 millions de dollars) marqué par une tentative
de coup d'Etat au Cameroun.
Durant les deux années qui suivent, on observe
également des valeurs élevées de la fuite des capitaux au
Cameroun. Ces deux années (1985-86) correspondent à la fin de la
période faste et à l'entrée du pays en crise. Crise dont
le pays ne s'est toujours pas totalement remise jusqu'aujourd'hui en
dépit de la reprise économique en 1994.
Cette reprise s'est accompagnée d'une importante fuite
des capitaux, soit 3350 et 2585,7 millions de dollars entre 1994 et 1995.
Toutefois, le pic le plus élevé s'observe en 2001 avec une
valeur de 6088,6. En analysant les différentes composantes de la fuite
des capitaux, on constate que ce pic est dû à la dette. En effet,
L'année 2000 correspond au Cameroun à l'atteinte du point de
décision de l'IPPTE46(*) qui a permis au gouvernement camerounais d'obtenir
des ressources financières importantes. Le pays a obtenu auprès
du FMI une Facilité pour la Croissance et la Réduction de la
Pauvreté d'un montant de 144 millions de dollars, destinés au
financement de son programme économique et financier pour la
période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 et de la
remise du service de la dette extérieure d'un montant de 1,3 milliard de
dollars.
Depuis 2002, on note un essoufflement de la fuite des capitaux
au Cameroun. Cet essoufflement pourrait s'expliquer par les initiatives de
lutte contre la corruption et le détournement de fonds publics mises en
oeuvre dans le pays. En effet, plusieurs études ont montré que la
corruption et les détournements de fonds publics constituent des
facteurs importants de la fuite des capitaux (Ajayi, 1992 ; Awung, 1996 ;
Bendoma, 2012).
En résumé, l'observation du graphique
précédent fait apparaitre des tendances variées de la
fuite des capitaux au Cameroun avec plusieurs pics. Si on peut noter que la
fuite des capitaux apparait véritablement dans le pays en 1977
coïncidant avec le début de l'exploitation
pétrolière, le pic le plus élevé apparait en 2001,
date à laquelle le pays bénéficie d'importantes ressources
financières dues à la dette. Ce qui semble confirmer le point de
vue de Chipalkatti et Rishi (2001) pour qui, la fuite des capitaux est
quantitativement importante lorsque le niveau de l'endettement est
élevé dans le pays. L'observation des tendances de la fuite des
capitaux en pourcentage de la dette extérieure se révèle
aussi nécessaire.
2.2. Evolution de la fuite des
capitaux en pourcentage de la dette extérieure
Le graphique suivant présente l'évolution de la
fuite des capitaux en pourcentage de la dette extérieure au Cameroun sur
la période d'étude. Graphique
2.5 : Evolution de la fuite des capitaux en pourcentage de la
dette extérieure
 Source : Boyce et Ndikumana (2012),
WDI(2012) et construction de l'auteur Source : Boyce et Ndikumana (2012),
WDI(2012) et construction de l'auteur
L'observation du graphique précédent permet de
faire certains constats. Comme précédemment, on observe une
alternance des périodes de fortes hausses et de baisses. Tout d'abord en
1973, le ratio fuite des capitaux/dette extérieure vaut 275%47(*), ce qui suggère que les
entrées de capitaux sont très largement supérieures
à la fuite de capitaux à cette date. Ensuite, en 1977, ce ratio
vaut 122%, ce qui montre que les capitaux sorties cette année-là
ont largement été supérieures à la dette
extérieure. Par la suite, ce ratio décroit progressivement et
passe de 71% en 1978 à 20% en 1980. Il augmente en 1984 à 78% et
chute en 1994 à 36%. Depuis 1994, le ratio fuite des capitaux/dette
extérieure est constamment en baisse et atteint une valeur de 0% en
2000. En revanche, il remonte à 62% en 2001. Depuis 2002, ce ratio est
négatif (-7%) et vaut -23% en 2010, ce qui montre que la dette
extérieure est supérieure aux sorties des capitaux du Cameroun.
Les développements précédents nous ont
permis de constater un essoufflement de la fuite des capitaux dans le pays
depuis 2002. Cet essoufflement pourrait être dû aux
différentes initiatives contre la fuite des capitaux. L'identification
de ces différentes mesures ne saurait être exclue de notre
étude.
2.3. Les mesures de lutte
contre la fuite des capitaux
Au Cameroun comme sur le plan international, de nombreuses
mesures ont été prises contre les sorties (normales ou anormales)
de capitaux. Au plan national, elles prennent la forme de mesures contre la
corruption et le détournement de fonds publics. Au plan international,
les mesures prises par des institutions telles que le FMI, le GAFI ou le
comité de Bâle tiennent compte du caractère licite ou
illicite des flux sortants de capitaux.
Nous présentons d'un premier abord les mesures de lutte
contre la fuite des capitaux au Cameroun, pour s'attarder ensuite sur ces
mesures sur le plan international.
2.3.1. Sur le plan
national
Les mesures de lutte contre la fuite des capitaux au Cameroun
prennent les couleurs d'une lutte contre la corruption et les
détournements de fonds publics. La CONAC, au cours de la période
1998 à 2004, estiment à 1845 milliards de francs CFA (soit 2,8
milliards d'euros) le montant des fonds détournés au Cameroun par
des dirigeants politiques corrompus. Un tel montant confirme que le Cameroun
fait face à des sorties massives de capitaux issus de
détournements de fonds publics.
Ainsi donc, nombreuses sont les initiatives prises dans ce
sens. Tout d'abord, l'opération judiciaire connu sous le nom de
``l'opération épervier'' mise sur pied sous la pression des
bailleurs de fonds. Elle consiste en l'analyse des fortunes amassées par
certains dirigeants politiques pour en déterminer l'origine frauduleuse
ou pas. Ensuite, La création en 2006 de la CONAC, dont la mission est
de suivre et d'évaluer la mise en oeuvre effective du plan
gouvernemental de lutte contre la corruption. Elle permet aussi d'assurer le
contrôle physique de l'exécution des projets et évalue les
passations de marchés publics. Enfin, le document de Stratégies
Nationales de Lutte contre la Corruption (SNLCC) validé en 2011 dresse
le plan d'actions à réaliser dans le cadre de la lutte contre la
corruption par secteur et par pilier d'intégrité.
De telles initiatives font preuve de la volonté des
autorités publiques à mobiliser les efforts contre la fuite
massive des capitaux au Cameroun. Des mesures similaires ont été
prises sur le plan international prenant en compte le caractère licite
ou illicite des sorties de capitaux.
2.3.2. Sur le plan
international
Nombreuses sont les institutions qui, sur le plan
international, agissent sur différents plans afin de maintenir
l'intégrité du système financier. Des institutions comme
le FMI, le GAFI, le Comité de Bâle sous l'égide de la
Banque des règlements internationaux, contribuent de façon
directe ou indirecte à la lutte contre la fuite des capitaux.
Leurs stratégies dépendent du caractère
licite ou illicite de cette fuite.
Ø Mesures de lutte contre les fuites licites
des capitaux
Les fuites licites de capitaux sont des sorties de capitaux
non-répressives par la loi en matière de flux de capitaux. Elles
regroupent des sorties de capitaux dues à des facteurs tels qu'une
incertitude, le besoin de diversification du portefeuille ainsi que les
activités des banques commerciales nationales qui visent à
étendre leurs avoirs à l'étranger, etc. Elles s'observent
en général lors des crises financières ou
économiques, ou encore suite à des problèmes
d'instabilité politique.
Dans ce cadre, les mesures prônées par des
institutions internationales telles que le FMI consistent le plus souvent en
des séries de réformes structurelles des institutions politiques,
économiques et financières. Ce fut le cas de plusieurs pays de la
zone Franc dans les années 80, qui face à la crise de la dette
qui sévissait dans leurs économies, ont dû souscrire aux
Plans d'Ajustement Structurel (PAS) soumis à eux par le FMI, pour
pouvoir être éligible à un rééchelonnement de
leur dette. Ces PAS prévoyaient entre autre des réformes dans les
systèmes financiers et monétaires des pays de la zone franc en
vue de le libéraliser et de permettre l'émergence d'un
marché financier, capable d'attirer les capitaux pour pallier aux
besoins de financement.
Ø Mesures de lutte contre les fuites illicites
des capitaux
L'article VII des statuts du FMI interdit l'exécution
de contrats de change contraire à la réglementation des changes
d'un autre Etat membre, en vue, précisément, de créer un
obstacle à la fuite illicite des capitaux. Pour passer inaperçus,
ces sorties illicites de capitaux se font à travers le mécanisme
de blanchiment d'argent. D'après
Cutajar(2012) , le blanchiment est ce processus qui permet
de faire disparaître l'origine illicite du produit de trafics interdits
en les réinjectant dans les circuits économiques légaux
pour leur donner l'apparence de capitaux légitimes. Il est souvent
utilisé pour camoufler le produit de la corruption et rendu difficile
à identifier par le secret bancaire.
Plusieurs initiatives peuvent être
recensées :
o La recommandation du Conseil de l'Europe du 27 juin
1980.
Cette recommandation a été adoptée par
le Comité des ministres du Conseil de l'Europe en proposant aux
États de mettre en place dans leur droit interne quatre obligations
à la charge des établissements financiers : la
vérification de l'identité des clients à laquelle la
recommandation consacrait une place essentielle en prévoyant qu'elle
devait être effectuée lors de l'ouverture d'un compte ou de la
constitution d'un dépôt, lors de la location d'un coffre et au
moment de l'exécution au comptant d'opérations portant sur des
sommes élevées ; la limitation de la location des coffres
forts à des personnes physiques ou morales avec lesquelles la banque se
trouve en relation d'affaires ou qu'elle considère comme dignes de
confiance ; la constitution de réserves de billets dont la
numérotation peut être signalée aux autorités en cas
d'utilisation à des fins criminelles ; une formation
adéquate du personnel bancaire de guichet, pour les contrôles
d'identité et le dépistage des comportements suspects.
o Le GAFI
Créé en 1989 lors du sommet du G7 à
Paris, Le Groupe d'Action Financière est un organisme
intergouvernemental dont l'objectif est de concevoir et de promouvoir des
stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il regroupe 32
pays et deux organisations internationales, dont la Commission
européenne. L'action menée par cet organisme quant à la
lutte contre le blanchiment d'argent se trouve consignée dans son plan
d'action constitué par 40 recommandations. Les 20 premières
concernent les Banques et Etablissements financiers qui devront identifier tous
leurs clients et conserver les documents appropriés et déclarer
les transactions suspectes.
Les révisions faites en 2003 intègrent
l'évolution des techniques du blanchiment. Parmi les principaux
changements, on peut noter l'extension des mesures anti-blanchiments aux
entreprises et professions non financières telles que les casinos, les
agents immobiliers, les négociants en pierres ou métaux
précieux.
o La convention des Nations Unies contre la corruption
du 31 octobre 2003.
Ouverte à la signature depuis décembre 2003,
la Convention des Nations Unies contre la corruption, lutte contre le pillage
des biens publics des pays en développement. En effet, la
résolution 55/188 du 20 décembre 2000 de la convention, permet de
prévenir et de lutter contre les pratiques corrompues et le transfert
illégal de fonds ainsi que le rapatriement de ces fonds vers les pays
d'origine. Pour prévenir le blanchiment du produit de la corruption, la
Convention prévoit que les Etats adoptent des procédures d'examen
des transactions suspectes, d'analyse des informations financières et
d'échange d'informations, d'examen des opérations inhabituelles.
La question du recouvrement des avoirs étant essentielle, le chapitre V
de la résolution prévoit que les sommes ou les biens
confisqués provenant de la corruption issus de détournements de
fonds publics notamment soient restitués à l'Etat qui a
été spolié.
Dans la zone CEMAC, la lutte contre la
fuite des capitaux prend surtout la forme de lutte contre le blanchiment
d'argent issu d'activités répressibles par la loi tel que le
détournement de deniers publics, la corruption, le trafic de drogues,
stupéfiants et autres.
Le séminaire de sensibilisation sur la lutte contre
le blanchiment des capitaux dans les pays de la CEMAC, tenu à
Yaoundé en novembre 2000, comptait parmi les toutes premières
actions de lutte contre le blanchiment d'argent de la CEMAC. Il y avait
été relevé que l'organisation de la lutte contre le
blanchiment des capitaux dans la sous-région devrait s'articuler autour,
d'une part, de la création d'un groupe intergouvernemental d'action et
d'unités spécialisées de renseignement financier, et,
d'autre part, de l'élaboration d'un texte communautaire. Ceci
permettrait de combler le vide législatif existant en matière de
prévention et de répression du blanchiment de capitaux. C'est
ainsi qu'à la Conférence des chefs d'Etat de la CEMAC tenue vers
la fin de l'année 2000 a été adoptée une
déclaration de principe sur la lutte contre le blanchiment, et le Groupe
d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC) a
été créé.
Toujours dans l'optique de la répression et de la
prévention du blanchiment d'argent, la BEAC a entrepris de combler le
vide juridique constaté en mettant en chantier un texte normatif sous la
forme d'un règlement CEMAC. C'est ainsi qu'un avant-projet de
règlement CEMAC qui regroupe en un seul texte, la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été
élaboré et examiné du 28 au 30 Octobre 2002 au
siège de la BEAC à Yaoundé. Il convient de noter que ces
entrevues ont aussi porté sur les questions de traitement des
renseignements financiers et la détection du blanchiment.
Les réflexions sur la manière dont devait
être menée cette lutte au niveau communautaire ont conduit au
règlement N°01/03 CEMAC/UMAC portant prévention et
répression du blanchiment des capitaux et du terrorisme en Afrique
Centrale qui voit finalement le jour le 28 mars 2003. En son article 25, ce
règlement porte création de l'Agence Nationale d'Investigation
Financière (ANIF) dans chaque Etat membre de la CEMAC.
Conformément à l'alinéa 1 de cet article, l'ANIF est
chargé de recevoir, de traiter et le cas échéant de
transmettre aux autorités judiciaires compétentes les
déclarations auxquelles sont tenues les organismes financiers et
personnes assujettis à ce règlement. En d'autres termes,
lorsqu'un organisme financier ou tout autre organisme compétent
détecte un flux d'argent de provenance douteuse celui-ci est tenu
conformément aux articles de le déclarer à l'ANIF, qui
mène l'investigation et saisit les autorités judiciaires en cas
de nécessité.
CONCLUSION
DU CHAPITRE
Ce chapitre nous a présenté
l'évolution globale de la dette extérieure et de la fuite des
capitaux au Cameroun. Les mesures mises sur pied contre la fuite des capitaux
au Cameroun et sur le plan international ont également été
mises en exergue. A priori, nous notons d'une part que la fuite des capitaux
apparaît au Cameroun en 1977, date de découverte et début
de l'exploitation pétrolière dans le pays. D'autre part, le pic
le plus élevé de la fuite des capitaux apparaît dans les
années 2000 lorsque le pays reçoit d'importants fonds liés
à la dette extérieure ; ce qui semble à priori
suggérer un lien entre la fuite des capitaux et la dette
extérieure. La nécessité de faire une analyse statistique
profonde s'impose afin d'analyser la relation entre la dette extérieure
et la fuite des capitaux au Cameroun. Le chapitre suivant est consacré
à la présentation des modèles, des variables, des
données et de la méthodologie qui sera utilisée dans le
cadre de notre analyse empirique.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
L'objectif de cette première partie était de
présenter la revue de la littérature inhérente à la
relation entre la dette extérieure et la fuite des capitaux ainsi que
leur évolution globale au Cameroun. Pour atteindre cet objectif, cette
partie a été structurée en deux chapitres :
Le premier chapitre a été consacré
à la revue de la littérature aussi bien théorique
qu'empirique. L'analyse théorique de la relation entre la dette
extérieure et la fuite des capitaux montre que la dette
extérieure peut entrainer la fuite des capitaux et inversement. Les
auteurs (Boyce, 1992 ; Beja 2006 ; Ndikumana et Boyce, 2013)
distinguent clairement quatre façons d'associer la dette
extérieure et la fuite des capitaux. Cette association fait intervenir
l'environnement macroéconomique, le climat des affaires ainsi que
l'environnement institutionnel.
La revue de la littérature empirique nous permet de
constater que de nombreuses études se sont consacrées à
l'analyse de cette relation. Que ce soit pour des pays pris individuellement
que pour des échantillons de plusieurs pays, la plupart des
études arrivent à la conclusion selon laquelle la dette
extérieure et la fuite des capitaux s'engendrent mutuellement
d'où le phénomène de « porte
financière tournante » que l'on retrouve dans la
littérature.
Le deuxième chapitre, consacré à
l'analyse de l'évolution globale de la dette extérieure et de la
fuite des capitaux au Cameroun, montre d'une part que la fuite des capitaux
représente une manne considérable que ce soit en valeur ou en
pourcentage du PIB dans le pays, et, d'autre part, que la dette
extérieure semble avoir un lien avec la fuite des capitaux en
particulier en 2001 lorsque le pays reçoit d'importants fonds
liés à la dette extérieure.
Même si dans la plupart des cas, il est admis que la
dette extérieure et la fuite des capitaux s'engendrent mutuellement,
seules des statistiques approfondies peuvent nous permettre d'avoir une
idée assez précise de la situation au Cameroun.
DEUXIEME PARTIE :
DETTE EXTERIEURE ET FUITE DES CAPITAUX AU CAMEROUN :
ANALYSE EMPIRIQUE
INTRODUCTION DE LA DEUXIEME PARTIE
Dans cette partie de notre travail, nous nous
intéressons essentiellement à l'analyse empirique liée
d'une part à l'effet de la dette extérieure sur la fuite des
capitaux, et, d'autre part, à l'effet de la fuite des capitaux sur la
dette extérieure.
Au chapitre trois, nous proposons une analyse
rigoureuse de la relation entre la dette extérieure et la fuite des
capitaux au Cameroun en adoptant l'approche autorégressive à
décalage temporel de cointégration. Cette approche est plus
adaptée lorsque les variables présentent des ordres
d'intégration différents. Elle permet également de
déceler à la fois les relations de court terme et de long terme
entre les variables retenues pour l'étude.
Au quatrième chapitre, nous vérifions d'abord
qu'aucune des variables n'est intégrée d'un ordre
supérieur à 2 car les valeurs tabulées de Pesaran et al.
(2001) sont calculées en tenant compte que toutes les variables sont
I(0) et I(1). Ensuite, nous vérifions qu'il existe une relation de long
terme entre les variables de chaque modèle retenu. Suivant Pesaran et
al.(2001), nous estimons les coefficients de court terme et de long terme pour
le(s) modèle(s) dont l'hypothèse nulle d'absence de relation de
long terme est rejetée. Enfin, nous mettons en oeuvre un ensemble de
tests afin de vérifier la stabilité des coefficients
estimés pour le court terme et pour le long terme.
Au total, c'est l'occasion d'analyser la relation qui
existe entre la dette extérieure et la fuite des capitaux au
Cameroun.
CHAPITRE 3 : APPROCHE METHODOLOGIQUE
Dans la littérature économique, les
chercheurs ont procédé de diverses manières pour analyser
la relation entre la dette extérieure et la fuite des capitaux afin de
confirmer ou d'infirmer les idées soutenues dans les débats
théoriques. A cet effet, la démarche méthodologique n'a
pas toujours été la même, car évoluant avec
l'avancée des techniques économétriques.
L'objet de ce chapitre est de présenter la
méthodologie de l'étude. Il s'agit dans un premier temps de
spécifier le modèle tout en présentant les variables
(endogènes et exogènes) qui le constituent, le type de
données utilisées ainsi que leurs sources. Dans un
deuxième temps, nous présentons la procédure d'estimation
du modèle.
1. Spécification du modèle :
La relation entre la dette extérieure et la fuite
des capitaux a conduit à de dissemblables recherches sur la formulation
précise des équations appropriées pour la
vérification des hypothèses. Différentes
méthodologies ont été utilisées. Pour notre
étude, nous nous inspirons du modèle spécifié par
Chipalkatti et Rishi (2001) qui examine la relation entre la dette
extérieure et la fuite des capitaux dans l'économie indienne sur
la période 1971-97. Ainsi, nous optons pour un modèle à
équations simultanées.
1.1.
Présentation de la forme fonctionnelle du modèle :
Vu nos hypothèses formulées en introduction,
nous retenons dans notre travail, la formulation de notre modèle ayant
trait aux hypothèses émises.
1.1.1. Le
modèle théorique
Nous avons retenu le modèle théorique
estimé dans l'article de Chipalkatti et Rishi (2001).
Théoriquement, ce modèle se présente comme suit :
FCRt = 
 a + âi?FCRt-i +
âj?DETt-j + åa,t
(1) a + âi?FCRt-i +
âj?DETt-j + åa,t
(1)
DETt = áb +
âi?DETt-i + âj?FCRt-j
+ åb,t (2)
La variable FCR mesure la fuite des capitaux, DET
correspond à la dette extérieure. áa et
áb sont les constantes de nos modèles, et
åa,t, åb,t, les termes d'erreurs. Selon
l'hypothèse de « porte financière
tournante », nous nous attendons à ce que la variable DET
affecte significativement la FCR (Equation 1), et qu'en retour, la FCR affecte
aussi significativement la dette extérieure (Equation 2). Cependant,
compte tenu du caractère spécifique de l'économie
Camerounaise, ce modèle théorique parait très simple
pour notre étude. A cet effet, nous avons formulé un
modèle empirique en apportant quelques modifications au modèle
théorique de Chipalkatti et Rishi (2001).
1.1.2. Le
modèle empirique
Nous estimons que le modèle de Chipalkatti et Rishi
(2001) paraît trop simple pour étayer la spécificité
de l'endettement extérieur et de la fuite des capitaux du Cameroun. Ceci
nous conduit à un modèle beaucoup plus détaillé
pour être en cohérence avec les hypothèses de
l'étude. Nous avons donc introduit des variables telles que le taux de
croissance du PIB, l'aide publique au développement, l'ouverture
commerciale, la rente totale provenant de ressources naturelles, la rente
pétrolière. Ces variables seraient très pertinentes dans
la mesure où elle permettrait de prendre en compte les
réalités politiques, économiques et financières
du pays. Ce faisant, la forme fonctionnelle retenue est la suivante :
FCRt= a0 +
a1?FCRt-i + a2?DETt-i +
a3?TPIBt-i + a4?REPt-i +
a5?OUVt-i + a6?APDt-i + Et
(3)
DETt= a0 +
a2?DETt-i + a1?FCRt-i +
a3?TPIBt-i + a4?REPt-i +
a5?OUVt-i + a6?APDt-i +ut
(4)
Avec :
- FCR : la fuite des capitaux réelle
- DET : la dette extérieure
- TPIB : le taux de croissance du produit
intérieur brut réel
- REP : la rente pétrolière
- OUV : ouverture commerciale
- APD : aide publique au développement
- E et u : les termes d'erreur ;
- t : indice temporel
- i : le décalage
1.2. Source des données, Explication des variables
et justification des différents signes attendus
L'utilisation de l'outil économétrique dans
les analyses économiques sur séries temporelles nécessite
que l'on soit en présence d'un certain nombre de données
statistiques reflétant le passé, et d'un certain nombre de
variables retenues de préférence en fonction des
caractéristiques de l'espace économique sur lequel on
s'intéresse. Ici, nous présentons successivement les sources des
données ainsi que la justification des variables et des signes
attendus.
1.2.1.
Source des données
Notre recherche porte sur le Cameroun sur la période
1970-2010. Les données des variables retenues proviennent de deux
sources :
- Des résultats des travaux de Boyce et Ndikumana
(2012) en ce qui concerne la variable fuite des capitaux réelle.
- De la base WDI (World Development Indicator) 2012 de la
Banque Mondiale, en ce qui concerne les variables dette extérieure, taux
de croissance du PIB, aide publique au développement, rente totale
provenant des ressources naturelles, rente pétrolière et
ouverture commerciale.
Afin d'analyser ces données, deux logiciels sont
utilisés : la version 7 du logiciel EXCEL pour la constitution de
notre base de données et la Version 9 du logiciel Eviews pour les
estimations. Cette dernière version du logiciel Eviews présente
un avantage essentiel pour notre modélisation; contrairement aux
versions précédentes, c'est la seule version qui intègre
directement l'estimateur ARDL48(*) ainsi que l'approche du « Bound
Testing » (« test limite ») de Pesaran et al.
(2001).
1.2.2.
Explication des variables du modèle et signes attendus des coefficients
des variables :
Ø La dette extérieure
C'est le ratio de la dette extérieure au PIB du pays
à l'instant t. Boyce (1992), Chipalkatti et Rishi (2001) et Beja (2006)
montrent tour à tour une relation causale et même bidirectionnelle
entre la dette extérieure et la fuite des capitaux. En regardant dans
la littérature sur la fuite des capitaux, on se rend compte que
pratiquement toutes les études empiriques réalisées ont
révélé que la fuite des capitaux est significativement
aggravée par la dette publique extérieure. Selon
l'hypothèse de « porte financière
tournante », nous nous attendons à ce que la variable
dette extérieure affecte de façon significativement positive la
fuite des capitaux et inversement.
Ø La fuite des capitaux
réelle
Dans la littérature économique, il existe
différentes méthodes de mesures de la fuite des capitaux. Ces
méthodes varient en fonction de la définition et de la conception
attribuées à ce phénomène. C'est ainsi que nous
pouvons classer avec
Kant (1996) ces différentes méthodes de
mesure en deux grands groupes : les méthodes directes et les
méthodes indirectes.
· Les méthodes de mesures
directes
Elles sont qualifiées de directes car ce sont des
méthodes qui recensent à partir des catégories de la
balance des paiements, les variables qui pourraient constituer directement la
fuite de capitaux. Elles agrègent les données relatives aux
variables recensées et déterminent alors le montant de capitaux
enfuis. Ces méthodes identifient les montants de capitaux enfuis aux
catégories de la balance des paiements qui correspondent aux flux
externes de capitaux de court terme. Ce sont des capitaux très sensibles
aux variations de conjoncture macroéconomique ainsi qu'aux crises
qu'elles soient politiques ou économiques et sont donc
considérés comme des capitaux qui peuvent retourner à
l'économie domestique une fois la crise passée.
· La méthode ``argent chaud''
Des auteurs, à l'instar de Cuddington (1986, 1987),
Ketkar et Ketkar (1989), Gibson et Tsakalotos (1993), ont utilisé cette
méthode. Selon cette méthode, la fuite des capitaux est
calculée en ajoutant les erreurs et omissions nettes aux flux
extérieurs de capitaux privés non bancaires à court terme.
La fuite des capitaux selon la méthode ``argent chaud'' (FCa), est
donnée par la relation suivante :
FCait=
FECCit+ EONit (5)
Où FECC désigne
les flux extérieurs de capitaux à court terme.
· La méthode des avoirs
Des études, comme celles de la Banque d'Angleterre
(1989), Hermes et Lensink (1992), Collier, Hoeffler et Pattillo (2001),
considèrent le stock total des avoirs des résidents non bancaires
détenus dans des banques étrangères comme une mesure de la
fuite des capitaux.
Toutefois des critiques ont été faites aux
méthodes de mesures directes. En effet, ces méthodes ne
considèrent que les capitaux de court terme pourtant, les motivations
pouvant amener un agent à détenir des actifs de long comme de
court terme à l'étranger sont les mêmes, même si
certains actifs sont plus liquides que d'autres. En ce qui concerne
particulièrement la méthode de Cuddington, le fait d'ajouter la
ligne omissions et erreurs nettes aux flux externes de capitaux, ne permet pas
d'avoir une meilleure estimation, car celle-ci ne contient pas que les
omissions de flux de capitaux, mais aussi des erreurs dues aux délais de
registration, ainsi que des omissions d'importations.
· Les méthodes de mesures
indirectes
Ce sont des méthodes qui définissent la
fuite des capitaux comme le résidu de la différence entre
plusieurs autres variables recensées pour la plupart à partir de
la balance des paiements.
· La méthode résiduelle
Elle a été élaborée par la
Banque Mondiale (1985) et par Erbe (1985). Selon cette méthode, la
fuite des capitaux d'un pays i au cours d'une année t
est égale à :
FCrit= ( ÄDETit+
INDEit) - (CCit+ÄRESit) (6)
Où FCr représente la
fuite des capitaux calculée selon la méthode résiduelle.
ÄDET est la variation du stock de la dette extérieure
reportée dans les données de la Banque Mondiale ; INDE
est l'investissement net direct étranger ; CC est le solde du
compte courant et ÄRES est la variation des réserves de
change.
L'on note aussi la présence dans la
littérature de quelques variantes de cette méthode, notamment la
méthode de Morgan Guaranty Trust Company (1986) qui se
réfère à la méthode résiduelle mais en y
ajoutant la variation des avoirs détenus à l'étranger par
les Banques domestiques (ÄABD). Selon cette méthode la fuite des
capitaux est égal à :
FCmit= (ÄDETit+
INDEit) - (CCit+ ÄRESit) ?
ÄABDit (7)
Toutefois, cette méthode admet quelques limites
soulevées par des auteurs tels que Boyce et Ndikumana (2001). Ces
derniers affirment que la méthode résiduelle est instable car
elle ne tient pas compte de l'effet des fluctuations du taux de change sur la
valeur en dollar américain du stock de la dette de fin d'année.
Une autre limite relevée à cette méthode, est qu'elle ne
tient pas compte des falsifications de transactions commerciales, qui
proviennent souvent de la surfacturation ou la sous-facturation respectivement
des importations et des exportations (
Roy, 1994). Plusieurs études portant sur la
mesure de la fuite des capitaux ont utilisé cette méthode comme
base tout en y apportant des ajustements. Ces études prennent en compte
dans leurs calculs l'effet sur le montant de la fuite des capitaux, des
facteurs tels que les fluctuations du taux de change, les falsifications de
transactions commerciales, le taux d'inflation, les transferts de fonds des
migrants, les abandons de créances et les revenus
d'intérêt.
Les variantes de cette méthode tiennent donc compte
des ajustements à ces facteurs cités plus haut (Boyce et
Ndikumana, 2001, 2002, 2012 ; Ndikumana et Boyce, 2013).
· La méthode de Dooley
Elle calcule la fuite des capitaux en faisant la
différence entre les flux extérieurs totaux de capitaux et la
variation du stock des avoirs extérieurs. Selon cette méthode, la
fuite des capitaux d'un pays est égale à :
FETCit= EEit+ INDEit-
CCit? ÄRESit- EONit- BMFMIit
(8)
Où FETC est égal aux flux
extérieurs totaux de capitaux ; EE est l'emprunt
extérieur comme reporté dans les statistiques de la balance des
paiements ; EON représente les erreurs et omissions nettes ;
BMFMI indique la différence entre la variation de la dette
extérieure reportée dans les statistiques de la Banque Mondiale
et l'emprunt extérieur reporté dans les statistiques de la
balance des paiements publiées par le FMI.
Le stock des avoirs extérieurs, correspondant aux gains
d'intérêt, est égal à :
  = =   (9) (9)
Où AE désigne les avoirs extérieurs ; r
est le taux d'intérêt sur les dépôts des Etats-Unis
(supposé être un taux d'intérêt d'un marché
international représentatif) ; GINT représente les gains
d'intérêt. Ainsi, la fuite des capitaux, selon la méthode
de Dooley (1986), est mesurée par :
FCdit= FETCit? ÄAEit
(10)
D'après Hermes, Lensink et Murinde (2002a), la
méthode de Dooley (1986) est conceptuellement fausse dans la mesure
où la distinction entre flux sortants normaux et anormaux de capitaux
est impossible sur le plan empirique.
· La méthode de la banque de France
Elle consiste à comparer le besoin de financement tel
que relaté par la balance de paiement avec la variation de la dette
extérieure relevée par la banque mondiale (1985), toutefois cette
dernière valeur est corrigée des fluctuations du taux de change.
La différence constitue alors la fuite des capitaux. Une limite de cette
méthode relevée par Ameth Saloum Ndiaye réside dans le
fait que cette méthode considère le seul emprunt extérieur
comme source de capital pour le financement de l'économie.
Après avoir passé en revue toute ces
méthodes ainsi que leurs limites, celle retenue pour notre analyse, est
la méthode de la Banque Mondiale, car elle est celle qui a le plus
été réajustée, par plusieurs auteurs aux fins de
rapprocher le plus possible les résultats obtenus des montants
réels de fuite de capitaux. Plus précisément, nous
utiliserons la méthode de la Banque Mondiale corrigée des
ajustements de Boyce et Ndikumana (2012). Ces ajustements sont :
Ajustement aux falsifications des transactions
commerciales
En nous intéressant à l'étude
menée par Boyce et Ndikumana et Ndikumana et Boyce, les falsifications
des transactions commerciales se calculent en comparant les données sur
les importations et exportations d'un pays à celles de ses partenaires
commerciaux. Le montant total de ses falsifications est égale
à :
  t = t = 
 + + 
 (11) (11)
Où DEX est le
différentiel d'exportation entre les pays de la ZF49(*) et les pays
industrialisés ; DIM est le
différentiel d'importation entre les pays de la ZF et les pays
industrialisés ; PMEX est la part moyenne des
pays industrialisés dans les exportations d'un pays de la ZF et
PMIM est la part moyenne des pays
industrialisés dans les importations d'un pays de la ZF.
Ajustements aux transferts de fonds des
migrants
Plusieurs pays d'Afrique subsaharienne reçoivent
d'importantes entrées de capitaux, provenant de transferts de fonds de
leurs citoyens qui travaillent en Europe, aux États-Unis et dans
d'autres pays industrialisés. D'après Ndikumana et Boyce(2013),
ces flux sont souvent sous-estimés dans les statistiques officielles de
la balance des paiements (BdP). Officiellement les envois de fonds sont
enregistrés dans les statistiques de la balance des paiements
principalement sous trois rubriques: « Les envois de
fonds des travailleurs », « la
rémunération des salariés », et
« les transferts des migrants ».
En conséquence, le volume de transferts de fonds
non-déclarés sera estimé en comparant les flux
estimés des pays industrialisés avec les entrées totales
enregistrées dans la balance de paiement officielle des pays africains.
Partant sur le principe que, ces dernières doivent être plus
grandes, car elles sont destinées à inclure les transferts de
fonds du monde entier et pas seulement en provenance des pays
industrialisés, si la différence s'avère positive, alors
cela peut être considéré comme une preuve solide de
sous-déclaration. Les transferts non enregistrés sont
calculés de la manière suivante :
FCAit= FCit+ ETFit
(12)
FCA est la fuite des capitaux ajustée,
FC est le montant de fuite des capitaux, ETF
représente l'écart estimé de transfert de fonds.
Ø Le taux de croissance du PIB
La croissance du PIB réel domestique est
normalement perçue comme un baromètre à partir duquel
on évalue la performance économique des pays et par lequel on
mesure aussi le taux de rendement réel de l'économie
(Mikkelsen, 1991); il peut aussi être vu comme un indicateur favorable
du climat des affaires et de l'investissement domestique. A cet effet, un PIB
domestique élevé ou des taux de croissance positifs du PIB
peuvent contribuer à la réduction du stock de fuite des capitaux
et inversement (Ajayi, 1992). C'est une relation qui est d'ailleurs
appuyée par de nombreux travaux (Hermes et Lensink, 1992 ; Hermes
et al., 2002; Beja, 2006; Makochekanwa, 2007; Boyrie, 2010) mais qui peut
être remise en cause dans un contexte où la croissance
économique repose pour l'essentiel sur l'exploitation des
ressources naturelles, minières et/ou pétrolières
(Cooper et Hardt, 2000). Le signe attendu du coefficient de cette variable est
négatif et significatif.
Ø La rente totale provenant des ressources
naturelles
C'est la rente provenant des ressources naturelles
rapportée au PIB. La littérature (Boyce et Ndikumana, 2012; BAD
et GFI, 2013) sur la fuite des capitaux en Afrique suggère qu'en
général, les pays fortement dotés en ressources naturelles
sont également ceux qui enregistrent les montants les plus
élevés en termes de fuite des capitaux.
En outre, Kharat (2013) dans son étude
réalisée sur un échantillon de 40 pays émergents,
trouve que la rente pétrolière a un impact significatif et
positif sur la fuite des capitaux. Ndiaye(2011) dans son étude sur un
échantillon constitué des pays de la zone Franc, trouve que les
exportations de pétrole ont un effet statistiquement significatif et
positif sur la fuite des capitaux. Conformément aux résultats
obtenus par ces auteurs, nous nous attendons à ce que le signe
associé à cette variable soit significatif et positif.
Ø L'ouverture commerciale
C'est le degré d'ouverture commerciale qui peut
être mesuré par plusieurs indicateurs mais le plus largement
utilisé est le ratio des exportations et des importations au
PIB. L'ouverture commerciale peut favoriser la fuite des capitaux dans la
mesure où cela faciliterait la diversification du portefeuille des
agents (Collier et al., 2001). Ainsi, le signe attendu est positif.
Ø L'aide publique au
développement
C'est le ratio de l'aide publique au développement au
PIB. Par définition, l'aide est un flux financier public
géré dans le but principal de promouvoir le développement
économique et le bien-être des pays en développement. Elle
est de nature concessionnelle et comporte un élément don d'au
moins 25%. Collier, Hoeffler et Patillo (2004) examinent les effets de l'aide
publique au développement sur la fuite des capitaux. Leurs
résultats suggèrent qu'à des niveaux élevés,
l'aide tend à amplifier la fuite des capitaux. Ainsi, nous nous
attendons à ce que le coefficient associé soit significatif et
positif.
Tableau 3.1 : Récapitulatif des
différents signes attendus des variables
|
DESCRIPTION DES VARIABLES
|
|
Variables d'intérêt
|
Signe prévu
|
|
DET
|
Dette extérieure
|
(+)
|
|
FCR
|
Fuite des capitaux réelle
|
(+)
|
|
Variables de contrôle
|
|
TPIB
|
Taux de croissance du PIB
|
(-)
|
|
REP
|
Rente totale des ressources naturelles
|
(+)
|
|
RTO
|
Rente pétrolière
|
(+)
|
|
OUV
|
Degré d'ouverture commerciale
|
(+)
|
|
APD
|
Aide publique au développement
|
(+)
|
Source : Notre
élaboration.
2. Procédure d'estimation du modèle :
Ici, nous présentons dans un premier temps la
méthodologie des tests de racine unitaire. Dans un deuxième
temps, nous présenterons l'approche du test limite de Pesaran et al.
(2001) pour analyser la relation entre la dette extérieure et la fuite
des capitaux à long terme comme à court terme.
2.1. Les tests de racine
unitaire
Granger et Newbold (1974) soutiennent qu'on ne pourrait
faire une régression sans s'assurer que toutes les variables sont
stationnaires car cela pourrait conduire à une régression
fallacieuse. Les tests de racine unitaire sont donc effectués pour
déceler la présence ou non de racine unitaire dans une
série permettant ainsi de conclure sur la stationnarité ou la
non-stationnarité des séries étudiées. La
série est alors stationnaire lorsqu'elle ne comporte pas de racine
unitaire et ne l'est pas dans le cas contraire. Une série est dite
stationnaire si ses moments d'ordre sont invariants dans le temps; elle ne doit
donc posséder ni tendance, ni saisonnalité. Afin de
déterminer l'ordre d'intégration des séries de notre
étude, nous utiliserons le test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF)
et de Phillips et Perron (PP) car la détermination de l'ordre
d'intégration des variables ne saurait être rigoureuse à
partir d'un seul test (Keho, 2004).
2.1.1. Le test de
Dickey-Fuller Augmenté (ADF)
Le test de racine unitaire de Dickey-Fuller
Augmenté (ADF) est le plus usuel. Ce test prend en compte uniquement la
présence d'autocorrélation dans les séries.
L'hypothèse nulle est la présence de racine unitaire
(série non-stationnaire). Pour réaliser ce test, on estime le
modèle sous sa forme la plus générale suivante :

L'hypothèse nulle du test est H0 :  -1=0 ; contre l'hypothèse alternative H1 : -1=0 ; contre l'hypothèse alternative H1 :
Si l'hypothèse nulle n'est pas rejetée, alors la
série comporte une racine unitaire et il faudra la différencier
pour la rendre stationnaire. Pour tester cette hypothèse, on calcule la
statistique de Dickey-Fuller à savoir :  (14) (14)
Les valeurs obtenues sont par la suite comparées aux
valeurs « standards » fournies par la table de la loi normale
centrée réduite.
2.1.2. Le test de
Phillips-Perron
Le test de Philips-Perron permet de prendre en compte
non seulement l'autocorrélation mais aussi
l'hétéroscédasticité des erreurs. Ce test s'appuie
sur les mêmes modèles que le test de Dickey-Fuller simple. Ce test
propose une correction non-paramétrique de la statistique t
estimée. Le test de de Philips-Perron s'effectue en quatre
étapes :
-Une estimation par les moindres carrés ordinaires
(MCO) des trois modèles du test de Dickey-Fuller et le calcul des
résidus åt estimés
- La détermination de la variance de court terme
- Estimateur du facteur correctif qui est appelé
variance de long terme
-Calcul de la statistique de Philips-Perron.
Phillips et Perron(1988) soutiennent que la correction
non-paramétrique proposée de la valeur de tá
estimée, n'apporte pas de modification à la distribution
asymptotique de ladite statistique, qui est égale à celle
observée dans le cas de Dickey-Fuller simple ; les valeurs
critiques tabulées de DF restent alors valables pour le test de
Phillips-Perron.
2.2. Présentation de la
méthode économétrique
La présentation de la méthode
économétrique ne saurait se faire sans justifier au
préalable le choix de cette méthode.
2.2.1. Justification de la
méthode économétrique
Il existe plusieurs techniques
économétriques pour tester les relations de long terme entre les
séries. Les plus utilisées sont la procédure en deux
étapes d'Engle et Granger (1987), l'approche de Johansen (1988) et la
méthode de Johansen et Juseluis (1990). La condition nécessaire
de mise en oeuvre de ces méthodes est que les séries soient
toutes intégrées d'ordre 1. Or, dans la plupart des séries
macroéconomiques cette condition n'est pas vérifiée
(Nelson et Plosser, 1982). Cette exigence suppose alors que l'étude de
la stationnarité de ces séries soit effectuée. De plus,
l'application des tests de stationnarité sur des échantillons de
petite taille conduit à des résultats qui manquent de puissance.
Face à cette insuffisance, la méthode ARDL de Pesaran et al.
(2001) propose au contraire de ces modèles une nouvelle approche
permettant d'obtenir de meilleures estimations. Elle est plus appropriée
pour tester l'existence des relations de long terme et de court terme dans des
échantillons de petite taille et, contrairement à l'approche de
Johansen et Juselius (1990), elle permet de les tester entre des variables dont
les ordres d'intégration sont différents (Acikgoz et Merter,
2010).
2.2.2. Le modèle
Autorégressif à Décalage Temporel de Pesaran et al.
(2001)
Un ARDL est une régression des moindres carrés
contenant des retards des variables dépendantes et des variables
explicatives. Ces modèles sont généralement notés
ainsi : ARDL (p, q1,...qk), où p est le
nombre de retards de la variable dépendante, q1 est le nombre
de retards de la première variable explicative, et qk le
nombre de retards de la kème variable explicative. Un
modèle ARDL peut-être écrit ainsi:
p k qj
yt = á + ? ui yt-i
+ ? ?âj,i Xj,t-i + åt
(15)
i=1 j=1 i=1
Certaines variables explicatives, Xj, peuvent avoir
des termes non-décalés dans le modèle (qj=0).
Ces variables sont appelées variables explicatives statiques ou fixes.
Les variables explicatives avec au moins un terme décalé sont
appelées variables explicatives dynamiques. Pour spécifier un
modèle ARDL, nous devons déterminer le nombre de décalages
de chacune des variables qui doivent être incluses (C'est-à-dire
spécifier p et q1,...,qk). Puisqu' un
modèle ARDL peut-être estimé par la méthode des
moindres carrés, les critères d'information standards tels que
celui d'Akaike, Schwarz et Hannan-Quinn peuvent-être utilisés pour
la sélection du modèle. Alternativement, on pourrait utiliser le
R2 ajusté des différentes régressions.
Pesaran et al. (2001) ont estimé le modèle ARDL
conditionnel suivant les « bounds testing approaches ». Il
s'agit d'une méthode plus générale que celle
développée par Johansen. En effet, pour effectuer ce test, les
variables du modèle n'ont plus l'obligation d'être
intégrées du même ordre. On peut donc utiliser des
séries qui sont intégrées d'ordre 0 ou 1. Ainsi, Pesaran
et al. (2001) ont formulé un modèle à correction d'erreurs
qui peut s'estimer en trois étapes suivantes :
Première étape : on estime la version
bivariée d'un modèle à correction d'erreur (ECM)
Äyt = á0 +
á1t + ??yt-1 + ?xt-1+
?p-1?iÄyt-i +
?q-1?jÄxt-j + Et (16)
où ?? et ? sont les multiplicateurs de long terme,
les paramètres ?i,i= 1,..., p-1 et ?i,j =
1,...,q-1 sont les coefficients dynamiques de court terme, p
et q sont les ordres du modèle ARDL sous-jacent (p
fait référence à yt et q fait
référence à xt ), t
représente le temps (variable déterministe) et Et est
un bruit blanc non-autocorrélé avec Äxt et avec les valeurs
retardées de xt et de yt . La procédure PSS (Pesaran-Shin-Smith)
distingue entre cinq cas suivant la présence des composantes
déterministes dans le modèle :
Cas 1 (sans constante et sans trend) : le
modèle à correction d'erreur (ECM) devient :
Äyt = ??yt-1 +
?xt-1+ ?p-1?iÄyt-i +
?q-1?jÄxt-j + Et (17)
Cas 2 (avec une restreinte constante et sans
trend): le modèle ECM devient:
Äyt = (yt-1-
?oy) + ?(xt-1- ?ox)+
?p-1?iÄyt-i +
?q-1?jÄxt-j + Et (18)
Cas 3 (avec une constante et sans trend):
le modèle ECM devient:
Äyt = á0 +
??yt-1 + ?xt-1+
?p-1?iÄyt-i +
?q-1?jÄxt-j + Et (19)
Cas 4 (avec une constante et avec un
restreint trend):
Äyt = á0+
(yt-1- á1yt) + ?(xt-1-
á1xt)+ ?p-1?iÄyt-i +
?q-1?jÄxt-j + Et (20)
Cas 5 (avec une constante et avec un
trend):
Äyt = á0 +
á1t + ??yt-1 + ?xt-1+
?p-1?iÄyt-i +
?q-1?jÄxt-j + Et (21)
Deuxième étape : on teste la
nullité jointe des multiplicateurs de long terme ?? et ?
utilisant la statistique de Fisher associée au test de Wald dont on
considère l'hypothèse nulle suivante:
Ho: 
 = ? = 0 (non cointégration) = ? = 0 (non cointégration)
En effet, il s'agit d'un test de rapport de vraisemblance
standard appliqué à l'hypothèse nulle. L'hypothèse
nulle est rejetée pour les valeurs calculées
élevées de la statistique de test. Cependant, la distribution
asymptotique de ce test varie si les variables sous-jacentes sont I(0) ou I(1).
En tout cas, ce n'est pas une distribution de Fisher standard et par suite la
valeur calculée de cette statistique doit être comparée aux
valeurs critiques fournies par PSS. On dispose de deux ensembles de valeurs
critiques appropriées : un ensemble suppose que toutes les variables
sont I(1) et un autre suppose qu'elles sont toutes I(0). Cela fournit une bande
couvrant toutes les classifications possibles des variables entre I(1) et I(0)
ou même fractionnement intégrées.
Troisième étape : les
F-Statistiques calculées à la deuxième étape
seront comparées aux bornes inférieures (Flower ,
Fl) et (Fupper, Fu) supérieures de la
bande critique de la procédure PSS aux niveaux de confiance 90, 95 et 99
%. Trois cas se manifestent: Si F > Fu alors on rejette
l'hypothèse nulle et on conclut qu'il existe une relation
d'équilibre de long terme entre xt et yt, en
indiquant la présence d'une relation de cointégration. Si F <
Fl alors on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle, et dans
une telle situation, une relation d'équilibre à long terme ne
semble pas exister entre les variables en question. Finalement si
Fl < F < Fu alors le test est non conclusif et
l'ordre d'intégration des variables sous-jacentes doit être
étudié plus profondément.
Ø Tests de Diagnostics et de tests de
Stabilité
Afin d'évaluer la robustesse des modèles
choisis, nous ferons un ensemble de tests. D'une part, des tests de diagnostic:
le test du multiplicateur de Lagrange pour l'autocorrélation des
résidus, le test de la forme fonctionnelle de Ramsey (RESET), le test de
Jarque-Béra pour la normalité des résidus et le test de
White pour l'homoscédasticité. D'autre part, nous ferons les
tests du Cusum et du carré du Cusum pour la stabilité des
coefficients de long terme et de court terme.
Conclusion du chapitre
Le présent chapitre consacré à l'aspect
méthodologique de notre travail nous a permis de présenter la
méthodologie ARDL de cointégration de Pesaran et al. (2001). Il
nous a également permis de présenter le modèle empirique
que nous estimerons par la suite pour le Cameroun, ainsi que les données
utilisées. Le chapitre suivant est consacré à la
présentation des différents résultats obtenus. Ces
résultats nous permettront de formuler quelques recommandations de
politiques économiques.
CHAPITRE 4 : RESULTATS ET RECOMMANDATIONS
Plusieurs études ont analysé la relation entre
la dette extérieure et la fuite des capitaux dans les pays en
développement. La méthodologie présentée au
Chapitre précédent nous permettra ainsi d'apprécier ces
faits au Cameroun où l'endettement extérieur a toujours
occupé une place importante pour le financement de l'économie. Le
présent chapitre consiste donc à présenter les
résultats des analyses économétriques d'une part, et de
faire une interprétation des résultats et de proposer des
recommandations de politique économique qui en découlent d'autre
part.
1. Présentation des résultats
Nous présentons dans cette section les résultats
des tests de stationnarité ainsi que les résultats des tests de
cointégration.
1.1. Etude de la
stationnarité
L'approche autorégressive à décalage
temporel50(*) (ARDL) de
cointégration ne nécessite pas de pré-tests de racine
unitaire des variables incluses dans le modèle contrairement à
d'autres techniques de cointégration telle que l'approche de Johansen
(Pesaran et al., 2001).
Cependant, comme l'a remarqué Ouattara (2004), si
l'ordre d'intégration des variables est supérieur à un,
par exemple une variable I(2), alors les valeurs critiques tabulées
par Pesaran et al. (2001) ne sont plus valides car elles sont calculées
sur la base que les variables sont I (0) ou I (1). En d'autres termes, il
s'agit de s'assurer qu'aucune variable n'est intégrée d'ordre 2
(I(2)) pour respecter l'hypothèse sous-jacente de la méthodologie
ARDL. Dans cet esprit, nous commençons l'analyse
économétrique, en analysant l'ordre d'intégration des
variables à l'aide des tests de racine unitaire de Dickey-Fuller
augmenté (ADF) et de Phillips et Perron (PP).
Tableau IV.1 : Résultats des
tests de racine unitaire ADF et PP :
|
Variables
|
En niveau
|
En différence première
|
Ordre d'intégration
|
Conclusion
|
|
ADF
|
PP
|
ADF
|
PP
|
|
|
|
DET
|
0,701
|
0,537
|
0,0002
|
0,0002
|
I(1)
|
Non-stationnaire
|
|
FC
|
0,0006
|
0,0005
|
...
|
...
|
I(0)
|
Stationnaire
|
|
TPIB
|
0,002
|
0,002
|
...
|
...
|
I(0)
|
Stationnaire
|
|
REP
|
0,230
|
0,207
|
0,00
|
0,00
|
I(1)
|
Non-stationnaire
|
|
RTO
|
0,1435
|
0,1349
|
0,00
|
0,00
|
I(1)
|
Non-stationnaire
|
|
OUV
|
0,1943
|
0,1943
|
0,00
|
0,00
|
I(1)
|
Non-stationnaire
|
|
APD
|
0,008
|
0,007
|
...
|
...
|
I(0)
|
Stationnaire
|
Source : Auteur à partir d'Eviews 9.
Le tableau précédent montre que les
séries ne sont pas intégrées d'un même ordre.
Pendant que certaines d'entre elles sont stationnaires en niveau (I(0)),
d'autres par contre sont intégrées d'ordre 1 (I(1)). Aucune de
ces variables n'est intégrée d'ordre 2. La méthode de
cointégration que nous envisageons dans cette étude est donc
l'approche ARDL.
1.2. Le test de
cointégration
Nous pouvons maintenant mettre en oeuvre le test de
cointégration développé par Pesaran et al. (2001) pour
déterminer l'existence (ou non) d'une relation de long terme entre les
variables des deux modèles retenues dans cette étude.
Selon l'approche ARDL, une relation de long terme entre les
variables du modèle existe lorsqu'on rejette l'hypothèse nulle
d'absence de relation de cointégration. Cette hypothèse est
testée à travers un test de Fisher dont la valeur calculée
de la statistique est comparée aux valeurs critiques simulées par
Pesaran, Shin, et Smith (2001). Ces auteurs fournissent deux ensembles de
valeur représentant respectivement des limites supérieures et des
limites inférieures. L'hypothèse d'absence de
cointégration est rejetée lorsque la valeur calculée de la
statistique de Fisher est plus élevée que la limite
supérieure. Elle n'est pas rejetée dans le cas où elle est
plus faible que la limite inférieure, et il n'est pas possible de
conclure au cas où elle est comprise entre les deux limites.
La méthode du critère d'information de Schwarz
(SIC) a été préférée car il est plus
parcimonieux que le critère d'information d'Akaike (AIC). Les
résultats des tests de co-intégration sont rapportés dans
le tableau 4.2 et les résultats empiriques de l'ARDL (1,1,1, 1, 0) sont
présentés dans le tableau 4.3 et ils présentent les
coefficients de court terme.
Tableau 4.2 : Statistiques des tests
de Wald
|
Valeurs critiques
|
F Wald test
|
P-value of Wald test
|
|
Modèles
|
1%
|
5%
|
10%
|
|
|
|
I(0)
|
I(1)
|
I(0)
|
I(1)
|
I(0)
|
I(1)
|
|
FCR(DET,APD,TPIB,OUV,RTO) (1)
|
3,29
|
4,37
|
2,56
|
3,49
|
2,2
|
3,09
|
5,20
|
0,0030
|
|
DET(FCR,APD,TPIB,OUV,RTO)
(2)
|
3,29
|
4,37
|
2,56
|
3,49
|
2,2
|
3,09
|
0,96
|
0,4211
|
Source : Auteur
à partir d'Eviews 9.
Notes : Les valeurs critiques sont
tirées de Pesaran et al. (2001).
Les résultats de la statistique de Fisher
associée au test de Wald font ressortir deux constats. Dans un premier
temps, nous notons l'existence d'une relation de long terme entre la fuite des
capitaux, la dette extérieure, l'aide publique au développement
le taux de croissance du PIB et l'ouverture commerciale. En effet, la
statistique de Fisher associée au test de Wald (6,91) est
supérieure à la borne supérieure de la valeur critique du
test limite (3,49) telle que tabulée par Pesaran et al.(2001). En outre,
la p-value associée est inférieure à 0,05. Ceci nous
amène à valider l'existence d'une relation de long terme entre la
fuite des capitaux, la dette extérieure, l'aide publique au
développement, le taux de croissance du PIB et l'ouverture commerciale
aux différents seuils retenus.
En revanche, en observant la ligne 2 du tableau 4.2, nous
constatons que cette relation n'est pas réciproque car non-seulement la
statistique de Fisher associée au test de Wald (0,88) est
inférieure à 3,49, mais aussi la p-value associée au test
de Wald (0,42) est supérieure à 5%. Ceci nous amène
à rejeter l'existence d'une relation de long terme entre la dette
extérieure, la fuite des capitaux, l'aide publique au
développement, le taux de croissance du PIB et l'ouverture commerciale
(Modèle 2). Nous pouvons donc dire qu'au Cameroun, la dette
extérieure affecte la fuite des capitaux (Modèle 1) mais la fuite
des capitaux à son tour n'affecte pas la dette extérieure
(Modèle 2).
Après avoir détecté l'existence d'une
seule relation de long terme entre la fuite des capitaux, la dette
extérieure, l'aide publique au développement, le taux de
croissance du PIB et l'ouverture commerciale, la deuxième étape
de la méthode consiste à rechercher les coefficients
estimés de court terme et de long terme du modèle pour lequel la
relation d'équilibre de long terme est validée. Dans notre cas,
il s'agit du modèle (1).
Présentation des
élasticités de court terme et de long terme
Les résultats obtenus dans le cadre de notre travail sont
résumés dans les tableaux qui suivent :
Tableau 4.3: Fuite des capitaux et dette
extérieure : élasticités de court terme
|
Variables coefficients
t-statistic P>[t]
Dépendante : FC
|
|
FCt-1
-1,0436***
-4.975061 0.0001
DETt-1
0.563554** 2.540027
0.0205
APDt-1
3,335468* 2,008805
0,0543
OUVt-1
0,817153* 2,026693
0,0508
TPIB 0,448642
0,917756 0,3658
TCEt-1
-855285***
-6,065609 0,0000
|
|
R2
70,36%
Observations
38
Log Vraisemblance -95,74
F-Statistique
3,932146
|
Source : Auteur à partir
d'Eviews 9. *** (**) [*] significativité à 1% (5%) [10%]
Tableau 4.4 : Fuite des capitaux et
dette extérieure : élasticités de long terme
|
Variable dépendante :
coefficients t-statistic
P>[t]
Fuite des capitaux
|
|
FCt-1
-0,855805*** -5,831656
0.0000
DETt-1
0,165825* 1,863796
0,0729
OUV
0,947014* 2,276800
0,0543
REP
1,032355** 2,186511
0,0360
RTO 1,202877**
2,121847 0,0414
APD -1,232877
2,121847 0,0414
TPIB 0,448642
0,917756 0,3658
|
|
R2
70,36%
Observations
41
Log Vraisemblance -161,67
|
Source : Auteur à partir
d'Eviews 9. *** (**) [*] significativité à 1% (5%) [10%]
Après estimation, nous constatons que :
- Le coefficient du terme d'erreur (TCE) qui représente
la vitesse d'ajustement de la relation de court terme vers l'équilibre
de long terme est bien négatif et significatif à 1%, ce qui
confirme donc l'existence de la relation de long terme.
- Au niveau global, le modèle est significatif avec un
coefficient de détermination R2 (0,7036) élevé.
Ce coefficient montre que la qualité d'ajustement du modèle est
assez bonne.
Cependant, certains tests de validation des hypothèses
sont nécessaires pour vérifier non seulement la bonne
spécification des modèles mais aussi la stabilité des
coefficients. Dans le premier cas, il s'agit du test d'autocorrélation
des erreurs, du test de normalité des résidus, du test de
spécification, du test d'hétéroscédasticité.
Dans le deuxième cas, il s'agit du test de stabilité des
paramètres du CUSUM et du carré du CUSUM.
Ø Test de l'autocorrélation des
résidus :
L'autocorrélation des résidus a
été testée à l'aide du test du multiplicateur de
Lagrange de Breusch-Godfrey pour l'autocorrélation des résidus
d'ordre n. Sous l'hypothèse nulle, toutes les autocorrélations
sont statistiquement nulles. L'acceptation de l'hypothèse nulle revient
à prouver la non-autocorrélation des résidus. Cette
décision est prise si la statistique de Breusch-Godfrey calculée
est inférieure à la valeur critique (5,99). La même
conclusion est prise si la probabilité critique de cette statistique est
supérieure au seuil de significativité de 5%. La p-value
associée à la statistique du test de Breusch-Godfrey est de
25,77%. On accepte donc l'hypothèse nulle de l'absence
d'autocorrélation des erreurs.
Ø Test de normalité des résidus
Pour tester la normalité des résidus, le test
J-B dit de JARQUE et BERA a été utilisé. Ce test suit une
distribution de Chi-deux à deux degrés de liberté. Il
formule l'hypothèse nulle de distribution normale des résidus et
cette hypothèse n'est acceptée que si la statistique J-B est
inférieure à la valeur critique = 5,99. Cette normalité
des résidus est aussi conclue lorsque la probabilité critique est
supérieure au seuil de 5%. Ainsi, la p-value associée à la
statistique de J-B est de 17,94%. On conclut que les résidus sont
normalement distribués.
Ø Test de spécification
Pour vérifier s'il n'y a pas des variables omises dans
le modèle et si la spécification est correcte, nous avons fait
recours au test de Ramsey RESET. Ce test procède par régression
successive en ajoutant des variables supplémentaires à la
régression initiale. Sous l'hypothèse nulle, les coefficients
estimés des régresseurs supplémentaires sont
statistiquement nuls, il n'y a donc pas d'erreurs de spécification ou de
variables pertinentes omises. L'hypothèse nulle est aussi retenue si la
probabilité critique de la statistique F-RESET est supérieure au
seuil de significativité (ici 5%). Pour notre estimation, la
probabilité F-RESET est de 42,5%. Il n'y a donc pas de
variables omises dans le modèle et par conséquent la
spécification du modèle est bonne.
Ø Test
d'hétéroscédasticité
L'identification de
l'hétéroscédasticité peut être faite à
l'aide de plusieurs tests, par exemple le test de Breusch-Pagan, le test de
Goldfeld, le test de Gleisjer et le test de White. Dans notre étude,
nous utilisons le test de Breusch-Pagan pour tester
l'hétéroscédasticité. Les critères de
décision sont les suivants :
· H0 : homoscédasticité
· H1 :
hétéroscédasticité
Si la probabilité associée au test est
inférieure à 5%, on rejette l'hypothèse
d'homoscédasticité (H0). En revanche, si la probabilité
est supérieure à 5%, l'hypothèse nulle est
vérifiée et nous pouvons supposer
l'homoscédasticité des résidus. Dans notre cas, la p-value
(32,08%) est supérieure à 5%. Nous ne rejetons donc pas
l'hypothèse nulle d'homoscédasticité.
Tableau 4.5 : Récapitulatif des
Tests de Diagnostic
|
Intitulé
|
p-value
|
|
Test de Normalité de
Jacque-béra
|
0,179424
|
|
Test d'autocorrélation de Breush
Godfrey
|
0,2577
|
|
Test d'hétéroscédasticité
de Breusch-Pagan
|
0,3208
|
|
Test de RESET
|
0,425
|
Source : Auteur à
partir d'Eviews 9
· Test de stabilité des
coefficients
Afin de mener à bien notre étude, il est
important de tester si les relations de court terme et de long terme
précédemment trouvées sont stables sur toute la
période de l'étude. Pour ce faire, nous devons tester la
stabilité des paramètres du modèle. La méthode que
nous utilisons ici est basée sur la somme cumulée (CUSUM) et la
somme cumulée carrées (CUSUMSQ) proposée par Brown et al.
(1975). Contrairement au test Chow qui exige que les points de rupture soient
spécifiés, les tests CUSUM peuvent être utilisés
même lorsque les points de rupture ne sont pas connus. Le test de CUSUM
utilise la somme cumulée des résidus récursifs sur la base
des n premières observations et il est mis à jour de
manière récursive. Le test de CUSUM carré utilise le
carré des résidus récursifs et suit la même
procédure.
Si les parcelles du CUSUM et du carré du CUSUM restent
dans les limites critiques du niveau de significativité de 5%,
l'hypothèse nulle selon laquelle tous les coefficients sont stables ne
peut être rejetée. Cependant, si la courbe coupe le corridor,
l'hypothèse nulle de la stabilité des paramètres est
rejetée. Les graphiques 4.1 et 4.2 présentent les
résultats des tests du CUSUM et du CUSUMSQ. L'observation de ces
graphiques permet de constater que les courbes du CUSUM et du CUSUMSQ qui
représentent la variable testée sont contenues dans la zone de
significativité. Il y'a donc stabilité de la relation sur le long
terme et le court terme.
Graphique 4.1 : Test de CUSUM
Source : Auteur à partir d'Eviews
9
Graphique 4.2 : Test de CUSUM
carré

Source : Construit par l'auteur à
partir d'Eviews 9
Les tests de diagnostic et de stabilité
effectués, nous pouvons passer à l'interprétation des
résultats obtenus de l'étude et formuler les recommandations de
politique économique qui en découlent.
2. INTERPRETATIONS DES RESULTATS ET RECOMMANDATIONS DE
POLITIQUES ECONOMIQUES
Il est nécessaire d'interpréter les
différents résultats que nous avons obtenus afin de
déboucher sur des recommandations de politiques économiques
pertinentes. Par soucis de précision dans ces interprétations,
nous nous intéressons tant sur l'aspect économétrique que
sur l'aspect économique pour l'analyse de la dynamique de court terme et
de l'équilibre de long terme.
2.1. Interprétations des
résultats
Nous interprétons ainsi les élasticités de
court terme et de long terme :
· Fuite des capitaux et Dette
extérieure
Les résultats issus des estimations nous permettent de
faire plusieurs constats : premièrement, nous constatons que le
niveau de la fuite des capitaux de la période précédente a
un effet significatif et négatif sur la fuite des capitaux courante.
Ensuite, la dette extérieure à un effet significatif et positif
sur la fuite des capitaux à court terme. En effet, à court terme,
tout accroissement de la dette extérieure d'un dollar conduit à
un accroissement de la fuite des capitaux de 54 centimes de dollar.51(*)
Néanmoins, à long terme, cet effet positif et
significatif de la dette extérieure sur la fuite des capitaux diminue
progressivement ; la hausse d'un dollar de dette extérieure entraine une
augmentation de 19 centimes de dollar52(*) de la fuite des capitaux sur le long terme.
En revanche, la fuite des capitaux n'affecte pas la dette
extérieure dans le court terme comme dans le long terme (Tableau 4.1).
Ainsi, le phénomène de « porte financière
tournante » (« Financial Revolving door »)
où la dette extérieure et la fuite des capitaux s'engendrent de
façon réciproque n'est pas vérifié pour le cas du
Cameroun sur la période de 1970 à 2010. La relation est
unidirectionnelle dans la mesure où c'est l'accroissement de la dette
extérieure qui conduit à l'augmentation de la fuite des
capitaux.
Sur le plan empirique, ce résultat parait similaire
à celui de Ndikumana et Boyce(2011) dans le cas des pays d'Afrique
subsaharienne. Ils soutiennent que pour chaque dollar d'emprunt
étranger, en moyenne plus de 50 centimes quittent le pays emprunteur la
même année. De même, ce résultat confirme celui de
Gankou, Bendoma et Sow (2014) qui soutiennent que le phénomène de
« porte financière tournante » n'est pas
vérifié pour le cas du Cameroun.
En outre, pour ce qui est de l'équation de la fuite
des capitaux, à part la dette extérieure, trois autres
variables se sont révélées significatives :
· L'aide publique au
développement :
Le coefficient associé à cette variable est
significatif et positif. L'observation du tableau 4.2 montre que sur le court
terme, une augmentation de 10 points de pourcentage de l'Aide publique au
développement par rapport au PIB provoque une hausse de 3,33 points de
pourcentage de la fuite des capitaux.
Sur le plan empirique, ces résultats semblent confirmer
les travaux de Collier et al.(2004) qui montrent que dans les pays en
développement, c'est à des niveaux considérables que
l'aide publique au développement affecte la fuite des capitaux.
· La rente provenant des ressources
naturelles :
La rente provenant des ressources naturelles affecte
également la fuite des capitaux sur le long terme. En effet, le
coefficient qui est associé à cette variable est significatif et
positif à long terme. Le tableau 4.2 montre qu'une hausse de la rente
provenant des ressources naturelles de 5 points de pourcentage du PIB engendre
une augmentation de 1,2 point de pourcentage de la fuite des capitaux sur le
long terme.
En particulier, l'augmentation de la fuite des capitaux
provoquée par ces ressources naturelles émanerait surtout de la
rente issue du pétrole. Le tableau 4.2 montre qu'une hausse de la rente
pétrolière de 5 points de pourcentage du PIB engendre un
accroissement de la fuite des capitaux de 1,03 point de pourcentage. Ce
résultat est conforme à celui de la BAD53(*) et du GFI54(*) (2013) qui mettent en
évidence l'importance du pétrole comme un déterminant
important du phénomène de fuite des capitaux en
Afrique.
· L'ouverture commerciale :
Le coefficient associé à cette variable est
aussi bien pertinent pour le court terme que pour le long terme. Ceci pourrait
se justifier par le fait que l'ouverture commerciale favorise une forte
mobilité des capitaux en facilitant la diversification du portefeuille
des agents (Collier et al., 2001).
L'interprétation de ces résultats nous permet de
proposer un ensemble de recommandations de politiques économiques.
2.2. Recommandations de
politiques économiques
Les résultats de nos estimations nous permettent
d'affirmer qu'au Cameroun, l'accroissement de la dette extérieure
entraine une augmentation de la fuite des capitaux. Par ailleurs, la fuite des
capitaux au Cameroun est également causée par l'aide publique au
développement et la rente provenant des ressources naturelles, en
particulier la rente pétrolière. Cet ensemble de constats nous
conduit à proposer quelques recommandations de politiques
économiques en vue de minimiser ce phénomène et
assainir le climat économique du pays :
Promouvoir une politique de prêts responsables de la
part des bailleurs de fonds et de plus de responsabilité dans la
gestion de la dette de la part du Cameroun ; les financements
extérieurs (Dette et Aide) accordés au Cameroun devraient
être assortis d'un préalable de conditions et
stratégies tant externes qu'internes en matières de gestion
et contrôle.
Les mesures relatives à l'assainissement des finances
publiques devraient se poursuivre avec un accent sur la qualité de
l'endettement. Les emprunts non concessionnels, qui par nature sont
accordés à des conditions moins avantageuses que celles du
marché, devraient être exclusivement orientés vers les
projets ayant une forte rentabilité financière et
économique55(*).
Le gouvernement devrait envisager des réformes
structurelles pour promouvoir une gestion transparente des ressources
naturelles du pays, et principalement les ressources pétrolières
et favoriser l'exploitation de ces ressources sur place afin d'accroître
le niveau de production intérieure.
Prendre de nouvelles résolutions pour
l'amélioration de l'environnement des affaires et l'assainissement de
l'environnement macroéconomique au Cameroun. Dans le rapport Doing
Business 2015, le Cameroun, en se classant 158ème/189
économies, figure parmi les pays les moins compétitifs de la
planète selon la Banque Mondiale. Ainsi, le pays perd 10 places dans le
classement par rapport à 2014 où il était
148ème dans la facilité à faire des affaires.
En outre, le même rapport indique que le Cameroun perd 6 places en 2015
en matière de création d'entreprises passant de
127ème à 133ème.
L'amélioration du cadre des affaires s'avère
donc impérieux pour réduire la fuite des capitaux au Cameroun.
Pour cela, il faudrait favoriser la modernisation de l'appareil de production,
l'amélioration de la productivité, de l'accès au
financement et du climat des affaires, ainsi que la promotion de
l'émergence des industries locales et la poursuite de la diversification
de l'économie et de ses partenaires commerciaux. Ces réformes
économiques pourraient davantage positivement influencer les
incitations à investir au Cameroun.
In fine, il n'est plus besoin de relever que la lutte contre
la corruption et l'amélioration de la gouvernance financière et
économique seront indispensables pour une réduction de la fuite
des capitaux au Cameroun.
Conclusion du chapitre
Dans ce chapitre, il a été question pour nous de
présenter les résultats empiriques de nos modèles et leurs
implications économiques. A cet égard, nous avons
présenté successivement les résultats du test de
stationnarité, les résultats du test de cointégration
ainsi que les résultats de la dynamique de long terme et de court terme.
Les résultats nous montrent que la dette extérieure a un effet
positif et significatif sur la fuite des capitaux. A court terme,
l'augmentation d'un dollar de la dette extérieure entraine une
augmentation de 54 centimes de dollar de fuite des capitaux. A long terme, cet
effet diminue et vaut 19 centimes de dollar. Cependant, la fuite des capitaux
n'a aucune incidence significative sur la dette extérieure. Nous avons
également constaté que l'aide publique au développement,
l'ouverture commerciale et la rente pétrolière entrainent une
augmentation de la fuite des capitaux. Suite à ces résultats,
nous avons pu dégager quelques recommandations de politiques
économiques en faveur d'une réduction de la fuite des capitaux et
d'une amélioration du climat des affaires.
Conclusion de la deuxième partie
L'objectif de cette deuxième partie était
d'examiner la relation entre la dette extérieure et la fuite des
capitaux au Cameroun d'un point de vue empirique. Pour atteindre cet
objectif, cette partie a été structurée en deux
chapitres :
Le premier chapitre a présenté la
méthodologique utilisée pour analyser la relation entre la dette
extérieure et la fuite des capitaux au Cameroun. Cette
méthodologie s'est appuyée sur l'approche ARDL de
cointégation de Pesaran et al. (2001) du fait des nombreux avantages que
cette approche présente, en particulier pour notre
modélisation.
Le second chapitre a analysé la relation entre la dette
extérieure et la fuite des capitaux au Cameroun. L'approche ARDL a
permis la modélisation. Parmi les multiples résultats, on peut
noter que la dette extérieure affecte la fuite des capitaux
à court terme mais cet effet diminue progressivement au fils du temps.
Aussi, la fuite des capitaux est influencée positivement par l'aide
publique au développement, l'ouverture commerciale ainsi que la rente
provenant des ressources naturelles, principalement la rente
pétrolière.
Par contre, la fuite des capitaux n'a aucun effet significatif
sur la dette extérieure. Ce résultat nous amène à
conclure que l'hypothèse selon laquelle la dette extérieure et la
fuite des capitaux s'engendrent mutuellement ne peut être validée
pour le cas du Cameroun.
CONCLUSION GENERALE
Quelle est la relation entre la dette extérieure et la
fuite des capitaux au Cameroun ? Telle était la question principale
à laquelle cette étude devait apporter une réponse. Pour
cela, la méthodologie a principalement consisté en l'utilisation
des outils à la fois documentaires, statistiques et
économétriques.
Une organisation équilibrée de notre travail
nous a imposé une structure en deux parties. La première partie a
consisté au chapitre un en la mise en évidence des
différents aspects théoriques discutant de la relation entre la
dette extérieure et la fuite des capitaux à travers le
phénomène de « porte financière
tournante ». Brièvement, nous pouvons retenir que les
auteurs (Boyce, 1992 ; Beja, 2006, Ndikumana et Boyce, 2013) distinguent
quatre façons d'associer la dette extérieure à la fuite
des capitaux : la fuite des capitaux peut découler de la dette
extérieure, la dette extérieure peut alimenter la fuite des
capitaux, l'emprunt étranger peut être induit par la fuite des
capitaux, et l'emprunt étranger peut être accélérer
par la fuite des capitaux. La revue de littérature empirique nous a
permis de mettre en évidence quelques résultats à la fois
pour des pays pris individuellement et des échantillons de plusieurs
pays.
Le chapitre deux quant à lui s'est chargé de
présenter l'évolution globale de la dette extérieure et de
la fuite des capitaux au Cameroun au cours de la période 1970-2010.
Nous avons également présenté les différentes
mesures de lutte contre la fuite des capitaux sur le plan national ainsi que
sur le plan international.
La deuxième partie de notre travail a consisté
au chapitre trois à présenter la méthodologie de notre
étude. Dans un premier temps, nous avons présenté la
méthodologie des tests de racine unitaire (ADF, PP). Dans un
deuxième temps, nous avons présenté la méthodologie
ARDL de de cointégration de Pesaran et al.(2001). L'avantage de cette
méthode est qu'elle permet de prendre en compte les variables ayant des
ordres d'intégration différents. Aussi, elle permet d'obtenir
à la fois la dynamique de long terme et de court terme.
Au chapitre 4, nous avons estimé l'effet de la dette
extérieure sur la fuite des capitaux d'une part, et l'effet de la fuite
des capitaux sur la dette extérieure d'autre part.
Nous avons en premier lieu constaté que toutes les
variables sont stationnaires en niveau ou en différence première:
ce qui nous a conduit à la mise en oeuvre de la méthodologie
ARDL. le test limite de Pesaran et al.(2001) nous a permis de détecter
l'existence d'une seule relation de long terme : pour le modèle dans
lequel la fuite des capitaux dépend de la dette extérieure, de
l'aide publique, de l'ouverture commerciale, du taux de croissance du PIB, et
de la rente totale provenant des ressources naturelles. Les résultats de
nos estimations ont montré qu'à court terme, un accroissement
d'un dollar de la dette extérieure entraine une augmentation de 54
centimes de dollar de la fuite des capitaux. Cette situation diminue
progressivement au fil du temps. En outre, nous avons constaté que trois
autres variables favorisent la fuite des capitaux au Cameroun : l'aide publique
au développement, l'ouverture commerciale ainsi que la rente provenant
des ressources naturelles en particulier la rente pétrolière.
En s'appuyant sur nos résultats, nous avons
formulé un certain nombre de recommandations. Ces recommandations
visent principalement à favoriser l'amélioration du climat des
affaires, de la gouvernance financière et économique ainsi
qu'à mettre l'accent sur la qualité de l'endettement.
Bien que
l'objectif visé
soit atteint, ce travail constitue une recherche préliminaire qui sert
de point de repère pour des recherches futures plus approfondies. Dans
le prolongement de ce travail, d'autres questions importantes qui pourraient
servir de recherche seraient par exemple la relation entre les
flux entrants de capitaux et la fuite illicite des capitaux en Zone Franc.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Acikgoz S. et Merter M. (2010). `
The
Endogeneity of the Natural Rate of Growth: An Application to Turkey',
Panoeconomicus, Savez
ekonomista Vojvodine, Novi Sad, Serbia, vol. 57(4), pages 447-469, December.
Adam Smith (1776). `Recherche sur la nature et les causes de
la richesses de nations.'
http://classiques.uqac.ca/classiques/Smith_adam/richesse_des_nations/livre_1/richesse_des_nations_1.pdf
Ajayi, Ibi S. (1992). `An Economic Analysis of Capital Flight
from Nigeria', World Bank, Working Paper 993.
Ajayi, Ibi S. (1995). `Capital Flight and External Debt in
Nigeria', African Economic Research Consortium, Research Paper 35.
Ajayi, S. I. (1997). `An Analysis of External Debt and
Capital Flight in the Severely Indebted Low-Income Countries in Sub-Saharan
Africa', Working Paper WP/97/68. International Monetary Fund, Washington,
DC.
Awung, W.J. (1996). `An Economic Analysis of Capital Flight in
Cameroon', Report forAfrican Economic Research Consortium, Nairobi.
Banque Africaine de Développement et Global
Financial Integrity. (2013). `Les Flux Financiers Illicites et la Question
des Transferts Nets de Ressources en Provenance de L'Afrique, 1980-2009',
Rapport Conjoint, Mai 2013.
Banque Afrique N013629 du 28 janvier 1992
Banque d'Angleterre (1989). `Capital Flight', Bank of England
Quarterly Bulletin, 29: 364-367.
Banque de France (1987). `L'évasion des capitaux dans
les pays en développement', Bulletin de Conjoncture, Mai.
Banque Mondiale (1985). `World Development Report 1985',
Washington DC: World Bank.
Banque Mondiale (1992) . `Rapport sur ??le
Développement dans le monde' New York : Oxford University Press
Banque Mondiale (2006). `Global Economic Prospects : Economic
Implications of Remittances and migration', Washington, DC.
Barro, R. J. (1974). `The Loan Market, Collateral, and Rates
of Interest.' Center for Math. Studies in Bus. And Econ., Univ. Chicago, Report
7401, January.
BBC (2002). `IMF : Angola»s missing millions', 18
octobre
Beja, Jr. L. E. (2006). `Revisiting the Revolving Door:
Capital Flight from Southeast Asia', DESA Working Paper N°16,
ST/ESA/2006/DWP/16
Beja, Jr. L. E. (2007). `Capital Flight and Economic
Performance after the asian Crisis', Working paper Series, no. 139, Political
Economy Research Institute, University of Massachusetts, Amherst ,
Bendoma, M. (2012). `La fuite des capitaux en Afrique
Centrale: Déterminants et effets sur la croissance économique',
Thèse de Doctorat, Université de Yaoundé II.
Boyce, J. K. (1992). `The revolving door? External debt and
capital flight: Philippine case study'. World Development, 20 (3): 335-349
Boyce, J. K. and L. Ndikumana (2001). `Is Africa a net
creditor? New estimates of capital flight from severely indebted sub-Saharan
African countries , 1970-1996', Journal of Development Studies 38 (2):
27-56.
Boyce, J.K., Ndikumana, L. (2002). `Public Debts and
Private Assets: Explaining Capital Flight from Sub-Saharan African
Countries'. World Development.
Boyce, J. K. and Ndikumana, L. (2012). `Capital Flight from
Sub-Saharan African Countries: Updated Estimates, 1970-2010', PERI Research
Report, October.
Boyrie M., (2010). `Determinants of Capital Flight and Capital
Movement through Trade Misspricing The African Case', Afican Journal of
Accounting Economics, Finance and Banking Research, Vol.6 No.6.
Brown, R.L., J. Durbin, et J.M. Evans (1975). `Techniques for
Testing the Constancy of Regression Relations Over Time', Journal of the Royal
Statistical Society, Series B, 37, 149-163.
CAA (Caisse Autonome d'Amortissement) (1998). `Glossaire des
termes usuels de la dette publique.' Yaounde 1998
CAA (Caisse Autonome d'Amortissement) (2013). `Dette publique
et à garantie publique du Cameroun : Portefeuille au 31
décembre 2012 et viabilité à l'horizon 2032'.
Chauvin S. (2012). `Cameroun: les enjeux de la croissance'
AFD/Macroéconomie et Développement/N°6 Novembre.
Chipalkatti, N., Rishi M. (2001). `External Debt and Capital
Flight in the Indian Economy', Oxford Development Studies, 29 (1).
CNUCED (Conférence des Nations unies sur le
Commerce et le Développement) (1992). `Rapport sur le Commerce
et le Développement'.
Collier, P., Hoeffler, A., Patillo, C. (2001). `Flight Capital
as a Portfolio Choice', World Bank Economic Review, 15 (1): 55-80.
Collier, P., Hoeffler, A. and Pattillo, C. (2004). `Aid
and Capital Flight', Oxford University: Centre for the Study of African
Economies.
Conesa, E.R. (1987). `The flight of capital from Latin
America', Mimeo, Inter-American Bank, in Washington, DC
Cooper, W. H., Hardt, J. P. (2000). `Russian Capital
Flight, Economic Reforms and U.S. Interests: An analysis', Report for
Congress, Congressional Research Service, March
Cuddington, J. T. (1986). `Flight Capital, Issues and
Explanations', Princeton Studies in International Finance, 58. Princeton, NJ:
Princeton University.
Cuddington, J. T. (1987). `Macroeconomic Determinants of
Capital flight: An Econometric Investigation', in Lessard, D. R. and
Williamson, J. (Eds), Capital Flight and Third World Debt. Washington DC:
Institute for International Economics, pp. 85-96.
Cutajar C. (2012). `Les instruments juridiques pour lutter
contre la délinquance économique et financière et le
blanchiment au niveau européen et international'.
Demir, F. (2004). `A Failure Story: Politics and Financial
Liberalization in Turkey, Revisiting the Revolving Door Hypothesis'. World
Development, 32(5). 85 1-869
Deppler, M., Willamson, M. (1987). `Capital Flight:
Concepts Measurement and Issues', Staff Papers for the World Economic
Outlook, Washington DC: International Monetary Fund, pp. 39-58
Dickey, D., Fuller, W.A., (1979). `Distribution of the
estimates for autoregressive time series with unit root', Journal of the
American Statistical Association74, June, 427-31.
Dooley, M. P. (1986). `Country - Specific Risk
Premiums, Capital flight and Net Investment Income Payments in Selected
Developing Countries', Washington DC: IMF, Unpublished Manuscript
Duwendag, D. (1989). `Capital flight from developing
countries'. Development Co-operation(3), 23-25.
Engle R. F. et Granger C. W. J. (1987). `Co-Integration and
Error Correction: Representation, Estimation, and Testing', Econometrica, Vol.
55, No. 2. (Mar., 1987), pp. 251-276.
Erbe, S. (1985). `The Flight of Capital from Developing
Countries', Intereconomics (November/December), pp. 268-275.
Fambon, S. (2002). `Endettement du Cameroun: problèmes
et solutions', World Institute for Development Economic Research (WIDER),
Discussion paper N°2002/49
FIDA (Fonds international de Développement Agricole)
(2007). `Sending Money Home : Worldwide Remittance Flows to Developing and
Transition Countries', Rome, FIDA,
www.ifad.org/events/remittances/maps/brochures.pdf.
Fofack Hippolyte (2008). `Technology-Trap and Poverty Trap in
Sub-Saharan Africa', World Bank Policy Research Working Paper No. 4582, The
World Bank Group.
Fofack, H. (2009). `Causality between External Debt and
Capital Flight in Sub-Saharan Africa', Policy Research Working Paper
N°5042, World Bank, September 2009.
FMI (2011). `Cameroun: Article IV consultation -staff
report', IMF Country Report n°11/266, septembre.
Gankou, J. M., Bendoma, M., et Sow, M. N. (2014).
`L'environnement institutionnel et les liens entre les flux de capitaux et la
fuite des capitaux au Cameroun'. African Economic Research Consortium
(AERC),CREA/AERC/2014
Gibson, H. D., Tsakalotos, E. (1993). `Testing a Flow Model of
Capital Flight in Five European Countries', the Manchester School, 61 (2):
144-166.
Granger C. et Newbold
P. (1974). `Spurious regressions in econometrics'
Journal of
Econometrics, 1974, vol. 2, issue 2, pages 111-120
Henry, J. (1986). `Where the money went: Third World debt
hoax', New Republic, 14 avril , pp.20-23.
Hermes, N. et R. Lensink(1992). `The magnitude and
determinants of capital flight : the case for six Sub-Saharan African
Countries', The Economist, 140(4), pp. 515-530.
Hermes, N. R., Lensink, R., Murinde, V. (2002a). `Flight
Capital and its Reversal for Developing Financing', UNU/WIDER, Discussion Paper
N°2002/99
Johansen, S., (1988). `Statistical analysis of cointegration
vectors', Journal of Economic Dynamics & Control12, June-September,
2131-54.
Johansen and Juselius, K., (1990). `Maximum Likelihood
Estimation and Inference on Cointegration-with Applications to the Demand for
Money', Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 52, No. 2, pp.
169-210
Kant, C. (1996). `Foreign Direct Investment and Capital
Flight'. Princeton Studies in International Finance N°80, NJ: Princeton
University.
Keho, Y., (2004). `Impact de l'investissement public sur la
croissance en Côte d'Ivoire', Politique Economique et
Développement (PED), N° 103, Octobre 2004, CAPEC-CIRES, Abidjan,
Côte d'Ivoire.
Ketkar, S. L., Ketkar, K. W. (1989). `Determinants of Capital
Flight from Argentina, Brazil and Mexico', Contemporary Policy Issues, 7
(3):11-27.
Kindleberger, C.P (1987). `Capital Flight - A Historical
Perspectives', in Lessard, D. R. and Williamson, J. (Eds) Capital Flight
and Third World Debt. Washington DC: Institute for International
Economics, pp. 7-26.
Kharat, O. (2013). `Fuite des Capitaux: Gouvernance, Facteurs
Institutionnels et variables macroéconomiques.' (Master), Ecole
Supérieure de Commerce de SFAX.
Laffer, A. B. (1979). `Statement Prepared for the joint
Economic Committee', in A. B. Laffer and J. P. Seymor, eds, The Economics of
the Tax Revolt : A Reader. New York: Harcourt Brace Jovanich.
Yapo, L.(2002), `Les déterminants de la dette
extérieure des PPTE : cas de la Côte d'Ivoire', World
Institute for Development Economic Research (WIDER), Discussion paper
N°2002/14
Lessard, D. R., Williamson, J. (1987). `Capital Flight
and Third World Debt', Washington, DC: Institute of International
Economics.
Makochekanwa, A. (2007). `An Empirical Investigation of
Capital Flight from Zimbabwe', University of Pretoria, Working Paper:
2007-11, July 2007
MacLeod, D. (2002). `Capital Flight', The Library of Economics
and Liberty.
Mikkelsen, J. (1991). `An econometric investigation of
capital flight', Applied Economics, 23: 73-85
Morgan Guaranty Trust Company (1986). `LDC Capital Flight',
World Financial Markets, 2: 13-16.
Naylor, R. T. (1987). `Hot Money and the Politics of Debt',
New York, Simon & Schuster.
Ndiaye, A. S. (2004). `La Fuite des Capitaux du
Sénégal : Ampleur et Déterminants.' (Master),
Université de Cheik Anta Diop de Dakar.
Ndiaye, A.S., (2011). `Impact de la fuite des capitaux sur
l'investissement domestique en Zone Franc'. Papier présenté au
Colloque International `Chocs dans les Pays en Développement' , Paris,
30 Juin et 1 Juillet 2011.
Ndiaye, A.S., (2012). `Une croissance économique forte
et durable est-elle possible dans un contexte de fuite massive des
capitaux en zone franc? ' Papier présenté à la
Conférence Economique Africaine 2012 sur `Promouvoir le
développement inclusif et durable en Afrique dans une
période d'incertitude pour l'économie mondiale' Kigali,
Rwanda, 30 octobre -2 novembre 2012.
Ndikumana, Leonce and James K. Boyce (1998). `Congo's Odious
Debt: External Borrowing and Capital Flight in Zaire', Development and Change
29(2): 195-217.
Ndikumana, L. and J.K. Boyce (2010). `Measurement of capital
flight: methodology and results for sub-Saharan African countries', African
Development Review22 (4): 471-81.
Ndikumana, L., Boyce, J. K. (2011). `Capital Flight from
Sub-Saharan Africa: Linkages with External Borrowing and Policy Options',
International Review of Applied Economics 25(2): 149-170.
Ndikumana, L., Boyce, J. K. (2013), `La dette odieuse de
l'Afrique : comment l'endettement et la fuite des capitaux ont saigné un
continent.' Editions Amalion.
Nelson. C.R. et C.L. Plosser (1982). `Trends and random walks
in macroeconomic time series: Some evidence and implications', Journal of
Monetary Economics 10. 139-162.
Nyoni, T. (2000). `Capital Flight from Tanzania', in I.
Ajayi and M. S. Khan (Eds), External Debt and Capital Flight in
Sub-Saharan Africa, Washington, DC: The IMF Institute, 265-99.
Ouattara, B., (2004). `The impact of project aid and programme
aid on domestic savings: A case study of Côte d'Ivoire, paper for the
conference «Growth, poverty reduction and human development in Africa',
Centre for the Study of African Economies, April.
Pastor, M. (1990). `Capital flight from Latin America', World
Development, 18 (1): 1-18.
Pesaran, M.H., Shin, Y., Smith, R.J.(2001). `Bounds testing
approaches to the analysis of level relationships', Journal of Applied
Econometrics 16, 289-326.
Phillips, P.C.B., Perron, P.,(1988). `Testing for a unit root
in time series regression', Biometrica 75, 335-446.
Ricardo, David (1951-1973), `The Works and Correspondence of
David Ricardo.' Edited by Piero Sraffa and M. Dobbs. Vols. I-XI. Cambridge:
Cambridge University Press
Touna Mama(1996), `Crise économique et politique de
déréglementation au Cameroun', Paris, l'Harmattan.
Programme des Nations Unies pour le Développement
(1994). `Rapport sur ??le Développement Humain', New York: Oxford
University Press
Roy, A. C. (1994). `Les fuites de capitaux: Analyse
théorique et empirique portant sur l'Argentine, le Brésil le
Mexique, et le Vénézuéla.' (Master),
Université de Montréal.
Walter, I. (1987). `The Mechanisms of Capital Flight',
in Lessard, D. R. And Williamson, J. (Eds) Capital Flight and Third World
Debt, Washington DC: Institute for International Economics, pp. 103-128
ANNEXES
ANNEXE 1 : Evolution des
différentes variables :
   
 

ANNEXES 2.1 : Dates importantes ayant marqué
l'évolution de l'endettement du Cameroun :
|
1951
|
Premier emprunt officiel du Cameroun enregistré dans le
système de gestion de la Caisse Autonome d'Amortissement(CAA). Il a
été contracté auprès de la Caisse Centrale de
Coopération Economique (CCCE) devenue aujourd'hui Agence
Française de Développement(AFD) consacré au projet de
construction de la centrale électrique d'Edéa.
|
|
1960
|
Quatre prêts sont en vigueur et engagés
auprès de l'AFD pour le développement
énergétique.
|
|
1970
|
18 prêts d'un montant de 20 milliards de FCFA sont
contractés auprès des bailleurs de fonds bilatéraux (la
France, l'Allemagne) et des bailleurs de fonds multilatéraux.
|
|
1986-1987
|
Premier recours aux institutions de Brettons Wood et
négociation d'un programme d'ajustement structurel (PAS) avec le FMI.
L'encours de la dette publique du Cameroun est estimé à
1 027 milliards de FCFA et représente 23,3% du PIB. Il est
composé de 881 milliards de FCFA de dette extérieure
correspondant à 20,9% du PIB.
|
|
1989
|
Premier passage du Cameroun devant les créanciers
membres du club de Paris le 24 mai 1989, (date butoir : 31 décembre
1988). L'encours de la dette publique dépasse 1500 milliards de FCFA,
dont plus de 1100 milliards de dette extérieure soit respectivement
à 37,5% et 34,4% du PIB.
|
|
1993
|
Le Cameroun est éligible au guichet concessionnel des
emprunts du groupe de la Banque Mondiale (IDA 2ème
guichet).
|
|
1994
|
Dévaluation du FCFA
Troisième passage du Cameroun devant les
créanciers membres du club de Paris. La dette publique s'établit
pour l'exercice 1994-1995 (Juillet 1994-Juin 1995) à 5 763
milliards de FCA, dont 4 343 milliards de FCFA de dette
extérieure, représentant respectivement 129% du PIB et 97% du
PIB.
|
|
1996
|
Quatrième passage du Cameroun devant les
créanciers membres du club de Paris. Traitements aux termes de Naples.
Le stock de la dette publique du Cameroun est de 5 711 milliards de FCFA,
soit 117% du PIB, dont plus de 1255 milliards de FCFA de dette
intérieure.
|
|
1997
|
Le Cameroun entame le premier programme triennal de
réformes structurelles appuyé par les ressources du FASR, le CAS
et les (PAS).
Cinquième passage au club de Paris. Le stock de la
dette publique est estimé à 5 833 milliards de FCFA, soit
109,5% du PIB, dont 4 441 milliards de FCFA de dette extérieure
représentant 83,4% du PIB.
|
|
2000
|
Atteinte du Point de décision de l'initiative PPTE.
Le ratio VA/Exportations de biens et services s'établit
à 205,1% après les allègements traditionnels,
comparés à un seuil fixé par les IBW à 150%.
L'encours de la dette publique dépasse 6 000 milliards de FCFA,
dont 4 934 milliards de FCFA de dette extérieure ; soit
respectivement 88,1% et 72,2% du PIB. La VA de la dette extérieure
représente plus de 222% des recettes d'exportations et 467% des recettes
budgétaires internes.
|
|
2006
|
Point d'achèvement de l'initiative PPTE en avril
2006.
Le Cameroun a bénéficié d'une annulation
de sa dette de plus de 2500 milliards de FCFA. L'encours de sa dette publique
au 31 décembre 2006 s'élève à 1 969 milliards
de FCFA dont 1 082 milliards de FCFA de dette extérieure. La dette
publique représente environ 21% du PIB et 108,8% des recettes publiques
internes en 2006
|
|
2008
|
Le stock de la dette publique s'établit à
1 374 milliards de FCFA, soit 12,9 % du PIB et 64,9% des recettes
budgétaires hors dons.
|
Source : CAA (2015).
Tableau 2.1 : Service de la dette
extérieure du Cameroun
|
Années
|
service de la dette extérieure (En milliards de FCFA)
|
Service de la dette ext. / Recettes Budgétaires
(En pourcentage)
|
|
1981/82
|
45,714
|
11,71
|
|
1982/83
|
31,559
|
4,7
|
|
1983/84
|
48,858
|
6,14
|
|
1984/85
|
61,515
|
7,62
|
|
1985/86
|
78,058
|
8,9
|
|
1986/87
|
80,789
|
11,2
|
|
1987/88
|
71,326
|
11,91
|
|
1988/89
|
74,926
|
13,31
|
|
1989/90
|
48,946
|
10,24
|
|
1990/91
|
65,309
|
12,9
|
|
1991/92
|
57,267
|
11,41
|
|
1992/93
|
66,208
|
14,77
|
|
1993/94
|
154,379
|
40,08
|
|
1994/95
|
153,747
|
28,65
|
|
1995/96
|
255,439
|
38,93
|
|
1996/97
|
253,080
|
32,98
|
|
1997/98
|
373,879
|
44,11
|
|
1998/99
|
254,084
|
27,8
|
|
1999/00
|
245,058
|
23,7
|
|
2000/01
|
203,620
|
15,44
|
|
2001/02
|
167,7
|
13
|
|
2002/03
|
74,9
|
11
|
|
2003/04
|
164,0
|
11,48
|
|
2004/05
|
136,8
|
10
|
|
2005/06
|
161,7
|
11,32
|
|
2006/07
|
136,0
|
3,04
|
|
2007/08
|
100,6
|
5,1
|
|
2008/09
|
112,3
|
5,07
|
|
2009/10
|
96,7
|
5,01
|
Source : Dette publique et
à garantie publique du Cameroun : Portefeuille au 31
décembre 2012 et viabilité à l'horizon 2032 (CAA, 2013)
|
Année
|
Fuite des capitaux en valeur du Cameroun (Million, Constant
2010$)
|
Taux de croissance du PIB
|
Dette extérieure/PIB
|
Service de la dette ext. / Recettes d'exportations
|
Fuite des capitaux/Dette extérieure (En pourcentage)
|
|
1970
|
-21,5
|
3,09
|
0,12579285
|
|
-15
|
|
1971
|
-78,3
|
3,48
|
0,14595243
|
|
-43
|
|
1972
|
-369,1
|
2,67
|
0,15483684
|
|
-167
|
|
1973
|
-731,1
|
5,36
|
0,15118884
|
|
-275
|
|
1974
|
-3,8
|
10,73
|
0,14346109
|
|
-1
|
|
1975
|
201,8
|
11,25
|
0,16035117
|
|
46
|
|
1976
|
-227,8
|
-5,5
|
0,19857065
|
|
-37
|
|
1977
|
1359,7
|
13,74
|
0,33059093
|
6,91378247
|
122
|
|
1978
|
1093,3
|
22
|
0,34674298
|
9,55977241
|
71
|
|
1979
|
1399
|
6,04
|
0,37374775
|
10,3547118
|
64
|
|
1980
|
508,3
|
-1,97
|
0,38167758
|
13,3344436
|
20
|
|
1981
|
755,6
|
17,08
|
0,34654807
|
16,5898599
|
29
|
|
1982
|
971,8
|
7,52
|
0,38276295
|
21,5091517
|
35
|
|
1983
|
1007
|
6,87
|
0,39225797
|
19,0423518
|
35
|
|
1984
|
2253,9
|
7,47
|
0,37118195
|
20,4102068
|
78
|
|
1985
|
1901
|
8,06
|
0,38799795
|
30,225347
|
60
|
|
1986
|
3047,8
|
6,77
|
0,38952646
|
26,1148606
|
74
|
|
1987
|
1963
|
-2,15
|
0,37297435
|
30,7820863
|
43
|
|
1988
|
105
|
-7,82
|
0,38527211
|
29,1029211
|
2
|
|
1989
|
1601,9
|
-1,82
|
0,48155867
|
17,2861405
|
30
|
|
1990
|
1166,6
|
-6,11
|
0,5884826
|
20,5242981
|
18
|
|
1991
|
-295,2
|
-3,81
|
0,54449698
|
17,6499141
|
-4
|
|
1992
|
143
|
-3,1
|
0,65974583
|
16,5118005
|
2
|
|
1993
|
-281,8
|
-3,2
|
0,56719816
|
24,5657267
|
-4
|
|
1994
|
3350,1
|
-2,5
|
1,00887531
|
21,3007882
|
36
|
|
1995
|
2585,7
|
3,3
|
1,25870065
|
21,0066375
|
24
|
|
1996
|
147,6
|
5
|
1,14209757
|
20,0852831
|
1
|
|
1997
|
-916,8
|
5,1
|
1,08949684
|
20,2707135
|
-9
|
|
1998
|
932,6
|
5,04
|
1,17427979
|
21,1367482
|
8
|
|
1999
|
-1082,5
|
4,39
|
1,02659938
|
24,7902944
|
-10
|
|
2000
|
-26,3
|
4,2
|
1,13716539
|
20,7750538
|
0
|
|
2001
|
6088,6
|
4,51
|
1,01164533
|
11,937159
|
62
|
|
2002
|
-762,3
|
4,01
|
0,94557855
|
11,5600217
|
-7
|
|
2003
|
-216,5
|
4,03
|
0,83749559
|
13,4895386
|
-2
|
|
2004
|
-1488,4
|
3,7
|
0,68814786
|
15,5173603
|
-14
|
|
2005
|
-2619,6
|
2,3
|
0,46420021
|
19,2788345
|
-34
|
|
2006
|
-938,6
|
3,22
|
0,19041605
|
10,1074343
|
-27
|
|
2007
|
-668,8
|
3,38
|
0,15103651
|
7,73156709
|
-22
|
|
2008
|
-660
|
2,56
|
0,12117618
|
6,09201506
|
-23
|
|
2009
|
-458,1
|
1,98
|
0,13848057
|
7,20992982
|
-14
|
|
2010
|
-729,8
|
2,93
|
0,13519705
|
3,46288051
|
-23
|
Tableau 2.2 : Fuite des capitaux et Taux
de croissance du PIB au Cameroun (1970-2010)
Source : Ndikumana et Boyce
(2012) et WDI(2012)
Tableau : Mesurer la fuite des
capitaux : (exemple : l'Angola en 2008)
Nouveaux emprunts : variation de l'encours de la dette
extérieure, Millions corrigée des
changements dans le stock de la dette USD imputables à
l'annulation de la dette et aux effets du taux de
change sur la valeur de cette dette en dollars. 3 655
(Source : Banque mondiale, Global Development Finance)
Plus + Investissements directs étrangers
en valeur nette (Source : Banque mondiale, Indicateurs de
développement dans le monde) 1679
Moins -
Déficit du compte des opérations courantes
(un chiffre négatif indique un excédent)
-6408 (Source : FMI, Balance of Payments Statistics)
Moins -Variations des réserves et
éléments connexes (un chiffre positif
indique une augmentation des réserves) 5610 (Source : FMI,
Balance of Payments Statistics) Egal =
Mesure résiduelle de la fuite des capitaux
6132 (Sous total avant correction) Plus
+ Correction pour fausse facturation des exportations 537
(un chiffre positif indique une sous-facturation)
(Source : FMI, Direction of Trade Statistics) Plus
+ Correction pour fausse facturations des importations
172 (un chiffre positif indique une sur-facturation
nette ;
un chiffre négatif indique une sous-facturation
nette Contrebande) (Source : FMI,
Direction of Trade Statistics) Plus
Correction pour envois de fonds non-enregistrés56(*) 804 Egal
= Fuite des capitaux d'Angola en 2008 7645
Source : Ndikumana et Boyce(2013)
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT
I
DEDICACE
II
REMERCIEMENTS
III
SOMMAIRE
IV
LISTE DES ILLUSTRATIONS ET GRAPHIQUES
VI
RESUME
VII
ABSTRACT
VIII
INTRODUCTION GENERALE
1
1. CONTEXTE DE L'ÉTUDE
3
2. PROBLÉMATIQUE
6
3. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE
7
4. HYPOTHÈSES DE L'ÉTUDE
7
5. INTÉRÊT DE
L'ÉTUDE
8
6. BREF APERÇU
MÉTHODOLOGIQUE
8
7. ORGANISATION DU TRAVAIL
9
PREMIERE PARTIE :
REVUE DE LA LITTERATURE ET EVOLUTION GLOBALE DE LA
DETTE EXTERIEURE ET DE LA FUITE DES CAPITAUX AU CAMEROUN
10
INTRODUCTION A LA PREMIERE PARTIE
11
CHAPITRE 1 :
REVUE DE LA LITTERATURE SUR LA RELATION ENTRE LA
DETTE EXTERIEURE ET LA FUITE DES CAPITAUX
12
1. DETTE EXTERIEURE ET FUITE DES
CAPITAUX : REVUE DE LA LITTERATURE THEORIQUE
13
1.1. LIENS DIRECTS ENTRE LA DETTE EXTERIEURE
ET LA FUITE DES CAPITAUX
15
1.1.1. Fuite des capitaux induite par la
dette extérieure
15
1.1.2. Fuite des capitaux alimentée
par la dette extérieure
16
1.1.3. Emprunt étranger induit par la
fuite des capitaux
17
1.1.4. Emprunt étranger
alimenté par la fuite des capitaux
17
1.2. LIENS INDIRECTS ENTRE LA DETTE
EXTÉRIEURE ET LA FUITE DES CAPITAUX
18
2. REVUE DE LA LITTÉRATURE EMPIRIQUE
SUR LA RELATION ENTRE LA DETTE EXTÉRIEURE ET LA FUITE DES CAPITAUX
19
2.1. RÉSULTATS OBTENUS SUR DES PAYS
PRIS INDIVIDUELLEMENT
19
2.2. RÉSULTATS DE QUELQUES
ÉTUDES PORTANT SUR PLUSIEURS PAYS
21
CONCLUSION DU CHAPITRE
22
CHAPITRE 2 :
EVOLUTION GLOBALE DE LA DETTE EXTERIEURE ET DE LA
FUITE DES CAPITAUX AU CAMEROUN
24
1. EVOLUTION GLOBALE DE LA DETTE EXTERIEURE
AU CAMEROUN
25
1.1 EVOLUTION DU STOCK DE LA DETTE
EXTÉRIEURE DU CAMEROUN :
25
1.2 EVOLUTION DU SERVICE DE LA DETTE
EXTÉRIEURE :
28
1.3 EVOLUTION DES RATIOS D'ENDETTEMENT
29
1.3.2. Ratio service de la dette
extérieure/Recettes budgétaires
30
2. LA FUITE DES CAPITAUX AU CAMEROUN :
ANALYSE EN VALEUR ET EN POURCENTAGE DE LA DETTE EXTERIEURE
31
2.1. LA FUITE DES CAPITAUX AU
CAMEROUN : ANALYSE EN VALEUR
32
2.2. EVOLUTION DE LA FUITE DES CAPITAUX EN
POURCENTAGE DE LA DETTE EXTÉRIEURE
34
2.3. LES MESURES DE LUTTE CONTRE LA FUITE
DES CAPITAUX
34
2.3.1. Sur le plan national
35
2.3.2. Sur le plan international
35
CONCLUSION DU CHAPITRE
39
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
40
DEUXIEME PARTIE :
DETTE EXTERIEURE ET FUITE DES CAPITAUX AU
CAMEROUN : ANALYSE EMPIRIQUE
41
INTRODUCTION DE LA DEUXIEME PARTIE
42
CHAPITRE 3 : APPROCHE METHODOLOGIQUE
43
1. SPÉCIFICATION DU
MODÈLE :
44
1.1. PRÉSENTATION DE LA FORME
FONCTIONNELLE DU MODÈLE :
44
1.1.1. Le modèle théorique
44
1.1.2. Le modèle empirique
45
1.2. SOURCE DES DONNÉES, EXPLICATION
DES VARIABLES ET JUSTIFICATION DES DIFFÉRENTS SIGNES ATTENDUS
45
1.2.1. Source des données
46
1.2.2. Explication des variables du
modèle et signes attendus des coefficients des variables :
46
2. PROCÉDURE D'ESTIMATION DU
MODÈLE :
52
2.1. LES TESTS DE RACINE UNITAIRE
52
2.1.1. Le test de Dickey-Fuller
Augmenté (ADF)
53
2.1.2. Le test de Phillips-Perron
53
2.2. PRÉSENTATION DE LA
MÉTHODE ÉCONOMÉTRIQUE
54
2.2.1. Justification de la méthode
économétrique
54
2.2.2. Le modèle Autorégressif
à Décalage Temporel de Pesaran et al. (2001)
54
CONCLUSION DU CHAPITRE
57
CHAPITRE 4 : RESULTATS ET RECOMMANDATIONS
58
1. PRÉSENTATION DES
RÉSULTATS
59
1.1. ETUDE DE LA STATIONNARITÉ
59
1.2 LE TEST DE COINTÉGRATION
60
PRÉSENTATION DES ÉLASTICITÉS
DE COURT TERME ET DE LONG TERME
61
2. INTERPRETATIONS DES RESULTATS ET
RECOMMANDATIONS DE POLITIQUES ECONOMIQUES
66
2.1. INTERPRÉTATIONS DES
RÉSULTATS
66
2.2. RECOMMANDATIONS DE POLITIQUES
ÉCONOMIQUES
68
CONCLUSION DU CHAPITRE
69
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE
70
CONCLUSION GENERALE
71
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
74
ANNEXES
80
TABLE DES MATIERES
86
* 1Fond Monétaire
International
* 2Plan mis en oeuvre par le
Secrétaire d'Etat d'administration Bush en 1989, suite à
l'échec des plans antérieurs parmi lesquels le plan Baker
(Secrétaire au Trésor Américain). Ce plan a
été utilisé par les pays d'Amérique Latine pour
échanger des réformes libérales contre des
réaménagements de leur dette.
* 3 Source : note de
conjoncture de la dette publique du Cameroun, Numéro 14 - mars 2015,
CAA
* 4Crise financière qui
débuta aux USA en 2007 et se propagea au reste du monde. Elle a
été causée par l'éclatement de la bulle
spéculative immobilière.
* 5Espagne, Italie, Irlande,
Grèce, Portugal, Belgique
* 6Allemagne, Luxembourg,
Pays-Bas
* 7Organisation non
gouvernementale située à Washington qui oeuvre à la
promotion des politiques, des mesures de protection et des ententes nationales
et multilatérales visant à freiner les mouvements
transfrontaliers de capitaux illicites : corruption, contrebande, crime
organisé et évasion fiscale.
* 8 « twins
problems ».
* 9Banque Américaine
issue de la fusion, réalisée en 1959, de la Guaranty Trust
Company of New York et de la banque J. P. Morgan and Co. Incorporated.
* 10 Banque Africaine de
Développement.
* 11 Global Financial
Integrity.
* 12 Cette méthode est
une solution aux limites du test de cointégration multi-variée de
Johannsen qui nécessite à priori que les séries soient du
même ordre d'intégration.
* 13 Cité par Yapo
(2002)
* 14 Cette
conjecture a
été énoncée en premier lieu par
David Ricardo,
économiste
classique du
XIXe siècle,
puis reprise par
Robert Barro en 1974.
Selon cette conjecture, il y aurait, sous certaines conditions,
équivalence entre l'augmentation de la
dette publique
aujourd'hui et l'augmentation des
impôts requise
demain pour le remboursement de cette dette et le paiement des
intérêts. Si les
agents
économiques se comportent de manière rationnelle, une
politique de
relance (distributions de revenus financées par la
dette publique) ne
les poussera pas à consommer, mais plutôt à
épargner, en prévision de hausses d'impôts futures.
* 15 Il revient à
Laffer (1979) le mérite d'avoir tenté de théoriser ce
qu'il nommait « l'allergie fiscale ». Il soutient que
lorsque les
prélèvements
obligatoires sont déjà élevés, une augmentation
de l'impôt conduirait alors à une baisse des recettes de
l'État, parce que les
agents
économiques surtaxés seraient incités à moins
travailler.
* 16 Cette expression
utilisée dans la littérature sur la fuite des capitaux
suggère que la dette extérieure entraine la fuite des capitaux et
inversement (Boyce, 1992).
* 17 Il s'agit de places
organisées par certains Etats ou certains territoires qui
réservent des règles spécifiques semblables à
celles des paradis fiscaux aux seules opérations internationales n'ayant
aucun lien avec une activité économique au sein de leur
territoire. Dans ces centres, la fiscalité est très faible, voire
nulle, les formalités sont réduites au minimum et la
confidentialité ou la discrétion des opérations sont
assurées. Ces règles très souples permettent de
réaliser des opérations financières légitimes mais
ces opérations peuvent également servir à des fins de
blanchiment d'argent ou de fraude fiscale.
* 18 Ce cas constitue
essentiellement le sujet du livre de Ndikumana et Boyce publié en 2013
aux Editions Amalion, La dette odieuse de l'AFRIQUE. Comment l'endettement
et la fuite des capitaux ont saigné un continent
* 19 Banque Mondiale
(1992) : Rapport sur ??le Développement dans le monde 1992 à
New York, Oxford University Press.
* 20 Programme des Nations
Unies pour le Développement (1994): Rapport sur ??le
Développement Humain de New York: Oxford University Press
* 21 Action d'introduire en
fraude des marchandises dans un pays.
* 22 Burundi, RCA,
Côte d'Ivoire Guinée équatoriale, Ethiopie, Ghana,
Guinée, Guinée Bissau, Kenya, Liberia, Madagascar, Mali,
Mauritanie, Mozambique, Niger, Rwanda, Sao Tome et Principe, Sierra Leone,
Somalie, Soudan, Tanzanie, Ouganda, Zaïre, Zambie.
* 23 Angola, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, RCA, Congo-Brazzaville, the République du Congo,
Côte d'Ivoire, Ethiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Madagascar, Malawi,
Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Somalie,
Soudan, Tanzanie, Uganda, and Zambie.
* 24 Indonésie,
Malaisie, Philippines, Thaïlande.
* 25 Ces résultats sont
contenus dans leur livre : La dette odieuse de l'Afrique, comment
l'endettement et la fuite des capitaux ont saigné un continent
* 26 Le premier emprunt
officiel du Cameroun enregistré dans le système de gestion de la
Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) date de 1951, il a été
contracté auprès de la Caisse Centrale de Coopération
Economique(CCCE) devenue aujourd'hui Agence Française de
Développement(AFD) et consacré au projet de construction de la
centrale hydroélectrique d'Edéa. Le deuxième a lieu en
1960 avec quatre prêts en vigueur et contractés auprès de
l'AFD destinés au développement énergétique. Enfin,
en 1970, 18 prêts contractés pour un montant total de 20 milliards
de FCFA auprès des bailleurs de fonds bilatéraux (France,
Allemagne) et des bailleurs de fonds multilatéraux (CAA, 2015).
* 27 Le budget du Cameroun
est passé de 310 milliards de FCFA en 1981/82 à 620 milliards de
FCFA en 1984/85. En 1986/87, année de retournement à la baisse de
l'activité économique, il était de 800 milliards de FCFA.
(TOUNA MAMA, 1996)
* 28L'Afrique Sub-Saharienne
et l'Amérique Latine ont enregistré la dégradation la
dégradation la plus forte des termes de l'échange au cours des
années 80, soit respectivement une baisse de 15 à 13% par rapport
aux années 70, du pouvoir d'achat des exportations, traduit en
capacité d'acquérir des articles d'importation (CNUCED :
`'Rapport sur le Commerce et le Développement'', 1992).
* 29 La
dépréciation d'environ 40% du dollar US par rapport au FCFA,
monnaie dans laquelle sont libellés les prix des principaux produits
d'exportation du pays, a conduit à une baisse des recettes de ceux-ci.
Les recettes des produits d'exportations sont ainsi passées de 238,4
milliards de FCFA en 1985/86 à 147,1 milliards de FCFA en 1987/88 (Touna
Mama, 1996).
* 30 Pour l'exercice
1991/92, les charges totales dues par le Cameroun au titre du service de la
dette extérieure s'élèvent à 525 milliards de FCFA
- dont 300 milliards d'arriérés - soit un peu moins que le budget
arrêté au titre de l'exercice 1993/94. (Banque Afrique
N013629 du 28 janvier 1992).
* 31 Période de crise
au Cameroun marquée par des taux de croissance négatifs
(Annexes : tableau 2.2).
* 32 Engagement :
correspond à la signature du contrat de prêt. Les engagements
correspondent à la dette souscrite mais pas encore forcément
mobilisée. Source : Glossaire des termes usuels de la dette,
CAA-Yaoundé 1998.
* 33Club de Paris :
« Cénacle » de créanciers publics, au sein
duquel se négocient les réaménagements de dettes.
* 34Club de Londres :
« Cénacle » de créanciers privés,
généralement les banques commerciales au sein duquel se
négocient les réaménagements de dettes.
* 35 Pays Pauvres Très
Endettés
* 36 Annexes : Tableau
2.2.
* 37 Source : CAA,
Août 2015.
* 38 Source : CAA,
Août 2015.
* 39 Glossaire Des Termes
Usuels De La Dette Publique, CAA, Yaoundé, 1998.
* 40 Date de début de
la crise au Cameroun
* 41 Outre
l'allégement de sa dette extérieure, le pays a obtenu
auprès du FMI une Facilité pour la Croissance et la
Réduction de la Pauvreté d'un montant de 144 millions de dollars,
destinés au financement de son programme économique et financier
pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003. Les
grandes lignes de ce programme sont retracées dans la lettre d'intention
du 6 décembre 2000, où le gouvernement s'engage désormais
dans des réformes dites de 2ème
génération qui met l'accent sur la réduction de la
pauvreté et la bonne gouvernance (CAA, 2015).
* 42 Ce ratio exprime le
poids de l'endettement d'un pays sur son économie. (Glossaire Des Termes
Usuels De La Dette Publique, CAA - Yaoundé 1998)
* 43 Annexes : Tableau
2.2.
* 44 Annexes : Tableau
2.1
* 45 Annexes : Tableau
2.2
* 46 L'IPPTE est un
programme mis en place par le FMI et la Banque Mondiale dont l'objectif
à terme est de permettre la réduction de la dette des pays
considérés comme pauvres et très endettés. Le
principe de l`IPPTE est de réallouer les fonds initialement
prévus pour le remboursement de la dette au financement des
projets de développement.
* 47 Annexes : Tableau
2.2
* 48 Autoregressive-Distributed
Lag
* 49
ZF : Zone Franc, Boyce et Ndikumana observe que la
différence entre les montants d'exportations et d'importations
reportés au niveau des balance des paiements, s'observent plus dans les
économies Subsaharienne. Ils ont considéré le cas des pays
de la Zone franc, c'est-à-dire les pays qui utilisent le Franc CFA comme
monnaie.
* 50 Autoregressive-Distributed
Lag
* 51 Afin de déterminer
l'élasticité de la variation de la fuite des capitaux
consécutive à un accroissement de la dette extérieure,
nous procédons ainsi : 54 = (0,563/1,04)*100 (Tableau 4.2)
* 52 Comme
précédemment, 19 = (0,165/0,855)*100 (Tableau 4.3)
* 53 Banque Africaine de
développement.
* 54 Global Financial
Integrity.
* 55 Par exemple, le FMI
(2011) note qu'entre janvier 2010 et avril 2011, les autorités du pays
ont contracté 30 accords d'emprunts (6 % du PIB de 2010), dont au moins
15 étaient à des conditions non concessionnelles avec un
élément dons de 21,3 %. Par ailleurs, la part de nouveaux
décaissements non concessionnels dans les décaissements totaux
devrait passer de 20 % en 2011 à 60 % en 2014 et à 80 % en
2031.
* 56 Les auteurs estiment
les envois de fonds non-enregistrés en comparant les estimations du FIDA
des entrées de fonds émanant des pays industrialisés au
total des entrées provenant de l'ensemble des pays qui sont
comptabilisés dans la BdP officielle. En effet, le FIDA(2007) en
s'appuyant sur des données d'enquête, propose de nouvelles mesures
des entrées de fonds provenant des travailleurs émigrés.
Il ressort que l'ampleur réelle des envois de fonds vers l'Afrique est
largement sous-estimée dans la BdP. Par exemple au Nigéria, les
entrées de fonds en provenance de pays industrialisés ont
totalisé 5,4 milliards de dollars en 2006, mais que seulement 3,3
milliards de dollars ont été comptabilisés officiellement.
De même en Angola, la BdP ne fait apparaitre aucun envoi de fonds pour
2008, alors que, d'après le FIDA, il y a eu 969 milliards de dollars de
flux entrants. Les estimations de la Banque Mondiale (2006) montrent que ces
envois de fonds non-enregistrés dans les pays africains
représentent plus de la moitié du total des transferts, largement
supérieurs aux flux d'aide et d'IDE.
| 


