|
REPUBLIQUE
FRANÇAISE REPUBLIQUE DU
CAMEROUN
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE PAIX - TRAVAIL -
PATRIE
--------------------------
-------------------------
![]()
![]()
MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES - STAGE DE MAI À
AOÛT 2008
Master en Informatique Approfondie Option Conception et
Management des Systèmes d'Informations
Conception et réalisation d'une application de
Webmapping d'Analyse Territoriale sur des SIG et Bases de Données Open
Source : Cas du territoire Camerounais
TCHIOFFO KODJO
Sous la direction de BATCHAKUI Barnabé
Enseignant chercheur à l'Ecole Nationale
Supérieure Polytechnique
Dédicaces
A ma feue grand-mère, NKOPIPIE Régine
A mes parents, KODJO et NKAMATCHA Jeanne d'Arc
A mon grand frère, NGUEUKAM KODJO
A mon cousin, NKOPIPIE Mathurin.
A mes frères et soeurs à Douala et
Yaoundé.
A ma grande soeur DAJOUM Mireille
Remerciements
C A tous les membres du jury pour leur disponibilité.
C A M WANTOU SIANTOU Lucien, Président Fondateur du
Complexe Universitaire Siantou, je vous exprime ma gratitude.
C A Docteur KANGUELIEU TCHOUAKE Mesmin, Directeur des
études, vos encouragements et votre bénédiction m'a permis
de toujours avancer.
C A M TAPIGUE Delphin, Chef du département
Informatique, votre disponibilité et votre confiance à mon
égard me ragaillardissent toujours.
C A mon encadreur académique Ingénieur Chercheur
BATCHAKUI Barnabé, enseignant au Département Informatique de
l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé et au
Complexe Universitaire Siantou, je tiens à lui rendre un hommage tout
particulier.
C A mon encadreur professionnel M TONGO Landry, Chef service
Informatique au Service National de la Cartographie et consultant à
CGICOM, votre sacrifice et votre rigueur sont les fondements de ce travail.
C A tous les enseignants pour leur soutien indéfectible
notamment Docteur NDJEYA Sélestin, M SOH Zéphyrin, Docteur
NDOUNDAM René, M SOH Mathurin, M MBATCHOU Guy, Mme ATATA.
La réalisation de ce travail n'aurait sans doute pas
été possible sans le soutien dont j'ai
bénéficié tout au long de mon séjour à la
société CGICOM Yaoundé.
C Mes remerciements vont ainsi tout droit à Monsieur
FOMEKONG Josué, Directeur Général de CGICOM.
C Mes remerciements vont également à Monsieur
PELIGUILE ONDAFE MOLENG pour son assistance capitale.
C A tout le personnel de la Direction des Etudes et
Développement et de la Direction des Opérations, trouvez ici le
résultat du parfait climat de collaboration que vous avez entretenu. Il
s'agit de DEMANOU Alain, FOTSING Michel, FOUEJIO David.
C Toute ma reconnaissance à tous mes amis KENMOUE
WOUABE Ronald, TCHOULA Alain, TCHAMBA Michaëlle pour tous les
encouragements qu'ils n'ont jamais cessés de manifester à mon
endroit.
C Je remercie fortement tous mes camarades de la promotion
2007-2008.
C Enfin je remercie toute ma famille étendue.
Summary
«For a modern country, the geographical information is a
central element for the national infrastructure, to the same level that
transportation and communication systems. It is nowadays an increasingly
important element in economic growth term.» (COSIG report, center of
geographical data coordination to the Canadian Federal Council , April
2001)
To facilitate its manipulation, panoply of solutions has been
proposed by the development of a technology called geomatic. With the advent of
the Internet, Webmapping, or distribution of maps by web sites, is in full
expansion due to the development of Open Source solutions.
This report presents the result of works led on the idea and
the implementation of a Webmapping application of territorial analysis on Open
Source GIS. Around Mapserver, the work has undertaken in two phases. The first
phase has consisted in understand the functioning of GIS and to conceive an
architecture for the web application. The second phase has ended to the
realization of the application in Open Source environments.
KEY WORDS
Webmapping, Open Source, GIS, Mapserver, web
Résumé
« Pour un pays moderne, l'information
géographique est un élément central de l'infrastructure
nationale, au même titre que les réseaux de transports et de
communication. Elle est de nos jours un élément de plus en plus
important en terme de croissance économique » (Rapport COSIG,
centre de coordination de données géographiques au Conseil
Fédéral Canadien, avril 2001).
Pour faciliter sa manipulation, un ensemble de solutions ont
été proposées par le développement d'une
technologie intégratrice appelée géomatique. Avec
l'avènement d'Internet, le Webmapping, ou diffusion de cartes via la
toile, est un domaine en pleine expansion grâce au développement
des solutions Open Source.
Ce mémoire présente le résultat des
travaux menés sur la conception et la mise en oeuvre d'une application
de Webmapping d'analyse territoriale sur des SIG Open Source. Autour de
l'incontournable Mapserver, le travail s'est effectué en deux phases. La
première phase a consisté à comprendre le fonctionnement
des SIG et à concevoir une architecture pour l'application web. La
seconde phase a aboutit à la réalisation de l'application dans
les environnements Open Source.
MOTS CLES
Webmapping, Open Source, SIG, Mapserver, web
SOMMAIRE
DÉDICACES
1
REMERCIEMENTS
3
SUMMARY
4
RÉSUMÉ
5
FIGURES
8
TABLEAUX
8
INTRODUCTION GENERALE
9
CONTEXTE DU STAGE
11
CHAPÎTRE I : ETAT DE L'ART
SIG
13
I.I GÉNÉRALITÉS SUR LA
CARTOGRAPHIE ET LES SIG
14
Préambule :
14
I.I.1 QU'EST CE QU'UN SIG ?
14
a. Définition
14
b. Historique
17
c. Questions auxquelles peuvent répondre les
SIG
18
d. Limites des SIG
18
I.I.2 ARCHITECTURE ET FONCTIONNEMENT D'UN SIG
20
a. Les composants d'un SIG
20
b. Objets géographiques et
Représentations
22
c. Mise en place d'un SIG
25
d. Fonctionnement d'un SIG
33
I.I.3 LES TECHNOLOGIES LIEES AUX SIG
34
a. CAO (Conception Assistée par
Ordinateur)
34
b. Traitement d'image et GPS
34
c. SGBD (Systèmes de Gestion de Bases de
Données)
35
d. Bilan
35
I.I.4 FONCTIONS DES SIG AU QUOTIDIEN
35
a. Les SIG, outils d'analyse performants
35
b. Les SIG, outils fédérateurs de
l'information
36
c. Les SIG, outils d'aide à la
décision
38
d. Les SIG, outils de simulation
39
I.II - LE WEBMAPPING
39
Préambule :
39
I.II.1 PRINCIPE GENERAL DE FONCTIONNEMENT DU
WEBMAPPING
40
I.II.2 SOLUTIONS CÔTÉ CLIENT
42
a. Quantum GIS 0.8.0 "TITAN"
43
b. UDIG (User Friendly Desktop Internet Gis)
44
c. THUBAN
44
d. OPENJUMP
45
I.II.3 SOLUTIONS CÔTÉ SERVEUR
46
a. MAPLAB
47
b. CHAMELEON
47
c. KA-MAPS
49
d. CARTOWEB 3
49
I.II.4 BILAN
50
CHAPÎTRE II : MODELISATION DE LA
SOLUTION
53
II.I MODÉLISATION UML ET ANALYSE
SPATIALE
54
Préambule :
54
II.I.1. L'APPROCHE UML POUR LA MISE EN oeUVRE DES
SYSTÈMES D'INFORMATION
54
II.I.2. APPLICATION DE L'APPROCHE UML AUX
SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
58
a. Acquisition des connaissances
60
b. Structuration de l'information
géographique
60
c. Spécification des fonctionnalités
de l'outil
61
d. Bilan
63
II.II MISE EN OEUVRE DES CONCEPTS
64
Préambule
64
II.II.1. EXPRESSION DES BESOINS
65
a. Besoin d'expérimentation
65
b. Besoins théoriques et didactiques
66
II.II.2. DIAGRAMMES DE MODÉLISATION
66
a. Diagramme des cas d'utilisations
66
b. Diagrammes de séquences
68
c. Diagramme des classes
73
d. Modèle physique des données
74
CHAPÎTRE III : MISE EN OEUVRE DE
LA SOLUTION
76
III.I ENVIRONNEMENT ET OUTILS DE
TRAVAIL
77
III.I.1. OUTILS UTILISÉS
77
a. Mapserver
77
b. PostgreSQL
79
c. Postgis
81
III.I.2. IMPLÉMENTATION
83
a. Langages utilisés
83
b. Données mise à disposition
83
c. Installation des logiciels
84
III.II. RÉSULTATS OBTENUS
84
a. Configuration de la base de données
84
b. Interfaces réalisées
86
c. Bilan
89
ARTICLES ET ANNEXES
93
BIBLIOGRAPHIE
97
GLOSSAIRE
99
FIGURES
Figure 1 - les composants d'un SIG
20
Figure 2 - Objets géographiques et
représentations
23
Figure 3 - Modèle raster et modèle
vecteur
25
Figure 4 -Analyse de proximité
32
Figure 5 - Analyse spatiale
32
Figure 6 - Les SIG, outils d'analyse performants
36
Figure 7 - les SIG, outils
fédérateurs de l'information
37
Figure 8 - les SIG, outils d'aide à la
décision
39
Figure 9 - principe général de
fonctionnement du webmapping
41
Figure 10 - Diagramme des cas d'utilisation
67
Figure 11 - Diagramme de séquence :
Visualiser une carte
69
Figure 12 - Diagramme de séquence :
Réaliser un zoom sur la carte
70
Figure 13 - Diagramme de séquence :
Réaliser un pan sur la carte
71
Figure 14 - Diagramme de séquence : Ajouter
une(des) couche(s) sur la carte
72
Figure 15 - Diagramme des classes de l'application
74
Figure 16 - Modèle physique de l'application
75
Figure 19 - création de la base de
données sous Postgresql
86
Figure 20 - Qgis, importation des données
86
Figure 21 - Zoom sur le village Bafang à
l'Ouest Cameroun
89
Figure 22 - Zoom sur le village Mbouda à
l'Ouest Cameroun
89
TABLEAUX
Tableau 1- Solutions SIG côté
serveur
52
Tableau 2 - Solutio ns SIG côté
client
52
Tableau 3 - Les diagrammes structurels d'UML
57
Tableau 4 - Les diagrammes comportementaux
d'UML
58
INTRODUCTION GENERALE
La valeur stratégique des informations relatives au
territoire (ou information géographique) est reconnue depuis très
longtemps. Mais la globalisation des phénomènes à prendre
en compte aujourd'hui la rend encore plus précieuse et indispensable. En
effet, les grands systèmes actuels (tels que l'environnement, les
villes, les transports...) appréhendent un grand nombre
d'éléments complexes, variés et interdépendants.
Le recours aux sciences de l'information géographique
permet de modéliser et d'analyser l'espace géographique à
l'aide de représentations numériques. La création de
cartes et l'analyse géographique à l'aide des SIG procurent une
plus grande vitesse et proposent des outils sans cesse innovant dans l'analyse,
la compréhension et la résolution des problèmes.
Des outils existent, mais en raison de leur coût et de notre situation de
pays en voie de développement, il est important pour nous
d'étudier la mise en place d'un tel système en utilisant des
produits libres qui existent.
Ce mémoire présente les travaux menés
dans le cadre de la « Conception et réalisation d'une
application de Webmapping d'analyse territoriale sur des outils
libres» dans la société CGICOM. Le mémoire
est divisé en trois chapitres. Le premier chapitre présente
l'état de l'art en matière de SIG avec les concepts moteurs, les
technologies et leur utilisation quotidienne. Le deuxième chapitre
traite de la modélisation de l'application avec le langage UML
appliqué aux SIG et la démarche à suivre. Le
troisième chapitre quant à lui développe la mise en oeuvre
de la solution.
CONTEXTE DU STAGE
Dans le cadre de notre formation de Master Professionnel I en
Informatique Approfondie, il est prévu la rédaction d'un
mémoire sur un thème attribué dans l'ordre de demande par
le responsable de la formation ou par l'entreprise. Il nous a été
attribué le thème Conception et réalisation d'une
application de Webmapping d'analyse territoriale sur des outils
libres.
Nos recherches ont été effectuées sous la
supervision et l'encadrement de M. BATCHAKUI Barnabé sur le plan
académique et M TONGO Landry sur le plan professionnel, qui, en plus de
leurs multiples engagements et tâches professionnelles, nous ont suivi de
bout en bout tout au long de la formation. Que Dieu vous bénisse.
Sur le plan de la rédaction proprement dite, nous avons
profité du fait que la formation en soi nécessite un ordinateur
connecté à Internet. Ainsi, tout au long de l'année
académique, nous avons fouillé, parcouru et exploité
plusieurs documents et sites web que nous avons mentionné en
bibliographie et webographie. Aux propriétaires de ces oeuvres, nous
tirons également notre révérence.
D'autres parts, il reste à noter les conditions
difficiles de suivie de la formation : Il n'est pas évident de
travailler en entreprise et de réserver 6h par jour pour lire les cours,
faire ses devoirs, discuter avec l'enseignant. Il faut un sacrifice
énorme.
Enfin, il faut noter le soutien de la composante
organisationnelle du Complexe Universitaire ESIG Siantou. Toujours attentifs
aux questions et remarques, répondant toujours au plus tôt, bref
de quoi les pays comme le notre (Cameroun) ont besoin pour lutter contre les
multiples lenteurs que l'on rencontre dans nos services.

CHAPÎTRE I : ETAT
DE L'ART SIG
Les SIG, outils de gestion, d'analyse et de
représentation cartographique de données 2D et 3D sont devenus
incontournables dans le contexte actuel. Ils permettent, entres autres, le
partage de l'information géographique, la coordination et la gestion de
situations suivant différents scénarii (simulations), la culture
de l'échange et la pratique de nouveaux usages auprès du grand
public. Après avoir défini le concept de SIG, nous
présenterons les concepts clés et les technologies SIG et nous
bouclerons avec l'utilisation de ces outils dans notre vie quotidienne.
CHAPITRE I
WEBMAPPING - ETAT DE L'ART SIG
I.I
Généralités sur la cartographie et les SIG
Préambule :
Les SIG, outils de gestion, d'analyse et de
représentation cartographique de données 2D et 3D sont devenus
incontournables dans le contexte actuel. Ils permettent, entres autres, le
partage de l'information géographique, la coordination et la gestion de
situations suivant différents scénarii (simulations), la culture
de l'échange et la pratique de nouveaux usages auprès du grand
public. Après avoir défini le concept de SIG, nous
présenterons les concepts clés et les technologies SIG et nous
bouclerons avec l'utilisation de ces outils dans notre vie quotidienne.
I.I.1 QU'EST CE QU'UN SIG ?
a. Définition
Un système d'information géographique (SIG) est
un outil informatique permettant d'organiser et présenter des
données
alphanumériques
spatialement référencées, ainsi que de produire des
plans et cartes
(Wikipédia).
Ses
usages couvrent les
activités
géomatiques de
traitement et diffusion de l'
information
géographique. La représentation est
généralement en deux dimensions, mais un rendu 3D ou une
animation présentant des variations temporelles sur un territoire sont
possibles.
Le rôle du
système
d'information est de proposer une représentation plus ou moins
réaliste de l'environnement spatial en se basant sur des
primitives
graphiques telles que des points, des
vecteurs (arcs), des
polygones ou des
maillages (raster).
À ces primitives sont associées des informations attributaires
telles que la nature (
route,
voie ferrée,
forêt, etc.) ou toute
autre information contextuelle (nombre d'habitants, type ou superficie d'une
commune par ex.).
L'information géographique peut être
définie comme l'ensemble de la description d'un objet et de sa position
géographique à la surface de la
Terre.
En
France, dans son acception
courante, le terme fait référence aux outils
logiciels. Cependant, le
concept englobe l'ensemble constitué par les
logiciels, les
données, le
matériel
et les savoir-faire liés à l'utilisation de ces derniers. On peut
aussi parler de
système
d'information à référence spatiale (SIRS) pour les
données et leur
structuration. L'acronyme SIT (système d'information sur le territoire)
est aussi utilisé dans quelques pays
francophones. Enfin, les
sigles BDU (banque de données urbaine), voire BDT (banque de
données sur le territoire), plus anciens, peuvent se rencontrer ici et
là.
Les SIG offrent toutes les possibilités des bases de
données (telles que requêtes et analyses statistiques) et ce, au
travers d'une visualisation unique et d'analyse géographique propres aux
cartes. Ces capacités spécifiques font du SIG un outil unique,
accessible à un public très large et s'adressant à une
très grande variété d'applications.
Les enjeux majeurs auxquels nous avons à faire face
aujourd'hui (environnement, démographie, santé publique...) ont
tous un lien étroit avec la géographie.
De nombreux autres domaines tels que la recherche et le
développement de nouveaux marchés, l'étude d'impact d'une
construction, l'organisation du territoire, la gestion de réseaux, le
suivi en temps réel de véhicules, la protection civile... sont
aussi directement concernés par la puissance des SIG pour créer
des cartes, pour intégrer tout type d'information, pour mieux visualiser
les différents scénarios, pour mieux présenter les
idées et pour mieux appréhender l'étendue des solutions
possibles.
De nombreux autres domaines tels que la recherche et le
développement de nouveaux marchés, l'étude d'impact d'une
construction, l'organisation du territoire, la gestion de réseaux, le
suivi en temps réel de véhicules, la protection civile... sont
aussi directement concernés par la puissance des SIG pour créer
des cartes, pour intégrer tout type d'information, pour mieux visualiser
les différents scénarios, pour mieux présenter les
idées et pour mieux appréhender l'étendue des solutions
possibles.
Les SIG sont utilisés par tous ; public,
entreprise, écoles, administrations utilisent les SIG. La
création de cartes et l'analyse géographique ne sont pas des
procédés nouveaux, mais les SIG procurent une plus grande vitesse
et proposent des outils sans cesse innovant dans l'analyse, la
compréhension et la résolution des problèmes.
Aujourd'hui, les SIG représentent un marché de
plusieurs milliards d'euros dans le monde et emploient plusieurs centaines
de milliers de personnes
Les SIG sont enseignés dans les écoles, les
collèges et les universités du monde entier. Les professionnels
dans leur très large majorité sont directement concernés
par les apports de la dimension géographique dans leur travail
quotidien.
b. Historique
On cite souvent comme première application des SIG
l'étude menée avec succès par le docteur John Snow pendant
l'épidémie de choléra dans le quartier de Soho à
Londres en 1854 : ayant représenté sur un plan la
localisation des malades et l'endroit où ils puisaient leur eau, il
détermina que c'était l'eau d'un certain puits qui était
le foyer de contamination. On peut faire du SIG sans ordinateur.
Le développement des SIG dans la science et l'
aménagement
du territoire a été permis par l'avancée de la
technologie
informatique, et
encouragé par prise de
conscience
environnementale et de nouvelles approches scientifiques transdisciplinaires,
intégratrices. Depuis les
années 1970,
notamment depuis le
sommet de la
Terre à Rio de Janeiro en
1992 qui a
généré une demande croissante de cartes présentant
l'état de l'environnement et utiles pour mesurer les impacts du
développement.
Maguire et al. (1991) distinguent trois périodes
principales dans l'évolution des SIG :
F fin des
années
1950 - milieu des
années
1970 : début de l'informatique, premières
cartographies automatiques ;
F milieu des
années
1970 - début des
années
1980 : diffusion des outils de cartographie automatique/SIG dans
les organismes d'
État (armée,
cadastre, services
topographiques, ...) ;
F depuis les
années
1980 : croissance du marché des
logiciels,
développements des applications sur PC, mise en réseau (
bases de
données distribuées, avec depuis les
années 1990, des
applications sur
Internet) et une
banalisation de l'
usage de l'
information
géographique (cartographie sur
Internet, calcul
d'itinéraires routiers, utilisation d'outils embarqués
liés au
GPS... ).
c. Questions auxquelles
peuvent répondre les SIG
Un SIG doit répondre à cinq questions, quel que
soit le domaine d'application :
F Où : où se situe le domaine
d'étude et quelle est son étendue
géographique ?
F Quoi : quels objets peut-on trouver sur
l'espace étudié ?
F Comment : comment les objets sont-ils
répartis dans l'espace étudié, et quelles sont leurs
relations ? C'est l'
analyse spatiale.
F Quand : quel est l'âge d'un objet
ou d'un phénomène ? C'est l'analyse temporelle.
F Et si : que se passerait-il s'il se
produisait tel événement ?
d. Limites des SIG
Les SIG ont comme limites :
F La pertinence, la richesse, et l'occurrence de mise
à jour de leurs bases de données, mais aussi parfois les
restrictions d'accessibilité ainsi que les droits d'auteur sur certaines
données et informations qui peuvent empêcher la diffusion de
cartes, ou empêcher leur réalisation pour les travaux partageant
les données de plusieurs SIG.
F L'accessibilité peut également souffrir de
mesures prises pour protéger des entités particulières
lorsque la taille de l'échantillon est trop petite (secret statistique),
ou par la présence sur une couche de données d'informations
stratégiques et/ou protégées.
F Enfin certaines requêtes demandent un temps ou une
puissance de calcul non disponibles.
I.I.2 ARCHITECTURE ET
FONCTIONNEMENT D'UN SIG
a. Les composants d'un SIG
Un SIG est constitué de cinq composants
majeurs tels que présentés par le schéma
ci-dessous:

Figure 1 - les composants
d'un SIG
Les
matériels
informatiques
Les SIG fonctionnent aujourd'hui sur une très large
gamme d'ordinateurs des serveurs de données aux ordinateurs de bureaux
connectés en réseau ou utilisés de façon autonome.
Des systèmes client-serveur en
intranet,
extranet voire via
Internet facilitant ensuite
et de plus en plus la diffusion des résultats.
Les logiciels
Ils assurent les 6 fonctions suivantes (parfois regroupées
sous le terme des `6A'):
F saisie des informations géographiques sous forme
numérique (Acquisition)
F gestion de base de données (Archivage)
F manipulation et interrogation des données
géographiques (Analyse)
F mise en forme et visualisation (Affichage)
F représentation du monde réel
(Abstraction)
F la prospective (Anticipation)
Les
données
Les données sont certainement les composantes les plus
importantes des SIG. Les données géographiques et les
données tabulaires associées peuvent, soit être
constituées en interne, soit acquises auprès de producteurs de
données.
Les utilisateurs
Un SIG étant avant tout un outil, c'est son utilisation
(et donc, son ou ses utilisateurs) qui permet d'en exploiter la quintessence.
Les SIG s'adressent à une très grande communauté
d'utilisateurs depuis ceux qui créent et maintiennent les
systèmes, jusqu'aux personnes utilisant dans leur travail quotidien la
dimension géographique. Avec l'avènement des SIG sur Internet, la
communauté des utilisateurs de SIG s'agrandit de façon importante
chaque jour et il est raisonnable de penser qu'à brève
échéance, nous serons tous à des niveaux différents
des utilisateurs de SIG.
Méthodes et savoir-faire
La mise en oeuvre et l'exploitation d'un SIG ne peut
s`envisager sans le respect de certaines règles et procédures
propres à chaque organisation. Un SIG fait appel à une
connaissance
technique et à divers savoir-faire et donc divers métiers qui
peuvent être effectués par une ou plusieurs personnes. Le
« sigiste » doit mobiliser des compétences en
géodésie
(connaissance des concepts de système de référence et de
système de projection), en analyse des
données, des
processus et de modélisation (analyse
Merise,
langage
UML par
exemple), en traitement statistique, en sémiologie graphique et
cartographique, en traitement graphique. Il doit savoir traduire en
requêtes informatiques les questions qu'on lui pose
b. Objets
géographiques et Représentations
L'information géographique contient soit une
référence géographique explicite (latitude & longitude
ou grille de coordonnées nationales) ou une référence
géographique implicite (adresse, code postal, nom de route...). Le
géocodage, processus automatique, est utilisé pour transformer
les références implicites en références explicites
et permettre ainsi de localiser les objets et les événements sur
la terre afin de les analyser.
Les
données
géographiques possèdent quatre composantes :
F les
données
géométriques ou attributaires renvoient à la
forme et à la localisation des objets ou phénomènes ;
F les
données
descriptives (qui font partie des données attributaires) renvoient
à l'ensemble des attributs descriptifs des objets et
phénomènes à l'exception de la forme et de la
localisation ;
F les
données
graphiques renvoient aux paramètres d'affichage des objets (type de
trait, couleur...) ;
F les
métadonnées
associées, c'est-à-dire les données sur les données
(
date
d'acquisition, nom du propriétaire, méthodes d'acquisition...).
Trois types d'entités géographiques peuvent
être représentés :
F le point (x,y) ou ponctuel ;
F la ligne ((x1,y1), ..., (xn, yn)) ou
linéaire ;
F le polygone ou surfacique.
À l'heure actuelle, aucun SIG ne gère
complètement les polyèdres, ou volumiques. Dans le meilleur des
cas, celui des logiciels dits 2D½, à un point (x,y) peut être
associé une cote (z) et une seule. Le schéma ci-dessous propose
une représentation des entités géographiques.
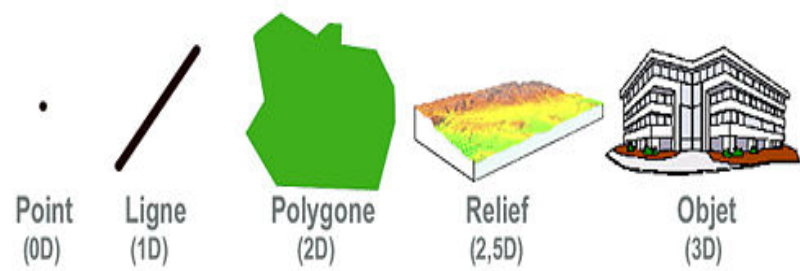
Figure 2 - Objets
géographiques et représentations
Les Systèmes d'Information Géographique
exploitent deux différents types de modèles pour
représenter l'information géographique:
· Le modèle vecteur
Dans le modèle vecteur, les informations sont
regroupées sous la forme de coordonnées x, y. on associe une
localisation à une entité descriptive. Le terrain est
représenté par des primitives graphiques (points, lignes,
surfaces). Seuls les endroits renseignés sont stockés. Il existe
une notion d'objet.
Les objets de type ponctuel sont dans ce cas
représentés par un simple point. Les objets linéaires
(routes, fleuves...) sont eux représentés par une succession de
coordonnées x, y. Les objets polygonaux (territoire géographique,
parcelle...) sont, quant à eux, représentés par une
succession de coordonnées délimitant une surface
fermée.
Le modèle vectoriel est particulièrement
utilisé pour représenter des données discrètes.
· Le modèle raster
Le modèle raster, quant à lui, est
constitué d'une matrice de points pouvant tous être
différents les uns des autres. C'est un mode maillé fondé
sur un quadrillage régulier du terrain. L'information est stockée
en lignes-colonnes. Chaque pixel contient une information (c'est-à-dire
que le vide est également codé). Il n'y a pas de notion
d'objet.
Il s'adapte parfaitement à la représentation de
données variables continues telles que la nature d'un sol.... Chacun de
ces deux modèles de données dispose de ses avantages.
Un SIG moderne se doit d'exploiter simultanément ces
deux types de représentation. Nous donnons ici une représentation
graphique de ces deux modèles :
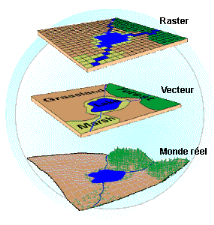
Figure 3 - Modèle
raster et modèle vecteur
c. Mise en place d'un
SIG
La mise en place d'un SIG est une opération qui se
déroule en plusieurs phases :
· De quelles données ai-je
besoin ?
Si l'on considère un Système d'Information
Géographique comme un moteur, il est essentiel pour qu'il fonctionne de
l'alimenter avec un carburant. Dans l'univers des SIG, ce carburant ce sont les
données. Si vous n'êtes pas familier avec les
données cartographiques, posez-vous d'abord la question " quel est
l'usage de ces données et qu'elle en est la finalité ? "
Nous vous proposons de découvrir ici quelques grands
thèmes de données disponibles aujourd'hui sur le marché
sachant que de nombreux projets SIG aujourd'hui dans le monde s'appuient sur
ces catalogues
F Les données cartographiques de base
Elles incluent les routes et autoroutes, les limites
administratives, les noms de communes, les cours d'eau, les espaces verts et
d'une façon générale toutes les informations habituelles
disponibles sur une carte papier. Ces données sont majoritairement
disponibles sous la forme raster.
F Les cartes et données sectorielles
Elles intègrent des informations sur la
démographie, les habitudes de consommation, les aspects financiers, la
santé, les télécommunications, la criminalité, la
sécurité civile, les entreprises, les transports et de nombreuses
autres informations sectorielles. Ces données sont disponibles suivant
les cas en format cartographique ou sous forme de données tabulaires.
F Les cartes et données environnementales
Elles réunissent les informations sur l'environnement,
le climat, les risques liés à l'environnement, les images
satellitales, la topographie et les ressources naturelles.
F Les cartes et données de références
mondiales
Elles illustrent une représentation mondiale
intégrant les frontières et toutes les informations liées
à chaque pays (populations, revenus, PIB, économie...).
· Comment trouver les données dont j'ai
besoin ?
S'il existe plusieurs offres de données dans le Monde,
celles ci ne sont pas toujours exhaustives et compatibles les unes avec les
autres. C'est pourquoi il existe au Cameroun, L'Institut National de la
Cartographie (INC), dont la vocation est de bâtir et de proposer les
catalogues de données les plus cohérents et opérationnels
sur l'ensemble du territoire.
L'INC n'étant pas producteur de données, c'est
au travers de coéditions avec les plus grands producteurs
français et européens qu'il vous propose un catalogue unique sur
le marché.
N.B : Un véritable atlas
géographique sur Internet
Le nouveau site cartographique du "
National Geographic
Society " (http://www.nationalgeographic.com/maps/index.html) illustre
parfaitement la diversité et la richesse des données disponibles.
Vous trouverez sur ce site un véritable atlas géographique
interactif intégrant une partie des données
évoquées ci dessus.
· Intégrer des données dans un SIG
(acquisition et saisie)
Un SIG ne peut fonctionner que s'il contient des
données. L'acquisition de ces données est la phase la plus
coûteuse dans la mise en place d'un projet SIG. Il y a donc tout
intérêt à bien définir ses besoins et à
comparer l'ensemble des données disponibles
Avant d'utiliser des données papier dans un SIG, il est
nécessaire de les convertir dans un format informatique. Cette
étape essentielle depuis le papier vers l'ordinateur s'appelle
digitalisation.
Les SIG modernes sont capables d'automatiser
complètement ces tâches pour des projets importants en utilisant
la technologie des scanners. D'autres projets moins importants peuvent se
contenter d`une phase de digitalisation manuelle (table à digitaliser).
Aujourd'hui de nombreuses données géographiques sont disponibles
dans des formats standard lisibles par les SIG. Ces données sont
disponibles auprès de producteurs de données et peuvent
être directement intégrées à un SIG
.A partir du moment où l'on a défini les
informations nécessaires à notre besoin, il reste à
régler la question du choix du mode d'acquisition des données :
si les données existent déjà, les importer ou dans le cas
contraire, les saisir.
Les données existent : il faut les importer
dans le système
L'importation de données est la première
manière d'acquérir des données. Les SIG offrent
généralement trois types de moyens d'importer des données
:
- importer une base de données structurée dans un format
interne à un SIG. Ce moyen convient entre les SIG d'un même type
mais est plus délicat entre des SIG de types ou de versions
différentes.
- importer un fichier "à plat", simple fichier textes
contenant toutes les informations structurées de façon simple.
Néanmoins un important travail de structuration des données est
nécessaire pour coïncider avec la structure interne du SIG.
- passer par une des normes d'échange disponible sur le
marché. Ce troisième moyen est le plus économique à
long terme.
D'une façon générale, l'importation des
données sémantiques est plus simple : import de simples fichiers
Excel ou Access....
Les données n'existent pas : il faut
créer une base de données
La géométrie des objets provient essentiellement
de vectorisation d'images existantes : fonds de carte, photos ou images
satellitales redressées. Mises comme fond d'écran en mode raster,
les objets peuvent être saisis à la souris ou bien
installés sur une table à digitaliser, ils sont saisis avec un
curseur. Pour passer une carte ou une photo en mode raster, on utilise un
scanneur.
La numérisation consiste à suivre avec le
curseur le contour d'un objet sur le document à numériser (carte
sur table ou image à l'écran), en enregistrant les points
caractéristiques (début, points intermédiaires, fin). Elle
peut être issue de relevés GPS ou de la photogrammétrie.
Le géocodage est une façon de créer des
objets géométriques très utilisée en
géomarketing. A partir de données sémantiques (n° de
commune, adresse, etc.) associées à un enregistrement, le
logiciel va rechercher dans une base de données existante la commune, la
rue...noter les coordonnées géométriques (X, Y ou
latitude, longitude) et positionner ainsi un nouvel objet
géométrique. Un client est ainsi correctement positionné
dans la bonne rue de sa commune. Après avoir numérisé la
géométrie des objets, l'opérateur remplira selon ses
besoins une fiche attributaire pour chaque objet, il entrera alors les
données alphanumériques dites sémantiques
· Gestion et organisation des
données
Les sources d'informations (comme celles décrites
précédemment) peuvent être d'origines très diverses.
Il est donc nécessaire de les harmoniser afin de pouvoir les exploiter
conjointement (c'est le cas des échelles, du niveau de détail,
des conventions de représentation...) Les SIG intègrent de
nombreux outils permettant de manipuler toutes les données pour les
rendre cohérentes et ne garder que celles qui sont essentielles au
projet.
Ces manipulations peuvent, suivant les cas n'être que
temporaires afin de se coordonner au moment de l'affichage ou bien être
permanentes pour assurer alors une cohérence définitive des
différentes sources de données.
Si pour les petits projets il est envisageable de stocker les
informations géographiques comme de simples fichiers, il en est tout
autrement quand le volume de données grandit et que le nombre
d'utilisateurs de ces mêmes informations devient important. Dans ce cas
il est essentiel d'utiliser un SGBD (Système de Gestion de Bases de
Données) pour faciliter le stockage, l'organisation et la gestion des
données.
Un SGBD n'est autre qu'un outil de gestion de la base de
données.
Il existe de nombreux types de SGBD, mais en Système
d'Information Géographique, le plus utilisé est le SGBDR
(Système de Gestion de Bases de Données Relationnel). Les
données y sont représentées sous la forme de tables
utilisant certains champs comme lien. Cette approche qui peut paraître
simpliste offre une souplesse et une flexibilité sans équivalent
permettant aux SIG de s'adapter à tous les cas de figure.
· Interrogation et analyses
Disposant d'un SIG et de données, vous allez pouvoir
commencer par poser des questions simple telles que :
§ A qui appartient cette parcelle ?
§ Lequel de ces deux points est le plus loin ?
§ Où sont les terrains utilisables pour une
industrie ?
Et des questions intégrant une analyse, comme par
exemple :
§ Quels sont les terrains disponibles pour construire de
nouvelles maisons ?
§ Quels sont les sols adaptés à la
plantation de cacao ?
§ Si je construis une autoroute ici, quel en sera le
trafic
Les SIG procurent à la fois des outils simples
d'interrogation et de puissantes solutions d'analyses accessibles à
tous les publics. Les SIG modernes disposent de nombreux et puissants outils
d'analyse, mais deux d'entre eux apparaissent comme particulièrement
essentiels :
L'analyse de proximité
- Combien existe-t-il de maisons dans une zone de 100
mètres de part et d'autre de cette autoroute ?
- Quel est le nombre total de client dans un rayon de 10 km
autour de ce magasin ?
Pour répondre à ces questions, les SIG disposent
d'algorithmes de calcul appelés " buffering " afin de
déterminer les relations de proximité entre les objets.
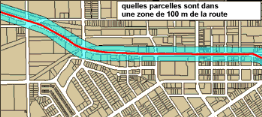
Figure 4 -Analyse de
proximité
L'analyse spatiale
L'intégration de données au travers des
différentes couches d'information permet d'effectuer une analyse
spatiale rigoureuse. Cette analyse par croisement d'information, si elle peut
s'effectuer visuellement (à l'identique de calques superposés les
uns aux autres) nécessite souvent le croisement avec des informations
alphanumériques.
Croiser la nature d'un sol, sa déclivité
(obliquité, inclinaison), la végétation présente
avec les propriétaires et les taxes payées sont un exemple
d'analyse sophistiquée que permet l'usage d'un SIG
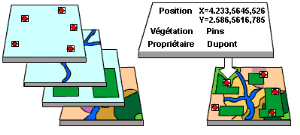
Figure 5 - Analyse
spatiale
· Visualisation
Pour de nombreuses opérations géographiques, la
finalité consiste à bien visualiser des cartes et des graphes.
Une carte vaut mieux qu'un long discours. La carte est en effet un formidable
outil de synthèse et de présentation de l'information.
Les SIG offrent à la cartographie moderne de nouveaux
modes d'expression permettant d'accroître de façon significative
son rôle pédagogique. Les cartes créées avec un SIG
peuvent désormais facilement intégrer des rapports, des vues
3D ; des images photographiques et toutes sortes d'éléments
multimédia.
d. Fonctionnement d'un
SIG
Un SIG stocke les informations concernant le monde sous la
forme de couches thématiques pouvant être reliées
les unes aux autres par la géographie. Ce concept, à la fois
simple et puissant a prouvé son efficacité pour résoudre
de nombreux problèmes concrets. Il est illustré par la figure
ci-dessous :

I.I.3 LES TECHNOLOGIES LIEES AUX SIG
S'il n'existe pas de règles établies pour
positionner toutes les technologies liées aux SIG les unes par rapport
aux autres, nous vous proposons néanmoins ici d'évoquer leurs
principales différences.
a. CAO (Conception
Assistée par Ordinateur)
Un système de CAO a pour vocation d'aider à
la conception et à la modélisation de bâtiments,
d'infrastructures et de produits manufacturés. Un système de CAO
procède par assemblage d'éléments dont les
caractéristiques sont fixes pour réaliser une infrastructure
globale. Ces systèmes requièrent quelques règles
(spécifiant comment assembler ces composants) et des capacités
d'analyse très limitées. Si certains logiciels de CAO sont
proposés pour la mise en oeuvre de solutions SIG, leurs capacités
demeurent très réduites et inadaptées pour l'analyse et la
gestion d'importantes bases de données géographiques.
b. Traitement d'image
et GPS
Le traitement et l'interprétation d'image sont
à la fois l'art et la science permettant de mesurer notre planète
grâce aux satellites, à la photographie aérienne et
à l'utilisation des GPS. Ces différentes sources d'images et de
mesures, permettent la collecte d'informations qui seront traitées,
visualisées, analysées et interprétées. Ils ne
peuvent être comparés aux SIG car ne traitant que les images ils
ne permettent pas d'analyser et de gérer les nombreuses autres grandes
familles de données. Les solutions de traitement d'images n'en demeurent
pas moins des auxiliaires précieux aux SIG dans leur ensemble.
c. SGBD
(Systèmes de Gestion de Bases de Données)
Les Systèmes de Gestion de Bases de Données
sont spécialisés dans le stockage et la gestion de tous types
d'informations y compris les informations géographiques. Les SGBD sont
optimisés pour stocker et retrouver des informations. De nombreux SIG
s'appuient sur ces capacités des SGBD pour organiser et localiser leurs
données. Mais le rôle des SGBD s'arrête là, car ils
ne disposent pas des outils de visualisation et d'analyse propres aux
Systèmes d'Information Géographique.
d. Bilan
Si les Systèmes d'Information Géographique sont
proches d'autres technologies telles que la CAO, le traitement d'image et la
gestion de bases de données, ils demeurent les seuls outils
adaptés à la visualisation et l'analyse de données
géographiques car complétant les imperfections de chacune de ces
technologies.
I.I.4 FONCTIONS DES SIG AU
QUOTIDIEN
L'information géographique numérique est facile
à partager et à exploiter. Elle devient une information
essentielle dans de nombreuses organisations qui l'utilisent comme cadre
référence utilisable par tous.
a. Les SIG, outils
d'analyse performants
La capacité des SIG en matière de recherche
des données et d'exécution des requêtes d'analyse
géographiques a permis à de nombreuses sociétés
d'économiser des dizaines de millions de francs. (ESRI France)
Les SIG participent à la réduction des
coûts en :
§ rationalisant les services aux clients
§ réduisant l'acquisition de terrain par une
meilleure analyse
§ réduisant les coûts de maintenance de
flotte de véhicules par une meilleure organisation logistique
§ analysant plus rapidement les informations, comme le
montre l'exemple suivant :
Un agent immobilier peut utiliser un SIG pour trouver des
maisons d'une certaine surface, avec 3 chambres et comportant un garage. Il
obtient ainsi simultanément une liste des maisons répondant
à ces critères ainsi que leur localisation géographique.
Cette requête peut ensuite être affinée avec l'aide de 2
nouveaux critères : une location inférieure à 4200 F
par mois et située à moins d'une certaine distance d'une
école. Le résultat de cette nouvelle requête s'affichera
dans les mêmes conditions.
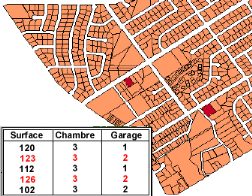
Figure 6 - Les SIG, outils
d'analyse performants
b. Les SIG, outils
fédérateurs de l'information
De nombreuses organisations qui ont intégré
l'usage d'un SIG, ont constaté qu'un des principaux
bénéfices obtenus, concerne la gestion de leurs propres
ressources.
Les SIG permettant de lier entre elles toutes sortes
d'informations par le biais de la géographie, ils permettent un meilleur
partage d'information et une meilleure communication entre les
différents services.
Par la mise en place d'une base de données
géographique partagée, tous les services de l'organisation
pourront profiter pleinement du travail réalisé par tous, une
information collectée une fois devenant ensuite exploitable par tous.
Plus la communication se développe entre les individus et les
départements, plus la redondance de l'information se réduit, la
productivité se développe, et l'organisation en
générale s'améliore.
Voici un exemple parmi tant d'autres qui illustre cet apport
des SIG : dans une société gérant des réseaux,
les bases de données clients et les bases de données des
infrastructures peuvent être intégrées en une seule et
même entité, si bien que, quand il sera nécessaire de
procéder à la maintenance d'un tronçon, tous les clients
concernés pourront facilement être prévenus par une lettre
personnalisée directement produite par le SIG.

Figure 7 - les SIG, outils
fédérateurs de l'information
c. Les SIG, outils
d'aide à la décision
Ce vieil adage " une meilleure information implique
une meilleure décision " est vrai pour un SIG autant que pour tout
autre système d'information. Un SIG n'est pas un système
automatique de décision mais plutôt une série d'outils pour
interroger, analyser et cartographier des données tout au long d'un
processus de décision.
Dans notre monde actuel, plus vous avez d'information
pertinente à votre disposition, plus il est facile de prendre une
décision réfléchie et construite. A la différence
d'une carte papier, un SIG vous permet de visualiser sous forme de couches
structurées toutes les informations dont vous avez besoin et d'exclure
celles qui vous sont inutiles. Les relations entre les informations
apparaissent plus évidentes, leur apportant une valeur ajoutée
indéniable.
Les SIG sont aussi utilisés en tant qu'outil
dans de nombreuses tâches telles que la présentation
d'études sur le terrain, la résolution de problèmes
territoriaux et tous les sujets concernant l'intégration dans un site.
Les SIG peuvent aider à choisir la meilleure solution permettant de
réduire l'impact d'une construction dans un site, à choisir les
zones les moins exposées aux risques naturels et le plus en
adéquation avec les réalités économiques.
La
qualité et la clarté des différents scénarios
possibles produits avec l'aide du SIG contribuent également à une
meilleure concertation et une meilleure compréhension des enjeux dans un
seul but : prendre la meilleure décision.
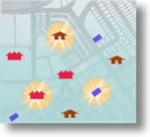
Figure 8 - les SIG, outils
d'aide à la décision
d. Les SIG, outils de
simulation
La prospective ou anticipation sur des situations futures est
une des fonctions les plus utilisés dans les SIG. Les cartes ont une
place toute particulière au sein d'un SIG. Le processus de fabrication
d'une carte avec un Système d'Information Géographique est
beaucoup plus souple qu'une production manuelle ou automatisée. Il
débute par la création de la base de données, les
informations existant sur support papier peuvent être digitalisées
et toutes les autres sources informatiques intégrées au sein du
SIG.
L'information contenue dans le SIG est continue sur l'ensemble
du territoire et totalement indépendante des problèmes
d'échelle. Les cartes issues du SIG sont réalisées en
fonction d'une localisation choisie, d'une échelle définie tout
en faisant apparaître les informations souhaitées. La mise en
évidence de certains phénomènes, la comparaison à
différentes époques, la simulation d'hypothèses sont
quelques uns des avantages importants des cartes produites par un SIG.
I.II - Le Webmapping
Préambule :
Le Webmapping définit le processus de
génération des cartes ainsi que leur diffusion pour visualisation
sur le Web. Autour de l'incontournable MapServer, l'objectif du présent
article est d'établir un état des lieux des solutions
«applicatives» qui facilitent la mise en ligne et la maintenance
d'information géographique. Cette expression «solutions
applicatives» recouvre en fait différents types de logiciels,
bibliothèques de fonctions, ensembles de scripts... Nous
détaillerons les briques logicielles les plus abouties qui ont pu
êtres testées dans notre environnement de travail. On distinguera
le côté client et le côté serveur avant de discuter
les résultats de ces tests.
I.II.1 PRINCIPE GENERAL DE FONCTIONNEMENT DU WEBMAPPING
Le serveur cartographique est le guichet automatique auquel
l'utilisateur fait appel pour afficher des cartes sur son poste informatique.
Par le protocole de communication Internet, TCP/IP, des ordinateurs
branchés en réseau peuvent échanger de l'information via
un navigateur Web ou transférer des fichiers grâce au protocole
FTP. L'architecture est de type client/serveur, c'est-à-dire qu'un
ordinateur dit serveur répond aux requêtes d'une série
d'ordinateurs dits clients.
L'utilisateur, à partir de son terminal effectue des
requêtes pour demander l'affichage d'une carte spécifique; le
serveur cartographique interprète cette requête et renvoie la
carte sous la forme d'une image matricielle (png, jpg,...) ou vectorielle (svg,
swf,...).
Le moteur cartographique peut être contrôlé
par des langages de script tels que PHP, Python ou Perl qui lui permettent de
générer dynamiquement une carte en réponse à une
requête préparée par une interface utilisateur. Le serveur
cartographique peut chercher l'information nécessaire à la
réalisation de la carte dans ses propres ressources, mais aussi sur des
serveurs de données distants.
La diffusion de l'information en ligne requiert une
installation côté serveur avec des logiciels tels que Apache
(projet Open Source) ou IIS (Internet Information Services, de
Microsoft) qui tournent en tâche de fond et donnent accès aux
serveurs de cartes à l'Intranet et à l'Internet. Ces logiciels
serveurs voient souvent leurs fonctions étendues par des
interpréteurs de scripts comme PHP ou ASP. Le serveur cartographique
s'appuie sur ces éléments pour recevoir des requêtes et
renvoyer des images et des données. Côté client, un
navigateur web suffit, accompagné éventuellement par un
viewer (visionneuse en français), pour afficher la carte (voir
schéma ci-dessus).
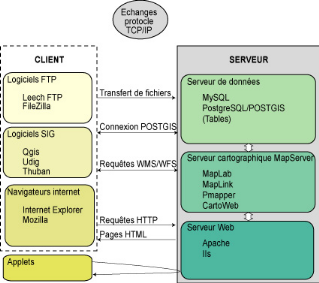
Figure 9 - principe
général de fonctionnement du Webmapping
Les données peuvent être gérées par
des logiciels spécifiques, les SGBDR tels PostgreSQL, MySQL, Oracle,
entre autres, qui peuvent être installés directement sur le
serveur contenant le serveur cartographique ou sur un autre serveur, distant.
Qu'importe le lieu, l'important est de pouvoir consulter et éditer des
données à distance.
PostgreSQL et son extension spatiale PostGIS est le
système de gestion de bases de données relationnelles le plus
abouti dans le domaine du logiciel libre. Actuellement la version 8.1 est
téléchargeable sur le site
http://www.postgresql.org/download.
PostGIS est désormais inclus dans la distribution officielle de
PostGreSQL (il est aussi disponible en version 1.0.4 sur son site propre:
http://postgis.refractions.net/download/).
Il offre des fonctionnalités approfondies pour stocker et traiter les
objets géoréferencés et géométriques.
Les différentes briques logicielles ont
été testées sous les systèmes d'exploitations
Windows XP et Linux Mandrake 10 pour évaluer leur
interopérabilité. Pour simuler la situation d'échange de
données via Internet, MapServer 4.4, PHP/MapScript, le SGBDR PostgreSQL
7.5 étendu de PostGIS 0.9.1 avec son interface graphique phpPgAdmin ont
été compilés sur un serveur Linux dédié.
L'utilisateur-testeur disposait des permissions de lecture et
d'écriture dans l'arborescence des répertoires de la
machine serveur, pour le stockage des solutions côté serveur
tandis que les solutions côté client ont été
placées sur la machine locale dans un environnement Windows XP pro.
I.II.2 SOLUTIONS CÔTÉ CLIENT
Les logiciels clients Open Source testés,
QGIS, UDIG, THUBAN et JUMP, sont des logiciels SIG en pleine évolution
possédant des fonctions qui font d'eux des outils avancés pour la
consultation et l'édition de données géographiques
à distance.
a. Quantum GIS 0.8.0
"TITAN"
QUANTUM GIS, est disponible sous la forme d'un
exécutable sur
http://qgis.sourceforge.net/.
Doté d'une interface conviviale, QGis permet de se connecter facilement
à des sources PostGIS afin de récupérer la
géométrie et les valeurs attributaires des couches vectorielles.
Des outils d'édition permettent ensuite de modifier les attributs, de
rajouter des formes et ces modifications s'inscrivent directement dans les
tables.
Par contre, on notera que l'on ne peut pas reprendre la
géométrie d'une couche. Par ailleurs, le projet en cours peut
être sauvegardé sous forme de mapfile dans l'optique de mettre
à jour un serveur cartographique MapServer. Cependant, celui-ci n'est
pas généré correctement et nécessite une
intervention manuelle notamment pour spécifier le type de connexion.
QGis possède des fonctions simples de discrétisation, propose des
outils basiques de création d'analyses thématiques. Les
différentes cartes sont imprimables. Pour le moment, on ne peut pas
effectuer des requêtes attributaires ou spatiales, même en langage
SQL. Ainsi, en local, il est possible de récupérer des
données distantes stockées dans une base de données, les
représenter thématiquement, rajouter des couches diverses, les
modifier et les exporter vers un PostGIS distant. En version bêta, ce
programme comporte encore de petits bogues comme par exemple dans la gestion
des projections, mais la communauté derrière ce projet est active
et réactive. QGIS sera présenté plus en détail dans
la suite.
b. UDIG (User Friendly
Desktop Internet Gis)
UDIG, acronyme de User Friendly Desktop Internet Gis, est
construit autour de la plate-forme java Eclipse. Il est une création de
Refraction Research Incorporation, la société qui produit
PostGIS.
La version 1.0.5 actuelle est stable, elle se
télécharge à l'adresse:
http://udig.refractions.net/confluence/display/UDIG/Home.
Son installation, dans un environnement Windows, est
facilitée car il a été compilé avec tous les
programmes java nécessaires à son fonctionnement.
L'inconvénient est son poids de 50Mo environ, assez long à
télécharger pour une petite connexion Internet. De plus, si
certaines applications java comme JRE sont déjà installées
sur la machine, cela crée une redondance de programmes et une occupation
d'espace disque non négligeable. Ses fonctionnalités sont
axées sur la connectivité Web, autrement dit sur les
requêtes WMS, WFS ou sur l'import de données distantes
géométriques stockées dans PostGIS. Il constitue une
implémentation de référence des recommandations de l'OGC.
Capable de charger des fichiers shape, il nécessite néanmoins des
extensions supplémentaires pour afficher les raster. Son
intérêt majeur est de réaliser des modifications
géométriques sur les couches chargées en mettant
directement à jour la table de données distante. Il ne permet pas
de faire des analyses thématiques ni de réaliser des
requêtes spatiales. Il semble être en revanche un excellent
programme de récupération et de visualisation des données
distantes. Il peut constituer une brique dédiée à la mise
à jour d'objets géographiques parmi un ensemble de solutions
clientes. Son développement est donc à suivre.
c. THUBAN
THUBAN est un programme interactif permettant de visionner des
données géographiques. Développé avec les
langages Python et en C++, un effort a été fait afin de le
fournir compilé pour Windows. Sa version est stable et
téléchargeable
http://thuban.intevation.org/. Des
bibliothèques de fonctions en Python sont nécessaires pour
l'installer, mais la documentation en anglais est bien faite. Ses
fonctionnalités permettent de se connecter à des bases de
données distantes, d'importer des shapefile et des raster, d'effectuer
des requêtes attributaires et des jointures, de générer des
analyses thématiques en plage de couleurs avec discrétisation
automatique et visualisation de la légende. Il peut également
charger des systèmes de projection et modifier celles des couches
chargées. Les cartes sont enregistrées sous forme d'images wmf ou
de session Thuban. Cette dernière permet de récupérer la
structure de la carte au format XML
d. OPENJUMP
OpenJUMP est un projet de refonte et d'amélioration des
fonctionnalités du logiciel SIG JUMP. Il s'appuie sur un réseau
international de thématiciens et d'informaticiens, coordonnés par
le Jump Pilot Project. OpenJUMP se déploie en deux niveaux, basique et
avancé, le premier se destinant à un public non
spécialiste qui souhaite s'initier au monde des SIG. Le logiciel
s'organise en effet sous la forme d'un noyau gérant les fonctions SIG de
base, sur lequel peuvent se greffer de nombreux plugin lui ajoutant des
fonctionnalités diverses, souvent disponibles uniquement dans les
logiciels SIG avancés (interpolation, requêtes spatiales, mise en
page, représentations graphiques...).
I.II.3 SOLUTIONS
CÔTÉ SERVEUR
En pratique ces applications ne se situent pas toujours
entièrement côté serveur car elles peuvent
nécessiter le téléchargement d'un plugin
léger par le client. Elles tendent toutes vers la mise à
disposition des fonctionnalités d'un SIG classique sans pour autant les
atteindre complètement. De base, les solutions côté serveur
Open Source apportent la possibilité à partir d'un
navigateur Internet classique de visualiser des couches géographiques
générées dynamiquement. Actuellement, de nouvelles
fonctionnalités plus avancées apparaissent comme la
possibilité d'ajouter ou de modifier de l'information en ligne.
a. MAPLAB
Ce produit de DM SOLUTIONS est disponible à l'adresse
http://www.maptools.org/maplab/index.phtml.
Dans un environnement Win32, son installation est relativement aisée si
on se base sur une installation simplifiée comme MS4W. Sous linux les
difficultés peuvent se situer au niveau de l'alias qui recherche le
répertoire apps/, dans la configuration du serveur Web. Attention aussi
lors de la définition des chemins de répertoires dans l'interface
de configuration. MapLab est une suite logicielle intégrée
destinée à faciliter le déploiement de solutions de Web
Mapping. Avec MapLab on peut construire graphiquement son mapfile (MapEdit),
visualiser l'ensemble des données (MapBrowser) et y rajouter, par
exemple, des couches d'information provenant d'une requête WMS sur un
serveur cartographique distant. Enfin, on peut configurer l'interface
proposée à l'utilisateur (GMapFactory). La mise au point de cette
dernière reste néanmoins basique et peut être
améliorée grâce aux composants de Chameleon.
b. CHAMELEON
Ce produit de DM SOLUTIONS est disponible à l'adresse
http://chameleon.maptools.org/index.phtml.
Cet ensemble de composants permet de créer simplement une interface
HTML, en réservant des espaces à l'affichage de cartes et de
données attributaires et à des outils, comme le zoom, la
sélection et de déplacement. Ainsi, Chameleon permet, en quelques
clics, de construire une base pour le développement d'une application de
visualisation cartographique dynamique (php) sur Internet. On peut
apprécier ces qualités avec la démonstration en ligne sur
îles Hawaï
http://www.mapsherpa.com/hawaii2/.
Remarquez que la carte se recharge après chaque opération.
c. KA-MAPS
KA-MAPS, (
http://ka-map.maptools.org/) Dernier
produit en liste chez DM Solutions, Ka-Maps est très prometteur au
niveau de la fluidité de navigation sur la carte. Avec les produits
classiques, la carte est régénérée par MapServer
à chaque déplacement de la zone de visualisation (Bounding Box);
Ka-Map, lui, télécharge progressivement les dalles dont il a
besoin et MapServer n'intervient quasiment plus pendant la navigation.
Codé principalement en Javascript, il utilise la technologie AJAX pour
les transferts d'information (utilisée par exemple pour Google Maps). De
plus, chaque dalle n'est générée qu'une fois, et reste
dans un cache sur le serveur sous la forme d'une image. Il est plutôt
destiné à un public de développeurs. On peut
apprécier la démonstration sur:
http://maps.dmsolutions.ca/demo/us_streets/
d. CARTOWEB 3
CARTOWEB3 disponible depuis mars 2005 répond à
plusieurs demandes dans le monde du Web Mapping libre. C'est la solution qui
à ce jour se rapproche le plus des fonctionnalités d'un SIG
classique tout en étant adaptée aux caractéristiques de
l'Internet. Il s'intègre facilement dans un environnement Apache, php5,
Mapserver 4.5 mais n'est pas compatible php4, ce qui empêche pour
l'instant une association avec MapEdit. Cartoweb3 fonctionne grâce aux
potentialités de php5 en langage objet par un système de plugin
et de core-plugin.
En pratique, il apporte une interface de consultation et
d'interrogation, des instruments d'annotation et de mesure, mais surtout un
ensemble d'outils pour une gestion facilitée et des optimisations
multiples (interface multilingue, systèmes de regroupement des couches
pour une légende en arbre hiérarchique, systèmes
d'optimisation graduelle par cache...).
CartoWeb est une solution conçue pour le web, elle
permet par son architecture cartoclient/cartoserveur acceptant
simultanément plusieurs utilisateurs, une gestion
décentralisée de l'information et est compatible avec une
connexion à débit limité.
CartoWeb3 est théoriquement capable de faire de
l'édition des éléments géométriques, mais
cette fonctionnalité n'est pas encore opérationnelle. Dans la
version courante on ne peut que dessiner par-dessus la carte un polygone, une
ligne ou un point et tant qu'on est dans la même session, la forme et ses
attributs sont conservés. Pour compléter la documentation
officielle, vous trouverez des informations en français sur ce sujet sur
le site
Forum
SIG (http://www.forumsig.org/).
I.II.4 BILAN
Le Web Mapping, ou diffusion de cartes via le
réseau Internet, est un domaine en pleine expansion grâce au
développement des solutions Open Source. Suivant la philosophie
GNU qui autorise la copie, la diffusion du logiciel et la modification du code
source, ces programmes généralement gratuits et d'utilisation
libre émergent à un rythme soutenu.
Au centre de cette sphère en développement
permanent:
MapServer.
Né au
sein de l'Université américaine du Minnesota, ce logiciel permet
la publication de données via un serveur Internet et propose un ensemble
de fonctions digne des meilleurs outils payants (navigation, requêtes,
mais aussi mise à jour à distance).
Dans l'état actuel des choses, les solutions
client/serveur peuvent être totalement complémentaires, l'une
(serveur) permettant d'effectuer des traitements propres à la
problématique des SIG (croisements de couches, requêtes, analyse
thématiques), l'autre (client) par l'intermédiaire du mapfile
affichant la carte dans une interface accessible sur Internet. Par ailleurs, on
voit apparaître des modules Open Source qui se greffent sur les
grands SIG commerciaux comme Amein maintenu par Terrestris pour ArCGIS 8 et
Wortomap développé par Tydac utilisable avec MapInfo 7.8, qui lui
permet d'exporter le mapfile du SIG pour afficher la même carte dans une
interface MapServer.
A ce stade encore primaire, les solutions «libres»
proposées ne sont que des prototypes et ne répondent pas aux
besoins-types d'un utilisateur de SIG. En effet, si quelques logiciels
permettent de réaliser des cartes thématiques en aplats de
couleurs, la discrétisation se fait souvent manuellement. En outre,
quasiment aucune solution ne permet pour l'instant la représentation de
symboles proportionnels (sauf OpenJUMP muni d'un plugin). Les
requêtes spatiales sont, dans la majorité des cas, faites en
langage SQL. Nous présentons ici deux tableaux synthétiques des
solutions côté client et côté serveur.
|
Solutions côté serveur
|
|
Nom
|
Description
|
Remarques
|
|
MAPLAB+CHAMELEON
http://www.maptools.org/
|
Interface graphique pour construire le mapfile.
Connexion
WMS.
Personnalisation de l'interface.
|
Accessibles aux moins expérimentés.
Outils
pas toujours fiables.
|
|
CARTOWEB3
http://www.cartoweb.org/
|
Visualisation, manipulation de données vectorielles et
raster.
Impression pdf, interface multilingue,
fonctionnalités Web.
Connexion PostgGIS, WMS.
|
Installation complexe.
Nécessite une configuration
particulière.
|
|
MAPLINK
http://maplink.sourceforge.net/
|
Possibilité d'édition en ligne de la
géométrie des couches.
Requêtes WMS/WFS.
|
Installation ardue...
|
Tableau 1- Solutions SIG
côté serveur
|
Solutions côté client
|
|
Nom
|
Description
|
Remarques
|
|
JUMP
http://www.projet-sigle.org/
http://www.jump-project.org/
|
Traitements complexes sur données
géographiques.
Connexion WMS, PostGIS.
|
Nombreux plugin nécessaires.
Accessibles
aux moins expérimentés.
|
|
Quantum GIS
http://qgis.sourceforge.net/
|
Visualisation, manipulation de données vectorielles et
raster.
Connexion WMS, PostGIS..
|
Installation facile.
Interface en français et
conviviale.
Simple d'utilisation.
Pas toujours fiable.
.
|
|
UDIG
http://udig.refractions.net/
|
Édition de la géométrie des couches.
Connexion MS/WFS, PostGIS.
|
Très fort sur les connexions
distantes.
Nécessite une plateforme Java JRE/JDK.
|
|
THUBAN
http://thuban.intevation.org/.
|
Traitements complexes sur données
géographiques.
Connexion WMS/WFS, PostGIS
|
Nécessite une plateforme Python.
|
Tableau 2 - Solutions SIG
côté client

CHAPÎTRE II :
MODELISATION DE LA SOLUTION
La mise en oeuvre de Systèmes d'Information
Géographique (au sens large du terme) dans une démarche d'analyse
spatiale nécessite la spécification des objectifs à
atteindre et la modélisation du domaine d'étude. Reconnue comme
un standard pour la conception des systèmes d'information, l'approche
UML (Unified Modelling Language) propose de nombreux modèles permettant
d'identifier les structures statiques et dynamiques des systèmes
informatiques. Après avoir présenté globalement cette
approche, nous étudierons son application aux SIG et nous terminerons
par la modélisation de notre système.
CHAPITRE II
MODELISATION DE LA SOLUTION
II.I Modélisation
UML et analyse spatiale
Préambule :
La mise en oeuvre de Systèmes d'Information
Géographique (au sens large du terme) dans une démarche d'analyse
spatiale nécessite la spécification des objectifs à
atteindre et la modélisation du domaine d'étude. Cela suppose
donc de se forger une représentation de la réalité
étudiée en décrivant d'une part les objets
géographiques que l'on retient, leurs caractéristiques et leurs
relations et, d'autre part, les traitements à réaliser
susceptibles de répondre aux objectifs fixés. Reconnue comme un
standard pour la conception des systèmes d'information, l'approche UML
(Unified Modelling Language) propose de nombreux modèles permettant
d'identifier les structures statiques et dynamiques des systèmes
informatiques. Cette approche nécessite une analyse et une structuration
des différents paramètres et informations nécessaires
à la mise en oeuvre de ces outils.
II.I.1. L'approche UML pour
la mise en oeuvre des systèmes d'information
UML (Unified Modelling Language) est un langage de
modélisation conçu pour construire, visualiser, et
spécifier les systèmes d'information (BOOCH et al, 1998), (MORLEY
et al, 2000). La notation UML repose sur deux concepts essentiels :
F la modélisation du mode réel au moyen de
l'approche orientée objet ;
F l'élaboration d'une série de diagrammes
facilitant l'analyse et la conception du système d'information, et
permettant de représenter les aspects statiques et dynamiques du domaine
à modéliser et à informatiser.
L'approche orientée objet a pour but de
représenter les objets du monde réel sous forme de classes, sous
classes et objets. Une classe est une abstraction du monde réel qui
regroupe un ensemble d'objets ayant des caractéristiques et des
comportements communs. Chaque classe est définie par un ensemble
d'attributs (qui représentent les caractéristiques ou
propriétés de la classe), et un ensemble d'opérations
qu'elle peut exécuter. Ces opérations représentent un
ensemble de traitements. Un objet est une unité
élémentaire d'une classe. Il hérite des
propriétés de la classe à laquelle il appartient, et il
est caractérisé par les valeurs affectées à ces
propriétés.
Classes et objets sont reliés entre eux par
différents types de relations :
F la relation d'instanciation : un objet est une instance
d'une classe
F la relation d'association qui représente les
connexions entre les objets de différentes classes. Cette relation
précise combien d'objets d'une classe peuvent être liés
à l'objet d'une classe associée. Ces associations peuvent
être bi-directionnelles.
F la relation de généralisation /
spécialisation qui permet d'identifier, parmi les objets d'une classe,
un sous ensemble d'objets (sous-classe) ayant des propriétés
spécifiques.
F les relations d'agrégation et de composition.
L'agrégation est une sorte d'association qui met en relation une classe
agrégat et une classe agrégée. Cette dernière
étant considérée comme une partie de la classe
agrégat. La composition est un cas particulier d'agrégation.
UML propose neuf diagrammes, dont sept interviennent en phase
d'analyse du système d'information, et deux en phase de
réalisation et sont utilisés exclusivement par les
informaticiens. En ce qui nous concerne, nous nous intéressons plus
particulièrement aux diagrammes qui ont pour fonction de faciliter la
spécification et la compréhension du système au cours de
son élaboration. On distingue parmi eux les diagrammes structurels des
diagrammes comportementaux :
F Les diagrammes structurels permettent de visualiser,
spécifier, construire et documenter l'aspect statique ou structurel du
système d'information. Il s'agit des diagrammes de classes, d'objets,
mais aussi de déploiement et de composants. Les deux premiers permettent
de modéliser les entités qui seront manipulées par le
système d'information et qui représentent les objets du monde
réel. Les deux derniers sont exclusivement utilisés en phase de
réalisation du système.
Le tableau suivant résume les objectifs des principaux
diagrammes structurels.
|
Diagrammes structurels
|
Objectifs et fonctionnalités
|
|
Diagramme de classe
|
Décrit les classes du système et les relations
entre celles-ci
|
|
Diagramme d'objets
|
Décrit les instances de classes et leurs relations qui
composent l'application. Donne une vue statique du système à
partir de cas réels
|
Tableau 3 - Les diagrammes
structurels d'UML
Les diagrammes comportementaux modélisent les aspects
dynamiques du système, c'est à dire les différents
éléments qui sont susceptibles de subir des modifications. Parmi
eux on distingue, les diagrammes de cas d'utilisation, de séquence, de
collaboration, d'états - transitions et d'activités. Ils
représentent la dynamique du système, à savoir, non
seulement les interactions entre le système lui même et les
différents acteurs du système, mais aussi, la façon dont
les différents objets contenus dans le système communiquent entre
eux. Le tableau suivant résume les objectifs des différents
diagrammes comportementaux.
|
Diagrammes comportementaux
|
Objectifs et fonctionnalités
|
|
Diagramme des cas d'utilisation
|
Décrit les fonctionnalités du système,
l'application et les différents cas d'utilisation. Assure une
communication aisée entre les analystes, les experts et les
utilisateurs.
|
|
Diagramme de collaboration
|
Définit les interactions d'un point de vue temporel
entre les différents objets du système pour un cas d'utilisation
donné. Il complète le diagramme d'objets en présentant la
façon dont les différents objets communiquent entre eux. Cette
communication s'effectue par échanges successifs de messages entre les
objets du système, et ce afin de réaliser une des fonctions du
système
|
|
Diagramme de séquence
|
Il s'agit d'une variante du diagramme de collaboration,
construit à partir des cas d'utilisation. Il présente
l'ordonnancement des messages (aspect temporel) pour une fonctionnalité
donnée du système. Il offre une meilleure visualisation des
interactions entre objets en présentant les messages
échangés entre eux. Il complète et détaille un cas
d'utilisation.
|
|
Diagramme d'états - transitions
|
Attaché à une classe ou à un cas
d'utilisation, il présente une classe par rapport à ses
états possibles et aux transitions qui le font évoluer. Permet de
spécifier ce que doit faire l'objet en réponse aux
événements (ou traitements) qui lui sont appliqués.
|
|
Diagramme d'activités
|
En s'intéressant ici plus aux actions qu'aux
états, il montre l'activité et le fonctionnement d'une
opération d'une classe
|
Tableau 4 - Les diagrammes
comportementaux d'UML
II.I.2. Application de
l'approche UML aux systèmes d'information géographique
Nombreuses sont les tentatives d'application des
méthodes de conception des systèmes d'information pour la mise en
oeuvre des systèmes d'information géographique. Les raisons de
leur inefficacité dans la conception des systèmes d'information
géographique sont citées dans l'ouvrage de PANTAZIS et DONNAY.
Retenons toutefois les plus significatives.
F Ces méthodes reposent sur deux approches distinctes,
privilégiant soit les données, soit les traitements. Or le
fonctionnement d'un système d'information géographique repose
justement sur une interdépendance étroite entre les
données et les traitements.
F L'information géographique s'organise
hiérarchiquement et les traitements qui sont appliqués sont
souvent complexes et reposent aussi sur des processus d'agrégation de
l'information. Or les méthodes proposées par les systèmes
d'information d'entreprise ne prennent en compte que des traitements simples de
type flux ou échange de données.
F L'utilisation des méthodes de conception des SI
présuppose que soient, au préalable, clairement identifiés
les besoins des applications et que l'on ait la maîtrise de leur
évolution. Or en matière d'analyse spatiale, de gestion et de
planification territoriale, les besoins s'identifient le plus souvent en
fonction des données dont on dispose, des résultats issus des
traitements réalisés, et de l'évolution des requêtes
adressées par les utilisateurs.
Il est certain que la modélisation UML ayant
été élaborée pour répondre aux besoins des
systèmes d'information classiques n'est donc pas conçue, a
priori, pour répondre aux spécificités des systèmes
intégrant de l'information géographique Ces derniers
gérant à la fois des données graphiques et des
données non graphiques sont considérés comme un cas
particulier des SI. Toutefois, il semble qu'a priori les principaux concepts
proposés par UML soient pertinents pour l'analyse et la conception des
systèmes de gestion et d'analyse des territoires. Cette approche peut
constituer un support intéressant en termes d'acquisition des
connaissances, de structuration de l'information géographique à
intégrer dans l'outil à concevoir, et de spécification des
fonctionnalités de l'outil.
a. Acquisition des
connaissances
Par connaissances, nous entendons à la fois les
données et l'information géographique mais aussi les relations
qui les lient, et les traitements réaliser. UML repose sur l'utilisation
simultanée d'un graphisme simple et du langage naturel. UML est un
langage qui possède un vocabulaire et des règles ; chaque symbole
possède une sémantique bien définie. Les diagrammes
proposés sont facilement compréhensibles, ce qui favorise la
communication entre les différents acteurs impliqués dans la mise
en oeuvre du système d'information, à savoir, analyste, expert du
domaine et utilisateurs. De ce fait, ces diagrammes constituent un outil
permettant d'acquérir les données et les connaissances à
intégrer dans l'outil. Cette acquisition peut s'effectuer de
façon incrémentale au fur et à mesure du processus de
modélisation.
b. Structuration de
l'information géographique
Dans la pratique, force est de constater que la mise en oeuvre
d'outils pour l'analyse et la gestion des territoires est trop souvent
guidée par l'entrée technologique. La modélisation des
données et des connaissances à prendre en compte pour
élaborer l'outil est trop souvent occultée ou guidée par
les spécificités de l'environnement informatique qui sera
utilisé. Ceci ne favorise ni la transposabilité de l'outil
à d'autres situations similaires, ni sa mise à jour ou son
évolution. Une démarche structurée et modélisatrice
s'impose dans la conception d'un système d'information qu'il soit de
type géographique ou non. L'intérêt d'utiliser l'approche
UML pour la réalisation d'un système d'information
géographique (au sens large du terme) réside dans l'association
des diagrammes structurels et comportementaux. Ceci permet d'intégrer
dans un même schéma conceptuel les données et les
traitements à réaliser sur ces données. Ainsi les
spécificités des outils pour l'analyse spatiale sont mieux prises
en compte, d'une part à travers le diagramme de classes qui offre un
cadre conceptuel pertinent pour la structuration des données, d'autre
part à travers le diagramme d'états - transition qui permet de
prendre en compte les différents traitements effectués sur ces
données, et donc leur évolution. Ainsi, l'ensemble des
entités qui constituent le domaine d'étude peut être pris
en compte.
Par ailleurs, la représentation centré-objet
constitue une réponse à la modélisation des faits
géographiques dont le caractère d'agrégation et de
composition est particulièrement important. Ce type de
représentation apparaît comme une possibilité pour la prise
en compte des emboîtements spatiaux.
c. Spécification des
fonctionnalités de l'outil
Quelle que soit l'application envisagée, la description
du problème auquel doit répondre l'outil à réaliser
est une phase essentielle dans la mise en oeuvre d'un outil de type
système d'information géographique. La pratique se résume
trop souvent à élaborer l'outil en fonction des données
dont on dispose et non pas en fonction des objectifs que l'on veut atteindre.
Ceci a pour conséquence l'accumulation d'une masse de données
dont certaines peuvent apparaître peu pertinentes, voire redondantes,
compte tenu des objectifs fixés, et contribuent à l'absence de
structuration de la base de données. Les diagrammes de cas d'utilisation
constituent en fait une aide à la spécification des
différentes fonctionnalités du système. Ceci permet donc
de déterminer les besoins du système non seulement en fonction
des cas d'utilisation définis, mais aussi selon les catégories
d'utilisateurs envisagés.
Par ailleurs ces diagrammes présentent
l'intérêt de pouvoir être élaborés selon une
démarche descendante au fur et à mesure de la
modélisation, précisant et complétant ainsi les
différentes fonctionnalités, mais aussi les entités du
domaine étudié.
d. Bilan
Nous avons ainsi présenté les principales
spécificités de l'approche UML et l'intérêt qu'elle
peut présenter dans la mise en oeuvre d'outil intégrant de
l'information géographique. Plusieurs expériences ont
été faites montrant l'intérêt de cette approche pour
la conception et la réalisation de système d'information
gérant de l'information géographique, SIRVA (VILLANOVA, 2000),
SPHERE (COEUR et al, 2000) et (DESCONNETS J-Ch, 2000). Certes, l'approche UML
peut aussi être considérée comme une démarche
guidée par les besoins. C'est en effet, à partir du diagramme de
cas d'utilisation que sont déclinés les autres diagrammes
comportementaux, ainsi que la structure des diagrammes de classes et d'objets.
Il est aisé de dire, qu'en matière de planification et de gestion
territoriale, les fonctionnalités de l'outil sont difficilement
identifiables au préalable, et qu'une méthode de conception de
système d'information guidée par les besoins n'est pas
pertinente. Mais ceci ne peut-il pas s'expliquer par l'absence de cadre
conceptuel structuré et global ? L'approche UML peut constituer ce
cadre, et même si l'identification des besoins ne peut pas être
faite de façon aussi précise et complète que pour un
système d'information classique, UML donne la possibilité de
modéliser les entités du domaine étudié, permettant
ainsi de structurer l'information géographique et assurant une meilleure
organisation de la base de données. Ceci a pour conséquence de
tendre vers une meilleure lisibilité et compréhension de l'outil
et favorise la mise à jour et l'évolution du système.
L'approche UML constitue un cadre pertinent pour la
modélisation des espaces et des faits géographiques. Elle permet
la modélisation des données non graphiques en prenant en compte
d'une part les données, d'autre part les traitements à appliquer
sur ces données. Actuellement, des travaux sont menés par
l'Université de Laval au Québec pour adapter l'approche UML
à l'intégration efficace des données géographiques
dans les systèmes d'information.
II.II Mise en OEuvre des
Concepts
Préambule
L'approche UML constitue un cadre pertinent pour la
modélisation des espaces et des faits géographiques. Elle permet
la modélisation des données non graphiques en prenant en compte
d'une part les données, d'autre part les traitements à appliquer
sur ces données.
La méthode utilisée ici se focalise à la
fois sur l'étude des données et des traitements associés.
Après avoir recensé les besoins et les données existantes,
nous procéderons à la production du diagramme des cas
d'utilisation puis des diagrammes de séquences et nous bouclerons avec
le diagramme des classes.
II.II.1. Expression des
besoins
a. Besoin
d'expérimentation
L'expérimentation de la cartographie dynamique sur
Internet est passée par la création d'un prototype axé sur
la carte du Cameroun. Cet outil ciblait le public désirant avoir des
informations sur le Pays. Les uns recherchant des informations
actualisées, les autres recherchant des informations territoriales
précises. L'outil devait répondre aux caractéristiques
techniques suivantes :
F permettre de visualiser sur une carte du Cameroun, les
circonscriptions administratives et le schéma du réseau
routier.
F proposer des possibilités de recherches
d'informations géographiques et attributaires par le biais de
requêtes
F disposer d'un module de mise à jour à distance
et de validation des données pour le maintien des résultats
cartographiques.
F s'appuyer sur des produits existants, open sources donc
libres de modification, documentés et maintenus.
Cette phase, celle qui a pris le plus de temps, a permis de
percevoir la complexité d'une telle mise en oeuvre, les ressources
humaines nécessaires en termes de développement web et de
connaissances SIG.
b. Besoins
théoriques et didactiques
Couplé à l'expérimentation, des rapports
ont été écrits afin d'expliciter dans le détail les
procédures suivies lors de la réalisation et d'établir un
état de l'art sur le sujet. Nous avons donc fourni une panoplie de
documents électroniques (pdf) didactiques à la
bibliothèque de l'entreprise. Les uns permettant de cerner l'offre
disponible en matière de programmes informatiques, l'autre servant
à circonscrire minutieusement l'ensemble de la démarche en
spécifiant les problèmes rencontrés surmontés ou
non.
II.II.2. Diagrammes de
modélisation
a. Diagramme des cas
d'utilisations
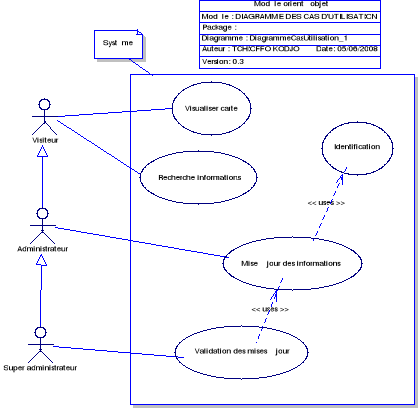
Figure 10 - Diagramme des
cas d'utilisation
b. Diagrammes de
séquences
Nous allons ici nous attarder seulement sur le cas
d'utilisation réalisé dans le cadre de notre application
SIG : Visualiser une carte.
Ce cas d'utilisation comporte les scénarios
suivants :
F Visualiser la carte d'accueil
F Réaliser un zoom sur la carte
F Réaliser un pan (déplacement horizontal) sur
la carte
F Ajouter une (des) couche(s) sur la carte
Pour chaque scénario, nous allons adopter la
démarche suivante : description textuelle puis réalisation
du diagramme de séquence associé.
|
Scénario 1 : Visualiser la carte
d'accueil
|
|
Objectif : Visualiser la carte d'accueil
|
|
Acteurs principaux : Visiteur
|
|
Préconditions : lancement du
navigateur
|
|
Postconditions : Affichage de la carte
d'accueil (succès) ou d'un message d'erreur (échec)
|
|
Scénario nominal
1 : le visiteur saisi l'url du site dans la barre d'adresse du
navigateur
2 : le système présente l'interface d'accueil du
site
3 : le visiteur sélectionne la partie cartographique
4 : le système présente la carte d'accueil
|
|
Scénarios alternatifs
2a : le site est indisponible ; l'url est incorrecte ;
le serveur subi un dysfonctionnement
2a1 : le système affiche un message d'erreur
|
Nous avons le diagramme de séquence suivant :
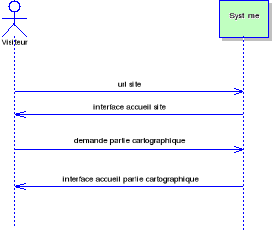
Figure 11 - Diagramme de
séquence : Visualiser une carte
|
Scénario 2 : Réaliser un zoom
sur la carte
|
|
Objectif : Zoomer sur la carte
|
|
Acteurs principaux : Visiteur
|
|
Préconditions : ouverture de la
carte d'accueil
|
|
Postconditions : zoom effectué sur
la carte
|
|
Scénario nominal
1 : le visiteur sélectionne le zoom (rapprochement=zoom in
ou éloignement=zoom out)
2 : le système active le zoom
3 : le visiteur sélectionne la partie de la carte
à zoomer
4 : le système présente la carte zoomée
|
Le diagramme découlant est alors le suivant :
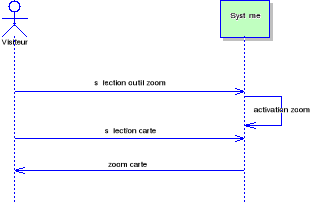
Figure 12 - Diagramme de
séquence : Réaliser un zoom sur la carte
|
Scénario 3 : Réaliser un pan sur
la carte
|
|
Objectif : Réaliser un pan sur la
carte
|
|
Acteurs principaux : Visiteur
|
|
Préconditions : ouverture de la
carte d'accueil
|
|
Postconditions : pan effectué sur la
carte
|
|
Scénario nominal
1 : le visiteur sélectionne le pan (déplacement
horizontal)
2 : le système active le pan
3 : le visiteur sélectionne la partie de la carte
à déplacer
4 : le système présente le déplacement de la
carte
|
On en déduit le diagramme ci-dessous
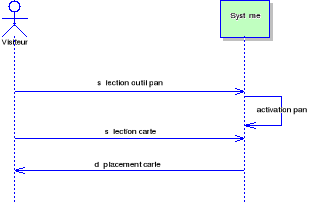
Figure 13 - Diagramme de
séquence : Réaliser un pan sur la carte
|
Scénario 4 : Ajouter une (des)
couche(s) sur la carte
|
|
Objectif : Ajout d'une (des) couche(s) sur
la carte
|
|
Acteurs principaux : Visiteur
|
|
Préconditions : ouverture de la
carte d'accueil
|
|
Postconditions : Couche(s)
ajoutée(s) sur la carte
|
|
Scénario nominal
1 : le visiteur sélectionne la (les) couche(s) à
ajouter
2 : le système active la (les) couche(s)
3 : le visiteur valide l'activation (clic sur la carte)
4 : le système présente la carte munie des couches
ajoutées
|
On a alors le diagramme suivant :
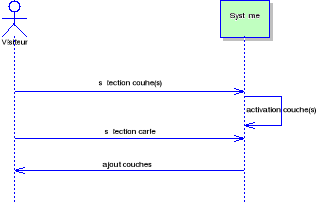
Figure 14 - Diagramme de
séquence : Ajouter une(des) couche(s) sur la carte
c. Diagramme des
classes
Une bonne conception dès le départ n'est pas une
perte de temps, bien au contraire elle limite les erreurs futures. Il est
important de considérer l'ensemble de données disponibles et le
format dans lequel elles sont proposées, de les organiser selon un
modèle, de réfléchir à leur type et aux traitements
dont elles peuvent faire l'objet. Le type est essentiel. Il défini la
donnée, l'espace qu'elle va occuper dans la base et permet la
compatibilité des jonctions attributaires sur les contraintes telles que
les clés. S'attacher à penser les données permet
d'éviter de longues manipulations, souvent dangereuses pour la base.
Après analyse de l'existant, nous sommes parvenus
à déterminer cinq classes particulières: les provinces,
les départements, les villes, les infrastructures de transport et les
types d'infrastructures de transport. Ci-après sont produits le
diagramme des classes et le modèle physique des données.
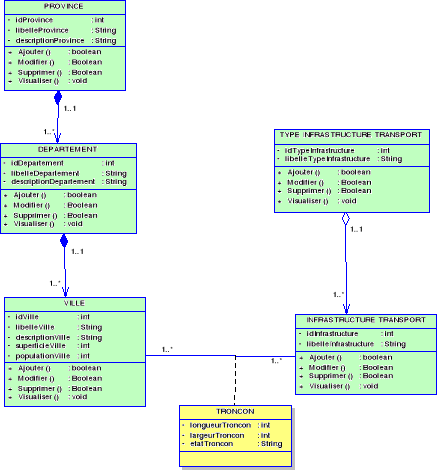
Figure 15 - Diagramme des
classes de l'application
d. Modèle physique
des données
Du diagramme des classes précédent, on
déduit le modèle physique suivent après application des
règles de passage :

Figure 16 - Modèle
physique de l'application

CHAPÎTRE III :
MISE EN OEUVRE DE LA SOLUTION
Il est question dans ce chapitre de développer
l'application cartographique spécifiée dans le chapitre
précédent. Il s'agit d'abord de la configuration de
l'environnement de travail puis de la présentation des outils
utilisés et enfin des résultats obtenus. Cette mise en oeuvre est
résumée en deux paragraphes :
1 - Environnement et outils de travail
2 - Résultats obtenus
Un bilan des travaux réalisés est
présenté dans la dernière section.
III.I Environnement et
outils de travail
III.I.1. Outils utilisés
a. Mapserver
Issu de milieux universitaires (Université du MINNESOTA
USA) et amélioré par des communautés de
développeurs, MapServer est un serveur cartographique open source
(à code ouvert) permettant de réaliser des applications de
Webmapping. Le Webmapping étant à la fois le processus de
génération des cartes ainsi que leur diffusion sur Internet et
leur visualisation dans un navigateur web. Mapserver respecte les
spécificités de l'OGC. Actuellement, la version 4.4 de Mapserver
s'adapte quasiment à tout type d'environnement. Il peut être
facilement étendu afin de supporter de nouveaux formats de
données, environnements de développement, systèmes
d'exploitation ou serveurs Web. En entrée, il accepte une multitude de
formats de données géographiques. En sortie, il produit des
cartes interactives à destination d'Internet sur plusieurs formats.
Mapserver et Apache
Apache est un programme permettant d'implémenter un
ordinateur en serveur Web. Il utilise le module PHP pour interpréter les
scripts. Il installé directement lors de l'installation de Mapserver.
C'est donc un programme capable d'interpréter les requêtes
HTTP
arrivant sur le
port
associé au protocole HTTP (par défaut le port 80), et de fournir
une réponse avec ce même protocole. Mapserver peut être
utilisé en CGI. Il faut rappeler qu' un serveur web est un logiciel
permettant à des
clients
d'accéder à des pages web, c'est-à-dire des fichiers au
format
HTML à partir d'un navigateur (aussi appelé browser)
installé sur leur ordinateur. Un des principaux intérêts de
l'utilisation de CGI est la possibilité de fournir des pages dynamiques.
Caractéristiques
F MapServer est performant en terme de vitesse d'affichage des
cartes.
F Il est très fiable car il peut faire face à
plus de 150000 connections simultanées.
F En terme d'adaptabilité et
d'évolutivité, il s'accommode quasiment à tous types
d'environnement. Il peut être facilement étendu afin de supporter
de nouveaux formats de données, environnement de développement,
système d'exploitation ou serveur web.
F Il peut facilement intégrer différents types
d'élément cartographiques dans une application tel que
l'échelle, la légende, la visibilité des couches
dépendant de l'échelle, système de prévisualisation
sophistiqué.
Fonctionnalités
F Mapserver est installé sur la machine serveur.
F Il est capable de stocker et gérer des données
localisées. Le stockage des données attributaires passe par un
Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles.
F Il permet de mettre à jour des données
graphiques et attributaires.
F le serveur de carte doit être couplé avec un
SGBDR capable de gérer la spatialité.
F Il retourne les informations sous forme adaptée aux
navigateurs Web ;
F Il doit permettre le croisement de données, le calcul
et la mesure de longueur et de superficie.
Avantages
F Le principal avantage de MapServer est le prix car il est
totalement gratuit.
F Il Incorpore plusieurs langages de programmation.
F Il Fonctionne avec un maximum d'explorateur client.
F Il Utilise des formats ouverts ou des formats
propriétaires (shapefile, geotiff, tab).
Inconvénient :
Comme la plupart des logiciels Open source :
F Mapserver nécessite un personnel motivé, et
formé;
F Il présente les difficultés
d'installation ;
F Il nécessite un temps d'investissement humain
important.
b. PostgreSQL
Notre sujet s'inscrit dans un cadre Open source,
c'est-à-dire logiciels dont les sources sont accessibles et modifiables.
Dans ce contexte, plusieurs SGBD nous sont proposés. Les plus connus
sont MySQL et PostgreSQL. D'une manière générale
PostgreSQL est un Système de Gestion de Base de Données
Relationnelles (SGBDR) développé au département
d'Informatique de l'université de Californie et fonctionnant sur des
systèmes de type UNIX ou WINDOWS. Son architecture est de type
client/serveur. Il est ainsi constitué d'une partie serveur, dont le
programme est postmaster, traitant les requêtes des clients et d'une
partie client permettant d'accéder aux données. PostgreSQL
supporte une grande partie du standard SQL tout en offrant de nombreuses
fonctionnalités modernes :
F requêtes complexes ;
F clés étrangères ;
F déclencheurs (triggers) ;
F vues ;
F intégrité des transactions ;
F contrôle des accès simultanés (MVCC ou
multiversion concurrency control).
De plus, PostgreSQL apporte une puissance additionnelle
substantielle en incorporant les quatre concepts de base ci-après afin
que les utilisateurs puissent facilement étendre le système. Il
s'agit des concepts de classes, héritage, types,fonctions.
D'autres fonctionnalités accroissent la puissance et la
souplesse : Ce sont les méthodes d'indexation, opérateurs,
contraintes et les fonctions d'agrégat.
Ces fonctionnalités placent PostgreSQL dans la
catégorie des bases de données objets relationnelles. Ainsi,
bien que PostgreSQL possède certaines fonctionnalités
orientées objets, il appartient avant tout au monde des SGBDR.
Vocabulaire
F client/serveur : c'est une
architecture dans laquelle plusieurs postes de travail dépendent d'un
poste contenant toutes les ressources du système.
F Le terme site désigne le hôte
sur lequel PostgreSQL est installé.
F Le super utilisateur (super user) Postgres
est l'utilisateur propriétaire des binaires (programmes) et des fichiers
de la base de données.
F L'administrateur des bases ou DBA est la
personne responsable de l'installation de Postgres et de la politique de
sécurité associée. Le DBA peut ajouter de nouveaux
utilisateurs et créer des bases.
F Le postmaster est un processus qui
reçoit et centralise les requêtes expédiées au
système PostgreSQL. Il peut également être défini
comme un serveur de bases de données multi-utilisateurs de
PostgreSQL.
Caractéristiques de
PostgreSQL
PostgreSQL possède de nombreuses
caractéristiques faisant de lui un SGBDR robuste et puissant digne des
SGBDR commerciaux. PostgreSQL dispose :
F des interfaces graphiques Windows et DOS nécessaire
pour gérer les bases de données ;
F des bibliothèques écrient en plusieurs
langages ;
F PostgreSQL peut-être employé comme base de
données spatiale principale pour les Systèmes d'Information
Géographique.
F une API ODBC permettant à n'importe quelle
application supportant ce type d'interface d'accéder à des bases
de données de type PostgreSQL.
Fonctionnement de
PostgreSQL
PostgreSQL fonctionne selon une architecture client/serveur.
Pour qu'une application cliente accède à une base de
données, elle se connecte via le réseau ou localement à un
postmaster en cours d'exécution. Ensuite, le postmaster déclenche
un processus serveur séparé pour gérer la connexion.
Lorsqu'une requête est faite, le processus Postmaster lance un nouveau
processus fils appelé postgres qui va établir la connexion entre
le client et le serveur PostgreSQL. Une fois la connexion établie, le
processus client peut envoyer une requête au serveur. La requête
est transmise en texte simple, c'est-à-dire qu'aucune analyse n'est
réalisée au niveau de l'interface client. Le serveur analyse la
requête, crée un plan d'exécution, exécute le plan
et renvoie les lignes trouvées au client par la connexion
établie. Ainsi PostgreSQL peut gérer plusieurs connexions
à partir des processus fils qu'il génère.
c. Postgis
PostGIS est un module d'extension de PostgreSQL, permettant
offrant des fonctionnalités pour les objets
géoreférencés et géométriques .PostGIS est
développé par Réfractions Research inc., comme projet de
recherche spatial de technologie de base de données. Réfractions
Research inc. est une compagnie de consultation de base de données se
spécialisant dans l'intégration de données et les
logiciels personnalisés de développement. PostGIS est une
prolongation du système de gestion de base de données PostgreSQL.
PostGIS utilise deux librairies principales GEOS et Proj4.
Geos est une librairie qui enrichit ou complète la panoplie des
fonctions spatiales de PostGIS tandis que Proj4 est une librairie permettant
la re-projection dans les divers systèmes de projection connus. Un
système de projection étant une transcription sur un plan d'une
surface courbe sans trop altérer ou provoquer des
déformations.
Caractéristiques
F PostGIS est implémenté conformément aux
spécifications SQL Standard de l'OGC ;
F PostGIS est actuellement à sa version 0.8.0,
couplable avec GEOS lui apportant des fonctionnalités bien utiles telles
que Within(), Disjoint(), Touches(), GeomUnion(), Intersection(),
Buffer()...
F PostGIS permet de créer des bases de données
afin de stocker et de traiter les données
géométriques ;
F PostGIS interagit avec plusieurs autres langages tel que le
C, le PHP, le java ...
L'architecture des applications de Webmapping est
illustrée par le schéma suivant.
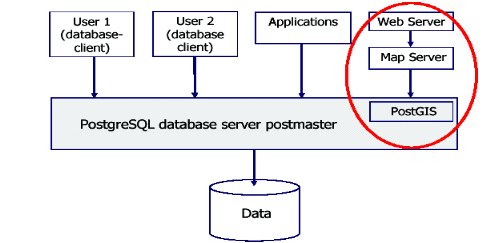
Figure 18 - Mise en évidence des applications
Web et PostGIS/PostgreSQL
Figure 18 - Mise en évidence des applications Web
et PostGIS/PostgreSQL
III.I.2.
Implémentation
a. Langages
utilisés
F Le Xhtml, (eXtended Hypertext Markup Langage) langage de
balisage hypertexte, est le langage informatique créé et
utilisé pour écrire les pages Web.
F Le SQL, (Structured Query Langage) langage de requête
interprété par le SGBDR.
F Le PHP,
langage
interprété (un langage de script) exécuté du
côté
serveur.
F Le JavaScript, langage de script incorporé dans un
document HTML.
b. Données mise
à disposition
Données vectorielles
Les données mises à disposition par CGICOM sont
vectorielles et attributaires.Les plans vectoriels sont au format SHP d'ESRI.
Ils correspondent au réseau routier, aux limites provinciales, aux
numérisations des limites des communautés de commune. Il a
été mis à notre disposition des couches vecteurs de la
carte du CAMEROUN aux formats (shapefile) . Ce sont les couches provinces,
départements, réseau routier, villes, population, terre.
Données
Attributaires
Les données attributaires proviennent des fichiers de
formes (.dbf) renseignant les différentes couches géographiques.
c. Installation des
logiciels
Les sources disponibles sur le Web peuvent être
téléchargées facilement à partir des sites web
(voir annexes). Cependant, leur installation et leur configuration ne sont pas
toujours aisées. Le suivi des instructions est d'une importance capitale
pour le bon fonctionnement de ces programmes. Les diverses installations
effectuées concernent PostgreSQL 8.1.3 (Annexe 1), PostGIS 1.1.2 (Annexe
1) et Mapserver (Annexe 3).
III.II. Résultats
obtenus
a. Configuration de la base
de données
Création de la base de données
La création d'une base « testgis »
se fait en tapant depuis la session du super utilisateur sous DOS les commandes
suivantes :
1.createdb testgis
2.createlang plpgsql testgis
3.psql -d testgis -f %PGHOME %\
share\contrib\lwpostgis.sql
4.psql -d testgis -f %PGHOME %\
share\contrib\spatial_ref_sys .sql
Createdb est la commande utilisée pour créer la
base. Les fonctions spatiales sont stockées dans la librairie dynamique
libwgeom.dll. PostgreSQL accède à ces fonctions à
condition de lui spécifier le langage PL/PGSQL. La seconde commande
« createlang » permet donc de doter notre base de ce
langage. Les définitions des diverses fonctions spatiales sont
stockées dans le fichier lwpostgis.sql que doit accepter notre base. On
charge les fonctions spatiales de PostGIS grâce à la
troisième commande. On assure donc un pont entre notre base de
données et la librairie libwgeom.dll.. La quatrième commande
permet de charger la base des différents systèmes de projections
connus (Lambert I Carto, Lambert II Etendu ...). Ces derniers sont
stockés dans une table par le biais du chargement du fichier
spatial_ref_sys.sql.
La commande psql est le moniteur interactif de PostgreSQL.
Elle permet en outre de faire des requêtes adressées directement
à un serveur PostgreSQL. On se connecte à la base de
données Testgis en faisant :
psql testgis
La création d'une table « test »
se fait comme suit :
CREATE TABLE test (id serial PRIMARY KEY ,genre text);
Nous lui avons ajouté une troisième colonne
où seront stockées nos données géométriques.
Ceci peut se faire directement ou en utilisant la fonction AddGeometryColumn()
dont la syntaxe est la suivante :
AddGeometryColumn ( [Table], [ nom_Colonne_Geometrique ],
[SRID], [ Type ], [Dimension ]);
on a donc :
SELECT AddGeometryColumn ( 'test ', 'geom ', -1, 'GEOMETRY ',
2 );
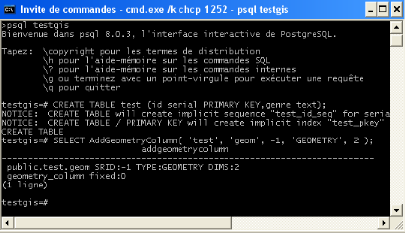
Figure 19 - création
de la base de données sous Postgresql
Importation des couches vecteurs de QGIS vers
PostgreSQL
On choisi le fichier à importer à partir du
bouton ajouter. Le fichier apparaît et il ne restera plus qu'à
l'importer.
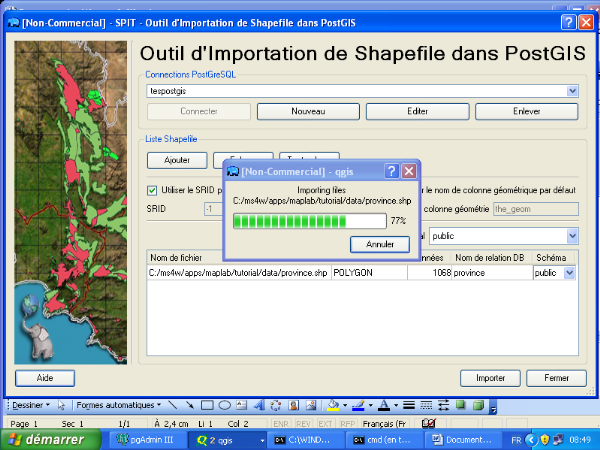
Figure 20 - Qgis,
importation des données
b. Interfaces
réalisées
Le modèle de page web conçu est le
suivant :
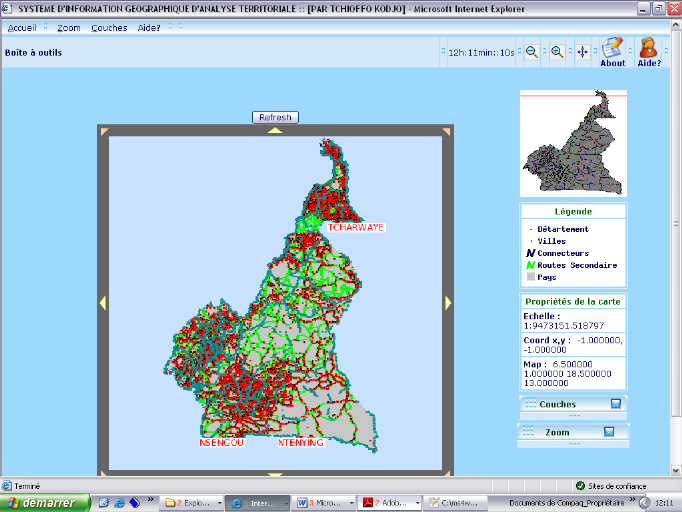
Il est constitué des éléments
suivants :
F Une barre de titre : elle
spécifie le titre et le sujet traité par l'application
F Une barre de menu : elle
spécifie l'ensemble des menus accessibles pour manipuler l'application.
Ce sont les menus :
o Accueil qui permet de retourner à la page principale
de l'application
o Zoom qui définit les différentes
fonctionnalités de manipulation par zoom sur la carte (Zoom In, Zoom
Out, Taille réelle)
o Couches qui permet d'ajouter ou d'enlever une couche
donnée dans la carte
o Aide qui contient l'aide en ligne
F Une boîte à outils: elle
contient les outils de manipulation immédiate de la carte. Ce sont les
outils :
o Zoom In  qui permet de faire un rapprochement immédiat d'une zone
ciblée sur la carte qui permet de faire un rapprochement immédiat d'une zone
ciblée sur la carte
o Zoom out  qui permet de s'éloigner d'une zone ciblée sur la
carte qui permet de s'éloigner d'une zone ciblée sur la
carte
o Taille réelle  qui redimensionne la carte à sa taille réelle qui redimensionne la carte à sa taille réelle
Elle contient en outre une horloge qui indique l'heure en
temps réel, de même qu'un bouton « About » qui
présente les auteurs de l'application et un bouton
« Aide » qui affiche l'aide en ligne.
F Une zone d'affichage de la carte : elle
affiche la carte et dipsoe d'un bouton « refresh » pour
réinitialiser la carte à sa taille réelle.
F Un panneau de contrôle : Il
contient :
o Une carte de localisation qui permet de situer
géographiquement la zone ciblée sur la carte
o Une légende qui explique les symboles visibles sur la
carte
o Une zone « propriétés de la
carte » qui spécifie l'échelle et les
coordonnées dans le plan de la carte
o Un panel couche qui spécifie les couches actives sur
la carte
o Un panel zoom qui spécifie le zoom actif sur la
carte
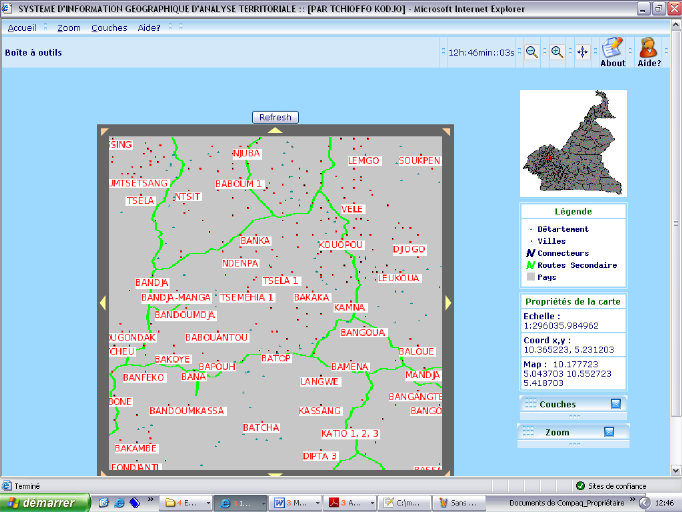
Figure 21 - Zoom sur le
village Bafang à l'Ouest Cameroun
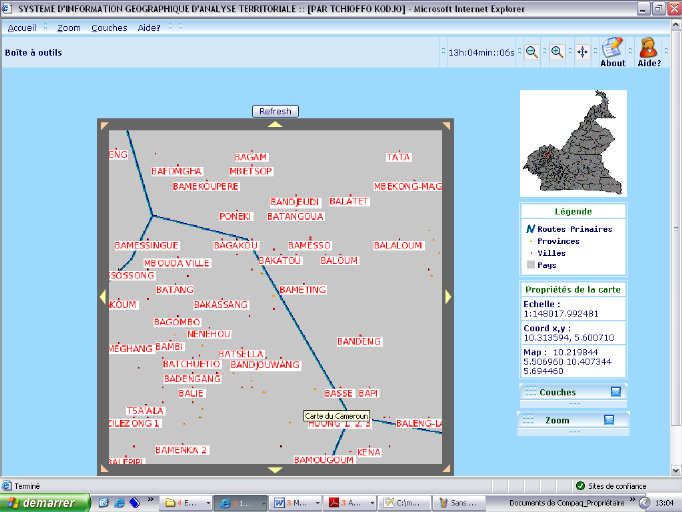
Figure 22 - Zoom sur le
village Mbouda à l'Ouest Cameroun
c. Bilan
On a ainsi produit une application cartographique permettant
une analyse territoriale de base sur la carte du Cameroun avec des
possibilités d'ajout de couches et de déplacement
orienté.
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES
Le projet initié a abouti à la création
d'une application permettant d'une part de visualiser des informations
géographiques sur une interface Web avec les informations attributaires
associées et d'autre part elle a permis de se familiariser avec
l'utilisation des SIG.
L'objectif principal de ce projet était la
compréhension des SIG, systèmes mettant en relation les
programmes informatiques de gestion de bases de données relationnelles
et de traitements des données géographiques. Outre la
réalisation de l'application et dans une optique de
reproductibilité ultérieure, nous avons marqué un accent
sur les rapports d'explication de la procédure adoptée.
Nous envisageons une extension de l'application avec
intégration des modules de mise à jour, le passage du mode GGI au
mode Mapscript et l'utilisation des outils de développement plus
productifs tels le couple Maplab/Chameleon ou Cartoweb.
S'agissant des perspectives, la géomatique est un champ
d'investigation de plus en plus prisé. Les applications SIG se
développent rapidement surtout ces dernières années avec
l'évolution des performances de l'informatique. Aujourd'hui, leur
évolution tend vers une accessibilité pour le
Web avec :
F Des serveurs cartographiques,
F Des SIRS (Système d'Information à
Référence Spatiale) partagés sur le
Web.
De plus, des outils SIG/SIRS nomades apparaissent grâce
au PDA (Personal Digital Assistant) dans le monde de l'
agriculture de
précision faisant de l'information géographique une ressource
vitale.
ARTICLES ET ANNEXES
Articles et annexes
Annexe 1
I - Installation de
PostgreSql/PostGIS
Etape 1 : Définition d'une
hiérarchie des répertoires
Elle consiste à définir une hiérarchie de
répertoires des sources pour pouvoir mieux nous retrouver pour la
suite. Nous avons créé les répertoires
suivants:
c :\msys\1.0\home\XXX\sources\Geos
c :\msys\1.0\home\XXX\sources\proj
c :\msys\1.0\home\XXX\sources\postgresql
c :\msys\1.0\home\XXX\sources\postgis
Etape 2 : Installation de PostgreSql
On télécharge les sources de PostgreSQL version
8.1.3 et on copie ce fichier vers le répertoire prévue quelconque
de notre machine. Les sources téléchargées se
présentent sous une forme compressée. A partir de Winzip, nous
avons décompressé ce fichier en destination du lecteur C.
Etape 3 : Installation de Geos et de
Proj
On télécharge les sources respectives de Geos et
de Proj et on les copie respectivement vers c
:\msys\1.0\home\XXX\sources\Geos et
c :\msys\1.0\home\XXX\sources\Proj. A partir
de Winzip, nous avons décompressé ce fichier en destination du
lecteur C. Les répertoires C:\proj et C:\geos vont automatiquement se
créer.
Etape 4 : Installation de PostGIS
On télécharge les sources de PostGIS version
1.1.2 et on copie ce fichier vers c
:\msys\1.0\home\XXX\sources\PostGIS. Winzip va donc nous permettre de
décompresser ce fichier en destination du lecteur C. Cette installation
n'est pas souvent nécessaire, car certaines versions de PostgreSql tel
que 8.1.3 installe postgis. Une fois les outils installés, il ne reste
plus qu'à paramétrer l'environnement de travail de PostgreSQL.
Annexe 2 Paramétrage de
PostgreSql/PostGIS
Elle consiste à rendre fonctionnel notre Server
PostgreSql. Pour cela, il est nécessaire de définir diverses
variables d'environnement.
Etape 1 : Création des variables
d'environnement de PostgreSQL
Les variables d'environnement suivant sont propres à
PostgreSQL :
· PGHOME = C :\PostgreSQL\8.1.3 :
permettra à PostgreSQL de savoir où est installée
la distribution
· PGDATA = C :\PostgreSQL\8.1.3\data :
permettra de connaître le répertoire racine des données des
diverses bases.
· PGHOST = localhost : permettra de
savoir à quel hôte se connecter et sur quel port.
· PGPORT = 5432 : Définit
l'hôte utilisé par PGHOST.
Etape 2 : Création du Super utilisateur
de PostgreSQL
Il s'agit d'un utilisateur physique de la machine. C'est lui
qui crée le répertoire PGDATA qui accueillera nos futures bases
de données. La création du super utilisateur consiste à
vérifier s'il n'existe pas sur notre machine un utilisateur ayant des
droits limités et possédant un mot de passe. Si ce dernier
n'existe pas, on le crée. Il est impératif que ce super
utilisateur ait des droits limités sur la machine et qu'il ait un mot de
passe. Les lignes de commandes permettant de distinguer les deux fenêtres
des utilisateurs commenceront par « # sous administrateur
: » ou bien '# sous Super-utilisateur :'
Si nous sommes connectés sous la session
administrateur. Il est possible de se connecter à une fenêtre DOS
sous la session du super utilisateur sans changer de session. Pour cela, on
utilise la commande runas de Windows. L'obtention de la
fenêtre en question se fait en saisissant dans une fenêtre DOS :
# sous administrateur:
runas /user:super-utilisateur cmd
Il suffit alors comme demandé de saisir le mot de passe
du super utilisateur. Il est également possible pour l'administrateur de
devenir super-utilisateur de PostgreSQL. Il vous suffira de saisir :
# sous postgres:
createuser -s administrateur
L'option -s permet à administrateur
non seulement de créer à son tour de nouveaux utilisateurs mais
aussi de créer de nouvelles bases de données. Ce code permet de
devenir maître absolu de notre PostgreSQL. On n'est plus obligé de
saisir la commande avec runas depuis la session
administrateur.
Etape 3 : Initialisation de
PostgreSQL
Elle consiste à la création du groupe des
futures bases de données par défaut. Cela va consister à
remplir le répertoire correspondant à la variable d'environnement
PGDATA. Le reste des configurations des paramètres du serveur peut par
la suite être reprise dans les fichiers .conf de
PostgreSQL. Pour l'initialisation, il faut utiliser l'outil
initdb. Dans la fenêtre du super utilisateur,
# sous super-utilisateur:
initdb -A trust -E SQL_ASCII
Par défaut ici, nous avons utilisé le jeu
d'encodage SQL_ASCII par la commande -E SQL_ASCII et
autorisons toute personne voulant se connecter au serveur par le réseau
sans demande de mot de passe par la commande -a trust
Etape 4 : Autoriser les connexions
TCP/IP
Pour autoriser les connexions TCP/IP, il faut
modifier le paramètre
listen_addresses du fichier c
:\Webmapping\8.1.3\data\postgresql.conf.
Ouvrez ce fichier et remplacez la ligne
# listen_addresses = 'localhost ' # what IP interface(s) to
listen on;
par
listen_addresses = '*' # what IP interface(s) to listen
on;
Etape 5 : Démarrage et arrêt de
PostgreSQL
Il existe deux types de démarrage :
o Démarrage/Arrêt manuel
Le démarrage manuel impose que nous démarrons
PostgreSQL à chaque démarrage physique de la machine. Pour cela,
nous devons utiliser l'outil pg_ctl .
# sous super-utilisateur:
pg_ctl start
Pour arrêter le serveur, nous tapons :
# sous super-utilisateur:
pg_ctl stop
o Démarrage/Arrêt automatique
Ici on ne se souci pas du démarrage de PostgreSQL
à chaque démarrage de la machine. Ici nous utiliserons toujours
pg_ctl avec l'option register.
La procédure est la suivante :
Nous allons créer le service nommé
postgresqlwin32 depuis la fenêtre DOS de l'administrateur :
# sous administrateur:
pg_ctl register -N postgresqlwin32 -U super-ultilisateur
-P « mot de passe »
Une fois le service est installé. Nous devons le
lancer. Il s'agit au dessus du mot de passe du super utilisateur. Le lancement
du service se fait en tapant :
# sous administrateur:
net start postgresqlwin32
Pour arrêter le service :
# sous administrateur:
net stop postgresqlwin32
pour désinstaller le service :
# sous administrateur:
pg_ctl unregister -N postgresqlwin32
Annexe 3 Installation de MapServer
Pour installer le serveur de carte, Mapserver il
faut :
· créer un répertoire pour recevoir le fichier
compressé contenant MapServer (C:\Mapserveur) ;
· copier dans ce répertoire le fichier
mapserver-4.2.0-win32-php4.3.4.zip ;
· décompresser ce fichier dans un répertoire
local (C:) ;
· créer un répertoire MapServer sous
C:\Apache\serveur\Apache2 \cgi-bin ;
· Copier le fichier MapServ.exe de C:\MapServeur\serveur
vers
C:\Apache\serveur\Apache2\cgi-bin\MapServeur ;
· Décompresser le fichier
C:\Mapserveur\Serveur\gdal-1.2.0.zip dans le répertoire
C:\MapDll ;
· Décompresser le fichier
C:\Mapserveur\Serveur\libcurl_dll.zip dans le répertoire
C:\MapDll ;
· Décompresser le fichier
C:\Mapserveur\Serveur\pdfdll.zip dans le répertoire C:\MapDll ;
· Décompresser le fichier
C:\Mapserveur\Serveur\xerces_dll.zip dans le répertoire
C:\MapDll ;
· Décompresser le fichier
C:\Mapserveur\Serveur\ECW_DLL.zip dans le répertoire C:\MapDll ;
· Décompresser le fichier
C:\Mapserveur\Serveur\libpq.zip dans le répertoire C:\MapDll ;
· Il faut modifier la variable d'environnement
Path pour préciser le chemin des DLL nécessaire
au fonctionnement de Mapserver.
Pour la modifier sous Windows 2000, il suffit de faire un clic
droit sur « poste de travail », on clique sur «
propriétés » onglet « Avancé » puis on
clique sur le bouton « variable d'environnement ». On modifie la
variable Path en ajoutant dans la liste des répertoires
C:\MapDll ;
· Ajouter dans le fichier de configuration d'Apache :
C:\Apache\Serveur\Apache2\conf\httpd.conf avant la
ligne ScriptAlias /cgi-bin "C:/Apache/serveur/Apache2/cgi-bin"
la ligne suivante : ScriptAliasMatch /cgi-bin/mapserv
"
C:/Apache/Serveur/Apache2/cgi-bin/Mapserveur/mapserv.exe"
L'ordre est important ;
· on reboote la machine.
BIBLIOGRAPHIE
|
LIVRES
|
|
[PAD96]
|
PANTAZIS D., DONNAY J-P., (1996), La conception de SIG,
méthodes et formalisme, Paris Editions Hermès.
|
|
[CDLM00]
|
COEUR D., DAVOINE P-A., LANG M., MARTIN H. 2000,
Intégration de l'information historique dans un système
d'information : l'exemple du projet SPHERE, Actes du colloque SIRNAT,
Cemagref, IMAG, Grenoble, septembre 2000.
|
|
[DML00]
|
DESCONNETS J-CH., MARTIN CH., LIBOUREL TH., 2000, Autour
d'une expérience de conception d'évaluation du risque
sismique, Actes du colloque SIRNAT, Cemagref, IMAG, Grenoble, septembre
2000
|
|
[MHL00]
|
MORLEY CH., HUGUES J., LEBLANC B., (2000), UML pour
l'analyse d'un système d'information, Paris Editions Dunod.
|
|
[VALE04]
|
VILLANOVA M. (2000), Modélisation UML pour les
systèmes d'information dédié aux risques naturels,
Actes du colloque SIRNAT, Cemagref, IMAG, Grenoble, septembre 2000.
|
|
[IVAR00]
|
Ivar Jacobson, Grady Booch, James Rumbaugh, Le Processus
Unifié de développement logiciel, Editions Eyrolles, 2000
|
|
[ROCQ01]
|
Pascal Roques, UML par la Pratique, Editions Eyrolles,
2001
|
|
[GRAD00]
|
Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, Le guide de
l'utilisateur UML, Editions Eyrolles,
|
|
NOTE DE COURS
|
|
[BATCH08]
|
BATCHAKUI Barnabé, "Génie logiciel". notes de
cours de Modélisation II année académique 2007-2008,
Master informatique Approfondie, ESIG Siantou Yaoundé.
|
|
MEMOIRES
|
|
[POM06]
|
PELIGUILE ONDAFE MOLENG. " Mise en oeuvre de la Carte
Administrative et Routière
du Canada sur un
OPENGIS POSTGIS
". Mémoire Technicien Supérieur IUT NGAOUNDERE
Génie informatique, 2005-2006,
|
|
[BAJ06]
|
BALDAGAI Jean Michel, "Conception et mise
en oeuvre d'un bus de service d'entreprise ESB". Mémoire
ingénieur de conception ENSP Yaoundé Génie informatique,
2005-2006
|
|
ARTICLES ET SITES WEB
|
|
[GEOS08]
|
« Visualisation des données
géospatiales » sur le site
http://www.geoconnections.org/, Article visité mai 2008.
|
|
[WISIG08]
|
« Système d'information
géographique » sur le site http://fr.wikipedia.org/,
visité juin 2008
|
|
[WIOP08]
|
« Définition de
l'« Open Source », version 1.0»,
sur le site http://fr.wikipedia.org/, visité juin 2008
|
|
[ESRI08]
|
« Les SIG » sur le site
http://www.esrifrance.fr visité mai 2008.
|
|
[HUBER07]
|
Hubert
d'Erceville ,
01 Informatique (n°
1911), Article publié le 29/06/2007 à 00h00 «Bataille en
vue sur les formats cartographiques»,
http://www.01net.com/, visité
en avril 2008.
|
|
[CKB05]
|
Marie Coutard, Jean-Pascal Klipfel, Samuel Blanc, Article
publié en décembre 2005, « La cartographie SIG en
ligne ou Webmapping: les outils «libres» État
des lieux des solutions «applicatives» autour de MapServer
(décembre 2005) ». sur http://mappemonde.mgm.fr/, site
visité mai 2008.
|
|
[DUB04]
|
Alain DUBOIS, Logiciels libres et SIG, PDF publié en
Mars 2004, téléchargement sur
http://www.sitg.com/, visité
Mai 2008
|
|
[LEPM07]
|
Philippe LEPINARD, « Découverte de
Mapserver » PDF publié le 04/08/2007 sur
http://www.MapTools.org,
visité en avril 2008
|
|
[LEPP07]
|
Philippe LEPINARD, « Premiers pas avec le tryptique
Postgresql/Postgis/Qgis» PDF publié le 13/07/2007 sur
http://www.MapTools.org,
visité en avril 2008.
|
Glossaire
![]()
A
American National Standards
Institute (ANSI)
L'ANSI est un organisme privé, sans but
lucratif, qui administre et coordonne le système américain
volontaire d'uniformisation et d'évaluation de la conformité.
L'ANSI offre des normes consensuelles sur des produits, des processus et des
services qui sont au coeur même de l'économie et de la
société américaines.
Applet
Un programme conçu pour
s'exécuter au sein d'une autre application. Contrairement aux
applications, les applets ne peuvent pas s'exécuter directement du
système opérationnel. Un applet bien conçu peut être
invoqué de plusieurs opérations différentes.
Application
Un programme qui exécute
directement une fonction spécifique pour un utilisateur. Les
applications peuvent faire usage des services de l'ICDG.
Architecture
La structure organisationnelle
et l'environnement opérationnel de l'ICDG, y compris les relations entre
ses parties, ainsi que les principes et les lignes directrices qui
régissent leur conception et leur évolution.
B
Booléen
En programmation, le terme
booléen fait référence au système combinatoire
conçu par George Boole qui combine des propositions au moyen des
opérateurs logiques AND (ET), OR (OU), IF THEN (SI ALORS), EXCEPT (SAUF)
et NOT (NON).
C
Cadastre
Archives publiques d'arpentages et
de cartes indiquant la valeur, l'étendue et la propriété
des biens-fonds à des fins de taxation.
Catalogue
Une liste complète de
choses, habituellement organisées de manière systématique.
La plupart des bases de données se composent de catalogues et
d'inventaires.
Client
Une composante ou une application
logicielles permettant d'accéder à un service.
Collection de données/produits
Les
données qui possèdent un ou plusieurs éléments
communs et qui ont été regroupées en fonction de ces
éléments communs pour former un groupe. Par exemple, la
collection de la Photothèque nationale de l'air comprend plusieurs
milliers de photos aériennes du paysage canadien prises au fil du temps.
Communauté de praticiens
Un groupe
organisé d'utilisateurs qui partagent des intérêts communs
sur un sujet ou des séries de problèmes communs ou encore qui ont
des besoins communs qu'une infrastructure peut satisfaire. Dans ce dernier cas,
au sein de la communauté de praticiens, les utilisateurs ont des
exigences communes.
Composante
Logiciel qui facilite
l'implantation d'un service chez un client ou sur un serveur et la mise au
point d'un ensemble d'interfaces. Une composante consiste en un code logiciel
(source, binaire ou exécutable) ou en équivalents tels que des
fichiers scripts ou des fichiers de commandes.
Composante réutilisable (RUC)
Un outil
cartographique en ligne gratuit pouvant être enchâssé dans
les pages Web d'une organisation à partir du Portail de
découverte de GéoConnexions. Les RUC permettent aux utilisateurs
d'ajouter rapidement à leur site Web des cartes interactives et des
localisateurs, ainsi que de coordonner des outils de saisie avec leur site Web.
Des interfaces normalisées (assistants) permettent aux
développeurs d'intégrer ces outils dans leurs applications.
Chacun de ces outils cartographiques interagit automatiquement avec les autres
qui sont intégrés dans une même page.
Couverture
Une représentation continue
d'une portion de la surface terrestre. Une couverture peut être une
collection d'entités (comme un jeu de données vectorielles) ou un
ou plusieurs attributs représentés sur une surface rastrée
ou maillée.
D
Descripteur de couches stylisées (Styled Layer
Descriptor) (SLD)
Une spécification complémentaire de
la spécification de l'interface de serveur cartographique Web (WMS), le
SLD offre le moyen de déterminer la représentation des
données retournées par un serveur WMS.
Données
Les données sont des
éléments d'information distincts, particulièrement de
l'information organisée pour permettre l'analyse, le raisonnement ou la
prise de décisions. Elles sont habituellement formatées d'une
manière spéciale et existent sous diverses formes : il peut
s'agir de chiffres ou de texte sur une feuille de papier, de bits ou d'octets
enregistrés dans une mémoire électronique, ou encore de
faits enregistrés dans le cerveau d'une personne. Les données de
l'ICDG comprennent les cartes, l'imagerie satellitaire, les publications et
toutes les autres données de caractère géospatial fournies
par des organisations canadiennes et internationales.
Données attributaires : Il s'agit de
données
associées à un objet ou une localisation géographique,
soit pour décrire un objet géographique, soit pour localiser des
informations : nom d'une route, type d'un bâtiment localisé
par son adresse, nombre d'habitants d'un immeuble localisé par ses
coordonnées Lambert, débit d'un cours d'eau, tension d'une ligne
de transport d'énergie, type d'arbres dans un verger localisé par
sa parcelle, etc. Les données attributaires sont reliées à
la géométrie de l'objet.
Données vectorielles : Elles
définissent le format de représentation géographique de
d'un objet; les objets sont représentés par des points, des
lignes, des polygones ou des polygones à trous ;
Données-cadres
L'ensemble des
données géospatiales qui constituent l'architecture de
référence pour toutes les géodonnées conformes
à l'ICDG.
Données
géospatiales
Géo-info ou géodonnées
présentant de l'information explicite de positionnement
géographique, comme un réseau routier tiré d'un SIG ou une
image-satellite géoréférencée. Les données
géospatiales peuvent inclure des données d'attributs qui
décrivent les entités contenues dans le jeu de données.
Digitalisation Conversion des
données du format papier vers un format informatique
E
Échelle
L'échelle des cartes
représente le rapport entre la distance sur la carte et la distance
réelle sur le terrain. À l'échelle de 1/50 000, par
exemple, 1 unité de mesure sur la carte représente 50 000
unités de la même mesure sur le terrain. L'échelle des
cartes s'exprime souvent comme une fraction représentative ou comme une
échelle graphique.
Entrepôt de données
Un
entrepôt de données destiné à soutenir le processus
décisionnel de gestion. La création d'un entrepôt de
données comprend le développement de systèmes permettant
d'extraire les données des systèmes d'exploitation, ainsi que
l'installation d'un système de gestion de base de données qui
permet aux gestionnaires d'accéder d'une manière souple aux
données.
F
Federal Geographic Data Committee (FGDC)
Un
organisme du gouvernement américain qui coordonne le
développement de la NSDI (National Spatial Data Infrastructure),
l'infrastructure américaine de données spatiales. Le FGDC a
été mis sur pied pour élaborer la norme CSDGM (Content
Standard for Digital Geospatial Metadata).
G
Géocommerce
Un secteur
économique émergent qui exploite les utilisations commerciales
des données et des services géospatiaux.
GéoConnexions
GéoConnexions est
une initiative nationale Canadienne de partenariat entre les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux, le secteur privé et
les universités qui travaillent à l'élaboration de l'ICDG,
afin de faciliter l'accès aux données, outils et services
géographiques du Canada sur Internet.
Géomatique
La science et la
technologie visant la collecte, l'analyse, l'interprétation, la
diffusion et l'utilisation de données géospatiales. La
géomatique s'intègre à une large gamme de disciplines, y
compris l'arpentage, les systèmes de positionnement global, la
cartographie et la télédétection.
Géocodage Le
géocodage est une façon de créer des objets
géométriques très utilisée en géomarketing.
A partir de données sémantiques (n° de commune, adresse,
etc.) associées à un enregistrement, le logiciel va rechercher
dans une base de données existante la commune, la rue...noter les
coordonnées géométriques (X, Y ou latitude, longitude) et
positionner ainsi un nouvel objet géométrique. Un client est
ainsi correctement positionné dans la bonne rue de sa commune.
I
Information géospatiale
(géo-info)
L'information géospatiale comprend des
cartes topographiques, aéronautiques et marines, divers types de cartes
telles que des cartes géologiques, agricoles et forestières, des
levés officiels, le cadastre, des photographies aériennes et des
images-satellites.
Infrastructure
Un environnement logiciel de
support fiable, analogue à un réseau routier ou à un
réseau de télécommunications, qui facilite l'accès
à de l'information géographique en utilisant un ensemble minimal
de pratiques, de protocoles et de spécifications normalisés.
Infrastructure canadienne de données
géospatiales (ICDG)
Une infrastructure Internet/Web
constituée de l'ensemble des développements des partenaires des
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que du
secteur privé, lesquels sont en train de créer la technologie,
les normes, les systèmes d'accès et les protocoles
nécessaires pour harmoniser toutes les bases de données
géospatiales du Canada et les rendre disponibles sur
Internet.
Infrastructure de données spatiales
(géospatiales) (IDS)
L'ensemble de base pertinent des
technologies, des politiques et des mesures institutionnelles qui servent
à faciliter la disponibilité des données spatiales et
l'accès à celles-ci. Une infrastructure de données
spatiales constitue une base pour la découverte, l'évaluation et
l'application de données spatiales par des utilisateurs et des
fournisseurs de tous les niveaux de gouvernement, du secteur commercial, du
secteur sans but lucratif et du milieu universitaire, et parmi les citoyens en
général.
Infrastructure mondiale de données spatiales
(IMDS) (Global Spatial Data Infrastructure, GSDI)
L'IMDS est une
organisation mondiale et ouverte qui coordonne l'organisation, la gestion et
l'utilisation des données géospatiales et d'activités
connexes. La promotion de l'IMDS se fait grâce à plusieurs nations
et organisations représentées par un comité directeur de
l'IMDS. Ce comité directeur multinational est formé de
représentants de tous les continents, et de tous les secteurs
(gouvernements, universités, secteur privé). La définition
de l'IMDS, adoptée lors de la deuxième conférence sur
l'IMDS, en décrit bien les objectifs : « L'IMDS englobe les
politiques, structure organisationnelle, données, technologies, normes,
mécanismes de livraison et ressources financières et humaines
nécessaires afin que ceux et celles qui travaillent à
l'échelle mondiale et régionale ne soient pas entravés
dans l'atteinte de leurs objectifs ». (http://www.gsdi.org/ )
Information géographique
L'information géographique peut être définie comme
l'ensemble de la description d'un objet et de sa position géographique
à la surface de la
Terre.
Interface de programmation d'application
(API)
L'interface (conventions d'appel) par laquelle un programme
d'application accède à des systèmes d'exploitation et
à d'autres services. Une interface API est un outil qui permet de
développer des interfaces utilisateurs personnalisées.
L'interface Web API offre une interface programmable au Portail de
découverte de GéoConnexions.
Inventaire
Un catalogue qui
énumère des produits individuels. La plupart des bases de
données se composent d'inventaires et de catalogues.
Jeu de
données
Un groupement de données par sujet, par
thème ou par type.
J
L
Langage de balisage géographique
(GML)
Une grammaire XML, indépendante du fournisseur,
permettant le transfert d'entités géographiques par Internet.
Logiciel de gestion de base de données
relationnelles
Un système pour la gestion de bases de
données relationnelles, c.-à-d. des bases de données sous
forme de tables comportant des rangées et des colonnes permettant
d'établir des relations entre les éléments et dans
lesquelles l'information permet d'établir des références
croisées entre deux éléments ou plus afin de
générer une troisième table.
M
Mécanisme de découverte
Un
service en ligne permettant aux utilisateurs de découvrir,
évaluer et obtenir des ressources (données, services et
organisations). Les mécanismes de découverte font le lien entre
les fournisseurs (ceux qui offrent des ressources) et les utilisateurs (ceux
qui utilisent les ressources).
Métadonnées
Les métadonnées sont des données sur des
sonnées. Elles décrivent comment, quand et par qui un jeu
particulier de données a été recueilli, et comment les
données sont formatées. Elles sont essentielles à la
compréhension de l'information enregistrée.
MIME Le type MIME
(Multipurpose Internet Mail Extensions) est un standard qui a été
proposé par les laboratoires Bell Communications en 1991 afin
d'étendre les possibilités du courrier électronique
(mail), c'est-à-dire de permettre d'insérer des documents
(images, sons, texte, ...) dans un courrier.
N
National Information Standards Organization
(NISO)
La NISO est une association américaine sans but
lucratif qui élabore et promeut des normes techniques utilisées
dans un large éventail de services d'information. La NISO a
élaboré des normes pour l'extraction d'information, comme le
protocole de recherche Z39.50.
Norme de contenu CSDGM (Content Standard for Digital
Geospatial Metadata)
Les objectifs de la norme américaine
CSDGM du FGDC sont d'offrir un ensemble commun de termes et de
définitions pour la documentation des données géospatiales
numériques. La norme définit les noms des éléments
de données et des éléments composés (groupes
d'éléments de données) qui sont utilisés à
cette fin; elle définit également ces éléments
composés et éléments de données, ainsi que
l'information au sujet des valeurs que peuvent avoir les éléments
de données.
Numérisation La
numérisation consiste à suivre avec le curseur le contour d'un
objet sur le document à numériser (carte sur table ou image
à l'écran), en enregistrant les points caractéristiques
(début, points intermédiaires, fin). Elle peut être issue
de relevés GPS ou de la photogrammétrie.
O
Objet fenêtre
Un objet fenêtre
permet d'ajuster la vitesse d'une simulation, et d'arréter, de relancer
et de quitter une simulation.
Open GIS® Consortium Inc. (OGC)
L'OGC
est une organisation sans but lucratif qui a été
créée pour régler le problème
d'interopérabilité entre les systèmes qui traitent des
données géospatiales. L'Open Geospatial Consortium, Inc. est un
consortium d'industrie international composé de 253
sociétés, agences gouvernementales et universités
participant à un processus de consensus afin d'élaborer des
spécifications d'interface disponibles au grand public. Les
spécifications OpenGIS® supportent les solutions
interopérables qui ajoutent un élément géospatial
aux services Web, sans fil et de localisation, ainsi que la TI courante.
Open source Terme
créé par Eric Raymond et utilisé pour désigner les
logiciels respectant les points suivants : Libre redistribution, la mise
à disposition du code source, la possibilité de distribuer les
travaux dérivés, le respect du code source originel, l'absence de
discrimination envers les personnes, l'absence de limitation sur le domaine
d'application du logiciel, la distribution de la licenece et sa non
spécificité à un produit, la non contamination de produits
logiciels dérivés. Exemples de licences conformes à l'Open
source : GNU GPL, BSD, X Consortium,
et Artistic. C'est aussi le cas de la MPL.
Opération
Une interaction entre un
client et un serveur, ayant pour résultat un transfert d'information ou
une action. Une opération peut être soit une interrogation (p. ex.
une requête-réponse), soit une annonce (p. ex. un avis).
Organisation
Dans le Portail de
découverte de GéoConnexions, une organisation désigne des
ministères fédéraux et provinciaux ainsi que des
administrations municipales, des organisations sans but lucratif, des
établissements d'enseignement (universités, collèges), de
même que des organisations commerciales qui offrent des données,
des services et des ressources de nature géospatiale.
Organisation internationale de normalisation
(ISO)
Une fédération mondiale d'organismes nationaux
de normalisation, représentant plus de 130 pays. La mission de l'ISO est
de promouvoir le développement des travaux de normalisation et des
activités connexes dans le monde, afin de faciliter l'échange
international des biens et des services et d'accroître la
coopération dans les sphères de l'activité intellectuelle,
scientifique, technologique et économique. Les travaux de l'ISO donnent
lieu à des ententes internationales qui sont publiées sous forme
de normes internationales.
orthophotographie :
Une
orthophotographie
est une image obtenue par redressement d'un cliché aérien (photo
argentique scannée ou photo numérique) pour le corriger des
déformations dues au relief du terrain photographié,
à la distorsion de l'appareil photographique, à l'inclinaison de
la prise de vue. type d'arbres dans un verger localisé par sa parcelle.
Les données attributaires sont reliées à la
géométrie de l'objet.
P
Photogrammétrie La
photogrammétrie utilise le principe de la vision en relief. Cette
technique permet de mesurer des objets à distance avec des images
métriques (des photos, le plus souvent) à l'aide d'appareils de
restitution.
Portail
Un site Web considéré
comme le point d'entrée d'autres sites Web, souvent en constituant ou en
offrant l'accès à un moteur de recherche. Le portail peut
être universel (comme Yahoo) ou être spécialisé
(comme le Portail de découverte de GéoConnexions qui est
spécialisé dans le domaine géospatial).
Portail de découverte de
GéoConnexions
Un service en ligne gratuit permettant aux
individus et aux organisations de trouver des produits et des services
géospatiaux du monde entier. Le Portail de découverte de
GéoConnexions offre aux organisations la possibilité d'inscrire
et d'annoncer leur organisation, leurs données, leurs services et leurs
ressources. Le Portail de découverte de GéoConnexions fait partie
de l'ICDG et constitue un lien vers d'autres parties de l'ICDG et vers d'autres
infrastructures de données spatiales.
Produit
On utilise de manière
interchangeable les termes « produits » et « collection de
données » pour décrire les données disponibles sur le
site Web du Portail de découverte de GéoConnexions. Toutefois, ce
qui distingue un produit d'une collection de données, c'est que la
collection de données regroupe plusieurs produits. Par exemple, les
quatre produits suivants peuvent être groupés dans une même
collection de données si on n'indique pas la résolution :
Mosaïque RADARSAT redressée du Canada, conique conforme de
Lambert, 250 mètres;
Mosaïque RADARSAT redressée du
Canada, conique conforme de Lambert, 500 mètres;
Mosaïque
RADARSAT redressée du Canada, conique conforme de Lambert, 750
mètres;
Mosaïque RADARSAT redressée du Canada, conique
conforme de Lambert, 1 000 mètres deviennent la
Mosaïque
RADARSAT redressée du Canada, conique conforme de Lambert.
Profil
Pour un protocole de recherche, un
profil désigne un ensemble de normes de base, avec des options et des
paramètres appropriés, nécessaires à
l'exécution de fonctions « identifier » à des fins
d'interopérabilité et pour une méthodologie de
référencement des divers usages des normes de base, de
façon à qu'elles soient significatives à la fois pour les
utilisateurs et les fournisseurs.
Pour une norme de données : un
profil précise les éléments qui doivent être
utilisés par un groupe particulier dans la norme nord-américaine,
p. ex. le profil nord-américain de la norme 19115 de l'ISO is the
International standard adapted to address North American's needs (attributes
are added).
Protocole de recherche avec état
Un
protocole de recherche avec état signifie qu'un mécanisme de
découverte établit la communication avec un serveur de recherche
et la maintient active pendant toute la durée de la session de
recherche.
Protocole de recherche sans état
Un
protocole de recherche sans état signifie qu'un mécanisme de
découverte établit la communication avec un serveur de recherche,
envoie un peu d'information, en reçoit un peu, puis coupe la
communication. Ainsi, la session de recherche comprend une série de ces
interactions ouvrir-envoyer-recevoir-fermer entre le mécanisme de
découverte et le serveur de recherche. Chaque interaction
ouvrir-envoyer-recevoir-fermer est indépendante des autres.
Protocole de recherche Z39.50
Le protocole de
recherche ANSI/NISO Z39.50 est un protocole de communication entre ordinateurs
conçu pour permettre la recherche et l'extraction d'information, de
documents plein texte, de données bibliographiques, d'images et
d'information multimédia dans un environnement réseau
réparti. Le protocole Z39.50 est actuellement utilisé dans le
Portail de découverte de GéoConnexions.
R
Registre
Une liste des jeux de données
ou des services individuels ou d'autres éléments qu'une
organisation met à la disposition des utilisateurs de l'ICDG. Il existe
deux types de registres : des registres des types (listes de divers types ou
classes d'objets, comme des services, des composantes ou des
événements que reconnaissent les services ou les applications de
l'ICDG) et des registres d'instances (listes de services, de composantes et de
jeux de données distincts ou d'autres éléments composant
l'ICDG ou qui sont pertinents pour ses utilisateurs. Les registres d'instances
permettent d'identifier, de situer et de décrire des instances
individuelles).
Répertoire
Un type de catalogue dans
lequel des collections de données sont décrites au moyen de
métadonnées. Dans le Portail de découverte de
GéoConnexions, le répertoire renferme des descriptions de
données et de services (incluant des services Web) géospatiaux,
ainsi que des organisations qui les offrent. Les utilisateurs peuvent effectuer
une recherche dans le contenu au moyen de contraintes spatiales, temporelles,
textuelles et par mots-clés, ou encore explorer le contenu du
répertoire.
Répertoire GCMD (Global Change Master
Directory)
Le répertoire GCMD de la NASA est un
répertoire exhaustif contenant les descriptions de jeux de
données touchant la recherche sur le changement climatique
planétaire. La base de données GCMD comprend les descriptions de
jeux de données portant sur le changement climatique, l'agriculture,
l'atmosphère, la biosphère, l'hydrosphère et les
océans, la géologie, la géographie et les dimensions
humaines du changement climatique planétaire.
Ressource
Dans l'ICDG, une ressource
désigne des services, y compris des services et des outils Web, des
produits et des organisations.
S
Schéma
Les schémas XML et GML
expriment des vocabulaires communs et permettent aux machines d'exécuter
des règles humaines. Un schéma permet de définir la
structure, le contenu et la grammaire des documents XML et GML.
Serveur
Un ordinateur sur un réseau,
qui est consacré à un objectif particulier et qui contient toutes
les données et exécute toutes les fonctions essentielles pour ce
faire (http://www.congressonlineproject.org/glossary.html#S).
Serveur de recherche
Un serveur de recherche
est un programme fonctionnant dans un ordinateur relié à
Internet. Il reçoit des requêtes de recherche par
l'intermédiaire d'Internet, qui transmet ensuite à une base de
données reliée au même réseau local (RL) que
l'ordinateur hôte du serveur. La base de données fournit un
résultat un serveur de recherche et celui-ci envoie ce résultat
au client Internet qui a soumis la requête originale.
Service
Un ensemble d'opérations,
accessible par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs interfaces, qui
permet à un utilisateur de définir une action importante pour
lui. Un service est fourni par un serveur. Une « instance de service
» est un autre nom pour un serveur.
Dans le Portail de découverte de GéoConnexions, un
service est une description de services professionnels, de services et de
logiciels en ligne offerts par des organisations ou des individus. Voir
l'annexe A2.2.1, Que pouvez-vous annoncer dans le Portail de découverte
de GéoConnexions pour obtenir une liste des services du Portail de
découverte de GéoConnexions.
Service de cartographie Web (Web Map Service)
(WMS)
Un service disponible sur Internet qui permet aux clients
d'afficher des cartes et/ou des images possédant une composante
géographique et dont les fichiers de données brutes
résident sur ou plusieurs serveurs WMS distants. Le WMS est conforme
à la spécification de l'interface de serveur cartographique Web
de l'OGC.
Service de couverture Web (Web Coverage Service) (WCS)
Une nouvelle spécification pour les couvertures,
c.-à-d. les grilles multidimensionnelles irrégulières
décrivant de nombreux types de phénomènes terrestres en
tous les points d'intersection.
Service d'entités Web (Web Feature Service) (WFS)
Une spécification qui définit les opérations
de manipulation des données relatives à des entités
géographiques, permettant des opérations de recherche,
d'extraction et de transaction (c.-à-d. ajout, mise à jour ou
suppression).
Site
Une adresse (p. ex. une URL) permettant
d'accéder à un système. Ensemble de fichiers
interliés accessibles à partir d'une adresse.
Système d'information géographique (SIG)
Un système informatique pour saisir, stocker,
vérifier, intégrer, manipuler, analyser et afficher des
données positionnées à la surface de la Terre. Un SIG peut
être utilisé pour traiter divers types de cartes. Celles-ci
peuvent prendre la forme de plusieurs couches différentes où
chaque couche contient des données pour un type d'entité
particulier. Chacune des entités est liée à une position
sur l'image d'une carte et les couches de données sont organisées
de façon à en permettre l'étude et l'analyse statistique.
SIRS, SIT, BDU, BDT
Système
d'information à référence spatiale ,
système d'information sur le territoire, banque de données
urbaine, banque de données sur le territoire: Ensemble constitué
par les
données et leur
structuration.
Système de
projection Un système de projection permet une
transcription sur un plan (la carte), une surface courbe (celle de la Terre),
sans trop altérer ou provoquer des déformations (distances,
angles et surfaces).
Système de coordonnées
terrestres : Un système de coordonnées terrestres
(sphérique ou projectif) permet de référencer les objets
dans l'espace et de positionner l'ensemble des objets les uns par rapport aux
autres. Les objets sont généralement organisés en couches,
chaque couche rassemblant l'ensemble des objets homogènes (bâti,
rivières, voirie, parcelles, etc.).
V
Variable d'environnement Une
variable d'environnement stocke des informations sur le système et/ou
son environnement et permet aux programmes d'avoir des informations sur leur
environnement.
W
Webmapping Le Webmapping
définit le processus de génération des cartes ainsi que
leur diffusion pour visualisation sur le Web.
| 


