REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEURE ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE DE KANANGA
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION


251659776
« Etude comparative des prévisions
et réalisations des recettes dans une régie
financière »
Cas de la Direction Provinciale des Impôts/
Kasaï Occidental
251651584
251661824
KATSHIENKE KAMBA Donatien
Travail de Fin de Cycle présenté en vue
de l'obtention du titre de Graduat en Sciences Economiques et de Gestion
Directeur : Dégrange MPUKA
BAKATUAMBAMBA
Chef de Travaux
ANNEE ACDEMIQUE 2012-2013
251662848
EPIGRAPHE
« Notre seule question est, s'il faut monter vaut-il
mieux suivre la raide mais sûre démarche du raisonnement
mathématique, ou marquer la dureté de l'ascension par les
détours et les zigzags du sentier fleur de la
littérature ».
F.Y. EDGEWERTH
DEDICACE
A toute la famille François KAMBA KATSHIENKE.
Donatien KATSHIENKE KAMBA.
REMERCIEMENTS
C'est par la grâce de l'Eternel Dieu tout puissant que
nous sommes arrivés à la fin de notre premier cycle
d'études universitaires. Et nous serons ingrats si à travers ce
travail de Fin de Cycle, nous ne disons pas un mot de remerciement à
tous ceux, de loin ou de près, de l'une ou de l'autre manière,
ont largement contribué tant soit peu à notre formation. Il nous
serait bien difficile de les citer tous, mais nous nous souvenons de tous avec
grande reconnaissance car : « la reconnaissance est la
mémoire du coeur » et la sagesse populaire de
surenchérir : « qui dit merci se montre
juste ».
Nous remercions de prime à bord le Chef de Travaux
Dégrange MPUKA BAKATUAMBAMBA, le directeur de ce travail,qui,
malgré ses multiples occupations, a voulu accepter la direction de ce
travail ; grâce à ses remarques et observations et surtout sa
disponibilité, nous sommes arrivés à présenter ce
modeste travail.
Nos remerciements s'adressent à toutes les
autorités académiques pour un bon encadrement pendant le temps
que nous étions sous leur responsabilité et au corps
enseignantpour nous avoir dotés des connaissances utiles à la
vie, lesquelles font de nous des cadres compétents pour le
développement de nos sociétés.
Une mention particulière de remerciements à mes
parents François KAMBA, Mireille LUKADI et Thérèse
TSHIMUANGA à qui, nous souhaitons une longue vie pour avoir guidé
nos pas, supporté nos caprices et grâce à leurs conseils
sages, nous faisons preuve aujourd'hui aux yeux du monde d'une éducation
particulière.
Nous pensons également à nos frères et
soeurs : Jean MULAMBA, Véronique MBOMBO, Mélanie BANAKAYI,
Béatrice BEYA, Marthe MPUTU, Jeancy NGALAMULUME, Felly KANKU, Suzanne
NGALULA, Mireille LUKADI et Ally KAMBA, pour leur amour et prière
manifestés à notre égard tout au long de ce cursus
universitaire, qu'ils trouvent ici notre sympathique et sincère
merci.
Aux fruits de nos entrailles Ally KAMBA, ces études
sont faites pour vous afin de vous laisser une trace et un modèle
à suivre pour le Congo de demain.
Nos vifs remerciements s'adressent à la famille
Valentin TSHIBANGU pour son encadrement et soutien de tous ordres tout au long
de notre parcours universitaire.
Nous pensons également à : Olivier
ELAMENJI, Darius NDAYE, Gilbert KALAMBAYI, Albert KAZADI, Felly TSHIMANGA,
Lajoie MASANKA, Thomas KALUME, André BUELA, pour vos conseils et
soutien, sentez-vous remercier pour tout ce que vous êtes pour nous.
Nous ne pouvons pas boucler la page sans toutefois faire
référence au bienfait et contribution de tous ordres
apportés à notre égard par nos camarades, amis (es) et
compagnons de lutte, nous citons : Charles KABEYA, Jean-Paul MBAMBI, Eddy
KITENGE, Laurraine MUBADI, David NGANDU, Alphonsine MUJINGA,...
Nous pensons enfin aux frères et soeurs, amis,
connaissances, compagnons de lutte dont les noms n'ont pas été
cités sur cette page, pour leur soutien tout au long de nos
études, qu'ils se sentent remercier dans cette oeuvre.
Donatien KATSHIENKE KAMBA
INTRODUCTION GENERALE
« A coeur vaillant, rien d'impossible : avec du
courage, on vient à bout du tout ». Avec ce maxime, nous
disons qu'il est de notoriété publique dans l'enseignement
supérieur et universitaire que tout étudiant finaliste d'un cycle
d'études de n'importe quel domaine fasse montrer son savoir.
De ce fait, nous trouvant au terme de notre cycle de graduat
en Sciences Economiques et de gestion à l'Université de Kananga,
« UNIKAN » en sigle, qui est notre champ et source
d'acquisition de nos connaissances scientifiques, nous sommes à
présent en droit de nous acquitter de cet ordre institutionnel.
0.1. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
a) CHOIX
Toute étude scientifique présente certaines
délicatesses qui intéressent agréablement l'attention du
chercheur.
Selon le Professeur ILUNGA KABONGO, le choix d'un sujet de recherche est tribut aire de l'angoisse
existentielle, c'est-à-dire l'ensemble d'investigations,
d'inquiétudes qui poussent à chercher les causes, les
manifestations et les conséquences d'un fait social de façon
à proposer une thérapeutique1(*).
Le désir de connaître a poussé notre
attention sur l'étude comparative des prévisions et
réalisations des recettes dans une régie financière. C'est
ainsi que nous avons jugé bon de mener nos recherches et vérifier
pour savoir quelles sont les prévisions et les recettes
réalisées par l'une des régies financières de la
République Démocratique du Congo qui est la Direction Provinciale
des Impôts (DPI), notre champ d'investigation. Notre souci en
élaborant ce sujet est de concilier la théorie apprise au premier
cycle d'études universitaires à la pratique, et pour tenter de
comparer la liaison existant entre les recettes et les prévisions en se
servant des informations statistiques provenant de cette dernière.
b) INTERÊT
L'intérêt de ce sujet est double, d'abord
scientifique dans la mesure où il donne une piste aux chercheurs qui
s'intéresseront aux recettes de cette régie financière en
particulier et celles des entités économiques en
général.
De plus, l'intérêt est public dans la mesure
où nous nous intéresseront aux recettes de cette régie
financière entant qu'habitant de cette ville, pour en savoir plus et
découvrir la nécessité de ces recettes, de quelle
façon elles sont utilisées dans la vie socio-économique de
la population Kanangaise en particulier et du peuple congolais en
général.
0.2. PROBLEMATIQUE ET
HYPOTHESES
a) PROBLEMATIQUE
La problématique est définie comme étant
la formulation d'un problème susceptible à l'investigation et
débouchant sur une série d'interrogations fondamentales du
chercheur sur une situation donnée qui préoccupe2(*).
Autrement dit, pour toute étude scientifique, il
s'impose la nécessité d'un questionnement faisant l'objet de
recherche. A ce propos J. BAETCHER enseigne qu'en science, la difficulté
n'est pas de trouver une série des réponses, mais de poser des
questions et de construire des axes autour desquels les matériaux
s'ordonnent3(*).
Vu l'espoir qu'a le gouvernement provincial sur la Direction
Provinciale des Impôts (DPI) en ce qui concerne la réalisation des
recettes ou ressources budgétaires, nous avons jugé utile de
procéder à l'analyse de ces recettes en cherchant de savoir s'il
y a des écarts considérables ou pas entre les recettes
réalisées et les prévisions ou assignations et
dégager les causes relatives de ces deux situations.
Eu égard à ce qui précède, nous
nous sommes posé les questions ci-après :
* Comment se présentent les recettes et les
prévisions de la Direction Provinciale des Impôts Kasaï
Occidental ?
* Y a-t-il des écarts considérables entre les
recettes et les prévisions de la Direction Provinciale des Impôts
Kasaï Occidental ?
* Au cas où il existerait des écarts entre les
recettes et les prévisions, quelles en sont les causes ?
Tout au long de ce travail, nous tenterons de répondre
à ces questions.
b) HYPOTHESE DU TRAVAIL
L'hypothèse est une idée directrice
formulée au début de la recherche destinée à guider
l'investigation et à être infirmée ou confirmée
d'après les résultats de la recherche4(*).
Elle est en fait un argument explicite aux questions que l'on
se pose au cours d'un travail, à tout chercheur de tracer une ligne de
conduite à suivre pour connaître davantage ce qu'il est
assoiffé de découvrir5(*).
De ce fait, nous disons que les recettes et les
prévisions de la Direction Provinciale des Impôts Kasaï
Occidental n'évoluent pas de la même manière.
En plus, étant donné la conjoncture actuelle, il
existerait des écarts considérables entre les prévisions
et les recettes réalisées au sein de cette régie
financière, qui est la Direction Provinciale des Impôts Kasaï
Occidental.
Ces écarts seraient causés par
l'insolvabilité des contribuables ; le détournement des
fonds par les agents chargés de recouvrement, la non réalisation
des assignations ou prévisions.
Ainsi, pour remédier à la situation :
* La conscientisation et sensibilisation des contribuables sur
le caractère obligatoire de l'impôt ;
* Le renforcement des capacités des agents de la
Direction Générale des Impôts sur l'incivisme
fiscal ;
* La révision à la hausse de la motivation des
agents.
Seraient des solutions parmi tant d'autres.
0.3. METHODES ET
TECHNIQUES
0.1.1. METHODES
Aucun travail scientifique ne peut être
élaboré sans que son auteur fasse appel aux méthodes et
techniques, et chaque méthode correspond à ses propres
techniques.
J.M MOUCHOUT et A. MOLES, définissent la méthode
comme une succession d'opérations permettant de progresser vers le but
avec maximum de chances, de succès à l'achat des
connaissances6(*).
Elle est encore une démarche à suivre pour
découvrir la vérité quand on l'ignore, ou pour la prouver
aux autres quand on la possède et ne dépend pas de la
volonté du chercheur mais des questions qu'il se pose à propos de
son sujet7(*).
Pour Benoit VERHAGEN, la méthode est un ensemble des
règles et des principes qui organisent le mouvement d'ensemble de la
communauté c'est-à-dire les relations entre l'objet de la
recherche et le chercheur, entre les informations concrètes
rassemblées à l'aide des techniques et le niveau de la
théorie et des conceptions8(*).
L'élaboration de ce travail a été rendue
possible grâce à l'utilisation des méthodes
suivantes :
a. METHODE COMPARATIVE
Antoine de Saint EXUPERY a dit ceci : « Quand
on ne sait pas ce qu'on recherche, on ne sait plus ce que l'on trouve bien que
l'on puisse trouver ce que l'on ne cherchait pas du tout9(*). »
Dans cet ordre d'idées, la méthode comparative
est celle qui, pour comprendre les faits, il faut les comparer
c'est-à-dire rechercher et expliquer les faits économiques
étudiés tout en décelant les liens de causalité ou
les facteurs de différence et de dissemblance entre les faits, mais il
faut comparer ce qui est comparable, cela veut dire les faits se trouvant dans
un même contexte culturel10(*).
Ainsi, nous disons que cette méthode nous a permis
d'opérer une comparaison entre les prévisions ainsi que les
recettes de la Direction Provinciale des Impôts (DPI) pour arriver
à faire un jugement sur ces dernières afin d'en tirer une
conclusion.
b. METHODE STATISTIQUE
Cette méthode se définit comme étant un
ensemble des données d'observation de l'activité qui consiste
dans leur recueil, leur traitement et leur interprétation11(*).
La méthode statistique est celle qui s'appuie sur la
formation des groupes, on les classe en indiquant le résultat dans des
tableaux, en utilisant les graphiques par la construction des
échantillons, rapport de mesure et la détermination des valeurs
de variables étudiées ainsi que leurs fréquences12(*).
Dans cette étude, elle nous a aidé à
présenter les différentes prévisions et
réalisations des recettes dans des tableaux pour ensuite montrer leur
évolution durant une période couverte par notre étude, en
les interprétant afin de donner une thérapeutique.
0.1.2. TECHNIQUES
Les techniques sont des instruments utilisés et
jugés nécessaires pour appréhender les problèmes
posés et collectionner les renseignements, les informations pouvant
servir à l'élaboration du travail13(*).
Les techniques ne sont au fond que des moyens utilisés
pour collecter des données.
Il existe plusieurs techniques pour recueillir les
données dont on a besoin pour mener une étude. Dans le cadre de
notre étude, nous avons fait appel à la technique documentaire et
technique d'interview libre.
a. TECHNIQUE DOCUMENTAIRE
Elle consiste à étudier et à analyser les
documents pour arriver à déterminer les faits ou
phénomènes dont les documents portent des traces14(*).
Pour élaborer ce travail, elle nous a permis
d'être précis dans certaines affirmations de nos investigations
sur terrain pour soutenir nos idées et enfin, nous a facilité la
tâche en accédant à l'information voulue par la
consultation d'une documentation préexistante.
b. TECHNIQUE D'INTERVIEW LIBRE
TALCOTT PARSONS, définit l'interview comme une
interaction verbale entre deux personnes l'une en face de l'autre en vue d'un
objectif déterminé15(*).
Grâce à cette technique, nous nous sommes
entretenus avec les agents des différentes divisions de la Direction
Provinciale des Impôts, ceux qui sont sensés détenir les
informations ayant comblé certaines lacunes observées dans les
documents écrits.
0.4. DELIMITATION DU
SUJET
Tout travail scientifique répond à une exigence
fondamentale qui veut que les contours de l'objet de la recherche soient
clairement circonscrits et perçus.
Dans l'objectif de mieux circonscrire le domaine de recherche
et préciser les contours de notre recherche, et pour mieux guider nos
lecteurs à bien nous saisir, cette circonscription est faite dans le
temps et dans l'espace.
· Dans le temps
Cette étude portera sur une période allant de
l'année 2009 à 2012. Si nous avons choisi cette période,
c'est pour la seule raison de la disponibilité des données
liées à notre étude.
· Dans l'espace
Nous avons choisi de faire une étude comparative des
prévisions et des recettes au sein de la Direction Provinciale des
Impôts, « DPI » en sigle dans la province du
Kasaï Occidental, ville de Kananga.
0.5. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Dans le souci de permettre aux lecteurs de
pénétrer la connaissance de notre travail, outre l'introduction
et la conclusion, nous avons conçu notre travail en deux grandes
parties, à savoir :
La première partie intitulée
« Approche théorique et conceptuelle » est
constituée de deux chapitres dont :
* Le premier chapitre est axé sur les
généralités. Il comprend deux sections, la
première est consacrée à la définition des concepts
et la deuxième à la présentation des théories et
notions de base utilisées dans ce présent travail.
* Le deuxième chapitre est consacré à
la présentation de notre cadre d'étude, qui est la
Direction Provinciale des Impôts/Kananga.
La deuxième partie intitulée
« Approche pratique et analyse des
données », comprend un chapitre orienté sur
l'étude comparative des prévisions et des recettes de la
Direction Provinciale des Impôts de 2009 à 2012.
0.6. DIFFICULTES
RENCONTREES
Tout travail scientifique rencontre toujours des
difficultés auxquelles le nôtre n'a pas fait exception.
Cela étant, ce dernier nous a fallu un travail de
longue haleine, la conjoncture économique actuelle très
serrée de notre pays, l'état d'enclavement de notre
contrée, l'accès difficile aux données nécessaires
à son élaboration, l'insuffisance de moyens financiers, manque de
temps nécessaire pour mener des recherches afin d'atteindre nos
objectifs, et les autres contraintes de la vie courante sont là autant
des difficultés qui ont émaillé notre étude.
Toutefois, nous avons fourni d'efforts exceptionnels en vue de mettre cette
oeuvre en place.
CHAPITRE I :
GENERALITES
Ce présent chapitre comportera deux sections, dont
l'une basée sur la définition des concepts d'une part, et d'autre
part, l'autre parlera de théories et notions de base.
Section 1 : DEFINITION
DES CONCEPTS
Pour mieux comprendre, décrire un sujet, il est normal
de saisir d'abord le sens des concepts qu'il renferme, faute de quoi toute
interprétation particulière serait source de dérapage. Car
la définition des concepts est une construction abstraite qui tend
à rendre compte de la réalité.
C'est dans cette perspective qu'Emile DURKHEIM dit :
« Le savoir doit d'abord définir son vocabulaire en vue de
faire savoir ce que réellement il dit afin d'orienter la
recherche»16(*).
Albert BRIMON ajoute que la théorie est acquise, l'intelligence ajoute
l'expérience, il s'agit d'un ensemble des propositions sur une
réalité perçue et vérifiée17(*).
A cet effet, pour éviter des malentendus, nous
définissons les concepts de base ci-après : Etude,
comparaison, prévision, réalisation, recettes et régie
financière.
I.1.1. ETUDE
Le terme « Etude » a
généralement une multitude de sens selon les relations qu'il
entretient dans la structure.
De ce fait, le terme « Etude » signifie
une activité intellectuelle par laquelle on s'applique à
apprendre, à connaître, une activité entant qu'effort
particulier d'observation, d'analyse, de compréhension pour la
réalisation d'un ouvrage d'une installation18(*).
Autrement dit, elle est une application méthodique de
l'esprit cherchant à apprendre et à comprendre ; effort
intellectuel pour acquérir des connaissances, un effort intellectuel
orienté vers l'observation et l'intelligence des êtres, des
choses, des faits.
Fondamentalement, l'étude appelle les ressources
considérables afin de fouiller, explorer, investir, découvrir la
vérité, c'est l'ensemble des travaux des articles intellectuels
qui tendent à la découverte des connaissances et des lois
nouvelles par l'existence d'un objet précis dans le domaine de savoir et
par usage d'une terminologie rigoureuse et éprouvée pour la
saisie de cet objet. Ce qui entraîne à l'étude le
caractère d'un procès autour de ces questions, quel
phénomène à résoudre ? Qui entreprend
l'investigation ? Où il entreprend ? C'est par quelle
méthodologie susceptible de conduire à une connaissance vraie,
vérifiable et communicable, aussi objective à l'étude ou
non ? Quel intérêt et apport voir le but de
l'étude ?
I.1.2. COMPARAISON
C'est le fait d'envisager ensemble (deux ou plusieurs objets
de pensée) pour en chercher les différences ou les
ressemblances.
Selon le dictionnaire universel, la
« Comparaison » est l'action de mettre en parallèle
les procédés de mise en conformité, en analogie, en
rapport de rapprochement : - les termes ; - les objets ; - les
produits ; - les services ; - les idées19(*).
Ainsi, l'étude comparative dans cette optique peut
être considérée comme l'analyse, une investigation
rigoureuse, critique et systématique menée sur un objet
précis et donnée sur base des procédés
méthodologiques permettant la saisie directe de la vérité
objective que ce qui est de la vérité objective sachant que ce
qui est comparable établit une typologie permettant l'observation des
faits, l'analyse de ressemblances et les différences.
De ce qui précède, dans le cadre conceptuel de
l'analyse économique, notre comparaison porte sur les variables
prévisions et recettes.
I.1.3. PREVISION
La prévision est une action de prévoir,
autrement dit c'est représenter à l'avance ce qui doit arriver,
ce qui est prévisible, ou encore organiser, disposer à
l'avance.
Elle est encore un processus d'identification de facteurs qui
pourront influencer de manière significative l'activité de
l'entreprise à moyen et à long terme.
I.1.4. REALISATION
La réalisation c'est l'action de réaliser, qui,
en économie veut dire vente des biens en vue de leur transformation en
monnaie. Autrement dit, c'est la vente sur le marché des marchandises
produites. C'est lorsque le producteur se confronte à la contrainte
monétaire qu'il peut transformer le capital-marchandise en
capital-argent et obtenir une part de la plus-value20(*).
I.1.5. RECETTES
Les recettes désignent les sommes perçues par
les administrations publiques provenant des impôts et des taxes. Elles
n'incluent pas les cotisations sociales21(*).
I.1.6. REGIE FINANCIERE
* Régie
C'est une gestion d'un service public qu'assurent soit des
agents nommés par l'autorité (Etat, région, etc.) et
appointés par elle (régie directe), soit une personne physique ou
morale n'en supportant pas les risques mais intéressée au
résultat d'exploitation (régie intéressée).
* Financière
C'est ce qui est relatif aux finances, qui dit finances, voit
l'ensemble des professions qui ont pour objet l'argent et ses modes de
représentation, notamment les valeurs mobilières.
Eu égard à ce qui précède, la
régie financière est l'ensemble des directions
générales du Ministère des finances chargées des
recettes : contributions directes et indirectes, douanes,
enregistrement-Douane-Timbre. Autrement dit, l'ensemble des institutions
organisées par le pouvoir public pour la mobilisation des recettes
fiscales et non fiscales.
Section 2 : NOTIONS ET
THEORIES DE BASE
I.2.1. NOTION DE
L'IMPÔT
I.2.1.1.
Définition
L'impôt est une prestation pécuniaire requise des
membres de la collectivité (personnes physiques et morales), elle est
perçue par voie d'autorité et à titre définitif,
sans contrepartie, en vue de la couverture des dépenses
publiques22(*).
I.2.1.2. CARACTERES DE
L'IMPÔT
De cette définition, il ressort trois caractères
de l'impôt, à savoir :
ü Caractère pécuniaire ;
ü Caractère obligatoire et forcé ;
ü Absence d'une contrepartie visible.
a. Caractère
pécuniaire
Par ce caractère, on comprend que l'impôt se paie
en argent et en espèce, et non en nature.
b. Caractère obligatoire et
forcé
Comme le mot l'indique « impôt »
c'est-à-dire imposer, imposition ; l'impôt exclut l'accord du
contribuable, l'impôt est donc une contrainte, il réside dans la
souveraineté de l'Etat. C'est qui signifie pour le contribuable
l'appellation « d'assujettis » (soumis).
En plus, le caractère forcé de l'impôt se
manifeste beaucoup plus dans la fixation du tarif de l'impôt qui est
unilatérale et son recouvrement opéré par la force.
c. Absence d'une contrepartie
visible
Dans ce cas, il n'y a aucune corrélation visible et
bien déterminée entre l'impôt et le service de l'Etat dont
bénéficie le contribuable. C'est là où
réside d'ailleurs la différence entre l'impôt et la
taxe.
I.2.1.3. LES PRINCIPES DE
L'IMPÔT
Nous avons trois principes de l'impôt, à
savoir :
ü Le rendement ;
ü L'égalité ;
ü L'intervention.
a. Le rendement
L'impôt est institué dans le but de fournir des
ressources à l'Etat. En effet, les ressources fiscales restent les plus
importantes dont doit disposer un Etat. Les ressources fiscales doivent couvrir
au moins 60% du budget ; si non l'Etat connaîtra de sérieuses
difficultés de financement de l'action gouvernementale. Pour cela, il
faut que l'impôt ait un bon rendement qui est fonction d'un certain
nombre des critères tes que :
ü L'universalité ;
ü La certitude ;
ü L'absence de fraude ;
ü La modernisation du taux ;
ü La stabilité.
1°) L'universalité
Ici, l'impôt est payé partout sur toute la
matière imposable ; ce qui exclut de privilèges d'exemption.
Toutefois, suivant la politique du gouvernement en rapport avec la conjoncture
économique, une partie de la matière imposable peut être
exemptée de l'impôt ; pour cela, il faut au préalable
une décision gouvernementale par le biais du Ministre des finances.
2°) la certitude
L'impôt auquel est assujetti le contribuable doit
être certain et donc non arbitraire. Pour cela, il faut indiquer d'avance
et, à l'intention du contribuable :
ü L'époque : sur quelle période porte
l'impôt, et quand sera-t-il payé ?
ü Le mode de paiement : Comment l'impôt sera
payé (par voie bancaire, au guichet de l'administration fiscale,
etc.)
ü La quantité : Quel est le taux
d'imposition ?
3°) L'absence de fraude
Le contribuable peut échapper à l'impôt
par la fraude, une fois que la fraude est constatée, le contribuable
s'expose à des sanctions car la fraude constitue en elle-même une
infraction par le fait que l'impôt est fixé par une loi : la
loi financière.
4°) La modernisation du taux
Il faut toujours observer une certaine limite dans la fixation
de taux d'imposition, car au-delà d'un certain taux, l'impôt
devient confiscatoire et incite le contribuable à réduire son
activité, et par conséquent la matière imposable.
D'où diminution des recettes fiscales.
A ce sujet, le professeur LAFFER a préconisé la
politique de taux d'imposition horizontale en lieu et place de taux vertical
qui verse souvent les gens dans l'informel23(*). Selon lui, pour maximiser les recettes fiscales,
l'Etat doit diminuer au minimum possible le taux d'imposition tout en
élargissant la manière imposable ; car les contribuables ne
sentent pas le poids de l'impôt et auront par conséquent
intérêt à exercer dans le circuit économique
formel.
5°) La stabilité
Un impôt est dit stable lorsqu'il ne subit pas
constamment les variations de la conjoncture, c'est-à-dire si son
rendement est le même en période de prospérité qu'en
période de récession.
b. Le principe
d'égalité
Ce principe veut que l'impôt soit réparti suivant
les capacités contributives de chaque citoyen. En d'autres termes, il
faut tenir compte de la situation personnelle du contribuable, c'est ce qu'on
appelle la personnalisation de l'impôt.
On peut personnaliser l'impôt par :
· L'abattement à la base : c'est une
réduction générale appliquée à tous les
contribuables, quelle que soit l'importance des revenus et qui correspond au
minimum vital. Ce minimum vital représente le revenu qu'il faut à
un individu pour vivre. Il est souvent déterminé par une loi.
En effet, si le minimum vital est fixé à
30.000FC, les personnes dont le revenu annuel est inférieur ou
égal à 30.000FC ne paient rien.
· La prise en considération des charges
familiales : il faut tenir compte de la situation familiale du
contribuable (célibataire, marié, père de
famille,...) ; car les dépenses de première
nécessité sont plus importantes pour un père de famille,
un marié, que pour un célibataire.
· La progressivité de
l'impôt : qui fait augmenter le taux d'imposition au fur et
à mesure que les revenus augmentent. Il faut toujours observer une
certaine limite dans la progressivité de l'impôt au-delà
d'un certain taux (60 à 70%) du contribuable. Dans ce cas, l'impôt
progressif au lieu d'être équitable, devient injuste.
c. Le principe d'interventionnisme
Préconisé par M. DUVERGER, le principe
d'interventionnisme de l'impôt est, selon lui, un principe qui
établit une véritable égalité dans sa politique, le
gouvernement peut utiliser l'impôt (politique fiscale) pour orienter
l'activité nationale dans telle ou telle direction selon qu'on est en
prospérité ou en récession. Il est donc un
procédé efficace d'intervention dans la vie économique et
sociale.
Il existe trois sortes d'interventionnisme :
ü L'interventionnisme par pression ou par
dépression ;
ü L'interventionnisme par discrimination ;
ü L'interventionnisme par redistribution.
1°) L'interventionnisme par pression ou par
dépression
Le premier (la pression) est utilisé en temps de
prospérité surtout quand la prospérité
dégénère en emballement ; le gouvernement peut
utiliser une politique d'imposition lourde dans le but de temporiser
l'activité économique.
Le second (dépression) est utilisé en temps de
crise. Elle consiste à diminuer de manière sensible le poids
général des impôts afin d'alléger l'économie
dont l'effet d'entraînement se traduit en conditions favorables à
la reprise.
2°) L'interventionnisme par
discrimination
L'Etat peut encourager ou décourager une ou une autre
activité économique par le mécanisme de l'impôt en
augmentant ou en diminuant le taux d'imposition d'un impôt bien
déterminé.
3°) L'interventionnisme par redistribution
Dans ce cas, l'Etat ampute (retranche) les gros revenus et
utilise le produit obtenu à augmenter les subventions aux revenus
faibles c'est ce qu'on appelle intervention à but égalitariste
dont l'objectif est d'égaliser le niveau de vie des citoyens et
redistribuer la richesse entre eux.
I.2.1.4. LES ASPECTS DE
L'IMPÔT
Nous parlerons sur deux aspects, qui sont : l'aspect
économique et social
ü Sur l'aspect
économique :
Les impôts ont une influence sur la vie
économique, car ils augmentent le coût de la vie par le fait
qu'ils sont incorporés dans les coûts et le prix de revient. Par
conséquent, il y aura diminution de pouvoir compétitif des
entreprises spécialement touchées d'une part, et d'autre part les
impôts constituent un moyen efficace de la politique économique du
gouvernement. Car, des exonérations accordées à certains
exportateurs tels que les agriculteurs ou l'imposition des certains
importateurs dans le but de protéger les produits locaux. Enfin,
l'imposition exagérée (atteignant 70 à 80% de
bénéfice) décourage les investisseurs et risque
d'entraîner la fuite des capitaux.
ü Sur l'aspect social :
Socialement l'impôt permet la redistribution des revenus
c'est le cas par exemple des subventions que l'Etat peut accorder aux
chômeurs qui sont sans revenu la prise en compte des charges familiales,
etc.
I.2.1.5. SORTES
D'IMPÔTS
On distingue plusieurs sortes d'impôts, mais dans cette
étude nous tenterons de donner une explication de quelques-uns,
notamment :
1. Impôt direct et indirect
Un impôt est dit direct lorsqu'il frappe directement le
revenu ou la fortune du contribuable. En d'autres termes, c'est un impôt
qui est payé directement à l'administration du trésor par
le contribuable. C'est le cas de l'impôt sur le revenu professionnel,
impôt foncier, impôt sur la cession, etc. sont par exemple des
impôts directs.
Par contre, l'impôt est dit indirect, lorsqu'il frappe
la consommation du contribuable c'est-à-dire l'usage fait de son revenu
et donc la dépense. C'est l'impôt sur le chiffre d'affaire, le
droit de douane et assise. En d'autres termes, c'est un impôt qui est
répercuté sur un autre agent économique par celui qui le
verse. Les impôts sont donc payés au fisc par un redevable qui ne
joue qu'un rôle d'intermédiaire.
Il convient de noter que l'impôt direct tient compte du
revenu ou de la fortune du contribuable (riche ou pauvre) contrairement
à l'impôt indirect qui frappe les riches et les pauvres de la
même façon.
2. Impôt global et impôt
cédulaire
Un impôt est dit global lorsqu'il frappe en bloque la
totalité du revenu du contribuable, on l'appelle souvent impôt
synthétique ; tandis que les impôts cédulaires
frappent chacun une catégorie distincte des revenus de manières
différentes.
3. Impôt réel et impôt personnel
L'impôt réel est celui qui porte sur la chose et
prend en compte uniquement la matière imposable sans tenir compte de la
personne du contribuable (riche ou pauvre, célibataire ou marié,
parent ou sans enfant), c'est le cas de l'impôt foncier.
L'impôt est dit personnel lorsque son taux varie en
fonction de la situation personnelle et ou familiale du contribuable, c'est le
cas de l'impôt sur le revenu professionnel, impôt sur les
successions.
4. Impôt proportionnel et impôt
progressif
Un impôt est proportionnel lorsqu'il atteint la
matière imposable suivant un taux. Sa proportionnalité se situe
entre le montant de l'impôt et le revenu du contribuable. En d'autres
termes, c'est un impôt dont le taux est fixe et dont le montant est
proportionnel au montant de l'assiette de l'impôt.
L'impôt est progressif lorsque son taux augmente au fur
et à mesure que les revenus du contribuable deviennent importants. Dans
ce cas, l'accroissement de l'impôt est plus que proportionnel à
celui de matière imposable. En d'autres termes, c'est un impôt
dont le taux augmente avec le montant de l'assiette de l'impôt.
Eu égard à ce qui précède, les
impôts gérés par la Direction Générale des
Impôts sont :
* Les impôts réels : de ces impôts
nous pouvons citer :
ü Impôt sur la superficie des
propriétés foncières bâties et non
bâties ;
ü Impôt sur les véhicules ;
ü Impôt sur la superficie des concessions
minières et d'hydrocarbures.
* Les impôts cédulaires sur les revenus, tels
que :
ü Impôts sur les revenus locatifs ;
ü Impôt mobilier ;
ü Impôt sur les revenus professionnels (impôt
sur les bénéfices et profits, et impôts professionnels sur
les rémunérations).
* Impôt exceptionnel sur les rémunérations
des expatriés (I.E.R.E)
* Impôt sur le chiffre d'affaires à
l'intérieur.
En plus des impôts cités ci-haut, la Direction
Générale des Impôts recouvre aussi les factures
émises par le Gouvernement, les entreprises et les services publics qui
sont rendues exigibles par elle.
De ce fait, conformément à la Constitution de la
République Démocratique du Congo, spécialement en son
article 204 point 16, il y a les impôts qui relèvent de la
compétence des provinces, sont entre autres : l'impôt
foncier, l'impôt sur les véhicules, l'impôt sur les revenus
locatifs, etc.
I.2.2. NOTION DES RECETTES ET PREVISIONS
I.2.2.1. NOTION DES
RECETTES
A. DEFINITION
Ce mot « recette » désigne
l'ensemble des perceptions que reçoit tout entrepreneur d'une
manière générale.
B. SORTES DES RECETTES
1°) RECETTES AU SENS
FISCAL
a. Les recettes fiscales
Elles désignent les sommes perçues par les
administrations publiques provenant des impôts et des taxes sans inclure
les cotisations sociales.
En d'autres termes, sont des impôts directs, des
impôts indirects et de toutes taxes de nature fiscale lesquels sont
gérés par les administrations dont la dénomination
s'emprunte aux matières qu'elles gèrent. Ces recettes sont
ordonnancées et recouvrées par la Direction
Générale de Douane et Accise (DGDA) et la Direction
Générale des Impôts (DGI).
b. Les recettes parafiscales
Sont les sommes des taxes parafiscales qui sont des
prélèvements opérés sur les usagers par certains
organismes (publics ou semi-publics, économiques et sociaux), en vue
d'assurer leur financement autonome. C'est le cas de cotisations versées
à la sécurité sociale, généralement
gérées en RD Congo par l'Institut National de
Sécurité Sociale (INSS).
2°) RECETTES AU SENS
ECONOMIQUE
Elles désignent les sommes encaissées par les
producteurs à la suite de la vente des produits obtenus en combinant des
facteurs de production (Nature, travail et capital). En d'autres termes, est un
montant égal au prix de vente obtenu par chaque unité vendue.
D'où la recette totale s'obtient en multipliant le nombre
d'unités vendues par le prix unitaire.
a. LA RECETTE MARGINALE ( Rm
)
Est la variation de la recette entraînée par la
vente d'une unité supplémentaire d'un bien. Autrement dit, celle
procurée par la dernière unité de produit vendue. Elle est
une dérivée de la recette fiscale, en concurrence parfaite ;
la recette marginale égale la recette moyenne qui est le prix par
unité du produit24(*).
La recette marginale est différente de la recette
moyenne, sa pente est deux fois plus élevée que celle de la
recette moyenne. Elle décroît lorsque les quantités vendues
augmentent.
Formule mathématique : Rm= 
 Cfr. Figure 2
Cfr. Figure 2
Avec Rm : Recette Marginale

 : Variation des Recettes
: Variation des Recettes

 : Variation des Quantités.
: Variation des Quantités.
b. LA RECETTE MOYENNE ( RM )
Est le rapport entre la recette totale et la quantité
des produits vendus. Elle est égale au prix de vente par unité de
produit. En concurrence parfaite, la recette moyenne pour une unité de
production est indépendante des quantités (sa droite est
parallèle à l'axe des abscisses) pour toute forme de
marché. La recette moyenne désigne la fonction de demande par
conséquent elle est une fonction décroissante25(*).
Tout accroissement des quantités entraînerait une
baisse de la recette moyenne à une valeur représentant la
moitié de celle de la pente marginale.
Mathématiquement : RM= 
 Cfr. Figure 2
Cfr. Figure 2
Avec RM : Recette Moyenne
RT: Recette Totale
Q : Quantité.
c. LA RECETTE TOTALE ( RT )
Est le produit de la recette marginale des biens et services
par la quantité vendue. En concurrence parfaite, pour une unité
de production. La recette totale est une fonction des quantités
vendues.
Pour autre forme de marché et pour l'ensemble des
entreprises, la recette totale tend vers une fonction parabolique. On
vérifie alors que la recette marginale est une pente deux fois plus
élevée que celle de la recette moyenne.
Mathématiquement : RT =
 x Q Cfr. Figure
1
x Q Cfr. Figure
1
Avec 
 : Revenu
: Revenu
Q : Quantité
RT : Recette Totale
Ainsi, graphiquement la situation se présente comme
suit :
251657728
251658752Q
251653632Rm
251652608
I.2.2.2. PREVISIONS
A. DEFINITION
Pour P.G BERGERON, la prévision est une activité
qui permet à un gestionnaire d'utiliser les renseignements
présents et futurs pour préciser le milieu dans lequel
l'entreprise fonctionnera26(*).
En d'autres termes, c'est le fait de connaître à
l'avance par certaines estimations, le but à atteindre, les actions
à entreprendre ainsi que la participation des responsables à cet
effet.
Il s'agit d'une étude préalable de la
décision, de la possibilité et de la volonté de
l'accomplir. Du point de vue de la gestion, la prévision se
conçoit à la fois comme une attitude volontariste, scientifique
et collective face à l'action future.
B.NATURE DE LA PREVISION
1°) PREVISION ATTITUDE
VOLONTARISTE
Il faut entendre par là que la prévision doit
être l'expression d'une politique d'un choix
délibéré, d'un pari qui se traduit par un engagement, une
anticipation sur l'avenir.
2°) PREVISION ATTITUDE
SCIENTIFIQUE
Dans ce cas, la prévision fait rarement appel à
l'intuition et au flair. Elle utilise plutôt la méthode
scientifique pour sa rigueur et sa confection. La prévision est
basée sur des méthodes statistiques, mathématiques, et
économiques.
3°) PREVISION ATTITUDE
COLLECTIVE
Dans cet ordre d'idées, la prévision n'est pas
l'affaire de seuls dirigeants. Elle requiert plutôt le concours de tous
les membres de l'entreprise. Chacun à son niveau y apporte sa
contribution et s'engage sur base du programme auquel il a participé.
C. LES DOMAINES DE LA
PREVISION
La prévision porte généralement sur
plusieurs domaines, notamment :
· L'évolution économique :
ici, la prévision est faite sur base des conditions économiques
locales, nationales et mondiales (par exemple le cours de matière
première et du carburant, le taux d'inflation, etc.)
· L'évolution technologique : les
prévisions sur le lancement de nouveaux produits sur le marché,
les innovations technologiques, etc.
· L'évolution de la concurrence :
ici les prévisions sont les informations les plus précises
concernant les activités, les ressources, les moyens et autres aspects
des concurrents les plus immédiats et les plus importants.
· L'évolution de la santé.
D. SORTES DES PREVISIONS
Maxime CRENER et MONTELLE, distinguent plusieurs types des
prévisions, à savoir :
ü La prévision par comparaison ;
ü La prévision par extrapolation ;
ü La prévision cyclique ;
ü La prévision par assignation ;
ü La prévision par analogie.
E. DIFFERENCIATION DE LA
PLANIFICATION
L'usage populaire est abusif de ce concept afin qu'il soit
confondu avec celui de planification. Elle est une étape
réflexive située au départ de toute planification :
la prévision prépare l'action. C'est ainsi que plusieurs auteurs
la qualifient de définition mentale de début, objectif et
d'autres procédures qui seront rendus réalisables par le plan.
Dans le cas échéant, elle apparaît comme
une représentation, imagination ou estimation loin d'être utopique
que l'Etat espère en contribution budgétaire pour un exercice
déterminé.
I.2.3. NOTION SUR L'ANALYSE DES
SERIES TEMPORELLES
I.2.3.1. SERIES
TEMPORELLES27(*)
On appelle série temporelle, série chronologique
ou, simplement chronique, une suite d'observations ordonnées dans le
temps, habituellement à intervalles égaux.
La production annuelle d'acier considérée sur
plusieurs années, le cours journalier des titres en bourse, la suite des
températures horaires communiquées par la
météorologie nationale, le décompte mensuel des ventes
dans un magasin, sont des exemples de séries temporelles.
Une série temporelle est définie
mathématiquement par les valeurs Y1, Y2,... d'une
variable Y (température, cours journalier de clôture d'une action,
etc.) à des temps t1, t2,..
Y est aussi une fonction du temps désignée par
Y=F(t)
I.2.3.2. GRAPHES DES SERIES
TEMPORELLES
On a une bonne image d'une série temporelle Y en
construisant le graphe de la variable Y en fonction du temps.
I.2.3.3. MOUVEMENTS
CARACTERISTIQUES D'UNE SERIE TEMPORELLE
Il est important d'observer que le graphe d'une série
temporelle, qui est décrit pour un point qui se déplace dans le
temps, de la même manière qu'une particule physique se
déplace sous l'influence de forces physiques. Mais, au lieu d'être
animé par des forces physiques, le mouvement peut être dû
à une combinaison de forces économiques, Sociologiques, ou
autres.
A travers de nombreux exemples, les séries temporelles
ont révélé un certain nombre de mouvements ou de
variations caractéristiques dont certains ou même tous se
manifestent des degrés variés. L'analyse de tels
mécanismes est très importante pour de nombreuses raisons, l'une
d'elles étant de pouvoir prévoir les variations futures. Il n'est
donc pas surprenant que beaucoup d'industries et d'organismes gouvernementaux
soient très intéressés par cet important problème.
I.2.3.3.1. CLASSIFICATION DES
MOUVEMENTS DES SERIES TEMPORELLES
En première approximation, on peut dire que tout
mouvement économique d'ensemble, s'il est observé sur une
série statistique assez longue, paraît composé de quatre
mouvements :
1. Le mouvement de longue durée (appelé aussi
trend en tendance générale) qui se maintient pendant de longues
années : développement continu d'une production, hausse de
longue durée des prix ou au contraire recul prolongé (exemples
opposés : production d'électricité, navigation par
voiliers) ;
2. les mouvements cycliques, résultant de l'alternance
de phases de prospérité et de dépression ;
3. les mouvements saisonniers, ou plus
généralement, périodiques. La périodicité
qui est le plus fréquemment annuelle, résulte d'influences
naturelles (récoltes) ou institutionnelles (fêtes, etc.) ;
4. les mouvements accidentels, n'obéissant à
aucun rythme, mais dus à des événements
exceptionnels : grève, guerre, panique, des inondations,
élections, etc.
I.2.3.4. L'ANALYSE DES
SERIE TEMPORELLES
L'analyse d'une série temporelle consiste à
faire une description (mathématique en général) des
« mouvements » qui la composent ; afin de justifier
les méthodes sur lesquelles on s'appuie pour une telle description.
La figure (a) ci-dessous montre une droite de tendance
à longue durée ou séculaire. La figure (b) montre cette
droite avec un cyclique (superposé périodique). la figure(c)
montre le mouvement saisonnier si l'on avait superposé des
mouvements accidentels au graphe de la figure (c), le résultat
correspondrait avantage à une série temporelle telle qu'on en
trouve dans la pratique.
0
Q
251654656RT
0
251655680
Fig. (1)
Fig. (2)
251656704
Les idées précédentes fournissent une
technique possible pour analyser les séries temporelles. on suppose
que la variable Y de la série temporelle est le produit de
variables T,C,S et A correspondant respectivement à la tendance,
à des mouvements cycliques, saisonnier et accidentel.
On écrira Y= T x C x S x A = TCSA
L'analyse de la série temporelle consiste à
rechercher les facteurs T, C, S, et A, et à considérer qu'ils
sont les composantes de base de la série.
On notera que certains statisticiens préfèrent
considérer Y comme la somme T+C+S+A. on choisira la meilleure
décomposition qui conduit au meilleur résultat.
I.2.3.5. LES MOYENNES MOBILES
I.2.3.5.1. LISSAGE DES SERIES
TEMPORELLES
Soient Y1, Y2 , Y3.....,
Yn un ensemble des nombres. on définit une moyenne
mobile d'ordre n que l'on obtient par la suite des moyennes
arithmétiques.

 ,
,
 ,
, 
 , (2)
, (2)
Les sommes des numérateurs sont appelées totaux
mobiles d'ordre n.
Exemple : Soient les nombres 2, 6, 1, 5, 3, 7, 2
La moyenne mobile d'ordre 3 est obtenue comme suit

 ,
,
 ,
, 
 ,
, 
 ,
, 
 ou encore 3 ; 4 ; 3 ; 5 ; 4
ou encore 3 ; 4 ; 3 ; 5 ; 4
Dans une moyenne mobile, il est commode de localiser chaque
nombre à sa position relative par rapport aux données
d'origine.
Ainsi, dans cet exemple, on écrira :
Données d'origine 2,6, 1, 5, 3, 7, 2
Moyenne mobile d'ordre 3 3, 4, 3, 5, 4
Quand les données sont annuelles ou mensuelles, les
moyennes prennent respectivement les noms de moyennes mobiles sur n
années ou n mois. On parle ainsi de moyenne mobile sur 5 ans, de moyenne
mobile sur 12 mois, etc. Toute autre unité de temps peut être
utilisée.
Les moyennes de mouvement ont tendance à
« amortir » les variations entre les données. Ainsi,
dans le cas des séries temporelles, on utilise souvent cette
propriété pour éliminer des fluctuations
indésirables. Le processus est alors dénommé lissage des
séries temporelles.
Si on recourt aux moyennes arithmétiques
pondérées dans (2), les poids doivent être
spécifiés à l'avance, la suite obtenue sera appelée
moyenne pondérée d'ordre n.
Exemple : Supposons que dans l'exemple
précédent l'on prenne les poids 1, 4, 1. la suite serait

 ,
, 
 ,
,
 ,
, 
 ,
, 

Ou 4, 5 ; 2, 5 ; 4 ; 5, 5 donne une moyenne de
mouvement pondéré d'ordre 3.
I.2.3.6. ESTIMATION DE LA
TENDANCE
La tendance peut être estimée de plusieurs
manières :
1.La méthode de moindres carrés vue
précédemment. Cette méthode permet de déterminer
l'équation de la droite ou de la courbe de tendance appropriée. A
partir de cette équation, on peut calculer les valeurs de T de la
tendance.
2. La méthode graphique, qui consiste à ajuster
une droite ou une courbe de tendance en se référant simplement
à son graphe, permet d'estimer T. cette méthode a
l'inconvénient d'être trop subjective.
3. La méthode de la moyenne mobile. Les moyennes
mobiles d'ordre approprié permettent d'éliminer les
modèles cycliques, saisonniers et accidentels et de ne conserver que
l'effet de la tendance. Un inconvénient de cette méthode est que
les données de début et de fin d'une série
sont « perdues ». Ainsi, dans le premier exemple, on
est parti d'un ensemble de 7 nombres, et au moyen d'une moyenne mobile d'ordre
3 on a obtenu 5 nombres. Un autre inconvénient est que les moyennes
mobiles peuvent engendrer des cycles ou d'autres mouvements qui
n'étaient pas présents dans les données d'origine. Enfin,
un troisième inconvénient est dû au fait que les moyennes
mobiles sont fortement affectées par les valeurs
« aberrantes » accidentelles.
4. La méthode des semi-moyennes consiste à
séparer les données en deux parties (de préférence
égale) et à faire la moyenne des données dans chaque
groupe.
On obtient ainsi deux points du graphique de la série
temporelle. On trace alors une droite de tendance entre ces deux points, ce qui
permet de déterminer les valeurs de la tendance. On peut aussi
déterminer les valeurs sans intermédiaire du graphique.
Bien que cette méthode soit simple à appliquer,
elle peut conduire à des résultats sans valeurs quand elle est
utilisée à tort et à travers. C'est pourquoi, bien qu'elle
soit valable dans le cas où les données peuvent être
classées en plusieurs groupes dans chacun desquels la
tendance est linéaire, elle n'est applicable que là
où la tendance est linéaire ou approximativement
linéaire.
I.2.3.7. ESTIMATION DES
VARIATIONS SAISONNIERES (INDICE SAISONNIER)
Les variations saisonnières sont définies par
Dugé de Bernouwille comme « les variations qui tendent
à se reproduire d'une manière régulière chaque
année sous l'influence des phénomènes naturels
périodiques dus au retour des saisons ou par l'effet de certains
règlements, de certaines coutumes et en général toutes
les variations dont le rythme se renouvelle dans une période
égale ou inférieure à un an ».
La variation saisonnière est importante sous trois
optiques :
1) Elle est différente à des stades successifs
du processus de production. Par exemple, pour les céréales, la
récolte a lieu l'été, les livraisons de blé
à la meunerie ont une pointe saisonnière en autonome et la
consommation de pain est à peu près égale à tout le
long de l'année.
Pour bien des produits industriels, au contraire, la
production est plus régulière (sauf Août= congés
payés) et c'est la demande qui connait des variations
saisonnières accusées : demande d'automobiles, de postes de
radio, de chocolat, etc.
2) La fluctuation saisonnière masque à
l'observateur superficiel le mouvement économique réel : en
autonome, le trafic ferroviaire augmente. seule la connaissance exacte de la
variation saisonnière permettra de savoir si le trafic de tel mois de
septembre bien qu'en hausse par rapport à Août signifie maintien
ou recul de l'activité.
L'augmentation de chômage au cours de l'hiver est
encore un autre exemple de phénomène saisonnier
intéressait.
3) La variation que nous retrouvons
régulièrement peut, dans des périodes
d'instabilités économiques, être le point de départ
d'un mouvement tout différent : la variation saisonnière
donne l'impulsion à un autre mouvement.
Un dernier exemple fera encore ressortir l'importance de la
connaissance des variations saisonnières. Après la fin de la
guerre, à l'époque de la taxation et du rationnement, les
pouvoirs publics avaient fixé un prix uniforme du lait d'un bout de
l'année à l'autre. Cette politique jouait en 1945-1947 comme une
pénalité à l'encontre des producteurs, au moment où
le lait est plus rare et au moment où les concurrences dans l'emploi du
lait étaient plus vives : élevage des veaux, beure au
marché noir etc. une politique de prix ignorant la fluctuation
saisonnière organise la disparition du produit.
* PRECAUTIONS PREALABLES
Parmi les nombreuses méthodes de calcul, nous ne
retiendrons que les plus simples. Il faut donc :
1. S'assurer qu'un mouvement saisonnier existe, par exemple en
superposant sur un graphique portant les mois de Janvier à
Décembre, les données relatives aux différentes
années.
2. Voir si cette variation saisonnière est
déformée par le mouvement de longue durée : un trend
ascendant ou descendant dispersera sur le graphique les courbes
représentatives de chaque année.
3. Voir si la variation saisonnière est additive ou
multiplicative, en d'autres termes si elle semble s'ajouter à la
tendance longue auquel cas la séparation des deux mouvements se fera par
simple différence ou si elle semble proportionnelle à le
tendance longue auquel cas il faudra faire le rapport entre les deux
mouvements et calculer un écart saisonnier.
CALCUL DE LA VARIATION SAINNIERE PAR LES MOYENNES
MOBILES
C`est la méthode la plus utilisée.Rappelons le
procédé.
La période du mouvement saisonnier étant de
douze mois, nous calculons la moyenne mobile sur douze mois. Pour centrer le
résultat sur le milieu de l'année (15 juillet), on est
amené à faire la somme sur un nombre impair de mois (13) et pour
éviter qu'un mois ne soit compté deux fois, on pondère
pour ½ les deux mois extrêmes.
ESTIMATION DE LA VARIATION SAISONNIERE PAR LA METHODE
DES RAPPORTS A LA MOYENNE MENSUELLE
Elle ne doit être employée que dans le cas
où la tendance longue est stationnaire.
CALCUL DE LA VARIATION SAISONNIERE PAR LA METHODE DES
RAPPORTS AU « TREND »
C'est le même que le précèdent. Mais si le
« trend » est ascendant ou descendant, le rapport se fait
non plus à la moyenne mensuelle de chaque année, mais au trend
précédemment calculé.
Exemple : Immatriculation des voitures automobiles en
Lidurie.
CHAPITRE II :
PRESENTATION DE LA DIRECTION PROVINCIALE DES IMPÔTS KASAÏ
OCCIDENTAL
II.1. LOCALISATION
La Direction Provinciale des Impôts du Kasaï
Occidental, en sigle DPI/K.OCC, est située au n°236 au croisement
des avenues Kasa-vubu et Guillaume LUBAYA, quartier Malandji, commune urbaine
de Kananga, ville de Kananga, province du Kasaï Occidental.
Elle a pour raison d'efficacité éloignée
deux de ses services dont l'un est situé au Rez-de-chaussée de
l'immeuble IMMO-Kasaï et l'autre sur le Boulevard de Laurent
Désiré KABILA, dans la commune de Kananga à
proximité de la gare centrale de la SNCC.
II.2. APERÇU
HISTORIQUE
La Direction Provinciale des Impôts du Kasaï
Occidental est l'un des services opérationnels de la Direction
Générale des Impôts, en sigles DGI, dont le siège
principal et l'administration centrale se trouvent à Kinshasa.
Cela étant, sa législation fiscale nationale se
fonde essentiellement sur les Ordonnances-lois n°69-006, 69-007 et 69-009
du 10 février 1969 ainsi que sur celle n°69-058 du 05
décembre 1969 relatives respectivement à l'impôt
réel, à l'Impôt Exceptionnel sur les
Rémunérations des Expatriés, aux impôts
cédulaires sur les Revenus et à l'impôt sur le chiffre
d'affaires.
De ce fait, cette dernière a connu des grands moments
forts de son histoire sur le plan structuro-administratif, gestionnaire et
législatif, nous citons :
De 1960 à 1988 : elle était sous la
tutelle du Ministère des Finances mais sans autonomie financière.
En province, elle dépendait de la Division des Finances qui était
la structure de gestion, mais laquelle n'a plus répondu au
développement technique moderne de la fiscalité et n'a pas
réussi la mobilisation et la maximisation du Trésor Public selon
les attentes du Gouvernement.
En 1988 : fut créée la Direction
Générale des Contributions, en sigle DGC, conformément
à l'Ordonnance-loi n°88/089 du 10 mars 1988 ayant une autonomie
financière et administrative dont la mission principale était de
mobiliser et de maximiser les recettes de l'Etat. Celle-ci est
créée en application de l'Ordonnance-loi n°89-100 du 12 mai
1989 fixant l'organisation et le cadre organique de la Direction Provinciale
des Impôts, mais avant cela, l'Ordonnance-loi n°88-039 du 10 mars
1988 créait déjà ses services publics qui doivent plus
tard être modifiés et complétés par le Décret
n°017/2003 et 18/2003 du 02 mars 2003.
De 2003 à nos jours : cette période est
marquée par des grandes mutations dont notamment le remplacement du
concept « Contribution » par celui
d' « Impôt » pour justifier le caractère
coercitif dans la manière de recouvrir les redevances de l'Etat.
Ces mutations ont été entérinées
par le Décret-loi n°04/099 du 30 décembre 2004 et tout son
personnel a été injecté dans la nouvelle Direction
Générale des Impôts, et ses structures changèrent
aussi28(*).
II.3. MISSION
La mission dévolue à la Direction Provinciale
des Impôts du Kasaï Occidental à l'instar des autres
Directions Provinciales est la suivante :
ü Exercer sa compétence en matière des
ressources humaines, de gestion budgétaire et services
généraux et d'information ;
ü La coordination et le suivi des activités des
services extérieurs en matière de gestion des dossiers uniques,
de contrôle fiscal, de recouvrement et de contentieux fiscal.
Cette dernière accomplie cette mission avec l'appui des
services extérieurs qui sont sous sa gestion
dénommé : les Centres des Impôts et les Centres
d'Impôts Synthétiques (CIS), autrefois appelés
« Ressorts de type A et B ».
II.4. ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET FONCTIONNELLE
Par l'application des dispositions de l'article 5 du
Décret n°0178/2003 portant création de la DGI, la Direction
Provinciale des Impôts du Kasaï Occidental est une des Directions
opérationnelles au niveau de la province et hiérarchiquement
soumise à l'autorité du Directeur Général.
C'est-à-dire qu'au sommet de la Direction Provinciale des Impôts
du Kasaï Occidental, se trouve un Directeur Général, une
inspection de service, les 8 Divisions ainsi que les Centres
Synthétiques des Impôts du type A et B, et les Centres des
Impôts urbains.
En ce qui concerne la Direction Provinciale des Impôts
du Kasaï Occidental, elle compte en son sein : les Centres urbains de
Kananga I, Kananga II, Tshikapa, Kamonia, Ilebo, Mweka, Luebo, Kazumba, Dibaya,
Luiza, Dimbelenge et celui de Dekese en phase expérimentale.
Ces centres des impôts sont chargés de la
gestion de l'ensemble des opérations fiscales auprès des
entreprises, des personnes physiques ou morales, sélectionnées
suivant les critères définis par la Direction
Générale.
Ils s'occupent notamment de la tenue des dossiers uniques (du
contrôle fiscal) du recouvrement et du contentieux de ces entreprises en
ce qui concerne tous les impôts et certains droits relevant de la
compétence de la Direction Générale des Impôts.
Jadis appelés « quartiers
fiscaux », les Centres d'Impôts Synthétiques (CIS)
sont chargés de la gestion des contribuables répondant aux
critères définis par la Direction Générale.
Ces centres fiscaux sont gérés par les cadres de
commandement et dépendent directement du Directeur Provincial, et sont
situés dans les communes et autres localités de la province du
Kasaï Occidental en fonction du potentiel fiscal qui s'y trouve.
Ainsi, nous pouvons les représenter comme
suit :
|
N°
|
DESIGNATION/ CENTRESDES IMPÔTS
|
TYPE DE CENTRE
|
|
1
|
CIS Kananga I
|
A
|
|
2
|
CIS Kananga II
|
A
|
|
3
|
CIS Tshikapa
|
A
|
|
4
|
CIS Ilebo
|
A
|
|
5
|
CIS Kamonia
|
A
|
|
6
|
CIS Luebo
|
B
|
|
7
|
CIS Luiza
|
B
|
|
8
|
CIS Demba
|
A
|
|
9
|
CIS Dibaya
|
B
|
|
10
|
CIS Mweka
|
B
|
|
11
|
CIS Kazumba
|
B
|
|
12
|
CIS Dimbelenge
|
B
|
|
13
|
CIS Dekese (en phase expérimentale)
|
B
|
Source : Archives de la DPI/Kasaï Occidental, 2012.
Chacun d'eux participent à la mobilisation des recettes
et à sa maximisation dans la situation globale de la province. Ils
constituent des services extérieurs sous la gestion de la Direction
Provinciale des Impôts/Kasaï Occidental dans le souci de rapprocher
les contribuables de structures fiables. Leurs compétences sont
déterminées par la loi et gèrent les contribuables
à faibles revenus selon le livre barémique.
La différence entre ces centres des impôts est
que, le type A est dirigé par un Chef de Division et le type B par le
Chef de Bureau.
II.5. STRUCTURE
ORGANIQUE
La Direction Provinciale des Impôts Kasaï
Occidental a des structures qui lui permettent de placer les hommes, les
matériels, les équipements et documents pour la réussite
de ses objectifs.
De ce fait, elle favorise le respect de la hiérarchie
en affectant les compétences et le savoir-faire ainsi qu'à
répartir les tâches selon le nombre d'agents en tenant compte de
grade de chacun.
La Direction Provinciale des Impôts Kasaï
Occidental outre le secrétariat et l'inspection, elle compte en son sein
7 Divisions, à savoir :
SECRETARIAT
Le secrétariat s'occupe de la relation et transmission
immédiate des correspondances revêtant un caractère urgent
au Directeur, le dispatching du courrier, suivi de l'expédition
effective du courrier sortant. Expéditions des lettres destinées
à l'administration centrale et autres destinations, réception
physique du courrier émanant des divers services.
En plus, il s'occupe également de la mise en
conformité des lettres et autres documents signés par le
Directeur Provincial ; la saisie des documents, préparation du
journal d'audience, de nettoyage des bureaux et l'entretien des mobiliers et
matériels de bureau du Directeur ; et autres tâches
traditionnellement dévolues à un secrétariat.
INSPECTION
Elle a pour tâches de (d') :
- Contrôler tous les services de la Direction
Provinciale des Impôts du Kasaï Occidental sur ordre du Directeur
Provincial ou sur celui du Directeur Général de force
exceptionnelle ;
- Effectuer des missions d'enquête et veiller à
l'application régulière des textes légaux ainsi que
règlements en vigueur et au respect strict des directives de
l'administration centrale ;
- Proposer, suite aux manquements constatés, les
mesures disciplinaires et les actions de nature à améliorer
l'organisation et le fonctionnement des services.
· LA DIVISION DES RESSOURCES
HUMAINES
Elle s'occupe de la gestion du personnel affecté
à la DPI/Kasaï Occidental, faire rapport à la
hiérarchie au besoin en recrutement et le besoin en formation. Elle fait
respecter et appliquer les normes administratives régissant le personnel
de la carrière publique.
Elle compte à son sein trois bureaux, à
savoir :
ü Bureau gestion du personnel ;
ü Bureau de la paie des agents ;
ü Bureau de formation des agents, ainsi que leur
recrutement.
· LA DIVISION DES AFFAIRES
SOCIALES
Comme toutes les autres Divisions, la Division des affaires
sociales a pour tâches :
- Supervision de toutes les manifestations, les rencontres et
les cérémonies organisées par la DPI/Kasaï
Occidental ;
- Programmation et paiement des appels de fonds et de
déclaration de créances médicales, supervision de la
distribution de livres, des tenues et autres ;
- Suivi de la mise à jour de la situation familiale des
agents ;
- Suivi des dossiers des agents malades
transférés dans des hôpitaux.
Elle a deux bureaux suivants :
ü Bureau des affaires sociales (santés,
funérailles, etc.) ;
ü Bureau des relations publiques, voyages, sports et
loisirs.
· LA DIVISION DE GESTION BUDGETAIRE ET SERVICES
GENERAUX
Elle a comme attributions : la gestion des crédits
alloués à la Direction Provinciale des Impôts du Kasaï
Occidental, coordination, harmonisation et suivi de la gestion de la part des
pénalités revenant aux services et la gestion de meubles et
immeubles lui appartenant.
Cette division est dirigée par un Chef de Division et
fonctionne avec quatre bureaux qui sont :
ü Elaboration du budget, dépense et gestion des
crédits ;
ü Gestion des biens meubles et immeubles ;
ü Gestion des matériels, charrois et
expédition ;
ü Gestion des fournitures et imprimés.
· LA DIVISION D'INFORMATIQUE
Elle s'occupe de l'information de tous les services de la DPI
Kasaï Occidental. Outre le secrétariat, elle a à son sein
deux bureaux dont celui de suivi des applications et l'autre de
maintenance.
· LA DIVISION D'ASSIETTE
Elle s'occupe de la tenue, actualisation et suivi du
répertoire général de la DPI du Kasaï Occidental
ainsi que toute la matière d'assiette fiscale. Elle est
subdivisée en quatre bureaux qui sont :
ü Immatriculation et gestion des
répertoires ;
ü Coordination des opérations d'assiettes ;
ü Gestion ;
ü Contrôle fiscal.
· LA DIVISION DE RECOUVREMENT
Elle a comme bureau à son sein :
ü Bureau des recettes provinciales ;
ü Bureau véhicules ;
ü Bureau d'apurement et attestation fiscale.
Cette Division s'occupe de la définition de la
stratégie ainsi que les objectifs quantitatifs et qualitatifs en
matière de recouvrement. Elle s'occupe de (d') :
- L'élaboration, coordination, harmonisation et
supervision des procédures de recouvrement et des poursuites sur
l'ensemble de la province ;
- L'évaluation des performances des services
opérationnels et consolidation des résultats en matière de
recouvrement ;
- Suivi des statistiques des recettes et du compte du
Trésor Public au regard des encaissements ;
- L'assistance, le cas échéant, des services
opérationnels dans le traitement des dossiers importants, en
matière.
· LA DIVISION DES CONTENTIEUX
Dirigée par un Chef de Division, elle compte deux
bureaux, à savoir :
ü Bureau suivi des procédures contentieuses ;
ü Bureau suivi des régimes fiscaux d'exception.
Cette dernière s'occupe de :
- La réception des copies des dossiers ayant fait
l'objet de recours ;
- Suivi et exploitation des statistiques des
réclamations réceptionnées et/ou instruites en nombre et
en valeur ;
- Exploitation des rapports mensuels ;
- La centralisation et exploitation des données
mensuelles des opérations exonérées ;
- Constitution et mise à jour des répertoires
général et sectoriel des contribuables exonérés.
II.6. ORGANIGRAMME
a) Définition
L'organigramme est un schéma de répartition des
tâches et des responsabilités à l'intérieur de
l'entreprise29(*).
Pour des raisons des conformités scientifiques, nous le
présentons de la manière ci-après :
b) ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION
PROVINCIALE DES IMPÔTS/KASAÏ OCCIDENTAL
DIRECTION
SECRÉTARIAT
INSPECTION
DIVISION D'ASSIETTE
DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES
DIVISION DU CONTENTIEUX
DIVISION DE RECOUVREMENT
SERVICES EXTÉRIEURS OU CENTRES D'IMPÔTS
SYNTHÉTIQUES
DIVISION DES AFFAIRES SOCIALES
DIVISION GESTION GESTION BUDGÉTAIRE ET SERVICES
GÉNÉRAUX
DIVISION INFORMATIQUE
CIS KAZUMBA
CIS DEKESE
CIS DIMBELENGE
CIS LUEBO
CIS DIBAYA
CIS DEMBA
CIS LUIZA
CIS MWEKA
CIS ILEBO
CIS KAMONYA
CIS TSHIKAPA
CIS KANANGA II
CIS KANANGA I
BUREAU RECOUVREMENT
BUREAU BRIGADE ET RECENSEMENT
BUREAU ACCUEIL ET VULGARISATION
BUREAU APPOINT ET CONTENTIEUX
BUREAUX
- Maintenance
- Suivi des applications
BUREAUX
· Affaires sociales
· Relations publiques, voyage, sport et loisirs
BUREAUX
ü Élaboration de budget, dépenses et
gestion
ü Gestion des biens meubles et immeubles
ü Gestion matériel, charroi et expédition
ü Fourniture et imprimés de valeur
BUREAUX
0. Immatriculation
1. Coordination des opérations d'assiettes
2. Gestion
3. Contrôle fiscal
BUREAUX
- Gestion du personnel
- Paie
- Formation
BUREAUX
- Recouvrement
- Suivi des procédures de recouvrement et tenue des
statistiques
- véhicules
BUREAUX
- Suivi des procédures contentieuses
- Suivi des régimes fiscaux
251663872
CHAPITRE III : ETUDE
COMPARATIVE DES PREVISIONS ET REALISATIONS DES RECETTES
Après avoir défini les concepts clés
faisant corps avec ce sujet, présenté notre cadre d'étude,
il serait mieux de faire une étude comparative des prévisions et
des recettes réalisées au sein de cette régie
financière qui est la Direction Provinciale des Impôts du
Kasaï Occidental.
C'est dans cette perspective que nous montrons dans les lignes
qui suivent comment les prévisions et les recettes
réalisées dans cette régie financière se
présentent au cours de la période couverte par notre étude
(soit de 2009 à 2012), comment elles évoluent et ensuite nous
allons comparer les prévisions aux recettes réalisées.
De ce fait, nous passons à la présentation des
données pour la période déjà
précitée.
III.1. PRESENTATION DES
DONNEES STATSTIQUES
Dans les tableaux ci-dessous nous présenterons les
statistiques de l'évolution des prévisions ainsi que des recettes
réalisées à la Direction Provinciale des Impôts
Kasaï Occidental, en sigle « DPI/K.OCC » pour une
période allant de 2009 à 2012.
Tableau n°1 : Données statistique
brutes de la DPI/K.occ de 2009 à 2012 en million de FC
|
ANNEES
MOIS
|
2009
|
|
2010
|
2011
|
|
2012
|
|
|
Prévision
|
Recettes
|
Prévisions
|
Recettes
|
Prévisions
|
Recettes
|
Prévisions
|
Recettes
|
|
Janvier
|
108467900
|
99564255
|
55000000
|
37550996,86
|
75400078
|
47283613
|
109977082
|
60898623
|
|
Février
|
109340100
|
64223522
|
55000000
|
37226322
|
58380916
|
64818210
|
109977082
|
63811561
|
|
Mars
|
120340000
|
61051874
|
69060000
|
45531137
|
136902725
|
66784827
|
110000000
|
55072745
|
|
Avril
|
120340000
|
62331820
|
68900000
|
54367223
|
81608869
|
71206668
|
141376186
|
85658600
|
|
Mai
|
131100000
|
65945261
|
68900000
|
46094075
|
77116075
|
106027759
|
124678097
|
74735081
|
|
Juin
|
129000000
|
47785539
|
65900000
|
40170506
|
79630833
|
83378120
|
126698093
|
80651987,4
|
|
Juillet
|
130400000
|
44371919
|
65900000
|
66282999
|
139335847
|
111786192
|
125688093
|
63720532
|
|
Août
|
133400000
|
40665520
|
70400000
|
48468581
|
80216122
|
81911053
|
141399105
|
55254804
|
|
Septembre
|
132000000
|
41840722
|
68900000
|
42910301
|
79269240
|
82267430
|
145688093
|
81926398
|
|
Octobre
|
133000000
|
64881174
|
94700000
|
46767027
|
116051352
|
88862140
|
168532140
|
129261650,2
|
|
Novembre
|
134500000
|
40061071
|
69500000
|
53589475
|
100000000
|
78801814
|
125688093
|
82017427,4
|
|
Décembre
|
127022428
|
58700851
|
70000000
|
50473696
|
112581143
|
71218776
|
141399105
|
77283902
|
|
TOTAL
|
1508910428
|
691423528
|
822160000
|
569432338,9
|
1136493200
|
954346602
|
1571101169
|
910293311
|
Source : Rapports annuels de la DPI Kasaï Occidental
2009, 2010, 2011 et 2012
III.1.1. TRAITEMENT ET
COMPARAISON DES DONNEES STATISTIQUES DE LA DPI/K.OCC de 2009 à 2012
Pour rendre nos calculs moins fastidieux, nous avons
divisé toutes les masses des données statistiques par 1.000.000.
Ainsi, on a les tableaux ci-dessous :
a. Tableau n°2 : Prévisions et
recettes réalisées à la DPI/K.OCC au cours de
l'année 2009 en million de FC
|
ANNEES
MOIS
|
2009
|
|
|
Prévision
(en million de FC)
|
Recettes réalisées
(en million FC)
|
|
Janvier
|
108,4679
|
99,564255
|
|
Février
|
109,3401
|
64,223522
|
|
Mars
|
120,34
|
61,051874
|
|
Avril
|
120,34
|
62,331820
|
|
Mai
|
131,10
|
65,945261
|
|
Juin
|
129,00
|
47,785539
|
|
Juillet
|
130,40
|
44,371919
|
|
Août
|
133,40
|
40,665520
|
|
Septembre
|
132,00
|
41,840722
|
|
Octobre
|
133,00
|
64,881174
|
|
Novembre
|
134,50
|
40,061071
|
|
Décembre
|
127,022428
|
58,700851
|
|
TOTAL
|
1508,910428
|
691,423528
|
SOURCE : Nous-mêmes à partir des données
du tableau n°1
Graphique n°1 : Evolution des
prévisions et des recettes réalisées par la DPI/K.OCC au
cours de l'année 2009
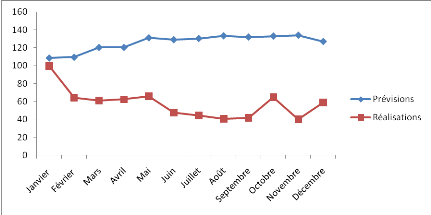
Source : Nous-mêmes à partir des données
du tableau n°2
Commentaires
Au vu de ce graphique, nous nous rendons compte que c'est
au mois de Janvier que la DPI/Kasaï Occidental a
réalisé les recettes considérables de 99,564255FC, soit
91,79% par rapport aux 100% des assignations lui fixé au mois de janvier
représentant 108,4679FC, et reste des mois, cette régie a
baissé ses recettes suite à la corruption des agents
chargés pour recouvrer ces recettes aux poches des contribuables pour le
compte de trésor public, l'incivisme fiscal constaté par les
contribuables de la province, ainsi que la ralentie du volume de transaction
des opérateurs économiques qui est faible.
Cela étant, en comparant les prévisions et les
recettes réalisées par la DPI Kasaï Occidental au cours de
l'année 2009, nous constatons que sur les assignations qui ont
été fixées à 1508,910428FC, cette dernière
n'a réalisé que 691,423528FC des recettes.
Bref, nous voyons que la Direction Provinciale des
Impôts n'a pas réalisé même le 50% de ce qui a
été prévu.
b. Tableau n°3 : Evolution des
prévisions et recettes réalisées à la DPI/K.OCC au
cours de l'année 2010 en million de FC
|
ANNEES
MOIS
|
2010
|
|
Prévisions
(en million de FC)
|
Recettes
(en million de FC)
|
|
Janvier
|
55,00
|
37,55099686
|
|
Février
|
55,00
|
37,226322
|
|
Mars
|
69,06
|
45,531137
|
|
Avril
|
68,90
|
54,367223
|
|
Mai
|
68,90
|
46,094075
|
|
Juin
|
65,90
|
40,170506
|
|
Juillet
|
65,90
|
66,282999
|
|
Août
|
70,40
|
48,468581
|
|
Septembre
|
68,90
|
42,910301
|
|
Octobre
|
94,70
|
46,767027
|
|
Novembre
|
69,50
|
53,589475
|
|
Décembre
|
70,00
|
50,473696
|
|
TOTAL
|
822,16
|
569,4323389
|
SOURCE :Nous-mêmes à partir du tableau
n°1
Graphique n°2 : Evolution des
prévisions et les recettes réalisées à la DPI/K.OCC
au cours de l'année 2010
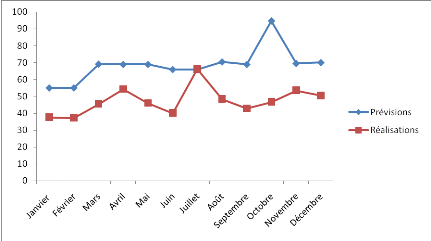
Source : Nous-mêmes à partir des données
du tableau n°3.
Commentaires
Pour raison de comparaison des prévisions aux recettes
réalisées à la Direction Provinciale des Impôts
Kasaï Occidental au cours de l'année 2010, nous voyons que cette
régie a réalisé 569,4323389FC des recettes contre les
assignations budgétaires de l'ordre de 822,16FC. Suite à ceci, il
se dégage un écart négatif de 252,7276611FC.
Nous voyons que c'est au mois de juillet que cette
régie a maximisé ses recettes en réalisant 66,282999FC par
rapport aux assignations prévues pour ce mois qui étaient de
l'ordre de 65,90FC, soit un écart positif de 0,382999FC des recettes par
rapport à tout le reste des mois auxquels cette dernière a
baissé sensiblement ses recettes suite au développement accru du
secteur informel ainsi que le détournement des fonds par les agents
chargés de recouvrer ces recettes.
c. Tableau n°4 : Evolution des
prévisions et recettes réalisées à la DPI/K.OCC au
cours de l'année 2011 en million de FC
|
ANNEES
MOIS
|
2011
|
|
|
Prévisions
(en million de FC)
|
Recettes
(en million de FC)
|
|
Janvier
|
75,400078
|
47,283613
|
|
Février
|
58,380916
|
64,818210
|
|
Mars
|
136,902725
|
66,784827
|
|
Avril
|
81,608869
|
71,206668
|
|
Mai
|
77,116075
|
106,027759
|
|
Juin
|
79,630833
|
83,378120
|
|
Juillet
|
139,335847
|
111,786192
|
|
Août
|
80,216122
|
81,911053
|
|
Septembre
|
79,269240
|
82,267430
|
|
Octobre
|
116,051352
|
88,862140
|
|
Novembre
|
100,00
|
78,801814
|
|
Décembre
|
112,581143
|
71,218776
|
|
TOTAL
|
1136,4932
|
954,346602
|
SOURCE :Nous-mêmes
à partir des données du tableau n°1
Graphique n°3 : Evolution des
prévisions et recettes réalisées à la DPI.K.OCC au
cours de l'année 2011
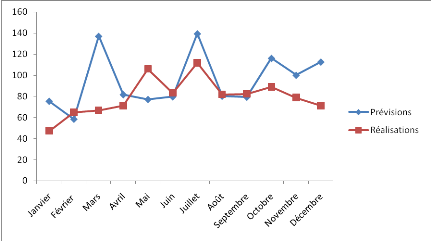
Commentaires
Au regard de ce tableau, nous constatons que la DPI/K.OCC au
cours de cette année a réalisé 954,346602FC des recettes
contre les assignations budgétaires prévues à 1136,4932FC.
Et ceci a dégagé un écart négatif de
182,146598FC.
En effet, nous rappelons qu'au cours de cette année, la
DPI/ Kasaï Occidental a eu à maximiser ses recettes pour quelques
mois, nous citons :
- Au mois de février on avait réalisé
64,818210FC des recettes contre les assignations budgétaires de
58,380916FC et l'écart dans ce mois est positif de 6,437294FC ;
- Au mois de mai, on avait réalisé 106,027759FC
des recettes contre les assignations budgétaires de 77,116075FC, et
l'écart dans ce mois était positif de l'ordre de 28,911684FC.
- Au mois de juin, les recettes étaient de 83,378120FC
contre les assignations budgétaires fixées à 79,630833FC,
avec un écart positif de 3,747287FC
- Au mois d'août, les recettes réalisées
étaient de 81,911053FC contre les prévisions ou assignations
budgétaires de 80,216122FC. Ceci a relevé un écart de
positif de 1,694931FC ;
- Au mois de septembre, les recettes réalisées
s'élevaient à 82,267430FC contre les assignations
budgétaires de 79,269240FC. Ceci a relevé un écart positif
de 2,998190FC.
d. Tableau N°5 : Evolution des
prévisions et recettes réalisées à la DPI/K.OCC au
cours de l'année 2012 en million de FC
|
ANNEES
Mois
|
2012
|
|
PREVISIONS
(en million de FC)
|
RECETTES
(en million de FC)
|
|
Janvier
|
109,977082
|
60,898623
|
|
Février
|
109,977082
|
63,811561
|
|
Mars
|
110,00
|
55,072745
|
|
Avril
|
141,376186
|
85,658600
|
|
Mai
|
124,678097
|
74,735081
|
|
Juin
|
126,698093
|
80,6519874
|
|
Juillet
|
125,688093
|
63,720532
|
|
Août
|
141,399105
|
55,254804
|
|
Septembre
|
145,688093
|
81,926398
|
|
Octobre
|
168,532140
|
129,2616502
|
|
Novembre
|
125,688093
|
82,0174274
|
|
Décembre
|
141,399105
|
77,283902
|
|
TOTAL
|
1571,101169
|
910,293311
|
Source : Nous-mêmes à partir des données
du tableau n°1.
Graphique n°4: Evolution des
prévisions et recettes réalisées à la DPI/K.OCC au
cours de l'année 2012 en million de FC
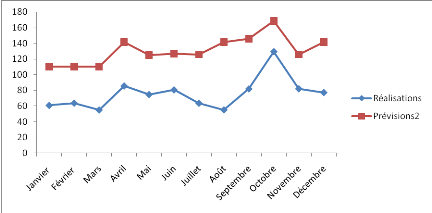
Source : Nous-mêmes à partir des données
du tableau n°5.
Commentaire
Au regard de ce qui précède, nous constatons que
la DPI Kasaï Occidental a réalisé 910,293311FC des recettes
par rapport aux assignations budgétaires fixées à
1571,101169FC ; et ceci a relevé un écart négatif de
660, 807 858FC.
SYNTHESE DES PREVISIONS ET
REALISATIONS DES RECETTES AU COURS DE LA PERIODE ALLANT de 2009 à
2012
Tableau n°6 : Présentation
synthétique des prévisions et réalisations des recettes
à la DPI/K.OCC de 2009 à 2012 en million de FC
|
Années
|
Prévision
|
Recettes réalisées
|
Ecarts
|
|
Valeur
|
%
|
|
2009
|
1508,910428
|
691,423528
|
817,486900
|
54,18%
|
|
2010
|
822,160
|
569,4323389
|
252,7276611
|
30,74%
|
|
2011
|
1136,4932
|
954,346602
|
182,146598
|
16,03%
|
|
2012
|
1571,101169
|
910,293311
|
660, 807 858
|
42,07%
|
Source : Nous-mêmes à partir des
données des tableaux n°2, 3, 4 et 5.
Graphique n°5 :
Evolution des prévisions et recettes réalisées au cours de
la période allant de 2009 à 2012
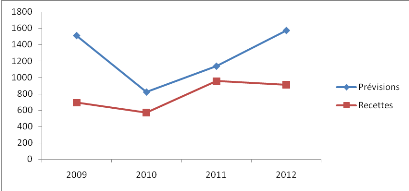
Source : Nous-mêmes à partir des données
du tableau n°6
III.1.2. INTERPRETATION
GLOBALE DES RESULTATS
Au vu de ce graphique, nous constatons qu'en 2009, la
DPI/K.OCC a réalisé 691423528FC, soit 45,82% des recettes par
rapport aux prévisions ou assignations budgétaires qui
étaient de 1508910428FC. Nous remarquons que les recettes
réalisées étaient faibles par rapport aux
prévisions suite à l'affectation de certains contribuables
potentiels à la Direction des Grandes Entreprises (DGE) et la fermeture
de toutes les sociétés minières qui contribuaient à
plus de 70% des recettes.
De ceci, nous avons relevé un écart
négatif de 817486900FC, soit 54,18%.
En 2010, contre les prévisions ou assignations
budgétaires fixées à 822160000FC, la DPI/K.OCC n'a pu
réaliser que 569432338,9FC soit 69,26% des recettes. Ceci était
dû à l'incivisme fiscal constaté chez les contribuables de
la province, le développement accru du secteur informel ainsi que le
détournement des fonds par les agents chargés de recouvrer ces
recettes aux mains des contribuables pour le compte du trésor public.
De ce fait, nous y avons relevé un de 30,74% soit
l'équivalent de 252727661,1FC.
En 2011, par rapport aux prévisions ou assignations
budgétaires fixées à 1136493200FC, cette régie a
réalisé 954346602FC, soit 83,97% des recettes. Tout ceci
causé par les raisons évoquées ci-haut.
Il se dégage un écart négatif de 16,03
soit l'équivalent de 182146598FC.
En 2012, nous nous rendons compte que sur les
prévisions ou assignations budgétaires fixées à
1571101169FC, la DPI/K.OCC a réalisé 57,94%, soit
l'équivalent de 910293311FC. Ceci nous a poussé à relever
un écart de 42,06%, soit l'équivalent de 660807858FC,
causé par l'insolvabilité de certains contribuables ainsi que le
détournement des fonds par les agents.
D'une manière générale, au regard de tout
ce qui précède, nous remarquons que les causes d'augmentation ou
de diminution des recettes au sein de la DPI/K.OCC pour les quatre
années couvertes par notre étude semblent être les
mêmes, notamment : la diminution due à
l'insolvabilité de certains contribuables, le détournement des
fonds par les agents chargés de recouvrement, la mégestion ou
mauvaise canalisation des recettes des entités (centres d'impôts)
par des agents percepteurs ainsi que le développement accru du secteur
informel. Nous remarquons aussi que les agents de cette régie
financière n'ont pas bien travaillé.
III.2. ESTIMATION
Au regard de tout ce qui précède, après
avoir présenté les données et leur évolution durant
la période allant de 2009 à 2012, soit 4 ans, nous avions
relevé des écarts négatifs pour toutes les quatre
années. C'est ainsi, entant que chercheur, nous sommes appelés
à trouver ou donner des pistes de solution à ce genre de
problème.
C'est pour cette raison que nous présentons ce
modèle des estimations qui pourra aider les futurs chercheurs, les
dirigeants de cette régie financière ainsi que l'Etat congolais
à mieux faire des prévisions au cas où ils en tiendront
compte.
Nous procédons ainsi, tout en sachant qu'au
départ toutes les masses des données étaient
divisées par 1.000.000, avec la seule raison de rendre nos calculs moins
fastidieux.
Dans le tableau ci-après, nous présentons les
moyennes mobiles centrées sur 12 mois obtenues à partir des
données initiales des recettes.
Tableau n°7 : Tableau des moyennes
mobiles
|
ANNEES & MOIS
|
DONNEES
|
SOMME MOBILE SUR 12 MOIS
|
SOMME MOBILE SUR 2 MOIS DE LA COLONNE 3
|
MOYENNE MOBILE CENTREE SUR 12 MOIS(Colonne
  ) )
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
Janvier
|
99,564255
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Février
|
64,223522
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mars
|
61,051874
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avril
|
62,33182
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai
|
65,045261
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juin
|
47,785539
|
|
|
|
|
|
|
691,424
|
|
|
|
Juillet
|
44,371919
|
|
1320,834
|
55,035
|
|
|
|
629,41
|
|
|
|
Août
|
40,66552
|
|
1231,823
|
51,326
|
|
|
|
602,413
|
|
|
|
Septembre
|
41,840722
|
|
1189,305
|
49,554
|
|
|
|
586,892
|
|
|
|
Octobre
|
64,881174
|
|
1165,82
|
48,576
|
|
|
|
578,928
|
|
|
|
Novembre
|
40,061071
|
|
1138,005
|
47,417
|
|
|
|
559,077
|
|
|
|
Décembre
|
58,700851
|
|
1110,539
|
46,272
|
|
2010
|
|
551,462
|
|
|
|
Janvier
|
37,55099686
|
|
1124,835
|
46,868
|
|
|
|
573,373
|
|
|
|
Février
|
37,226322
|
|
1154,549
|
48,106
|
|
|
|
581,176
|
|
|
|
Mars
|
45,531137
|
|
1163,421
|
48,476
|
|
|
|
582,245
|
|
|
|
Avril
|
54,367223
|
|
1146,376
|
47,766
|
|
|
|
564,131
|
|
|
|
Mai
|
46,094075
|
|
1141,791
|
47,575
|
|
|
|
577,66
|
|
|
|
Juin
|
40,170506
|
|
1147,092
|
47,796
|
|
|
|
569,432
|
|
|
|
Juillet
|
66,282999
|
|
1148,597
|
47,858
|
|
|
|
579,165
|
|
|
|
Août
|
48,468581
|
|
1185,922
|
49,413
|
|
|
|
606,757
|
|
|
|
Septembre
|
42,910301
|
|
1234,768
|
51,449
|
|
|
|
628,011
|
|
|
|
Octobre
|
46,767027
|
|
1272,861
|
53,036
|
|
|
|
644,85
|
|
|
|
Novembre
|
53,589495
|
|
1349,635
|
56,235
|
|
|
|
704,785
|
|
|
|
Décembre
|
50,473696
|
|
1452,776
|
60,532
|
|
2011
|
|
747,991
|
|
|
|
Janvier
|
47,283613
|
|
1541,485
|
64,229
|
|
|
|
793,494
|
|
|
|
Février
|
64,81821
|
|
1620,431
|
67,518
|
|
|
|
826,937
|
|
|
|
Mars
|
66,784827
|
|
1693,231
|
70,551
|
|
|
|
866,294
|
|
|
|
Avril
|
71,206668
|
|
1774,683
|
73,945
|
|
|
|
908,389
|
|
|
|
Mai
|
106,027759
|
|
1841,991
|
76,75
|
|
|
|
933,602
|
|
|
|
Juin
|
83,37812
|
|
1887,951
|
78,665
|
|
|
|
954,349
|
|
|
|
Juillet
|
111,786192
|
|
1922,311
|
80,096
|
|
|
|
967,962
|
|
|
|
Août
|
81,911053
|
|
1934,917
|
80,622
|
|
|
|
966,955
|
|
|
|
Septembre
|
82,26743
|
|
1922,198
|
80,092
|
|
|
|
955,243
|
|
|
|
Octobre
|
88,86214
|
|
1924,938
|
80,206
|
|
|
|
969,695
|
|
|
|
Novembre
|
78,801814
|
|
1908,097
|
79,504
|
|
|
|
938,402
|
|
|
|
Décembre
|
71,218776
|
|
1874,078
|
78,087
|
|
2012
|
|
935,676
|
|
|
|
Janvier
|
60,898623
|
|
1823,286
|
75,97
|
|
|
|
887,61
|
|
|
|
Février
|
63,811561
|
|
1748,564
|
72,857
|
|
|
|
860,954
|
|
|
|
Mars
|
55,072745
|
|
1721,567
|
71,732
|
|
|
|
860,613
|
|
|
|
Avril
|
85,6586
|
|
1761,626
|
73,401
|
|
|
|
901,013
|
|
|
|
Mai
|
74,735081
|
|
1805,241
|
75,218
|
|
|
|
904,228
|
|
|
|
Juin
|
80,6519874
|
|
1814,521
|
75,605
|
|
|
|
910,293
|
|
|
|
Juillet
|
63,720532
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Août
|
55,254804
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septembre
|
81,926398
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octobre
|
129,2616502
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Novembre
|
82,0174274
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Décembre
|
77,283902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
On divise ensuite chacune des valeurs mensuelles par la moyenne
mobile centrée sur 12 mois correspondante et on exprime chaque
résultat sous forme de pourcentage.
Le tableau ci-après présente ces calculs.
Tableau n°8 : Calcul des indices
|
Janvier
|
Février
|
Mars
|
Avril
|
Mai
|
Juin
|
Juillet
|
Août
|
Septembre
|
Octobre
|
Novembre
|
Décembre
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
80,6
|
79,2
|
84,4
|
133,6
|
84,5
|
126,9
|
|
2010
|
80,1
|
77,4
|
93,9
|
113,8
|
96,9
|
84,1
|
138,5
|
98,1
|
83,4
|
88,2
|
95,3
|
83,4
|
|
2011
|
73,6
|
96
|
94,7
|
96,3
|
138,2
|
106
|
139,6
|
101,6
|
102,7
|
110,8
|
99,1
|
91,2
|
|
2012
|
80,2
|
87,6
|
76,8
|
116,7
|
99,4
|
106,7
|
|
|
|
|
|
|
|
MEDIANE
|
80,1
|
87,6
|
93,9
|
113,8
|
99,4
|
106
|
138,5
|
98,1
|
84,4
|
110,8
|
95,3
|
91,2
|
Pour obtenir le pourcentage moyen de chaque mois sur les
diverses années, nous avons utilisé la médiane à
cause de la présence des valeurs extrêmes aberrantes.
Etant donné que la somme des médianes donne 1199,1
nous devons réajuster ces données en les multipliant par
1200/1199,1 = 1,001.
Ainsi, on a : 80,2 ; 87,7 ; 94 ;
113,9 ; 99,5 ; 106,1 ; 138,6 ; 98,2 ; 84,5 ;
110,9 ; 95,4 ; 91,3.
Ces valeurs constituent des indices saisonniers.
Les valeurs mensuelles futures sont représentées
par Y= TCSI
Où T : La valeur de tendances
C : Le mouvement cyclique
S : Variation saisonnière
I : Mouvement irrégulier ou aléatoire
Dans cette expression, on doit estimer T, C, S et I. pour
cela, on calculera les valeurs de tendance par la méthode de
semi-moyenne.
Le tableau ci-dessous, on a divisé en deux parties
égales les moyennes mobiles centrées sur 12 mois (allant de
juillet 2009 à juin 2012).
Tableau n°9 : Les semi-moyennes pour les trois
dernières années
|
Juillet 2010
|
47,858
|
|
Juillet 2011
|
80,096
|
|
Août 2010
|
49,413
|
|
Août 2011
|
80,622
|
|
Septembre2010
|
51,449
|
|
Septembre 2011
|
80,092
|
|
Octobre2010
|
53,036
|
|
Octobre 2011
|
80,206
|
|
Novembre2010
|
56,235
|
|
Novembre 2011
|
79,504
|
|
Décembre2010
|
60,532
|
|
Décembre 2011
|
78,087
|
|
Janvier2011
|
64,229
|
|
Janvier2012
|
75,97
|
|
Février 2011
|
67,518
|
|
Février2012
|
72,857
|
|
Mars2011
|
70,551
|
|
Mars2012
|
71,732
|
|
Avril 2011
|
73,945
|
|
Avril 2012
|
73,401
|
|
Mai2011
|
76,75
|
|
Mai 2012
|
75,218
|
|
Juin 2011
|
78,665
|
|
Juin2012
|
75,605
|
|
TOTAL
|
750,181
|
|
TOTAL
|
923,39
|
|
Moyenne
|
62,515
|
|
Moyenne
|
76,949
|
A partir des moyennes dans chaque partie, on constate qu'il y
a une augmentation de 76,949 - 62,515 = 14, 434 en 12 mois soit 14,434/12 =
1,203/mois.
En ajoutant 1,203 à 75,605 le dernier terme
correspondant à juin 2012, on obtient les valeurs de la tendance pour
2013 comme le voit dans le tableau ci-après :
Tableau n°10 :Les recettes prévues
pour 2013
|
Janvier
|
Février
|
Mars
|
Avril
|
Mai
|
Juin
|
Juillet
|
Août
|
Septembre
|
Octobre
|
Novembre
|
Décembre
|
|
Valeur de la tendance (T) pour 2012
|
|
|
|
|
|
75,605
|
76,808
|
78,011
|
79,214
|
80,417
|
81,62
|
82,823
|
|
Valeur de la tendance (T) pour 2013
|
84,026
|
85,229
|
86,432
|
87,635
|
88,838
|
90,041
|
91,244
|
92,447
|
93,65
|
94,853
|
96,056
|
97,259
|
|
Indices saisonniers (S en %)
|
80,2
|
87,7
|
94
|
113,9
|
99,5
|
106,1
|
138,6
|
98,2
|
84,5
|
110,9
|
95,4
|
91,3
|
|
recettes prévues
(T x S)
|
67,4
|
74,7
|
81,2
|
99,8
|
88,4
|
95,5
|
126,5
|
90,8
|
79,1
|
105,2
|
91,6
|
88,8
|
Comme nous l'avons dit précédemment, nos
données étaient divisées par 1.000.000 en raison de rendre
nos calculs simples, c'est ainsi qu'au vu de ces résultats
trouvés dans le tableau ci-haut (tableau n°10), nous multiplierons
la somme des recettes prévues par 1.000.000afin d'obtenir les recettes
que cette régie financière aura à réaliser par nos
estimations pour l'année 2013 en franc congolais.
Nous disons que, par nos estimations, la Direction Provinciale
des Impôts du Kasaï Occidental aura à réaliser en 2013
comme recettes pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai,
juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre
respectivement de 67.400.000FC, 74.700.000FC, 81.200.000FC, 99.800.000FC,
88.400.000FC, 95.500.000FC, 126.500.000FC, 90.800.000FC, 79.100.000Fc,
105.200.000FC, 91.600.000FC et 88.800.000FC dont, nous prions aux futurs
chercheurs qui choisiront en particulier un tel sujet ou en
général un sujet traitant des recettes de cette régie
financière, de nous compléter tout en comparant les recettes
réelles de la DPI/K.OCC pour l'exercice 2013 à celles
estimées.
II.4. CRITIQUES ET
SUGGESTIONS
a) CRITIQUES
Ne dit-on pas que : « L'air ne fait pas la
chanson : l'apparence n'est pas la réalité ».
C'est avec l'idée de ce maxime que nous disons que nos investigations
menées sur l'étude comparative des prévisions et
réalisations des recettes à la Direction Provinciale des
Impôts du Kasaï Occidental nous pousse à dire ceci :
- L'incivisme fiscal est beaucoup plus développé
par les contribuables au niveau de la province ;
- La modicité de salaire des agents ;
- L'impunité ;
- Répertoire des redevables non
actualisé ;
- Effectif du personnel (agents et cadres) incompatible au
volume du travail ;
- La non mécanisation de certains agents et nouvelles
unités ;
- Le développement accru du secteur informel sur
l'étendue de la province empêchant l'Etat de maximiser ses
recettes.
b) SUGGESTIONS
Au regard de nos critiques, nous formulons d'une
manière non exhaustive les suggestions suivantes tout en
demandant aux responsables de la Direction Provinciale des Impôts du
Kasaï Occidental de (d') :
- Conscientiser et sensibiliser les contribuables de la
province du Kasaï Occidental sur le caractère obligatoire de
l'impôt ;
- Octroyer une prime aux agents en cas de contrôle
efficace face à l'objectif de maximisation des recettes ;
- Bien rémunérer les agents et améliorer
les conditions de travail ;
- Organiser des séances de formation afin de renforcer
les capacités de son personnel sur l'incivisme fiscal ;
- Appliquer les pénalités au regard des textes
légaux en cas la découverte d'une intention frauduleuse ;
- Renforcer l'effectif des agents pour faire face au volume du
travail ;
Et enfin, nous demandons à l'Etat congolais de songer
à la mécanisation des nouvelles unités et de leur accorder
tous les avantages sociaux, car ces dernières sont à la base de
corruption et fraude à partir de la base en ce qui concerne le
recouvrement des recettes fiscales de l'Etat.
CONCLUSION
Nous voici arriver au terme de notre Travail de Fin de Cycle
portant sur l' « Etude comparative des prévisions et
réalisations des recettes au sein de la Direction Provinciale des
Impôts du Kasaï Occidental de 2009 à
2012 ».
Notre objectif était de comparer les prévisions
aux réalisations des recettes au sein de cette régie
financière afin de vérifier s'il existe une relation ou non entre
les prévisions et les recettes, savoir comment elles évoluent
afin de donner une thérapeutique au cas où il existerait des
écarts.
Pour y arriver, nous avons subdivisé notre travail en
trois grands chapitres, subdivisés en deux grandes parties. Et pour
atteindre notre objectif, nous avons fait appel aux méthodes comparative
et statistique, secondées par les techniques documentaire et d'interview
libre.
Partant de nos analyses, nous avions fait une étude
comparative entre les prévisions et les réalisations des recettes
à partir de nos tableaux de calcul pour la période de notre
étude. De ce fait, nous avons constaté qu'il se dégage des
écarts entre les prévisions et les réalisations, et ces
écarts sont négatifs pour la période sous
étude respectivement de 54,18% ; 30,74% ; 16,03% et 42,07%
pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012. Ainsi, nous disons que nos
hypothèses selon lesquelles les prévisions et les
réalisations des recettes n'évoluent pas dans le même sens
au sein de cette régie financièresont affirmées.
Cela étant, pour remédier à cette
situation, entant que chercheur, nous étions appelés à
donner des pistes de solution à ce genre de problème. C'est ainsi
que nous avons :
- Proposé un modèle prévisionnel pouvant
aider les dirigeants de cette régie financière, les futurs
chercheurs ainsi que l'Etat congolais à mieux faire des
prévisions. C'est pourquoi, à partir de ce modèle, nous
avions fait des estimations des recettes pour l'année 2013 et avions
trouvé que la DPI/K.OCC aura à réaliser comme recettes
pour l'année précitée concernant les mois de janvier,
février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre,
octobre, novembre et décembre respectivement de 67.400.000FC,
74.700.000FC, 81.200.000FC, 99.800.000FC, 88.400.000FC, 95.500.000FC,
126.500.000FC, 90.800.000FC, 79.100.000Fc, 105.200.000FC, 91.600.000FC et
88.800.000FC.
- Envisagé la mise sur pieds d'une structure de
contrôle susceptible de contrôler autrement dit de faire une contre
vérification du travail réalisé sur terrain par les agents
de la DPI auprès des contribuables afin de canaliser les recettes
fiscales vers le trésor fiscal. Mais, en cas de conformité des
rapports, appliquer des sanctions positives pour tous ceux qui se seraient
comportaient dignement, en procédant par un système de cotation
ainsi que la prime d'encouragement pour un travail bien fait.
Par contre, en cas de non-conformité des rapports, il
faut infliger ou appliquer des pénalités au regard des textes
légaux à tout celui qui se serait impliqué dans le
détournement des fonds à la base ; telles que ouvrir
une action disciplinaire suivie d'une suspension immédiate des
fonctions, la retenue sur salaire, l'exclusion temporaire avec privation de
tous les avantages sociaux, ...
En concluant ce travail, nous ne prétendons pas avoir
tout dit sur les prévisions et réalisations des recettes à
la Direction Provinciale des Impôts du Kasaï Occidental, mais nous
avons apporté notre pierre à l'achèvement de cet
édifice qu'est la science.
Que les futurs chercheurs trouvent cette oeuvre comme un
document de référence et nous restons ouverts à toutes
critiques et remarques constructives.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1. BAETCHER J., Les phénomènes
révolutionnaires, Paris, PUF 1991
2. BERGERON P.G., la gestion moderne : théorie
et cas, Gaétan Morin, Chicoutimi, 1983
3. BOUDEN R., Les méthodes en sociologie, PUF,
Paris 1970
4. GUEVARA, THONY B., Participation et organisation,
édition Dunod, Paris 1990
5. J.M MOUCHOUT et A. MOLES, Les méthodes de
sciences humaines dans l'entreprise, édition Fayard-Dame, Paris
1991
6. MURRAY R. SPIAGEL, Théorie et application de la
statistique, édition française, 1984.
7. SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche
scientifique, PUK, 2002, Kinshasa
8. VERHAGEN B., Méthodes et techniques de recherche
en sciences sociales, in analyse sociale, Col. 1 n°2, mars-avril
1984
II. DICTIONNAIRES
1. BREMOND, J & GELEDAN, A., Dictionnaire des
théories et mécanismes économiques, Hatier, Paris, 1984
2. Dictionnaire des sciences économiques
2ème édition Armand Colin, Paris 2007
3. Encyclopediauniversalis, édition Paris, V15
4. Larousse, dictionnaire de poche, Paris 2010
5. P. FOULQUIE et R. Saint Jean, Dictionnaire de la langue
philosophique, 3ème édition, PNF, 1962
III. MEMOIRES ET TFC
1. CHENGA TSHISANDA, « L'impact du coût de
produit pétrolier sur les économies africaines, Mémoire en
SPA, UNILU 2003
2. MAKALO M-E., in « Essai d'une étude
évolutive sur les recettes d'assurance-vie à la SONAS direction
sud 1999 »
3. MUPONDO M., in « La politique de la maximisation
des recettes dans une entreprise industrielle, G3 SCA, 2002-2003,
ISP/Kananga.
IV. NOTES DE COURS
1. BAKENGE K., cours de méthodes de recherche en
sciences sociales, G2 SEG, UNIKAN 2011-2012, inédit
2. Prof J.J. MWALABA K., notes de cours de l'économie
politique II, UNILU 1993-1994
3. TURNER T., cours de méthodes de travail
scientifique, UNAZA, Campus de Lubumbashi, G1 SPA 1975
4. USOTSHIKA A., cours des finances publiques, G3 SEG, UNIKAN
2011-2012.
V. AUTRES SOURCES
Ordonnance-loi n°89-039 du 10 mars 1988, portant
création de la DGI, un journal officiel de la RD Congo,
30ème numéro spécial, juin 1987
TABLE DES MATIERES
0. INTRODUCTION GENERALE
1
0.1. CHOIX ET INTERET DU SUJET
1
a) CHOIX
1
b) INTERÊT
1
0.2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
2
a) PROBLEMATIQUE
2
b) HYPOTHESE DU TRAVAIL
3
0.3. METHODES ET TECHNIQUES
3
0.3.1. METHODES
3
0.3.2. TECHNIQUES
5
0.4. DELIMITATION DU SUJET
6
0.5. SUBDIVISION DU TRAVAIL
6
0.6. DIFFICULTES RENCONTREES
7
CHAPITRE I : GENERALITES
8
Section 1 : DEFINITION DES CONCEPTS
8
I.1.1. ETUDE
8
I.1.2. COMPARAISON
9
I.1.3. PREVISION
9
I.1.4. REALISATION
9
I.1.5. RECETTES
10
I.1.6. REGIE FINANCIERE
10
Section 2 : NOTIONS ET THEORIES DE BASE
10
I.2.1. NOTION DE L'IMPÔT
10
I.2.1.1. Définition
10
I.2.1.2. CARACTERES DE L'IMPÔT
11
I.2.1.3. LES PRINCIPES DE L'IMPÔT
11
I.2.1.4. LES ASPECTS DE L'IMPÔT
14
I.2.1.5. SORTES D'IMPÔTS
15
I.2.2.1. NOTION DES RECETTES
17
A. DEFINITION
17
B. SORTES DES RECETTES
17
1°) RECETTES AU SENS FISCAL
17
2°) RECETTES AU SENS ECONOMIQUE
17
I.2.2.2. PREVISIONS
20
A. DEFINITION
20
B.NATURE DE LA PREVISION
20
C. LES DOMAINES DE LA PREVISION
20
D. SORTES DES PREVISIONS
21
E. DIFFERENCIATION DE LA PLANIFICATION
21
I.2.3. NOTION SUR L'ANALYSE DES
SERIES TEMPORELLES
21
I.2.3.1. SERIES TEMPORELLES
21
I.2.3.2. GRAPHES DES SERIES TEMPORELLES
22
I.2.3.3. MOUVEMENTS CARACTERISTIQUES D'UNE SERIE
TEMPORELLE
22
I.2.3.3.1. CLASSIFICATION DES MOUVEMENTS DES SERIES
TEMPORELLES
22
I.2.3.4. L'ANALYSE DES SERIE TEMPORELLES
23
I.2.3.5.1. LISSAGE DES SERIES TEMPORELLES
24
I.2.3.6. ESTIMATION DE LA TENDANCE
25
I.2.3.7. ESTIMATION DES VARIATIONS SAISONNIERES
(INDICE SAISONNIER)
26
CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA DIRECTION
PROVINCIALE DES IMPÔTS KASAÏ OCCIDENTAL
29
II.1. LOCALISATION
29
II.2. APERÇU HISTORIQUE
29
II.3. MISSION
30
II.4. ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET
FONCTIONNELLE
30
II.5. STRUCTURE ORGANIQUE
32
II.6. ORGANIGRAMME
35
a) Définition
35
b) ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION PROVINCIALE
DES IMPÔTS/KASAÏ OCCIDENTAL
36
CHAPITRE III : ETUDE COMPARATIVE DES
PREVISIONS ET REALISATIONS DES RECETTES
37
III.1. PRESENTATION DES DONNEES STATSTIQUES
37
III.1.1. TRAITEMENT ET COMPARAISON DES DONNEES
STATISTIQUES DE LA DPI/K.OCC de 2009 à 2012
38
SYNTHESE DES PREVISIONS ET REALISATIONS DES
RECETTES AU COURS DE LA PERIODE ALLANT de 2009 à 2012
43
Graphique n°5 : Evolution des
prévisions et recettes réalisées au cours de la
période allant de 2009 à 2012
44
III.1.2. INTERPRETATION GLOBALE DES RESULTATS
44
III.2. ESTIMATION
45
II.4. CRITIQUES ET SUGGESTIONS
51
a) CRITIQUES
51
b) SUGGESTIONS
51
CONCLUSION
52
BIBLIOGRAPHIE
54
TABLE DES MATIERES
56

* 1 ILUNGA KABONGO, cité
par CHENGA TSHISANDA, l'impact du coût de produit pétrolier sur
les économies africaines, Mémoire en SPA, UNILU 2003, p6
* 2 TURNER T., Cours de
méthode de travail scientifique, UNAZA, Campus de Lubumbashi, G1 SPA,
1975
* 3 BAETCHER J., Les
phénomènes révolutionnaires, Paris, PUF 1991, p4
* 4 GUEVARA, THONY B.,
Participation et organisation, édition Dunod, Paris 1990, p19
* 5 KABENGELE, cité par
MAKALO, M-E, in « Essai d'une étude évolutive sur les
recettes d'assurance-vie à la SONAS direction sud 1999 »,
p2
* 6 J.M MOUCHOUT et A. MOLES,
Les méthodes de sciences humaines dans l'entreprise,
édition Fayard-Dame, Paris 1991, p182
* 7 BOUDEN R., Les
méthodes en sociologie, PUF, Paris 1970, p13
* 8 VERHAGEN B.,
Méthodes et techniques de recherche en sciences sociales, in
analyse sociale, Col. 1 n°2, mars-Avril 1984, p51
* 9 Antoine de Saint EXUPERY,
cité par MUPONDO M., in « La politique de la maximisation des
recettes dans une entreprise industrielle, G3 SCA 2002-2003 ISP/Kananga.
* 10 BAKENGE K., cours de
méthodes de recherche en sciences sociales, G2 SEG UNIKAN, 2011-2012,
inédit.
* 11Encyclopediauniversalis,
édition Paris, V15, p15
* 12 BAKENGE K., Op-cit
* 13 SHOMBA KINYAMBA,
Méthodologie de la recherche scientifique, PUK, 2002, Kinshasa
* 14 David MUKENGE, M.L., Cours
d'initiation à la recherche scientifique, inédit CIDEP
2009-2010.
* 15 TALCOTT PARSONS,
cité par BAKENGE K., Op-cit
* 16 DURKHEIM E., cité
par BAKENGE K., Op-cit
* 17 BRIMO A., cité par
BAKENGE K., Op-cit
* 18 Larousse, dictionnaire de
poche, Paris 2010, p310
* 19 BREMOND, J & GELEDAN,
A., dictionnaire des théories et mécanismes économiques,
Hatier, Paris 1984, p384
* 20 Dictionnaire des sciences
économiques 2ème édition Armand Colin, Paris
2007, p403
* 21 Idem, p404
* 22 Ibidem, p182
* 23 LAFFER, cité par
USOTSHIKA A., Cours des finances publiques, G3 SEG UNIKAN, 2011-2012
* 24J.J. MWALABA K., Notes de
cours d'économie politique II, UNILU 1993-1994
* 25 Idem
* 26 P.G. BERGERON, La
gestion moderne : théorie et cas, Gaétan Morin,
Chicoutimi 1983, p437
* 27MURRAY R. SPIAGEL,
Théorie et application de la statistique, édition
française, 1984, p302-323
* 28 Ordonnance-loi
n°89-039 du 10 mars 1988 portant création de la DGI, un journal
officiel de la RDC, 30ème numéro spécial, juin
1987, p5
* 29 P. FOULQUIE et R. Saint
Jean, Dictionnaire de la langue philosophique, 3ème
édition PNF, 1962, p42



