
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR REPUBLIQUE DU MALI
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI
UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES ET DE
GESTION DE BAMAKO (USSGB)
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION (FSEG)
MEMOIRE DE MASTER
THEME
INVESTISSEMENT, CROISSANCE ECONOMIQUE ET CREATION
D'EMPLOI DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL AU MALI DE 1990 - 2018
Présenté et soutenu par
CHECK OUMAR TRAORE
Pour l'obtention du Diplôme de Master Recherche en Economie
Appliquée au Développement
Option : Economie et Politique Agricole
Membre du jury :
1- Maitre-Assistant CAMES Dr Dramane L TRAORE :
Président du jury
2- Maitre-assistant CAMES Dr Ousmane MARIKO : Directeur de
mémoire
3- Maitre-assistant CAMES Dr Moulaye MAIGA : Membre du
jury
4- Dr Amadou BAMBA : Membre du jury
PROMOTION 2ème promotion 2017-2018
Date de la soutenance : le 06 / 09 / 2019
Dédicace
Je dédie ce mémoire à ma mère et
à mes frères, en guise de reconnaissance des souffrances, des
moments de bonheur, de malheur, de complicité que nous avons eu à
partager et que nous continuerons toujours à partager.
Remerciements
Je remercie tout d'abord DIEU, le Tout puissant,
clément et miséricordieux de m'avoir accordé ce moment si
important de ma vie.
Mes sincères remerciements vont à mon directeur
de mémoire Dr. OUSMANE MARIKO, pour l'encadrement, la formation, le
savoir-faire qu'il nous a inculqué au cours des années de cycle
universitaire. Ma profonde gratitude va au corps professoral de la
faculté des sciences économiques et de gestion. Je remercie
précisément les membres du jury pour avoir accepté de
porter un regard critique et scientifique sur notre travail. Apprendre
quelqu'un est facile et difficile à la fois, de ce fait vous êtes
le gage de la prospérité du Mali puisqu'il est dit que le
développement d'une nation passe par une bonne éducation de son
peuple. C'est pour vous dire que vous êtes une référence
pour l'éducation du Mali, un modèle pour le développement
du Mali. Et la citation de Jean Jacques Rousseau vient corroborer cette
affirmation ; il dit : « on façonne les plantes par la culture et
les Hommes par l'éducation ».
Mes remerciements à mes camarades, amis et
collègues.
Ma reconnaissance et mes remerciements vont enfin à
l'endroit de tous ceux et celles qui ont contribué d'une manière
quelconque au bon déroulement de ce mémoire.
Sigles et abréviations
AFD Agence Français de Développement
ANPE Agence Nationale Pour l'Emploi
AGOA Africain Growth Opportunities Act (Loi sur la Croissance et
les Opportunités de
Développement en Afrique)
API Agence pour la Promotion de l'Industrie
AMADER Agence Malienne pour le Développement de
l'énergie Domestique et de l'Electrification Rurale
BCEAO Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
BCEM Baromètre de Conjoncture des Entreprises du Mali
BIM Banque Internationale pour le Mali
BMCE Banque Marocain du Commerce Extérieur
BTP Bâtiment et Travaux Publics
CIES Centre de l'Information Economique et Sociale des Nations
Unies
CDA Centre de Développement du Secteur de
l'Agro-Alimentaire
CEDEAO Communauté Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest
DNI Direction Nationale de l'Industrie
DNH Direction Nationale de l'Hydraulique
EDM Energie Du Mali
EMOP Enquête Modulaire et Permanente auprès des
Ménages
EPAM Enquête Emploi Permanente Auprès des
Ménages
FBCF Formation Brut de Capital Fixe
FGSP fonds de garantie du secteur privé
FMI Fond Monétaire International
FOCAC Forum sur la Coopération entre la Chine et
l'Afrique
HIMO Haute Intensité de Main d'oeuvre
ICS Intervenants Communautaire Scolaire
IDE Investissement Direct Etranger
IDH Indice de Développement Humain
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques
INSTAT Institut National des Statistiques
OPI Organisation Patronale des Industries
PDES Projet de Développement Economique et Social
PDI Politique de Développement Industriel
PIB Produit Intérieur Brut
PMA Pays les Moins Avancés
PPP Partenariats Publics Privés
SEMOS Société d'Exploitation des Mines d'Or de
Sadiola
SITAMA Société Malienne de Transformation de
l'Acier au Mali
SOMIKA Société des Mines d'or de Kalana
SOMAGEP Société Malienne de Gestion d'Eau Potable
SOMAPEP Société Malienne de Production d'Eau Potable
SOPAM Sogoli Pangueba Mohamed (groupe SOPAM énergie
Mali)
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
ZES Zones Economiques Spéciales
Résumé
De la théorie Keynésienne aux théories de
croissance endogène, l'importance de l'investissement1
(public ou privé) sur la croissance est une évidence pour maints
théoriciens comme SOLOW ou encore BARRO. Il s'avère donc
nécessaire pour pays de créer des conditions indispensables en
vue d'accroitre le niveau de ce dernier pour soutenir la croissance. Cela
étant, notre étude analyse le rôle et l'importance de
l'investissement sur la croissance et l'emploi dans le secteur industriel
malien de 1990 à 2018. En partant de l'hypothèse qu'il existe une
relation linéaire entre les trois variables, nous parvenons à
l'aide de la méthode à correction d'erreur à montrer qu'il
existe une relation positive et significative entre l'investissement (FBCFPUB
et IDE) et la valeur ajoutée industriel mais négative et non
significative sur l'emploi industriel excepté (FBCFPRIV). Et les
résultats obtenus sont plus significatives à long terme.
Ainsi nos implications en termes de politique
économique sont en faveur des mesures visant à stimuler l'impact
de l'investissement tant sur la croissance que sur l'emploi dans l'industrie
malienne dans le but d'accroitre la part de cette dernière sur le
PIB.
Mots clés : Investissement - croissance
industriel - modèle à correction d'erreur
Abstract
From Keynesian theory to theories of endogenous growth, the
importance of investment (public or private) in growth is obvious to many
theorists like SOLOW and BARRO. It is therefore necessary for countries to
create the necessary conditions in order to increase the level of the latter to
support growth. However, our study analyzes the role and importance of
investment on growth and employment in the Malian industrial sector from 1990
to 2018. Assuming that there is a linear relationship between the three
variables, we manage to use the error correction method to show that there is a
positive and significant relationship between investment (FBCFPUB and IDE) and
industrial value added but negative and not significant on industrial
employment except (FBCFPRIV). And the results obtained are more significant in
the long term.
Thus, our implications in terms of economic policy are in
favor of measures aimed at stimulating the impact of investment both on growth
and on employment in the Malian industry with the aim of increasing the
latter's share in the GDP.
Keywords: Investment - industrial growth - error
correction model
1 L'investissement utilisé dans cette
étude fait allusion à la formation brute de capital fixe.
Sommaire
DEDICACE 2
REMERCIEMENTS 3
SIGLES ET ABREVIATIONS 4
RESUME 6
SOMMAIRE 7
INTRODUCTION 9
CHAPITRE 1 : ANALYSE DESCRIPTIVE DE L'INVESTISSEMENT
INDUSTRIEL 12
SECTION 1 : SITUATION DES ACTIONS PUBLIQUES EN FAVEUR DE
L'INVESTISSEMENT EN
AFRIQUE SUBSAHARIENNE 13
I. PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE 14
II. INITIATIVES INTERNATIONALES DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT
PRIVE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 15
SECTION 2 : ETAT DU PARC INDUSTRIEL ET DE SON
INVESTISSEMENT AU MALI 17
I. GENERALITE 17
II. INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET LA CROISSANCE ECONOMIQUE AU
MALI 21
III. INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET CREATION D'EMPLOI AU MALI
30
IV. POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (PDI) ET D'EMPLOI
AU MALI 32
CHAPITRE 2 : CONCEPT ET REVUE DE LITTERATURE
36
SECTION 1 : CONCEPT ET DEFINITION 37
SECTION 2 : REVUE DE LITTERATURE 40
I. REVUE THEORIQUE 40
II. REVUE EMPIRIQUE 47
CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE ET ANALYSE DES RESULTATS
53
SECTION 1 : METHODOLOGIE APPLIQUEE 54
I. MODELE THEORIQUE 54
II. MODELE EMPIRIQUE 55
SECTION 2 : INTERPRETATION ET DISCUSSIONS DES RESULTATS
EMPIRIQUES 63
I. INTERPRETATION DES RESULTATS EMPIRIQUES : 63
II. DISCUSSION DES RESULTATS 67
CONCLUSION ET IMPLICATIONS 69
BIBLIOGRAPHIE 71
ANNEXE : RESULTAT EMPIRIQUE 76
Liste des tableaux et des figures
Tableaux
|
Tableau 1 : Statuts juridiques des entreprises maliennes de 2009
à 2011
|
17
|
|
Tableau 2 : Situation des unités industrielles entre 2015
et 2016
|
.17
|
|
Tableau 3 : Chiffre clés de la SOMAGEP -SA
|
.30
|
|
Tableau 4 : Budget et réalisation 2017
|
30
|
|
Tableau 5 : Répartition des actifs occupés selon la
branche d'activité 2007 à 2010
|
31
|
|
Tableau 6 : Présentation des sources de donnée
|
..56
|
|
Tableau 7 : Résultat des tests de stationnarité
|
.58
|
|
Tableau 8 : Présentation des résultats empiriques
|
62
|
Figures
Figure 1 : Evolution du nombre des entreprises industrielles
entre 2003 à 2015 18
Figure 2 : Evolution de la formation brute de capital fixe et
du produit intérieur brut entre
1990 à 2018 ..19
Figure 3 : IDE entrée nette et PIB entre 1990 à
2017 20
Figure 4 : Evolution de l'IDE par rapport à la FBCF au
Mali 20
Figure 5 : Evolution de l'investissement total public et
privé 21
Figure 6 : Comparaison PIB IDE FBCF 1990 à 2018 22
Figure 7 : Répartition de la production
d'électricité par centre en2016 .28
Figure 8 : Evolution du taux d'emploi et du taux
d'investissement au Mali ..31
Introduction
Depuis le début du XXIème
siècle, le Mali enregistre une croissance annuelle moyenne de son PIB de
l'ordre de 4,5 % par an la croissance s'est accélérée pour
atteindre 7% en 2014, son plus haut niveau depuis 2003 et demeurer robuste en
2015 et 2016 à 6,0% et 5,8% respectivement.
L'économie malienne s'est montrée
résiliente aux menaces persistantes pour la sécurité avec
un taux de croissance de 5,3% en 2017. La croissance devrait se modérer
à 5% en 2018 et se maintenir à un taux moyen de 4,7% à
moyen term (commerce & Mondiale, 2018).
Lorsque le secteur agricole et le secteur tertiaire comptent
tous les deux pour environ 40% du PIB du pays, le secteur secondaire,
principalement concentré sur la transformation des produits agricoles,
ne représente que près de 20% restants.
Quant à la contribution de l'investissement à la
création de richesse, il se situe selon les années entre 15 et 27
% du PIB, avec une légère tendance à la baisse depuis le
début de la décennie 2000. Cet investissement est
concentré dans l'extraction de minerai, de fabrication de produits
alimentaires et le bâtiment-travaux publics (BTP), l'agriculture n'en
recevant qu'une part modeste (PNISA, 2009).
L'investissement, quelque soit sa forme (de renouvellement, de
capacité, ou de productivité), constitue la clé
essentielle de l'amélioration des performances économiques.
Cependant le Mali ne manque pas de bonnes raisons d'investir parmi lesquelles
les potentialités minières et énergétiques du pays
sont en partie inexploités, l'accès au marché
régional et international est facile puisque situé au coeur de
l'Afrique occidentale et partageant ses frontières avec sept autres
Etats, le Mali est un lieu privilégié pour explorer le
marché régional. En effet tout investissement dans le pays
bénéficie d'un véritable marché commun d'environ 73
millions de consommateurs en ce qui concerne l'UMEOA et d'un vaste
marché d'environ 220 millions en ce qui concerne les 15 Etats membres de
la CEDEAO.
Les échanges commerciaux entre le Mali et les Etats
voisins seront le plus amplifiés par la mise en oeuvre de grands projets
de développement des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux :
achèvement de la route transsahélienne reliant Bamako au
Sénégal, construction d'axes routiers vers les ports de
Nouakchott, Dakar et Conakry, liaison ferroviaire entre le Mali et le Nigeria
et enfin la construction de ports fluviaux dans certaines localités
maliennes, sénégalaises et mauritaniennes visant à
désenclaver le Mali à partir du fleuve Sénégal.
Outre le contraste entre l'immensité des richesses
naturelles de notre pays et la faible capacité de transformation de ces
ressources est important comme l'atteste le patron de l'OPI : Cyril
Outre le marché régional, le Mali dispose d'un
accès privilégié au marché international :
grâce à son statut des PMA, le pays bénéficie d'une
part des avantages de l'AGOA auquel il est éligible depuis 2002 et
d'autre part d'un libre accès au marché de l'union
européenne en franchise de droits et contingent grâce à
l'initiative (tout sauf les armes). Cet accès privilégié
au marché international a eu pour conséquence une croissance
économique significative du Mali, laquelle se trouve largement au-dessus
de la moyenne des Etats de la sous-région.
Quant à l'initiative privée et les
opportunités d'investissement, le Mali est un pays traditionnellement de
négoce et de migration. L'esprit d'entreprise de sa population s'est
jusqu'ici manifesté dans les domaines du commerce, de l'hôtellerie
et de la distribution. Si en terme absolu, l'IDE demeure faible en dépit
de l'importance, les IDE en termes relatifs sont supérieurs à la
moyenne des Etats de la sous-région. Et les opportunités
d'affaires dans les divers secteurs de l'économie sont bien
exploitées.
Les potentialités qu'offre le marché
économique malien sont reflétées par la
libéralisation du secteur des télécommunications en 2001,
laquelle a permis l'émergence d'opérateurs privés dans la
téléphonie mobile qui ont tous très largement
dépassé leurs prévisions commerciales.
Nonobstant, le Mali reste un pays enclavé, avec une
économie essentiellement rurale et dépendant des aides
budgétaires (environ 40% des ressources de l'Etats) OPI, mais qui
regorge d'énormes potentialités de développement,
notamment dans les filières porteuses et propices à
l'émergence d'industrie et peut figurer parmi les nations africaines les
plus développées.
Il est déplorable le fait que le Mali, l'un des plus
grands producteurs de coton d'Afrique, continue d'importer des pagnes, des
T-shirts, du Bazin ainsi que d'autres produits dérivés du coton,
sans compter les centaines de milliards de F CFA versés à
l'économie d'autres pays à travers les importations de friperie
vestimentaire. A ce propos seulement 2% du coton malien est transformé
sur place, comme l'atteste l'organisation patronale des industries du Mali les
exportations du Mali sont également constituées à hauteur
de 90% par le secteur primaire (l'or, coton-fibre, et les animaux vivants).
C'est pourquoi, la redynamisation de notre industrie doit
être un pilier majeur pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire
porter sa contribution au PIB à 42% en 2025. Afin d'atteindre un nombre
d'entreprise industrielle comparatif à celui des pays comme le
Sénégal 3000 unités industrielles voire mieux comme la
Côte d'Ivoire 6000 unités industrielles.
Achkar. Etant donné la situation actuelle de
l'industrie malienne jusque-là embryonnaire, cela nous a poussé
à poser les questions suivantes :
? Quels sont les impacts de l'investissement en termes de
croissance économique dans le secteur industriel ?
? Quels sont les impacts de l'investissement en termes de
création d'emploi dans le secteur industriel ?
L'objectif général de cette étude est
d'analyser le rôle et l'importance de l'investissement sur la croissance
dans le secteur industriel au Mali entre 1990 et 2018. Les objectifs
spécifiques sont :
· analyser l'évolution du secteur industriel dans la
croissance du PIB malien ;
· analyser les différentes formes
d'investissement au Mali, ainsi que leurs impacts sur l'ensemble des secteurs
de l'économie puis en déduire celui de l'industrie
précisément ;
· de voir l'impact de l'évolution de ce dernier
sur la croissance de l'emploi.
Ainsi les hypothèses de notre recherche sont les
suivantes :
? L'investissement est le levier indispensable à la
croissance économique.
? L'investissement la principale ressource de la
création d'emploi dans les unités industrielles.
Afin de répondre aux problématiques et à
l'objectif général, nous allons adopter la méthode de
recherche suivante :
· Un recueillement de données auprès des
institutions et organismes concernées (INSTAT, DNI, API) et une
recherche sur internet (Banque Mondiale, Wikipédia, Cairn) des
données et documentations indispensables ;
· Une estimation économétrique par la
méthode d'Engle et Granger (1987) pour comparer les résultats
obtenus avec les études antérieurs ;
· Et le questionnement des personnes aptes à
apporter des éclaircissements pour mener à bien cette
étude.
Elle sera scindée en trois grands chapitres qui sont les
suivants :
- le premier chapitre est fondée sur une analyse
descriptive de la situation de l'investissement industriel malien ;
- le deuxième chapitre est porté sur
l'état de la littérature théorique et empirique de cette
recherche ;
- le troisième chapitre est consacré sur la
méthodologie et l'analyse empirique.
Chapitre 1 : Analyse descriptive de
l'investissement industriel
Ce premier chapitre retrace une analyse descriptive de la
situation de l'investissement industriel en Afrique subsaharienne en
général et du Mali en particulier. La première section
décrite la situation de l'investissement en Afrique subsaharienne aussi
bien actuelle que future à travers les études empiriques de
Banque Africaine pour le Développement (BAD). Dans un premier temps nous
avons les bienfaits des partenariats publics et privés pour ensuite
mettre en évidence les perspectives de développement à
travers les initiatives internationales à l'investissement en Afrique
Subsaharienne. Et la deuxième section retrace l'état de lieu du
tissu industriel et de son investissement au malien. On peut y constater
à travers des tableaux et des courbes l'évolution des
différents agrégats qui influent sur la relation entre
l'investissement, la croissance et la création d'emploi.
Section 1 : Situation des actions publiques en faveur
de l'investissement en Afrique Subsaharienne
La création d'une entreprise ou d'une installation
nouvelle nécessite un investissement et génère des postes
de travail supplémentaires. Le nombre d'emplois créés
dépend du montant de l'investissement réalisé et du
secteur d'activité. Aux effets directs, constatés au niveau de
l'unité de production, s'ajoutent des effets indirects plus difficiles
à apprécier, dûs aux interdépendances au sein de
l'économie (Jean-Claude Dutailly 1983 pp.3-14).
Ce qui sous-entend qu'en Afrique Subsaharienne,
l'investissement aussi bien public que privé reste un levier
indispensable à la relance de la croissance économique et
à la création d'emploi surtout au Mali. Pourtant les
études empiriques récentes (précisément celle de la
BAD) montrent qu'en Afrique subsaharienne, le secteur privé investit
moins que dans les pays à niveau de développement comparable. Ce
faible niveau de l'investissement privé freine la productivité du
travail, pèse sur la croissance des salaires réels et le revenu
des ménages et entrave les efforts de la région pour
améliorer la situation sociale. Consciente des effets positifs d'une
hausse de l'investissement, de nombreux pays d'Afrique subsaharienne ont donc
lancé de vastes programmes d'investissements publics pour combler des
déficits d'infrastructures importants d'une part et d'autre part le
déficit de compétence en espérant catalyser
l'investissement privé.
Quoi qu'il en soit, en raison du faible degré de
développement financier, des déficits d'infrastructure
importants, et de la rareté des ressources aussi bien humaines que
naturelles en Afrique subsaharienne, mais aussi des difficultés à
accéder aux financements extérieurs (ou à assurer le
service de la dette en résultant), l'éviction de l'investissement
privé par l'investissement public est un risque réel.
Pour ce faire le Mali comme les autres pays d'Afrique
subsaharienne, participent à des initiatives en faveur de
l'investissement étranger telles que le Pacte du G-20 avec l'Afrique
(coordination des efforts pour faciliter l'investissement privé et
améliorer l'offre d'infrastructures) et la nouvelle Route de la soie
chinoise (signé en juillet 2019 avec le Mali), qui doivent aider la
région à mieux s'intégrer dans les chaînes de valeur
mondiales. Ces initiatives visent à stimuler l'investissement
privé et public en améliorant l'environnement économique
et l'offre de financements. Les ressources pour investir seraient ainsi plus
disponibles et mieux réparties, ce qui pourrait améliorer les
perspectives de croissance à moyen terme, et améliorer les
niveaux de vie des pays bénéficiaires en passant par la
création de nombreux emploi. Il serait donc souhaitable que le Mali
promeuve d'autres modes de
financement des investissements, notamment le
développement des systèmes financiers, la conclusion de PPP et la
mobilisation accrue des recettes fiscales.
Outre ces mesures, d'autres leviers pourraient être
actionnés pour dynamiser l'investissement privé notamment :
l'IDE, les ZES et des initiatives mondiales. Ces possibilités sont
examinées ci-après.
I. Partenariat public-privé
Théoriquement, les PPP pourraient contribuer à
améliorer la qualité des infrastructures essentielles en Afrique
subsaharienne, apporter au secteur privé l'expertise requise pour
accroître l'efficience des infrastructures et atténuer certaines
des contraintes financières pesant sur l'investissement.
Dans la pratique, toutefois, l'expérience
internationale ne semble pas démontrer que les PPP sont un moyen plus
efficient de financer les infrastructures que les marchés publics. Qui
plus est, ils sont basés sur des dispositifs complexes dont les risques
budgétaires sont difficiles à évaluer (FMI, 2015). Les PPP
supposent l'adoption de cadres institutionnels et juridiques permettant de
quantifier, d'évaluer et de maîtriser les risques associés
aux projets de grande envergure et complexes, susceptibles d'engendrer un
passif éventuel et des risques budgétaires considérables.
Les PPP devraient donc être examinés avec attention.
L'Afrique subsaharienne est la région où le
ratio moyen de la valeur des PPP/PIB est le plus élevé du monde.
Depuis 2000, il est de 1,4 %, contre 1 % du PIB en moyenne ailleurs, et
reflète les besoins substantiels en infrastructures. La
répartition des PPP en Afrique subsaharienne n'est pas uniforme.
Mesurés par le ratio moyen projets PPP/PIB sur la période
2000-2016, ces projets revêtent une grande importance dans les pays
pauvres en ressources.
Depuis 2000, ces projets ont représenté en
moyenne 21/4 % du PIB dans ces pays, 13/4 % du PIB dans les pays riches en
ressources hors pétrole dont le Mali.
Les PPP sont des instruments précieux pour le
financement des investissements et donc à la création de nombreux
emplois, mais, en l'absence de compétences et de cadres institutionnels
appropriés, ils ne sont pas sans risques pour les budgets. Il serait
donc judicieux de mettre en place une formation de qualité
adéquat et aussi la création d'institutions appropriés
pour profiter pleinement les PPP.
II. Initiatives internationales de soutien à
l'investissement privé en Afrique
subsaharienne
Diverses initiatives internationales visent à soutenir
l'investissement privé en Afrique subsaharienne, notamment la nouvelle
Route de la soie et le Pacte du G-20 avec l'Afrique.
L'initiative chinoise présentée en 2013 pour
lancer la Ceinture économique terrestre et son corollaire maritime du
XXIe siècle est un cadre destiné à relier la Chine avec
l'Asie du Sud, l'Asie centrale, l'Asie de l'Ouest, l'Europe et l'Afrique par le
biais du commerce, des infrastructures, de l'investissement et de la
finance.
L'objectif est de construire un pont terrestre en
créant cinq grands couloirs économiques et des axes de transport
maritime reliant de grands ports. Les financements nécessaires à
ce projet, dont le coût pourrait totaliser 1 000 milliards de dollars sur
10 ans (essentiellement pour le développement des infrastructures),
seraient levés en Chine. En 6 ans seulement, 131 pays (dont 39 pays
africains), la Chine entend à travers cette initiative, envisager la
connexion et la coordination de la politique du développement,
d'investissements, de commerce et d'échanges humains. Ainsi cette
nouvelle route de soie est une route d'opportunité. Face aux
défis de la décroissance économique mondiale, le volume
d'investissement directs des entreprises chinoises dans ces pays
s'élève à 90 milliards de dollars, 87 parcs industriels
ont été installés dans ces pays, créant 300 000
emplois. Ce sont des éléments réels et solides qui
contribuent à la croissance économique des pays
concernés.
Il convient aussi de noter qu'en 2015, lors du dernier Forum
sur la coopération entre la Chine et l'Afrique (FOCAC), soit deux ans
après le lancement de la nouvelle Route de la soie, la Chine a plus que
doublé ses engagements 60 milliards de dollars pour financer des projets
et fournir une assistance technique afin de soutenir le développement
africain.
Aujourd'hui, face à la loi de la jungle, les pays
participants préconisent plus que jamais la paix, l'indépendance,
l'égalité et le respect. Selon confucius : "l'harmonie est
primordiale". "Une seule fleur ne fait pas le printemps, cent fleurs en plein
épanouissement apportent le printemps." De par notre expérience,
le développement est impossible sous la domination, encore moins dans
l'instabilité. "Un arbre ne fait pas la forêt."
En profitant de la relation historique datant de plus de 60
ans tout en profitant de la nouvelle route de soie, le Mali continuera de
bénéficier l'accompagnement indéfectible de la Chine aussi
bien sur le plan développement économique que social, avec des
projets stratégiques d'infrastructure comme dans le passé mais
aussi à réfléchir à de nouveaux mécanismes
de
coopération, celle de la coopération
gagnant-gagnant. Ainsi, les entreprises devront être mobilisées,
les politiques préférentielles adaptées sur mesure devront
être préparées.
Initiative internationale destinée à promouvoir
l'investissement privé dans la région subsaharienne nommée
le Pacte avec l'Afrique qui pourrait redynamiser les flux d'IDE. Il a
été lancé au début de 2017 et prévoit la
coopération du G-20, de la Banque africaine de développement, du
FMI, de la Banque mondiale et de divers pays. Il vise plus
particulièrement à coordonner les efforts des participants pour
faciliter les projets en faveur de l'investissement privé (FMI, Banque
africaine de développement et Banque mondiale, 2017).
Avec l'appui du FMI et de la Banque mondiale, le G-20 met en
place un mécanisme de suivi du Pacte avec l'Afrique pour en garantir la
continuité et la cohérence, mais aussi pour lancer des processus
d'analyse comparative et d'apprentissage par les pairs.
De manière générale, le mécanisme
de suivi servira à évaluer les progrès
réalisés par rapport aux engagements pris au titre des trois
piliers du Pacte :
? cadre macroéconomique (préservation de la
stabilité macroéconomique et investissements suffisants dans les
infrastructures),
? cadre économique (moyen d'accroître
l'attractivité des pays pour les investisseurs privés).
? cadre financier (augmentation de l'offre de financements
disponibles, à moindres coûts et à moindres risques).
En résumé, il est possible de progresser dans
plusieurs domaines de la gestion de l'investissement public au Mali, et cela
augmenterait l'efficience de ce dernier. On pourrait y parvenir en
renforçant la programmation et la sélection des PPP, la
crédibilité de la gestion pluriannuelle, l'efficacité de
l'évaluation et de la sélection des projets, le suivi de leur
mise en oeuvre et l'enregistrement des infrastructures. Le renforcement des
institutions pourrait aussi concourir à améliorer l'efficience de
l'investissement public en Afrique subsaharienne. Plus
précisément, une hausse de 10 % de l'indice du contrôle de
la corruption ou de celui de la qualité réglementaire serait
susceptible d'entraîner une réduction d'environ 12 % de
l'écart d'efficience dans les pays d'Afrique subsaharienne (pour des
résultats plus détaillés, (voir Barhoumi et al). Au Mali,
l'amélioration de l'efficience de l'investissement public est une
priorité, car le pays a encore des besoins substantiels en
matière d'infrastructures et ne disposent que d'un espace
budgétaire limité. Outre l'insuffisance des infrastructures, on
estime généralement que celles qui existent sont de
qualité relativement faible. Ainsi, la qualité de l'offre
d'électricité, des routes et du réseau ferré est
moins bien notée que celle des pays
comparables. L'efficience de l'investissement public a des
conséquences importantes non seulement sur la croissance
économique mais surtout sur la croissance du taux d'emploi à
travers la formation adéquate. Comme nous allons le démontrer
dans la suite de cette recherche, l'existence d'une corrélation entre
l'investissement public, privé et la croissance économique mais
également une corrélation entre l'investissement et la
création d'emploi.
Section 2 : Etat du parc industriel et de son
investissement au Mali
I. Généralité
Le recensement industriel réalisé en 2015
dénombre 829 entreprises industrielles dont 765 en activité. La
plupart, 52,69 %, sont installées dans le district de Bamako. Les
entreprises industrielles employaient 30438 personnes selon le dernier rapport
corrigé en 2015, contre 13127 personnes en 2002. La valeur
ajoutée créée par le secteur industriel s'est
élevée à 398,06 milliards de F CFA en 2010 ; 442,31
milliards en 2011 ; 1 289,09 milliards en 2012 ; 1 465,64 en 2013 et 782,48
milliards en 2014. Le taux d'accroissement annuel moyen a été de
11,11 % en 2011, 191,44 % en 2012, 13,69 % en 2013 et - 46,61 % en 2014. Il
s'agit essentiellement d'industrie de transformation de la production agricole
: biscuiterie, pâtes alimentaires, confiserie, conserverie, brasserie,
boulangerie, huilerie, sucrerie, laiterie, usine textile et de tabac. La plus
grande partie de la population travaille dans le secteur informel.
Tableau 1 : Statuts juridiques des entreprises maliennes de 2009
à 2011
Forme juridique
|
2009
|
2010
|
2011
|
Commerce général
|
792
|
2195
|
2546
|
Commerce Import-Export
|
80
|
184
|
184
|
Autres formes d'entreprise individuelle
|
157
|
356
|
314
|
Groupement d'Intérêt Général
|
110
|
341
|
229
|
Société à Responsabilité
Limitée
|
535
|
1474
|
1818
|
Société Anonyme
|
44
|
131
|
132
|
Total
|
1718
|
4681
|
5223
|
|
Source : API
Tableau 2 : Situation des unités industrielles entre
2015 et 2016
Situation en 2016
|
Nombre d'entreprises
|
%
|
A l'arrêt
|
21
|
2,16
|
En activité
|
878
|
90,14
|
Fermée
|
71
|
7,29
|
Liquidée
|
4
|
0,41
|
Totale
|
974
|
100
|
|
Source : Rapport d'activité annuel DNI 2016
Figure 1 : Evolution du nombre des entreprises industrielles de
2003-2015
829
1000
|
|
Nombre d'entreprises industrielles
|
|
|
|
|
|
|
|
243
0
2003 2006 2010 2015
Source : Rapport des recensements industriels
2015
A. L'investissement intérieur
Il est mesuré à travers la formation brute de
capital fixe a beaucoup évolué sur la période 20002017. Il
est passé de 521 million $ US en 2000 à 3 146 million $ US en
2017. Au Mali, la FBCF publique est estimée en comptabilité
nationale comme une dérivée de la dépense d'investissement
inscrite au budget de l'Etat, corrigée des dépenses ne concourant
pas à la formation d'actifs durables.
Figure 2 : Evolution de la formation Brute de Capital Fixe et
du produit intérieur brut du Mali 1990-2018 (FCFA)
100000 80000 60000 40000 20000
0
|
|
2000 1500 1000 500 0
|
|
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIB (FCFA) FBCF ( FCFA)
Source : perspective monde (Banque Mondiale)
Cette courbe de la FBCF du Mali sur la période
1990-2017 apparait croissante et continue de 521 millions $ US à 3 146
millions $ US. Cependant en 2012 il marque une chute due à la crise
politique et sécuritaire du pays.
Nous pouvons constater à travers cette figure qu'il
existe une forte dépendance entre le PIB et de la FBCF au Mali entre la
période d'étude.
L'étude sur 27 ans de l'effort d'investissement public
(FCBF public) du Mali fait ressortir les tendances suivantes : la part de
l'investissement public dans le PIB est en baisse constante sur la
période ; elle est très volatile, avec un écart moyen de
1.7 % de PIB d'une année sur l'autre et, depuis 2011, le Mali
décroche de l'UEMOA. Au final, le retard pris par le Mali sur la moyenne
de l'UEMOA atteint 4 % de PIB en 2015. Ces tendances peuvent s'expliquer par
une progression du PIB assez forte sur la période
considérée (4.6 % en moyenne annuelle) qui ne s'est pas
accompagné d'une croissance équivalente de l'investissement
public, la forte vulnérabilité de l'investissement public
à la volatilité des financements extérieurs, et l'effet
des chocs macroéconomiques et géopolitiques, en particulier celui
de 2012 (Guide d'investissement au Mali).
B. L'Investissement Direct Etranger (IDE) au Mali
Les pays les moins avancés (PMA) qui cherchent
à réaliser pleinement leur potentiel de croissance
économique et de développement sont confrontés à de
nombreux obstacles.
La faiblesse de l'investissement, y compris de
l'investissement direct étranger (IDE), constitue à cet
égard un problème majeur pour ces pays.
Source : Perspective monde
Dans le secteur bancaire, les capitaux marocains sont très
engagés et se sont renforcés dans ces dernières
années à travers la BIM (groupe Attijariwafa Bank), la BOA-Mali
(BMCE Bank) et la banque Atlantique Mali.
Les secteurs du BTP, de l'industrie de transformation et de la
distribution attire des capitaux chinois sans qu'il soit toutefois possible
d'identifier les montants de manière précise.
Figure 3 : IDE entrée nette (FCFA) et PIB (FCFA) entre
1990-2017
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
100000 80000 60000 40000 20000
0
|
Titre du graphique
|
5000 4000 3000 2000 1000 0
|
|
|
PIB (FCFA) IDE (FCFA)
Source : Perspective monde (Banque
Mondiale)
Les investissements directs étrangers (IDE) ont
augmenté à partir des années 2000 tant en termes de flux
que de stock et ont évolué en fonction de l'ouverture du pays aux
échanges commerciaux et des performances du secteur privé.
Sur la période 2000-2017 on enregistre une moyenne
annuelle de 250 887 332 $ US. Le stock d'IDE s'est élevé à
3 325 milliards $US en 2013 contre 8 279 $US pour la Cote d'Ivoire et 5 031 $US
pour le Niger. Cette croissance s'explique par l'augmentation des exportations
d'or et de coton ayant contribué pour 81% aux recettes dans les
années 2000.
Pourtant les performances du secteur des IDE demeurent encore
freinées par un manque de développement du milieu des affaires
délimitant à certaines activités commerciales.
Figure 4 : Evolution de l'IDE par rapport à la FBCF au
Mali
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
-500
IDE (FCFA) FBCF (FCFA)
Figure 5 : Evolution de l'investissement Total, Public et
Privé
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
|
|
|
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015
|
|
Investissement public Investissement privé Investissement
total
Source : Perspective monde (Banque Mondiale)
II. Investissement industriel et la croissance
économique au Mali
La contribution du secteur secondaire dans le PIB demeure
minoritaire, représentant 22.37% du PIB en 2014. Elle a toutefois
été croissante depuis les années 2000, avec un taux moyen
ayant augmenté de 4.4 % annuellement sur la période 1999-2013.
Ses performances sont attribuées à la branche "Autres
activités industrielles", qui contient la sous branche
"métallurgie et fonderie" reste prépondérante. Elle
représente près de 39% de la valeur ajoutée du secteur
dont 25% pour la sous branche "métallurgie et fonderie" (Production
d'or). Cette dernière branche est celle qui a connu la plus grande
progression en lien avec l'essor de la production d'or. En effet, de 16% du PIB
du secteur secondaire en 1999, elle est remontée à environ 39% de
celui-ci en 2006 (production record d'or) pour ensuite se stabiliser à
27% sur le reste de la période.
La branche BTP occupe aussi une place importante dans
l'économie malienne. Elle représente en moyenne 31% du PIB du
secteur secondaire. L'essor de cette branche est à mettre en rapport
avec les grands travaux de construction entrepris par l'Etat au cours de ces
dernières décennies jusqu'en 2011 avec en moyenne 33% du PIB du
secteur. Sur les deux dernières années, le poids du BTP tombe en
moyenne à 20% soit une perte de plus 10 points de pourcentage en
relation avec l'arrêt ou la suspension de la plupart des travaux publics
à la suite de la crise de 2012.
La part de la branche Industries agroalimentaires est
restée stable dans le secteur secondaire et ressort en moyenne à
17% de la valeur ajoutée total du secteur.
Quant au secteur textile, sa part reste faible (10% en 2012
taux le plus élevé depuis 2000) mais en progression
parallèle avec l'évolution de la filière coton depuis la
libéralisation du secteur en 2002 et la croissance de la demande des
entreprises chinoises.
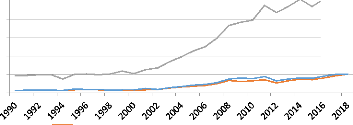
Cependant l'économie malienne est dominée par le
secteur informel. Ce secteur regroupe les entreprises appartenant à des
ménages. Ces entreprises ne constituent pas des entités
juridiques distinctes et indépendantes des membres du ménage
à qui elles appartiennent. De manière pratique, le secteur
informel est composé d'unités de production qui ne produisent pas
de documents comptables et/ou ne disposent pas d'un numéro
d'enregistrement (statistique, fiscal ou registre de commerce).
Le secteur informel contribue pour près de 55% du PIB.
Hors secteur primaire, il ne représente que 22% du PIB.
Par secteur, l'informel représente près de 98%
du secteur primaire et 66% du secteur tertiaire. Son poids dans le secteur
secondaire reste relativement plus faible que dans les autres secteurs avec
seulement 22% INSTAT 2015.
Les investissements des sociétés
minières étant la principale source d'investissements
étrangers au Mali, ce ralentissement se traduit par une chute des
investissements directs étrangers au Mali. Ceux-ci sont tombés
à 308 millions de dollars en 2013, soit une chute de plus de
moitié depuis un pic à 650 millions de dollars en 2009. A titre
de comparaison, les fonds d'aide au développement versés au Mali
représentaient 1,4 milliards de dollars en 2013. Ces investissements
étrangers sont accompagnés de transfert de capital et de
technologies qui bénéficient au pays par-delà leur valeur
monétaire en renforçant la productivité de son
économie sur le long terme.
Figure 4 : Comparaison PIB, IDE et FBCF au Mali de 1990 à
2018
14
|
000
|
000
|
000
|
000,00
|
12
|
000
|
000
|
000
|
000,00
|
10
|
000
|
000
|
000
|
000,00
|
8
|
000
|
000
|
000
|
000,00
|
6
|
000
|
000
|
000
|
000,00
|
4
|
000
|
000
|
000
|
000,00
|
2
|
000
|
000
|
000
|
000,00
|
|
|
|
|
0,00
|
|
FBCF (FCFA) IDE (FBCF) PIB Réel
(FCFA)
Source : Perspective Monde (Banque Mondiale)
Ici on peut constater qu'il existe une corrélation
assez forte entre la croissance et l'investissement. Bien que d'autres facteurs
jouent un rôle crucial à l'accroissement du PIB telle que la
consommation, mais une baisse de l'investissement peut entrainer une baisse de
la
croissance par le biais de la vétusté des
capitaux existants. Par exemple entre 2001 le taux d'investissement n'a pas eu
assez d'impact sur la croissance du PIB qui a atteint son taux le plus
élevé depuis 20ans, mais cette augmentation du P113 est due
à la consommation finale à l'approche de la Can 2002. Par contre,
un ralentissement de 11.5% des investissements total à entrainer une
récession de (-0.8%) du P113, phénomène dû à
la crise multidimensionnelle de 2012.
1. Situation de l'activité extractive
Moteur de croissance pour l'économie malienne.
L'activité extractive est une source essentielle de revenus pour l'Etat
Malien. Elle contribue à la création de valeurs à travers
les exportations et l'emploi. Elle est aussi accompagnée d'un transfert
de capital et de technologie vers le Mali. La demande et l'investissement
qu'elle génère crée un effet multiplicateur positif (mais
limité) dans l'économie locale qui s'ajoute aux initiatives de
développement communautaire que les sociétés
minières financent. La présence d'une mine industrielle dans les
environs d'un village stimule l'activité économique locale. Le
niveau d'intensité lumineuse des villages à proximité des
mines (intensité lumineuse capturée par satellite et
corrélée au niveau de développement économique)
suggère que ces villages se développent plus vite que les autres
communautés rurales. L'indice de développement communautaire
produit par l'ODHD confirme cette tendance et montre un net avantage de
développement pour les villages avoisinant les mines industrielles.
L'activité minière stimule ainsi le
développement régional et permet de désenclaver les
communes où elle prend place.
La crise politique et sécuritaire de 2012 a
montré que l'orpaillage aussi avait une forte importance pour
l'économie malienne en tant que sources de travail et de revenus,
fournissant à nombre de maliens une activité alors que nombre de
secteurs économiques étaient durement touchés. A travers
ses investissements et sa consommation, l'activité minière est un
moteur du développement économique régional.
Les mines industrielles en production sont
opérées par huit sociétés venant de sept pays
différents : le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Grande
Bretagne et l'Allemagne. La société, Wassoul'Or, seule
société qui appartient à un privé malien et l'Etat
malien. L'Etat détient 20% du capital social dans toutes les autres
à l'exception de la SEMOS S.A dans laquelle sa participation
s'élève à 18%.
1.1. L'activité d'extractive et la croissance
L'impact de l'activité minière sur le reste de
l'économie n'est pas seulement une question de revenus fiscaux et de
dépense des salaires mais dépend aussi de l'intégration du
secteur minier avec les autres secteurs de l'économie, en amont et en
aval. En plus de ces relations directes entre entreprises et fournisseurs ou
sous-traitants, l'activité minière contribue à
l'agrandissement et à la création de villages en
générant mouvements de population et nouvelles activités
économiques. Le Mali est devenue le troisième producteur d'or en
Afrique (derrière l'Afrique du Sud et le Ghana) avec une production de
63 tonnes en 2002, production qui a doublé entre 2000 et 2002. En 2006,
la production était de 61,3 tonnes. Entre 1997 et 2005, la production
d'or a rapporté au Mali plus de 600 milliards de francs CFA. L'or est la
première exportation avec 394,4 milliards de francs CFA en 2006. L'or
représente 15 % du PIB et 70 % des recettes d'exportation. De nouvelles
mines d'or devraient être ouvertes en 2009 : Kara koto (région de
Kayes), Syama et Kodaira (région de Sikasso). En 2014, le secteur minier
représentait près de 6% du produit intérieur brut (PIB),
soit 345 milliards de FCFA. La vaste majorité (plus de 90%) de cette
contribution vient de l'activité aurifère.
D'après des estimations avancées lors du forum
sur l'orpaillage en septembre 2014, la production aurifère artisanale
représentait presque 15% de la contribution du secteur minier au PIB en
2012. Cela implique que l'orpaillage représenterait un peu plus de 1% du
PIB.
Au cours de la dernière décennie, la valeur
ajoutée produite par le secteur minier a augmenté de 244
milliards de FCFA en 2006 à 345 milliards de FCFA en 2014, avec un pic
à 422 milliards de FCFA en 2012 grâce à un prix de l'or
particulièrement fort sur les cours internationaux. La chute de la
contribution du secteur minier au PIB en 2010 est liée à un
ralentissement de la production dans les mines vieillissantes de Yatéla
et Sadiola qui s'approchent de la fermeture. L'ouverture des mines de Syama et
de Gounkoto ont permis depuis à la production aurifère de croitre
à nouveau.
La valeur ajoutée du secteur minier a cru de 43% sur
dix ans alors que le PIB du pays a cru de 85% pendant la même
période. Le PIB du pays augmentant plus vite que la valeur
ajoutée du secteur minier, la contribution du secteur a diminué
de manière non linéaire de 7,5% en 2006 à 5.8% en 2014,
même si sa contribution en valeur absolue a augmenté.
Si la production d'or représentait moins de 6% du
produit intérieur brut en 2014, elle compte pour presque un quart du
revenu de l'Etat (275 milliards de francs CFA) et 66% des exportations du pays.
Les statistiques provisoires de la Cellule de Planification et de Statistique
du Ministère des Mines montrent une stabilisation de la production
aurifère autour de 50 tonnes entre 2012 et 2014. Le Mali est le
troisième producteur aurifère africain et le treizième
producteur mondial.
En 2002, l'homme d'affaires et entrepreneur Aliou Diallo a
fondé "WASSOUL'OR SA" et ouvert, en 2012, la première mine d'or
industrielle au Mali à capitaux essentiellement nationaux. S'engageant
pour le respect de l'environnement, Aliou Diallo prohibe l'utilisation du
cyanure pour l'eau dans le traitement du minerai. En parallèle à
l'activité de Wassoul'Or, il développe un programme de lutte
contre le chômage et la pauvreté et de développement local
en faveur des populations. Cette initiative comprend la construction d'une
mosquée, de salles de classes, retenue d'eau et d'un dispensaire.
Un modèle économique s'intéressant aux
inputs et outputs des mines industrielles du Mali montre que la richesse
créée pour l'économie malienne de l'activité
minière était équivalent à une fois et demie la
valeur de l'or produit. Cela signifie que pour chaque franc d'or produit par
les mines industrielles maliennes, l'équivalent de 1,50 francs de
richesse est créé au Mali.
A titre de comparaison, pour chaque dollar de coton produit,
la valeur ajoutée pour l'économie malienne est estimée
à 2,28 francs, et pour chaque franc de produit agricole, 1,94 francs. Le
modèle s'intéresse aux dépenses des mines industrielles et
aux activités économiques créées par ces
dépenses. Il suggère que l'équivalent de 20% de la valeur
de l'or produit était consommé lors de la production pour acheter
du pétrole et 8% pour acheter des manufactures produites localement. Le
modèle s'intéresse aussi à l'utilisation de l'or produit.
Il montre que 94% de l'or produit était directement exporté. Bien
que ces résultats soient hautement imprécis, ils suggèrent
que l'impact économique indirect du secteur minier industriel est
relativement limité comparé à d'autres secteurs
économiques.
Les mines industrielles consomment de large quantité
de fuel, de produits chimiques, de matériel, de pièces de
rechange et de services divers et variés. Elles contractent des
sous-traitants pour de nombreuses activités, allant de l'extraction et
le transport de minerai, à la production d'électricité, la
restauration et la sécurité. Faute d'une capacité locale
pour produire ces biens et ces services, les sociétés
minières ne peuvent s'approvisionner localement que de manière
très limitée. Elles doivent apporter la majorité de ces
biens et ces services de Bamako ou les importer de l'étranger. Le
carburant est généralement fourni par des sociétés
maliennes, ainsi qu'une partie des pièces mécaniques et des
composants électriques et électroniques.
1.2. L'activité d'exploitation de carrière
et la croissance
Par ailleurs il existe bien d'autres activités
minières comme l'exploitation de carrière. Ces carrières
contiennent du calcaire, du marbre, de la dolomie, de la dolérite, du
granite, du grès, du schiste, du gravier, du sable, de l'argile et de
l'Alhor. Seuls le calcaire, la dolomie, le marbre et la dolérite sont
exploités industriellement. Les autres matériaux sont
exploités artisanalement.
Six carrières industrielles sont en opération
au Mali. STONES exploite le marbre de Sélinkégni dans la zone de
Bafoulabe. Une carrière de dolomie est exploitée dans la
région de Bafoulabe, comme amendement de sol.
Trois carrières produisent de la dolérite aux
alentours de Bamako (Nord de Kati, et Mountougoula). WACEM (West African
Cement) exploite un gisement de calcaire à Gangontéry et dispose
d'une unité de broyage et d'une usine de ciment. WACEM (Diamond Cement)
a produit 600.000 tonnes de ciment en 2014 et compte produire 750.000 tonnes en
2015. En plus de la création d'emplois et de valeur ajoutée,
l'implantation d'une cimenterie a permis une baisse du prix du ciment sur le
marché local (de 125.000 FCFA/tonne à 80.000 FCFA/tonne) et une
diminution des importations de ciment.
1.3. L'extraction artisanale et la croissance
Les mines artisanales au Mali produisent en moyenne quatre
tonnes d'or par an selon les informations de la BECAO. Ce chiffre sous-estime
probablement la réalité. Si les exportations des mines
industrielles sont enregistrées dans leur quasi-totalité par les
statistiques officielles, une partie significative de l'or produit de
manière artisanale y échappe probablement.
L'activité minière artisanale a aidé
à combattre au Mali une pauvreté rurale croissante. Cette
pauvreté a été exacerbée par de nombreuses
sècheresses et par la crise politique et économique de 2012.
L'orpaillage, en particulier, a été décrit, lors du forum
sur l'orpaillage tenu à Bamako en septembre 2014, comme un sous-secteur
vital de l'économie permettant de faire vivre près de deux
millions de personnes.
1.4. Les recettes fiscales de l'activité
extractive
Les recettes fiscales tirées de l'activité
minière ont cru de 13% annuellement en moyenne de 2006 à 2014.
En dépit d'une chute de la production minière
et des investissements miniers depuis la crise de 2012, la contribution du
secteur minier s'est maintenue à plus de 25% du budget malien,
atteignant 275 milliards de francs CFA en 2014.La rente minière a fait
rentrer presque 1.200 milliard de francs CFA dans les caisses de l'Etat au
cours des cinq dernières années, sous forme d'impôts (62%),
droits de douane (18%) et de dividendes, de taxe ad valorem et de redevances
superficiaires (21%).
L'Etat malien détient entre 18 et 20% de parts dans
chaque projet aurifère sur son territoire. Il est un partenaire
silencieux dans la gestion des mines et se contente de recevoir les
dividendes
correspondants. Ces dividendes représentaient sous
forme de taxes domaniales 22% des recettes de l'Etat en 2012.
La patente est la principale taxe allant de la mine aux
collectivités locales. La Commune est censée recevoir 60% de
cette patente, le Cercle 25% et la Région 15%. Cette taxe transite par
le budget central de l'Etat et le Trésor Public, et il est difficile
d'évaluer exactement la valeur des patentes effectivement
transférée aux différents niveaux de gestion territoriale.
La patente ne commence à être payée par la
société minière que cinq ans après le début
de la production. L'apport de l'activité minière artisanale au
budget de l'Etat reste inexistant. Les autorités traditionnelles et les
maires soulèvent des impôts sur l'accès aux sites miniers.
Par exemple, le coût de l'accès à un site d'orpaillage est
compris dans le code minier entre 10.000 et 12.500 francs CFA en fonction de la
qualité du minerai exploité. A cela peut aussi s'ajouter le
prélèvement d'une partie de la production. Le coût d'une
carte d'orpaillage est fixé entre 2.500 et 10.000 francs CFA.
2. L'activité de fabrication
Sur les 878 entreprises industrielles au Mali, 753
entreprises appartiennent à l'activité de fabrication soit 80.7%
en 2015 des emplois permanents dans l'ensemble des emplois créent par le
secteur industriel avec une contribution au PIB de 15.3% en 2011 et 14% en
2015. Et en termes de valeur ajoutée, cette section a contribué
à hauteur de 379 milliards de F CFA en moyenne entre 2010 et 2014 contre
un investissement de 82 504 millions de F CFA en moyenne de la même
période selon le dernier recensement industriel 2015. Quant à sa
contribution au budget de l'Etat malien, la section `'activité de
fabrication» a payé 18 926 millions de F CFA à titre
d'impôts et taxes en moyenne entre 2010 et 2014. Il regroupe les
entreprises agro-industrie du Mali permettant la transformation des
matières premières issues de l'agriculture, de la pêche et
de la foresterie.
L'agro-industrie est l'un des plus grands secteurs
économiques du Mali. Il réunit toutes les entreprises qui
touchent à l'alimentation ainsi qu'à l'agro-industrie. Cependant
les branches les plus importantes sont : la fabrication produit alimentaires,
édition ; imprimerie et reproduction d'enregistrements ; fabrication de
produits chimiques. Au total ces (03) branches représentent 84.1% des
entreprises de la section `' Activités de fabrication `'.
Par ailleurs cette section attire d'ample projet
d'investissement notamment dans le domaine d'agro-industrie qui sont en cour de
réalisation parmi lesquels :
? Une unité industrielle d'extraction, de raffinage et
de production d'huile de riz prévoyait un investissement de 7 000
millions.
? Une unité Agro-industrielle de transformation pour la
commercialisation du sésame SITAMA.
Pour les projets d'investissement déjà
réalisés récemment (2015-2016) nous avons :
? Une unité Agropole de Kamalé-projet ICS par
SCS international a récemment fait un investissement de 7 383 millions
dans la filière mangue. La mangue étant le premier fruit
d'exportation du Mali avec une production potentielle d'environ 575 00 tonnes,
dont 200 000 tonnes pouvant être commercialisées ou
transformées. En 2016, il a été exporté 40 457
tonnes de mangues fraiches. Le chiffre d'affaires de la filière en 2016,
s'est élevé à environ 15 milliards de F CFA, dont 11
milliards pour l'exportation de la mangue fraiche.
3. Section production et distribution
d'électricité, de gaz et d'eau
La consommation énergétique provient en grande
partie (81 %) du bois et du charbon de bois, largement devant les produits
pétroliers (16 %) et l'électricité (3 %). Cette
surconsommation des produits du bois (6 millions de tonnes en 2002) crée
une pression trop forte sur les forêts et accélère la
désertification.
En 2015, le taux d'accès à
l'électricité est de 55 % en zone urbaine et de 15 % dans les
zones rurales. Pour favoriser l'électrification des zones rurales, le
ministère de l'énergie et des mines a créé l'Agence
malienne pour le développement de l'énergie domestique et de
l'électrification rurale (AMADER).
D'importantes coupures d'électricité continuent
d'avoir lieu dans les mois de mai et juin, quand les barrages n'ont pas
recueilli assez d'eau.
Plusieurs villes ainsi que la capitale sont privées de
courant plusieurs heures par jour. Cela est particulièrement dommageable
pour les industries et les services.
Production brute totale + achats :
1 905 232,44

20%
11%
7%
62%
production centre isolés Achat
production thermique production hydraulique
Figure 5 : Répartition de la production
d'électricité par centre en 2016
Les potentiels énergétiques : Ressources
hydrauliques :
· Puissance totale de sites identifiés : 1150 MW
;
· Sites aménagés : 31 % du potentiel national
(Félou 60 MW, Sotuba 5,2 MW, Sélingué 44 MW, et Manantali
200 MW). Ressources solaires et éoliennes :
· 5 à 7 kWh/m2/jour de rayonnement solaire bien
reparti sur le territoire national disponible pendant plus de 300 jours par
an.
· 3 à 7 m/s en moyenne annuelle dans les zones
sahéliennes et sahariennes du pays.
Source : EDM-SA, Rapport annuel
d'activités 2016
En réalité comme le secteur de l'énergie,
le secteur de l'eau est l'un des secteurs clés du développement.
Afin de satisfaire le besoin de la population en eau potable, le gouvernement a
mise en place plusieurs programmes parmi lesquels : le Programme d'Urgence
Sociales d'accès à l'Eau Potable (PUS-AEP). Ledit programme est
exécuté par les deux (02) structures : SOMAGEP-SA et
SOMAPEP-SA.
Depuis son exécution, il a été
opéré une extension du périmètre de concession de
la SOMAPEP-SA, à tous les chefs-lieux de cercle, les localités
frontières et autres centres spécifiques, portant la taille du
périmètre de 18 centres en 2016, à 74 centres en 2017.
Par ailleurs le nombre de villages/sites dépourvus de
point d'eau potable (abstraction faite des hameaux et quartiers
éloignés) a été réduit de 2226 à
l'issus de l'inventaire de 2003 à 1269 au 31 décembre 2017.
Tableau 3 : Chiffres clés de la SOMAGEP-SA
|
Réalisations
|
2016
|
2017
|
|
Production Eau en (millions de m3)
|
99.58
|
105.07
|
|
Evolution du nombre d'abonnés à l'eau
|
187 467
|
200 588
|
|
Taux d'accès à l'eau potable (pop
2009)
|
|
|
|
En milieu rural
|
65.3%
|
65.3
|
|
En milieu urbain et semi urbain
|
70.6%
|
74.7%
|
|
National
|
66.9%
|
68%
|
|
Taux de facturation
|
76.2%
|
74.6%
|
Source : SOMAGEP-SA
Ce faisant, le taux d'accès reste stagnant à
65.3% en milieu rural, avec une augmentation de 4.1% en milieu urbain et semi
urbain et de 1.1% au niveau national, par rapport à 2016. Selon
la même source 13 297 nouveaux branchements
réalisés en 2017 sont constitués de 176 bornes fontaines
et 13 121 branchements particuliers, soit 504 EPEM.
Au titre de l'année 2017, les dotations budgétaires
et l'exécution financière tant au niveau du budget national qu'au
niveau des financements extérieurs se présentent comme
indiqué dans le tableau ci-dessous :
Tableau 4 : Budget et réalisations 2017
|
En FCFA
|
Dotation
|
|
Réalisation
|
|
Budget national
|
3 352
|
495
|
000
|
3 352
|
494
|
000
|
|
Ressources extérieures
|
138 518
|
030
|
511
|
51 961
|
903
|
383
|
|
Total
|
141 870
|
525
|
511
|
55 314
|
397
|
383
|
|
Part des ressources propres
|
2.36
|
|
|
6.06
|
|
|
|
Part des ressources extérieures
|
97.64
|
|
|
93.94
|
|
|
Source : DNH
Ici l'écart considérable qui existe entre le
financement extérieur et celui du budget national est le résultat
de l'appui des partenaires technique et financiers des programmes
d'amélioration de la qualité et de la durabilité du
service de l'eau.
III. Investissement industriel et création d'emploi
au Mali
1. Situation de l'emploi au Mali
Depuis plus d'une décennie, le Mali a marqué un
fort engagement en faveur de l'emploi. Il a été un des premiers
pays de la sous-région à formuler une Politique de l'emploi en
1998. Par ailleurs, le Président du Mali a fait de cette question un axe
central de son Projet de Développement Economique et Social 2007-2012
(PDES), reconnaissant ainsi la création d'emplois comme vecteur de
transmission de la croissance à la réduction de la
pauvreté. Dans un contexte de forte croissance démographique, le
pays fait aujourd'hui face à d'importants défis en matière
d'accès aux services sociaux de base, d'urbanisation rapide et de
pressions sur les ressources naturelles.
Tableau 5 : Répartition des actifs occupés selon
la branche d'activités 2007 et 2010 en fusion avec l'emploi total
|
Branches d'activités
|
2007
|
2010
|
|
% emploi total
|
% emploi total
|
|
Secteur primaire
|
60
|
63
|
|
Secteur secondaire
|
14
|
11
|
|
Secteur tertiaire
|
26
|
26
|
|
Total
|
100
|
100
|
Source : EPAM 2007 et 2010
Ce tableau nous montre clairement que la part du secteur
secondaire est assez modeste à l'instar des autres secteurs. Cependant
ce chiffre signifie non seulement que le secondaire n'est pas à forte
utilisation de capital humain mais de capital physique mais aussi du
caractère jusque-là embryonnaire de ce secteur au Mali.
Figure 8 : Evolution du taux d'emploi et du taux d'investissement
au Mali
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018

20
15
10
5
0
Taux d'emploi total (%) Taux d'investissement total (%)
Source : Perspective monde
D'après le calcul du coefficient de corrélation
entre l'investissement et l'emploi qui donne 0,877. On peut constater qu'il
existe une forte corrélation entre ces deux variables. Cependant le cas
malien est assez particulier, puisqu'une grande partie des investissements
venus de l'étranger est destinée au secteur industriel, pourtant
ce secteur emploie plus de capital physique au détriment de main
d'oeuvre.
Selon les statistiques du Ministère des mines,
l'activité minière industrielle n'est qu'une source
limitée d'emploi, en particulier une fois la phase de construction
terminée, ce qui peut être source de mécontentement pour
les populations locales. L'orpaillage au contraire est une source importante de
travail pour de nombreux maliens.
L'activité minière industrielle employait un
total de 12,000 travailleurs (permanent et non permanent) et 8,000
sous-traitants en 2014. En comparaison, il est généralement
estimé que
l'orpaillage fournit une activité économique
à plus de 200,000 personnes. Il n'y a pas de statistiques officielles
sur les autres activités minières artisanales.
2. Effets collatéraux des investissements
industriels sur l'emploi
En plus des emplois directs générés par
l'activité minière (main d'oeuvre de la société
minière, sous-traitants, ou mineurs artisanaux), l'activité
économique d'un site minier est aussi source d'un grand nombre d'emplois
dérivés, visant à satisfaire les besoins des mineurs et de
la population grandissante.
Aussi les formations organisées par les
sociétés minières pour leurs travailleurs varient d'un
site à l'autre. Elles se concentrent généralement sur des
questions techniques ou de sécurité. Ces formations
améliorent la productivité, l'employabilité et les
perspectives économiques de la main d'oeuvre locale.
IV. Politique de Développement Industriel (PDI) et
d'emploi au Mali
Le développement industriel a toujours
été placé au centre des préoccupations des
différents gouvernements successifs. Celui-ci devrait permettre la
modernisation des différents secteurs de l'économie et la
valorisation des principales productions brutes de l'agriculture, de
l'élevage, et de la pêche et des mines.
1. Politique de Développement Industriel
(PDI)
L'actuel document de Politique de développement
Industriel (PDI) a été adopté en mars 2010, avec son plan
opérationnel 2010-2012. Ce plan d'action a été
évalué en 2014 et un nouveau plan d'action 2015-2017 a
été adopté en mai 2015.
L'objectif général de la PDI demeure un
développement industriel ordonné, rapide, durable et
équilibré, générateur d'emplois, permettant au
secteur secondaire d'atteindre une contribution à la formation du
produit intérieur brut (PIB) de 20% en 2012 et 42% en 2025. Il
s'articule autour de trois objectifs spécifiques, à savoir :
Objectif spécifique 1 : Améliorer
l'environnement des entreprises industrielles pour attirer les investisseurs et
faire du secteur privé le vecteur de la croissance économique.
Objectif spécifique 2 : Améliorer la
compétitivité des unités industrielles existantes afin
qu'elles puissent poursuivre leur modernisation industrielle et
pénétrer des marchés d'exportation avec des produits
à plus forte valeur ajoutée.
Objectif spécifique 3 : Encourager la
création de nouvelles unités industrielles et l'utilisation des
meilleures idées, technologies, techniques et méthodes en
s'appuyant sur les actifs de la propriété intellectuelle.
2. Politique d'emploi au Mali (PE)
L`emploi est une priorité du gouvernement malien. C'est
souligné dans les deux documents de référence de la
politique économique, le Programme d'Actions du Gouvernement (PAG
20132018) et le Cadre Stratégique pour la Croissance et la
Réduction de la Pauvreté (CSCRP 20122017). L'adoption par le
Conseil des Ministres du 18 mars 2015 d'une nouvelle Politique Nationale de
l'Emploi (PNE) et de son Plan d'Actions Opérationnel (PAO) pour la
période 2015-2017 est une autre expression de cette priorité. La
politique de l'emploi contribue à l'efficacité économique
et la justice sociale. Elle a deux fonctions principales. La première
est d'augmenter le nombre d'actifs (occupés et non occupés) et
d'améliorer les compétences et la productivité des
participants aux dispositifs de l'emploi. Par là-même, la
politique de l'emploi concourt à l'augmentation de la croissance
économique et du PIB. La seconde fonction est d'aider les groupes
rencontrant des difficultés à accéder à un travail
et à une rémunération.
2.1. Structure et dynamique de l'emploi du Mali
Le Mali connait une forte croissance démographique qui
se traduit par une augmentation rapide de la population active. La majeure
partie des actifs travaille dans le secteur primaire et le secteur tertiaire,
63% et 25% respectivement et le reste dans le secteur secondaire. Et le secteur
formel, privé et public, n'emploie que 6% des actifs occupés.
Selon les projections du BIT, la population active au Mali
croître à un rythme soutenu et devras continuer de croître
au cours des années à venir, entre 2,9 % et 3 % par an, soit
environ 150 000 actifs. Ce chiffre prend en compte les entrées sur le
marché du travail ainsi que les sorties pour raison d'âge ou
autres raisons. Le nombre brut d'entrées est bien sûr beaucoup
plus élevé. Il était estimé à 278 000 en
2010 et devrait atteindre 434 000 en 20132. Les données de
l'EMOP confirment que le chômage touche plus les jeunes que les actifs
plus âgés.
2.2. Les défis et les dispositifs de la Politique de
l'Emploi au Mali 2.2.1. Les défis majeurs
Le premier défi concerne l'augmentation rapide de la
population en âge de travailler et les grandes difficultés
d'insertion professionnelle des jeunes.
Le deuxième défi concerne l'importance des
emplois informels, c'est-à-dire des emplois qui ne sont pas soumis aux
dispositions de la législation du travail ou qui sont exercés
dans des entreprises sans comptabilité ou sans immatriculation fiscale.
Au Mali, selon les données les plus récentes de l'EMOP, les
emplois informels constituent plus de 9 emplois sur 10. La
2 Beaujeu et al. (2011), p. 175.
majeure partie de ces emplois se trouve dans l'agriculture,
même si une part non négligeable se trouve dans le secteur des
services et à un degré moindre dans l'industrie.
Le troisième défi, l'autre face de la même
pièce, est la faible proportion d'emplois formels dans le secteur
privé ou public. Ces emplois constituent moins d'un emploi sur dix ! Le
secteur public est le plus grand pourvoyeur d'emplois formels (5 % de l'emploi
total contre 4 % pour les entreprises privées).
Le quatrième défi concerne la faible
accumulation de capital humain (éducation et acquis de
compétences professionnelles sur le tas) et le fait que les
qualifications acquises dans le système de formation initiale
(secondaire, technique et professionnelle et supérieure) soient
insuffisantes, et le plus souvent mal adaptées aux demandes des
entreprises et autres acteurs économiques.
Le cinquième défi majeur concerne les fortes
inégalités de genre et les inégalités dans
l'espace. Les inégalités de genre reflètent d'abord les
différences d'accès à l'emploi avec de grands
écarts entre les taux d'activité des femmes et des hommes, en
défaveur des premières. Une répartition inégale des
activités domestiques au sein des ménages explique en partie ces
différences dans les taux d'activité. Les
inégalités de genre concernent ensuite le fait que les femmes et
les hommes sont répartis de manière très inégale
entre les secteurs d'activités économiques
(ségrégation horizontale) et à l'intérieur de ces
secteurs plus on s'élève dans la hiérarchie des postes
(ségrégation verticale).
Le sixième défi, enfin, concerne la situation de
quasi post-conflit dans laquelle se trouve le pays depuis le
déclenchement de la crise sécuritaire en 2012. La crise s'est
traduite par une contraction du secteur formel, une augmentation de l'informel
et des emplois précaires, une augmentation de la pluriactivité et
une augmentation du chômage. Une illustration de la contraction du
secteur formel est la forte diminution du nombre d'offres d'emploi
enregistrées par l'ANPE et les bureaux de placement privés entre
2012 et 2013. Selon les données collectées par l'ANPE, le nombre
d'offres d'emploi enregistrées par les bureaux de placement (public et
privés) a quasiment été divisé par deux en passant
de 3 583 en 2010 à 1 972 en 20133. Les données de
l'EMOP sur le chômage pour 2011 et 2014 (octobre-décembre)
confirment l'augmentation du chômage suite à la crise, surtout
pour les jeunes et les femmes en milieu urbain.
3 Les données sur les offres d'emploi
enregistrées par l'ANPE et les bureaux de placement privés sont
disponibles dans les rapports d'analyse situationnelle annuelle du
marché du travail du DOEF de l'ANPE.
2.2.2. Les dispositifs mis en oeuvre
La politique active de l'emploi embrasse cinq types de
dispositifs. Le premier type couvre les mesures d'intermédiation
destinés à améliorer la fluidité du marché
du travail et à encourager une meilleure et plus rapide
adéquation de l'offre à la demande de travail.
L'amélioration de l'information sur les emplois vacants, des mesures
incitatives à la mobilité professionnelle et géographique,
une intensification du suivi des demandeurs d'emploi et des conseils
d'orientation sont le genre de mesures appartenant à ce premier type de
dispositifs.
Le second type concerne toutes les mesures prises pour
développer l'auto-emploi et favoriser la création de micro et
petites entreprises, en facilitant l'accès aux facteurs de production
(équipement, crédit ou/et terre) et en développant
l'esprit d'entreprise.
Le troisième type de dispositifs couvre les travaux
publics (travaux HIMO ou autres) qui garantissent aux participants une
rémunération en échange d'une activité entreprise
pendant un temps limité. Le plus souvent les travaux publics permettent
de faire face à une insuffisance conjoncturelle ou saisonnière de
la demande de travail et sont ciblés sur des groupes bien définis
(les pauvres ruraux ou les jeunes déscolarisés, par exemple) ou
des régions.
Le quatrième type concerne les mesures de formation et
d'apprentissage qui sont conçues pour combler les lacunes du
système de formation initiale (technique et professionnelle mais aussi
général) et de donner aux participants les compétences et
les qualifications demandées sur le marché du travail.
Le cinquième type, enfin, concerne les aides ou autres
avantages financiers (comme les allègements de charges sociales)
accordés aux entreprises et aux employeurs qui embauchent des groupes
bien ciblés et éprouvant des difficultés d'insertion comme
les jeunes diplômés ou les chômeurs de longue durée.
Ces cinq types de dispositifs ne s'excluent pas les uns les autres. Il est
facile de concevoir des mesures qui sont des hybrides de deux ou plusieurs
types de dispositifs. Par exemple, il est courant de voir dans beaucoup de pays
des travaux publics qui comportent un volet formation et maintien des
compétences techniques. Il est aussi fréquent de voir des
dispositifs de formation (et reconversion) professionnelle associés
à un soutien à l'auto-emploi et à la création
d'entreprise.
Chapitre 2 : Concept et revue de littérature
Ce chapitre traitre la partie théorique de ce
travail. Il énumère les différentes théories
économiques sur le rôle et l'importance de l'investissement sur la
croissance économique ainsi que sur la création d'emploi. La
première section part de la théorie Keynésienne à
la théorie de croissance endogène en mettant en évidence
les nuances respectives et l'avantage de chacune. Et la seconde traite la
partie empirique dans laquelle les travaux empiriques les plus récentes
qui viennent confirmer ou infirmer les théories énoncées
précédemment.
Section 1 : Concept et définition
Les majorités politiques peuvent évoluer et les
conjonctures économiques nationales ou mondiales se modifier sans
affecter le contenu d'un des discours les plus constants de nos dirigeants : la
formation brute de capital fixe et, plus particulièrement, sa composante
essentielle, l'investissement industriel, ne sont jamais à des niveaux
jugés suffisants.
Les références pour accuser leur carence
relative ne manquent pas, qu'il s'agisse du niveau de l'emploi, de la
croissance des revenus et, surtout, de notre aptitude à affronter la
concurrence internationale ou, plus nettement aujourd'hui, à
conquérir le marché intérieur (Alain Cotta 1983 pp.
691-731).
Cependant investir c'est acquérir des biens et services
durables afin de s'en servir comme moyens de production .Il s'agit de prendre
un pari sur l'avenir .C'est de la décision d'investir que résulte
l'augmentation du stock de l'outil de production. C'est ce que l'on appelle la
formation brute du capital fixe.
L'investissement peut concerner des biens matériels
(immeubles, machines, mobilier, matériel roulant,...) ou des biens
immatériels (la recherche-développement, la formation, les
brevets, licences de fabrication,...).
Et les agents économiques qui investissent dans ces
biens sont principalement les ménages (acquisition des maisons, des
voitures et divers biens et services), les entreprises (acquisition des
machines pour produire, obtention des brevets pour les inventions, formation du
personnel, achat des bâtiments) et l'Etat (investissements publics dans
les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, la formation, la
santé, etc...).
Par ailleurs, il convient de signaler que l'investissement
provient de l'épargne voire de l'endettement. En effet, l'épargne
est investie quand les agents économiques sont persuadés que le
rendement des placements financiers (actions, obligations et produits
dérivés) est inférieur au rendement des capitaux investis,
lequel rendement est qualifié de taux de rentabilité interne
(T.R.I.).
Concernant la typologie, les agents économiques
investissent dans 3 types de cas :
- soit pour remplacer des actifs amortis : investissements de
remplacement. Ceux-ci n'augmentent pas la croissance.
- soit pour augmenter la capacité de production : on
parle des investissements de capacité.
- soit pour augmenter la productivité : il s'agit des
investissements de productivité dont l'objectif est d'améliorer
le rendement du travailleur par heure travaillée.
Toutes choses restant égales par ailleurs, en parlant
d'investissements dans ce travail, qu'il soit entendu qu'il s'agit des
dépenses d'investissements publics et privés car ils sont
indispensables à la croissance économique ainsi qu'à la
création d'emploi au Mali.
La formation brute de capital fixe (FBCF)
: Selon la définition de l'Insee, est constituée
par les acquisitions moins cessions d'actifs fixes réalisées par
les producteurs résidents. Les actifs fixes sont les actifs corporels ou
incorporels issus du processus de production et utilisés de façon
répétée ou continue dans d'autres processus de production
pendant au moins un an.
L'Investissement Direct Etranger (IDE)
: c'est l'investissement qu'une unité institutionnelle
résidente d'une économie effectue dans le but d'acquérir
un intérêt durable dans une unité institutionnelle
résidente d'une autre économie et d'exercer, dans le cadre d'une
relation à long terme, une influence significative sur sa gestion.
Par convention, une relation d'investissement direct est
établie dès lors qu'un investisseur acquiert au moins 10% du
capital social de l'entreprise investie. Les investissements directs
comprennent non seulement l'opération initiale qui établit la
relation entre les deux unités, mais également toutes les
opérations en capital ultérieures entre elles et entre les
unités institutionnelles apparentées, qu'elles soient ou non
constituées en sociétés.
L'industrie : Elle regroupe
l'ensemble des activités économiques qui produisent en
série des biens matériels, par la transformation de
matières premières ou de matières ayant déjà
subi une ou plusieurs transformations, et l'exploitation de sources
d'énergie.
Selon la nomenclature d'activités des Etats membres
d'AFRISTAT (NAEMA), l'activité industrielle peut être
classée en quatre (04) sections d'activités : la section
activités extractives ; - La section activités de fabrication ;
la section production et distribution d'électricité et de gaz ;
la section production et distribution d'eau, assainissement, traitement et
dépollution.
Cependant une entreprise est dite industrielle lorsqu'elle est
dotée d'une technologie, utilisant à la fois le facteur capital
(machine/outils, équipements et moyens financiers) et le facteur humain
capable d'assurer la transformation de matières premières pour
donner un produit fini.
La notion de la croissance économique
: La croissance économique est définie par BERNIER,
B. (1998) comme étant « ...une augmentation de la production sur
une longue période. ». Elle désigne au sens large
l'augmentation des produits et services produits par une économie sur
une période donnée. Selon la définition plus restreinte de
François Perroux, la croissance
économique correspond à « l'augmentation
soutenue durant une ou plusieurs périodes longues d'un indicateur de
dimension ; pour une nation : le produit global net en termes réels
»
Elle est l'augmentation soutenue du PIB réel d'une
année à l'autre. La croissance peut être le produit d'une
augmentation de la population (accroissement de la main d'oeuvre, et donc
potentiellement de la production) ou du capital à court terme.
Toutefois, sur le long terme, l'augmentation de ces deux facteurs étant
nécessairement limitée, la croissance provient d'une augmentation
de la productivité c'est-à-dire d'un accroissement du rapport
entre la quantité produite d'un bien et les moyens mis en oeuvre pour
l'obtenir (Lexique économique ; 2008, 10ème
édition).
Cette croissance est généralement mesurée
par le PIB et dernier est calculé selon l'optique de la production :
PIB = somme des valeurs ajoutées brutes de toutes les
unités institutionnelles qui exercent des activités de production
(augmentée des éventuels impôts moins les subventions sur
les produits non inclus dans la valeur de leurs productions).
Selon l'optique des dépenses :
PIB = Consommation finale + FBCF + Variations des stocks +
Acquisitions moins cessions d'objet de valeurs + Exportations des biens et
services - Importation des biens et services. Selon l'optique des revenus :
PIB = Rémunération des salariés + Autres
Impôts sur la production - Autres subventions sur la production +
Consommation de Capital Fixe + Excédent Brut d'exploitation/Revenu
mixte. La notion de création d'emploi consiste
à la création des opportunités de travail et ou utiliser
des personnes actives de la population à des activités
économiques. Il s'agit souvent d'un contrat passé entre deux
parties, l'employeur et le salarié, pour la réalisation d'un
travail contre une rémunération, par l'exercice d'une profession,
ou bien pour un travailleur indépendant, la réalisation de
multiples contrats implicites ou explicites dans le cadre de l'exercice d'une
profession.
Toutefois, l'augmentation de la productivité
elle-même résulte du progrès technologique,
c'est-à-dire de l'apparition de moyens de production plus productifs,
ainsi que de l'invention de nouveaux biens et services commercialisables. Le
contenu de la croissance économique n'est donc pas un simple
accroissement des volumes produits, mais aussi et surtout l'effet de
l'innovation des biens et services plus sophistiqués, variés
performants ou adaptés à des besoins nouveaux.
De ce fait elle tire son origine dans plusieurs facteurs dont
les principaux sont la consommation et l'investissement.
Par ailleurs le mécanisme de transmission
des effets de l'investissement sur la croissance peut se décliner ainsi
: l'Investissement(I) augmente l'emploi(L) qui augmente la consommation(C) et
la consommation augmente, à son tour, le PIB (Produit intérieur
brut).
Afin de limiter notre recherche, et à cause de la
difficulté d'obtenir les données nécessaires, nous avons
consacré cette étude à l'impact de l'investissement sur
l'emploi et la croissance du PIB. Cependant dans l'optique de la croissance
économique et de l'emploi dans le secteur industriel, nous allons
montrer le rôle et l'importance de l'investissement à travers des
théories économiques néoclassiques. Vu que ces
modèles s'intéressent à la croissance de long terme
reposant sur des rendements constants dans l'accumulation des facteurs de
production.
Section 2 : Revue de littérature
I. Revue théorique
1. Théorie Keynésienne
Théorie Keynésienne selon laquelle,
l'investissement est considéré comme le moteur
privilégié de la croissance. Il est ce qui rattache «
l'économie future à l'économie présente ».
Dans l'optique du cycle économique, le retour à l'expansion, en
partant d'une période de basse pression de l'activité, est
possible à partir d'une politique de déficit budgétaire
grâce au jeu du multiplicateur.
1.1. Le multiplicateur de Keynes
Le multiplicateur auquel il fait allusion est un
multiplicateur des dépenses publiques, lesquelles permettent à
des personnes au chômage d'encaisser des revenus et de les
dépenser quasiment en totalité puisque leur propension à
consommer est très forte en période de dépression.
Keynes ajoute : « À une époque de
chômage rigoureux, des travaux publics, même d'une utilité
douteuse, peuvent donc être largement payants »
L'auteur fait la distinction entre « l'augmentation de
l'emploi associé à l'outillage existant » et la situation de
saturation de la capacité de production qui requiert une «
extension de cet outillage ». Or, « le montant de l'emploi
associé à un équipement donné constitue une mesure
satisfaisante du montant de la production qui en résulte ».
Keynes précise que les dépenses de l'État
financées par l'emprunt désignent aussi bien «
l'investissement public... que toute autre dépense publique courante
couverte par le même moyen » et qu'elles « peuvent, même
lorsqu'elles sont inutiles, enrichir la communauté ».
Quant on croit à cette théorie
général de l'emploi de Keynes, il est claire qu'il s'agit bien
d'une adéquation de l'offre d'emploi à la demande d'emploi.
Cependant au Mali on constate une inadéquation évidente entre le
ratio offre/demande d'emploi.
1.2. L'investissement et l'emploi selon Keynes
L'investissement stimule aussi la demande. Le fait que
l'investissement agisse surtout sur la demande pour être facteur de
croissance, est une idée surtout keynésienne. Cette stimulation
peut se faire de trois façons : grâce au multiplicateur
keynésien, au moyen du principe de l'accélération ou par
le biais de l'oscillateur de Samuelson.
D'après le multiplicateur keynésien, une
augmentation de l'investissement entraîne une variation amplifiée
du revenu national. Un accroissement de l'investissement va engendrer des ondes
successives de revenus et de dépenses. Cette dépense du revenu va
se faire à différentes étapes selon la propension
marginale à consommer.
Par conséquent, une hausse de l'investissement va se
traduire par une augmentation des revenus qui va suivre une progression
géométrique. Il faut cependant que le taux d'intérêt
soit inférieur à l'efficacité marginale du capital pour
que les entrepreneurs soient incités à investir. Le principe
d'accélération énoncé par John Maurice Clark
affirme qu'une variation de la demande finale induit une variation plus que
proportionnelle de l'investissement. C'est en effet la croissance de la demande
qui engendre comme réponse un investissement. Il y a donc un
décalage dans le temps qui entraîne des vagues d'investissement
plus amples que la consommation.
Les effets directs peuvent se distingués suivant :
? Si l'investissement est de capacité, il augmente le
niveau d'emploi en permettant l'augmentation de la quantité produite.
? Que l'investissement soit de capacité ou de
productivité, il implique l'acquisition de machines et augmente le
niveau d'emploi en permettant l'augmentation de la quantité produite.
? Que l'investissement soit de capacité ou de
productivité, il implique l'acquisition de machines : création ou
soutien de l'emploi dans d'autres entreprises (fournisseurs de matières
premières, fabricants, transporteurs, ...).
Le modèle néoclassique et ses
prolongements ultérieurs décrivaient bien le rôle de
l'accumulation du capital dans le processus de croissance, mais en raison des
rendements
2. Théories néoclassiques
Pour la théorie néoclassique, c'est la
flexibilité des techniques de production qui permet de maintenir le
plein-emploi. Dans les modèles d'inspiration «
postkeynésienne » la flexibilité résulte au contraire
de l'impact des variations de la répartition des revenus sur le taux
d'épargne. Les années soixante verront se développer
à la fois les prolongements théoriques et empiriques du
modèle néoclassique : optimalité des régimes de
croissance, modèles à générations de capital,
analyse des facteurs de la croissance à long terme.
Il est important de considérer ensemble
l'investissement, la croissance et l'emploi, car toutes les théories
économiques analysent l'investissement comme le principal facteur de
croissance en passant par la création d'emploi.
En revanche, elles s'opposent toutes sur la manière
dont la croissance agit. Son action peut se faire sur deux plans : sur l'offre
et sur la demande.
L'investissement agit tout d'abord sur l'offre de trois
manières : il permet l'augmentation du capital et donc des
capacités de production, il favorise l'innovation et il accroît la
productivité. Ce sont les économistes de l'offre (Thomas Gilder
ou Arthur Laffer) qui mettent l'accent sur l'effet d'offre de l'investissement
(ils reprennent la loi des débouchés de Say selon laquelle
l'offre crée sa propre demande).
Concernant l'innovation, il s'agit d'une idée de
Schumpeter : l'investissement en permettant d'introduire l'innovation engendre
la croissance d'une économie. L'entrepreneur qui innove dispose d'un
monopole qui lui permet d'établir des prix élevés et
d'engranger des profits jusqu'à ce qu'il soit imité par ses
concurrents. Une fois le monopole brisé, charge à lui de relancer
ses profits par une nouvelle innovation, ce qui engendre un cercle vertueux de
croissance. On remarque en effet que les taux de croissance les plus
élevés sont ceux des pays où la R&D est forte.
Enfin, dans les modèles théoriques de croissance
(Solow ou Harrod et Domar), l'investissement joue un rôle clef dans la
productivité, grâce notamment à son effet sur le
progrès technique. Et dans les nouveaux modèles théoriques
de la croissance endogène (Römer, Lucas ou Barro), l'investissement
public améliore la productivité du secteur privé lorsqu'il
est dirigé vers le développement du capital humain et
technologique.
décroissants du capital, la croissance ne se maintenait
à long terme que par la présence de facteurs exogènes tels
que l'augmentation de la population et le progrès technique.
Pour engendrer une croissance entretenue, il fallait
abandonner l'hypothèse de rendements décroissants des facteurs de
production accumulables. Mais alors se pose le problème des rendements
croissants de l'ensemble des facteurs de production et sa compatibilité
avec l'existence et l'optimalité de l'équilibre concurrentiel.
Dans les modèles de croissance endogène, les
rendements constants des facteurs accumulables résultent presque
toujours d'externalités positives engendrées par le processus de
croissance. De ce fait, l'équilibre concurrentiel existe, mais n'est pas
socialement optimal : le rythme de croissance est plus élevé
lorsqu'il résulte d'une planification centralisée des ressources
plutôt que de l'optimum des agents individuels. Il reste cependant un
long chemin à parcourir pour confirmer ou infirmeries conclusions les
plus controversées auxquelles conduisent ces nouvelles
théories.
La politique économique modifie-t-elle seulement
transitoirement le rythme de croissance, comme le suppose la théorie
traditionnelle ou durablement comme le suggèrent les théories de
la croissance endogène ? Il faudra sans doute de longues années
pour que les théories récentes conduisent à des
résultats empiriques suffisamment robustes pour guider les politiques
économiques.
De ce fait, l'investissement étant le levier indispensable
pour accroitre les rendements de façon continuelle des facteurs de
production d'une économie, à l'instar des pays
développés, les pays en développement notamment le Mali
doivent inclure dans leur politique économique des mesures visant
à stimuler l'investissement de capacité ou de production pour
relever non seulement le défi de croissance mais également celui
du chômage grandissant.
1. L'analyse néoclassique de la croissance : le
modèle de Solow-Swan (1956)
À la question « qu'est ce qui fait croître
la production ? », les néoclassique répondent : les facteurs
de production. « L'on peut, selon la conception néoclassique,
rapporter à trois sources distinctes la croissance de la production,
à savoir : croissance de la main d'oeuvre, croissance du capital, enfin
l'innovation technique en elle-même » (SAMUELSON, 1969). La relation
qui unit ces facteurs est la fonction de production. À l'aide de cette
fonction, SOLOW (1956, 1957) a formalisé le modèle
néoclassique. Dans ce modèle, le rôle de l'investissement
peut se résumer à l'aide de deux équations
familières :
? La première est la relation entre la production (Y)
et les facteurs capital (K), travail(L), et technologie (A) (neutre au sens de
Hicks),
? et la seconde est l'équation d'accumulation du
capital (inventaire permanent), qui régit la relation entre
l'investissement en biens matériels, I, et le stock de capital,
En considérant une fonction de production de type
Cobb-Douglas, la production peut s'énoncer
comme suit : ÄlnY = á ÄlnK + f3 ÄlnL +
ÄlnA (3)
où ÄlnA est le « résidu de Solow
», á et f3 les élasticités de la production par
rapport respectivement au capital et au travail, les hypothèses
néoclassiques supposent que : á + f3 = 1
La simplicité intuitive de ce cadre néoclassique
est à la base de plusieurs travaux empiriques et théoriques sur
la productivité et la croissance économique. Cependant, en
dépit de sa popularité, le modèle néoclassique
engendre certains résultats troublants : la technologie est
habituellement décrite par une quelconque fonction ad hoc, telle que,
où est un paramètre non expliqué de l'économie,
autrement dit le progrès technique est exogène. De plus les
données internationales ne semblent pas corroborer le modèle
néoclassique de base pour ce qui a trait aux propriétés de
convergence.
Ces lacunes ont donné l'impulsion à plusieurs
pistes de recherche sur la relation entre l'investissement et la croissance de
la productivité. Une école de pensée (qui demeure
fermement ancrée dans la tradition néoclassique), qui remonte
à JORGENSON et GRILICHES (1967) et dont les travaux ont
été résumés par JORGENSON (1990, 1996), a
tenté de mettre au point de meilleures mesures de l'investissement, du
capital, du travail et d'autres intrants négligés en vue de
réduire l'importance du résidu inexpliqué.
Une deuxième école de pensée est
allée au-delà du modèle néoclassique pour tenter
d'élaborer un mécanisme endogène tenant compte de
l'évolution du progrès technique, demeuré
inexpliqué dans les travaux antérieurs. En modélisant
explicitement les rouages de la concurrence, de l'innovation et des
retombées de la production, ces travaux de recherche ont abouti aux
modèles de croissance endogène de la nouvelle théorie de
la croissance. Cette nouvelle théorie repose en effet sur quatre
facteurs de la croissance.
2. Modèle de Barro 1990
La théorie de la croissance endogène apparus
dans les années 1980, traite la question de la croissance
économique de long terme. Cette théorie récente suppose
l'existence des externalités positives qui favorisent l'accumulation des
progrès technique.
Le modèle de référence de tous les
modèles de croissance endogène celui élaboré par
Paul Romer en 1986 : le modèle AK qui remplace les rendements
d'échelles décroissants des facteurs par les rendements
constants. La fonction de production nationale pour ce modèle est :
Yt = AtKt
Y mesure la croissance, A est le progrès technique, K le
capital. Dans ce modèle, le stock du capital n'est plus constant, le
taux de croissance du stock de capital, et donc de l'économie
s'écrit :
Kt-Kt- 1
Tel que ?????? le taux d'épargne et ?? le taux de
dépréciation du capital. L'état régulier de
l'économie est toujours établi d'une façon endogène
grâce à cette équation. D'où, la différence
entre les pays en matière de croissance peut être expliquée
par leurs progrès techniques. Ainsi, le modèle AK met en valeur
la politique économique puisqu'elle peut augmenter l'épargne et
donc le capital pour aboutir à une croissance économique
importante.
Le modèle de références de croissance
endogène favorise trois sources importantes de croissance : les
nouvelles connaissances (Romer, 1990), l'innovation (Aghion et Howitt, 1992) et
les infrastructures publiques (Barro, 1990). Ainsi, les politiques publiques
sont appelées à jouer un rôle essentiel dans la performance
de l'économie à long terme.
Les modèles de croissance endogène tiennent
compte de ces externalités positives dans l'analyse de
l'évolution de long terme des taux de croissance des
économies.
Les premiers modèles se sont centrés sur la
connaissance (Römer, 1986, 1990) et la formation (Lucas, 1988), puis les
dépenses publiques au sens large ont été
évoquées (Barro, 1990 ; Artus et Kaabi, 1993). Ces derniers
travaux mettent en avant la nécessité de la production par 1'Etat
de certains services source d'externalités.
Il y a croissance endogène lorsque « les
principaux déterminants de la croissance sont endogène au
modèle » (BARRO, R et SALA-I-MARTIN, X., 1996).
Selon les théoriciens de la croissance endogène,
il existe quatre facteurs de croissance endogène à
l'économie :
? L'accumulation de capital. Ces modèles font des
rendements croissants le fondement de la croissance. En effet, sans rompre
totalement avec l'hypothèse des rendements constants, ils
considèrent qu'il existe des rendements d'échelle croissants
liés aux externalités positives des investissements.
? La recherche-développement développée
dans des travaux de ROMER. Elle est considérée comme une
activité à rendement croissant du double fait que la
connaissance
est un bien « non rival » et que le coût de
son appropriation est minimal pour chaque chercheur. La croissance
économique résulterait ainsi d'une activité d'innovation,
engagée par des agents qui espèrent en tirer profit. Cette
analyse permet d'incorporer dans le capital physique le seul progrès
technologique et non l'ensemble des investissements directs.
? L'accumulation du capital humain fut mise en valeur par
LUCAS (1988). Ce capital est défini comme le stock de connaissances
valorisables économiquement et incorporées aux individus
(qualification, état de santé, hygiène, ...). LUCAS
développe dans son analyse, le capital humain qui est volontaire
(accumulation de connaissances (schooling)) et involontaire (learning by
doing). En outre, la productivité privée du capital humain a un
effet externe positif car, en améliorant son niveau d'éducation
et de formation, chaque individu augmente le stock de capital humain de la
nation et par la même occasion contribue à améliorer la
productivité de l'économie nationale.
? L'investissement de l'État dans les infrastructures,
car selon BARRO (1990), les infrastructures publiques constituent aussi un
facteur de croissance qui engendre des rendements croissants à long
terme en raison des économies internes qu'elles permettent pour les
producteurs privés
Le rôle économique de l'Etat est alors clair :
produire des services qui vont accroître la productivité (Barro,
1990) et/ou accroître l'utilité des ménages (Artus et
Kaabi, 1993), sans être directement financés par les agents mais
par une taxe, et permettre à l'économie de se positionner sur une
trajectoire de croissance optimale. Il part du principe relativement simple que
des dépenses visant à créer les infrastructures telles
qu'une autoroute, une ligne de chemin de fer ou encore un réseau de
télécommunications rendent plus efficace l'activité du
secteur productif. Dans son modèle, il considère que ce sont des
biens collectifs purs (non rivaux, non excluables). Il se pose alors le
problème traditionnel de leur financement par le secteur privé.
La sphère privée ne peut se substituer au gouvernement pour le
financer. C'est la raison pour laquelle l'État prélève un
impôt de façon à produire ce type de bien. Les entreprises
privées utilisent donc deux types de facteurs pour produire: le capital
privé et le « capital public ». Le capital privé a des
propriétés usuelles : il connaît des rendements
décroissants, à dépenses publiques constantes, sa
productivité marginale décroît. On est dans le cas
classique d'un modèle à la SOLOW (1956) où un seul facteur
est accumulable et où la croissance « s'étouffe ». Le
capital public est en fait une dépense financée par
l'État, les dépenses sont intégralement financées
par l'impôt, que l'on suppose proportionnel au revenu. Selon BARRO
(1990), la dépense publique a deux effets opposés. Le premier est
que le capital public rend le capital
privé plus productif et évite que sa
productivité marginale s'annule progressivement quand le revenu
augmente. Cependant, l'impôt a un effet dépressif sur cette
productivité, puisqu'il réduit son rendement privé en
ôtant aux entreprises une part du revenu tiré de leur
activité. Et il montre que pour une petite taille du gouvernement (des
dépenses publiques), le premier effet l'emportera. Puis, il montre que
de moins en moins, l'on peut déterminer une dépense publique
optimale. À ce point, un dollar de dépense publique
supplémentaire coûte plus en productivité que ce qu'il
rapporte. BARRO (1990) fait quelques remarques sur la nature des
dépenses publiques. Tout d'abord, il fait remarquer que, si les
dépenses qui représentent une prestation de services aux
consommateurs ont un impact en termes d'utilité, elles
découragent la croissance. En effet, elles n'accroissent pas la
productivité du capital privé, mais leur financement par
l'impôt pèse sur la rentabilité du capital. Seul l'effet
négatif joue au niveau des entreprises. L'imposition liée
à ces dépenses décourage l'épargne et
l'investissement. On peut remarquer que la nature de la croissance liée
aux dépenses publiques d'investissement est effectivement une
externalité. L'activité d'un agent (l'État en
l'occurrence) a des effets sur celle d'un autre agent (les entreprises
privées).
Le modèle néoclassique décrit ci-dessus
peut facilement être étendu au-delà de l'investissement en
biens matériels pour rendre compte de tout facteur accumulé
contribuant à la production. Cela englobe la substitution
qu'opère l'investissement entre des biens matériels
hétérogènes, l'investissement en capital humain lié
à l'éducation et à la formation des travailleurs, l'effort
de recherche-développement et les dépenses publiques en
infrastructures. Cette dernière se fait dans le cadre global de l'action
publique dont le fondement peut éclairer les analyses.
II. Revue empirique
Plusieurs études empiriques basées sur une
fonction de type Cobb Douglas ont donc été
réalisées pour rendre compte du caractère productif de
l'investissement public.
F. Bonetto (2004) établit dans son analyse en coupe
transversale sur la période 1970-19954, un impact
significativement positif du taux d'investissement public (au sens large) sur
le taux de croissance ; en particulier, les différences entre les
nations quant aux taux d'investissement public en équipements physiques,
en recherche, en infrastructures ou en éducation expliqueraient (pour
partie) l'hétérogénéité des dynamiques de
croissance.
4 Des pays comme l'Egypte, Israël, le Maroc, la
Tunisie ou la Turquie sont présents dans certains des
échantillons retenus.
Robinson, M. Olulu et al (2014) trouvent que les
dépenses publiques au Nigeria peuvent stimuler l'investissement local
comme étranger avec l'utilisation de deux modèles à court
terme par la méthode des moindres carrés ordinaires et à
long terme par la méthode d'ADF.
L'étude recommande le gouvernement du Nigeria de
dépenser plus dans les secteurs sociaux comme l'éducation et la
santé.
Dans un modèle d'accélérateur simple
N'guessan (2007) suppose que la technologie de production est
caractérisée par la relation entre le stock de capital
désiré et le niveau de production aboutit aux résultats
permettant d'établir l'existence d'un effet d'entrainement de
l'investissement public sur l'investissement privé en côte
d'ivoire, au Togo, et dans la moindre mesure au Niger. Cependant, l'effet
d'entrainement n'a pu être mis en évidence au Bénin, au
Burkina, au Mali, et au Sénégal. La décomposition des
dépenses publiques s'est avérée déterminante dans
la dynamique de la croissance de l'union.
Okoro A.S. (2013) a conclu qu'à long terme, il existe
un équilibre entre les dépenses publiques et la croissance
économique et que la dynamique de court terme ajuste l'équilibre
à long terme à un taux de 60% par an, suite à son
étude concernant les dépenses publiques au Nigeria.
Ales Kuhar et al (2005) dans un modèle input-output
concernant une étude de la périphérie de la
Slovénie aboutit aux résultats qui montrent que les fonds publics
peuvent stimuler la croissance économique dans les
périphéries de la Slovénie, cependant la comparaison au
niveau nationale montre qu'il a des régions en retards.
Ali Sulieman (2014) montre d'après une étude sur
les dépenses publiques en Jordanie que les dépenses en capital et
en éducation ne conduisent pas à la croissance économique
car il existe des contraintes financières. Mais en contrepartie les
dépenses en santé et en affaire économique ont un impact
sur la croissance du PIB.
Akonji, R.D et al (2013) suite à une étude sur
les relations entre les dépenses publiques et la croissance en testant
la loi de Wagner, Akonji, R.D et al approuvent que les dépenses totales
en capital et le PIB respectant la loi de Wagner par le test de
causalité de Granger avec une causalité unidirectionnelle.
Riadh BEN JELILI EN 2000 : Dépenses publiques et
croissance : Une étude économétrique sur séries
temporelles pour la Tunisie. Les variables utilisées sont : Les
dépenses d'investissement en capital humain des administrations, les
dépenses d'investissement en infrastructure et les dépenses de
consommation publique. Et la méthode utilisée est Ordinary Ridge
Regression. Et les conclusions tirées sont : Contribution productive des
dépenses d'investissement publiques
en infrastructure et en capital humain à la croissance
du PIB en Tunisie, ainsi qu'in impact d'externalité positif très
significatif des dépenses publiques de consommation.
KANE EN 2004 Amadou Habib : Impacts des dépenses
publiques sur la croissance économique d'un pays en développement
: le cas du Sénégal. Les variables utilisées sont : -Le
taux de croissance du PIB par tête, le taux de croissance du PIB par
tête décalé, le ratio des dépenses en capital au
PIB, le ratio des dépenses courantes au PIB, les recettes
budgétaires au PIB, le déficit budgétaire, et l'inflation.
La méthode utilisée est : MCO avec une représentation
à correction d'erreur sur la période d'étude de 1970-1999.
Et les conclusions tirées est : Les dépenses publiques en capital
ont un impact positif et significatif sur la croissance économique au
Sénégal, ainsi que les dépenses de fonctionnement.
Niloy Bose, M Emranul Haque 2003, et Denise R Osborn : Public
Expenditure and Economic Growth: A Disaggregated Analysis for Developing
Countries. Plus de quarante variables utilisées, dont le PIB, les
dépenses publiques consommation en défense, les dépenses
d'investissement en éducation, en santé, en agriculture et en
transport et communication... En utilisant la méthode SURE ce dernier
est parvenu à la conclusion suivante : La part des dépenses des
investissements publiques dans le PIB est positivement et significativement
corrélée avec la croissance économique. Au niveau
sectoriel, seules les dépenses publiques en éducation sont
significativement associées à la croissance, une fois la
contrainte budgétaire et les variables omises prises en
considération.
Deux études sur les impacts des dépenses
publiques sur la croissance économique : le premier : Les
dépenses publiques porteuses de croissance au Maroc (1970- 2004), 2005 :
Mohamed
Raja AMRANI, Lahcen OULHAJ et Khalid HAMMES. Et les variables
utilisées sont : les dépenses publiques d'investissement, les
dépenses publiques en éducation, les dépenses publiques de
santé, les dépenses publiques en infrastructure et PIB non
agricole. Ils ont utilisé la régression linéaire simple en
testant les effets sur l'offre et la demande. Et ils ont tirés les
conclusions suivantes : les dépenses publiques d'investissement ont un
effet demande sur la croissance, les dépenses publiques d'infrastructure
ont un effet demande sur la croissance, les dépenses publiques
d'éducation ont un effet demande sur la croissance et enfin les
dépenses publiques de santé ont un effet d'offre sur la
croissance.
Et le deuxième : Identification (ventilation) des
dépenses publiques porteuses de croissance économique : cas du
Maroc de 1970 à 2003 EN 2005 : Abdelkader ELKHIDER, El Mustapha KCHIRID
et Chakib TAHIRI. Les variables utilisés sont : PIB en milliard de
Dirham courant, dépenses publiques d'investissement, dépenses
publiques en éducation, et les dépenses
publiques de santé. En utilisant le MCO en premier
lieu, puis la méthode SUR à cause de la
simultanéité, ils arrivent à la conclusion suivante :
Seules les dépenses publiques d'investissement, de l'éducation et
de défense nationale sont porteuses de croissance.
Deux « équipes » des Universités de
Rabat-Agdal et de Marrakech ont étudié les effets des
investissements publics au Maroc, elles ont procédé de
façons différentes et ont abouti, de ce fait, à des
résultats différents.
AMRANI, OULHAJ et HAMMES (2004) de l'équipe de
Rabat-Agdal ont testé la relation entre les dépenses publiques
d'investissement et la croissance économique au Maroc entre 1970 et 2004
à travers les ratios des dépenses publiques totales
d'investissement rapportées au PIB, les dépenses publiques
d'investissement par secteur rapportées au PIB et les dépenses
publiques totales par secteur rapportées au PIB. Ils arrivent à
la conclusion selon laquelle, empiriquement, seul l'investissement public dans
le secteur de la santé semble porteur de croissance.
La seconde équipe, de Marrakech, après une
présentation descriptive des dépenses publiques d'investissement
entre 1970 et 2003, précise que le choix de la période
d'étude et des variables à introduire dans le cadre du
modèle économétrique mis en oeuvre a été
limité par la disponibilité des données pour ces
dépenses publiques réparties par catégories.
Les auteurs à l'issue de cette analyse concluent que
seules les dépenses d'investissement dans les entreprises publiques, les
dépenses publiques d'éducation et les dépenses de
défense nationale sont positivement associées (ou reliées)
à la croissance économique au Maroc tout au long de la
période d'étude. Des dépenses publiques de santé ne
sont pas statistiquement significatives, contrairement aux résultats de
l'équipe de Rabat-Agdal.
ABDELKAFI et GABSI (2005) ont montré l'existence d'un
lien significatif entre l'éducation et la croissance économique
en Tunisie entre 1970 et 2001.
Une étude similaire a été
réalisée en Égypte sur la période allant de 1950
à 2003 par DUARTE, M. et PEDROSA. Ils intègrent dans leur
modèle le produit global, la consommation privée,
l'investissement public et la consommation publique et arrivent à la
conclusion selon laquelle l'élasticité du capital humain
relativement aux dépenses de l'État est de 33,7% dans
l'estimation par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO).
Cette valeur est très élevée et traduit donc la grande
importance des dépenses de l'État pour l'augmentation du stock du
capital humain en Égypte.
Au Niger, une étude basée sur une
équation de croissance (inspirée de BARRO et
SALA-1-MARTIN(1995)), intégrant les investissements publics a
été estimée par la méthode des
moindres carrés ordinaires dans le cadre d'un
modèle à correction d'erreur. Cette étude a eu pour objet
d'évaluer l'impact des investissements publics sur la croissance sur la
période 1975-2004.
HAMIDOU HAMA (2005) montre ainsi qu'à court terme les
investissements publics ont un effet positif mais non significatif sur la
croissance économique. A long terme, la relation entre les
investissements publics et la croissance a tendance à se
dégrader, confirmant que les investissements publics se concentrent dans
des projets de réhabilitation ou d'entretien dans le monde rural. Ce
résultat selon l'auteur suggère également que les
investissements publics ne sont pas orientés vers l'accumulation du
capital nécessaire à la croissance économique, et confirme
en partie les études menées sur la question au Niger.
L'étude a également montré que l'ouverture a un impact
négatif mais non significatif sur la croissance économique, que
le développement financier agit positivement sur la croissance.
Bien que la majorité des études citées
plus haut semblent supporter l'idée selon laquelle les investissements
des administrations publiques ont un effet positif sur la croissance, certaines
ne trouvent aucun effet positif. Ces résultats controversés ont
eu pour principale explication l'approche méthodologique
utilisée. Pour résoudre le problème associé
à l'approche par fonction de production basée sur les
séries temporelles, les chercheurs ont utilisé une approche
Vecteur Autorégressif (VAR).
Parmi ceux-ci, NAVEED NAQVI (2003) postule un modèle de
BARRO (1990) au cas du Pakistan entre 1965 et 2000. Dans sa
spécification il utilise un modèle basé sur une fonction
de production de type COBB-DOUGLAS et dans lequel il introduit le capital
public.
Le facteur B représente le résidu de SOLOW
(progrès technique exogène). Dans son introduction, NAVEED NAQVI
(2003) présente également le caractère exogène
(MANKIW et al (1992)) et endogène (ARROW (1962) et ROMER (1987)) du
facteur qui est le progrès technique. Étant donné qu'il
peut y avoir une externalité positive ou négative du capital
public, il ne fait aucune restriction au modèle et travaille avec les
données ramenées par unité de travailleurs.
NAVEED NAQVI (2003) montre que le progrès technique est
endogène (externalité produit par le capital). Après avoir
montré que les différentes variables sont
cointégrées au seuil de 5%, il arrive aux résultats selon
lesquels les élasticités à long terme du capital public et
privé diffèrent suivant les hypothèses sur
l'évolution du facteur technologique. Il montre également que
l'élasticité du capital privé varie entre 0.25 et 0.29,
l'élasticité du capital public à son tour se situe entre
0.23 et 0.49. Ceci implique donc que pour le cas du Pakistan, le capital public
est aussi productif que le capital privé. Par ailleurs, l'analyse des
chocs montre qu'un choc exogène
sur le capital privé prend beaucoup de temps pour
disparaître qu'un choc équivalent sur le capital public. Plusieurs
études ont donc été menées utilisant l'approche
VAR.
Aussi Keho Yaya (2007) : Dépenses Publiques et
croissance Economique en Côte d'Ivoire : Une approche en terme de
causalité. Avec l'utilisation d'un modèle VAR il a montré
que les dépenses publiques totales et l'éducation n'ont pas
d'impact significatif sur le PIB, ainsi que les dépenses
d'investissement n'ont pas d'effet significatif sur l'évolution du PIB,
en ajoutant que l'évolution du PIB influence positivement les
dépenses publiques dans les secteurs de la santé et des
transports et négativement les dépenses dans le secteur de
l'énergie.
Et Kebo (2008) soulève qu'à long terme, il
existe une absence de causalité au sens de Granger entre le PIB et les
dépenses publiques dans le secteur d'éducation.
Comme on peut le constater, ces études empiriques ne
sont pas encore assez claires sur l'effet de l'investissement public sur la
croissance. Les résultats diffèrent selon la méthodologie
utilisée, la région ou le pays d'étude.
Chapitre 3 : Méthodologie et analyse des
résultats
Cette partie traite la méthode appliquée
dans laquelle ce travail a été effectué. En partant de la
description du modèle théorique de Barro 1990 et du modèle
empirique choisis, nous y avons spécifié notre modèle qui
nous permettra de vérifier la relation entre l'investissement, la
croissance économique et la création d'emploi dans le secteur
industriel malien. Pour ensuite conclure en une analyse des résultats
obtenus ainsi que des recommandations par rapport à la politique
économique du Mali.
Section 1 : Méthodologie appliquée
De la théorie de croissance exogène de Solow
à la théorie de croissance endogène, la relation entre
l'investissement, emploi et croissance reste une préoccupation majeure
des économistes pour atteindre une croissance à long terme.
Les modèles de croissance endogène tiennent
compte de ces externalités positives dans l'analyse de
l'évolution de long terme des taux de croissance des économies.
Les premiers modèles se sont centrés sur la connaissance
(Römer, 1986, 1990) et la formation (Lucas, 1988), puis les
dépenses publiques au sens large ont été
évoquées (Barro, 1990 ; Artus et Kaabi, 1993). Ces derniers
travaux mettent en avant la nécessité de la production par 1
'Etat de certains services source d'externalités. Le rôle
économique de l'Etat est alors clair : produire des services qui vont
accroître la productivité (Barro, 1990) et/ou accroître
l'utilité des ménages (Artus et Kaabi, 1993), sans être
directement financés par les agents mais par une taxe, et permettre
à l'économie de se positionner sur une trajectoire de croissance
optimale.
I. Modèle théorique
Notre modèle s'inspire du modèle de BARRO 1990.
Le Modèle de BARRO (1990) se base sur les travaux de SOLOW et SWAN
(1956) présentés ci-dessus et ses hypothèses viennent en
plus des hypothèses Néoclassiques.
La spécificité de ce modèle de BARRO 1990
consiste donc à faire apparaître les dépenses publiques
d'investissement dans le processus de production, et par conséquent
à mettre en évidence un lien explicite entre la politique
gouvernementale et la croissance économique de long terme dans un cadre
de croissance endogène. La production est représentée par
une fonction de type COBB DOUGLAS définie par :
Yt = ALt1-á Ktá
Gtf3
Les termes Lt et Kt désignent respectivement le niveau
de l'emploi et le stock de capital privé à la date t. Les
paramètres á et f3 correspondent respectivement aux
élasticités de la production par rapport au stock de capital
privé et public. Lorsque l'on suppose que les rendements sont constants
par rapport aux facteurs K et G (á + f3 = 1), on
aboutit à une situation de croissance endogène. Soit Y la
production de la firme représentative. L'effet net de l'intervention
publique dépend de la différence entre le taux marginal de
prélèvement public et l'élasticité du produit par
rapport aux dépenses publiques. Dès lors si le gouvernement
adopte la maximisation de la
croissance comme objectif de sa politique fiscale, il choisira
un taux d'imposition égal à l'élasticité des
dépenses publiques.
Une seconde approche de la mesure de l'impact des
investissements publics à été réalisée par
FEDER (1983) et RAM (1986) et étendue par HERRERA (1997). Une
présentation simplifiée de cette approche a été
faite par BEN JELILI (2000).
III. Modèle
empirique
1. Modèle de base
En nous appuyant sur les résultats théoriques du
modèle de BARRO 1990, nous allons nous appuyer sur le modèle
empirique des deux (02) équipes du Maroc. Notre intérêt sur
ce modèle résigne sur le fait qu'il se rapproche de notre
thème.
AMRANI, OULHAJ et HAMMES (2004) de l'équipe de
Rabat-Agdal ont testé la relation entre les dépenses publiques
d'investissement et la croissance économique au Maroc entre 1970 et 2004
à travers les ratios des dépenses publiques totales
d'investissement rapportées au PIB, les dépenses publiques
d'investissement par secteur rapportées au PIB et les dépenses
publiques totales par secteur rapportées au PIB. Ils arrivent à
la conclusion selon laquelle, empiriquement, seul l'investissement public dans
le secteur de la santé semble porteur de croissance.
La seconde équipe après une présentation
descriptive des dépenses publiques d'investissement
périodisées, a précisé que le choix de la
période d'étude et des variables à introduire dans le
cadre du modèle économétrique mis en oeuvre a
été limité par la disponibilité des données
pour ces dépenses publiques réparties par catégories.
Donc, en tenant compte de ces difficultés, les auteurs
présentent un modèle qui fait intervenir le taux de croissance
économique (GR) mesuré comme étant le taux de croissance
du PIB en termes réel, les dépenses publiques par
catégories (G) (dépenses publiques d'investissement,
d'éducation, de santé, de transport et communication et de
défense nationale) par rapport au PIB, les taxes sur les revenus par
rapport au PIB (TR), l'investissement privé par rapport au PIB (PI), le
niveau initial de développement (G(0)) mesuré par le PIB par
tête en logarithmes, l'indicateur social de capital humain (H),
mesuré par le taux de scolarisation au primaire et au secondaire et
l'indicateur social de santé (life) mesuré par l'espérance
de vie en logarithmes.
Le modèle suivant a été testé pour la
période de 1970 à 2003 :
GRt = â0+ â1Gt+ â2TRt+ â3PIt+
â4Gt(0) + â5Ht+ â6lifet+ mt
Ces variables sont au nombre de neuf : formation brut de
capital fixe publique (FBCFPUB), formation brut de capital fixe privée
(FBCFPRIV), valeur ajoutée du secondaire (VASEC),
Les tests de l'équipe de Marrakech montrent que les
effets, sur la croissance, des dépenses publiques de santé ne
sont pas statistiquement significatifs, contrairement aux résultats de
l'équipe de Rabat-Agdal. Une relation positive entre la croissance
économique et cette catégorie de dépenses au Maroc, est
mise en évidence par l'équipe de Rabat-Agdal, alors que cet effet
n'est pas observé à long terme par l'équipe de
Marrakech.
En conclusion cette étude des deux équipes du
Maroc et de Marrakech ont montrés que les dépenses publiques
d'investissement prises dans leur ensemble, leur effet sur la croissance
économique est positif, et même s'il s'agit plutôt d'un
effet keynésien de court terme, l'importance de ces dépenses (et
donc du rôle de l'Etat dans ce secteur pour l'économie marocaine)
est à retenir.
2. Présentation du modèle
Les travaux empiriques évoqués dans la revue de
littérature ci-dessus nous ont permis d'élaborer notre
modèle en se basant sur les séries temporelles. La
méthodologie adoptée dans ce travail consiste à
modéliser l'impact des dépenses de l'investissement sur la
croissance économique ainsi que sur la création d'emploi dans le
secteur industriel au Mali. Comme indiqué dans les modèles
ci-dessus, l'ensemble des variables utilisées pour effectuer cette
modélisation peuvent se résumer ci-après :
On s'est inspiré de plusieurs études
effectuées dans ce sens pour trouver la formulation du modèle la
plus adéquate. Ce modèle s'écrit sous forme d'une fonction
de type de Cobb-Douglass comme suit :
Modèle 1 : VASt = á0+ á1(FBCFPUBt) +
á2(FBCFPRIVt) + á3(IDEt) + á4(TXINSECt) + åt
Modèle 2 : EMPLINDt = â0+ â1(FBCFPUBt) +
â2(FBCFPRIVt) + â3(IDEt) + â4(TXINSECt) +
åt
A. Description des variables
Selon la littérature (croissance endogène)
utilisée dans cette étude pour mesurer l'impact de
l'investissement sur la croissance et sur l'emploi le modèle
utilisé dans cette étude modélise par essence les
relations dynamiques entre un groupe de variables (capital physique, et en
capital humain) choisies pour caractériser la croissance
économique.
emploi industriel (EMPLOIIND), investissement direct
étranger (IDE), taux d'inscription aux études secondaires
(TXINSEC).
L'indicateur utilisé pour mesurer la croissance
économique dans le secteur industriel est la valeur ajoutée
secondaire (VASEC).
Dans le cadre de ce type de modèle, il s'agit
d'examiner la relation ou les rapports réciproques entre
l'investissement et la croissance économique en adoptant une
démarche en termes de causalité pour identifier les canaux de
transmission les plus importants vers la croissance économiques.
La croissance économique apporte de nombreux
bénéfices aux pays : amélioration du niveau de vie et du
pouvoir d'achat, augmentation de l'espérance de vie, meilleure
scolarisation et formation, baisse de la pauvreté et du chômage,
stabilité politique, baisse des risques liés aux conflits, entre
autres.
IDE dans le cas de cette définition, on prend en compte
le solde des entrées et des sorties. Il s'agit, en fait, de la
différence entre les capitaux investis à l'étranger et les
capitaux reçus de l'étranger.
FBCFPUB ici il s'agit d'investissement de renouvellement (pour
usure et obsolescence), ainsi que d'investissements nouveaux de l'Etat. Elle
est composée d'investissement en infrastructures de base et une
composante immatérielle (logiciels, brevets et formations).
FBCFPRIV comme énumérer ci-dessus cet
agrégat désigne aussi bien les investissements de renouvellement
que les investissements nouveaux du secteur privé.
VASEC (variable expliquée) cette valeur mesure la
richesse brute créée par le secteur industriel,
c'est-à-dire sa capacité à générer de la
richesse par son cycle de production.
EMPLOIIND (variable expliquée) il s'agit du nombre de
salariés qui travaillent dans le secteur industriel en termes de
pourcentage par rapport à l'ensemble des emplois. En plus des emplois
manufacturiers, ce secteur comprend, entre autres, les activités
minières, le forage, la construction ainsi que des emplois dans les
services publics comme l'électricité, le gaz et l'aqueduc. En
pourcentage de l'emploi total.
TXINSEC est le taux d'inscription aux études secondaires :
la qualité des ressources humaines du pays d'accueil constitue un
élément essentiel pour l'attraction de l'investissement au Mali.
Le capital humain est mesuré par le taux d'inscription aux études
secondaires (en % brut), il a évolué au Mali de 6,79% en 1990
à 41,47% en 2017.
Nous voulons savoir si les séries sont stationnaires
(intégrées d'ordre 0) ou non stationnaires
(intégrées d'un ordre supérieur ou égal à
1).
L'introduction de la nouvelle technologie de communication et
l'amélioration de l'infrastructure de base (eau, transport,
énergie...) sont des facteurs de succès pour la croissance et la
création d'emploi.
B. Source des données
Tableau 6 : Présentation de la source de données
|
Variables
|
Définition
|
source
|
Mesure
|
|
FBCFPUB
|
Formation brute de capital fixe publique
|
BAD
|
En milliard de F CFA
|
|
FBCFPRIV
|
Formation brute de capital fixe privée
|
BAD
|
En milliard de F CFA
|
|
IDE
|
Investissement direct étranger
|
BAD
|
En milliard de F CFA
|
|
VASEC
|
Valeur ajoutée du secondaire
|
Banque Mondiale
|
En milliard de F CFA
|
|
EMPLOIIND
|
Emploi généré par l'industriel
|
Banque Mondiale
|
En effectif
|
|
TXINSEC
|
Taux d'inscription aux études secondaires
|
Banque Mondiale
|
En %
|
3. Démarche méthodologique
Le choix des variables s'inspire des travaux empiriques
d'AMRANI, OULHAJ et HAMMES (2004) et aussi de Tchouassi Gérard 2016 :
Capital Humain et croissance économique et des travaux d'Ahmed ZAKANE
2009 : Impact des dépenses d'infrastructures sur la croissance en
Algérie. Ces deux auteurs se sont inspirés des nouvelles
théories de la croissance économique, auxquelles sont
associés les noms de Römer (1986), Lucas (1988) et Barro (1996).
Après avoir étudié la
stationnarité des séries, nous avons constaté qu'elles
sont intégrées d'ordre 1, nous pouvons donc émettre
l'hypothèse que nos variables soient cointégrées. Pour
valider cette hypothèse, nous allons utiliser le test du nombre de
relation de cointégration de JOHANSEN (1988). Ensuite, il conviendra de
suivre la procédure en deux étapes d'ENGLE-GRANGER pour estimer
la relation de long terme et de court terme.
A. Tests pré-estimation
Nous voulons déterminer l'ordre d'intégration
des variables. Cette étape est importante pour la suite. Nous utilisons
différents tests de stationnarité : parmi lesquels le test de
racine unitaire de Dickey-Fuller (ADF).
Nous employons la stratégie séquentielle des tests
de racine unité. Nous estimons, en premier lieu, le modèle avec
tendance et constante. Quand la variable tendance n'est pas significative,
alors nous estimons le modèle avec constante seulement.
1. Test de stationnarité des variables de type
Philippe Perron
Les séries macroéconomiques sont en
général non stationnaires. Il convient donc de les rendre
stationnaires avant l'estimation des coefficients du modèle par la
méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) qui ne s'applique
qu'aux séries stationnaires.
Une série chronologique est stationnaire si elle est la
réalisation d'un processus stationnaire. Ceci implique que la
série ne comporte ni tendance, ni saisonnalité et plus
généralement, aucun facteur évoluant avec le temps.
Autrement dit, un processus stochastique Xt est stationnaire si
:
- E (Xt) = E (Xt+h) = ì ? t et ? h, c'est-à-dire la
moyenne est constante et indépendante du temps - La variance est finie
et indépendante du temps ;
- La fonction d'auto covariance cov (Xt, Xt+h) est
indépendante du temps.
Parmi les tests de détection de racine unitaire, on
distingue essentiellement celui de Dickey et Fuller et celui de Phillips et
Perron. Nous allons utiliser ici le test de Phillips et Perron (PP) pour
prendre en compte l'hypothèse d'autocorrélation des erreurs.
Les hypothèses, nulle et alternative se présentent
comme suit :
H0 : le processus est non stationnaire (présence de racine
unitaire) H1 : le processus est stationnaire
La règle de décision consiste à comparer la
valeur PP à celle critique (CV). Si PP < CV, on accepte
l'hypothèse de stationnarité de la série. On peut aussi
lire tout simplement la valeur de la probabilité (prob) correspondante
et effectuer une comparaison avec un seuil donné (1%, 5% ou 10%). Dans
ce cas, si prob <5%, on accepte l'hypothèse de
stationnarité.
Les résultats des tests de stationnarité des
variables sont retracés dans le tableau qui suivent dans lesquels sont
données les t-statistiques à niveau et en différence
première.
Tableau 7 : Résultat des tests de stationnarité
|
Variables en log
|
I(0)
|
I(1)
|
|
FBCFPUB
|
-3,853**
|
-
|
|
FBCFPRIV
|
-
|
-7,762***
|
|
IDE
|
-4,168*
|
-
|
|
VASEC
|
-
|
-4,749***
|
|
EMPLOIIND
|
-
|
-5,976***
|
|
TXINSEC
|
-
|
-4,243***
|
Source : Auteur à partir de STATA 15
- I(0) = Test de stationnarité à niveau ;
- I(1) = Test de stationnaire en différence
première ;
- *** = Seuil de 1% ; ** = Seuil de 5% et * = Seuil de 10%
Il ressort du tableau que les variables du modèle ne
sont pas stationnaires au même niveau. Seuls les variables FBCFPUB et IDE
sont stationnaires à niveau tandis que les autres sont stationnaires en
différence première. Ce qui nous amène à texter le
degré d'intégration des variables à l'aide de la technique
de cointégration de Johansen (1988).
2. Test de cointégration de Johansen (1988)
L'existence d'une relation de long terme entre des variables
individuellement non stationnaire est à la base de la théorie de
la cointégration. Cette théorie permet d'étudier des
séries non stationnaires mais dont une combinaison linéaire est
stationnaire. Le but de ce test est donc de détecter si les variables
possédant une racine unitaire ont une tendance stochastique commune. Si
les variables sont cointégrées, elles admettent une
spécification dynamique de type correction d'erreur, qui transforme le
problème initial de régression sur les variables non
stationnaires. La cointégration permet d'identifier la relation
véritable entre deux variables en recherchant l'existence d'un vecteur
de cointégration et en éliminant son effet, le cas
échéant.
Soient les hypothèses suivantes :
H0 : absence de cointégration
H1 : présence de vecteur cointégrant
La règle de décision consiste à comparer
le ratio de vraisemblance à la valeur critique (CV). Si le ratio de
vraisemblance est supérieur à la valeur critique, on accepte
l'hypothèse de cointégration ; sinon on la rejette. On peut aussi
comparer la probabilité correspondante (prob)
Modèle 2 : LOG(EMPLOIIND)t = â0+
â1ln(FBCFPUBt) + â2ln(FBCFPRIVt) + â3ln(IDEt) +
â4ln(TXINSECt) + åt
au seuil de 5%. Dans ce cas si prob < 5%, on accepte
l'hypothèse de cointégration, sinon on la rejette. Sur STATA, on
dispose de plusieurs options. L'hypothèse de cointégration est
admise si le test concluant pour au moins une des options.
D'après les résultats du test on accepte
l'hypothèse de cointégration puisque la probabilité est
inférieure au seuil de 5% ainsi que le ratio de vraisemblance est
supérieur à la valeur critique. Comme les variables sont
cointégrées, elles admettent une spécification dynamique
de type correction d'erreur. Nous pouvons alors estimer un modèle
appelé modèle à correction d'erreur (MCE) qui
intègre les variables en variation et en niveau (le
théorème de la représentation d'Engle et Granger met en
évidence le lien entre cointégration et modèle à
correction d'erreur). L'emploi d'un modèle à correction d'erreur
dans le cas de la cointégration permet d'obtenir des prévisions
plus fiables que si on avait utilisé la relation de long terme car les
résultats de l'estimation de cette relation sont faussés par la
non stationnarité des séries (voir annexe).
B. Estimation par le modèle à correction
d'erreur de type Engle et Granger
L'une des approches de la théorie de la
cointégration est la méthode à deux étapes
proposée par ENGLE et GRANGER (1987). L'approche de ENGLE GRANGER
consiste, lors de la première étape à montrer qu'il existe
une relation de long terme entre une variable dépendante et des
variables explicatives, puis lors de la seconde étape, à exprimer
ces variables cointégrées sous la forme d'un modèle
à correction d'erreur.
Le coefficient ä doit être significativement
négatif. Dans le cas contraire, la spécification de type MCE
n'est pas valable.
L'inconvénient de la méthode d'Engle et Granger
(1987) est qu'elle ne permet pas de distinguer plusieurs relations de
cointégration. En effet, si on étudie simultanément N
variables avec N>2, on peut avoir jusqu'à (N-1) relations de
cointégration. La méthode d'Engle et Granger (1987) ne nous
permet d'obtenir qu'une seule relation de cointégration. Afin de pallier
cette difficulté, Johansen (1988) a proposé une approche
multivariée de la cointégration fondée sur la
méthode du maximum de vraisemblance.
L'estimation de ce dernier permettant notamment de
déterminer les ajustements de court terme. Le modèle à
long terme est le suivant :
Modèle 1 : LOG(VASEC)t = á0+
á1ln(FBCFPUBt) + á2ln(FBCFPRIVt) + á3ln(IDEt) +
á4ln(TXINSECt) + åt
I. Étape 1 : Estimation de la relation long terme
Modèle 1 :
LOG(VASESC)t = 2,73 + 0,19ln(FBCFPUBt) - 0,24ln(FBCFPRIVt) +
0,39ln(IDEt) + 1,27ln(TXINSECt)
R2 = 0,98 ; Test de Fisher = 437,02 ; Prob = 0,0000 ;
Observation = 25 Modèle 2 :
LOG(EMPLOIIND)t = 15,58 - 0,02ln(FBCFPUBt) +
0,04ln(FBCFPRIVt) - 0,02ln(IDEt) + 0,55ln(TXINSECt)
R2 = 0,97 ; Test de Fisher = 224,47 ; Prob = 0,0000 ;
Observation = 25
Comme précisé plus haut la relation de long
terme suppose qu'il existe une combinaison stable à long terme entre les
variables. L'estimation du modèle à long terme conduit au
résultat suivant :
II. Étape 2 : Estimation de la relation dynamique
Le modèle à correction d'erreur (dynamique de
court terme) se définit par la différentiation d'ordre un de la
relation de long terme, puis par ajout du résidu retardé de la
relation de long terme. Où åt représente les erreurs et
ä est la force de rappel vers l'équilibre, il a pour rôle de
« corriger l'erreur » (faire tendre la relation de court terme vers
la valeur cible de long terme). Ce terme doit avoir un signe négatif,
sinon il n'existe pas de phénomène de retour à
l'équilibre. L'estimation du modèle à court terme est la
suivante :
Modèle 1 :
DLOG(VASESC)t = 0,02 - 0,56ä(Residual)t-1 +
0,25D(lnFBCFPUBt) - 0,01D(lnFBCFPRIVt) + 0,01D(lnIDEt) + 0,90D(lnTXINSECt) +
åt
R2 = 0,36 ; F- Statistic = 1,83 ; Prob = 0,1628 ; Observation =
25 Modèle 2 :
DLOG(EMPLOIIND)t = 15,58 - 1,18ä(Residual)t-1 -
0,06D(lnFBCFPUBt) - 0,03D(lnFBCFPRIVt) - 0,01D(lnIDEt) + 0,09D(lnTXINSECt) +
åt
R2 = 0,97 ; F- Statistic = 224,47 ; Prob = 0,0000 ; Observation =
25
Comme précisé plus haut la relation de long
terme suppose qu'il existe une combinaison stable à long terme entre les
variables. L'estimation du modèle à long terme conduit au
résultat suivant :
C. Test post-estimation
Pour la validation du modèle il est indispensable
d'effectuer les tests d'autocorrélation et de significativité.
Pour ce faire nous avons effectué le test d'autocorrélation de
type Breusch Godgrey pour vérifier si les erreurs sont
corrélées. A noter qu'en cas du MCO la variance des erreurs est
la même quel que soit l'observation. Donc les erreurs sont
homoscédastiques. D'après les résultats obtenus les
modèles MCE sont très satisfaisants et cela pour plusieurs
raisons :
? le coefficient de ä(Residual)t-1 est négatif, ce
qui permet de valider les MCE ;
? le coefficient de détermination est : R2 =
0,97 pour le modèle (2) et R2 = 0,98 pour le modèle
(1) ;
? la probabilité Prob = 0,0000 pour le modèle 2
et prob = 0,0000 pour le modèle 1 sont inférieurs à 0.05
donc il existe au moins un paramètre significativement non nul autrement
dit le modèle 1 et 2 sont globalement significatifs ;
? le F - statistic est 437,02 pour le modèle 1 et 224,47
pour le modèle 2 ;
? les résidus ne sont pas autocorrelés, en effet
le test de BREUSCH-GODFREY indique les probabilités supérieur
à 0.05 pour les modèles 1 et 2 (voir annexe 2).
Les modèles 1 et 2 nous semblent assez satisfaisants et
les hypothèses sur les résidus aussi, nous pouvons donc
dès à présent nous intéresser à
l'interprétation des résultats.
Section 2 : Interprétation et discussions des
résultats empiriques
I. Interprétation des résultats empiriques
:
Tableau 8 : Présentation des résultats
empiriques
|
Variables en log
|
Court terme
|
Long terme
|
|
Modèle (1) et (2)
|
Modèle (1)
|
Modèle (2)
|
Modèle (1)
|
Modèle (2)
|
|
FBCFPUB
|
0,25
|
-0,06
|
0,34
|
-0,02
|
|
FBCFPRIV
|
-0,01
|
-0,03
|
-0,43
|
0,04
|
|
IDE
|
0,01
|
-0,01
|
0,70
|
-0,02
|
|
TXINSEC
|
0,90
|
0,09
|
2,27
|
0,55
|
Source : résultat de l'estimation de l'auteur
L'objectif principal de notre travail est d'évaluer
l'impact de l'investissement sur la croissance du secteur industriel d'une part
et d'autre en termes de création d'emploi dans le dit secteur. De
façon générale on constate que toutes les variables
agissent positivement sur la valeur ajoutée
industrielle malien sauf la variable formation brute de
capital fixe privée. Et que toutes les variables sont plus
significatives à long terme qu'à court terme.
Mais contrairement au premier modèle on constate que
toutes les variables agissent négativement sur l'emploi industriel
à court terme sauf le taux d'inscription aux études secondaires.
Et cette tendance continue à long terme mais la formation brute de
capital fixe privée rejoint le rang positif.
Pour atteindre les objectifs spécifiques qui sont sous
forme de questions, l'interprétation des résultats se fera donc
dans le cadre de ces questions de recherche.
? Quels sont les impacts de l'investissement en termes de
croissance économique dans le secteur industriel ?
Elasticités de court terme
L'élasticité de court terme de la croissance
dans le secteur industriel par rapport à la formation brute de capital
fixe publique est : 0,25. Ce qui signifie que si la formation brute de capital
fixe publique augmente de 10%, la valeur ajoutée dans le secteur
industriel augmente de 25%.
L'élasticité de court terme de la croissance
dans le secteur industriel par rapport à la formation brute de capital
fixe privée est : -0,01. Ce qui signifie que si la formation brute de
capital fixe privée augmente de 10%, la valeur ajoutée dans le
secteur industriel diminue de 1%.
L'élasticité de court terme de la croissance
dans le secteur industriel par rapport à l'IDE est : 0,01.Ce qui
signifie qu'au Mali si les IDE augmentent de 10%, la valeur ajoutée dans
le secteur industriel augmente de 1%.
L'élasticité de court terme de la croissance
dans le secteur industriel par rapport au taux d'inscription aux études
secondaires est : 0,90.Ce qui signifie qu'au Mali si le taux d'inscription aux
études secondaires augmente de 10%, la valeur ajoutée dans le
secteur industriel augmente de 90%.
Elasticités de long terme
L'élasticité de long terme de la croissance dans
le secteur industriel par rapport à la formation brute de capital fixe
publique est : 0,19/-0,56 = 0,34. Ce qui signifie qu'au Mali si la formation
brute de capital fixe publique augmente de 10%, la valeur ajoutée dans
le secteur industriel augmente de 34%.
L'élasticité de long terme de la croissance dans
le secteur industriel par rapport à la formation brute de capital fixe
publique est : - 0,02 / - 0,56 = - 0,04. Ce qui signifie qu'au Mali si la
L'élasticité de long terme de la croissance dans
le secteur industriel par rapport à la formation brute de capital fixe
privée est : -0,24/-0,56 = -0,43. Ce qui signifie qu'au Mali si la
formation brute de capital fixe privée augmente de 10%, la valeur
ajoutée dans le secteur industriel diminue de 43%.
L'élasticité de long terme de la croissance dans
le secteur industriel par rapport à l'IDE est : 0,39/-0,56 = 0,70. Ce
qui signifie qu'au Mali si les IDE augmentent de 10%, la valeur ajoutée
dans le secteur industriel augmente de 70%.
L'élasticité de long terme de la croissance dans
le secteur industriel par rapport au taux d'inscription aux études
secondaires est : 2,27.Ce qui signifie qu'au Mali si le taux d'inscription aux
études secondaires augmente de 10%, la valeur ajoutée dans le
secteur industriel augmente de 227%.
? Quels sont les impacts de l'investissement en termes de
création d'emploi dans le secteur industriel ?
Elasticités de court terme
L'élasticité de court terme de l'emploi dans le
secteur industriel par rapport à la formation brute de capital fixe
publique est : -0,06. Ce qui signifie que si la formation brute de capital fixe
publique augmente de 10%, l'emploi dans le secteur industriel diminue de 6%.
L'élasticité de court terme de la croissance
dans le secteur industriel par rapport à la formation brute de capital
fixe privée est : -0,03. Ce qui signifie que si la formation brute de
capital fixe privée augmente de 10%, l'emploi dans le secteur industriel
diminue de 3%.
L'élasticité de court terme de la croissance
dans le secteur industriel par rapport à l'IDE est : -0,01. Ce qui
signifie qu'au Mali si les IDE augmentent de 10%, la valeur ajoutée dans
le secteur industriel diminue de 1%.
L'élasticité de court terme de la croissance
dans le secteur industriel par rapport au taux d'inscription aux études
secondaires est : 0,09. Ce qui signifie qu'au Mali si le taux d'inscription aux
études secondaires augmente de 10%, l'emploi dans le secteur industriel
augmente de 9%.
Elasticités de long terme
formation brute de capital fixe publique augmente de 10%,
l'emploi dans le secteur industriel diminue de 4%.
L'élasticité de long terme de la croissance dans
le secteur industriel par rapport à la formation brute de capital fixe
privée est : 0,04 / - 0,56 = 0,07. Ce qui signifie qu'au Mali si la
formation brute de capital fixe privée augmente de 10%, l'emploi dans le
secteur industriel augmente de 7%.
L'élasticité de long terme de la croissance dans
le secteur industriel par rapport à l'IDE est : - 0,02 / - 0,56 = -
0,04. Ce qui signifie qu'au Mali si les IDE augmentent de 10%, l'emploi dans le
secteur industriel diminue de 4%.
L'élasticité de court terme de la croissance
dans le secteur industriel par rapport au taux d'inscription aux études
secondaires est : 0,55. Ce qui signifie qu'au Mali si le taux d'inscription aux
études secondaires augmente de 10%, l'emploi dans le secteur industriel
augmente de 55%.
Le terme de correction d'erreur (coefficient de
ä(Residual)t-1) est de 0,56 pour le modèle 1 ce qui signifie que
56% des chocs qui affectent la valeur ajoutée secondaire en courte
période s'ajuste en longue période. Autrement dit, 56% du
déséquilibre entre la valeur ajoutée secondaire
désiré et la valeur ajoutée secondaire effectif est
comblé en longue période. Ainsi, les chocs sur la valeur
ajoutée industrielle au Mali se corrigent-ils à 56% par l'effet
de « feed back ». En d'autres termes, un choc constaté au
cours d'une année est entièrement résorbé au bout
d'une année et 8 mois (1/ 0,134 = 1,8 année).
Le terme de correction d'erreur (coefficient de ä
Residualt-1) est de 1,18 pour le modèle 2 ce qui signifie que 118% des
chocs qui affectent l'emploi dans l'industrie en courte période s'ajuste
en longue période. Autrement dit, 118% du déséquilibre
entre l'emploi dans l'industrie désiré et l'emploi dans
l'industrie effectif est comblé en longue période. Ainsi, les
chocs sur l'emploi industriel au Mali se corrigent-ils à 118% par
l'effet de « feed back ». En d'autres termes, un choc constaté
au cours d'une année est entièrement résorbé au
bout de 8 mois (1/ 1,18 = 0,8 année).
Le R2 = 0,98 pour le modèle 1 ce qui
signifie que 98% de la relation est expliqué par le modèle et
seulement 2% par l'erreur. Et R2 = 0,97 pour le modèle 2 ce
qui signifie que 97% de la relation est expliqué par le modèle et
seulement 3% par l'erreur.
II. Discussion des résultats
Cette partie se focalise essentiellement sur une comparaison
des résultats de notre étude et des résultats empiriques
antérieurs. D'après les résultats des tests de
stationnarités et de cointégration, on conclut qu'il existe une
relation de long terme entre l'investissement et la croissance et
l'investissement et la création d'emploi.
Cependant on peut conclure que l'investissement quelque soit
sa nature (publique ou privée) est significatif et positif sur la
croissance dans le secteur industriel mais non significatif et négatif
sur l'emploi dans le secteur industriel au Mali.
Rappelons que la formation brute de capital fixe, est
l'agrégat qui mesure en comptabilité nationale, l'investissement
(acquisition de biens de production) en capital fixe des différents
agents économiques résidents.
De nombreuses études démontrent la pertinence de
l'investissement sur la croissance dans le secteur industriel même si
quelques-uns trouvent le résultat contraire. Par contre les effets de ce
dernier sur l'emploi sont assez mitigés. Parmi les études
empiriques le concernant le premier cas on peut noter :
- M.-P.Brugnes-Romieu, Investissements industriels et
développement en Tunisie, pp. 521525 / Année 1968. Les auteurs
ont dégagés avec un maximum de clarté l'ensemble des
effets significatifs et positifs économiques et sociaux entrainés
par les investissements industriels en Tunisie. Outre ils suggèrent que
cela n'est possible qu'avec l'accompagnement des mesures adéquates de la
part des responsables de l'économie.
- Jean-Claude Dutailly, Investissement et créations
d'emplois en France : impact par secteur d'activité et taille
d'entreprise. Année 1983 / pp. 3-14. Dutailly démontre que le
nombre d'emploi créés dépend du montant de
l'investissement réalisé et du secteur d'activité.
- Mano Yempabou Landry Clotaire 2015 : Effets de l'ouverture
commerciale sur la croissance économique au Burkina Faso. Cet auteur
trouve que l'investissement direct étranger et le capital humain
agissent négativement sur le PIB réel burkinabè.
Outre d'autres études empiriques démontre aussi
l'effet négatif de l'investissement sur l'emploi dans le secteur
industriel, parmi lesquelles :
- Billaudot Bernard. Accumulation, croissance et emploi dans
l'industrie française : rétrospective 1959-1974. In: Economie et
statistique, N°127, Novembre 1980. pp. 83-99. Cet article stipule que
l'accumulation du taux d'investissement se caractérise
essentiellement sur la substitution du capital/travail et une
réduction progressive de l'efficacité de la main d'oeuvre dans
les industries à court et moyen terme.
- L'OCDE 2007 : Les délocalisations et l'emploi
Tendances et impacts. Ce dernier article fait allusion au caractère
délocalisation des industries manufacturières. Cependant il met
en garde l'importation massive des produits manufacturiers : « une
augmentation de 1% de la part des produits manufacturiers importés
réduirait de 0,18 % l'emploi dans le pays d'accueil ».
Enfin nous avons de bonnes raisons de croire que dans le long
terme et court terme, l'investissement quelque soit sa nature (publique ou
privée) reste un levier indispensable à la croissance dans le
secteur industriel même s'il faut noter que ces effets sur l'emploi n'est
pas significatif. Le caractère non significatif de l'investissement sur
l'emploi dans le secteur industriel malien peut s'expliquer sous plusieurs
formes notamment : l'inadéquation de l'offre et la demande d'emploi et
aussi la forte substitution du capital/travail dans ce secteur.
Conclusion et implications
A la lumière de cette étude, nous avons pu
constater que l'investissement (public et IDE) est effectivement un instrument
fondamental de la relance économique par le biais de l'industrie aussi
bien dans la littérature économique que dans les travaux
empiriques. Surtout dans un pays où la part de l'industrie reste encore
marginale dans le PIB. L'intervention de l'Etat dans la sphère
économique en matière de dépenses surtout en
infrastructure de base deviendra donc une exigence économique et une
condition nécessaire pour stimuler l'investissement privé voire
la croissance durable.
Dans cette étude, nous nous sommes basés sur une
évidence empirique à savoir le modèle à correction
d'erreur qui permet de déterminer la dynamique de l'investissement dans
le court et le long terme. En termes de résultats, l'estimation du
modèle (1) par la méthode Engle et Granger a pu montrer que
l'investissement représentent une variable endogène,
c'est-à-dire que la valeur ajoutée industrielle augmente au fur
et à mesure que l'investissement augmente.
Par contre l'estimation du modèle (2) par la même
méthode montre que l'effet négatif et non significatif de
l'investissement sur l'emploi dans le secteur industriel malien. Outre le taux
d'inscription aux études secondaires a un effet considérable sur
l'emploi industriel malien.
Au Mali malgré les efforts entrepris par les pouvoirs
publics, l'industrie demeure dans une situation embryonnaire et cela pour
plusieurs raisons. Il s'agit notamment :
- de l'importation massive des biens manufacturiers ;
- de l'aggravation des déficits publics qui ont pour
danger d'exercer des effets d'éviction sur
l'endettement des entreprises privées ;
- la globalisation des économies qui peut faire subir les
aléas venant d'ailleurs sur une
économie malgré qu'elle ait investi lourdement ;
- de la lourdeur administrative de création d'entreprise
;
- le coût élevé de
l'électricité et le cout élevé des matières
premières ;
- la concurrence et la fraude fiscale ;
- à tous ces défis s'ajoute la difficulté de
financement de projets industriels.
Ainsi pour permettre aux dépenses d'investissement dans
le secteur industriel de répondre pleinement aux attentes et de
participer à hauteur de souhait à l'essor économique
nationale par le biais de l'accroissement de la valeur ajoutée et de
créer plus d'emploi dans ce secteur, certaines dispositions doivent
être prises. Notamment en matière d'encouragement de projet
d'investissement industriel et d'adéquation de l'offre et de la demande
d'emploi industriel :
> à faciliter l'accès aux financements des
entreprises industrielles ;
> d'asseoir un tarif préférentiel
d'électricité plus soutenable pour les industries ;
> collecter, traiter et diffuser les données relatives
au secteur de l'industrie ;
> réaliser des études et recherches en vue
d'élaborer des stratégies appropriées et
adéquates
pour le secteur industriel ;
> assurer la coordination du suivi des entreprises et projets
industriels et le contrôle des
engagements au titre de l'agrément au code des
investissements ;
> développer la coopération industrielle ;
> améliorer le développement des pôles
industriels ;
> contribuer à l'amélioration de la
compétitivité du secteur industriel ;
> assurer un appui technique et technologique aux
unités industrielles ;
> introduire des filières d'étude technique
industrielles dans le système éducatif national ;
> mis en place des politiques d'incitation pour encourager
l'employabilité des sortants du
système éducatif national.
Il impératif de mentionner qu'il existe plusieurs
pistes de recherches pour améliorer cette modeste étude entre
autres. Dans une perspective d'enrichissement de notre étude, une voie
de recherche consiste à examiner l'impact de l'investissement sur la
croissance économique pour le cas des pays de l'UEMOA et les pays en
développement afin d'identifier les points de similarités et de
différences.
Bibliographie
1. Ouvrages généraux
· Robert Ford et Pierre Poret : L'investissement des
entreprises, Edition 1991 ;
· Guide d'investissement au Mali, Nations Unies, Edition
2000 ;
· Colletaz, G. (03 Avril 2017). Une présentation
simplifiée de l'approche de johansen ;
· Pierre-Alain Muet, juin 1993 ;
· Investissement et emploi de Phillipe Madinier, Sep 1976,
pp.244-253 ;
· Claude Dutailly 1983 pp. 3-14 ;
· Théorie générale de l'emploi, de
l'intérêt et de la monnaie, John Maynard Keynes, 1936 ;
· Jean-Claude Dutailly 1983 pp.3-14) : Le dynamique du
sysème productif : Investissement, emploi, rentabilité ;
· Martine Ledrans, 2014 : Séries temporelles et
modèles de régression ;
· Arthur Charpentier : Modèles de prévision
Séries temporelles, hiver 2011 ;
· Patrick Artus et Moncef Kaabi : Dépenses
publiques, progrès technique et croissance, 1993 / 44-2 / pp. 287-318
;
· Perspectives économiques en Afrique 2019.
2. Ouvrages spécialisés :
· Croissance, Emploi et politiques de l'emploi au Mali,
1ère Edition ; Bourdet, Yves, Dabitao, Kassim,
Dembélé, Aoua Saran, 2012 ;
· Perspectives économiques régionales :
Afrique subsaharienne, chap3 : Redynamiser la croissance par l'investissement
privé par : Jesus Gonzalez-Garcia, Romain Bouis, Paolo Cavallino, Nkunde
Mwase, Hector Perez-Saiz, Ludger Wocken et Mustafa Yenice ;
· Marché de l'investissement d'impact en Afrique de
l'Ouest, Juin 2016 ;
· Hélène Hamisultane : Modèle à
correction d'erreur (MCE) et application, Janvier 2016 ;
· Perspectives économiques de l'OCDE 2015 : Chap 3 :
Stimuler l'investissement pour une croissance plus forte et durable ;
· Alain Cotta 1983 pp. 691-731 : Le Capitalisme.
3. Articles :
· Mohamed Raja AMRANI, Lahcen OULHAJ et Khalid HAMMES 2005
: Deux études
sur les impacts des dépenses publiques sur la
croissance économique (1970- 2004) ;
· Essai de modélisation de l'impact des
dépenses publiques sur la croissance économique au Maroc : Salah
Eddine Salhi, Mohammed Janati and Abdellah Echaoui, October 2018 ;
· Jonas Kibala Kuma Avril 2018 : Les modèles VAR et
VEC : Applications sur Stata (var,vec) et analyse des outputs Eviews (var) ;
· Ahmed ZAKANE 2009 : L'impact des depnses
d'infrastructures sur la croissance en Algérie. Une approche en series
temporelles multi variées (VAR) ;
· Marius Bendoma et Cyrille Messiné Essomba :
Investissement public et croissance au Cameroun, Juin 2017 ;
· Sylvie Charlot Mai 2017 : Dépenses publiques et
croissance : effets macroéconomiques et spécificités
régionales ;
· Fousseini Traoré : Chômage et conditions
d'emploi des jeunes au Mali, Edition 2005 ;
· Maurice Catin : Les mécanismes et les
étapes de la croissance régionale, Edition 1995 ; Tchouassi
Gérard. (01 Mai 2017). Capital humain et croissance économique :
une modélisation VAR avec cointégration ;
· Asiedu, 2002, 2006 ; Dupasquier et Osakwe, 2006 : Foreign
direct investment in Africa
· Farole et Moberg, 2017 : Redynamiser la croissance par
l'investissement privé ;
· Steenbergen et Javorcik, 2017 : Dynamique du
développement en Afrique ;
· Investissement et création d'emplois : impact par
secteur d'activité et taille d'emploi ;
· IBANDA KABAKA Paulin, 2017 : L'importance des depenses
d'investissement sur la croissance économique ;
· Latif Dramani, Oumy Laye, 2017 : Lien entre les
investissements en technologies de l'information et de la communication, la
croissance et l'emploi au Sénégal ;
· Tahtah, Hind, 2013 : Public expenditures and economic
growth in Morocco ;
· BARRO, R et SALA-I-MARTIN, X., 1996 : La croissance
économique ;
· Aghion et Howitt, 1992 : L'innovation ;
· Barro 1990 : Les nouvelles connaissances. 4.
Rapports :
· Opportunités d'investissements au Mali Edition
2017 ;
· Le Mali en chiffre 2016 et 2014 ;
· Rapport d'Analyse Economique du Développement du
Secteur Minier et des Défis de la Préservation de de
l'Environnement et des Ressources Naturelles des Ministère de
l'Environnement, de l'Assainissement et du
Développement Durable (MEADD) Ministère de l'Economie et des
Finances (MEF), Novembre 2015;
· Rapport d'assistance technique - Evaluation de la
gestion des investissements publics-PIMA, 2018 ;
· Recensement industriel 2015 ;
· Rapport ITIE 2014 : Initiative pour la transparence
dans les industries extractives du Mali ;
· Compte Economique du Mali 1999-2013 ;
· Claude BERTHOMIEU, Fabienne BONETTO (CEMAFI. Nice) :
Analyse des investissements publics de croissance (capacity building public
investments) et les difficultés de leur financement. Etude des cas pour
six pays partenaires méditerranéens : Maroc, Tunisie, Turquie,
Egypte, Israël, Liban, Février 2006 ;
·
5. Textes législatifs et règlementaires
:
· Document de la Politique Nationale de l'emploi (PNE),
Edition 2005 ;
· Document de la Politique de Développement
Industriel (PDI) du Mali, Edition 2010 ;
· Code des Investissements au Mali, Edition 1991 ;
6. Sites internet :
· Portail : Economie - Wikipédia (
www.wikipédia.com)
· OpenEdition (
www.OpenEdition.org)
· Banque Mondiale : Perspective monde (
www.perspective.usherbrooke.ca)
· Opendata (
http://Mali.opendataforafrica.org)
BIBLIOGRAPHIE 71
Table des matières
DEDICACE 2
REMERCIEMENTS 3
SIGLES ET ABREVIATIONS 4
RESUME 6
SOMMAIRE 7
INTRODUCTION 9
CHAPITRE 1 : ANALYSE DESCRIPTIVE DE L'INVESTISSEMENT
INDUSTRIEL 12
SECTION 1 : SITUATION DES ACTIONS PUBLIQUES EN FAVEUR
DE L'INVESTISSEMENT EN
AFRIQUE SUBSAHARIENNE 13
I. PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE 14
II. INITIATIVES INTERNATIONALES DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT
PRIVE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 15
SECTION 2 : ETAT DU PARC INDUSTRIEL ET DE SON
INVESTISSEMENT AU MALI 17
I. GENERALITE 17
A. L'investissement intérieur 18
B. L'Investissement Direct Etranger (IDE) au Mali 19
II. INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET LA CROISSANCE ECONOMIQUE AU MALI
21
1. Situation de l'activité extractive 23
2. L'activité de fabrication 27
3. Section production et distribution
d'électricité, de gaz et d'eau 28
III. INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET CREATION D'EMPLOI AU MALI 30
1. Situation de l'emploi au Mali 30
2. Effets collatéraux des investissements industriels
sur l'emploi 32
IV. POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (PDI) ET D'EMPLOI AU
MALI 32
CHAPITRE 2 : CONCEPT ET REVUE DE LITTERATURE
36
SECTION 1 : CONCEPT ET DEFINITION 37
SECTION 2 : REVUE DE LITTERATURE 40
I. REVUE THEORIQUE 40
1. Théorie Keynésienne 40
2. Théories néoclassiques 42
II. REVUE EMPIRIQUE 47
CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE ET ANALYSE DES RESULTATS
53
SECTION 1 : METHODOLOGIE APPLIQUEE 54
I. MODELE THEORIQUE 54
II. MODELE EMPIRIQUE 55
1. Modèle de base 55
2. Présentation du modèle 56
3. Démarche méthodologique 58
SECTION 2 : INTERPRETATION ET DISCUSSIONS DES RESULTATS
EMPIRIQUES 63
I. INTERPRETATION DES RESULTATS EMPIRIQUES : 63
II. DISCUSSION DES RESULTATS 67
CONCLUSION ET IMPLICATIONS 69
ANNEXE : RESULTAT EMPIRIQUE 76
Annexe : Résultat empirique
Tableau : Résultat du test de cointégration de
Johansen 1988
Johansen tests for cointegration
Trend: constant Number of obs = 26
Sample: 1992 - 2017 Lags = 2
5%
maximum trace critical
rank parms LL eigenvalue statistic value
0 30 19.025702 . 74.2417 68.52
1 39 38.359633 0.77400 35.5738* 47.21
2 46 46.22801 0.45407 19.8371 29.68
3 51 51.517228 0.33426 9.2586 15.41
4 54 55.098377 0.24079 2.0963 3.76
5 55 56.146536 0.07746
Source : Auteur sur stata 15
Tableau : Résultat de l'estimation à long terme du
modèle 1 par la méthode Engle et Granger
Source
SS df MS Number of obs = 25
F(4, 20) = 437.02
Residual
18.8787448 4 4.71968619 Prob > F =
0.0000
.215996222 20 .010799811 R-squared =
0.9887
Adj R-squared = 0.9864
19.094741 24 .795614207 Root MSE =
.10392
lvasec
Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
lide
ltxinsec Model
_cons
.1907702 .1191798 1.60 0.125 -.0578345 .4393748
-.2462685 .0804894 -3.06 0.006 -.4141663 -.0783706
.0399065 .0264884 1.51 0.148 -.0153474 .0951604
1.279633 .1343931 9.52 0.000 .9992935 1.559972
2.735886 .3888838 7.04 0.000 1.924689 3.547083
Total
Source : Auteur par stata 15
Tableau : Résultat de l'estimation de la relation
dynamique du modèle 1 par la méthode Engle et Granger
SS df MS Number of obs = 22
lfbcfpub Model
lfbcfpriv
F(5, 16) = 1.83
.060456303 5 .012091261 Prob > F =
0.1628
.105440877 16 .006590055 R-squared =
0.3644
Adj R-squared = 0.1658
Source
.16589718 21 .007899866 Root MSE =
.08118
Residual
Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
Total
lfbcfpub
D.lvasec
lfbcfpriv
.2570521 .1040778
2.47 0.025 .0364169
.4776872
-.01517 .0866778 -0.18 0.863 -.1989188 .1685788
D1.
lide
.0027355 .0154181 0.18 0.861 -.0299495 .0354205
D1.
ltxinsec
D1.
.9087882 .4571292 1.99 0.064 -.0602825 1.877859
D1.
L1.
_cons
erreur
Source : Auteur avec stata 15
-.4933663 .2590444 -1.90 0.075 -1.042516 .0557833
.0279146 .0385198 0.72 0.479 -.0537436 .1095729
Après l'estimation des paramètres par la
méthode des MCO, on effectue le test de corrélation des erreurs
de Breusch-Godfrey.
Tableau : Test de corrélation des erreurs du modèle
1 de type Breusch-Godfrey
Number of gaps in sample: 2
Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
chi2 df Prob > chi2
lags(p)
H0: no serial correlation
Source : Auteur avec stata 15
Les erreurs ne sont pas corrélés puisque les
probabilités sont tous supérieurs à 5%, donc on rejete
l'hypothèse de corrélation des erreurs.
Tableau : Estimation du modèle 1 par la méthode de
Cochrane-Orcutt
Iteration 20: rho = -0.4110
Cochrane-Orcutt AR(1) regression -- iterated
estimates
Source
19
SS df MS Number of obs =
F(9, 9) = 1.87
Model
.118645627 9 .013182847 Prob > F =
0.1823
.063427112 9 .007047457 R-squared =
0.6516
Adj R-squared = 0.3033
Total
.08395
.182072739 18 .010115152 Root MSE =
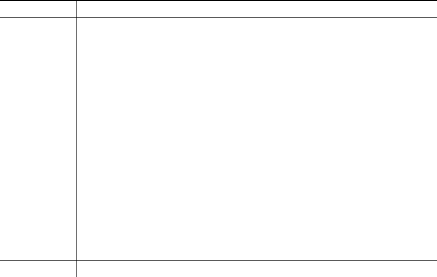
L1.
-.2376058 .2335711 -1.02 0.336 -.7659804 .2907687
Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
D.lvasec
Residual
lfbcfpub
.2533516 .160762 1.58 0.149 -.1103172 .6170205
lfbcfpriv
-.1077039 .1973578 -0.55 0.599 -.5541582 .3387504
lide
.0433935 .0317614 1.37 0.205 -.0284557 .1152426
ltxinsec
.7457448 .9669645 0.77 0.460 -1.441681 2.93317
lvasec
-.5633295 .5218356 -1.08 0.308 -1.743804 .6171447
lfbcfpub
-.0543511 .2566137 -0.21 0.837 -.6348516 .5261493
lfbcfpriv
lide
D1.
D1.
D1.
D1.
L1.
L1.
L1.
.0734521 .0645695
1.14 0.285 -.0726143 .2195185
-.4109721
.8327598 .6106595 1.36 0.206 -.548648 2.214168
2.598888 1.464161 1.78 0.110 -.7132752 5.911051
rho
Tableau : Résultat de l'estimation à long terme du
modèle 2 par la méthode Engle et Granger
ltxinsec
Durbin-Watson statistic (original)
1.954144
L1.
Durbin-Watson statistic (transformed) 2.058384
_cons
Source : Auteur avec stata 15
|
|
|
|
|
|
|
2.71911545
|
|
|
|
Prob
|
|
|
|
.060568427
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
Adj
|
|
|
|
2.77968387
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P>|t|
|
|
|
|
-.0272578
|
.0631106
|
-0.43
|
0.670
|
-.1589043
|
|
|
.0474493
|
.0426225
|
|
0.279
|
-.0414596
|
|
|
-.0228969
|
.0140267
|
-1.63
|
0.118
|
|
|
|
.5521746
|
.0711668
|
7.76
|
0.000
|
.4037233
|
|
|
15.58935
|
|
75.70
|
0.000
|
15.15979
|
|
Source : Auteur avec stata 15
25 224.47 0.0000
0.9782 0.9739 .05503
Interval]
.1043887 .1363582 .0063623
.7006258 16.01891
Tableau : Résultat de l'estimation de la relation
dynamique du modèle 2 par la méthode Engle et Granger
|
|
|
|
Number of obs =
F(4, 20) =
> F =
R-squared =
|
|
|
|
5
16
|
.005171569
|
|
SS
|
df
4
|
MS
.679778861
.003028421
|
|
|
|
|
P>|t|
|
R-squared =
|
|
Total
|
|
24
|
.115820161
|
Root
|
MSE =
|
|
|
-.0644086
|
.0921987
|
-0.70
|
0.495
|
|
|
lemploiind
|
Coef.
|
Std. Err.
|
t
|
|
[95% Conf.
|
|
lfbcfpub lfbcfpriv lide
Source
|
SS
-.0382685
|
df
.0767847
|
1.11
MS
-0.50
|
0.625
|
-.0521561
Number of obs =
-.2010448
|
|
ltxinsec
_cons
Model
Residual
|
.00895141
.082745102
|
.2059301
|
.001790282
|
|
F(5, 16) =
Prob > F =
R-squared =
|
|
|
|
Total
|
.091696511
.0940826
|
21
|
.004366501
0.23
|
0.819
|
Adj R-squared =
Root MSE =
|
|
|
D.lemploiind
|
Coef.
|
Std. Err.
.2294779
|
t
0.17
|
0.867
|
[95% Conf.
|
|
|
.028289
|
|
0.83
|
0.419
|
-.044049
|
|
lfbcfpub
D1.
lfbcfpriv
ltxinsec
L1.
.0390721
_cons
Source : Auteur avec stata 15
22 0.35 0.8772
0.0976 -0.1844 .07191 Interval]
-.2598612
.1310439
D1.
lide
.1245079
D1.
-.011214
.0136584
-0.82
0.424
-.0401684
.0177405
.404954
-.7643814
.9525466
-.4473992
.5255435
.0341232
.100627
Après l'estimation des paramètres par la
méthode des MCO, on effectue le test de corrélation des erreurs
de Breusch-Godfrey.
Tableau : Test de corrélation des erreurs du modèle
2 de type Breusch-Godfrey
D1.
Number of gaps in sample: 2
erreur
Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
chi2 df Prob > chi2
lags(p)
0.216 1 0.6419
H0: no serial correlation
1
Source : Auteur avec stata 15
Les erreurs ne sont pas corrélés puisque les
probabilités sont tous supérieurs à 5%, donc on
rejete l'hypothèse de corrélation des erreurs.
Tableau : Estimation du modèle 2 par la méthode de
Cochrane-Orcutt
Iteration 39: rho = 0.6304
Cochrane-Orcutt AR(1) regression -- iterated
estimates
Source
SS df MS Number of obs =
F(9, 9) = 5.00
Model
Residual
.120808918 9 .013423213 Prob > F =
0.0125
.024170237 9 .002685582 R-squared =
0.8333
Adj R-squared = 0.6666
Total
.144979155 18 .008054398 Root MSE =
.05182
D.lemploiind
Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
lfbcfpub
D1.
-.1990688 .0985567 -2.02 0.074 -.4220195 .023882
lfbcfpriv
D1.
-.0851462 .0730285 -1.17 0.274 -.2503481 .0800557
lide
D1.
-.0048132 .0155478 -0.31 0.764 -.0399847 .0303583
ltxinsec
D1.
-.016765 .435691 -0.04 0.970 -1.002367 .9688366
lemploiind
L1.
-1.184543 .2655349 -4.46 0.002 -1.785224 -.5838611
lfbcfpub
L1.
-.2902292 .1523926 -1.90 0.089 -.6349651 .0545068
lfbcfpriv
L1.
-.010037 .0994431 -0.10 0.922 -.2349928 .2149189
lide
L1.
-.0132245 .0303937 -0.44 0.674 -.0819798 .0555308
ltxinsec
L1.
.9941015 .307744 3.23 0.010 .2979363 1.690267
_cons
19.31307 4.362954 4.43 0.002 9.443379 29.18276
.6303917
rho
Durbin-Watson statistic (original) 1.697099
Durbin-Watson statistic (transformed) 1.299203
Source : Auteur avec stata 15



