INTRODUCTION GENERALE
0.1. PROBLEMATIQUE
Très longtemps, les sociétés humaines
font toujours face aux besoins multiples qui nécessitent des ressources
qui restent en général rares et incertaines. L'Etat utilise des
ressources financières en particulier, pour assurer la couverture et la
satisfaction des besoins de sa population. Dès lors, les Finances
Publiques occupent une place considérable dans le fonctionnement et la
survie des communautés humaines.
Cependant, la mobilisation, l'utilisation, la
répartition ainsi que l'évaluation de ces ressources
nécessitent une bonne gestion pour assurer réellement et
efficacement le fonctionnement harmonieux des collectivités et le
développement socioéconomique de ces dernières. Dans cette
perspective, les finances publiques doivent être gérées de
manière à assurer la stabilité des paramètres
macroéconomiques, de promouvoir la productivité, de stimuler le
commerce extérieur, de créer des emplois, etc.1(*)
La République Démocratique du Congo est l'un des
pays où la pauvreté et la précarité des conditions
de vie sont l'expression caractéristiques de sa population. Les
conditions sanitaires et socioéconomiques dans lesquelles les
populations congolaises vivent laissent à désirer. Par ailleurs,
« les indicateurs sociaux affichent des niveaux tellement bas qu'il
s'avère pratiquement impossible pour le pays d'atteindre un seul des
Objectifs du Millénaire pour le Développement.
En dépit de ses grandes étendues de terres
arables, son important réseau hydrographique, sa diversité de
climats, son potentiel halieutique et d'élevage considérable, la
République Démocratique du Congo se classe parmi les pays
déficitaires en matière agricole et de sécurité
alimentaire.
Cette situation fait suite à l'absence depuis plusieurs
décennies d'une politique agricole appuyée par une
législation susceptible d'impulser la croissance économique et le
développement. Vu son importance dans le renforcement de la
sécurité alimentaire et la réduction de la
pauvreté, l'agriculture occupe une place fondamentale dans le Programme
Multisectoriel d'Urgence de Réhabilitation et de Reconstruction (PMURR),
de relance de l'économie congolaise.2(*)
Bien que l'agriculture ait été reconnue
priorité des priorités depuis le début de la
Deuxième République, le secteur agricole ne contribue pas de
façon significative au développement socioéconomique du
pays. L'incohérence des politiques mises en oeuvre n'a pas permis
d'atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire arrêté
à l'époque.3(*)
Malgré des efforts fournis par le gouvernement
congolais depuis un certain temps, l'état actuel de la gestion des
Finances Publiques inquiète et frustre plus d'un observateur. La
croissance économique et d'autres indicateurs macroéconomiques
sont appréciables mais les conditions de vie de la population restent
médiocres.
Tel a été longtemps le cas et semble
l'être encore aujourd'hui où les méthodes de gestion sont
aux antipodes de l'orthodoxie financière. C'est là une
manifestation de la mauvaise gouvernance, mauvaise affectation de deniers
publics ou mauvaise gestion qu'il faut combattre par la mise sur pieds d'une
éthique publique susceptible d'améliorer les conditions de vie de
la nation.
Eu égards à ce qui vient d'être dit,
certaines questions se soulèvent à savoir:
- les finances publiques sont-elles capables de jouer un
rôle important dans la relance du secteur agricole ?
- une fois relancé, le secteur agricole peut-il devenir
un secteur clé et porteur de croissance économique en
RDC ?
- le choix du secteur agricole comme le
porte-étendard du décollage économique peut-il relever les
défis auxquels sont plongés les congolais depuis plusieurs
décennies comme : la pauvreté et l'insécurité
alimentaire ?
Telles sont les questions auxquelles tenteront de
répondre la présente étude.
0.2. HYPOTHESE DU TRAVAIL
Elle peut être définie comme une idée
directive, une tentative d'explication des faits destinés à
guider l'investigation et à être confirmée ou
infirmée par les résultats de la recherche4(*).
Le secteur agricole ne serait capable de soutenir mieux de
porter la croissance économique de la RDC qu'à condition pour le
pouvoir public d'opérer une transformation structurelle du secteur
agricole. Une telle mutation ne saurait être obtenue que par : une
recherche agricole à grande échelle, la diffusion des innovations
technologiques respectueuses de l'environnement, l'affectation des budgets
adéquats dans le contexte de la décentralisation, la mise en
oeuvre du plan de restructuration des services du Ministère de
l'Agriculture et du Développement Rural, la promotion des
systèmes financiers adaptés à la nature des
activités du secteur agricole, l'expansion de l'infrastructure publique
dans le but de viabiliser les sites de production. Ceci permettrait à la
population de relever le défi de la pauvreté et de
l'insécurité alimentaire.
0.3. INTERET DU SUJET
Depuis des décennies, le secteur agricole stagne faute
de moyens à la mesure de ses ambitions. Le sous financement chronique de
ce secteur maintient près de 70 % de la population congolaise dans la
pauvreté absolue et la faim sévère. Les enfants, les
jeunes et les femmes en sont les premières victimes.
En dépit des succès probants de quelques
programmes, les études, rapports et témoignages des acteurs de
terrain indiquent que les activités du secteur agricole et rural ne sont
pas adéquatement financées. Les infrastructures d'appui à
la production, et celles de transport (routes, rail fluvial) sont
dégradées et peu opérationnelles. La part du secteur
agricole oscille entre 0 et 2 % du budget national. De plus, le taux de
décaissement n'atteint guère 20 %. Les projets cofinancés
(gouvernement-partenaires) n'ont pas reçu la contrepartie du
gouvernement.
Cette étude nous le souhaitons bien devra servir d'un
élément détonateur pour tout lecteur et acteur tant
politique que civile soucieux d'une gestion efficiente et saine des ressources
naturelles et financières.
0.4. CADRE METHODOLOGIQUE
Il sera beaucoup plus question de préciser les
méthodes et techniques utilisées pour le traitement et la
récolte des données d'une part, et d'autre part, de donner les
approches statistiques et théoriques de notre problématique.
0.4.1. METHODES
Par méthode, on entend « une démarche
organisée et rationnelle de l'esprit pour arriver à un certain
résultat ».5(*)
Etymologiquement le terme méthode vient du
latin methodus qui veut
dire « recherche rationnelle à l'esprit pour arriver à la
connaissance et à la démonstration d'une vérité
».6(*)
Dans ce travail nous avons fait recours à trois
méthodes à savoir :
La méthode
historique qui nous permettra de remonter dans le temps en vue de
la reconstitution, de l'analyse des faits et phénomènes ayant
traits à l'objet de notre étude, ainsi suivre leur
évolution dans le temps et dans l'espace.
La méthode des
homologies
structurales (appelée la
méthode comparative) qui procède par la comparaison de ce qui est
comparable pour trouver une explication des faits que l'on étudie en
ressortant les points de ressemblance et les points de dissemblance. Cette
méthode nous permettra de jeter non seulement un regard analytique mais
aussi comparatif de ce qui se fait en RD Congo par rapport à ce qui
devrait être fait ou ce qui se fait ailleurs (d'autres pays) sur les
questions de la gestion des Finances Publiques, le secteur agricole, la
croissance économique, etc.
La méthode dialectique nous parait une
méthode complète que les autres, pour ne pas dire La
méthode, car elle correspond aux exigences fondamentales de la notion
même de méthode. Elle est d'abord une attitude vis-à-vis de
l'objet : empirique et déductive, elle commande par là une
certaine façon de recueillir les données concrètes. Elle
représente ensuite une tentative d'explication des faits sociaux,
c'est-à-dire elle est directement liée à la notion de la
totalité. La dialectique est donc la voie prise par l'humanité
en marche pour saisir les totalités réelles mouvantes qui portent
de près ou de loin son empreinte.
Cependant, l'apport et l'importance de la dialectique dans ce
travail se justifient par le fait qu'elle nous permettra de mener une
étude explicative en faisant le lien entre le rôle des ressources
pécuniaires publiques, leur allocation dans le secteur agricole et
l'impact qu'aura cette allocation dans la croissance économique en
République Démocratique du Congo.
0.4.2. TECHNIQUES DE RECHERCHE
Pour récolter des données
nécessaires à l'élaboration de ce travail, nous
avons fait recours à trois techniques telles que :
L'analyse documentaire qui nous a permis de recueillir et
d'accumuler des informations utiles grâce à des ouvrages, des
travaux, des rapports, des articles, des dictionnaires, des documents
officiels, etc. édits et inédits que nous avons consultés
afin d'avoir un minimum des données théoriques et pratiques sur
notre étude.
En outre, nous nous sommes servis également de
l'observation directe qui nous a permis de prendre note des
constats relevés dans notre environnement immédiat en rapport
avec notre objet d'étude qu'est l'analyse critique de la gestion des
finances de l'Etat sur la croissance économique et le
développement socio-économique de la République
Démocratique du Congo.
En suite nous nous sommes servis de la technique
d'interview (entretien) qui nous a permis d'entrer en
contact direct avec les acteurs oeuvrant dans le champ de cette étude et
qui nous ont parlé sur leur expérience et connaissance dans ce
domaine.
0.5. DELIMITATION DU SUJET
Pour mener à bien cette étude, il est utile de
la circonscrire dans le temps, dans l'espace et dans le champ de recherche.
- Dans le temps, nous avons opté pour la période
allant de 2010 à 2014. horizon de temps que nous
estimons suffisant pour une recherche réalisée à ce
niveau, ce qui n'empêche à rien de faire une comparaison avec les
renseignements antérieurs ou postérieurs de notre période
sous étude.
- Dans l'espace, la République Démocratique du
Congo constitue notre cadre d'étude mais qui dans la suite
d'étude peut être comparée au reste du monde.
- Dans le champ des recherches nous nous sommes
limités dans le domaine des finances publiques, le secteur agricole et
la croissance économique. Dans ce champ nous reconnaissons nos limites
dans l'épuisement des données et nos imperfections dans le
strict respect d'une étude qualifiée scientifique.
0.6. CANEVAS
Outre l'introduction générale et la conclusion
générale, ce travail se divise en quatre chapitres dont :
- L'analyse du cadre conceptuel et théorique : les
finances publiques ;
- Le secteur agricole comme moyen de relance de la croissance
économique ;
- Le rôle des finances publiques dans le secteur
agricole en République Démocratique du Congo et
- L'apport du secteur agricole dans la croissance
économique en République Démocratique du Congo.
Chapitre premier :
L'ANALYSE DU CADRE
CONCEPTUEL ET THEORIQUE :
LES FINANCES PUBLIQUES
Pour mieux préciser le cadre théorique et
conceptuel de la présente étude, il importe d'en expliquer ou
d'en expliciter les concepts clés en se basant sur différentes
théories. C'est ainsi que ce chapitre se confie la tâche
d'expliciter les principaux concepts des finances publiques.
1.1. Définition de
finances publiques
Sans distinction typologique de manière
générale, les finances publiques sont l'étude des
règles et des opérations relatives aux deniers publics. Selon le
critère organique, les finances publiques peuvent être
présentées comme l'ensemble des règles gouvernant les
finances de l'Etat, des collectivités locales, des organismes de
sécurité sociale, des établissements publics et de toutes
autres personnes morales de droit public. C'est un champ à la
croisée du droit fiscal, du droit constitutionnel, ainsi que de la
comptabilité publique.7(*)
Le professeur français Maurice Duverger cité par
le professeur Georges ZUKA8(*) , définit les finances publiques comme la
Science des moyens par lesquels l'Etat et les autres collectivités
publiques se procurent et utilisent les ressources nécessaires à
la couverture des dépenses publiques, par la répartition entre
individus des charges qui en résultent.
Pou le professeur George ZUKA, considère les finances
publiques comme une science dont l'objet est la production et l'utilisation
rationnelles des deniers public par l'Etat, en sa qualité d'acteur de
développement global, en ayant recours à certaines
méthodes et techniques propres aux disciplines scientifiques qui la
composent9(*).
La double conception des finances publiques nous donne
également deux définitions des finances publiques selon soit leur
conception classique ou soit leur conception moderne :
1.1.1. Définition selon
la conception classique
Les finances publiques c''est une étude des moyens par
lesquels l'Etat et les autres collectivités publiques se procurent et
utilisent les ressources nécessaires à la couverture des
dépenses publiques, par la répartition entre individus des
charges qui en résultent.
La plus grande question selon cette définition
traditionnelle est de vouloir savoir : comment l'Etat va-t-il couvrir ses
dépenses ? En cherchant la réponse, on s'aperçoit
immédiatement que les ressources de l'Etat sont toujours tirées
d'un prélèvement sur les citoyens. La science des finances
publiques consiste donc, en dernière analyse, à repartir entre
ceux-ci le poids des dépenses publiques. La portion supportée par
chacun s'appelle charge publique.
1.1.2. Définition selon
la conception moderne
Les finances publiques c'est l'étude de
l'activité de l'Etat en tant qu'il emploi des techniques
particulières, dites techniques financières :
dépenses, taxes, impôts, emprunts, procédés
monétaires, budget, etc.
C'est uniquement une définition par les moyens, les
buts n'étant pas différents de ceux qu'on reconnait à
l'activité de l'Etat en général. Au plan conceptuel, on
peut dire qu'à la doctrine classique de l'Etat libéral, s'est
succédé au XXe siècle celle de l'Etat
interventionniste avec pour idée centrale la sauvegarde d'un certain
équilibre général dans la société. On a
abouti ainsi à un bouleversement, la tâche de la dépendance
publique n'est plus essentielle.
Il faut souligner cependant la parenté profonde entre
les deux conceptions. En effet, on a constaté en définitive que
toute la politique économique et sociale de l'Etat moderne, dont la
politique financière n'est qu'un des aspects, ayant pour but
d'établir un équilibre social complet, une sorte de
« plein équilibre » qui dépasse en
l'englobant la vielle notion d'équilibre budgétaire. Equilibre
de la production et des échanges, équilibre général
de la répartition des biens et des risques sociaux,
équilibre de la monnaie et des prix, équilibre
général du développement de la nation, équilibres
des échanges extérieurs, tels sont les buts essentiels de
l'intervention par des techniques financières en particulier.
1.2. Les finances publiques
et leurs environnements11(*)
Les activités financières de l'Etat se
déroulent dans un macro environnement qui diffère d'un pays
à l'autre. En effet, chaque pays est une identité propre par
rapport aux autres, car l'environnement politique, l'environnement social et
culturel, l'environnement économique ne sont jamais identiques.
Dans l'optique managériale des finances publiques, il
est donc nécessaire de connaître toute la sphère
environnementale dans laquelle sont appelées à s'insérer
ces activités de l'Etat.
1.2.1. L'environnement
politique
Les finances publiques sont une activité de l'Etat,
c'est-à-dire une activité sous le contrôle du pouvoir
public qui peut s'exercer dans le cadre soit d'un régime
démocratique, soit d'un régime autocratique :
- Dans les régimes démocratiques : ce sont
des ressources au service du peuple et auxquels celui-ci consent. Le peuple en
assure le financement et le contrôle par ses élus qui peuvent
sanctionner les abus éventuels. Ces sont ces finances publiques
qu'enseigne la science des finances et qui respectent les principes
éprouvés. C'est à ces finances que notre pays est entrain
d'aspirer.
- Dans les régimes autocratiques : ce sont des
ressources essentiellement au service du détenteur du pouvoir. Si le
détenteur du pouvoir est de bonne foi, si sa dictature est positive et
humaine, il peut faire don du développement à son peuple
(quelques exemples existent, dont celui de la Tunisie du général
ben Ali). Si par malheur le détenteur du pouvoir est un homme sans
coeur, obscurantiste, les finances publiques deviennent un instrument
d'enrichissement de l'oligarchie et d'exploitation du peuple dont le
développement n'est qu'une chimère. C'est le cas de plusieurs
pays africains.
1.2.2. L'environnement social
et culturel
a. Environnement social :
La société qui est le
« producteur » et le « consommateur »
des finances publiques vit-elle un certain standing et croupit-elle dans la
pauvreté et la misère prédominante ?
Il convient de souligner que la psychologie financière
est largement dépendante de conditions sociales des usagers. Les
finances publiques des riches et celles de pauvres ne seront jamais sur le
même diapason.
b. Environnement culturel
Le niveau d'éducation civique et son appropriation par
le citoyen, la perception par rapport à la culture universelle de
développement (culture de la prédation, de l'individualisme, de
l'irresponsabilité, du statuquo, etc. ou le contraire d cela ?)
sont quelques facteurs de l'environnement culturel auxquels se greffent les
finances publiques
Plus on aime sa nation, son pays, plus grande est en effet la
propension à fournir des efforts pour l'intérêt
général. En réalité, le facteur culturel a une
énorme influence sur le rendement de finances publiques.
1.2.3. L'environnement
économique
Les finances publiques puisent l'essentiel de leurs ressources
dans le secteur économique, étant donné que les
impôts frappant les faits générateurs non
économiques n'entrent que très faiblement dans la structures des
budgets de recettes des pays contemporains.
C'est encore dans cet environnement qu'il faut rechercher les
paramètres qui forment le cadre macroéconomique où
s'élaborent les hypothèses budgétaires. Ci-dessous les
principaux paramètres du cadre macroéconomiques :
a. PIB (Produit Intérieur Brut), qui mesure
l'activité économique d'un pays au cours d'une année et
qui est constitué de l'ensemble des valeurs ajoutées ;
b. Taux de croissance du PIB, qui mesure l'évolution
haussière ou baissière du PIB ;
c. Taux d'inflation (inflation monétaire étant
une hausse générale et durable des prix des biens et services),
qui mesure donc cette hausse ;
d. Taux de change moyen (le change étant une
opération qui permet de convertir une certaine quantité de
devises, c'est-à-dire des moyens de paiement acceptés à
l'étranger), qui est la moyenne annuelle du taux de change qui indique
le nombre variable d'unité de devise qu'on peut obtenir pour le nombre
variable d'unités de devises qu'on peut obtenir pour une unité d
monnaie nationales, à un moment donné et dans des conditions
données ;
e. Taux de la pression fiscale (la pression fiscale
étant la mesure du rapport entre l'ensemble des
prélèvements obligatoires et le PIB), qui mesure ce rapport.
1.3. Rôle des
finances publiques
Le rôle des finances publiques a beaucoup
évolué : des finances traditionnelles, on en est aujourd'hui
aux finances modernes. La différence n'est pas que chronologique.
L'évolution des finances publiques est l'émanation et le reflet
de l'évolution historique de la notion d'Etat. Dans les finances
publiques modernes, deux rôles peuvent être
dégagés :
- Le budget qui apparait comme un acte parlementaire de
prévision et d'autorisation des dépenses et des recettes
publiques pendant l'année, a pour première préoccupation
de financer le fonctionnement de l'Administration publique (paiement des
salaires des fonctionnaires, construction des routes, d'hôpitaux,
d'écoles, d'éclairage public, etc.). c'est la fonction des
finances publiques la plus ancienne et la plus connue. Elle correspond à
une vision d'un Etat réduit aux charges de police, d'armée et de
justice. L'Etat est présenté comme libéral, comme
Etat-gendarme (conception des disciples d'Adam Smith), comme Etat-bourgeois
(par les marxistes).12(*)
- L'Etat intervient dans d'autres secteurs (notamment
économiques et sociaux) et se propose de repartir les ressources selon
une préoccupation d'équité. L'Etat ne se borne plus aux
tâches militaires, policières et judiciaires. Il intervient pour
corriger les imperfections du marché et les déséquilibres
dans la sécurité sociale. Il apparaît donc comme un
Etat-providence qui se préoccupe d'assurer un certain bien-être de
la population. Il est présenté comme l'Etat Faustien (qui
organise et dirige l'ensemble des activités nationales, comme le
héros du second Faust).
Dans le premier rôle, les finances publiques (selon la
conception traditionnelle) servent de moyen d'assurer la couverture de
dépenses d'Administration de l'Etat. Dans la conception moderne, en plus
du rôle tradition, les finances publiques permettent à l'Etat
d'intervenir dans la vie sociale, d'exercer son autorité dans
l'organisation de l'ensemble de la nation et cela, dans différents
domaines d'activité humaine.
Ce dernier rôle est fondamentale car il permet à
l'Etat d'insérer le budget dans l'ensemble de la politique
économique de l'Etat. Il permet aussi aux finances publiques
d'étendre leurs tentacules sur la politique, l'économie et la vie
sociale de la nation.
1.4. Eléments
constitutifs des finances publiques
1.4.1. Budget de l'Etat
Tout budget, qu'il soit privé ou public, est une
prévision d'activité ? Les particuliers, les entreprises,
les collectivités publiques et l'Etat en premier sont tous amenés
à établir des programmes financiers sous forme d'états
prévisionnels de leurs recettes et de leurs dépenses.
Bien que tous soient des budgets, il existe bien une
différence fondamentale entre les budgets des entreprises et ceux de
l'Etat. Les premiers visent à prévoit le plus exactement possible
le résultat d'exploitation. Tan disque les seconds, L'étude des
finances publiques trouve son impact focal dans l'analyse du budget de l'Etat
en tant que catégorie politique, économique, sociale et
juridique. L'importance du budget en finances publiques est telle que
plusieurs observateurs s'arrêtent à son examen pour rendre compte
de la plénitude des finances publiques. Cette façon de voir les
choses est réductive et élude la complexité de
l'activité financière de l'Etat.
Pour RIVOLI, le budget est un acte qui prévoit et
autorise, généralement dans le cadre de l'année, les
activités des administrations d'Etat et les moyens de financement de ces
activités.
Dans plusieurs pays, le budget respecte un nombre de principes
notamment :
a) Principe d'annualité
budgétaire : c'est la règle budgétaire qui
impose le vote annuel du budget par le pouvoir législatif;
b) Principe d'unité budgétaire :
c'est la règle budgétaire qui exige que les
prévisions des recettes et des dépenses soient
présentées dans un seul et même document ;
c) Principe d'universalité
budgétaire : ce principe voudrait que soient inscrites
dans le budget toutes les dépenses et recettes de l'Etat sans qu'il
puisse y avoir de contraction entre les recettes et les dépenses. C'est
le principe de non-compensation, il a pour fonction de permettre au parlement
de prendre une connaissance détaillée de toutes les
opérations financières prévues par le budget.
d) Principe de
spécialité budgétaire: ce principe souligne
le fait que les dépenses autorisées par la loi budgétaire
ne puissent pas être utilisées, par les gestionnaires des
crédits, pour n'importe quel objet. Ainsi, les crédits ouverts
par la loi budgétaire de l'année doivent toujours être
employés pou un objet précis comme préalablement
déterminé par le dispositif légal : une
dérogation expresse permet, toutefois, de se dispenser de cette
obligation.
1.4.2. Recettes
publiques
Les recettes publiques correspondent aux recettes
perçues par l'ensemble des administrations publiques : l'Etat et
les organismes divers d'administration centrale, les administrations publiques
locales ainsi que les administrations de sécurité sociale.
13(*)
Les recettes publiques se scindent en deux catégories
principales : les prélèvements obligatoires et les autres
recettes.
Les prélèvements obligatoires sont une notion de
comptabilité nationale ; ils désignent tous les versements
effectués par des personnes physiques ou morales aux administrations
publiques afin de financer leurs dépenses. On distingue :
- Les impôts
- Les cotisations sociales
- Les taxes fiscales
Les recettes projetées dans la loi de finances
constituent les minima obligatoires à percevoir par les services
mobilisateurs.
L'exécution d'une recette publique passe par les quatre
étapes requises en comptabilité publique, à
savoir14(*) :
- la constatation,
- la liquidation,
- l'ordonnancement et
- le recouvrement.
La constatation a pour objet d'identifier et d'évaluer
la matière imposable. La liquidation consiste à déterminer
le montant de la créance sur le redevable en indiquant les bases, taux
et tarifs appliqués. L'ordonnancement consiste à établir
un titre de perception destiné à la prise en charge de la recette
et permettant au Comptable Public d'en assurer le recouvrement.
Toute recette régulièrement constatée par
les services générateurs des recettes fait l'objet,
préalablement à son recouvrement, d'une liquidation et d'un
ordonnancement. Toute recette au comptant fait l'objet, après son
encaissement, d'un ordonnancement pour régularisation.
L'ensemble de recettes assure l'exécution de l'ensemble
de dépenses sans aucune affectation de leur produit à des
dépenses particulières. Ce qui implique l'interdiction du
système de compensation ou de consommation à la source. En outre,
les services chargés de la collecte des recettes ont l'obligation de
tenir la comptabilité des droits constatés, liquidés,
ordonnancés et recouvrés.
Les recettes sont prises en compte au titre du budget de
l'année au cours de laquelle elles sont encaissées.
Le recours aux avances de la Banque Centrale du Congo est
strictement prohibé.
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'Action du
Gouvernement, les administrations financières sont tenues de mettre en
place un mécanisme efficace d'encadrement et de suivi de mobilisation
des ressources budgétaires de manière à permettre un
financement satisfaisant des actions du Gouvernement.15(*)
Les séances de conciliation des chiffres doivent
être mensuellement organisées, d'une part au plus tard le 5 du
mois suivant, entre la DGRAD et les services d'assiette, et d'autre part au
plus tard le 10 du mois suivant, entre les Ministères des Finances, du
Budget, les administrations financières, la Banque Centrale du Congo et
les autres intervenants financiers en vue d'évaluer le niveau de
réalisation effective des recettes publiques et leur
cohérence.
1.4.3. Dépenses
publiques
Les dépenses publiques sont l'ensemble des
dépenses réalisées par les administrations publiques. Leur
financement est assuré par les recettes publiques (impôt, taxes et
cotisations sociales) et par le déficit public.16(*)
Les crédits budgétaires inscrits dans la loi de
finances constituent le plafond des dépenses pouvant être
engagées par les administrations durant l'exercice budgétaire.
L'exécution de la dépense publique passe par les
quatre étapes requises en comptabilité publique, à
savoir17(*) :
- l'engagement,
- la liquidation,
- l'ordonnancement et
- le paiement.
L'engagement est l'acte par lequel l'Etat crée ou
constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une
charge. La liquidation a pour objet de vérifier la réalité
de la dette et d'arrêter le montant exact de la dépense.
L'ordonnancement est l'acte administratif par lequel, conformément aux
résultats des calculs de la liquidation, l'ordre est donné au
caissier concerné de payer la dette de l'Etat. Le paiement est l'acte
par lequel l'Etat se libère de sa dette.
Toute dépense régulièrement
engagée et liquidée par le Gestionnaire des crédits fait
l'objet, préalablement à son paiement, d'un ordonnancement.
Le respect des procédures et du circuit
d'exécution de la dépense publique doit être de stricte
observance. Toute pratique consistant à adresser les lettres de demande
de paiement directement au Ministre en charge des Finances ou du Budget est
prohibée.
Aucun dossier de dépense en photocopie ne sera admis au
traitement dans la Chaîne de la dépense.
Le dépassement des crédits budgétaires
est strictement interdit. En cas d'insuffisance des crédits, le
Gestionnaire des crédits est tenu de solliciter le virement des
crédits au Ministre en charge du Budget.
Deux procédures de sollicitation de virement des
crédits sont d'application :
- la procédure classique suivant laquelle le
Gestionnaire des crédits est tenu d'adresser une demande formelle au
Ministre en charge du Budget pour solliciter un Arrêté de virement
des crédits dans laquelle il fera les propositions de virement
(montants, imputations créditrices, imputations débitrices,
libellés).
- dans le souci de raccourcir la prise d'Arrêté
de virement, le Gestionnaire des crédits, lors de l'établissement
du BDE, peut adjoindre au dossier de la dépense une fiche de
décision de virement dans laquelle il fera les propositions de virement
(montants, imputations créditrices, imputations débitrices,
libellés). Lors du contrôle du dossier à la DCB, deux cas
peuvent se présenter :
· Virement par rapport au Plan Engagement
Budgétaire (PEB) : si le cas de virement ne concerne que les
montants des lignes libérées au Plan d'Engagement
Budgétaire sans toucher aux plafonds de la dotation annuelle, seule la
décision de virement signé par le Gestionnaire des
crédits, dûment visée par le Contrôleur
Budgétaire, accompagne le dossier. Le Ministre en charge du Budget
approuve cette décision qui constitue l'autorisation de la modification
des montants des lignes concernées du PEB dans la base des
données de la Chaîne de la dépense.
· Virement par rapport à la loi :
dans le cas d'un virement touchant les plafonds de la dotation annuelle, la
demande de virement sera envoyée à la DPSB pour l'obtention du
projet d'arrêté de virement. Ainsi, le dossier de la
dépense est accompagné de la demande et du projet
d'arrêté de virement. La signature de l'Arrêté par le
Ministre en charge du Budget constitue l'autorisation de la modification des
montants des lignes concernées de la loi et du PEB dans la base des
données de la Chaîne de la dépense.
Par ailleurs, des transferts de crédits peuvent
être opérés entre les programmes d'un même
ministère ou d'une même Institution. Ils concernent les titres de
même nature repris dans chacun des programmes. Le montant cumulé
des transferts de crédits effectués sous cette forme au cours
d'une même année est fixé par Décret du Premier
Ministre délibéré en Conseil des ministres sur proposition
du Ministre ayant le Budget dans ses attributions. Ces transferts font l'objet
des propositions d'ouverture des crédits dans le projet de loi de
finances rectificative.
Des transferts de crédits peuvent être
effectués entre programmes de différents ministères ou
institutions. Ces transferts concernent les crédits destinés
à financer certaines actions d'un programme. Ils se rapportent aux
titres de même nature repris dans chacun des programmes. Ils
interviennent par Décret du Premier Ministre après avis
préalable du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et sur
proposition des Ministres ou Responsables d'institutions concernés. Ils
font l'objet de propositions d'ouverture des crédits dans le projet de
loi de finances rectificative.
Tout dossier de dépense doit être initié
sur base d'un Bon d'Engagement dûment signé par le Gestionnaire
des crédits compétent et visé par le Contrôleur
Budgétaire du secteur. Ce Bon d'Engagement doit être appuyé
des documents prévus dans le Vade-mecum des pièces justificatives
relatives à l'exécution des dépenses publiques.
Aucun dossier de dépense relatif aux marchés
publics ne peut être introduit à la Chaîne de la
dépense sans avoir au préalable respecté la
procédure de passation des marchés publics.
Seul le Comptable Public des dépenses est
autorisé à se présenter aux guichets de la Banque Centrale
du Congo ou auprès des autres intermédiaires financiers
agréés pour le retrait des fonds dont il répond
personnellement et pécuniairement.
La paie du personnel politique des Cabinets
Ministériels et Institutions Politiques ainsi que celle des agents et
cadres de l'Administration Publique, de la Police Nationale Congolaise et des
Forces Armées de la République Démocratique du Congo se
fait par voie bancaire sur toute l'étendue du territoire national. Dans
les contrées où les intermédiaires financiers n'existent
pas, elle se fait par les partenaires agréés ou les Comptables
Publics.
La Direction du Contrôle Budgétaire est tenue,
dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du Programme d'Actions du
Gouvernement, de présenter hebdomadairement au Ministre en charge du
Budget le tableau de suivi de la mise en oeuvre des objectifs du Gouvernement
par rubriques, administrations, natures et axes prioritaires du Programme. Ce
tableau comprendra les dotations ainsi que le volume des engagements et
liquidations. Il permettra ainsi de dégager les écarts entre les
actions budgétisées et le financement de leur mise en oeuvre.
1.4.4. Déficit
budgétaire
Le déficit budgétaire peut se traduire par de
nouveaux emprunts contractés par l'Etat au cours de l'année, en
sus de ceux destinés à amortir les emprunts antérieurs
arrivés à échéance. Ces emprunts viennent aliment
la dette de l'Etat, de même que le déficit public augmente la
dette publique. Ainsi ces deux données sont liées mais se
distinguent par leur nature : le déficit est un flux alors que la
dette est un stock.18(*)
Concrètement, les budgets publics mesurés avec
une période annuelle, sont très souvent déficitaires, dans
la majorité des pays ; dans le cas opposé, on parle
d'excédent budgétaire.
1.4.5. Déficit
public
Le déficit public correspond aux besoins de financement
des administrations publiques auquel est ajouté le solde des gains et
des pertes des opérations sur swaps (produits dérivés).
Le besoin de financement est le solde du compte de capital : il
intègre non seulement les dépenses courantes de fonctionnement et
les opérations de redistribution, mais aussi les dépenses en
capital, l'investissement ainsi que les transferts en capital et les
impôts en capital.
Le déficit public apparait lorsque les produits (les
recettes fiscales essentiellement) sont inférieurs aux charges
(dépenses budgétaires essentiellement) des administrations
publiques. Cette différence entre les charges et les produits
s'apprécie sur une période légale,
généralement l'année civile.
1.4.6. Dette publique
La dette publique est, dans le domaine des finances publiques,
l'ensemble des engagements financiers pris sous formes d'emprunt pat l'Etat,
les collectivités publiques et les organismes qui en dépendent
directement (certaines entreprises publiques, les organismes de
sécurité sociale, etc.).
La dette publique augmente à chaque fois qu'un
déficit public est financé par l'emprunt. La dette publique
représente donc l'accumulation des besoins de financement des
périodes successives de ces administrations.
La dette publique prend le plus souvent la forme d'emprunt
d'Etat. La capacité de remboursement des emprunts contractés au
titre de la dette publique par les Etats et les collectivités
publiques est évaluée par les agences de notation
financière. Les pays les moins fiables, au regard des marchés
financiers et des agences de notation, peuvent avoir recours aux banques
commerciales ou à des institutions internationales (Banque mondiale,
Fonds Monétaire International, Banque Régionale de
Développement).
Au sein de la dette publique, on distingue la dette
publique intérieure, détenue par les agents
économiques résidents de l'Etat émetteur et la dette
publique extérieure, détenue par des prêteurs
étrangers. On distingue également la dette de court terme (un an
ou moins), à moyen terme (jusqu'à dix ans) et à long
terme (au-delà de dix ans). En macroéconomie, la dette publique
se distingue de la dette des ménages ou de la dette des entreprises.
1.5. La science des
finances publiques
Une discipline aussi plurielle, diverse et multidimensionnelle
appelle une méthode globalisante et totalisante. Or, au niveau des
connaissances actuelles, l'approche sociologique semble propice à la
satisfaction de cette quête scientifique.
En effet, Paul Löwenthal cité par la professeur
Henri MOVA SAKANYI, signale que les finances publiques ne se limitent ni aux
finances ni au secteur public : elles sont un point de passage
obligé de presque toute politique économique et sociale
d'ensemble (dans son livre économie et finances publiques, 2e
édit. Paris-Bruxelles, de Boeck université, 1996, p.3).19(*)
L'évidence de sa conclusion se construit au tour du
constat selon lequel l'importance économique des finances publiques est
longtemps restée limiter, en fait comme en doctrine.
Chez les classiques, notamment RICARDO (1921), on ne trouve
qu'une théorie de l'impôt, qui porte sur sa répartition
entre les contribuables. A la fin du XIX e siècle, les marginalistes
mettent en évidence l'interdépendance des variables
économiques dans les faits comme dans les rationalités de
comportement, et ils fondent une théorie des finances publiques qui
envisagent désormais les dépenses comme les recettes, en niveau
et répartition.
Depuis les années trente du XIX e siècle, enfin,
les finances publiques sont élargies en une économie publique
avec l'assignation de deux fonctions supplémentaires :
v Améliorer la répartition sociale des
ressources ;
v Réduire l'instabilité macroéconomique
(J.M. Keynes).
Notre étude sera beaucoup plus centrée sur les
deux dernières fonctions qu'assument les finances publiques. Ceci
permettra d'identifier trois champs d'action des finances publiques
dont :
- L'allocation des ressources, qui est un objectif
économique d'ordre technique ;
- La répartition des revenus et des fortunes, qui est
un objectif social ;
- La conjoncture macro-économique.
1.6. La paternité
scientifique des finances publiques
Deux approches scientifiques se disputent la paternité
de la science des finances publique. Il s'agit de la démarche juridique
étudiant les règles qui régissent les finances publiques
et la démarche économique qui apporte un renouveau à cette
matière , en faisant une analyse sous tous leurs aspects de
comportement de la puissance publique avec leurs conséquences à
court, à moyen et à long terme.
Conclusion partielle
La partie qui touche à sa fin à mis en exergue
l'analyse du cadre conceptuel et théorique des finances publiques.
Ceci permet à poursuivre cette étude dans les
lignes qui suivent en abordant le chapitre suivant qui traitera à son
tour « le secteur agricole comme moyen de relance de la croissance
économique ».
Chapitre
deuxième
LE SECTEUR AGRICOLE COMME
MOYEN DE RELANCE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
Nous examinerons tour à tour dans ce chapitre :
- la croissance économique,
- le rôle des finances publiques dans la croissance
économique et
- le rôle de la croissance agricole.
2.1. CROISSANCE
ECONOMIQUE
2.1.1. Définition et
Mesure de la croissance
Etymologiquement, le mot croissance en latin
« srescere » signifie croître, grandir, etc.
La croissance c'est l'augmentation soutenue pendant une ou
plusieurs périodes longues d'un indicateur de dimension, pour une
nation, le produit net en termes réels.20(*)
En économie, la croissance désigne
l'évolution annuelle, exprimée en pourcentage du PIB (Produit
Intérieur Brut) ou du PNB (Produit National Brut). Pour éviter le
problème dû à l'augmentation des prix, la croissance est
calculée en « monnaie constante »
c'est-à-dire hors inflation, le PIB étant corrigé de
l'augmentation de l'indice des prix. Ceci permet de calculer une croissance en
volume.
Nous retenons de cette diversité de définition
que, la croissance économique est un concept qui décrit une
période plus ou moins longue les évolutions positives, de la
production nationale en termes soit de PIB soit du taux de croissance tels que
le Revenue National, le Revenu par tête d'habitant, etc.
La formule de calcul, dans le cas du PIB de l'année n,
est la suivante :
Croissance =  
On distique généralement la
croissance extensive qui est une augmentation des
quantités de facteurs de production (culture de nouvelles terres,
ouverture de nouvelles usines). Cette croissance dite extensive
génère des créations d'emplois.
La croissance intensive n'est autre
que l'augmentation par des gains de productivité, de la production
à volume de facteurs de production identiques, notamment sans
création d'emplois supplémentaires.
Une croissance du PIB n'implique pas nécessairement
une élévation du niveau de vie. En effet, si la croissance
démographique est plus rapide que la croissance du PIB, le PIB par
habitant diminue. En outre, certaines activités ne sont pas prises en
compte dans son calcul : voir les limites du PIB.
D'une manière plus générale, la
croissance correspond, pour une nation, à une augmentation soutenue et
durable pendant une période suffisamment longue de la production de
biens et de services appréhendée par des indicateurs comme le
PIB ou le PNB. Cependant, n'étant qu'une mesure quantitative d'un
agrégat économique, la croissance n'est qu'une des composantes
du développement qui est une notion plus abstrait et qualitative. Il
peut donc y avoir croissance sans développement et inversement du
développement sans croissance.
La croissance telle qu'on la définit et qu'on la
mesure aujourd'hui est un phénomène relativement récent
à l'échelle de l'humanité qui peut être daté
du début de l'industrialisation.
2.1.2. Différents cycles
de croissance économique dans le monde21(*)
Les dernières décennies ont vu se
succéder une série de cycles de croissance soutenue et de
récession ou de faible croissance :
- croissance des années 1919-1929,
- récession des années 1930 ;
- forte croissance de l'après guerre : les 30
glorieuses ;
- ralentissement après le choc pétrolier de
1973 ;
- forte croissance des années 1980-1990,
- ralentissement de 1992 à 1997 après la
première guerre du Golf ;
- reprise de la croissance de 1997 à 2001(attentat du
11 septembre).
2.1.3. Différentes
conceptions de croissance économique chez les économistes22(*)
a. Adam SMITH (1723-1790)
Dans son ouvrage intitulé « richesse de la
nation », il développe les premiers éléments de
la théorie de la croissance. Prenant sa source dans la division du
travail, la croissance lui apparaît comme illimitée.
b. Thomas ROBERT MALHUS (1766-1834)
Pour lui, la croissance de la population plus rapide que celle
de la production de la terre, conduit à des famines qui permettent de
rétablir, à court terme, le bon rapport entre les deux
jusqu'à ce que l'écart entre population et production de la terre
provoque une nouvelle crise.
c. David RICARDO (1772-1823)
Ricardo propose que pour faire face à la croissance de
la population de nouvelles terres doivent être cultivées. Or
celles-ci ont un rendement décroissant (les meilleures étant
déjà utilisées). Il s'en suit inéluctablement
à long terme un état stationnaire.
d. Karl MARX (1818-1883)
Pour lui, l'accumulation du capital permet à ce dernier
de se substituer au travail. L'augmentation du chômage et la baisse des
salaires qui en découlent, provoquent une baisse de la consommation et
du taux de profit et par conséquent de la croissance.
e. John MAYNARD KEYNES (1883-1946)
L'économiste britannique insiste sur le rôle de
l'Etat qui, par les investissements publics, peut relancer l'économie en
jouant sur la demande et favorisant ainsi la croissance.
2.1.4. Facteurs de la
croissance économique
Il existe plusieurs facteurs de la croissance dont notamment
l'augmentation de la population active et l'amélioration de sa
qualification, accroissement du capital technique et son perfectionnement,
progrès technique et innovation, etc. « Ces facteurs peuvent jouer
différemment et conduire à deux grands types de croissance, une
croissance dite extensive et une croissance dite intensive.
L'augmentation d'une population active de qualité (main
d'oeuvre en quantité et en qualité) permet aux entreprises
grâce aux innovations et à la technologie de produire en masse et
bénéficier des économies d'échelles grâce
également à la maitrise par ces entreprises de leurs coûts
de production, ce qui engendre au plan national une forte croissance
économique. En outre, « comme l'a montré Joseph SCHUMPETER,
le progrès technique contribue ainsi à la réalisation de
gains de productivité, lesquels concourent sous de multiples formes
à la croissance. Le progrès technique contribue aussi à
produire des effets externes positifs sur toute l'économie comme le
montre la théorie récente de la croissance endogène.
2.1.5. Sources de la
croissance
On distingue deux sources de la croissance dans la
théorie économique traditionnelle « la croissance de la
population et le progrès technique qui permettent des gains de
productivité mais aussi de multiples innovations (l'innovation des
produits est l'un des cinq types d'innovations mis en évidence par
Joseph SCHUMPETER). La croissance démographique conduit aussi à
accroître la demande des ménages comme les gains de
productivité accroissent les profits des entreprises et donc la demande
pour des biens d'équipements ».
2.1.5.1. La croissance
endogène
Etymologiquement, l'endogène : du grec ancien
endo « endov »signifie dedans (sans mouvement), et de
gène du grec « gennân » engendrer. L'adjectif
endogène signifie qualifie ce dont la cause est interne, ce qui est
produit, ce qui émane de l'intérieur d'un organisme ou d'une
structure, en dehors de tout apport ou influence extérieur.
On appelle la croissance, non pas une forme de croissance,
mais une théorie qui explique la croissance économique par des
facteurs endogènes comme le développement du captal humain, les
savoir-faire, le progrès technique. Cette théorie remet en
question le modèle édicté par l'économiste
américain Robert Solow (dit « modèle de croissance
endogène ») pour lequel le progrès technique aurait
pour origine des facteurs extérieurs à la production, sans pour
autant en expliquer la cause et qui conclut à une convergence des
économies vers un état de croissance stationnaire, ce qui n'a pas
été constaté.
Les théories récentes cherchent
précieusement à rendre ce facteur endogène
c'est-à-dire à construire des modèles qui expliquent son
apparition. Ces modèles se fondent sur l'hypothèse que la
croissance génère par elle-même le progrès
technique.23(*)
Ainsi, il n'y a plus de fatalité des rendements
décroissants : la croissance engendre un progrès technique
qui permet que ces rendements demeurent constants. La croissance, si elle
génère du progrès technique, n'a donc plus de limite. A
travers le progrès technique, la croissance constitue un processus qui
s'auto entretient.
Ces modèles expliquent que la croissance engendre du
progrès technique par trois grands mécanismes :
1° le Learning by Doing : plus on produit, plus on
apprend à produire de manière efficace. En produisant, on
acquiert en particulier de l'expérience, qui accroit la
productivité.
2° la croissance favorise l'accumulation du capital
humain, c'est à-dire les compétences possédées par
la main d'oeuvre et dont dépend sa productivité. En effet, plus
la croissance est forte, plus il est ^possible d'accroître le niveau
d'instruction de la main d'oeuvre, en investissant notamment dans le
système éducatif. D'une manière générale, la
hausse de niveau de l'éducation de la population par des moyens publics
ou privés est bénéfique.
3° la croissance permet de financer des infrastructures
(publiques ou privées) qui la stimulent. La création de
réseaux de communication efficaces favorise, par exemple,
l'activité productive.
2.1.5.2. La croissance
exogène
Etymologiquement, exogène du grec ancien
« exo » signifie dehors et gène
« gennân » qui veut dire engendrer. L'adjectif
exogène qualifie ce dont la cause est extérieure, ce qui
provient, ce qui émane de l'extérieur d'un organisme ou d'une
structure. Il s'oppose à endogène.
2.2. FINANCES PUBLIQUES ET
CROISSANCE ECONOMIQUE
Dans cette partie nous parlerons de la gestion des finances
publiques et la croissance économique d'une part et le rôle des
finances publiques dans la croissance économique d'autre part.
2.2.1. La gestion des finances
publiques et la croissance économique
Les investissements privés à eux seuls ne
suffisent pas pour engendrer la croissance économique dans un pays.
Encore faudra-t-il qu'il y ait aussi des investissements publics. Cependant,
ces investissements publics pour se réaliser nécessitent des
ressources en général et ressources financières en
particulier qui proviendront des impôts, taxes, droits de douane,
redevances, etc.
Par ailleurs, ces fonds publics pour financer des
investissements nécessitent qu'elles soient gérer de
manière efficace par différents gestionnaire des fonds
publics.
2.2.2. Rôle des finances
publiques dans la croissance et le développement
Les finances publiques permettent non seulement à
l'Etat d'intervenir dans la vie économique du pays, mais
également à travers les investissements publics de l'État
de participer aux activités de production qui, à
côté des investissements privés peuvent engendrer la
croissance économique.
De plus, l'importance de l'effet des finances publiques peut
être perçue sur l'équation de la demande globale à
travers laquelle dès lors que l'Etat augmente le niveau de ses
dépenses (G), le volume du PIB croit également. Ainsi, du fait
que le développement suppose l'existence de la croissance, nous voyons
qu'à travers les finances publiques plus spécifiquement les
dépenses d'investissement de l'État, celui-ci peut participer
à la croissance et cela débouche au développement socio
économique du pays.
Ainsi donc, les finances publiques constituent une
matière vaste et complexe, néanmoins nous avons essayé de
donner l'essentiel sur les notions de base là-dessus. La croissance
économique est une condition essentielle au processus de
développement qui est un ensemble des transformations techniques,
sociales et culturelles permettant l'apparition et le soutien durable de la
croissance économique ainsi que l'amélioration des conditions de
vie des populations.
En effet, les finances publiques peuvent dès lorsqu'il
y a des investissements publics qui, à côté des
investissements privés dans le cadre des Partenariats Publics-
Privés engendrer la croissance économique.
2.3. SECTEUR AGRICOLE ET LA
CROISSANCE AGRICOLE
2.3.1. Agriculture
Du latin « agricultura » composé
à partir de « ager » signifie cham ; et
« colere » signifie cultiver. C'est un processus par lequel
les hommes aménagent leurs écosystèmes pour satisfaire les
besoins alimentaires en premier et autres, de leur
société.24(*)
Elle désigne l'ensemble des savoir-faire et
activités ayant pour objet la culture des terres, et, plus
généralement, l'ensemble des travaux sur le milieu naturel (pas
seulement terrestre) permettant de cultiver et prélever des êtres
vivants (végétaux, animaux, voire champignons ou microbes) utiles
à l'être humain.
En économie, l'économie agricole est
définie comme le secteur d'activité dont la fonction est de
produire un revenu financier à partir de l'exploitation de la terre
(culture), de la forêt (sylviculture), de la mer, des lacs et des
rivières (aquaculture, pêche), de l'animal de ferme
(élevage) et de l'animal sauvage (chasse).
Dans la pratique, cet exercice est pondéré par
la disponibilité des ressources et les composantes de l'environnement
biophysique et humain. La production et la distribution dans ce domaine sont
intimement liées à l'économie politique dans un
environnement global.
L'agriculture est née avec la mise en terre de semence
ou graine par l'homme. Cela a commencé il y a 10 000 ans au
Moyen-Orient, en Iran, en Méso-Amérique ainsi qu'en nouvelle
-guinée. C'est ce que l'on a appelé la révolution
néolithique.25(*)
Malgré exode rural massif contemporain, la population
agricole active serait d'environ 1,34 milliard de personne soit près de
43% de la population active mondiale.
2.3.2. La production
agricole
L'activité agricole assure principalement
l'alimentation des humains. En outre, l'agriculture produit un nombre
important de produits tels que des peaux d'animaux, des engrais, des produits
destinés à l'industrie, des plantes vertes et fleurs, du bois...
elle représente un maillon indispensable dans la chaine
agro-alimentaire, en lui assurant l'approvisionnement en matières
premières (fécule, oignon, céréale, fruit,
etc.).
La délimitation précise de ce qui entre ou non
dans le champ de l'agriculture conduit à des nombreuses conventions qui
ne font pas tout l'objet d'un consensus. Certaines production peuvent
être considérées comme ne faisant pas partie de
l'agriculture ; la mise en valeur de la forêt (sylviculture),
l'élevage d'animal aquatique (aquaculture), élevage hors-sol de
certains animaux (volaille), la culture sur substrat artificiel (culture
hydroponique)... Mis à part ces cas particulier, on distingue
principalement le végétal et l'élevage pour
l'activité concernant l'animal.
La culture ou la production végétale est
divisée en grandes cultures (céréales, oléagineux,
protéagineux, et quelques légumes), arboriculture
fruitière, viticulture (production du raisin) sylviculture et
horticulture.
L'élevage ou la production animale vise à faire
naître et élever des animaux pour la consommation directe
(viande) ou pour leur production (lait, oeuf, laine, miel, etc.) les
exploitations agricoles peuvent par exemple orienter leur production vers les
bovins, les porcins, les ovins/caprins ou les granivores.
2.3.3. Complexité
agricole
De nombreux facteurs interviennent dans l'agriculture en
favorisant ou perturbant la production :
§ L'eau : sur le plan de la
disponibilité au moment opportun mais aussi sur le plan de la
qualité.
§ Le climat : avec ses variations
inattendues (chaleur, sécheresse, pluie, grêle, gel et autres
calamités climatiques).
§ Le sol avec ses
inégalités
§ Les espèces
végétales
§ Les espèces animales
§ Les prédateurs (parasites,
maladies, et consommateurs de toutes sortes : végétaux,
insectes, animaux sauvages...)
§ La mécanisation agricole
§ L'agronomie (fertilisation, biologie,
génétique, etc.)
§ Et globalement tout l'environnement
socioéconomique (prix de pétrole, législation,
consommateur, gouvernement, etc.).
2.4. RÔLE DE LA
CROISSANCE AGRICOLE
Le rôle de la croissance agricole dans la croissance
économique est de la réduction de la pauvreté et la faim.
La productivité totale des facteurs en agriculture était
supérieure à celle de secteur non agricole, venant ainsi
contredire l'idée selon laquelle l'agriculture serait un secteur
arriéré, où les investissements et les politiques sont
systématiquement moins aptes que dans les autres secteurs à
générer de la croissance.
Dans l'ensemble, la croissance agricole a probablement un
rôle plus important à jouer en tant que facteur de
réduction de la pauvreté, plutôt que comme moteur de la
croissance économique. Cela s'explique par le fait que la proportion
des individus travaillant dans l'agriculture est nettement supérieure
à la part de la production économique provenant de l'agriculture.
Dans les pays les moins avancés, la population active occupée
dans le secteur agricole représente plus de la moitié de la
population active totale, soit le double de la part de l'agriculture dans le
PIB.
On peut en déduire que les travailleurs agricoles ont
en général des revenus moindres, comme l'indique d'ailleurs le
fait que la pauvreté est surtout concentrée dans les campagnes.
Etant donné que beaucoup de pauvres travaillent dans l'agriculture, la
croissance agricole aura probablement des effets plus bénéfiques
pour les pauvres que la croissance non agricole.26(*)
Selon une étude récente analysant la croissance,
d'un pays à l'autre, la croissance réduit la pauvreté
parmi les plus démunis, à condition que les
inégalités de revenus ne soient pas trop criantes. Dans les pays
à faible revenu dotés de peu de ressources, un taux donné
de croissance du PIB dû à la croissance agricole réduit
cinq fois plus la pauvreté que le même taux de croissance du PIB
dû au développement d'autres secteurs (sauf en Afrique
subsaharienne)27(*). En
Afrique subsaharienne, la croissance agricole se révèle onze fois
plus efficace. Il est donc essentiel d'accroître la production et la
productivité agricoles si l'on veut réduire la pauvreté de
manière efficiente, surtout dans les pays à faibles revenus.
2.4.1. Politique agricole
Pendant de nombreuses années, l'agriculture a
été oubliée des programmes de développement et de
l'aide internationale. Dans les années 80-90, la plupart des pays
africains ont été soumis à des Plans d'Ajustement
Structurel (PAS), qui se sont traduits par une réduction drastique des
dépenses publiques, une ouverture à la concurrence internationale
et une politique de privatisation. Après ces importantes
réformes, les ressources publiques et l'aide au développement du
secteur agricole en Afrique n'ont presque plus évolué.
La crise alimentaire de 2008 a remis l'agriculture sur le
devant de la scène et a montré la nécessité pour
les pays de trouver des réponses structurelles capables d'assurer leur
sécurité alimentaire, faire face à la pauvreté
rurale et assurer des emplois à une population essentiellement
constituée de jeunes.
Les processus en cours au niveau continental (Programme
Détaillé de Développement de l'Agriculture Africaine)
mettent l'accent sur l'augmentation des investissements publics dans
l'agriculture (engagements pris à Maputo par les chefs d'Etats africains
de porter à 10% le budget alloué à l'agriculture) et la
croissance agricole (qui doit être portée à 6%). 28(*)
Cependant le principal enjeu pour les pays africains reste la
mise en place de politiques agricoles concertées et cohérentes,
en rapport avec les principaux enjeux de développement et
opportunités du continent, et capables d'assurer la souveraineté
alimentaire des pays.
2.4.2. Les
caractéristiques des politiques agricoles
Une politique agricole se compose d'un ensemble de mesures
d'interventions publiques qui portent sur la production agricole nationale ou
sur les importations et exportations de produits agricoles.
Elle se caractérise généralement par
« un ensemble de mesures réglementaires, dispositifs structurels,
moyens financiers et humains interdépendants, mis en oeuvre par la
puissance publique pour contribuer à la progression du secteur agricole
». Les politiques agricoles concernent les actions que mène
directement l'Etat au niveau de ses structures centralisées, ou au
niveau des échelons décentralisées, mais aussi les actions
visant à orienter le comportement des acteurs privés.
Cette définition d'une politique agricole «
idéale » repose sur un certain nombre de conditions qui ne sont que
rarement réunies dans le contexte africain. Elle suppose :
- qu'il y ait une cohérence globale tout au long du
processus de politique agricole, depuis le choix de la stratégie, la
formulation des objectifs spécifiques, l'identification des instruments
et mesures, leur mise en oeuvre et leur évaluation, et qu'il y ait une
cohérence avec les autres politiques sectorielles menées
(commerciale, environnementale, etc.) ;
- qu'il existe des moyens inscrits dans la durée
permettant de mettre en oeuvre ces mesures, sans rupture dans le financement,
de manière à ce que la politique soit appliquée de
manière stable.
En pratique, ces conditions sont loin d'être
vérifiées dans bon nombre de pays africains. Les gouvernements
dépendent en effet principalement des financements des partenaires au
développement, dont les programmes ne recoupent parfois que
partiellement les priorités définies par les Etats et
s'inscrivent généralement dans une durée limitée.
2.4.3. Les finalités des
politiques agricoles
Les politiques agricoles poursuivent plusieurs
finalités, qui sont souvent complémentaires :
- stabiliser les prix et réguler les marchés,
- développer les filières agricoles,
- moderniser les exploitations et intensifier la production,
- soutenir le revenu des producteurs,
- rendre l'alimentation accessible aux populations les plus
vulnérables,
- préserver l'utilisation durable de la terre et des
autres ressources naturelles, etc.
Cependant, les politiques agricoles sont évolutives et
fortement influencées par le contexte. Durant la période post
Indépendances, les politiques agricoles de nombreux pays africains
reposaient sur une logique d'exportation de cultures de rente pour
générer des revenus, et d'importations de produits alimentaires
bon marché pour assurer la sécurité alimentaire des
populations.
Depuis le début des années 2000, avec la crise
persistante des marchés des matières premières agricoles
et l'augmentation du déficit des produits vivriers, on note des
tentatives d'inversion de la tendance.
Conclusion partielle
Dans le chapitre qui touche à sa fin, il a
été question d'analyser les concepts comme croissance
économique, le secteur agricole. Mais surtout, il a plus consisté
à dégager le rôle des finances publiques dans la croissance
économique et aussi le rôle de la croissance agricole dans la
réduction de la pauvreté.
Chapitre Troisième:
LE RÔLE DES FINANCES
PUBLIQUES DANS LE SECTEUR AGRICOLE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
3.1. LES FINANCES
PUBLIQUES
La bonne gestion des finances publiques est capitale pour le
présent et l'avenir de la République Démocratique du
Congo, qui émerge de longues années de crise de
légitimité nourrie par des conflits armés. Ces conflits
ont entamé le monopole de la coercition de l'Etat, freiné le
développement du pays et réduit ses capacités de
gouvernance.
Face à cet héritage et aux besoins des
populations, le Gouvernement a adopté une stratégie de
développement qui s'appuie sur cinq piliers, à savoir :
a. promouvoir la bonne gouvernance et consolider la paix par
le renforcement des institutions;
b. consolider la stabilité macroéconomique et la
croissance;
c. améliorer l'accès aux services sociaux et
réduire la vulnérabilité;
d. combattre le VIH/SIDA et
e. appuyer la dynamique communautaire.
Les réponses aux questions relatives à chacun
des piliers ci-dessus indiqués dépendront, en grande partie, de
la manière dont les ressources financières seront
mobilisées et utilisées.
Dès lors, les faiblesses notables dans la gestion des
finances publiques doivent être redressées afin de rendre
réalisable la stratégie de développement et permettre sa
mise en oeuvre effective et satisfaisante. Il ne s'agit pas simplement de faire
face à des déficits conjoncturels ou aux effets induits passagers
des conflits armés et des crises politiques.
Il s'agit de répondre à la décomposition
du système des finances publiques qui est responsable notamment de la
perte de valeur de la monnaie nationale et des difficultés d'orienter
les efforts des pouvoirs publics vers les populations les plus
vulnérables.
3.1.1. Evolution des recettes
publiques
3.1.1.1. Dette publique
En 2011, le stock de la dette extérieure a
été évalué à 4.517,6 millions USD dont 91,7
% de dette à moyen et long terme et 8,3 % de dette à court terme
principalement contenu dans le compte divers de la BCC. Les institutions
multilatérales détiennent près de la moitié du
stock total.
Le service de la dette effectué s'est situé
à 184,8 millions USD contre celui prévu de 168,0 millions, soit
un taux d'exécution de 110,0 %. Il convient de signaler que ce
dépassement s'explique par le paiement des arriérés en
faveur du Club de Kinshasa et celui de la dette non allégée au
mois de juillet en faveur de la BAD. Le service envers les Institutions
Multilatérales s'est établi à 56,5 millions USD, dont 3,6
millions USD et 6,6 millions respectivement en faveur du FMI et de la Banque
des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC).
3.1.1.2. Finances
publiques
Le Gouvernement a engagé des réformes des
finances publiques, un des secteurs prioritaires dans le cadre de la gestion
transparente des ressources de l'État. La politique budgétaire
durant les dix dernières années a reposé sur
l'assainissement des finances publiques en vue de contribuer à la
consolidation de la stabilité macroéconomique et de soutenir la
croissance à long terme.
Ces actions ont été poursuivies jusqu'en 2012 et
ont consisté à accroître les recettes publiques à
travers la rationalisation de la fiscalité, l'élargissement de la
base d'imposition, l'amélioration du recouvrement de l'impôt et
l'accroissement des recettes non fiscales tirées de l'exploitation des
ressources naturelles du pays. Le déficit budgétaire
consolidé s'est encore détérioré en passant de 1,8
% du PIB en 2011 à 2,6% du PIB contre un excédent de 1,2% en 2010
consécutif à une évolution des dépenses plus rapide
que celles des recettes, compte tenu du fait de l'organisation des
élections qui ont eu lieu en novembre 201129(*).
3.1.1.3. Les recettes
budgétaires
Les recettes budgétaires ont augmenté de 0,3 %
entre 2010 et 2011 et de 28,7% entre 2011 et 2012. Cette performance s'explique
par la conjonction de plusieurs facteurs notamment par la bonne tenue des
recettes fiscales, qui ont augmenté entre 2010 et 2012 grâce
à la poursuite de la modernisation des services fiscaux,
l'intensification de la lutte contre la fraude, la fin de certaines
exonérations accordées en soutien à la crise alimentaire
et énergétique, et une meilleure gestion de la TVA.
Certaines études semblent montrer qu'il reste une marge
de progression et que le taux d'impôt moyen optimal en RDC se situe
autour de 45% du PIB30(*).
Ainsi, en dépit de cette performance, ces ressources demeurent
insuffisantes et allouées de façon non optimale pour
répondre aux besoins de lutte contre la pauvreté.
Tableau n°01. Evolution type des recettes
publiques en RDC
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
RECETTES ET DONS
|
16,9%
|
20,3%
|
24,3%
|
30,4%
|
32,1%
|
30,6%
|
|
RECETTES FISCALES ET NON FISCALES
|
14,7%
|
18,1%
|
16,8%
|
18,7%
|
19,0%
|
21,8%
|
|
· RECETTES FISCALES (DGDA)
Douanes et Accises
Recette douanières
Accises
Impôts directs et indirects
Impôts directs
Impôts indirects
· RECETTES NON FISCALES (DGRAD)
|
11,6%
5,4%
4,6%
07%
6,2%
2,5%
3,7%
3,1%
|
14,2%
6,4%
5,1%
1,3%
7,8%
3,6%
4,2%
3,8%
|
13,0%
6,2%
3,7%
2,4%
6,8%
3,1%
3,7%
3,9%
|
14,3%
6,5%
3,9%
2,6%
7,8%
3,8%
4,0%
4,5%
|
14,2%
7,5%
4,4%
3,0%
7,6%
3,7%
3,9%
4,8%
|
16,2%
7,9%
4,8%
3,1%
8,3%
4,4%
3,9%
5,6%
|
|
DONS (Courants)
|
2,2%
|
2,3%
|
7,5%
|
11,7%
|
10,6%
|
8,8%
|
|
Dons budgétaires
Dons projets
Allégement de dette PPTE
|
0,0%
0,6%
1,6%
|
0,0%
1,1%
1,2%
|
0,7%
2,0%
3,8%
|
0,8%
7,1%
3,8%
|
0,3%
7,8%
2,5%
|
0,0%
6,2%
2,5%
|
Source : UNDP-CD-Rapport Socioéconomique-2013,
p23
3.1.1.4. Les
dépenses publiques
Les dépenses publiques ont
doublé entre 2007 et 2011, passant respectivement de 18,9% du PIB
à 36,4%. En 2012, elles seraient situées à 33,4% du PIB.
Cette hausse est consécutive à la volonté du Gouvernement
de poursuivre la mise en oeuvre des mesures et des actions prioritaires de
réduction de la pauvreté, ainsi que des grands travaux
d'investissements amorcés dans la révolution de la
modernité.
Cependant, il y a lieu de noter que l'exécution du
budget des dépenses demeure encore et toujours en deçà des
prévisions budgétaires, soit en moyenne 55,8%. En outre,
l'accroissement des dépenses publiques est dû, entre autres, dans
une moindre mesure à la hausse de la masse salariale ainsi qu'à
la réalisation des dépenses exceptionnelles respectivement de
2,3% à 13,8%, et de 0,9% à 3,5% du PIB en 2007 à 6,3% en
2010. En effet, la masse salariale a enregistré 7,2% du PIB contre 6,27%
entre 2007 et 2010, imputable au réajustement des salaires des
professionnels de santé, des magistrats et du personnel enseignant. Les
dépenses des biens et services ont connu également un
accroissement de 254,0 % contre un recul de 17,1 % en 2010.
3.1.1.5. Analyse
sectorielle des dépenses
Cette analyse des dépenses dont il question à ce
point porte essentiellement sur les secteurs OMD que sont la santé,
l'éducation, l'agriculture, le développement rural,
l'environnement et le Genre. Il sera question ici d'examiner et de comparer le
budget voté des dépenses de chaque secteur aux prévisions
qui ont été faites pour ensuite en apprécier le taux
d'exécution, afin de répondre à la préoccupation
d'identification du secteur OMD qui a le plus bénéficié de
l'apport du Gouvernement en matière d'allocation budgétaire.
Figure 1. Structure des dépenses OMD
2010-2012

Source : UNDP-CD-Rapport Socioéconomique-2013,
p23
La lecture de ce tableau montre clairement que c'est le
secteur de l'éducation, dont l'enveloppe globale représente 51%
du total des dépenses de lutte contre la pauvreté, qui vient en
tête pour cette catégorie de dépenses suivi du secteur de
la santé avec 27,7% devançant l'agriculture qui a 10% et le
développement rural 6%, ainsi que l'environnement 5% et le Genre 1%.
Cette logique est également respectée pour ce qui de
l'exécution des projets. On note en effet que le secteur de
l'éducation occupe encore une fois la tête du classement avec un
taux d'exécution de 64,9%, suivi du secteur de la santé (58,8%)
et des autres secteurs (avec une moyenne de 41,5%).
Globalement, les dépenses en faveur des secteurs
sociaux restent faibles, par le fait de la rigidité structurelle qui
caractérise l'économie nationale d'une part, et par la
difficulté de maintenir les finances publiques sous contrôle dans
un contexte sécuritaire difficile d'autre part. Le rapport de mise en
oeuvre du DSCRP1 a relevé d'ailleurs que les dépenses
liées à la sécurisation du pays ont exercé un effet
d'éviction sur les dépenses sociales pendant la période
allant de 2006 à 2010. Il en découle que le défi majeur
sera celui de maintenir la tendance haussière des recettes et d'en
améliorer l'affectation en vue de s'assurer de leur caractère
pro-pauvre.
3.1.1.6. Une gestion des
finances publiques à refonder
La combinaison prolongée d'une faible croissance
économique et du maintien des déséquilibres internes et
externes présenterait de sérieux risques car elle contrarierait
les objectifs légitimes de viabilité à terme des finances
publiques, de réduction de la pauvreté voire de paix sociale.
Conjurer de tels risques rend indispensable de poursuivre résolument
l'effort de réforme engagé par le Gouvernement.
3.1.1.7. Les principales
réformes en cours
Au cours des années récentes, la RDC a
engagé plusieurs réformes dans le domaine de gestion des finances
publiques. Tout d'abord, dans son effort de modernisation du cadre
législatif de la vie économique et sociale, des textes de loi
importants qui concernent les finances publiques ont été
révisés ou préparés : révision de la
législation fiscale applicable aux PME, projet de code des
marchés publics, projet de code des douanes, projet de loi portant
introduction de la taxe sur la valeur joutée, projet de loi sur les
finances publiques.
Deuxièmement, l'informatisation de la chaîne de
la dépense opérationnelle depuis 2003 permet, à tout
instant, la consultation de l'évolution d'une dépense dans le
circuit et le suivi des engagements par rapport aux crédits
autorisés, ainsi que des décaissements par rapport aux
engagements.
Ajouté à la production, notamment en fin de
mois, des états de suivi budgétaire et leur communication aux
ministères et organismes bénéficiaires, la gestion des
finances publiques s'est enrichie d'un outil de gestion précieux pour
les gestionnaires de crédits et, d'une manière
générale, les responsables de la conduite de l'action
gouvernementale.
Le Gouvernement congolais a lancé en 2003 un programme
de modernisation du système fiscal comprenant :
- la réorganisation et la modernisation de
l'administration fiscale, avec une reconfiguration des services fiscaux en
trois niveaux selon le chiffre d'affaires des assujettis;
- la révision de la législation, notamment la
modification de l'impôt sur le chiffre d'affaires en préparation
de l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
- l'amélioration de la gestion de l'impôt avec la
mise en place d'un nouvel identifiant fiscal (NIF);
- la modernisation des procédures douanières;
- l'instauration des guichets uniques dans certains postes
douaniers et
- l'informatisation des bureaux de douane.
3.1.2. La
nécessité de refonder le système et la gestion des
finances publiques
Malgré les efforts fournis, la gestion des finances
publiques est encore marquée par d'importantes faiblesses qui se
résument à la difficulté de maîtriser aussi bien les
recettes que les dépenses. Plus spécifiquement et comme
souligné dans plusieurs diagnostics dressés par le Gouvernement
avec l'appui des partenaires au développement, on observe notamment
que :
§ le budget s'écarte souvent des priorités
de la stratégie de développement,
§ la crédibilité du budget est
limitée par les écarts entre l'exécution et les
autorisations budgétaires; ce qui laisse de nombreux services de
l'administration sans les ressources budgétisées alors que,
à l'inverse, certaines entités bénéficient de
fortes sur-exécutions,
§ la transparence budgétaire est affectée
par l'importance des dépenses hors budget,
§ l'absence de maîtrise des effectifs et la
pratique des enveloppes globales non nominatives affectent la pertinence de la
solde,
§ la chaîne de la dépense souffre de
l'importance des procédures exceptionnelles,
§ les contrôles des corps de contrôle sont
faibles et peu suivis d'effet.
De plus, la sécurisation des recettes reste un grand
défi en raison de nombreux dysfonctionnements facilités par la
multitude des règlements et des intervenants, ainsi que par les
faiblesses institutionnelles des administrations concernées.
Il ne s'agit pas d'une simple amélioration de la
procédure budgétaire, mais d'un changement total de perspective.
Avant ces lois et directives, le Gouvernement demandait au Parlement des
autorisations de dépenser sans justifier les objectifs de la
dépense. Aujourd'hui, le Gouvernement sollicite des autorisations de
dépense sur la base de programmes, c'est-à-dire de politiques
publiques, auxquels sont associés des objectifs et des indicateurs qui
permettront, après exécution, d'en mesurer le degré de
réalisation.
Les pays anglophones, avancés ou en
développement, sont entrés dans ces nouvelles finances
publiques avant les pays francophones. Néanmoins, ces derniers sont en
voie de combler leur retard. La quasi totalité des pays francophones
soit sont déjà passé au système des budgets de
programmes (un petit nombre), soit mènent des expériences pilotes
dans l'intention de réaliser à bref délai ce passage. La
plupart des pays dans cette deuxième situation ont mis en place une
organisation institutionnelle aux fins de piloter la transition.
L'intérêt de la transition vers les nouvelles
finances publiques est difficilement contestable. Le budget de moyens est plus
simple à établir et à exécuter que le budget de
programmes, mais il est de peu de signification. Il autorise la dépense,
mais la dépense pour quoi ? Il ne le dit pas.
Une fois la dépense autorisée, les gestionnaires
publics, qui ne se sont engagés sur aucun objectif, peuvent se sentir
libres de dépenser comme ils l'entendent, sans que les gaspillages
inhérents à l'absence de responsabilité puissent leur
être reprochés. Il leur est simplement demandé de respecter
les dépenses par nature de l'autorisation parlementaire.
Le budget de programmes est plus complexe à
établir et à exécuter que le budget de moyens, mais il est
le seul qui permette de traduire les politiques publiques en un budget,
instrument d'opérationnalisation de ces dernières.31(*)
Par ailleurs, la Constitution affirme l'option de
décentralisation dans l'organisation et le fonctionnement des
institutions publiques. Elle indique notamment les compétences
exclusives et respectives du pouvoir central et des provinces ainsi que celles
exercées conjointement par le pouvoir central et les provinces. Le
transfert des compétences voulu par la Constitution doit se traduire par
des transferts de ressources financières grâce à
l'allocation aux Provinces de 40% des recettes à caractère
national.
Cependant, la décentralisation pose des défis
sans précédents, notamment du point de vue de la gestion des
ressources financières dont le transfert aux provinces et aux
entités territoriales décentralisées (ETD) n'atteindra
l'objectif recherché que s'il s'accompagne de progrès en
matière de gouvernance (amélioration des services publics,
transparence et imputabilité). Or, la faiblesse des jeunes
administrations provinciales constitue une contrainte majeure, notamment pour
une gestion des fonds publics effectivement orientée vers la fourniture
de services publics aux populations.
Face aux faiblesses accumulées au cours des
décennies en matière de gestion des finances publiques et aux
défis de la décentralisation et de la réduction de la
pauvreté, le Gouvernement a trouvé nécessaire de repenser
l'ensemble que forment les dépenses et les recettes, en vue de refonder
le système financier public dans sa totalité tout en tirant
partie des avancées de ces dernières années.
3.1.3. Une vision
ambitieuse
Ambitieuse, la vision des finances publiques du Gouvernement
doit s'inspirer, en premier lieu, des attentes des acteurs de la vie
économique, sociale et politique. Elle doit tenir compte aussi de la
réalité d'un monde globalisé dans lequel la RDC doit
continuer à jouer son rôle.
3.1.1.1. L'ambition de légitimité
La première ambition du Gouvernement serait de mettre
en place un système de finances publiques qui répond aux attentes
de la nation. Ceci implique une vision des finances publiques qui satisfait aux
trois principes suivants :
a. Le respect des fondamentaux de la gouvernance
politique.
La refondation dont il est question devra conduire à un
système de gestion des finances publiques qui respecte et soutient les
principes fondamentaux et l'architecture de la gouvernance politique. Ceci
comprend notamment :
- la souveraineté du peuple, exercée à
travers ses représentants élus dans un contexte politique
pluraliste;
- la séparation des pouvoirs;
- une architecture institutionnelle
décentralisée pour la gestion publique; et
- un Etat de droit32(*).
Il résulte de ce qui précède, par exemple
et selon les termes de l'article 174 de la Constitution, « qu'il ne
peut être établi d'impôts que par la loi et qu'il ne peut
être établi d'exemptions ou d'allègements fiscaux qu'en
vertu de la loi ». De même, la séparation des pouvoirs
implique le renforcement du contrôle parlementaire et
l'indépendance de la Cour des Comptes par rapport au pouvoir
exécutif.
b. La gestion des finances publiques au service de la
réduction de la pauvreté
Le citoyen et l'acteur de la vie économique attendent
de la gestion des finances publiques la facilitation d'une croissance forte
orientée vers la lutte contre la pauvreté, la réduction
des inégalités, l'accès élargi aux services de
base, l'exploitation optimale et durable des potentialités
économiques et le développement équilibré et
harmonieux du territoire.
A ces attentes correspondent pour le Gouvernement des choix
d'allocation des ressources publiques qui seront orientées
prioritairement vers les secteurs de la santé, de l'éducation, du
développement rural, de l'agriculture et des infrastructures, en mettant
l'accent sur les actions dont bénéficient les zones les plus
affectées par la pauvreté, à savoir le milieu rural et les
périphéries des grandes agglomérations urbaines. De ces
choix, devraient résulter, dans un horizon à moyen terme, une
amélioration sensible des indicateurs économiques et sociaux
grâce à la qualité de la dépense publique.33(*)
c. La viabilité des finances
publiques
Enfin, la vision du Gouvernement serait celle d'une gestion
des finances publiques qui se prévaut d'une viabilité qui
perdure. Ceci suppose et signifie que l'Etat et les institutions publiques en
général, ont une capacité d'autofinancement de leurs
besoins en rapport avec l'indépendance ou l'autonomie dont ils disposent
en droit.
L'ampleur des déséquilibres et le
caractère insoutenable de la situation financière actuelle (tant
du point de vue du poids des financements extérieurs et donc de la
viabilité à terme que de la réaffirmation du rôle
social de l'État) doivent être corrigés. L'ambition du
Gouvernement est qu'à moyen terme, à partir de ses ressources
ordinaires, l'Etat puisse assurer :
ü l'équilibre primaire des finances publiques;
ü le paiement régulier des salaires;
ü le service prioritaire de sa dette;
ü le fonctionnement régulier et satisfaisant des
services publics;
ü une contribution significative à
l'investissement nécessaire aux infrastructures économiques et
sociales.34(*)
L'ambition est aussi de mettre en place une gestion des
finances publiques dans laquelle l'action des pouvoirs publics répond
aux normes internationales et s'inspire des bonnes pratiques en la
matière. Ainsi, en référence au cadre
général reconnu de mesure de la performance qu'offre le PEFA, le
Gouvernement retient les points suivants de la bonne gouvernance des finances
publiques comme principes directeurs :
ü Crédibilité du budget -
Le budget est réaliste et mis en oeuvre de la façon
prévue.
ü Couverture et transparence - Le budget
et l'analyse du risque fiscal sont complets, et les informations fiscales et
budgétaires sont mises à la disposition du public.
ü Budgétisation basée sur les
politiques publiques - Le budget est préparé en prenant
en compte la politique gouvernementale.
ü Prévisibilité et suivi de
l'exécution du budget - Le budget est mis en oeuvre de
façon organisée et prévisible, et des arrangements sont
mis en place pour l'exercice du suivi.
ü Comptabilité, enregistrement de
l'information et rapports financiers - Des informations
adéquates sont produites, maintenues et disséminées pour
satisfaire les exigences du suivi de la prise de décision, de la gestion
et de la rédaction de rapports financiers.
ü Surveillance et vérification externes
- Des systèmes d'examen rigoureux des finances publiques et de
suivi d'exécution sont mis en place.
3.1.1.2. L'ambition d'efficacité : la gestion
axée sur les résultats
La vision du Gouvernement qui se veut aussi ambitieuse en ce
sens qu'elle doit mettre l'accent sur l'efficacité de l'action des
pouvoirs publics dont les performances sont mesurables et suivies. Ceci
implique l'adoption de l'approche de Gestion axée sur les
résultats (GAR) dont les instruments, au niveau des finances publiques,
sont le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) et la
budgétisation par programmes d'activités dite budget de
programmes (ou budget-programmes).
La mesure de la performance est un outil indispensable pour
répondre à un enjeu particulier, l'exigence démocratique
de compte rendu, et à une contrainte spécifique de l'action
publique l'absence d'information faute de mécanisme de marché. Ne
pas mesurer la performance nuirait à la fois à la qualité
du débat démocratique et à l'efficience de la gestion.
Tout d'abord, les acteurs publics, qu'ils soient politiques ou
gestionnaires, davantage que les organisations ou les entreprises
privées, ont des comptes à rendre sur l'emploi de ressources
publiques. Les articles 14 et 15 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme et du citoyen expriment cette exigence démocratique
qui consiste à rendre des comptes aux citoyens, aux usagers, aux
contribuables et à leurs représentants. 35(*)
Cette exigence de compte rendu est renforcée dans la
mesure où elle est la contrepartie naturelle des libertés de
gestion offertes par le nouveau cadre budgétaire et la globalisation des
crédits au sein des programmes. La fixation d'objectifs a priori et la
mesure des résultats atteints constituent le socle de la
responsabilisation des gestionnaires sur les résultats.36(*)
a. Une approche systémique et
réaliste
Traduire dans les faits la vision résumée
ci-dessus demandera plusieurs années d'effort et du réalisme dans
l'appréhension des difficultés et la conduite des actions de
réforme. Ceci rend nécessaire d'adopter une approche
systémique des réformes de finances publiques et de suivre une
démarche progressive et participative.
Le réalisme demande d'abord de reconnaître le
caractère systémique du changement à apporter; ce dernier
résultant lui-même de la nature des maux à corriger. La
démarche systémique a plusieurs implications. Elle
appréhende les réformes générales de finances
publiques de manière fonctionnelle et reste attentive aux
interconnexions entre les domaines de réformes.
A cet égard, le Gouvernement est conscient que, par
moment, la refondation du système de finances publiques s'accompagnera
nécessairement de la modification des agencements institutionnels
existants. Dans chaque cas, les mesures seront prises afin de mener à
bien les réformes.
La corruption étant un mal systémique dont le
recul substantiel est indispensable pour la refondation des finances publiques
illustre bien le caractère systémique des problèmes
auxquels il faut s'attaquer et, par conséquent, des réformes
à mettre en oeuvre. La corruption n'est ni un phénomène
cantonnée à tel ou tel secteur d'activité ou profession,
ni une pratique répandue par le fait du hasard.
Elle est, tour à tour, conséquence et cause de
multiples dysfonctionnements. Sa généralisation dans la
société (au sein des administrations publiques notamment)
témoigne d'une ampleur et d'un enracinement dans les moeurs et "le
système" face auxquels des considérations morales et des
initiatives isolées auraient des effets limités.
Lutter contre la corruption demande, par conséquent,
d'agir sur le système à plusieurs niveaux y compris : la
législation et les dispositions réglementaires, l'organisation
des services, les méthodes et procédures de travail, la formation
et la rémunération des personnels, le renforcement des
capacités du système judiciaire, la diffusion de l'information
notamment financière, l'affirmation du rôle de la
société civile etc.
a. Réaffirmer la place centrale du budget dans la
gestion des finances publiques
v Au niveau national
Le Gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires
afin que le caractère central du budget dans la gestion des finances
publiques se traduise dans la réalité, à travers la
gestion quotidienne des fonds publics. Il s'agit d'abandonner des pratiques
héritées du passé et qui ne suggèrent rien de moins
que la négation de l'instrument budgétaire.
Or, le non respect du budget peut conduire à un
redéploiement des crédits entre les catégories de
dépenses qui traduit des préférences personnelles
plutôt qu'un souci d'organisation efficiente des services.
De plus, les activités qui ne sont pas
gérées ou rapportées dans le cadre des procédures
budgétaires appropriées ont peu de chance d'être soumises
aux mêmes types d'examens et de contrôles que les opérations
inscrites au budget. Cela tend à augmenter la probabilité que ces
activités aient lieu sans référence aux objectifs
budgétaires fixés par le Gouvernement et que les risques
potentiels qu'elles comportent ne soient pas pris en compte; d'où un
risque accru de non réalisation des objectifs de solde budgétaire
ou de création de dettes insoutenables pour l'Etat.
La signification concrète de la centralité du
budget dans la gestion des finances publiques ressort en détail dans la
présentation des grands chantiers de réforme. Il convient de
souligner, dès à présent, que la réhabilitation de
la crédibilité et de l'utilité du budget impliquera
notamment l'élargissement du champ budgétaire, la pluri
annualité, la pertinence des prévisions, la
sincérité des comptes et l'effectivité du contrôle.
Sur le plan institutionnel, la réaffirmation du
caractère central du budget entraîne le renforcement des
rôles des services chargés de la préparation
budgétaire et de la gestion des dépenses au niveau des
ministères ayant des responsabilités transversales (Budget,
Finances, Plan) comme à celui des ministères aux
responsabilités sectorielles.
v Dans les provinces
L'importance des finances, notamment de la gestion
budgétaire, ressort également au niveau des provinces et des
entités territoriales décentralisées (ETD). Le
Gouvernement est déterminé à traduire pleinement dans les
faits, l'organisation et la conduite de la gestion publique de manière
décentralisée.
Il s'agit d'une option prise par la nation congolaise à
travers la Constitution de 2006 et l'adoption de trois lois organiques majeures
portant respectivement sur :
- les principes fondamentaux relatifs à la libre
administration des provinces,
- les modalités de fonctionnement de la
conférence des Gouverneurs des provinces,
- la composition, l'organisation et le fonctionnement des
entités territoriales décentralisés (ETD) et leurs
rapports avec le Pouvoir central et les Provinces.
Cependant, les contraintes financières de l'Etat
(Pouvoir Central et Provinces) auxquelles s'ajoute la faible capacité de
la plupart des administrations provinciales expliquent le sentiment selon
lequel le transfert effectif des compétences se réalise plus
lentement que prévu. En somme, la mise en oeuvre effective de la
décentralisation dépendra, elle aussi, de la pertinence de la
gestion des ressources à travers les budgets au niveau central comme
à celui des provinces.
3.1.1.3. Refonder les finances publiques dans un cadre
juridique moderne
3.1.1.3.1. La nécessité de
rénover le cadre juridique
La gestion des finances publiques s'effectue actuellement dans
un cadre juridique et institutionnel totalement inadapté au contexte de
la Constitution, adoptée par référendum et
promulguée en février 2006, qui prône notamment la
décentralisation. Sous-tendue par les dispositions de la loi
financière n° 83-003 du 23 février 1983, telle que
modifiée et complétée par l'ordonnance-loi n° 87-004
du 10 janvier 1987, cette gestion n'est plus en phase avec ladite loi
financière malgré l'effort fait pour tenir compte de certaines
innovations induites par les réformes mises en oeuvre depuis 2002 par le
Gouvernement (principalement en ce qui concerne la présentation des
documents budgétaires, les intervenants dans la chaîne de la
dépense, le report des crédits d'une année sur l'autre et
les nomenclatures budgétaires de dépenses et de recettes).
Si des réformes partielles ont pu être
engagées au cours de ces dernières années, la refondation
des finances publiques demande un nouveau socle juridique sur lequel reposera
toute l'architecture légale et règlementaire de la mobilisation
et de l'utilisation des fonds publics. Telle est l'ambition d'une loi sur les
finances publiques (LOFIP) qui doit offrir un cadre systémique, puis
être suivi d'autres textes d'application, notamment le règlement
général de la comptabilité publique.
Sur le plan opérationnel, la loi sur les finances
publiques s'annonce comme la pierre angulaire et, à beaucoup
d'égards, elle constitue le facteur déclencheur de la dynamique
de réforme globale des finances publiques congolaises qui devrait
s'étaler sur plusieurs années. En raison de sa vocation
systémique, la LOFIP, une fois adoptée, offrira, en permanence,
des repères et un test de cohérence à l'action
réformatrice et à la gestion. Il s'agira de consolider les acquis
obtenus en mettant en cohérence avec le cadre juridique de la LOFIP, les
innovations qui seront introduites de manière pragmatique.
La finalisation du projet de texte et l'adoption de la LOFIP
par les instances législatives constitue donc actuellement une grande
priorité dans la mesure où le processus de refondation du
système de finances publiques en dépend.
La pertinence du projet de loi sur les finances publiques
(LOFIP)
3.1.1.3.2. La traduction effective de la vision sur le
plan juridique
Le Gouvernement doit élaborer un projet de LOFIP qui va
bénéficier des commentaires et suggestions des partenaires
extérieurs et qui sera présenté prochainement aux
législateurs. Ce projet de loi est pertinent, car le cadre des finances
publiques qu'il propose tient compte des dispositions de la Constitution et
requiert une organisation de l'action gouvernementale avec le souci de
performance.
La modernité du projet de LOFIP s'exprime
particulièrement à travers la mutation qu'il implique, à
savoir ce passage d'une gestion centrée sur les moyens à une
gestion axée sur les résultats. Formalisant les réformes
entamées et anticipant les perspectives d'une gestion moderne des
finances publiques, le projet de LOFIP se caractérise par des
innovations et des réaffirmations importantes dont les plus saillantes
sont :
- les principes d'unité et d'universalité
budgétaires qui impliquent que le budget présente la liste de
toutes les dépenses et de toutes les recettes et que par une
soustraction de ces ensembles, on puisse en établir le solde;
- une récapitulation de la totalité des recettes
et de la totalité des dépenses qui implique l'interdiction
d'opérations de dépenses publiques en dehors du budget,
couramment appelées débudgétisation ou dépenses
extrabudgétaires;
- la gestion budgétaire au moyen de budget de
programmes dans lequel l'allocation des crédits budgétaires est
faite au profit d'actions à mener dans le cadre de politiques publiques
explicites;
- un cadrage budgétaire pluriannuel sous-tendant
l'élaboration du cadre des dépenses à moyen terme des
ministères et institutions et dont la loi de finances devient la tranche
annuelle. Cela permet d'assurer la continuité dans la gestion des
programmes en préconisant les autorisations d'engagement pluriannuelles
votées en totalité la première année de leur
prévision, dont les crédits de paiement correspondant sont
ramenés à l'exercice budgétaire;
- la centralisation des fonds publics du Pouvoir Central sur
le compte général du Trésor ouvert chez le caissier de
l'État, ce qui permet de créer une véritable unité
de caisse et de trésorerie.
3.1.1.4. L'enrichissement du rôle
du législateur lors du vote de la loi de finances
Le projet de LOFIP est aussi moderne en ce sens qu'il annonce
une modification radicale des conditions de vote des lois de finances annuelles
qui renforce le rôle du législateur dans l'appréciation des
stratégies et des politiques gouvernementales. Seront notamment requis
:
- un vote d'ensemble pour les évaluations de recettes
(budget général, budgets annexes et comptes spéciaux);
- un vote sur l'évolution de la dette qui permettra
l'organisation d'un débat sur celle-ci;
- un vote des crédits par programme (liés
à des missions et des politiques publiques) plutôt que par
ministère. Ceci ouvre la voie à une organisation des
débats autour des politiques publiques reflétées dans les
grandes natures de dépenses;
- une spécialisation des crédits par grandes
natures de dépenses, ce qui consacre le principe de fongibilité
avec une responsabilisation accrue des gestionnaires de programmes;
- un vote unique sur le plafond des autorisations d'emplois
rémunérés par l'État qui sera l'occasion d'un
débat d'ensemble sur l'emploi public et la masse salariale37(*).
La mise en application des dispositions de la LOFIP et des
textes connexes comportant de nombreuses innovations, devra, parfois,
être préparée et organisée par étapes. A
titre d'illustration, la vision à terme d'une approche budgétaire
basée sur le concept de programmes assortis d'objectifs à
atteindre est complexe et non encore bien connue des différents
acteurs.
3.2. LE SECTEUR AGRICOLE
CONGOLAIS
Le secteur agricole congolais est confronté à de
nombreuses contraintes d'ordre technique, économique et institutionnel,
à savoir : une faible productivité des filières
végétales, animales et halieutiques, une allocation
budgétaire encore insuffisante, un cadre institutionnel insuffisamment
organisé avec un déficit en ressources humaines, techniques et
matérielles, tant au niveau central qu'au niveau des provinces, un
régime foncier dualiste tiraillé entre le légal formel et
le traditionnel informel.
L'on pourrait ajouter aussi la faible capacité de
financement des opérateurs agricoles ainsi que les difficultés
d'accès au crédit agricole, la dégradation et le faible
niveau d'accès aux infrastructures de base, le manque d'organisation des
producteurs et autres acteurs des filières agricoles,
l'inadéquation de l'offre de services de recherche et de vulgarisation
agricole au regard de la demande d'appui-conseil des organisations paysannes et
autres opérateurs, le faible niveau d'accès aux informations sur
les marchés, la faiblesse de la demande interne du fait du faible
pouvoir d'achat des consommateurs, enfin le faible niveau de valorisation des
productions.38(*)
3.2.1. Les
potentialités du secteur agricole de la RDC
La République Démocratique du Congo dispose de
plus ou moins 80 millions d'hectares de terres arables dont moins de 10 % sont
actuellement exploités. La diversité des climats, appuyée
par un important réseau hydrographique, permet de pratiquer une gamme
variée des spéculations agricoles.
Les étendues d'herbage et de savanes sont susceptibles
de supporter un élevage de plus ou moins 40 millions de têtes de
gros bétail. Les forêts tropicales occupent 135 millions
d'hectares, soit 52 % du territoire national. Elles constituent une importante
réserve de biodiversité et des terres aménageables.
Le potentiel d'irrigation est évalué à 4
millions d'hectares. Cependant, cette pratique est encore modeste. Elle est
confinée à la production industrielle de la canne à sucre
et dans une moindre mesure à la riziculture. Le potentiel halieutique se
trouvant dans les parties congolaises de l'Océan Atlantique,
ajouté à celui du fleuve Congo, de ses affluents et l'ensemble
des lacs est estimé à 707.000 tonnes de poissons par an.
3.2.2. Paradoxe Congolais39(*)
Bien que l'agriculture ait été reconnue
priorité des priorités depuis le début de la
Deuxième République, le secteur agricole ne contribue pas de
façon significative au développement socioéconomique du
pays.
L'incohérence des politiques mises en oeuvre n'a pas
permis d'atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire arrêté
à l'époque. A part la production du manioc et des légumes
qui permettait de couvrir la demande intérieure, celle des autres
groupes de produits ont cessé de couvrir cette demande depuis.
En effet, le taux moyen de croissance annuelle de ce groupe de
culture évolue en dessous de celui de la croissance
démographique. A partir de 1999, la production du manioc, produit
principal de l'économie des ménages, a chuté de plus de 20
% à cause de la pression des maladies et d'insectes nuisibles à
cette culture.
D'une manière générale, depuis les
années 1990, le taux de croissance annuelle moyenne de la production
vivrière (2%) est resté inférieur à celui de la
croissance démographique (3,3%).
Les productions des filières agro-industrielles
(café, coton, cacao, hévéa, caoutchouc, etc.) n'ont
cessé de régresser. La récolte de café a connu une
baisse de plus de 85 % entre 1991 et 2000.
Les activités de pêche artisanale sont aussi en
baisse. Le nombre d'embarcations est passé d'une pirogue en moyenne pour
deux pêcheurs avant les évènements politico-militaires,
à une pirogue pour six pêcheurs actuellement. Avec une
disponibilité en matériel de pêche qui a chuté de 25
à 60 %, la baisse moyenne de la production est estimée à
45%. Alors que le potentiel halieutique est estimé à 707.000
tonnes de poissons par an, la production annuelle actuelle atteint à
peine 22.000 tonnes.
Cette production correspond à une disponibilité
moyenne annuelle de 5,2 KG par tête d'habitant, disponibilité
nettement inférieure à la norme de 13Kg par tête d'habitant
par an. Concernant la production animale, avant les années 90, le
cheptel national comptait plus d'un million de bovins, 725.000 porcins, 700.000
ovins, 2.500.000 caprins et plus ou moins 15 millions de volailles.
Les guerres successives ont entraîné une perte de
près de 80 % du cheptel dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, et en
Ituri; elles ont décimé les élevages de gros et petit
bétail dans le Bandundu. La production du sous-secteur de
l'élevage ne couvre actuellement que 5,5 % des besoins de la
population.
Les considérations ci-dessus montrent que les
productions locales du secteur agricole ne couvrent pas les besoins de la
population. Cette situation ne permet pas la réalisation de la
sécurité alimentaire objective de développement,
actuellement adopté par le Gouvernement.
La session budgétaire pour l'exercice 2014 s'est active
au Palais du peuple où les députés étaient entrain
de visiter les propositions gouvernementales sur la loi budgétaire en
2014. Le développement de ce débat budgétaire note un
réel revirement du côté gouvernemental qui a maintenu
pendant longtemps le budget de l'Agriculture à son seuil habituel ne
dépassant pas deux pourcent.
3.2.3. Agriculture
En 2013, l'indice d'activité de cette sous-branche
s'est établie à 103,2 points contre 102,7 une année
auparavant. Cet accroissement a résulté essentiellement de celui
de la composante « production agricole vivrière» qui a
pesé pour 96,3 % dans l'ensemble de la production agricole. Ce dynamisme
fait suite notamment aux actions engagées par l'Etat au plan national
à travers les différentes campagnes agricoles en vue
d'améliorer la sécurité alimentaire et de renforcer la
vigueur des filières d'exportation.
Graphique n°01. Evolution des indices de production
agricole globale et de production agricole d'exportation

Source : Banque Centrale du Congo, rapport annuel 2013,
p.10 pdf
3.2.4. Production agricole
vivrière
En 2013, l'indice d'activité agricole vivrière a
renseigné un accroissement de 4,3 % rapproché à son niveau
de 2012, en liaison essentiellement avec la hausse de la production des
oléagineux (4,2 %), racines et tubercules (2,4 %) et légumes et
légumineuses (2,6 %). Cependant, il a été observé
une tendance à la baisse au niveau de certaines productions, notamment
les fruits (2,2 %) et les céréales (2,0 %).
3.2.5. Culture de rente
Pour ce qui est de la sous-branche «cultures
d'exportation» ou «culture de rente», son indice
d'activité, de l'ordre de 101,4 points en 2013 contre 100,7 points en
2012, a affiché une faible progression de 0,7 %. Certains produits ont
accusé des variations positives en 2013, en l'occurrence : les
oléagineux (27,1 %), le café robusta (21,5 %), le café
arabica (8,2 %), les grumes (0,4 %) et l'huile de palmiste (53,2 %), en raison
notamment des efforts déployés par l'Etat pour soutenir le
rendement dans ce secteur.
Par contre, d'autres productions, comme celles de cacao et de
caoutchouc, se sont inscrites de nouveau en baisse respectivement de 0,7 % et
16,3 %, principalement imputable au vieillissement et au manque d'entretien des
plantations. Pour la redynamisation des activités agricoles en RDC,
notamment celles de rente ou agro-industrielles, en faible croissance depuis
plus d'une décennie, il est préconisé le
développement des stratégies visant à attirer les
investissements directs étrangers dans ce domaine.
A cet effet, la création des zones économiques
spéciales, faisant partie intégrante des programmes de
modernisation de plusieurs pays, serait la bonne option, car sa
réalisation permet de créer les conditions d'émergence et
de développement d'un axe de compétitivité et de
croissance capable d'exercer un puissant effet d'entraînement sur
l'économie nationale d'un pays. Elle constitue donc l'un des leviers
principaux de la stratégie de croissance
accélérée.
3.2.6. Elevage, pêche et
chasse
L'indice d'activité de la sous-branche « Elevage,
pêche et chasse » s'est accru de 4,1 % en 2013, s'établissant
à 117,7 points contre 113,1 points en 2012. S'agissant de
l'élevage, les bonnes techniques et pratiques utilisées ont
permis de relever, quoique faiblement, le niveau de production de certains
bétails, notamment les bovins (0,3 %), les ovins (0,2 %), les caprins
(0,1 %) et les porcins (0,2 %).
Quant aux activités de pêche et chasse, elles ont
enregistré des évolutions positives. En effet, la production de
poisson frais et celle de gibier se sont accrues respectivement de 6,2 % et 2,7
%.
3.2.7. Financement du secteur
agricole en RDC
Pour mettre fin au déclin du secteur agricole sur le
continent, les ministres africains ont adopté, à la
vingtième Conférence Régionale pour l'Afrique (CRA), le 8
février 2001 au Caire, une résolution sur les étapes clefs
à considérer dans le domaine agricole dans le cadre du Nouveau
Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD).
Afin de mettre en oeuvre cette résolution, ils ont
approuvé le Programme Détaillé pour le
Développement de l'Agriculture Africaine (PDDAA), lors d'une session
spéciale sur le NEPAD de la Conférence régionale de la FAO
pour l'Afrique qui s'est tenue à Rome le 9 juin 2002. Le PDDAA qui est
le volet agricole de NEPAD a pour objectif de restaurer la croissance agricole,
le développement rural et la sécurité alimentaire en
Afrique. Les cinq piliers principaux du PDDAA sont:
1. l'augmentation des superficies cultivées de
façon durable et desservies par des systèmes fiables de
maîtrise de l'eau;
2. l'amélioration de l'infrastructure rurale et des
capacités commerciales pour faciliter l'accès au
marché;
3. le renforcement et l'augmentation des approvisionnements
alimentaires et la réduction de la faim (en mettant l'accent sur les
catastrophes et autres situations d'urgence qui nécessitent des
réponses alimentaires et agricoles);
4. le développement de la recherche agricole, la
diffusion et l'adoption de technologies pour accroître la
productivité à long terme; et
5. des activités de développement rural
liées aux secteurs élevage, pêche et forêts.
En pratique, le PDDAA permettra de mettre en oeuvre les
principales recommandations sur la sécurité alimentaire, la
réduction de la pauvreté et l'utilisation durable des ressources
naturelles faites lors des récentes conférences, incluant
Johannesburg, le Sommet mondial pour l'alimentation, cinq ans après,
Monterrey, Doha et Kyoto.
En relation avec le processus national de la stratégie
de réduction de la pauvreté, le programme est une manifestation
claire des engagements pris par les gouvernements africains, auxquels le
Gouvernement de la RDC a souscrit, pour développer l'agriculture du
continent.
La volonté de conduire à bon port le PDDAA a
été confirmée par la réunion des chefs d'Etat
africains tenue à Maputo au Mozambique en juillet 2003. Lors de cette
réunion, les chefs d'Etat se sont engagés à consacrer dans
les cinq années à venir, au moins 10% de leur budget pour la mise
en oeuvre de politiques de développement allant dans le sens du
PDDAA.
Par ailleurs, à l'invitation de la FAO, 18
représentants de ministres africains de l'Agriculture des pays membres
du Comité de mise en oeuvre du NEPAD et d'autres organismes (BAD, PAM,
FIDA, BM, etc.) se sont réunis le 17 septembre 2003 à Rome
pour:
Ø discuter de la mise en oeuvre du PDDAA et plus
spécifiquement, de l'approche à suivre pour analyser et
actualiser les stratégies nationales de sécurité
alimentaire et de développement agricole à long terme;
Ø préparer des programmes nationaux
d'investissements à moyen terme;
Ø et formuler des « projets bancables ».
Pour rester conforme à l'esprit de PDDAA/NEPAD et
soucieux de renforcer les actions de lutte contre la pauvreté et
l'insécurité alimentaire, le Gouvernement de la République
démocratique du Congo a adressé une requête à la FAO
pour le financement d'un appui à l'élaboration d'un Programme
national d'investissement à moyen terme (PNIMT) et d'un portefeuille de
projets bancables. Le TCP/DRC/2908 a été approuvé par le
Directeur général de la FAO en novembre 2003 et signé par
les autorités congolaises en janvier 2004.
Pour une meilleure gestion des projets dans le domaine
agricole, il est apparu indispensable de mettre sur pied un PNIMT dont les
objectifs se présentent comme suit:
Ø créer un environnement favorable à une
meilleure compétitivité du secteur agricole et rural;
Ø atteindre les objectifs quantitatifs fixés et
mobiliser les ressources nécessaires pour réaliser les
investissements correspondants;
Ø allouer au secteur des ressources du budget national
à hauteur des engagements de la déclaration de MAPUTO;
Ø et enfin créer un cadre de
référence pour le financement bilatéral et
multilatéral coordonné du secteur.
Tableau n° 02. Exemple type des dépenses
votées et exécutées au secteur agricole : fin
décembre 2011
|
Secteurs/nature
|
Budget voté
en Francs constants
|
Structure de
prévision
|
Exécution
|
Taux
d'exécution
|
|
AGRICULTURE
Dépenses de prestation
Transferts interventions de l'Etat
Equipements
Construction, réfection et réhabilitation
Autres
|
92 312,2
15 032,4
725,3
57 492,7
258,3
18 803,3
|
3%
1%
2%
0%
0%
0,0
|
30 442,0
1 182,9
860,0
12 269,0
235,5
15 892,6
|
33%
8%
119%
21%
91%
|
Source : Ministère du Budget,
Direction de Programmation et de Suivi Budgétaire, rapport annuel 2011,
p21
Ce tableau révèle une réalité qui
reste évidente jusqu'à présent. Une allocation qui est au
départ très faible avec un taux de prévision de 3%, et qui
dans l'exécution n'est pas débloquée en totalité et
tombe sur un taux d'exécution de 33% de 3%. Ce qui pose encore de
doute, car le taux d'exécution même qui est de 33% n'est pas
totalement orienté dans le secteur, car la réalité
d'antivaleurs (corruption, détournement, etc.) reste incontestable en
République Démocratique du Congo.
Tableau n°03. Evolution de l'allocation
budgétaire du secteur agricole et du développement
rural
|
TAUX D'ALLOCATION
|
|
1999
|
2000
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
3.3 %
|
2.01 %
|
2.26 %
|
4.5 %
|
2 %
|
|
TAUX D'EXECUTION
|
|
118 %
|
64 %
|
14 %
|
26 %
|
29%
|
Source : la voix du paysan congolais publication
n°min/mrpinc/lmo/046/ 2013
Soulignons que ce tableau reprend deux secteurs dont celui de
l'agriculture et du développement rural. On peut critiquer ce dernier
non seulement par le fait d'allocation d'un montant annuel à faible
taux, mais aussi d'un taux d'exécution très faible tout en
gardant à l'esprit qu'il s'agit de deux secteurs différents.
Ceci traduit la situation dans laquelle la République
démocratique du Congo par les biais de ses dirigeants a
négligé le secteur agricole et celui du développement
rural plusieurs années.
3.2.8. L'an 2014 :
Année de l'Agriculture familiale
Aujourd'hui, le gouvernement a revu ce seuil à la
hausse en donnant à l'Agriculture et au développement rural une
part qui approche le 6 % dans le budget national, soit 3 % par
secteur.
En effet, les propositions du pouvoir central atteignent
216.151.224.000 Francs Congolais pour le secteur agricole et 191 901 854 000
Francs Congolais pour le développement rural. La sommation
donne 408 053 078 000 FC pour les deux secteurs.
Soit une majoration de plus de 6% par rapport au budget 2013
qui a apporté aux deux secteurs un total de 130 998 990 842 FC, soit
moins de 3 %. Mais, trêve de jubilation, car un mauvais partage de parole
à l'Assemblée nationale peut faire basculer toute proposition et
amener les députés à revoir tout à la baisse.
Toujours est-il que, avec ces propositions gouvernementales
jamais la RDC n'a été si prête du Protocole de Maputo qui
demande aux gouvernements africains de consacrer au moins 10 % du budget
national à l'Agriculture. Ces propositions, qui devront
assurément être confirmées par les députés,
arrivent donc à point nommé en cette 2014 proclamée
année de l'Agriculture familiale.
Cette aubaine budgétaire devra booster le secteur
agricole surtout au moment où le gouvernement a enclenché les
mécanismes de campagne agricole qui ne donne pas encore des signes de
vitalité. Encore en discussion au Parlement, le budget 2014 se propose
donc à réserver une bonne portion au secteur agricole.
Mais au-delà de tous les optimismes, il y a aussi la
question de l'application effective de la loi budgétaire. Car, souvent
la totalité de fonds ne sont pas débloqués et ce qui est
débloqué est affecté à autre chose. Il est bon que
la gestion des ces affectations soit confié totalement au ministre de
l'Agriculture et mettre en place les mécanismes de suivi de
l'utilisation de ces fonds.
3.2.9. Déficit
d'exploitation
Selon le rapport de l'Institut National des statistiques
(INS), la RDC exploite 10% de son potentiel de terres arables. Sur le 80
maillons d'hectares de terres arables, seulement 8 millions d'hectares sont
exploitées.
Selon la même source, 3% de ce potentiel sont
utilisés pour les cultures et 7% pour l'élevage. Mais avec ces
potentiels exploités, le pays peut couvrir l'ensemble de ses besoins
alimentaires. Ce pendant, les 10% de ce potentiel ne sont pas convenablement
exploités. Plusieurs facteurs empêchent la meilleure exploitation
de ce potentiel dont notamment le faible pourcentage du budget
alloué chaque année au secteur de l'agriculture.
Selon des normes internationales auxquelles la RDC a
souscrit, le secteur de l'agriculture devrait bénéficier de 10%
du budget national, comme pour l'année 2011 par exemple, le
Ministère de l'agriculture pêche et élevage attendait 200
milliards des francs congolais (217 391 304 $US) ; mais il n'a
reçu que 92 milliards (100 000 00 USD), soit en moyenne 40% du
budget qui lui était alloué.
3.2.10. Quelle loi pour la
relance agricole
Le 28 octobre 2009, un projet de loi portant Code agricole en
République démocratique du Congo. Ledit projet fut
approuvé fin 2008 par le gouvernement, ce document, qui définit
la politique nationale en matière d'agriculture et de
sécurité alimentaire, a pour objectif essentiel la relance
agricole en faisant de ce secteur un pôle économique de
développement.
Il est axé sur la nécessité de soutenir
les efforts de la RDC en vue de la réalisation du premier Objectif du
millénaire pour le développement, à savoir la
réduction de moitié, à l'horizon 2015, du nombre de
sous-alimentés et de pauvres.
À travers le Code agricole, l'Etat entend « lever
les options claires et formuler un projet de développement pour les 30
prochaines années en mettant en place des conditions incitatives de
développement, notamment le refinancement de l'économie agricole
et des infrastructures, la formation continue de la jeunesse en techniques
agricoles. » Le gouvernement voudrait aussi faire du Code agricole «
un cadre cohérent de référence et un outil d'aide à
l'action » à la disposition de l'ensemble des acteurs.
Ce Code poursuit, par ailleurs, plusieurs objectifs
particuliers et diversifiés : développement de l'encadrement des
paysans, équité dans la répartition et l'accès aux
terres, réduction des pressions fiscales et policières,
incitation des entités décentralisées à s'impliquer
dans le développement communautaire, relance du crédit agricole,
etc.
Une autre loi portant principes fondamentaux relatifs à
l'agriculture du décembre 2011 vient compléter et enrichir le
code agricole du 28 octobre 2009. Elle prend en compte les objectifs de la
décentralisation, intègre à la fois les diversités
et les spécificités agro-écologiques et vise à :
· favoriser la mise en valeur durable des
potentialités et de l'espace agricole intégrant les aspects
sociaux et environnementaux ;
· stimuler la production agricole par l'instauration d'un
régime douanier et fiscal particulier dans le but d'atteindre, entre
autres, l'autosuffisance alimentaire ;
· relancer les exportations des produits agricoles afin
de générer des ressources importantes pour les investissements
;
· promouvoir l'industrie locale de transformation des
produits agricoles ;
· attirer de nouvelles technologies d'énergie
renouvelable ;
· impliquer la province, l'entité territoriale
décentralisée et l'exploitant agricole dans la promotion et la
mise en oeuvre du développement agricole40(*).
Aussi, cette loi apporte-t-elle d'importantes innovations
notamment par :
· la création d'un Fonds national de
développement agricole et sa gestion en synergie avec les institutions
financières bancaires et non bancaires ;
· l'implication des agriculteurs et des professionnels du
secteur agricole dans le processus décisionnel ; ce qui justifie la
création du Conseil consultatif aussi bien au niveau national,
provincial que local ;
· la prise en compte des exigences des instruments
internationaux relatifs à la conservation et à l'utilisation des
ressources phytogénétiques;
· la prise en compte de la protection de l'environnement
;
· le renforcement du mécanisme de surveillance des
terres destinées à l'exploitation agricole et le suivi de la
production ;
· l'institution d'une procédure de conciliation
préalable à toute action judiciaire en matière de conflits
de terres agricoles.
3.2.11. Points forts de la
nouvelle vision
La nouvelle politique agricole de la RDC a l'avantage d'avoir
bénéficié, pour son élaboration, de la
participation d'un large éventail de partenaires du secteur. Aux
politiques et experts gouvernementaux se sont joints des chercheurs
indépendants, des opérateurs économiques du domaine, des
coopératives et autres organisations associatives, des
représentants, des partenaires bi- et multilatéraux (FAO,
Coopération technique belge, etc.).
L'ensemble du processus a connu une implication constante de
ces partenaires qui, auparavant, avaient produit la Note de politique agricole
rassemblant les données essentielles et esquissant des objectifs et
pistes de solution aux défis de la relance agricole pour la
sécurité et la souveraineté alimentaires.
Le gouvernement a démontré ses bonnes
dispositions. En effet, dans sa déclaration en rapport avec la Note de
politique agricole, il se dit prêt à « créer des
richesses en milieu rural, par une agriculture compétitive reposant sur
la promotion des petites et moyennes entreprises agricoles et d'élevage
animées par des professionnels », en référence aux
attentes et au rôle dévolu au secteur agricole dans le Document de
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP),
rédigé en collaboration avec le Fonds monétaire
international et la Banque mondiale.
D'autre part, prenant en compte le principe de
libéralisme et de la subsidiarité, l'état se
désengage des fonctions de production et de commercialisation pour se
concentrer sur le contrôle, la planification, la collecte, la production
et la diffusion des informations utiles à la production et à
l'organisation des circuits de commercialisation, de façon à
favoriser une concurrence loyale entre acteurs. Pour assurer un meilleur suivi
des initiatives dans les entités décentralisées, il est
prévu la mise en place des structures du Conseil agricole rural de
gestion (CARG).
3.2.12. L'accès
à la terre grâce au Code agricole
Celui-ci a pour but d'organiser l'encadrement du paysannat et
la structuration en coopératives, de diffuser les éléments
de la loi et vulgariser le Code agricole, de sécuriser les structures
juridiques du paysannat et des coopératives, de limiter les taxes et les
tracasseries et de sécuriser la propriété
foncière.
Pour assurer une exploitation agricole rentable, il est aussi
prévu d'assurer la formation à travers la création des
écoles agricoles et des écoles artisanales. Ces structures seront
chargées de la formation continue en gestion financière des
micro-entreprises, de la comptabilité prévisionnelle, etc.
Enfin le CARG assurera la constitution et la gestion d'un
fonds d'appui financier ou de garantie. Ce fonds devra être
financé, non pas seulement par le gouvernement, mais aussi par une
partie des taxes de promotion industrielle, culturelle ou touristique, des
intérêts provenant de microcrédits, des taxes sur les
produits agricoles et des taxes sur l'exploitation ou l'exportation de
richesses non renouvelables.
Conclusion partielle
La partie qui s'achève s'est articulé sur deux
grands points à savoir : les finances publiques et l'agriculture en
République démocratique du Congo. L'articulation globale de cette
étude portait sur tous les défis pris en compte et
intégrés dans les réponses à y apporter.
Il s'agit, notamment, des allocations des ressources publiques
dans le secteur agricole, la valorisation de terres à destination
agricole, de l'énergie, des infrastructures, de la formation et la
recherche agricole, du crédit agricole, des régimes douanier,
fiscal et parafiscal, de législation en matière agricole, etc.
Ceci étant, nous passons au chapitre suivant qui nous
amènera à analyser l'apport de ces efforts déjà
épinglés sur la croissance économique en RDC.
Chapitre
Quatrième :
L'APPORT DU SECTEUR
AGRICOLE DANS LA CROISSANCE ECONOMIQUE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Il y a plusieurs raisons pour justifier le choix du secteur
agricole comme pilier du décollage économique de la
République Démocratique du Congo (RDC). Premièrement, en
dépit de la croissance soutenue que réalise l'économie
congolaise depuis quelques années, l'incidence sur la réduction
de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire, est
à peine perceptible. En majeure partie, ceci s'explique par le fait que
la croissance actuelle provient essentiellement des Mines, de la Construction
et des Services (Banques, Télécommunications, etc.) qui emploient
une proportion plutôt faible de la population congolaise limitant ainsi
les effets en termes de revenu.
Le gouvernement ne peut donc compter que sur des
mécanismes de transfert pour arriver à redistribuer les effets
d'une croissance provenant des secteurs utilisant une faible proportion de la
population. Il et évident que le gouvernement congolais ne dispose pas
encore de capacités pour mettre en place des tels mécanismes ;
d'où la nécessité d'ancrer l'économie à un
secteur ayant un potentiel élevé en termes d'effets
d'entraînement non seulement sur les ménages, mais aussi sur les
autres secteurs de l'économie nationale.
La deuxième raison tient à l'impératif de
transformation de l'économie congolaise à l'instar des pays
émergents.
En effet, dans la plus part des économies
sous-développées, l'agriculture et pratiquement le secteur le
plus important, car elle contribue entre 40 et 60% du revenu national et
emploie entre 40 et 80% de la population active41(*). La transformation structurelle dans ce cas doit
être axée sur l'agriculture, à condition bien en tendu que
la principale contrainte à son développement, à savoir,
l'utilisation des ressources à des niveaux de productivité
très faibles soit éliminée. En effet, une croissance
accélérée de la productivité agricole et capable de
booster l'industrialisation de l'ensemble de l'économie, car non
seulement elle facilite le transfert de ressources vers d'autres secteurs, mais
favorise également l'accélération de la croissance dans
d'autres secteurs.
4.1. EVOLUTION DE LA
CROISSANCE DANS LE MONDE
Il nous est impérieux de commencer par
décortiquer et analyser la croissance économique
réalisée dans le monde et en République
Démocratique du Congo.
Tableau n°04. Evolution de la croissance
mondiale (en pourcentage)
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
Production mondiale
|
5,2
|
3,9
|
3,2
|
3,0
|
3,1
|
|
Pays avancés
|
3,2
|
1,6
|
1,3
|
1,3
|
1,2
|
|
Pays émergents et en développement
|
7,3
|
6,3
|
5,1
|
5,0
|
5,2
|
|
Afrique subsaharienne
|
5,3
|
5,3
|
4,8
|
4,9
|
4,7
|
Source : banque centrale du Congo, rapport annuel 2013,
p18
Graphique n°02. Evolution de la croissance
mondiale (en pourcentage)
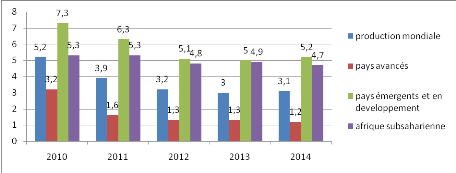
Source : élaboré sur base des
données du tableau n°07
De 2010 à 2014 la situation indiquée dans ce
tableau et reprise dans sous forme de graphique ci-haut, montre que la
croissance économique mondiale en pourcentage se présente
progressivement à une courbe galopante c'est-à-dire que d'une
année à l'autre nous constatons de montée et descente
même si cela n'est pas conforme en baisse ou en hausse.
Les économies émergentes ont été
les moteurs de l'expansion mondiale qui a suivi la crise économique. A
l'inverse la croissance dans les pays les plus avancés se poursuit
à un rythme modéré et est souvent trop faible pour
réduire le chômage de manière significative".
Cette croissance reste en outre sujette à des risques,
citant notamment la cherté des prix des produits alimentaires et des
matières premières, qui pourrait entraîner des tensions
politiques et sociales dans les pays en développement.
La croissance mondiale est distribuée
inégalement. La différence des chemins de croissance des nations
implique des inégalités entre les pays. Il y a aussi une
augmentation des inégalités dans chaque pays.
Les évolutions technologiques liées à la
croissance semblent favoriser l'embauche de travail qualifié et forcent
à des réductions d'emplois dans les secteurs en déclin.
Contrairement aux sociétés animales (de fourmis
ou d'abeilles1), les sociétés humaines connaissent depuis
approximativement 200 ans la croissance économique, elles s'enrichissent
: Non seulement au cours du temps elles produisent de plus en plus, mais la
production augmente plus vite que la population. Le problème à
expliquer n'est pas l'augmentation de la production mais l'augmentation du PIB
par tête, ou encore l'augmentation de la productivité.42(*)
4.2. SITUATION ECONOMIQUE
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE CONGO DE 2010 A 2014
4.2.1. L'activité
économique intérieure 2010
Après s'être ressenti des effets de la crise
financière et économique internationale en 2009,
l'activité économique intérieure s'est nettement
consolidée attestée par une croissance établie à
7,2 % contre 2,8 % une année plutôt, sous l'impulsion notamment de
la production minière influencée par l'embellie des cours des
matières premières sur le marché mondial.
a. Le taux d'inflation 2010
S'agissant de l'inflation, le rythme de formation des prix
intérieurs sur le marché des biens et services a sensiblement
baissé par rapport à l'année 2009. En effet, l'inflation
annuelle s'est située à 9,8 % contre une réalisation de
53,4 % une année auparavant et un objectif de 9,9 %. Sur l'ensemble de
l'année, les prix ont progressé de manière discontinue
à travers trois phases caractérisées par :
- des évolutions erratiques sur fond de fortes
poussées inflationnistes au cours de deux premiers mois de
l'année,
- une relative stabilité entre mars et août et
- un retour des tensions à partir du mois de septembre
à cause des effets conjugués de l'excès de
liquidité et du renchérissement de principaux produits de grande
consommation sur le marché international.
b. Les finances publiques de 2010
En ce qui concerne les finances publiques, elles ont
été marquées par la poursuite de mesures d'ajustement
budgétaire prises par le gouvernement depuis la fin de l'année
2009. Ces mesures ont contribué à obtenir des résultats
satisfaisants en vue de l'atteinte du point d'achèvement.
En outre, dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures
contenues dans le plan stratégique de la réforme des finances
publiques, le Gouvernement a pris l'option de moderniser le cadre
législatif régissant les finances publiques. A ce titre, le
projet de loi portant code des douanes et celui de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée ont été adoptés au Parlement et
promulgués par le Chef de l'Etat.
c. Le secteur extérieur 2010
Pour ce qui est du secteur extérieur,
l'évolution du taux de change a été
caractérisée par une relative stabilité traduite par une
dépréciation de 1,4 % du cours indicatif contre celle de 29,2 %
en 2009.
L'analyse infra-annuelle révèle les constats
ci-après :
- une dépréciation au terme de deux premiers
mois de l'année faisant suite essentiellement au phénomène
cyclique lié au besoin de reconstitution des encaisses en devises par
les opérateurs économiques après les festivités de
fin d'année.
- une stabilité entre les mois de mars et septembre
2010, due à l'amélioration de la coordination des politiques
macroéconomiques et l'amélioration de la position nette du
Gouvernement ;
- une nouvelle dépréciation au dernier
trimestre, induite par la résurgence des déficits publics,
lesquels se sont traduits par un accroissement des besoins des banques en
devises.
Par ailleurs, les réserves internationales ont
été confortées et portées à 7,7 semaines
d'importations des biens et services à fin décembre et une
amélioration des comptes extérieurs de la RDC a été
observée.
Quant au secteur monétaire, en dépit des
tensions sur la liquidité observées aux premiers et derniers
trimestres, les objectifs de la politique monétaire ont tous
été atteints. Le dispositif de la politique monétaire a
été assoupli à plusieurs reprises au cours de
l'année.
En effet, la situation monétaire a été
caractérisée par une croissance modérée de l'offre
de la monnaie centrale et de la masse monétaire. L'expansion de la base
monétaire a été inférieure à celle
programmée, soit 29,6 % d'augmentation contre une expansion
prévisionnelle de 31,0 %. La masse monétaire a connu une
augmentation de 30,1 % contre une cible de 40,3 %.
4.2.2. L'activité
économique intérieure 2011
L'activité économique est demeurée
vigoureuse en 2011, en dépit de son léger ralentissement par
rapport à l'année 2010. En effet, le taux de croissance du PIB
réel s'est établi à 6,9 % contre 7,1 % une année
avant, stimulé essentiellement par le regain dans les secteurs des
mines, de la construction, de l'agriculture ainsi que du commerce de gros et de
détail.
a. Le taux d'inflation de 2011
S'agissant du rythme de formation des prix intérieurs
sur le marché des biens et services, l'année 2011 a connu une
inflation de 15,4 % contre 9,8 % en 2010 et une cible annuelle de 17,0 % dans
le cadre du Programme Economique du Gouvernement (PEG II).
L'accélération de l'inflation enregistrée en 2011 est due
essentiellement aux chocs extérieurs liés à
l'envolée des prix mondiaux des produits alimentaires et
énergétiques.
b. Les finances publiques 2011
Les finances publiques ont été principalement
marquées en 2011 par la réapparition du déficit du
Trésor, à la suite de l'expansion des dépenses
liées notamment au processus électoral.
c. Le secteur extérieur 2011
En ce qui concerne le secteur extérieur, il s'est
globalement observé une stabilité relative de la monnaie
nationale sur le marché des changes. La balance commerciale du pays
s'est sensiblement améliorée suite au bon comportement des cours
des matières premières sur les marchés mondiaux.
Néanmoins, le niveau des réserves internationales a
légèrement baissé à la suite de la forte
consommation des devises.
Cette situation aurait été pire n'eut
été les achats des devises par la Banque Centrale.
d. Le secteur monétaire 2011
Pour ce qui est du secteur monétaire,
la situation à fin décembre 2011 présente un
dépassement de la base monétaire par rapport à la
programmation. Cependant, le taux d'inflation ainsi que la masse
monétaire sans provisions ni dépôts en devises sont
demeurés sous contrôle.
S'agissant du comportement des instruments de politique
monétaire, la BCC a durci, en début d'année 2011, sa
politique monétaire par le relèvement du taux directeur en
janvier 2011, suite aux tensions observées sur les
principaux marchés. Par la suite, la
Banque a assoupli cette politique par la révision,
à deux reprises, du taux directeur au second semestre, du fait du
ralentissement de l'inflation. Cette baisse du taux directeur a induit la
réduction de sa marge de positivité par rapport à
l'inflation. Par ailleurs, le coefficient de la réserve obligatoire est
resté inchangé.
4.2.3. L'activité
économique 2012
L'activité économique en République
Démocratique du Congo a poursuivi son expansion, dans un contexte de
ralentissement de la croissance économique mondiale. En effet, le taux
de croissance du PIB s'est établi à 7,2 % contre 6,9 %
l'année précédente. Cette croissance a été
impulsée par la performance des secteurs des mines, du commerce de gros
et de détail, des bâtiments et travaux publics ainsi que de
l'agriculture.
a. Le taux d'inflation 2012
Sur le marché des biens et services, il a
été enregistré un taux d'inflation de 2,72 % sur
l'ensemble du territoire national face à un niveau programmé de
9,90 % retenu dans le cadre du Programme Economique du Gouvernement. Ce taux
d'inflation est sensiblement faible en comparaison à ceux
observés dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne.
b. Les finances publiques 2012
Les opérations financières de l'Etat se sont
clôturées par un excédent budgétaire
représentant 2,5 % du PIB. Ce solde résulte essentiellement
d'importants ajustements à la baisse des dépenses
budgétaires dont le taux d'exécution n'a atteint que 51,0 %.
Ce faible taux d'exécution des dépenses
publiques est partiellement expliqué par l'adoption tardive du budget
2012 qui a retardé la planification des projets, le lancement des
marchés publics et les engagements financiers.
c. Le secteur extérieur 2012
En ce qui concerne le secteur extérieur, il s'est
observé la poursuite de la stabilité de la monnaie nationale sur
le marché des changes. La balance des paiements s'est sensiblement
améliorée suite au bon comportement du compte capital et
opérations financières. Cette situation a induit des flux
importants des devises ayant conduit l'autorité monétaire
à accroître ses interventions à l'achat des devises.
d. Le secteur monétaire 2012
Au plan monétaire, la Banque Centrale du Congo a
poursuivi l'assouplissement de sa politique. Elle a revu successivement
à la baisse son principal taux de référence, lequel est
passé de 20,0 % à fin décembre 2011 à 4,0 %
à fin décembre 2012. Néanmoins, dans le cadre de sa
stratégie de prudence, elle a maintenu le coefficient de la
réserve obligatoire à 7,0 % dans un contexte de
flexibilité du Billet de trésorerie.
Cette orientation stratégique, laquelle a
bénéficié du renforcement de la coordination des
politiques macroéconomiques, s'est traduite par la réalisation de
toutes les cibles de la politique monétaire au cours de la
période sous revue. En effet, les prix à la consommation ont
connu un ralentissement notable. Aussi, l'offre de monnaie est globalement
demeurée sous contrôle. En effet, le stock monétaire et la
base monétaire ont été contenus en deçà de
leurs cibles annuelles.
4.2.4. Activité
économique 2013
L'économie est restée vigoureuse en 2013 avec
une croissance de 8.1 % (contre 7.2 % en 2012), grâce aux industries
extractives, mais aussi au commerce, à la construction et
l'agriculture.
La croissance a bénéficié de
l'amélioration de certains éléments du climat des
affaires, de la reconstruction des infrastructures et d'une demande soutenue.
L'exploitation minière a constitué le principal levier de
croissance. Plusieurs sociétés minières sont
passées de la phase d'exploration à celle de l'exploitation
depuis 2013.
La rationalisation des politiques macroéconomiques et
la stabilité des cours des produits de base a permis de contenir
l'inflation, qui s'est située à 1.1 %, contre 2.7 % en 2012 et
une cible de 4 % en 2013.
Le taux de change s'est faiblement
déprécié (0.3 %). La bonne coordination des politiques
budgétaire et monétaire et le rebond des recettes d'exportation
ont par ailleurs accru les réserves de change de la Banque centrale du
Congo. Ces dernières sont passées de 1 213.7 à 1 766.45
millions CDF (francs congolais) de 2012 à 2013, couvrant 9.4 semaines
d'importation.
4.2.5. Activité
économique 2014
Les indicateurs macroéconomiques se sont
consolidés durant la période sous étude et sont verts,
mais la situation sociale demeure préoccupante.
Le marché du travail reste très exigu et les
salaires réels n'augmentent pas.
La malnutrition, qui sévit fortement, est l'une des
principales causes de mortalité. Beaucoup d'enfants restent en dehors
d'un système éducatif dont la qualité pose par ailleurs
problème. Le défi majeur du pays consiste à mettre
l'économie au service du développement humain.
Ceci étant, nous nous donnons le devoir de
redéfinir la croissance économique et de montrer sa mesure avant
de poursuivre.
Graphique n°03: Croissance du PIB réel
par habitant (en pourcentage) en RDC

Source : banque centrale du Congo, rapport annuel 2013,
p.6.pdf
La situation graphique ci-dessus illustre qu'à partir
de 2010 jusqu'à 2014 le PIB en RDC a connu des mouvements de
récession et d'ascension. D'où le taux qui était de 7,2%
en 2010 a connu une simple baisse ou une récession pour constater de
2011 à 2012 une ascension progressive jusqu'en 2014.
Comme nous le présente la courbe de taux de croissance
du revenu réel par tête d'habitant tracée dans ce
graphique. C'est-à-dire que même si les conditions sociales de la
population congolaise demeurent précaires, mais la croissance
économique en République Démocratique du Congo est bien
certaine selon les rapports des institutions habilitées en la
matière.
4.2.6. L'agriculture et la
croissance économique43(*)
La croissance agricole a préludé aux
révolutions industrielles qu'a connues le monde tempéré,
depuis l'Angleterre au milieu du XVIIIème siècle jusqu'au Japon
à la fin du XIXème siècle. Plus récemment, en
Chine, en Inde et au Viêt Nam, une croissance agricole rapide a
précédé le développement de l'industrie.
L'accroissement de la productivité agricole qui a
entraîné un surplus agricole (en partie taxé pour financer
le développement industriel) et permis une baisse des prix de
l'alimentation a été à la base des succès de la
transformation structurelle.
Le paradoxe dans cette transformation est qu'une croissance
agricole plus forte était nécessaire pour stimuler la croissance
économique en général, ce qui a ensuite causé le
déclin de la part du secteur agricole dans le produit intérieur
brut (PIB).
Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, la croissance
agricole peut-elle toujours déclencher une croissance globale ?
Quelles sont les mesures essentielles pour accélérer la
croissance agricole et lui permettre de remplir son rôle
économique en RDC ? Telles sont les questions que traite le
présent chapitre.
4.2.7. Raisons de
déclencher la croissance par le secteur agricole
a. Un vaste secteur
Dans les pays à faible revenu au début de leur
transformation, la part importante de l'agriculture dans le PNB laisse à
penser qu'une forte croissance de l'agriculture est nécessaire à
une croissance économique.
De fait, l'agriculture a été à l'origine
d'environ un tiers de la croissance en Afrique subsaharienne ces quinze
dernières années. Avec l'augmentation du PNB par habitant, la
part de l'agriculture dans le PNB régresse, de même que sa
contribution à la croissance, même si ce secteur peut rester
important dans certaines régions de pays plus développés,
comme dans l'État du Bihar en Inde ou dans plusieurs États du
Brésil.
b. Réduction des prix
alimentaires
Dans nombre de pays d'Afrique subsaharienne, la
commercialisation des produits alimentaires est imparfaite à cause de la
prévalence des denrées alimentaires de première
nécessité qui sont peu commercialisées au niveau
international, c'est le cas notamment des racines, des tubercules et des
céréales locales.
Même pour les aliments qui sont largement
commercialisés au niveau mondial, une grande partie de l'économie
alimentaire nationale demeure isolée des marchés internationaux
en raison du coût élevé du transport et de la
commercialisation, en particulier dans les arrière-pays ruraux et les
pays enclavés. Dans ces pays, la productivité agricole
détermine le prix des aliments, qui détermine à son tour
le niveau des salaires et la capacité concurrentielle
générale. La productivité concernant les denrées
alimentaires de première nécessité est donc la clé
de la croissance.
c. Avantage comparatif
La plupart des pays d'Afrique subsaharienne
dépendent d'un portefeuille différent de produits primaires
exportés bruts ou transformés (y compris dans le secteur minier
et le tourisme).
Pendant de nombreuses années, l'Afrique subsaharienne
gardera un avantage comparatif pour les activités primaires et la
transformation des produits agricoles du fait de ses richesses naturelles
favorables à l'agriculture, de l'absence de main-d'oeuvre
qualifiée et d'un climat d'investissement difficile qui limite la
compétitivité des biens manufacturés.
d. Relations entre différentes formes de
croissance
La croissance agricole est très fortement liée
à d'autres secteurs économiques. Lorsque les revenus agricoles
sont dépensés pour acheter des biens et des services non
commercialisables produits au niveau local, cela stimule la demande en produits
industriels et en services au niveau local. Cela favorise ainsi la croissance
de la production agricole et de la commercialisation des denrées
alimentaires, ainsi que la hausse de la demande en produits et en services
intermédiaires.
4.2.8. Constats et
analyses
La RDC dispose d'un potentiel agricole énorme,
grâce à ses conditions climatologiques et hydrologiques et la
disponibilité de plus de 80 millions d'hectares de terres cultivables,
dont seulement 10 millions sont aujourd'hui mises en valeur. L'agriculture
occupe plus de 75% des Congolais, mais la performance a connu une
détérioration depuis déjà 30 ans,
caractérisée par une chute libre des exportations de produits
agricoles et une baisse de la production vivrière avec près de
20%, résultant en une situation d'insécurité alimentaire
et monétaire qui touche aujourd'hui plus de 70% de la
population44(*).
La relance de l'agriculture est aujourd'hui freinée par
la faible gouvernance du secteur, qui est une contrainte essentielle pour
dépasser le niveau de l'agriculture de subsistance et la gestion de la
précarité et des conflits. Les dynamiques et pratiques actuelles
ne sécurisent pas les investisseurs, les producteurs ou les
commerçants ; elles rendent difficiles l'accès aux intrants, au
capital, aux compétences techniques et conseils et aux marchés.
Dans ce contexte, le métier de l'agriculture (et ses
métiers connexes) n'attire pas les jeunes ou les plus dynamiques, et
ceux qui sont contraints de l'appliquer évitent de prendre des risques,
limitent leur production aux besoins du marché local et n'investissent
pas dans une croissance durable de leur activité.
Cette faible gouvernance est liée, entre autres,
à :
- des facteurs juridiques et politiques : un cadre
législatif encore incomplet, un portage politique très partiel
des réformes et de la priorisation affichée du secteur, un
chevauchement des attributions entre ministères et entre le niveau
central et le niveau décentralisé, une démarche de
décentralisation qui est encore très timide, une faible
application des textes réglementaires...
- des services publics qui ne sont pas à même
d'offrir un encadrement adéquat au monde rural, dû, d'une part,
à l'absence totale d'une politique ou praxis de valorisation des
ressources humaines, d'équipement ou de moyens de fonctionnement, mais,
d'autre part, encore renforcé par une érosion des valeurs dans
plusieurs services, ainsi que par l'ambiguïté de leur rôle
comme régulateur, encadreur, mais aussi percepteur de taxes.
- la généralisation des tracasseries, taxes et
impôts, de façon arbitraire, par une multitude de services qui ne
semblent soumis à aucun règlement précis et connu, ni
à un contrôle adéquat ou un régime disciplinaire.
- la faible structuration du monde paysan et de la
société civile en général, etc.
Les engagements de l'Etat, ainsi que des bailleurs, pour
renforcer cette gouvernance sont encore disparates, peu concertés et
faiblement soutenus dans leur mise en oeuvre. Les dispositifs d'harmonisation
et d'alignement sont peu fonctionnels, tant au niveau national que
provincial.
Quelques dynamiques ou opportunités de changement
commencent à se mettre en place, mais elles sont encore très
fragiles. On pense entre autres à la genèse des CARG, à
l'adoption récente du Code agricole ou à l'exercice de
programmation dans le cadre du PDDAA.
Transformer ce système de gouvernance, qui est
aujourd'hui un frein pour l'agriculture, vers une culture et une praxis de
gouvernance qui impulsent et encadrent l'agriculture, est donc un défi
majeur et une condition essentielle pour une relance durable et
équitable du secteur.
4.3. L'APPROCHE
D'INCIDENCE DU SECTEUR AGRICOLE DANS LE PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB)
4.3.1. Evolution du PIB
Selon cette approche, l'analyse de la croissance
révèle que la fermeté de l'activité
économique en RDC a été principalement acquise grâce
à la robustesse des secteurs primaire et tertiaire, lesquels ont
contribué à la croissance et 3,0 points respectivement comme nous
l'avons dit.

Source : réalisé à partir des
données de la BCC
Dans
la période sous-étude, ce graphique indique la part ou la
contribution du secteur agricole dans la formation du produit intérieur
brut en République Démocratique du Congo. En 2010 et 2011, la
part du secteur agricole était identique soit 1,1%, mais en 2012 et 2013
sa contribution a connu une pente descendante respectivement de 1.04% et 0.8%.
C'est en 2014 qu'il y a eu une légère performance et la part du
secteur agricole dans le PIB a atteint une fois de plus le 1%.
4.3.2. Sous-branche
agriculture
Les deux dernières années, dont 2013 et 2014
cette sous-branche s'est manifestée comme contributeur au PIB en
établissant à 103,2 points contre 102,7 une année
auparavant. La production agricole vivrière quant à elle a
pesée pour 96,3% dans l'ensemble de la production agricole.
Actuellement retenons que cette branche fait et pourrait faire
de plus grâce aux actions engagées par l'Etat congolais au plan
national à travers les différentes campagnes agricoles en vue
d'améliorer la sécurité alimentaire et de renforcer la
vigueur des filières d'exportation.
4.3.3. Sous-branche agricole
vivrière
Il est aussi vraie que cette sous-branche contribue au PIB
comme l'indice d'activité agricole vivrière nous a
renseigné un accroissement acquis en 2013 de 4,3% tel que
rapproché à celui de 2012, en liaison essentiellement avec la
hausse de la production des oléagineuses (2,6%). Quelques soit cette
baisse au niveau de certaines productions, notamment les fruits (2,2%) et les
céréales (2,0%).
4.3.4. Sous-branche culture de
rente
De celle-ci appelée aussi « cultures
d'exportation » contribue avec un indice important d'activité,
comme en 2014 de l'ordre de 102,4 points contre 101,7 points en 2013. Quelque
soit une faible progression de 0,7%.
Dans la même perspective nous avons trouvé que
certains produits de la culture de rente ont accusé des variations
positives en 2013 et 2014, en l'occurrence les oléagineux (27,1%), le
café robusta (21,5%), le café arabica (8,2%), les légumes
(0,4%) et les huiles de palmistes (53,2%), en raison notamment des efforts
déployés par l'Etat pour soutenir le rendement dans ce secteur.
Quelque soit l'inscription de nouveau en baisse des certaines productions entre
autres celles de cacao et de caoutchouc, respectivement de 0,7% et 16,3%,
principalement imputable au vieillissement et au manque d'entretien des
plantations.
4.3.5. Sous-branche
forêt
Selon la réalité retrouvée dans cette
sous-branche, l'indice d'activité dans la sylviculture a connu un
accroissement de 4,8% en 2013 par rapport à son niveau de 2012. Cela
veut dire que la production de bois de chauffage et celle de charbon de bois
ont enregistré des accroissements respectifs de 4,9% et 3,1% atteignant
78.980,0 tonnes et 3.039,0 tonnes. Les évolutions notées sont
consécutives à l'accroissement de la demande de ces produits par
les ménages pour pallier le déficit en fourniture de
l'énergie électrique45(*).
4.3.6. Sous-branche
élevage, pêche et chasse
De cette dernière, l'indice d'activités persiste
contributeur au PIB comme le rapport de la Banque centrale du Congo nous a fait
voir que celui-ci s'était accru de 4,1% en 2013 et celui qui
s'était établi à 117,7 points contre 113, 1 points en
2012.
Quant à l'élevage, les bonnes techniques et
pratiques sont utilisées afin de relever cette sous-branche, quant bien
même le niveau de production de certains bétails s'est affaibli,
notamment les bovins (0,3%), les ovins (0,2%), les caprins (0,1%) et les
porcins (0,2%).
A la pêche et chasse, notons que ces dernières
contribuent à leurs tours avec des évolutions positives dont la
production de poissons frais et celle de gibier se sont accrues respectivement
de 6,2% et 2,7%.
4.4. LA PREVISION
BUDGETAIRE AU SECTEUR AGRICOLE
Les échecs que connaît l'incidence du secteur
agricole dans la formation du produit intérieur brut en
République Démocratique du Congo sont complexes. Ces
échecs tirent ses origines sur une chaîne d'organisation,
c'est-à-dire qu'en commençant par l'élaboration du budget,
l'exécution du budget, la gestion des fonds alloués au secteur,
etc.
4.4.1. L'allocation
budgétaire à l'agriculture
Nous référant au tableau n°06, nous avons
constaté qu'au départ, le montant alloué au secteur
agricole est minime pour booster le secteur. Faire du secteur agricole un
levier de la croissance économique en RDC dépendra de
l'importance que donneraient les gouvernants à l'agriculture dans
l'élaboration du budget.
L'agriculture est la base de l'économie congolaise. Sa
part dans le revenu national a atteint jusqu'à 50% dans les
années 1990, en partie à cause de l'effondrement des autres
secteurs de l'économie (secteur minier en particulier).
Depuis la restauration de la paix en 2002, cette part a
graduellement baissé, mais le secteur agricole fournissait encore 40,3%
du PIB (contre environ 13% pour le secteur minier) et employait les trois
quarts de la population active en 2006.
De toutes les sources de croissance, le secteur agricole a le
plus fort potentiel de réduction de la pauvreté. Tout d'abord, il
est intensif en main d'oeuvre. Pour ne mentionner qu'une filière, la
production d'arabica requiert 450 jours de travail soit deux emplois agricoles
à plein temps à l'hectare, y compris la production et les
activités en aval. C'est donc 20 000 emplois a plein temps que
créerait la mise en production de 10 000 ha supplémentaires et,
donc, des revenus pour environ 160 000 personnes. Il en est de même pour
le palmier à huile et la plupart des autres cultures industrielles. Ces
emplois sont, de plus, créés à un coût très
faible.
En second lieu, les revenus agricoles tendent à
être dépensés sur des biens et services produits
localement, ce qui a un effet multiplicateur important sur l'économie
locale. Enfin, la croissance de la productivité agricole réduit
les prix des denrées alimentaires, fournissant ainsi des transferts
invisibles à l'ensemble de la population et aux autres secteurs de
l'économie. Ainsi, on a constaté que la croissance des revenus
ruraux réduisait non seulement la pauvreté rurale mais encore la
pauvreté urbaine (alors que l'inverse n'est pas vrai)
La productivité agricole a connu une baisse constante
depuis un demi-siècle et la régression des cultures
pérennes/industrielles (café, cacao, thé,
hévéa, palmier a huile, coton) a été spectaculaire.
Au moment de l'Indépendance, le Congo était le deuxième
exportateur d'huile de palme du monde, après la Malaisie mais devant
l'Indonésie.
Aujourd'hui le pays en importe plus de 50 000 tonnes. La RDC
était aussi le premier producteur africain de coton avec plus de 180 000
tonnes de graines produites par 800 000 petits producteurs : la production
de coton a pratiquement disparu aujourd'hui (moins de 6 000 t/an). De
même, les productions d'hévéa, d'arabica, de robusta et de
thé ont toutes chuté de façon spectaculaire.
Cette sous-utilisassion des ressources naturelles du pays et
corollairement des ressources humaines représentent à la fois un
immense gaspillage et un gisement d'accroissement de la production très
important, pourvu que les capacités soient recréées pour
que les producteurs puissent répondre aux besoins du marché.
Depuis 2012, le gouvernement s'est lancé dans la mise
en oeuvre des politiques de soutien au secteur agricole à travers le
financement de la campagne agricole, la relance du Domaine Agro-industriel
Présidentiel de la N'Sele (DAIPN) et le développement progressif
des parcs agro-industriels dans les différentes provinces du pays.
Dans le cadre de la campagne agricole, les appuis ont
porté sur le recrutement des moniteurs agricoles pour accompagner les
activités culturales et leur préparation ainsi que sur les
interventions dans les provinces à concurrence de 21 milliards de francs
congolais46(*). Toutes les
provinces bénéficiaires ont validé ces interventions
affectées à la relance de la production végétale,
animale et à l'accès à l'eau potable dans les milieux
ruraux. En mai 2013, le gouvernement a signé un contrat
d'ingénierie et de construction en vue d'appuyer la relance du DAIPN.
4.4.2. Stratégie de
développement des parcs agro-industriels
Depuis l'année 2013, cette stratégie a
était lancée afin de répondre aux défis de la
modernisation des systèmes de production agricole et de stimuler une
croissance économique soutenue, entre autres par le secteur agricole.
Cette stratégie repose sur trois axes qui sont : le
développement des fermes commerciales ; l'appui aux petits fermiers
vivant dans la périphérie des sites sélectionnés et
; le développement des coopératives agricoles à haute
intensité de capital, de technologie ou de main d'oeuvre.
Cette évaluation vient à point nommé
puisque de plus en plus des voix s'élèvent sur les contre
performances de la campagne agricole, lancée tambour battant par le
premier ministre de la RDC qui n'a pas donné des résultats
palpables sur le terrain. Tout ce que l'on voit ce sont des déclarations
sur les médias et l'exhibition politique.
Fondamentalement, il est question de satisfaire la double
exigence de la lutte contre la malnutrition et l'insécurité
alimentaire ainsi que la promotion d'une croissance économique durable.
Pour ce faire, il faut cibler prioritairement les productions vivrières
par la mise en place de Pôles d'entreprises agricoles sous forme de parcs
agro-industriels, tout en assurant la promotion des cultures industrielles.
Les différentes études portant sur les
principales spéculations ont démontré que les
augmentations de rendement étaient techniquement réalisables
lorsque les investissements correspondants étaient
réalisés ; notamment sur les filières prioritaires (2,7%
pour le maïs ; 2,5% pour le riz ; 3,2% pour le manioc, 3% pour le plantain
et 6,5% pour les cultures industrielles).47(*)
Soutenu par une agriculture irriguée, un parc
agro-industriel est un carrefour, un paquet minimum de services aux
entreprises, une concentration d'infrastructures de production intégrant
les équipements et technologies appropriés pour soutenir
l'ensemble de la chaine de valeurs de l'activité agricole en respectant
les standards internationaux. Le parc intègre toutes les infrastructures
de base, y compris une alimentation adéquate en eau, en
électricité ainsi que des services de
télécommunication48(*).
Les grands défis à relever par la RDC dans
l'avenir très proche sont de trois ordres. Il est important de
sécuriser et moderniser les systèmes de production agricole pour
améliorer durablement la productivité des filières, par un
meilleur accès aux facteurs de production, aux marchés et par
l'amélioration de l'environnement juridique et de la gouvernance.
Ensuite, il faut arriver à vaincre la malnutrition et
l'insécurité alimentaire, et réduire significativement le
niveau de pauvreté de la population rurale.
Enfin, il devient impérieux de mobiliser des
investissements conséquents pour permettre à tous les acteurs du
secteur agricole de jouer pleinement leur rôle dans la modernisation,
dans la croissance économique et dans le développement du
pays.
4.4.3.Promotion de la
croissance des secteurs économiques clés
L'économie congolaise a connu ces dix dernières
années une croissance économique moyenne de 5%, impulsée
principalement par les secteurs des mines, de l'agriculture, des
infrastructures et du commerce de gros et de détail. Ce taux reste
encore très faible pour induire un décollage du pays et
générer suffisamment d'emplois.
Dans le souci de consolider cette croissance, il est
prévu de relancer et/ou selon le cas, de développer les secteurs
économiques clés (agriculture, énergie électrique,
mines, hydrocarbures et gaz naturel, télécommunication et
nouvelles technologies de l'information, forêt, environnement et
tourisme) et de les réformer en vue d'améliorer leur contribution
à la formation du PIB et à la création d'emplois et de
revenus.
4.4.3.1. Culture, Élevage et
Pêche
Avec 80 millions d'hectares d'étendue des terres
arables, quatre millions d'hectares de terres irriguées, de nombreux
cours d'eau comportant d'importantes ressources halieutiques, la RDC dispose
des atouts majeurs pour devenir une puissance agricole
mondiale.
Aujourd'hui, bien que le secteur agricole contribue entre 35 et
40% dans la formation du PIB et participe pour plus de 60% à la
création des emplois, il ne parvient pas encore à assurer
l'indépendance alimentaire du pays et à générer
suffisamment des revenus et d'emplois durables.
L'action du Gouvernement
doit viser à:
- renforcer sa contribution à la croissance
économique;
- restaurer la sécurité alimentaire du pays;
- réduire la pauvreté et la
précarité dans les milieux ruraux;
- accroître la production des produits vivriers et
pérennes.
Pour atteindre ces objectifs, on doit répondre aux
stratégies et politiques agricoles et rurales qui touchent à la
sensibilisation, la production, l'évacuation, le stockage, la
transformation et la commercialisation.
Il entend au niveau du sous secteur de l'Agriculture
(production végétale):
- intensifier la production agricole vivrière en vue
d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en denrées de base, par le
renforcement du programme de mécanisation agricole,
l'amélioration des infrastructures de recherche agronomique, la
disponibilisation des intrants agricoles aux agriculteurs et la promotion de la
technologie approprié post récolte;
- redynamiser l'agriculture à la base, par la
mobilisation et l'encadrement des populations rurales, de manière
à atteindre un objectif de superficie de 1 ha par ménage;
- promouvoir la professionnalisation des acteurs agricoles
(incubateurs), de la jeunesse désoeuvrée, des retraités et
démobilisés dans la production agricole en vue de leur auto-prise
en charge.
4.4.3.2. Au niveau du sous
secteur de la Pêche:
- relancer, avec l'appui des privés, la pêche
industrielle à Moanda (centre de pêche de N'Siafumu), sur les Lacs
Albert (Tchomia et Kasenya), Edouard (Vitchumbi), Tanganyika (Kalemie, Moba,
Uvira), Kivu et Moero (Pweto et Kashobe) ainsi que sur la dépression de
Kamalondo au Katanga (Lacs Nzilo et Upemba);
- assurer la sensibilisation des pêcheurs à la
gestion durable des ressources halieutiques par l'utilisation des filets
à mailles recommandées, le respect des périodes de
fermetures de pêche (novembre à février) pour la
reproduction des poissons ainsi que la protection des zones de frayeurs.
4.4.3.3. Au niveau du sous
secteur de l'élevage:
- intensifier l'élevage des animaux à cycle
court: volaille, ovins, caprins, et porcins en assurant l'extension des
activités du DAIPN et Bukangalonzo dans d'autres grands centres urbains
ou périurbains du pays et appuyant la création et le
développement des fermes privées et des petites exploitations
familiales;
- relancer l'élevage et la production de gros
bétail en repeuplant, des ranches bovins, décimés par la
guerre, au niveau des Provinces du Katanga (Plateau de Kundelungu), Nord-Kivu
(Masisi), Sud Kivu, Kasaï-Occidental, Kasaï#172;Oriental, Bandundu
(Feshi et Kikwit), Province Orientale (Ituri), grâce aux facilités
à accorder pour l'importation des bétails de reproduction,...
Conclusion partielle
Dans le chapitre quatrième qui est le tout dernier dans
cette étude, il a été question d'analyser l'apport du
secteur agricole dans la croissance économique en RDC, ce qui nous a
permis de revoir la situation économique de la République
Démocratique du Congo dans la période sous étude et
où, nous avons montré les raisons pour lesquelles le secteur
agricole peut déclencher une croissance économiques soutenue et
peut être à même de réduire la pauvreté et la
faim. Pour y arriver, nous avons suggéré au gouvernement de
prendre ses responsabilités en revoyant la prévision
budgétaire à la hausse et en veillant à son
exécution et ceci aura d'incidence dans la formation du produit
intérieur brut.
CONCLUSION GENERALE
Nous voici à la fin de notre étude qui s'est
confiée la tâche de parler du rôle des finances
publiques dans la relance du secteur agricole en République
Démocratique du Congo ». Cette étude est menée
pour une période allant de 2010 à 2014, soit 5 ans.
La problématique de ce travail est centrée sur
des questions pertinentes favorisants de dégager une idée globale
du travail telles que :
- les finances publiques sont-elles capables de jouer un
rôle important dans la relance du secteur agricole ?
- une fois relancé, le secteur agricole peut-il devenir
un secteur clé et porteur de croissance économique en
RDC ?
- le choix du secteur agricole comme le porte-étendard
du décollage économique peut-il relever les défis auxquels
sont plongés les congolais depuis plusieurs décennies
comme : la pauvreté et l'insécurité
alimentaire ?
Par rapport aux questions posées, nous avons
formulé l'hypothèse selon laquelle :
Le secteur agricole ne serait capable de soutenir mieux de
porter la croissance économique de la RDC qu'à condition, pour
le pouvoir public d'opérer une transformation structurelle du secteur
agricole. Une telle mutation ne saurait être obtenue que par : une
recherche agricole à grande échelle, la diffusion des innovations
technologiques respectueuses de l'environnement, l'affectation des budgets
adéquats dans le contexte de la décentralisation, la mise en
oeuvre du plan de restructuration des services du Ministère de
l'Agriculture et du Développement Rural, la promotion des
systèmes financiers adaptés à la nature des
activités du secteur agricole, l'expansion de l'infrastructure publique
dans le but de viabiliser les sites de production. Ceci permettrait à la
population de relever le défi de la pauvreté et de
l'insécurité alimentaire.
Pour atteindre le résultat, nous avons utilisé
la méthode historique, la méthode comparative ainsi que
la méthode dialectique.
Nous avons fait recours aux différentes techniques pour
récolter les données dont notamment : l'analyse
documentaire, l'observation directe et la technique d'interview
(entretien).
Le travail a été divisé en quatre
chapitres à savoir :
0. l'analyse du cadre conceptuel et théorique :
les finances publiques,
1. le secteur agricole comme moyen de relance de la croissance
économique,
2. le rôle des finances publiques dans le secteur
agricole en République Démocratique du Congo,
3. l'apport du secteur agricole dans la croissance
économique en République Démocratique du Congo.
L'hypothèse telle que formulée a
été certainement confirmée tout au long de cette
étude.
Au Gouvernement congolais, nous demandons instamment
de :
1. financer l'agriculture et le développement rural en
accordant une part importante et continue (d'au moins 10 %) du budget national,
soit une place prééminente sur l'agenda national ;
2. renforcer la mobilisation des ressources nationales et
réduire la dépendance liée au financement international ;
3. doter le pays d'une politique agricole qui tiendrait compte
d'une affectation rationnelle des ressources : une priorisation des appuis
intégrés, une bonne organisation du monde rural et paysan (petite
et moyenne entreprise agricole, Asbl du secteur, coopératives, dynamique
femme et jeunes) ;
4. adopter un système incitatif à la production
;
5. relancer le crédit agricole,
6. implanter des parcs agro-industriels dans toutes les
entités territoriales décentralisées,
7. harmoniser le code agricole avec les autres codes existants
(minier, forestier) à actualiser ;
8. financer la recherche agricole et les services connexes, en
collaboration avec les organisations paysannes et le secteur privé.
Aux partenaires bilatéraux et multilatéraux
de :
1. respecter les engagements pris, et accompagner les
dirigeants congolais dans leurs ambitions de devenir un pays émergeant
(à croissance rapide) en canalisant leurs efforts financiers vers et
dans le secteur agricole;
2. financer l'agriculture en y investissant, condition de
lutte efficace et durable contre la pauvreté et la faim en
République Démocratique du Congo.
Aux chercheurs d'apporter une contribution pour le
perfectionnement des techniques culturales et l'innovation technologique
à travers les centres de recherche et en coopération avec le
monde industriel.
BIBLIOGRAPHIE
1. OUVRAGES
· H. Mova SAKANYI, la science des finances
publiques, Edition Safari, Kinshasa, 2000
· J. MATHIS, gestion et finances publiques en Afrique
francophone, inédit, Paris-Dauphine, 2012
· Kembola KEJUNI, Agriculture Congolaise de nos
jours, inédit, 2008, Kinshasa-RDC,
· M. BUABUA wa KAYEMBE, les finances publiques
congolaises, Editions universitaires, Kinshasa, 2013, Juin 2009
· O. Fakaba SISSOKO, analyse de la croissance
économique du Mali depuis l'indépendance, inédit,
2009
· P. DARREAU, Expliquer la croissance,
inédit, octobre 2003
· P. M. SOLOTSHI, méthodes de recherche en
sciences sociales, God'Hope collection, Kin, 2012
1. TEXTES ET RAPPORTS OFFICIELS
· Analyse de la gouvernance du secteur Agricole en RD
Congo, ACE Europe - Rapport final - version définitive
· Banque Centrale du Congo, Rapport annuel 2013
· Circulaire n° 001/VPM/MIN.BUDGET/2014 du 26
février 2014 contenant les instructions relatives a l'exécution
de la loi de finances No 14/002 du 31 janvier 2014.
· Deuxième rapport national sur l'état des
Ressources Phytogénétiques en RDC, Projet FAO TCP/DRC/3104
· Loi portant principes fondamentaux relatifs à
l'agriculture, Kinshasa-RDC, décembre 2011
· Ministère du Budget, Direction de Programmation
et de Suivi Budgétaire, rapport annuel 2011
· Rapport sur le développement BANQUE MONDIALE,
2013 extraits pdf.
· UNDP-CD-Rapport Socioéconomique-2013
2. ARTICLES ET DIVERS DOCUMENTS
· Emmanuel KOKOLO, la voix du paysan congolais dans
budget 2014 : Aller jusqu'à 10 % pour le secteur agricole, 2013,
N°26.
· J. ARROUS, dans les théories de la croissance,
cahiers français n°279, janvier-février 1997
· Larousse, 2008
· Le Petit Larousse illustré, 1993
3. NOTES DE COURS, MEMOIRES ET INEDITS
· Développement rural Intitulé «
Informons les organisations paysannes du Sud sur les politiques agricoles et
rurales », article inédit, 2013
· G. ZUKA, l'essentiel sur les finances publiques, notes de
cours, UPN, 2010-2011
· Initiative Prospective agricole et rurale (IPAR), dans le
cadre du projet d'Inter-réseaux
· J. M. Ulimwengu, PhD, la transformation de
l'agriculture congolaise par le développement des parcs
agro-industriels, 13ème édition, inédit,
2013
4. WEBOGRAPHIE
·
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr consulté le 9 mai
2015 à 13h45
·
http://wikipedia.org/wiki/finances_publiques consulté le 14
janvier 2015 à 13h15'
· http://www.google.cd
consulté le 22 Mai 2015 à 11h30'
· http://www.radiofrance.fr
consulté le 4 Avril 2015 à 19h20'
· http://www.fao.org
consulté le 08 Mai 2015 à 16h20'
· http://www.wikipedia.com
consulté le 12 mai 2015 à 13h15'
TABLE DE MATIERES
EPIGRAPHE...................................................................................................i
DEDICACE.....................................................................................................ii
IN
MEMORIAM.............................................................................................iii
REMERCIEMENTS........................................................................................iv
LES ABREVIATIONS ET SIGLES
UTLISES............................................................v
LISTE DE
TABLEAUX.....................................................................................vi
LISTE DE GRAPHIQUES ET
FIGURES...............................................................vii
RESUME DU
TRAVAIL.................................................................................viii
SUMMARY...................................................................................................x
0. INTRODUCTION GENERALE
1
0.1. PROBLEMATIQUE
1
0.2. HYPOTHESE DU TRAVAIL
3
0.3. INTERET DU SUJET
4
0.4. CADRE METHODOLOGIQUE
4
0.4.1. METHODES
4
0.4.2. TECHNIQUES DE RECHERCHE
5
0.5. DELIMITATION DU SUJET
6
0.6. CANEVAS
7
Chapitre premier :
L'ANALYSE DU CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE :
LES FINANCES
PUBLIQUES......................................................................................................8
1.1. Définition de finances
publiques
8
1.1.1. Définition selon la conception
classique
9
1.1.2. Définition selon la conception
moderne
9
1.2. Les finances publiques et leurs
environnements
10
1.2.1. L'environnement politique
10
1.2.2. L'environnement social et
culturel
11
1.2.3. L'environnement économique
12
1.3. Rôle des finances publiques
13
1.4. Eléments constitutifs des
finances publiques
14
1.4.1. Budget de l'Etat
14
1.4.2. Recettes publiques
15
1.4.3. Dépenses publiques
17
1.4.4. Déficit budgétaire
21
1.4.5. Déficit public
22
1.4.6. Dette publique
22
1.5. La science des finances publiques
23
1.6. La paternité scientifique des
finances publiques
24
Chapitre deuxième :
LE SECTEUR AGRICOLE COMME MOYEN DE RELANCE DE LA
CROISSANCE ECONOMIQUE
25
2.1. CROISSANCE ECONOMIQUE
25
2.1.1. Définition et Mesure de la
croissance
25
2.1.2. Différents cycles de croissance
économique dans le monde
27
2.1.3. Différentes conceptions de croissance
économique chez les économistes
27
2.1.4. Facteurs de la croissance
économique
28
2.1.5. Sources de la croissance
29
2.1.5.1. La croissance endogène
29
2.1.5.2. La croissance exogène
31
2.2. FINANCES PUBLIQUES ET CROISSANCE
ECONOMIQUE
31
2.2.1. La gestion des finances publiques et la
croissance économique
31
2.2.2. Rôle des finances publiques dans la
croissance et le développement
31
2.3. SECTEUR AGRICOLE ET LA CROISSANCE AGRICOLE
32
2.3.1. Agriculture
32
2.3.2. La production agricole
33
2.3.3. Complexité agricole
34
2.4. RÔLE DE LA CROISSANCE AGRICOLE
35
2.4.1. Politique agricole
36
2.4.2. Les caractéristiques des politiques
agricoles
37
2.4.3. Les finalités des politiques
agricoles
38
Chapitre Troisième::
LE RÔLE DES FINANCES PUBLIQUES DANS LE
SECTEUR AGRICOLE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
40
3.1. LES FINANCES PUBLIQUES
40
3.1.1. Evolution des recettes publiques
41
3.1.1.1. Dette publique
41
3.1.1.2. Finances publiques
41
3.1.1.3. Les recettes budgétaires
42
3.1.1.4. Les dépenses publiques
43
3.1.1.5. Analyse sectorielle des
dépenses
44
3.1.1.6. Une gestion des finances publiques
à refonder
45
3.1.1.7. Les principales réformes en
cours
45
3.1.2. La nécessité de
refonder le système et la gestion des finances publiques
46
3.1.3. Une vision ambitieuse
49
3.1.3.1. L'ambition de
légitimité
49
3.1.3.2. L'ambition d'efficacité : la
gestion axée sur les résultats
52
3.1.3.3. Refonder les finances publiques
dans un cadre juridique moderne
56
3.1.3.4. L'enrichissement du rôle du
législateur lors du vote de la loi de finances
59
3.2. LE SECTEUR AGRICOLE CONGOLAIS
60
3.2.1. Les potentialités du secteur
agricole de la RDC
60
3.2.2. Paradoxe Congolais
61
3.2.3. Agriculture
63
3.2.4. Production agricole
vivrière
63
3.2.5. Culture de rente
64
3.2.6. Elevage, pêche et chasse
64
3.2.7. Financement du secteur agricole en
RDC
65
3.2.8. L'an 2014 : Année de
l'Agriculture familiale
68
3.2.9. Déficit d'exploitation
69
3.2.10. Quelle loi pour la relance
agricole
70
3.2.11. Points forts de la nouvelle
vision
72
3.2.12. L'accès à la terre
grâce au Code agricole
73
Chapitre Quatrième :
L'APPORT DU SECTEUR AGRICOLE DANS LA CROISSANCE
ECONOMIQUE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
75
4.1. EVOLUTION DE LA CROISSANCE DANS LE MONDE
76
4.2. SITUATION ECONOMIQUE DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE CONGO DE 2010 à 2014
78
4.2.1. L'activité économique
intérieure 2010
78
4.2.2. L'activité économique
intérieure 2011
80
4.2.3. L'activité économique
2012
81
4.2.4. Activité économique 2013
83
4.2.5. Activité économique 2014
84
4.2.6. L'agriculture et la croissance
économique
85
4.2.7. Raisons de déclencher la croissance
par le secteur agricole
86
4.2.8. Constats et analyses
87
4.3. L'APPROCHE D'INCIDENCE DU SECTEUR AGRICOLE
DANS LE PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB)
89
4.3.1. Evolution du PIB
89
4.3.2. Sous-branche agriculture
90
4.3.3. Sous-branche agricole vivrière
91
4.3.4. Sous-branche culture de rente
91
4.3.5. Sous-branche forêt
91
4.3.6. Sous-branche élevage, pêche et
chasse
92
4.4. LA PREVISION BUDGETAIRE AU SECTEUR
AGRICOLE
92
4.4.1. L'allocation budgétaire à
l'agriculture
93
4.4.2. Stratégie de développement des
parcs agro-industriels
95
4.4.3.Promotion de la croissance des secteurs
économiques clés
96
4.4.3.2. Au niveau du sous secteur de la
Pêche:
98
4.4.3.3. Au niveau du sous secteur de
l'élevage:
98
CONCLUSION GENERALE
100
BIBLIOGRAPHIE
103
TABLE DE MATIERES
105
* 1 M. BUABUA wa KAYEMBE, les
finances publiques congolaises, Editions universitaires, Kinshasa, 2013, p16
* 2 Deuxième rapport
national sur l'état des Ressources Phytogénétiques en RDC,
Projet FAO TCP/DRC/3104
Juin 2009, p11
* 3 Kembola Kejuni, dans
« Agriculture Congolaise de nos jours », inédit,
2008, Kinshasa-RDC, p01
* 4 P. M. SOLOTSHI,
méthodes de recherche en sciences sociales, God'Hope collection,
Kinshasa, 2012, p.123.
* 5 Larousse, 2008, p.512
* 6 Le Petit Larousse
illustré, 1993, p.526
* 7
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finances_publiques:
consulté mercredi 14janvier 2015 à 13h15'
* 8 G. ZUKA, l'essentiel sur les
finances publiques, notes de cours, UPN, 2010-2011, p7.
* 9 10 G. ZUKA,
l'essentiel sur les finances publiques, notes de cours, UPN, 2010-2011, p7.
* 11 G. ZUKA MOND'O,
l'essentiel sur les finances publiques, notes de cours, UPN 2011,
inédit, p9
* 12H. MOVA SAKANYI, la science
des finances publiques, Edition Safari, 2000, Kinshasa, p.19
* 13
http://performance-publique.budget.gouv.fr
consulté le 9 mai 2015 à 13h45
* 14 Circulaire n°
001/VPM/MIN.BUDGET/2014 du 26 février 2014 contenant les instructions
relatives a l'exécution de la loi de finances No 14/002 du 31 janvier
2014.p8 sur Pdf
* 15 Circulaire n°
001/VPM/MIN.BUDGET/2014 du 26 février 2014 contenant les instructions
relatives a l'exécution de la loi de finances No 14/002 du 31 janvier
2014.pp9-10 sur Pdf
* 16
http://wikipedia.org/wiki/dépenses_publiques
consulté le 9 mai 2015 à 13h55
* 17 Circulaire n°
001/vpm/min.budget/2014 du 26 février 2014 contenant
les instructions relatives a l'exécution de la loi de finances no 14/002
du 31 janvier 2014, p9.
* 18
http://google.com consulté le 22
avril 2015 à 11h10'
* 19 H. MOVA SAKANYI, idem, p.
22
* 20 J. Arrous : les
théories de la croissance, cahiers français n°279,
janvier-février 1997
* 21
http://www.google.cd consulté
le 9 mai 2015 à 12h25'
* 22 Idem
* 23 Oumar Fakaba sissoko,
analyse de la croissance économique du Mali depuis
l'indépendance, inédit, master II économie internationale,
Paris 2008, p24
* 24 http://
www.radiofrance.fr publication
de Marc Dufumier (Ir. Agronome à INA Paris-Grignon), consulté
le 04 avril 2015
* 25
http://www.google.com
consulté le 3 juin 2015
* 26
http://www.fao.org consulté le
08 mai 2015
* 27
http://www.fao.org consulté le
08 mai 2015
* 28 Initiative Prospective
agricole et rurale (IPAR), dans le cadre du projet d'Inter-réseaux
Développement rural Intitulé « Informons les organisations
paysannes du Sud sur les politiques agricoles et rurales », article
inédit, 2013. Pp10-15
* 29 UNDP-CD-Rapport
Socioéconomique-2013, p22
* 30 UNDP-CD-Rapport
Socioéconomique-2013,p23
* 31 Jean Mathis, gestion et
finances publiques en Afrique francophone, inédit, Paris-Dauphine, 2012,
p.7
* 32http//:www.google.com/
Plan stratégique de reforme des finances publiques,
consulté le 14 mai 2015, p 14.pdf.
* 33 Idem, p15.pdf
* 34 http//:www.google.com/
Plan stratégique de reforme des finances publiques publié en mars
2010. P.15pdf
* 35http//:www.google.com,
consulté le 22 mai 2015
* 36 http//:www.google.com/
Plan stratégique de reforme des finances publiques publié en mars
2010. P.17 pdf
* 37http://
www.wikipedia.com consulté
le 12 mai 2015
* 38 John M. Ulimwengu, PhD, la
transformation de l'agriculture congolaise par le développement des
parcs agro-industriels, 13ème édition, inédit,
p25
* 39 Kembola Kejuni,
Agriculture Congolaise de nos jours, article inédit, p01.
* 40 Loi portant principes
fondamentaux relatifs à l'agriculture, Kinshasa-RDC, décembre
2011, p. ii, pdf
* 41 John ULIMWENGU
« la transformation de l'agriculture congolaise par le
développement des parcs agro-industriels »,
13ème Edition, 2014, p28.
* 42 Philippe Darreau
``Expliquer la croissance'', octobre 2003, inédit
* 43 Rapport sur le
développement BANQUE MONDIALE, 2013 extraits pdf.
* 44 Analyse de la gouvernance
du secteur Agricole en RD Congo, ACE Europe - Rapport final - version
définitive,p25.
* 45 Banque Centrale du Congo,
Rapport annuel 2013, p12
* 46 Emmanuel Kokolo,
la voix du paysan congolais dans budget 2014 : Aller jusqu'à 10 %
pour le secteur agricole, 2013, N°26.P.3
* 47 John ULIMWENGU, op.cit
* 48 John ULIMWENGU, Op.cit
| 


