|
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (UAC)

Institut National de la Jeunesse, de l'Education Physique et du
Sport
(INJEPS)

EN SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES
(STASE)
Option : Développement Communautaire
THEME
COMMUNICATION DANS LA GESTION DES COLLECTIVITES
LOCALES :
CAS DE LA COMMUNE DE BOHICON
Réalisé par:
AGO Maurice
Sous la direction de :
Pr. Kossivi ATTIKLEME, Maître de conférences des
Universités CAMES,
Enseignant Chercheur à l'INJEPS/UAC
15è promotion
Décembre 2013 EFFICACITE DES
ENSEIGNANTS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LE MANAGEMENT DES LYCEES ET
COLLEGES AU BENIN : réinvestissement des acquis initiaux des
enseignants dans gestion des collèges.
SOMMAIRE
In
memorium-----------------------------------------------------------------------------------------------ii
Dédicace---------------------------------------------------------------------------------------------------iii
Remerciements--------------------------------------------------------------------------------------------iv
Sigles et
Abréviations------------------------------------------------------------------------------------vi
Tableau et liste des
graphes-----------------------------------------------------------------------------vii
Epigraphe-------------------------------------------------------------------------------------------------viii
INTRODUCTION-----------------------------------------------------------------------------------------1
Partie I : CONTEXTUALISATION DE LA
RECHERCHE----------------------------------------4
Partie II : PROBLEMATISATION DE
L'ETUDE--------------------------------------------------10
Partie III: DEMARCHE
METHODOLOGIQUE----------------------------------------------------28
Partie IV : PRESENTATION ET ANALYSE DES
RESULTATS-------------------------------35
SUGGESTIONS-----------------------------------------------------------------------------------------51
CONCLUSION-------------------------------------------------------------------------------------------52
Références
bibliographiques----------------------------------------------------------------------------53
Annexe-----------------------------------------------------------------------------------------------------55
Table des
matières---------------------------------------------------------------------------------------58
In memorium
-----@-@-@-----
Mon père Pierre AGO, apprenant tout ce
qu'il a fait pour moi, ses mérites, ses sacrifices et la grande
affection qu'il me témoignait dès les premières
années de ma vie, je ne saurais ne pas mettre tout ce travail en sa
mémoire. Ma réussite dans la vie aurait été pour
lui une récompense, malheureusement, il n'est plus là pour jouir
de ses fruits. En voilà la disposition du Seigneur. Que la terre lui
soit légère.
DEDICACE
-----@-@-@-----
· A ma mère, Marcelline AYIHOU.
Ma chère maman, voici la première couronne dont je
t'auréole en reconnaissance des mille peines que tu as souffertes, des
mille conseils que tu me donnes, de l'ardente affection dont tu m'enveloppes,
et de tes efforts de tous les jours pour me bâtir. Te dédiant ce
travail, je te présente ma profonde gratitude pour ton courage et ton
amour à supporter presque seule la charge de tes enfants dont je suis le
benjamin. Maman chérie, du fond de mon coeur, je te dis :
« éternel merci ! ''
· A mes grands-frères et grand-soeurs
Alfred, Dénis, Justine, Laure et Barnabé. Ma
réussite et ma destinée vous ont été
confiées depuis un certain temps de ma vie. Mais vous les avez
assumées sous tant de peines, abstinences que souffrances. Je vous dis
« Fraternel et sincère merci !!!''
REMERCIEMENTS
-----@-@-@-----
Ce mémoire n'aurait pu prendre forme sans les soutien,
conseil et encadrement de certaines personnes auxquelles je ne puis
m'empêcher de manifester l'expression de ma profonde et sincère
gratitude. Ainsi, mes remerciements s'adressent à :
· mon Directeur de mémoire, Professeur Kossivi
ATTIKLEME, Maître de conférences des Universités CAMES,
Directeur Adjoint, Chargé des Affaires Académiques à
l'INJEPS qui a accepté, malgré ses multiples occupations,
d'encadrer ce travail. C'est le moment et le lieu de lui reconnaître le
savoir intellectuel et la rigueur scientifique qu'il a mis au service de ce
travail. Sincère et profonde gratitude !
· tout le personnel administratif et le corps professoral
de l'INJEPS pour leurs engagement et efforts permanents à mettre au
service du pays de ressources humaines qualifiées;
· Mme SEHOU Chantal, la bibliothécaire de l'INJEPS
pour son accueil, son service rendu et sa considération pour ma
personne ;
· ma belle-soeur, Reine AGO, née HONZOUNON pour
son soutien et son souci permanents de me voir réussir ;
· ma chère amie Gwladys GBAGUIDI pour tout ;
· Mathias AGO pour son soutien moral, matériel et
financier qui a été très indéfectible dans ma
formation. Gratitude et remerciements les plus sincères ;
· Placide AGO et sa femme pour leurs conseils et soutiens
dont ils m'enveloppent ;
· Monsieur Mathieu HONZONON. Qu'il trouve ici
l'expression de mes remerciements pour son soutien moral, matériel et
financier dans le cadre de mes études ;
· Parfait AYIHOU et Constant YETCHENOU pour leur soutien
fraternel ;
· mon frère-camarade Armel LANMATCHION. C'est ici
le lieu le plus idoine de le remercier de toute la patience qu'il a
observée à l'égard de mes perpétuels et permanents
dérangements. Ce travail n'aurait été
rédigé, n'eurent été son secours, sa patience et
son éminent sens de fraternité. A travers ce mémoire, je
lui présente ma gratitude ;
· mes amis de promotion Cyriaque SOSSA, Hermane GANDAHO,
Bienvenu AHANDESSI et Déo-Gratias AYAKA pour leurs collaboration,
solidarité, entraide, conseils et ambiance dont ils nourrissent nos
relations depuis notre entrée à l'INJEPS ;
· Marcellin AGO et Samson GBLOHOUN pour leur
fraternité et leur soutien ;
· toute la 15e promotion STASE de
l'année 2009-2014 ;
· Les élus locaux de la commune de Bohicon au
titre du mandat 2008-2013 en particulier ceux interviewés dans le cadre
de la réalisation de ce travail scientifique.
SIGLES ET ACRONYMES
ANCB : Association
Nationale des Communes du
Bénin ;
BM : Banque
Mondiale ;
CA : Chef
d'Arrondissement ;
CIRD : Centre
International de Recherche en
Développement
CSCP : Chef Service
Communication et Protocole ;
CSAF : Chef
Service des Affaires
Financières ;
DC :
Développement Communautaire ;
FAO : Organisation des
Nations-Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture ;
INSAE : Institut National de
la Statistique et de l'Analyse
Economique ;
MD : Mission de
Décentralisation ;
MDGLAAT :
Ministère de la
Décentralisation, de la Gouvernance
Locale, de l'Administration et de
l'Aménagement du Territoire ;
OCS : Observatoire du
Changement Social ;
ONG : Organisation
Non Gouvernementale ;
PAE : Plan
d'Action Environnementale ;
PDC : Plan de
Développement Communal ;
PDES : Plan de
Développement Economique et
Social ;
PDM : Plan de
Développement Municipal ;
PGDP : Programme de
Gouvernance et de Droits de la
Personne ;
PNUD : Programme des
Nations-Unies pour le
Développement ;
RGPH : Recensement
Général de la Population et de
l'Habitat ;
STASE : Sciences et
Techniques
TABLEAU ET GRAPHES
Tableau : Présentation de
la taille de l'échantillon
Graphe I : répartition des
enquêtés selon leur appréciation de la gouvernance
locale
Graphe II : répartition
des enquêtés selon la reconnaissance de leur rôle dans la
gouvernance locale
Graphe III : répartition
selon le degré de participation des populations à
l'élaboration du PDC
Graphe IV : répartition
des enquêtés selon leur degré de participation aux conseils
communaux
Graphe V : répartition
suivant le niveau d'implication des populations aux affaires communales
Graphe VI : répartition
des enquêtés selon leur niveau d'information sur les
décisions et actions du CC
Graphe VII : répartition
des enquêtés selon leur niveau d'information sur
l'évaluation des actions de développement
Graphe VIII : répartition
des enquêtés selon leur niveau d'information sur les comptes
rendus du CC
Graphe IX : répartition
des enquêtés selon leur niveau d'information sur la gestion
fiscale
Graphe X : répartition
suivant la participation des populations aux séances d'information et de
sensibilisation organisées dans la commune
Graphe XI : répartition
des enquêtés selon leur volonté de s'informer sur la
gestion communale
Graphe XII : répartition
des enquêtés selon leurs canaux d'information
préférés
EPIGRAPHE
Cernea, 1998
« Mettre les acteurs sociaux, les
gens au premier plan dans les projets n'est pas un appel à la bonne
volonté, ni un plaidoyer commandité par l'éthique ..
.C'est une requête reposant sur des fondements théoriques,
adressée aux dirigeants, aux planificateurs et aux experts techniques
pour que soit reconnue la place centrale de ce qui est le facteur principal
dans les processus de développement : la participation populaire.
»
INTRODUCTION
En Afrique, avec l'avènement de la démocratie,
bon nombre de pays en voie de développement ont procédé
à de salutaires réformes. Le centralisme ou l'étatisme
absolu, comme mode de gestion des peuples a été modifié
dans ces pays en faveur de la gestion concertée, de la gestion
participative. En effet, « Face à
l'incapacité grandissante de l'Etat central, à faire face
à ses engagements vis-à-vis de ses populations et aux
résultats décevants de ses politiques dirigistes de conduite du
développement, les décideurs politiques de nombre de pays en
développement se sont vus obligés, sous la contrainte des
bailleurs internationaux, de procéder à de profondes
réformes sur la gestion de leurs nations. Au nombre des objectifs
visés dans le cadre des réformes, on compte entre autres la
responsabilisation des populations locales dans la gestion de leurs affaires,
notamment par le mécanisme de la
décentralisation«. (Hounmenou, 2001). Au
Bénin, si l'existence des collectivités territoriales a
été consacrée depuis 1990 par le constituant
béninois lors de la Conférence des Forces Vives de la Nation
(Constitution béninoise : art.150), la mise en oeuvre de cette
réforme administrative a été d'une progressive
évolution. En effet, de la détermination des grandes options de
décentralisation en 1993 à l'adoption des textes de loi sur sa
mise en vigueur en 1999, le processus est devenu une réalité en
2002 avec l'organisation des élections communales et municipales. Ce
processus a procédé à l'institutionnalisation de 77
communes constituées chacune d'arrondissements et de quartiers ou de
villages pour une véritable communalisation de la gouvernance. Depuis la
mise en place des premiers conseils communaux et municipaux en février
et mars 2003, les espoirs dans la décentralisation n'ont cessé de
grandir. Car ainsi engagé, le processus a créé une
nouvelle réalité au niveau local marquée essentiellement
par une autonomie financière et juridique ainsi qu'un domaine de
compétences plus élargi aux communes. Désormais, les
élus locaux ont la responsabilité d'assurer le
développement et la démocratie à la base et de
gérer l'économie locale. Cette nouvelle orientation de la
gouvernance dans notre pays a pour objectif premier de confier la direction et
la gestion des affaires locales aux communautés concernées pour
qu'elles puissent, elles-mêmes, décider de leur propre vie, se
donner le chemin à suivre pour une véritable résolution de
leurs problèmes ou une réelle satisfaction de leurs besoins
à travers la valorisation de leurs potentialités. Dans cette
optique, le processus de décentralisation devrait permettre une
meilleure participation des citoyens aux affaires publiques et faciliter leur
accès aux services publics de base.
Après quelques années d'expérience en
matière de gouvernance locale, vu que les fruits ne tiennent pas la
promesse des fleurs, il semble nécessaire de faire un bilan du
système de gestion de nos communes en vue de réorienter, par des
mesures correctionnelles, le processus en faveur d'une prise en compte des
actions d'amélioration des imperfections. L'évaluation à
mi-parcours des communes au Bénin révèle que les attentes
escomptées ne sont généralement pas comblées.
L'étude-bilan menée sur l'impact de la décentralisation
sur la pauvreté et les conditions de vie des ménages au
Bénin montre que «la relation entre le conseil communal et les
citoyens souffre de beaucoup de carences par rapport à la participation
populaire, à la bonne gouvernance locale, au renforcement du capital
social et de la citoyenneté active«. (L'Observatoire du
Changement Social, 2010, 28p).
Par ailleurs, d'autres problèmes de fonctionnement
interne et externe ont été enregistrés par ANCB lors de
sa deuxième édition de l'auto-évaluation en 2012. Ils sont
relatifs à l'adoption du budget, à l'information entre
conseillers communaux et à la participation des citoyens et
organisations de la société civile.
Il existe ainsi un dysfonctionnement interne des
administrations communales et un faible niveau de vie des populations
approuvés par ces différents rapports qui ont mis un accent
particulier sur la participation active des citoyens aux affaires
communautaires. Cette participation n'est possible que grâce à une
information périodique, source d'une réelle implication de ces
derniers. Des recommandations issues de différents ateliers ont,
à cet effet, mis l'accent sur l'importance de la communication dans la
gouvernance locale. Ainsi, nous nous demandons si ces recommandations sont
vraiment mises en vigueur dans la commune de Bohicon. En d'autres termes, la
population de Bohicon est-elle, comme de droit, informée et
impliquée dans la gestion de ses affaires ?
Cette préoccupation a attiré notre attention et
nous a fait nous intéresser au domaine de la gouvernance locale avec
pour thème « Communication dans la gestion des
collectivités locales : cas de la commune de
Bohicon » afin de montrer la place de la communication dans
la gestion communale.
OBJECTIF
L'objectif principal de cette étude est de montrer le
rôle fondamental de la communication locale dans la réalisation
des actions de développement.
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Ø analyser les modes de communication et d'information
des populations mis en place dans la commune de Bohicon ;
Ø déterminer le taux d'implication de la
population dans la gestion communale ;
Ø évaluer le degré d'information des
citoyens sur la mise en oeuvre de la gouvernance locale.
Cette étude s'articule autour de quatre grandes
parties. D'abord après une introduction, la première partie
présente la contextualisation de la recherche. La deuxième partie
est consacrée à la problématisation à savoir la
revue de littérature, le cadre théorique, la problématique
et les hypothèses de l'étude. Ensuite, la troisième partie
met en exergue la démarche méthodologique utilisée pour
recueillir les données. Et enfin, la dernière partie est
consacrée à la présentation, l'interprétation et
l'analyse des résultats issus de l'enquête. Suivent quelques
suggestions et la conclusion pour l'amélioration de la gouvernance
locale dans la commune.
Partie I
CONTEXTUALISATION DE LA RECHERCHEE
1.1. CADRE JURIDIQUE
1.1.1. Lois de la décentralisation
La décentralisation au Bénin est sous-tendue par
un arsenal juridique qui non seulement régit le processus, mais surtout
définit les droits et les devoirs de chaque acteur du système et
les conditions de sa mise en oeuvre. En effet, dans le souci d'observer les
recommandations issues de la Conférence des Forces Vives de la Nation de
1990, le Bénin procéda, en 1993, à la définition
des principes directeurs de l'organisation de l'Administration Territoriale. En
1997, la Mission de Décentralisation a été
créée pour la coordination du processus. Il a fallu 1999 pour que
les lois sur la décentralisation soient adoptées. Ainsi, cinq
différentes lois sont votées pour l'effectivité de la mise
en oeuvre du processus de la décentralisation :
· loi n°97-028 portant organisation de
l'administration territoriale en République du Bénin ;
· loi n°97-029 portant organisation des Communes en
République du Bénin ;
· loi n° 98-005 portant organisation des
Communes à statut particulier ;
· loi n° 98-007 portant régime financier
des Communes en République du Bénin ;
· loi n° 98-006 portant régime
électoral communal et municipal en République du Bénin.
Chacune de ces lois aborde et régit un volet
spécifiquement important dans la mise en oeuvre du processus de la
décentralisation. Ainsi,
La loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation
de l'administration territoriale en république du Bénin traite
des généralités sur le découpage territorial pour
fixer le niveau de la déconcentration (préfecture) et les
conditions de son administration, la décentralisation dont le seul
niveau est la commune.
La loi n°97-029 portant organisation des Communes en
République du Bénin traite de l'organisation du fonctionnement et
des compétences de la commune. En effet, dans cette loi sont
définies les attributions du maire et du conseil communal ainsi que les
domaines d'intervention de la commune.
La loi n° 98-005 portant organisation des Communes
à statut particulier détermine les critères de
définition des communes à statut particulier, le fonctionnement,
les attributions et compétences de ces grandes agglomérations.
La loi n° 98-007 portant régime financier des
Communes en République du Bénin a spécifiquement trait aux
finances locales. Le législateur, à travers cette loi, a
prévu des mécanismes légaux par lesquels les élus
locaux peuvent mobiliser et gérer les ressources financières
locales. Ainsi des structures d'accompagnement et de subvention des communes
sont mises en place. Au nombre de ces structures, on peut citer entre autres,
la Commission Nationale des Finances Locales et le Fonds d'appui au
développement des Communes.
La loi n° 98-006 portant régime
électoral communal et municipal en République du Bénin
fixe des conditions ou règles générales et
particulières applicables aux élections communales et municipales
ainsi que les infractions en la matière et les sanctions y
afférentes.
Ces diverses lois ont permis au Bénin de se lancer de
pleins pieds dans le système de gestion décentralisée
faisant ainsi l'option, d'une part, de renforcer la démocratie à
la base et d'autre part, de créer les conditions efficientes d'un
développement équilibré de toutes les localités du
pays. Autrement dit, l'objectif fondamental et le défi majeur de la
décentralisation est le développement local. Mais il exige
certaines conditions qui sont la ligne de direction de la gouvernance
locale.
1.1.2. Conditions nécessaires au
développement local
La réalisation du développement local est
liée à la réunion de certaines conditions indispensables
qui sont :
· une volonté locale :
l'initiative des projets de développement est le fait des élus et
des groupes sociaux.
· l'interdisciplinarité : le
développement local intègre la diversité des dimensions
économiques, sociales et culturelles.
· le territoire : le
développement local concerne un territoire ayant un statut et une
taille.
· la capacité locale : le
développement local s'appuie sur la mobilisation des données
endogènes (ressources locales, épargne de proximité,
solidarité de voisinage...) et une capacité locale
d'entreprendre, c'est-à-dire de générer des
activités et donc de créer de la richesse.
· la communication : le
développement local dépend de la circulation de l'information et
du système de communication mis en place.
· la formation : la formation est
indispensable pour modifier certains comportements négatifs et pour
améliorer les performances à tous les niveaux.
· l'animation :
l'efficacité d'une politique de développement local
dépend surtout de la façon dont les pouvoirs publics exercent
leur fonction d'animation économique et sociale
Il est à remarquer que ces conditions pour la plupart
sont orientées vers les populations cibles. De même, même si
la communication constitue une condition à part entière, il faut
dire qu'elle est aussi ce sans quoi aucune des autres conditions ne puisse
être remplie.
1.1.3. Dispositions relatives à la communication
dans la gestion
La loi met un accent particulier sur l'ouverture de la gestion
communale aux citoyens ; cette ouverture qui ne peut se faire que par le
biais de la communication. La communication dans la gestion se traduit
par :
ü la reddition de comptes : « Il est
dressé un procès-verbal et/ou un compte rendu de chaque
séance du conseil communal. Un relevé des décisions
signé du maire et du secrétaire de séance est
affiché à la mairie à l'endroit destiné à
l'information du public dans les huit Jours suivant la
séance » art. 33 de la loi n°97-029 portant
organisation des Communes en République du Bénin
ü l'accès aux documents
administratifs : « Toute personne a le droit de
consulter sur place le procès-verbal et/ou le compte rendu des
délibérations du conseil communal, les divers actes communaux et
d'en prendre copie à ses frais. » Art. 34 de la
même loi.
ü la participation du citoyen aux séances du
conseil communal : « Les séances du conseil communal
sont publiques ». Art. 30 de la même
loi.
ü l'implication du citoyen dans les affaires
locales : « La commune est l'expression de la
décentralisation et le lieu privilégié de la participation
des citoyens à la gestion des affaires publiques
locales » (art. 2 de la même loi). Cette implication est
aux fins que la gouvernance locale prenne appui sur la capacité locale,
les données endogènes (ressources locales, épargne de
proximité, solidarité de voisinage...)
Vu l'indéniable importance de la communication, la
Mission de Décentralisation (MD) fait obligation à toutes les
communes de disposer d'un service d'information et de communication qui sera
comme un excellent moyen pour véhiculer les messages de la mairie vers
les populations. Ce service permet le renforcement de l'éveil de la
population et la crédibilité des autorités auprès
des citoyens, l'instauration d'un climat de confiance entre acteurs de
développement (gestionnaires publics/élus et citoyens),
l'amélioration des prestations, une forte mobilisation des ressources,
l'accroissement des investissements de la part des PTF, l'augmentation de la
visibilité de la commune....
Les conseillers municipaux ou communaux ont alors comme
obligation de mettre tous les acteurs notamment les citoyens au coeur de la
gestion décentralisée. Pour ce faire, un guide d'exercice de
reddition de comptes a été élaboré pour leur
proposer les moyens d'exercice de la reddition de comptes afin de favoriser une
prestation plus efficace et plus efficiente des services sociaux de base et une
prise de décision plus équitable, transparente et participative.
En effet, ce guide est un document d'informations et d'orientation à
l'intention des acteurs intervenant à tous les niveaux dans les
initiatives de reddition de comptes et qui vise essentiellement la promotion de
la démocratie et de la bonne gouvernance, la participation des
populations à la construction d'un espace de dialogue et de
citoyenneté pour la satisfaction des services de base.
De même, un guide de planification communale est mis
à disposition des communes pour assurer leur conformité dans les
conditions d'élaboration de ce principal outil de développement.
En effet, la planification est pour chaque commune, un processus
d'élaboration et de mise en oeuvre concertée d'un ensemble
d'actions et de mesures permettant de valoriser toutes les ressources de son
terroir. Elle repose alors sur une approche participative.
1.2. CADRE GEOGRAPHIQUE
1.2.1. Localisation et aspect physique de la commune de
Bohicon

La commune de Bohicon pourrait être
considérée comme la métropole des neuf communes du
département du Zou. De par sa situation géographique ou sa
position spatiale par rapport aux autres communes, elle représente un
grand pôle d'attraction, le principal centre commercial du
département. Dans le sud-ouest du département du Zou à 130
km de Cotonou, Bohicon se situe entre 6°55 et 7°08 de latitude Nord,
1°58 et 2°24 de longitude Est. Elle a une superficie de 139 km2 et
elle est limitée :
· au nord par la commune de
Djidja ;
· au sud par la commune de
Zogbodomey ;
· à l'est par la commune de
Za-kpota ;
· à l'ouest par les communes d'
Abomey et d'
Agbangnizoun
La commune de Bohicon jouit d'un climat subéquatorial
de transition, caractérisé par deux saisons de pluie (avril
à juin et septembre à novembre) et deux saisons sèches
(juillet à août et décembre à mars). La hauteur
des pluies atteint en moyenne 1.025 mm par an. Leur maximum se situe entre juin
et octobre. Cette période humide et pluvieuse, se caractérise par
des précipitations assez bien réparties. La pluviométrie
y est largement excédentaire (parfois 349 mm en 12 jours). Le mois le
plus frais de l'année est le mois d'août. La température
varie entre 25 et 32°C. C'est la période favorable à
certaines maladies liées à l'environnement. Par contre, le
minimum des hauteurs de pluie se situe entre janvier et mars. Cette
période, chaude et ensoleillée, est caractérisée
par une pluviométrie presque nulle : 5 mm de pluie en quatre mois
parfois. Le mois le plus chaud est le mois de février ou mars. La
température monte à plus de 34°C. En général,
il pleut en moyenne 73 jours dans l'année. En juillet, il pleut pendant
une quinzaine de jours avec en moyenne dix jours d'orage, tandis que les mois
de décembre, janvier et février n'enregistrent parfois aucun
jour de pluie. Ces caractéristiques climatiques commandent les
activités des hommes, leur mode de vie et de production.
1.2.2. Administration territoriale
Devenue commune à l'avènement de la
décentralisation du pouvoir de gouvernance au Bénin en 2003,
Bohicon est stratifié en dix arrondissements. Il s'agit de :
· 1er arrondissement ou Bohicon I avec neuf
quartiers ;
· 2e arrondissement ou Bohicon II comprenant
huit quartiers ;
· Agongointo regroupant quatre quartiers ;
· Avogbanna dont l'étendue territoriale couvre
cinq quartiers ;
· Gnidjazoun avec deux quartiers ;
· Lissèzoun qui regroupe quatre
quartiers ;
· Ouassaho comptant cinq quartiers ;
· Passagon avec cinq quartiers ;
· Saclo regroupant deux quartiers ;
· Sodohomè qui couvre sept quartiers.
La direction de l'espace communal a été donc
entreprise avec de nouvelles vision et orientations. Le tout premier maire
élu à la tête de cette commune, suite aux élections
municipales de 2003, est le feu
Paulin Tomanaga.
Suite à l'élection de ce dernier comme député lors
des législatives de 2007, la destinée de la commune
de Bohicon est entrée, depuis 2008, entre les mains d'un conseil
communal de 25 membres dirigé par le maire
Luc Sètondji Atropko, le premier adjoint au tout-premier maire.
Le pouvoir politique moderne incarné par le Maire et le
Conseil Communal est renforcé par divers types de services tels que le
Bureau du Maire, les Bureaux des Adjoints au Maire, le Bureau du
Secrétaire Général (SG), le Bureau des Affaires Domaniales
(BAD), le Bureau des Affaires Economiques (BAE), le Bureau des Affaires
Générales (BAG), le Bureau des Affaires Financières (BAF),
le Bureau des Affaires Civiles et Militaires (BAEC/ M), le Bureau des Archives,
de Documentation et Information (BADI), le Secrétariat Administratif
(SA) et le Bureau de Transmission (BT). Au-dessus de cette organisation
administrative, il y a bien entendu le conseil communal composé des
différents conseillers élus de la commune dont le rôle est
de voter, suivre la mise en oeuvre du budget de la commune.
1.2.3. Ressources humaines
Selon les données monographiques (2006), la population
de Bohicon est d'une évolution exponentiellement recrudescente. Cette
croissance rapide de la population résulte d'un taux de
fécondité élevé et d'une mortalité en baisse
hormis la couche infantile.
D'après les résultats du RGPH 3, le
département du Zou fait partie des départements ayant un poids
démographique relativement homogène. La commune ayant la plus
forte population est Bohicon avec 18,84% de la population totale du Zou. On
peut donc conclure que la population de Bohicon a connu un rythme de croissance
démographique plus important que le département dont il
dépend. Cette densité de la population est diversifiée en
de groupes socioculturels ou ethnies dont les plus majoritaires sont les Fon
(93,0%), Yoruba (4,6%), Adja (1,4%), Bariba (0,1 %) et autres (0,6%).
Les personnes âgées de 60 ans et plus
représentent seulement 5,5% de la population totale. Il s'en
déduit donc que la couche juvénile, dynamique et active, et de ce
fait, gage de l'avenir de la commune n'est pas moins importante. Si nous
considérons la célèbre et populaire maxime de ce
démographe de l'antiquité « il n'y a de richesse que
d'hommes«, nous pouvons conclure que la commune de Bohicon dispose de
ressources humaines suffisantes pour pouvoir promouvoir son
développement. L'homme est à la fois le moyen et la fin de tout
processus de développement, il en est à la fois en amont et en
aval.
1.2.4. Ressources économiques de la commune
Les principales activités de la population sont par
ordre d'importance décroissant le commerce (46% des actifs),
l'artisanat (17%), le fonctionnariat (15%) et l'agriculture (11%). Le nombre
d'actifs dans le secteur agricole a diminué de plus de moitié
entre1979 et 2002 (en passant de 24% à 11%) au profit du commerce
pendant que le nombre des artisans est resté stable dans la même
période. (Monographie de Bohicon, 2006)
Cette évolution des activités commerciales a
donné au marché central de la commune toute son importance. En
effet, ce marché qui s'anime tous les quatre jours constitue un
véritable lieu de transactions et d'échanges entre les divers
acteurs où la provision de tout ce dont on a besoin se fait. Le conseil
communal a su vite remarquer le poids économique que constitue ce
marché dans les finances locales de la commune et procéda
à son réhabilitation. Aujourd'hui, le marché central de
Bohicon est un marché à caractère départemental et
national. Départemental en ce sens qu'il est beaucoup
fréquenté par les populations des communes environnantes à
savoir les communes d'
Abomey, d'
Agbangnizoun, de
Djidja, de
Zogbodomey, de
Zakpota,
de Covè et autres. National en ceci que le marché de Bohicon
n'est plus seulement un point de rencontre entre l'offre et la demande pour les
citoyens locaux ou des communes voisines mais représente tout un
pôle de transit d'articles entre le sud et le nord du Bénin, entre
les marchés du sud en l'occurrence le marché international de
Dantokpa et les marchés du département des Collines et toutes les
zones septentrionales du pays. L'économie de Bohicon étant en
majeure partie fiscale, le marché central communal, national constitue
un facteur socle des ressources fiscales dont dispose la commune.
En dehors du marché central, d'autres marchés
secondaires fondent l'économie locale des populations. Il va s'agir des
marchés qui se situent dans la plupart des arrondissements,
spécifiques dans les échanges mais qui s'animent de façon
harmonisée pour ne pas coïncider avec le jour du grand
marché. Tous ces marchés sont d'une importance pour la commune du
fait qu'ils ne manquent d'apporter leur pierre à l'édifice de la
constitution des ressources pour la promotion du développement local.
C'est d'ailleurs la véritable raison qui pousse le conseil communal
à procéder à leurs création et
réhabilitation.
Après le commerce, l'artisanat s'impose comme
étant le second secteur économique dans la commune de Bohicon. Il
occupe un nombre important de l'ensemble de la population (17 % des
actifs) et contribue beaucoup, lui aussi de son côté, aux recettes
communales (38% de l'ensemble des recettes locales). Monographie de Bohicon,
2006. Ces acteurs répartis en 1425 ateliers, selon la monographie
élaborée depuis 2006, mettent sur le marché des produits
diversifiés en vue d'approvisionner les marchés en artisanal.
Aussi, la commune de Bohicon se fait-elle compter parmi les
communes du département qui détiennent une importante gare
routière constituée de deux parcs automobiles et de taxi-moto
régulièrement installés. La gare routière de la
commune alimente le transport régional en desservant les communes
voisines et celui national. Surtout en raison de sa position
géographique stratégique, la commune de Bohicon constitue un
véritable pôle de transit pour les transporteurs entre le
Port
autonome de Cotonou et le nord du Bénin, voire les pays de l'inter
land ; la construction d'un parking de transit pour les gros porteurs en
est une illustration. La ville revendique la quatrième place en termes
d'importance économique et de contribution à l'alimentation des
ressources financières du Bénin.
La situation géographique de la ville de Bohicon,
permettant le transport et le commerce a favorisé le
développement rapide du secteur de l'hôtellerie et de la
restauration. En effet, nombreuses sont les initiatives entreprises dans ce
domaine en vue de satisfaire les transporteurs, les marchands, les
commerçants et surtout les touristes. Il s'agit des buvettes, les bars,
les restaurants et les hôtels qui sont installés un peu partout
dans les zones urbaines de la commune. Ne serait-il pas superflu de parler de
la position mitoyenne de cette ville par rapport à la capitale
historique du pays (Abomey) qui ne cesse de recevoir en permanence des
visiteurs et touristes venant d'un peu partout du territoire national voire
d'au-delà des frontières. Ces touristes résident pour la
plupart pendant leur séjour dans ville métropolitaine du
département située juste à côté sur la voie
inter-Etats. Aussi, la découverte et l'aménagement du site
historique et archéologique d'Agongointo attirent plus d'un touriste
pour attribuer à la ville de Bohicon un caractère touristique.
Dans la commune de Bohicon, l'agriculture ne contribue-t- elle
pas en tant que tel aux finances locales en ce sens qu'elle est essentiellement
une agriculture de subsistance ; étant donné que l'espace
cultivable s'amenuise de jour après jour. Pourtant, elle permet aux
populations de ne pas trop dépendre d'autres communes en matière
de produits vivriers.
Structure financière
Au service de l'administration publique jusqu'à la fin
des années 1990, la structure financière de la ville de Bohicon
repose fondamentalement sur les banques et les institutions de micro-finance.
Depuis le renouveau démocratique, le développement du tissu
économique de la ville a suscité un grand intérêt
pour le secteur financier béninois. La grande majorité des
banques du pays y ont ouvert des agences, comblant ainsi le vide
engendré par la disparition de la Banque commerciale du Bénin
(BCB) vers la fin des années 80. Aujourd'hui, on y dénombre
près d'une dizaine d'agences de banque. Au rang des structure de
micro-finance : PAPME, PADME, CPEC et la CLCAM auxquels s'ajoute un nombre
important de petites institutions qui ont pour vocation de distribuer certaines
formes de crédit d'accès aisé à la population en
général.
Système de communication mise en place dans
la commune
La commune de Bohicon n'a pas manqué de mettre sur pied
un système de communication permettant d'assurer le circuit
d'information avec les acteurs communaux. En effet, au sein de son organisation
administrative se trouve un service chargé de communication
dénommé Service Communication et Protocole. Ce service est la
structure organisée de la mairie chargée d'assurer l'information
entre les différents services internes et externes de la mairie. C'est
également ce service qui se charge de mettre l'information au niveau du
public. Cela constitue déjà un pas non négligeable pour la
mairie dans le domaine de la communication. L'information est rendue accessible
au citoyen dans la commune de Bohicon par les canaux comme l'affichage, la
presse orale (radio locale) et par les crieurs publics. A chaque canal est
destinée une catégorie d'information bien précise. Ainsi,
les PV et les comptes rendus des sessions ou conseils communaux sont mis
à disposition du public par l'affichage. Le citoyen est
présumé se faire informer des délibérations du
conseil en se déplaçant de temps à autre à la
mairie, à l'endroit indiqué pour en faire lecture. Par les
crieurs publics, sont passées des informations relatives à une
campagne de vaccination, de don de sang ou de sollicitation de la population
à une action de solidarité.
La radio s'occupe très souvent des informations ayant
trait aux actions déjà entreprises par la mairie. Les organes de
la presse de la commune sont invités aux cérémonies
d'importante envergure en vue de faire parvenir l'information à un
public un peu plus large aux fins peut-être de promouvoir et de graver
l'image positive de l'équipe de gestion dans la conscience collective
des populations. Ainsi, les informations données par la presse orale ou
télévisée sont exclusivement relatives à la mise en
exécution des actions du maire ou du conseil.
Faut-il souligner aussi les réunions de concertation et
d'explication qui se tiennent au sein de l'ensemble du personnel de l'organe
communal. A travers ces réunions, le maire avec son cabinet essaie de
mettre lesdits agents au parfum des informations qu'il juge pouvant leur
parvenir et leur explique ainsi que de donner de recommandation ou
d'orientation pour la réussite des actions.
Partie II
PROBLEMATISATION DE LA RECHERCHE
2.1- REVUE DE LITTERATURE
La participation des bénéficiaires au processus
de développement fait l'objet de plusieurs débats et
études en Afrique et dans tout le monde. Ainsi, elle préoccupe
bon nombre de chercheurs et institutions qui ont mené des investigations
et études spécifiques dans le domaine en vue de cerner le contour
de la question et de redynamiser les moyens et stratégies mis en place
pour promouvoir le développement.
La nécessité de la communication dans la
gestion
La FAO (1994), se propose de développer le concept de
communication pour le développement en l'illustrant par des exemples
concrets issus d'expériences personnelles visant à montrer
comment les méthodes et techniques de communication peuvent servir de
base à l'atteinte des objectifs du développement. Il s'agit des
dispositions qui doivent être adoptées par les décideurs et
les planificateurs pour que la communication joue pleinement son rôle.
Ainsi, dans son rapport « la communication pour un
développement à dimension humaine », elle montre
toute l'importance de la communication qui devra être conçue comme
un secteur transversal, au même titre que l'éducation, la
formation ou la planification. Elle doit être observée dans tous
les secteurs de la vie économique où la participation populaire
est indispensable. Selon la FAO, le rôle de la communication est
décisif pour promouvoir un développement qui prenne en compte la
dimension humaine dans le climat de changement social. En effet,
l'évolution du monde vers plus de démocratie, de
décentralisation et l'introduction de l'économie de marché
crée des conditions favorables pour que les populations deviennent les
principaux acteurs du changement. Il est alors essentiel de susciter leur
participation et leur capacité d'initiative. La communication a un
rôle central à jouer dans ce domaine dans ce cas. Elle est une
source de motivation au développement. Malheureusement, la FAO a
montré que la communication est encore sous-utilisée dans
beaucoup de pays africains. Elle doit être cependant en amont et en aval
de toutes les actions de l'Etat ou des institutions de développement.
D'où, la FAO privilégie, primo une politique
générale de communication qui, prenant de façon
participative en compte les besoins des populations, doit établir la
formulation de tout programme de développement concernant les
communautés rurales et exprimer les objectifs et les plans
stratégiques de réalisation. Secundo, la création d'une
nouvelle législation : les interrelations entre ministères,
institutions et ONG et la définition de leurs attributions respectives
en matière de communication pour le développement devront faire
l'objet de dispositions juridiques et d'une réglementation
spécifique. Tertio, elle propose un cadre institutionnel
approprié pour la coordination logistique et organisationnelle des
activités de communication. Quarto, elle préconise une autonomie
financière des services ou structures de communication en vue d'un
d'autofinancement.
De grands ateliers se sont tenus aussi sur la communication
dans la gouvernance pour mettre en relief sa place déterminante.
Ainsi, des premières journées de la commune
africaine, dénommées « Africités
98 » tenues du 26 au 31 janvier à Abidjan (Côte
d'Ivoire), il ressort certaines décisions stratégiques. Au cours
de cette rencontre, plus d'un millier de participants dont plus de 300 maires,
des ministres, des directeurs de services techniques, des experts, des
représentants d'agences internationales de coopération, des
chercheurs et des communicateurs ont réfléchi sur la plupart des
problèmes de la gouvernance municipale. Des débats enrichis
d'avis d'experts et nourris de leçons de l'expérience
régionale et internationale ont été menés sur les
quatre sujets suivants et ce, par ateliers :
- la priorité entretien ;
- les enjeux de la communication locale en Afrique ;
- des villes et des régions solidaires dans un monde
solidaire ;
- la ville africaine : un marché
émergent.
A l'issue de réflexions fournies lors de chacun des
ateliers, des différentes mesures ont été prises pour
l'amélioration de la qualité de gestion au niveau local. Pour le
compte de l'atelier sur « les enjeux de la communication locale en
Afrique », un accent particulier est mis sur la
nécessité de considérer la communication comme un outil de
développement. Outre un appel à une coopération plus
étendue entre médias et collectivités locales, et en
faveur d'un échange permanent et simple entre municipalités et
administrés, les participants de cet atelier ont insisté sur
l'impératif rôle de la communication locale : celle-ci doit
constituer un outil d'accompagnement et d'explication des politiques
municipales et favoriser au niveau des différents acteurs un sentiment
d'appartenance.
Centrés sur les deux conditions nécessaires
relatives à la communication à savoir : le
développement de la citoyenneté, d'un sentiment d'appartenance
à la cité, et la promotion d'une image positive de la ville, les
débats constituent un cadre privilégié de vives
discussions entre les dirigeants d'une part, les journalistes et les
professionnels des médias d'autre part, en vue d'établir une
nette distinction entre les concepts de communication et de propagande. Ainsi,
la communication ne doit pas être prise pour une politique autonome qui
se substituerait aux actes concrets ou pallierait artificiellement l'absence de
politiques réelles. Elle ne doit pas être pour les dirigeants
locaux, une occasion d'abus de la démocratie pour flatter les passions
populaires ou pour développer la subtilité démagogique
afin de parvenir à leurs fins politiques. Elle doit être en accord
avec l'image vécue par la population dans le but de donner plus de
confiance aux partenaires techniques et financiers. D'où la recherche
d'harmonie entre la réalité promue (le dire) et celle
vécue (le faire) nécessitant une implication tous les acteurs
locaux.
C'est dans cette optique qu'il est utile d'évoquer
l'atelier de la coopération maghrébine des villes et
municipalités sur la bonne gouvernance.
En effet, tenu du 18 au 19 octobre 2012, l'atelier porte sur
le thème « communication locale, un outil
d'amélioration de la gouvernance locale » pour montrer
toute l'importance de la communication dans la gestion communale. Il en ressort
que pour être réel et durable, le développement local est
une oeuvre collective impliquant plusieurs acteurs. Le seul moyen par lequel
ces acteurs peuvent s'expliquer leurs rôles puis se confier les uns les
autres est la communication. La gouvernance locale suppose le respect des
principes de participation, de transparence, de responsabilisation, de
primauté du droit, d'efficacité et d'équité. Il en
jaillit comme conséquences la mobilisation, l'implication, la
crédibilité, la disponibilité, et l'efficience en vue
d'éclore le développement local et le changement social.
D'où, la communication est au coeur de la gouvernance.
La gestion participative
Dans le bulletin intitulé «
financer la décentralisation rurale : Taxes
et impôts à l'échelle locale au Bénin, Burkina Faso
et Mal », Bako-Arifari, Dicko, Doevenspeck, Sanou et Singer
(2004) insistent sur le fait que la décentralisation fiscale doit
être au coeur de toute gestion décentralisée. Ainsi, pour
assurer le fonctionnement de la collectivité et exécuter le plan
de développement communal, les communes doivent mobiliser des ressources
financières locales. Le volume à mobiliser est fonction des
ambitions de développement de la commune, des procédures de
contrepartie concernant les investissements, des subventions disponibles, de la
capacité et de la volonté des populations des communes à
participer par le paiement des taxes et impôts ou de contributions
occasionnelles. Mais, en Afrique de l'Ouest, selon Bako-Arifari et al (2004),
le recouvrement des taxes et impôts au niveau local a
généralement été faible en raison du manque de
volonté des populations de payer. La coercition est souvent le principal
moyen utilisé pour les y contraindre. Cependant, la volonté de la
population de confier une partie de ses ressources à la commune,
affirment ces auteurs, est fonction de l'importance qu'elle accorde aux
activités proposées et de la transparence de la gestion
financière de la commune. Alors, « c'est donc de plus
en plus aux collectivités locales qu'il appartient de
répondre à la demande, sans cesse croissante d'équipement
collectif [...] car les collectivités locales, en dépit de leurs
faiblesses et leur manque de ressources financières, sont mieux
placées que quiconque pour répondre aux besoins
locaux ». (Banque Mondiale, 2002)
Le magazine trimestriel d'information sur la
décentralisation et la déconcentration intitulé
La Territoriale met accent sur les principes de la
gouvernance locale consignés dans la charte de la gouvernance locale au
Bénin mise en vigueur en 2011. En effet, pour une réelle
promotion du développement local et de la démocratie à la
base, le respect strict de ces règles doit être de mise dans les
espaces communaux et municipaux. Il s'agit de la légalité
et/ou la primauté du droit ; la participation des citoyens
organisés ou non au processus de prise de décisions ; la
transparence dans le partage de l'information impliquant une ouverture de
procédures de gestion de prise de décisions ;
l'efficacité et l'efficience des décisions et actions des
autorités locales ; l'équité, l'égalité
et l'impartialité dans le traitement des cas similaires ;
l'obligation de compte rendu des élus à leurs mandants et des
fonctionnaires communaux à leurs hiérarchies, la
responsabilisation ou l'imputabilité des élus et fonctionnaires
communaux et enfin la prise en compte de la dimension genre. Ces règles
visent, en somme, la gestion saine des affaires publiques pour une
réussite effective du processus de décentralisation amorcé
au Bénin. Ce magazine d'information y met un accent particulier dans le
but de rappeler et de repréciser aux différents acteurs de la
gouvernance locale leurs rôles et missions, afin de les ramener à
l'ordre. Ces principes constituent la ligne directrice de toute gestion. Ils
n'ont pas mis en marge l'aspect de la participation et d'implication des
citoyens. En effet, la reddition de comptes de la gestion, la participation des
citoyens au processus de prise de différentes décisions et aux
diverses phases des projets de développement doivent être une
activité quotidienne dans la gestion.
Dans «un aperçu sur la décentralisation
fiscale et les finances locales en Afrique francophone« Boko (2008),
souligne les difficultés des collectivités locales en
matière de la décentralisation fiscale. Après son
étude sur la relation qui existe entre l'autonomie fiscale des
Administrations locales et le solde budgétaire ainsi que la taille
financière du gouvernement central, l'auteur parvient à cette
conclusion : la mise en application de la décentralisation fiscale
en Afrique francophone est handicapée par plusieurs obstacles. D'abord
l'économiste Boko montre l'étroitesse de la base des recettes des
administrations locales. Ensuite, les systèmes de gestion
financière au niveau local ne remplissent pas les normes internationales
et demeurent inadéquats vis à vis des responsabilités
accrues qui accompagnent la décentralisation. Enfin, le chercheur
affirme que les systèmes de contrôle (audit interne et externe)
sont encore très faibles. Il relève aussi le problème de
la faiblesse d'accès du public à l'information qui est d'ailleurs
un efficace outil de contrôle de la gouvernance. D'où
l'inexploitation du capital humain et social.
Après avoir exposé le rôle du gouvernement
dans l'application d'une politique de la décentralisation fiscale, Boko
débouche sur la responsabilité des communes vis-à-vis de
leurs citoyens. Les communes doivent procéder à
l'élaboration d'une planification stratégique qui permet aux
autorités locales, en concertation avec la population, de définir
une vision, d'identifier les objectifs stratégiques á atteindre,
de développer un plan d'action, d'allouer les ressources
nécessaires á la réalisation des objectifs et d'identifier
les rôles et contributions de chaque partie prenante. Elles doivent
également et surtout procédé à une planification
opérationnelle qui est un plan de mobilisations des ressources locales
qui permet d'orienter les communautés locales vers une meilleure
exploitation des techniques d'émission et de recouvrement mises à
leur disposition par la loi relative aux finances locales. Aussi les
compétences de l'administration fiscale et les capacités de
gestion des communes doivent-elles être renforcées pour mieux
exécuter les objectifs d'une planification opérationnelle.
La communication pour la participation
populaire
Dans son article information et participation populaire au
développement, Adotevi (1984) fait cas de cette participation qui
doit être sous-tendue par une information régulière des
populations cibles. Il s'inscrit alors dans une logique africaine de
participation et d'information populaire. En effet, le
sous-développement suppose une organisation particulière. Cette
organisation doit prendre en compte tous les éléments
susceptibles de promouvoir le développement, considéré
comme une activité dont l'objet est la mise en oeuvre de toutes les
potentialités humaines, financières, matérielles et
naturelles. Parlant des potentialités, l'auteur met l'accent sur la
valorisation de toutes les couches constituant la population qui doivent
être considérées comme le moteur et la
finalité du changement. (Adotevi, 1984, 401p). L'auteur propose
une politique persuasive sous-tendue par l'information et la
communication au détriment de la méthode
contraignante : « Sans une information correcte,
reçue et rendue par la population concernée, tout projet de
développement est voué à
l'échec.... cette information doit précéder
l'action, se maintenir pendant son exécution et se poursuivre
après, si l'on veut que la participation des populations soit effective
et active » (Adotevi, 1984, 403p). Le rôle capital de
cette information est de mettre la population au centre de tout le processus de
développement et de lui montrer qu'elle est une unité en
évolution, une « communauté
économique » en croissance. L'information participe de la
prise de conscience de la population par rapport à ses rôles et
missions pour la réalisation des objectifs pour lesquels des
investissements se font dans le milieu. Mais comment informer les
populations ? Par quels mécanismes peut-on le faire ?
Parmi les nombreux moyens de communication existant, Adotevi
privilégie la radio, la télévision et la presse
quotidienne qui pourront permettre d'expliquer, de clarifier et de faire des
comptes rendus fidèles aux populations. Ces moyens permettront à
l'ensemble des citoyens de se rendre à l'évidence de ce que le
gouvernement, chaque commune ou village réalise dans le cadre de la
promotion de son développement pour que « ça
change » ou pour que « ça ne change
pas », afin d'en prendre appui. Ces instruments loin de
constituer un réseau de propagande et de démagogie pour les
gouvernants, doivent s'utiliser pour maintenir l'éveil de la population
à l'égard de leurs problèmes ou pour des comptes rendus
objectifs et fidèles.
Ce chercheur débouche enfin sur la notion de la
« presse rurale ». En effet, l'information ne doit pas
être seulement verticale ou à sens unique ; elle doit aussi
partir de la base au sommet. La presse rurale constitue l'indéniable
canal à travers lequel les acteurs-cibles pourront exprimer et faire
parvenir leurs besoins, problèmes et initiatives aux dirigeants. A cet
effet, l'alphabétisation fonctionnelle jouera un rôle
prépondérant.
De même, dans son ouvrage intitulé «La
décentralisation entre risques et espoirs« Dehoumon (2006) a
fait une analyse du processus de décentralisation
déclenché au Bénin depuis 2003. Selon lui, la
décentralisation considère les collectivités locales comme
des espaces d'un développement économique et social devant
nécessairement passer par l'esprit d'initiatives, la
responsabilité et la maximisation de l'utilisation des
potentialités locales. Mais ce changement social et économique ne
peut s'éclore sans la participation citoyenne qui est un principe
capital du processus de décentralisation. Selon l'auteur, c'est un
garant pour la promotion du développement politique et
économique ; développement politique dans le sens de
l'approfondissement de la démocratie à la base et
développement économique en ce que la décentralisation
vise le changement social et l'amélioration des conditions d'existence.
Il n'y a donc pas de démocratie locale si le citoyen n'exerce, ni ne
jouit de sa liberté de pensée, d'expression et de participation
au processus de prise de décisions puis de son droit de contrôle
permanent de la gestion des dirigeants communaux. S'appuyant sur la
première expérience de l'exercice du pouvoir
décentralisé, Dehoumon essaie de situer la faille de la froide et
passive relation qui se tenait entre les responsables locaux et les
populations: les dirigeants et les citoyens ne sont pas préparés
ou formés au mode de gouvernance de la décentralisation. Les
citoyens dans un contexte africain sont comme un ensemble d'individus qui se
considèrent comme de simples bénéficiaires des projets ou
actions orientées à leur intention. C'est un monde à part,
très exigeant qui ne réclame que ses droits, se souciant
très peu de ses devoirs. Alors, il leur faudra une formation, une
éducation et une sensibilisation particulières et
répétées afin qu'ils aient la « conscience
civique » de leurs rôles dans la reconstruction de
l'édifice communal. Selon cet auteur, ceci n'est possible qu'en
résorbant le problème de communication noté au niveau des
administrations locales. En effet, la communication, dans un système de
démocratie locale est une réorganisation des échanges au
sein de la société dans le sens d'une reconnaissance de
l'individu, considéré non plus comme un spectateur passif de
développement, mais plutôt comme un acteur impliqué et
responsabilisé. « Lorsque le citoyen n'est pas
impliqué dans la gestion municipale, il vivra deux choses : les
réalisations et des rumeurs et toute initiative qui lui est
étrangère provoque de sa part un rejet, ou, pour le moins, son
indifférence ». Dehoumon (2006). Sa participation ou son
information sur n'importe quelle décision influant ou concernant sa vie
s'avère indispensable. C'est alors une source de motivation.
Au chapitre de « Gouvernement et
transparence » de l'ouvrage intitulé « Le
droit d'informer : le rôle des médias dans le
développement économique », Stiglitz (2005) met
l'accent sur le rôle de l'information dans la gouvernance. En effet,
comme les dirigeants d'une entreprise et ses actionnaires, il doit être
observé un courant d'information entre les gouvernants et ceux qu'ils
sont censés servir, gage d'une transparence dans la sphère
publique. Il s'agira d'une nouvelle base de relations entre les gouvernants et
les gouvernés, relations qui reposent sur les principes mêmes du
processus démocratique. « Dans toutes les
sociétés démocratiques, les citoyens ont le droit
d'être informés, d'exprimer leur opinion, de savoir ce que fait le
gouvernement, pourquoi il le fait, et d'en débattre ».
(Stiglitz, 2005). Une gestion empruntant ce modèle est disposée
à la transparence et à l'ouverture. L'ouverture est un
élément essentiel du contrôle qu'exerce le peuple sur son
gouvernement, une véritable clé de voûte des processus
démocratiques mais à laquelle tout secret ou secret de tous
genres «fait obstacle''.
Pour ce faire, les médias ont un rôle capital
dans l'accessibilité et la mise à disposition d'informations aux
populations. L'information des citoyens n'est possible que grâce aux
médias qui jouent un rôle déterminant dans la compilation,
la diffusion ou la communication des données informationnelles. Il
s'agit de médias auxquels le législatif ou le
réglementaire accorde un cadre bien approprié.
Amadou (2008), à travers son mémoire de fin
d'année de maîtrise en Sciences et Techniques des Actions
Socio-Educatives intitulé « La problématique de la
communication dans la gouvernance locale au Bénin: le cas de la commune
de Savé » s'intéresse à la question de
participation et d'information communautaire dans les communes. A travers cette
étude, il a étudié les rapports qui existent entre les
élus locaux et les citoyens d'une part et l'importance qu'accordent les
responsables à la communication sur la gestion des affaires publiques
d'autre part.
En ce qui concerne les rapports entre les dirigeants et les
citoyens, les résultats de ses travaux ont permis de constater que les
difficultés de la mise en oeuvre de la décentralisation à
sont liées d'une part au faible taux des populations ayant conscience de
leurs rôles et contribution au développement de la localité
et au très faible niveau d'implication de ces dernières dans la
gestion de leurs affaires ; soit un pourcentage de 95,31% en sont
laissés en marge. Il est parvenu à la conclusion selon laquelle
les relations entre administration locale et population sont
caractérisées par une absence de solidarité agissante, un
défaut de considération et d'implication des citoyens.
Pour analyser le degré de la mise en oeuvre de la
communication dans la gouvernance, l'auteur, après avoir
interrogé les élus locaux et les populations, a soulevé
certaines insuffisances dont la gestion unilatérale,
l'incrédibilité des responsables et le déficit
d'information. Des séances d'information ne sont pas
périodiquement organisées dans la commune, de même la
reddition de comptes des séances du conseil communal n'est pas
effective. Les populations en conséquence n'ont aucune idée de
la gestion financière des ressources fiscales, ce qui est d'ailleurs un
handicap pour la relation entre les citoyens et les dirigeants de la commune de
Savè. Tout ceci veut dire qu'en réalité, les citoyens sont
en marge de la gestion quotidienne de leur localité contrairement aux
dispositions de la loi.
Ainsi tous ces fondements et idéologies donnent aux
collectivités la plus lourde des responsabilités en
matière de stratégie de développement. C'est dire que la
participation, l'imprégnation des collectivités dans la gestion
locale se pose et s'impose de nos jours à la conscience de tous les
gouvernants.
2.2- CADRE THEORIQUE
2.2-1 Clarification des concepts
Gouvernance locale : c'est un
système d'administration et de gestion locale dans lequel l'ensemble des
acteurs sont appelés à coordonner leurs efforts dans la
conception, la mise en oeuvre et le contrôle des actions de
développement local ; Selon le PNUD, elle comprend un ensemble
d'institutions, de mécanismes et de processus par lesquels les citoyens
peuvent exprimer leurs intérêts et leurs besoins, négocier
leurs différences et exercer leurs droits et leurs obligations au
niveau local. Elle implique donc un partage du pouvoir dans le processus
décisionnel. Elle doit contribuer de façon significative
à la décentralisation démocratique, à la
réduction de la pauvreté et à la gestion durable des
ressources naturelles locales. La gouvernance locale est aussi entendue
comme « un processus permettant aux élus
locaux de bien gérer les affaires publiques suivant les dispositions
juridiques en vigueur et avec une certaine transparence et visibilité.
Cette gouvernance suppose que les élus responsables de la commune
mettent tout en oeuvre pour la promotion de l'économie locale et un
épanouissement de la vie communale ».
On distingue plusieurs types de gouvernance. Pour le CIRD, il
existe quatre niveaux de gouvernance à l'échelle locale :
politique, administratif, économique budgétaire et financier.
La gouvernance politique locale explique le processus de prise
de décisions dans l'exercice d'une gestion démocratique
locale ; quant à la gouvernance administrative locale, elle
implique la gestion des services publics locaux, la gestion de l'état
civil, la gestion des ressources humaines et la tutelle administrative alors
que la gouvernance économique locale apporte un éclairage sur
quelques démarches en matière de mobilisation des ressources
internes et externes au niveau local, en matière de gestion du
patrimoine foncier communal. Enfin la gouvernance budgétaire et
financière locale explique les procédures de présentation
du budget de la commune, l'exécution et le contrôle de ce budget.
Au niveau de chacune de ces formes de gouvernance, la communication doit servir
de cordon ombilical reliant tous les acteurs, les amenant à parler la
même langue afin de converger leurs efforts aux mêmes buts.
Développement local :
c'est la promotion du changement dans une localité, dans une commune.
Selon Albertini (1981), « le développement local n'est pas
la croissance économique, mais un mouvement culturel, économique,
social qui tend à augmenter le bien-être d'une localité....
Il doit valoriser les ressources d'un territoire par et pour les groupes qui
occupent ce territoire. » Le développement local est
donc une initiative des citoyens et permet la promotion économique,
sociale et culturelle de leur milieu par la valorisation des
potentialités du terroir.
Selon Guidou (1984), « le développement
local est l'expression de la solidarité locale créatrice de
nouvelles relations sociales et la manifestation de la volonté des
habitants d'une micro-région de valoriser les richesses locales, ce qui
est créateur de richesse économique ». Le
développement local dans une commune ne peut donc se passer de la
participation des citoyens qui sont les bénéficiaires de cette
action. C'est une forme alternative de développement qui consiste
à rechercher localement et avec le concours des populations,
l'amélioration significative de leur situation. Cette démarche
passe par un sentiment d'appartenance au territoire et l'émergence d'une
dynamique collective démontrant la capacité d'un groupe à
identifier ses ressources et à prendre en main son destin. (Amadou,
2008). C'est le résultat de l'ensemble des initiatives d'une
communauté pour l'amélioration du quotidien et des perspectives
d'avenir, une dynamique au sein de laquelle la participation de tous les
acteurs est prépondérante.
Participation : selon le dictionnaire
Le Robert pour tous, c'est l'action de prendre part à quelque
chose. C'est le rôle que l'on joue dans un ensemble. La notion de
participation dans la gestion a donné naissance à beaucoup de
théories et concepts : l'approche participative, le
développement participatif, le développement communautaire,
démocratie participative, démocratie de proximité...
toutes ces théories développées visent la même
finalité : l'implication de tous les acteurs du
développement et surtout la responsabilisation des citoyens des actions
de développement. La participation est pour une personne ou une
communauté, le fait de prendre part à une décision,
à son exécution et à la jouissance de ses
résultats. Elle doit s'observer au niveau de toutes les instances de
gouvernance locale et peut être financière, matérielle
comme en main d'oeuvre.
La participation peut connaître divers
degrés :
* La transparence : Les instances qui
détiennent le pouvoir se limitent à informer et rendre compte des
décisions prises, de leur processus et de leurs résultats. C'est
le degré le plus faible de la participation. Les populations ne peuvent
guère influencer les décisions, contribuer à
l'exécution et profiter des résultats.
*La consultation : L'instance de pouvoir
demande l'avis des personnes concernées et tient compte de leur
réaction. La participation reste faible surtout pour ce qui est de
l'exécution et des résultats.
*La concertation : Diverses instances de
pouvoir échangent leurs avis (sur un pied d'égalité et
prennent ensemble des décisions). La participation est plus importante,
mais ne dépasse guère le domaine de la prise de
décision.
*L'implication : Instauration d'une
dynamique participative généralisée, au quotidien,
pilotée par la collectivité locale, plus qu'une offre de
participation ponctuelle proposée par une institution autour d'une
problématique précise.
*La collaboration : En plus de la
concertation au niveau de la décision, les instances se partagent
également le travail. Une conception collective du projet
s'établit dès le départ entre divers acteurs du
territoire. Les pouvoirs publics acceptent d'entrer dans une dynamique commune
de réflexion et de choix d'orientations partagées avec d'autres
acteurs. Il ne s'agit plus de participer à la conception de projets ou
à la décision à leur propos, mais bien de participer
à leur mise en oeuvre concrète. C'est un niveau de participation
plus élevé.
*Le soutien : L'intervention ne se fait
plus que sous la forme d'un appui (contributions, conseils, aides, etc.)
à une initiative qui appartient à d'autres. La participation des
personnes concernées est maximale
Communication locale : la
communication tout simplement est le fait de communiquer, de faire savoir
quelque chose à quelqu'un. Elle est un processus dynamique au cours
duquel deux/plusieurs individus ou deux/plusieurs organisations ou encore
individu(s) et organisation(s) échangent et partagent des informations,
des idées, des opinions, des sentiments ou des réactions.
En terme de gouvernance, la communication appelée
locale est un ensemble d'actions entreprises par une commune dans le but de
favoriser l'adhésion de ceux qui vivent et/ou circulent dans l'espace de
proximité, mobiliser et d'impliquer l'ensemble des acteurs locaux
(décideurs et citoyens). Selon la FAO (2002) citée par Amadou,
elle est « l'utilisation du processus de communication, des
techniques et des médias pour aider les gens à prendre conscience
de leur situation et des options à leur disposition pour toute action de
changement, à résoudre le conflit social et à travailler
vers un consensus, à aider des gens à planifier l'action de
changement et du développement durable, à aider les populations
à saisir les connaissances et les qualifications en vue
d'améliorer leurs conditions et celles de leur communauté et
améliorer l'efficacité des établissements
publics ». Elle consiste en « l'utilisation de
façon planifiée et organisée des techniques et des moyens
de communication (médiatiques ou non médiatiques) pour promouvoir
le développement, à travers un changement d'attitudes et/ou de
comportements, en diffusant l'information nécessaire et en suscitant la
participation active et consciente de tous les acteurs y compris des
bénéficiaires au processus ». C'est donc une
communication qui doit se traiter dans une logique de proximité, de
transparence, de continuité, d'actualité et de modernité.
Il existe plusieurs types de communication dans la gestion locale :
La communication exécutive dont le but
est de donner de la lisibilité aux choix stratégiques et à
l'action communale. Elle aborde aussi la communication financière
(budget, coûts de projets), les activités du conseil municipal ou
communal, du Maire... utilisant des moyens comme les publications,
émissions interactives, séance d'écoute des citoyens,
boites à idées...
La communication interne: Pour assurer une
circulation efficace de l'information au sein de l'équipe communale.
Elle suppose la circulation de manuel de procédure, organigramme, notes
de formations, gestion des réclamations, notes de services, rapports,
réunions, messagerie interne et autres... en vue de l' efficience et
l'efficacité de l'administration locale.
La communication de service pour mieux faire
connaitre aux populations les services et les prestations rendus par la commune
à travers les émissions radio, guides, dépliants...
La communication relationnelle pour mobiliser
les populations et autres acteurs de développement. Le premier
responsable de la commune puisse aller en tournée dans les
arrondissements, les quartiers et les villages dans le but de la participation
citoyenne et la proximité.
La communication civique pour le
renforcement de la citoyenneté (habitant > citoyen), pour
l'acquisition des comportements civiques et fiscaux à adopter aux
populations grâce aux campagnes d'information et de sensibilisation
organisées périodiquement.
Le marketing territorial qui est une forme de
communication s'occupant de la promotion du territoire communal auprès
des Partenaires Techniques et Financiers dans la promotion d'une image positive
de la commune, le partage des expériences afin d'attirer plus de
capitaux externes.
2.2.2- Modèle d'analyse : la théorie de
Adotevi (1984)
La communication est le seul moyen par lequel un climat de
collaboration, de partage et de compréhension puisse se maintenir entre
les différents acteurs de développement. Ainsi, elle est un
élément fondamental qui suscite la participation populaire sous
toutes ses formes. Cela nous amène à nous servir de la
théorie de Adotevi (1984) sur la participation populaire comme notre
modèle d'analyse. En effet, selon lui, pour une participation des
citoyens aux projets de développement, il faut la mise en place d'une
politique persuasive qui aura comme moyen d'action l'information et la
communication : « Sans une information correcte,
reçue et rendue par la population concernée, tout projet de
développement est voué à l'échec ». Cela
permet de mettre véritablement au service de la société
toutes les couches sociales et toutes les ressources territoriales susceptibles
de promouvoir le développement qui n'est que le résultat de la
mise en oeuvre des potentialités humaines, financières,
matérielles et naturelles. Ce faisant, on procède à une
responsabilisation des citoyens en les considérant comme le moteur et la
finalité du changement. Ce faisant, la communication participe de la
prise de conscience des citoyens par rapport à leurs rôles et
missions dans les actions de développement pour l'atteinte des
objectifs. Adotevi fait mention ici d'une information locale verticale qui
joue un double rôle : la transparence dans la gestion et la
motivation pour la participation citoyenne.
Mais l'information ne va pas être toujours descendante
ou à sens unique dans la gestion, il faut une autre forme
d'information « ascendante » qui constituera le canal
par lequel les populations puissent exprimer et faire parvenir leurs besoins et
problèmes, leurs aspirations et initiatives aux dirigeants. Selon
l'auteur, cette forme d'information permettra de prendre véritablement
en compte, dans l'élaboration des projets de société, les
profonds besoins et aspirations des populations. La communication locale est
alors un élément de cadrage des projets ou programmes de
développement communaux aux vrais problèmes et besoins que vivent
les citoyens. D'ailleurs, si l'action répond à un besoin de la
population, elle s'investit mieux pour sa réussite.
Il apparaît alors que la communication est un
véritable moyen d'action communale en ce qu'elle génère
transparence, crédibilité et motivation d'une part et constitue
un élément de cadrage des actions de développement aux
besoins citoyens d'autre part.
Communication ainsi comprise, il se pose alors la question
à savoir si les élus locaux en font usage dans leur gestion pour
favoriser la participation citoyenne en vue d'un développement local
effectif.
2.3- PROBLEMATIQUE
La décentralisation, étant un moyen par
excellence de la promotion du développement local et de l'expression de
la démocratie à la base, est devenue une réalité au
Bénin avec l'organisation des élections communales et municipales
de 2002. Cette réforme a permis au pouvoir central de faire le transfert
de certaines de ses compétences et attributions aux collectivités
décentralisées afin de leur doter d'une personnalité
juridique et d'une autonomie financière. (Les art. 94 à 107 de la
loi N° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en
République du Bénin). Les maires et les conseillers communaux ont
pris en mains depuis ce temps la conduite de la destinée des
communautés dont ils ont la charge dans les domaines politique,
économique, socioculturel et environnemental. Pour ce faire, de
multiples outils de développement sont élaborés au niveau
des communes (Plan de Développement Communal PDC, Plan de
Développement Economique et Social PDES, Plan d'Action Environnementale
PAE,...) afin de relever le niveau de vie et d'améliorer la condition
d'existence des populations. Mais il se remarque un véritable handicap
à la réalisation de ces plans : le manque de ressources. Il est
rare de voir ces outils réalisés, au bout du temps à leur
consacrer, à un taux de 50%.
En effet, des études menées dans le cadre du
financement des communes ont mis l'accent sur la situation d'amenuisement
progressif des ressources propres ou locales. Les statistiques
enregistrées nous renseignent qu'il y a eu beaucoup de fluctuations
fiscales au niveau des communes. Le taux des ressources fiscales est descendu
de 95% jusqu'à 45% entre 2008 et 2011 selon les communes. Cette
situation n'a pas manqué d'avoir logiquement de répercussions sur
l'investissement local. En effet, étant donné que la
participation locale devient de plus en plus limitée, l'investissement
territorial des communes en reflète l'image. Les taux d'exécution
des communes sur l'étendue du territoire national montrent que les
espoirs certains qui fondaient le processus de décentralisation ne sont
pas en voie d'être réalisés. (La territoriale, 2012).
Par ailleurs, dans la commune de Bohicon, déjà
en 2003, le taux de réalisation des recettes de fonctionnement est
passé de 80% en 1999 à 30% en 2003 pendant que celui des recettes
d'investissement est passé de 50% en 1999 à 10% en 2003.
(Monographie de Bohicon, 2006).
Cette situation d'amenuisement des ressources locales
dénote d'un manque de participation des citoyens. Mais qu'est-ce qui
pourrait expliquer ce comportement de ces derniers en face des projets de
développement arrêtés à leur intention ?
L'ANCB, se basant sur les résultats de son
évaluation, note une contre-performance dans la gouvernance
locale. Celle-ci se justifie en général par de
faibles scores enregistrés en matière de fonctionnalité
des commissions, du respect des procédures de passation des
marchés publics, d'information des citoyens et de consultation des
organisations et associations féminines. (Rapport ANCB, 2012)
De même, les diagnostics du Programme de Gouvernance et
de Droits de la Personne (PGDP) dans le département du Zou ont
montré qu'il y a une faible implication des acteurs du
développement dans le processus de la gestion
décentralisée. Ce faible taux d'implication des acteurs a pour
cause directe le manque d'information et de communication autour de la
gouvernance communale. On peut en déduire qu'il n'y a pas de bons
rapports de collaboration entre les dirigeants et les citoyens. Ces derniers,
dans ces conditions, ne s'acquittent pas de leur devoir fiscal. Cela justifie
donc les disputes, conflits et tensions qui surgissent chaque fois entre les
agents collecteurs d'impôts ou taxes et les populations. Il urge alors,
comme le préconisait Adotevi, qu'une communication « verticale
et ascendante » s'instaure entre les différents acteurs
locaux : les autorités communales, les agents techniques, les PTF
et les populations cibles.
Pour ce faire, le PGDP de la Danida a fait élaborer
pour chacune des neuf communes du département du Zou en 2006 une
stratégie de communication dans le but qu'elles mettent en amont et en
aval de la gestion, une communication locale qui sera un infaillible outil de
gouvernance et un moyen ad hoc de mobilisation des populations à la
participation en vue d'une réelle promotion du développement
local. Si dans la commune de Bohicon, il se remarque un manque criard de
participation aux actions de développement de la part des populations,
nous sommes en droit de nous demander certaines questions :
Questions de recherche
Ø le plan de communication élaboré par le
PGDP est-il véritablement mis en oeuvre dans la commune de
Bohicon ?
Ø les citoyens sont-ils impliqués dans la
gouvernance locale de la commune ?
Ø quel est le niveau d'information de la population de
Bohicon sur la gestion communale ?
Il est essentiellement question de mettre en exergue, dans
cette étude, le rôle cardinal de la communication pour
l'implication et la participation plus grandissantes des populations aux
actions de développement. En d'autres termes, il s'agit de montrer le
lien étroit qui existe entre la communication dans la gestion et la
participation populaire.
2.4- HYPOTHESES
ü la mise en oeuvre de la stratégie de
communication mise à disposition par le Programme de Gouvernance et de
Droits de la Personne (PGDP) n'est pas effective dans la commune de
Bohicon ;
ü les citoyens ne sont pas impliqués dans la
gestion communale de Bohicon, ni informés de cette gestion.
Partie III
DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Il est question dans cette rubrique de faire état de
l'ensemble des procédés et techniques utilisés pour
recueillir les données ou informations nous permettant de parvenir aux
résultats de notre étude.
3.1- Nature d'étude
Compte tenu de notre modèle d'analyse, nous avons
choisi de faire deux types d'étude : une étude qualitative
et une étude quantitative. En effet, afin d'avoir une description claire
de la manière dont le pouvoir est géré dans la commune de
Bohicon et de comprendre le niveau de participation de la population, une
interview est accordée aux responsables en charge de la gestion
politique et administrative de ladite commune. De même, un questionnaire
est adressé aux populations pour des informations
complémentaires. Cette étude qualitative et quantitative nous a
permis de vérifier nos hypothèses dans notre champ d'étude
et de faire aussi quelques suggestions pour un développement local
durable.
3.2- Population d'enquête
Compte tenu de la diversité des informations à
recueillir, nous avons considéré comme population
d'enquête, l'ensemble des dirigeants (élus locaux et
gestionnaires) et populations impliqués dans la gouvernance locale de la
commune.
3.2.1- Groupes-cibles
Les administrés : les habitants
et les chefs de quartier ou de village de la commune de Bohicon ;
Les membres du conseil communal : les
CA ;
Le personnel de la mairie : le Chef
Service Communication.
C'est à partir de ces groupes cibles que
l'échantillonnage a été réalisé.
3.3- Echantillonnage
3.3.1- Méthode d'échantillonnage
Elle repose sur le choix au hasard et le choix
raisonné.
Choix au hasard
La méthode probabiliste est employée pour le
choix de cinq (5) arrondissements sur les dix (10) que compte la commune. Les
CA de ces arrondissements font partie de notre échantillon parce que
constituant à la fois les dirigeants et le relais de l'information au
niveau des communautés.
Vu l'impossibilité de prendre en compte l'effectif des
habitants des cinq arrondissements sélectionnés, cette même
méthode est utilisée pour identifier les citoyens et les chefs de
quartier ou de village appartenant à notre échantillon.
Choix raisonné
La méthode non-probabiliste est utilisée pour
l'identification de l'agent de la mairie. Ainsi le Chargé de la
communication à la mairie est retenu pour avoir les informations
relatives aux mécanismes d'information dans la commune. Nous pouvons
aussi dire que les cinq (5) CA sont choisis par cette méthode à
considérer que c'est leurs arrondissements qui sont choisis par la
méthode probabiliste.
3.3.2- Techniques d'échantillonnage
En fonction de notre population d'étude, nous avons
procédé à l'échantillonnage aléatoire simple
des habitants et des chefs de quartier ou de village de chaque arrondissement.
Nous avons fait usage de cette opération parce qu'il fallait aller de
maison en maison pour interroger les sujets.
Le même procédé est utilisé pour le
choix des cinq (5) arrondissements sur les dix de la commune. En effet, les
arrondissements ont été numérotés selon l'ordre
alphabétique et inscrits sur des post it puis mélangés. Au
hasard cinq post it ont été tirés : ce sont les
numéros 2 ; 5 ; 7 ; 8 et 6 qui correspondent
respectivement aux arrondissements de Bohicon II, Gnidjazoun, Ouassaho,
Passagon et Lissèzoun.
En ce qui concerne le chef service communication et les
élus locaux, nous les avons identifiés grâce à
l'organigramme dont dispose la mairie de Bohicon après que les
arrondissements sont choisis au hasard.
3.3.3- Taille de l'échantillon
Le nombre de chacun de nos groupes-cibles diffère. Dans
chaque arrondissement retenu, nous avons soumis trente (30) habitants à
notre questionnaire dont un (1) des chefs de quartier ou de village desdits
arrondissements. Ce qui revient à cent cinquante (150) habitants soumis
au questionnaire.
Concernant les interviews, il s'agit des cinq (5) CA et le
Chef Service Communication. Le total fait six (6) sujets.
La taille de l'échantillon est
récapitulée dans le tableau ci-après :
Tableau I : Présentation
de la taille de l'échantillon
|
Population d'étude
|
Nombre total de sujets par catégorie
|
|
Habitants
|
150
|
|
CA
|
5
|
|
Agent de mairie
|
1
|
|
Total
|
156
|
Signalons que les arrondissements dans lesquels se trouvent
les habitants et les CA sélectionnés sont tirés au
sort.
Au total, cent cinquante six (156) sujets sont
enquêtés. Il faut souligner à ce niveau que les sujets sont
interrogés indépendamment de leur sexe. La dimension genre est
ainsi observée dans le cadre de notre étude, ce qui constitue
d'ailleurs un principe pour la gouvernance locale.
3.4- Instruments d'investigation
Au total, nous nous sommes servi de trois outils
d'investigation. Il s'agit du questionnaire et de grille d'entretien.
3.4.1- Le questionnaire :
L'enquête par questionnaire a concerné les
populations, les chefs de quartier ou de village. Cette technique nous a permis
de recueillir auprès de ces personnes, des informations précises
portant sur leur niveau d'information relatif à la gestion et leur
niveau d'implication dans la gouvernance locale.
3.4.2- Le guide d'entretien
Deux (2) guides d'entretien : un (1)
à l'endroit des conseillers communaux et un autre (1) à l'endroit
du chargé de communication en vue de leur offrir une plus grande
liberté d'expression. Cette technique nous a permis d'obtenir des
données relatives à l'information et au niveau de participation
des citoyens.
Les modèles de ces outils se trouvent en annexe de
notre document.
3.5- Collecte des données
Pour administrer les questionnaires, nous nous sommes rendu
dans les arrondissements ciblés pour rencontrer les personnes
concernées. Nous sommes allé de ménage en ménage
pour effectuer les enquêtes. Nous avons partagé les questionnaires
aux enquêtés instruits et les avons assistés dans la
réponse aux questions. Ce qui nous a permis de limiter les mauvais
remplissages, les pertes de questionnaire et de rendre les informations plus
exploitables. Par contre, pour les enquêtés non-instruits, nous
avons essayé de transcrire fidèlement leurs opinions sur nos
feuilles d'enquête.
Pour ce qui concerne les entretiens, nous les avons
réalisés après un rendez-vous. Ces entretiens ont
duré chacun plus de dix (10) minutes.
Nos investigations se sont déroulées du 20 mai
au 7 juin de l'année 2013.
3.6- Traitement des données
ü Traitement des données du
questionnaire
Nous avons procédé au traitement des
informations que nous avons recueillies lors de nos enquêtes à
l'aide de logiciel Microsoft Excel. Les réponses ont été
évaluées en considérant l'effectif total de
l'échantillon et l'information recherchée. Elles sont
représentées ainsi dans des graphes à l'aide de ce
logiciel.
ü Traitement des données de
l'entretien
Après transcription de toutes les interviews, nous
avons procédé à une analyse de contenu en faisant des
rapprochements et des différenciations.
3.7- Difficultés rencontrées
Lors de nos enquêtes dans la commune de Bohicon, nous
avons été confronté à bon nombre de
problèmes pouvant constituer un obstacle au déroulement de notre
enquête. Mais avant d'en faire mention, il faut souligner que ces
investigations ont coïncidé avec le déroulement de la phase
opératoire de la quatrième édition du RGPH dans le pays.
Cela a favorisé notre accueil par les habitants
prédisposés psychologiquement à recevoir dans leur maison
des agents devant leur administrer de questions. Néanmoins, cette
occasion n'a pas réglé le problème de réticence de
la population à répondre à nos questions. En effet, nous
sommes obligé d'expliquer et de réexpliquer le but de notre
étude afin d'apaiser les inquiétudes de la population
déjà sollicitée par les enquêteurs du RGPH. De plus,
avec les tâches qui sont les leurs dans le cadre de la réalisation
de cette phase du recensement des populations, les chefs d'arrondissements ne
se retrouvent pas à leurs services, ce qui nécessite des appels
téléphoniques intempestifs, si leurs secrétaires acceptent
de nous donner leurs numéros. Plusieurs rendez-vous n'ont pas
été respectés par les CA qui prétendent suivre les
activités des agents recenseurs. Cette situation a perduré et
nous a empêché de pouvoir d'interviewer le CA de Bohicon I qui
assumait l'intérim de celui de Oussaho. D'où l'entretien est
réalisé avec quatre (4) chefs d'arrondissement au lieu de cinq
(5).
De même, c'est à la mairie que nous avons
noté l'indisponibilité cruciale des agents. Il a
été prévu de nous entretenir avec le Chef Service
Communication et Protocole de la mairie et de consulter certains documents.
Mais une fois sur le terrain, les réalités ont été
tout autres. Le CSCP était perpétuellement absent à son
poste. Dès le premier jour de notre enquête, il nous a
été servi qu'il est allé en mission et que ce n'est pas
possible de le joindre par téléphone. Durant tout le temps de
notre enquête, semble-t-il que sa mission n'a pas pris fin.
Concernant les documents à consulter, cela n'a pas
été non plus facile. Nous avons fini par rencontrer le Chef
Service Planification et Développement local, suite, lui aussi, à
ses absences répétées durant notre enquête. Mais
l'accès au PDC de la commune a été difficile. En effet, ce
PDC 2e génération n'est pas jusque-là
validé par l'autorité de tutelle (préfecture) alors que ce
document est censé être élaboré depuis la fin de la
mise en exécution du PDC 1re génération en
2008. L'accès ou la copie des données de ce document est
protégée par la loi et nous avons été obligé
de faire une consultation sur place.
Les intempéries climatiques aussi ont rendu notre
enquête difficile. Pendant notre séjour dans la commune, il y a eu
pluie presque tous les jours, d'où les difficultés de nous rendre
sur les lieux d'enquête.
Partie IV :
PRESENTATION, INTERPRETATION ET ANALYSE DES
RESULTATS
4.1- Présentation des résultats
Dans cette partie, nous avons fait usage de sous-thèmes
nous permettant de regrouper les données autour d'un même
objectif. Les données recueillies ont été
représentées en graphes suivant les questions que nous avons
administrées.
La perception de la population de la gouvernance
locale
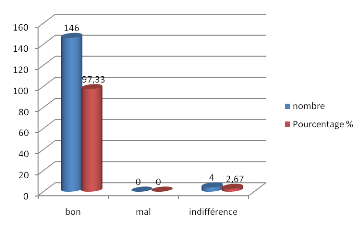
Graphe I : l'appréciation
des populations de la gouvernance locale
La gouvernance locale est bien appréciée par la
population de la commune de Bohicon. 97,33% de la population
ont une bonne appréciation de cette gouvernance contre 2,67
% qui en sont indifférents.
Graphe II : reconnaissance du
rôle de la population

D'après cet histogramme, 98,67 % des
populations sont conscientes de leur rôle dans l'exercice de la
gouvernance et 1,33 % en sont
indifférentes.
Implication de la population dans la gestion
communale
Graphe III : le degré de
participation des populations à l'élaboration du PDC
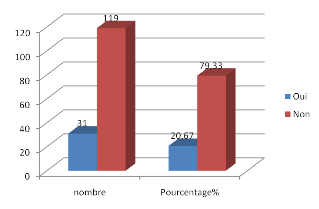
Selon les données de ce graphique,
20,67% des populations ont pris part à
l'élaboration des PDC dans la commune contre 79,33% qui
n'y sont pas invitées.
Graphe IV : le degré de
participation aux réunions

Ce diagramme montre que 2,67% de la
population prennent part aux réunions à la mairie pendant que
97,33% de cette population n'y participent.
Graphe V : le niveau
d'implication des populations aux affaires communales

Parmi les enquêtés, 08%
reconnaissent être impliqués dans la gestion des affaires de la
commune tandis que 92% ne sont pas impliqués.
Niveau d'information de la population par rapport
à la gestion
Graphe VI : niveau d'information
sur les décisions et actions du CC

Ce graphique montre que 37,33% des
enquêtés sont informés des délibérations du
CC contre 62,67% qui ne le sont pas.
Graphe VII : niveau d'information
sur l'évaluation des actions de développement

Selon graphique VII, par rapport aux évaluations des
actions de développement, 5,33% des populations sont au
courant pendant que 94,67% n'en sont pas.
Graphe VIII : niveau
d'information sur les comptes rendus du CC

Selon ce graphe, 12,67% des populations sont
informées des comptes rendus du CC pendant que 87,33%
n'en sont pas informées.
Graphe IX : niveau d'information
sur la gestion fiscale

Par rapport aux comptes rendus de la gestion des impôts
et taxes dans la commune, le graphique IX montre que 3,33% des
populations sont informées et 96,67% ne le sont
pas.
Graphe X : Participation aux
séances d'information et de sensibilisation dans les arrondissements

100% des enquêtés ont
répondu que des séances de sensibilisation et d'information ne
sont pas organisées dans les arrondissements par la mairie.
Suggestions de la population
Graphe XI : volonté de
s'informer sur la gestion communale

Le graphique XI révèle la volonté de la
population à s'informer sur la gestion communale. 98%
des populations ont répondu « oui » et
2% en ignorent l'importance.
Graphe XII : les canaux
d'information préférés
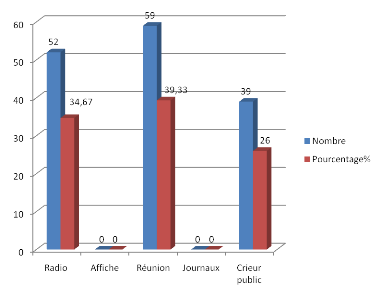
Ce graphique montre que 34,67% de la
population ont voulu être informées par la radio,
39,33% par les réunions et 26% par les
crieurs publics. 0% a voulu être informé par les
journaux ou par voie d'affiche.
4.2- INTERPRETATION ET ANALYSE DES DONNEES
Cette analyse s'organise autour des sous-thèmes
dégagés lors de la présentation. Elle se fait d'une
façon transversale.
Perception des dirigeants et des populations par
rapport à la gouvernance locale
La décentralisation a permis la gestion du pouvoir
à la base. Elle est le processus par lequel les affaires locales sont
laissées à la gestion de la population elle-même en vue
d'une expression de la démocratie locale, d'une résolution
commune des problèmes et besoins d'intérêt
général afin de promouvoir le développement local. A
Bohicon comme dans d'autres communes du Bénin, l'exercice du pouvoir
local est à sa deuxième expérience.
La perception de l'exercice de cette décentralisation
est une condition pour la réussite de sa mise en oeuvre. Ainsi elle fait
l'objet d'un sous-thème d'enquête dans notre étude.
Des dirigeants (CA) aux populations, la gouvernance locale
est perçue, dans la commune de Bohicon, comme une bonne et judicieuse
décision dont découleront beaucoup de retombées en
matière de développement. En effet, sur le nombre total des
enquêtés, 97,33% ont approuvé le processus de la
décentralisation contre 2,67% qui ont gardé une position
d'indifférence. Cela exprime l'opinion massive, la bonne perception de
la population par rapport à la gouvernance locale. De même, tous
les quatre Chefs d'Arrondissement interviewés dans la commune
s'accordent pour affirmer que la gouvernance locale est la gestion de la
population par la population elle-même. Selon le CA de Bohicon II, elle
«favorise leur participation aux activités de
développement''. A travers l'exercice du pouvoir local, dira le CA
de Kpassagon, les populations gèrent elles-mêmes leurs ressources.
Ainsi, les dirigeants de la commune ont conscience du rôle, de la
responsabilité des populations dans la mise en oeuvre du processus de
développement dans la commune. En outre, du côté des
populations, la reconnaissance de leur part de responsabilité dans la
gouvernance locale a été soldée par un pourcentage de
98,67% contre un taux d'indifférence de 1,33%. (Graphe III). Ces
données statistiques nous permettent d'affirmer, sans aller trop vite en
besogne, que la population de Bohicon a une conscience claire du
déterminant et indispensable rôle qu'elle a à jouer dans le
processus du développement communal. La vision de la population de
Bohicon s'accorde bien avec les exigences prescrites par Dehoumon (2006) qui
dit que le développement économique et social doit
nécessairement passer par l'esprit d'initiatives, la
responsabilité et la maximisation de l'utilisation des
potentialités locales ; ces potentialités qui ne sont rien
d'autres que le capital humain, économique, social des citoyens.
Alors, en termes de la perception des dirigeants et des
populations de Bohicon par rapport à la gouvernance locale, nous pouvons
conclure, sous la base des données recueillies, que la vision reste la
même tant au niveau des dirigeants qu'au niveau des populations. Cette
vision révèle que la gouvernance est bonne en soi en ceci qu'elle
réunit tous les citoyens d'une localité ou commune autour des
questions les concernant en vue d'une satisfaction commune. Si selon la BM
« c'est (...) aux collectivités locales qu'il appartient de
répondre à la demande, sans cesse croissante d'équipement
collectif car [...] les collectivités locales sont mieux placées
que quiconque pour répondre aux besoins locaux », alors,
chaque citoyen a un rôle déterminant, une responsabilité
inaliénable dans ce dynamisme de développement. Chacun a sa
pierre à apporter à la construction de l'édifice
communal.
Implication de la population dans la gestion
communale
Les dispositions législatives en vigueur sur la
décentralisation au Bénin font obligation aux élus locaux
d'impliquer la population dans le processus de développement des
collectivités locales. On peut citer par exemples les articles 2 et 30
de la loi n°97-029 du 15/01/99 portant organisation des communes en
République du Bénin et les articles 23 et 34 du décret
2001-414 du 15 octobre 2001 fixant le cadre général du
règlement intérieur du conseil communal. Il s'agira de mettre les
citoyens en amont et en aval de l'ensemble des initiatives, décisions et
actions entreprises. Il est pour les dirigeants de faire sienne la
théorie de l'approche participative qui faisait loi depuis les
années 80
Mais les statistiques que nous avons obtenues au niveau de la
population par rapport à leur implication aux affaires locales nous
révèlent que les théories de l'approche participative ne
sont pas de mise à Bohicon, quoique déterminantes dans la
gouvernance locale. En effet, sur le nombre total des enquêtés, ce
n'est qu'un taux de 08% qui reconnaît être impliqué dans la
gestion des affaires au détriment d'une grande masse de 92% qui en est
épargnée (GrapheV). Ces données, à elles seules,
montrent et prouvent déjà le fait que la population de Bohicon ne
participe pas aux affaires de sa commune. Par ailleurs, à la question de
savoir si les élus locaux font de sondages d'opinions avant la prise des
décisions au niveau du conseil communal, trois (3) CA sur les quatre (4)
interviewés soit un taux de 75% ont répondu par la
négative. Cette réponse des dirigeants de la commune a
été sous-tendue par divers arguments tels l'analphabétisme
de la population impliquant leur désintéressement aux affaires
(CA Lissèzoun), la mentalité politique des citoyens (CA
Gnidjazoun). Tout compte fait, au niveau de la population comme au niveau des
dirigeants, les informations recueillies concourent à l'affirmation
selon laquelle les citoyens de Bohicon ne sont pas impliqués dans la
gestion de leurs affaires. Ces citoyens ne sont pas considérés
comme le moteur et la finalité du changement comme
préconisait Adotevi en 2008.
Le PDC est le grand document dans lequel sont consignés
l'ensemble des vision et orientations de développement, des besoins et
problèmes des populations ainsi que les différents projets ou
programmes prévus en vue de faire face à ces problèmes et
besoins. Selon le Guide d'Elaboration de PDC, les populations doivent
être mises au coeur du processus d'élaboration de ce document
ainsi qu'à la phase de sa mise en oeuvre car ce sont elles qui
connaissent mieux leurs problèmes et besoins. Mais force est de
constater, après nos enquêtes sur le terrain que la population de
Bohicon ne participe pas à l'élaboration de ce document, ni
à son adoption. Ce n'est qu'un taux de 20,67% de la population qui
était invité aux ateliers d'élaboration du PDC de Bohicon
laissant en marge un effectif de 79,33% des citoyens. (Graphe III). Ces
chiffres ont été confirmés par les entretiens tenus avec
les élus locaux de la commune. En effet, à en croire les CA de
Lissèzoun et de Kpassagon, la participation des populations aux
activités de la commune n'est pas remarquable. Pour celui de
Lissèzoun « c'est difficile, car la grande masse de la
population est analphabète. Tout le monde n'est pas lettré. Les
populations ne comprennent pas leurs droits et devoirs dans la gouvernance
locale. » . Pour l'autre « il faut dire que la
décentralisation les a surprises, elles ne sont pas bien mûres
pour être autonomes, maintenant nous sommes en train de travailler que
les gens connaissent ce que c'est que la décentralisation. Sinon, tel
que la population devait participer, ce n'est pas encore
ça ». Ainsi, ces deux élus interviewés ont
répondu carrément « non » que la population
ne participe pas aux activités. En outre, à bien analyser les
propos du CA de Gnidjazoun, nous remarquons aisément que c'est en
faisant allusion aux frais de légalisation qu'il a répondu
à cette question par l'affirmative : «
oui, pour leurs papiers, les légalisations, ils
achètent déjà les timbres, je vois que par là
déjà ils participent au développement ».
Ces déclarations de part et d'autre des dirigeants de la commune ont
été pour nous une preuve, sinon un complément des
pourcentages obtenus au niveau de la population pour affirmer qu'au cours des
ateliers d'élaboration du PDC, la population n'a pas été
suffisamment impliquée. Cela ne répond pas aux exigences du Guide
d'Elaboration du PDC mis à disposition des communes par le MDGLAAT et ne
conforme, non plus, au cours théorique du Développement
Communautaire reçu en STASE.
Ne reste-t-il plus à démontrer que le
développement local ne peut être viable si la contribution des
communautés de base, qui en sont les bénéficiaires, n'est
pas effective. Or cela ne peut se faire sans les réunions de
proximité qui sont des `'espaces de concertation et de socialisation''
(FAO ; 1995). C'est justement pour cette raison que la loi 97-029 du 15
janvier 1999 portant organisation des communes en République du
Bénin, en son article 30 rend obligatoire l'ouverture des séances
du conseil communal au public. Mais dans la commune de Bohicon, après
nos investigations auprès des citoyens, nous nous sommes rendu compte
que la population ne prenne pas part aux réunions ou conseils communaux.
Selon les données du graphe IV, un pourcentage de 97,33% n'a jamais
été suivre une séance de réunion à la
mairie. Cela se comprend aisément que le droit de participation aux
conseils communaux n'est ni joui, ni exercé par les citoyens de Bohicon
alors que cette participation pourra faire ceux-ci toucher du doigt les
réalités de leur milieu et faciliter ou améliorer leurs
relations avec les dirigeants.
Le maire peut aussi initier des rencontres périodiques
avec les populations (ou tout au moins certaines corporations ou groupes
professionnels) pour des séances d'information et de sensibilisation
dans les maisons du peuple ou lieux publics. Mais le graphe XI nous informe
que cela n'a jamais été organisé dans la commune de
Bohicon. Au CA de Gnidjazoun de le prouver davantage quand il lui a
été demandé les moyens par lesquels il motive la
population pour une plus grande participation : « par les
séances, les ONG qui font les campagnes de sensibilisation. Nous aussi
nous passons par le biais de ces organisations pour leur éduquer sur le
plan d'un bon citoyen ». Cela voudra simplement dire qu'il n'y a
pas de séance proprement dite organisée par la mairie dans les
arrondissements.
Il ne s'agit pas seulement de savoir, mais aussi et surtout de
faire. Mais, à la lumière de ces analyses, nous nous sommes rendu
à l'évidence que la population de Bohicon a seulement conscience
de son rôle dans la gouvernance locale ; elle n'y est pas
impliquée.
Niveau d'information de la population sur la
gestion communale
D'entrée de jeu, par rapport à l'information de
la population, nous avons remarqué que tous les CA avec lesquels nous
nous sommes entretenu ont été unanimes pour acquiescer que la
mairie de Bohicon dispose-t-elle d'un plan de communication auquel est
alloué un budget spécifique. De plus, de par les mêmes
entretiens, nous avons su que l'affichage, la presse média et les
réunions sont les voies par lesquelles les dirigeants informent la
population. A en croire ces dirigeants alors, les citoyens sont au courant de
la gestion dont ils font de la commune. D'ailleurs, au cours des interviews,
tous les interviewés ont répondu unanimement et ouvertement
à cette question par l'affirmative. Mais à la question de savoir
que faire pour améliorer la participation citoyenne, le CA de Kpassagon
nous livre : « on doit les sensibiliser parce que
beaucoup ne savent pas que ces décisions sont affichées, il faut
leur donner de conseils par la voie des ondes que les décisions du
conseil sont toujours affichées à la mairie ».
Cette réponse nous donne comme impression que ce dirigeant est bien
conscient que la population ne se déplace pas à la mairie pour la
consultation des Procès Verbaux (PV) des réunions
affichés. De plus, il ressort de cette même déclaration que
l'on n'informait pas la population à travers les média que des
décisions sont ainsi affichées. La pertinence de ces
déductions a été approuvée par les pourcentages que
nous avons obtenus au niveau de notre questionnaire. En effet, le diagramme VI
nous révèle que 37,33% de la population sont informés des
délibérations et des actions entreprises par les dirigeants de la
commune. Mais cette couverture ne vaut pas grand-chose à
côté du grand public (62,67% des citoyens) qui en est
dispensé.
Pour certains CA, l'information suit un circuit bien
défini. « Après les sessions et les conseils, je
rends compte au conseil d'arrondissement et à certaines personnes
ressources de l'arrondissement. Les chefs quartiers à leur tour,
relayent les informations, les décisions et les activités au
niveau de la localité. » (CA Bohicon II). Ce qui
manquerait à ce système est la mise en place d'un
mécanisme de vérification pour s'assurer que l'information est
vraiment parvenue aux communautés. Car le graphique VIII nous apprend
que 87,33% des enquêtés reconnaissent n'avoir jamais
été soumis à un compte rendu de la part de quelque
élu local que ce soit.
Sur la base de ces données, nous pouvons affirmer que
l'information dans la gestion communale à Bohicon n'est pas encore
effective. Si pour Stiglitz (2005), « les citoyens ont
le droit d'être informés, d'exprimer leur opinion, de savoir ce
que fait le gouvernement, pourquoi il le fait, et d'en
débattre », les citoyens de Bohicon sont privés de
ce droit.
Ø Volet financier
Selon les dispositions légales sur la
décentralisation, toute personne a le droit de consulter à la
mairie de sa commune, non seulement les procès verbaux et les comptes
rendus des délibérations du conseil communal ou municipal, mais
encore les divers actes communaux (arrêtés, décisions,
contrats, etc..) et d'en prendre copie à ses frais. Cette mesure va au- delà du simple affichage des
comptes rendus qui sont le plus souvent des extraits ou des
résumés de délibérations prises qui n'informent que
d'une manière partielle et parcellaire. Les documents sont disponibles
dans l'intégralité de leur rédaction. De même, une
fois votés par le conseil communal et approuvés par
l'autorité de tutelle (la préfecture), les budgets communaux
restent déposés à la mairie où ils sont tenus
à la disposition du public. La consultation des budgets de la commune
permet au citoyen de prendre connaissance des prévisions en recettes et
en dépenses, ce qui lui permet d'apprécier la politique communale
en terme budgétaire.
Dans une commune, les CA sont les personnes indiquées
pour donner d'appréciation sur la gestion des ressources
financières. Ainsi d'après nos enquêtes auprès des
CA de la commune de Bohicon, nous remarquons que les ressources locales
(fiscales) de la commune sont très insuffisantes. Selon le CA de
Lissèzoun, les habitants de la ville de Bohicon ne s'acquittent pas de
leur obligation fiscale « ...puis que vous savez ... les
ressources de Bohicon sont basées sur les impôts et les taxes
surtout les fonciers bâtis et non bâtis. Mais malheureusement les
gens ne connaissent pas qu'ils ont l'obligation de payer les taxes. C'est ce
qui appauvrit Bohicon ». A en croire alors ces responsables, les
prévisions fiscales n'ont jamais été respectées
dans la commune. Sur le plan financier alors, la population de Bohicon ne
participe pas tel qu'il le faut afin que l'on axe le développement sur
le potentiel local.
Mais les citoyens sont-ils informés du peu qui soit
collecté, ce qui constituerait une source de motivation pour eux
à participer ?
Le graphe IX nous renseigne qu'un pourcentage de 96,67% des
populations de Bohicon ne savent rien de la gestion financière. Elles ne
connaissent rien des Plans d'Investissement Annuel (PIA), rien des
dépenses prévisionnelles de la commune. Elles n'aient non plus
aucune idée des ressources fiscales réunies, ni comment cela a
été géré. La question de payement d'impôts et
taxes peut alors constituer un problème, un conflit permanent entre les
citoyens et les agents chargés de la collecte, « car la
volonté de la population de confier une partie de ses ressources
à la commune est fonction de l'importance qu'elle accorde aux
activités proposées et de la transparence de la gestion
financière de la commune » (Bako-Arifari et al, 2004)
La cause de cette situation n'est pas qu'incivisme fiscal,
mais elle réside aussi dans le manque d'information autour de la
gestion. Au graphe XI de nous dire jusqu'à quel degré les
populations sont avides et assoiffées d'information sur la gestion de la
commune. En effet, 98% d'elles ont exprimé une volonté manifeste
d'être informées de la gestion des dirigeants. Ainsi, elles ont
fait option des canaux par lesquels elles préfèrent se faire
informer. Parmi ceux-ci, le privilège a été donné
à la « réunion '' avec 59% qui, selon les
enquêtés, favorise le débat, un échange d'avis entre
les participants pour permettre une meilleure compréhension. La radio
est le second canal priorisé avec un taux de 52%. Selon les
enquêtés, ce moyen permet de couvrir tout l'espace communal et si
possible le débat si autorisation est donnée aux auditeurs
d'intervenir dans une émission d'information et de sensibilisation.
Vient en troisième lieu « l'information par voie des crieurs
publics » (39%) pour le fait qu'il permet de passer l'information
à domicile, de ménage en ménage. Ces trois (3) canaux sont
privilégiés par la population de Bohicon au détriment de
« journaux » 0% et « affichage » 0%
(graphe XII) ; cet affichage qui est le moyen ad hoc trouvé par la
mairie pour donner l'information.
SUGGESTIONS
Les résultats auxquels cette étude nous a
conduit nous amènent à faire quelques suggestions dont la prise
en compte dans la gouvernance de la commune de Bohicon pourra favoriser
l'atteinte de l'ultime objectif de la décentralisation : le
développement local. Ainsi, il va s'agir pour les autorités
locales de :
- rendre la cellule chargée de la communication de la
mairie dénommée Service Communication et Protocole plus
active et opérationnelle ;
- élaborer de plans de communication tenant
véritablement compte des besoins en information des citoyens de la
commune ;
- adopter un système d'information dans tous les volets
de la gouvernance locale et élaborer de différents plans à
l'endroit des différents acteurs de développement dans la
commune ;
- mettre le plan de communication au même pied
d'égalité que les autres plans de
développement communal ;
- mettre en place un système d'éducation
à la citoyenneté pour mieux expliquer aux populations leur part
de responsabilité dans la mise en oeuvre de la
décentralisation ;
- mettre en place un système d'information
périodique dans la commune et ce, par les moyens de communication
privilégiés par les citoyens (réunions - radios
locales - crieurs publics) ;
- accorder une part suffisante à la communication et
à l'information dans le budget communal ;
- chercher aussi de Partenaires Techniques et Financiers pour
la réalisation des plans de communication ;
- mettre en place un système de suivi-évaluation
du plan de communication ;
- octroyer de bourses d'étude aux étudiants pour
une spécialisation dans le domaine de la gestion locale, en l'occurrence
dans le domaine de la communication à la participation ;
- assurer la formation des agents de la mairie par rapport
à leurs postes et le rôle de la communication dans la gestion.
CONCLUSION
La décentralisation, dans les principes de sa mise en
oeuvre au Bénin, exige la participation des citoyens à la base.
Ce primordial principe ne peut être véritablement mis en pratique
dans les collectivités locales sans une communication autour de la
gestion qui se présente comme la clé de voûte de toute
participation. La gouvernance locale ne saurait promouvoir le
développement local sans un minimum de communication entre les
gouvernants (élus locaux) eux-mêmes d'une part et les gouvernants
et les gouvernés (populations) d'autre part. Ainsi, notre thème
de recherche « communication dans la gestion des
collectivités locales : cas de la commune de Bohicon»
est d'une importance capitale pour toutes les collectivités
décentralisées en général, et spécifiquement
pour la commune de Bohicon en ceci qu'il vise la motivation et
l'amélioration de la participation des populations.
Ce sujet de recherche nous a permis de faire un état
des lieux de la gouvernance sous son volet communication afin d'évaluer
le degré d'information des citoyens de Bohicon sur la gestion communale.
Après nos investigations sur la commune, les informations recueillies
nous rendent à l'évidence que la communication dans la commune de
Bohicon souffre encore d'un déficit. L'absence d'implication et le
manque d'information sont les maux à retenir dans la gestion. Cela
explique alors l'insuffisance permanente ou l'amenuisement progressif des
ressources locales dans la commune. Nos hypothèses selon lesquelles
« la mise en oeuvre de la stratégie de communication mise
à disposition par le Programme de Gouvernance et de Droits de la
Personne (PGDP) n'est pas effective dans la commune de Bohicon »
et que « les citoyens ne sont pas impliqués dans la gestion
communale de Bohicon, ni informés de cette gestion » sont
confirmées alors à l'issue de notre analyse.
S'il est indubitable que la participation citoyenne est une
condition sine qua non de la promotion du développement local dans les
communes, il s'avère évident que la communication est la
principale source de motivation de cette participation. Il urge qu'une vraie
politique de communication soit mise en place dans la commune de Bohicon pour
rapprocher les gouvernés des gouvernants en vue d'un cadre de dialogue
social, de solidarité, d'échange et de conversion des actions
vers le développement.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Ø Adotevi, A. J-B. (1984). Information et participation
populaire au développement, In Mondjanagni, A. la
participation populaire au développement en Afrique noire.
Paris : Karthala. 448p.
Ø Albertini, J. (1981). La
décentralisation : l'administration territoriale dans la
réforme de l'Etat. Paris : Economica. 238p.
Ø Amadou, M. (2008). La problématique de la
communication dans la gouvernance locale au Bénin: le cas de la commune
de Savé. Mémoire de fin d'année de maîtrise en
Sciences et Techniques des Actions Socio-Educatives. INJEPS /UAC, Porto-Novo
87p
Ø ANCB (2007). Rapport général sur
l'auto-évaluation de la gouvernance locale au Bénin, 213
p.
Ø ANCB (2012). Rapport général sur
l'auto-évaluation de la gouvernance locale au Bénin.
Ø Bako-Arifari, N., Dicko, A.B., Doevenspeck, M.,
Sanou, B.U. et Singer, U. (2004). Financer la décentralisation
rurale : Taxes et impôts à l'échelle locale
au Bénin, Burkina Faso et Mal. Amsterdam : KIT publishers.
96p
Ø Boko, S. H. (2008). Un aperçu sur la
décentralisation fiscale et les finances locales en Afrique
francophone. 12p.
Ø Charte de la gouvernance locale au Bénin du 20
octobre 2011.
Ø Cernea, M. M. (1998). La dimension humaine dans
les projets de développement. Les variables sociologiques et
culturelles. Paris : Karthala. 586p
Ø CIRD (2006). Guide d'une bonne gouvernance
démocratique locale. Cotonou, 246 p.
Ø Constitution béninoise du 11décembre
1990.
Ø Décret 2001-414 du 15 octobre 2001 fixant le
cadre général du règlement intérieur du conseil
communal
Ø Dehoumon, P.S. (2006). La décentralisation
entre risques et espoirs. Cotonou : COPEF. 214p.
Ø Diatta, L. (2010). Analyse de la participation
des populations bénéficiaires du projet infoclim : cas de la
communauté rurale de Fandene. ENEA, Dakar, 38p
Ø FAO (1994). La communication pour un
développement à dimension humaine. Rome, 68 p.
Ø FAO (2001). Politiques et stratégies de
communication pour le développement. Rome, 89 p.
Ø Guidou, J.L. (1984). Le développement
local, espoirs et freins. Revue municipal N°246.
Ø Hounmenou, B. G. (2001). Nouveaux modes de
coordination des acteurs dans le développement local : cas des
zones rurales au Bénin. Développement durable et
territoires. Cotonou, 40p.
Ø La territoriale N°23 (2012). Le magazine
trimestriel d'information sur la décentralisation et la
déconcentration. Cotonou, 63p.
Ø loi n°97-029 portant organisation des Communes
en République du Bénin.
Ø loi n° 98-007 portant régime
financier des Communes en République du Bénin.
Ø Maslow, A. (1943). A theory of human motivation.
Psychological review. N°L, volume 4, pp 370 - 396.
Ø MD (2003). Le guide à l'usage
du maire, ordonnateur de la commune,
172p.
Ø MD (2003). Guide pour la planification du
développement communal. Cotonou, 59p.
Ø MD (2007). Le guide du conseiller communal et
municipal, 63p.
Ø MD (2012). Communication locale, outil
d'amélioration de la gouvernance locale. Tunis, 20p
Ø Meister, A. (1977). La participation pour le
développement. Paris : Ouvrières. 176p.
Ø OCS (2010). L'évaluation de l'impact de la
décentralisation sur la pauvreté et les conditions de vie des
ménages au Bénin. Cotonou, 107p.
Ø PDM (1993). Rapport du séminaire sur la
communication et l'information locales, Bangui.
Ø PDM (1998). Rapport des premières
journées de la commune africaine (Africité98), Abidjan,
42 p.
Ø PNUD (2000). Rapport National sur le
Développement Humain au Bénin, 149p.
Ø PNUD (2002). Gouvernance locale dans la perspective
de la réduction de la pauvreté en Afrique, 40p.
Ø Stiglitz, J. (2005). Gouvernement et
transparence, In De Boeck et Larcier, le droit d'informer : le
rôle des médias dans le développement
économique. De Boeck, 406p
Ø Tonoukouin, S. (1999). Le rôle de la
société civile dans le processus de la décentralisation au
Bénin : cas des ONG et associations locales de
développement. ENAM /UAC, Calavi, 58p.
ANNEXE
Annexe
Elle regroupe les exemplaires des guides d'entretien et
questionnaire administrés à notre échantillon
d'enquête.
Questionnaire à l'endroit des populations et des
chefs de village ou quartier de ville de Bohicon
Nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions
ci-dessous le plus sincèrement possible. Les données recueillies
sont confidentielles, et utilisées uniquement à des fins de
recherche.
Merci de votre compréhension
Consignes : Les petites cases ont
été prévues pour votre réponse, mettez une croix au
niveau de celle qui correspond à votre choix.
1- Selon vous, c'est quoi la gouvernance locale ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2- Avez-vous un rôle à jouer dans le
développement de cette commune ?
Oui Non
3- Etes- vous impliqué dans l'élaboration et
l'adoption du Plan de Développement de la commune ?
Oui Non
4- Participez-vous aux réunions ou aux décisions
concernant votre commune ?
Oui Non
5- Etes-vous informé des décisions, des actions
de développement entreprises par l'équipe de gestion
communale ?
Oui Non
6- Les résultats des évaluations de ces actions
vous sont-ils communiqués ?
Oui Non
7- Le conseil communal vous rend-t-il compte de ses
délibérations ?
Oui Non
8- Vous fait-on périodiquement le bilan des
impôts et taxes perçus dans la commune ?
Oui Non
9- Si oui, par quel (s) canal (aux) :
Radio journaux crieur public
réunion affiches
10- Savez-vous clairement à quelles fins l'argent des
impôts et taxes sont employés ?
Oui Non
11- Est-ce que la mairie organise des séances
d'information à votre intention ?
Oui Non
12- Parmi les canaux sus-cités, dites celui ou ceux par
lesquels vous préférez être informé ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13- Pourquoi ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14- Pensez-vous être impliqué dans gouvernance
locale de votre commune ?
Oui Non
15- Pensez-vous que vous êtes suffisamment
informé de la gestion fiscale de cette commune ?
Oui Non
16- Si non, que proposeriez- vous ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une fois encore, recevez nos sincères remerciements
pour votre disponibilité et l'effort requis par vos réponses
à ce questionnaire.
Guide d'entretien à l'endroit des autorités
locales (CA)
Ce guide élaboré vise à étudier la
gouvernance locale en rapport avec l'information et la participation citoyenne
de la commune de Bohicon (département du Zou).
1- La perception de la gouvernance locale
2- la participation citoyenne
3- La communication dans la gestion communale
4- Amélioration de la participation citoyenne
Table des matières
Sommaire----------------------------------------------------------------------------------------------------i
In
memorium-----------------------------------------------------------------------------------------------ii
Dédicace---------------------------------------------------------------------------------------------------iii
Remerciements--------------------------------------------------------------------------------------------iv
Sigles et
acronymes---------------------------------------------------------------------------------------vi
Le tableau et la liste des
graphes-----------------------------------------------------------------------vii
Epigraphe-----------------------------------------------------------------------------------------------viii
Introduction-------------------------------------------------------------------------------------------------1
Objectif------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Contextualisation de la
recherche---------------------------------------------------------------------4
1.1- Contexte
juridique--------------------------------------------------------------------------------5
1.1.1- Lois de la décentralisation
----------------------------------------------------------------------5
1.1.2- Conditions du développement
local------------------------------------------------------------6
1.1.3- Dispositions relatives à la communication dans
la gestion----------------------------------7
1.2- Aire géographique de
l'étude-------------------------------------------------------------------9
1.2.1- Localisation et aspect physique de la commune de
Bohicon-------------------------------9
1.2.2- Administration
territoriale-----------------------------------------------------------------------9
1.2.3- Ressources
humaines---------------------------------------------------------------------------10
1.2.4- Ressources économique de la
commune-----------------------------------------------------12
1.2.5- Structure
financière-----------------------------------------------------------------------------14
1.2.6- Système de communication mise en place dans la
commune-----------------------------14
I- Problématisation de la
recherche------------------------------------------------------16
2.1- Revue de
littérature-----------------------------------------------------------------------------17
2.2- Cadre théorique
---------------------------------------------------------------------------------25
2.3- Clarification des concepts
---------------------------------------------------------------------25
2.4- Modèle
d'analyse--------------------------------------------------------------------------------29
2.5-
Problématique-----------------------------------------------------------------------------------30
2.6-
Hypothèses---------------------------------------------------------------------------------------32
II- Démarche
méthodologique--------------------------------------------------------------33
3.1- Nature
d'étude-----------------------------------------------------------------------------------34
3.2- Population
d'enquête----------------------------------------------------------------------------34
3.2.1-
Groupes-cibles-----------------------------------------------------------------------------------34
3.3-
Echantillonnage----------------------------------------------------------------------------------35
3.3.1- Méthode
d'échantillonnage---------------------------------------------------------------------35
3.3.2- Techniques
d'échantillonnage------------------------------------------------------------------35
3.3.3- Taille de
l'échantillon---------------------------------------------------------------------------36
3.4- Instruments
d'investigation---------------------------------------------------------------------37
3.4.1-
questionnaire-------------------------------------------------------------------------------------37
3.4.2- guide
d'entretien---------------------------------------------------------------------------------37
3.5- Collecte des
données----------------------------------------------------------------------------37
3.6- Traitement des
données-------------------------------------------------------------------------38
3.7- Difficultés
rencontrées--------------------------------------------------------------------------38
IV- Présentation,
interprétation et analyse des
résultats--------------------------------40
4.1- Présentation des
résultats--------------------------------------------------------------------41
4.2- Interprétation et analyse des
données-----------------------------------------------------48
Suggestions-----------------------------------------------------------------------------------------------55
Conclusion------------------------------------------------------------------------------------------------56
Références
bibliographiques----------------------------------------------------------------------------57
Annexe-----------------------------------------------------------------------------------------------------59
Table des
matières---------------------------------------------------------------------------------------63
 
| 


