DEDICACE
A mon Feu BILALA HOMBOY Joseph,
A ma mère BADISA BIBEFO Célestine,
A mes frères et soeurs,
A mes oncles et tantes,
A mes neveux et nièces,
A ma bien aimée MAKASIDjenny,
A mes cousins et cousines,
A mes amis et amies.
Je dédie ce travail.
AVANT
PROPOS
L'honnêteté scientifique nous interpelle
d'avouer que la réussite de ce travail n'a pas été le
fruit de notre dévouement seul, bien au contraire des autres
personnes à qui nous devons une certaine gratitude.
Mes remerciements vont premièrement à notre
Seigneur Jésus-Christ lui qui est le Dieu Tout Puissant, source de vie,
à lui mérite toute gloire, adoration et louange.
Nous tenons à remercier plus
particulièrement le Docteur MUANZA DIKAMBA, directeur de ce travail,
pour avoir volontiers accepté de diriger ce travail malgré ces
multiples occupations.
Nos remerciements vont aussi auprès du Docteur MBEY
qui était mon co-directeur pour m'avoir accepté et aidé
dans l'élaboration de ce travail.
A ma très chère mère, je cite BADISA
BIBEFO Célestine, j'adresse mes remerciements pour son affection,
sacrifices et privations à mon égard.
Notre gratitude très profonde va à l'endroit
des familles suivantes : famille BIFUTIKA, à la famille BADISA,
à la famille FERREIRA, famille LENGE, à la famille MANZALA pour
leur soutien tant moral, spirituel et matériel.
Notre gratitude va également à l'endroit du
responsable du CYBER SATHNET je cite NGUYA Blaise pour son soutien
matériel.
Nous remercions également la Chorale Saint
François de Sales pour le soutien moral et surtout spirituel.
Nous adressons nos remerciements également à
tous les services des Cliniques Universitaires de Lubumbashi en
générale et de chirurgie en particulier pour leur assistance et
leur encadrement.
Nous tenons également à remercie Docteur
SALEH UGUMBA qui a accepté de censurer ce travail malgré
l'absence improvisée de notre directeur.
A mes amis et connaissances : MBOMBO BOPE MINGA
Francis, LOBO François, BOYO LUEMBA, NGELEKA Yves, MUNDA Guillaume,
MAMBILA Nicolas, NDOKO Dieu-merci, MUBIAYI Chris, LUMINGU Platini, NZENDO
Juvenal, KILUMBU Jerry, MALEKANI Chris, MALANDALA Sadie, etc.
A vous mes compagnons de lutte : ALI NGOIE, ANGHA
NDATI, AYOMBO SANGWA, BIKOPO BUTANA, BIFUTUKA INKALABA, EBADU WA LIBOSONDA,
DJAMBA LUTUNDULA, DIANZOENO NDIAMBU, KABANGE NDALA, BIRA MUKANDIRWA, BAKISOLOLO
MAKIESE, BINDA FITA, ILUNGA NGOY KAUNDA, GAVUDISA GATAMBA, ILUNGA MWENZE,
KASONGO KATENDE, ENDUKA OKOTO, BILAMBADJOKO LUWADJA, KITANIKA MAURICE, KAHUTU
SANGWA, KABULO ILUNGA, ILUNGA MBIYA, ILUNGA KABAMBA, ILUNGA TSHIAMALA, ELUMBA
MBU, INGWE CHUY, KABANGE BARUANI, KABWE KABAMBA, KANGOMBE BAKAJIKA, KIALA SOKI,
BANZA KYUNGU, BEBEJA ILUNGA, BISIMWA NYENYEZI, BOTULU BOTEMBE, BIPELE GUELORD,
SUSSA JOEL, KINGANDA EDDY, LENDO MANGANI, CHOMBA NTABU, etc.
A tous ceux dont les noms ne figurent pas dans ce travail
qui m'ont soutenu par leurs prières.
BILALA NGUMBA Serge
PLAN DU TRAVAIL
DEDICACE
AVANT PROPOS
INTRODUCTION
Ière PARTIE :
CONSIDERATIONS THEORIQUES
CHAPITRE I : RAPPEL ANATOMIQUE DE LA
JAMBE
I.1. Ostéologie de la jambe
I.2. Les articulations de la jambe
I.3. La myologie de la jambe
I.4. La vascularisation de la jambe
I.5. L'innervation de la jambe
CHAPITRE II : FRACTURES DES OS DE LA
JAMBE
II.1. Définition
II.2. Etiologies et Mécanismes
II.3. Epidémiologie
II.4. Classification anatomoclinique des fractures de la
jambe
II.5. Clinique
II.6. Paraclinique
II.7. Evolution et complications
II.8. Traitement
IIème PARTIE : CONSIDERATIONS
PRATIQUES
CHAPITRE I : MATERIELS ET
METHODES
I.1. MATERIELS
1.1.1. Présentation du cadre de
l'étude
1.1.2. Patients
I.2. METHODES
CHAPITRE II : PRESENTATION DES RESULTATS
CHAPITRE III : DISCUSSIONS
CONCLUSION ET SUGGESTIONS
RESUME
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
TABLE DE MATIERES
INTRODUCTION
Les fractures des os de la jambe sont des ruptures de la
continuité d'un ou desdeux os de la jambe situées à trois
travers de doigts au-dessous del'interligne du genou et à trois travers
de doigts au-dessus del'interligne tibio-tarsienne.Elles sont dites ouvertes
lorsque le foyer fracturaire est encommunication avec l'extérieur
à travers une plaie et fermées lorsque la peau est intacte
(BUISSON et al.,2003).
Plusieurs études ont été menées
dans le monde, en Afrique et en République Démocratique du
Congoà propos de cette pathologie. C'est ainsi qu'à Lubumbashi
une étude menée par KAPE de Janvier 2006 à Décembre
2009 a révélé sur 87 patients admis pour fractures
ouvertes des membres, 80,45% représentent les fractures des membres
inférieurs et la jambe à elles seules représentent 50%de
ces lésions(KAPE, 2011).
Une étude faite en 1998 par DIKAMBA MUANZA a
révélé 14,8 % des fractures ouvertes de la jambe et 85,2
% des fractures fermées (DIKAMBA MUANZA, 1998).
Au MALI, une étude a révélé que
les deux os de la jambe se fracturent le plus souvent au même moment en
cas de fracture de la jambe(DIAKITE FAMBOUGOURI, 2006).
Encore au MALI, l'affluence des patients en consultation dans
le service detraumatologie est importante. Dans cette affluence lesfractures de
la jambe occupent une place de choix avec 21 - 29% del'ensemble des
plâtrages effectués dans la salle de plâtre de
l'hôpitalGabriel Touré en 2006(NOUHOUM A DIALLO, 2008).
Au Maroc, plus précisément à
CASABLANCA, une étude menée par CHAHID NAZHA a rapporté
une série de 159 cas de fracture de la jambe à l'hôpital
Hassan II de Khouribga durant la période s'étalant du 1er janvier
1998 au 31 décembre 2002. Il s'agissait de 104 fractures fermées
et 55 fractures ouvertes(CHAHID NAZHA, 2003).
Alors qu'en Occident précisément en France,
selon Alain Charles MASQUELET elles occupent le premier rang de l'ensemble
destraumatismes avec une fréquence de 25%(MASQUELET AC, 2004).
En voyant ces données, nous constatons que les
fractures de deux os de la jambe demeurent une préoccupation majeure
pour le Chirurgien traumatologue orthopédiste car en cas d'une mauvaise
ou de l'absence de la prise en charge, on assiste à plusieurs
complications telles quel'ouverture cutanée qui peut se faire
d'emblée, les lésions des muscles, les lésions vasculaires
et nerveuses, l'infection(tétanos, gangrène gazeuse), la
nécrose cutanée, les phlébites, les déplacements
secondaires, troubles trophiques, l'embolie graisseuse, pseudarthrose, raideurs
articulaires,...
Ainsi certaines questions méritent d'être
posées dans notre milieu :
1°. Quelle est la fréquence des fractures des os
de la jambe aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi ?
2°. Quels sont les différents types de fractures
rencontrées au niveau de la jambe ?
3°. Quelles sont les mesures de prise en charge des
fractures des os de la jambe ?
4°. Quelle est l'évolution de cette fracture ainsi
que leurs complications ?
Ainsi, nous nous proposons comme :
a) Objectif général :
- Mener une étude sur les fractures de la jambe au
service de chirurgie des Cliniques Universitaires de Lubumbashi.
b) Objectifs spécifiques :
- Déterminerla prévalence hospitalière
des fractures de deux os de la jambe aux Cliniques Universitaires de
Lubumbashi,
- Déterminer le profil démographique, les types
anatomo-cliniques des fractures de deux os de la jambe,
- Relever les complications liées à ces
fractures,
- Relever les pronostics évolutifs précoces et
tardifs des fractures de la jambe aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi.
Pour réaliser ce travail, nous avons utilisé une
étude descriptive transversale sur les différents cas des
fractures de deux os de la jambe observés aux Cliniques Universitaires
de Lubumbashi dans la période allant de Janvier 2009 à
Décembre 2012, soit une période de 4 ans.
Notre travail se subdivise en deux grandes parties :
- La partie théorique qui reprend un bref rappel
anatomique de la jambe, et enfin les fractures de os de la jambe.
- La partie pratique qui reprend la présentation de
cadre du travail, la méthodologie, la présentation des
résultats, la discussion enfin une conclusion et des recommandations.
CONSIDERATIONS THEORIQUES
CHAPITRE 1 : RAPPEL
ANATOMOHISTOLOGIQUE DE LA JAMBE
1.1. Ostéologie de la
jambe
1.1.1. Le tibia
Le tibia, presque gros et robuste que le fémur,
transmet le poids du corps du fémur au pied. Son extrémité
proximale plus large présente le condyle latéral du tibia
(externe) et le condyle médial du tibia (interne) concaves,
séparés par un relief irrégulier, l'éminence
intercondylaire qui est de taille variable et parfois même inexistante
chez certaines personnes. Les condyles du tibia s'articulent avec les condyles
du fémur correspondants. Le condyle latéral porte la surface
articulaire fibulaire pour l'articulation tibio-fibulaire proximale, juste
sous les condyles, sur la face antérieure du corps du tibia, se trouve
la tubérosité tibiale, le point d'attache du ligament
patellaire(ELAINE MARIEB N., 1999).
La diaphyse tibiale est triangulaire en coupe
transversale : elle présente sur son bord antérieur la
crête du tibia. Cette crête saillante ainsi que la surface interne
du tibia sont aisément perceptible sur toute leurs longueur, juste sous
la peau, car elles ne sont pas recouvertes de muscle(ELAINE MARIEB N.,
1999).
L'extrémité distale du tibia s'émousse
à l'endroit où elle s'articule avec le talus de la
cheville ; son prolongement interne vers le bas se termine par la bosse
interne de la cheville, la malléole médiale. L'incisure fibulaire
est située sur la face externe du tibia et contribue à
l'articulation tibio-fibulaire distale (ELAINE MARIEB N., 1999).
1.1.2. Le péroné (La fibula)
Le péroné, ou fibula, est un os en forme de
baquette, dont les extrémités s'élargissent quelque peu
pour s'articuler avec les faces externes des épiphyses proximale et
distale du tibia. La tête du péroné se trouve à son
extrémité proximale ; la malléole latérale,
à son extrémité distale, forme la volumineuse bosse
externe de la cheville et s'articule avec le talus(ELAINE MARIEB N., 1999).
La diaphyse de la fibula semble avoir été tordue
d'un quart de tour sur elle-même et présente de nombreuses
crêtes. Le fibula ne supporte pas le poids du corps, mais elle est le
point d'attache de plusieurs muscles(ELAINE MARIEB N., 1999).
1.2. Les articulations
péronéo-tibiales
Le péroné et le tibia sont unis par les
articulations péronéo-tibiales supérieure et
inférieure et par le ligament interosseux.
1.2.1. L'articulation péronéo-tibiale
supérieure
Cette articulation unit l'extrémité
supérieure du péroné à celle du tibia. C'est une
arthrodie.
1°. Surfaces
articulaires : la facette articulaire du tibia est
située sur la partie postéro-externe de la
tubérosité externe du tibia. La facette articulaire du
péroné siège sur l'extrémité
supérieure de cet os, en dedans de l'apophyse styloïde. Ces deux
surfaces sont recouvertes d'une mince couche de cartilage(ROUVIERE, 1974).
2°. Moyens d'union :
l'articulation tibio-péronière supérieure possède
une capsule articulaire renforcée par deux ligaments qui sont les
ligaments péronéo-tibiaux antérieur et supérieur et
postérieur et supérieur (KAPANDJI A., 2010).
3°. Mouvements :
L'articulation péronéo-tibiale supérieure ne
peut exécuter que des mouvements de glissement de peu d'étendue
(ROUVIERE, 1974).
1.2.2. L'articulation péronéo-tibiale
inférieure
Les extrémités inférieures des deux os
de la jambe sont unies par une articulation de la classe des amphiarthroses.
1°. Surfaces
articulaires :Les surfaces articulaires sont simplement
recouvertes de périoste. Celle du tibia occupe la face externe et celle
du péroné est le plus souvent convexe d'avant en arrière,
mais les deux surfaces articulaires ne s'opposent que par leurs bords(ROUVIERE,
1974).
2°. Moyens
d'union :l'articulation péronéo-tibiale
inférieure unie par les ligaments péronéo -tibiaux
antérieur et inférieur et postérieur et inférieur
(KAPANDJI A., 2010).
3°. Mouvements : cette
articulation présente de légers mouvements transversaux par
lesquels la malléole externe s'écarte ou se rapproche du tibia.
Ces mouvements sont liés à ceux de l'articulation
tibio-tarsienne(ROUVIERE, 1974).
1.2.3. Le ligament interosseux de la jambe
Ce ligament est une membrane fibreuse et épaisse, elle
comble l'espace entre le tibia et le péroné. Les fibres
collagènes descendent obliquement du bord latéral du tibia au
bord interosseux du péroné, à l'exception de la partie
haute de la membrane où une bande fibreuse monte du tibia à la
fibula(RICHARD DRAKE L. et al., 2006).
Il y a deux ouvertures dans la membrane interosseuse, l'une
à son sommet, l'autre à sa partie inférieure, pour le
passage des vaisseaux qui vont du compartiment postérieur de la jambe.
La membrane interosseuse non seulement unit le tibia et la fibula ensemble,
mais aussi fournit une surface d'insertion à de nombreux muscles(RICHARD
DRAKE L. et al., 2006).
1.3. La myologie de la
jambe
Les muscles de la jambe sont classés en deux grands
groupes suivantleur fonction. Ils s'insèrent tous sur le squelette du
pied à l'exception du poplité quis'insère sur la
jambe(KAHLE W. et al., 1991).
Les différents groupes musculaires sont :
1.3.1. Groupe des extenseurs :
- Muscle jambier antérieur
- Extenseur commun des orteils
- Extenseur propre du gros orteil
- Long péronier latéral
- Le court péronier latéral
Ces deux derniers muscles s'insèrent sur le tubercule
du cinquièmemétatarsien (KAHLE W. et al., 1991).
1.3.2. Les muscles postérieurs de la jambe :
- Muscle soléaire
- Le jumeau interne
- Jumeau externe
Ces trois muscles s'unissent pour former le tendon d'Achille
quis'insère sur la tubérosité postérieure du
calcanéum (KAHLE W. et al., 1991).
- Le plantaire grêle :(muscle inconstant) à son
origine au niveau de celle du jumeau externe, son insertion inférieure
se fait au bord interne du tendon d'Achille (KAHLE W. et al., 1991).
1.3.3. Plan profond :
- Jambier postérieur
- Le long fléchisseur propre du gros orteil
- Le muscle fléchisseur commun des orteils (KAHLE W. et
al.,1991).
1.4. La vascularisation de
la jambe
1.4.1. Artérielle
Elle est assurée par les deux branches terminales
del'artère poplitée, qui sont :
a) Artère tibiale antérieure : Elle naît
de l'artère poplitée au niveau de l'anneau du soléaire et
se termine à l'interligne tibio-tarsienne où elledevient
l'artère pédieuse.
Elle donne les branches collatérales suivantes :
- Artère récurrente tibiale
postérieure.
- Artère récurrente péronière
postérieure.
- Artère récurrente tibiale
antérieure.
- Artère récurrente péronière
antérieure.
- Artère malléolaire interne.
- Artère malléolaire externe et les
artères musculaires (ROUVIERE, 1974).
b) Le tronc tibio-péronier :Deuxième branche de
bifurcation de l'artère poplitée, née au niveau de
l'anneau du soléaire ; se divise en deux branches à quatre
centimètres plus bas en : Artère tibiale postérieure
et artère péronière.
Elle donne les branches collatérales suivantes :
Artère nourricière du tibia, artère récurrente
tibiale interne et artères musculaires (ROUVIERE, 1974).
1.4.2. Veineuse :
Les veines de la jambe sont regroupées en veines
profondes et enveines superficielles ou sous-cutanées.
a) Les veines profondes : Elles sont satellites des
artères. Elles sont deux par artère et sont homonymes aux
branches artérielles qu'elles suivent.
b) Les veines superficielles : Les deux principales sont :
- La veine saphène interne : naît en avant de la
malléole interne et se jette dans la veine fémorale.
- La veine saphène externe : Elle naît de l'union
de la veine plantaire externe superficielle et de la veine marginale externe
derrière la malléole externe.
Elle se jette dans veine poplitée (ROUVIERE, 1974).
1.5. Innervation : Elle est
assurée par le plexus lombo-sacré :
- Nerf péronier commun.
- Nerf péronier profond (tibial antérieur).
- Nerf péronier superficiel (musculo-cutané)
- Nerf cutané sural latéral.
- Nerf cutané sural médial ou saphène
tibial.
- Nerf tibial : sciatique poplité interne (ROUVIERE,
1974).
CHAPITRE 2 : FRACTURES DE
DEUX OS DE LA JAMBE
1. DEFINITION
Les fractures de jambe sont des ruptures de la
continuité d'un ou des deux os de la jambe situées à trois
travers de doigts au-dessous de l'interligne du genou et à trois travers
de doigts au-dessus de l'interligne tibio-tarsienne (BUISSON et al.,2003).
C'est aussiune fracture diaphysaire et
métaphyso-diaphysaire, extra articulaire, d'un ou des deux os de la
jambe (CASTELAIN C. et al.,2000).
2. ETIOLOGIES ET
MECANISMES
1.1. Les étiologies peuvent être multiples selon
qu'il s'agisse d'un traumatisme, où d'une pathologie qui fragilise l'os.
a) Les causes traumatiques sont :
- Les accidents de la voie publique
- Les accidents de sport.
- Les accidents de travail.
- Les
accidents du domicile(POILLEUX F., 1968).
b) Les causes pathologiques sont :
- Une ostéoporose
- Une tumeur ostéolytique. La fracture peut faire
découvrir la tumeur. Le plus souvent il s'agit de métastases mais
parfois, de simples kystes osseux peuvent entraîner des fractures, chez
l'enfant par exemple(LERAT JL, 2009).
1.2. Le mécanisme d'une fracture de jambe peut
être de deux types :
1. Mécanisme direct :
Agent traumatisant vient frapper l'os qui cède au point
d'impact.Le mécanisme explique l'importance des lésions
associées des partiesmolles, en particuliers l'ouverture cutanée
qui est extrêmementfréquente (POILLEUX F., 1968).
2. Mécanisme indirect :
Une contrainte mécanique imposée à l'os
détermine sa rupture à distance du point d'application des
forces, ainsi on distingue :
a) Fracture par compression axiale.
b) Fracture par flexion
c) Fracture par torsion(POILLEUX F., 1968).
3. EPIDEMIOLOGIE
La fréquence des fractures de la jambe des hommes est
le double de celle des femmes et dans la plupart des cas ces fractures c'est
post traumatique(BOUTELIER P., 1999).
Selon RAGGUENEAU JL et JARRIGE, le taux représente
25,8% (RAGGUENEAU JL et JARRIGE, 1978).
Chez nous à Lubumbashi, les fractures de deux os de la
jambe sont très fréquentes. Le sexe masculin en constitue la
victime préférentielle avec 77% de cas ; et 63,22% de ces
fractures sont provoquées par les accidents du trafic routier(KAPE,
2011).
4. ANATOMOPATHOLOGIE
4.1. Les lésions osseuses
a) Le tibia
- Fracture transversale : le trait de fracture est plus
ou moins perpendiculaire à l'axe diaphysaire. Le trait siège
à un niveau variable mais plus volontiers en zone médio
diaphysaire. Sa cause est le plus souvent la flexion responsable d'une fracture
transversale des deux os de la jambe ; le trait siège au même
niveau sur le tibia et le péroné(THOREUX JY NORDIN, 1995).
- Fracture spiroïde : elle est toujours secondaire
à un traumatisme indirect de torsion. Le trait de fracture
péronier siège dans le prolongement de la spire tibiale. Le
déplacement du foyer de fracture se traduit selon le cas par un
chevauchement, un raccourcissement, une rotation, une angulation ou une
translation.
Une variété particulière de fractures
spiroïdes du tibia est la fracture demi-spire décrite par
BOEHLER(THOREUX JY NORDIN, 1995).
- Fracture oblique : le trait est oblique avec une
inclinaison variable par rapport à l'horizontale. Il existe les
fractures obliques courtes qui sont proches des fractures transversales et les
fractures obliques longues dont l'axe est proche de celui de la diaphyse et
s'apparentent aux fractures spiroïdes(BEL MOYEN, 1996).
- Fracture à troisième fragment : il y a
par torsion et en coin de flexion.
1. Par torsion, c'est une fracture spiroïde mais
l'énergie du traumatisme est plus importante et le troisième
fragment est le plus souvent de siège postéro interne dans le
tiers inférieur du tibia et le péroné est toujours
fracturé. Ce troisième fragment garde ses attaches
périostées et consolide habituellement en cas de traitement
orthopédique(THOREUX JY NORDIN, 1995).
2. En coin de flexion sont plus fréquentes que les
fractures par torsion, c'est un mécanisme indirect en flexion. Le
fragment détaché est souvent de siège antéro
externe dans le tiers moyen de la diaphyse (THOREUX JY NORDIN, 1995).
- Fracture bifocale : c'est une fracture à haute
énergie, il s'agit généralement de fracture transversale
ou oblique courte, isolant sur une longueur variable un segment
intermédiaire du tiers moyen de la diaphyse tibiale. Son
mécanisme causal est toujours violant rendant compte de la
fréquence des lésions ouvertes(BONNEVIALE, 2003).
- Fracture comminutive ou fracas : ce sont des fractures
présentant une comminution de tout un segment du cylindre osseux tibial
sur une hauteur variable avec absence de contact entre les deux fragments. Le
plus souvent, elles s'accompagnent d'une ouverture cutanée avec
expulsion d'une esquille osseuse. On parle de fracture avec perte de substance.
b) Le péroné
Les fractures de la diaphyse péronière ne sont
responsables en règle que d'une douleur et d'une gêne
fonctionnelle modérées liées au rôle fiable du
péroné dans la transmission du poids du corps. Le traitement est
purement symptomatique dépendant de la gêne fonctionnelle et de la
douleur. L'abstention thérapeutique est possible (THOREUX JY NORDIN,
1995).
4.2. Les lésions des parties molles
4.1.1. Les lésions cutanées
La face interne de la diaphyse tibiale est directement sous
cutanée, ce qui explique la fréquence des fractures ouvertes.
L'ouverture cutanée et l'infection qui en résulte ont des
conséquences péjoratives sur la consolidation, voilà
pourquoi une fracture ouverte de jambe impose une série de gestes
urgents comme : la prévention du tétanos par une
sérothérapie, l'antibiothérapie, un parage et fermeture de
la plaie, une immobilisation de la fracture,... (ROLLAND E. et al.,1995).
CAUCHOIS et DUPARC ont individualisé trois types
d'ouverture cutanée :
a) Type 1 : c'est une lésion cutanée
bénigne. La plaie est sans décollement ni contusions et les
berges saignent bien après excision économique ;
l'évolution de ces lésions vues précocement est favorable
après stabilisation du foyer.
b) Type 2 : il existe des diverses lésions
cutanées ayant en commun le risque de nécrose cutanée
secondaire en regard du tibia, les plaies délimitant des lambeaux de
vitalité douteuse, il existe un décollement pré tibial et
la plaie associées à une contusion plus ou moins
sévère et étendue.
c) Type 3 : elle est caractérisée par
l'existence d'une perte substance présidial en regard ou à
proximité du foyer de fracture. (MASQUELET AC et al.,1995).
Vers les années 1970, GUSTILLO constate le manque de
précision du type III décrit par CAUCHOIX et DUPARC et propose la
classification suivante :
1°. Le type IIIA : est caractérisé par
une attrition étendue des parties molles qui n'empêchent pas,
cependant, la couverture du foyer de fracture. Dans cette sous type, la
référence à l'élément cutané n'est
pas importante et l'essentiel étant la couverture du foyer.
2°. Le type III B : est marqué par une perte
de substance étendue des parties molles exposant le foyer de fracture.
L'os à proximité du foyer est lui-même deperiosté.
Dans cette sous type il y a une contamination massive.
3°. Le type IIIC : correspond au type IIIB
compliqué par une lésion artérielle responsable d'une
lésion artérielle responsable d'une ischémie du membre.
D'où, la frontière de gravité se situe donc en
réalité dans le type IIIA et IIIB (MASQUELET AC et al., 1995).
4.1.2. Les lésions musculaires
Elles sont extrêmement variables en fonction de la
violence du traumatisme et de l'importance du déplacement. Elles sont
souvent modérées, une simple contusion musculaire, ou une
attrition musculaire localisée cependant que le périoste est
décollé ou déchiré. La destruction des masses
musculaires et de leurs artérioles est responsable d'une ischémie
osseuse compromettant la consolidation osseuse, d'une ischémie
cutanée et d'une ischémie du membre par la suppression des
circulations collatérales(BOURAMDANE NAIMA, 2007).
Il peut aussi arriver dans les lésions musculaires une
simple déchirure du muscle par un fragment de la fracture, un
traumatisme musculaire modéré accompagné d'un
hématome intramusculaire et lorsque cet hématome est volumineux
il peut provoquer un Syndrome des loges de la jambe(MENADI A.,
2007).
Dans les fractures de jambe par écrasement musculaire,
on peut avoir une destruction complète du muscle qui peut entrainer une
insuffisance rénale fonctionnelle par libération de myoglobine
dans le sang puis organique(MENADI A., 2007).
4.1.3. Les lésions vasculo-nerveuses
1°. Vasculaires : les fractures de jambe restent les
grandes pourvoyeuses de lésions vasculaires. Celles-ci surviennent quasi
constante sur les fractures ouvertes. Il peut s'agir de contusion, compression
ou rupture vasculaire. Il faut craindre la lésion de l'artère
poplitée en cas de fracture métaphysaire haute «
Fracture à gangrène de WATSON JONES » surtout
si le traumatisme a été violant et à haute
énergie(MENADI A., 2007).
2°. Nerveuses : Les lésions nerveuses traumatiques
sont peu fréquentes dans les fractures de jambe et la sciatique
poplitée externe peut cravater le col du péroné. Les
lésions nerveuses ischémiques sont irréversibles et
compliquent toute interruption prolongée du flux
artériel(BOURAMDANE NAIMA, 2007)
On peut aussi avoir :
- Neurapraxie : compression simple.
- Axonotmésis : section d'un ou plusieurs axones sans
que le nerf ne soit complètement sectionné.
- Neurotmésis : perte complète de la
continuité du nerf(DAHMANI O. et al.,2009).
5. CLINIQUE
a. Interrogatoire précise :
- L'heure du traumatisme,
- Le mécanisme et son importance,
- La notion de douleur vive, craquement et impotence
fonctionnelle du membre atteint,
- Les sièges des douleurs car une autre douleur oriente
vers d'autres lésions associées,
- Les antécédents du blessé.
b. Examen clinique général
On doit évaluer :
- Etat de conscience, état hémodynamique,
respiration
- Etat du reste de l'appareil locomoteur : bassin,
rachis, crâne
- Examen somatique : abdomen, thorax, ...
c. Examen loco régional
1°. Inspection : est essentielle car permet non
seulement d'évaluer l'état musculo- cutané mais aussi
permet de mettre en évidence le siège de la fracture et le
déplacement : une attitude fréquente est la rotation externe
associée à un raccourcissement. Selon les cas on peut avoir :
§ Une angulation en varus dont le segment
inférieur est en dedans,
§ Une angulation en varus dont le segment
inférieur est en dehors
§ Flexum
§ Recurvatum.
On peut noter également un oedème, desecchymoses
et même des phlyctènes d'apparition tardive.
2°. La palpation : permet de localiser un point
douloureux exquis, explorant une zone osseuse directement sous-cutanée
et de rechercher des crépitations. Si c'est une fracture ouverte, il
faut la classer selon la classification de CAUHOIX et DUPARC ou selon celle de
GUSTILLO.
Les pouls périphériques : pédieux et
tibial postérieur sont à rechercher car les signes d'une
ischémie vasculaire aigue peut se manifester par les quatre
P de Griffith : Pain, Palor, Paralysis et no
Puls. (MENADIA., 2007).
Le déficit sensitif et/ou moteur en aval peut se voir
également.
6. PARACLINIQUES
6.1. La radiographie :
C'est l'examen de choix, après un alignement prudent et
une immobilisation par une attelle transparente aux rayons X, un bilan
radiologique est demandé.
Il comporte des radiographies de face et de profil de la jambe
et des radiographies centrées sur le genou et la cheville. Il
précise :
a) Le siège de la fracture qui est défini par
tiers
b) Le trait de fracture qui peut être unique (fracture
simple) ou complexe (fracture comminutive).
c) Le déplacement de la fracture en 4 types :
- Angulation : dans le plan frontal avec déviation
en valgus ou en varus, dans le plan sagittal avec flessum ou
recurvatum ;
- Baïonnette : translation d'un fragment par rapport
à un autre
- Chevauchement
- Décalage
d) L'existence de trait de refend articulaire
e) L'existence de fractures associées (malléole,
plateau tibial, ...)
f) L'existence de fracture isolée de la diaphyse
tibiale ou péronière.
5.1. L'échographie : Elle permet la
recherche des lésions musculaires et vasculaires.
5.2. Le scanner : permet de donner de
détail en cas de fractures complexes
5.3. La biologie : est très importante
en cas de bilan préopératoire ; si le cas est à
opérer.
7. LE TRAITEMENT
5.4. LES INDICATIONS THERAPEUTIQUES DANS LES FRACTURES DE
LA JAMBE
Ellesse font :
a) En fonction de l'âge
b) En fonction du trait de fracture
c) En fonction du siège de la fracture
d) En fonction des lésions cutanées
5.5. BUT DU TRAITEMENT
Le but du traitement est :
a) D'obtenir la consolidation sans sepsis.
b) De rétablir l'intégrité du squelette
de la jambe
c) De réduire au minimum l'incapacité de
travail et les séquelles fonctionnelles.
5.6. LES METHODES THERAPEUTIQUES
Il existe deux grandes méthodes thérapeutiques
qui sont :
a) orthopédiques non sanglantes, sans
ouverture du foyer de fracture
Les différentes méthodes orthopédiques
non sanglantes sont :
a) Leplâtre cruro-pédieux ;
b) L'extension continue ;
c) La méthode deSARMIENTO(SARMIENTO A., 1967).
On peut aussi utiliser les méthodes suivantes : La
réduction sur cadre de TRILLAT suivie de plâtre, L'association du
plâtre et de broches(LERAT JL, 2009).
b) Le traitement chirurgical
b.1. But :
L'ostéosynthèse a un triple but :
- Réduire anatomiquement le foyer de fracture,
- Maintenir solidement la réduction jusqu'à
consolidation,
- Permettre la mobilisation la plus précoce des
articulations sus et sous-jacentes du foyer de fracture.
b.2. Avantage : Elle assure une
immobilisation durable, solide, sans risque de déplacement secondaire.
La cicatrisation de la plaie et des parties molles se fait dans de meilleures
conditions.
b.3. Inconvénients :
- Risque de non consolidation favorisée par la
dévascularisation des fragments par un dépériostage trop
étendu.
- Le risque infectieux redoutable, voilà pourquoi sa
technique doit être extrêmement rigoureuse et l'asepsie la plus
parfaite.
b.4. Contre-indication :
l'infection avérée
b.5. Moyens :
a. L'ostéosynthèse à foyer ouvert :
- Le vissage simple,
- Les cerclages métalliques,
- Les plaques vissées,
- Le fixateur externe
b. L'enclouage centromédullaire à foyer
fermé(BOURAMDANE NAIMA, 2007).
8. LES COMPLICATIONS
On les classe en complications immédiates, secondaires
et tardives
5.7. Les Complications immédiates
1° L'ouverture cutanée
2° Les lésions des muscles
3° Les lésions vasculaires et nerveuses
4° Les complications générales
5.8. Les Complications secondaires
1° L'infection
2° La nécrose cutanée
3° Les phlébites
4° Les déplacements secondaires sous
plâtre
5° Troubles trophiques
6° L'embolie graisseuse
5.9. Les Complications tardives
1° Retard de consolidation
2° Pseudarthrose : Les pseudarthroses
hypertrophiques et atrophiques
3° Les cals vicieux
4° Raideurs articulaires(LERAT JL, 2009).
CONSIDERATIONS PRATIQUES
CHAPITRE I : MATERIELS ET
METHODES
I.1. MATERIELS
I.1.1. PRESENTATION DU CADRE DE L'ETUDE
Notre étude s'est déroulée aux Cliniques
Universitaires de Lubumbashi (CUL), qui se trouve dans la ville et zone de
santé de Lubumbashi (chef-lieu de la province du Katanga) en
République Démocratique du Congo (RDC).
Les Cliniques Universitaires de Lubumbashi sont
limitées :
- Au Nord par l'avenue KAMBOVE,
- Au Sud par l'avenue NJAMENA,
- A l'Est par l'avenue KASAI,
- A l'Ouest par le lycée TUENDELEE.
Les Cliniques Universitaires Lubumbashi comprennent plusieurs
services :
- Le service de Gynécologie obstétrique ;
- Le service de Pédiatrie;
- Le service de Médecine interne ;
- Le service de Chirurgie ;
- Les services des Spécialités.
L'histoire des CUL révèle que ces
dernières, jadis appelées Cliniques Reine Elisabeth, ont
été construites pendant l'époque coloniale à
partir de 1919 et inaugurées en 1923 pour les soins des colonisateurs
(les blancs) et des personnes dites évoluées. La gestion de cette
institution hospitalière a été confiée aux membres
d'une congrégation Religieuse Catholique, les soeurs de charité
de Grand.
A partir de Novembre 1975, la gestion des Cliniques Reine
Elisabeth a été confiée à l'UNAZA
(Université Nationale du Zaïre), l'actuelle UNILU
(Université de Lubumbashi), d'où le nom des Cliniques
Universitaires de Lubumbashi. Dès lors, l'accès aux soins
médicaux est ouvert à quiconque remplit les formalités
exigées et les objectifs sont fixés sur la recherche et la
formation des étudiants en médecine et en santé
publique.
I.1.2. PATIENTS
L'étude a concerné tous les patients et toutes
patientes de n'importe quel âge hospitalisés au service de
chirurgie des Cliniques Universitaires de Lubumbashi pour une pathologie
traumatique et plus précisément la fracture de la jambe.
I.2. METHODES
I.2.1. PERIODE ET TYPE D'ETUDE
Nous avons procédé à une étude
descriptive transversale des cas de la fracture de la jambe chez les patients
hospitalisés au cours de la période allant de Janvier 2009
à Décembre 2012, soit une période de 4 ans.
I.2.2. CRITERES D'INCLUSION
Tout patient hospitalisé pour fracture de la jambe dans
le service de Chirurgie aux CUL et ayant été
déclaré apte à sortir de l'hôpital après le
traitement bien suivi avec de rendez-vous pour évaluer son
évolution.
I.2.3. CRITERES D'EXCLUSION
Ont été exclus de notre étude, tous
patients :
1. Non hospitalisé pendant la période
d'étude,
2. Hospitalisé pendant la période d'étude
mais ayant demandé une sortie,
3. Hospitalisé pour la (les) complication (s) de la
fracture de la jambe.
4. Ou encore les fiches des patients pas mal remplis.
I.2.4.PARAMETRES ETUDIES
1. Age : nous l'avons comme paramètre pour
rechercher s'il existe une corrélation entre l'âge et la
fréquence de la fracture de la jambe
2. Sexe : ce paramètre a été retenu
avec un objectif de rechercher la fréquence de la fracture de la jambe
entre les deux sexes. Ceci peut nous donner une idée sur la
fréquence dece traumatisme entre homme et femme.
3. Délais entre l'accident et la consultation :
ce paramètre nous aide à rechercher les facteurs qui peuvent
influencer la prise en charge par rapport à l'intervalle de temps
écoulé entre la fracture et la prise en charge. Par exemple en
cas d'une fracture ouverte, il y a la présence d'une plaie, or toute
plaie est considérée comme aseptique dans les 6 à 8 heures
qui suivent le traumatisme, ce qui fait que la prise en charge d'une fracture
ouverte de la jambe où la plaie est infectée est
différente de celle dont la plaie n'est pas infectée.
4. Antécédents
médicochirurgicaux : ce paramètre est retenu pour la
recherche d'un antécédent quelconque qui pourrait expliquer la
survenue de fracture pathologique par exemple.
5. Durée d'hospitalisation : ce paramètre
est retenu pour vérifier le temps de consolidation de la fracture de la
jambe chez les différents patients de même âge ou des
âges différents et savoir les facteurs qui influencent le
délai de consolidation.
6. Etiologie : ce pour vérifier ou voir
l'étiologie la plus fréquente pour la survenue de la fracture.
7. Mécanisme : ce paramètre a
été choisi afin de voir l'impact d'un mécanisme quelconque
à la survenue de la fracture de la jambe chez les différents
patients.
8. Signes cliniques : choisit pour donner l'aspect
clinique ou bien les manifestations cliniques dans la fracture de la
jambe
9. Type de fracture : permet de nous donner une
idée du type de fracture prédominant qu'on peut trouver dans la
jambe.
10. Côté atteint : permet de voir le
côté atteint et le plus touché.
11. L'os atteint : étant donné que nous
avons deux os dans la jambe, ce paramètre nous aidera de voir si un seul
os est plus atteint ou soit les deux os en rapport avec les différents
mécanismes de survenue d'une fracture de la jambe.
12. Autres Fractures associées :ce
paramètre nous permettra de vérifier la survenue des autres
fractures qui s'accompagnent avec celle de la jambe en cas d'accident.
13. Radiographie : ce paramètre est très
utile pour nous donner les éléments en rapport avec l'os atteint,
les traits de fractures et les différents déplacements.
14. Traitement : ce paramètre a été
retenu pour donner le type de traitement qu'on peut adopter devant un type
quelconque de fracture de la jambe.
15. Evolution : permet d'apprécier si la prise en
charge a été bonne ou mauvaise ainsi parler d'une bonne ou
mauvaise évolution de la fracture de la jambe.
16. Complication : nous aidera à donner toutes
sortes de complications qu'on peut avoir en cas de fracture de la jambe.
I.2.5. COLLECTE DES DONNEES
Les données ont été colligées
à partir des registres, des fiches d'hospitalisation, des fiches de
récolte de données préalablement établies.
Les données ont été saisis à
l'ordinateur en utilisant les logiciels Microsoft Word et Excel 2010 puis
analysés sur Epi info version 3.5.1 année 2008.
Concernant les données quantitatives, elles ont
été présentées sous formes de moyenne,
écart-type et de médiane.
Le regroupement en classe s'est effectué à
partir des calculs statistiques de la manière suivante :

· Détermination de nombre de classes :
(Formule de STURGE)
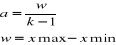
· Amplitude des classes :
(Formule de STURGE)
Avec , Intervalle de
variation
CHAPITRE II : PRESENTATION
DES RESULTATS
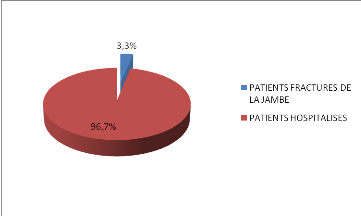
FIGURE 1 : Fréquence de la fracture de la
jambe sur tous les patients hospitalisés
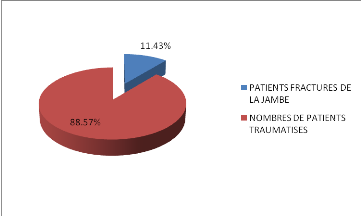
FIGURE 2 : Fréquence de la fracture de la
jambe par rapport autres traumatisme.
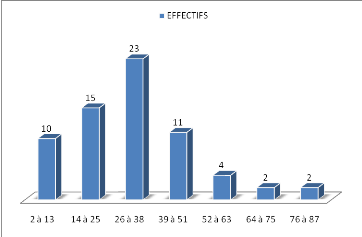
Figure
3 : Répartition Selon L'âge
Il se dégage de cette figure que l'âge des
patients a varié entre 2 et 77 ans, la tranche d'âge de 26
à 38 ans est la plus touchéeavec 23 patients soit, 34,3%, suivi
de la tranche d'âge de 14 à 25 ans avec 15 patients soit, 22,4%.
La moyenne d'âge était de 31,9 #177; 16,9 ans et la médiane
était de 30,0 ans.
TABLEAU I : REPARTITION SELON LE SEXE
|
SEXE
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
|
F
|
21
|
31,3
|
|
M
|
46
|
68,7
|
|
Total
|
67
|
100
|
Il se dégage de ce tableau que le sexe masculin est le
plus touché avec 46 patients, soit 68,7%.
TABLEAU II : REPARTITION SELON LE DELAIS ENTRE
L'ACCIDENTS ET LA CONSULTATION
|
DELAIS ENTRE L'ACCIDENTS ET LA CONSULTATION
|
FREQUENCE
|
POURCENTAGE (%)
|
|
10 minutes à 24 heures
|
55
|
82,1
|
|
2 jours à 10 jours
|
7
|
10,4
|
|
Nos spécifié
|
5
|
7,5
|
|
Total
|
67
|
100
|
Le tableau II révèle que 82,1% de patients ont
consulté pour la fracture de la jambe dans les 10 minutes à 24
heures qui ont suivi l'accident.
TABLEAU III : REPARTION SELON LES ANTECEDENTS
|
ATCD
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
|
Drépanocytose
|
1
|
1,5
|
|
Hypertension artérielle
|
1
|
1,5
|
|
Hypertension artérielle compliquée de
paraplégie droite
|
1
|
1,5
|
|
Hypertension artérielle et tuberculose
compliquée d'hydrocèle
|
1
|
1,5
|
|
Ostéomyélite chronique
|
2
|
3,0
|
|
Sans antécédents
|
61
|
91,0
|
|
Total
|
67
|
100
|
Ce tableau montre que dans 91% de cas aucun
antécédent en rapport avec la pathologie n'a été
observé.
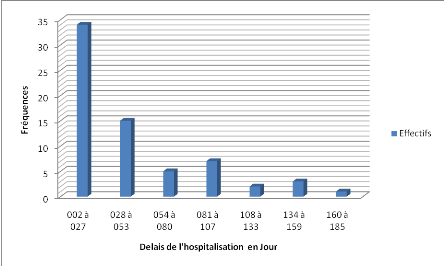
Figure 4 :
Répartition selon la durée d'hospitalisation
Il se dégage de cette figure
que la durée d'hospitalisation a varié entre 2 et 160jours, les
patients fracturés de la jambe ont été plus
hospitalisé dans une période allant de 2 jours à 27 jours
suivi de la tranche de 28jours à 53 jours. La moyenne du séjour
hospitalier était de 39,2 #177; 41,7 jours et la médiane
était de 24,0 jours.
TABLEAU IV : REPARTITION SELON LES ETIOLOGIES
|
ETIOLOGIE
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
|
Accident de Sport
|
2
|
3,0
|
|
Accident de travail
|
3
|
4,5
|
|
Accident domestique
|
3
|
4,5
|
|
Accidents du trafic routier
|
51
|
76,1
|
|
Balle à feu
|
3
|
4,5
|
|
Chute
|
4
|
6,0
|
|
Coups de bâton
|
1
|
1,5
|
|
Total
|
67
|
100
|
Ce tableau nous révèle que les causes de la
fracture de la jambe sont dominées par les accidents de trafics routiers
(ATR) dans 76,1%.
TABLEAU V : REPARTITION SELON
LE MECANISME
|
MECANISME
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
|
Direct
|
56
|
83,6
|
|
Inconnue
|
1
|
1,5
|
|
Indirect
|
10
|
14,9
|
|
Total
|
67
|
100
|
Il se dégage de ce tableau que le mécanisme
direct est plus rencontré avec 56 cas des fractures de la jambe, soit
83,6%.
TABLEAU VI : REPARTITION SELON LES SIGNES CLINIQUES
|
SIGNES CLINIQUES
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
|
Douleur, impotence fonctionnelle, déformation et
oedème
|
7
|
10,4%
|
|
Douleur, impotence fonctionnelle et
déformation
|
16
|
24%
|
|
Douleur, impotence fonctionnelle et
oedème
|
17
|
25,3%
|
|
Douleur et impotence fonctionnelle
|
27
|
40,2%
|
|
Total
|
67
|
100,0%
|
Du point de vue clinique, ce tableau révèle que
la clinique de la fracture de la jambe est dominée par la douleur et
impotence fonctionnelle.
TABLEAU VII : REPARTITION SELON LES TYPES DE
FRACTURES
|
TYPES DE
FRACTURES
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
|
Fermées
|
25
|
37,3%
|
|
Ouvertes
|
42
|
62,7%
|
|
Total
|
67
|
100,0%
|
Il se dégage de ce tableau que dans notre série
les fractures ouvertes ont prédominé dans 62,7% soit 42
patients.
TABLEAU VIII : REPARTITION SELON L'OUVERTURE
CUTANEE
|
TYPES DE FRACTURES OUVERTES
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
|
Ouverte, CAUCHOIX 1
|
12
|
28,6
|
|
Ouverte, CAUCHOIX 2
|
28
|
66,7
|
|
Ouverte, CAUCHOIX 3
|
2
|
4,7
|
|
Total
|
42
|
100,0%
|
Ce tableau montre que selon
l'ouverture cutanée c'est la fracture ouverte type II selon CAUCHOIX et
DUPARC qui est dominant avec 28 fractures soit 66,7%.
TABLEAU IX : REPARTITION SELON LE COTE ATTEINT
|
COTE ATTEINT
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
|
Droit
|
31
|
46,3
|
|
Gauche
|
36
|
53,7
|
|
Total
|
67
|
100
|
Ce tableau révèle
que la jambe gauche est plus fracturée que le côté
droit.
TABLEAU X : REPARTITION SELON LES AUTRES LESIONS
ASSOCIEES
|
FRACTURES ASSOCIEES
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE(%)
|
|
Fracture bi malléolaire
|
1
|
1,5
|
|
Fracture de la clavicule gauche
|
1
|
1,5
|
|
Fracture de la main
|
1
|
1,5
|
|
Fracture des cotes
|
1
|
1,5
|
|
Fracture des côtes et des phalanges
|
1
|
1,5
|
|
Fracture du bassin
|
2
|
3,0
|
|
Fracture du cubitus et radius
|
1
|
1,5
|
|
Fracture du fémur
|
1
|
1,5
|
|
Fracture du radius
|
1
|
1,5
|
|
Pas de fractures associées
|
57
|
85,1
|
|
Total
|
67
|
100,0%
|
Ce tableau révèle que la fracture de la jambe
n'est pas souvent associée à d'autres fractures.
TABLEAU XI: REPARTION SELON L'OS
ATTEINT
|
L'OS ATTEINT
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
|
Fracture isolée du
péroné
|
4
|
6,0
|
|
Fracture isolée du tibia
|
30
|
44,8
|
|
Fracture associée du tibia et
péroné
|
33
|
49,3
|
|
Total
|
67
|
100
|
Ce tableau nous montre que devant la fracture de la jambe, il
y a souvent association des fractures de deux os de la jambe : tibia et
péroné.
TABLEAU XII : REPARTITION SELON LE SIEGE DE
FRACTURE
|
TIBIA
|
PERONE
|
|
SIEGE
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
|
Tiers inférieur
|
20
|
31,7
|
18
|
46,1
|
|
Tiers moyen
|
29
|
46,0
|
12
|
30,7
|
|
Tiers supérieur
|
14
|
22,3
|
8
|
20,5
|
|
Total
|
63
|
100
|
39
|
97,3
|
Au niveau du tibia 46,0% de
fractures siège au tiers moyen et au niveau du péroné
46,1% de fracture siège au tiers inférieur.
TABLEAU XIII : REPARTITION SELON TRAITS DE
FRACTURES
|
TIBIA
|
PERONE
|
|
TRAITS DE FRACTURE
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
|
Transversal
|
16
|
25,4
|
17
|
47,2
|
|
Oblique
|
24
|
38,0
|
10
|
27,8
|
|
Spiroïdes
|
18
|
28,6
|
9
|
25
|
|
Comminutive
|
3
|
4,8
|
0
|
0
|
|
Verticale
|
1
|
1,6
|
0
|
0
|
|
Fissure
|
1
|
1,6
|
0
|
0
|
|
Total
|
63
|
100
|
36
|
100
|
Les fractures obliques prédominent avec 38% au niveau
du tibia contrairement aux transversal au niveau du péroné
représentant 42,2%.
TABLEAU XIV : REPARTITION SELON LE NOMBRES DE
FRAGMENTS
|
TIBIA
|
PERONE
|
|
NOMBRES DE FRAGMENTS
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
|
UN
|
1
|
1,6
|
0
|
0
|
|
DEUX
|
40
|
63,5
|
26
|
70,3
|
|
TROIS
|
11
|
17,5
|
8
|
21,6
|
|
MULTIPLES
|
11
|
17,5
|
3
|
8,1
|
|
TOTAL
|
63
|
100
|
37
|
100
|
Les fractures à deux fragments représentent
63,5% au niveau du tibia et 70,3% au niveau du péroné. TABLEAU XV :
REPARTITION SELON LE DEPLACEMENT FRACTURAIRE
|
DEPLACEMENT
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
|
ANGULATION
|
10
|
12,5
|
|
CHEVAUCHEMENT
|
18
|
22,5
|
|
NON DEPLACE
|
45
|
56,25
|
|
TRANSLATION
|
7
|
8,75
|
|
TOTAL
|
80
|
100
|
Ce
tableau nous révèle que les fractures non déplacées
sont dominants avec 56,25%.
TABLEAU XVI : REPARTITION SELON LE TRAITEMENT
CHIRURGICALE
|
TRAITEMENT
CHIRURGICAL
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
|
ORTHOPEDIQUE
|
40
|
59,7
|
|
SANGLANT
|
14
|
20,4
|
|
ORTHOPEDIQUE ET SANGLANT
|
13
|
19,4
|
|
TOTAL
|
67
|
100
|
Le traitement chirurgical
orthopédique prédomine avec 59,7% devant les autres traitements
chirurgicaux.
TABLEAU XVII : RAPARTITION SELON LE TYPE DE
TRAITEMENT CHIRURGICAL
|
TYPE DE TRAITEMENT
CHIRURGICAL
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
|
Attelle métallique post.
|
1
|
1,5
|
|
Attelle postérieure et Fixateur
externe
|
1
|
1,5
|
|
Botte plâtrée
|
5
|
7,5
|
|
Enclouage centromédullaire
|
1
|
1,5
|
|
Fixateur externe
|
12
|
17,9
|
|
Fixateur externe et plâtre
cruro-pédieux
|
1
|
1,5
|
|
Genouillère plâtrée
|
2
|
3,0
|
|
Plaque vissée et plâtre
cruro-pédieux
|
2
|
3,0
|
|
Plaque vissée et plâtre cruro-pédieux
fenêtré
|
5
|
7,5
|
|
Plâtre cruro-jambier
|
1
|
1,5
|
|
Plâtre cruro-pédieux
|
15
|
22,4
|
|
Plâtre cruro-pédieux
fenêtré
|
13
|
19,4
|
|
Plâtre jambier
|
1
|
1,5
|
|
Repositionnement sanglant et plâtre
cruro-pédieux
|
3
|
4,5
|
|
Sequestrectomie et plâtre
cruro-pédieux
|
1
|
1,5
|
|
Traction transcalcanéenne et plâtre
cruro-pédieux
|
1
|
1,5
|
|
Traction transcalcanéenne
|
1
|
1,5
|
|
Vissage simple
|
1
|
1,5
|
|
Total
|
67
|
100
|
Le traitement fait de plâtre cruro-pédieux
représente 22,4% de tous les types de traitements alors que le
traitement fait de plâtre cruro-pédieux fenêtré
représente 19,4%.
TABLEAU XVIII : REPARTITION SELON L'EVOLUTION
|
EVOLUTION
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
|
Favorable
|
41
|
61,2
|
|
Mauvaise
|
26
|
38,8
|
|
Total
|
67
|
100
|
Parmi les patients, 61,2% ont une évolution favorable
contre 38,8% de cas avec une mauvaise évolution.
TABLEAU XIX : REPARTITION SELON LES
COMPLICATIONS
|
COMPLICATION
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE (%)
|
|
Absentes
|
41
|
61,2
|
|
Cal vicieux
|
1
|
1,5
|
|
Déplacement secondaire
|
12
|
18
|
|
Infection cutanée
|
2
|
3,0
|
|
Ostéite
|
8
|
12
|
|
Retard de consolidation
|
1
|
1,5
|
|
Thrombophlébite
|
2
|
3
|
|
Total
|
67
|
100
|
61,2% de cas de fractures de la jambe n'ontaucune complication
et les complications les plus fréquentes sont les déplacements
secondaires avec 18% de cas suivi d'une ostéite dans 12% de cas.
TABLEAU XX : REPARTITION SELON LES ANNEES
|
ANNEES
|
EFFECTIFS
|
POURCENTAGE (%)
|
|
2009
|
24
|
35,8
|
|
2010
|
13
|
19,4
|
|
2011
|
14
|
20,9
|
|
2012
|
16
|
23,9
|
|
TOTAL
|
67
|
100
|
Ce tableau nous montre que
l'année 2009 a été l'année ou il y a eu plus de
fractures de la jambe avec 35,8% de cas.
CHAPITRE III : DISCUSSION
3.1. Fréquence
Notre étude a porté sur 2045 cas des patients
aux cliniques universitaires de Lubumbashi dans le service de chirurgie
pendant une période allant de janvier 2009 à décembre
2012, période durant laquelle nous avons enregistré 67 cas des
fractures de la jambe soit 3,3% des cas. Sur le total des malades
traumatisé dans le service de chirurgie, nous avons eu un taux de
11,43%. Ce taux représente un taux très inférieurs par
rapport aux constats de NOUHOUM A DIALLO, ROGGUENEAU et al. et Alain CHARLES
MASQUELET qui ont rapportés un pourcentage respectivement de 29,7%,
25,8% et 25% de cas de fracture de la jambe.
Nous constatons une différence d'environ 17,3% et cela
pourrait s'expliquer par le fait que la plupart des patients demandaient des
sorties avant le début de la prise en charge des médecins.
3.2. L'âge
Notre étude a révélé les patients
les plus touchés sont ceux de la tranche d'âge de 26 à
38ans, soit 34,3% ; suivi de la tranche d'âge de 14 à 25 ans,
soit 22,4%. Ces résultats sont prochesde ceux deNOUHOUM A DIALLO et
Alain CHARLES MASQUELETqui ont rapporté les tranches d'âgede 21
à 30 ans pour le premier et de 18 à 40 ans pour les seconds.
Ce résultat pourrait s'expliquer par le fait que ces
tranches d'âge sont les tranches d'âge où les
activités sont plus exécutées.
3.3. Le sexe
Notre étude a révélé une
prédominance du sexe masculin avec 68,7% contre 31,3% pour le sexe
féminin.
Ce résultat se rapproche de celui d'OUSMANE MAIGA qui a
trouvé 65% pour le sexe masculin et 35% pour le sexe féminin.
NOUHOUM A DIALLO a trouvé 76% pour le sexe masculin et
24% pour le sexe féminin et CHAHIDNAZHA a trouvé que les hommes
constituent 84% des cas et les femmes constituent 16% des cas.
Ces résultats pourraient s'expliquer par le fait que
les hommes sont plus exposés aux traumatismes en raison des
activités qu'ils mènent.
3.4. Le délai entre l'accident et la
consultation
Notre étude a révélé que 82,1% de
patients ont consulté entre 10 minutes à 24 heures qui ont suivi
l'accident.
En effet, KAPE a rapporté que la plupart des patients
consultent avec un délai minimum de 10 minutes et maximum de 168heures
et 74,7% des patients ont atteint l'hôpital avant la 6ème heure
post- traumatisme.
RIBAULT L., VERGOS M., KONAN P. dans leur série de 47
cas de fractures ouvertes de jambe, ils ont constaté que 28
blessés soit 60% sont arrivés à l'hôpital avant la
6ème heure et ont pu bénéficier des soins.
Nous pensons que bon nombre des patients arrivent à
l'hôpital à temps après un traumatisme grâce aux
efforts de l'entourage car un patient fracturé ne saura de
lui-même se déplacer afin d'arriver à l'hôpital. Nous
pensons aussi que l'entourage, étant informé du danger que peut
entrainer un traumatisme sans traitement, se presse d'amener à
l'immédiat un patient traumatisé le plus vite que possible
à l'hôpital pour une prise en charge adéquate.
3.5. L'étiologie
Dans notre étude, nous avons noté que les
accidents du trafic routiers représentent les premières causes
fractures de la jambe dans 76,1% de cas.
NOUHOUM A DIALLO a enregistré 64% de fractures dues aux
ATR, CHAHID NAZHA ont enregistré 61% des cas dues aux ATR.
Dans notre étude, la fréquence très
élevé pourrait s'expliquer par des courtoisies routières
élargies, la surpopulation avec recrudescence des véhicules dans
la ville de LUBUMBASHI avec saturation de parking, l'ignorance et le
non-respect du code de la route et parfois même l'ivresse au volant, en
plus le transport à moto dit « phénomène
MANSEBA » joue un rôle important dans la survenue de
traumatisme en générale et de la fracture de la jambe en
particulier.
3.6. Le mécanisme
Dans notre étude nous avons constaté que le
mécanisme direct est plus à la base de la fracture de la jambe
avec 83,6% de cas.
NOUHOUM A DIALLO, dans son étude a constaté
aussi la prédominance du traumatisme par mécanisme direct mais
avec une fréquence de 64,0%.
3.7. Le type de fractures
Notre étude a révélé une
prédominance de fractures de la jambe ouvertes avec 62,7% de cas contre
les fractures de la jambe fermées avec 37,3% de cas.
Ce résultat est très différent de celui
de NOUHOUM A DIALLO et de CHAHID NAZHA qui ont enregistré
respectivement 64% de fractures fermées, 36% de fractures ouvertes et
65,4% de fractures fermées et 35,6% de fractures ouvertes ; par
contre DIKAMBA MUANZA a révélé 14,8 % des fractures
ouvertes de la jambe et 85,2 % des fractures fermées.
Nous pensons que cette grande différence serait
justifié du faite du choc traumatique trop violant que subissaient les
patients concernés et en plus la partie antérieure de la jambe
est peu matelassé c'est-à-dire ne contient pas des muscles.
3.8. L'ouverture cutanée
Notre étude a révélé que le type 2
de la classification de CAUCHOIX et DUPARC a été la plus
rencontrée dans 66,7% de cas de fractures ouvertes.
Ce résultat estinférieur par rapport à
ceux de NOUHOUM A DIALLO, KAPE, OUSMANE MAIGA et MOYIKOUA et al.qui ont
trouvés respectivement 44,4% ; 34,5% ; 56% et 58,4%.
Le point commun entre nous et ces auteurs est que c'est le
type II de la classification de CAUCHOIX et DUPARC qui prédomine en cas
de la fracture ouverte de la jambe.
La différencepar rapport aux pourcentages seraient peut
être due aux différents types d'études
réalisées et la taille de l'échantillon utilisé par
ces auteurs. Le premier a fait une étude prospective sur un
échantillon de 25 patients, le deuxième, son étude
était prospective et portait sur les fractures ouvertes des membres et
la jambe à elle seule comprenait 49 cas, le troisième a
présenté une étude prospective sur 110 patients.
Ce résultat pourrait s'expliquer par le fait que la
fracture type II selon CAUCHOIX se réalise le plus souvent de dehors en
dedans et l'agent traumatique pourrait entrainer une contusion de partie molle
aux alentours de la plaie, ainsi la jambe ayant moins de muscles dans sa partie
antérieure au tiers moyen, voit plus les fractures ouvertes type II
à ce niveau.
3.9. Le côté atteint
Notre étude a révélé que le
côté le plus touché en cas de fractures de la jambe est le
côté gauche dans 53,7% de cas.
Ce résultat est très prochede celui d'OUSMANE
MAIGA qui a trouvé 50%.
Le côté gauche serait plus atteint par le fait
que la majorité de nos patients étant des droitiers se servent de
la jambe gauche comme jambe d'appuis.
3.10. L'os atteint
Nous avons constaté que les deux os de la jambe se
fracturent le plus souvent ensemble dans 49,3% de cas suivi de la fracture du
tibia dans 44,8% de cas.
NOUHOUM A DIALLO a constaté 84% de cas de fractures de
deux os de la jambe et 16% de fractures isolées du tibia.
OUSMANE MAIGA a constaté l'atteinte concomitante des
deux os de la jambe a été la plus représentée avec
80% des cas dans la fracture de la jambe.
Et DIAKITE FAMBOUGOURI a constaté que les deux os de la
jambe se fracturent au même moment dans 53,70% de cas.
Malgré les différences considérables de
pourcentages entre nous et ces trois auteurs, au niveau de la jambe, les deux
os de la jambe se fracturent le plus souvent au même moment.
Cela pourrait s'expliquer par le mécanisme du choc et
l'impact du traumatique.
3.11. Le siège de fracture
Le siège de fracture était plus dans le tiers
moyen et le tiers supérieur dans respectivement 46,0% de cas pour le
tibia et 46,1% de cas pour le péroné.
Ceci pourrait s'expliquer par le fait que le tiers moyen de la
jambe soit la partie la plus exposée au choc du traumatisme et en plus
du fait que les os de la jambe à ce niveau soient le plus en sous
cutanée.
3.12. Le traitement chirurgical
Notre étude a révélé que le
traitement orthopédique a été instauré dans 59,7%
de cas ; le traitement sanglant dans 20,4% de cas et les deux traitements
ensembles dans 19,4% de cas.
Ce résultat est presque semblable à celui de
CHAHID NAZHA qui a trouvé que le traitement étant
orthopédique dans 52% des cas et sanglant dans 48% de cas.
L'utilisation fréquente du traitement
orthopédique serait expliqué par le fait que la plupart de ces
fractures ouvertes était du type II selon CAUCHOIX et DUPARC, devant ces
genres de fractures on doit la rendre le plus fermée possible.
3.13. Le type de traitement chirurgical
Notre étude a révélé que parmi le
traitement orthopédique,les plâtres cruro-pédieux
étaient utilisés dans 22,4% de cas et les plâtres
cruro-pédieux fenêtré étaient utilisés dans
19,4% de cas. Parmi le traitement sanglant, le fixateur externe était
plus utilisé dans 17,9% de cas.
CHAHID NAZHA a constaté que le traitement était
orthopédique dans 52% des cas et chirurgical dans 48% repartie de la
manière suivante : 61,8% de plaque vissée, 12% d'enclouage
centro-médullaire, 23,6% de fixateur externe d'Hoffman et 2,6% de vis de
compression.
Ce résultat pourrait s'expliquer par le fait que la
plupart de fractures ouvertes ont été rendu fermé pour
diminuer le risque infectieux dû aux fractures ouvertes.
3.14. Les séjours hospitaliers
Notre étude a révélé que la
durée d'hospitalisation variait entre 2 et 160 jours et les patients
fracturés de la jambe ont été plus hospitalisé dans
une période allant de 2 jours à 27 jours suivi de la tranche de
28 jours à 53 jours.
NOUHOUM A DIALLO dans son étude 56.0 % de patients
n'étaient pas hospitalisés.
Nous pensons que cette différence serait
justifiée par deux raisons : La première est que son
étude était prospective avec une taille de l'échantillon
différente de la nôtre, la seconde serait par rapport aux types de
fractures qu'il a enregistré qui était plus de fractures
fermées stables qui, après une bon moyen de réduction et
de contention, permet aux patients de rentrer à domicile et de suivre le
traitement en ambulatoire.
Nos résultats s'expliquerait par le fait que nous avons
enregistré plus de fractures ouvertes que fermée ce qui fait que
le patient concerné va être hospitalisé afin de bien suivre
une prise en charge adéquate. Nous pensons également que plus une
fracture est fermée et stable plus le séjour hospitalier est
réduit, ce qui serait peut-être notre cas car nous avons
signalé que la plus part de fractures ouvertes ont été
rendue fermée.
3.15. L'évolution
Dans 59,7% de cas, notre étude a
révélé que l'évolution était bonne contre
37,3% des mauvaises évolutions c'est-à-dire
évoluées vers les complications.
En effet, OUSMANE MAIGA, dans son étude a eu presque le
même résultat ; 63,64% des cas l'évolution
était bonne tandis que 36,36% des cas ont été mauvaises.
Ce résultat serait justifié par le fait d'une
bonne prise en charge de la fracture de la jambe, car une prise en charge
précoce et adéquate prévient et évite les
différentes sortes de complications qu'on peut avoir en cas de la
fracture de la jambe.
3.16. Les complications
Dans 61,2% de cas notre étude a
révélé l'absence des complications contre 38,8% de cas de
complications reparties de la manière suivante :
déplacements secondaires dans 18% de cas, les ostéites dans 12%
de cas, les infections cutanées et les thrombophlébites dans
chacun 3% de cas et enfin les cals vicieux et le retard de consolidation dans
chacun 1,5% de cas.
Ce résultat est comparable à celui de NOUHOUM A
DIALLO qui a constaté dans son étude que 64% de cas de fractures
ont évolué sans complications et 36% de cas de fractures ont
évolué vers les complications.
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Les fractures de la jambe ont constitué l'un des motifs
les plus fréquents des consultations dans 11,43% de cas au service de
chirurgie des Cliniques Universitaires de Lubumbashipendant cette
période allant de janvier 2009 au décembre 2012.
Les causes les plus rencontrées étaient les
accidents de circulations routières avec une prédominance de
fractures ouvertes du type II selon CAUCHOIX et DUPARC.
La tranche d'âge la plus touchée était
comprise entre 26 à 38 anssuivis de la tranche d'âge de 14
à 25 ans et les hommes ont été les plus touché par
rapport aux femmes.
Le diagnostic était le plus souvent clinique et la
radiographie standard était l'examen clé de confirmation du
diagnostic.
La plupart de fractures se sont réalisées du
côté gauche et les deux os de la jambe ont étaient les plus
souvent fracturées au même moment.
Hormis les parages chirurgicaux et le traitement
médical, le traitement chirurgical était dominé par les
plâtres cruro-pédieux et les plâtre cruro-pédieux
fenêtré si méthode orthopédique et les fixateurs
externes si méthode sanglante.
L'évolution de ces fractures était le plus
souvent favorable et les complications étaientplus marquées par
les déplacements secondaires et les ostéites.
Ce constat nous pousse à formuler quelques
recommandations :
· Aux autorités congolaises
de :
1°. Réaliser les campagnes de sensibilisation
concernant le code de la routepar le media sous forme de spot publicitaire et
veiller à ce que les conducteurs de véhicules ne soient pas en
état d'ivresse au volant,
2°. Former des conducteurs dans des auto-écoles
responsables,
3°. Supprimer toutes sortes des courtoisies
routières élargies, aux conséquences néfastes sur
la circulation routière.
· A la population Lushoise, d'amener le
plus tôt possible un patient ou une patiente victime d'un traumatisme en
générale et d'une fracture de la jambe en particulier à
l'hôpital après un accident de trafic routier même minime
étant donné le déficit organisationnel de système
de ramassage des blessés dans notre milieu.
· Aux professionnels de la santé,
de :
1°. Conduire une bonne démarche diagnostic en
demandant un cliché radiologique de la jambe lorsque la fracture est
suspectée chez un patient ;
2°. Référer un patient à temps dans
une institution hospitalière plus qualifiée dès le
diagnostic de la fracture de la jambe est posée,
3°. Instaurer une sérothérapie
associée à l'antibiothérapie avant un
éventuelplâtrage ou pose d'un fixateur externe ou autres
matériels, devant toutes fractures ouvertes afin d'éviter toutes
complications graves telles que le tétanos.
· Aux futurs chercheurs, de faire
une étude sur la prise en charge des complications de la fracture de la
jambe afin de voir si la prise en charge utilisée aux Cliniques
Universitaires est bonne ou pas pour permettre l'amélioration et la
performance de la prise en charge.
RESUME :
Nous avons réalisé une étude
rétrospective de janvier 2009 à décembre 2012 portant sur
67 cas de fracture de jambe. L'âge moyen était 31,9 #177; 16,9 ans
avec des extrêmes de 2 à 77 ans.
La douleur et impotence fonctionnelle du membre
inférieur ont été les signes évocateurs de fracture
de jambe. Le diagnostic a été confirmé par la radiographie
standard de la jambe. Les accidents des trafics routiers ont été
l'étiologie les plus fréquentes.
Le traitement orthopédique avec plâtre
cruro-pédieux a été le plus utilisé et les
complications les plus rencontrées étaient le déplacement
secondaire.
BIBLIOGRAPHIE
· BEL MOYEN ; Fracture de jambe, mécanisme,
diagnostic et traitement ; Socoft ; 1996.
· BONNEVIALE ; Fractures bifocale de la jambe ;
étude critique de 49 cas ; 2003.
· BOUTELIER Phillip. ; Sémiologie
Chirurgicale, 6ème édition ; 1999.
· BOURAMDANE NAIMA ; L'enclouage
centromédullaire dans le traitement des fractures des deux os de la
jambe, 2007.
· BUISSON, MAYRET P FESSY ; Orthopédie
Traumatologie. Edition Vernazobres, 2003.
· CASTELAIN Christophe, CHRISTOFILIS Michel, JAYANKURA
Marc, SAMAHA Camille et ZOUAOUYSamy ; Orthopédie pierre et marie curie ;
2000.
· CHAHID NAZHA ; Fracture de jambe à
l'hôpital Hassan II de KHOURIBGA ; 2003.
· DAHMANI Omar, BELCAID Amal, Ouafa EL AZZOUZI et Hayat
EL HAMI ; Les fractures ouvertes de jambe : Anapath et traitement,
2009.
· DIAKITE FAMBOUGOURI ; Fracture de Jambe chez
l'enfant dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique de
l'Hôpital Gabriel Touré : étude
épidémiologique et clinique ; 2006
· DIKAMBA MUANZA ; Fractures ouvertes de la jambe
à l'hôpital SENDWE ; 1998.
· ELAINE MARIEB N. ; Anatomie et physiologie
humaine ; 6ème édition ; 2006
· KAHLE W, LEONHARDT H, PLATTZER W ; Anatomie,
Appareil locomoteur ; Flammarion-Médecine-sciencesTome 1 ;
1991.
· KAPANDJI ADALBERT IBRAHIM ; Physiologie
articulaire : membres inférieurs ; 5ème
édition ; 2010
· KAPE ; Traitement des fractures ouvertes des
membres à Lubumbashi de 2006 à 2009 ; 2011.
· LERAT JL ; Généralités sur
les fractures, fractures de l'enfant, fractures de la jambe et fractures du
fémur ; 2009.
· MASQUELET AC ; Chirurgie Orthopédique,
principe, généralité et techniques chirurgicales
orthopédiques de l'adulte ; Elsevier Masson ; 2004.
· MASQUELET AC, BEGUE T., COURT C. ; fractures
ouvertes de jambe ; Elsevier Paris, 1995.
· MENADI A. ; Fractures de jambe ; 2007.
· NOUHOUM A DIALLO ; Prise en Charge des fractures
de jambe à L'hôpital de Sikasso Du 1er Janvier Au 31
Décembre ; 2008.
· OUSMANE MAIGA ;Etude épidémiologique
et clinique des fractures ouvertes des os de la jambe dans le service de
chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Gabriel
Toure ; 2006.
· PETER LE COULTER VASEY ; Evolution du traitement
des fractures ouvertes de jambe ; SOCOFT, 2000.
· POILLEUX F. ; Sémiologie chirurgicale,
Flammarion médecine sciences, Tome I ,3ème édition ;
1968.
· RAGGUENEAU JL et JARRIGE ; Guide
orthopédique, 2ème édition paris 1978.
· RIBAULT L., VERGOS M. et KONAN P. ; Fractures
ouvertes de jambe. Indications thérapeutiques à propos de 47 cas
traités dans un centre régional en zone sub-sahélienne de
l'Afrique de l'ouest. Médecine d'Afrique noire : 1990.
· RICHARD DRAKE L., WAYNE VOGL et ADAM MITCHELL
W.M. ; Gray's anatomie pour les étudiants ; édition
Elsevier Masson ; 2006.
· ROLLAND E., SAILLANT G. ; La consolidation osseuse
normale et pathologique, Elsevier, 1995.
· ROUVIERE ; Anatomie humaine, descriptive,
topographique et fonctionnelle ; onzième édition ; tome
III, 1974.
· SARMIENTO A; Functional bracing of tibialfracture;
springer; 1995.
· THOREUX P. JY. NORDIN : Fracture fermée de
la jambe de l'adulte, EMC ; 1995.
ANNEXE
FICHE DE RECOLTE DES
DONNEES
1. Nom et Post nom :
....................................................................................
2. Age : .........
3. Sexe : A. Masculin B. Féminin
4. Délais entre l'accident et la consultation :
......................................................
5. Antécédents médicaux :
...............................................................
6. Antécédents chirurgicaux :
..............................................................
7. Hospitalisation antérieure : a. OUI b. NON
8. Durée d'hospitalisation : A. ? 24 H B. 24 - 48 H
C. ? 48 H
9. Etiologie : A. ATR B. Accident de sport C. Accident du
travail D. Accident domestique E. Autres
10. Mécanisme : A. Direct B. Indirect
11. Signes cliniques :
a. Douleur : 1. OUI 2. NON
b. Déformation : 1. Varus 2. Valgus 3. Flexum 4.
Recurvatum
c. Impotence fonctionnelle : A. OUI B. NON
d. OEdème : A. OUI B. NON
e. Autres : .............................................
12. Type de fracture : a : Fermée b : Ouverte :
b1.Cauchoix I b2. Cauchoix II b3. Cauchoix III
13. Cote atteint : a. Droit b. Gauche
14. Autres Fractures associées : a. Tête b.
Thorax c. Pelvienne d. Cuisse e. Pieds f. Autres
15. Autres lésions associées : a.
cutanées b. Vasculaires c. Nerveuses d. Musculaire
16. Examens Complémentaires :
I : Radiographie :
A : Fracture isolée du tibia :
A1 : Siège : a. 1/3 supérieur b.1/3 moyen c.1/3
: inférieur
A2 : Trait de fracture : a. Spiroide b. Oblique c.
Transversal
A3 : Nombre de fragment : a. Deux fragments b. Trois fragments
c. Multiples
A4: Déplacement : a. Non déplacée b.
Angulation c. Translation d. Chevauchement
B : Fracture isolée du péroné :
B1 : Siège : a. 1/3 supérieur b.1/3 moyen c.1/3
: inférieur
B2 : Trait de fracture : a. Spiroïde b. Oblique c.
Transversal
B3 : Nombre de fragment : a. Deux fragments b. Trois fragments
c. Multiples
B4: Déplacement : a. Non déplacée b.
Angulation c. Translation d. Chevauchement
C : Fracture associe des os : a. OUI b. NON
II : Echographie : a. OUI b. NON
III : TDM : a. OUI b. NON
17. Traitement :
A. Général : 1. SAT 2. VAT 3.
Analgésiques 4. Antibiotique
B. Local :
a. Orthopédique :
..................................................................
b. Chirurgicale : b1. Plaque vissée b2. Vissage
simple
b3. Enclouage centromédullaire b4. Embrochage
b5. Parage b6. Fixateurs externes
18. Evolution : a. Favorable b. Mauvaise
19. Complication :
a. Immédiates : a1. Ouverture cutanée a2.
Vasculaire a3. Nerveuse
b. Secondaires : b1. Déplacement secondaire b2.
Nécrose de la peau b3. Autres
c. Tardives : c1. Retard de consolidation c2. Pseudarthrose
c3. Ostéite
c4. Cal vicieux c5. Autres
TABLE DES MATIERES



