|
_

Département Pédagogique : Action
Médicale.
Section : Santé Publique.
1ère Promotion.
24
Année 2012-2013
N°
TITRE :
EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA CONSULTATION
PRENATALE RECENTREE : CAS DE L'HÔPITAL REGIONAL DE L'ESTUAIRE
À MELEN.
Mémoire de fin de cycle pour l'obtention d'un
Diplôme de Master en Santé Publique.
Rédigé et présenté
par :
Sous la direction du :
Nadège Marina NGUIDANG OBIANG
Docteur Médard TOUNG MVE
épouse NGUEMA MBA
Spécialiste en Santé
Publique
Libreville, Avril, 2013
Table des
matières
Table des matières
ii
Avant propos
iv
Dédicaces
vi
Remerciements
viii
Liste des acronymes ou abréviations
ix
Liste des tableaux
x
Liste des figures
xi
Liste des annexes
xii
Résumé
xiv
Abstract
xv
Introduction
1
PREMIERE
PARTIE : PRESENTATION DU CADRE DE TRAVAIL
6
Chapitre
1 : Analyse situationnelle du Gabon et de la Région Sanitaire
Ouest
7
1.1. Généralités sur le
Gabon
7
1.1.1. La situation géographique et
démographique du Gabon
7
1.1.2. La situation économique du
Gabon
7
1.1.3. L'état sanitaire de la
population gabonaise
8
1.1.4. Le système sanitaire du
Gabon
8
1.2. La Région Sanitaire Ouest dans
la Province de l'Estuaire
9
1.2.1. Situation
géo-démographique
9
1.2.2. L'offre des soins dans le Komo
Mondah
9
Chapitre
2 : Milieu de l'étude
11
2.1. Présentation de la structure
11
2.1.1. Localisation géographique et
population couverte
11
2.1.2. Historique
11
2.1.3. Objectif et missions
12
2.1.4. Statut juridique
12
2.1.5. Fonctionnement de la structure
12
2.1.6. Organisation de la structure
13
2.2. Présentation du service CPN
14
2.2.1 Les objectifs de la CPN:
14
2.2.2. La structuration du service de la
CPN
14
2.2.3. Le personnel intervenant dans le
service de la CPN
15
2.2.4. Fonctionnement et organisation du
travail
15
2.2.5. La tarification des actes
16
2.2.6. Présentation des
activités réalisées
17
2.2.7 Les points forts du service de la
CPN :
18
2.2.8 Les points faibles du service de la
CPN :
18
DEUXIEME
PARTIE : RECENSION DES ECRITS ET METHODOLOGIE
19
Chapitre
3 : Recension des écrits
20
Chapitre
4 : Méthodologie
22
4.1. Définitions des
concepts :
22
4.1.1. Evaluation :
22
4.1.2. La mise en oeuvre :
22
4.1.3. La consultation prénatale
recentrée :
23
4.2. Cadre conceptuel
24
4.3. Population d'étude
25
4.4. Méthode et technique de
l'échantillonnage
25
4.5. Stratégies de recherche
25
4.5.1. Méthodes et types de
recherche
25
4.5.2. Techniques et choix des outils
25
4.6. Pré-test
27
4.7. Déroulement de
l'enquête
27
4.8. Dépouillement et traitement des
données
27
4.9. Limites de notre étude
27
4.10. Considérations
éthiques
28
TROISIEME
PARTIE : PRESENTATION DES RESULTATS ET DISCUSSION
29
Chapitre
5 : Résultats de l'enquête
30
5.1. Etude des structures
30
5.1.1. Infrastructure
30
5.1.2. L'équipement et le
matériel :
31
Les compétences :
33
5.2. Etude des procédures
(processus) :
33
5.2.1. La pratique de la consultation
prénatale recentrée
33
5.2.2. Accessibilité du service
45
5.3. Entretien avec les prestataires de la
CPN
47
Chapitre
6 : Discussion
48
6.1. Le respect des normes et des
procédures de la CPNR à l'HREM
48
6.1.1. Normes par rapport à
l'environnement physique :
48
6.1.2. Normes par rapport à la
procédure de la CPNR :
49
6.1.3. Normes par rapport aux
activités intégrées à la CPNR :
50
6.2. L'évaluation des prestataires et
du programme de la CPN
54
6.2.1. Evaluation des compétences des
prestataires:
54
6.2.2. Evaluation du programme de la
CPN :
56
Conclusion
et suggestions
59
Références
bibliographiques
62
ANNEXES
66
Glossaire
81
AVANT PROPOS
Avant propos
Le système de santé gabonais, orienté
vers l'hospitalocentrisme, se caractérise par de faibles indicateurs.
Cette situation est préoccupante pour les nouvelles autorités qui
se proposent de conduire le Gabon au rang des pays émergents. Ainsi,
l'amélioration de l'état de santé des populations
revêt plus que jamais une importance capitale. Cette volonté
politique s'est concrétisée, entre autres, par la réforme
de l'Ecole Nationale d'Action Sanitaire et Sociale (ENASS) en Institut National
de Formation d'Action Sanitaire et Sociale (INFASS) pour former les personnels
de santé en particulier les étudiants en Master de Santé
Publique. Le but étant de former des praticiens spécialistes en
Santé Publique qui contribueront à la promotion de la
santé, à la protection sanitaire et à la prévention
des maladies dans la population au moyen d'un effort communautaire. L'objectif
final de cette formation est d'agir sur les facteurs sanitaires non
médicaux et médicaux au sein de la population.
Aussi, en vue, d'une part, de valoriser l'application
rigoureuse des concepts et techniques acquis lors de la dispensation des
différents modules de formation, et, d'autre part, de permettre aux
étudiants de développer les habiletés pour devenir des
professionnels de santé publique, des travaux de fin d'étude
sont-ils élaborés par les apprenants en fonction des
problèmes prioritaires du pays.
C'est dans cette optique que nous avons effectué notre
étude à l'Hôpital Régional de l'Estuaire à
Melen (HREM) dans le service de consultation prénatale du 03 septembre
au 03 octobre 2012. Notre attention a porté sur l'intervention en
santé maternelle. Le thème choisi est la Consultation
Prénatale Recentrée(CPNR) qui se présente comme
une meilleure stratégie, moins chère et plus efficace dans
l'accélération de la réduction de la mortalité
maternelle en vue d'atteindre l'Objectif 5 du Millénaire et du
Développement (OMD5) relatif à l'amélioration de la
santé maternelle.
Ce document analyse la mise oeuvre de la CPNR à l'HREM
en tenant compte des normes et procédures qui y sont établies. Il
permet également d'améliorer la pratique des consultations
prénatales focalisées par la critique des résultats
obtenus et la prise en compte des suggestions formulées à ce
sujet.
Nous espérons que ce travail puisse servir d'outil de
référence pour contribuer à l'amélioration du
programme de la CPNR dans la politique de la santé de la reproduction au
Gabon.
DEDICACES
Dédicaces
Je dédie ce travail :
A toutes les mères qui ont perdu la vie en donnant la
vie ;
A toutes les femmes qui ont perdu leur produit de conception
en voulant donner la vie ;
A toutes les femmes victimes des difficultés de la
grossesse et de l'accouchement ;
Aux orphelins dont les mères ont succombé en
leur donnant la vie ;
Aux femmes qui désirent une maternité en
vain ;
A mon père feu OBIANG NDONG Moïse pour nous avoir
inculqué les valeurs morales, d'être parmi les meilleurs, de
croire en ses capacités, de suivre son destin et d'aller jusqu'au bout
de ses rêves. Nous te devons cette forte personnalité. Repose en
paix Papa ;
A ma mère MIMBOUI mi ONDO Marie Constantine, femme
Africaine, femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve
Woleu, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui la première m'ouvris
les yeux aux prodiges de la terre. Merci de m'avoir mis au monde, merci pour
tout ce que tu fis pour moi ;
A mon cher époux NGUEMA MBA Jean Urbain qui n'a
ménagé aucun effort pour la réalisation de ce travail,
qu'il soit le fruit de ton soutien multiforme. Que Dieu t'accorde longue vie
pleine de santé ;
A mes enfants : MINTSA mi NGUEMA Jeanne Chancelia, OBIANG
MBA Bernard Thibault, MVOU MBA Pierre Aymar pour l'amour que vous m'apportez.
Vous êtes ma joie de vivre. Je vous suis reconnaissante d'avoir
supporté mes nombreuses absences à la maison pour
l'élaboration de ce travail. Ce dernier est la trace de vos
pas ;
Que tous ceux ou celles qui n'ont pas été
cités (es) nommément trouvent ici l'expression de ma profonde
gratitude.
REMMERCIEMENTS
Remerciements
Je voudrais profiter de cette page, pour témoigner ma
profonde gratitude et adresser mes sincères remerciements, à tous
ceux qui de près ou de loin ont contribué à la
réussite de ce travail. Je pense particulièrement :
Aux Autorités Gabonaises qui nous ont permis d'obtenir
le concours d'admission à l'Institut National de Formation d'Action
Sanitaire et Sociale (INFASS) pour préparer le Diplôme de Master
en Santé Publique ;
Aux personnels de la direction de l'Institut National de
Formation d'Action Sanitaire et Sociale (INFASS) plus particulièrement
à Monsieur le Directeur de l'institut Léonard
ASSONGO pour ses encouragements, son dynamisme et son assiduité
au travail ;
Au corps enseignant pour l'intérêt qu'il nous a
accordé, en plus de la qualité de l'enseignement dispensé
durant ces deux années d'étude.
Au Docteur Médard TOUNG MVE qui a
accepté d'être mon encadreur, pour m'avoir conseillé et
guidé dans ce travail. Sa rigueur, ses orientations et sa
disponibilité ont été un atout indéniable ;
A Monsieur Emmanuel ASSOUMOU NKA qui a bien
voulu lire notre travail et apporter les corrections nécessaires ;
Aux personnels de la Direction Nationale de la Santé
Maternelle et Infantile ainsi que les personnels des organismes internationaux
pour leur disponibilité et la mise à disposition de la
documentation et autres informations nécessaires. Il s'agit notamment
de :
-Madame Clarisse MOULAMBA chargée de
la composante Consultation Prénatale Recentrée (CPNR°)
à la Direction Nationale de la Santé Maternelle;
-Madame Dominique AYINGONE, Chargée
d'Etudes à la Direction Nationale de la Santé Maternelle;
-Dr Patricia KEBA (UNFPA) ;
-Dr Annie MBADINGA, Mme Ghislaine
SOUAMY (OMS), Mme Blandine ONDZAGHE (UNICEF).
A tout le personnel du service de la CPN à l'HREM pour
la collaboration et la disponibilité de tous en particulier les
Sages-femmes ;
A toute ma promotion courage et persévérance.
Liste des acronymes ou
abréviations
|
Sigles
|
Désignation
|
|
BPN
|
Bilan Prénatal
|
|
CIPD
|
Conférence Internationale sur la Population et le
Développement
|
|
CNAMGS
|
Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale
|
|
CPN
|
Consultation Prénatale
|
|
CPNR
|
Consultation Prénatale Recentrée
|
|
CSP
|
Cadre de Santé Publique
|
|
DNSMI
|
Direction Nationale de Santé Maternelle et Infantile
|
|
EDSG
|
Enquête Démographique et de Santé au Gabon
|
|
HREM
|
Hôpital Régional de l'Estuaire de Melen
|
|
HTA
|
Hypertension Artérielle
|
|
IEC
|
Information Education Communication
|
|
INFASS
|
Institut National de Formation d'Action Sanitaire et Sociale
|
|
MII
|
Moustiquaire Imprégné d'Insecticide
|
|
MILDE
|
Moustiquaire Imprégné à Longue Durée
d'Efficacité
|
|
OMD
|
Objectif du Millénaire pour le Développement
|
|
OMS
|
Organisation Mondiale de la Santé
|
|
PF
|
Planification Familiale
|
|
PIB
|
Produit Intérieur Brut
|
|
PK
|
Point Kilomètre
|
|
PMA
|
Paquet Minimum d'Activité
|
|
PNDS
|
Plan National de Développement Sanitaire
|
|
PRDSO
|
Plan Régional de Développement Sanitaire Ouest
|
|
PNUD
|
Programme des Nations Unies pour le Développement
|
|
PTME
|
Prévention pour la Transmission du VIH de la Mère
à l'Enfant
|
|
SA
|
Semaine d'Aménorrhée
|
|
SF
|
Sage-femme
|
|
SIDA
|
Syndrome Immunodéficience Acquise
|
|
SITAN
|
Analyse de la Situation de la Mère et de l'Enfant
|
|
SMI
|
Santé Maternelle et Infantile
|
|
SP
|
Sulfadoxine Pyriméthamine
|
|
SR
|
Santé de la Reproduction
|
|
TPI
|
Traitement Préventif Intermittent
|
|
UNFPA
|
Fonds des Nations Unies pour la Population
|
|
UNICEF
|
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
|
|
VAT
|
Vaccin Antitétanique
|
|
VIH
|
Virus de l'Immunodéficience Humaine
|
Liste des tableaux
|
TABLEAUX
|
TITRES
|
PAGES
|
|
1
|
Répartition du personnel soignant et non soignant
à l'HREM
|
12
|
|
2
|
Répartition des sources de financement de l'HREM en
2012
|
13
|
|
3
|
Nombre et état des locaux affectés à la
CPN à l'HREM
|
30
|
|
4
|
Etat de l'environnement du service de la CPN entre
sept-oct.2012 à l'HREM
|
31
|
|
5
|
Etat des équipements dans le service de la CPN en
sept-oct.2012 à l'HREM
|
31
|
|
6
|
Etat du plateau technique du service de la CPN entre
sept-oct.2012 à l'HREM
|
32
|
|
7
|
Outils/Supports de sensibilisation du service de la CPN entre
sept-oct.2012 à l'HREM
|
32
|
|
8
|
|
33
|
|
9
|
Répartition des gestantes vues en CPN1 selon le terme
de la grossesse entre sept-oct.2012 à l'HREM
|
34
|
|
10
|
Répartition des gestantes vues en CPN4 selon le terme
de la grossesse entre sept-oct.2012 à l'HREM
|
35
|
|
11
|
Répartition des gestantes selon le nombre
d'échographies prescrites à la CPN entre sept-oct.2012 à
l'HREM
|
37
|
|
12
|
Classification des gestantes en fonction des risques
dépistés à la CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM
|
37
|
|
13
|
Répartition des facteurs de risque
dépistés chez les gestantes à la CPN entre sept-oct.2012
à l'HREM
|
38
|
|
14
|
Répartition des gestantes référées
par le service de la CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM
|
38
|
|
15
|
Répartition des gestantes selon le motif de
référence en CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM
|
39
|
|
16
|
Répartition des gestantes selon le nombre de vaccins
proposés en CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM
|
39
|
|
17
|
Répartition des gestantes ayant reçu la
supplémentation fer/acide folique en CPN en sept-oct.2012 à
l'HREM.
|
40
|
|
18
|
Répartition des gestantes selon le nombre TPI prescrits
en CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM
|
41
|
|
19
|
Répartition des gestantes selon le terme de la
prescription de la SP en CPN entre sept-oct. 2012 à l'HREM
|
42
|
|
20
|
Répartition des gestantes ayant entendu parler de la
CPNR entre sept-oct. 2012 à l'HREM
|
44
|
|
21
|
Répartition des gestantes en fonction des
critères de choix du service de la CPN entre sept-oct.2012 à
l'HREM
|
45
|
Liste des figures
|
FIGURES
|
TITRES
|
PAGES
|
|
1
|
Approche évaluative de la qualité selon
Donabédian
|
24
|
|
2
|
Répartition des gestantes selon le nombre de CPN
effectuées entre sept-oct.2012 à l'HREM
|
34
|
|
3
|
Proportion des gestantes ayant été
examinée en CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM
|
35
|
|
4
|
Proportion des gestantes ayant reçu la prescription du
BPN en CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM
|
36
|
|
5
|
Proportion des gestantes ayant réalisé le BPN
entre sept-oct.2012 à l'HREM
|
36
|
|
6
|
Proportion des gestantes ayant reçu la prescription des
vermifuges en CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM
|
40
|
|
7
|
Proportion des gestantes ayant reçu la prescription de
la SP en CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM
|
41
|
|
8
|
Proportion des gestantes ayant un Counseling avant et
après le dépistage VIH/SIDA en sept-oct.2012 à l'HREM
|
43
|
|
9
|
Répartition des gestantes selon les thématiques
sensibilisées individuellement en CPN entre sept-oct.2012 à
l'HREM
|
43
|
|
10
|
Répartition des gestantes selon les conseils
reçus individuellement en CPN pour la préparation à
l'accouchement entre sept-oct.2012 à l'HREM
|
44
|
|
11
|
Répartition des gestantes selon le lieu de
résidence entre sept-oct.2012 à l'HREM
|
45
|
|
12
|
Opinions des gestantes sur la satisfaction de l'accueil et des
prestations offertes en CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM
|
46
|
Liste des annexes
|
ANNEXES
|
TITRES
|
PAGES
|
|
1
|
Autorisation d'enquête
|
67-68
|
|
2
|
Carte de la Région Sanitaire Ouest
|
69
|
|
3
|
Organigramme de la structure
|
70
|
|
4
|
Fiche d'observation
|
71-72
|
|
5
|
Fiche d'entretien avec le personnel
|
73
|
|
6
|
Fiche d'entretien avec la cliente
|
74
|
|
7
|
Ordonnance prénatale et liste des articles
nécessaires à l'accouchement
|
75
|
|
8
|
Calendrier vaccinal de la femme enceinte
|
76
|
|
9
|
Affiche sur les signes de danger collée au mur
|
77
|
|
10
|
Affiche sur les avantages de la planification familiale
collée au mur
|
78
|
|
11
|
Structuration du service de la CPN à l'HREM en
février 2012
|
79
|
|
12
|
Chronogramme de travail
|
80
|
RESUME/ABSTRACT
Résumé
Le présent travail se propose d'apprécier
l'état de la mise en oeuvre de la CPNR à l'HREM en vue de
contribuer à l'amélioration de la pratique des soins
prénatals focalisés pour réduire la mortalité
maternelle au Gabon. Pour y parvenir, la démarche méthodologique
a consisté en une recherche documentaire, une observation de la CPN et
des entretiens avec les prestataires et gestantes. Un échantillon non
probabiliste de 100 gestantes vues en CPN a fait l'objet d'une enquête
formelle. Il ressort de l'analyse des résultats que les soins
prénatals paraissent accessibles aux gestantes avec un accueil favorable
à 65% et une satisfaction face aux prestations offertes à 80%.
Ces soins sont gérés par un personnel qualifié et
compétent. Mais quelques gestantes ont effectué plus de 6 visites
au lieu de 4 comme le prévoit l'OMS, et viennent consulter tardivement
pour effectuer la première CPN. Aussi, 33% des gestantes parmi les 100
observées n'ont pas été proposées à se faire
vacciner. Le TPI a été prescrit chez 10 gestantes avant la
16èmeSA. L'IEC et la préparation à
l'accouchement sont presque négligées par les prestataires. Par
ailleurs, 23% des gestantes ont été dépistées
à risque et 7% d'entre elles étaient
référées. Malgré l'accès et l'utilisation du
service de la CPN par les gestantes, la mise en oeuvre de la CPNR à
l'HREM ne respecte pas les recommandations de l'OMS et son efficacité
reste à démontrer. D'où la nécessité de
faire des suggestions pour remettre à niveau la pratique de la CPNR.
Mots clés : consultation
prénatale recentrée, mise en ouvre, Hôpital Régional
de l'Estuaire Melen.
Abstract
The present work proposes to appreciate the condition on
implementation of the RPNC to HREM with in the view to contribute to the
improvement of the practices of prenatal cares focused to reduce maternal
mortality in Gabon. For reaching it, the methodological step consisted of a
documentary's research, an observation to PNC and a deal or negotiation with
customers and recipients. A non-probabilistic sample of 100% customers looked
in PNC subject to a formal investigation. It emerges from analysis of the
results that the prenatal cares appear accessible to the customers with a
favourable welcome at 65% and a satisfaction facing offered allowance to 80%.
There cares are managed by a qualified and competent staff. But some customers
made more than 6 medical examinations instead of 4 as the WHO planed it and
come consult later for carrying out the 1st PNC. Also 33% of the
customers among the 100 observed have not been suggested become vaccinate. The
TPI has been prescribed by 10 customers before the 16th SA.IEC and
the preparation to birth are almost disregarded by the recipients. Moreover,
23% of the customers have been screened at risk and 7% among them have been
referred. Despite the access and the use of the service of the PNC by
customers, the implementation of the RPNC to HREM doesn't respect the
recommendations of WHO und his effectiveness must be proved. Hence the need to
make propositions to put a standard practice of the RPN
Keys words: refocused prenatal consultation,
implementation, Regional Hospital of Estuary Melen
INTRODUCTION
Introduction
Avec plus de 300 millions de femmes dans le monde qui
souffrent de pathologies aigues ou chroniques consécutives à la
grossesse ou à l'accouchement et près de 529.000 femmes1(*) qui meurent chaque année
des causes liées à la grossesse, la mortalité maternelle
constitue un véritable problème de santé publique.
Les pays en voie de développement sont les plus
durement touchés (99% des décès mondiaux), et,
particulièrement ceux de l'Afrique subsaharienne où 1 femme sur
13 meure pour des raisons liées à la grossesse contre une femme
sur 4085 dans les pays industrialisés2(*) . Ce qui fait de la mortalité maternelle un
indicateur qui révèle la plus grande inégalité
entre les pays développés et les pays en voie de
développement. 3(*)
Le Gabon, pays situé en Afrique Centrale
n'échappe pas à cette triste réalité. Selon l'EDSG
en 2000 et l'OMS en 2005, les taux de mortalité maternelle
étaient estimés respectivement à 519 décès
pour 100.000 naissances vivantes et 420 décès pour 100.000
naissances vivantes, soit 200 décès maternels par an4(*). Parmi ces décès,
environ un sur cinq (19%) serait dû à des causes
maternelles5(*). Ce fort
taux de mortalité maternelle contraste avec le succès que
connaissent les soins prénatals, leur accessibilité et leur bonne
couverture respectivement de 94% pour la CPN1, et 63% pour les 4 CPN6(*).Cet écart de couverture
entre la CPN1 et CPN4 peut avoir un impact négatif sur
l'efficacité du suivi prénatal pour la réduction de la
morbidité et de la mortalité maternelles et néonatales.
Dès la fin des années 80, la communauté
internationale prend conscience de l'ampleur et de la nécessité
de lutter contre cette mortalité maternelle, d'où la
conférence de Nairobi « l'Initiative sur la
maternité sans risque » organisée en 1987, le programme
d'action de la conférence internationale sur la population et le
Développement du Caire en 1994, les Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD) lancés par les Nations Unies en 2000. Ces
réflexions se sont matérialisées, à la demande de
l'OMS, par l'adoption en 2004 d'une feuille de route africaine dont le but est
d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle
et néo-natale. Le Gabon adopte sa propre feuille de route en mars 2007
et l'actualise en février 2012. Elle vise à
accélérer la réduction de la morbidité et de la
mortalité maternelle, néonatale, infanto-juvénile et des
adolescents en vue d'atteindre les OMD. C'est dans ce processus que s'inscrit
le programme de la Consultation Prénatale Recentrée (CPNR)
devenue effective à partir de 2008. D'où l'élaboration
d'un manuel de référence par Ministère de la Santé
intitulé « consultation pré et post natale
recentrée en 2008 » destiné à former les
prestataires des soins prénatals avec différents modules.
En effet, depuis, la mise en oeuvre de la CPNR, aucune
évaluation n'a jamais été réalisée à
l'Hôpital Régional de l'Estuaire de Melen (HREM) pour
apprécier son déroulement. Ce qui nous a motivé de
réaliser une étude sur « Evaluation de la mise
en oeuvre de la Consultation Prénatale Recentrée : cas de
l'Hôpital Régional de l'Estuaire de Melen du 03 septembre au 03
octobre 2012 » C'est dans cette perspective que nous
nous sommes posés la question de savoir comment est-ce que la CPNR a-t-
elle été mise en oeuvre à l'HREM ?
Questions de recherche :
· la mise en oeuvre de la CPNR est-elle effective
à l'HREM ?
· les normes et procédures de la CPNR sont-elles
respectées à l'HREM ?
· l'équipement et le matériel
utilisés pour la réalisation de la CPNR sont-ils
adaptés à l'HREM?
· les prestataires de soins prénatals sont-ils
formés à la CPNR ?
· les prestataires réalisent-ils les
séances d'éducation pour la santé ?
· la CPNR est-elle accessible aux gestantes ?
· les gestantes sont-elles sensibilisées à
la CPNR ?
· l'environnement du service est-il favorable aux
prestataires et aux gestantes ?
But :
Notre étude permettrait de contribuer à
l'amélioration de la mise en oeuvre de la CPNR en vue de réduire
la mortalité maternelle au Gabon.
Objectifs :
Les objectifs de cette étude se divisent en objectif
général et objectifs spécifiques
Objectif général :
· contribuer à l'amélioration de la mise en
oeuvre de la CPNR à l'HREM du 03 Septembre au 03 Octobre 2012.
Objectifs spécifiques :
· apprécier les pratiques et connaissances des
prestataires de la CPNR à l'HREM ;
· suggérer des propositions d'amélioration
de la mise en oeuvre de la CPNR à l'HREM.
Hypothèses de recherche :
Pour mener à bien ce travail, nous formulons nos
hypothèses de la manière suivante :
· la mise en oeuvre de la CPNR respecterait les normes et
procédures ainsi que les directives nationales inspirées de
l'OMS ;
· la mise en oeuvre permettrait d'identifier le niveau de
connaissance/compétences des prestataires en matière de CPNR.
Choix du cadre de l'étude :
Nous nous sommes intéressés à l'HREM
surtout à cause de la proximité et du délai de stage
imposé par l'INFASS.
Justificatifs :
L'intérêt de notre étude se justifie
à trois niveaux : socio-économique, scientifique et
professionnelle /politique.
· Sur le plan socio économique :
Une forte population constitue un atout indéniable pour
le développement économique d'un pays. Le Gabon se
caractérise par un sous peuplement avec les taux de mortalité
maternelle et néonatale toujours élevés.
En effet, les décès maternels ont des
conséquences graves au sein des familles étant donné le
rôle crucial que joue la mère pour la santé et le bien
être de ses enfants. Le décès d'une mère accroit
considérablement le risque de décès des enfants en bas
âge, surtout si la famille n'est pas à même de trouver une
solution de remplacement7(*).
Selon les études effectuées, les
nouveau-nés dont la mère meurt ont moins de chance de survie. La
survie des enfants plus âgés est également affectée
par le décès de la mère. Quand une mère meurt, sa
communauté perd un membre productif et son travail,
rémunéré ou non. Son pays perd ce qu'il a investi pour sa
santé, son éducation ainsi que sa contribution escomptée
à l'économie.8(*)
Ces décès laissent derrière eux des
familles à la dérive souvent ruinées par le coût
élevé des soins dispensés trop tard ou restés sans
effets9(*) .
De ce fait la morbidité affaiblit la mère et
réduit considérablement sa capacité à s'occuper de
sa progéniture. Le décès d'une mère ou sa
morbidité déstabilise le tissu familial et entraine une baisse de
la productivité globale et une augmentation des dépenses en
santé10(*).
· Sur le plan scientifique :
Cette étude trouve sa pertinence dans la recherche des
solutions pour contribuer à la réduction de la mortalité
maternelle en santé publique. Les causes de ces décès
sont : les hémorragies, les infections, l'hypertension
artérielle et ses complications, l'anémie et la dystocie. A cet
effet, les soins prénatals focalisés permettent de
détecter et de soigner toute complication éventuelle pouvant
survenir pendant la grossesse.
· Sur le plan professionnel et politique :
La santé maternelle est passée du statut de
problème technique à celui d'impératif moral et politique.
Les complications de la grossesse et de l'accouchement imposent un lourd
fardeau sur le système de santé. Ainsi, en donnant la vie, une
femme peut risquer la sienne, mais cela peut être évité
avec des interventions efficaces qui doivent être assurées par un
personnel qualifié et compétent. Les interventions à haut
impact et à moindre coût pour améliorer cette situation
sont connues et reposent sur un continuum de soins. Toutes ces mesures
nécessitent un système de santé maternelle organisé
avec différents services mis en réseaux, avec respect de la
qualité des soins et des relations personnelles de santé /
population11(*). Il s'agit
ici de replacer la santé maternelle dans le cadre d'un projet simple de
grande ampleur consistant à faire droit à une revendication de la
société considérée comme légitime.
Au Gabon, l'atteinte des OMD risque d'être
retardée par des goulots d'étranglements internes du
système de santé et des choix stratégiques, car nous
déplorons un manque de suivi/évaluation sur des activités
de la SMI. Il faut noter également une faible participation
communautaire dans les interventions visant à réduire la
mortalité maternelle ainsi que l'absence de mise en oeuvre des soins de
santé primaires conjugué avec la persistance de la
pauvreté des populations.
Les informations issues de cette étude permettront
d'apprécier, non seulement le niveau de mise en oeuvre de la CPNR
à l'HREM, mais aussi, aideront à une remise à niveau sur
la pratique des soins prénatals recentrés en vue de contribuer
à la réduction de la mortalité maternelle et d'atteindre
l'OMD5.
Notre travail est subdivisé en trois parties :
· La première partie porte sur la
présentation du cadre de travail ;
· La deuxième partie est consacrée à
la recension des écrits et à la méthodologie ;
· La troisième partie présente les
résultats d'enquête et aborde la discussion ;
· Enfin la conclusion et les suggestions.
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU CADRE DE TRAVAIL
Chapitre 1 : Analyse
situationnelle du Gabon et de la Région Sanitaire Ouest
Ce chapitre consiste à faire une présentation
sommaire du Gabon et de la Région Sanitaire Ouest.
1.1.
Généralités sur le Gabon
Elles concernent la situation géo-démographique,
la situation économique, l'état sanitaire de la population, et le
système de santé au Gabon.
1.1.1. La situation
géographique et démographique du Gabon
Pays d'Afrique centrale et à cheval sur
l'équateur, le Gabon a une superficie de 267667 km2 dont plus de 85% de
couverture forestière. La population gabonaise est estimée
à 1.587.685 habitants repartie dans 9 provinces12(*) . Les femmes
représentent 52% contre 48% d'hommes. Près de 85% de la
population vit en zone urbaine dont 50% à Libreville et
Port-Gentil13(*). Le reste
est dispersé à l'intérieur du pays, en particulier le long
des axes routiers et fluviaux.
1.1.2. La situation
économique du Gabon
L'économie du pays repose essentiellement sur trois
produits d'exportation : le pétrole, le manganèse, et le
bois. A l'intérieur de ces produits d'exportation, le pétrole
représente 82% des exportations et 48% de contribution du PIB en
201014(*). Le PIB per
capita est de 15960$ en 201115(*), et classe le Gabon parmi les pays à revenu
intermédiaire de la tranche supérieure. L'indice de
développement humain (IDH) estimé à 0,653, place le Gabon
au 106ème rang mondial sur 187 pays recensés16(*), contrastant ainsi avec les
données du PIB.
L'état de santé de la population gabonaise
notamment celle de la mère et de l'enfant n'est pas celui auquel on
s'attendrait compte tenu du niveau du PIB du pays car les dépenses
totales de santé avec l'appui des partenaires avoisinent 302$US per
capita17(*).
1.1.3. L'état sanitaire de la population gabonaise
Sur le plan sanitaire, l'espérance de vie à la
naissance est 62 ans pour les femmes et 58 ans pour les hommes18(*).
Le taux de mortalité maternelle (TMM) est de 519
décès pour 100.000 naissances vivantes et l'indice
synthétique de fécondité est de 4,2 enfant/femme19(*).
Les principales causes de ces décès sont :
les hémorragies de la délivrance, les infections, l'hypertension
artérielle (HTA) et ses complications; les complications d'avortement
provoqués clandestins20(*).
Les principales causes de morbidité chez les femmes
enceintes sont caractérisées par les pathologies au cours de la
grossesse ou de l'accouchement telles que : l'HTA, le paludisme, les
problèmes nutritionnels, les infections puerpérales et le
VIH/SIDA.
Le taux de mortalité infantile (0-11 mois) est de 61
pour 1000 naissances vivantes, le taux de mortalité
infanto-juvénile (0-4ans) est de 91 pour 1000, et le taux de
mortalité juvénile (1-4ans) est de 32 pour 1000. Le paludisme,
les autres maladies infectieuses, la prématurité, les
diarrhées, les Infections Respiratoires Aigües (IRA) et la
malnutrition sont les principales causes de mortalité chez les enfants
de moins de 5 ans.
On note également la réémergence de la
tuberculose, la trypanosomiase et l'apparition de la fièvre
hémorragique de type Ebola ayant sévi en 4 flambées
épidémiques de 1995-2001.
La prévalence du VIH a régressé au cours
de ces dernières années. Elle est passée de 8,1% en 2004
à 5,9% en 2007. En 2010, elle est de 5,221(*).
1.1.4. Le système
sanitaire du Gabon
Dans le cadre de la politique générale du
gouvernement, la santé est retenue parmi les secteurs prioritaires. En
vue de satisfaire les besoins et les demandes des populations, le
Ministère de la Santé est chargé de la mise en oeuvre de
cette politique. Ainsi, les différents secteurs du système
sanitaire sont répartis de la manière suivante :
· Le secteur public civil dont l'organisation est
calquée sur le découpage administratif, compte actuellement 10
régions sanitaires et 52 départements sanitaires avec une
organisation pyramidale à 3 niveaux :
- Le niveau opérationnel ou périphérique
appelé département sanitaire est le premier niveau de la pyramide
sanitaire ;
- Le niveau intermédiaire ou d'appui technique qui est
composé de 10 directions régionales de santé ;
- Le niveau central ou stratégique comprend les
structures de référence nationale pour le diagnostic et la prise
en charge, les universités, le Ministère de la santé et
toutes les directions centrales.
· Le secteur public militaire dépend directement
du Ministère de la Défense Nationale ;
· Le secteur parapublic constitué essentiellement
de la CNSS ;
· Le secteur privé non lucratif et lucratif y
compris la médecine traditionnelle.
1.2. La Région
Sanitaire Ouest dans la Province de l'Estuaire
Il s'agit ici d'examiner la situation
géo-démographique de la Région Sanitaire Ouest de la
Province de l'Estuaire et l'offre des soins dans le Département du Komo
Mondah.
1.2. 1. Situation
géo-démographique
D'après la carte (
Annexe 2), la Région Sanitaire Ouest est
située au Nord-Ouest de la Province de l'Estuaire. Avec une superficie
de 20740 km2 soit 7,7% de la surface totale du Gabon, la province de
l'Estuaire, compte tenue de sa forte démographie soit 662.028
habitants22(*) a
été scindée en deux régions sanitaires : la
Région Sanitaire Libreville/Owendo (RSLO) et la Région Sanitaire
Ouest (RSO).
La Région Sanitaire Ouest est composée de trois
départements sanitaires : le Komo Mondah, le Komo Kango et la Noya.
Le Komo Mondah est le département sanitaire dans lequel se situe
l'Hôpital Régional de l'Estuaire à Melen.
1.2. 2. L'offre des soins dans
le Komo Mondah
Ce département sanitaire dispose des structures
publiques et privées.
Les structures publiques comprennent :
· Un (1) Hôpital Régional à
Melen pour 72172 habitants;
· Deux (2) centres de santé
spécialisés (le Centre National de Gérontologie et le
Centre National de Santé Mentale) à Melen ;
· Un (1) Centre Médical à Ntoum pour 32694
habitants (la norme OMS étant de 1/10.000);
· Un (1) centre de Santé Rural à
Nzamaligué ;
· Douze (12) dispensaires, soit un ratio d'un dispensaire
pour 5162 habitants (la norme OMS étant de 1/150) ;
· Cinq (5) infirmeries reparties dans les
établissements scolaires.
Les structures privées disposent de :
· deux (2) dispensaires ;
· cinq (5) infirmeries.
Ces établissements offrent les soins de base. Ils sont
le lieu du système de santé, où se fait le premier contact
de la population avec les services de santé.
Après cette analyse des
généralités sur le Gabon et la Région Sanitaire
Ouest, nous allons maintenant présenter le milieu d'étude, ainsi
que les activités réalisées dans le service de la CPN de
l'HREM.
Chapitre 2 : Milieu de
l'étude
Notre étude s'est déroulée du 03
septembre au 03 octobre 2012 à l'Hôpital Régional de
l'Estuaire de Melen (HREM), plus précisément dans le service de
la consultation prénatale.
2.1. Présentation de
la structure
L'HREM est une structure du niveau secondaire dans le cadre de
l'offre des soins au Gabon. Il sert de référence aux structures
de niveau primaire. Il est dirigé par un Docteur, médecin
spécialiste en ORL, nommé par décret pris en conseil des
ministres. Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur est assisté
par un adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.
2.1. 1. Localisation
géographique et population couverte
L'HREM appartient à la Région Sanitaire Ouest.
Il est situé dans le département du Komo Mondah, à la
périphérie de Libreville dans le district IKOY ITSINI sur la
Route Nationale 1 au Point Kilomètre11 (PK11). Juxtaposés au
Centre National de Santé Mentale et à la Direction
Régionale Sanitaire Ouest, les bâtiments de l'HREM sont
disposés de part et d'autre d'une route secondaire non bitumée.
Il est limité au (à) :
· Nord par le centre émetteur de la RTG
Melen ;
· Sud par les villages NTSENG-NKELE ET NDZENG
MIANG ;
· l'Est par la montagne NKOL BISSENG (dans les environs
du sanctuaire notre Dame du Gabon) ;
· l'Ouest par le Collège Evangélique de
Melen.
L'HREM dessert une population estimée à 72.172
(4,7%) habitants dont 15.445 femmes en âge de procréer (15-49
ans)23(*) soit 2598
grossesses attendues.
2.1. 2. Historique
L'Hôpital Régional de l'Estuaire de Melen
était au départ un site pour accueillir les enfants victimes de
la guerre civile du Biafra de 1967 à 1968. Récupéré
en 1970 par l'Etat gabonais, et notamment par le Ministère de la
Santé, ce centre d'accueil fût transformé en annexe du
Centre Hospitalier de Libreville pour désengorger ce dernier.
Conformément à l'article 1er du décret
N°113/PR/MSPP/78, cette structure sanitaire devient l'Hôpital
Provincial de l'Estuaire de Melen.
2.1. 3. Objectif et missions
Tout système de santé doit contribuer à
la prévention, au traitement des maladies et à la santé
publique. A ce titre, l'HREM vise à améliorer le bien être
des populations à travers la préservation, la promotion de la
qualité des soins et la guérison des usagers.
2.1. 4. Statut juridique
L'HREM est régi par de nombreux textes de lois qui
réglementent les structures sanitaires du Gabon. Parmi les plus
importants, il y a :
- le Décret N°113/PR/MSPP/78 portant
création dudit hôpital ;
- le Décret N°646/PR/MSPP du 24 juin 1971 portant
application du règlement sur l'organisation et le fonctionnement des
structures sanitaires ;
- l'Ordonnance 01/95 portant orientation de la politique
nationale de santé, du 14 janvier 1995 ;
- le Décret 1158 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère de la Santé, du 4 septembre
1997 ;
- le Décret 00488 portant organisation des
Régions et Départements Sanitaires du 30 mai 1995.
2.1. 5. Fonctionnement de la
structure
Pour fonctionner de façon autonome, l'HREM dispose des
ressources humaines, financières et matérielles mises à sa
disposition par les autorités compétentes.
2.1.5.1. Les
ressources humaines
Le personnel de l'HREM est pluridisciplinaire (agents
médicaux, paramédicaux et administratifs). Le nombre d'agents
s'élève à 405, répartis de la manière
suivante :
Tableau 1 : Répartition du personnel
soignant et non soignant à l'HREM.
|
Qualifications :
|
Nombre
|
|
|
|
Administrateurs de santé
|
3
|
|
Attachés d'administration sanitaire
|
26
|
|
Adjoints techniques de statistique
|
2
|
|
Informaticien
|
1
|
|
Commis d'administration
|
1
|
|
Secrétaires de santé
|
14
|
|
Médecins spécialistes (dont 6
gynécologues)
|
21
|
|
Médecins généralistes
|
13
|
|
Sages-femmes
|
21
|
|
Techniciens supérieurs de biologie médicale
|
34
|
|
Adjoints techniques de laboratoire
|
6
|
|
Adjoints techniques de puériculture
|
4
|
|
Adjoints techniques de pharmacie
|
7
|
|
Infirmiers (ères) d'Etat
|
49
|
|
Infirmiers (ères) Assistants (es)
|
203
|
|
Total
|
405
|
Source : Plan Régional de Développement
Sanitaire Ouest, juin 2012
2.1.5.2. Ressources
financières
D'après le tableau 2 relatif à la
répartition des sources de financement de l'HREM en 2012, les ressources
financières étaient d'un milliard treize millions (1.013.000.000)
FCFA. Celles-ci proviennent, d'une part, de la subvention de l'Etat à
hauteur de six cent soixante dix sept millions (677.000.000) FCFA soit 66,83%,
et, d'autre part, des fonds propres estimés à trois cent trente
six millions (336.000.000) FCFA soit 33,13%.
Tableau 2 :
Répartition des sources de financement de l'HREM en 2012
|
Financement de l'HREM
|
Fonctionnement de la structure
|
|
Subvention de l'Etat
|
677.000.000 FCFA
|
|
Fonds propres
|
336.000.000 FCFA
|
|
Apports extérieurs
|
0 FCFA
|
|
Total
|
1.013.000.000 FCFA
|
Source : rapport annuel d'activités de l'HREM,
2012.
2.1.5.3. Ressources
matérielles
L'HREM possède : 1 voiture de liaison ; 1
ambulance ; 2 bus de transport ; 90 lits dont 18 sont
réservés au service d'obstétrique ; des
fournitures ; des équipements médicaux et biomédicaux
repartis entre les différents services qui le composent. Ces derniers
permettent de réaliser les multiples activités de la
structure.
2.1.6. Organisation de la
structure
L'organisation de la structure est présentée par
l'organigramme schématisé (
Annexe 3). On distingue une direction et les
différents services.
· La Direction est chargée de planifier les plans
d'investissement et les programmations des activités sanitaires et de
veiller au suivi des relations avec les institutions et les organismes
internationaux.
· les différents services constituent
l'organisation fonctionnelle et opérationnelle résultant de la
dynamique de travail en équipe pour obtenir la qualité des soins
pour les clients. Cette organisation comprend :
- les services administratifs : Service du Personnel,
Bureau des entrées, la Dépense, la Billetterie, la Cuisine, les
Services Social, Statistique, et Informatique.
- les services médicaux : Urgences,
Médecine Générale, Cardiologie, Pédiatrie,
Dermatologie, Gynécologie-Obstétrique, Bloc Opératoire,
Anesthésie-Réanimation, Chirurgie, ORL, Stomatologie,
Kinésithérapie, Gastro-entérologie, Ophtalmologie.
- les services médico-techniques : Pharmacie,
Nutrition, Laboratoire, Radiologie, Hygiène Hospitalière, Service
Technique (Maintenance, Ambulanciers, Buanderie, Entretien espace vert).
Le service de la consultation prénatale de la
Gynécologie-obstétrique a constitué le centre
d'intérêt de notre étude.
2.2. Présentation du
service CPN
Pour présenter cette unité nous verrons
successivement les objectifs du service, la structuration, le personnel, le
fonctionnement et l'organisation du travail, la tarification des actes et les
activités réalisées.
2.2.1. Les objectifs de la
CPN:
La CPN a pour objectif général d'aider la femme
à mener une grossesse jusqu'à terme dans les meilleurs conditions
en vue d'un bon déroulement de l'accouchement. Par ailleurs, les
objectifs spécifiques sont :
· déterminer l'âge de la grossesse ;
· surveiller l'évolution de la grossesse ;
· dépister les pathologies liées ou
associées à la grossesse ;
· prendre en charge des pathologies liées à
la grossesse ;
· mener des activités de prévention et
d'éducation pour la santé (IEC).
2.2.2. La structuration du
service de la CPN
La structuration du service de la CPN est reprise en
Annexe 11 du présent document.
D'après ce dernier, le service de la consultation de l'HREM comprend un
bureau de recouvrement, une salle d'accueil, trois bureaux de CPN, deux
couloirs qui servent de salle d'attente, deux toilettes et une terrasse.

Source : résultats d'enquête mémoire
Nadège Marina NGUIDANG OBIANG
2.2.3. Le personnel intervenant
dans le service de la CPN
Le personnel intervenant dans le service de la CPN à
l'HREM est pluridisciplinaire. Il est constitué de :
· deux médecins dont un gynécologue et un
généraliste affectés dans le service de
gynécologie ;
· quatre (4) sages femmes (SF) dont deux affectées
dans le service de gynécologie, renforcent l'équipe du service de
la CPN;
· quatre (4) infirmières assistantes ;
· deux (2) secrétaires médicales;
· deux (2) techniciennes de surface.
2.2.4. Fonctionnement et
organisation du travail
Le service de la CPN est ouvert du lundi au vendredi de 7h30
à 15h30. Suivant les prestataires, le travail est organisé ainsi
qu'il suit :
· les médecins travaillent en fonction de leur
planning et font des consultations gynécologiques dans la
majorité des cas. Toutefois, ils prennent aussi en charge les gestantes
suspectées à risque par les SF en CPN.
· les sages-femmes, toutes major de service, travaillent
en continue et reçoivent en moyenne une vingtaine de gestantes par jour.
En marge des CPN, elles font aussi des consultations curatives des femmes
enceintes.
· les infirmières postées au bureau
d'accueil, sont reparties en équipe de deux et font les rotations tous
les deux jours. Elles sont chargées de prendre les constances aux
gestantes et les orientent vers les différents bureaux
des sages femmes pour la visite prénatale. Au terme de
celle-ci, les gestantes repassent au bureau d'accueil pour l'enregistrement des
données de la CPN.
· les secrétaires médicales quant à
elles assurent d'une part la réception et l'orientation des gestantes
vers les infirmières et sages-femmes, d'autre part s'occupent du
recouvrement des coûts auprès des gestantes et du versement des
fonds chez le gestionnaire.
· les techniciennes de surface s'occupent de l'entretien
des locaux.
2.2.5. La tarification des
actes
Deux types de gestantes sont reçus à la CPN de
l'HREM : les assurées de la CNAMGS et les non assurées.
· Pour les gestantes assurées de la CNAMGS, trois
(3) visites prénatales sont prises en charge selon les modalités
ci après :
- la première visite à trois (3) mois pour un
coût de deux mille six cent trente (2630) FCFA dont le carnet 2000 FCFA
et la consultation 630FCFA;
- la gratuité pour les deuxième (six mois) et
troisième (huit mois) visites;
- la quatrième visite (neuf mois) coûte deux
mille (2000) FCFA répartis de manière suivante : 1000 FCFA
pour la visite et 1000 FCFA pour l'examen d'urine (albumine/sucre).
- le bilan prénatal et l'échographie sont
gratuits.
- les visites subséquentes (visites inattendues par
rapport à l'état de santé de la cliente) sont à
630FCFA.
· Pour les gestantes non assurées :
- la première visite à trois (3) mois pour un
coût de quatre mille (4000) FCFA dont le carnet 2000 FCFA, la visite
1000FCFA et l'examen d'urine (albumine/sucre) 1000FCFA;
- les deuxième (six mois), troisième (huit mois)
et quatrième (neuf mois) visites sont à 2000FCFA chacune soit
1000FCFA pour la visite et 1000 pour l'examen d'urine (albumine/sucre).
- les visites subséquentes sont à
1000FCFA ;
- le bilan prénatal est évalué à
quarante un mille (41.000FCFA) réparti entre le groupe sanguin 2000FCFA,
BW 6000FCFA, SRV 5000FCFA, Toxoplasmose/rubéole 10000FCFA, HBS 6000FCFA,
NFS 3000FCFA, KOP 1000FCFA, Glycémie 2000FCFA, GE 1000FCFA,
Electrophorèse 5000FCFA.
- trois échographies pour un montant total 30.000 FCFA
à raison de 10.000FCFA/échographie.
2.2.6. Présentation des
activités réalisées
Le service de la CPN de l'HREM réalise deux genres
d'activités : les activités préventives et les
activités curatives. Les activités promotionnelles (EPS) sont peu
développées.
2.2.6.1. Les
activités préventives
Elles sont réalisées en synergie avec le
laboratoire et le service de la vaccination. Dans la pratique, chaque service
opère de la façon suivante :
· le service de la CPN assure la surveillance de la
grossesse en effectuant :
- la prise des paramètres (poids, tension
artérielle, taille) à la recherche d'un
antécédent ;
- L'examen physique se fait sur une table d'examen pour
rechercher une boiterie, une pâleur conjonctivale, des varices et des
oedèmes, la croissance foetale/la hauteur utérine et les bruits
du coeur foetal ;
- La protéinurie est faite systématiquement
à chaque visite prénatale pour rechercher la concentration du
sucre et du sel dans l'urine ;
- La supplémentation en Fer (60mg)/Acide-Folique
(500ug) est généralement prescrite à toutes les gestantes
pour lutter contre l'anémie ;
- La chimio prophylaxie antipaludique systématique
pendant la grossesse est la règle à raison de deux prises (16SA
quand les mouvements foetaux sont actifs pour la première prise et la
deuxième prise s'administre à 28 SA) ;
- Le déparasitage des gestantes se fait au
deuxième trimestre de la grossesse pour lutter contre l'ankylostomiase.
Les conseils sont donnés aux gestantes de
manière ponctuelle au moment de la visite sur quelques
thématiques.
· le laboratoire quant à lui réalise le
bilan prénatal à savoir :
- la numération formule sanguine (NFS) pour rechercher
l'anémie ;
- le groupe sanguin rhésus (GSRH) pour rechercher
l'incompatibilité foeto-maternelle ;
- la sérologie de la syphilis sous le nom de
Bordet-Wasserman (BW), la toxoplasmose, la rubéole et l'hépatite
virale à la recherche d'une infection quelconque ;
- la goutte épaisse (GE) à la recherche du
plasmodium dans le sang ;
- l'électrophorèse de l'hémoglobine pour
rechercher la tare de drépanocytose ;
- le test de dépistage du VIH/SIDA.
· le service de vaccination administre gratuitement aux
gestantes le vaccin antitétanique à raison de deux doses par
grossesse pour éviter le tétanos maternel et néonatal.
2.2.6.2. Les
activités curatives :
En plus du service de la CPN, les activités curatives
font intervenir le service de la gynécologie et la maternité.
Ainsi,
· le service de la CPN prend en charge les cas de
paludisme suspectés, d'anémie et d'HTA simple
dépistées.
· le service de gynécologie prend en charge des
femmes à risque dépistées (HTA...)
· la maternité s'occupe des accouchements, des
avortements et des pathologies liées à la grossesse.
2.2.7. Les points forts du
service de la CPN :
La forte demande en soins prénatals dans ce service
s'explique par :
· l'accessibilité du service sur le plan de
l'accueil et les prestations offertes;
· l'existence du régime d'assurance maladie
à travers la CNAMGS qui prend en charge les femmes enceintes.
2.2.8. Les points faibles du
service de la CPN :
Le bâtiment qui abrite les services de la CPN et de la
Vaccination, est en réalité celui de gynécologie externe,
d'où l'inégale répartition dans l'occupation des
différents bureaux. Une des Sages-femmes sur 4 qui interviennent en CPN
n'a pas un bureau de consultation. Celle-ci occupe le bureau du
gynécologue quand ce dernier est absent. Elle travaille donc
involontairement à temps partiel. Il en résulte un nombre
réduit de sage femme en service et un accroissement du volume de
travail.
Il n'y a pas de collaboration franche entre les sages-femmes,
tant l'absence de réunions pour débattre des problèmes
concernant le fonctionnement du service fait défaut avec acuité.
Aussi, le planning de travail n'est pas affiché. Egalement, les autres
postes de la SMI que sont la pesée, la nutrition se retrouvent dans le
service de la Pédiatrie.
Après cette description du milieu de l'étude,
nous abordons maintenant la deuxième partie consacrée à la
recension des écrits et à la méthodologie.
DEUXIEME PARTIE : RECENSION
DES ECRITS ET METHODOLOGIE
Chapitre 3 : Recension des écrits
Dans le cadre de ce travail, nous avons consulté un
certain nombre de documents qui nous ont permis de bien comprendre notre
thématique, c'est-à-dire la consultation prénatale de
qualité offerte aux femmes enceintes. De cette revue de la
littérature, il ressort ce qui suit :
Pour réaliser la pratique des soins prénatals
recentrés, l'OMS a élaboré un guide en 2003
intitulé « soins liés à la grossesse,
à l'accouchement et la période néonatale. Guide pratique
essentielle » qui recommande des interventions que chaque pays
doit adapter selon son contexte culturel, économique et social. Ce guide
permettrait d'aider les prestataires de soins anténatals à
identifier les femmes qui présentent des conditions exigeant un
traitement et une surveillance plus fréquente.
Selon A.Prual et al24(*) dans leur
publication « rôle potentiel de la consultation
prénatale dans la lutte contre la mortalité maternelle et la
mortalité néonatale en Afrique subsaharienne », la
consultation prénatale (CPN) a un rôle certain à jouer dans
la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans
les pays en voie de développement, d'autant que les femmes l'utilisent
largement quand elle est accessible. Pour ces auteurs, ce n'est pas la
quantité de CPN qui en justifie l'efficacité chez la plupart des
femmes, mais la qualité. En effet, il faut que les CPN soient faites
à des périodes clefs de la grossesse (<12, 26,32 et 36 SA).
Toute chose qui permet de maximiser les chances de dépistage, de prise
en charge (PEC) adéquate et de référence
appropriée. De même, les séances de soins anténatals
doivent être mises à profit pour apprendre aux femmes et à
leur famille, comment déceler tout signe de danger pendant la grossesse
et l'accouchement. C'est l'occasion d'aider ces femmes à planifier leur
accouchement en tenant compte des antécédents et de leur
état de santé.
L'aspect de la qualité de la CPN est confirmé
par STEPHENSON Patricia 25(*), dans son article publié dans les bulletins
techniques de santé globale intitulé « soins
prénatals focalisés : une meilleur stratégie, moins
chère et plus rapide fondée sur les données
probantes ». D'après cet auteur, la nouvelle voie
d'approche concernant les soins focalisés met l'accent sur la
qualité des soins au lieu de leur quantité.
L'OMS recommande uniquement quatre visites prénatales
dans le cas d'une grossesse normale. L'objectif principal des soins
prénatals focalisés est d'aider les femmes à maintenir des
grossesses normales de la manière suivante :
· identification des conditions de santé
préexistantes ;
· détection précoce des complications
survenant pendant la grossesse ;
· promotion de la santé et prévention de la
maladie ;
· préparation à la naissance et
planification pour se préparer à des complications.
Ce nouveau modèle de soins prénatals
focalisés discrédite l'approche relative aux risques, bien
qu'elle soit encore appliquée à grande échelle. Toutefois,
cette approche risque ne peut pas prévoir qui va effectivement
développer des complications au cours de la grossesse et de
l'accouchement.
A leur tour SHAVER Theresa et KINZIE Barbara 26(*) dans leur publication
intitulée « soins prénatals, vieux mythes,
nouvelles réalités » paru dans MAG mini University
Washington en 2011 réaffirment cette assertion que toute femme enceinte
est exposée au risque de complication. Ainsi, une femme enceinte doit
avoir accès à des soins obstétricaux de qualité
avec un plateau technique adéquat, par un prestataire compétent,
dans une structure proche de son domicile.
Nous partageons cet avis sur l'approche du risque. En effet,
notre expérience de sage femme nous a amené à vivre des
situations où les femmes, malgré qu'elles aient été
bien suivies pendant leur grossesse, développaient souvent des
complications pendant ou après l'accouchement. Parallèlement,
celles qui avaient des antécédents majeurs accouchaient
normalement. Par conséquent, les prestataires de soins anténatals
doivent considérer toute femme enceinte comme étant à
risque.
Après cette analyse bibliographique, nous allons
maintenant présenter la démarche méthodologique que nous
avons adoptée dans le cadre de notre travail.
Chapitre 4 :
Méthodologie
Il s'agit ici de définir les principaux concepts, de
concevoir un cadre conceptuel et d'expliquer la démarche et les outils
utilisés pour répondre aux attentes soulevées par la
problématique.
4.1. Définitions des
concepts :
Pour bien appréhender notre étude, il est
important de définir les principaux concepts qui charpentent notre
thématique.
4.1.1. Evaluation :
Selon l'OMS, l'évaluation est une procédure
scientifique et systématique qui permet d'apprécier dans quelle
mesure un programme ou un projet a atteint avec succès un ou des
objectifs qui lui ont été préalablement fixés.
C'est aussi un processus d'analyse quantitative ou qualitative qui consiste
à apprécier le déroulement d'une action ou d'un programme
ou encore à mesurer leurs effets (effets spécifiques et les
conséquences de l'impact).
Sur le plan technique, l'évaluation, c'est mesurer pour
comparer. La comparaison se fait par rapport à un
référentiel qui peut être un critère, une norme ou
un objectif.
De notre point de vue, l'évaluation est un processus
qui accompagne l'action depuis sa conception jusqu'à ses
résultats. Elle a pour but de porter un jugement de valeur. Elle permet
également de changer de stratégies si les objectifs initialement
prévus n'ont pas été atteints.
4.1. 2. La mise en
oeuvre :
Selon WIKIPEDIA, la mise en oeuvre est définie comme la
mise en place d'un produit ou d'une activité permettant d'atteindre les
objectifs fixés.
Sur le plan technique, la mise en oeuvre est la
réalisation des activités (c'est à dire
l'opérationnalisation).
En ce qui nous concerne, la mise en oeuvre est le fait
d'entreprendre les actions/activités efficacement dans le but
d'atteindre un objectif préalablement fixé.
L'évaluation de la mise en oeuvre pourrait entrer dans
la catégorie de l'évaluation formative ou l'évaluation du
processus (activités) puisqu'elle détermine si le programme est
appliqué efficacement et s'il faut apporter les améliorations.
4.1.3. La consultation
prénatale recentrée :
· Consultation :
Dans le domaine de la santé, selon LAROUSSE, la
consultation désigne l'examen d'un malade que le médecin pratique
à son cabinet ou un avis motivé de plusieurs médecins au
chevet d'un malade.
· Prénatale :
Selon le dictionnaire MEDIADICO,
prénatale est la
période
qui précède la naissance d'un enfant.
· Consultation prénatale recentrée
(CPNR) :
C'est une approche actualisée qui met l'accent sur la
qualité des consultations plutôt que sur la quantité. Elle
reconnait par ailleurs que les femmes dites à « haut
risque » développent rarement des complications et les femmes
dites à « faible risque » en développent
souvent.
L'OMS recommande quatre visites focalisées comme norme
pour une grossesse normale.
De notre avis, la CPNR est une consultation qui intègre
toutes les disciplines pour un meilleur suivi et une prévention des
complications liées à la grossesse. Elle répond à
un souci d'offrir des prestations de qualité au couple
mère/enfant. Le but de la CPNR est d'avoir une femme bien suivie, un
bébé né à terme et en bonne santé.
4.2. Cadre conceptuel
Dans ce cadre conceptuel, nous abordons la qualité de
la Consultation Prénatale selon le modèle de
Donabédian27(*) sur
la qualité des soins en évaluant la triade de la
qualité : Structure, Processus, et
Résultat.
Les services de santé reproductive dans un continuum de
soins commencent avec la structure et s'accomplissent à travers le
processus. Le résultat final est l'aboutissement de ce processus.
Structure/ Infrastructure
Ressources humaines
Ressources matérielles (matériel et
équipement)
Infrastructure
Ressources financières
Processus (activités)/ Normes et procédures
CPN : 1- 2-3- 4.
TPI 1 et 2.
VAT 1 et 2
Fer/Acide folique.
Thématiques sensibilisées.
Risques dépistés.
Références effectuées.
Attitude des prestataires pendant la CPN.
Résultats
Nombre de clientes vues CPN1 et 4.
Nombre de clientes sous TPI1 et 2 et sous Fer.
Nombre de clientes ayant reçu la 1ère
et la 2ème dose de VAT.
Nombre de clientes dépistées à risque.
Nombre de clientes référées
Nombre de clientes ayant été
sensibilisées par thématique.
Satisfaction des clientes prestations offertes
Figure 1 : approche
évaluative de la qualité selon Donabédian
La structure : est l'ensemble des ressources
humaines, matérielles et des ressources financières mises
à la disposition des prestataires et le cadre physique et
organisationnel dans lequel ils travaillent.
Le processus : est l'ensemble des
activités ayant lieu entre les prestataires et les gestantes.
Les résultats : il s'agit des
résultats obtenus par rapport à l'activité
effectuée.
4.3. Population
d'étude
Elle est composée d'une cible primaire et d'une cible
secondaire. La cible primaire est constituée de femmes enceintes
(gestantes) suivies dans le service de la CPN de l'HREM et la cible secondaire
représente les prestataires de soins de la CPNR notamment les
Sages-femmes, les Infirmières.
4.4. Méthode et
technique de l'échantillonnage
Pour réaliser notre échantillonnage, nous avons
opté pour une approche non probabiliste. Cette technique consiste
à inclure dans notre étude des sujets (gestantes) qui se
présentent au moment de l'enquête. L'avantage de cette
méthode est qu'elle s'utilise facilement et est moins coûteuse.
Aussi, notre échantillon est composé de cent
(100) gestantes vues en CPN pendant le moment de l'enquête. Par ailleurs,
nous nous sommes entretenus (es) individuellement avec les quatre prestataires
(Sages-femmes) qui interviennent dans le service de la CPN de l'HREM.
4.5. Stratégies de
recherche
Elle englobe plusieurs points à savoir les
méthodes et types de recherche ; les techniques et choix des
outils.
4.5.1. Méthodes et
types de recherche
Il s'agit d'une étude descriptive et analytique de type
transversale. Nous avons adopté une méthode de recherche
qualitative par le fait que les données collectées sont en grande
partie la communication des sages-femmes lors des consultations
c'est-à-dire des discours explicatifs liés aux perceptions, aux
comportements.
4.5.2. Techniques et choix des
outils
Pour collecter les données, nous avons utilisé
les techniques suivantes :
· la recherche documentaire ;
· l'observation ;
· l'entretien.
4.5.2.1. La recherche documentaire
Elle constitue une étape importante de notre
étude, car elle nous a permis non seulement d'avoir une idée des
différents auteurs qui avaient déjà écrit sur notre
thématique, mais aussi de faire notre bibliographie. De nombreux
documents ont été exploités à savoir:
· les rapports annuels des organismes
internationaux ;
· les textes législatifs et réglementaires
du Gabon ;
· les revues scientifiques ;
· les mémoires des étudiants de FMPOS de
Bamako au Mali.
Nous avons eu accès à ces documents dans les
structures suivantes:
· la Direction Nationale de la Santé Maternelle et
Infantile (DNSMI) ;
· l'Institut National de Formation d'action Sanitaire et
Sociale (INFASS) ;
· les organismes internationaux : UNICEF, OMS,
UNFPA ;
· le site Google internet, WIKIPEDIA.
4.5.2.2. L'observation
Elle nous a permis d' :
· explorer l'environnement externe et interne du service
de la CPN (l'état des locaux et du matériel utilisé,
l'existence des affiches avec ou sans protocole de soins, le nombre de
personnel, la capacité d'accueil) ;
· apprécier les gestes et les comportements des
prestataires dans la pratique des soins prénatals. L'outil
utilisé est la fiche d'observation (voir
Annexe 4).
4.5.2.3. L'entretien
Il s'agit des entretiens semi-structurés avec les
prestataires et les gestantes. Cette technique nous a aidées à
collecter les informations pour mieux cerner notre sujet. Elle nous a
également permis d'avoir une idée du fonctionnement et de
l'organisation du service. Le guide ou fiche d'entretien a été
l'outil utilisé (Cf.
Annexe 5 et
Annexe 6). La souplesse et l'attrait du contact
direct avec l'interlocuteur expliquent le choix de cet instrument.
L'interlocuteur était soumis à des questions ouvertes. Les
principaux thèmes abordés ont été les
suivants :
· la formation du personnel à la CPNR ;
· la pratique des soins prénatals
focalisés ;
· les conditions de travail ;
· les difficultés rencontrées ;
· les éventuelles solutions ;
· les opinions des gestantes.
4.6. Pré-test
Il nous a permis de vérifier le degré de
compréhension des questions posées aux enquêtées.
4.7. Déroulement de
l'enquête
Notre étude s'est déroulée du 03
septembre au 03 octobre 2012 dans le service de la CPN de l'HREM. Cette
période a été choisie conformément à la
décision de mise en stage prédéfinie par l'INFASS.
L'enquête s'est effectuée en trois phases :
La phase préparatoire comprenait :
· les formalités administratives (pour la
rédaction des autorisations d'enquête à l'endroit de la
structure où l'on devait effectuer les recherches);
· les rencontres préliminaires ou rendez-vous avec
les personnes ressources/institutions ciblées par l'enquête.
La deuxième phase comprenait :
· la recherche documentaire;
· la construction du modèle d'analyse ;
· l'évaluation de l'outil d'enquête ou
pré-test à l'hôpital Egypto-Gabonais.
La troisième phase correspond à l'enquête
de terrain (cf. Chronogramme de travail en
Annexe 12).
4.8. Dépouillement
et traitement des données
Pour la collecte des données nous avons utilisé
une approche qualitative. Les données collectées ont
été traitées à l'aide des logiciels
suivants :
· WORD pour le traitement de textes ;
· Epi Info version 3.5.1 pour la saisie du questionnaire
et l'analyse des données ;
· EXEL pour la production des tableaux et figures.
4.9. Limites de notre
étude
Comme tout travail scientifique, le notre s'est heurté
à un certain nombre de difficultés parmi lesquelles :
· le temps imparti pour réaliser ce travail nous a
semblé court ;
· la rétention de l'information et/ou le manque de
disponibilité de certaines personnes ressources ;
· le problème d'encadrement lié à la
disponibilité tardive du directeur de recherches ;
· l'arrivée tardive du personnel au lieu de
travail retardait implicitement le début des consultations. Toute chose
qui nous a obligé à limiter à cinq le nombre de gestantes
à observer journalièrement alors que 15 auraient
été mieux pour un échantillon raisonnable ;
· l'impossibilité de faire des comparaisons entre
les résultats obtenus ou attendus conformément aux objectifs du
programme de la CPNR à cause du manque d'indicateurs objectivement
vérifiables (IOV) nous a contraint à une étude descriptive
et analytique des moyens (ressources humaines, matérielles et
financières) et du processus (activités) ;
· La non disponibilité des données sur la
CPNR au niveau du Gabon ;
· l'initiation au cours d'ÉPI info à la fin
du stage a fondamentalement bouleversé notre programme de travail
notamment, la reprise du questionnaire d'enquête ;
· le retard accusé par l'institut
d'élaborer un canevas de travail pour nos mémoires.
4.10.
Considérations éthiques
Sur le plan de l'éthique, l'INFASS a adressé une
correspondance à la direction de l'HREM dans laquelle se trouvait une
autorisation d'enquête des étudiants (es) (voir
Annexe 1).
Ensuite, les personnels des services concernés ont
été informés de notre arrivée. Ainsi, dans la phase
de collecte des données, l'objectif de notre étude a
été clarifié aux enquêtés et l'anonymat
était assuré. Aucune interview n'a eu lieu sans le consentement
des personnes cibles de l'enquête.
Dans l'ensemble, la méthodologie nous a permis de
justifier les méthodes utilisées, et d'exposer la démarche
méthodologique retenue pour réaliser notre étude.
Malgré les difficultés, nous avons pu obtenir un minimum
d'informations dont les résultats seront présentés dans le
chapitre 5 de la troisième partie de notre étude.
TROISIEME PARTIE :
PRESENTATION DES RESULTATS ET DISCUSSION
Chapitre 5 :
Résultats de l'enquête
Nos recherches ont porté essentiellement sur les
données physiques (équipement et matériel), humaines et
les procédures (activités).
5.1. Etude des
structures
Où vont les femmes quand elles sont enceintes ?
Les offres de services de CPN aujourd'hui se situent dans le système de
santé.
5.1.1. Infrastructure
L'infrastructure détermine l'environnement, les
conditions de travail qui devraient être le plus confortables et le plus
humanisées possibles. Elle constitue le premier attrait pour la cliente.
C'est un critère d'accueil.
Le
Tableau 3 fait la répartition des locaux en
fonction de leur nombre et de leur état dans le service de la CPN
à l'HREM.
Tableau 3 Nombre et état des locaux
affectés à la CPN à l'HREM.
|
Locaux réservés à la CPN à
l'HREM
|
Nombre
|
Etat
|
|
|
Bon
|
Mauvais
|
|
Bâtiment
|
1
|
|
X
|
|
Salle d'accueil CPN
|
1
|
X
|
|
|
Bureau CPN
|
3
|
X
|
|
|
Bureau secrétaire
|
1
|
X
|
|
|
Couloir
|
2
|
|
X
|
|
Toilettes
|
2
|
|
X
|
|
Terrasse
|
1
|
X
|
|
|
Vestiaire personnel
|
0
|
|
|
Source : résultats d'enquête mémoire
Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
D'après ce tableau, le couloir et les toilettes sont en
mauvais état et il n'existe pas de vestiaires pour le personnel.
Le tableau 4 décrit l'environnement du service de la
CPN à l'Hôpital Régional de Melen.
Tableau 4: Etat de
l'environnement du service de la CPN entre sept-oct. 2012 à
l'HREM.
|
Rubriques
|
Existence
|
Etat
|
|
Oui
|
Non
|
Bon
|
Mauvais
|
|
Réseau de distribution d'eau
|
X
|
|
X
|
|
|
Approvisionnement régulier en eau
|
|
X
|
|
X
|
|
Réseau de fourniture de l'électricité
|
X
|
|
X
|
|
|
Fourniture régulière de
l'électricité
|
X
|
|
X
|
|
|
Groupe électrogène de relais
|
|
X
|
|
|
|
Toilettes
|
X
|
|
|
X
|
|
Présence de la poussière
|
X
|
|
|
X
|
|
Ramassage régulier des ordures
|
X
|
|
X
|
|
|
Incinérateur pour traitement des
déchets
|
X
|
|
|
X
|
Source : résultats d'enquête mémoire
Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Au regard de ce tableau, nous notons le manque
d'approvisionnement régulier en eau, la poussière
omniprésente dans le service, l'insalubrité des toilettes.
5.1.2. L'équipement et
le matériel :
Le tableau 5 fait l'inventaire des équipements en
fonction de leur nombre et de leur état dans le service de la CPN de
l'HREM.
Tableau 5: Etat des
équipements dans le service de la CPN entre sept-oct. 2012 à
l'HREM.
|
Equipements réservés à la CPN
à l'HREM
|
Nombre
|
Etat
|
|
Bon
|
Mauvais
|
|
Bancs et chaises pour les usagers
|
27
|
X
|
|
|
Armoires
|
1
|
X
|
|
|
Split
|
5
|
|
X
|
|
Ventilateurs
|
2
|
X
|
|
|
Poubelles pour déchets infectieux (gants et doigtiers
souillés)
|
0
|
|
|
|
Poubelles pour déchets non infectieux
|
3
|
|
X
|
|
Conteneurs pour isoler les objets pointus et coupants
utilisés
|
0
|
|
|
|
Escabeau 3 marches
|
2
|
X
|
|
|
Pèse-personne adulte
|
1
|
X
|
|
|
Toise adulte
|
1
|
|
X
|
|
Stéthoscope Obstétrical
|
3
|
X
|
|
|
Table d'examen gynécologique
|
3
|
X
|
|
|
Thermomètres
|
0
|
|
|
|
Mètre ruban
|
3
|
X
|
|
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Dans ce tableau, les thermomètres et les poubelles pour
déchets infectieux sont inexistants. Les objets pointus sont
isolés dans les bouteilles vides d'eau minérale.
Le tableau 6 fait l'inventaire du plateau technique
(matériel) en fonction de leur présence ou non dans le service de
la CPN à l'HREM.
Tableau 6: Etat du plateau
technique du service de la CPN entre sept-oct. 2012 à
l'HREM.
|
Matériel réservé à la CPN
à l'HREM
|
Présence
|
|
Oui
|
Non
|
|
Matériel à usage unique (gants, doigtiers,
seringues etc.)
|
X
|
|
|
Matériel de labo pour la protéinurie
|
X
|
|
|
Bandelettes réactives pour l'analyse d'urine
|
X
|
|
|
Savon pour lavage des mains
|
|
X
|
|
Sulfadoxine Pyriméthamine(SP) pour TPI
|
|
X
|
|
MILDE
|
|
X
|
|
Compléments Fer/Acide-Folique
|
|
X
|
|
Anti-retro viraux pour PTME
|
|
X
|
|
Vermifuges pour traitement de l'ankylostomiase
|
|
X
|
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Il ressort dans ce tableau que le savon pour le lavage des
mains n'est pas disponible dans les bureaux de consultation. Par ailleurs, nous
notons la rupture de dotation des MILDE, de la Sulfadoxine
Pyriméthamine, et la non distribution des antis rétroviraux, du
fer/acide folique et des vermifuges.
Le tableau 7 fait l'inventaire des outils de sensibilisation
en fonction de leur présence ou non dans le service de la CPN à
l'HREM.
Tableau 7: Outils/Supports de sensibilisation du
service de la CPN entre sept-oct. 2012 à l'HREM
|
Supports de sensibilisation à la CPN à
l'HREM
|
Présence
|
|
Affiches collées sur le mur
concernant:
|
Oui
|
Non
|
|
-Signes de danger
|
X
|
|
|
-Avantages et utilisation de la MILDE
|
|
X
|
|
-Paludisme
|
X
|
|
|
-PEV/Calendrier vaccinal de la femme enceinte
|
X
|
|
|
-Avantages de la Planification familiale
|
X
|
|
|
Protocoles de prise en charge collés sur le mur
concernant:
|
|
|
|
-Paludisme
|
|
X
|
|
-TPI
|
|
X
|
|
-PTME
|
|
X
|
|
-PF
|
|
X
|
|
-Directives nationales de la CPNR
|
|
X
|
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Les protocoles de PEC du TPI, PTME, PF ainsi que les
directives de CPNR sont absents.
Les
compétences :
Le tableau 8 fait la répartition du personnel de la CPN
en fonction de leur nombre et de leur qualification de sept-oct.2012 à
l'HREM.
Tableau 8: Répartition
du personnel en fonction du nombre et de la qualification entre sept-oct.2012
à l'HREM.
|
Personnels
|
Nombre
|
|
Médecin Gynécologue
Médecin Généraliste
|
1
1
|
|
Sages-femmes
|
4
|
|
Infirmières assistantes
|
4
|
|
Secrétaires
|
2
|
|
Techniciennes de surface
|
2
|
|
Gardien
|
1
|
|
Total
|
15
|
Source : résultats d'enquête mémoire
Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
D'après le tableau ci contre, le service de la CPN est
composé de 15 personnels, dont un médecin gynécologue, un
médecin généraliste, quatre sages femmes, quatre
infirmières assistantes, deux secrétaires, deux techniciennes de
surface et un gardien.
5.2. Etude des
procédures (processus) :
D'une manière générale, la CPNR
intègre un paquet minimum d'activités qui concourent à
améliorer la qualité des soins prénatals.
5.2.1. La pratique de la
consultation prénatale recentrée
Les soins prénatals de qualité n'ont un effet
positif sur la santé maternelle et néonatale que s'ils sont
accessibles et efficaces.
· La consultation prénatale:
La figure 2 fait la répartition des gestantes de l'HREM
selon le nombre de consultations de sept-oct. 2012.
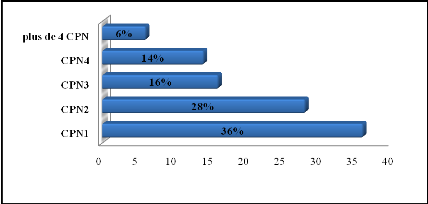
Figure 2: Répartition des gestantes selon le
nombre de CPN effectuées entre sept-oct. 2012 à
l'HREM.
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Au regard de cette figure, nous remarquons que 36% des
gestantes ont bénéficié d'au moins une CPN. Par contre 14%
seulement de ces femmes ont eu au moins quatre CPN.
La CPN1 est définie comme la visite
prénatale ayant lieu au premier trimestre de la grossesse
(jusqu'à la 14ème semaine d'aménorrhée incluse). Le
tableau 9 fait la répartition des gestantes de l'HREM qui ont
été vues en CPN1 selon le terme de la grossesse de
sept-oct.2012.
Tableau 9:
Répartition des gestantes vues en CPN1 selon le terme de la grossesse
entre sept-oct. 2012 à l'HREM.
|
Terme de la CPN 1
|
Effectif (N=100)
|
Pourcentage
|
|
<15SA
|
20
|
55,80%
|
|
16SA-27SA
|
15
|
41,8%
|
|
28SA-32SA
|
1
|
2,80%
|
|
Total
|
36
|
100,00%
|
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Parmi les 36 gestantes vues en CPN1, 16 n'ont pas
respecté la norme de la CPN du premier trimestre de la grossesse selon
l'OMS (0-15SA).
La quatrième Consultation Prénatale (CPN4) doit
avoir lieu obligatoirement au 9ème mois de la grossesse (entre la 32SA
et la 36SA). Elle sera orientée vers l'évaluation pronostique de
l'accouchement, et recherchera des causes potentielles de dystocie. Le tableau
10 fait la répartition des gestantes de l'HREM qui se sont
présentées pour leur quatrième visite de sept-oct.2012.
Tableau 10:
Répartition des gestantes vues en CPN4 selon le terme de la grossesse
entre sept-oct.2012 à l'HREM.
|
Terme de la CPN 4
|
Effectif (N=100)
|
Pourcentage
|
|
28SA-31SA
|
1
|
7,10%
|
|
32SA-36SA
|
13
|
92 ,9 %
|
|
Total
|
14
|
100,00%
|
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Ce tableau met en évidence que la majorité des
gestantes soit 92,9% ont respecté la norme de la CPN4.
· Examen physique
Cette figure(3) montre la proportion des gestantes de l'HREM
qui ont été examinées lors de leur visite au mois de
sept-oct. 2012.
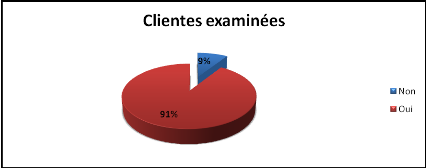
Figure 3: Proportion des gestantes ayant
été examinées en CPN entre sept-oct.2012 à
l'HREM.
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Au regard de cette figure, 91% des gestantes ont
été examinées contre 9% qui n'ont pas subi cet acte.
· Bilan Prénatal
Cette figure(4) illustre la proportion des gestantes de l'HREM
qui ont reçu la prescription du bilan prénatal dans la
période de sept-oct.2012.

Figure 4: Proportion des gestantes ayant reçu
la prescription du BPN à la CPN entre sept-oct.2012 à
l'HREM.
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Parmi les gestantes observées, le bilan prénatal
a été demandé dans la majorité des cas, soit 89%
contre 11% qui n'ont pas eu cette prescription.
La figure 5 montre la proportion des gestantes de l'HREM qui
ont réalisé ou non leurs examens prénataux de
sept-oct.2012.
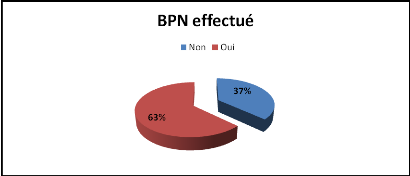
Figure 5: Proportion des
gestantes ayant réalisé le BPN entre sept-oct.2012 à
l'HREM.
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Dans cette figure, 63% des gestantes avaient
déjà effectué leur bilan prénatal au moment de
l'enquête contre 37% qui ne l'avaient pas encore
réalisé.
· Echographie
Le tableau 11 fait la répartition des gestantes de
l'HREM qui ont bénéficié de la prescription
d'échographies dans le service de la CPN de sept-oct.2012.
Tableau 11:
Répartition des gestantes selon nombre d'échographies prescrites
à la CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM.
|
Echographie
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
Aucune
|
16
|
16,00%
|
|
Echo1
|
38
|
38,00%
|
|
Echo2
|
33
|
33,00%
|
|
Echo3
|
13
|
13,00%
|
|
Total
|
100
|
100,00%
|
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Parmi les gestantes observées, 38% ont
bénéficié de la prescription de la première
échographie, 33% de la deuxième et 13% de la troisième.
Parallèlement, 16% des gestantes n'ont pas eu de demande
d'échographie.
· Dépistage des facteurs de risque chez
les gestantes
Le tableau ci-dessous (12) fait la classification des
gestantes de l'HREM appartenant à un groupe à risque ou non.
Tableau 12: Classification
des gestantes en fonction des risques dépistés à la CPN
entre sept-oct.2012 à l'HREM.
|
Groupe à risque
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
Absence de risque
|
77
|
77,00%
|
|
Existence de facteurs de risque
|
23
|
23,00%
|
|
Total
|
100
|
100,00%
|
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Il ressort que parmi 100 gestantes observées, 23% ont
été déclarées à risque contre 77% qui ne
possédaient pas de facteurs de risques.
Le tableau 13 fait la répartition des facteurs de
risque dépistés chez les gestantes.
Tableau 13: Répartition des facteurs de risque
dépistés chez gestantes à la CPN entre sept-oct.2012
à l'HREM.
|
Facteurs de risque
|
Effectif (N=100)
|
Pourcentage
|
|
Anémie
|
1
|
4,30%
|
|
ATCD Mort-né
|
1
|
4,30%
|
|
Gémellarité
|
2
|
8,60%
|
|
Grossesse issue d'un Viol
|
1
|
4,30%
|
|
Grossesse précoce
|
1
|
4,30%
|
|
HIV et Grossesse
|
4
|
17,40%
|
|
HTA
|
5
|
21,60%
|
|
Multiparité
Utérus cicatriciel
|
5
3
|
21,60%
12,90%
|
|
Total
|
23
|
100,00%
|
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Sur les différents facteurs de risque
dépistés, l'HTA et la multiparité sont des facteurs
dominants avec un taux de 21,60% chacune. L'HIV et grossesse soit 17,40% ainsi
que l'Utérus cicatriciel 12,90 sont aussi des facteurs non
négligeables.
· Référence des gestantes
Le tableau 14 montre la répartition des gestantes de
l'HREM qui ont été référées ou non au mois
de Sept/oct.2012
Tableau 14: Répartition des gestantes
référées du service de la CPN entre sept-oct.2012 à
l'HREM.
|
Gestantes référées
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
Non
|
93
|
93,00%
|
|
Oui
|
7
|
7,00%
|
|
Total
|
100
|
100,00%
|
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Une part très importante des gestantes observées
dépistées à risque soit 93% n'ont pas connu de
référence.
Le tableau 15 montre la répartition des gestantes
référées de l'HREM selon le motif du risque
dépisté de sept-oct. 2012.
Tableau 15:
Répartition des gestantes selon le motif de référence en
CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM.
|
Motif de référence
|
Effectif (N=100)
|
Pourcentage
|
|
PEC HIV
|
3
|
42,90%
|
|
PEC HTA
|
2
|
28,60%
|
|
Gémellarité
|
1
|
14,30%
|
|
PEC Utérus Cicatriciel
|
1
|
14,30%
|
|
Total
|
7
|
100,00%
|
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Sur les 7 gestantes référées, les motifs
de référence les plus effectués sont la PEC HIV soit
42,90% et la PEC HTA soit 28,60%.
· Traitements préventifs
Le tableau 16 donne la répartition des gestantes en
fonction de la couverture vaccinale.
Tableau 16 :
Répartition des gestantes selon le nombre de vaccins proposés en
CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM.
|
Nombre de VAT
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
Aucune
|
33
|
33,00%
|
|
VAT1
|
28
|
28,00%
|
|
VAT2
|
39
|
39,00%
|
|
Total
|
100
|
100,00%
|
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Ce tableau révèle que beaucoup de gestantes,
soit 33%, n'ont pas été orientées pour se faire vacciner.
Cependant, 28% des gestantes observées ont été
recommandées à effectuer la première dose de VAT et 39%
la deuxième dose.
Le tableau 17 présente la répartition des
gestantes ayant eu la prescription du fer/acide folique.
Tableau 17:
Répartition des gestantes ayant reçu la supplémentation en
fer/acide folique à la CPN entre sept et oct.2012 à
l'HREM.
|
Prescription d'une supplémentation en Fer/acide
folique
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
Non
|
12
|
12,00%
|
|
Oui
|
88
|
88,00%
|
|
Total
|
100
|
100,00%
|
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Ce tableau démontre que 88% des gestantes ont eu la
prescription du fer/acide-folique contre 12% qui n'en ont pas
bénéficié.
La figure 6 donne la proportion des gestantes qui ont
reçu la prescription des vermifuges.
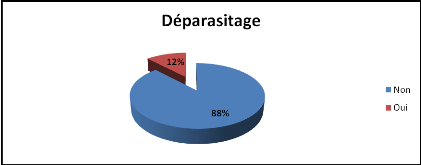
Figure 6: Proportion des gestantes ayant reçu
la prescription des vermifuges en CPN entre sept/oct.2012 à l'HREM.
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Cette figure illustre que la majorité des gestantes,
soit 88%, n'ont pas bénéficié de la prescription des
vermifuges.
La figure 7montre la proportion des gestantes qui ont
bénéficié la prescription de la SP.

Figure 7: Proportion des femmes ayant reçu la
prescription de la SP en CPN entre sept et oct.2012 à
l'HREM.
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Au regard de cette figure, il est à noter que la
quasi-totalité des gestantes, soit 88%, a eu la prescription de la
Sulfadoxine (SP) Pyriméthamine.
Le tableau 18 donne la répartition des gestantes ayant
reçu le TPI selon de la prise correspondante.
Tableau 18:
Répartition des gestantes selon le nombre TPI prescrits en CPN entre
sept-oct.2012 à l'HREM.
|
Prescription de la SP
|
Effectif (N=100)
|
Pourcentage
|
|
|
|
|
SP1
|
41
|
46,60%
|
|
SP2
|
46
|
52,30%
|
|
SP3
|
1
|
1,10%
|
|
Total
|
88
|
100,00%
|
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Parmi les gestantes observées, la deuxième prise
de la SP a été prescrite aux 46 gestantes soit 52, 30%, et 46,60%
pour la première prise, par contre 1,10% restante a eu la prescription
de la troisième prise, qui est optionnelle chez les gestantes
séropositives.
Le tableau 19 reprend la répartition des gestantes qui
ont eu la prescription de la SP selon le terme de leur grossesse.
Tableau 19:
Répartition des gestantes selon le terme de prescription de la SP en CPN
entre sept-oct.2012 à l'HREM.
|
SI OUI, QUELLE PRISE (N=100)
|
|
A quel terme de la grossesse pour la prise
|
SP1
|
SP2
|
SP3
|
TOTAL
|
|
9SA
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
11SA
|
2
|
0
|
0
|
2
|
|
12SA
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
13SA
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
14SA
|
3
|
0
|
0
|
3
|
|
15SA
|
2
|
0
|
0
|
2
|
|
16SA-
|
2
|
0
|
0
|
2
|
|
17SA
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
18SA
|
3
|
0
|
0
|
3
|
|
19SA
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
20SA
|
4
|
1
|
0
|
5
|
|
21SA
|
3
|
2
|
0
|
5
|
|
22SA
|
2
|
2
|
0
|
4
|
|
23SA
|
1
|
1
|
0
|
2
|
|
24SA
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
25SA
|
2
|
2
|
0
|
4
|
|
26SA
|
1
|
2
|
0
|
3
|
|
27SA
|
1
|
2
|
0
|
3
|
|
28SA
|
2
|
2
|
0
|
4
|
|
30SA
|
3
|
4
|
0
|
7
|
|
31SA
|
0
|
3
|
0
|
3
|
|
32SA
|
3
|
2
|
0
|
5
|
|
33SA
|
0
|
4
|
0
|
4
|
|
34SA
|
1
|
2
|
0
|
3
|
|
35SA
|
0
|
2
|
0
|
2
|
|
36SSA
|
0
|
11
|
1
|
12
|
|
37SA
|
0
|
3
|
0
|
3
|
|
39SA
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|
TOTAL
|
41
|
46
|
1
|
88
|
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Il ressort dans ce tableau que la prescription de la SP ne
respecte pas la procédure établie par l'OMS. Ici, la SP a
été prescrite aux gestantes à : 9SA, 11SA, 12SA,
13SA, 14SA, et 15SA.
La figure 8 montre la proportion des gestantes ayant eu un
Counseling avant et après le dépistage du VIH/SIDA.
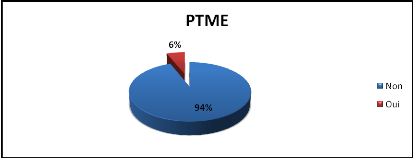
Figure 8: Proportion des gestantes ayant reçu
un Counseling avant et après le dépistage VIH/SIDA en CPN entre
sept-oct.2012 à l'HREM.
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Cette figure indique que 6% seulement des gestantes ont eu un
Counseling avant et après le dépistage du VIH/SIDA. Par contre
94% de ces gestantes n'ont pas été sensibilisées.
· Conseils et éducation sanitaire/IEC chez
les gestantes
La figure 9 donne la répartition des gestantes selon
les thématiques sensibilisées individuellement lors de la
visite.

Figure 9: Répartition des gestantes selon les
thématiques sensibilisées individuellement en CPN entre
sept-oct.2012 à l'HREM.
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Au regard de cette figure, la thématique la plus
sensibilisée individuellement aux gestantes est la fréquence et
la programmation des visites soit 60%.
· Préparation à l'accouchement chez
les gestantes
La figure 10 montre la répartition de certaines
gestantes selon les conseils reçus individuellement avec la Sage-femme
lors de la préparation à l'accouchement.
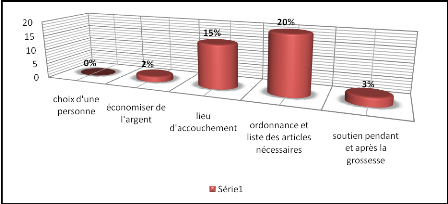
Figure 10: Répartition des gestantes selon les
conseils reçus individuellement en CPN pour la préparation
à l'accouchement entre sept-oct.2012 à l'HREM.
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Il ressort dans cette figure que le conseil le plus
donné parmi les gestantes observées lors de la préparation
à l'accouchement est celui de l'ordonnance et la liste des articles
nécessaires pour un accouchement hygiénique soit 20%.
· Gestantes ayant entendu parler de la
CPNR.
Le tableau 20 donne la répartition des clients qui ont
entendu parler de la CPNR
Tableau 20 :
Répartition des gestantes ayant entendu parler de la CPNR entre
sept-oct.2012 à l'HREM.
|
Avez-vous déjà entendu parler de la
CPNR?
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
Non
|
79
|
79,00%
|
|
Oui
|
21
|
21,00%
|
|
Total
|
100
|
100,00%
|
Source résultats d'enquête mémoire
Nadège Marina. NGUIDANG OBIANG, 2012.
Parmi les gestantes observées, 21% ont entendu parler
de la consultation prénatale recentrée et 79% ne savent rien.
L'encadré 1 explique l'insuffisance d'informations sur
la nouvelle approche des visites.
Encadré 1 : Raison de la
méconnaissance de la CPNR
1-Les sages-femmes n'ont pas suffisamment de temps pour donner
des informations sur certains aspects.
2-Aucune campagne de sensibilisation n'a été
réalisée concernant ce sujet comme les thèmes de la
santé maternelle.
3-L'absence d'affiches sur la nouvelle approche CPN sur les
murs du le service et bureau de SF.
5.2.2. Accessibilité du
service
· Milieu de résidence des
gestantes
La figure 11 fait la répartition des gestantes selon
leur lieu de résidence.
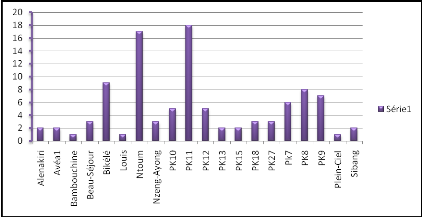
Figure 11: Milieu de résidence des gestantes
observées en CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM.
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Parmi les gestantes vues en CPN, 56%
résident à proximité (moins de 5km) et 20% sont
éloignées (plus de 30 km)
· Critères de choix du service
La répartition des gestantes en fonction des
critères du choix du service est reprise dans le tableau 21.
Tableau 21 :
Répartition des gestantes en fonction des critères de choix du
service de la CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM.
|
Raisons choix du service
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
Accueil favorable
|
35
|
35,00%
|
|
Connaissance d'un parent
|
20
|
20,00
|
|
Existence CNAMGS
|
16
|
16,00%
|
|
Tarifs abordables
|
34
|
34,00%
|
|
Proximité
|
56
|
56,00%
|
|
Service efficace
|
23
|
23,00%
|
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Ce tableau indique le critère de choix le plus
évoqué pour le suivi prénatal des gestantes est la
proximité soit 56% des cas. 20% résident loin dont 17%
proviennent de Ntoum et 3% d'Owendo.
· Accueil et prestations offertes.
La figure 12 présente le degré de satisfaction
des gestantes sur l'accueil et les prestations offertes.

Figure 12: Opinions des gestantes sur la satisfaction
de l'accueil et des prestations offertes en CPN entre sept-oct. 2012 à
l'HREM.
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège Marina NGUIDANG OBIANG, 2012.
Dans cette figure, 65% des gestantes sont satisfaites par
l'accueil qui leur est réservé. Et 80% sont satisfaites des
prestations offertes par les prestataires.
L'encadré 2 explique les raisons de l'insatisfaction
des gestantes sur l'accueil et les prestations offertes.
Encadré 2: Raisons de l'insatisfaction sur
l'accueil et les prestations offerts et suggestions
Raisons de l'insatisfaction
1-Les toilettes ne sont pas fonctionnelles et sont
insalubres.
2-Les prestataires ne respectent pas l'horaire de travail
comme le prévoit l'administration.
3-L'attente est longue due au retard du personnel et aux
formalités de la CNAMGS.
4-Les sages femmes ne sont pas nombreuses pour que le travail
soit rapide.
Suggestions
1-Rendre les toilettes fonctionnelles et construire les
latrines à l'extérieur.
2-Respecter l'horaire de travail établi par
l'état.
3-Former le personnel de la CNAMGS sur les
méthodes/organisation de travail qui réduisent le temps d'attente
des clientes.
4-Renforcer les ressources humaines des prestataires de soins
prénatals.
5.3. Entretien avec les
prestataires de la CPN
L'entretien avec les prestataires s'est fait de manière
individuelle mais les réponses aux questions posées
étaient semblables. Sur les quatre sages-femmes (SF)
enquêtées, deux ont une ancienneté de trois ans dans le
service, et les deux autres ont respectivement deux ans et un an.
Toutes les sages-femmes sont Major de service et consultent en
moyenne une dizaine de gestantes par jour selon les périodes.
La CPNR, selon elles, a été mise en oeuvre en
2009 à l'HREM soit environ 3 ans et demi. Parmi les 4 SF qui
interviennent en CPN, seule une n'est pas formée à la CPNR, les 3
autres ont suivi un atelier de formation durant la période de Mars-Avril
2010 à Libreville.
Toutes les 4 sages-femmes connaissent les normes et
procédures de cette activité. Pour l'ensemble des prestataires
rencontrées, la CPNR connaitrait des dysfonctionnements qui se
résumeraient au :
· manque de protocoles de prise en charge pour
réaliser cette activité ;
· manque de suivi et évaluation ;
· non respect des rendez-vous par les gestantes.
De même, les séances collectives d'IEC sont
inexistantes. Selon elles, l'IEC se fait de manière individuelle et
transversale au moment de la visite. Les raisons évoquées par les
prestataires sur l'absence des séances collectives d'IEC sont:
· le manque d'organisation de leur part ;
· l'insuffisance des ressources humaines ;
· le manque de supports d'IEC ;
· le volume de travail dû à l'affluence des
femmes.
Encadré 3 : Les suggestions des
prestataires pour améliorer la CPNR
1-Former toutes les sages-femmes à la CPNR afin
qu'elles subissent les évaluations régulières.
2-Améliorer les conditions de travail et le plateau
technique.
3-Doter le service de supports d'IEC.
4-Renforcer les effectifs en SF du service.
Ces résultats découlent des observations
réalisées, en fonction des objectifs de notre thématique.
Ils nous permettent de faire la discussion dans le chapitre 5 ci-dessous, en
confrontant les hypothèses de notre étude.
Chapitre 6 :
Discussion
6.1. Le respect des normes
et des procédures de la CPNR à l'HREM
Cette partie concerne l'évaluation du service de la CPN
et notamment les équipements, le matériel, l'environnement de
travail et activités réalisées. En d'autres termes, il
s'agit de vérifier si les normes et procédures sont conformes aux
directives nationales recommandées par l'OMS.
6.1.1. Normes par rapport
à l'environnement physique :
La couverture des soins prénatals est un indicateur de
l'accès et de l'utilisation du service de la CPN pendant la grossesse.
À l'HREM, les soins prénatals paraissent accessibles, d'où
l'affluence des gestantes. En effet, d'après les résultats de
notre enquête, près de 56% des gestantes (
Figure 11 et
Tableau 21) qui sollicitent les soins
prénatals vivent proches de l'établissement (c'est-à-dire
à moins de 5 kilomètres), 20% (
Figure 11) parcourent de longues distances entre
Owendo et Ntoum (plus de 30 kilomètres). Ces résultats avoisinent
ceux de l'EDSG 2000 en ce qui concerne le milieu de résidence. Les
gestantes interrogées estiment être reçues par les
prestataires avec respect et amabilité dans la majorité des cas
65% (
Figure 12).
Malgré le bon accueil, l'accessibilité à
la CPN de l'HREM cache beaucoup de disparités dans le fonctionnement du
service.
Sur le plan structural, la SMI n'existe que de nom à
l'HREM. Les différents postes qui la composent sont dispersés
dans d'autres services de la structure. C'est ainsi que le service de la CPN se
retrouve dans le bâtiment de gynéco externe avec les services de
vaccination, de gérontologie et le service de recherche sur le
paludisme. L'un (6,6176m2(tableau3)) des trois bureaux de
consultation qu'occupent les sages-femmes, ne correspond pas à la norme
structurale (15m2)28(*).
Sur le plan environnemental (
Tableau 5), les poubelles pour déchets
infectieux sont absentes dans le service. Les bouteilles d'eau minérale
vides ouvertes sont utilisées à la place des conteneurs pour
isoler les objets pointus souillés. Le savon pour le lavage des mains
fait défaut. Les toilettes sont sales et manquent
régulièrement d'eau. Une route secondaire non bitumée
traverse l'hôpital et entraine, selon les saisons, de la poussière
ou de la boue dans le service de la CPN.
Autant de choses qui exposent non seulement le personnel mais
aussi les gestantes aux infections nosocomiales. Un tel environnement de
travail a une incidence sur la santé des personnels de santé et
les gestantes.
S'agissant du plateau technique, le
Tableau 6 révèle que la rupture de
stock de la SP et des MII entrave l'efficacité des interventions en
matière CPNR. Or, les gestantes démunies ne pourraient pas se
procurer ces produits, qui pourtant devaient leur être distribués
gratuitement dans le souci de réduire la morbidité et la
mortalité liées au paludisme.
Concernant les outils de sensibilisation (
Tableau 7), il est à noter une absence des
protocoles de PEC du paludisme et des directives nationales dans les bureaux de
CPN. Cette situation peut rendre l'activité de la CPNR inefficace.
Malgré ces manquements, le service continue de
fonctionner et les prestataires travaillent toujours tant bien que mal.
6.1.2. Normes par rapport
à la procédure de la CPNR :
La consultation prénatale recentrée fait partie
des interventions qui visent la réduction de la mortalité
maternelle. La problématique qu'elle pose est celle de son contenu et de
sa qualité.
Selon l'OMS, un minimum de 4 visites prénatales suffit
dans le cadre d'une grossesse normale.
La
Figure 2 nous montre que 36% des gestantes ont
bénéficié d'au moins une CPN et 14% d'au moins quatre CPN.
Ce résultat semble être le même dans l'EDSG 2000, où
le taux de couverture en CPN1 était plus élevé (94%) que
celui de la CPN4 (63%). Ce qui crée un écart considérable
entre la CPN1 et la CPN4. Un tel écart pourrait avoir un impact sur
l'efficacité du suivi prénatal pour la réduction de la
morbidité et de la mortalité maternelles et néonatales.
Aussi, dans notre étude, les prestataires sont
allés jusqu'à 6 CPN voir même plus (
Figure 2). Ces CPN sont justifiées par la
survenue d'autres problèmes de santé chez les gestantes.
Sur un tout autre plan, certaines visites n'ont pas
été faites à des périodes clefs de la grossesse
comme le prévoit la littérature. Ainsi, les
Tableau 9 et
Tableau 10 révèlent que certaines
gestantes ont effectué leur visite tardivement. Ce qui nous a
amené à nous poser la question de savoir si cette situation vient
de la négligence des gestantes, du non respect des rendez-vous ou encore
de la démotivation des prestataires face aux recommandations de la
pratique clinique de la CPNR.
Par ailleurs, le rapport 2005 de l'OMS sur la santé
dans le monde, souligne que, «même si la couverture des services de
soins prénatals s'est nettement améliorée ces
dernières années, nul ne conteste que les soins prénatals,
actuellement dispensés dans bien des régions du monde, ne
correspondent pas aux normes préconisées. La
nécessité d'évaluer ces soins les rendrait plus
performants donc plus utiles».
6.1.3. Normes par rapport aux
activités intégrées à la CPNR :
D'une manière générale, la CPNR
intègre un paquet minimum d'activités qui concourent à
améliorer la qualité des soins prénatals. Ces
activités doivent être réalisées de manière
systématique à chaque visite prénatale selon les
directives nationales et les recommandations de l'OMS. Elles (activités)
comprennent : l'examen physique, le BPN, le dépistage des
complications, les soins promotionnels/IEC, les soins préventifs et
curatifs.
6.1.3.1. Les soins préventifs et curatifs.
Ces soins ont pour objectifs de prévenir et de traiter
certaines complications pouvant affecter la santé de la mère et
de l'enfant à naitre. Ils contiennent : la vaccination, la
supplémentation en fer/acide folique, le TPI, le
déparasitage...
Le tétanos maternel et néonatal est une maladie
à éliminer. L'anatoxine tétanique est efficace dans la
prévention du tétanos maternel et néonatal. Selon l'EDSG
2000, 80% des naissances des cinq dernières années ont
été protégées par, au moins une dose de vaccin
antitétanique reçue par la mère pendant la grossesse. En
effet, sur 100 gestantes observées au moment de notre enquête 39%
ont effectué leur deuxième dose de VAT et 28% la première
dose (
Tableau 16). Comparée au PNDS 2010 et
à SITAN 2009, la couverture en VAT2 est respectivement de 52% et de 54%.
De ce fait, le
Tableau 16 nous montre que 33% des gestantes n'ont
reçu aucune dose de vaccin conformément au calendrier vaccinal de
la femme enceinte (
Annexe 8). Ce résultat est assez
inquiétant dans la mesure où la vaccination est gratuite chez la
femme enceinte. Le service de vaccination se trouve également à
10 mètres du service de la CPN à l'HREM. Si ces doses sont
oubliées, les gestantes ne pourront pas être
protégées contre le tétanos maternel et néonatal.
L'OMS recommande aux prestataires de donner les
micronutriments (Fer/Acide folique) aux gestantes tout au long de la grossesse
jusqu'à l'accouchement. Cette supplémentation est efficace sur le
statut hématopoïétique des mères et des nouveaux
nés. Dans notre étude, la prescription du fer/acide-folique a
été effective dans la majorité des cas soit 88% (
Tableau 17). De même, la proportion des
gestantes ayant reçu un traitement contre l'anémie après
le résultat de la Numération Formule Sanguine est de 10%.
Contrairement au Mali, le pourcentage de prescription du fer/Acide-Folique est
de 82%, selon l'étude réalisée par Diallo AÏSSATOU
Souleymane MAÏGA en 2008 sur « l'évaluation de la
qualité de la CPN dans la Commune I».
Le paludisme a une incidence élevée chez les
femmes enceintes et a de graves conséquences sur la mère et le
foetus. C'est pourquoi, l'OMS recommande la chimio prophylaxie antipaludique
systématique pendant la grossesse par Sulfadoxine Pyriméthamine
(SP) à 16SA pour la première prise (avec sensation des mouvements
foetaux) et à 28 SA pour la deuxième. Les gestantes
séropositives reçoivent la troisième prise au
troisième trimestre de leur grossesse.
A l'HREM, parmi les 100 gestantes rencontrées en CPN,
88% ont eu la prescription de la SP. Seulement 12% d'entre elles ne sont pas
protégées contre le paludisme (
Figure 7). La deuxième prise de la SP
(TPI2) a été prescrite aux 46 gestantes soit 52, 30%, 46,60% pour
la première prise (TPI1) et 1,10% restante pour la troisième
prise (
Tableau 18). Cette dernière est optionnelle
chez les gestantes séropositives. Ces taux se rapprochent de SITAN en
2009 avec TPI2 entre 42 à 50% et TPI1 à 66%. Mais la couverture
en TPI2 a régressé au cours de ces dernières années
soit 12% selon l'EDSGII 2012. Concernant la norme de prescription du traitement
préventif intermittent (TPI) du paludisme, nous relevons un écart
dans nos résultats. Ainsi, dans le
Tableau 19, la SP a été prescrite
aux gestantes trop tôt (entre 9SA et 15SA) avant la perception des
mouvements actifs foetaux. Ce constat est accablant étant donné
que le TPI est l'une des activités la plus pratiquée dans les
services de SMI. Le protocole de prise en charge devrait être disponible
dans tous les bureaux de CPN pour aider les prestataires à respecter
correctement le schéma thérapeutique. La Direction Nationale de
Santé Maternelle et Infantile doit faire beaucoup d'efforts à ce
niveau. De même, la proportion des gestantes ayant reçu un
traitement correct dans les 24h qui suivent l'apparition des premiers signes de
paludisme est de 3%.
Les ankylostomes peuvent contribuer de façon
significative à l'anémie en infectant les femmes enceintes. De la
sorte, l'OMS conseille aux prestataires de donner un traitement
présomptif anti helminthique aux gestantes au deuxième trimestre
de la grossesse. Or, parmi les 100 gestantes observées à la CPN
de l'HREM, 12 seulement ont eu la prescription des vermifuges (
Figure 6) alors que, plus d'une trentaine d'entre
elles étaient presqu'à leur troisième visite.
6.1.3.2. Soins promotionnels
Ce sont des séances de soins anténatals mises
à profit pour informer, éduquer et communiquer avec les gestantes
sur plusieurs thématiques que sont : le dépistage du
VIH/SIDA, l'allaitement maternel, la PF, le paludisme et l'utilisation des MII,
la nutrition, les signes de dangers, la fréquence des visites.
Au service de la CPN de l'HREM, les prestataires, par manque
de supports et d'organisation, ne pratiquent pas les séances collectives
d'EPS/IEC. Ces personnels traitants font l'IEC de manière transversale
au moment de la consultation suivant les différents thèmes
abordés.
Concernant le dépistage du VIH/SIDA, le Counseling
pré et post test devrait être disponible pour chaque cliente. Il
constitue une partie essentielle dans la prise en charge du VIH/SIDA au cours
de la grossesse. De plus, le dépistage du VIH/SIDA offre l'occasion de
mettre en oeuvre des stratégies pour essayer d'empêcher la
transmission à l'enfant du VIH (PTME) par la mise en place d'une
thérapie anti rétrovirale (ARV). Cependant, le thème
relatif au VIH/SIDA n'a été abordé qu'avec 6 gestantes au
moment de notre enquête (
Figure 8 et
Figure 9). Au reste, les ARV ne sont pas
disponibles dans le service de la CPN de l'HREM (
Tableau 6).
S'agissant de l'allaitement maternel, et, surtout
l'allaitement maternel exclusif, il est important d'en expliquer les avantages
aux gestantes. Malheureusement, cette thématique a rarement
été abordée durant notre enquête, car, sur les 100
gestantes observées, une seule a été sensibilisée (
Figure 9) sur l'allaitement maternel.
La planification familiale (PF) a toujours été
une intervention organisée en santé de la reproduction (SR). Le
but étant non seulement d'espacer les naissances, mais aussi, de
contribuer à la réduction de la mortalité maternelle. Pour
y parvenir, les prestataires doivent apprendre aux gestantes comment
accéder aux services de PF, afin de connaitre l'utilisation des
méthodes contraceptives convenant au post partum. Dans le service de la
CPN, bien qu'il existe des affiches concernant les avantages de la PF (
Annexe 10), rien que deux gestantes (
Figure 9) aient été
sensibilisées à ce thème. Par ailleurs, les produits de PF
ne sont pas disponibles dans le service de la CPN de l'HREM.
Le paludisme constitue la première cause de
morbidité et de mortalité chez les femmes enceintes (64%) et 7%
présentent une anémie liée au paludisme29(*). Le paludisme maternel
augmente le risque d'avortement, de mortinatalité, de naissance
prématurée et d'insuffisance pondérale. Aussi,
l'utilisation de la MILDE (ou MII) est mieux indiquée pour lutter
efficacement contre cette pathologie. Nous avons constaté
amèrement que, d'une part, les prestataires ne recommandaient pas
suffisamment aux gestantes de dormir sous moustiquaire imprégnée
soit 21% (
Figure 9), et, d'autre part, les stocks des MII
étaient épuisés depuis deux ans suite à la
suspension du financement du Fonds Mondial pour l'achat de ce matériel.
Il en résulte que la sensibilisation et la promotion des MII deviennent
moins effectives en CPN.
Une bonne nutrition prénatale comporte la satisfaction
des besoins caloriques, la consommation d'aliments fournissant des
micronutriments spécifiques, et l'apport en compléments micro
nutritionnels. De ce fait, une mère de faible poids a plus de risque
d'avoir un bébé de faible poids de naissance. De même, un
faible apport en fer contribue à l'anémie. Lors de nos
enquêtes, une infime partie des gestantes (19% parmi les 100
observées (
Figure 9)) a reçu le conseil relatif
à la nutrition prénatale. Ce qui les expose à des risques
d'anémie liés aux problèmes nutritionnels.
Les gestantes doivent être informées des
conditions sanitaires pouvant mettre en danger leur grossesse. Cela leur
permettrait de savoir reconnaitre les signes de complications et s'orienter
pour obtenir de l'aide. C'est aussi l'occasion idéale pour attirer
l'attention de ces gestantes quant à la nécessité de
revenir consulter à la moindre anomalie durant l'évolution de
leur grossesse (visite subséquente 29%
Figure 9). Malheureusement, très peu de
femmes observées ,12% (
Figure 9) ont bénéficié des
conseils au sujet des signes de danger (
Annexe 9), ce, malgré l'existence des
affiches sur cette thématique.
Le respect de fréquence et la programmation des visites
de l'ordre de 60% (
Figure 9), contraste avec le respect de la
procédure des visites à des périodes définies de la
grossesse (
Tableau 9 et
Tableau 10).
6.1.3.3. La préparation à l'accouchement
La préparation à l'accouchement est une
activité recommandée par l'OMS. Elle permet aux prestataires
d'aider la cliente et sa famille à faire face aux complications
possibles. Ce qui donnera à la femme enceinte l'occasion d'être
plus apte à recevoir les soins prompts et de qualité dont elle a
besoin pour protéger sa santé et celle de son
nouveau-né.
Malheureusement, cette activité est faiblement
vulgarisée dans notre étude. Elle se limite seulement à
l'ordonnance et à la liste des articles nécessaires soit 20% des
cas (
Figure 10). C'est-à-dire les
médicaments du travail d'accouchement et les éléments de
la layette de la mère et du nouveau né (Cf.
Annexe 7).
La préparation à l'accouchement et aux
complications éventuelles avant le développement d'une
complication est la clé de la survie30(*). Elle mérite d'être approfondie et
développée dans les centres de SMI. Elle doit se rattacher
à la composante PF dans la SR, car si les naissances sont
planifiées, elles doivent aussi être préparées afin
que les bénéficiaires soient aptes à faire face aux
complications. Cela permettrait aux gestantes de prendre conscience que la
grossesse peut comporter un risque, et, par conséquent occasionner des
dépenses financières. Il doit donc être conseillé
aux gestantes de faire des économies pour répondre aux urgences
éventuelles. Dans notre échantillon, 2% des gestantes (
Figure 10) ont été
sensibilisées sur la nécessité d'épargner de
l'argent pour faire face aux complications liées à la grossesse.
Cette situation est presque la même au Mali où la
préparation à l'accouchement n'était pas suffisamment
expliquée aux gestantes31(*).
6.2. L'évaluation
des prestataires et du programme de la CPN
En matière de consultation prénatale, l'OMS opte
que les soins prénatals focalisés soient assurés par des
sages-femmes ou agents de santé possédant les compétences
voulues en obstétriques dans un établissement
décentralisé. Lorsqu'un problème obstétrical
dépasse le niveau de compétence des prestataires ou que
l'équipement n'est pas adéquat, les prestataires de soins
prénatals ont l'obligation de se référer à un
niveau supérieur pour une meilleure prise en charge.
6.2.1. Evaluation des
compétences des prestataires:
Les effectifs en personnel du service de la CPN sont
insuffisants. En effet, sur les 6 gynécologues et 21 sages-femmes (
Tableau 1) que compte l'HREM, seulement 6 agents
dont un gynécologue, un généraliste et 4 SF interviennent
dans le service de la CPN (
Tableau 8). Les médecins n'étant pas
souvent disponibles, les soins prénatals sont donc
régulièrement gérés par les sages-femmes. Toute
chose qui a un impact sur le volume de travail et le rendement des
prestataires.
L'absence d'une évaluation peut affecter la
qualité de la CPNR. Au cours de notre entretien avec les prestataires,
il ressort qu'une des sages-femmes parmi les 4 intervenants dans le service de
la CPN, n'a pas été formée à la CPNR. Pour, les
autres la formation remonte à deux ans. Or, le manque de supervision
deux ans après, ne garantit pas la conservation des compétences
du personnel formé.
Pendant la CPN focalisée, les prestataires
compétents doivent être capables de dépister
précocement et de prendre en charge les complications pouvant affecter
la santé de la mère mais aussi d'accompagner la cliente tout au
long de la grossesse. Les résultats de nos enquêtes indiquent que
les gestantes ont été examinées dans la majorité
des cas soit 91% (
Figure 3), contrairement à Hôpital
Régional de Ségou au Mali 60%32(*). Les 9% de gestantes non examinées sont
généralement les jeunes primipares (environ 15 ans). Ces
dernières ne supportent pas le toucher vaginal. Cette situation peut
s'expliquer par le fait qu'elles ne soient pas suffisamment
préparées à subir cet acte.
De manière systématique, le bilan
prénatal a été demandé dans 89% (
Figure 4) des cas chez les gestantes à la
recherche d'une infection quelconque qui sera traitée en fonction du
résultat d'examen. C'est à ce titre que l'anémie (10% des
cas) et le paludisme (3%) ont été décelés chez les
gestantes présentant une pâleur conjonctivale et la fièvre
avec frissons. Ces pathologies ont été méthodiquement
prises en charge. De ce fait, les 11% des gestantes, n'ayant pas eu la
prescription du bilan prénatal, ont consulté avant 12 SA. A cet
âge, l'issue de la grossesse est ignorée. C'est pourquoi les bons
d'examens ne sont pas délivrés à ces gestantes pour leur
éviter de dépenser inutilement. En comparaison avec le Mali, les
examens complémentaires se limitaient à l'Albumine/sucre33(*).
Selon l'OMS, trois échographies sont demandées
aux gestantes en fonction du terme de la grossesse. La première
échographie (obstétricale) se fait au premier trimestre (0-12SA)
pour dater la grossesse, la deuxième (20-22SA) au deuxième
trimestre pour la morphologie foetale et la dernière au troisième
trimestre (30-32SA) pour la biométrie foetale. Lors de nos recherches,
16% des gestantes n'ont pas eu la prescription d'échographie (
Tableau 11).
Les soins anténatals offrent l'occasion aux
prestataires compétents de dépister les risques et complications
majeurs chez les gestantes pour la PEC et l'orientation vers un niveau
supérieur.
Sur 100 gestantes observées au moment de notre
étude, 23% ont été déclarées à risque
contre 77% qui ne possédaient pas de facteurs de risques (
Tableau 12). Sur les 23 gestantes
dépistées à risque, 7 d'entre elles (
Tableau 15) ont été orientées
vers un spécialiste (gynécologue) et vers le centre de traitement
ambulatoire (CTA) pour une meilleure prise en charge. Ces chiffres avoisinent
ceux observés lors d'une étude réalisée par Diallo
Aïssatou Souleymane Maïga en 2008
sur « l'évaluation de la qualité de la CPN
dans la Commune I au Mali» où le nombre de
gestantes à risque dépistés étaient à 23,5%.
Aussi, selon l'étude de Diarra Mohamed au Mali34(*), 104 grossesses sur un
échantillon de 200 gestantes étaient dépistées
à risque dont 80 gestantes avaient des antécédents de
césarienne. Pour Daouda Camara, malheureusement la découverte des
facteurs de risque médicaux et obstétricaux n'était
suffisamment pas prise en compte par les prestataires.
Malgré ces aptitudes positives, l'inter action
personnel/gestantes (communication interpersonnelle) est de moins bonne
qualité. Car certains aspects n'étaient pas clairement
expliqués aux gestantes en matière de CPNR. En effet, sur 100
gestantes rencontrées en CPN, 79% (
Tableau 20) déclaraient n'avoir jamais
entendu parler de la CPNR. Toute chose qui confirme que l'IEC sur
différentes thématiques n'est pas pratiquée comme
prévu dans l'organisation des activités de la SMI. Au mali l'IEC
se fait essentiellement sur les MST/SIDA et l'écoulement
vaginal35(*).
L'affluence des gestantes, peut être perçue comme
un facteur alourdissant les soins prénatals. Cela épuise les
prestataires de telle sorte qu'ils peuvent manquer de temps pour offrir du
Counseling, la préparation à l'accouchement. Ce qui entrave la
capacité du service de la CPN à gérer la qualité
des soins prénatals. Malgré ces manquements, les gestantes
arrivent tant bien que mal à trouver leur compte du moment où
leur degré de satisfaction face aux prestations offertes par les
sages-femmes est de 80% dans notre étude (
Figure 12).
6.2.2. Evaluation du programme
de la CPN :
La loi 12/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la
politique de santé en République Gabonaise, fait mention dans son
article 5 de « protection de la mère et de
l'enfant ». Le Ministère de la Santé, régit par
le décret 1158/PR/MSPP du 04 septembre 1997, est chargé
d'appliquer, de mettre en oeuvre et de coordonner cette politique sanitaire sur
toute l'étendue du territoire. La Direction Nationale de Santé
Maternelle et Infantile est la structure de coordination des activités
de SMI.
L'élaboration d'un programme de santé avec des
interventions telle que la CPNR doit :
· impliquer tous les acteurs ;
· tenir compte des conditions socio-économiques
et culturelles de la population cible ;
· nécessiter un encadrement juridique ;
· prévoir les directives nationales.
Aussi, avant de mettre en oeuvre les soins prénatals
focalisés, le Ministère de la santé et la Direction
Nationale de Santé Maternelle et Infantile devraient
préalablement :
· mettre à jour les normes cliniques et les
directives ;
· former sur place tous les prestataires concernés
et leurs superviseurs ;
· réaliser une évaluation à priori
et un plan détaillé pour effectuer les modifications des
médicaments, d'équipements et de matériels
nécessaires pour la mise en pratique de l'ensemble ;
· réviser et valider les modules de formation et
des programmes pour aider les prestataires à mettre leur connaissance et
leurs aptitudes à jour.
Pour n'avoir pas respecté ces orientations, il est
regrettable de constater aujourd'hui, que la CPNR souffre de beaucoup
d'insuffisances depuis sa mise en oeuvre. Les résultats de notre
étude nous permettent d'avoir les tendances sur la faible performance de
la CPNR.
Après avoir critiqué et interprété
les résultats de notre analyse, nous allons enfin conclure ce travail et
formuler quelques suggestions.
CONCLUSION ET SUGGESTIONS
Conclusion et suggestions
Au terme de ce travail sur le thème :
«évaluation de la mise en oeuvre de la consultation
prénatale recentrée : cas de l'Hôpital Régional
de l'Estuaire à Melen », nous pouvons retenir, par
rapport à l'opinion des gestantes sur l'accueil et les prestations
offertes, que les soins prénatals sont accessibles. Toutefois, cette
bonne accessibilité cache des dysfonctionnements importants.
En effet, l'environnement de travail pour la pratique de la
consultation prénatale recentrée (CPNR) ne correspond pas aux
normes. Les supports de sensibilisation sont inexistants. Les protocoles de
prise en charges de certaines pathologies liées à la grossesse
sont absents. La rupture de stock de la SP et des MII, la non
disponibilité des antirétroviraux (pour la PTME) et des produits
de la PF rendent la CPNR moins effective.
Les effectifs des prestataires à la CPNR sont
insuffisants. Bien que certains prestataires soient formés à la
CPNR, ils ne maîtrisent pas la pratique. Ils ne respectent pas la norme
de prescription de la SP (
Tableau 19). Nous voulons pour preuve, ils
oublient parfois d'orienter les gestantes pour se faire vacciner (33% des cas,
Tableau 16). De plus, les séances
collectives d'EPS/IEC sont presque inexistantes. Enfin, les sages femmes ne
sont pas évaluées régulièrement à
l'activité de la consultation prénatale (CPN).
Au regard de ce qui précède, nous pouvons
affirmer sans risque de nous tromper que la CPNR n'est pas totalement effective
à l'HREM. De facto, la stratégie de réduction de la
mortalité maternelle à travers la CPNR est plus
qu'hypothétique.
Alors que les stratégies de lutte contre la
mortalité et la morbidité maternelle se sont toujours
penchées sur les consultations prénatales, il est donc urgent que
tous les acteurs du système agissent en synergie avec compétence
et motivation, dans le respect de l'autre et des règles éthiques
pour améliorer la pratique de la CPNR au Gabon.
Le Ministère de la santé et la Direction
Nationale de Santé Maternelle et Infantile doivent faire beaucoup
d'efforts. Car le rendez-vous du millénaire est proche pour
évaluer les progrès accomplis en matière de santé
maternelle et infantile.
Par ailleurs, cette étude nous a permis de comprendre
le rôle sensibilisateur que peuvent jouer les affiches et les protocoles
de PEC de certaines pathologies liées à la grossesse pour aider
les prestataires à mettre leurs connaissances à jour.
Sur le plan professionnel, cette étude nous permettra
d'impliquer les individus, les familles et les communautés dans les
interventions visant à réduire la mortalité maternelle et
néonatale. Et elle gagnerait à être approfondie par de
nouvelles recherches sur les pistes telles que : « la
qualité des soins prénatals selon la perspective
gestantes » ; et « la planification familiale dans la
perspective de la préparation à
l'accouchement ».
A cet effet, nous proposons :
Au Ministère de la Santé de
(d') :
· assurer une formation continue du personnel en
CPNR ;
· superviser régulièrement
l'activité de la CPNR au sein des différents services de
SMI ;
· sensibiliser les prestataires de soins prénatals
sur l'utilité de réaliser les séances collectives
d'IEC;
· renforcer l'effectif en personnel du service de la CPN
de l'HREM ;
· former les communicateurs à la CPNR afin qu'ils
puissent réaliser les émissions télé et Sketches
sur l'importance des visites prénatales ;
· promouvoir la CPNR en effectuant les campagnes de
sensibilisation plus accrue sur l'importance des soins prénatals
focalisés ;
· Vulgariser la CPNR en encourageant les femmes enceintes
à se faire suivre pendant leur grossesse ;
· intégrer largement la participation
communautaire dans les interventions visant à réduire la
mortalité maternelle.
À la Direction Nationale de Santé
Maternelle et Infantile de (d') :
· élaborer les affiches comportant les messages sur
les avantages de la CPNR et les rendre disponibles dans tous les services de
SMI ;
· élaborer les protocoles pratiques de PEC de la
CPNR et les rendre disponibles dans les bureaux des Sages-femmes des
différents services de SMI.
Aux partenaires au développement
de:
· renforcer leur appui technique et financier à
l'amélioration de la santé maternelle et infantile, notamment en
CPNR.
À la direction de l'HREM de (d')
· réorganiser le plan des activités de la
CPNR de telle sorte que les SF puissent réaliser effectivement les
séances collectives d'IEC;
· mettre à disposition des sages femmes le
matériel approprié pour réaliser pleinement
l'activité de la CPNR ;
· améliorer l'état des toilettes du service
de la CPN ;
· confectionner une boite à idées en vue
d'évaluer la satisfaction des gestantes sur les prestations offertes et
l'accueil ;
· réorganiser le planning de travail des SF en
adoptant le programme ci-dessous :
De lundi à Mardi : CPNR des gestantes non
assurées.
Mercredi : pour toutes premières visites
confondues (assurées ou non).
Jeudi et Vendredi : CPNR des gestantes assurées
à la CNAMGS.
Aux prestataires de (d')
· respecter les normes (directives nationales) en
matière de CPNR ;
· assurer une collaboration étroite entre
eux ;
· renforcer l'interaction cliente soignant par l'IEC sur
les différentes thématiques qui intègrent la CPNR et
encourager les gestantes sur l'utilisation de la MII.
Aux gestantes de :
· respecter les consignes des Sages femmes ;
· faire suivre les grossesses dès leur
début.
Nous espérons que la prise en compte des propositions
faites dans le cadre de ce travail contribuera à l'amélioration
de la CPNR à l'HREM, et par ricochet, à la réduction de la
mortalité maternelle liée aux pathologies imputables à la
grossesse.
Références bibliographiques
Bibliographie française
Rapports :
- Direction de l'Information et la Statistique
(DIS) « Carte sanitaire du
Gabon», 2008, (123P), p31 et 74
- Direction Générale de la Statistique et des
Etudes Economiques, Ministère de la Santé Publique et de la
Population, Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme
(DGSEE et MFPF), « Enquête
démographique et de la santé, rapport de
synthèse », 2000, (30P), p7 et 8.
- Ministère de la santé de l'hygiène
publique chargée de la famille et de la promotion de la femme
(MSPFPF) « Consultations pré et post
natales recentrées, Manuel de
référence »,2008.54P
- Ministère de la Santé, des Affaires Sociales,
de la Solidarité et de la Famille, Fonds des nations unies pour la
population (MSASSF et UNFPA) « Rapport
final de l'enquête sur l'évaluation des besoins en matières
des SONU au Gabon », Mai 2010.81P
- Ministère de la Santé, des Affaires Sociales,
de la Solidarité et de la Famille (MSASSF)
« Plan National de Développement
sanitaire »,2010-2015. 76P ; p9, 11 et 26-27.
- Ministère de la Santé, des Affaires Sociales,
de la Solidarité et de la Famille, Agence française de
développement (MSASSF et
AFD) « Manuel de suivi et évaluation des
activités de la SMI », mai 2011.61P ; p5,
13,22-23,45.
- Ministère de la Santé, des Affaires Sociales,
de la Solidarité et de la Famille (MSASSF)
« Normes du secteur de la santé », janvier
2012.290P
- Ministère de la Santé, des Affaires Sociales,
de la Solidarité et de la Famille, Direction Nationale de la
Santé Maternelle et Infantile (MSASSF et
DNSMI) « feuille de route pour la réduction
de la morbidité et la mortalité maternelles, néonatales,
infanto-juvéniles et des adolescents au Gabon,
actualisée », février 2012 .37P ; p2-3 et
16
Revue :
- STEPHENSON Patricia «Soins
prénatals focalisés : une meilleure stratégie, moins
chère et plus rapide, fondée sur les données
probantes », Bulletin technique de santé globale, USAID,
2005 in
http://archive.k4health.org/system/files/focused%20care-fre.pdf
consulté 20/08/2012
Ouvrages :
- MERGER. R.LEVY.J, MELCHIOR.J,
« Précis d'obstétrique »,
5ème édition Masson, Paris, 1978.663P
- POCHET Bernard
« Méthodologie documentaire », 2è
édition, de Boeck, Bruxelles, 2005.200P
Mémoires :
- BAMADIO Aly « Evaluation
de la qualité de CPN au CSCO de Salibougou secteur1 de la commune du
District de Bamako »,2008.105P in
http://www.keneya.net/fmpos/theses/2008/med/pdf/0M286.pdf
consulté 20/08/2012.
- B CISSOUMA Souleymane
« Evaluation de la qualité des CPN au Cs Réf de
Mopti, Ascotamb et le CSCO de Toguel », 2008. 85P in
www.keneya.net/fmpos/theses/2008/med/pdf/08M242.pdf
consulté le 31/07/2012.
- CAMARA Daouda
« Evaluation de la qualité de CPN au CSCO de Bacodjicoroni
en commune »,2008 .87P in
http://www.keneya.net/fmpos/theses/2008/med/pdf/08M217.pdf
consulté 10/08/2012.
- CHEIKNA Badiaga
« Evaluation de la qualité de CPN à la maternité
du Cs Réf de Kati. A propos de 380 cas »,2008.
98P in
http://www.keneya.net/fmpos/theses/2008/med/pdf/08M201.pdf
consulté 10/08/2012.
- DIALLO Aïssatou Souleymane
MAÏGA « Evaluation de la qualité de
CPN au centre de santé de référence (Cs Réf) de la
commune I du District de Bamako »,2008 .86P in
http://www.keneya.net/fmpos/theses/2008/med/pdf/08M216.pdf
consulté 30/07/2012.
- KAMATE Pierre « Evaluation de
la qualité de CPN au Cs Réf de
Koutiala. »,2007.104P in
http://www.keneya.net/fmpos/theses/2008/med/pdf/07M88.pdf
consulté 10/08/2012.
- MOHAMED Diarra
« Evaluation de la qualité de CPN à l'hôpital
régional de Ségou»,2008.119P in
http://www.keneya.net/fmpos/theses/2008/med/pdf/08M244.pdf.
consulté le, 31/07/2012
- M.KEITA Siaka « Evaluation de
la qualité de CPN au Cs Réf de Kita »,2008.81P
in
http://www.keneya.net/fmpos/theses/2008/med/pdf/08M248.pdf
consulté 31/07/2012.
- SAMASSEKOU Garba
« Evaluation de la qualité des SOU en salle d'accouchement
au CSCO de Kalabancoura Asacocal de la commune V du district de
Bamako »,2008.102P in
www.keneya.net/fmpos/theses/2008/med/pdf/08M101.pdf
consulté le, 20/08/2012
English bibliography
Reports:
- I.RANSON Elisabeth and V.YINGER Nancy
«for a safe motherhood: how to eliminate the barriers (obstacle) to
care», reference population office, July 2002.34P in
www.prb-org/pdf/makmothersafer_fr.pdf
consulted le 05/10/2012
- World health organization
(WHO) « Integrated management of pregnancy
and childbirth: recommended intervention for to ameliorate the maternal and
newborn health », 2007, p2, depart from make pregnancy safer, N°
who/MPS/07-05.6P
- World health organization
(WHO) « Pregnancy, Childbirth, Postpartum
and Newborn care: a guide for essential practice» second edition,
Geneva, 2009.187P
- World health organization
(WHO) «make its chance at every child and every
mother », world health report 2005 .16P in
http://www.who.int/whr/2005/overview_fr.pdf
. Consulted 05/10/2012.
- United Nations Children Fund (UNICEF),
Regional Office for Gabon, Equatorial Guinea and Saotome
Principe« analysis of the situation of the child and mother in
Gabon » partnership, 2009.193P
Review or periodical articles:
- CHALUMEAU M. «Can clinical risk
factors for perinatal mortality in West Africa be detected during antenatal
care or during labor? »inserm, united 149,epidemiological
search united in perinatal health and women health 123, royal port
boulevard,75014 Paris vol31 n°1,2002, p63-69.
- PRUAL A. and al
«Potential role of prenatal care in reducing maternal and
perinatal mortality in Sub-Saharan Africa», Maternal health in Africa
French-speaking, 2002, vol31, n°1, p90-99, Masson edition, Paris.
- SHAVER Theresa and KINZIE Barbara
« antenatal care :old myths, new realities »
presentation at MAG Mini University, WASHINGTON, DC,2011 April 20th in
www.maqweb.org consulted
2012,august,20th
ANNEXES
Annexe 1: Autorisation
d'enquête.
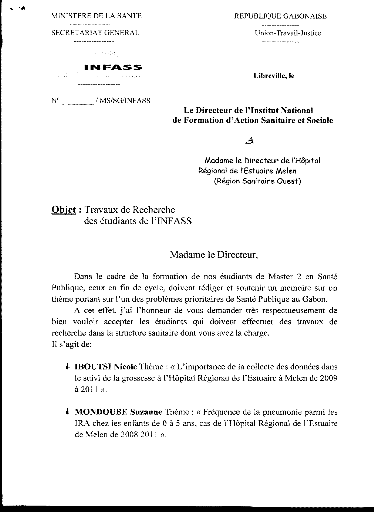

Annexe 2: Carte de la Région Sanitaire Ouest.
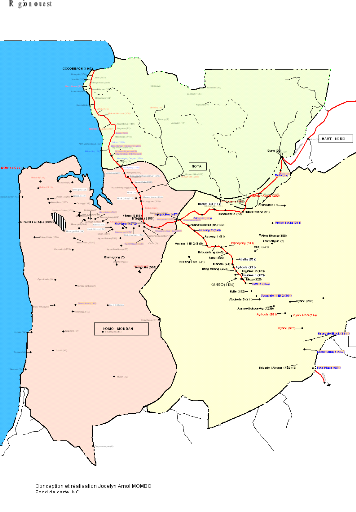
Annexe 3 : Organigramme de la structure.

Annexe 4 : Fiche d'observation en CPNR.
Structure
Numéro fiche
Date d'observation..................
1/Accueil de la cliente :
Le prestataire acceuille-t-il la cliente avec respect,
amabilité et l'instale ? : Oui non
Comportement envers la cliente : bon mauvais
2/Fréquence et programmation
CPN
CPN1 : 1er trimestre 0-15 SA oui
non
CPN2 : 2ème trimestre 16-27
SA oui non
CPN3 :3ème trimestre 28-35
SA oui non
CPN4: 3ème trimestre 36-40 SA oui
non
3/Suivi prénatal
Examen physique : oui non
Bilan prénatal prescrit lors de la consultation : oui non
Bilan prénatal réalisé : oui
non
Echographie obstétrical : 1er trimestre
0-15 SA oui non
Echographie morphologique : 2ème
trimestre 16-28 SA oui non
Echographie biométrique : 3ème trimestre
30-36 SA oui non
Aucune échographie :
Grossesse dépisté à risque : oui
non Si oui quel est le facteur de risque ?
Cliente référée vers : aucune
gynécologue autre établissement Si
référence, quel motif ?
4/Vaccination proposée
Aucune
VAT1
VAT2 :
5/TPI
Prescription de la SP : oui non
Si oui, quelle prise et quel terme de la grossesse? SP1:
SP2 SP3
PEC paludisme : oui non
6/Anémie
Prescription d'une supplémentation en fer/acide
folique : oui non
PEC anémie : oui non
7/Déparasitage : oui
non si oui quel est l'âge de la grossesse ?
8/PTME
Counseling pré et post test: oui non
9/Conseils et éducation sanitaire/IEC sur
les thèmes suivants :
-planification familiale : oui non
-allaitement maternel : oui non
-signes de danger : oui non
-paludisme (TPI et MII): oui non
-nutrition: oui non
-repos et l'activité: oui non
-hygiène: oui non
-programmation des visites: oui non
-dépistage VIH /SIDA: oui non
-visites subséquentes : oui non
10/Préparation à
l'accouchement
Prescription d'une ordonnance et liste des articles
nécessaires à l'accouchement: oui non
Orientation vers un lieu d'accouchement: oui non
Rappel de la nécessité de se procurer de
l'argent: oui non
Choix d'une personne pour prendre les décisions :
oui non
Soutien de la cliente pendant et après la
grossesse : oui non
Annexe 5 : Fiche d'entretien avec le personnel.
Date d'entretien...................
1/Depuis combien de temps êtes vous affecté(e)
à la SMI?
2/Qu'entendez-vous par Consultation Prénatale
Recentrée (CPNR) ?
- Plusieurs visites prénatales
- Consultation basé sur l'approche risque
- Quatre consultations par grossesse
- Prévention des complications
- Consultation prénatale de qualité
- Meilleur suivi de la grossesse
3/Depuis quand la CPNR a été
intégrée dans la SMI de l'HREM ?
4/Êtes-vous formé à la CPNR ? Oui
non
5/Combien de gestantes recevez-vous en moyenne par
jour ?
6/Faites-vous l'IEC ? Oui non Si oui
existe-t-il une programmation ?oui non
Si oui, avez-vous des supports ? Oui.... non
Si non pourquoi : manque d'organisation volume de
travail insuffisance RH autres
7/Avez-vous déjà été
évalué(e) sur l'activité de la CPNR ? Oui non
8/Êtes-vous satisfait(e) de vos conditions de
travail ? Insatisfait satisfait très satisfait
9/Quel est votre appréciation sur le fonctionnement de
la CPNR ?
Manque de suivi/évaluation disfonctionnement
pas de supports ne marche pas
10/Quelles sont les obstacles que vous rencontrez pour
réaliser la CPNR
- Problème de plateau technique
- non respect des rendez-vous
- affluence des femmes
- autres
11/Quelles sont vos propositions d'amélioration de la
CPNR :
- faire le suivi et évaluation
- améliorer les conditions de travail
- faire la sensibilisation
- limiter le nombre de gestantes par jour
Je vous remercie de votre attention
Annexe 6 : Fiche d'entretien avec la
cliente.
Date ..........
Fiche numéro
1) Quartier
habité............................................
2) Pourquoi avez-vous choisi la SMI de Mélen pour le suivi
de votre grossesse ?
Proximité Qualité de l'accueil
Efficacité du service
Tarifs abordables Conseil Connaissance
d'un parent
Fourniture gratuite de médicaments Existence
de la CNAMGS
3) Avez-vous déjà entendu parler de la Consultation
Prénatale Recentrée : oui non
4) Avez-vous les difficultés pour faire vos
visites ?
aucunes résidence éloignée
problème financier attente longue
5) Quelle est votre degré de satisfaction?
Pas Satisfaite Satisfaite
Très satisfaite
6) Dans tous les cas, quelles sont vos propositions
d'amélioration du service de la CPNR ?
Améliorer les toilettes renforcer les RH
être ponctuel au travail autres
Je vous remercie de votre attention
Annexe 7 : Ordonnance prénatale et liste des
articles nécessaires à l'accouchement.
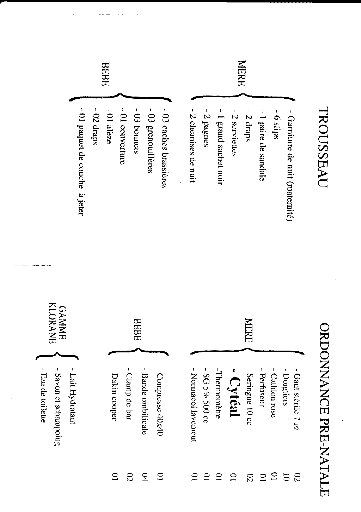
Annexe 8 : Calendrier vaccinal de la femme enceinte.

Annexe 9 : Affiche sur les signes de danger
collée au mur.
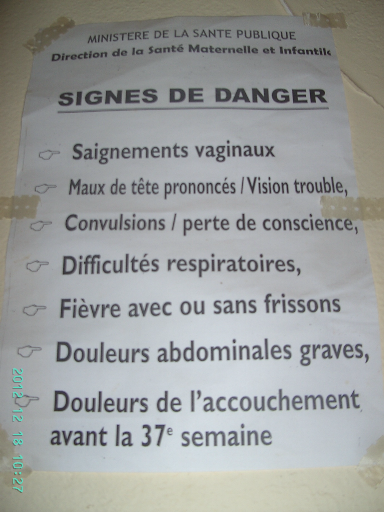
Annexe 10: Affiche sur les avantages de la planification
familiale collée au mur.

Annexe 11 : Structuration du service de la CPN à
l'HREM en février 2013.
   
Les infirmières prennent les paramètres.
La Sage-femme reçoit la cliente.
 
La Sage-femme consulte la cliente. Le
service de vaccination.
Sources: résultats d'enquête mémoire
Nadège. M. NGUIDANG OBIANG, 2012.
Annexe 12: Chronogramme de travail.
|
Période
|
Activités
|
|
27 juillet 2012
|
Formulation et définition du sujet d'étude avec
la commission pédagogique d'approbation.
|
|
31 juillet 2012
|
Formalités administratives à l'INFASS :
lettre de stage
|
|
Du 02 août au 24 août 2012
|
Phase exploratoire : Recherche documentaire et
construction du modèle d'analyse avec le professeur de
méthodologie.
Rencontre avec les personnes ressources au MSP.
|
|
Du 27 août au 03 sept 2012
|
Formalités administratives à la Direction de
l'HREM : dépôt de la lettre de stage et prise de contact avec
les responsables et personnel de l'HREM.
|
|
Du 03 au 05 sept 2012
|
Elaboration des outils de collectes des données :
fiches d'observation et d'entretien avec le personnel et les gestantes, et la
grille de gestion du service.
|
|
06 sept 2012
|
Test des outils de collectes à HCEG et
réajustement.
|
|
06 sept 2012
|
Entretien avec les personnes ressources et autres
acteurs : UNFPA, UNICEF, OMS, Ministère de la Santé...
|
|
7 sept 2012
|
Evaluation des équipements et matériels du
service de la CPN de l' HREM en fonction de leur nombre et leur état
sans oublier l'état environnemental.
|
|
7 sept 2012
|
Entretiens individuels semi-structurés avec les
prestataires des soins prénatals.
|
|
9 sept 2012
|
Exploitation du registre de la CPN.
|
|
Du 10 sept au 03 oct. 2012
|
Collecte des données sur le terrain.
|
|
Du 07 au14 oct.2012
|
Elaboration des fiches de lecture, de la bibliographie, du
cadre conceptuel et du plan de rédaction du mémoire.
Choix du directeur de mémoire.
|
|
Du 15 au 19 oct. 2012
|
Ebauche de rédaction d'une introduction. Mise au point
avec le Directeur de mémoire sur l'état d'avancement des
travaux.
|
|
Du 22 oct.au 15 janv.
.2013
|
Saisie du questionnaire et Analyse (univariée) des
données (qualitatives) sur EPI Info ; production des tableaux et
graphiques dans Excel.
|
|
Du 20 janv. au 15 fév.2013
|
Discussion des résultats en comparaison avec les autres
auteurs.
|
|
18 fév. 2013
|
Entretien avec le Directeur de mémoire sur
l'état d'avancement des travaux.
|
|
Du. 19 fév. au 05 mars 2013
|
Rédaction de la conclusion et formulation des
suggestions
|
|
Du 06 au 08 mars 2013
|
Rédaction du résumé français et
traduction en anglais.
|
|
Du 11 mars au 10 avril
|
Corrections, impressions et dépôt du
mémoire.
|
|
Du 15 au 22 avril
|
Présentation Power Point mémoire et
corrections.
|
|
30 avril 2013
|
Soutenance du mémoire.
|
Source : résultats d'enquête
mémoire Nadège. Marina. NGUIDANG OBIANG, 2012.
Glossaire
|
Grossesse
|
C'est l'état qui débute par la fusion d'un
spermatozoïde avec un ovule. Elle prend fin avec l'expulsion d'un produit
de conception.
|
|
Grossesse à risques
|
C'est une grossesse qui comporte un ou plusieurs facteurs de
risque.
|
|
Facteur de risque
|
C'est une caractéristique pendant la grossesse qui
lorsqu'elle existe indique que cette grossesse a des chances d'être
compliquée.
|
|
Normes
|
C'est une règle à laquelle se
référer (recommandation) pour la pratique clinique. Ce sont
les types de services offerts, les conditions minimales acceptables des
performances et des qualifications requises exigées pour chaque service
offert.
|
|
Mortalité maternelle
|
C'est le décès d'une femme survenue au cours de
la grossesse ou dans un délai de quarante deux jours après sa
terminaison quelle qu'en soit la durée ou la localisation, pour une
cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse
ou les soins qu'elle a motivés, mais ni accidentelle ni fortuite .
|
|
Paquet minimum d'activités
|
C'est l'offre d'activités intégrées de
soins de santé. Il comporte des activités préventives,
curatives et promotionnelles. Il s'agit entre autres de traitement des maladies
courantes consultations prénatales et post natales avec accouchement et
vaccination.
|
|
Procédures
|
Elles décrivent les gestes logiques indispensables et
nécessaires à l'offre des soins de qualité par les
prestataires.
|
|
Référence
|
C'est l'orientation vers un spécialiste ou un centre
spécialisé en absence de toute urgence d'une pathologie dont le
traitement dépasse les compétences de l'équipe de
consultation prénatale.
|
|
Qualité des soins
|
Les soins de qualité sont les soins visant à
maximiser le bien être des patients après avoir pris en compte le
rapport bénéfice/risques à chaque étape du
processus de soins. Avedis Donabedian
Selon l'OMS, la qualité des soins consiste à
délivrer à chaque patient un assortiment d'actes diagnostiques et
thérapeutiques qui lui assurent le meilleur résultat en terme de
santé, conformément à l'état actuel de la science
médicale, au meilleur coût pour un même résultat, au
moindre risque iatrogène et pour sa plus grande satisfaction en termes
de procédure, résultats, contacts humains à
l'intérieur du système de soins.
|
|
Taux de mortalité maternel
|
C'est le rapport des décès maternels
observés durant une année, au nombre des naissances vivantes de
la même année, généralement exprimé pour
100.000.
|

* 1 World health organization
(WHO) «make its chance at every child and every mother
», world health report 2005 in
http://www.who.int/whr/2005/overview_fr.pdf
* 2 I.RANSON Elisabeth and
V.YINGER Nancy «for a safe motherhood: how to eliminate the barriers
(obstacle) to care», reference population office, July 2002 in
www.prb-org/pdf/makmothersafer_fr.pdf
* 3 WHO, 2005 Op cit
* 4 SITAN,UNICEF, Regional
Office for Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tomé et Principe
« analysis of the situation of the child and mother in
Gabon » partnership,2009
* 5 Direction
général de la statistique et des études
économiques, Ministère de la santé publique et de la
population, Ministère de la famille et de la promotion de la
femme, « Enquête démographique et de la
santé, rapport de synthèse », 2000, p7 et 8
* 6 EDSG, 2000 Op cit
* 7 Conférence
Internationale sur la Population et le Développement en 1994 au
Caire.
* 8 I.RANSON Elisabeth and
V.YINGER Nancy,2002,Op cit
* 9 WHO, 2005, Op cit
* 10 UNICEF(SITAN), 2009 Op
cit
* 11PRUAL. A, and al
«Potential role of prenatal care in reducing maternal and
perinatal mortality in Sub-Saharan Africa», Maternal health in Africa
French-speaking, 2002, vol31, n°1, p90-99, Masson edition, Paris
* 12 Recensement
Général de la Population et de l'Habitat de 2003 au Gabon
* 13EDSG, 2000 op cit
* 14 DG Trésor, mars
2012
* 15Banque Mondiale,
septembre 2012
* 16 Programme des Nations
Unies pour le Développement, 2011
* 17PNUD 2011 Op cit
* 18 Statistiques sanitaires
mondiales 2010
* 19 EDSG, 2000 op cit
* 20,
Ministère de la santé des affaires sociales de la
solidarité et de la famille, Fonds des nations unies pour la population
(UNFPA) « Rapport final de l'enquête sur
l'évaluation des besoins en matières des SONU au
Gabon », Mai 2010.
* 21 Ministère de la
Santé, des Affaires Sociales, de la Solidarité et de la Famille
« Plan National de Developpement Sanitaire »,
2010-2015.
* 22 RGPH, 2003 op cit
* 23 Direction de
l'information et la statistique « Carte sanitaire du
Gabon », 2008, p31 et 74.
* 24 Prual .A et al, op
cit
* 25 STEPHENSON
Patricia,USAID,2005
* 26 SHAVER Theresa et
KINZIE Barbara,2011
* 27 DONABEDIAN A.
The quality of care: How can it be assessed?
JAMA 1988; 260: 1743-1748 [cross-réf].
* 28Ministère de la
santé des affaires sociales de la solidarité et de la
famille « Normes du secteur de la
santé », janvier 2012
* 29 Direction
Générale de la Statistique, Ministère de
l'économie, de l'emploi et du Développement Durable,
Ministère de la Santé,
ICF-International « Enquête Démographique et de
la Santé, Rapport préliminaire »,2012
* 30 SHAVER Theresa et
KINZIE Barbara « antenatal care :old myths, new
realities » presentation at MAG Mini University, WASHINGTON,
DC,2011 April 20th in
www.maqweb.org
* 31 CAMARA Daouda
« Evaluation de la qualité de CPN au CSCO de Bacodjicoroni
en commune »,2008 in
http://www.keneya.net/fmpos/theses/2008/med/pdf/08M217.pdf
* 32 MOHAMED Diarra, 2008,
Op cit.
* 33 CAMARA Daouda, 2008, Op
cit
* 34 MOHAMED Diarra, 2008,
Op cit
* 35 CAMARA Daouda, 2008, Op
cit
| 


