UNIVERSITE DE YAOUNDE II
THE UNIVERSITY OF YAOUNDE II
|
INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU
CAMEROUN
B.P. : 1637 Yaoundé
Tel : 22 31 03 05
Fax : (237) 22 31 89 99
|
|
INTERNATIONAL RELATIONS INSTITUTE OF
CAMEROON
P.O Box: 1637 Yaoundé
Tel: 22 31 03 05
E-Mail: iric@uycdc.unicet.cm
|
LE MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC EN
HAUTE MER
Mémoire préparé et soutenu publiquement en
vue de l'obtention d'un Master II en Relations Internationales,
Option : Contentieux
International
PAR :
ABE SAMBA Sophie Ruth
Sous la Direction et la supervision de :
Pr. Alain Didier OLINGA
Maître de conférences en droit public
Chef de département de Droit International
(IRIC)
DEDICACE
A mes parents qui ont toujours cru en moi et ont
veillé à ce que je dispose du nécessaire pour suivre
sereinement mes études : M. SAMBA Dieudonné et Mme SAMBA
née ZE MBO Ruth.
REMERCIEMENTS
Nous adressons nos sincères remerciements :
- Au Professeur Alain Didier OLINGA,
Chef de département de droit international à l'IRIC, notre
« véritable maitre » académique, pour avoir
accepté de diriger ce travail. Ses conseils, orientations,
recommandations et avis gracieusement prodigués, tant à
l'endroit de l'étudiante que de l'individu, auront largement
contribué à faire de nous le juriste que nous sommes
aujourd'hui. Sa grande rigueur et son exigence scientifique auront
été pour nous tout au long de notre séjour à
l'IRIC des exemples et défis à relever.
- Au Docteur Robert KANGUE EKEUH, enseignant
à l'IRIC, dont l'aide à été déterminante
notre travail de recherche, et dont les conseils ont toujours été
très encourageants.
- A mes soeurs et mon frère qui n'ont jamais
cessé de me soutenir.
- A mes amis et mes camarades de promotion pour les
encouragements et la saine émulation durant nos années
d'étude et même après.
- A tous ceux que je ne peux nommer ici individuellement, et
qui ont tous oeuvré à faciliter notre séjour et nous ont
accompagné tout au long de nos études.
Que tous daignent trouver ici l'expression de notre totale et
infinie gratitude.
LISTE DES ACRONYMES ET DES ABREVIATIONS
AFDI : Annuaire Français de Droit International
AFRI : Annuaire Français des Relations
internationales
AIFM : Autorité Internationales des Fonds
Marins
c/ : contre
CDMT : Centre de Droit Maritime et de Transport
CE : Communauté Européenne
CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme
CIJ : Cour Internationale de justice
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
CNUDM : Convention des Nations Unies sur le Droit de la
Mer
CSNU : Conseil de Sécurité des Nations
Unies
Ed : édition
FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture
JO : Journal Officiel
IDDR : Institut du Développement Durable et
Responsable
IEER : Institut pour la Recherche pour l'Energie et
l'Environnement
INPES : Institut National de Prévention et
d'Education pour la Santé
IRIC : Institut des Relations Internationales du
Cameroun
OCDE : Organisation pour la Coopération et le
Développement Economiques
OIT : Organisation Internationale du Travail
OMI : Organisation Maritime Internationale
OTAN : Organisation du Traité Atlantique Nord
P : page
PUF : Presse Universitaire de France
RGDIP : Revue Générale de Droit
International Public
SDN : Société Des Nations
TIDM : Tribunal International du Droit de la mer
UIT : Union Internationale des
Télécommunications
Vol : volume
ZEE : Zone Economique Exclusive
ZIFM : Zone Internationale des Fonds Marins
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I : REPRESENTATION DES DIFFERENTS ESPACES
MARITIMES
ANNEXE II : EXTRAIT DE LA PARTIE VII DE LA
CNUDM
SOMMAIRE
INTRODUCTION.................................................................................................
1
PREMIERE PARTIE : LA HAUTE MER, UN CADRE PROPICE
A L'ORDRE
PUBLIC...........................................................................................................
13
CHAPITRE I : L'ENVIRONNEMENT DU MAINTIEN DE
L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE
MER................................................................................................................
15
Section I : IDENTIFICATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES
TROUBLES A L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE
MER....................................................................................
15
Section II : LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA GARANTIE DE
L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE
MER.....................................................................................................
26
CHAPITRE II : L'AMENAGEMENT DE LA REPRESSION DES
ATTEINTES A L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE
MER........................................................................................
42
Section I : LES ACTEURS DE LA
REPRESSION.............................................................. 42
Section II: LES MECANISMES DE
REPRESSION........................................................ 53
DEUXIEME PARTIE : EVALUATION DU MAINTIEN DE
L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE
MER..............................................................................................................
63
CHAPITRE III : L'EFFECTIVITE DU MAINTIEN DE
L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE
MER.................................................................................................................
65
Section I : UNE EFFECTIVITE AMOINDRIE PAR DIVERS
OBSTACLES........................... 65
Section II : LE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ET DE LA
SURETE EN HAUTE MER PAR LES INSTITUTIONS
INTERNATIONALES.................................................................
73
CHAPITRE IV : PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE
L'ORDRE PUBIC EN HAUTE
MER.................................................................................................................
80
Section I : L'IMPORTANCE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
EN MATIERE JURIDIQUE ET
TECHNIQUE..................................................................................
80
Section II : LE RENFORCEMENT DE LA COHERENCE DES
POLITIQUES SECTORIELLES DES
ETATS...............................................................................................................
86
CONCLUSION....................................................................................................
95
ANNEXES........................................................................................................
99
BIBLIOGRAPHIE..............................................................................................
100
TABLE DES
MATIERES......................................................................................
118
RESUME
L'institution de la « Charte du droit de la
mer », notamment la Convention des Nations Unies sur le Droit de
la mer de 1982 dite « Convention de Montego Bay », marque
un tournant décisif en ce qui concerne l'ordre public en haute mer. En
effet, la partie VII de la dite Convention encadre juridiquement la haute mer
en instituant des droits et des obligations pour une pleine jouissance des
différentes libertés en haute mer. Par ailleurs, la
réalité du maintien de l'ordre public en haute s'opère
par le biais des organisations internationales chargées de fixer
juridiquement les différents aspects de l'ordre public. Les Etats, quant
à eux, sont les sujets directs et les principaux garants du maintien de
l'ordre public en haute mer. Le travail a pour objectif d'évaluer les
différents mécanismes et modalités du maintien de l'ordre
public en haute mer ainsi que leur efficacité.
Par une triple démarche descriptive, analytique et
comparative, notre étude porte sur l'appréciation de
l'effectivité du maintien de l'ordre public en haute mer. Il en
découle que la haute mer bénéficie d'un environnement
favorable à l'ordre public à travers l'institution, tant au plan
international que national, de deux modalités incontournables au
maintien de l'ordre public en haute mer : la prévention et la
répression.
Par ailleurs, en termes d'efficacité et
d'effectivité, le maintien de l'ordre public en haute mer connaît
certaines limites d'ordre juridique, technique et financier. Il est donc
nécessaire, dans une perspective d'amélioration, d'intensifier la
coopération internationale dans ses différents aspects et
d'envisager la possibilité d'une gouvernance internationale relative en
haute mer ; ceci dans l'objectif de préserver l'environnement
important pour le développement durable.
INTRODUCTION
I- CONTEXTE ET OBJET DE L'ETUDE
La mer renvoie aux étendues d'eau salée, en
communication libre et naturelle, qui couvrent près de trois quart de
la surface de la terre. Face à l'importance que représentent les
différents espaces maritimes, leur règlementation dans un ordre
juridique spécifique a été rendue nécessaire.
Ainsi, des conférences ont été réunies sous
l'égide de la SDN et de l'ONU. En effet, la Conférence de La Haye
de 1930, sur la codification du droit de la mer va aboutir à
l'élaboration d'un Acte final dans lequel les Etats vont
reconnaître les notions de mer territoriale, de zone contigüe et de
droit de poursuite. Aussi, l'entreprise de codification sera reprise par l'ONU.
C'est avec la Conférence de Genève de 1958 que les
plénipotentiaires des Etats adopteront le 24 avril de la même
année quatre conventions internationales. La première porte sur
la mer territoriale et la zone contigüe, la deuxième sur la haute
mer, la troisième est relative à la pêche et la
conservation des ressources biologiques en haute mer et la quatrième au
plateau continental. Les deux premières consacrent le droit coutumier
et indiquent par ailleurs les pouvoirs de l'Etat en fonction des espaces
maritimes. Ainsi, l'Etat exerce une souveraineté absolue sur les eaux
intérieures et sur la mer territoriale. En ce qui concerne la zone
économique exclusive et la haute mer, ces espaces maritimes
échappent en quelque sorte à la souveraineté des
Etats,1(*) ce qui en fait
des espaces internationaux.
On remarque donc qu'au sein des espaces maritimes, il existe
des espaces sous la souveraineté de l'Etat côtier2(*), des espaces sous juridiction et
des espaces internationalisés3(*). Si les espaces maritimes sous souveraineté et
sous juridiction ne posent pas véritablement de problèmes, les
espaces maritimes internationalisés ont un régime particulier
encadré par le principe de liberté qui est cependant
atténué par certaines restrictions imposées aux Etats.
S'agissant de la haute mer, en ce qui concerne son statut juridique, le
principe de liberté était contesté unanimement par les
pays en voie de développement à l'aube de la troisième
Conférence de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer4(*). Ils estimaient que
ce principe avait été imposé par les grandes puissances
maritimes et ne profitait guère qu'à elles, se traduisant en
pratique par une liberté de procéder à la surpêche,
voire de polluer. La Convention de Montego Bay, en plus de réaffirmer
les quatre libertés fondamentales de la haute mer telles que
déclinées en 19585(*), soit celles de navigation, de pêche, de
dépôt de câbles et de pipelines ainsi que de survol, va
rajouter6(*) les
libertés de construire des îles artificielles ainsi que
d'effectuer de la recherche scientifique. L'idée essentielle qui ressort
du principe de liberté en haute mer est celle de l'interdiction de toute
interférence dans la navigation en temps de paix d'un pavillon à
l'égard d'un autre pavillon7(*). La haute mer est ainsi considérée
comme un espace de liberté a-territorialisé8(*). A cet effet, toute la
difficulté consiste dans les possibilités d'action
laissées aux autorités d'un Etat en haute mer. Cette question est
extrêmement importante pour la surveillance maritime et la
répression des trafics illicites.
La haute mer est également une ressource et un espace
indispensable pour l'économie mondiale. La pêche hauturière
bien sûr, mais aussi le transport maritime, la bio prospection, la pose
de câbles de télécommunication, la production de nouvelles
formes d'énergies, la recherche scientifique, l'exploitation
minière et pétrolière constituent de nouveaux enjeux
économiques et environnementaux. Face à la multitude d'enjeux que
représentent les activités menées en haute pour la
communauté internationale, il était primordial pour les acteurs
de droit international de procéder à la règlementation
des différents secteurs d'activités en haute mer mais
également de veiller au respect des différentes mesures de
prévention et de répression de comportements illicites.
II- CLARIFICATION DES CONCEPTS
1- Le maintien
Le maintien peut être défini comme l'action de
faire durer ou de conserver en l'état. On peut ainsi parler de
sauvegarde et de préservation. Dans le cadre de notre étude le
maintien peut être défini comme toutes les mesures mises
en oeuvre afin de prévenir et réprimer toute violation des
règles qui encadrent, organisent et régissent la haute
mer. Le droit international est donc la norme par excellence qui
régit la haute mer. En effet, la haute mer est un espace
internationalisé régi dans la Convention de Montego Bay de 1982
notamment à la partie VII. Les différentes dispositions de cette
partie portent sur des principes, des obligations ainsi que sur des mesures
répressives en cas de violation des dites dispositions.
Par ailleurs, bien que le maintien ait un aspect juridique,
il est important de signaler qu'il faudrait aussi l'associer à l'aspect
matériel de la haute mer notamment son environnement. Ainsi, il peut
être appréhendé sous le prisme de la préservation
et de la conservation en l'état. Le maintien peut aussi être
défini comme l'action de préserver l'environnement de
l'espace de la haute mer. Ainsi on peut assimiler dans ce cadre le
maintien à la notion de développement durable,9(*) évoqué dans le
principe 5 de la Charte de la terre encore appelée Déclaration de
Rio, sur l'Environnement et le Développement. Il y a donc ici un souci
de préservation et de protection de l'environnement de la haute mer.
2- Ordre public
Le concept d'ordre public est un concept interne et externe au
droit : interne quand il définit l'ensemble des règles
régissant l'organisation d'un Etat ; externe quand il
désigne ce qui ne doit pas être troublé sous peine de
mettre à mal l'unité de la société10(*).
L'ordre public peut être défini comme
l'ensemble des principes et des règles régissant le bon
fonctionnement des institutions, la sécurité et la
moralité des citoyens, et auxquelles ces derniers ne peuvent
déroger11(*).
Selon Jean-Pierre QUENEDEC12(*), il existe trois sens de l'ordre public en
mer ; d'abord l'ordre public matériel ayant pour objet de
sauvegarder, recouvrant la salubrité, la sécurité et la
santé publiques. Ensuite, du point de vue de la fonction remplie par la
notion d'ordre public, on fera référence aux règles
d'ordre public13(*) comme
étant des règles auxquelles il est impossible de déroger
et qui peuvent être invoquées par l'office du juge.
Enfin, la notion d'ordre public est parfois assimilée
à celle d'ordre juridique comme on l'a constaté dans le
préambule de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de
1982, qui fait référence à « un ordre
juridique pour les mers et les océans ». En ce qui
concerne le domaine de la mer, la notion d'ordre public doit être
adaptée aux nouvelles exigences d'ordre public en mer14(*) : la
sécurité de l'espace maritime, la salubrité (la protection
de l'environnement marin) et la tranquillité publique.
Au regard de ce qui précède, l'ordre public
peut être appréhendé comme l'ensemble des
règles juridiques nécessaires à l'organisation et au
fonctionnement de la société, et auxquelles nul ne peut
déroger. Par ailleurs dans le cadre du droit de la mer, plus
précisément dans la haute mer, on parlera d'ordre public
international15(*). La notion d'ordre public ne peut être
appréhendée négativement comme une obligation ; il
n'existe pas une opposition entre ordre public et liberté. L'ordre
public s'entend ici comme l'ensemble de mesures visant à faciliter et
favoriser le plein exercice des différentes libertés en haute
mer.
3- Haute mer
La haute mer est généralement définie
comme une « zone marine qui, en principe, échappe à
toute souveraineté16(*) ». Juridiquement, la haute mer est
définie de manière par les textes internationaux notamment la
Convention de Genève sur la Haute Mer de 1958 et la Convention de
Montego Bay de 1982.
En effet, ces deux textes procèdent par exclusion en
définissant la haute mer. Par ailleurs, la Convention de Genève
sur la haute mer de 1958, définit la haute mer comme toutes les
parties de la mer n'appartenant pas à la mer territoriale ou aux eaux
intérieures d'un Etat. D'autre part, la Convention de Montego
Bay, signée le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur le
16 novembre 1994, reprend cette définition et y ajoute d'autres
éléments d'exclusion. Ainsi, l'article 86 définit la haute
mer comme toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone
économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures
d'un Etat, ni dans les eaux archipélagiques d'un Etat archipel. De
manière plus précise, la haute mer correspond à l'espace
maritime situé au-delà de 200 miles marins. Cet espace
échappe ainsi à la souveraineté des Etats et est donc
considéré comme un espace maritime international. La haute mer
est ainsi aujourd'hui un « espace international libre17(*) ».
III- INTERET DU SUJET
Le sujet présente un intérêt sur trois
plans :
- Sur le plan scientifique, s'il paraît
plus aisé de maîtriser les principes et les règles de droit
international en ce qui concerne l'ordre public, on dénote
particulièrement dans le cadre de la haute mer la difficulté de
concilier les notions « d'intérêt commun » et
le principe de liberté. Il est donc important, dans le cadre du maintien
de l'ordre public en haute mer, de prendre des mesures adéquates qui
satisfont aux différents intérêts que représente cet
espace tant pour la communauté internationale que pour l'humanité
toute entière.
- Sur le plan écologique, le maintien
de l'ordre public assure l'intégrité et la préservation
du milieu marin, notamment en cas de surexploitation des ressources biologiques
et de l'exploitation pétrolière et gazière,
dégradant ainsi l'environnement de la haute mer. Dans le but de
satisfaire aux différentes exigences du développement durable, il
serait primordial de veiller au respect de l'ordre public en haute mer, car
l'océan joue un rôle de régulateur dans le climat de la
planète : il intervient au premier plan dans les scénarios de
changement climatique, dont les conséquences peuvent être
catastrophiques pour certaines populations riveraines ou insulaires.
- Sur le plan personnel, le but visé
est de traité un sujet prompt à nous faire maîtriser les
rudiments du droit de la mer en général. En particulier le sujet
permet d'analyser les différents mécanismes et
spécificités liées à la haute mer qui ne sont
pas très connues et abordées par les pays en voie de
développement du fait du manque de capacité et de moyens.
L'étude consiste également en l'édification sur les
différents intérêts d'ordre économique et technique
que procure la haute mer. La satisfaction d'une telle ambition n'aura pour
conséquence, que de nous offrir d'authentiques opportunités
professionnelles, dans le domaine de plus en plus porteur du droit de la mer
pour les pays en voie de développement de l'Afrique.
IV- Revue de la littérature
La revue de littérature porte sur quatre ouvrages qui
ont l'objet d'une attention particulière.
Le premier ouvrage s'intitule Que reste-t-il de la
liberté de la pêche en haute mer ? de
Magali Le Hardy18(*). Cet ouvrage est un essai sur le régime
juridique de l'exploitation des ressources biologiques en haute mer. Pour
échapper au cercle vicieux de l'overfishing, les Etats exploitant les
ressources marines doivent prendre des mesures de conservation
règlementant l'exploitation et permettant de préserver le
patrimoine halieutique. Cependant, l'auteur mentionne que la rationalité
économique impose aux Etats d'assurer la rentabilisation des
investissements effectués sur leurs flots de pêche. Les conflits
entre les Etats à propos de l'opportunité et de l'organisation
des limitations de la pêche entrainent l'aménagement des
ressources biologiques de la haute mer, qui se traduit par deux objectifs
notamment la conservation des espèces et l'organisation des
pêcheries. Ainsi la conservation des espèces donne lieu à
de nombreuses difficultés, en raison des enjeux économiques qui
opposent les différents Etats qui les exploitent. A l'opposé,
précise l'auteur, ces Etats ont réussi à développer
en commun les moyens permettant d'améliorer la mise en valeur
économiques des ressources, notamment l'amélioration des
méthodes d'exploitation et l'organisation de l'aménagement. Il se
penche également sur le problème des adaptations du principe de
la liberté de la pêche en haute mer. Ainsi il précise que,
bien que ce principe se soit maintenu, ses conditions d'exercice ont
été rendus plus strictes suite à l'évolution de ses
fondements. De plus, les adaptations à ce principe s'expliquent par
l'influence des extensions juridiques sur la notion de haute mer, à
l'instar des extensions de compétences étatiques en haute mer et
les effets de restriction de haute mer sur la gestion des ressources marines.
Le Hardy analyse l'affrontement des politiques étatiques
d'appropriation qui s'explique par la protection limitée des ressources
en vue de leur appropriation par les Etats pêcheurs. En effet, l'auteur
dénote une efficacité relative des régimes de
rentabilisation de l'exploitation, ceci dû aux critères limitatifs
de la rentabilisation des pêcheries et aux limites de la conservation par
les commissions d'aménagement. Parlant de l'effectivité
limitée des régimes de conciliation des intérêts des
exploitants, il l'explique par l'absence de valeur contraignante des
décisions et par l'absence de contrôle efficace. Ensuite, il
dénonce les tentatives d'appropriation de certains Etats côtiers.
D'une part, il note les tentatives unilatérales d'établissement,
par l'Etat côtier, de compétences spéciales sur les stocks
chevauchants. D'autre part, l'auteur évoque les tentatives
régionales d'établissement, par les Etas côtiers, de
compétences de gestion sur les stocks chevauchants, avec l'appropriation
reconnue par le droit international au titre de la souveraineté de ces
Etats sur leurs ressources naturelles et les tentatives d'appropriation aux
travers d'organisations internationales et régionales.
Le second ouvrage est de René RODIERE
et de Martine Remond GOUILLOUD19(*) et s'intitule La
mer droits des hommes ou proie des Etats ? Parlant des
devoirs et intérêts des Etats, les auteurs mentionnent que l'Etat
joue un rôle croissant dans le Monde maritime qui relève de deux
impératifs. D'une part, il fait de la mer et de ses richesses l'objet de
ses convoitises. Le navire est donc investi du pouvoir de prendre les moyens
de sauvegarde propres à éviter ou à limiter les effets
d'une pollution de la mer. D'autre part, lorsque le navire nationalisé
est chargé de pêcher plus loin des côtes, il accomplit une
mission commerciale. Les auteurs examinent également la notion
d'assistance classique en établissant la différence entre la
notion d'assistance et les cas de fausse assistance. En effet, l'assistance
classique y est définie comme l'aide qu'un navire apporte à un
autre navire en danger de se perdre. Néanmoins, ils précisent
qu'on parle de fausse assistance lorsqu'il s'agit de l'aide qu'un navire
apporte à un autre navire qui ne l'a pas demandé encore qu'il
soit en danger de se perdre. Ensuite ils évoquent le cas du secours
moral et intellectuel qui peut être apporté en cas de
difficulté ; et enfin l'aide matérielle apportée
à un navire qui n'est pas en difficulté mais qui menace d'autres
intérêts que ceux de l'expédition dont il est le noyau. De
plus, une attention particulière est accordée à
l'intervention des Etats en haute mer. En effet, on estimait couramment que
l'Etat n'avait pas à intervenir uniquement à titre gracieux. Ceci
s'explique par le fait que les Etats exerçaient leurs
souverainetés uniquement sur leurs eaux territoriales. Cependant, les
catastrophes écologiques ont démontré que l'intervention
des Etas n'est plus l'affaire des intéressés directs et
immédiats20(*). Les
auteurs s'attardent également sur le problème de la pollution en
mer avec la présence en mer des pétroliers, qui a engagé
la conscience internationale, ce qui a abouti à la signature de la
Convention de Bruxelles de1969. Cette Convention a permis aux signataires de
s'autoriser réciproquement à prendre, à propos de la haute
mer, des mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou
éliminer les dangers graves et imminents, que représente la
pollution pour leurs côtes ou pour leurs intérêts
connexes.
Le troisième ouvrage est un mémoire
est rédigé par Anne-Claire Du MOUCHEL 21(*)et porte sur Les
atteintes à la sûreté en haute mer. D'abord,
l'auteur s'est appesanti sur la prévention de ces atteintes qui
s'opère au niveau terrestre avec une importance accordée
à la sûreté dans la zone portuaire. S'agissant de cette
zone, l'auteur précise que la sûreté passe par celle des
ports et des installations, par la sûreté de la marchandise et par
la sûreté humaine avec le contrôle des accès et celui
de l'identité des personnes. Ensuite, il y est mentionné
l'importance du rôle de l'Etat dans la prévention terrestre de ces
atteintes et qui s'articule autour de sa législation, notamment le
respect du droit international et la mise en place des dispositifs nationaux.
En ce qui concerne la prévention maritime, elle implique la
prévention à bord des navires avec le plan de sûreté
du navire, le recours aux sociétés de sécurité
privée, mais aussi avec la formation de l'équipage et de
l'équipement du navire. La prévention sur la zone maritime porte
également sur la surveillance totale qui s'avère impossible,
d'où la nécessité du rôle fondamental du
renseignement, le déroulement et le débat relancé sur la
guerre de course. L'auteur accorde une importance particulière aux
interventions contre les atteintes à la sûreté en haute
mer. A ce sujet, elle souligne que la variabilité des techniques
d'intervention s'explique par les fondements22(*) de la convention UNCLOS23(*) et par les fondements non
envisagés par cette Convention, notamment le terrorisme maritime,
l'immigration clandestine, la traite des êtres humains et la controverse
de la légitime défense. L'auteur précise que la
juridiction est incertaine en ce qui concerne la répression de la
piraterie ; ceci s'explique par l'absence de textes spécifiques
à cet effet. Par ailleurs, l'auteur examine les modalités
d'intervention qui sont de plusieurs ordres, notamment les techniques
d'intervention à bord du navire et l'intervention en mer avec l'escorte
et l'accompagnement des navires de guerre, la poursuite et la destruction du
navire. Enfin, l'auteur se penche sur la répression des atteintes
à la sûreté en haute mer qui s'effectue en droit
international avec la compétence de principe de la loi de l'Etat du
pavillon, néanmoins atténuée par le principe de la
compétence universelle, la concurrence des droits nationaux, les
compétences qui sont dites « bilatérales »
et « multilatérales. Cette répression s'effectue
également dans les droits nationaux à l'exemple du droit
français, avec le rôle de sa juridiction et le champ d'application
de la loi française à raison du droit français et des
conventions internationales. De même, l'auteur analyse l'action de la
juridiction française dans la lutte contre ces atteintes qui s'est
affirmée dans la répression du terrorisme, le trafic de
stupéfiants, l'immigration illégale et la traite des êtres
humains et le trafic d'ADM24(*).
Le Pr BEURIER, dans un article intitulé25(*) « La
police de la conservation des ressources vivantes de la haute mer,
problème d'actualité », fait l'analyse de
l'évolution de la fonction de la police des Organisations
Internationales de Pêches. Selon lui, la police des navires de
pêche en haute mer a fait son apparition vers la fin du XIXème
sicle avec la convention de la Haye du 16 novembre 1887. Cette police avait
pour fonction de lutter contre la vente des spiritueux des navires de
pêche en mer du Nord. La police de conservation des ressources vivantes
de la haute mer, quant à elle, a été instituée par
les Organisations Internationales de Pêches. Le pouvoir de police
comprenait donc la surveillance, le contrôle et parfois l'exercice de la
contrainte sur les navires de pêches. L'auteur s'attarde
également sur la place importante qu'occupent les inspecteurs en
matière de contrôle de l'application des résolutions prises
par les organisations internationales de pêches.
Par ailleurs, le Pr BEURIER s'appesanti sur les
différentes motivations des revendications des Etats côtiers en
matière de contrôle des pêcheries au large de leur
territoire. D'après lui, la raréfaction des ressources due
à la surpêche et la surcapacité des flottilles ; le
gaspillage généralisé des ressources libres
d'accès poussent les Etats côtiers à revendiquer des
juridictions rampantes de ces Etats. Ces Etats côtiers se fondent sur
l'article 63 alinéa 2 de la CNUDM pour revendiquer le droit de
contrôler l'exploitation des stocks de poissons lors de leur migration en
haute mer.
V- DELIMITATION DU SUJET
1- Délimitation
matérielle
Le travail porte principalement sur l'ordre public
international précisément sur les règles régissant
l'organisation et le bon fonctionnement des activités menées en
haute mer. Ainsi, une analyse particulière des différentes normes
internationales que nationales en matière de prévention et de
répression des actes portant atteinte à l'ordre public en haute
mer est consacrée. Par ailleurs, nous étudierons les
différents moyens et techniques du maintien de l'ordre public en haute
mer. Ces différentes phases permettent d'apprécier
l'effectivité et l'efficacité du maintien de cet ordre.
2- Délimitation spatiale
Seule l'espace maritime de la haute mer fera l'objet de notre
étude. Ainsi, l'étude sera limitée aux différentes
régions géographiques internationales abritant les espaces de
haute mer.
3- Délimitation temporelle
Le travail porte sur une analyse de l'évolution dans le
temps du maintien de l'ordre public en haute mer. Il est question dans cette
étude de s'appesantir sur les différentes actualités dans
le domaine de la prévention et de la répression en haute mer.
VI- PROBLEMATIQUE
Face à la diversité, à la contradiction
et la complexification des règles régissant l'espace de la haute
mer, on se pose très souvent des questions en ce qui concerne leur
effectivité et leur réalité. En effet la
multiplicité des conventions internationales dans la
règlementation de cet espace maritime, ainsi que la pluralité des
organisations tant internationales que régionales en la matière
laissent certains très sceptiques en ce qui concerne l'ordre public en
haute mer. La principale question qui se pose est la suivante : Quel
état peut-on faire du maintien de l'ordre public en haute mer ? En
d'autres termes, quelle analyse peut-on faire à propos de
l'effectivité du maintien de l'ordre public en haute mer ? Telles
sont donc les questions que soulève la problématique du maintien
de l'ordre public en haute mer et qui nous permettront d'analyser les
différentes atteintes à l'ordre public, ainsi que les dispositifs
de prévention et de répression des troubles à la
sécurité, à la tranquillité et à la
salubrité de la haute mer. De même, nous nous intéresserons
à leur effectivité et à leur efficacité.
VII- HYPOTHESE
Notre hypothèse est que le maintien de l'ordre public
est bien réel. En effet, le maintien de l'ordre public s'opère
à travers des règles édictées tant dans les
conventions internationales que dans des organisations internationales. A cet,
effet, il est imposé, dans certaines mesures, aux Etats de prendre des
dispositions afin de respecter et d'appliquer les règles liées
à l'espace maritime. Ces règles interviennent sur le plan
économique avec la règlementation de la pêche en ce qui
concerne l'exploitation des ressources biologiques, ainsi que sur le plan de
l'exploitation des ressources pétrolières et gazières.
Aussi, des règles sont édictées en matière
environnementale en ce qui concerne la pollution, les accidents en mer et la
conservation des ressources biologiques. Des règles sont
également élaborées pour réprimer les comportements
illicites.
Par ailleurs, il faudrait noter qu'une place
particulière est accordée à la sûreté et
à la sécurité qui sont des notions découlant de
l'ordre public en mer. Ainsi, il existe bel et bien des dispositifs de
sécurité et de sûreté élaborés et mis
en place à cette fin. De plus, nous remarquons que même si les
organisations internationales sont considérées comme acteurs
principaux dans le maintien de l'ordre public, les Etats y participent
également, dans la mesure où ils sont prédisposés
à appliquer les normes juridiques internationales dans leurs ordres
juridiques et dans leurs politiques.
Cependant, le maintien de l'ordre public en haute mer est
limitée dans son efficacité et dans sont effectivité. Ceci
peut s'expliquer par des obstacles d'ordre national et d'ordre international.
VIII- METHODE DE TRAVAIL
1- Méthode collecte des
données
La collecte de données porte uniquement sur la
recherche documentaire. La recherche documentaire26(*) consiste à trouver des
documents mais aussi de les consulter physiquement, ou tout au moins sur le
net, afin de s'intéresser à ceux qui fournissent des informations
pertinentes en relation avec notre sujet d'étude.
2- La méthode d'analyse
théorique
Pour ce qui est de l'analyse théorique, elle
s'appuiera sur la méthode juridique traditionnelle, la dogmatique
juridique, définie comme le type de recherche juridique qui ne prend en
compte que la juridicité par le droit positif et permet également
d'établir la conformité de la situation juridique à
l'ordre international. L'analyse nous permettra de recueillir et agencer les
données juridiques, et d'interpréter le droit international.
IX- ESQUISSE DE PLAN
L'approche de l'étude sera tout au long de son
cheminement une présentation, une description et une analyse du maintien
de l'ordre public en haute mer. Ainsi, la première partie porte sur les
principales modalités du maintien de l'ordre public en haute mer
notamment la prévention et la répression. La deuxième
partie consiste en une analyse de l'effectivité du maintien de cet
ordre et des perspectives d'amélioration.
PREMIERE PARTIE : LA HAUTE MER, UN CADRE PROPICE
A L'ORDRE PUBLIC
La haute mer est un espace règlementé tant par
les organisations internationales que par les Etats. Ceci s'explique par le
statut de la haute mer qui est considérée comme le patrimoine
commun de l'humanité ; par conséquent cet espace est
affecté à des fins pacifiques27(*). La communauté internationale a donc
élaboré des normes instituant des droits et des obligations
à l'encontre de toute personne (physique ou morale) qui serait
amenée à user de cet espace maritime international à des
fins déterminées par le droit international. L'analyse de
l'environnement du maintien de l'ordre public (Chapitre I)
est donc nécessaire ; dans la mesure où cet
environnement participe non seulement à la prévention de toute
sorte d'infraction liée à cet espace, mais aussi à
l'instauration de la sécurité publique, la tranquillité
publique et la salubrité publique.
Relevons par ailleurs que bon nombre d'infractions
constituent des troubles aux différents éléments de
l'ordre public en haute mer. La communauté internationale a donc mis
sur pied des mécanismes de répression pour faire face à
ces différents troubles. De plus, face aux nouveaux défis
environnementaux que représente la haute mer, il a été
institué un certain ordre public écologique afin de pallier aux
différentes conséquences négatives liées à
la mauvaise utilisation de la haute mer, et qui entraine la dégradation
de cet espace. L'aménagement de la répression des atteintes
à l'ordre public en haute mer apparaît donc comme une
modalité indispensable (Chapitre II).
CHAPITRE I : L'ENVIRONNEMENT DU MAINTIEN DE L'ORDRE
PUBLIC EN HAUTE MER
La prévention, comme modalité de l'ordre public,
se matérialise par l'encadrement de la haute mer par des règles
qui peuvent être d'ordre international, communautaire et national. Bien
que cet encadrement ait pour principal fondement l'instauration de l'ordre, il
s'explique aussi par le souci de prévenir les infractions qui
constituent des troubles à cet ordre. Ainsi, il convient avant tout de
s'appesantir sur les différentes atteintes à travers
l'identification des éléments de trouble à l'ordre public
en haute mer (Section I).
D'autre part, il convient de noter que plusieurs acteurs
participent dans l'encadrement normatif de l'ordre public en haute mer, dans le
but de règlementer tous les secteurs d'activités de la haute
mer, et en matière environnementale. Nous nous étendrons de ce
fait sur ces différents acteurs qui participent à la garantie de
l'ordre public en haute mer (Section II).
SECTION I : IDENTIFICATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS
DE TROUBLES A L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE MER
Les échanges internationaux sont le moteur de la
mondialisation. Or, prés de 90 % des échanges commerciaux
s'effectuent par voie maritime en raison de la faiblesse du coût du
transport maritime et de l'a-territorialisation de la haute mer28(*). En effet, la haute mer
représente un espace propice aux échanges maritimes
internationaux qui représentent 75% des échanges mondiaux et 90%
des échanges hors Union Européenne. En outre elle fournit une
variété de ressources tant biologiques que minières,
favorisant ainsi le développement de plusieurs secteurs
d'activités économiques. De ce fait, il existe une grande
juxtaposition des activités difficiles à gérer et
à surveiller. Ces activités sont source de richesses et donc
propices au développement d'activités criminelles29(*). Non seulement la haute mer
est d'une importance particulière dans le cadre du transport, notamment
le transport des personnes, mais aussi une source énergétique.
Par ailleurs, on dénote d'une part plusieurs atteintes
à la sûreté et à la sécurité dans
les différents secteurs d'activités, et d'autre part des
infractions qui portent atteinte à l'environnement physique de la
haute mer. Il convient donc d'étudier les différentes infractions
dans le domaine de la navigation (Paragraphe I) et dans les
domaines des activités économiques et de l'environnement
(paragraphe II).
PARAGRAPHE I : DANS LE DOMAINE DE LA NAVIGATION
Dans le domaine de la navigation en haute mer, plusieurs types
d'infractions affectent, de près ou de loin, les navires, les
équipages, les marchandises et les passagers. De même, certaines
infractions sont commises par des navires se livrant à des
activités illicites. Il est donc important de classer ces infractions
dans plusieurs activités : les activités illicites
effectuées par les navires (A), et les
activités portant atteinte à la sûreté des voies
maritimes (B).
A- Les activités illicites effectuées par
les navires
Il peut s'agir d'activités commises par des navires
conformes aux normes de droit international, c'est-à-dire des navires
immatriculés, conformément aux articles 91 et 92 de la CNUDM de
198230(*). Par ailleurs on
remarque très souvent que les navires non immatriculés,
notamment ceux n'ayant aucun lien matériel avec un Etat, sont les
auteurs d'activités illicites en haute mer. Ces infractions constituent
des atteintes à la sûreté en haute mer. La
sûreté en haute mer peut être définie comme la
prévention et la lutte contre tout acte illicite (terrorisme,
malveillance) à l'encontre du navire, de son équipage et de ses
passagers31(*).
L'étude des infractions telles que le trafic de
stupéfiants et de substances psychotropes (1), le
trafic d'esclaves et l'immigration clandestine (2), les
émissions non autorisées (3), le transport
d'armes de destruction massive (ADM) (4) est primordiale.
1) Le trafic de stupéfiants et de substances
psychotropes
Un stupéfiant est une substance nocive
figurant sur la liste des stupéfiants annexée à la
convention de 196132(*).
Il s'agit entre autres de l'opium, morphine, héroïne,
méthadone, codéine, cocaïne, cannabis... Les
substances psychotropes comprennent des molécules
synthétisées par les industries chimiques et
pharmaceutiques33(*). Ces
substances sont soumises à un contrôle international en raison de
leur potentiel d'abus, de dépendance et de leur nocivité pour la
santé publique et le bien-être social34(*). Ces substances sont donc
prohibées tant au plan international35(*) qu'au plan national. Il existe une diversité
de ces substances ; néanmoins, seuls quatre drogues ont un impact
mondial et intéressent les réseaux nationaux et internationaux :
l'héroïne, la cocaïne, les amphétamines et le
cannabis.
Ce type de trafic permet aux trafiquants de transporter une
grande quantité de drogue en courant des risques relativement
réduits36(*). En
effet, le trafic maritime fait intervenir deux opérations
distinctes37(*): le trafic
par conteneurs et le trafic au moyen de navires aménagés de
manière à pouvoir dissimuler de la drogue. Dans le premier cas,
le trafic se fait généralement à l'insu de l'armateur, du
capitaine et de l'équipage, tandis que dans le second, ces derniers
participent activement.
Par ailleurs, il existe un autre type de trafic intimement
lié aux personnes physiques qui s'opère également dans le
domaine de la navigation. Il s'agit notamment du trafic d'esclaves et
l'immigration clandestine.
2) Le trafic d'esclaves et l'immigration
clandestine
Il s'agit non seulement de deux atteintes aux droits de
l'Homme, mais également à la sûreté et à la
sécurité maritime. L'interdiction du transport des esclaves par
mer a été confirmée par l'article 25 de l'Acte
anti-esclavagiste de Bruxelles du 2 juillet 1890. L'article 99 de la CNUDM
réaffirme l'interdiction du trafic d'esclaves. De ce fait, tout Etat
prend des mesures efficaces pour prévenir et réprimer le
transport d'esclaves par les navires autorisés à battre son
pavillon, et pour prévenir l'usurpation de son pavillon à cette
fin.
De nombreux incidents ont été
répertoriés ces 30 dernières années, causant
jusqu'à la mort de plusieurs centaines de personnes, et attirant ainsi
l'attention de la communauté internationale sur le problème.
C'est vers la fin des années 70, notamment avec le
phénomène dramatique boat people, que l'immigration
clandestine prend toute son ampleur. En effet, plusieurs migrants qui fuyaient
leurs pays pour des raisons économiques ou politiques ont mis leur vie
en péril jusqu'à la perdre en empruntant des embarcations de
fortune en mauvais état, où ils étaient entassés
par centaines.
L'immigration clandestine peut être
appréhendée sous deux axes : d'une part, elle est le fait de
passagers clandestins qui se cachent dans les navires ; d'autre part elle
est le fait de passeurs qui transportent des migrants sur des embarcations de
fortune moyennant de grosses sommes d'argent. L'immigration clandestine
représente un danger pour la vie des clandestins,38(*) du fait non seulement de la
dangerosité des embarcations empruntées (petites embarcations,
navires n'étant pas en mesure de naviguer...), mais aussi du fait des
cachettes à bord des navires.
3) Les émissions non
autorisées
L'article 109 de la CNUDM, notamment en son alinéa 2,
définit les émissions non autorisées depuis la haute mer
comme les émissions de radio ou de télévision
diffusées à l'intention du grand public depuis un navire ou une
installation en haute mer, en violation des règlements internationaux,
à l'exclusion de la transmission des appels de détresse.
Les émissions des stations de radiodiffusion et de
station de télévision s'effectuent en dehors de la
règlementation internationale et perturbent de ce fait les services de
radionavigation39(*). Ces
stations sont appelées des « stations- pirates »,
leur établissement en haute mer leur permet d'échapper aux
législations nationales sur les télécommunications, sur la
publicité et sur le monopole de la radio diffusion.
Par ailleurs ces stations opèrent à partir des
longueurs d'ondes qui ont déjà été
attribuées par le Comité International de répartition de
fréquences de l'U.I.T, par les organisations régionales de
télécommunications, ou les Etats Membres et Associés de
l'U.I.T40(*). Ces
émissions non autorisées sont dirigées vers divers
services de télécommunications nationaux et internationaux.
Enfin, il importe de s'intéresser au transport d'ADM
comme infraction portant atteinte à la sûreté et à
la sécurité de la navigation en haute mer.
4) Le transport d'armes de destruction
massive
Rien dans la CNUDM n'interdit explicitement le transit des
ADM, ni ne donne aux Etats le droit d'interdire un tel transit41(*). Les partisans du
désarmement nucléaire et de la non-prolifération ont fait
valoir l'argument que le transit des armes nucléaires devrait être
interdit, au même titre que le transit des esclaves et des
stupéfiants en évoquant la confirmation par la Cour
internationale de justice42(*) que le transit de ces armes se ferait donc en
violation de l'Article 301 de la CNUDM43(*).
D'ailleurs, de nombreux incidents ont eu lieu au titre
desquels l'interception du BBC China, navire allemand à
destination de la Lybie, en octobre 2003. Ce navire transportait du
matériel nucléaire nécessaire à la construction
d'une centrifugeuse afin d'enrichir le pays de l'uranium. Cette activité
a révélé l'existence, l'ampleur et la portée du
plus grand réseau clandestin de prolifération nucléaire.
De plus, un démantèlement a été
opéré en 2007 notamment celui d'un marché noir de vente
d'uranium hautement enrichi, entre l'Iran et une société
britannique, le Soudan servant de relais. Ces faits marquent la
nécessité d'intervenir et de ne pas laisser faire se
développer un tel trafic.
L'analyse des phénomènes de piraterie et de
terrorisme dans la mesure où ils représentent des dangers en
matière de sécurité des voies maritimes.
B- Les activités portant atteinte à la
sûreté des voies maritimes
Ces activités constituent des obstacles au transport
maritime, dans la mesure où elles sont des obstacles à la
circulation internationale, affectant ainsi l'économie mondiale du fait
de la capture des marchandises. Aussi, elles sont des menaces pour la
sécurité et la paix internationales. Nous étudierons tour
à tour la piraterie (1) et le terrorisme maritime
(2).
1) La piraterie
La CNUDM, en son article 101, définit la piraterie
comme « tout acte illicite de violence, de
détention, de déprédation commis par l'équipage ou
des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant
à des fins privées. L'acte illicite qu'est la piraterie est
dirigé contre un autre navire ou aéronef, contre des personnes
ou des biens à leur bord. Cet acte illicite peut aussi être
dirigé en haute mer contre des personnes ou des biens, dans un lieu ne
relevant de la juridiction d'aucun Etat ». Par
ailleurs, une distinction doit être faite entre la piraterie et les
autres activités proches. En effet, la piraterie ne concerne que la
haute mer. Si des actes similaires sont commis en dehors, il s'agit de
brigandage soumis dès lors à la compétence de l'Etat ayant
juridiction sur ces eaux44(*). De plus, la piraterie est aussi à distinguer
de l'activité corsaire45(*) où le pirate agit sous mandat du gouvernement
en temps de guerre.
Aujourd'hui, on assiste à une nouvelle forme de
piraterie qui consiste en un groupe organisé, hiérarchisé,
avec une connaissance des dernières technologies en matière de
repérage maritime, des informateurs dans le monde, des armes puissantes,
et des bases à terre sur des territoires de non-droit46(*).
Les pirates ne se limitent plus, à l'heure actuelle,
à piller les marchandises et les effets personnels contenus sur les
navires, vont même jusqu'à tuer tout l'équipage pour
revendre la marchandise et se servir du navire détourné pour
faire transiter en toute impunité une marchandise qui sera
détournée à nouveau, et ainsi de suite. Selon les chiffres
de l'IMB PRC47(*), 293
attaques ont été recensées en 2008. Les prises d'otages
très fréquentes témoignent du danger que courent les gens
de mer à naviguer sur les eaux à risque.
La piraterie est cependant à distinguer du terrorisme.
En effet, certaines similitudes sont constatées entre ces deux formes de
violence en mer, et pourtant un critère les sépare.
2) Le terrorisme maritime
Le terrorisme maritime se distingue de la piraterie dans la
mesure où le terrorisme a pour finalité d'attirer l'attention de
l'opinion publique internationale sur une cause politique, publique ou
idéologique, bien qu'il constitue un acte illicite de prise d'un navire
par la violence. Le pirate quant à lui est en premier lieu motivé
par l'appât du gain. Il convient de noter qu'il n'existe ni
définition reconnue du terrorisme, ni convention portant sur le
terrorisme maritime. Cependant la définition du dictionnaire Larousse
peut être retenue : « ensemble d'actes de
violence (attentats, prises d'otages, etc...) commis par une organisation ou un
groupe d'individus, agissant pour son propre compte ou pour celui d'un Etat, en
vue de créer un climat d'insécurité, d'exercer un chantage
sur un gouvernement ou une organisation internationale, afin de satisfaire une
haine à l'égard d'une communauté, d'un
système ».
La principale caractéristique du terrorisme, et qui se
vérifie en mer, est qu'il fait beaucoup de dégâts avec peu
de moyens, dans une logique de « minimisation du rapport
coût-efficacité »48(*).
Il existe trois modes d'actions terroristes49(*) :
- l'attentat contre les navires qui peut être
effectué de la même manière que le font les
pirates50(*) ;
- l'utilisation d'un navire civil comme arme ;
- l'utilisation d'un navire civil pour une action terroriste
dans un territoire donné.
Les cibles des terroristes ne sont pas choisies pour ce
qu'elles représentent, mais pour leur impact psychologique ou
économique51(*). En
ciblant le commerce maritime, les terroristes agissent sur la circulation
mondiale52(*) et par
là même s'attaquent aux intérêts humains et
économiques de l'Etat lui même. Les cibles potentielles,
c'est-à-dire les plus « intéressantes » pour les
terroristes, sont essentiellement les transporteurs de matières
dangereuses : propaniers, butaniers, méthaniers, pétroliers.
Ceci a pu être vérifié par des
nombreuses attaques terroristes en haute mer, bien que ces attaques soient
rares. Ainsi, le 24 avril 2004 deux plates formes pétrolières
irakiennes (attentat contre les terminaux offshore de Bassorah le 24 avril
(2004) ; et algériennes (attentat de Dellys de décembre 2005).
Il existe d'autres types d'infractions qui sont des menaces
non seulement pour le développement durable, mais aussi pour
l'environnement. Ces infractions portent atteinte à un nouveau type
d'ordre découlant de l'ordre public, notamment l'ordre public
écologique.
PARAGRAPHE II : DANS LE DOMAINE DE LA PECHE ET DE
L'ENVIRONNEMENT
Dans ce cadre, il s'agit d'infractions propres à
différentes activités en haute mer notamment la pêche,
l'exploitation des ressources minières, ou la recherche scientifique.
Ces infractions ont un grand impact tant au niveau de l'économie
mondiale qu'au niveau de l'environnement, dans la mesure où elles sont
des obstacles au développement durable. Une attention
particulière est centrée d'une part sur les infractions
résultant des activités de pêche (A) et
d'autre part sur le phénomène de la pollution
(B).
A- Les infractions issues des activités de
pêche
Selon l'article 116 de la CNUDM, tous les
Etats ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer
sous réserve de leurs obligations conventionnelles et des principes du
droit international. Néanmoins, de plus en plus des
phénomènes tels que la pêche illicite, non
déclarée et non règlementée (INN)
(1) et la surpêche (2) se
développent.
1) La pêche illicite, non déclarée
et non règlementée
Ce type de pêche est favorisée par la
capacité de pêche excédentaire des flottes, le versement de
subventions par les gouvernements (qui maintiennent ou augmentent la
capacité de pêche) et l'inefficacité du suivi, du
contrôle et de la surveillance53(*).
La pêche illicite peut être
définie 54(*),en ce
qui concerne la haute mer, sous deux angles : d'une part, il s'agit
d'activités de pêche effectuées par des navires battant
pavillon d'États membres d'une organisation régionale de gestion
des pêches compétente, mais qui contreviennent aux mesures de
conservation et de gestion adoptées par cette organisation. D'autre part
elle s'entend comme les activités de pêche effectuées par
des navires contrevenant aux lois nationales ou aux obligations
internationales, y compris celles contractées par les États
coopérant avec une organisation régionale de gestion des
pêches.
La pêche non déclarée est
définie comme toute activité de pêche entreprise dans la
zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des
pêches compétente, qui n'a pas été
déclarée ou l'a été de façon fallacieuse,
contrevenant ainsi aux procédures de déclaration de cette
organisation.
Par pêche non
règlementée, on entend55(*) les activités de pêche qui sont
menées par des navires sans nationalité, par des navires battant
pavillon d'un Etat non partie à une organisation régionale de
gestion des pêches donnée, ou par une entité de
pêche. Ces activités sont menées d'une façon non
conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette
organisation.
En outre, la pêche INN provoque des effets
néfastes sur la situation économique et sociale de ceux qui sont
impliqués dans la pêche légale. Elle fausse la concurrence
pour les pêcheurs qui opèrent légalement et diminue la
motivation à jouer selon les règles; contribue à
l'épuisement des stocks de poissons dans le monde entier et compromet
les efforts visant à sécuriser et reconstruire les stocks pour
l'avenir; enfin, elle détruit les habitats marins au moyen du
phénomène de surpêche.
2) La surpêche
La surpêche consiste en une production trop
intensive qui nuirait au maintien de l'écosystème marin et
à la reproduction des espèces56(*). La pêche industrielle est très
souvent à l'origine de la surpêche. En effet, face à
l'épuisement des ressources mondiales, les captures diminuent depuis
1989, les pêcheries industrielles se tournent maintenant vers des
poissons des profondeurs (comme les Français avec l'Empereur, poisson
mal connu à croissance très lente et probablement
déjà menacé ; ou comme les flottes pirates espagnoles sous
pavillons de complaisance qui braconnent la Légine australe)57(*).
Par ailleurs, la surpêche compromet également la
satisfaction des besoins alimentaires de populations importantes, pour qui les
produits de la pêche constituent au moins la moitié de leur apport
essentiel en minéraux et en protéines animales. Elle modifie
radicalement l'équilibre naturel des écosystèmes marins et
ne laisse pas à la nature se capacité de renouveler ses
ressources. Par ailleurs, ces écosystèmes qui soutiennent les
stocks se dégradent de plus en plus sous l'effet de la
pêche58(*).
Il convient à présent d'analyser le
phénomène de la pollution en haute mer qui peut dégrader
l'environnement et l'existence de la faune et de la flore marine.
B- La pollution de l'environnement marin
La pollution en haute mer résulte des activités
humaines qui peuvent être liées au trafic maritime ou encore
à l'exploitation pétrolière. Elle est définie
59(*)comme
l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou
d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a
ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques
et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de
l'homme, entraves aux activités maritimes ,y compris la pêche et
les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la
qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et
dégradation des valeurs d'agrément. C'est
également la définition retenue par la CNUDM en son article
premier. Ainsi, dans le cadre de cette partie porte uniquement sur la
pollution par les hydrocarbures. Un accent est donc mis d'une part sur les
sources de cette pollution (1) et d'autre part sur les
différentes conséquences de cette pollution
(2).
1) Les sources de la pollution par les
hydrocarbures
D'après le livre bleu des engagements du grenelle
de la mer60(*), 80%
de la pollution proviennent des activités terrestres et 20 % des
activités maritimes. Par ailleurs, la cause la plus visible de la
croissance de la pollution pétrolière du milieu marin est la
croissance et le développement des opérations du transport de
pétrole61(*)
á travers les mers. La capacité de la flotte
pétrolière mondiale étant d'environ 280 millions de
tonnes62(*).
Cependant, une distinction doit être faite entre la
pollution accidentelle63(*) et la pollution opérationnelle qui est
celle causée par les rejets illicites d'hydrocarbures pendant
l'exploitation courante des navires, que ce soit pour le transport des
marchandises ou des passagers64(*). La pollution accidentelle fait appel au divers cas
d'abordage entendu comme collision accidentelle entre deux navires.
Les hydrocarbures représentent les
différentes formes de pétroles et les produits
pétroliers65(*). La pollution par les hydrocarbures est
originaire de deux sources. Elle peut résulter soit de l'exploitation de
ces hydrocarbures, notamment avec les cas de rupture ou de
détérioration d'un câble ou d'un pipeline sous-marin ;
soit alors66(*) des
déversements par les plates-formes pétrolières.
Dans ces différents cas, on assiste à un
déversement d'hydrocarbures créant ainsi des marées noires
(on peut également citer les guerres comme cause de marées
noires) qui sont les manifestations de cette pollution. Tel a été
le cas de la marée noire de la guerre du Golfe en 1991, qui est la plus
grande marée noire de l'histoire humaine, entre 700 000 et 900 000
tonnes d'hydrocarbures se déversant dans le Golfe Persique au fil des
semaines67(*).
La pollution par les hydrocarbures présente des risques
pour l'écosystème mais également pour les côtes
environnantes, ceci dû au déversement du pétrole qui va
souvent à des milliers de kilomètres.
2) Les conséquences
La pollution pétrolière est très
dangereuse pour le milieu marin, elle perturbe l'équilibre
environnemental de la mer, comme la vie des poissons et les autres êtres
vivants, les plages et les établissements récréatifs et
économiques. En outre, du seul fait de son immensité, la mer a
longtemps paru à l'abri des atteintes de l'homme. Or, lorsqu'une nappe
d'hydrocarbures est déversée, elle s'étale d'une
façon fantastique et finit souvent sa course en s'agglomérant sur
les côtes.
Les hydrocarbures forment un film qui empêche la
réoxygénation naturelle de l'eau et compromet le pouvoir auto
épurant du milieu, tuant ainsi non seulement quantité de poissons
et oiseaux marins, mais détruisant également la flore marine,
base de la chaîne alimentaire de ces animaux.
Outre les effets directs précités, il faut
également redouter les effets indirects, essentiellement sur le
tourisme, principale source de revenu pour les entreprises exerçant leur
activité dans ce domaine (la catastrophe de l'Erika le 12
décembre 1991 a provoqué la faillite de nombreuses entreprises de
tourisme en France).
La dangerosité de pollution pétrolière,
tout comme les différentes atteintes à l'ordre public en haute
mer, provenant des navires, a généré un reflexe au
niveau international pour la répression et la prévention contre
la pollution de ce type de pollution.
SECTION II: LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA GARANTIE DE
L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE MER
Du point de vue historique, la communauté
internationale notamment les organisations internationales sont à
l'origine de la prévention aux atteintes à l'ordre public,
notamment avec l'élaboration de mesures préventives dans les
conventions internationales. Les Etats adhérents aux différentes
conventions internationales, ont pris des mesures pour mettre en oeuvre les
dispositions internationales dans leurs ordres juridiques internes. Un examen
plus concret des différentes mesures prises tant par les organisations
internationales (paragraphe I) que par les Etats
(paragraphe II) dans le cadre du maintien de l'ordre public en
haute mer et en matière de prévention, est nécessaire.
PARAGRAPHE I: LE ROLE PREPONDERANT DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES A TRAVERS L'EDICTION DES NORMES INTERNATIONALES
Il n'est pas question d'étudier les structures des
différentes organisations internationales en tant qu'institutions ;
mais plutôt de s'attarder sur les différentes mesures
préventives de leurs conventions. De cette manière, les actions
de ces organisations sont analysées. Ainsi, d'un côté un
accent est mis sur les normes internationales à caractère
universel (A) proprement dit, et de l'autre sur les normes
internationales à caractère régional (B)
dans les différents domaines d'activités en haute mer.
A- Les conventions internationales
Il est question d'appréhender les différentes
règles internationales qui participent à la prévention,
d'abord dans le domaine de la navigation (1), ensuite dans le
domaine de la pêche (2) et enfin dans le domaine de
l'environnement (3).
1) Dans le domaine de la navigation
S'agissant de la navigation68(*) en haute mer, tout Etat, avec ou sans littoral, a le
droit de faire naviguer des navires battant son pavillon. Le droit de
navigation est soumis à l'observation de la condition de
l'immatriculation des navires, offrant ainsi la possibilité à
tout type de navire de battre pavillon de l'Etat sous lequel il a
été immatriculé sous réserve des obligations de
l'article 94 de la CNUDM.
S'agissant des accords internationaux adoptés, l'OMI
est l'institution des Nations Unies chargée de la réglementation
du secteur maritime et donc compétente en matière de navigation.
S'agissant de la sécurité de la navigation69(*), la Convention SOLAS70(*) (Convention internationale
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer) porte sur de règles en
matière de contrôle, de construction du navire, de son personnel
et sur toutes les autres normes de sécurité des personnes en
mer.
En matière de sûreté de la navigation, le
Code International sur la Sûreté des navires et des Installations
Portuaires (Code ISPS) est un code intégré à la convention
SOLAS.71(*)Il exige des
navires qu'ils soient toujours munis d'une fiche synoptique indiquant tous les
changements de propriété et de contrôle de l'exploitation
du navire. Le fonctionnement de ce code prévoit trois niveaux de
sûreté qui ont pour objectif de limiter la
vulnérabilité72(*). D'après ce code les ports des Etats doivent
être dotés d'un plan de sûreté73(*) relatif qui doit écrire
les mesures de protection à mettre en oeuvre tant à bord de
chaque navire que dans chaque port international.
En matière de sûreté humaine,
l'Organisation Internationales du Travail (OIT)74(*) joue un rôle important. Son action s'est
traduit en 2003 par l'élaboration d'un code : Code of practice
on Security in ports qui porte code sur les usages de sûreté
des ports75(*). Les
mesures de sûreté humaine passe par le contrôle76(*) d'accès et celui du
personnel77(*). Ce
contrôle présente ainsi un intérêt tant en ce qui
concerne la lutte contre l'immigration illégale que contre le terrorisme
ou les trafics divers.
La sûreté humaine passe aussi par contrôle
du personnel, l'identification des marins est régie par la Convention
n°185 révisée, sur les pièces d'identité des
gens de mer, adoptée à Genève le 19 juin 200378(*), et entrée en vigueur
le 9 février 2005. Elle prévoit un système
d'identification plus pointu, dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Ce
système permet de s'assurer que les gens de mer ont bien les
qualifications requises pour exercer leur activité professionnelle et
donc d'éviter les infiltrations de personnel clandestin.
Il existe également un contrôle de passagers.
Ainsi, selon le Protocole additionnel à la convention des Nations Unies
contre la criminalité organisée, contre la traite des personnes
et contre le trafic illicite de migrants les Etats doivent rendre obligatoire
la vérification par les transporteurs de la possession par chaque
passager des « documents de voyage requis pour l'entrée
dans l'Etat d'accueil79(*) ». A présent, il
importe d'étudier les différentes mesures de prévention
élaborées dans les normes internationales notamment dans le
domaine de la pêche.
2) Dans le domaine de la pêche
La FAO joue un rôle important en matière de
pêche, elle a élaboré plusieurs normes dans le but de
prévenir toute atteinte à l'activité de pêche en
haute mer. Dans le cadre de l'organisation de la pêche en haute mer, le
Code de conduite pour une pêche responsable a été
adopté à l'unanimité par la Conférence de la FAO en
1995 et est facultatif80(*). Le Code propose des directives pour une pêche
responsable, définissant des principes et des normes applicables
à la conservation, à l'aménagement et à la mise en
valeur de toutes les pêcheries.
En ce qui concerne la pêche INN81(*), un comité d'experts de
la FAO a élaboré, en 2001, un Plan d'Action International visant
à prévenir, à contrecarrer, et à éliminer
la pêche INN (PAI-INN). Ce Plan est un instrument facultatif qui
s'applique à tous les États et entités, ainsi qu'à
tous les pêcheurs. Les mesures de ce plan portent sur les
responsabilités de tous les États82(*), de l'État du pavillon83(*), de l'État
côtier84(*), de
l'Etat du port85(*). Le
Plan préconise des mesures telles que le suivi, le contrôle et la
surveillance. Les États devraient s'engager à exercer un suivi,
un contrôle et une surveillance (SCS) systématiques et efficaces
de la pêche, du commencement des opérations jusqu'à la
destination finale. Ils devraient aussi mettre en place un système de
surveillance des navires et un programme d'observateurs conformément aux
normes nationales, régionales ou internationales pertinentes.
S'agissant de la formation des pêcheurs et le personnel
de pêche, la Convention STCW-F, qui a été adoptée
par l'OMI en 1995, contient des prescriptions concernant le personnel des
navires qu'il s'agisse des dirigeants, du personnel technique, que du
personnel responsable des communications radio. Le chapitre III de l'annexe
à la convention comprend des prescriptions relatives à la
formation de base à la sécurité pour tous les personnels
des navires de pêche. Egalement, le domaine de l'environnement marin de
la haute mer a été l'objet de plusieurs conventions
internationales.
3) Dans le domaine de l'environnement
La protection du milieu marin est une obligation pour les
Etats qui ont le droit souverain d'exploiter les ressources naturelles86(*). En ce qui concerne les
mesures de prévention de la pollution du milieu marin par les navires,
l'OMI a élaborée en 1972 la Convention de Londres qui a
adopté une approche désormais courante en répertoriant,
à l'Annexe I, les substances qui ne peuvent être
déversées dans l'océan, et à l'Annexe II, celles
qui ne peuvent l'être qu'avec une autorisation. La structure de la
réglementation, qui oblige les Etats signataires à faire
respecter ces obligations par tout navire chargeant dans leurs ports ou
arborant leur pavillon dans n'importe quel endroit du monde, a progressivement
durci son régime ; et les parties ont désormais
effectivement cessé d'immerger en mer des déchets industriels.
Ensuite, l'OMI a élaboré la Convention sur la
prévention de la pollution par les navires de 197387(*). Cette Convention instaure
des règles universelles qui ont pour but de renforcer la
sécurité à bord de tous les navires, submersibles, engins
flottants88(*)à
l'exception des navires d'États affectés à des usages non
commerciaux et aux activités liées à l'exploration des
fonds marins et opérations d'immersion. Cette convention impose d'autre
part la tenue d'un « registre des hydrocarbures »
mentionnant tous les chargements, transferts ou déchargements de
pétrole, ainsi que des informations sur le nettoyage et le
déversement des eaux de ballast89(*).
La pollution par les hydrocarbures en haute mer, elle est
encadrée par la Convention spécifique d'intervention en haute
mer dans les cas causant ou pouvant causer la pollution par le pétrole
(Bruxelles 1969)90(*).
L'objectif de cette Convention est de réaliser un équilibre entre
le droit de l'État côtier d'intervenir en haute mer en cas
d'accidents qui peuvent faire venir la pollution pétrolière et le
principe de la liberté de la navigation91(*).
La protection de l'environnement en haute mer implique
également la conservation des ressources biologiques par leur
protection. La CMB interdit la surexploitation en haute mer92(*). A cet effet, les États
doivent coopérer à la conservation des ressources biologiques
qu'ils exploitent en commun, lorsqu'il s'agit de ressources situées dans
plusieurs ZEE adjacentes ; ainsi que pour celles de la haute mer. En
matière de conservation des ressources biologiques en haute mer, la
protection marine est mieux encadrée par les conventions
régionales.
B- Les normes internationales à
caractère régional
Il s'agit d'une part les normes édictées par
l'Union Européenne (1) et d'autre part les conventions
régionales spécifiques (2).
1) Les normes de l'Union Européenne
Dans le domaine de l'environnement, notamment en
matière de lutte contre la pollution, la communauté
européenne a joué un rôle vital en ce qui concerne les
interventions liées à la pollution marine, par le biais du
programme d'action communautaire93(*). Le Parlement européen et son conseil ont eu
également à adopter la Résolution N°2850/2000/CE du
20 décembre 2000. Cette décision a instauré un cadre
communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine
accidentelle ou intentionnelle94(*). De plus, l'EMSA95(*) a adopté le 22 octobre 2004 un plan d'action
en matière de préparation et de lutte en cas de pollution par
les hydrocarbures.
S'agissant de la protection et de la conservation des
ressources biologiques en haute mer, la Commission a adoptée le
Règlement N° 2244/2003 du 18 décembre 2003 relatif à
la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques qui met
en place un système de surveillance des navires par satellite
(VMS)96(*).
Dans le domaine de la pêche, l'UE a pris des actes
unilatéraux en ce qui concerne l'organisation de la politique commune de
pêche. S'agissant du contrôle de cette politique, le Conseil a
adopté le 21 décembre 2006 le règlement (CE) N°
1966/2006 concernant l'enregistrement et la communication électronique
des données relatives aux activités de pêche et les
dispositifs de télédétection97(*). L'Union Européenne a
également adopté le Règlement sur la pêche INN le 29
septembre 2008 qui entra en vigueur en 2010. Il a pour but d'empêcher,
dissuader et éliminer tout commerce des produits de la pêche INN
au sein de l'Union Européenne, dans toutes les eaux de l'UE, et interdit
la participation des ressortissants communautaires aux activités INN,
dans quelque pays que ce soit98(*).
En ce qui concerne le trafic illicite de drogue en haute mer,
le Parlement européen a adopté la Convention relative à la
répression par les administrations douanières du trafic illicite
de drogue en haute mer99(*) du 9 mars 2004. Conformément à cette
convention, les administrations douanières des États membres de
l'Union coopèrent de la manière la plus large possible afin
d'éliminer le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes par la voie maritime, conformément au droit maritime
international100(*).
En outre, il convient de noter que dans le domaine de la
pêche en haute mer, l'UE a conclu des accords régionaux avec les
organisations régionales de pêche en haute mer. Ces organisations
élaborent donc des conventions propres à leurs régions
maritimes.
2) Les conventions régionales
spécifiques
En ce qui concerne la pêche, la Commission
Générale des pêches pour la
Méditerranée (CGPM) a adoptée101(*) en 2006, des recommandations
obligatoires concernant des mesures d'aménagement, y compris celles
relatives à l'effort de pêche et à la protection de
certains habitats sensibles ; ainsi que d'autres recommandations relatives
à la pêche INN avec l'établissement d'une liste noire de
navires.
La Commission des poissons anadromes du pacifique Nord
(CPAPN), en ce qui concerne la lutte contre la pêche
INN102(*), a
institué, en 2006, des patrouilles communes qui ont réunis les
navires des coastguards américains et de leurs homologues
russes. Pour renforcer ces efforts, un système web a
développé par la Russie permettant de partager les informations
relatives aux activités de mise en oeuvre et de partager l'observation
d'activités illégales.
La CEPANE (Commission des pêches de l'Atlantique
Nord-Est) a adopté plusieurs mesures en 2006, parmi lesquelles
la décision de fermer aux pêcheries une zone
supplémentaire, afin de protéger les espèces
vulnérables. Elle a également établi, dans le cadre de la
lutte contre la pêche INN, avec son organisation soeur dans
l'atlantique Nord- Ouest103(*), une liste noire commune des navires INN. Les autres
organisations régionales de pêche104(*) ont également
élaboré des mesures en matière de prévention de la
pêche illicite et de gestion raisonnée des pêches.
En ce qui concerne l'environnement, la Convention pour
la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est105(*) (ensemble quatre annexes et
deux appendices dite « Convention OSPAR ») a pour but
d'améliorer la qualité des eaux, la préservation et la
restauration des écosystèmes marins dans l'Atlantique du
Nord-Est. Désormais, les Etats doivent coopérer pour l'adoption
de programmes et de mesures visant à protéger certains
écosystèmes et certaines espèces marines, tout en
réglementant les activités humaines qui peuvent avoir des impacts
négatifs sur leur conservation.
La Convention sur la protection de la Mer
Méditerranée contre la pollution dite « Convention de
Barcelone »106(*) pose des obligations minimales auxquelles
souscrivent les Etats signataires et renvoie à des dispositions
techniques de lutte contre les formes particulières de pollution
à des protocoles additionnels. L'accord cadre et les protocoles
constituent un ensemble complémentaire baptisé «
système de Barcelone ».
L'élaboration des normes internationales par les
organisations internationales et régionales a pour principale
finalité leurs transpositions dans l'ordre juridique interne des Etats
qui doivent les aménager à telle enseigne qu'elles puissent avoir
plein effet.
PARAGRAPHE II : L'ETAT DANS LA MISE EN OEUVRE DES
NORMES INTERNATIONALES
Dans ce paragraphe s'articule autour des modalités
d'aménagement des normes internationales par les Etats
(A) qui sont communes à chaque domaine de
règlementation de la haute mer. Un accent particulier est mis sur le
cas du Cameroun dans l'application de ces normes (B).
A- Les modalités d'aménagement des normes
internationales par les Etats
L'aménagement de ces normes s'observe à deux
niveaux. D'une part dans le cadre des mesures préventives
terrestres107(*)
(1) et d'autre part dans au niveau des mesures
préventives maritimes (2).
1) Les mesures préventives
terrestres
La sûreté en haute mer, et en mer en
général, passe par le déploiement de moyens terrestres.
Les mesures préventives portent généralement sur la
sûreté maritime, c'est-à-dire la sûreté de la
vie humaine, des navires et par là même de la navigation.
Ces mesures visent d'abord la sûreté de la
zone portuaire notamment la sûreté des installations portuaires.
En effet le port est le point de départ et le passage obligé de
tout navire, le lieu où celui-ci est chargé, le lieu
d'embarquement des marins, leur lieu de débarquement, en clair, le lieu
de tout mouvement à bord du navire. Il est donc nécessaire
qu'il soit doté d'une législation permettant de renforcer les
dispositifs de sûreté: les infrastructures, leur accès, la
marchandise.108(*)S'agissant de la sûreté des
installations portuaires, le code ISPS comporte l'obligation de la mise en
place un plan de sûreté portuaire109(*), pour prévenir les
atteintes aux personnes, aux navires et aux cargaisons. Ces plans doivent
être définis et mis en oeuvre par des agents de
sûreté (PFSO) désignés à cet effet ; il y en
a un pour chaque installation portuaire. La sûreté
portuaire110(*)passe
certes par la sûreté de son accès, de ses installations,
mais aussi par celle des passagers et des marchandises.
En droit français l'Etat est seul responsable de la
sûreté portuaire, tant en ce qui concerne la définition de
son contenu que du contrôle de son application111(*). Dans les ports maritimes
relevant de l'Etat une zone portuaire de sûreté112(*)est définie par le
Préfet maritime, et se compose du port maritime lui-même et des
zones terrestres contigües intéressant la sûreté
portuaire, ce qui semble plus pertinent dans le cadre d'une politique de
sûreté complète et efficace.
S'agissant de la sûreté des
marchandises113(*), il est nécessaire de pouvoir effectuer un
contrôle optimal de ce qui est chargé à bord des navires
d'autant plus que 90% du commerce maritime mondial s'effectue par
conteneurs114(*). Le
moyen de contrôle le plus simple est le passage de la marchandise au
rayon X (technique non intrusive), renforcé par la mise en place de
dispositifs particuliers, comme par exemple des techniques de détection
de CO2 pour repérer des clandestins115(*). La douane joue un grand rôle en
matière de contrôle des conteneurs116(*) et la circulation de
produits particuliers (notamment les matières nécessaires pour
mettre au point des ADM). Elle participe aussi à la lutte contre
l'immigration illégale.
Des dispositifs de sûreté des marchandises ont
été mis en place par les Etats-Unis et, par effet de contagion,
par d'autres Etats. Il s'agit de la Container Security Initiative
117(*)(l'Initiative
américaine de sûreté des conteneurs : CSI) et de
la Loi 100% scanning, dite House revolution 1 ou 100
percent scanning of U.-S bound container cargo, votée par le
Congrès américain le 3 août 2007118(*).
La sûreté humaine s'opère
par le contrôle d'accès et celui du personnel119(*). La France, un
arrêté ministériel du 4 juin 2008 en fixe les
modalités (conditions d'accès et de circulation), avec notamment
la distinction de titres de circulation temporaires ou permanents120(*). Au regard de tout ce qui
précède, il convient d'étudier la particularité des
mesures préventives maritimes.
2) Les mesures préventives maritimes
En ce qui concerne la navigation, les mesures portent sur la
prévention à bord des navires et sur la prévention sur la
zone maritime de la haute mer. La prévention à bord
s'opère par le plan de sûreté du navire ;
les navires battant pavillon des Etats doivent disposer d'un système
AIS (système automatique d'identification). Le Plan AIS pose
problème, dans la mesure où le système d'alerte du navire
se retourne contre ceux qu'il doit protéger121(*). La France a donné
des listes d'organismes de sûreté maritime reconnus122(*).
Le Contrôle Naval Volontaires français est un
exemple des mesures préventives à bord des navires. Ce
Contrôle, institué par l'instruction inter ministérielle du
27 juin 2001, est un protocole de coopération et d'échange
d'informations entre un armateur français et la Marine Nationale. Son
but est d'assurer la protection des navires marchands en temps de
paix123(*). Son
efficacité a été démontrée notamment dans
l'affaire du Ponant124(*) : le fait que ce navire soit soumis au CNV a permis
une intervention très rapide, puisqu'un quart d'heure après le
lancement de l'alerte, un avion français décollait du territoire
français. Très peu d'attaques ont de plus été
recensées contre les navires français.
La prévention sur la zone maritime
s'opère par le biais des pouvoirs de police en mer.125(*) Elle s'exerce par des
actions de surveillance et de contrôle, voire de contrainte, selon des
modalités spécifiques. Les Etats du pavillon doivent exercer
effectivement leur juridiction et leur contrôle dans les domaines
technique, administratif et social sur les navires battant leur pavillon.
Le renseignement est essentiel car on ne peut agir en mer sans
en connaître les enjeux, ni contre des personnes sans en connaître
les mobiles, les revendications, les modes de vie, les techniques. Une
présence permanente dans chaque région du monde est
nécessaire pour pouvoir connaître le milieu et anticiper au
maximum les attaques.
Dans le domaine de la pêche, les mesures
préventives consistent en la surveillance et le contrôle et
sont prises par les polices de pêche de chaque Etat. La
prévention de la pêche INN est généralement l'oeuvre
des OIP (Organisations Internationales de Pêche) et ORP (Organisations
Régionales de pêche). L'Etat se limite uniquement à la mise
en oeuvre des mesures prises par ces organisations. Ainsi, pour contrer les
menaces que présentent les activités de pêche INN pour
la durabilité des pêches du Canada, le gouvernement canadien a mis
en oeuvre un certain nombre de politiques et de programmes, conformes aux
principes du PAI-INN, au fil des ans. Les instruments législatifs
conçus pour atteindre les objectifs du Canada concernant les ressources
halieutiques comprennent : la Loi sur le ministère des Pêches
et des Océans126(*), la Loi sur les océans127(*) et la Loi sur les
pêches128(*).
Dans le cadre de la prévention de la pollution
volontaire, plusieurs textes législatifs et
réglementaires français ont sensiblement renforcé la
capacité de l'État à lutter contre les rejets illicites en
mer129(*).
Simultanément, l'institution judiciaire s'est spécialisée
tandis que les administrations en charge de la surveillance en mer, notamment
la douane130(*) et la
marine nationale131(*),
ont modernisé leurs moyens. Le droit anglais, quant à lui, avec
le Merchant Shipping (Prevention of Oil Pollution) Regulations 1996 (MSR
1996)132(*), a
régi de nombreux aspects du contrôle de la pollution par les
pétroliers. Par ailleurs, il convient de préciser que la
mise en oeuvre de ces normes internationales est moins effective, en ce qui
concerne la haute mer, dans les pays en voie de développement africains
à cause d'un certain nombre de problèmes.
B- Le Cameroun et l'application des normes
internationales
Une étude de l'application de ces normes dans le
domaine de la pêche (1) et de l'environnement
(2) est nécessaire. Les normes internationales en
matière de navigation sont appliquées par le Cameroun mais
concernent uniquement ses eaux intérieures et ses mers territoriales.
Ceci est dû au manque de moyens matériels et de capacité
pour l'Etat du Cameroun pour procéder au suivi, contrôle et
surveillance des activités en haute mer.
1) Dans le domaine de la pêche
En ce qui concerne l'application du Code de conduite
internationale pour une pêche responsable, la Commission
Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources halieutiques en
CEMAC(CEBEVIRHA)133(*), s'est interrogée sur la situation des pays
de l'Afrique Centrale concernant la mise en oeuvre de cet instrument juridique
régissant les activités de pêche, au niveau mondial, en
décembre 2004. La Commission a mentionné les progrès
réalisés dans la mise en oeuvre, qui est une utilité pour
ces Etats.
Néanmoins, il est important de mentionner que la
gestion des pêches, les pratiques après capture, le commerce, la
recherche halieutique et le développement des pêches
intérieures sont des questions prioritaires pour les Etats de la CEMAC,
quoiqu'à des degrés différents. Ainsi, cette question est
d'intérêt mineur pour le Cameroun vu qu'il ne dispose pas de
moyens pour pouvoir prendre des mesures adéquates.
Cependant, le Cameroun applique un système de
surveillance des navires pour la totalité de la flotte de pêche
opérant dans les eaux relevant de la juridiction nationale. Par contre,
la surveillance des activités des bateaux battant pavillon d'un Etat
menées dans les eaux internationales ou les eaux sous juridiction d'un
autre Etat, est une question sans objet pour les Etats de la CEMAC, car ces
Etats disent ne pas être concernés par ces activités.
S'agissant de la recherche halieutique, on
note de graves lacunes se traduisant par l'absence d'estimations fiables de
l'état des stocks sur des périodes relativement longues, le
manque de statistiques à jour, complètes et fiables sur les
captures et l'effort de pêche ainsi que le manque de personnel
qualifié pour produire les donnés nécessaires à la
gestion durable des ressources halieutiques.
Pour la mise en oeuvre des Plans d'Action
Internationaux134(*),
aucun plan n'est disponible au Cameroun quoique des
évaluations préliminaires aient été entamées
dans certains pays. Les Etats de la zone CEMAC déclarent ne
pas pratiquer la pêche à la palangre et, par conséquent,
affirment qu'il n'existe pas de problème de captures accidentelles
d'oiseaux de mer.
S'agissant de l' Accord de la FAO de 1993 visant
à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des
mesures internationales de conservation et de gestion et Accord de l'ONU de
1995 sur les stocks de poissons, à ce jour, le Cameroun n'en est pas
partie prenante. Mais a l'intention d'en devenir partenaire et a
entamé le processus d'adhésion à ces Accords, en
soumettant des projets d'instruments de ratification, d'acceptation ou
d'accession, suivant les cas, à l'adoption de son Parlement.
En définitive les obstacles rencontrés par le
Cameroun pour l'application des normes internationales dans le domaine de la
pêche relèvent de l'insuffisance des crédits
financiers, de matériel et de personnel qualifié pour produire
les donnés nécessaires à la gestion durable des ressources
halieutiques. La faiblesse du niveau de la recherche scientifique, se
traduit ici par l'absence d'estimations fiables de l'état des stocks, le
manque de statistiques à jour, complètes et fiables sur les
captures et l'effort de pêche, et l'absence de suivi, contrôle et
surveillance, impliquant ainsi la persistance de la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée. Il convient
d'analyser également les obstacles à l'application des normes
internationales dans le domaine de l'environnement.
2) Dans le domaine de l'environnement
La mise en oeuvre du dispositif de Marpol au Cameroun135(*)est
riche d'enseignement dans la mesure où la convention élabore des
règles pertinentes applicables aux plates-formes des forages et autres
plates-formes. L'analyse de cette convention révèle
l'imprécision de certaines de ses dispositions sur les moyens et
méthodes de sa mise en oeuvre. Or, une claire définition desdits
moyens et méthodes est susceptible de faciliter leur mise en
oeuvre136(*).
Cette
lacune vient aggraver l'état des choses car l'application de certaines
dispositions de la dite convention ne semble pas favorable à l'Etat
camerounais. Les facteurs matériel et technologique font
défaut dans la mesure où le Cameroun ne dispose pas les moyens
nécessaires pour se procurer des navires et aéronefs
chargés de l'inspection des mers conformément à la lettre
de l'article 8 alinéa 4. Dans cette condition, il est
évident que ce texte n'y est que partiellement mis en oeuvre.
Communément appelée convention de Bonn
de 1979137(*)et
ratifiée par le Cameroun le 07 septembre 1981, la mise en
oeuvre de ce dispositif juridique ne nécessite plus aucun effort
supplémentaire dans la mesure où les institutions de recherches
scientifiques à l'instar du CERECOMA, ayant déjà
procédé à une étude des écosystèmes
marins et à la classification des types d'espèces qu'on y
retrouve, il ne reste plus qu'à booster le processus
d'élaboration des mesures juridiques nécessaires pour leur
conservation durable en coopération ou non.
En somme, le Cameroun présente encore des lacunes pour
la mise en oeuvre des dispositions internationales, ce qui est dû
à sa réticence à adhérer et à ratifier ces
normes. Cela résulte aussi du manque de moyens adéquats pour
appliquer les mesures de prévention en haute mer, et de l'absence de
formation d'experts qualifiés en la matière.
Il convient à présent d'examiner les
mécanismes de répression des troubles à l'ordre public en
haute mer.
CHAPITRE II: L'AMENAGEMENT DE LA REPRESSION DES
ATTEINTES A L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE MER
Le maintien de l'ordre public se matérialise
également par la répression qui a pour principal objectif, non
seulement de dissuader toute personne qui pourrait porter atteinte à
cet ordre préétabli, mais également de sanctionner toute
atteinte dans un processus ordonné. Ainsi, la répression
obéit à une procédure bien précise qui prend en
compte les impératifs du droit international ; d'où la
nécessité de l'examen de ses mécanismes (Section
II). Au préalable, la répression est soumise à
la mise une place résultant d'un aménagement (Section
I) opéré par un certain nombre d'acteurs.
SECTION I : LES ACTEURS DE LA REPRESSION
La répression est gouvernée par le principe
de la compétence de l'Etat du pavillon138(*). D'après ce principe, seul l'Etat du pavillon
a le droit d'intervenir, du fait du constat de la commission de toute atteinte
à l'ordre public en haute mer. L'intervention est donc à la base
de la répression. Ainsi, une attention particulière est
accordée au rôle des organisations internationales et l'action
des Etats en matière répressive (Paragraphe I).
Par ailleurs, les juridictions (paragraphe II) jouent un
rôle non négligeable dans la mesure où elles
représentent les institutions par excellence de la répression.
PARAGRAPHE I: L'ASSISTANCE TECHNIQUE DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES ET L'ACTION DES ETATS
Le droit international permet de
définir la compétence des Etats pour connaître de cette
répression. C'est dire qu'il existe une complémentarité
entre les organisations internationales, qui définissent le cadre de la
répression, et les Etats qui en définissent le contenu. Ainsi,
une attention particulière est accordée à l'importance des
organisations internationales (A) et l'action des Etats
(B) dans l'aménagement de cette répression.
A-L'importance des organisations internationales
L'édiction des normes internationales en
matière de répression d'actes illicites en haute mer est
principalement axée sur le principe de la loi de l'Etat du pavillon
(1), conformément au respect du principe de
liberté. D'autre part, ce principe est atténué par
quelques exceptions (2).
1) Le principe de la loi de l'Etat du
pavillon
La répression d'actes illicites en haute mer est
soumise à la compétence exclusive de la loi de l'Etat du
pavillon. Ainsi, les navires battant pavillon d'un Etat sont soumis à sa
juridiction exclusive139(*). La loi du pavillon est définie comme :
« loi du pays dont le navire arbore le pavillon ; loi
nationale d'un navire ou d'un aéronef servant à déterminer
le régime juridiques applicable au bien considéré,
éventuellement à ceux qui se trouvent à son bord, aux
actes qui y sont accomplis et à l'autorité qui y est
exercée par le capitaine140(*) ». L'Etat a donc une
certaine responsabilité vis-à-vis des navires battant son
pavillon. En effet, il exerce tout d'abord sa compétence personnelle
active sur les navires battant son pavillon, ce qui signifie qu'il doit faire
respecter les lois et règlements nationaux et internationaux, s'assurer
de leur bonne application, et également en sanctionner les manquements.
S'agissant de la répression par les administrations
douanières du trafic illicite de drogue en haute mer141(*), la CNUDM a
réitérée la compétence de la loi de l'Etat
pavillon. La Convention pour la répression d'actes illicites contre la
sécurité de la navigation maritime142(*) fonde la juridiction des
Etats parties et leur aptitude à réprimer les infractions qu'elle
établit (détournement de navire, actes de violence...)143(*). Tout Etat peut
établir sa compétence pénale en informant l'OMI en cas
d'infraction commise à l'encontre d'un navire battant son
pavillon ; en cas d'infraction commise par un ressortissant, et en cas
d'infraction commise dans le but de contraindre cet Etat à accomplir un
acte quelconque ou à s'en abstenir.
En ce qui concerne la répression de la piraterie, le
Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté une
résolution144(*)
incitant les Etats à favoriser l'arrestation et le jugement des pirates,
y compris par le mécanisme du « shiprider» qui
consiste à d'embarquer des officiers de police judiciaire de l'Etat
côtier sur les bâtiments de guerre, ce qui facilite la
procédure d'appréhension et de remise des pirates aux
autorités locales145(*).
La répression d'actes illicites dans le domaine de
l'environnement s'opère généralement par le biais de la
coopération internationale, bien que les navires battant pavillon d'un
Etat soient sous la juridiction nationale146(*).
Par ailleurs, il existe des cas où d'autres Etats
peuvent intervenir en lieu et place de l'Etat pavillon. Néanmoins,
l'Etat du pavillon garde toujours une main mise et peut décider
d'exercer son droit et faire valoir sa juridiction: il s'agit de la
compétence « préférentielle147(*) ». La CNUDM,
en matière de répression du trafic de stupéfiants,
prévoit la possibilité pour l'Etat du pavillon de décider
de « récupérer » sa compétence en
matière de répression des personnes appréhendées
par l'intervenant, alors même qu'il a donné son autorisation
d'intervention à un autre Etat. Cependant, l'application stricte du
principe de la loi de l'Etat du pavillon aurait amoindri l'effectivité
de la répression en haute mer. Il a donc été
nécessaire d'y apporter des atténuations.
2) Les exceptions au principe de la loi de l'Etat du
pavillon
La compétence universelle peut
être définie148(*) comme une compétence reconnue à un
Etat pour réprimer des infractions commises par des particuliers en
dehors de son territoire, alors que ni le criminel ni la victime ne sont des
ressortissants. Il est important de mentionner que cette compétence
n'est réelle et applicable qu'en matière de répression de
la piraterie maritime149(*). Cette vision a donc favorisé la
consécration d'une actio popularis reconnaissant à tout
Etat le pouvoir d'intervenir en haute mer150(*). Cependant, cette compétence n'est efficace
que si et seulement si les Etats déclarés compétents
disposent d'une législation pertinente permettant de réprimer les
actes de piraterie151(*).
La compétence de l'Etat du pavillon peut être
concurrencée par d'autres lois et règlements
applicables152(*). Ceci
s'explique par la nationalité du navire qui peut très souvent
être différente de celles de l'équipage et de celle de
l'armateur. Dans ces cas, on assiste à une concurrence entre les
droits nationaux, qui revendiquent la compétence de leurs tribunaux, et
ceux de l'Etat du pavillon.
Par ailleurs, le droit international autorise, par
dérogation au principe de la loi du pavillon, les navires de guerre
à mettre fin aux comportements les plus graves commis par certains
bâtiments, même s'ils n'ont pas leur nationalité et sans que
l'Etat du pavillon ait à délivrer une autorisation
préalable153(*).
Il en est ainsi de l'obligation faite aux Etats154(*) d'empêcher que leurs
navires s'adonnent à la traite, et du droit155(*)aux navires de guerre de
procéder à la visite d'un navire suspecté de transporter
des esclaves.
Selon la Convention sur l'intervention en haute mer en cas
d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les
hydrocarbures, l'Etat riverain peut prendre des mesures pour protéger
ses intérêts menacés par une pollution résultant
d'un accident de navigation. Elle institue, au fond, une sorte d'état de
nécessité, dérogatoire aux règles
traditionnellement applicables dans les espaces de la haute mer156(*). Néanmoins les Etats
peuvent passer des accords bilatéraux ou multilatéraux donnant
ainsi la capacité aux autres Etats d'intervenir en haute mer.
B-L'action des Etats
L'aménagement de la répression par les Etats
s'opère d'une part à travers l'adoption d'accords ou
conventions bilatérales ou multilatérales avec les autres Etats
(1). D'autre part, l'Etat procède à la
transposition des normes internationales et communautaires dans l'ordre
juridique interne. Ainsi, un accent est mis sur l'adaptation par le droit
français des normes internationales (2).
1) L'adoption de conventions bilatérales ou
multilatérales
Les Etats peuvent conclure entre eux des accords
bilatéraux ou multilatéraux, afin de conduire les suspects
arrêtés par un Etat en vue de leur remise à d'autres
Etats. S'agissant de la répression de la piraterie, le Royaume Uni a
conclu en décembre 2008 un accord avec le Kenya en ce qui concerne les
personnes arrêtées pour acte de piraterie dans le Golfe d'Aden.
Cet Accord vise à la remise par le Royaume Uni de ces personnes au
Kenya. Un accord a également été conclu entre l'Union
Européenne et le Kenya157(*), visant la traduction devant la justice kenyane les
pirates arrêtés dans le cadre de l'opération EUNAVFOR
Atalanta,158(*)et fixant les conditions et modalités de
transfert des suspects. Cet accord prévoit des garanties données
de la part du Kenya, selon lesquelles la peine de mort ne soit pas
appliquée et que des traitements dégradants ou inhumains ne
soient pas infligés aux suspects, comme le prévoit la convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, de l'ONU du 10 décembre 1984. La première
application de cet accord a eu lieu récemment, par l'Allemagne, qui,
après l'appréhension le 9 mars 2009 de neuf pirates par la
frégate Rheinland-Pfalz, les a remis aux autorités
kenyanes à Mombassa le lendemain159(*).
En ce qui concerne la répression du trafic des
stupéfiants, un Accord régional de Strasbourg du 31 janvier 1995
reconnaît la possibilité de l'intervention d'un Etat tiers, sous
réserve l'exercice de sa compétence préférentielle
à l'Etat du pavillon, pour connaître des suites
judiciaires160(*). Un
autre Accord a été conclu dans ce cadre, notamment l'Accord
d'Aruba sur la répression du trafic illicite de stupéfiants du 10
avril 2003161(*). De
nombreux autres accords ont été conclus dans le domaine de la
répression du trafic des immigrants clandestins et du trafic d'ADM. La
France a élaboré des normes nationales dans le but d'adapter les
normes internationales en matière de répression en haute mer
à sa législation nationale.
2) L'adaptation par le droit français des normes
internationales
Le principe de la territorialité régit
l'application de la loi pénale française dans l'espace162(*). En effet, une infraction
commise par un navire battant pavillon français en haute mer n'est pas
soumis de facto à la loi pénale française.
Toutefois l'article 113-3 de cette loi prévoit la compétence de
la loi française pour des infractions commises sur des navires
français où à leur encontre, quelqu'en soit le lieu. Le
champ d'application de la loi française varie en fonction du droit
français et des conventions internationales. Dans le premier cas de
figure, le principe de personnalité a été dicté par
le code pénal en ce qui concerne les infractions commises hors du
territoire de la République163(*). Ainsi, on parlera de personnalité
passive164(*) si la
victime est française ; et de personnalité active s'il
s'agit de l'auteur des faits.
Quant à la répression de la piraterie a
été introduite par la Loi du 5 janvier 2011165(*). Cette loi fournit un cadre
juridique de la répression de la piraterie par le droit français.
Cette loi ne crée pas une nouvelle incrimination de piraterie dans le
code pénal166(*),
mais elle détermine les infractions susceptibles d'être
commises167(*) par les
pirates, en se référant à des incriminations existantes,
susceptibles de répondre aux actes de piraterie, tels que définis
par la CNUDM. Cette loi a marqué une nouvelle étape en
complétant le cadre de l'action de l'Etat en mer par un nouveau
dispositif relatif à la lutte contre la piraterie maritime. Elle permet
en effet au commandant du bâtiment de l'Etat de procéder à
des mesures de contrôle et de coercition168(*) afin de lutter contre la
piraterie. Les organes nationaux169(*) participant à la lutte contre la piraterie
sont le Ministère de la défense170(*) et le Ministère des affaires
étrangères et européennes.
En ce qui concerne la répression du trafic de
stupéfiants, la France à procédé à
l'adoption de Loi n° 96-359 du 29 avril 1996171(*) relative au trafic de
stupéfiants en haute mer. Ce texte prévoit la
nécessité, pour les commandos des bâtiments et des
aéronefs de l'Etat d'exercer et d'obtenir au préalable l'accord
de l'Etat du pavillon, en matière de lutte contre la piraterie. Les
mesures d'intervention et de contrôle pourront être mises en
oeuvre, concernant les navires sans pavillon ou les navires battant un pavillon
étranger. Il en est de même en ce qui concerne la lutte contre
l'immigration clandestine.
Quant à la répression de la pollution par les
hydrocarbures, la Convention MARPOL a été transposée en
droit français par la loi du 5 juillet 1983 qui a depuis, fait l'objet
de nombreuses modifications jusqu'à l'adoption de la Loi du
1er août 2008172(*). Cette loi a allégé la
rédaction des peines et incriminations relatives à l'infraction
de rejets d'hydrocarbures. Par ailleurs, Le Code de l'environnement173(*) est le texte français
de référence174(*) pour la condamnation des contrevenants aux
infractions de la Convention MARPOL. Néanmoins, l'étude de
l'aménagement de la répression par les juridictions doit
être faite.
PARAGRAPHE II : LE ROLE DES JURIDICTIONS DANS
L'AMENAGEMENT DE LA REPRESSION
L'aménagement de la répression en haute mer par
les juridictions s'effectue sous deux angles. D'une part le rôle
primordial de la compétence des juridictions nationales
(A) chargées, conformément au principe de
compétence de la loi de l'Etat du pavillon, de prendre des mesures
répressives à toute atteinte à l'ordre public. Et d'autre
part, les juridictions internationales (B) ont des
compétences bien définies par le droit international et viennent
renforcer l'action des juridictions nationales.
A- Les juridictions nationales
Dans ce cadre l'étude de la compétence de ces
juridictions s'opère par le biais des dispositions nationales et
internationales (1). Néanmoins, face aux lacunes
législatives en matière de répression de certains actes,
il a été nécessaire d'étendre la compétence
des juridictions nationales en les dotant d'une « compétence
universelle » (2).
1) L'établissement de la compétence des
juridictions nationales
En ce qui concerne la répression du terrorisme en haute
mer, l'article 689-3 du Code pénal français175(*), prévoit que cette
infraction ne peut être réprimée uniquement lorsqu'elle est
commise en dehors du territoire français. Ainsi tout Etat peut
établir sa compétence en cas d'infraction commise à
l'encontre d'un navire battant son pavillon ou par un ressortissant. Il
le peut aussi en cas d'infraction commise dans le but de contraindre cet Etat
à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ; et
lorsqu'un ressortissant est menacé, blessé ou tué. Le
terrorisme constitue des circonstances aggravantes176(*).
En ce qui concerne la répression du trafic de
stupéfiants, l'Article 15 de la loi n°94-589 du 15 juillet
1994177(*)
prévoit que la juridiction française est compétente,
lorsque « des accords bilatéraux ou
multilatéraux le prévoient ou avec l'assentiment de l'Etat du
pavillon, ainsi que dans les cas où ces infractions sont commises
à bord d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans
nationalité ». A titre d'illustration le
jugement du 28 mai 2005 de la Cour d'assises spéciale de
Rennes178(*), dans
l'affaire du cargo Winner179(*), condamnant quatre des sept marins
poursuivis pour trafic de drogue, allant de 3 à 20 ans d'emprisonnement.
S'agissant de la répression de la piraterie, les
tribunaux de l'Etat qui a procédé à la saisie du navire ou
aéronef, à l'appréhension des personnes et à la
saisie des biens se trouvant à bord, peuvent se prononcer sur les peines
à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui
concerne le navire, l'aéronef ou les biens, réserve faite des
tiers de bonne foi. Par exemple, la compétence des juridictions
françaises était établie sur la base de l'article 224-6
du Code pénal qui dispose que «le fait de
s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace d'un
aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord
desquels des personnes ont pris place »... « est puni de
vingt ans de réclusion criminelle ». Il était
donc nécessaire d'élargir la compétence de ces
juridictions.
2) La nécessité de l'établissement
d'une compétence universelle
Le Kenya a exercé sa compétence universelle
dès 2006180(*).La
Cour de première instance (Subordinate Court) de Mombasa
s'était alors déclarée compétente pour juger des
pirates somaliens arrêtés par un navire de guerre des Etats-Unis,
après qu'ils aient attaqué, en haute mer, un navire battant
pavillon indien (décision du 26 octobre 2006). La décision se
fondait sur une définition de la piraterie « jure
gentium» (Code pénal de 1967, section 69, se
référant au droit international coutumier sans préciser
les éléments constitutifs de l'infraction).
Même s'ils n'en ont pas encore fait pleinement usage, la
Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, la Tanzanie et les Seychelles se
sont dotés d'une compétence quasi-universelle ou universelle pour
juger les personnes suspectées de piraterie. Une telle transposition du
droit international en droit interne doit être encouragée et
soutenue. Il ne suffit cependant pas de se doter d'une compétence
universelle, encore faut-il que les Etats acceptent de poursuivre effectivement
les pirates.
L'extension de la compétence des juridictions
françaises s'est opérée par le biais de la loi N°
2011-13 du 5 janvier 2011, qui permet aux autorités françaises de
juger les pirates interpellés non seulement en haute mer et dans les
espaces ne relevant de la juridiction d'aucun État, (ce qui est
déjà prévu par la Convention de Montego Bay), mais aussi
dans les eaux territoriales d'un État étranger, lorsque le droit
international l'autorise. De plus, l'extension de la compétence des
juridictions françaises s'est également opérée dans
le domaine de la répression de trafic de stupéfiants. En effet,
dans son titre II, le projet de loi181(*) étend la compétence des juridictions
françaises au jugement des auteurs d'infractions de trafic de
stupéfiants, commises à bord de navires étrangers en haute
mer, sur le fondement d'une convention d'entraide judiciaire ou encore d'un
accord ou arrangement particulier conclu entre des Etats parties à la
Convention de Vienne.
Par ailleurs, les juridictions internationales sont d'un
apport incontournable en ce qui concerne le respect, par les Etats, des
règles de droit international pour ce qui est des moyens utilisés
par les juridictions nationales pour réprimer les atteintes à
l'ordre public en haute mer.
B- Les juridictions internationales
L'établissement de la compétence de ces
tribunaux diffère en ce qui concerne les matières. Une
étude des juridictions internationales à compétence
générale : cas du TIDM (1) et les
juridictions internationales en matière des droits de l'Homme : cas
de la CEDH, doit être faite (2).
1) Les juridictions à compétence
générale : cas du TIDM
La partie XV de la CNUDM a prévu un système de
règlement des différends pour toutes les parties contractantes.
Ainsi, le règlement de différends par voie pacifique est une
obligation.182(*) Les
instances judiciaires auxquelles se réfère la Convention,
à savoir le TIDM et la CIJ ainsi que les tribunaux ad-hoc183(*), ont les mêmes
pouvoirs pour résoudre en droit les litiges et prescrire des mesures
conservatoires. Leurs décisions sont définitives et ont force
obligatoire.
Le TIDM, dans son organisation, est doté de formations
parmi lesquelles comptent la chambre pour le règlement des
différends relatifs aux pêcheries184(*), la chambre pour le
règlement des différends relatifs aux milieux marins185(*), la chambre de
procédure sommaire qui peut prescrire des mesures conservatoires, et les
chambres ad-hoc qui peuvent être constituées à la demande
des parties.
Le tribunal connaît donc des litiges, entre Etats
parties ou non186(*)
à la convention, relatifs à l'interprétation ou à
l'application de la CNUDM. Le tribunal connaît également des
différends portant sur la procédure de prompte main levée,
de l'immobilisation du navire ou de prompte libération de son
équipage187(*).
Aussi, le tribunal peut prescrire188(*), en cas d'urgence dans les affaires soumises
à un tribunal arbitral en attendant la formation de ce dernier, des
mesures conservatoires189(*).
L'ordonnance du 27 août 1999 du TIDM dans l'Affaire du
Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c.
Japon) est un exemple de mesures conservatoires prise par ce tribunal. Cette
ordonnance porte sur la question des stocks chevauchants notamment les Thons
à nageoire bleu(TNB)190(*).
Il importe de préciser que le TIDM n'a pas encore
été saisi de différends en ce qui concerne la pollution en
haute mer. Par ailleurs, il existe une autre juridiction internationale
compétente pour connaître des atteintes à l'ordre public en
haute mer. Cette juridiction intervient de manière subsidiaire.
2) Les juridictions internationales en
matière des droits de l'Homme: cas de la CEDH
Cette juridiction intervient de manière subsidiaire
dans la mesure où le respect des droits de l'Homme fait partie de
l'ordre public en haute mer. La CEDH a ainsi un rôle dans le respect par
les Etats des droits de l'Homme en matière de répression des
contrevenants à l'ordre public en haute mer.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme est le fruit
de l'institution du Protocole N°11 à la Convention
européenne de 1950, qui a été adopté le 11 mai 1994
et est entré en vigueur le 1er novembre 1998. En ce qui
concerne son apport dans l'aménagement de l'ordre public en haute mer,
la CEDH connaît des requêtes posées par les individus
lorsqu'ils estiment que les Etats ont violé leurs droits. Mais pour
cela, la Cour oblige l'épuisement des voies de recours internes. Dans ce
cas, il s'agit de violations en ce qui concerne les procédures de
détention et d'appréhension de suspects dans le cadre de
l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police. La cour intervient donc de
manière subsidiaire dans la mesure où elle ne statue que sur les
violations des droits de l'Homme.
Elle a eu à se prononcer sur ces cas dans plusieurs
affaires parmi lesquelles l'affaire Medvedyev et autres c/
France191(*).
Dans cette affaire, la cour a estimé que les normes juridiques
évoquées par le Gouvernement français n'offraient pas une
protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit à
la liberté, dès lors qu'aucune de ces normes ne vise
expressément la privation de liberté des membres de
l'équipage du navire intercepté et n'encadre les conditions de la
privation de liberté à bord, d'une part, et qu'elles omettent de
la placer sous le contrôle d'une autorité judiciaire d'autre part.
Un autre cas de violation des droits des suspects a
été constaté dans l'affaire HIRSI JAMMAA et
autres contre l'Italie192(*). Nous examinerons également
les sanctions comme finalité de la répression.
SECTION II : LES MECANISMES DE REPRESSION
Ces mécanismes reposent d'une part sur une
procédure (Paragraphe I) bien précise qui est
l'intervention, et d'autre part sur les sanctions (paragraphe
II) qui sont les conséquences de toute atteinte à
l'ordre public en haute mer en matière répressive.
PARAGRAPHE I : LA PROCEDURE :
L'INTERVENTION
L'intervention en haute mer est un corolaire de la
compétence de la loi de l'Etat du pavillon, dans la mesure où
l'Etat peut exercer ses pouvoirs de police en haute mer. Ainsi l'Etat exerce la
police maritime uniquement à l'égard de ses navires, aux fins de
respect des règles internationales de la navigation et de la
pêche. Toutefois, ce principe préconise l'autorisation de l'Etat
du pavillon pour que les autres Etats puissent intervenir193(*).
Les modes d'intervention diffèrent en fonction de
l'action illicite à laquelle les navires de guerre se trouvent
confrontés, mais aussi en fonction du droit applicable : droit national,
international, ou conventions particulières. L'intervention s'articule
autour du principe de la compétence de la loi de l'Etat du pavillon
(A) et ses exceptions (B).
A- Le principe de la compétence de la loi de
l'Etat du pavillon
On peut considérer l'intervention en haute mer comme
la base de l'exercice des pouvoirs de police194(*) de l'Etat en haute mer. Il ne s'agit pas d'analyser
les procédures judiciaires, vu qu'elles sont majoritairement pareilles,
qu'on soit devant les juridictions nationales ou internationales. Il s'agit
plutôt d'analyser les différentes opérations195(*) de contrainte dont disposent
les Etats pour intervenir en haute mer. Les techniques d'intervention
s'effectuent à bord du navire (1) et en mer
(2).
1) Les techniques d'intervention à bord du
navire
Selon la CNUDM, les actions de police doivent être
menées par les navires affectés à un service public ou par
les aéronefs de guerre et assimilés. Le navire de guerre est le
représentant de l'Etat du pavillon dont il aborde le pavillon196(*). Il agit en matière
de police à l'encontre des navires marchands ou de plaisance de sa
nationalité, quelle que soit la zone considérée. Ces
différentes techniques sont encadrées dans la CNUDM aux articles
107 et 110.
Ainsi, l'approche197(*) consiste à manoeuvrer
de façon à reconnaître les signes extérieurs de la
nationalité d'un navire. La reconnaissance198(*) consiste à s'assurer
de l'identité et de la nationalité d'un navire privé
rencontré en mer en l'invitant à hisser son pavillon ; elle peut
être effectuée à l'égard de tout navire privé
en haute mer, sans condition particulière. Par ailleurs, sa
portée est limitée dans la mesure où elle ne s'exerce que
dans les cas de piraterie, traite, émissions pirates, absence ou refus
pour un navire d'arborer son pavillon.
L'enquête a pour but de vérifier
la nationalité du navire et son droit à arborer le pavillon
qu'il présente, et est autorisée en vertu de la «
sûreté des navigateurs paisibles199(*) ». L'Etat
interviendrait donc pour une mission de protection rapprochée. En cas de
refus du navire suspect, le navire de guerre va tirer un coup de boulet qui
devrait interpeller l'autre navire de son intention d'avoir recours à
des mesures plus coercitives200(*).
La visite à bord a lieu après
une reconnaissance active du navire suspect et doit de ce fait reposer sur
des soupçons sérieux. Cette visite se divise en deux
opérations : l'examen des papiers de bord (enquête de pavillon) et
la perquisition, c'est-à-dire l'examen de la cargaison et
l'interrogatoire de l'équipage. Ce n'est que si les soupçons
persistent, après vérification, que le navire suspect pourra
être soumis à l'examen des intervenants, mais « avec tous les
égards possibles.201(*)Lorsque les circonstances l'exigent, le navire peut
être arrêté et redirigé vers un port de sa
nationalité ou de celle de l'Etat du navire intervenant.
Le déroutement vise à assurer
l'effectivité du contrôle en mer dans le cas où
l'accès à bord est refusé ou matériellement
impossible, en raison des conditions météorologiques notamment.
Il peut aboutir à l'immobilisation du navire, c'est-à-dire
à la saisie du navire et de sa cargaison pour prouver ou sanctionner une
infraction commise en mer. Lorsque la pollution par les hydrocarbures en haute
mer est constatée, le navire doit se rapprocher de l'Etat côtier
afin de déterminer le port dans lequel l'inspection sera
effectuée202(*).
Cette procédure peut également être effectuée en cas
d'abordage203(*). A
présent il convient d'étudier les autres techniques
d'intervention notamment en mer.
2) Les techniques d'intervention en mer
Ces techniques s'effectuent lorsque le navire ne peut
intervenir à bord d'un autre navire pour diverses raisons notamment du
fait du principe de son intervention (escorte et
accompagnement), du fait de la non coopération du navire
interpellé (poursuite) et dans les cas extrêmes
de destruction.
Une distinction doit être faite entre l'accompagnement
et l'escorte. Dans le premier cas, le navire accompagnant n'a pas la lourde
charge de la responsabilité de celui qu'il accompagne. C'est
l'accompagné qui décide de choisir un navire accompagnant, qui
adopte une position neutre. Contrairement à l'accompagnement, le navire
escorteur endosse la responsabilité de celui qui l'accompagne, car il
s'agit du placement de l'escorté sous le contrôle
opérationnel de l'escorteur.
Suite à l'appel du Programme Alimentaire Mondial en
2007, il y a ainsi eu l'opération Alcyon, afin de protéger les
navires du PAM acheminant l'aide humanitaire en Somalie204(*). Cette opération a
été relayée par le Canada, le Danemark et les Pays-Bas.
Trois cas de figures sont à distinguer en ce qui
concerne le champ d'application de la poursuite205(*). On parlera de poursuite
chaude qui commence dans les eaux territoriales et qui se poursuit en haute
mer. Il s'agit d'un transfert en haute mer des compétences de police
exercées par le riverain206(*) dans ses zones sous souveraineté ou sous
juridiction. Le droit de poursuite chaude207(*) a pour fondement la commission d'une infraction
constituant une atteinte à la souveraineté et la
sécurité de l'Etat côtier, alors que le navire tiers
transitait dans ses eaux. L'Etat côtier peut donc le poursuivre en haute
mer, l'arraisonner, le dérouter vers l'un de ses ports, et sanctionner
les auteurs de l'infraction. Le TIDM a reconnu la condition du lien avec
l'Etat de contravention, dans son arrêt du 1erjuillet 1999
rendu dans l'Affaire du Saïga208(*).
Le droit de suite est l'inverse du
droit de poursuite chaude dans la mesure où la poursuite commence en
haute mer et se poursuit dans les eaux territoriales. De ce fait, le navire
intervenant pourra le poursuivre le navire contrevenant même à
l'intérieur de ces eaux, à la seule condition d'en avoir pour
cela reçu au préalable l'accord de l'Etat côtier. Le
problème n'est toutefois pas pour autant résolu, puisque le plus
souvent cette poursuite demeure impossible, le temps de requérir
l'accord et d'en recevoir la réponse étant beaucoup trop long
pour une poursuite qui a lieu en temps réel. C'est pourquoi l'accord
préalable, par convention209(*) bilatérale par exemple, serait bien
préférable.
Le recours à la force, en ce qui concerne la
destruction d'un navire, interdit par le droit international, peut être
autorisé dans le cadre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies en
cas de légitime défense. Ainsi un navire qui serait en
situation de légitime défense pourrait être amené
à détruire le navire menaçant. Cela pourrait par
exemple se produire lors d'un arraisonnement en cas de résistance des
occupants ; mais aussi en cas de grave pollution, comme cela a
été le cas dans l'affaire du Torrey Canyon.
Par ailleurs, l'application stricte du principe de la
compétence de la loi de l'Etat du pavillon serait un obstacle à
l'efficacité de la répression en haute mer, dans la mesure
où certaines infractions seraient restées impunies,
résultant de la rigidité du droit international.
B- Les exceptions au principe
Il s'agit d'une part l'intervention des navires
étrangers et les autorisations du CSNU (1), et d'autre
part les autres exceptions (2) liées à
l'extension de la compétence d'intervention à d'autres
organismes.
1) L'intervention des navires étrangers et les
autorisations du CSNU
La CNUDM a prévu trois cas de figures offrant la
possibilité aux navires étrangers d'intervenir en haute mer. Ce
qui permet ainsi de pallier aux difficultés de répression dues
à une application stricte de la compétence de la loi du
pavillon. L'originalité du régime juridique de la piraterie est
que les navires publics de tous les Etats ont le droit de contrôler,
visiter, arraisonner les navires suspects et de capturer les coupables. Dans ce
cas s'applique le principe de juridiction pénale internationale, en
vertu duquel les Etats capteurs ont compétence pour juger les individus
auteurs des infractions.
Ensuite, l'article 110 de la CNUDM permet aux navires et
aéronefs, militaires ou autorisés à cette fin, de tout
Etat, d'arraisonner ou de visiter tout navire suspecté de se livrer
à la traite d'esclaves.
Enfin, l'article 109 de la CNUDM habilite non seulement les
Etats qui disposent d'un titre de compétence juridique à
l'égard des biens utilisés par les stations et des personnes,
mais aussi tous les Etats qui reçoivent les émissions ou
subissent un brouillage, à intervenir en matière de
répression des émissions de radio non autorisées en haute
mer. Les personnes peuvent être arrêtées et les biens
saisis, dans un souci d'efficacité maximum.
Les résolutions du Conseil de sécurité
des Nations Unies peuvent apparaître comme des palliatifs du droit
international et peuvent autoriser l'intervention des Etats sur la base du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies210(*).Ainsi selon la résolution 1816 du 2 juin
2008, le Conseil a permis aux navires de guerre des Etats étrangers de
continuer la poursuite des pirates dans les eaux territoriales somaliennes,
après l'accord de l'Etat côtier211(*).La résolution 1851 du 16 décembre 2008
va plus loin et autorise le droit de suite à terre, mais uniquement pour
les Etats dont la liste a été préalablement dressée
par le gouvernement transitoire somalien, et dont la France fait partie. Aussi,
ces résolutions du Conseil de sécurité ne constituent en
rien une déclaration d'un droit nouveau, mais permettent de combler des
insuffisances dans une situation bien précise, notamment celle de la
piraterie dans le Golfe d'Aden212(*). Les résolutions du conseil permettent ici de
pallier le droit international afin de résoudre une crise d'impact
mondial dans le souci de préserver la paix et la sécurité
internationales.
2) Les autres exceptions
Ces exceptions portent non seulement sur l'extension de la
compétence d'intervention aux navires étrangers, dans les
domaines où la CNUDM a prévu le droit exclusif des Etats
pavillon ; mais aussi sur l'extension de ces compétences à
certains organes. En ce qui concerne l'intervention des navires
étrangers pour des trafics de stupéfiants la Convention
des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes du 19 décembre 1988, dite Convention de
Vienne, a mis en vigueur de nouvelles dispositions internationales et
posé les bases d'une véritable coopération. Ainsi,
l'article 17 de cette Convention prévoit qu'une partie
qui, pour des motifs raisonnables, soupçonne qu'un navire se livre au
trafic illicite de drogue, cet Etat peut le notifier à l'Etat du
pavillon, demander la confirmation de la nationalité du navire. Si cette
nationalité est confirmée, l'Etat partie peut demander à
cet Etat l'autorisation de prendre les mesures appropriées à
l'égard de ce navire. L'article 4 de la Convention de
Vienne introduit par ailleurs la possibilité pour les Etats parties, au
travers des accords développés en application de l'article 17, de
déroger au principe de compétence exclusive de l'Etat du
pavillon, et de prévoir les conditions dans lesquelles l'Etat
intervenant pourra poursuivre et juger les auteurs d'infractions à la
législation sur les stupéfiants commises en haute mer, à
bord des navires battant pavillon de l'autre partie213(*).
Dans le domaine de la pêche, la CNUDM (articles
61,62, 117 à 120) impose aux Etats de conserver les ressources
biologiques de la haute mer et des eaux internationales, et de coopérer
tant pour la conservation que pour la gestion de ces ressources. Par ailleurs,
cette coopération est mise en oeuvre par les organisations
régionales, sous régionales ou mondiales des
pêches214(*).
Ainsi, ces Etats sont habilités à contraindre le navire
présumé en infraction à s'arrêter. Ils peuvent
procéder à une enquête à bord et établir un
rapport. Les Etats parties conservent cependant le monopole en matière
répressive. La surveillance commune repose ainsi sur une sorte de mandat
mutuel auquel les parties consentent.
Le Protocole additionnel de Palerme du 15 novembre
2000 contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, en son
article 8, reprend le même mécanisme que celui mis en
place pour la lutte contre le narco trafic. Il permet ainsi à un Etat de
déléguer ses pouvoirs de police à un autre Etat qui
apparaît mieux à même de les exercer. Ce texte s'applique
aux activités transnationales avec implication d'un groupe criminel
organisé, ce qui en réduit sa portée. L'Etat intervenant
peut demander confirmation de l'immatriculation à l'Etat du pavillon, et
autorisation d'intervenir et de prendre les mesures nécessaires :
arraisonnement, visite, ou autres mesures autorisées par cet Etat. Suite
à ces différents développements de l'intervention en haute
mer, il paraît primordial d'étudier les questions de sanction qui
font partie des finalités de la répression avec l'effet
dissuasif.
PARAGRAPHE II : LES SANCTIONS
La primauté de la loi de l'Etat du pavillon s'applique
également en ce qui concerne la fixation des sanctions qu'encourt toute
personne qui aurait commis une infraction. En effet, la compétence
répressive de l'Etat du pavillon s'établit sous deux
angles : sur ses ressortissants et sur les navires battant son pavillon
du fait de l'extension de sa territorialité en haute mer ; Les
sanctions liées aux infractions en haute mer peuvent être de trois
ordres notamment en matières pénale (A),
administrative et civile (B).
A- Les sanctions pénales
Ces sanctions sont les peines d'emprisonnement
(1) et d'amende (2).
1) Les peines d'emprisonnement
Il appartient aux Etats de fixer eux même les peines
à affliger aux contrevenants. Par ailleurs, l'intervention de toute
convention internationale dans cette action serait une ingérence et par
là une atteinte à la souveraineté des Etats. Cependant
cette mesure doit être prise dans les conditions de respect des
règles internationales des droits de l'Homme et de droit pénal
international.
Les peines d'emprisonnement peuvent être fixées,
et varier en fonction des types d'infractions conformément aux
dispositions légales de chaque pays. Dans le cadre de la
pollution accidentelle, la loi française215(*)prévoit 3 ou 5 ans
d'emprisonnement, lorsque l'infraction d'imprudence est accompagnée
d'une circonstance aggravante. L'alinéa 1er de l'article 252 du Code
Pénal russe216(*)a prévu une peine de 4 mois et peut être
portée à 5 ans, lorsque la pollution maritime est suivie de la
mort d'un individu. La peine d'emprisonnement ne peut être
appliquée uniquement si la responsabilité de la personne a
été prouvée. La responsabilité des personnes
morales quant à elle est à prouver dans le cadre de l'amende.
2) Les amendes
Le paiement de l'amende peut être élargi aux
personnes physiques comme aux personnes morales. Dans le dernier cas,
les personnes morales de droit privé peuvent être
condamnées à des sanctions pénales, si
une personne physique a commis une infraction pénale pour leur
compte. Cette personne physique peut avoir agi seule ou en tant que
membre d'un organe de la personne morale. Elle doit avoir un pouvoir de
direction, c'est-à-dire un pouvoir de représentation, de
décision et de contrôle au sein de la personne morale. Elle est
également responsable des infractions par omission commises par des
personnes physiques, c'est à dire l'absence de surveillance ou de
contrôle. Par ailleurs, le fait d'engager la
responsabilité de la personne morale n'empêche pas les poursuites
pénales contre les personnes physiques impliquées.
La CNUDM217(*) précise que seules des peines
pécuniaires peuvent être infligées, en cas d'infraction aux
lois et règlements nationaux ou aux règles et normes
internationales applicables visant à prévenir, réduire et
maîtriser la pollution du milieu marin, qui ont été
commises par des navires étrangers au-delà de la mer
territoriale. Ainsi, la loi française du 1er août
2008 sanctionne les cas de rejet simple des hydrocarbures en mer d'une amende
de 50.000 euros et l'alourdit de 100.000 euros en cas de récidive. Il
existe d'autres sanctions résultant de l'établissement de la
responsabilité civile.
B- Les sanctions administratives et civiles
La responsabilité civile est fondée sur la
conduite fautive. La personne qui n'exécute pas une obligation, ou qui
l'exécute mal, encourt une responsabilité lorsqu'il y a faute
volontaire ou d'imprudence. La faute civile est définie comme l'attitude
subjective d'une personne à l'égard de son action illégale
qui méconnaît les intérêts de la
société ou de certaines personnes. Cette définition est
applicable à la fois aux personnes physiques et aux personnes morales.
Ainsi, nous appréhenderons les sanctions administratives
(1) avant les sanctions civiles (2).
1) Les sanctions administratives
Ces sanctions sont prises par les administrations de
l'Etat du pavillon ou de la nationalité des personnes. Ainsi
nous pouvons citer la confiscation, en ce qui concerne le
trafic des stupéfiants en haute mer. La loi du 14 novembre 1990,
portant adaptation de la législation française aux dispositions
de l'article 5 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20
décembre 1988, est applicable à toute demande émanant
d'une autorité étrangère partie à cette Convention
tendant à la confiscation de ces objets, produits, installations,
matériels et biens. Egalement, cette mesure peut être prise en
matière de pollution. L'article 8.17 du Code des délits
administratifs, et quelle que soit la qualité de l'auteur des faits (le
capitaine ou le responsable d'une personne morale, une personne physique ou une
personne morale), peut être prononcée, en plus de l'amende, la
confiscation du navire et des autres moyens ayant servi à la commission
du délit administratif.
En plus de cette sanction, l'administration de l'Etat du
pavillon peut décider de prendre des mesures
disciplinaires à l'égard du capitaine, des membres de
l'équipage ou les armateurs, conformément à l'article 97
(1) de la CNUDM. Parmi ces mesures on peut compter la
suspension ou la révocation de la personne de
ses fonctions. Par ailleurs les sanctions civiles ont pour but la
réparation du dommage causé.
2) Les sanctions civiles
Ces mesures visent la réparation du dommage
écologique consistant à la remise en l'état ou
l'indemnisation, par le biais du versement d'une somme au titre de dommages et
intérêts. Dans le cadre de l'indemnisation en matière de
pollution, la Convention internationale de 1996 sur la
responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au
transport par mer, de substances nocives et potentiellement dangereuses,
(Convention SNPD)218(*) a pour objet de garantir une indemnisation
convenable, prompte et efficace pour les dommages aux personnes et aux biens,
le coût des opérations de nettoyage, les mesures de remise en
état et les pertes économiques liés au transport par mer
de substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD).
Du fait du nombre insuffisant de ratification de cette
convention, une deuxième conférence internationale, tenue en
avril 2010, a adopté un Protocole à la Convention SNPD
(Protocole SNPD de 2010). La convention couvre les cas de
lésions corporelles ou décès à bord ou à
l'extérieur du navire transportant des SNPD ; dommages
causés aux biens ou pertes de biens à l'extérieur du
navire ; pertes économiques résultant de la contamination de
l'environnement, par exemple dans les secteurs de la pêche, de la
mariculture et du tourisme ; coûts des mesures de sauvegarde, par
exemple les opérations de nettoyage en mer et sur le rivage ;
coûts des mesures raisonnables de remise en état de
l'environnement. Cette couverture est possible grâce au financement du
Fonds SNDP219(*) par les
Etats parties.
Cependant, il se pose le problème de
l'effectivité et de l'efficacité des différentes mesures
préventives et répressives dans le maintien de l'ordre public en
haute mer.
DEUXIEME PARTIE : EVALUATION
DU MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE MER
Dans le cadre de cette partie l'effectivité du
maintien de l'ordre public en haute mer est abordée. Il ne suffit pas
seulement d'édicter des normes au niveau national, régional, et
international pour encadrer l'ordre public en haute mer, il faudrait s'assurer
de l'application effective des normes et de leur efficacité, ce qui
permettrait alors de renforcer les différents dispositifs en
matière de sécurité et de sûreté en haute
mer.
Malgré les différentes mesures
préventives et répressives mises en place par le droit
international et dans les différents ordres juridiques nationaux, nous
relevons que l'efficacité de ces différentes mesures
connaît quelques obstacles. En effet, le respect stricte de la
souveraineté des Etats est à l'origine de ces obstacles, dans la
mesure où l'ordre public en haute mer a un caractère volontariste
tant en matière préventive qu'en matière
répressive. L'efficacité du maintien de cet ordre est donc
limitée. De ce fait, il convient d'examiner l'effectivité du
maintien de l'ordre public en haute mer (Chapitre III) avant
d'étudier les perspectives d'amélioration du maintien de cet
ordre (Chapitre IV).
CHAPITRE III: L'EFFECTIVITE DU MAINTIEN DE L'ORDRE
PUBLIC EN HAUTE MER
D'une manière générale,
l'effectivité du maintien de l'ordre public en haute mer porte sur une
appréciation de l'application des mesures préventives et
répressives dans le cadre de la lutte contre les infractions
résultant des différentes activités en haute mer. De ce
fait, quelques insuffisances et limites dans la mise en oeuvre des mesures
préventives et répressives par les Etats sont à relever.
Ces insuffisances constituent des obstacles à l'efficacité du
maintien de l'ordre public en haute mer, et résultent du statut
juridique de la haute mer. En effet, la haute mer est un espace maritime
international encadré par le principe de liberté
conformément au respect de la souveraineté internationale des
Etats. Par conséquent, les Etats ne peuvent être contraints de se
conformer aux engagements internationaux qu'ils auraient pris. Ainsi,
l'effectivité du maintien de l'ordre public est amoindrie par un certain
nombre d'obstacles (Section I).
L'analyse des différentes entraves au maintien de
l'autre public en haute mer permet de mieux appréhender l'action de
certaines organisations internationales notamment leur importance en
matière de suivi et de contrôle de l'application des mesures
étatiques. De plus, des opérations internationales sont
menées dans le cadre de la lutte contre les activités illicites
afin de pallier aux différents obstacles à l'efficacité du
maintien de l'ordre public en haute mer. Ainsi, une étude est faite sur
le renforcement de la sécurité et de la sûreté en
haute mer par les institutions internationales (Section
II).
SECTION I : UNE EFFECTIVITE AMOINDRIE PAR DIVERS
OBSTACLES
D'une part, droit de la mer est face à un dilemme
notamment celui de respecter les principes de droit international et de
préserver les exigences de l'ordre public en haute mer, du fait des
différents enjeux que représente cet espace tant pour la
communauté internationale que pour chaque Etat. Cette difficulté
de concilier la souveraineté des Etats et les objectifs de l'ordre
public affaiblit l'efficacité et l'effectivité de l'application
des normes préventives et répressives. De ce fait, on assiste
à une mise en oeuvre partielle et relative de ces mesures par les Etats.
Il convient donc d'examiner les insuffisances des Etats dans la mise en oeuvre
des normes internationales (Paragraphe I).
D'autre part, le droit international est essentiellement
consensuel et obligatoire pour les Etats parties aux différents
traités internationaux. Par conséquent l'effectivité et
l'efficacité du maintien de l'ordre public sont soumises à la
volonté des Etats qui peuvent décider de s'y conformer ou pas,
dans la mesure où ils ne peuvent faire l'objet de mesures contraignantes
de la part du droit international. Ceci implique donc une étude des
entraves à l'ordre public en haute mer liées à la nature
du droit international (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES INSUFFISANCES DES ETATS EN
MATIERE DE MISE EN OEUVRE DES NORMES INTERNATIONALES
L'article 94 de la CNUDM sur les obligations de l'Etat du
pavillon stipule que : « Tout Etat exerce
effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines
administratif, technique et social sur les navires battant son
pavillon ». Le contrôle est donc un point
déterminant dans le maintien de l'ordre public en haute mer, dans la
mesure où il contribue à l'efficacité en matière
préventive et répressive ;
Les insuffisances sont propres à l'ordre interne des
Etats et ne concernent que les moyens administratifs et techniques dont
disposent les Etats pour procéder à l'application des mesures
préventives et répressives, en matière d'infractions
liées aux activités en haute mer. De ce fait, ces insuffisances
résultent d'une part du faible contrôle des Etats en
matière d'immatriculation des navires (A) et d'autre
part les conséquences des pavillons de complaisance et des registres bis
(B).
A- Le faible contrôle des Etats en matière
d'immatriculation des navires
Les Etats préviennent et entament, de manière
efficace, la procédure de répression des atteintes à
l'ordre public en haute mer à travers le contrôle. Cependant, un
certain délaissement de la part des Etats est observé dans
la pratique; ceci pour plusieurs raisons dont les principales sont les
insuffisances de moyens de contrôle des Etats (1) et
les avantages tirés par les armateurs du fait du défaut de
contrôle en matière d'immatriculation(2).
1) Les insuffisances de moyens des Etats
Les Etats sont très souvent confrontés à
l'insuffisance voire à un manque de moyens qui constitue un obstacle
important en matière de contrôle tant en mer que sur terre
(notamment dans les ports). Dans ce cas, l'Etat peut contrôler de
manière insuffisante les navires battant son pavillon. Dans le cas
extrême, il ne procède à aucun contrôle. Ces
insuffisances s'articulent autour des moyens financiers et techniques.
En effet, le contrôle des navires en haute mer demande le
déploiement d'aéronefs, d'hélicoptères et de
technologies très sophistiquées telles que les radars et autres
moyens spatiaux. La possession de ces moyens est sujette à la
disponibilité de moyens financiers qui sont très
élevés. De ce fait la majorité des pays, bien qu'ayant une
certaine capacité de navigation, ne peuvent de doter de moyens
techniques. Dans ce cadre les Etats ne disposant pas de moyens financiers et
par conséquent de matériels, ne peuvent procéder de
manière efficiente au contrôle des navires en haute mer.
Par ailleurs, l'Etat de pavillon ou l'Etat du port, faute de
personnel qualifié ni de structures administratives adéquates en
matière de contrôle, procède souvent au contrôle des
navires de manière irrégulière. Généralement
le personnel assigné au contrôle des navires n'est pas
qualifié et par conséquent il y a défaillance dans ce
contrôle.
2) Les avantages tirés par les
armateurs
Le délaissement de la part des Etats est un facteur
aggravant de « l'insécurité maritime ».
Ce délaissement se matérialise par le laxisme de certains
Etats dans les modalités d'attribution de matricules aux
navires. Ce laxisme se manifeste par l'assouplissement des
modalités d'acquisition par les navires de matricules au
détriment du respect des normes internationales ; ce qui
représente très souvent des avantages pour l'armateur. Ainsi,
l'armateur totalement libre du choix du pavillon, effectuera ce choix en
fonction essentiellement des critères économiques, s'il s'agit
d'un pavillon de libre immatriculation ne requérant pas des
critères de nationalité : taxes, nationalités des
équipages et bien sûr coût dû au respect de la
réglementation technique. Ces critères sont donc compressibles
à l'inverse bien souvent du prix du fret, qui pour sa part est un prix
de marché220(*).
De plus, ils disposent d'une très large liberté
de manoeuvre pour déterminer les normes d'exploitation de leurs navires,
et de façon délibérée, pour ne pas se conformer aux
règles et normes internationales sur la sécurité et la
lutte contre la pollution existant dans l'industrie des transports
maritimes221(*). Ce
faisant, ils obtiennent des avantages financiers qui peuvent représenter
un pourcentage important222(*) des coûts globaux d'exploitation des
navires.
Par ailleurs, l'armateur peut aussi tirer un avantage
financier, du fait que les navires défectueux ne sont pas
décelés par les autorités de l'Etat du port, de l'Etat du
pavillon ou par les sociétés de classifications223(*). En effet, les armateurs qui
décident, de façon délibérée, de ne pas ce
conformer aux diverses mesures concernant la sécurité et la
pollution tirent des avantages financiers qui peuvent être mis en
évidence à partir des principaux types de manquement
décelés lors des visites annuelles effectuées par l'Etat
du pavillon. Certes, il s'agit pour la plupart de manquements mineurs, qui
n'entraînent pas que des économies réduites de coûts,
mais certains manquements majeurs peuvent avoir des conséquences
financières sensibles, surtout si le manquement se traduit directement
par l'arrêt immédiat de l'exploitation d'un navire.
Par ailleurs, le défaut de contrôle des Etats en
matière d'immatriculation résulte très souvent des
phénomènes de pavillons de complaisances et de registres bis qui
ont des conséquences néfastes en matière de
sécurité et de sûreté en haute mer.
B- Les conséquences des pavillons de
complaisance et des registres bis
Le droit international, peu contraignant, exige uniquement
qu'il existe un lien substantiel entre l'Etat et son pavillon en matière
d'immatriculation. Ainsi, très souvent les Etats disposent de registres
ouverts224(*)à
travers lesquels ils peuvent attribuer des immatriculations à des
navires de nationalité étrangère. Le pavillon de
complaisance est le « nom donné au pavillon qui
couvre le rattachement fictif d'un bâtiment à des ordres
juridiques souples et peu contraignants sur le plan fiscal échappant
aux charges sociales et aux sujétions fiscales supportées
par les marines marchandes traditionnelles mais également aux
contrôles administratifs»225(*).
Le registre bis ou registre papiers se
caractérise par le fait que c'est la loi de l'Etat du registre qui
va consacrer elle même l'extra-territorialité des lois
sociales en posant le principe que le contrat de travail du marin ne
relèvera pas, par exemple, de la loi du pavillon mais du lieu de
résidence du marin. Il a été conçu pour
permettre aux armateurs de s'adapter à la concurrence internationale,
en réduisant leurs coûts.
De prime à bord, tout navire est soumis à la
juridiction exclusive de l'Etat dont il bat le pavillon. Il incombe donc aux
Etats de faire respecter toutes les règles et mesures internationales
et nationales. De nombreux Etats ont adopté cette pratique en raison de
l'apport des revenus non négligeables issus des droits d'enregistrement
des navires ; les compagnies maritimes y ont recours car les dispositions
législatives y afférent sont moins sévères. Dans ce
cas, la portée de l'immatriculation des navires se limite aux diverses
procédures administratives et au paiement des taxes.
L'Etat complaisant ne peut ni exercer efficacement son
autorité sur ces types de navires, ni s'assurer de l'effectivité
de l'application des mesures internationales et nationales. Cette
situation facilite ainsi la violation, par ces types de navires, des
dispositions tant nationales et internationales, portant ainsi atteinte
à la sécurité et à la sûreté en haute
mer. La majeure partie des pavillons de complaisance ne sont pas liés
aux différentes conventions internationales en matière de
sécurité et de sûreté en haute mer, de même,
et ne font même pas partie des organisations régionales de
pêche. Ce statut leur permet d'agir en toute impunité et donc de
procéder à la surexploitation des ressources biologiques et
à la surpêche du fait de l'inobservation, menaçant ainsi
l'existence de ces ressources à long terme. De plus, l'inobservation
des mesures de sécurité de la navigation, du fait de l'absence
du contrôle effectif de ces navires, est souvent à l'origine des
pollutions accidentelles ou intentionnelles en haute mer. En effet,
l'interdiction de rejet des déchets en mer n'est pas
généralement respecter en mer.
En définitive le souci du respect de l'identité
souveraine des Etats, en ce qui concerne l'application des normes
internationales, est à l'origine des insuffisances dans
l'effectivité du maintien de l'ordre public en haute mer. Il importe
donc d'analyser les
PARAGRAPHE II : LES ENTRAVES LIEES A LA NATURE DU
DROIT INTERNATIONAL
Le droit international est caractérisé par le
respect de la souveraineté des Etats, ce qui se manifeste par le
volontarisme de l'Etat dans la mise en oeuvre des normes internationales.
Ainsi, l'exécution de ces normes n'est soumise à aucune mesure
contraignante de la part des institutions internationales. Ces entraves sont
liées aux inconvénients du respect strict de la
souveraineté étatique (B) et à la
complexité du droit de la mer (A).
A- La complexité du droit de la mer
Cette complexité se manifeste à travers
l'imprécision des conventions internationales dans la formulation du
droit de la mer(1) et à travers les lacunes du droit
de la mer en matière répressive(2).
1) L'imprécision des conventions internationales
dans la formulation du droit de la mer
Ces insuffisances relèvent du caractère
générale des diverses mesures préventives que
préconisent les conventions internationales. La CNIUDM est une
convention de renvoi, en ce sens qu'elle ne défini pas de manière
détaillée la mise en oeuvre par les Etats des mesures
préventives et répressives pour la protection de la haute mer.
Cette insuffisance réduit le champ d'application et celui de
l'élaboration des normes en la matière par les conventions
internationales qui font généralement appel à la
convention en tant que « Charte du droit de la
mer ». Ce qui se manifeste par la difficulté
d'adaptation de la CNUDM par ces conventions.
Il en est ainsi des obligations pour les Etats de
coopérer pour la répression de la piraterie (art.100), du trafic
illicite de stupéfiants et de substance psychotropes (art.108) et des
émissions non autorisées (art.109). Ces dispositions ont
essentiellement un caractère déclaratif ; il n'ya aucune
précision quant aux différentes modalités de ces
coopérations ; ce qui est souvent à l'origine de l'absence
et de l'insuffisance de l'application de ces dispositions.
Toujours en ce qui concerne les infractions commises
en haute mer, la CNUDM reste imprécise et insuffisante dans la
définition et la qualification des éléments constitutifs
des infractions. Il en est ainsi de la définition des
substances psychotropes et des stupéfiants et de la limitation des actes
de pirateries aux actes accomplis à des fins privées. La
Convention n'a pas prévu les cas de terrorisme maritime,
réduisant ainsi le champ d'application des mesures préventives et
répressives dans le domaine de la haute mer.
Dans le domaine de la protection de l'environnement,
particulièrement en ce qui concerne la conservation et la gestion des
ressources biologiques, la CNUDM ne précise aucune modalité quant
aux différents outils de pêches que peuvent utiliser les navires.
De même, il n'est pas fait mention des espèces rares et en voie de
disparition qui devraient bénéficier d'une protection
particulière.
Tout ceci explique l'insuffisance de conventions
internationales en matière de protection des espèces biologiques
en haute mer. Par ailleurs, les lacunes du droit de la mer en matière de
répression méritent d'être présentées.
2) Les lacunes du droit de la mer en matière
répressive
Les conventions internationales, pour la majeure partie, ne
prévoient pas de manière claire les types de sanctions à
infliger aux différents acteurs participant aux activités
illicites et aux activités dégradant l'environnement de la haute
mer. Ainsi, on y retrouve seulement les moyens d'intervention des Etats en
haute mer, c'est-à-dire l'exercice des pouvoirs de police en haute mer
pour prévenir et réprimer les atteintes à l'ordre public.
Ces lacunes ont pour conséquence les insuffisances voire l'absence de
normes nationales ayant spécifiquement trait aux types de sanctions
propres à chaque infraction commise en haute mer.
C'est ainsi que les Etats ne prévoient pas de
dispositions spécifiques en la matière, et se bornent uniquement
à exercer une sorte de revirement des différentes sanctions
prévues dans les lois civiles et pénales en matière de
droit commun. Néanmoins, il convient d'étudier les obstacles
liés à la nature du droit international, au rang desquels figure
le respect de la souveraineté étatique qui représente un
problème en matière d'effectivité de la répression
dans l'ordre public en haute mer.
B- Le respect de la souveraineté des
Etats
Le droit international est soucieux du respect de
l'identité souveraine des Etats. De ce fait, la souveraineté des
Etats est observée tant dans la portée des conventions
internationales (1) que dans la nature et l'exécution
des normes des institutions internationales(2). Le droit de
la mer, faisant partie du droit international ne peut déroger à
ce principe, et par conséquent son efficacité dans le maintien de
l'ordre public en haute mer est limitée à la volonté et la
bonne foi des Etats.
1) La portée des conventions
internationales
Les conventions internationales sont soumises, dans
leur portée, à l'effet relatif des traités internationaux.
Tout traité a pour effet de produire à l'égard
des Etats parties des droits et des obligations dans leurs rapports mutuels
ou encore de poser une règle de conduite que les parties s'engageront
à suivre. Le traités internationaux n'ont d'effet qu'à
l'égard des parties contractantes qui sont ainsi tenues de se conformer
aux obligations qu'elles ont convenues d'exécuter. L'effet relatif des
traité est gouverné par la règle
« pacta sunt servanda »
énoncée à l'article 26 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités de 1969, qui voudrait que tout
traité en vigueur lie les parties et soit exécutée de
bonne foi.
Il est important de mentionner que cette règle ne peut
prendre effet que si les Etats parties ont ratifié le traité en
question à travers des instruments de ratification, qui
démontrent de manière explicite cette ratification. Dans
le cadre des conventions internationales sur la haute mer, nous constatons que
la plupart des Etats, bien qu'ayant adhéré et signé les
ces conventions, ne les ont pas ratifiés226(*). Ainsi, les Etats
ne peuvent pas appliquer les conventions internationales auxquelles ils ont
adhéré, et par conséquent celles-ci ne peuvent entrer en
vigueur dans leurs ordres juridiques internes. Le manque de ratification des
conventions internationales par les traités est donc un frein à
l'effectivité de l'application des mesures préventives et
répressives en matière de sécurité et de
sûreté en haute mer. Par conséquent, cette situation peut
entrainer des troubles à l'ordre public en haute mer, dans la mesure
où les navires des Etats qui ne sont pas solennellement liés par
ces conventions, peuvent agir en toute impunité en haute mer. Il en
est de même des Etats tiers qui ne sont pas en principe liés par
les conventions auxquelles ils n'ont pas adhéré. De ce fait, ils
ne sont pas soumis au respect des obligations des conventions
internationales.
Par ailleurs, le respect de l'identité souveraine des
Etats s'observe également dans la portée des décisions
prises par les institutions et dans l'exécution de ces
décisions
2) La nature et l'exécution des normes des
institutions internationales
Les institutions internationales, en ce qui concerne la
règlementation de la haute mer, élaborent des normes qui
constituent des lignes de conduite qui devront être mises en oeuvre par
les Etats. Ceci est articulé dans les différents codes
élaborés par l'OMI, l'OIT, la FAO et les différents
organes régionaux dans le domaine de la pêche et de
l'environnement (en ce qui concerne la pollution). Ces codes précisent
les différentes procédures que doivent adopter les Etats, afin de
protéger et de préserver l'environnement de la haute mer.
De plus, les institutions internationales prennent
généralement des directives, des recommandations, des
règlements. Ces diverses normes lient de manière relative
les parties qui sont tenues d'une part par un résultat, laissant ainsi
la possibilité aux Etats quant aux moyens et à la forme,
d'atteindre les résultats escomptés par les diverses institutions
internationales. D'autre part, les recommandations ne lient pas les parties
qui ne sont pas obligées de les appliquer.
L'effectivité et l'efficacité du maintien de
l'ordre public en haute mer sont donc soumises à la bonne foi des
Etats qui peuvent appliquer ou non ces normes. Il en est de même de
l'exécution des décisions des institutions judiciaires
internationales, du fait de l'absence de mesures contraignantes à
l'égard des Etats. Ces institutions, judiciaires ou non, ne peuvent
contraindre les Etats du fait de la reconnaissance de leur souveraineté
en droit international. En définitive nous pouvons dire que la bonne foi
des Etats dans l'exécution des décisions internationales, reste
l'outil de la garantie de l'ordre public en haute mer. Cet espoir basé
uniquement sur la bonne foi des Etats ne peut être le seul facteur de
garantie permanente de l'ordre public en haute mer.
Néanmoins, les institutions internationales ont pris
des mesures pour pallier aux différents obstacles au maintien de l'ordre
public en haute mer.
SECTION II : LE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ET DE
LA SURETE EN HAUTE MER PAR LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES
Le renforcement de la sécurité
et de la sûreté en haute mer s'opère par le biais des
différentes mesures de contrôle, suivi et surveillance de la mise
en oeuvre par les Etats, des normes internationales (Paragraphe
I). De plus, certaines institutions internationales mettent en oeuvre
des actions afin participer à l'efficacité du maintien de
l'ordre public en haute mer (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I: LES MESURES DE CONTROLE, SUIVI, ET
SURVEILLANCE DE LA MISE EN OEUVRE DES NORMES INTERNATIONALES
Ces différentes mesures s'appréhendent sous
deux angles : dans le domaine de la navigation (A), et
dans les domaines de l'environnement et de la pêche
(B).
A- Dans le domaine de la navigation
L'OMI étant l'institution des Nations Unies
chargée de la règlementation du secteur maritime, a pour
principale mission d'assurer et de préserver le secteur maritime de
toute sorte d'atteinte, avec pour fondement l'observation d'un environnement
efficace et durable. Ainsi, pour renforcer davantage l'application effective
de ses instruments par les Etats, le Comité de la
coopération technique (TCC) de l'OMI a mis sur pied le
Programme Intégré de Coopération Technique (PICT) depuis
1990. L'un des principes clés de ce Programme227(*) est de s'assurer, par le
biais de système de suivi et d'exercices d'évaluation de
l'impact, que les objectifs des différents programme de l'Organisation
sont efficaces et atteints.
Par ailleurs, afin d'améliorer l'efficacité de
ce Programme, l'OMI a élaboré un cadre de contrôle,
d'évaluation et d'audit, qui se matérialise par une
évaluation sur place, une évaluation rétrospective et un
exercice d'évaluation d'impact. De plus, la fonction du TCC a
été renforcée, en ce qui concerne la mise en oeuvre des
activités de coopération technique de l'Organisation, par le fait
qu'il est tenu d'examiner et d'approuver des rapports très complets sur
l'exécution du PICT et sur les exercices d'évaluation de
l'impact. Il importe de mentionner que la mission de l'OMI entre dans une
certaine mesure dans le cadre de la préservation de l'environnement.
B- Dans les domaines de la pêche et de
l'environnement
S'agissant de la pêche des Plans d'Actions
Internationales (PAI)228(*) ont été
élaborés par la FAO afin de dresser des lignes de conduites
à l'égard des Etats, dans l'optique de protéger et de
préserver les activités de pêche en haute mer ainsi que
l'environnement. Dans le cas de la mise en oeuvre de ces plans, les Etats et
les organisations régionales de pêche sont invités à
rendre compte de l'évolution de la situation, dans le cadre de leur
rapport biennal. La FAO quant à elle procède à leur
publication à temps opportun. De même, le Comité de
pêche de la FAO rend compte, tous les deux ans, des progrès
accomplis dans la mise en oeuvre de ces Plans en se basant sur une analyse
détaillé effectuée par le Secrétariat de cette
Organisation.
Dans le domaine de l'environnement, plus
précisément en ce qui concerne la lutte contre la pollution en
haute mer, il n'existe pas de mécanismes adéquats et favorables
au suivi des normes internationales édictées par diverses
institutions. Les différentes mesures de suivi et de contrôle de
l'OMI peuvent être ralliées dans le cadre de la
préservation de la sécurité maritime et de
l'environnement, en matière de lutte contre la pollution. Par ailleurs,
il existe un organisme qui participe activement dans la préservation de
l'environnement marin notamment l'AESM, qui fera l'objet d'un autre
développement dans le cadre de l'action des instituions
internationales.
PARAGRAPHE II : LES ACTIONS DES INSTITUTIONS
INTERNATIONALES DANS LA SECURITE ET LA SURETE EN HAUTE MER
Il s'agit de la participation de certaines
institutions en termes d'opérations au le maintien de la paix et la
sécurité, ainsi que de l'ordre public en ce qui concerne la haute
mer. Ainsi des navires battant pavillon des organisations internationales
(A) et d'autre part, la participation de l'OTAN jouent un
rôle important(B).
A- Le rôle des navires battant pavillon des
organisations internationales
Un accent est mis sur le fondement de l'existence ces types de
navires (1) et sur leur pratique (2).
1) Fondement juridique
L'évolution juridique de l'attribution du pavillon des
organisations internationales se caractérise par le pragmatisme, bien
que le sujet ait fait l'objet de plusieurs débats229(*) en ce qui concerne
l'immatriculation des navires ayant un lien de rattachement avec
l'organisation. C'est ainsi que la Convention de Genève sur la Haute mer
(CGHM) de 1958 est restée évasive sur la question ; il en a
été de même en ce qui concerne la CNUDM de 1982. Ainsi,
l'article 93 de la CNUDM stipule que : « Les
articles précédents ne préjugent en rien la question des
navires affectés au service officiel de l'Organisation des Nations
Unies, de ses institutions spécialisées ou de l'Agence
internationale de l'énergie atomique battant pavillon de
l'Organisation ». De plus, aucune précision n'a
été apportée ni sur le lien de rattachement avec
l'organisation internationale, encore moins sur la juridiction applicable.
Cependant, nous pouvons dire que cette clause de sauvegarde
vise les dispositions précédant cet article, s'agissant des
droits et des obligations de l'Etat du pavillon. Egalement nous pouvons
déduire que le terme « service
officiel » constitue le fondement de l'utilisation du
pavillon par les organisations internationales. C'est dire que le service
officiel est entendu comme « une activité
effectuée par une organisation internationale, dans l'exercice de sa
mission, pour satisfaire un besoin d'intérêt
général »230(*). Il convient dès lors
d'étudier la pratique des navires battant pavillon des organisations
internationales.
2) La pratique de ces types de navire
Au regard de la pratique, de nombreuses organisations
arborent leurs pavillons sur les mers. S'agissant des Nations Unies,
l'utilisation de pavillons s'opère suivant les nécessités
de ses buts et principes. Le principe directeur de l'utilisation de navires par
les Nations Unies est énoncé dans le modèle
d'accord sur le statut des forces pour les opérations de maintien de la
paix qui prescrit : « Le Gouvernement
reconnaît à l'opération de maintien de la paix des Nations
Unies le droit d'arborer à l'intérieur du [pays ou territoire
hôte] le drapeau des Nations Unies sur les lieux de son quartier
général et de ses camps ou autres installations, ainsi que sur
ses véhicules, navires, etc»231(*).
En dehors de l'exercice de sa mission de maintien de la paix
et de la sécurité internationales, l'ONU peut avoir recours aux
navires de ses Etats pour la réalisation des projets de la FAO et du
PNUD232(*), mais
également dans le cadre des assistance humanitaires, et de la recherche
scientifique marine.
Par ailleurs, on observe d'autres cas où les navires
battent pavillon d'autres organisations internationales, bien que la CNUDM ne
l'ait pas prévu. C'est le cas de l'Agence Européenne
pour la Sécurité maritime (AESM). Les récents
accidents survenus dans les eaux communautaires, notamment le naufrage
des pétroliers «Erika» (1999) et « Prestige »
(2002), ont conduit la Communauté européenne à
adopter des mesures législatives233(*), afin de renforcer la sécurité et de
prévenir la pollution dans les transports maritimes. En plus de sa
mission d'assistance technique et scientifique aux Etats membres et la
Commission, dans la mise en oeuvre des normes communautaires en matière
de sécurité maritime et de prévention de pollution par
les navires, des moyens supplémentaires lui ont été
octroyés. En effet, le Règlement (CE) 724/204 du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004234(*) a permis à l'Agence
d'affréter par contrat seize navires marchands pouvant être
rapidement transformés en navires dépollueurs235(*).Ces bâtiments
affrétés qui portent sur leur château le logo de l'AESM
pourraient constituer l'embryon d'une « garde côtière
européenne »236(*).
Il importe de mentionner qu'il existe une autre organisation
à compétence régionale qui agit de manière
efficiente en matière de sécurité en haute mer :
c'est le cas de l'OTAN qui fera l'objet d'un autre développement.
B- La participation de l'OTAN
Le rappel des missions de l'OTAN (1) est
primordial avant de préciser ses différentes opérations
dans le cadre du maintien de la sécurité en haute mer
(2).
1) Rappel des missions de l'OTAN
D'abord, l'OTAN a pour première mission la
défense collective telle que consacrée par l'article
5 du Traité de l'Atlantique Nord. Pour cela elle
dispose de moyens appropriés, à savoir une structure de
commandement militaire intégrée237(*) et les forces maritimes multinationales
intégrées, élément central des capacités
maritimes de l'OTAN, auxquelles on peut faire appel en toutes circonstances
pour fournir un appui maritime aux opérations de l'Alliance.
Ensuite, l'OTAN a pour mission d'établir des
partenariats maritimes et la diplomatie navale. Ces deux
modalités ont pour but de renforcer les capacités et, de
faciliter l'interopérabilité dans le domaine maritime.
Les commandements maritimes de l'OTAN et les Groupes maritimes
permanents jouent un rôle de premier plan à tous les
niveaux de la politique d'ouverture maritime de l'OTAN, réalisant des
visites diplomatiques de routine aux pays membres, pays partenaires et autres
pays non membres de l'OTAN.
L'OTAN contribue par ailleurs à la
sécurité maritime en menant des opérations
destinées à améliorer et à renforcer la
sécurité en mer. L'OTAN participe désormais activement
à la sécurité des flux maritimes le long des voies de
communications maritimes vitales et à la lutte contre les
activités illicites en mer, endossant de ce fait des fonctions visant
à faire respecter la loi.
2) Les opérations de l'OTAN
L'Opération Active Endeavour (OAE) est
un exemple de l'importance de l'OTAN dans le maintien de la
sécurité en haute mer. En effet, le mandat de cette
opération a été élargi en 2004 pour couvrir non
seulement le secteur oriental de la Méditerranée mais aussi
l'ensemble des eaux internationales de la mer Méditerranée. Cette
opération a pour principal objectif de détecter et de
prévenir par la dissuasion les menaces terroristes grâce à
une présence maritime de l'OTAN en Méditerranée. Par
ailleurs, les règles d'engagement de l'OAE ont également
été renforcées en avril 2003 pour permettre
l'arraisonnement selon le droit international de bâtiments suspects (soit
la possibilité d'arraisonner un navire avec le consentement du
commandant de bord et de l'Etat du pavillon).238(*) Depuis octobre 2004, l'OAE est devenue une
opération axée sur l'information et le renseignement, qui
s'emploie à rassembler et à traiter des informations concernant
certains navires d'intérêt particulier plutôt que de
patrouiller.
Par ailleurs, suite à la multiplication sans
précédent des actes de piraterie au large de la Somalie, le
Conseil de l'Atlantique Nord a adopté un mandat élargi (le 17
août 2009) et a lancé la nouvelle opération
OceanShield. Cette opération avait pour but de fournir une
contribution à long terme à l'OTAN, de dissuader, combattre et
démanteler les activités de piraterie dans la zone.
Malheureusement les Alliés avaient décidé en
février 2010 de proroger cette opération jusqu'à fin 2012.
Il convient à présent d'appréhender dans
quelle mesure le maintien de l'ordre public peut être plus efficace.
CHAPITRE IV: PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE L'ORDRE
PUBLIC EN HAUTE MER
Le maintien de l'ordre public en haute mer
fait appel à des propositions de solutions qui seront aptes à
faire perdurer le respect de l'ordre public. Ces perspectives constituent des
palliatifs aux différentes limites à l'efficacité et
l'effectivité de l'ordre public en haute mer. Ces solutions peuvent
participer à un meilleur encadrement, et par là même,
à un meilleur cantonnement des troubles à la tranquillité,
la sécurité et la salubrité publiques en haute mer. Ce
n'est que par le maintien effectif et efficace de l'ordre public en haute mer
que les générations avenir pourront jouir des idéaux de la
notion de développement durable. C'est dans ce cadre que la
coopération paraît prioritaire en termes de préservation
non seulement de la sécurité et de la sûreté, mais
également en ce qui concerne l'environnement physique de l'espace marin
de la haute mer. Ainsi, la coopération, en matière juridique et
technique, est primordiale pour la communauté internationale
(Section I).
Par ailleurs, il importe de noter que la coopération
à elle seule ne peut résoudre de manière durable les
problèmes liés à l'ordre public en haute mer. Ainsi, la
nécessité du renforcement de la cohérence des politiques
et structures institutionnelles (Section II) est
incontournable en la matière.
SECTION I : L'IMPORTANCE DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE EN MATIERE JURIDIQUE ET TECHNIQUE
La CNUDM, en tant que « Charte du
droit de la mer », est le fondement juridique de la
coopération, dans le sens où elle sert de point de départ
de la prise en considération, par les sujets de droit international, de
l'importance cette modalité dans l'évolution et
l'efficacité de l'ordre public en haute mer. La coopération
internationale est une modalité importante en ce qui concerne la gestion
et l'encadrement des questions menaçant l'ordre public, dans la mesure
où elle est un cadre propice aux négociations entre les sujets
de droit international ayant une personnalité juridique. Cette
modalité est incontournable étant donné que la haute mer
est un bien de l'humanité. Les décisions concernant cet espace ne
peuvent donc être prises sans le concours des Etats.
Bien que la liste des obligations de coopération des
Etats soit limitée239(*), les institutions internationales et
étatiques ont consacré la coopération comme moyen efficace
pour pallier aux atteintes à l'ordre public en haute mer. Ainsi, il
convient d'étudier les aspects de cette coopération notamment en
matière juridique (Paragraphe I) et en
matière technique (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : EN MATERE JURIDIQUE
L'amélioration des différentes modalités
concourant au maintien de l'ordre public en haute mer peut s'opérer par
l'amélioration de l'arsenal juridique dans le cadre de la
coopération internationale (A). De même, une
protection efficace de l'environnement de la haute mer doit s'effectuer
à travers le renforcement de la coopération régionale
(B).
A- L'amélioration de l'arsenal juridique
international
Cette amélioration implique l'examen des solutions aux
obstacles normatifs internationaux (1) et la
réduction des marges de manoeuvres des Etats (2).
1) Les solutions aux obstacles normatifs
internationaux
La prise de mesures juridiques internationales
supplémentaires pour lutter contre les atteintes à l'ordre public
est nécessaire. En effet, les imprécisions et quelques fois le
vide juridique, dont souffrent la majeure partie des conventions
internationales, devraient être remédiés par
l'élaboration de normes internationales plus précises et
beaucoup plus centrées sur les spécificités des
infractions (en ce qui concerne la piraterie, le trafic de stupéfiants
et de substance psychotropes, l'immigration clandestine et la pollution)
commises en haute mer.
L'adaptation des normes internationales au contexte
réel des troubles à l'ordre public en haute mer est
primordiale. Cela permettrait une meilleure qualification de ces
troubles, et par là même, une meilleure application par les
Etats dans leurs ordres juridiques des normes internationales. Aussi, dans
le même ordre d'idées, les organisations internationales
devraient prévoir, de manière très
détaillée, les mesures que doivent prendre les Etats tant en
matière de prévention qu'en matière de répression
des atteintes à la sécurité et à la
sûreté en haute mer.
En outre, le renforcement de la coopération
internationale entre les instances judiciaires et répressives
paraît nécessaire. En effet, dans un contexte de
mondialisation où la criminalité transnationale ignore les
frontières étatiques et la souveraineté des Etats,
il devient indispensable d'avoir une approche globale de la lutte
contre cette forme de criminalité240(*). Les Etats gagneraient ainsi à
coopérer en matière de police de pêche, afin de
poursuivre et de sanctionner, de manière efficace, les auteurs
d'infractions portant atteinte à la sécurité et à
la sûreté en haute mer. De même, pour lutter de
manière efficace contre la criminalité en haute mer, il est
nécessaire de mettre en oeuvre des actions coercitives à long
terme et qui dépassent les frontières. Le Conseil de
Sécurité des Nations Unies jouerait un rôle
prépondérant dans le cadre de son mandat de garant de la paix et
de la sécurité internationales, dans la lutte contre la
criminalité en haute mer.
Par ailleurs, il importe de mentionner que la
réduction des marges de manoeuvres accordées aux Etats dans les
normes internationales, participerait également de manière
efficace au maintien de l'ordre public en haute mer.
2) La réduction des marges de manoeuvres
accordées aux Etats
L'absence et l'insuffisance du contrôle par les Etats
complaisants résultent de la multiplication des pavillons de
complaisance en haute mer. Par conséquent, cette situation est souvent
à l'origine de violations de l'ordre public en haute mer. Ainsi, les
marges de manoeuvre des Etats devraient être réduites en
matière de prévention et de répression de
sécurité et sûreté maritimes. Ainsi, la lutte contre
les pavillons de complaisance a une importance particulière en ce qui
concerne la prévention de la pêche INN. La diminution des
pavillons de complaisance augmenterait la capacité des Etats à
contrôler et à surveiller leurs navires, ce qui participerait de
manière efficace à la lutte contre la pêche
INN.
Le principe de la compétence exclusive de la loi de
l'Etat du pavillon devrait être atténué au profit du
renforcement de la compétence de l'Etat côtier et de l'Etat du
port, en ce qui concerne la sécurité maritime. En effet, l'Etat
côtier tout comme l'Etat du port dispose de moyens appropriés pour
prévenir et réprimer les atteintes à la
sécurité en haute mer. L'Etat côtier est
généralement doté de moyens techniques, tels que les
gardes-côtes qui procèdent à la poursuite et au
contrôle des navires. L'Etat du port procède à l'inspection
du navire et contrôle l'application par les navires des dispositions
internationales en matière de sécurité.
Un autre aspect non négligeable dans le maintien de
l'ordre public en haute mer est la protection de l'environnement dans le cadre
du développement durable. Pour cela, le renforcement de la
coopération régionale est nécessaire.
B- Le renforcement de la coopération
régionale pour la protection de l'environnement de la haute
mer
La lutte globale-régionale contre la pollution des mers
est une approche juridique élaborée pour la protection et la
préservation d'un milieu marin régional particulier La
coopération régionale dans le cadre de la protection de
l'environnement de la haute mer devrait s'intensifier par la création de
conventions régionales ayant pour champ d'application les espaces de
haute mer situés dans une région donnée. Ces conventions
constituent un réseau cohérent, facilement adaptable et qui peut
se répartir en deux catégories : les Conventions
régionales préventives contre les nuisances destinées
à préserver et protéger l'environnement marin et les
conventions curatives destinées à organiser la
coopération en cas de situation critique.
Les conventions pour la protection des mers régionales
ont principalement pour objectifs de réduire ou supprimer les pollutions
à leur source, et de protéger les milieux marins non encore
dégradés241(*). Ces conventions se situent dans un contexte global
de préservation et de restauration des ressources biologiques en haute
mer.
Par ailleurs, l'amélioration du maintien de l'ordre
public en haute ne saurait être effective si les Etats ne disposent pas
de ressources adéquates. En effet, certains Etats moins nantis que
d'autres, ne disposent pas de moyens financiers et techniques, pour assurer de
manière efficace le contrôle et le suivi des navires, d'où
l'importance de la coopération internationale en matière
technique pour y remédier.
PARAGRAPHE II : EN MATIERE TECHNIQUE
La coopération internationale est nécessaire
pour s'attaquer aux inéquités entre les pays riches et les pays
moins nantis. Elle permet de pallier au déficit technique et financier
dont souffrent certains Etats pour mettre en oeuvre les normes
préconisées par le droit international. De ce fait, il importe
d'analyser le rôle de l'assistance entre les Etats (A)
avant de s'attarder sur le renforcement technique et
opérationnel dans les organisations régionales et
sous-régionales (B).
A- L'importance de l'assistance entre les
Etats
Cette assistance est incontournable en matière
d'effectivité du maintien de l'ordre public en haute mer dans la mesure
où les Etats dépourvus de ressources adéquates ne
sauraient appliquer les différentes dispositions du droit international.
Ainsi, une assistance technique (1) de la part des pays
développés aux pays moins nantis pour pouvoir appliquer les
normes internationales. De plus, l'assistance technique ne saurait être
valable sans l'assistance financière (2).
1) L'assistance technique
L'effectivité des mesures de prévention et de
répression liées aux infractions commises en haute est soumise
à leur mise en oeuvre par tous les Etats. Force a été de
constaté que l'effectivité de ces mesures est limité par
le défaut de moyens techniques de certains pays en voie
développement. En effet, la mise en oeuvre par les pays en voie de
développement, des activités liées à la protection
de l'environnement de la haute mer doit correspondre au niveau de
capacité technologique de chacun d'entre eux, et dépend en
dernière analyse des transferts de technologie et des moyens financiers
nécessaires qui sont mis à leur disposition.
Ainsi, en ce qui concerne les activités de protection
de l'environnement de la haute mer par les pays en voie de
développement, les Etats développés doivent soutenir les
efforts que feraient ces pays, en leur fournissant ou en leur facilitant
l'accès aux technologies moins polluantes et aux travaux de recherche
pertinents242(*).
L'assistance des pays développés envers les pays qui le sont
moins, leur permet de se sentir responsables et d'agir aussi pour la
préservation du milieu marin en adhérant aux Conventions. Les
Organisations Internationales ont un rôle d'assistance technique non
négligeable qui aide certains États à être en mesure
de respecter les obligations des Conventions. Un système de surveillance
par les États en continu et d'évaluation écologique est
mis en place.
De plus, en ce qui concerne la pollution en haute mer, l'OMI
et les autres organismes des Nations Unies compétents devraient, lorsque
les Etats concernés le demandent, évaluer le cas
échéant, l'état de la pollution marine. Cette
évaluation a pour but de faire respecter les réglementations
internationales, généralement acceptées, en particulier
celles qui ont trait aux rejets illicites des navires, conformément aux
dispositions de la Partie III de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer. Il convient à présent d'étudier l'assistance
financière aux pays en développement.
2) L'appui de l'assistance
financière
L'assistance financière s'opère par le biais des
accords de partenariats entre les organisations régionales et les pays
en voie de développement. L'UE est un acteur incontournable dans le
développement du secteur de la pêche. La multiplication des
accords de partenariats est de ce fait nécessaire dans le cadre de la
coopération au développement du secteur de la pêche. Le
renforcement de la gestion et de la conservation durable des ressources dans
le cadre de la coopération entre l'Union Européenne et les pays
(Afrique Caraïbes Pacifique) ACP est donc important.
Cette coopération au développement pourrait
contribuer à préparer ou à rehausser la base sur laquelle
reposent les accords de partenariats, à savoir : le renforcement des
capacités, la formulation d'une politique sectorielle, la gestion des
ressources (SCS, recherche, etc.), l'infrastructure, et la promotion du
commerce et des investissements. Cela pourrait s'appliquer en particulier aux
pays partenaires qui ont obtenu via l'APP une contribution financière
relativement limitée. Par ailleurs, il convient d'étudier
l'assistance technique dans le cadre régional.
B- Le renforcement technique et opérationnel
dans les organisations régionales et sous-régionales
Les organisations régionales et sous régionales
devraient harmoniser leurs différentes politiques et par là
même leurs différentes législations nationales. La
coopération régionale au sein de ses institutions doit porter sur
les différentes questions de sécurité et de
sûreté en haute mer. Des partenariats entre les pays membres
doivent s'intensifier au moyen d'assistance technique et financière au
pays dépourvus de capacités pour la mise en oeuvre des normes
internationales.
Des politiques maritimes intégrées devraient
être mis en place afin de renforcer la sécurité et la
sûreté des espaces de la haute mer de cette région. Ainsi,
des mécanismes et outils de surveillance maritimes tels que des
patrouilles maritimes communes seraient utiles en matière de
prévention. Le déploiement de patouilles navales permanentes
auront les mêmes pouvoirs que la police dans le cadre de l'action de
l'Etat en haute mer. De fait, on assistera à l'élargissement de
la compétence des Etats membres aux organismes
régionaux243(*)
institués par l'organisation régionale ou sous régionale.
Le renforcement technique et opérationnel de ces
organisations permettra la mise en oeuvre effective des normes internationales
en matière de sécurité en haute mer, au niveau des
différentes régions et de manière efficace.
Il convient à présent d'examiner renforcement
de la cohérence des politiques institutionnelles au niveau
international, dans le cadre d'une gouvernance internationale en haute mer.
SECTION II : LE RENFORCEMENT DE LA COHERENCE DES
POLITIQUES SECTORIELLES DES ETATS
La coordination des politiques des Etats en ce qui concerne
l'encadrement de la haute mer est nécessaire dans une optique de
cohérence (Paragraphe I). De plus, la
nécessité de l'adoption d'une gouvernance internationale pour la
protection de l'environnement de la haute mer est incontournable
(Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA COORDINATION DES POLITIQUES
NATIONALES
La vulgarisation des informations
(A) est le vecteur non négligeable en matière
de coordination des politiques. Cependant, l'intensification de la formation
du personnel (B) est un élément important en
matière de sécurité maritime.
A- La vulgarisation des informations
La vulgarisation des informations en matière de
sécurité et de sûreté en haute mer est
nécessaire, dans la mesure où elle contribuera à
l'amélioration dans l'adoption de mesures adéquates pour
prévenir et réprimer toute infraction à l'ordre public.
Cette modalité revêt deux aspects, à savoir
l'établissement d'un système d'échange d'informations
(1) et la sensibilisation du public (2).
1) L'établissement d'un système
d'échanges d'informations
L'intensification des échanges d'informations
entre les Etats participera à une meilleure coordination des politiques
étatiques. En outre le concours des organisations
internationales est nécessaire pour cette coordination.
L'intensification des échanges est primordiale tant dans le domaine de
la pêche que dans le domaine de la sécurité. En effet la
diffusion d'informations entre les Etats est nécessaire en
matière de prévention technique de la piraterie, dans la mesure
où elle vise à réduire l'exposition des navires. De
même la diffusion d'informations permet de sensibiliser les
opérateurs économiques et les Etats aux enjeux de la piraterie.
En outre le renseignement est une priorité en
matière de prévention des infractions et dans le cadre du
développement durable en haute mer. Le renforcement des
capacités de renseignement est nécessaire pour la prise de
décisions adéquates tant au niveau régional qu'au niveau
international dans le cadre du développement durable. Ainsi, certaines
missions relevant de la compétence d'un garde-côte
requièrent une coopération en matière de renseignement,
suivi, voire d'intervention en haute mer244(*). De ce fait, il faudrait étudier le
développement de systèmes de suivi et de surveillance.
L'insuffisance d'information des pays en développement,
dans le contexte du Code de conduite pour une pêche responsable,
devrait être remédiée par l'assistance requise par les
institutions de pêche des pays en développement. Cette solution
est nécessaire pour vérifier que l'infrastructure des TIC est
suffisante et appropriée, et pour renforcer le développement de
la capacité humaine, afin qu'ils deviennent des partenaires à
part égale dans les réseaux d'information245(*).
Par ailleurs, la désignation d'un organisme
national chargé d'enregistrer les données relatives aux
accidents en mer est d'une importance capitale. L'analyse des
données peut avoir un effet positif sur la formulation et
l'amélioration des programmes de sécurité en haute mer,
sur la détermination du coût des accidents en mer en termes
de vies perdues, et sur l'établissement d'un budget public pour
les interventions futures246(*). Il est donc recommandé à chaque pays
de désigner cet organisme qui aura pour mission d'enregistrer et
d'analyser tous les accidents en haute mer.
Cependant, il convient d'étudier les possibilités
d'accès des individus aux informations, afin de mieux les
sensibiliser.
2) La sensibilisation du public
La sécurité et le développement durable
de la haute mer devraient être préservés au moyen de
l'éducation et de l'information du public. Le public visé
ici représente les différents opérateurs tant
économiques que scientifiques sur les diverses normes internationales
règlementant les différentes activités de la haute
mer. La plupart de ces opérateurs n'ont pas suffisamment
conscience de l'importance des mesures de sécurité et de
sûreté en haute mer. Il est donc important que la
communauté internationale soit constamment sensibilisée à
ces questions (par la presse locale et des programmes radio), de manière
à ce que ces opérateurs se familiarisent davantage sur les
questions et enjeux de la haute mer pour l'humanité.
L'éducation au moyen de campagnes
répétées, renforcées par une action à long
terme semble offrir les meilleures chances de voir s'améliorer la
sécurité et la sûreté en haute mer. Dans le
même ordre d'idées, la formation du personnel de l'Etat du port
et des navires est nécessaire afin de faire respecter les normes
environnementales et de sécurité en haute mer.
B- L'intensification de la formation du
personnel
L'insuffisance de personnel qualifié en
matière de sûreté des navires et de sécurité
est un obstacle dans la mise en oeuvre des normes internationales. Ainsi, il
importe d'intensifier la formation tant du personnel des navires que du
personnel administratif des ports. Cette intensification peut s'opérer
à travers l'organisation d'ateliers et de programmes de formation par
les organisations internationales et régionales, en matière de
sécurité et de sûreté en haute mer. Les Etats
peuvent également en faire autant.
Un personnel qualifié en matière de
sécurité et de sûreté est apte à prendre
des mesures adéquates pour prévenir et réprimer les
infractions liées aux activités de pêche. C'est dans cette
optique qu'il est important de présenter les différents aspects
de la formation du personnel en matière de sécurité et de
sûreté (1) et en matière technique et
commerciale (2).
1) En matière de sécurité et de
sûreté
La formation à la sécurité porte
sur les équipages, la sécurité du navire, la cargaison et
l'environnement et elle est couverte par l'OMI : les Conventions STCW,
SOLAS et MARPOL et les obligations qu'elles imposent. Par ailleurs, des stages
et évaluations doivent être mis sur pied et permettront aux
membres de l'équipage d'acquérir des certificats de
compétences dans les domaines de la veille, de la lutte anti-incendie,
de la sécurité sur les pétroliers et du transport de
marchandises dangereuses247(*).
En outre, une autre obligation de cette formation est qu'elle
doit être effectuée à bord des navires à travers des
démonstrations, d'exercices pratiques et de l'utilisation des
équipements (les gilets de sauvetage et extincteurs d'incendies) et
des processus d'urgence tels que les cas de collision ou de pollution.
La formation à la sûreté porte sur
les différentes opérations de contrôle au niveau des
ports. Il s'agit ainsi, de la formation du personnel administratif des
ports tels que les inspecteurs et les agents de la douane.
Par ailleurs, il est requis une formation spécifique en
matière de surveillance des navires et de la préservation de
l'environnement marin, dans les activités commerciales en haute mer.
2) En matière technique et
commerciale
La formation technique est étroitement
liée à la formation dans le domaine de la sécurité.
Cependant, cette formation diffère de celle liée à la
sécurité, en ce qu'elle n'est obligatoire que pour
l'interprétation générale des normes du Code ISM. Cette
formation porte donc sur les équipements très
perfectionnés dont les navires sont souvent dotés, et sur la mise
en place des nouvelles techniques ou procédés à bord,
qu'il s'agisse de l'installation d'un nouveau radar ou d'une modification
à la procédure de soutage.
La formation commerciale quant à elle
porte sur les opérations commerciales associées au navire et
à son exploitation, les procédures et procédés
visant à satisfaire aux obligations contractuelles de l'exploitation,
plutôt qu'aux obligations légales (charte-partie et droit
contractuel, contentieux sur les marchandises, etc.). Elle couvre
également les obligations commerciales et sociales associées
à la gestion de l'équipage (paie, indemnisations, accidents de
travail).
Cependant, il importe de mentionner que ces différentes
formations ne sont pas exclusives l'une de l'autre comme l'a rappelé la
FAO, en ce qui concerne la formation des pêcheurs pour les programmes de
sécurité en haute mer248(*).
Néanmoins, l'adoption d'une gouvernance internationale
en haute mer est nécessaire pour la protection de l'environnement
marin, qui s'inscrirait ainsi dans la perspective d'un développement
durable.
PARAGRAPHE II : LA NECESSITE DE L'ADOPTION D'UNE
GOUVERNANCE INTERNATIONALE EN HAUTE MER POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
La protection de l'environnement de la haute mer en tant que
« bien commun de l'humanité » est importante pour de
développement durable de cet espace. Ainsi, il est primordial
d'étendre les aires marines protégées (AMP) aux autres
régions de la haute mer qui n'en font pas partie. Il faudrait donc
créer un réseau mondial d'AMP (A). Par ailleurs,
la compétence de l'Autorité Internationale des Fonds Marin dans
la préservation du milieu marin devrait être élargie
à la haute mer (B).
A- La création d'un réseau mondial
d'aires marines protégées
De prime à bord il est important de rappeler les
objectifs des AMP (1) avant d'appréhender la
gouvernance du réseau mondial d'Aires Marines
Protégées(2).
1) Rappel des objectifs des AMP
La création d'aires marines protégées
(AMP) découle du constat qu'il est nécessaire de protéger
la biodiversité marine en favorisant la conservation des
écosystèmes, des espèces et des habitats dans leur milieu
naturel. Les AMP sont considérées comme des outils adaptés
à la protection des océans et leur biodiversité. Les AMP
ont pour fondement l'article 194 alinéa 5 de la CNUDM qui stipule -
dans le cadre des mesures visant à prévenir, réduire ou
maîtriser la pollution du milieu marin - que «Les
mesures prises conformément à la présente partie
comprennent les mesures nécessaires pour protéger et
préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi
que l'habitat des espèces et autres organismes marins en
régression, menacés ou en voie
d'extinction ». Cet article s'applique donc sur tous
les océans et mer, y compris dans les zones au-delà des
juridictions nationales.
Ainsi, l'institution d'AMP en haute mer a été
l'initiative prise par les Parties à la Convention OSPAR, de
créer six aires marines protégées en haute mer lors de la
réunion ministérielle de Bergen en septembre 2010, et a
été saluée par la communauté
internationale249(*). Toutefois, la seule
désignation d'aires marines protégées ne saurait
être suffisante. Elle doit nécessairement être suivie
par l'adoption de plans de gestion contraignants, adaptés aux menaces
pesant sur les écosystèmes et opposables au plus grand nombre.
Initialement, le souci de la création d'un réseau mondial d'AMP
a été pris en compte dans le plan d'action de Johannesburg de
2002, où les Etats s'étaient engagés à mettre en
place ce réseau au plus tard en 2012.
Par ailleurs, il se pose le problème de l'adoption de
la gouvernance de ces AMP.
2) La gouvernance du réseau mondial d'AMP
Un bon nombre d'organismes dans le cadre de la CNUDM
partagent les mandats des mesures de protection des zones internationales de
fonds marins et celles des hautes mers. La nécessité de
déterminer les principes communs de protection de
l'écosystème et des espèces vulnérables de ces
zones ne peut s'opérer que par le biais d'une coopération et
d'une collaboration internationale. Ceci permettra créer un
réseau écologiquement cohérent d'AMP. De même, ce
type de mesures conservatoires ne doit en aucune manière
entraîner une forme de revendication nouvelle de territoires
au-delà des zones de juridiction nationale250(*).
Un réseau écologiquement
cohérent d'AMP bien gérées soutiendrait
l'écosystème au sens large, dans la mesure où
espèces et habitats d'une AMP dépendent des processus se
déroulant en dehors de cette AMP. Le problème qui
se pose est celui de la complexité des rapports entre ces
différentes espèces. Ces rapports s'établissent à
une échelle plus grande que les écosystèmes terrestres
et présentent une importance particulière pour les
espèces très mobiles, telles que certains oiseaux de mer,
mammifères marins et poissons.
Néanmoins, l'instauration et la gestion d'un
réseau mondial d'AMP est impératif, afin de protéger
l'environnement de la haute mer des effets néfastes de l'exploitation
industrielle imminente, des nodules polymétalliques et des gisements
contenus dans les amas sulfurés. Aussi, l'élargissement de la
compétence de l'AIFM en haute mer serait une solution durable pour la
protection de ce milieu, du fait des diverses activités
économiques et industrielles qui s'y déroulent.
B- L'élargissement des compétences de
l'AIFM pour la préservation de l'environnement de la haute
mer
Afin de mieux cerner l'importance que pourrait avoir l'AIFM
dans la préservation de l'environnement de la haute mer, il convient de
préciser ses compétences (1) avant
d'appréhender son apport pour la protection et la préservation
de la haute mer (2).
1) Les compétences de l'AIFM
L'AIFM est une organisation internationale autonome qui a
été créée, conformément à
l'article 156 de la CNUDM et à l'Accord de 1994 relatif
à l'application de la partie XI de ladite
Convention. C'est une organisation par l'intermédiaire de
laquelle les États parties à la Convention, conformément
au régime établi pour les fonds marins et leur sous- sol
au-delà des limites de la juridiction nationale (la Zone) dans la partie
XI et l'Accord, organisent et contrôlent les activités
menées dans la Zone, notamment aux fins de l'administration de ses
ressources. Par ailleurs, elle est chargée de veiller à ce que
les avantages économiques tirés de l'exploitation des ressources
minérales des fonds marins internationaux soient partagés
par les exploitants et la communauté internationale.
En outre, l'article 133 de la CNUDM définit le terme
« ressources » comme :
« toutes les ressources minérales solides,
liquides ou gazeuses in situ qui, dans la Zone, se trouvent sur les fonds
marins ou dans leur sous-sol, y compris les nodules
polymétalliques ». Relevons dans ce cas qu'une
exclusion est faite des ressources vivantes quelles qu'elles soient, notamment
les ressources marines et génétiques. A cet effet, l'AIFM agit
dans le cadre de la protection de l'environnement marin et est
compétente en matière d'adoption des règles,
règlements et procédures visant à prévenir,
réduire et maîtriser la pollution du milieu marin et à
faire face aux autres risques qui le menacent. Aussi, elle accorde une
importance particulière à la nécessité de
protéger l'environnement marin des effets nocifs d'activités
telles que forages, dragages, excavations, élimination de
déchets, construction et exploitation ou entretien d'installations, de
pipelines et d'autres engins utilisés pour ces activités. De
plus, elle participe à la protection et à la préservation
des ressources naturelles de la zone, et à la prévention des
dommages à la flore et à la faune marines.
Compte tenu de ces différentes compétences et de
son importance dans la protection de l'environnement marin, du fait des
spécificités en matière de préservation des
ressources de la ZIFM (Zone Internationale des Fonds Marins), l'AIFM pourrait
avoir un rôle important dans la protection et la préservation de
l'environnent de la haute mer, compte tenu de sa proximité avec cette
dernière.
2) L'apport de l'AIFM dans la protection et la
préservation de l'environnement
Il importe de noter que la ZIFM, qui relève de la
compétence de l'AIFM, se caractérise par l'affectation des
grands fonds marins et de leurs ressources à la communauté
internationale toute entière. La ZIFM, du point de vue
géographique, fait partie des « fonds
marins » de la haute mer dont la délimitation se fait
à partir des lignes de base. Il s'agit donc d'un patrimoine commun de
l'humanité. Compte tenu de ce dernier élément et de sa
similitude en ce qui concerne sa qualification, qui est proche de celle de la
haute mer, la 251(*)possibilité d'extension des compétences
de l'AIFM est donc envisageable
L'AIFM pourrait voir ses compétences
élargies à l'ensemble des ressources biologiques et
génétiques en haute mer ainsi qu'aux activités de
bio-prospection. Afin de garantir une plus grande transparence et
efficacité d'une telle gouvernance, le concours des organismes et
associations, tant nationales qu'internationales, de protection de
l'environnement est important pour le suivi de la mise en oeuvre de ces
nouvelles compétences. Par ailleurs cette initiative nécessitera
une refonte radicale dans le fonctionnement de l'AIFM.
CONCLUSION
L'étude du maintien de l'ordre public en haute mer
s'effectue de prime à bord par l'analyse des différentes
modalités de l'ordre public en haute mer à savoir la
prévention et la répression. De ce fait, la prévention
est l'expression même de l'ordre public en haute mer dans la mesure
où les différentes activités menées en haute mer
sont encadrées juridiquement ainsi que les différentes
infractions constituant des troubles à l'ordre public. Il a donc
été nécessaire d'identifier les différents
éléments constitutifs des troubles à l'ordre public tels
que définis par la CNUDM et les différentes conventions
internationales. Ces infractions sont propres à différents
domaines d'activité en haute mer à savoir la navigation, la
pêche et l'environnement. Il s'agit de prévenir les atteintes
à l'ordre public par la mise en oeuvre de mesures adéquates afin
de préserver l'ordre public en haute mer. Par ailleurs, les
organisations internationales et les Etats sont les principaux acteurs en
matière de prévention. Les organisations interviennent en amont
à travers l'édiction des normes internationales qui
circonscrivent les différentes activités en haute mer ;
ainsi que les droits et obligations des Etats afin d'assurer la
sécurité, la salubrité et la tranquillité publique
en haute mer. Les Etats sont les sujets immédiats de l'ordre public en
haute et y participe dans le cadre de la mise en oeuvre des normes
internationales. En effet, les Etats disposent de modalités
d'aménagement des normes internationales à savoir les mesures
préventives terrestres et les mesures préventives maritimes.
La répression apporte un appui incontestable à
la prévention des troubles à l'ordre public en haute mer dans la
mesure où il a été nécessaire de prendre des
mesures pour réprimer et dissuader les différents contrevenants
à l'ordre public en haute mer. Ainsi, l'aménagement de cette
répression est opéré par les organisations internationales
qui assistent les Etats en matière technique en fixant de
manière générale les modalités
d'aménagement de la répression. Les Etats jouent un rôle
important en ce sens où ils élaborent des conventions
bilatérales ou multilatérales encourageant ainsi la
coopération en matière répressive. De plus deux
juridictions internationales font partie des acteurs contribuant à
l'aménagement des atteintes à l'ordre public. L'une intervenant
à titre subsidiaire dans le cadre de la protection des droits de l'Homme
notamment en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux dans la
procédure répressive : c'est la Cour Européenne des
Droits de l'Homme. L'autre juridiction internationale compétente est le
TIDM qui connaît des différents relatifs à
l'interprétation et à l'application de la CNUDM. De
manière plus pratique, la procédure de répression est
l'intervention corolaire des pouvoirs de police des Etats en mer ayant pour
fondement le principe de la loi de l'Etat du pavillon. Néanmoins
l'intervention revêt diverses techniques qui s'effectuent à bord
des navires et en mer. En outre, le droit international et les droits nationaux
ont prévu des sanctions pénales, administratives et civiles.
Le maintien de l'ordre public en haute mer implique
l'analyse de l'effectivité évaluant ainsi l'efficacité
des mesures préventives et répressives. De ce fait, il a
été important d'analyser les différents obstacles au
maintien de l'ordre public en haute mer. En effet, certaines insuffisances
relèvent du délaissement par les Etats de leur obligation de
contrôle dans le cadre de l'immatriculation des navires. Ceci peut
s'expliquer par l'insuffisance de moyens des Etats. De même, il importe
de noter que ce délaissement peut être à l'origine d'un
désordre de la part des armateurs qui en tirent très souvent des
avantages. Par ailleurs, d'autres obstacles à l'efficacité du
maintien de l'ordre public sont liés à la nature du doit
international à savoir la complexité du droit de la mer et le
problème que pose le respect de la souveraineté des Etats.
Néanmoins, les institutions internationales jouent rôle important
en ce qui concerne l'action de maintenir l'ordre public. En effet, elles
participent au renforcement de la sécurité et de la
sûreté en haute mer par le biais de mesures de contrôle, de
suivi, et de surveillance de la mise en oeuvre par les Etats des normes
internationales. Aussi, ces institutions mènent des opérations au
rang desquelles figure l'OTAN.
Dans une perspective d'amélioration de l'ordre public
en haute mer, la coopération internationale est une modalité
incontournable dans la mesure où elle constitue un cadre à
l'amélioration de l'arsenal juridique face aux différents
obstacles d'ordre juridique à l'effectivité de l'ordre public en
haute mer. D'un autre côté, il est important que les pays
développés assistent financièrement et techniquement les
pays en voie de développement principalement les pays africains qui ne
disposent pas, pour la plupart, de capacité et de ressources pour
appliquer les différentes précautions de l'ordre public en haute
mer. De plus, la coopération régionale est un atout dans le cadre
de la préservation et la protection de l'environnement en haute mer. Il
en est également du renforcement technique et opérationnel dans
les organisations régionales. L'une des autres solutions à
l'efficacité du maintien de l'ordre public en haute mer est le
renforcement de la cohérence des politiques des Etats. Cette
cohérence implique la coordination des politiques nationales à
travers la vulgarisation des informations et l'intensification de la formation
du personnel. L'adoption d'une gouvernance internationale pour la protection
de l'environnement s'avère nécessaire et devrait impliquer la
création d'un réseau d'aires marines protégées et
l'élargissement des compétences de l'AIFM.
Notre hypothèse semble alors être
confirmée ; en effet, le maintien de l'ordre public en haute mer
est effectif et son efficacité est plutôt relative. L'une des
insuffisances de l'ordre public en haute mer est son application relative voir
absente par certains pays dont la majeure partie est en voie de
développement et de ce fait ne disposent ni de moyens, ni de
capacité pour assurer la sécurité, la salubrité et
la tranquillité publique en haute mer.
ANNEXE I : REPRESENTATION DES DIFFERENTS ESPACES
MARITIMES
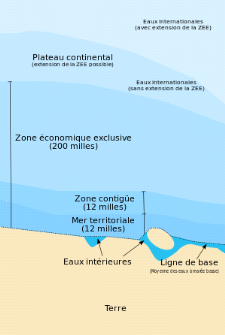
Source :
http://www.google.cm/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Zonmar.svg/
ANNEXE II : EXTRAIT DE LA PARTIE VII DE LA
CNUDM
PARTIE VII
Haute mer
SECTION 1
Dispositions générales
Article 86
Champ d'application de la présente partie
La présente partie s'applique à toutes les parties
de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique exclusive, la
mer territoriale ou les eaux intérieures d'un Etat, ni dans les eaux
archipélagiques d'un Etat archipel. Le présent article ne
restreint en aucune manière les libertés dont jouissent tous les
Etats dans la zone économique exclusive en vertu de l'article 58.
Article 87
Liberté de la haute mer
1. La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu'ils
soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer
s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la
Convention et les autres règles du droit international. Elle comporte
notamment pour les Etats, qu'ils soient côtiers ou sans littoral :
a) la liberté de navigation;
b) la liberté de survol;
c) la liberté de poser des câbles et des pipelines
sous-marins, sous réserve de la partie VI;
d) la liberté de construire des îles artificielles
et autres installations autorisées par le droit international, sous
réserve de la partie VI;
e) la liberté de la pêche, sous réserve des
conditions énoncées à la section 2;
f) la liberté de la recherche scientifique, sous
réserve des parties VI et XIII.
2. Chaque Etat exerce ces libertés en tenant dûment
compte de l'intérêt que présente l'exercice de la
liberté de la haute mer pour les autres Etats, ainsi que des droits
reconnus par la Convention concernant les activités menées dans
la Zone.
Article 88
Affectation de la haute mer à des fins
pacifiques
La haute mer est affectée à des fins pacifiques.
Article 89
Illégitimité des revendications de
souveraineté sur la haute mer
Aucun Etat ne peut légitimement prétendre soumettre
une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté.
Article 90
Droit de navigation
Tout Etat, qu'il soit côtier ou sans littoral, a le droit
de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon.
Article 91
Nationalité des navires
1. Chaque Etat fixe les conditions auxquelles il soumet
l'attribution de sa nationalité aux navires, les conditions
d'immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises
pour qu'ils aient le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent
la nationalité de l'Etat dont ils sont autorisés à battre
le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l'Etat et le navire.
2. Chaque Etat délivre aux navires auxquels il a
accordé le droit de battre son pavillon des documents à cet
effet.
Article 92
Condition juridique des navires
1. Les navires naviguent sous le pavillon d'un seul Etat et sont
soumis, sauf dans les cas exceptionnels expressément prévus par
des traités internationaux ou par la Convention, à sa juridiction
exclusive en haute mer. Aucun changement de pavillon ne peut intervenir au
cours d'un voyage ou d'une escale, sauf en cas de transfert réel de la
propriété ou de changement d'immatriculation.
2. Un navire qui navigue sous les pavillons de plusieurs Etats,
dont il fait usage à sa convenance, ne peut se prévaloir,
vis-à-vis de tout Etat tiers, d'aucune de ces nationalités et
peut être assimilé à un navire sans nationalité.
Article 93
Navires battant le pavillon de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées des Nations Unies ou de
l'Agence internationale de l'énergie atomique
Les articles précédents ne préjugent en rien
la question des navires affectés au service officiel de l'Organisation
des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de
l'Agence internationale de l'énergie atomique battant pavillon de
l'Organisation.
Article 94
Obligations de l'Etat du pavillon
1. Tout Etat exerce effectivement sa juridiction et son
contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les
navires battant son pavillon.
2. En particulier tout Etat :
a) tient un registre maritime où figurent les noms et les
caractéristiques des navires battant son pavillon, à l'exception
de ceux qui, du fait de leur petite taille, ne sont pas visés par la
réglementation internationale généralement
acceptée;
b) exerce sa juridiction conformément à son droit
interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les
officiers et l'équipage pour les questions d'ordre administratif,
technique et social concernant le navire.
3. Tout Etat prend à l'égard des navires battant
son pavillon les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité en mer, notamment en ce qui concerne :
a) la construction et l'équipement du navire et sa
navigabilité;
b) la composition, les conditions de travail et la formation des
équipages, en tenant compte des instruments internationaux
applicables;
c) l'emploi des signaux, le bon fonctionnement des communications
et la prévention des abordages.
4. Ces mesures comprennent celles qui sont nécessaires
pour s'assurer que :
a) tout navire est inspecté, avant son inscription au
registre et, ultérieurement, à des intervalles appropriés,
par un inspecteur maritime qualifié, et qu'il a à son bord les
cartes maritimes, les publications nautiques ainsi que le matériel et
les instruments de navigation que requiert la sécurité de la
navigation;
b) tout navire est confié à un capitaine et
à des officiers possédant les qualifications voulues, en
particulier en ce qui concerne la manoeuvre, la navigation, les communications
et la conduite des machines, et que l'équipage possède les
qualifications voulues et est suffisamment nombreux eu égard au type,
à la dimension, à la machinerie et à l'équipement
du navire;
c) le capitaine, les officiers et, dans la mesure du
nécessaire, l'équipage connaissent parfaitement et sont tenus de
respecter les règles internationales applicables concernant la
sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention des abordages, la
prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution et
le maintien des services de radiocommunication.
5. Lorsqu'il prend les mesures visées aux paragraphes 3 et
4, chaque Etat est tenu de se conformer aux règles, procédures et
pratiques internationales généralement acceptées et de
prendre toutes les dispositions nécessaires pour en assurer le
respect.
6. Tout Etat qui a des motifs sérieux de penser que la
juridiction et le contrôle appropriés sur un navire n'ont pas
été exercés peut signaler les faits à l'Etat du
pavillon. Une fois avisé, celui-ci procède à une
enquête et prend, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour
remédier à la situation.
7. Chaque Etat ordonne l'ouverture d'une enquête,
menée par ou devant une ou plusieurs personnes dûment
qualifiées, sur tout accident de mer ou incident de navigation survenu
en haute mer dans lequel est impliqué un navire battant son pavillon et
qui a coûté la vie ou occasionné de graves blessures
à des ressortissants d'un autre Etat, ou des dommages importants
à des navires ou installations d'un autre Etat ou au milieu marin.
L'Etat du pavillon et l'autre Etat coopèrent dans la conduite de toute
enquête menée par ce dernier au sujet d'un accident de mer ou
incident de navigation de ce genre.
Article 95
Immunité des navires de guerre en haute mer
Les navires de guerre jouissent en haute mer de l'immunité
complète de juridiction vis-à-vis de tout Etat autre que l'Etat
du pavillon.
Article 96
Immunité des navires utilisés exclusivement
pour
un service public non commercial
Les navires appartenant à un Etat ou exploités par
lui et utilisés exclusivement pour un service public non commercial
jouissent, en haute mer, de l'immunité complète de juridiction
vis-à-vis de tout Etat autre que l'Etat du pavillon.
Article 97
Juridiction pénale en matière d'abordage ou
en ce qui
concerne tout autre incident
de navigation maritime
1. En cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation
maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou
disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il
ne peut être intenté de poursuites pénales ou
disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou administratives
soit de l'Etat du pavillon, soit de l'Etat dont l'intéressé a la
nationalité.
2. En matière disciplinaire, l'Etat qui a
délivré un brevet de commandement ou un certificat de
capacité ou permis est seul compétent pour prononcer, en
respectant les voies légales, le retrait de ces titres, même si le
titulaire n'a pas la nationalité de cet Etat.
3. Il ne peut être ordonné de saisie ou
d'immobilisation du navire, même dans l'exécution d'actes
d'instruction, par d'autres autorités que celle de l'Etat du
pavillon.
Article 98
Obligation de prêter assistance
1. Tout Etat exige du capitaine d'un navire battant son pavillon
que, pour autant que cela lui est possible sans faire courir de risques graves
au navire, à l'équipage ou aux passagers :
a) il prête assistance à quiconque est trouvé
en péril en mer;
b) il se porte aussi vite que possible au secours des personnes
en détresse s'il est informé qu'elles ont besoin d'assistance,
dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre qu'il agisse de
la sorte;
c) en cas d'abordage, il prête assistance à l'autre
navire, à son équipage et à ses passagers, et, dans la
mesure du possible, indique à l'autre navire le nom et le port
d'enregistrement de son propre navire et le port le plus proche qu'il
touchera.
2. Tous les Etats côtiers facilitent la création et
le fonctionnement d'un service permanent de recherche et de sauvetage
adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et
aérienne et, s'il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs
voisins dans le cadre d'arrangements régionaux.
Article 99
Interdiction de transport d'esclaves
Tout Etat prend des mesures efficaces pour prévenir et
réprimer le transport d'esclaves par les navires autorisés
à battre son pavillon et pour prévenir l'usurpation de son
pavillon à cette fin. Tout esclave qui se réfugie sur un navire,
quel que soit son pavillon, est libre ipso facto.
Article 100
Obligation de coopérer à la répression
de la piraterie
Tous les Etats coopèrent dans toute la mesure du possible
à la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre
lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat.
Article 101
Définition de la piraterie
On entend par piraterie l'un quelconque des actes suivants :
a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute
déprédation commis par l'équipage ou des passagers d'un
navire ou d'un aéronef privé, agissant à des fins
privées, et dirigé :
i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des
personnes ou des biens à leur bord, en haute mer;
ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des
biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat;
b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation
d'un navire ou d'un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits
dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou
aéronef pirate;
c) tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les
actes définis aux lettres a) ou b), ou commis dans l'intention de les
faciliter.
Article 102
Piraterie du fait d'un navire de guerre, d'un navire
d'Etat
ou d'un aéronef d'Etat dont l'équipage s'est
mutiné
Les actes de piraterie, tels qu'ils sont définis à
l'article 101, perpétrés par un navire de guerre, un navire
d'Etat ou un aéronef d'Etat dont l'équipage mutiné s'est
rendu maître sont assimilés à des actes commis par un
navire ou un aéronef privé.
Article 103
Définition d'un navire
ou d'un aéronef
pirate
Sont considérés comme navires ou aéronefs
pirates les navires ou aéronefs dont les personnes qui les
contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l'un des
actes visés à l'article 101. Il en est de même des navires
ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu'ils
demeurent sous le contrôle des personnes qui s'en sont rendues
coupables.
Article 104
Conservation ou perte de la
nationalité
d'un navire ou d'un aéronef
pirate
Un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver sa
nationalité. La conservation ou la perte de la nationalité est
régie par le droit interne de l'Etat qui l'a conférée.
Article 105
Saisie d'un navire ou d'un aéronef pirate
Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de
la juridiction d'aucun Etat, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou
un navire ou un aéronef capturé à la suite d'un acte de
piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et
saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l'Etat qui a
opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à
infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le
navire, l'aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne
foi.
Article 106
Responsabilité en cas de saisie arbitraire
Lorsque la saisie d'un navire ou aéronef suspect de
piraterie a été effectuée sans motif suffisant, l'Etat qui
y a procédé est responsable vis-à-vis de l'Etat dont le
navire ou l'aéronef a la nationalité de toute perte ou de tout
dommage causé de ce fait.
Article 107
Navires et aéronefs habilités à
effectuer
une saisie pour raison de piraterie
Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les
autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures
indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et
qui sont autorisés à cet effet, peuvent effectuer une saisie pour
cause de piraterie.
Article 108
Trafic illicite de stupéfiants et
de substances
psychotropes
1. Tous les Etats coopèrent à la répression
du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes auquel
se livrent, en violation des conventions internationales, des navires naviguant
en haute mer.
2. Tout Etat qui a de sérieuses raisons de penser qu'un
navire battant son pavillon se livre au trafic illicite de stupéfiants
ou de substances psychotropes peut demander la coopération d'autres
Etats pour mettre fin à ce trafic.
Article 109
Emissions non autorisées diffusées
depuis
la haute mer
1. Tous les Etats coopèrent à la répression
des émissions non autorisées diffusées depuis la haute
mer.
2. Aux fins de la Convention, on entend par «
émissions non autorisées » les émissions de radio ou
de télévision diffusées à l'intention du grand
public depuis un navire ou une installation en haute mer en violation des
règlements internationaux, à l'exclusion de la transmission des
appels de détresse.
3. Toute personne qui diffuse des émissions non
autorisées peut être poursuivie devant les tribunaux de :
a) l'Etat du pavillon du navire émetteur;
b) l'Etat d'immatriculation de l'installation;
c) l'Etat dont la personne en question est ressortissante;
d) tout Etat où les émissions peuvent être
captées; ou
e) tout Etat dont les radiocommunications autorisées sont
brouillées par ces émissions.
4. En haute mer, un Etat ayant juridiction conformément au
paragraphe 3 peut, en conformité avec l'article 110, arrêter toute
personne ou immobiliser tout navire qui diffuse des émissions non
autorisées et saisir le matériel d'émission.
Article 110
Droit de visite
1. Sauf dans les cas où l'intervention procède de
pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui
croise en haute mer un navire étranger, autre qu'un navire jouissant de
l'immunité prévue aux articles 95 et 96, ne peut l'arraisonner
que s'il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire:
a) se livre à la piraterie;
b) se livre au transport d'esclaves;
c) sert à des émissions non autorisées,
l'Etat du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu de l'article
109;
d) est sans nationalité; ou
e) a en réalité la même nationalité
que le navire de guerre, bien qu'il batte pavillon étranger ou refuse
d'arborer son pavillon.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre
peut procéder à la vérification des titres autorisant le
port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une embarcation,
sous le commandement d'un officier, auprès du navire suspect. Si,
après vérification des documents, les soupçons subsistent,
il peut poursuivre l'examen à bord du navire, en agissant avec tous les
égards possibles.
3. Si les soupçons se révèlent
dénués de fondement, le navire arraisonné est
indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à
condition qu'il n'ait commis aucun acte le rendant suspect.
4. Les présentes dispositions s'appliquent mutatis
mutandis aux aéronefs militaires.
5. Les présentes dispositions s'appliquent
également à tous autres navires ou aéronefs dûment
autorisés et portant des marques extérieures indiquant clairement
qu'ils sont affectés à un service public.
Article 111
Droit de poursuite
1. La poursuite d'un navire étranger peut être
engagée si les autorités compétentes de l'Etat
côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a
contrevenu aux lois et règlements de cet Etat. Cette poursuite doit
commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations se
trouve dans les eaux intérieures, dans les eaux archipélagiques,
dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de l'Etat poursuivant,
et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer
territoriale ou de la zone contiguë qu'à la condition de ne pas
avoir été interrompue. Il n'est pas nécessaire que le
navire qui ordonne de stopper au navire étranger naviguant dans la mer
territoriale ou dans la zone contiguë s'y trouve également au
moment de la réception de l'ordre par le navire visé. Si le
navire étranger se trouve dans la zone contiguë, définie
à l'article 33, la poursuite ne peut être engagée que s'il
a violé des droits que l'institution de cette zone a pour objet de
protéger.
2. Le droit de poursuite s'applique mutatis mutandis aux
infractions aux lois et règlements de l'Etat côtier applicables,
conformément à la Convention, à la zone économique
exclusive ou au plateau continental, y compris les zones de
sécurité entourant les installations situées sur le
plateau continental, si ces infractions ont été commises dans les
zones mentionnées.
3. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi
entre dans la mer territoriale de l'Etat dont il relève ou d'un autre
Etat.
4. La poursuite n'est considérée comme
commencée que si le navire poursuivant s'est assuré, par tous les
moyens utilisables dont il dispose, que le navire poursuivi ou l'une de ses
embarcations ou d'autres embarcations fonctionnant en équipe et
utilisant le navire poursuivi comme navire gigogne se trouvent à
l'intérieur des limites de la mer territoriale ou, le cas
échéant, dans la zone contiguë, dans la zone
économique exclusive ou au-dessus du plateau continental. La poursuite
ne peut commencer qu'après l'émission d'un signal de stopper,
visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire
visé de le percevoir.
5. Le droit de poursuite ne peut être exercé que par
des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou d'autres navires ou
aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement
qu'il sont affectés à un service public et qui sont
autorisés à cet effet.
6. Dans le cas où le navire est poursuivi par un
aéronef :
a) les paragraphes 1 à 4 s'appliquent mutatis mutandis;
b) l'aéronef qui donne l'ordre de stopper doit
lui-même poursuivre le navire jusqu'à ce qu'un navire ou un autre
aéronef de l'Etat côtier, alerté par le premier
aéronef, arrive sur les lieux pour continuer la poursuite, à
moins qu'il ne puisse lui-même arrêter le navire. Pour justifier
l'arrêt d'un navire en dehors de la mer territoriale, il ne suffit pas
que celui-ci ait été simplement repéré comme ayant
commis une infraction ou comme étant suspect d'infraction; il faut
encore qu'il ait été à la fois requis de stopper et
poursuivi par l'aéronef qui l'a repéré ou par d'autres
aéronefs ou navires sans que la poursuite ait été
interrompue.
7. La mainlevée de l'immobilisation d'un navire
arrêté en un lieu relevant de la juridiction d'un Etat et
escorté vers un port de cet Etat en vue d'une enquête par les
autorités compétentes ne peut être exigée pour le
seul motif que le navire a traversé sous escorte, parce que les
circonstances l'imposaient, une partie de la zone économique exclusive
ou de la haute mer.
8. Un navire qui a été stoppé ou
arrêté en dehors de la mer territoriale dans des circonstances ne
justifiant pas l'exercice du droit de poursuite est indemnisé de toute
perte ou de tout dommage éventuels.
Article 112
Droit de poser des câbles ou des pipelines
sous-marins
1. Tout Etat a le droit de poser des câbles ou des
pipelines sous-marins sur le fond de la haute mer, au-delà du plateau
continental.
2. L'article 79, paragraphe 5, s'applique à ces
câbles et pipelines.
Article 113
Rupture ou détérioration d'un
câble
ou d'un pipeline sous-marin
Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires
pour que constituent des infractions passibles de sanctions, la rupture ou la
détérioration délibérée ou due à une
négligence coupable par un navire battant son pavillon ou une personne
relevant de sa juridiction d'un câble à haute tension ou d'un
pipeline sous-marin en haute mer, ainsi que d'un câble
télégraphique ou téléphonique sous-marin dans la
mesure où il risque de s'ensuivre des perturbations ou l'interruption
des communications télégraphiques ou téléphoniques.
Cette disposition vise également tout comportement susceptible de
provoquer la rupture ou la détérioration de tels câbles ou
pipelines, ou y tendant délibérément. Toutefois, elle ne
s'applique pas lorsque la rupture ou la détérioration de tels
câbles et pipelines est le fait de personnes qui, après avoir pris
toutes les précautions nécessaires pour l'éviter, n'ont
agi que dans le but légitime de sauver leur vie ou leur navire.
Article 114
Rupture ou détérioration d'un câble ou
d'un pipeline sous-marin par le propriétaire d'un autre câble ou
pipeline.
Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires
pour qu'en cas de rupture ou de détérioration en haute mer d'un
câble ou d'un pipeline sous-marin causée par la pose d'un autre
câble ou pipeline appartenant à une personne relevant de sa
juridiction, cette personne supporte les frais de réparation des
dommages qu'elle a causés.
Article 115
Indemnisation des pertes encourues pour avoir
évité de détériorer un câble ou un pipeline
sous-marin
Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires
pour que le propriétaire d'un navire qui apporte la preuve qu'il a
sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche pour
éviter d'endommager un câble ou un pipeline sous-marin soit
indemnisé par le propriétaire du câble ou du pipeline
à condition que le propriétaire du navire ait pris toutes mesures
de précaution raisonnables.
SECTION 2
Conservation et gestion des ressources
biologiques
de la haute mer
Article 116
Droit de pêche en haute mer
Tous les Etats ont droit à ce que leurs ressortissants
pêchent en haute mer, sous réserve :
a) de leurs obligations conventionnelles;
b) des droits et obligations ainsi que des intérêts
des Etats côtiers tels qu'ils sont prévus, entre autres, à
l'article 63, paragraphe 2, et aux articles 64 à 67; et
c) de la présente section.
Article 117
Obligation pour les Etats de prendre à
l'égard de leurs ressortissants des mesures de conservation des
ressources biologiques de la haute mer
Tous les Etats ont l'obligation de prendre les mesures,
applicables à leurs ressortissants, qui peuvent être
nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de
la haute mer ou de coopérer avec d'autres Etats à la prise de
telles mesures.
Article 118
Coopération des Etats à la conservation et
à la gestion des ressources biologiques en haute mer
Les Etats coopèrent à la conservation et à
la gestion des ressources biologiques en haute mer. Les Etats dont les
ressortissants exploitent des ressources biologiques différentes
situées dans une même zone ou des ressources biologiques
identiques négocient en vue de prendre les mesures nécessaires
à la conservation des ressources concernées. A cette fin, ils
coopèrent, si besoin est, pour créer des organisations de
pêche sous-régionales ou régionales.
Article 119
Conservation des ressources biologiques
de la haute
mer
1. Lorsqu'ils fixent le volume admissible des captures et
prennent d'autres mesures en vue de la conservation des ressources biologiques
en haute mer, les Etats :
a) s'attachent, en se fondant sur les données
scientifiques les plus fiables dont ils disposent, à maintenir ou
rétablir les stocks des espèces exploitées à des
niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux
facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les
besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des
méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance
des stocks et de toutes normes minimales internationales
généralement recommandées au plan sous-régional,
régional ou mondial;
b) prennent en considération les effets de ces mesures sur
les espèces associées aux espèces exploitées ou
dépendant de celles-ci, afin de maintenir ou de rétablir les
stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un
niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement
compromise.
2. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques
relatives aux captures et à l'effort de pêche et les autres
données concernant la conservation des stocks de poisson sont
diffusées et échangées régulièrement par
l'intermédiaire des organisations internationales compétentes,
sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu'il y a lieu, et
avec la participation de tous les Etats concernés.
3. Les Etats concernés veillent à ce que les
mesures de conservation et leur application n'entraînent aucune
discrimination de droit ou de fait à l'encontre d'aucun pêcheur,
quel que soit l'Etat dont il est ressortissant.
Article 120
Mammifères marins
L'article 65 s'applique aussi à la conservation et
à la gestion de mammifères marins en haute mer.
Source :
http://www.un.org/french/law/unclos/closindex.htm
BIBLIOGRAPHIE
A- Ouvrages et dictionnaires
- CORNU (G), Vocabulaire juridique, 7ème
éd., PUF, 2006, p. 575.
- DE FONTETTE (F.), Que sais-je ? , 6éme
édition ,PUF, 1998.
- Gidel (G), Annuaire de la Commission du Droit
International, 1950.
- Le HARDY (M.), Que reste-t-il de la liberté de
pêche en Haute mer ?, éditions A.PEDONE, Paris, 2002,
417 pages.
- PANCRACIO (J-P), Droit international des espaces, Armand
Colin, p. 171
- RODIERE (R.) et GOUILLOUD (M. R.), La mer droits des
hommes ou proie des Etats ?, éd A.PEDONE, Paris Vème,
1980.
B- Articles
- BEURIER (J-P.), « La police de la conservation
des ressources vivantes de la haute mer, problème
d'actualité » in Revue Juridique NEPTUNUS, Vol 1,
1996.
- BORDES (C), « le renouveau de la dimension
stratégique des océans le nouveau rôle des marines de
guerre », AFRI, vol X, 2009.
- CHAFFEE (D), « La liberté ou le
règne de la force en haute mer ? Opération d'interdiction
des armes et droit international » in Energie et
sécurité, IEER, N° 29, 2005
- CHAUMETTE (P.), « le contrôle des
navires par les Etats riverains » in Les Cahiers
Scientifiques du Transport, N° 35, 1999, pages 55-72.
- DE ROANY (C.), « La pêche dans le
monde » in Annuaire du droit de la mer de l'Institut du Droit
Economique de la Mer, Tome XI, ed. PEDONE, Paris, 2006.
- FRECON (E) et GRANT (H), « Des terroristes dans
le sillage des pirates asiatiques : une menace stratégique ?
», in Défense nationale et sécurité
collective, août-septembre 2003.
- GARNIER (G), « Les enjeux de la compétition
maritime entre l'Inde et la Chine » in Bulletins d'études
de la marine, n° 37, mars 2007
- GIRERD (P.), « De l'utilité du concept
de piraterie »in Annuaire de droit maritime et
océanique, n°22, 2004, p. 92.
- GROUPE DE L'ACADEMIE MARINE, « Une
garde-côtes, Quelle garde-côtes ? » in La Revue
Marine (revue trimestrielle de l'Institut Français de la Mer), N°2,
2004.
- KAGAN (S.), « La pêche industrielle
s'est muée en une `surpêche' qui met en danger tant les
pêcheurs que les consommateurs et les écosystèmes
marins », in Développement et paix, disponible
sur
www.dvp.org/dossiers/peches.htm
- MONGIN (F.), « La douane et la sécurisation
du trafic maritime par conteneurs », in Défense et
Sécurité nationale, août-septembre 2003
- RIGALDIES (F.), « L'entrée en vigueur
de la Convention de 1982 sur le droit de la mer: enfin le
consensus » in La Revue juridique Thémis, vol29 -
numéro 1, 283 pages
- ROCHETTE (J.) et DRUEL (E.), « les zones
marines protégées en haute mer dans le cadre de la Convention
OSPAR ; état des lieux et perspectives » in IDDR,
N°03, 2011
- SAVADOGO (L.) « Les navires battant pavillon
d'une organisation internationale » in AFDI, LIII, éd.
CNRS, Paris, 2007.
- WAHAB BIAD (A.), « La lutte contre la
prolifération des armes de destruction massive à la
croisée des chemins » in AFRI, vol.5, 2004, p.
772.
- « La répression des émissions
de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires
nationaux. -- Législations nationales et accord
européen », in: AFDI, vol 12, 1966 ; disponible sur
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_00663085_1966_num_12_1_1896
C- Thèses et mémoires
- ALBAKJAJI (M.), La pollution de la mer
méditerranée par les hydrocarbures liée au trafic
maritime, Mémoire, Université de Paris-Est, 2011
- AMER (S-A.), Le nouveau droit international des mers,
Université arabe, ed. Le Centre Supérieur de la Culture, Caire,
1989, p.105.
- BOUDONG (N), La piraterie maritime moderne,
Mémoire, Université de Paul CEZANNE III, 2009, 132 pages.
- DU MOUCHEL (A-C.), Les atteintes à la
sûreté en haute mer, Université de
Panthéon-Assas, 2009, 113 pages.
- HAFFAF (M.), Sécurité et
sûreté maritime : de l'élaboration des textes à
la difficulté de mise en oeuvre, DESS, Université d'Angers,
2002
- LEFEVRE (H.) et COURDE (P-A.), La sécurité
maritime et la protection de l'environnement : quelles
contradictions ?, DEA de droit maritime et océanique, CDMT
- MONTEIL (L.), L'évolution de la répression
pénale de la pollution marine par les Hydrocarbures, Mémoire,
CDMT, 2009, P.28
- NGAMALIEU NJIADEU (A.), La protection de l'environnement
marin au Cameroun: contribution à l'étude de la mise en
ouvre des conventions internationales, DEA, université de Douala,
2005
- TOURET (C), La piraterie au vingtième
siècle. Piraterie maritime et aérienne, Thèse,
LGDJ, 1992.
- TUSEAU (G.), La pollution opérationnelle des
navires, Mémoire, Université de droit
d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 1997-1998.
- WALLIS (E.), Approche de la réparation des
dommages de pollution causés par les hydrocarbures- Le
FIPOL, Mémoire, Université de droit
d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 2006-2007, p.2.
D- Textes
Ø Textes conventionnels
- Accord du Conseil de l'Europe relatif au trafic illicite par
mer du 31 janvier 1995
- Accord de la FAO de 1993 visant à favoriser le
respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales
de conservation et de gestion
- Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer du 10
décembre 1982
- Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars1961
- Convention du 21 février 1971 sur les substances
psychotropes
- Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer du 1er novembre 1974 (Convention SOLAS)
- Convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) de 1978
- Convention internationale pour la prévention de la
pollution par les navires (Convention MARPOL) de 1973
- Traité du 23 mars 1990 entre l'Italie et l'Espagne
pour la répression du trafic illicite de drogue par mer
- Convention internationale sur la responsabilité et
l'indemnisation pour les
dommages liés au transport par mer de substances
nocives et potentiellement dangereuses (Convention SNPD) de 1996
- Règlement N°2850/2000/CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un
cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution
marine accidentelle ou intentionnelle
- Règlement N° 72/2004/CE du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant le Règlement
(CE) N°106/2002 instituant une agence européenne pour la
sécurité maritime
- Règlement International pour Prévenir les
Abordages en Mer de 1972
- Règlement N° 2244/2003/CE du 18 décembre
2003 relatif à la conservation et l'exploitation durable des ressources
halieutiques qui met en place un système de surveillance des navires par
satellite de la Commission européenne
- Règlement (CE) N° 1966/2006 concernant
l'enregistrement et la communication électronique des données
relatives aux activités de pêche et les dispositifs de
télédétection
Ø Textes nationaux
- Loi Implementing Recommandations of the 9/11 Commission Act
of 2007
- Loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative
à la responsabilité environnementale et à diverses
dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de
l'environnement, publiée le 2 août 2008, JORF n°0179
- Loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à
la responsabilité environnementale
- Loi N° 2011-13 du 15 janvier 2011 relative à
la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de
l'Etat en mer, JORF N° 0004 du 6 janvier 2011
- Loi N° 96-359 du 19 avril 1996 relative au trafic
de stupéfiants en haute mer portant adaptation de la législation
française de l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le
trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes de 1988
- Loi n°2008-757 du 1er août 2008
relative à la responsabilité environnementale et à
diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de
l'environnement, JORF, n°0179, 2008
E- Jurisprudence
- Avis consultatif de la Cour internationale de justice sur la
licéité de la menace ou de l'utilisation des armes
nucléaires de 1966
- CEDH, 29 décembre 2010, affaire Medvedyev et autres
c/ France, requête n°3394/03, 10 juillet 2008.
- CEDH, 23 février 2012, affaire HIRSI JAMMAA et
autres c/l'Italie
- TIDM, arrêt rendu le 1er juillet 1999 dans l'affaire
du Saïga, R.G.D.I.P. 2000, p.514.
- L'ordonnance du 27 août 1999 du TIDM dans l'Affaire du
Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c.
Japon)
F- Autres documents
- DENEZ L'HOSTIS et MESQUIDA (C.), Rio+20 les océans
à la croisée des chemins, plaidoyer, document de FNE (France
Nature Environnement).
- DOULMAN (D. J.), « Pêche INN :
portée du plan d'action international », consultation
technique sur la pêche INN organisée par le Département de
la pêche de la FAO, 2-6 octobre 2000
- DUJARDIN (B), « Irrégularités et guerre
sur mer », Séminaire organisé par le Centre
d'Enregistrement Supérieur de la Marine (CESM) , le 5 février
2009.
- DUSCHESNE (T.), « la fonction
gardes-côtes, la marine nationale et les nouvelles exigences d'ordre
public en mer », L'ordre public en mer colloque du
10 au 13 mai 2011, Brest.
- FILLON (J-L.), « La piraterie maritime au
XXI° siècle : Défis et
réponse »s, Colloque organisé par le Club Sup-Mer
avec la collaboration du Centre d'enseignement supérieur de la marine,
19 mars 2009.
- GROUPE ECOLES DES AFFAIRES MARITIMES, « Droit
de la mer », Centre d'Instruction et de Documentation
Administrative Maritime, Bordeaux, janvier 2002
- HERAN (F), « la réalisation d'un
document scientifique mémoire de DEA, thèse,
article... », Université de Lille I, Séminaire
Méthodologique de l'Ecole doctorale des sciences économiques et
sociales, 2003, 72 pages
- INPES, Drogues savoir plus, livret juridique, avril
2004
- Le livre bleu des engagements du Grenelle de la Mer
(10 au 15 juillet 2009), Paris, MEEDDM, p.21, disponible sur
http://www.legrenelle-mer.fr/IMG/pdf/LIVRE_BLEU_Grenelle_Mer.pdf
- Mc KENNA (P.), rapporteur de la Commission de pêche
du parlement européen, Document de travail N°1 sur le rôle
des pavillons de complaisance dans le secteur de la pêche, 11avril
2001.
- Ministère de la justice française (Services
des Affaires Européennes et Internationales), Les pollutions
maritimes le régime des infractions et des peines ; cas de la
fédération russe, JURISCOPE, 2009, P.26.
- NAGEON DE LESTANG (J.), Etude de la sécurité
en mer pour la pêche artisanale au sud-ouest de l'océan indien,
Circulaire n° 1024/1 de la FAO, 2007
- NGODI (E.), « L'Afrique centrale face aux
nouveaux enjeux sécuritaires du XXIe siècle »,
Colloque organisé par l'Université Marien NGOUABI portant sur
L'Afrique et les défis du XXIème siècle, du 5 au 9
décembre 2011.
- POINGT (P.), « Ordre public : approche
philosophique » in : L'ordre public en mer, colloque du
10 au 13 mai 2011, Brest
- Publication de l'OCDE, Avantages concurrentiels dont
bénéficient certains armateurs du fait de l'inobservation des
règles et des normes internationales en vigueur, Paris, 1996
- QUENEUDEC (J-P.), Rapport de synthèse
« Ordre public en mer », Colloque du 10 au 13 mai
2011, Centre de droit et d'économie de la mer (AMURE)
TABLE DES MATIERES
DEDICACE................................................................................................
i
REMERCIEMENTS....................................................................................
ii
LISTE DES ACRONYMES ET
ABREVIATIONS............................................. iii
LISTE DES
ANNEXES................................................................................
iv
SOMMAIRE..............................................................................................
v
RESUME................................................................................................
vii
INTRODUCTION.......................................................................................
1
PREMIERE PARTIE : LA HAUTE MER, UN CADRE PROPICE
A L'ORDRE
PUBLIC ..................................................................................................
13
CHAPITRE I : L'ENVIRONNEMENT DU MAINTIEN DE
L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE
MER...........................................................................................
15
SECTION I : IDENTIFICATION DES ELEMENTS
CONSTITUTIFS DES TROUBLES A L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE
MER....................................... 15
Paragraphe I : Dans le domaine de la
navigation................................................... 16
A- Les activités illicites effectuées par les
navires............................................. 16
1) Le trafic de stupéfiants et de substances
psychotropes................................ 17
2) Le trafic d'esclaves et l'immigration
clandestine...................................... 17
3) Les émissions non
autorisées.............................................................
18
4) Le transport d'armes de destruction
massive.......................................... 19
B- Les activités portant atteinte à la
sûreté des voies maritimes........................... 19
1) La
piraterie..................................................................................
20
2) Le terrorisme
maritime.....................................................................
21
Paragraphe II : Dans le domaine de la pêche et de
l'environnement............................. 22
A- Les infractions issues des activités de
pêche................................................ 22
1) La pêche illicite, non déclarées, et
non règlementée.................................... 22
2) La
surpêche..................................................................................
23
B- La pollution de l'environnement
marin...................................................... 24
1) Les sources de la pollution par les
hydrocarbures.................................... 25
2) Les
conséquences...........................................................................
26
SESCTION II : LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA
GARANTIE DE L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE
MER..........................................................................
26
Paragraphe I: Le rôle prépondérant des
organisations internationales à travers l'édiction des normes
internationales..................................................................................
27
A- Les normes internationales à caractère
universel............................................ 27
1) Dans le domaine de la
navigation.......................................................... 27
2) Dans le domaine de la
pêche...............................................................
29
3) Dans le domaine de
l'environnement...................................................... 28
B- Les normes internationales à caractère
régionale............................................ 31
1) Les normes de l'Union
Européenne....................................................... 32
2) Les conventions régionales
spécifiques................................................... 33
Paragraphe II : L'Etat dans la mise en oeuvre des normes
internationales........................ 34
A- Les modalités d'aménagement des normes
internationales par les Etats.................. 35
1) Les mesures préventives
terrestres......................................................... 35
2) Les mesures préventives
maritimes....................................................... 37
B- Le Cameroun et l'application des normes
internationales.................................. 39
1) Dans le domaine de la
pêche...............................................................
39
2) Dans le domaine de
l'environnement...................................................... 40
CHAPITRE II : L'AMENAGEMENT DE LA REPRESSION DES
ATTEINTES A L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE
MER............................................................ 42
SECTION I : LES ACTEURS DE LA
REPRESSION............................................ 42
Paragraphe I : L'assistance technique des organisations
internationales et l'action des
Etats..........................................................................................................................................
42
A- L'importance des organisations
internationales.............................................. 43
1) Le principe de la loi de l'Etat du
pavillon................................................ 43
2) Les exceptions au principe de la loi de l'Etat du
pavillon............................ 44
B- L'action des
Etats.................................................................................
45
1) L'adoption de conventions bilatérales ou
multilatérales................................ 46
2) L'adoption par le droit français des normes
internationales................................... 47
Paragraphe II : Le rôle des juridictions dans
l'aménagement de la répression.................. 48
A- Les juridictions
nationales......................................................................
48
1) L'établissement de la compétence des
juridictions nationales........................ 49
2) La nécessité de l'établissement d'une
compétence universelle....................... 50
B- Les juridictions
internationales.................................................................
51
1) Les juridictions à compétence
générale : cas du TIDM.................................
51
2) Les juridictions internationales en matière des
droits de l'Homme : cas de la
CEDH..........................................................................................
52
SECTION II: LES MECANISMES DE
REPRESSION...................................... 53
Paragraphe I : La procédure :
l'intervention......................................................... 53
A- Le principe de la compétence de la loi de l'Etat du
pavillon............................... 54
1) Les techniques d'intervention à bord du
navire.......................................... 54
2) Les techniques d'intervention en
mer..................................................... 55
B- Les exceptions au
principe......................................................................
57
1) L'intervention des navires étrangers et les
autorisations du CSNU................... 57
2) Les autres
exceptions........................................................................
58
Paragraphe II : Les
sanctions...........................................................................
59
A- Les sanctions
pénales............................................................................
60
1) Les peines
d'emprisonnement..............................................................
60
2) Les
amendes..................................................................................
60
B- Les sanctions administratives et
civiles....................................................... 61
1) Les sanctions
administratives..............................................................
61
2) Les sanctions
civiles.........................................................................
62
DEUXIEME PARTIE : EVALUATION DU MAINTIEN DE
L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE
MER..........................................................................................
63
CHAPITRE III : L'EFFECTIVITE DU MAINTIEN DE
L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE
MER...........................................................................................
65
SECTION I : UNE EFFECTIVITE AMOINDRIE PAR DIVERS
OBSTACLES........ 65
Paragraphe I : Les insuffisances des Etats en
matière de mise en oeuvre des normes
internationales............................................................................................
66
A- Le faible contrôle des Etats en matière
d'immatriculation des navires................... 66
1) Les insuffisances de moyens des
Etats................................................... 66
2) Les avantages tirés par les
armateurs...................................................... 67
B- Les conséquences des pavillons de complaisance et
des registres bis..................... 68
Paragraphe II : Les entraves liées à la
nature du droit international.............................. 69
A- La complexité du droit de la
mer............................................................... 70
1) L'imprécision des conventions internationales dans
la formulation du droit de la
mer.............................................................................................
70
2) Les lacunes du droit de la mer en matière
répressive.................................... 71
B- Le respect de la souveraineté des
Etats........................................................ 71
1) La portée des conventions
internationales................................................ 72
2) La nature et l'exécution des normes des institutions
internationales.................. 72
SECTION II : LE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ET
DE LA SURETE EN HAUTE MER PAR LES INSTITUTIONS
INTERNATIONALES.......................... 73
Paragraphe I : Les mesures de contrôle, suivi, et
surveillance de la mise en oeuvre des normes
internationales............................................................................................
74
A- Dans le domaine de la
navigation.............................................................. 74
B- Dans les domaines de la pêche et de
l'environnement..................................... 75
Paragraphe II : Les actions des institutions
internationales dans la sécurité et la sûreté en
haute
mer.........................................................................................................
75
A- Le rôle des navires battant pavillon des
organisations internationales.................... 75
1) Fondement
juridique........................................................................
76
2) La pratique de ces types de
navires........................................................ 77
B- La participation de
l'OTAN.....................................................................
78
1) Rappel des missions de
l'OTAN........................................................... 78
2) Les opérations de
l'OTAN..................................................................78
CHAPITRE IV : PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE
L'ORDRE PUBIC EN HAUTE
MER...........................................................................................
80
SECTION II: L'IMPORTANCE DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE EN MATIERE JURIDIQUE ET
TECHNIQUE...................................................... 80
Paragraphe I : En matière
juridique...................................................................
80
A- L'amélioration de l'arsenal juridique
international.......................................... 81
1) Les solutions aux obstacles normatifs
internationaux................................... 81
2) La réduction des marges de manoeuvres
accordées aux Etats.......................... 82
B- Le renforcement de la coopération régionale
pour la protection de l'environnement en haute
mer..........................................................................................
83
Paragraphe II : En matière
technique..................................................................
84
A- L'importance de l'assistance entre les
Etats.................................................. 84
1) L'assistance
technique.......................................................................
85
2) L'appui de l'assistance
financière.........................................................
85
B- Le renforcement technique et opérationnel dans les
organisations régionales et sous
régionales..........................................................................................
85
SECTION II : LE RENFORCEMENT DE LA COHERENCE DES
POLITIQUES SECTORIELLES DES
ETATS.....................................................................
86
Paragraphe I : la coordination des politiques
sectorielles.......................................... 86
A- La vulgarisation des
informations..............................................................
87
1) L'établissement d'un système d'échange
d'informations.............................. 87
2) La sensibilisation du
public................................................................ 88
B- L'intensification de la formation du
personnel.............................................. 88
1) En matière de sécurité et de
sûreté.........................................................
89
2) En matière technique et
commerciale..................................................... 89
Paragraphe II : La nécessité de l'adoption
dune gouvernance internationale en haute mer pour la protection de
l'environnement......................................................................
90
A- La création d'un réseau d'aires marines
protégées.......................................... 90
1) Rappel des objectifs des
AMP............................................................. 91
2) La gouvernance du réseau mondial
d'AMP.............................................. 91
B- L'élargissement des compétences de l'AIFM
pour la préservation de l'environnement
marin...............................................................................................
92
1) Les compétences de
l'AIFM................................................................ 92
2) L'apport de l'AIFM dans la protection et la
préservation de l'environnement...... 93
CONCLUSION..........................................................................................
95
ANNEXES................................................................................................
99
BIBLIOGRAPHIE....................................................................................
100
TABLE DES
MATIERES...........................................................................
118
* 1 Article 89 de la
Convention de Montego Bay de 1982
* 2 Il s'agit de la mer
territoriale, le plateau continental, la zone contigüe et dans une
certaine mesure la Zone Economique exclusive.
* 3 La haute mer et la Zone
Internationale des Fonds Marins
* 4 RIGALDIES (F.),
« L'entrée en vigueur de la Convention de 1982 sur le
droit de la mer: enfin le consensus » in La Revue juridique
Thémis, ed Thémis, volume 29 - numéro 1, 283 pages
* 5 Convention de Genève
sur la Haute Mer de 1958
* 6 Article 87 de la
Convention de Montego Bay de 1982
* 7Gidel (G), Annuaire de la
Commission du Droit International, 1950
* 8 BORDES (C),
« le renouveau de la dimension stratégique des
océans le nouveau rôle des marines de guerre », in
Annuaire Français de Relations Internationales, volume X, 2009, p.1.
* 9 Le Rapport Brundtland en
1987 la définit comme le développement permettant aux
générations futures de jouir de leur environnement dans les
mêmes conditions que les générations présentes.
* 10POINGT (P.),
« Ordre public : approche philosophique » in :
L'ordre public en mer, colloque du 10 au 13 mai 2011, Brest
* 11 DE FONTETTE (F.),
Que sais-je ? , PUF 6éme édition, 1998.
* 12 QUENEUDEC (J-P.),
Rapport de synthèse « Ordre public en mer »,
Colloque du 10 au 13 mai 2011, Centre de droit et d'économie de la mer
(AMURE)
* 13Au sens de l'art 6 du
Code Civil
* 14DUSCHESNE
(T.), « la fonction gardes-côtes, la marine nationale
et les nouvelles exigences d'ordre public en mer, in L'ordre public en
mer », colloque du 10 au 13 mai 2011, Brest.
* 15 La haute mer est un
espace maritime international et fait ainsi appel à la notion d'ordre
public international
* 16 CORNU (G),
Vocabulaire juridique, 7ème éd., PUF, 2006, p. 575.
* 17 PANCRACIO (J-P),
Droit international des espaces, Armand Colin, p. 171
* 18 Le HARDY (M.), Que
reste-t-il de la liberté de pêche en Haute mer ?, Paris,
éditions A.PEDONE, 2002, 417 pages.
* 19 RODIERE (R.) et
GOUILLOUD (M. R.), La mer droits des hommes ou proie des Etats ?,
ed A.PEDONE, Paris Vème , 1980.
* 20 Notamment le capitaine,
l'équipage, l'armateur, les propriétaires de cargaisons, les
pêcheurs, les ostréiculteurs...
* 21 Du MOUCHEL (A-C.), Les
atteintes à la sûreté en haute mer,
Université de Panthéon-Assas, 2009, Paris, 113 pages
* 22 Notamment la piraterie
maritime, les trafics des stupéfiants et les substances psychotropes,
l'émission non autorisée depuis la haute mer et la traite des
esclaves.
* 23 Convention des Nations
Unies sur le Droit de la Mer.
* 24 Arme de destruction
massive
* 25 BEURIER (J-P.),
« La police de la conservation des ressources vivantes de la
haute mer, problème d'actualité » in Revue
Juridique NEPTUNUS, Volume 1, 1996.
* 26 HERAN (F),
« la réalisation d'un document scientifique mémoire
de DEA, thèse, article... », Université de Lille
I, Séminaire Méthodologique de l'Ecole doctorale des sciences
économiques et sociales, 2003, 72 pages
* 27 Art. 88 de la CNUDM
* 28GARNIER (G), « Les
enjeux de la compétition maritime entre l'Inde et la Chine » in
Bulletins d'études de la marine, n° 37, mars 2007
* 29Anne-Claire Du MOUCHEL,
Les atteintes à la sûreté en haute mer,
Université de Panthéon-Assas, 2009, Paris, p.12
* 30Chaque Etat fixe les
conditions auxquelles il soumet l'attribution de sa nationalité aux
navires, les conditions d'immatriculation des navires sur son territoire et les
conditions requises pour qu'ils aient le droit de battre son pavillon. Les
navires naviguent sous le pavillon d'un seul Etat et sont soumis, sauf dans les
cas exceptionnels expressément prévus par des traités
internationaux ou par la Convention, à sa juridiction exclusive en
haute mer.
* 31 Définition
donnée par le Ministère des transports français,
information disponible sur
http://www.mer.gouv.fr/rubrique.php3
* 32D'après la
convention unique sur les stupéfiants du 30 mars1961 (modifiée
par un protocole en 1972).
* 33 Hallucinogènes,
amphétamines, MDMA (ecstasy), etc.
* 34 INPES, Drogues
savoir plus, livret juridique, avril 2004
* 35 Art. 108 de la CNUDM,
voire également les articles 36 (de la convention du 30 mars 1961 sur
les stupéfiants) et 22 de la convention du 21 février 1971 sur
les substances psychotropes.
* 36Le 29 janvier 2008, sur
la base de renseignements et à la demande du centre européen
d'analyse et d'opérations contre le trafic maritime de
stupéfiants (MAOC-N Maritime Analysis Operation Center - Narcotics) en
accord avec l'OCRTIS (office central pour la répression du trafic
illicite de stupéfiants).
* 37 Guide pratique de
l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
* 38 Il a été
récemment démontré lors du naufrage de trois embarcations
clandestines au large de la Lybie le 30 mars 2009, causant la disparition de
300 personnes
* 39 « La
répression des émissions de radiodiffusion effectuées par
des stations hors des territoires nationaux. -- Législations nationales
et accord européen ». In: AFDI, volume 12, 1966 ;
disponible sur
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1966_num_12_1_1896
* 40 Op. Cit.
* 41 CHAFFEE (D),
« La liberté ou le règne de la force en haute
mer ? Opération d'interdiction des armes et droit
international » in Energie et sécurité, IEER,
N° 29, 2005
* 42L'Avis consultatif de la
Cour internationale de justice sur la licéité de la menace ou de
l'utilisation des armes nucléaires (CIJ, 1996)
* 43Dans l'exercice de leurs
droits et l'exécution de leurs obligations en vertu de la Convention,
les Etats Parties s'abstiennent de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat, ou de toute autre manière
incompatible avec les principes de droit international énoncés
dans la Charte des Nations unies.
* 44Anne-Claire Du MOUCHEL,
Les atteintes à la sûreté en haute mer,
Université de Panthéon-Assas, 2009, Paris, page 13
* 45 TOURET (C), La
piraterie au vingtième siècle. Piraterie maritime et
aérienne, Thèse, LGDJ, 1992.
* 46BOUDONG (N), La
piraterie maritime moderne, Mémoire, Université de Paul
CEZANNE III, 2009, p.6
* 47 Ces chiffres sont
tirés du Piracy and armed robbery against ships,Annual report 1
January, 31 december 2008, ICC International Maritime Bureau.
* 48 FRECON (E) et GRANT
(H), « Des terroristes dans le sillage des pirates asiatiques
: une menace stratégique ? », in Défense nationale
et sécurité collective, août-septembre 2003.
* 49 DUJARDIN (B), «
Irrégularités et guerre sur mer », Séminaire
organisé par le Centre d'Enregistrement Supérieur de la
Marine (CESM), le 5 février 2009.
* 50L'attaque de
l'Alondra Rainbow de 1999 est-elle considérée comme un
exemple de détournement de navire utilisant des moyens pirates, mais
dans un but terroriste.
* 51Du MOUCHEL (A-C), Les
atteintes à la sûreté en haute mer,
Université de Panthéon-Assas, 2009, Paris, p.18
* 52 En fait le trafic
maritime est non seulement d'une grande importance économique, mais
aussi une nécessité vitale pour les Etats.
* 53 DOULMAN (D. J.),
« Pêche INN : portée du plan d'action
international », consultation technique sur la pêche INN
organisée par le Département de la pêche de la FAO, 2-6
octobre 2000
* 54Plan d'action
international visant à prévenir, à contrecarrer et
à éliminer la pêche illicite, non déclarée et
non réglementée, (PAI- INDNR), FAO, 2001, disponible sur
http://www.fao.org/docrep/003/y1224f/y1224f00.HTM
* 55PAI- INDNR, FAO, 2001
* 56 Encyclopédie
Larousse
* 57 KAGAN
(S.), « La pêche industrielle s'est muée en une
`surpêche' qui met en danger tant les pêcheurs que les
consommateurs et les écosystèmes marins », in
Développement et paix, disponible sur
www.dvp.org/dossiers/peches.htm
* 58Information disponible
sur www.mpo-dfo.gc.ca
* 59 Définition
donnée en 1983 par le Groupe mixte d'experts chargés
d'étudier les aspects Scientifiques de e protection de l'environnement
marin (GESAMP). Cette définition a été a été
reprise dans tous les instruments juridiques approuvés au niveau
international pour la prévention et le contrôle de la pollution
marine.
* 60Le livre bleu des
engagements du Grenelle de la Mer (10 au 15 juillet 2009), MEEDDM, Paris,
p.21, disponible sur
http://www.legrenelle-mer.fr/IMG/pdf/LIVRE_BLEU_Grenelle_Mer.pdf
* 61Près de 8 000
navires pétroliers sillonnent les mers et les océans,
transportant cette énergie liquide des lieux de production vers ceux de
consommation.
* 62WALLIS (E.), Approche
de la réparation des dommages de pollution causés par les
hydrocarbures-
Le FIPOL, Mémoire,
Université de droit d'économie et des sciences
d'Aix-Marseille,2006-2007, p.2.
* 63Les pétroliers
Torrey- Canyon en 1967,Amaco Cadiz en 1978, Erika en 1999... en sont des
exemples.
* 64TUSEAU (G.), La
pollution opérationnelle des navires, Mémoire,
Université de droit d'économie et des sciences d'Aix-Marseille,
1997-1998.
* 65ALBAKJAJI (M.),
La pollution de la mer méditerranée par les hydrocarbures
liée au trafic maritime, Mémoire, Université de
Paris-Est, 2011
* 66Art. 113 de la CNUDM.
* 67 Information disponible
sur le site internet du CEDRE :
http://www.cedre.fr/fr/accident/golfe/golfe.php
* 68 Art 90 de la CNUDM
* 69La
sécurité de la navigation cherche à assurer la sauvegarde
de la vie humaine en mer et la défense contre les dangers naturels et
navals, ainsi qu'à assurer la sûreté du commerce en
protégeant le navire et son équipage contre les dangers
résultant de pratiques criminelles dont la mer est le
théâtre : piraterie, trafic illicite en tout genre,
stupéfiants, armes
* 70 La première
convention internationale concernant la sécurité en mer a
été la convention SOLAS (Safety of Life atSea),
élaborée à la suite du naufrage du Titanic en 1911. Elle a
d'abord été adoptée en 1914, avec des modifications en
1929 et 1948. Lorsque l'OMI a été fondée en 1958, sa
première tâche importante a été de modifier cette
convention en 1960; elle a ensuite veillé à ce qu'elle soit
régulièrement révisée.
* 71 C'est un amendement
à cette convention. Il est entré en vigueur en 2004
* 72 D'abord en l'absence
de menace avec l'exploitation normale du navire, ensuite en cas de menaces
particulières ou plausibles des mesures additionnelles de protection
doivent être prises, enfin en cas de menaces clairement
identifiées probables ou imminentes des mesures renforcées
doivent être prises
* 73En ce sui concerne la
procédure d'élaboration, Chaque Armement doit désigner un
Officier de Sûreté de Compagnie (Company Security Officer) capable
d'assurer une veille 24h/24 de tous les navires. Ce CSO est l'interlocuteur
privilégié de l'Officier de Sûreté de chaque Navire
(SSO). Ces officiers devront être formés et
entraînés. De plus, une évaluation des risques des navires
(Ship Security Assesment) opérés par l'Armement doit être
faite par le CSO aidé ou non d'une société de
sûreté agrée (Recognised Security Organisation). De cette
évaluation des risques, des plans de sûreté adaptés
à chaque navire doivent être établis (Ship Security Plan)
puis soumis à l'approbation de l'Administration.
* 74Voir également le
recueil pratique des directives du BIT (Bureau International du Travail)sur la
prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les
ports, 1994.
* 75Ce code ne dicte que les
recommandations, ce qui le distingue du code ISPS qui est obligatoire.
* 76 Ce contrôle est
essentiel, le port étant par nature un endroit dans lequel la
circulation des personnes, indispensable, est très ouverte ; c'est aussi
un endroit de circulation très dense. Pour autant les gens de mer n'ont
pas nécessairement besoin d'accéder à toutes les parties
du port.
* 77Anne-Claire Du MOUCHEL,
Les atteintes à la sûreté en haute mer,
Université de Panthéon-Assas, 2009, Paris
* 78Dont les conditions sont
définies aux articles R321-33 à R321-410 du Code des ports
maritimes.
* 79 Art. 11. (3) du
Protocole
* 80 Le fait que, dans une
large mesure, le Code n'ait pas un caractère obligatoire s'est
avéré être un atout. Il apparaît ainsi comme un
modèle attrayant sur lequel on peut fonder la gestion des pêches,
et son adoption ne comporte pas les mêmes conséquences officielles
que les conventions sur lesquelles il repose. Le Code fonctionne bien en tant
que modèle pouvant être appliqué dans diverses situations,
sans qu'il soit obligatoire de respecter des normes qui ne sont pas
adaptées à la nation en question.
* 81 Ce PAI-
INDNR a été conçu comme un instrument facultatif,
dans le cadre du Code de conduite pour une pêche responsable, en
réponse à un appel formulé à la
vingt-troisième session du Comité des pêches. Un projet de
Plan d'action international a été élaboré lors
d'une Consultation d'experts à Sydney (Australie) en mai 2000. Ce
document a été utilisé pour les négociations des
consultations techniques qui se sont tenues au siège de la FAO, à
Rome, en octobre 2000 et février 2001. Le Plan d'action international a
été adopté par consensus à la
vingt-quatrième session du Comité des pêches le 2 mars 2001
et entériné par le Conseil de la FAO à sa vingtième
session le 23 juin 2001.
* 82 Les États sont
encouragés, de manière prioritaire, à ratifier ou à
accepter la Convention des Nations Unies de 1982, l'Accord des Nations Unies de
1995 sur les stocks de poissons et l'Accord de la FAO de 1993 ou à y
adhérer, selon qu'il convient. Les États qui n'ont pas encore
ratifié ou accepté les instruments internationaux pertinents, ou
qui n'y ont pas encore adhéré, ne devraient pas agir d'une
manière incompatible avec ces instruments.
* 83Les Etats doivent
s'assurer que les navires de pêche autorisés à battre leur
pavillon ne s'adonnent à aucune activité de pêche illicite,
non déclarée et non réglementée et ne favorisent
pas ce type d'activité. Ils doivent également éviter
d'accorder la nationalité aux navires qui se sont donnés
à ce genre d'activité dans le passé.
* 84 Il doit s'assurer
qu'aucun navire ne s'adonne à la pêche dans ses eaux sans
autorisation valable de pêcher délivrée par cet État
côtier ; mais également s'assurer que chaque navire
pêchant dans ses eaux tient un journal de bord faisant état de ses
activités de pêche, le cas échéant.
* 85Avant d'autoriser
l'accès au port, les États devraient exiger des navires de
pêche et des navires utilisés pour des activités
liées à la pêche qui demandent l'autorisation d'entrer dans
leurs ports qu'ils les avertissent suffisamment longtemps à l'avance de
leur entrée dans le port et fournissent un exemplaire de leur
autorisation de pêcher et des renseignements détaillés sur
leur sortie en mer et la quantité de poisson se trouvant à bord,
compte dûment tenu des règles applicables en matière de
confidentialité, afin de s'assurer que le navire n'a pas
participé ni collaboré à des activités de
pêche illicite, non déclarée et non
réglementée.
* 86 Art. 192 et 193 de la
CNUDM
* 87 Il s'agit de la
convention MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution
fromShips) qui remplace la convention OILPOL de 1954 quine comportait aucune
sanction et ne concernait pas les pollutions accidentelles. Les États
ont pris conscience de ce grand vide juridique après la première
marée noire en 1967. C'est pourquoi elle a été
remplacée par la Convention internationale MARPOL.
* 88Il s'agit du
renforcement des contrôles par les États sur les navires battant
leur pavillon, interdiction de tout déversement volontaire de substances
nocives en mer provenant de la cargaison et des soutes...
* 89 Règle 20
* 90 Suite à la
première grande catastrophe de pollution marine par les hydrocarbures :
le naufrage du Torrey-Canyon le 18 mars 1967, les États ont conclu cette
convention sur la pollution par les hydrocarbures
* 91AMER (S-A.), Le
nouveau droit international des mers, Université arabe, ed. Le
Centre Supérieur de la Culture, Caire, 1989, p.105.
* 92 Art.119
* 93 En vigueur depuis
l'adoption d'une Résolution du Conseil du 26 juin 1978
* 94 Ce cadre avait pour
objectif de soutenir et compléter les efforts des Etats membres ;
de contribuer à améliorer leurs capacités d'intervention
en cas d'incidents ; et de renforcer les conditions permettant de
faciliter une assistance et une coopération mutuelle efficace.
* 95 Agence
européenne pour la sécurité maritime, instituée en
2002 par le règlement (CE) N° 1406/2002 est compétente dans
le domaine de la pollution causée par les navires
* 96 Des dispositifs
électroniques ou « boîtes bleues » sont installés
à bord des navires. Ces dispositifs envoient automatiquement des
données à un système de satellite qui les transmet
à une station terrestre qui, à son tour, les envoie au centre de
surveillance des pêches (CSP)
* 97Ce règlement
établit un dispositif de télédétection
destiné à contrôler la présence de navires
opérant dans une zone de pêche donnée, mais aussi de rendre
obligatoire l'utilisation des instruments de contrôle qui visent à
enregistrer et à transmettre, par voie électronique, les
informations relatives aux activités de pêche.
* 98 Information disponible
sur le site web de département général de la
pêche :http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing/pdf/information_note01_en.pdf
* 99 Journal Officiel de
l'Union Européenne du 28 avril 2004.
* 100A cet effet, Lorsqu'il
y a lieu de soupçonner que l'un des actes de trafic illicite de
substances psychotropes ou de drogues a été commis, chaque
État membre reconnaît aux autres États membres un droit de
représentation, qui donne aux navires ou aéronefs appartenant
à leurs autorités douanières respectives un droit
d'intervention contre les navires d'un autre État membre.
* 101 De ROANY (C.),
« La pêche dans le monde » in Annuaire du droit de
la mer de l'lnstitut du droit économique de la mer, Tome XI, ed. PEDONE,
Paris, 2006.
* 102 La Commission a
ébauché de lignes de conduite pour les navires des Etats non
membres surpris à pêcher le saumon dans la zone d'application de
la Convention.
* 103 OPANO :
Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest
* 104 Il s'agit de l'OPASE
(Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-est), de la WCPFC (
Commission pour la conservation de poissons grands migrateurs dans le Pacifique
oriental et central, et de la Commsion de pêche pour le Sud-ouest de
l'Océan indien.
* 105 Adoptée le 22
septembre 1992 et entrée en vigueur en mars 1998
* 106 Adopté le 16
février 1976, entrée en vigueur le 12 février 1978 et
amendée le 10juin 1995.
* 107 Ces mesures sont
prises au niveau de l'Etat du port en ce qui concerne la prévention aux
atteintes à la sûreté maritime en haute mer.
* 108 DUMOUCHEL (A-C.),
Les atteintes à la sûreté en haute mer,
Mémoire, Université Panthéon Assas-Paris, 2009.
* 109Leur but est de
protéger les installations portuaires, c'est-à-dire l'interface
entre les navires et les terminaux portuaires, les postes d'attentes et leurs
abords ainsi que les zones mouillage (chapitre XI-2 de la convention SOLAS
ajouté par le code ISPS).
* 110 Elle tend à
assurer la protection des personnes et des biens contre des actes
criminels.
* 111 Art. L. 302-1 du Code
des ports maritimes
* 112 Art. L. 321-4 du Code
des ports maritimes.
* 113 Il est essentiel
d'assurer la sûreté des marchandises. Celles-ci pouvant servir
à perpétrer des actes terroristes (en mer ou sur le territoire de
destination du navire), notamment par l'embarquement d'armes ou de
matériels spécifiques (substances liquides, gaz...), ou encore
à transporter soit de la drogue, soit des passagers clandestins ou
encore des armes.
* 114MONGIN (F.),
« La douane et la sécurisation du trafic maritime par
conteneurs », in Défense et Sécurité
nationale, août-septembre 2003
* 115DUMOUCHEL (A-C),
Les atteintes à la sûreté en haute mer,
Mémoire, Université Panthéon Assas, 2009.
* 116 La douane joue ainsi
un rôle majeur dans le bon fonctionnement des échanges
commerciaux, en facilitant d'une part le commerce international, d'autre part
en en faisant respecter les règles et en protégeant ainsi
l'économie des pratiques déloyales et de la contrefaçon,
notamment grâce à l'action de l'OMD.
* 117 Elle a
été en janvier 2002 par l'US Customs Service, qui est
le service des douanes américain. Dans le souci de contrôler tout
ce qui entre sur leur territoire ont-ils décidé d'opérer
un contrôle sur les navires à destination de leurs ports en
amont ; Ce qui permet d'une part d'éviter l'embarquement
illégal d'hommes ou de marchandises, d'autre part de simplifier les
arrivées aux ports de destination puisque les contrôles aux
terminaux sont allégés de cette charge de travail.
* 118Loi Implementing
Recommandations of the 9/11 Commission Act of 2007, signée par
Georges W. BUSH
* 119 Avec le
contrôle des pièces d'identité du personnel et des
passagers.
* 120 Dont les conditions
sont définies aux articles R321-33 à R321-410 du Code des ports
maritimes
* 121Le système AIS
est en effet en vente libre ; la consultation des données est
conditionnée par un simple abonnement internet, ce qui en fait un outil
très accessible. Ce système est complété en haute
mer par celui du
LRIT (Résolution du MSC, 81ème session, mai
2006, entrée en vigueur le 31décembre 2008), qui prévoit
le signalement de la position du navire quatre fois par jour à l'Etat du
pavillon.
* 122Arrêtés
des 16 décembre 2004, 16 mars 2005 et 7 mars 2006
* 123 DUMOUCHEL (A-C.), Les
atteintes à la sûreté en haute mer, Mémoire,
Université Panthéon Assas, 2009.
* 124 « Chasse aux
pirates », Brèves marines, n°75, 14 avril 2008
* 125 Les
prérogatives des Etats en matière de police sont ainsi fonction
à la fois du pavillon du navire et du statut de l'espace maritime
où il navigue.
* 126 Cette loi
établit les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités du
ministre des Pêches et des Océans qui englobent toutes les
questions relevant de la compétence du Parlement en matière de
pêches côtières et intérieures; sciences
halieutiques et marines; coordination des politiques et des programmes du
gouvernement du Canada concernant les océans.
* 127Elle confère au
ministre des Pêches et des Océans l'autorité
législative de faire appel à tous les intervenants du Canada qui
ont des intérêts océaniques, y compris les organisations
autochtones, pour élaborer une stratégie de gestion des
océans reposant sur le développement durable et la gestion
intégrée des activités et des ressources dans les eaux
estuariennes, côtières et marines.
* 128 La Loi sur les
pêches est la pierre angulaire de la politique de gestion des
pêches du Canada, prévoyant des pouvoirs élargis permettant
au ministre de gérer, de conserver et de protéger les ressources
halieutiques.
* 129 Après une
première augmentation des sanctions par une loi du
30
mai 2001, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de
la justice aux évolutions de la criminalité a aggravé les
sanctions en élevant le maximum encouru à dix ans
d'emprisonnement et un million d'euros d'amende pour les pollutions volontaires
commises par les navires de grande taille
* 130Deux avions mis en
oeuvre par la douane sont spécialisés dans la
télédétection diurne et nocturne des pollutions marine.
L'avion POLMAR 3 a été livré à la douane
début 2005. La capacité nocturne d'identification des navires
pollueurs, qui constitue sa nouveauté technologique, est en cours de
mise au point. Dès que celle-ci sera achevée, l'avion POLMAR 2
sera mis au standard informatique du POLMAR 3 et équipé de la
même capacité d'identification nocturne.
* 131 La marine nationale
conduit des études afin de doter d'une capacité de
télédétection (radar latéral) les avions de
surveillance Falcon 50 M et d'assurer ainsi une complémentarité
avec les avions de la douane.
* 132 Qui réglemente
exclusivement la pollution par les hydrocarbures en reprenant les dispositions
de l'Annexe I de MARPOL 73/78.
* 133 Institution
spécialisée de la CEMAC (Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale) dont les Etats membres sont: le
Cameroun, le Centrafrique, le Congo Brazzaville, le Gabon, la Guinée
Equatoriale et le Tchad. Le siège de la CEBEVIRHA est à N'DJAMENA
au Tchad.
* 134 Ces plans d'action
concernent la capacité de pêche, les requins, les oiseaux de mer
et la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée.
* 135 Il est important de
rappeler que cette convention a été ratifiée par le
Cameroun en décembre 2006
* 136 NGAMALIEU NJIADEU
(A.), La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution
à l'étude de la mise en ouvre des conventions
internationales, DEA, Université de Douala, 2005
* 137 Elle a
été signée à Bonn le 23 juin 1979 et est
entrée en vigueur le 1er novembre 1983.
* 138Ce principe est ancien et
a été consacré dans l'arrêt Lotus du 7
septembre 1927 de la CPJI avant de l'être par la CNUDM (art.97).
* 139Art. 92 de la
CNUDM.
* 140V° Pavillon (loi
du), CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Assoc. Henri
Capitant, éd. 7, PUF, 2006, p.656.
* 141Journal Officiel de
l'Union Européenne du 28/04/2004.
* 142 Cette convention a
été adoptée par l'OMI à Rome le 10 mars 1988.
* 143 GROUPE ECOLES DES
AFFAIRES MARITIMES, Droit de la mer, Centre d'Instruction et de
Documentation Administrative Maritime, Bordeaux, janvier 2002
* 144 La résolution
1851 le 16 décembre 2008 fondée Chapitre VII de la Charte
des Nations unies
* 145 FILLON (J-L.), La
piraterie maritime au XXI° siècle : Défis et
réponses, Colloque organisé par le Club Sup-Mer avec la
collaboration du Centre d'enseignement supérieur de la marine, 19 mars
2009.
* 146 Art. 114 de la CNUDM, en
cas de rupture ou détérioration d'un câble ou d'un pipeline
par le propriétaire d'un autre câble ou pipeline.
* 147 DUMOUCHEL (A-C.), Les
atteintes à la sûreté en haute mer, Université
de Panthéon-Assas-Paris, 2009
* 148 V° Universelle
(compétence), CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Assoc. Henri
Capitant, éd. 7, 2006, p. 929.
* 149 Cette compétence
s'explique par le fait que le pirate a toujours été
considéré comme un ennemi de « genre humain »
portant atteinte aux intérêts et à la
sécurité de la navigation maritime.
* 150 Ce principe a
été confirmé par l'article 105 de la CNUDM, qui
prévoit que les tribunaux de l'Etat qui a opéré la saisie
peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les
mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l'aéronef ou les
biens, réserve faite des tiers de bonne foi.
* 151GIRERD (P.),
« De l'utilité du concept de piraterie »in
Annuaire de droit maritime et océanique, n°22, 2004, p.
92.
* 152 Il s'agit de
questions particulières de droit international privé.
* 153 GROUPE ECOLES DES
AFFAIRES MARITIMES, Droit de la mer, Centre d'Instruction et de
Documentation Administrative Maritime, Bordeaux, janvier 2002, P. 38
* 154 Art. 99 de la
CNUDM.
* 155 Art. 110 de la
CNUDM
* 156 QUENEDEC
(J-P.), « chronique de droit de la mer »,
AFDI, vol 15, 1969. pp. 748.
* 157 Le 6 mars 2009 et
publié au Journal Officiel de l'Union Européenne du 25 mars 2009,
L 79/49.
* 158 Cette
opération a pour mission de fournir une protection aux navires du PAM,
notamment par une présence à bord de militaires
armés ; protéger les navires marchands ; surveiller les
zones du Golfe d'Aden et de la Somalie ; intervenir, en utilisant la force si
nécessaire, contre les actes de piraterie ; appréhender, retenir
ou transférer des personnes ayant commis des actes de piraterie afin de
permettre des poursuites judiciaires, et établir une liaison avec les
autres forces navales en place.
* 159 DUMOUCHEL (A-C.),
Les atteintes à la sûreté en haute mer,
Université de Panthéon-Assas-Paris, 2009, P. 102.
* 160 Art. 14 de l'Accord
relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'article 17 de la
convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes, Strasbourg, 31.01.95.
* 161Cet accord encourage
la coopération internationale en matière de répression du
trafic illicite de stupéfiant. Il a été établi des
mesures facilitant cette coopération notamment à l'article 4.
* 162Décision
n°2005-514 DC relative à la loi portant création du RIF, 28
avril 2005, JO 4 mai 2005, p. 702
* 163La loi
française peut avoir vocation à s'appliquer alors que le navire
intercepté ne bat pas pavillon français dès lors que la
personne concernée a la nationalité française
* 164Art. 113-7 du Code
pénal.
* 165La France disposait
d'une législation ancienne relative à la piraterie maritime, avec
la loi du 10 avril 1825, mais cette loi a été abrogée par
la loi de simplification du droit du 20 décembre 2007.
* 166 Rapport N° 499
de la session ordinaire de 2011-2012 du SENAT
* 167 Il s'agit du
détournement d'aéronefs, de navire ou de tout autre moyen de
transport ; de l'enlèvement et la séquestration lorsqu'ils
précèdent, accompagnent ou suivent un détournement de
navire ;
* 168le texte habilite les
commandants des bâtiments et des aéronefs de l'Etat à
exercer, au-delà des eaux territoriales françaises, des mesures
de contrôle sur les navires, pouvant comprendre l'usage de la force.
* 169 BOUDONG (N.), La
piraterie maritime moderne, Université de PAUL CEZANNE III,
mémoire, 2009.
* 170 Il dispose de
plusieurs chefs d'état-major, qui sont l'Armée de terre, la
Marine nationale, et l'Armée de l'air. Il a par ailleurs sous sont
autorité de nombreux organismes comprenant entre autres la direction
générale de la sécurité extérieure (DGSE),
ou la Direction de la protection, de la sécurité et de la
défense (DPSD).
* 171 Elle a subi des
modifications le 18 janvier 2013, information disponibles sur le site :
www.Légifrance.gouv.fr.
* 172Loi n°2008-757 du
1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale
et à diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le
domaine de l'environnement, publiée le 2 août 2008, JORF
n°0179.
* 173La partie
législative du code résulte de deux ordonnances n° 2000-914
du 18 septembre 2000 et n° 2001/321 du 11 avril 2001,
complétées et validées par le législateur (loi
n°2003-591 du 2 juillet 2003).
* 174 MONTEIL (L.),
L'évolution de la répression pénale de la pollution
marine par les Hydrocarbures, Mémoire, Centre de droit maritime et
des transports, 2009, P.28
* 175 Cet article consacre
l'application de la convention de Strasbourg pour la répression du
terrorisme du 27 janvier 1977 et celle de l'accord de Dublin du 4
décembre 1979.
* 176Art. 421-3 du Code
pénal
* 177Elle est relative aux
modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer,
modifié par la loi n°2005-371 du 22 avril 2005, art. 1 et 10,
JORF du 23 avril 2005.
* 178Confirmant
l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 15 janvier
2003, Droit maritime français, n°55, n°637, 2003.
* 179Le Winner
avait été arraisonné au large du Cap Vert en juin
2002 par la Marine française, sur accord des autorités
cambodgiennes (Etat du pavillon), ce qui avait permis de trouver 80 kg de
cocaïne, alors que le reste (2-2, 5 tonnes) avait été
jeté par-dessus bord.
* 180Rapport du Conseiller
spécial du Secrétaire Général pour les questions
juridiques liées à la piraterie au large des côtes
somaliennes, ce rapport avait été demandé par le
Secrétaire général à l'issue du débat au
Conseil de sécurité du 25 août 2010 et
avait pour objectif d'identifier des mesures supplémentaires à
prendre pour aider les États de la région et d'autres Etats
à poursuivre et incarcérer les personnes impliquées dans
les activités de piraterie, et d'étudier la disposition
d'États de la région à accueillir éventuellement un
des possibles nouveaux mécanismes judiciaires.
* 181 Projet de loi de 1995
relatif au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de
la législation française aux dispositions de l'article 17 de la
convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants
et substances psychotropes faite à Vienne le 20 d.
* 182 Art. 279 de la
CNUDM
* 183A défaut
d'option exprimée, et encas d'options divergentes entre les Etats, le
recours à l'arbitrage s'imposera.
* 184 Elle connaît
des différends relatifs à la conservation et la gestion des
ressources biologiques marines.
* 185 Elle connaît
des différends relatifs à la protection et à la
conservation des milieux marins.
* 186 Cas de forum
prorogatum : une partie à un différend envoie une
requête au greffe du tribunal en indiquant généralement
espérer que l'autre partie acceptera la compétence du tribunal.
La partie concernée en est informée et peut accepter la
compétence du tribunal même si elle ne soit pas partie à la
convention.
* 187 Art.292 de la
CNUDM
* 188 Paragraphe 5 de
l'art. 290 de la CNUDM
* 189 Ces mesures ne
préjugent en rien la décision au font et peuvent être
confirmées ou infirmées par le tribunal dès qu'il est
constitué.
* 190Après
l'incubation, les poissons juvéniles nagent dans la région
côtière de l'Australie pendant deux ou trois années puis
font une grande migration entre la région côtière de
l'Afrique du sud et celle de la Nouvelle-Zélande par l'océan
Atlantique, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Les bateaux de
pêche japonais pèchent le TNB à la ligne longue, en haute
mer, au Sud de l'Australie tandis que les Australiens pratiquent la pêche
au filet cernant (purse seine) dans leur zone économique exclusive ;
ceci permet à l'Australie de capturer des poissons de deux ou trois
ans.
* 191 Arrêt de la grande
chambre de la CEDH du 29 décembre 2010
* 192 Arrêt de la
grande chambre de la CEDH du 23 février 2012
* 193 Nous précisons
ici que Ce principe exclut donc (ou plutôt évite) la
constitution d'une police universelle de la haute mer, afin d'assurer et de
conserver la liberté de cet espace.
* 194 Du point de vue
matériel, la police désigne les modalités de l'action
publique visant soit à prévenir les troubles à l'ordre
public, soit à réprimer les infractions.
* 195 Ces opérations
s'effectuent très souvent à l'aide de moyens
sophistiqués.
* 196Selon la CMB, les
actions de police doivent être menées par les navires
affectés à un service public ou par les aéronefs de guerre
et assimilés.
* 197Selon la Commission de
droit international (1950), le droit d'approche, ainsi que la
vérification du pavillon, est la seule exception de droit coutumier au
principe général interdisant toute ingérence en haute mer
dans la navigation d'un navire battant pavillon d'un autre Etat en temps de
paix.
* 198C'est le premier stade
permettant de confirmer ou non les soupçons que l'on peut avoir sur un
navire tiers.
* 199 WAHAB BIAD (A.),
« La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive
à la croisée des chemins »in AFRI, vol.5,
2004, p. 772.
* 200 DUMOUCHEL (A-C.),
Les atteintes à la sûreté en haute mer,
Université de Panthéon-ASSAS-Paris, 2009, P. 83.
* 201Si le navire
intervenant agit alors que les soupçons s'avèrent finalement
infondés, la responsabilité de l'Etat de son pavillon pourra
être engagée et l'indemnisation de toute perte ou tout dommage
sera due au navire inspecté, mais à la seule condition qu'il
n'ait commis aucun acte le rendant suspect (Art. 110 alinéa 2 de la
CNUDM).
* 202MONTEIL (L.),
L'évolution de la répression pénale de la pollution
maritime par les hydrocarbures, CDMT, Université de Droit d'Economie
et des Sciences d'Aix-Marseille III, P.97.
* 203Affaire Sokalike
contre Ocean Jasper 2007.
* 204 Cette
opération a débuté en 2007, assurée par la France
de novembre 2007 à février 2008, ce qui a permis l'acheminement
par le PAM de 300 000 tonnes de nourriture.
* 205 D'abord le cas dans
lequel le navire est poursuivi des eaux territoriales en haute mer ;
ensuite celui dans lequel le navire est poursuivi de la haute mer dans les eaux
territoriale et enfin celui dans lequel les occupants du navire seraient
poursuivis à terre.
* 206 Ce droit de poursuite
peut être exercé en haute mer par un Etat côtier à
l'encontre d'un navire civil battant pavillon d'un Etat tiers qui a commis une
infraction à ses lois et règlements dans les eaux
intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë ou la ZEE.
* 207 Les conditions
d'exercice de ce droit sont encadrées par l'article 11 de la CNUDM.
* 208TIDM, arrêt
rendu le 1er juillet 1999 dans l'affaire du Saïga, R.G.D.I.P.
2000, p.514.
* 209L'autorisation du
Conseil de sécurité (Résolution 1816) dans le cadre de la
lutte contre la piraterie au large de la Somalie est ici très
intéressante, et surtout très efficace, puisque permettant par
avance la poursuite d'un navire pirate dans les eaux territoriales somaliennes
; il s'agit là d'une exception donnée uniquement pour la Somalie,
et qui n'est pas valable ailleurs.
* 210Le Conseil de
sécurité est intervenu à plusieurs reprises au titre de la
lutte contre la piraterie dans le Golfe d'Aden, par le biais de
résolutions dans la mesure où la piraterie est
considérée comme une menace la paix et à la
sécurité internationales.
* 211 Il en est de
même pour la résolution 1838 du 7 octobre 2008
* 212DUMOUCHEL (A-C.),
Les atteintes à la sûreté en haute mer,
Université de Panthéon-ASSAS-Paris, 2009, P. 80
* 213C'est sur ce fondement
qu'ont été conclus notamment le Traité du 23 mars 1990
entre l'Italie et l'Espagne pour la répression du trafic illicite de
drogue par mer et l'Accord du Conseil de l'Europe relatif au trafic illicite
par mer du 31 janvier 1995.
* 214D'une façon
générale, les modalités du contrôle sont
déterminées au sein de chaque OIP : procédure d'inspection
mutuelle adoptée par l'Organisation des Pêches de l'Atlantique
Nord-Ouest (OPANO) avec embarquement d'observateurs à bord des navires
de pêche, schéma de contrôle de la Commission des
Pêcheries de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), etc.
* 215 Loi n°2008-757
du 1er août 2008 relative à la responsabilité
environnementale. Pour les pollutions opérationnelles, la peine maximale
est toujours de 10 ans et elle s'applique désormais à tous les
navires quelle que soit leur catégorie. Pour les navires de faible
capacité, la peine encourue passe de 7 à 10 ans.
* 216 Ministère de
la justice française (Services des Affaires Européennes et
Internationales), Les pollutions maritimes le régime des infractions
et des peines ; cas de la fédération russe, JURISCOPE,
2009, P.26.
* 217 Art 230
* 218 La Convention SNPD a
été adoptée en mai 1996, à Londres, par une
conférence internationale organisée par l'Organisation maritime
internationale (OMI) et elle s'inspire du modèle très
réussi de la Convention sur la responsabilité civile et de la
Convention portant création du Fonds, qui traitent des dommages par
pollution résultant de déversements d'hydrocarbures persistants
provenant de navires-citernes.
* 219 Il est identique au
FIPOL
* 220HAFFAF (M.),
Sécurité et sûreté maritime : de
l'élaboration des textes à la difficulté de mise en
oeuvre, DESS, Université d'Angers, 2002
* 221 Publication de
l'OCDE, Avantages concurrentiels dont bénéficient certains
armateurs du fait de l'inobservation des règles et des normes
internationales en vigueur, Paris, 1996
* 222L 'OCDE a
démontré qu'un armateur qui parviendrait à ne pas
respecter les règles de sécurité pourrait
économiser jusqu'à 30% de ses charges d'exploitation et au
minimum 10% des charges globales.
* 223Ibid
* 224Mc KENNA (P.),
rapporteur de la Commission de pêche du parlement européen,
Document de travail N°1 sur le rôle des pavillons de complaisance
dans le secteur de la pêche, 11avril 2001.
* 225 CHAUMETTE (P.),
« le contrôle des navires par les Etats
riverains » in Les Cahiers Scientifiques du Transport,
N° 35, 1999, page 55-72.
* 226 La ratification est un
instrument solennel dans lequel l'Etat s'engage internationalement
* 227Document de l'OMI :
La contribution de l'OMI au développement maritime durable,
renforcement des capacités en vue de garantir la
sécurité et la sûreté et l'efficacité de la
navigation sur des océans propres par le biais du Programme
Intégré de Coopération Technique, disponible sur
www.imo.org
* 228 PAI visant à
prévenir, à contrecarrer et à éliminer la
pêche illicite, non déclarée et non
règlementée, 23 mai 2001 ; PAI visant à
réduire les captures accidentelles de mer par les palangriers,
1998 ; PAI pour la conservation et la gestion des requins, février
1999, PAI pour la gestion de la capacité de pêche juin 1999.
* 229 Le problème de
l'attribution de pavillon aux organisations internationales restait
controversé d'après les interventions des
délégués à la Conférence de Genève de
1958.
* 230SAVADOGO (L.)
« Les navires battant pavillon d'une organisation
internationale » in AFDI, LIII, éd. CNRS, 2007, Paris
* 231 AGNU, Étude
d'ensemble de toute la question des opérations de maintien de la paix
sous tous leurs aspects, Doc. A/45/94, 9 octobre 1990, 15 p.
* 232 Plus
récemment, dans le cadre du programme Fridtjof Nansen, la FAO a
utilisé des navires de pêche et des navires de recherche
scientifique marine dans des pays en développement (Afrique,
Amérique latine, Asie). Ces bâtiments arboraient le pavillon de la
Norvège conjointement avec celui des Nations Unies.
* 233L'AESM a
été instituée par le règlement (CE) 1406/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002
* 234Il modifie le
règlement (CE) 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la
sécurité maritime. JO UE du 29 avril 2004, L. 129/1.
* 235 European Maritime
Safety Agency , « Latest EMSA Oil Recovery Vessel Contracts Finalized
», Press Release, 27 November 2007.
* 236 SAVADOGO (L.),
« Les navires battant pavillon d'une organisation
internationale » in AFDI, LIII, éd. CNRS, 2007, Paris
* 237Deux Commandements
maritimes alliés (CM) sont chargés d'élaborer et de mettre
en oeuvre les éléments maritimes des opérations et des
politiques de l'OTAN. CM Northwood relève du Commandement de forces
interarmées Brunssum, tandis que CM Naples, Italie, est destiné
au Commandement de forces interarmées Naples4.
* 238BORDES (C.),
« Le renouveau de la dimension stratégique des
océans » in Annuaire Français des Relations
Internationales, Volume X, 2009
* 239 La CNUDM a prévu
des dispositions obligeant les Etats à coopérer pou
réprimer le trafic illicites de substances psychotropes (art.108), de la
piraterie (art.100), des émissions non autorisées (art. 109),
mais également pour la conservation et la gestion des ressources
biologiques en haute mer.
* 240 NGODI (E.),
« L'Afrique centrale face aux nouveaux enjeux
sécuritaires du XXIe siècle », Colloque
organisé par l'Université Marien NGOUABI portant sur
L'Afrique et les défis du XXIème siècle, du 5 au 9
décembre 2011.
* 241 LEFEVRE (H.) et COURDE
(P-A.), La sécurité maritime et la protection de
l'environnement : quelles contradictions ?, DEA de droit maritime
et océanique, CDMT
* 242 Chapitre 17 du Programme
Action 21 adopté par les gouvernements à la Conférence des
Nations Unies sur le développement et l'Environnement
* 243 C'est le cas par exemple
de l'Agence Européenne de défense pour la surveillance des eaux
européennes
* 244 Conclusions
établies par un groupe de l'Académie Marine, « Une
garde-côtes, Quelle garde-côtes ? » in La Revue
Marine (revue trimestrielle de l'Institut Français de la Mer), N°2
(janvier-mars ), 2004.
* 245 Directives techniques
pour une pêche responsable, information et partage des connaissances,
2009.
* 246 NAGEON DE LESTANG (J.),
Etude de la sécurité en mer pour la pêche artisanale au
sud-ouest de l'océan indien, Circulaire n° 1024/1 de la FAO,
2007.
* 247 Projet de l'OCDE portant
sur l'offre et la formation de personnel maritime -conséquences pour
l'avenir, préparé par Precious Associated Limeted,
Décembre 2002.
* 248 NAGEON DE LESTANG
(J.), Etude de la sécurité en mer pour la pêche
artisanale au sud-ouest de l'océan indien, Circulaire n° 1024/1 de
la FAO, 2007.
* 249 ROCHETTE (J.) et DRUEL
(E.), « les zones marines protégées en haute mer
dans le cadre de la Convention OSPAR ; état des lieux et
perspectives » in IDDR, N°03, 2011
* 250 DENEZ L'HOSTIS et
MESQUIDA (C.), Rio+20 les océans à la croisée des
chemins, plaidoyer, document de FNE (France Nature Environnement).
* 251 Ibid.



