|
DEDICACE
A tous les amis pourleursreproches qu'ils ontimplorés
pour la réalisation de ce travail.
Isaac KASEREKA KAKULE
REMERCIMENT
A la réalisation de la présente étude
de recherche scientifique, qu'il nous soit licite d'exprimer notre
reconnaissance à l'Esterel Dieu tout puissant qui nous a nous fait
grâce d'atteindre cette période et nous a donné la force et
l'intelligence de réaliser cette oeuvre.
Nos sincères remerciements s'adressent à
notre Directeur, Chef de Travaux Joseph KYAKIMWA MULERE et l''Assistant
Lendsphor TSONGO KAYIRI qui ont voulu, malgré ses multiples labeurs,
assurer la direction de ce travail.
Nous sommes particulièrement convenant envers le
corps scientifique de l'Institut Supérieur de Commerce, ISC-GOMA, pour
sa contribution à notre connaissance.
Nos remerciements s'adressent
également à nos parents Christoph PALUKU SOKONI et KAHAMBU
VALERIA pour leur assistance et sacrifice consentis tout au long de notre
carrière scientifique. Il serait déplaisant de notre part de
passer à cette liste sans remercier de coeur mes frères Bosco
MUHINDO et Georges MUHINDO sans oublier maman Dorothée MANGOLOPA qui
étaient de ferveur avec nous pour la réussite de ce travail.
Que tous ceux qui nous sont chers et compagnons
d'études trouvent ici l'expression de notre reconnaissance.
Isaac KASEREKA KAKULE
SIGLES ET ABREVIATIONS
AMB : Alliance Mondiale Baptiste
ASBL : Association Sans But Lucratif
BWA : Baptist Alliance World
CBCA :
Communauté Baptiste au Centre de l'Afrique
CETA :
Conférence des Eglises de Toute l'Afrique
LT : Long Terme
MEU :Mission Evangélique Unie Allemagne
OB : Organisation de
Base
ONG : Organisation Non
Gouvernementale
ONGD :Organisation Non
Gouvernementale de Développement
ONGH : Organisation Non Gouvernementale Humanitaire
PNK :Protestant Kerkeactie
UAM : Unevengelized Africa Mission
UPMGB : Union Pentecontale des Missionnaires de Grande
Bretagne
CBFMS : Conservative Baptist Federation Mission
Society
MEU : Mission Evangélique Unie
UAM : Unevengelized Africa Mission
CBFMS : Conservative Baptist Mission Society
MBK : Mission Baptiste au Kivu
EPBK : Eglise Protestante Baptiste au Kivu
CPBK : Eglise Protestante Baptiste au Kivu
CBK : Communauté Baptiste au Kivu
ECC : Eglise du Christ au Congo
MINENFANT : Ministère des Enfants
SFF : Service Femme et Famille
MJC :Messe de Jeunes Chrétiens
Rév : Révérant
RL : Représentant Légal
RSL :Représentant Légal Suppléant
TRECOM : Trésorerie Communautaire
SECOM : Secrétaire Communautaire
INTRODUCTION
1. ETAT DE LA QUESTION
Toute personne ou communauté trouve sa raison
d'être dans la satisfaction de certains besoins qu'elle éprouve.
La nation par exemple, assurer la sécurité de ses membres et de
leurs biens. La communauté religieuse procure une satisfaction morale
et/ou spirituelle à ses adhérents. La famille quant à
elle, constitue la base de l'éducation et de l'affectivité. Au
niveau des nations, le gouvernement reste le premier garant du bien-être
des citoyens et autres personnes vivant dans son espace territorial. Ainsi, la
satisfaction des besoinsnécessite un moyen minimum de financement, il en
est de même pour les ASBL ; car pour aboutir à leurs
missions, il leurs en faut un financement.C'est subséquemment, pour
effectuer notre analyse sur les ASBL, il sied de nous référer
à nos prédécesseurs qui auraient parléde la
situation des ASBL. C'est ainsi que nous avons axé notre travail sur
celui de l'étudiant :
- Michel MASUMBUKO MULUME : qui avait parlé de
l'analyse financière d'une association sans but lucratif, pour le cas de
l'association Muungano Solidarité. Il s'était
intéressé à savoir la structure financière de
ladite association et connaître son ratio de solvabilité. C'est
ainsi que sa problématique se basait autour des questions
suivantes :
· la structure financière de l'ASBL AMS est-elle
performante pour atteindre son équilibre financière ?
· l'Association Muungano Solidarité est-elle
capable de rembourser ses dettes face à ses créanciers ?
Il avait conclu, après analyse, que la structure
financière de cette association était bonne et permettait de
garder un équilibre financier minimum, c'est-à-dire que l'AMS
présente des bilans bien structurés à l'Actif et au Passif
avec un Fonds de Roulement et un Besoin en Fonds de Roulement positif en chaque
année mais aussi la trésorerie étant positive, ce qui
confirmait sa première hypothèse. En calculant le ratio de
solvabilité générale, il avait constaté que les
avoirs de l'AMS pendant ces trois années d'étude étaient
à mesure de rembourser toutes les dettes contractées à
Court Terme. D'où sa deuxième hypothèse qui était
confirmée selon laquelle l'AMS est crédible vis-à-vis
deses créanciers1(*).
- Georges SHAMABU NTOLE : avait parlé de l'Analyse
Financière d'une société des personnes à
responsabilité limitée en partant du cas d'AFRICAN OIL.2(*)Qui, sa problématique
était formée de trois questions :
· Les résultats réalisés par AFRICAN
OIL sont-ils significatifs d'une année à une autre ?
· Le principe de l'équilibre financier minimum y
est-il respecté ?
· L'AFRICAN OIL a-t-il une autonomie financière et
une liquidité immédiate suffisante ?
Après analyse des données, il constata que
durant les 5 ans d'études, les résultats d'AFRICAN OIL
étaient insignifiantsmême s'ils connaissaient une augmentation
d'une année à une autre, soit de 8000 en 2006, 9200 en 2007, 9500
en 2008, 10200 en 2009 et 11500$ en 2010.Ces derniers lui avaient poussé
d'infirmer sapremière hypothèse selon laquelle les
résultats réalisés par cette dernière sont
significatifs d'une année à une autre. Il avait constaté
en outre, que ses capitaux permanents finançaient les immobilisations
comme exige le principe d'équilibre financier. Les capitaux permanents
ont financés toutes les immobilisations en dégageant un
excédent en 2006 de 137002, 89391 en 2007, 145541 en 2008, 115769 en
2009 et 201698 en 2010. Ces résultats lui poussant d'affirmer sa
deuxième hypothèse qui stipulait que le principe de
l'équilibre financier minimum y était respecté. En
observant le ratio d'indépendance financière d'AFRICAN OIL durant
les trois dernières années par rapport à sa période
d'étude, il avait vu qu'il se rapprochait de 1, ce qui montrait que
AFRICOM OIL avait une indépendance financière. En ce qui concerne
la liquidité immédiate, il avait aussi constaté que seules
les années 2006, 2007 et 2008 avaient un ratio ne dépassant pas
l'unité et que les années 2009 et 2010 avaient un ratio qui la
dépassait. De ceci, l'entreprise devenait à mesure de rembourser
ses dettes à Court Terme par ses disponibles, ce qui avait prouvé
la confirmation de sa troisième hypothèse selon laquelle AFRICAN
OIL avait une autonomie financière et la liquidité suffisante
pour permettre de faire face à ses différents besoins. Quant
à la rentabilité, qu'elle soit économique ou
financière, il avait été remarqué qu'AFRICAN OIL
n'était pas rentable, ce qui infirmait sa quatrième
l'hypothèse de la santé financière d'AFRICAN OIL du point
de vue rentabilité économique et financière qui
était bonne durant sa période d'étude.
Puis il aboutit par recommander et souhaiter aux responsables
de ladite entreprise de procéder à la croissance de son fonds de
roulement pour lui permettre d'avoir un chiffre d'affaires très
élevé et qui pourra bel et bien accroître sa santé
financière et économique.
Quant à nous,nous voulons savoir si le financement que
perçoit l'ASBL en étude lui permet d'être performante en
calculant son efficacité et son efficience dans lacouverture de ses
dépenses et la réalisation de son budget de recettes, savoir son
degré d'indépendance et connaître la corrélation qui
existerait entre leseffectifs des membres fidèles et les recettes
perçues au sein de la CBCA KATOYI.
2. PROBLEMATIQUE
La problématique est la mise en perspective de
l'ensemble de liens qui existent entre les faits, les acteurs et les
composantes d'un problème donné, elle s'élabore autour de
la question principale, des hypothèses de recherche et des lignes
d'analyse qui permettent de replacer son thème de recherche dans un
contexte3(*).
Ainsi, nous sommes persuadés par l'état actuel
de plusieurs sociétés dans les pays en voie de
développement, y compris la RD Congo, où bon nombre de
gouvernements ont failli à leur mission qui n'est autre que de garantir
la sécurité sociale, économique et environnementale
à leurs gouvernés. Cela étant, on se base à un
chevauchement des organisations non gouvernementales dites de
développement et sans but lucratifsqui ne cessent d'apparaître du
jour au lendemain intervenant dans plusieurs domaines différents disant
pour le développement de ces derniers. La multiplicité des ASBL
entraîne la convergence de ces dernières souvent dans le domaine
d'intervention et le champ d'action qui leur engage dans une compétition
de recherche de financement pour la réalisation de leurs objectifs
auprès des bailleurs de fonds.
Malgré la création de plusieurs ASBL, prenant le
cas de laParoisse CBCA Katoyi, en ville de Goma, la situation
socio-économique et environnementale demeure toujours difficile et des
conséquences néfastes ne cessent de se manifester dans la vie de
la population de la ville, ceci donne lieu de poser la question de savoir
pourquoi la multiplicité et l'existence des ASBL. En partant de cette
question, nous voulons analyser la structure financière d'une
ASBL : efficacité et efficience. Celle-ci étant un ensemble
des méthodes et outils qui permettent le traitement des informations
internes et externesen vue de formuler des recommandations pertinentes,
concernant la situation d'un agent économique donné, le niveau et
la qualité des performances, ainsi que le degré de risque dans un
environnement fortement concurrentiel, tel le laborantin face à un
échantillon d'un malade ou patient, le financier a ce droit de porter
une analyse sur la situation financière qu'il aura à
prendre4(*).
De ce fait, pour sa bonneprogression, les ASBL doivent avoir
une certaine indépendance vis-à-vis detierces personnes
c'est-à-dire vu qu'elles n'ont pas la capacité totale
d'être autonome, elles recourent de l'extérieur.Mais, il est au
mieux qu'elles aient les frais de première nécessité pour
sa constitution ou sa fondation pour qu'elles aient une image qui leur
permettra d'avoir un financement de la part de bailleurs.
En guise de cette situation, nous nous sommes posé
trois questions qui sont libellées comme suit :
- Les financements reçus des bailleurs des fonds
permettent-ils à la CBCA KATOYI d'être performante et couvrir ses
dépenses ?
- Quelle est le degré d'indépendance de la CBCA
KATOYI ?
- Y-a-t-il une corrélation positive entre les effectifs
des membres fidèles et les recettes de laCBCA KATOYI?
3. HYPOTHESES
Pour le Dictionnaire Larousse de poche, l'hypothèse
est la proposition initiale à partir de laquelle on construit un
raisonnement5(*).C'est le
fait de prendre position en n'ayant aucune certitude sur cette
dernière.
Compte tenu des préoccupations évoquées
ci-haut, nous avons émis des réponses qui suivent à notre
problématique :
- La CBCA KATOYI serait performante et serait capable de
couvrir ses dépenses ;
- Nous supposons que la CBCA KATOYI peut être
indépendante financièrement en terme de 60% ;
- Nous osons croire qu'il y a une forte corrélation
positive entre les fidèles est les recettes perçues.
4. OBJECTIFS DU TRAVAIL
L'objectif principal de notre travail est de vérifier
si la Paroisse CBCA Katoyi est performante dans la mobilisation et
répartition des recettes. En plus, vérifier comment la
pluralité de membres de l'église peut jouer sur les recettes
aussi savoir si cette dernière dépend en totalité de
l'extérieur pour son bon fonctionnement.
5. METHODESET TECHNIQUES
UTILISEES
Manière de conduire et d'exprimer sa pensée
conformément aux principes du savoir6(*).
Dans ce travail, afin d'atteindre nos objectifs, nous nous
sommes servi :
- De la méthode analytique qui nous apermis d'analyser
systématiquement les informations (les données
récoltées). Elle insiste beaucoup sur chaque cas, chaque
élément d'un tout. Elle considère les choses dans leur
individualité que dans l'ensemble.
- De la méthode synthétique qui nous a
été utile pour résumer les différentes
théories développées par les auteurs en rapport avec notre
sujet de recherche.
Une technique est comme l'ensemble des moyens et
procédés qui permettent à un chercheur de ressembler des
informations originales sur un sujet donné7(*). Dans ce travail, les méthodes ci-avant ont
été appuyées par des techniques de recherche
suivantes :
- Technique documentaire : qui consiste à
récolter les données dans la littérature existante telle
que les ouvrages, les revues et autres archives, les statistiques, les cours,
les travaux de nos prédécesseurs,etc. Elle permet de circonscrire
le problème d'étude autour de notre sujet.
- L'interview : qui nous a permis de réunir sur
terrain des données et / ou des informations pour tenter de clarifier
nos observations, nos interviews et nos entretiens.
6. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Nous avons opté pour ce travail, afin d'effectuer une
analyse financière d'une Association sans But Lucratif, car cette
recherche permet d'approfondir nos notions théoriques et ainsi joindre
la théorie à la pratique, aussi ce travail va continuer à
l'amélioration de la qualité de la gestion de cette ASBL, car les
responsables pourront y référer pour savoir si elle est
performante, savoir ledegré d'indépendance et connaître si
l'augmentation de leur fidèle a un effet sur ses recettes.Parmi aussi de
multiples questions du développement humain qui se posent aujourd'hui,
nous avons opté ce sujet pour des raisons que :
Le problème du développement reste
d'actualité dans le monde entier et aujourd'hui la quasi-totalité
de pays en voie de développement quis'organise pour atteindre un
standing de vie acceptable de leur population, telle étant la raisonde
la création des ASBL, c'est ainsi que nous avons voulu vérifier
leur mode de fonctionnement et surtout par leurs financement si elles sont
compétitives dans la gestion du financement reçu.
Etant donné que cette ASBL intervient dans
l'encadrement d'un bon nombre de gens dans la morale et la spiritualité,
faire comprendre à l'Etat, par le biais de ce travail, le bien
fondé du soutien des initiatives qui se donnent le zèle dans
cette mission d'encadrement qui peuvent diminuer aux différentes
férocités qui pourraient survenir.
En revanche, ce travail nous permet de savoir
l'authenticité qui se cache de la multiplicité des ASBL dans la
ville de Goma et connaître leur degré d'indépendance.
D'autre part, sur le plan scientifique, le travail constitue
une modeste contribution à l'analyse des financements sévissant
la profession au sein d'une ASBL et pouvant influencer d'une manière ou
d'une autre la croissance de celle-ci. Les futurs chercheurs dans ce domaine
peuvent trouver en ce travail un guide pratique quant à leurs recherches
postérieures en analysant le mode de répartition de ces
financements reçus de bailleurs de fonds.
7.DELIMITATION DU SUJET
La finalité de tout travail scientifique est la
précision pour une bonne compréhension. Ainsi, notre travail est
délimité, dans l'espace, à la Communauté Baptiste
au Centre de l'Afrique précisément, la CBCA KATOYI,une
église protestante en République Démocratique du Congo,
Province du Nord-Kivu, en ville de Goma, commune Karisimbi, au Quartier Katoyi.
Du point de vue temporel, notre recherche s'étale sur une période
de cinq ans allant de 2010-2014, du point de vue thématique, nous nous
intéresserons à l'analyse de la structure financière de la
CBCA KATOYI.
8.SUBDIVISION DU TRAVAIL
Le travail comporte trois chapitres notamment :
- Le premier intitulé « Elucidation des
concepts »
- La deuxième porte sur la présentation de notre
cible
- Le dernier chapitre traitesur l'analyse de résultat
et l'interprétation des résultats.
9. DIFFICULTES RENCONTREES
La récolte des données, interview libre et
autres renseignements ont connu des difficultés dues à la
discrétion de certaines données, de la non détention des
documents comptablequi nous paraîtraient trop nécessaires pour
élargir nos investigations pour cette ASBL, tel que le Bilan.
CHAPITRE I :
LITTERATURE SUR LES CONCEPTS DE BASE
Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, pour que nous
soyons sur la même hauteur d'ondes afin de mieux comprendre le travail,
nous avons jugé opportun de définir les concepts clés de
l'intitulé de notre travail. Ce chapitre aura pour objectifs
d'éclairer le lecteur sur le sujet de recherche.
I.1. DEFINITION D'ANALYSE ET
ANALYSE FINANCIERE
Selon le Robert méthodologique, le
mot « Analyse »signifie une opération
intellectuelle consistant à composer une oeuvre, un texte en ses
éléments essentiels afin d'en saisir les rapports et de donner un
schéma de l'ensemble8(*). Elle est une étude faite en vue de discerner
les diverses parties d'un tout.
L'analyse financière est une étude
méthodologique des informations comptables et financières en vue
de connaître la situation et l'évolution de l'entreprise ;
elle présente un ensemble de concepts, des méthodes, permettant
de comprendre les mécanismes de fonctionnement de l'entreprise, de
formation de sa rentabilité dans son environnement9(*). En s'appuyant sur le traitement
et l'interprétation d'informations comptables ou d'autres informations
de gestion, cette discipline participe à des démarches de
diagnostic, de contrôle et d'évaluation qui ont tout d'abord
concerné les entreprises privées à caractère
capitaliste. Ses méthodes tendent à être utilisées
de plus en plus largement et concernent aujourd'hui toute institution
dotée d'une certaine autonomie financière qu'il s'agisse des
entreprises de toute forme, des associations, des coopératives, des
mutuelles ou de la plupart des établissements10(*).
I.2. HISTOIRE DE L'ANALYSE
FINANCIERE
A la veille de la crise de 1929 qui devrait introduire une
profonde mutation des habitudes, le métier des banquiers consistait
essentiellement à assumer les mouvements des comptes et à
octroyer des caisses occasionnelles. Le problème était d'assurer
le financement d'industries naissantes (charbon, textile, construction,
mécanisme, etc.).
Des crédits d'exploitation étaient consentis
moyennant de solides garanties destinées à éviter une
confusion entre le risque du banquier et celui de l'entreprise, mais non
directement affectés par son exploitation ou tout simplement sur le
patrimoine personnel du (des) propriétaire (s) de l'entreprise. Le
patrimoine était essentiellement constitué aux yeux des gens de
l'époque, comme depuis toujours en France, par des biens fonciers et
immobiliers. Il en résulte que le risque du crédit bancaire
était alors lié aux modalités juridiques de la prise de
garantie. Encore fallait-il vérifier que le bien donné en
garantie avait une valeur indépendante de l'évolution de
l'entreprise et, en suite, évaluer le bien ainsi que les risques des
moins-values liées.
L'incertitude quant à la valeur réelle de
l'actif net en cas de liquidation joint à la difficulté
d'évaluer les biens donnés en garantie et à
déterminer l'indépendance à l'égard de
l'exploitation de l'entreprisemontrera aux banquiers que la simple optique de
la recherche de la solvabilité était insuffisante pour
déterminer rationnellement la décision d'octroi de crédit.
Un échange complémentaire se trouvait
indispensable : « Analyse de la structure de
l'entreprise ». Dès lors, l'analyse
financière trouve sa justification et sa raison d'être.
I.3. IMPORTANCE ET ETAPES DE
L'ANALYSE FINANCIERE11(*)
L'analyse financière est un outil indispensable
à la bonne marche de l'entreprise. Son objectif consiste à
utiliser les ressources limites d'un agent économique de la façon
la plus efficace possible. Berzille Rejean distingue trois décisions
essentielles pouvant être prises sur base de la gestion financière
notamment :
· La décision d'investir ;
· La décision de financer une entreprise ;
· La décision de distribuer les dividendes.
Ces trois types de décisionreviennent à la
possibilité du Directeur financier d'une entreprise sur plusieurs plans,
à savoir :
- La planification et la prévision
financière ;
- L'analyse des états financiers ;
- Le suivi et l'évaluation de la performance de
l'entreprise.
Plusieurs agents économiques s'intéressent
à l'information financière publiée par les entreprises. Il
s'agit notamment des créanciers à court terme et à moyen
terme, principalement les banquiers, les actionnaires actuels et
éventuels, les services gouvernementaux, les représentants
syndicaux et les gestionnaires. Chacun de ses acteurs utilise ces informations
par ses propres intérêts. Le banquier étudie la demande de
prêt à Court Terme et s'intéresse à
déterminer si l'emprunteur sera à mesure de faire face à
l'échéance.
Quant à l'actionnaire, il se préoccupe de la
solvabilité ainsi que de la rentabilité de l'entreprise. En
tenant compte des intérêts divergents de tous ces acteurs,
l'analyse financière demeure fondamentalement un outil et une
méthode permettant de définir l'entreprise à partir de
quelques points clés12(*). Pour être en mesure de porter un jugement sur
la situation d'une entreprise, l'analyse doit tenir compte de l'ensemble
d'informations disponibles, surtout celles publiées par la
comptabilité ou par d'autres sources. Généralement,
plusieurs étapes doivent être suivies, à savoir :
- Préciser les objectifs de l'analyse, procéder
à l'examen global des états financiers. Cet examen porte
généralement sur des emplois, des ressources, des ventes et des
bénéfices ;
- Analyser le rapport du vérificateur,
l'énoncé des principes comptables, les notes aux états
financiers et d'autres informations pertinentes ;
- Appliquer les techniques d'analyse comme les ratios,
l'étude du bilan en masse etc. ;
- Enfin, porter un jugement sur la situation, formuler des
recommandations et prendre des conclusions.
I.4. PLANIFICATION
FINANCIERE13(*)
Le plan d'investissement et de financementest un outil de
synthèse de la politique financière à long terme.
En effet, il retrace sur une période de 3 à 6
ans l'évolution des besoins et des ressources de l'entreprise et
s'attache à déterminer leur équilibre en fin de
période. C'est donc un outil de décision. Son objectif est
très clairement d'assurer l'équilibre financier futur de
l'entreprise. Il s'agit de vérifier que les décisions
d'investissement et de financement prises n'entraîneront pas une
évolution non maîtrisée ou non voulue de l'équilibre
financier. Ce plan permet de contrôler si les décisions politiques
générales n'auront pas, dans le futur, un effet
défavorable sur la solvabilité structurelle de la firme.
I.5. DIAGNOSTIC FINANCIER
Le diagnostic financier a un sens plus étroit que
l'analyse financière. Par analogie avec le diagnostic médical qui
est l'action de déterminer une maladie d'après ses
symptômes, le diagnostic financier a pour objet de :
- Rechercher des dysfonctionnements dans la situation ou les
performances de l'entreprise ;
- Trouver les causes de ses difficultés ;
- Proposer des remèdes aux déséquilibres
pour les corriger.14(*)
I.6. LE RISQUE FINANCIER
Il est le risque supplémentaire qui dépend du
financement de l'entreprise (dettes financières). Lorsqu'une entreprise
est financée exclusivement par des capitaux propres, il n'y a pas de
charges d'intérêt et pas de risque financier, seul existe le
risque économique. Le risque financier apparaît lorsque
l'entreprise s'endette (dettes financières), alors les associés
doivent supporter à la fois le risque économique et le risque
financier, c'est-à-dire le risque global. Ce dernier s'exprime par
l'accroissement de la variable du taux de rentabilité des capitaux
propres, par rapport à la rentabilité. Plus les dettes sont
supérieures aux capitaux propres, plus le risque financier est
important, l'endettement accroît le risque financier. Le risque financier
est distinct de faillite qui correspond à l'impossibilité pour
l'entreprise de faire face à toutes ses dettes. L'endettement
accroît le risque financier et le risque de faillite et les deux sont
souvent liés.15(*)
I.7. L'INTERMEDIARE
FINANCIER16(*)
L'intermédiaire financier sert d'interface entre les
prêteurs primaires (qui offrent leur épargne financière) et
les emprunteurs ultimes (qui financent des achats de biens réels) :
elle offre aux prêteurs primaires des instruments d'épargne
adaptés à leurs besoins (durée, liquidité, etc.) et
aux emprunteurs ultimes des financements répondant à leur
demande. Elle est constituée d'intermédiaires tels que les
banques, les établissements de crédit, les caisses
d'épargne, les organismes d'assurance etc.
Ces intermédiaires sont faciles à trouer, et
leur solvabilité assure un niveau élevé de
sécurité. Ces qualités expliquent que l'essentiel des
capitaux ait longtemps transité par ce dernier. L'activité
d'intermédiation a un coût lié au fonctionnement des
établissements (locaux, salaires, frais généraux, taxes,
etc.) et aux risques. Ceux-ci sont de trois natures.
- Le risque de contrepartie, c'est-à-dire le coût
de la défaillance éventuelle des emprunteurs ;
- Le risque de liquidité, lié à ce que la
durée moyenne des instruments d'épargne est inférieure
à celle des crédits accordés. A un instant, une
banque est donc incapable de rembourser la totalité des
dépôts qu'elle a reçus (ils sont servis à financer
des crédits qui ne peuvent pas être recouvrés dans
l'instant). Cette situation qualifiée de transformation est
inhérente à l'activité bancaire et permet de compenser
l'écart de durée moyenne entre l'offre primaire et la demande
ultime des capitaux ;
- Le risque de marché, qui résulte des
fluctuations de prix d'un actif financier. Ainsi, la banque doit compenser les
divergences entre les taux d'intérêt servis aux instruments
d'épargne (taux variable, par exemple) et ceux perçus sur les
prêts (taux fixe, par exemple).
I.8. LES MARCHES FINANCIERS17(*)
Les marchés financiers assurent un passage direct des
prêteurs primaires vers les emprunteurs ultimes. Leur avantage et leur
handicap principal tiennentà ce que c'est le même produit (une
obligation) qui constitue à la fois l'instrument d'épargne et de
présage ; il y a donc économie d'une bonne part du
coût d'intermédiation, mais les parties prenantes doivent faire
leurs affaires de l'ajustement entre les besoins des uns et des autres.
Les marchés financiers constituent une interface entre
les prêteurs et les emprunteurs. Cet état de fait a pour
conséquence qu'un opérateur peut facilement rencontrer des
contreparties : il lui suffit de s'adresser à un
intermédiaire agréé (banque, société de
bourse) et de suivre de procédures prévues à cet effet, il
peut trouver sans difficulté l'information afférente aux
émissions des titres et à l'activité des
émetteurs.
Cette fonction d'interface de marchés financiers a
aussi pour effet de réduire le risque de liquidité attaché
au titre. L'apparence de choses est qu'un emprunteur émet un titre
(obligation) souscrit par un prêteur, mais c'est du marché que
l'émetteur obtient de l'argent, c'est-à- dire de la
communauté des investisseurs qui succéderont jusqu'au
remboursement de l'emprunt.L'investisseur et le souscripteur prêtent
au marchéqui lui remboursera son capital : lors du remboursement ou
par le revenu du titre. Une telle présentation illustre l'unité
profonde qui existe entre les marchés primaires et secondaires :
- Le marché primaire est celui sur lequel sont
émis les titres neufs. Il ne peut exister que si les souscripteurs sont
rassurés de pouvoir les revendre en cas de besoin et de ne pas avoir
leur capital bloqué pendant 10 ou 20 ans (voire d'avantage pour les
actions), il existe d'un marché secondaire est donc la condition
même de celle d'un marché primaire significatif ;
- Le marché secondaire est celui sur lequel sont
négociées les valeurs mobilières d'occasion, il n'existe
que si des titres neufs ont été émis au préalable,
et s'ils continuent de l'être, ne serait-ce que pour compenser des
disparitions (remboursement, rachat, faillites, etc.)
Le marché financier ne peut transférer vers les
emprunteurs ultimes qu'une part limitée de l'épargne
financière disponible. Les raisons en sont :
v Le montant de chaque opération est
élevé, ne serait-ce qu'une raison des coûts fixes
comportant attachés au montage d'une émission de titres, et de la
nécessité d'assurer sa liquidité sur le marché
secondaire ; le marché est donc réservé aux
entreprises assez grandes pour avoir de tels besoins ;
v L'accès à ce marché est
réservé aux émetteurs les plus connus et solvables ;
la pratique de la notation permet d'augmenter le nombre des entreprises
concernées, mais dans une relativement faible mesure. Il en
résulte une sélectivité particulière des
marchés financiers qui contribue à limiter leur accès aux
grandes entreprises ;
v Le risque de marché, c'est-à-dire la
possibilité d'une baisse du prix des titres dissuade une bonne partie
des épargnants d'investir en valeurs mobilières. Or, cette
variabilité des cours est nécessaire car elle assure l'ajustement
entre l'offre et la demande (alors que l'intermédiation utilise
également le rationnement).
Le marché financier permet aussi de fournir de
l'épargne longue à un prix modéré aux emprunteurs
ultimes et est son principal intérêt. Mais, son importance
était quantitativement limitée. Par ailleurs, des
intermédiaires se refinancent sur le marché financier par des
emprunts obligataires ; c'est le cas des organismes des crédits
à LT et dans une moindre mesure des banques qui y trouvent des
ressources longues. Ainsi, le circuit de financement peut se représenter
de la sorte :
Figure N°01 : le schéma du circuit de
financement
Emprunteurs ultimes
Prêteurs primaires
Marchés financiers
L'intermédiaire financier
Source : livre des techniques internationales
I.9. NOTION SUR LE
FINANCEMENT
I.9.1 Définition du
financement
A. VALEY18(*) définit le financement comme un moyen de
mettre à la disposition de l'entreprise des capitaux
nécessaireset suffisants tels qu'ilslui permettent d'acquérir les
immobilisations, les approvisionnements et fonds de roulement utiles à
l'activité que la situation économique permet à
l'entreprise d'exercer. L'application des ressources aux emplois
s'appelle « financement ». Le financement peut se
définir aussi comme étant une méthode nécessaire
à toute acquisition d'actif et qui permet le paiement.19(*) Il est une action de procurer
à une entreprise, une organisation publique ou semi-publique les moyens
financiers nécessaires à son fonctionnement, son
développement ou l'accomplissement de sa tâche.
La finance se distingue de la comptabilité par sa
vocation prospective, elle prend en compte le risque, s'intéresse donc
aux différents secteurs et la façon dont ils atteignent leurs
objectifs par l'utilisation d'outils financiers dédient. Ce secteur
d'activité comprend notamment la banque, l'assurance, les bourses, les
immobiliers sans oublier les budgets publics. Ses dérivés sont
budgétaires, monétaires et d'une façon
générale concrétisent les échanges entre les
individus, les peuples, les Etats, les banques, les entreprises. La finance,
c'est assurer le paiement d'une action, d'une opération ou au
financement d'une organisation ou à l'application d'une politique.
I.9.2 Sortes de financement
La distinction des moyens de financement auxquels peut faire
recours un gestionnaire financier est donc trop capital. Le financement est la
plupart de temps obtenu par une négociation avec les associations sans
but lucratif ou au Gouvernement du Nord.20(*)De ce fait, on diverge plusieurs sortes de financement
mais nous pouvons retenir ceux qui suivent : le financement interne et le
financement externe.
I.9.2.1 financement interne
L'autofinancement occupe une majeure place parmi les moyens
de financement utilisés par l'entreprise ou l'organisation. C'est une
source de financement dont l'organisation dispose sans recourir à des
tiers.
L'autofinancement est défini comme étant une
source des capitaux que l'entreprise se crée et entretient
elle-même par son actif propre et qui est constitué par des moyens
de financement permanent ou d'une durée que l'entreprise trouve dans ses
propres ressources.21(*)
Les cash-flows secrétés par les actifs existants de la firme
peuvent être considérés comme un financement interne.
Dès lors que les cash-flows appartiennent aux
propriétaires des fonds propres de l'entreprise, ils sont ainsi
appelés « capitaux internes ». Les fonds
perçus del'extérieur de la firme, qu'ils proviennent de
financement privés ou bien des marchés financiers, sont
considérés comme des financements externes.22(*)
Les firmes peuvent préférer le financement
interne (autofinancement) au financement externe pour plusieurs raisons.
Pour les firmes non cotées, le financement externe est
généralement difficile à obtenir et même lorsque la
possibilité existe (à travers par exemple, la prise de
participation d'une société de capital-risque), le choix de ce
type de financement est accompagné d'une perte de contrôle et de
flexibilité. Pour les firmes cotées, le financement externe peut
être plus facile à obtenir mais il n'en demeure pas moins
coûteux en termes de coûts d'émission (dans le cas de
nouvelle dette).
En revanche, les cash-flows sécrétés de
façon interne peuvent être utilisés pour financer des
opérations sans que cela entraîne d'importants coûts de
transaction ou de perte de flexibilité.
L'autofinancement a comme avantage d'assurer
l'indépendance financière de l'entreprise (dans la mesure
où il n'est pas à solliciter des ressources externes), il se
traduit par l'augmentation des capitaux propres. L'autofinancement est
constitué de :
ü Réserves : il s'agit des
bénéfices des exercices antérieurs qui n'ont pas
été distribués aux propriétaires de l'entreprise et
que l'on a gardé dans l'entreprise pour augmenter les fonds
propres ;
ü Amortissement : est la
dépréciation en valeur monétaire des valeurs
immobilisées à leur coût d'achat direct, du fait de leur
utilisation, usure ou de la détention par l'entreprise ;
ü Provisions : correspondent aux
charges comportant quelques incertitudes quant à leur montant et parfois
quant à leur existence même. Ces charges étant nées
au cours de l'exercice que l'on clôture, elles doivent être
comptabilisées en fin d'exercice pour que le résultat obtenu soit
exact que possible ;
ü Bénéfice non
distribué : il est la retenue des bénéfices
annuels dans les excédents non distribués aux associés et
reste encore dans l'entreprise pour être utilisé, il est
évidemment la méthode la plus sûre et la moins
coûteuse de financer une entreprise.23(*)
I.9.2.2 Financement externe
Etant donné que le financement interne n'est pas trop
suffisant pour couvrir tous les besoins de l'entreprise, c'est ainsi qu'elle
doit recourir de l'extérieur pour la recherche des ressources, soit pour
accroître son capital, soit pour augmenter son exploitation.
Le crédit bancaire étant le moyen de financement
le plus couramment utilisé par les entreprises, la grande
diversité des formes de crédit bancaire permet en effet de
répondre à un grand nombre de besoins. On peut utiliserplusieurs
types de critères pour classer sommairement des crédits :
§ selon le nombre d'interlocuteurs, négociation
directe (ou bilatéral) ;
§ selon l'échéance, crédit à
court terme, crédit à moyen et long terme ;
§ selon l'ordre de remboursement24(*).
Dans l'optique de l'endettement à court terme, à
moyen terme et à long terme, le financier doit respecter une
règle exclusivement financière, celle dite de l'équilibre
financier minimum. Les emplois stables doivent être financés par
les ressources stables, c'est qui ne pas le cas pour les ASBL qui
dépendent en grande partie de l'extérieur. Mais, pour une
entreprise visant le lucre, le gestionnaire doit analyser l'effet de levier
dans le but de mesurer l'impact des dettes sur la rentabilité. Dans la
deuxième optique, l'augmentation du capital est un financement externe
vu que celle-ci fait recours à des tiers, soit des souscripteurs qui
disent devenir membres d'une entreprise existante25(*).
I.10. PROCESSUS DU FINANCEMENT
DES ASBLS26(*)
Cette section porte essentiellement sur les différentes
sources des financements, leurs conditions d'obtention et les modalités
de négociations des contrats auprès des divers bailleurs de fonds
qui financent les ASBL. Il insiste également sur l'organisation du suivi
des dossiers des donateurs et la présentation des rapports financiers.
Enfin, il explique la nécessité de tenir l'audit et le
suivi-évaluation des actions menées.
Après avoir un plan de
financement, « la prochaine étape pour les gestionnaires
d'un projet ou d'une organisation est lanégociation du financement avec
les partenaires financiers ou les bailleurs de fonds. ». Cette
section présente quelques articulations clés entrebailleurs de
fonds et les acteurs responsables des ASBL. Parmi ces articulations on peut
citer :
- Les sources, les conditions et les étapes de
négociation de contrats de financement ;
- L'organisation et le suivi des dossiers des
donateurs ;
- La présentation des rapports financiers ; et
- L'audit externe
Les Associations peuvent avoir plusieurs sources de
financement comme le précise R. Minani et al. Les Associations peuvent
avoir à faire à : « des Banques ou à
des organisations donateurs pour trouver les moyens pouvant combler ce qui leur
manque. Lorsque la demande est adressée à une Banque il s'agit
d'un crédit que les responsables du projet souhaitent obtenir. Dans ce
cas, ils s'engagent à rembourser cet emprunt ».
Souvent, les responsables des projets de développement
sollicitent une aide auprès d'organisations donateurs. Cette aide peut
concerner les ressources humaines, matérielles ou financières.
Lorsque c'est une aide en ressources humaines, on parle
d' « envoi de coopérant ». Lorsque c'est une
aide financière ou matérielle, on parle de
« subvention ». L'aide n'est pas remboursable, à la
différence d'un crédit.
Etant donné que l'aide sollicitée est non
remboursable, le donateur a besoin de savoir s'il peut faire confiance à
celui qui la demande. Ainsi, il s'attend à obtenir le maximum
d'informations qui renseignent sur l'Association et le projet.
Généralement, ce sont des Organisations déjà
enracinées, avec plusieurs années d'expériences, qui
attirent l'attention des donataires. Il n'est pas dit que les grandes
Organisations fortement financées et qui ont réalisé des
actions visibles sont seules à pouvoir être éligiblespour
obtenir le financement. Même « les petites structures
appelées Organisation de Base (OB) » peuvent aussi
développer des idées pertinentes de projet et être en
mesure de bien gérer les finances si elles sont soutenues par les
grandes structures. C'est pourquoi il est nécessité que soit
encouragé le parrainage de petites structures par les grandes pour
donner la chance auxidées nouvelles, et peut-être pertinentes, de
développement, d'émerger, quelle que soit la grandeur de la
structure qui les porte ».
Afin d'être éligible à pouvoir obtenir un
financement auprès des bailleurs de fonds, les responsables des
Associations doivent savoir quels sont les domaines d'intervention des
bailleurs, car : » les Organisations donateurs travaillent sur
base d'une vision stratégique concernant un pays ou une région
donnée. Ils font connaître leur vision à leurs partenaires
locaux. Si un groupe qui est dans le besoin de ressource veut entrer en contact
avec une Organisation donateur, il doit vérifier au préalable si
ses activités entrent dans la vision de ce dernier ». C'est en
fonction de ces directives que les acteurs locaux formulent leurs projets et
les soumettent à ce dernier pour espérer une aide quelconque.
I.11. NOTION SUR LES
ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF (ASBL)
Les ASBL étant légions en RDC, elles participent
à l'émergence de la société civile congolaise et
contribuent tant soit peu à l'amélioration des conditions
socio-économiques des populations. On les retrouve dans tous les
secteurs de la vie, notamment en matière d'éducation, de
santé, de la jeunesse, de sport, de la promotion de femme, de
défense des droits humains, de lutte contre la pauvreté, de lutte
contre le VIH/SIDA, du logement, du désenclavement, des droits des
enfants et des autres personnes marginalisées, de la bonne gouvernance
et de la démocratie, de l'assistance humaine, etc.27(*)
Cette partie traite les
généralités sur les ASBL en se fixant pour objet de
renseigner sur leur définition. Ainsi, il consacre une partie de sa
théorie à la classification des concepts clés qui sont
couramment utilisés par les acteurs des ASBL, dans leurs divers sens.
I.11.1 Définition de
l'ASBL
La loi N° 004/2001 du 20 Juillet 2001 portant
dispositions générales applicables aux Associations sans But
Lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, définit une
ASBL de la manière ci-après : « L'Association
sans But Lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations
industrielles ou commerciales, si ce n'est à titre accessoire, et qui ne
cherche pas à procurer à ses membres un gain
matériel28(*) ».
Pout le petit Larousse, « l'Association est un
groupe de personnes réunies dans un dessein commun non
lucratif »29(*)
La loi française de 1901 définit plus précisément
l'association comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs
activitésdans un but autre que de partager des bénéfices.
Cette définition met en évidence des
caractéristiques communes à la forme, sous laquelle elles sont
constituées.30(*)
Les Association sans But Lucratif ont pour essentiel, contribué à
l'amélioration des conditions de vie des populations
bénéficiaires vulnérables. Il s'en suit donc que la
motivation première pour créer une ASBL est de rendre service.
Une ASBL ne vise pas à procurer un gain matériel à ses
membres.
I.11.2 Typologies des ASBL
Ø Association sans But Lucratif
S'agissant de la typologie, la loi sus évoquée,
en son article 2, précise que l'Association sans but lucratif est par sa
nature et son objet soit :
- Une association à caractère culturel, social,
éducatif ou économique ;
- Une Organisation non Gouvernementale, ONG en sigle
- Une association confessionnelle
Ø Organisation non Gouvernementale et Organisation non
Gouvernementale de Développement
La loi N° 004/2001 du 20 Juillet 2001 portant
dispositions générales applicables aux Associations sans But
Lucratif et aux Etablissements d'utilité publique définit une ONG
comme une ASBL dotée de la personnalité juridique dont l'objectif
concourt au développement social et économique des
communautés locales31(*).Baudoin Hamuli Kabaruza définit une ONG comme
tout regroupement de personnes qui s'est constitué dans le seul but
d'aider une population cible défavorisée et bien
identifiée à maîtriser ses conditions de vie sur le plan
socio-économique et culturel32(*).
Minani Rigobert, pour sa part, définit une ONGD comme
Association de personnes qui vise l'amélioration durable, participative
et consciente des conditions de vie des populations et dont la création
ne résulte pas de la création33(*).
De toutes ces définitions, il ressort qu'il n y a pas
de différence entre une ASBL et une ONG. Une ONG est en
conséquence une ASBL. Par contre une ONGD est différente d'une
ONG. Une ONGD est une Organisation non Gouvernementale de Développement.
Selon les objectifs poursuivis et la nature de leurs activités on peut
distinguer quatre types d'ONGD, à savoir :
- Les ONG de développement (ONGD) qui s'adonnent aux
activités socio-économiques visant l'amélioration durable
des conditions de vie des populations dans une perspective à long
terme ;
- Les ONG de défense et de promotion des droits humains
et de la participation citoyenne (ONGDH) qui oeuvrent pour la défense
des droits humains et la promotion du respect de ces droits et
l'éducation populaire pour améliorer la connaissance par les
populations de leurs droits et obligations et renforcer leur participation
citoyenne à la vie publique
- Les ONG humanitaires (ONGH) qui apportent l'assistance
humanitaire ou d'urgence aux populations affectées par les crises et les
catastrophes
- Les ONG Socio-culturelles qui ont pour objet de promouvoir
la culture, les valeurs sociales ainsi que la cohésion et la paix
sociale.
I.11.3 Les motivations34(*)
Comme les situations esquissées ci-dessus les font
apparaître, l'intention de créer une Association peut être
inspirée par des motivations de nature et d'intensité très
variable. On les regroupe en deux catégories qui ne s'excluent pas
mutuellement.
v Motivations personnelles, voire égocentriques
La motivation de créer une association peut provenir de
soi-même à la suite d'une situation donnée, d'une
expérience professionnelle, d'une aspiration personnelle,... C'est comme
dit Francis Bornet et Olivier Degryse que l'on peut créer une
Association pour « Agir par dépit, être investi d'un
pouvoir, se parer d'un titre, compenser un manque d'intérêt dans
l'existence familiale, ou professionnelle, demeurer actif pendant la retraite,
disposer d'un tremplin pour accéder à d'autres fonctions ou pour
obtenir une promotion, contester, faire diffuser ses idées,
etc. » Ce désir est donc personnel afin de répondre
à un besoin qui hante le promoteur d'une Association ;
v Motivations d'ordre social
On peut être motivé à créer une
ASBL en vue de promouvoir des valeurs (démocratie, solidarité,
tolérance) ou des idéaux (civiques, philosophiques, politique),
lutter contre l'exclusion, préserver des intérêts
menacés (corporatives, environnementaux, matériels), ressembler
des individus animés par une même passion ou une même
identité sociale, contribuer au changement de la société.
Ce désir vient du fait que les membres d'une communauté se
mettent ensemble afin d'apporter des solutions aux problèmes qui se
posent dans leurs milieux de vie. Pour la plus part de cas et dans le contexte
congolais, c'est cette forme de motivation qui pousse les individus ayant
parfois la même vision de créer une Association.
I.11.4. Indice de la mauvaise
gestion dans les associations35(*)
Selon l'esprit de Loi 004/2001 du 21 Juillet 2001, une
Association sans but lucratif est créé pour ne pas accorder des
gains ou des bénéfices à ses membres. Ceci veut dire que
les membres ne doivent pas prétendre recevoir en termes matériel
ou monétaire des avantages relatifs à leurqualité de
membre. Ainsi, ils s'associent librement sans poursuivre le lucre.
Cependant, on observe dans la pratique quotidienne que les
associations sont habituellement créées, avec des agendas
cachés des fondateurs dans le but de l'enrichissement illicite. Ceci est
à la base de la mauvaise gestion des Associations par certains
Directeurs et Présidents qui les pilotent. Ce comportement
anti-associatif est à la base des conflits et de la mauvaise gestion qui
rend inefficaces les associations sans but lucratifs. Ainsi, quelques
éléments d'indice de la mauvaise gestion dans les associations
sont les suivants :
- Manque de démocratie et de transparence au sein de la
communauté d'ONG ;
- Pouvoir centralisé des leaders fondateurs ;
- Manque d'organe de contrôle ou alors cet organe, bien
qu'existant, est inopérationnel ;
- Conflits de leadership sur des Postes des
responsabilités ;
- Détournement d'argent et du patrimoine par les
Directeurs et Présidents ;
- Manque d'harmonisation sur l'utilisation de fonds ;
- Absence d'un manuel de procédures administratives et
financières qui réglemente la prise de décisions,
l'autorisation et l'exécution des dépenses ;
- Non-respect des statuts, du règlement
intérieur et du manuel de procédures ;
- Manque de tenue de comptabilité ;
- Appropriation des fonds par le gestionnaire à des
fins personnelles ;
- Acceptation des financements conditionnés ;
- Déloyauté ;
- Fraude ;
- Manque des rapports de justification des fonds ;
- Non réalisation de certaines activités
prévues ;
- Clientélisme et tribalisme ;
- Trafic d'influence ;
- Etc.
CHAPITRE II :
PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE
II.1. ASPECTS DOCTRINAUX ET
CULTURELS DE LA CBCA
La Communauté Baptiste au Centre de l'Afrique (CBCA)
est une Eglise Baptiste fondée sur la doctrine de la Bible et qui
prêche la Bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à l'homme
tout entier (Corps, Ame et Esprit).
Elle est une communauté des chrétiens qui
accompagnent la recommandation de Jésus-Christ de baptiser les nouveaux
croyants et les recevoir dans la communion du Seigneur. Gagner les âmes
à Christ, les enseigner, les envoyer et les équiper
spirituellement et physiquement, C'est-à-dire prêcher la bonne
nouvelle du royaume de Dieu et sa justice à tout le monde et
préparer le chemin du Seigneur jusqu'à son retour.
a. VISION
Faire des fidèles de la Communauté Baptistes
d'hommes et femmes rendus capables et courageux à faire face aux
défis évangéliques du moment.
b. MISION
Prêcher l'évangile de Jésus-Christ pour le
salut intégral de tout homme et de tout l'homme, c'est-à-dire sa
libération et sa promotion sur le plan spirituel, physique,
matériel, social et économique.
c. VALEURS
1. Bienséance et ordre ;
2. La paix avec tous ;
3. Humilité dans le leadership ;
4. La patience dans les épreuves ;
5. La communauté dans la vérité ;
6. L'amour sans discrimination ;
7. La compassion envers tous ;
8. La fidélité et la piété.
La CBCA a comme mission : gagner, former ; envoyer
et servir l'homme tout entier. Par contre son logo  est : JESUS-CHRIST est l'Alpha et Omega de toute activité
entreprise par la CBCA. est : JESUS-CHRIST est l'Alpha et Omega de toute activité
entreprise par la CBCA.
d. LANGUES
Le swahili est la langue utilisée par la
communauté dans des assemblées. Néanmoins, ceux qui
parlent l'une des langues suivantes n'auront pas de difficultés à
visiter la CBCA : l'anglais, le français et l'allemand.
Quelques églises locales de la CBCA utilisent le
français au culte ou dans les services, d'autres membres le swahili et
les langues vernaculaires (Mashi, Kinande, Kihunde, Kinyanga, kihavu, kipiri,
Filero, Kinyarwanda, kibembe, kitembo,...).
II.2. RELATIONS
INTER-RELIGIUESES
Comme souligné plus haut, la CBCA est membre de
l'Eglise du Christ au Congo, de la CETA (Conférence des Eglises de Toute
l'Afrique), l'AMB (Alliance Mondiale Baptiste) ou BWA (Baptist Alliance World),
de la MEU (Mission Evangélique Unie Allemagne devenu actuellement PNK
(Protestant Kerkeactie). Elle collabore aussi avec toute initiative
chrétienne qui se soumet à l'autorité de la Bible et qui
veut promouvoir le royaume de Jésus-Christ sur la terre.
II.3. OBJECTIFS POURSUIVIS
Former l'homme dans toute son intégrité :
gagner, former, envoyer et servir l'homme tout entier. C'est-à-dire
corps, esprit et âme.
II.4. PRESENTATION DE LA CBCA
KATOYI
II.4.1. Situation
géographique
La Paroisse CBCA-KATOYI est localisée à Goma
dans la même concession qui héberge l'Institut Majengo sur la
route Notre Dame d'Afrique au n°1 de l'Avenue Lubango, au Quartier
Mabanga-Nord, dans la Commune de Karisimbi, en Ville de Goma, Province du
Nord-Kivu en République Démocratique du Congo.
II.4.2. Historique
Avant de parler de l'histoire de la CBCA katoyi, parlons
d'abord de l'histoire de la CBCA, en général :
II.4.2.1. Historique de la CBCA communauté
En 1921, l'oeuvre missionnaire protestante débuta au
Kivu, après les missionnaires catholiques romains de la
Congrégation des Pères blancs, assomptionnistes, qui s'engagent
comme dans les protestants dans la promotion sociale des campagnes. Le Kivu fut
évangélisé par plusieurs sociétés
missionnaires.
Les pentecôtistes suédois arrivèrent
à Matshumbi (MLC) en 1921 suivi en 1922 des pentecôtistes
Norvégiens (MLN) à Kaziba, l'évangélisation Society
Africain Mission, ESAM en sigle, s'établit à Shabunda, les
méthodistes (MMC) Tunda, l'Union pentecontale des Missionnaires de
Grande Bretagne à Kalembelembe (UPMGB) et Unevengelized Africa Mission
(UAM).
La CBCA est une église issue de cette dernière
société qui commença son oeuvre en 1927 au Kivu,
précisément Lubero-Kitsombiro, en RDC. L'UAM fut l'oeuvre du
missionnaire Paul Hurlburt de nationalité Américaine. Il fut
d'abord encouragé par les chrétiens américains qui lui
promirent un soutien financier. Il recruta ensuite des missionnaires pour son
oeuvre au Kivu. Via Uvira, Hulburt gagna le Congo Belge. Accompagné de
familles William, Maning, Bell, Mindose, Mindose et Bigelow, il
pénétra la zone de Lubero via Pinga en zone de Walikale,
guidé par des missionnaires Suédois, qui informèrent
Hulburt avant, d'une région très peuplée où
n'oeuvraient que les missionnaires Suédois. Celle-ci se trouvait au Nord
du champ d'évangélisation des pentecôtistes Suédois
qui s'étendaient jusqu'à Walikale.
En 1927, il y aura établissement de la station
missionnaire de Kitsombiro suivi de celle de Katwa en 1932 du Gouvernement
Belge qui accordera aussi la personnalité civile à l'UAM. Cette
association traversa une crise financière grave qui n'a pas permis
Hurlburt de continuer convenablement sa tâche. C'est ainsi qu'il confia
l'UAM à la conservative Baptist Mission Society (CBFMS) de Chicago (USA)
en 1946. Au cours de cette année, celle-ci envoya ce premier messager au
Kivu (les familles Bothmell, Larence et Kevorkiam) suivis d'autres groupes.
Dans le domaine de l'évangélisation, de
nouvelles stations furent ouvertes. C'est par le nom Mission Baptiste au Kivu
(MBK) que la CBFMS sera connue au Congo jusqu' à la période du
Schisme en 1946 afin de l'adapter à la réalité et à
la législation coloniale belge. Elle fut par l'Ordonnance-loi N°
881/225 du 26 Août 1946 qui sortira ses effets en 1957. La revendication
d'une formation de la jeunesse et d'une gestion ecclésiale participative
par les autochtones aboutit à la création de la nouvelle
communauté autonome (Eglise Protestante au Kivu : EPBK) en 1959
dotée d'une personnalité civile le 12 Juin 1964.
En 1971, l'EPBK devient CPBK (communauté Protestante
Baptiste au Kivu). En 1973, ce nom devient Communauté Baptiste au Kivu).
La CBK deviendra Communauté Baptiste au Kivu (CBK). La CBK deviendra
Communauté Baptiste au Centre de l'Afrique (CBCA) après commun
accord des membres effectifs, réunis en Assemblée
Générale de 1996 tenue à Goma. Depuis lors, elle est
membre de l'Eglise du Christ au Congo (ECC) et membre d'autres groupements
d'Eglise à travers le monde.
II.4.2.2. Histoire De La Paroisse Katoyi
La Paroisse CBCA-KATOYI est le fruit de l'époque du
Révérend Pasteur KAMBALE MUSAVULI MUVISWA à la tête
de la Paroisse CBCA-VIRUNGA se trouvant dans le poste Ecclésiastique de
Goma qui est un de dix-sept Postes de la CBCA qui créa cette
dernière comme cellule de KATOYI en 1990 pour faciliter les paroissiens
de cette contrée au trajet qu'ils effectuaient chaque jour et au vol de
la journée quand ils sont au culte dominical. Ainsi, cette cellule fut
mise sous la responsabilité de MUHINDO TUVERE Jackson et assisté
par le Révérend Honoraire KITSONGERI NGULIRO.
Avec l'effort que ces serviteurs de Dieu ont fourni, le
nombre de chrétiens augmentait, et en date du 18 Août 1993,
l'Eglise-mère autorisa le premier fonctionnement du culte dominical et
cela dans une des salles de classe de l'Institut Majengo, une des
propriétés actuelles de cette paroisse, et à l'occasion,
le Révérend KAMBALE KABWARO Balthar fut le Prédicateur du
jour. Et le message du Matthieu 5, 13-16 était une exhortation à
tous les fidèles sur leur envoi en tant que sel et lumière dans
le monde.
A partir de ce jour, le Révérend KAMBALE
KABWARO fut affecté à Katoyi pour s'entraider avec deux premiers
responsables, et ainsi, pour tout sacrement, ils devaient aller à la
Paroisse-mère, la CBCA-VIRUNGA.
Après proclamation de l'Eglise de KATOYI comme devant
fonctionner par ses propres initiatives et vu qu'elle avait à sa
tête Pasteurs et anciens, donc un consiste, le besoin d'organiser
différents services tels : la diaconie, la SFF (Service femme et
famille), ECODIM/MINENFANT (Ministère des Enfants), et le MJC (Messe de
Jeunes Chrétiens), se fit sentir. Voici comment les Présidents
élus se sont succédé à la tête de ces
services depuis 1993 jusqu'à nos jours.
Figure N°02 La diaconie
|
N°
|
Noms et post nom
|
Fonction
|
Année
|
|
01
|
KASAY BULAMBO
|
Président
|
1993-2006
|
|
02
|
MBUSA NGOROMBI Samy
|
Président
|
2006 à nos jours
|
Source : rapport annuel de la CBCA
KATOYI
Figure N°03 :Le service femme et famille
(SFF)
|
N°
|
Noms et post nom
|
Fonction
|
Année
|
|
01
|
KAVIRA SIHERA
|
Présidente
|
1993-1996
|
|
02
|
WAWADI MANGOLOPA
|
Présidente
|
1996-1999
|
|
03
|
KAHAMBA KIHIGHA Ruth
KAVUGHO HELENA
|
Président
Vice/Présidente
|
1999-2004
|
|
04
|
KATUNGU VAVUGHE Rachel
MASIKA ZAWADI
|
Présidente
Vice/Présidente
|
2004-mai 2012
|
|
05
|
KAVIRA SIVYALEGHANA Justine
MASIKA OLIVINE
|
Présidente
Vice/Présidente
|
Juin 2012 à aujourd'hui
|
Source : rapport annuel de la CBCA
KATOYI
Figure N°04 :Ministère des jeunes
pour christ
|
N°
|
Noms et post nom
|
Fonction
|
Année
|
|
01
|
KASEREKA SEKERA
KAMATE KAMBRE ISRON
|
Président
Vice/Président
|
1993-1999
|
|
02
|
KAMATE KAMBRE ISRON
NZANDI VIKAYILWIRA
|
Président
Vice/Président
|
1999-2005
|
|
03
|
Maurice KOMBI SYLEVEKWA
MUMBERE SABUNI
|
Président
Vice/Président
|
2005-2012
|
|
04
|
ALI MWAMBA Colin
Maurice KOMBI SYALEVEKWA
|
Président
Vice/Président
|
Le 10/02/2012 à nos jours
|
Source : rapport annuel de la CBCA
KATOYI
Figure N°05 : EcoDim/Minenfant
|
N°
|
Noms et post nom
|
Fonction
|
Année
|
|
01
|
ZAWADI MANGOLOPA
SEDEKIA MUKAMA
|
Directrice
Direadjoint
|
1993-1996
|
|
02
|
SEDEKIA MUKAMA
MUMBERE KATSWERE
|
Directeur
Direadjoint
|
1996-1999
|
|
03
|
MUMBERE KATSWERE
KAVUSA MAHAMBA
|
Directeur
Direadjoint
|
1999-2000
|
|
04
|
KAVUSA MAHAMBA
MUMBERE KAUSA NARKISON
|
Directeur
Direadjoint
|
2000-2008
|
|
05
|
MUMBERE KAUSA NARKISON
PALUKU KEUKEU
|
Directeur
Direadjoint
|
2008 à nos jours
|
Source : rapport annuel de la CBCA
KATOYI
Le 23 Avril 1995, la pose de la pierre pour la construction du
Temple de la CBCA-KATOYI fut effective et cette dernière fut
posée par le Révérend MUHINDO TAMWASI, alors Pasteur
surveillant du poste ecclésiastique de Goma et KABUYAYA KYOTA Fannuel,
Pasteur Paroissial de la CBCA-VIRUNGA.
En date du 18 Février 1996, les élections des
anciens de l'Eglise furent organisées à la Paroisse CBCA-KATOYI
sous la direction du Révérend TAMWASI, le Révérend
PALUKU LIKANYA, Pasteur sectionnaire et le Révérend Pasteur
KISUGHU NYOTA, Pasteur paroissial de la CBCA-VIRUNGA. Et à cette
occasion, une autorisation d'organiser et de célébrer la
sainte-saine, la dédicace des enfants et autres, sauf le baptême,
fut accordée par le Révérend MUHINDO TAMWASI, Pasteur
surveillant du Poste ecclésiastique de Goma. A ce jour, MAMBO LEO,
KAMBALE NGWANA, PALUKU BAHATI, KAMBALE KIVISI, KONDELEO MUPIRA, KATSONGO
KASEREKA et KAMBALE KAIKUTA furent élus comme anciens. Comme c'est
à la même année que la CBCA avait adopté de servir
les Paroisses en collège pastoral, celui de la CBCA-KATOYI fut
constitué de pasteurs suivants :
1. Révérend KAMBALE KABWARO ;
2. Révérend MWENGESYALI MALONA ;
3. Révérend KITSONGERI NGULIRO ;
4. Révérend NGANZA SYAYIKOMWA ;
5. Révérend KATEGHE NDUNGO ;
6. Révérend MALIKIDOGO.
La date du 16 Décembre 2000 fut celle où la
chapelle de la CBCA-KATOYI était proclamée comme Paroisse
autonome sous le numéro matrice 430/CBCA.
Depuis son implantation, les serviteurs de Dieu s'y sont
succédé comme suit :
Figure N°06 : la succession des
serviteurs de Dieu
|
Noms du pasteur titulaire
|
Année d'exercice
|
Nom du pasteur assistant
|
|
Rév. KAMBALE KABWARO Balthazar
|
De 1990 - 05/09/1997
|
Rév. KITSONGERIE NGULIRO
|
|
Rév. KATEMBO MWENGASYALI
|
05/09/1997 - 2000
|
KAGABO HABIMANA
|
|
Rév. KAHONGYA BWIRUKA
|
Juillet - Août 2002
|
NDUNDI MATHE
|
|
Rév. BISIMWA NKINZI
|
Sept 2002 - 2007
|
Rév. KASEREKA MUHONGYA
|
|
Rév. KASEREKA MUHONGYA
|
2007 - 15/10/2008
|
Rév. MUSAKI Thomas
|
|
Rév. WANZIE VANGISIVAVI
|
15/10/2008 - 14/10/2011
|
Rév. MUSAKI Thomas
|
|
Rév. LIKANYA NDATA YA MBULA
|
14/10/2011 - 30/07/2012
|
Rév. MUSAKI Thomas
|
|
Rév. NDEMESI MUSEKWA Moise
|
31/07/2012 - 31/08/2012
|
Rév. MUSAKI Thomas
|
|
Rév. MUHINDO NYONDO Joseph
|
01/07/2012 à nos jours
|
Rév. MUSAKI Thomas
|
Source : rapport annuel de la CBCA
KATOYI
Commentaire : les années d'exercice concernent
seulement les Pasteurs titulaires.
Au fur et à mesure que la Paroisse grandit, la CBCA
KATOY, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a donné naissance à
d'autres Paroisses telles :
1. La Paroisse CBCA-SHABA avec à la succession des
responsables : le Révérend Pasteur KAMBALE KIVISI, PALUKU
KAHONGYA SYAUMBA, Samuel NGAYIHEMBAKO MUTAHINGA et aujourd'hui le Rév.
MAUKA MATHE BULALO assisté par MUHEKO SYAUSWA ;
2. La Paroisse CBCA MABANGA-NORD/KIBWE dans la
responsabilité et à la succession des responsables suivant ;
le Rév. KAMBALE KABWARO suivi du Rév. KAMBALE KANEHO et du
Rév. KAMBALE SIBENGEHA puis le Rév. MUHINDO KAVINGULO ;
3. La Paroisse OSSO KATO qui est en sa première
année d'ouverture et supervisée par le Rév. MUSAKI Thomas
et aujourd'hui remplacé par le Rév. BUSIMBA KWEZI affecté
par la hiérarchie de la communauté en Décembre 2012 ou
tous les services y sont organisés.
A part ces Paroisses ci-haut, la Paroisse CBCA KATOY a cinq
chapelles formées par 30 cellules dont voici la citation : la chapelle
CENTRALE, KATOY II, KATOY III, KATOY IV et LOWA. Les anciennes chapelles KATOY
I et KINDU II sont ceux qui ont formé la nouvelle Paroisse OSSO-KATO.
La CBCA opère au Congo (RDC) dans les Provinces du
Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Province Orientale et Kinshasa la capitale puis
dans d'autres Pays. Son objectif durant ces dernières années est
de conquérir toute l'Afrique Centrale par la proclamation de la bonne
nouvelle du Christ.
II.4.2.3 Forme de Gouvernement au sein de la CBCA
D'après TURN BULL, l'Eglise Protestante depuis sa
séparation avec l'Autorité papale, utilise trois formes
fondamentales de Gouvernement ecclésiastique : le
congrégationniste, l'épiscopal et le presbytéral36(*).
· Le congrégationniste appelé
indépendant dans ce sens que chaque église locale est autonome,
toute autorité législative est exercée par l'Eglise locale
et sans interférence du dehors.
· L'Episcopal, c'est le Gouvernement de l'Eglise par les
Evêques qui, seuls, ont le pouvoir d'établir les Ministres, mais
dans certains cas, le Surveillant a le pouvoir de choisir et de nommer les
Officiers. Il existe principalement trois sortes de ministres : les
Evêques, les Prêtres et les Diacres.
· Le presbytéral est le Gouvernement de l'Eglise
par les anciens, il prévoit habituellement les Ministres
suivants :
- Comité de l'église locale (le
Consistoire) ;
- Comité des membres effectifs au niveau communautaire
(assemblée générale) ;
Ces trois formes de gouvernement, argumente TURN BULL,
étaient utilisées dans l'église primitive. Dans
l'église naissante, la congrégation choisissait ses responsables
et les responsables agissaient selon les directives et suffrages de gens (actes
61-2, 15, 6,1. Timothée 4,14). Au sein de la CBCA, l'organisation est
définie dans les deux brochures que voici :
· Le statut ;
· Le Règlement d'Ordre Intérieur de la
CBCA.
De la synthèse de ces brochures, l'on est tenté
de dire que les formes du Gouvernement sont toutes utilisées dans la
CBCA, mais sur le plan pratique, il s'observe la prédominance du
Gouvernement Congrégationniste.
Au niveau de la base, on remarque une forme
Congrégationniste. Chaque église locale traite ses affaires,
baptise, enseigne, intègre ses membres, discipline, excommunie, prend
des décisions concernant la bonne marche de l'église et fait
seulement rapport à la hiérarchie.
Au niveau du Poste, sont seuls les Pasteurs et membres de
leurs bureaux qui dirigent. Les membres effectifs sont conseillés de
dirigeants des Postes, ils prennent part aux réunions de
l'Assemblée générale et sont habilités à
élire les dirigeants de la communauté. Ils engagent
l'église au niveau du Poste vers la base (Sections, Paroisse, Chapelles,
cellules, familles puis fidèles ou membre).
Ainsi, dans chaque Paroisse, le Pasteur responsable
représente automatiquement le Pasteur Surveillant et/ou le
Représentant légal selon des attributions définis aux
différentes organisations de la CBCA.
Au niveau national et international
A ce niveau, le Représentant légal dirige la
politique générale de l'Eglise sur tout le plan,cfr le
Règlement d'Ordre Intérieur de la CBCA qui stipule ce qui
suit :
Le Représentant légal en tant qu'organe est le
Coordinateur général et animateur principal de toute
activité aux services de l'association. Il est le Président du
comité, principal responsable et répondant au numéro un de
l'exécution des décisions des Assemblée
Générale. Il ordonne et consacre les serviteurs de Dieu
(Pasteurs,etc.) dans la commission de Ministre Pastoral au cours d'une
cérémonie solennelle et appropriée pour la circonstance,
il délègue ses pouvoirs aux Pasteurs des Paroisses selon le cas,
il veille au respect des statuts et Règlement d'Ordre Intérieur
de l'église en vue de garantir les qualités morales, spirituelles
et intellectuelles de ses membres. Il est gestionnaire des comptes ouverts
auprès des institutions financières (Banque, compte
chèques postaux) par le Trésorier communautaire qui est aussi un
de quatre mandateurs. Il désigne, mute, encourage, nomme, suspend et
révoque les membres de différents organes et comités
constitués au sein de la CBCA en collaboration avec son équipe
directoire. Il est secondé par un Vice-président et
représentant légal suppléants ou à un membre
quelconque de l'équipe dirigeante de son choix. Son mandat est de cinq
ans renouvelable37(*). A
ce niveau, le représentant légal est le chef de la
communauté à qui on amène toutes les décisions.
Au niveau de la Paroisse
Le Pasteur responsable de la paroisse représente le
Représentant légal dans sa Paroisse sous supervision du
Pasteur-surveillant du Poste ou District. Il coordonne toutes les
activités spirituelles et administratives de l'église et l'engage
devant les autorités politiques, militaires, civiles et religieuses au
nom du Représentant légal pour le problème non complexe et
fait rapport chaque trimestre, semestre et annuellement à la
hiérarchie c'est-à -dire au Poste.
Le Pasteur Associé de la Paroisse : il est
secondé d'un Evangéliste qui supervise les activités et
les enseignements aux nouveaux convertis qui se préparent pour le
baptême. Ces deux sont chargés de la statistique des
fidèles (membres ou chrétiens) dans la Paroisse. Ils
détiennent des registres contenant l'identité des membres selon
chaque cellule et chapelle. Ils font rapport au Pasteur titulaire qui, lui
aussi, fait son rapport chaque trimestre, semestre et annuellement au Poste qui
est son hiérarchie.
II.4.2.4. Structure au niveau de la Communauté
L'organe suprême de la CBCA est l'Assemblée
générale. Celle-ci est constituée de 120 membres effectifs
délégués de 17 Postes ecclésiastiques (ou
districts). Elle se réunit une fois l'an en session ordinaire. Le second
organe en dix-sept postes exécutifs avec 38 membres. La CBCA se
subdivise en dix-sept postes ecclésiastiques appelés dans
d'autres communautés secteurs. Il y a un Pasteur-surveillant à la
tête de chaque poste. L'administration de la CBCA est assurée par
un Président communautaire et Représentant légal
assisté par 3 mandataires élus pour cinq ans renouvelables.
Voici les quatre postes des mandataires de la CBCA :
ü Président et Représentant légal
(RL) ;
ü Vice-président et Représentant
légal suppléant (RLS) ;
ü Trésorier communautaire (TRECOM) ;
ü Secrétaire communautaire (SECOM).
II.4.2.5.Strucure Organisationnelle au niveau de la
Paroisse
MINISTERE DE DEVELOPPEMENT
ASSEMBLEE PAROISSIALE
CONSEIL ELARGI
CONSISTOIRE
PAROISSE
SECRETARIAT ET COMPTABILITE
MINISTRERE DES ENFANTNTS
EVANGELISATION
MISSION DE JEUNES CHRTIENT
PASTORALE
PROJET SOCIALE
SERVICE HOMME ET FAMILLE
SERVICE FEMME ET FAMILLE
CHAPELLES
CELLULES
FAMILLES
FigureN°07 Organigramme
Source : rapport annuel de la CBCA
KATOYI
a) Assemblée Ordinaire Paroissiale
C'est un regroupement de tous les fidèles
(chrétiens) effectifs de la Paroisse communiant (participent à la
sainte Saine). Elle a comme rôle d'élire les dirigeants et
serviteurs de Dieu au sein de la Paroisse (anciens, diacres...). Elle discute
différents problèmes enrapport du conseil Paroissial et de
différentes commissions permanentes de la Paroisse. Elle élabore
le plan d'action et prévision budgétaire de chaque
année.
b) Le Conseil Elargie
Ce dernier est convoqué par le consistoire pour
évaluation, et faire le suivi des activités planifiées
dans chaque service de la Paroisse et a pour membres composant les
comités de différents services. Cet organe siège chaque
après un ou deux mois sous la direction du Pasteur Paroissial.
c) Le Consistoire
Il est composé de serviteurs permanents et les anciens
de l'Eglise. Ils se réunissent chaque samedi de 7 à 11h30'.
Placé au-dessus de différents services, il s'occupe de la vie de
l'Eglise, reçoit, discute et oriente différentes
préoccupations et suggestions des commissions transmises soit
verbalement, ou par correspondance. Il planifie et supervise les
activités culturelles, l'évangélisation ainsi que les
visites pastorales. Il est présidé par le Pasteur Titulaire
Responsable et en cas d'empêchement ce dernier sera présidé
par le Pasteur Associé et/ou un des Anciens désigné par le
Pasteur responsable (crf)
d) Le Pastoral
Ce dernier est présenté par le Pasteur Titulaire
responsable de la Paroisse. Il est l'Administrateur, Directeur et Coordonnateur
de toutes les activités des services Paroissiaux et s'occupe
particulièrement du suivi spirituel des familles de tous les
fidèles :
- Des anciens ;
- Des diacres ;
- Des membres des commissions permanentes de la Paroisse ou
comités paroissiaux (SFF, SHF, MINENFANT (ECODIM), JPSC) et tous les
fidèles ;
- S'assure de l'exécution des tâches relative aux
programmes ;
- Prévoit mensuellement l'évolution du travail
au conseil élargi
- Il fait asseoir, dans le cadre de finance, le programme de
mobilisation et de gestion de ressources. Il en est gérant ;
- Il élabore le budget de recette
prévisionnelle, ordonne des dépenses en observant les
prévisions de l'année. Il en est de même des
activités non prévues.
En collaboration avec le Secrétaire comptable, il
coordonne toutes les activités internes et externes de la Paroisse.
C'est ainsi qu'il coordonne toutes les activités de la paroisse en vue
de :
- S'assurer que les objectifs de la paroisse sont poursuivis
tel que prévus ;
- Proclamer l'évangile du Royaume de Dieu selon les
écritures saintes ;
- Administrer les sacrements et assurer d'autres
activités pastorales comme le baptême, le mariage, la Sainte
saine, le culte funèbre, etc. ;
- Initier et entretenir des oeuvres sociales entre
autre : les écoles, les oeuvres médicales et d'autres
projets de développement durable et non durable.
e) L'évangélisation
Chapeauté par le Pasteur Associé aidé par
l'Evangéliste Paroissial, il est organisé par le Comité
des Evangélistes. Ayant comme objectifs de gagner les âmes pour
Christ en annonçant la bonne nouvelle dans la Ville de Goma et de ses
environs, d'affirmer les chrétiens spirituellement, d'accompagner les
fidèles dans leur parcours spirituel et social, il organise :
- Des campagnes d'évangélisation en
pleinair ;
- Des enseignement et études bibliques ;
- Des intercessions et délivrances, l'accompagnement
spirituel ;
- Des formations des ambassadeurs, l'élaboration de
moutures (versions) de la catéchèse, de la préparation des
néophytes au baptême ;
- Organise des séminaires et fait l'affermissement.
Dans le cadre administratif, les Pasteurs Associés et
Evangélistes s'occupent du recensement physique des fidèles
(membres) par famille de la Paroisse, ils enregistrentles fidèles
maisons par maison et disposent d'un registre statistique dans chaque Cellule
et Chapelle. Il signale les mouvements des chrétiens dans ces registres
(arrivée des chrétiens, déménagements,
décès, nouveaux baptisés, ...), et détiennent
également un registre centralisateur au bureau de la Paroisse.
En rapport avec la politique de la mobilisation des recettes,
ils réfléchissent sur les stratégies et les thèmes
pouvant inciter les chrétiens ou fidèles à souscrire de
manière consistante au fonctionnement et vie de la Paroisse.
Après identification des chrétiens de la paroisse, ils organisent
des visites familiales avec les anciens et Pasteur titulaire afin d'une
confortation et prière.
f) La Diaconie
S'occupe du développement de la Paroisse et
réfléchit sur les projets d'autofinancement. S'assurer que les
biens de l'église tels que repris dans le registre d'inventaire
existent, sont gardés en bon état et bien protégés
(par les règlements de la communauté et la loi de notre Pays). Du
point de vue finance, elle veilleà la bonne gestion des fonds selon la
planification et les prévisions budgétaires dans les limites de
sa responsabilité en collaboration avec le comptable et le Pasteur
responsable. A part les tâches citées ci-haut, elle
s'occupe de (d') :
- Exécuter les dépenses d'investissement
prévues (projet, équipement, entretien,...) ;
- Envisager la réalisation d'au moins un projet
d'autofinancement par an, c'est ainsi qu'au coeur de cette année, il a
des projets encours tel : des champs, cantine, élevage et
dépôts à faire louer ;
- Veiller à la propreté du temple, de la
parcelle de la Paroisse et même des maisons des serviteurs.
g) Le Secrétariat et Comptable
Ø SECRETARIAT
Dirigé par un secrétaire qui est chargé
de :
· L'exploitation des lettres destinées à
l'administration de l'Eglise, aux différents services et tiers ;
· Classement des dossiers et lettres
reçus ;
· La réception physique des courriers
émanant de différents Postes, Paroisses et des tiers ;
· La transmission des dossiers et courriers ;
· La mise en conformité des lettres et autres
documents signés par le Pasteur ;
· Faire le rapportage des réunions du consistoire
et des conseils Elargi ;
· La saisie de différents documents et comptes
rendus ;
· Enseignement de nouveaux baptisés, nouveaux
mariés, nouveaux venus, des décès, des enfants
dédiés, de nouvelles fiançailles, etc. ;
· L'annonce et orientation des visiteurs ;
· La préparation du journal d'audience du
Pasteur ;
· L'organisation du programme de nettoyage des bureaux et
entretien des mobiliers et matériels de bureau du Pasteur ;
· Veiller aux listes de présence des agents et
cadres sous son autorité ;
· Veiller sur les limites des dépenses
planifiées dans la prévision budgétaire annuelle ;
· Gérer les carnets des comptes et des
chèques ;
· Faire le rapport de finance de la Paroisse ;
· Mettre à jour les fiches comptables ;
· Mettre à jour la liste des membres et la
statistique.
Ø LE CAISSIER
Chargé de la comptabilité de l'Eglise telle
que :
· Réception des offrandes et autres fonds en
liquidité de la Paroisse ;
· Tenir en jour les livres de caisse ;
· Garder les fonds de l'Eglise. Il peut également
participer à l'approvisionnement des rayons ou à
l'étiquetage des produits. Il indique le solde de la caisse lorsqu'il a
pris son poste et le solde à la fin de son temps de travail.
h) Les Présidents ou Chefs des
Services
Ces derniers sont des représentants du Pasteur au
niveau de leurs services, chapelles et cellules. Ils organisent des
séminaires, des enseignements répondant aux besoins de chaque
catégorie des fidèles ou membres. Ils font les rapports au Chef
qui est le Pasteur responsable à travers le service de
l'évangélisation. Dans cette organisation (église), sont
seulement rémunérés : les Pasteurs, le
secrétaire comptable, l'Evangéliste, le caissier et la sentinelle
qui forment l'équipe des agents permanents de la Paroisse. Le salaire
des agents de la Paroisse proviennent des 40% de recettes de chaque mois. Ils
n'ont pas un salaire fixe. Les finances viennent des offrandes et des fonds des
chrétiens membres, des amis et de différentes recettes des
services d'autofinancement de la Paroisse. Peuvent recevoir des encouragements
des tous les autres Chefs des services et Président responsables des
chapelles en cas de bénédiction dans la Paroisse. La CBCA a comme
mission : gagner, former, envoyer et servir et l'homme tout entier
c'est-à-dire corps, esprit et âme.
CHAPITRE III :
PRESENTATION, ANALYSE DES DONNEES ET INTERPRETATION DES RESULTATS
Dans ce dernier chapitre, nous allons présenter d'abord
toutes nos données récoltées auprès de la CBCA
KATOYI, en suite procéder à leur analyse et en fin
interpréter les résultats trouvés à l'issue de nos
analyses.
III.1 PRESENTATION DES
DONNEES
III.1.1 Effectifs de la CBCA
KATOYI de 2010-2014
FigureN°08 Les effectifs des fidèles de la CBCA
KATOYI de 2010-2014
|
Désignation
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
Les baptisés
|
1050
|
1189
|
1134
|
1088
|
1038
|
|
Les non baptisés
|
1269
|
1427
|
1165
|
1214
|
1445
|
|
Total
|
2319
|
2616
|
2299
|
2302
|
2483
|
Source : rapports annuels de la CBCA
KATOYI
Commentaire : la diminution des fidèles pour les
années 2010 et 2012 est liée à l'ouverture de deux
Paroisses, qui sont la Paroisse CBCA SHABA et la Paroisse CBCA
KIBWE/MABANGA-NORD.
III.1.2 Tableau du budget de
recettes
Figure N°09 Prévisions de recettes
budgétaires en $
|
Désignation
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
Total
|
Moyenne
|
|
Offrandes ordinaires
|
22500
|
29600
|
30400
|
28305
|
28208
|
139013
|
27802,60
|
|
Engagements
|
18550
|
14728
|
13685
|
21070
|
20652
|
88685
|
17737,00
|
|
Offrande des services
|
3425
|
2500
|
3250
|
2900
|
3577
|
15652
|
3130,40
|
|
Chapelles
|
300
|
290
|
285
|
400
|
358
|
1633
|
326,60
|
|
Contributions des écoles
|
500
|
250
|
850
|
260
|
350
|
2210
|
442,00
|
|
Orphelins
|
1600
|
2083
|
3500
|
2070
|
1860
|
11113
|
2222,60
|
|
Total
|
46875
|
49451
|
51970
|
55005
|
55005
|
258306
|
51661,20
|
|
Moyenne
|
7812,5
|
8241,83
|
8661,67
|
9167,5
|
9167,5
|
|
|
Source : rapports annuels de la CBCA
KATOYI
En effet, au vu des moyennes annuellesde recettes
budgétaires, on trouve qu'en 2010 la CBCA KATOYI avait
élaboré un budget en moyenne de 7812,5, 8241,83 en 2011, 8661,67
en 2012, 9167,5 en 2013 et 9167,5 en 2014. Pour toutes les cinq années
d'observation, la moyenne annuelle a été 51661,2$. Ce qui fait
que la CBCA KATOYIélabore un budget de recette mensuellement autour
51661,2$/12 mois, soit 4305,1$ par mois. Nous remarquons qu'elles ont connu un
accroissement pendant presque toutes les années d'études sauf
pour les deux dernières où elles sont restées statiques.
La CBCA KATOYI ayant un principe fondé sur la
« fois » c'est la raison pour laquelle il y a toujours
augmentation du budget et il a été dit que le budget peut rester
statique pour deux années suite à la réalisation du budget
de l'année écoulée, mais par conséquent, n'est peut
être réduit
III.1.3. Tableau de
l'exécution du budget de recettes
|
Désignation
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
Total
|
Moyenne
|
|
Offrande ordinaire
|
26453
|
24353
|
26251
|
22428
|
23563
|
123047,1
|
24609,42
|
|
Engagement
|
15458
|
14956
|
18201
|
18516,8
|
20544
|
87674,75
|
17534,95
|
|
Offrande des services
|
5420
|
3526,6
|
4002
|
4184,02
|
2870
|
20002,59
|
4000,518
|
|
Chapelles
|
250
|
297,95
|
245
|
395.49
|
358
|
1150,95
|
230,19
|
|
Contributions des écoles
|
300
|
720
|
760
|
290
|
350
|
2420
|
484
|
|
Cantine
|
1600
|
900
|
1500
|
1872
|
1294
|
7166
|
1433,2
|
|
Dons
|
2300
|
2566
|
2155
|
3768,74
|
1500
|
12289,74
|
2457,948
|
|
Emprunt
|
3245,95
|
1700
|
6563
|
4100
|
3650
|
19258,95
|
3851,79
|
|
Total
|
55027
|
49019
|
59676
|
55555
|
54128
|
273405,55
|
54681,11
|
|
Moyenne
|
6878,37
|
6127,41
|
7459,53
|
6944,38
|
6766,01
|
|
|
Tableau N°10 Tableau de la réalisation
du budget de recettes
Source : Source : rapports annuels de la
CBCA KATOYI
En lisant les contenus de ce tableau, nous constatons qu'en
moyenne les réalisations budgétaires de recettes se sont
retranchées à 6878,37$ en 2010, 6127,41$ en 2011, 7459,53$en
2012, 6944,38$en 2013 et 6766,01$en 2014. Bien qu'il y a eu scission de cette
dernière mais les recettes en moyenne de toutes les cinq se sont
levées à 54681,11$. De part ceux-ci, les moyennes de composante
de la réalisation du budget se retracées ainsi : 24609,42$
pour les offrandes ordinaires, 17534,95$ pour les engagements, 4000,518$ pour
les offrandes ordinaires, 230,19$ pour les chapelles, 484$ pour les
contributions des écoles, 1433,2$ pour le cantine, 2457,948$ pour les
dons et 3851,79$ pour les emprunts.
III.1.4. Tableau du budget
dépense
Tableau N°11 Prévisions
budgétaire de dépenses
|
Désignation
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
Total
|
Moyenne
|
|
Administration
|
22800
|
24490
|
23550
|
19730
|
21263
|
111833
|
22366,6
|
|
Evangélisation
|
5050
|
4830
|
4260
|
7070
|
7200
|
28410
|
5682
|
|
Fonctionnement service
|
4200
|
3500
|
2973
|
3180
|
3200
|
17053
|
3410,6
|
|
Développement
|
4180
|
4390
|
8250
|
10630
|
9566
|
37016
|
7403,2
|
|
Sociale
|
1115
|
1500
|
2654
|
2600
|
2958
|
10827
|
2165,4
|
|
Contribution
|
4050
|
4750
|
5169
|
5745
|
4300
|
24014
|
4802,8
|
|
Divers rencontre
|
2670
|
2389
|
2164
|
1550
|
2964
|
11737
|
2347,4
|
|
Autres charges
|
2810
|
3602
|
2950
|
4500
|
3554
|
17416
|
3483,2
|
|
Total
|
46875
|
49451
|
51970
|
55005
|
55005
|
258306
|
51661,2
|
|
Moyenne
|
5859,38
|
6181,38
|
6496,25
|
6875,63
|
6875,63
|
|
|
Source : rapports annuels de la Paroisse CBCA
KATOYI
Les dépenses prévues pour les différentes
années se sont présentées moyennement à5859,38$ en
2010, 6181,38$ en 2011, 6496,25$ en 2012, 6875,63$ en 2013 et 6875,63$ pour
l'année 2014. Aussi, en les moyennes annuelles se sont
enrôlées en administrationpour 22366,6$, 5682$ pour
l'Evangélisation, 3410,6$ pour le fonctionnement service, 7403,2$ pour
le développement, 2165,4$ pour le sociale, 4802,8$ pour les diverses
contributions, 2347,4$ pour divers rencontres et 3483,2$ pour les autres
charges. La moyenne totale de toutes les cinq s'était sommée
à 51661,2$.
III.1.5. Tableau de la
réalisation du budget de dépenses
Tableau N°12 Exécution du budget de
dépense
|
Désignation
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
Total
|
Moyenne
|
|
Administration
|
24325,2
|
24317,6
|
24951
|
22311
|
24537
|
120441,7
|
24088,34
|
|
Evangélisation
|
7185
|
4871
|
7962
|
4459,8
|
7700,6
|
32178,42
|
6435,684
|
|
Fonctionnement service
|
2946,45
|
2521,4
|
3987
|
3283,3
|
4024
|
16762,15
|
3352,43
|
|
Développement
|
8456,3
|
9708,8
|
8568
|
10256
|
8352,9
|
45341,9
|
9068,38
|
|
Sociale
|
4336
|
3003,3
|
4433
|
4156,9
|
3793,65
|
19722,81
|
3944,562
|
|
Contribution
|
3591
|
1257,41
|
5163
|
5651,8
|
1934,2
|
17597,44
|
3519,488
|
|
Divers rencontre
|
1938
|
1771,24
|
2032
|
1946,6
|
1289,8
|
8977,61
|
1795,522
|
|
Autres charges
|
1963
|
1132
|
2456
|
2982
|
1645
|
10178
|
2035,6
|
|
Total
|
54741
|
48582,8
|
59552
|
55047
|
53277,2
|
271199,85
|
54239,97
|
|
Moyenne
|
6842,62
|
6072,84
|
7444,00
|
6880,88
|
6659,64
|
|
|
Source : rapports annuels de la Paroisse CBCA
KATOYI
Pendant notre période d'étude, les
dépenses réelles de la Paroisse CBCA KATOYI durant les 5 ans ses
sont enrôlées en moyenne à 6842,62$ en 2010, 6072,84$ en
2011, 7444$ en 2012, 6880,88$ en 2013 et 6659,64$ en 2014. Les moyennes des
affectations de sommes affectées se sont enrôlés de
24088,34$, 6435,684$ pour l'évangélisation, 3352,43$ pour le
fonctionnement service, 9068,38$ pour le développement, 3944,562$ pour
les sociales, 3519,488$ pour diverses contributions, 1795,522$ pour les
rencontres, 2035,6$ pour les autres charges. Ainsi, la moyenne des 5 cinq est
élevée à 54239,97$
III.2 ANALYSE DES DONNEES ET
INTERPRETATION DES RESULTATS
III.2.1 Calcul de
l'efficacité de la Paroisse CBCA KATOYI
Figure N°13 Tableau du calcul de
l'efficacité
|
Année
|
Prévision
|
Réalisation
|
Ecarts
|
|
|
|
|
Favorable
|
Défavorable
|
|
2010
|
46875
|
55026,95
|
8151,95
|
|
|
2011
|
49451
|
49019,3
|
|
431,7
|
|
2012
|
51970
|
59676,2
|
7706,2
|
|
|
2013
|
55005
|
55555
|
550
|
|
|
2014
|
55005
|
54128,1
|
|
876,9
|
|
Total
|
258306
|
273405,55
|
16408,15
|
1308,6
|
|
Solde
|
15099,55
|
|
|
15099,55
|
|
Balance
|
273405,55
|
273405,55
|
16408,15
|
16408,15
|
Source : tableau établi par nous
même à partir des données recueillies
Selon le tableau ci-haut, nous avons constaté
après qu'on ait effectué les calculs en confrontant les
prévisions aux réalisations de la CBCA KATOYI seules les
années 2010, 2012 et 2013 ont eu les écarts importants et
favorable de 8152$ soit 17,39%, 7706,2$ soit 14,83% et 876,9$ soit 0,99%
successivement suite aux grandes contributions qu'effectuées les
fidèles pour l'ouverture de la Paroisse SHABA et MABANGA-NORD/KIBWE et
une salle polyvalente. Et les écarts défavorables se sont
manifestés aux années 2011 de 431,7 soit 0,87% et 2014 de 876,9$
soit 1,59% suite une diminution des fidèles qui s'était
manifestée au début de ces années qui
occasionnèrent la non réalisation.
III.2.2 Calcul de l'efficience
de la Paroisse CBCA KATOYI
Figure N°14 Tableau du calcul de
l'efficience
|
Année
|
Prévision
|
Réalisation
|
Ecarts
|
|
|
|
|
Favorable
|
Défavorable
|
|
2010
|
46875
|
54740,95
|
|
7865,95
|
|
2011
|
49451
|
48582,75
|
868,25
|
|
|
2012
|
51970
|
59552
|
|
7582
|
|
2013
|
55005
|
55047
|
|
42
|
|
2014
|
55005
|
53277,15
|
1727,85
|
|
|
Total
|
258306
|
271199,85
|
2596,1
|
15489,95
|
|
Solde
|
12893,85
|
|
12893,85
|
|
|
Balance
|
271199,85
|
271199,85
|
15489,95
|
15489,95
|
Source : tableau établi par nous même
à partir des données recueillies
L'efficience étant l'utilisation rationnelle de moyens
mise à la disposition des tierces personnes ou entreprises, d'où
l'analyse par exception qui se focalise aux montants ou pourcentages
importants, la CBCA KATOYI avait connu des écarts signifiants
négatifs (défavorables) aux années 2010 et 2012 suite
à la scission de cette dernière pour l'ouverture de la Paroisse
SHABA et MABANGA-NORD/KIBWE où il eut fallu une grande dépense
pour la réussite de cet évènement.
Figure N° 15 Démonstration de la
performance 38(*)
|
EFFICACE
|
EFFICIENCE
|
PERFORMANCE
|
|
Oui
|
Non
|
Non
|
|
Non
|
Oui
|
Non
|
|
Oui
|
Non
|
Non
|
|
Oui
|
Non
|
Non
|
|
Non
|
Oui
|
Non
|
Source : tableau établi par nous même
à partir des données recueillies
La performance étant la manigance du facteur
efficacité et efficience39(*), en nous basant aux figures n° 13, 14 et 15 nous
avons constaté que la CBCA KATOYI n'est pas performante dans son
évolution.
III.2.3 Calcul de
l'indépendance Financière
Pour déterminer l''indépendance
financière il faut effectuer le rapport entre les recettes propres et
les passif total (totales recettes). D'où

Figure N°16Calcul de l'indépendance
financière
|
Année
|
Recettes Propres
|
Totales Recettes
|
Pourcentage
|
|
2010
|
49481
|
55026,95
|
89,92%
|
|
2011
|
44753,3
|
49019,3
|
91,30%
|
|
2012
|
50958,2
|
59676,2
|
85,39%
|
|
2013
|
47686,2
|
55555
|
85,84%
|
|
2014
|
48978,1
|
54128,1
|
90,49%
|
Source : tableau établi par nous
même à partir des données recueillies
A ce qui concerne l'indépendance financière de
la CBCA KATOYI, en explorant notre tableau, nous constatons que cette
dernière est indépendante en terme globale de financer ses
activités sans recourir aux emprunts en fonction de 89,92% en
2010 ; 91,3% en 2012 ; 85,39% en 2012 ; 85,84en 2013 et 90,49 en
2014.
Tableau N°17 calcul de la couverture des dépenses
par rapport aux recettes propres.
|
Année
|
Recettes Propres
|
Dépenses engagées
|
Ecarts
|
Pourcentage
|
|
2010
|
49481
|
54741
|
5260
|
17,93%
|
|
2011
|
44753,3
|
48582,8
|
3829,5
|
13,05%
|
|
2012
|
50958,2
|
59552
|
8593,8
|
29,29%
|
|
2013
|
47686,2
|
55047
|
7360,8
|
25,09%
|
|
2014
|
48978,1
|
53277,2
|
4299,1
|
14,65%
|
|
Total
|
241856,8
|
271200
|
29343,2
|
100,00%
|
Source : tableau établi par nous
même à partir des données recueillies
Nous référant à ces calculs, nous
constatons que la CBCA KATOYI avait recouru aux dettes en termes de 17,93%,
13,05%, 29,29%, 25,09% et 14,65% successivement aux années
d'études pour faire face à ses dépenses
exécutées. Ce qui veut signifier que cette dernière
était à mesure de financer ses dépensesà travers
ses recettes propres en termes de 82,07%, 86,95%, 70,71%, 74,91%, 85,35%.
Figure N°18calcul de la structure
financière en $ et en%
|
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
Total fin. Reçus
|
|
Montant
|
%
|
Montant
|
%
|
Montant
|
%
|
Montant
|
%
|
Montant
|
%
|
241856,88 soit 88,46%
|
|
Offrande ordinaire
|
26453
|
48,07%
|
24353
|
49,68%
|
26251
|
43,99%
|
22428
|
40,37%
|
23563
|
43,53
|
|
Engagement
|
15458
|
28,09%
|
14956
|
30,51%
|
18201
|
0,30
|
18516,75
|
33,33%
|
20544
|
37,95
|
|
Offrande des services
|
5420
|
9,85%
|
3526,6
|
7,19%
|
4002
|
6,71%
|
4184,02
|
7,53%
|
2870
|
5,30
|
|
Chapelles
|
250
|
0,45%
|
297,95
|
0,61%
|
245
|
0,41%
|
395,49
|
0,71%
|
358
|
0,66
|
|
Contributions des écoles
|
300
|
0,55%
|
720
|
1,47%
|
760
|
1,27%
|
290
|
0,52%
|
350
|
0,65
|
|
Cantine
|
1600
|
2,91%
|
900
|
1,84%
|
1500
|
2,51%
|
1872
|
3,37%
|
1294
|
2,39
|
|
Total financement interne
|
49481
|
|
44753,32
|
|
50958,2
|
|
47686,26
|
|
48978,1
|
|
|
Dons
|
2300
|
4,18%
|
2566
|
5,23%
|
2155
|
3,61%
|
3768,74
|
6,78%
|
1500
|
2,77
|
31548,69 soit 11,54%
|
|
Emprunt
|
3246
|
5,90%
|
1700
|
3,47%
|
6563
|
11,00%
|
4100
|
7,38%
|
3650
|
6,74
|
|
Total financement externe
|
5545,95
|
|
4266
|
|
8718
|
|
7868,74
|
|
5150
|
|
|
Total financements Reçus
|
55026,95
|
|
49019,32
|
|
59676,2
|
|
55555
|
|
54128,1
|
|
273405,57
|
Source : tableau établi par nous
même à partir des données recueillies.
A la lecture de ce tableau, nous constatons que sur une somme
de 55026,95$ en 2010 collectée par la CBCA KATOYI, le financement
interne a été de 49481 soit 89,92%, en 2011 le financement
interne est chiffré à 44753,32$ soit 91,3% , en 2012 le
financement interne était de 50958,2$ soit 85,39% , en 2013 le
financement interne a été de 47686,26$ soit 85,84% et en 2014 le
financement interne était de 48978,1$ soit 90,49%.,57$ . Du total
de financement reçu et collectés par la CBCA KATOYI, les
financements internes ont été de l'ordre de 241856,88$ soit
88,46% contre 31548,69$ soit 11,56%. Nous constatons que la CBCA KATOYI est
autonome en grande partie de 88,46% de son financement provenant de ses
services.
D'une manière générale, sur les 273405$
du total de financement reçu et collecté par la CBCA KATOYI, les
financements internes ont été de l'ordre de 241865,88$ soit
88,46% contre 31548,69$ soit 11,54% reçu des bailleurs de fonds.
III.2.1 Calcul de de la
corrélation par source de recettes de la Paroisse CBCA KATOYI
Nous voulons vérifier si y peut être
expliqué par x ou du moins si x influence y. quelques formules de base,
X étant les recettes de la Paroisse et Y les effectifs de membre de la
CBCA KATOY.
- La moyenne des effectifs de la CBCA KATOYI :
- La moyenne de recettes de la CBCA KATOYI :
Coefficient de corrélation : r² étant égale à
1-r r² étant égale à
1-r
 
|
Année
|
Effectifs (xi)
|
Offrande Ordinaire (yi)
|
xi-X
|
yi-Y
|
x²
|
y²
|
(xi-X)(yi-Y)
|
|
2010
|
2319
|
26453
|
-84,80
|
1843,58
|
7191,04
|
3398787,22
|
-156335,584
|
|
2011
|
2616
|
24353
|
212,20
|
-256,42
|
45028,84
|
65751,22
|
-54412,324
|
|
2012
|
2299
|
26250,5
|
-104,80
|
1641,08
|
10983,04
|
2693143,57
|
-171985,184
|
|
2013
|
2302
|
22428
|
-101,80
|
-2181,42
|
10363,24
|
4758593,22
|
222068,556
|
|
2014
|
2483
|
23562,6
|
79,20
|
-1046,82
|
6272,64
|
1095832,11
|
-82908,144
|
|
Total
|
12019
|
123047,1
|
0,00
|
0,00
|
79838,80
|
12012107,33
|
-243572,68
|
|
Moyenne
|
2403,8
|
24609,42
|
|
|
|
|
|
Tableau N° 19 la corrélation entre les effectifs
et les offrandes ordinaires
Source : tableau établi à
partir des données recueillies





Ce coefficient étant inférieur à 0,1 et
en même temps négatif, les deux variables fidèles et
offrandes ordinaires varient dans le sens contraire. Plus les fidèles
n'augmentent, les offrandes ordinaires ont tendance à baisser. Le fait
que -0,248720723 est inférieur à 0,1 il y a donc une
corrélation négative. Le coefficient de détermination
r2 = 0,06186 signifie que le nombre de fidèles explique
à 6,186% les recettes réalisées.
Comme nous avons calculé l'équation de tendance
 , et comme la pente est négative (a < 0) ; dans la suite
soumettons cette pente à un test statistique en vue d'envisager une
quelconque explication de cette croissance. , et comme la pente est négative (a < 0) ; dans la suite
soumettons cette pente à un test statistique en vue d'envisager une
quelconque explication de cette croissance.
v Test de la tendance
1°. Hypothèses
- Nulle ou H0 : a =0
Test bilatéral
- Alternative ou Ha : a ? 0
2°. Seuil de signification á = 1%
3°. Comme n = 5 < 30, nous utilisons la loi de
distribution « t » de student pour approximer T
4° la règle de décision est telle :
Rejeter Ho si Tc> Tth
Calcul du t 
TC = 1,788246003 alors que T+h = 1,53,
nous rejetons H0 au seuil de 1% et concluons que la pente
« a » est significativement différent de
zéro. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une relation parfaite entre les
fidèles et les recettes
Tableau N°20 corrélation entre les effectifs et
les engagements
|
Année
|
Effectifs (xi)
|
Engagement (yi)
|
xi-X
|
yi-Y
|
x²
|
y²
|
(xi-X)(yi-Y)
|
|
2010
|
2319
|
15458
|
-84,8
|
-2076,95
|
7191,04
|
4313721,303
|
176125,36
|
|
2011
|
2616
|
14955,8
|
212,2
|
-2579,15
|
45028,84
|
6652014,723
|
-547295,63
|
|
2012
|
2299
|
18200,7
|
-104,8
|
665,75
|
10983,04
|
443223,0625
|
-69770,6
|
|
2013
|
2302
|
18516,75
|
-101,8
|
981,8
|
10363,24
|
963931,24
|
-99947,24
|
|
2014
|
2483
|
20543,5
|
79,2
|
3008,55
|
6272,64
|
9051373,103
|
238277,16
|
|
Total
|
12019
|
87674,75
|
0
|
0,00
|
79838,8
|
21424263,43
|
-302610,95
|
|
Moyenne
|
2403,8
|
17534,95
|
|
|
|
|
|
Source : tableau établi à partir des
données recueillies





Le pourcentage de r² étant de 0,05353643 soit
5,35% veut dire que la variation de y s'explique par la variation de x ou en
d'autre terme x fait varier y dans l'ordre de 5,35%, les 94,65% de variation de
y étant expliqués par d'autres facteurs. Etant donné que
le coefficient est négatif de 0,2313794, il veut signifier qu'il y a une
corrélation variant dans le sens contraire. L'augmentation de x a
tendance à diminuer y.
Etant donné qu'on a calculé l'équation de
tendance  , et comme la pente est négative (a < 0) ; dans la
suite soumettons cette pente à un test statistique en vue d'envisager
une quelconque explication de cette croissance. , et comme la pente est négative (a < 0) ; dans la
suite soumettons cette pente à un test statistique en vue d'envisager
une quelconque explication de cette croissance.
v Test de la tendance
1°. Hypothèses
- Nulle ou H0 : a =0
Test bilatéral
- Alternative ou Ha : a ? 0
2°. Seuil de signification á = 1%
3°. Comme n = 5 < 30, nous utilisons la loi student
pour approximer T
4° la règle de décision est telle :
Rejeter Ho si Tc> Tth
Calcul du t 
TC = 1,78036347 alors que T+h = 1,53,
nous rejetons H0 au seuil de 1% et concluons que la pente
« a » est significativement différente de
zéro. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une relation parfaite entre les
fidèles et les engagements des fidèles.
Tableau N°21 corrélation entre les effectifs et
les offrandes de service
|
Année
|
Effectifs (xi)
|
Offrandede service (yi)
|
xi-X
|
|
yi-Y
|
x²
|
y²
|
(xi-X)(yi-Y)
|
|
2010
|
2319
|
5420
|
-84,8
|
|
1419,48
|
7191,04
|
2014929,148
|
-120372,0736
|
|
2011
|
2616
|
3526,57
|
212,2
|
|
-473,95
|
45028,84
|
224626,7067
|
-100571,7656
|
|
2012
|
2299
|
4002
|
-104,8
|
|
1,48
|
10983,04
|
2,196324
|
-155,3136
|
|
2013
|
2302
|
4184,02
|
-101,8
|
|
183,5
|
10363,24
|
33672,984
|
-18680,5036
|
|
2014
|
2483
|
2870
|
79,2
|
|
-1130,52
|
6272,64
|
1278070,948
|
-89537,0256
|
|
Total
|
12019
|
20002,59
|
0,00
|
|
0
|
79838,8
|
3551301,984
|
-329316,682
|
|
Moyenne
|
2403,8
|
4000,518
|
|
|
|
|
|
|
Source : tableau établi par nous
même à partir des données recueillies


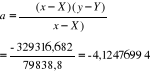


Les deux variables fidèles et recettes varient dans le
sens inverse vu que le coefficient est négative de . Le coefficient de détermination r² étant
égale à 0,38249508 soit 38,24% il signifie que les engagements
interviennent à la réalisation de recettes en termes de 38,24%,
les 61,76% sont expliqués par d'autres sources que les engagements. . Le coefficient de détermination r² étant
égale à 0,38249508 soit 38,24% il signifie que les engagements
interviennent à la réalisation de recettes en termes de 38,24%,
les 61,76% sont expliqués par d'autres sources que les engagements.
Etant donné qu'on a calculé l'équation de
tendance  , et nous constatons que la pente est négative (a< 0) ;
dans la suite soumettons cette pente à un test statistique en vue
d'envisager une quelconque explication de cette croissance. , et nous constatons que la pente est négative (a< 0) ;
dans la suite soumettons cette pente à un test statistique en vue
d'envisager une quelconque explication de cette croissance.
v Test de la tendance
1°. Hypothèses
- Nulle ou H0 : a =0
Test bilatéral
- Alternative ou Ha : a ? 0
2°. Seuil de signification á = 1%
3°. Comme n = 5 < 30, nous utilisons la loi de
distribution de « t » de student pour approximer T
4° la règle de décision est telle :
Rejeter Ho si Tc> Tth
Calcul du t 
TC = 2,2041463 alors que T+h = 1,53,
nous rejetons H0 au seuil de 1% et concluons que la pente
« a » est significativement différente de
zéro. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une relation parfaite entre les
fidèles et les offrandes de services.
Tableau N°22 Corrélation entre les effectifs et
les contributions de chapelles
|
Année
|
Effectifs (xi)
|
Chapelles (yi)
|
xi-X
|
yi-Y
|
x²
|
y²
|
(xi-X)(yi-Y)
|
|
2010
|
2319
|
250
|
-84,8
|
-59,288
|
7191,04
|
3515,06694
|
5027,6224
|
|
2011
|
2616
|
297,95
|
212,2
|
-11,338
|
45028,84
|
128,550244
|
-2405,9236
|
|
2012
|
2299
|
245
|
-104,8
|
-64,288
|
10983,04
|
4132,94694
|
6737,3824
|
|
2013
|
2302
|
395,49
|
-101,8
|
86,202
|
10363,24
|
7430,7848
|
-8775,3636
|
|
2014
|
2483
|
358
|
79,2
|
48,712
|
6272,64
|
2372,85894
|
3857,9904
|
|
Total
|
12019
|
1546,44
|
0,00
|
0,00
|
79838,8
|
17580,2079
|
4441,708
|
|
Moyenne
|
2403,8
|
309,288
|
|
|
|
|
|





Ayant calculé le coefficient qui est positif de
0,11855804, il implique que les offrandes de chapelles varient dans le
même sens que les effectifs, avec le coefficient de détermination
r² de 0,01405601 soit 1,4% qui nous indique que les fidèles
intervient à 1,4% dans la variation de contribution de chapelles en
revanche pour participer à la réalisation du budget de la
Paroisse, les 98,6% étant expliqué par autres facteurs que les
contribuions des chapelles. Vuqu'on a calculé l'équation de
tendance  , et comme la pente est négative (a < 0) ; dans la
suite soumettons cette pente à un test statistique en vue d'envisager
une quelconque explication de cette croissance. , et comme la pente est négative (a < 0) ; dans la
suite soumettons cette pente à un test statistique en vue d'envisager
une quelconque explication de cette croissance.
v Test de la tendance
1°. Hypothèses
- Nulle ou H0 : a =0
Test bilatéral
- Alternative ou Ha : a ? 0
2°. Seuil de signification á = 1%
3°. Comme n = 5 < 30, nous utilisons la loi student
pour approximer T
4° la règle de décision est telle :
Rejeter Ho si Tc> Tth
Calcul du t 
TC = 1,744355352 alors que T+h = 1,53,
nous rejetons H0 au seuil de 1% et concluons que la pente
« a » est significativement différente de
zéro. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une relation parfaite entre les
fidèles et la contribution de chapelles dans la réalisation du
budget de recettes.
Tableau N°23 de règle de décision
|
Sources de recettes
|
T calcul
|
1%
|
|
Offrandes ordinaires
|
1,788246003
|
>1,53
|
|
Engagement
|
1,78036347
|
>1,53
|
|
Offrandes des services
|
2,2041463
|
>1,53
|
|
Chapelles
|
1,744355352
|
>1,53
|
Source : nos calculs
La table nous donne 1,53 au seuil de 1%, t calculé est
nettement >au t tabulaire ou théorique. Nous rejetons
l'hypothèse nulle H0 et nous acceptons l'hypothèse
alternative selon laquelle Il n'existe pas une différence
statistiquement significative parfaite entre les différentes sources de
recettes et les effectifs de fidèles de la Paroisse CBCA
KATOYI.Figure N°24 tableau du calcul de corrélation des
fidèles et les recettes reçus total
|
Années
|
Xi
|
Yi
|
X= xi-x
|
Y=yi y
|
X*Y
|
X²
|
Y²
|
Y
|
ei=y-Y
|
ei²
|
  ² ²
|
|
2010
|
2319
|
55026,95
|
-84,8
|
345,84
|
-29327,23
|
7191,04
|
119605,31
|
56685,38
|
-1658,43
|
2750386,612
|
4017094,06
|
|
2011
|
2616
|
49019,3
|
212,2
|
-5661,81
|
-1201436,08
|
45028,84
|
32056092,48
|
49665,71
|
-646,41
|
417849,7355
|
25154207,31
|
|
2012
|
2299
|
59676,2
|
-104,8
|
4995,09
|
-523485,43
|
10983,04
|
24950924,11
|
57158,08
|
2518,12
|
6340909,504
|
6135398,90
|
|
2013
|
2302
|
55555
|
-101,8
|
873,89
|
-88962,00
|
10363,24
|
763683,73
|
57087,18
|
-1532,18
|
2347569,491
|
5789163,33
|
|
2014
|
2483
|
54128,1
|
79,2
|
-553,01
|
-43798,39
|
6272,64
|
305820,06
|
52809,20
|
1318,90
|
1739497,835
|
3504047,94
|
|
Total
|
12019
|
273405,55
|
0,00
|
0,00
|
-1887009,14
|
79838,8
|
58196125,68
|
273405,55
|
0,00
|
13596213,18
|
44599911,53
|
|
Moyenne
|
2403,8
|
54681,11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source : tableau établi par nous même
à partir des données recueillies.
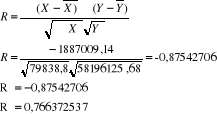


 ?- ?-



Le coefficient r étant négatif, les deux
variables fidèles et recettes varient dans le sens inverse. Plus les
fidèles augmentent plus les recettes ont tendances à diminuer. Le
fait que -0,87542706 est inférieur à 0,766372537, il y a une
faible corrélation entre les effectifs de membre de la CBCA KATOYI et
les recettes de ladite Paroisse. Le coefficient de détermination
r²= (-0,87542706)²= 0,766372537=76,6%.Les effectifs de membre
expliquent à 76,6% dans la variation totale des recettes. Les 23,4%
autres sont expliqués par d'autres facteurs tels que les dons, les
emprunts...

F tabulaire 
Figure N°25 le tableau d'ANOVA
|

source des variations
|
sommes des carres
|
Ddl
|
carrés moyens
|
Rapport" de snédecor
|
|
Facteurs
|
SCF=6832292852
|
1
|
6832292852
|
234,4806444
|
|
Résidus
|
SCE=58275964,48
|
2
|
29137982,24
|
|
Total
|
TSS=6890568817
|
|
|
Source : nos calculs
Etant donné que le F calculé est de 234,4806444
et supérieur au F théorique de 98,50 au seuil de 1% avec le
degré de liberté 1 et 2, nous acceptons l'hypothèse
H1 et nous rejetons H0 avec une certitude de 99%. Nous
affirmons que la moyenne des recettes de la CBCA KATOYI est statistiquement
différente de celle des fidèles.
CONCLUSION
Nous voici à la quintessence de notre sondage qui a
porté sur l'analyse de la structure financière d'une ASBL :
efficacité et efficience pour le cas de la CBCA KATOYI de 2010-2014.
L'objectif de ce travail a été de savoir en
tenant compte de l'importance des effectifs de membres au sein de la Paroisse
CBCA KATOYI, si les recettes réalisées sontinfluencées par
l'augmentation ces derniers, c'est-à-dire savoir si l'augmentation des
effectifs de membres peut entrainer l'augmentation des recettes d'une part, et
d'autre part savoir si cette dernière est performante dans la
mobilisation et répartition des recettes perçues mais aussi
vouloir savoir si elle dépend en totalité de l'extérieure
pour son fonctionnement.
Pour aborder ce thème, nous sommes parie d'une
problématique qui a étéformulée de la
manière suivante :
- Les financements reçus des bailleurs des fonds
permettent-ils à la CBCA KATOYI d'être performante et couvrir ses
dépenses ?
- Quelle est le degré d'indépendance globale de
la CBCA KATOYI ?
- Y-a-t-il une corrélation entre les effectifs des
membres fidèles et les recettes de la CBCA KATOYI ?
Ces interrogations nous ont conduits aux réponses
anticipatives suivantes :
- La CBCA KATOYI serait performante et serait capable de
couvrir ses dépenses ;
- Nous supposons que la CBCA KATOYI peut être
indépendante financièrement en terme de 6O% ;
- Nous osons croire qu'il y a une forte corrélation
entre les effectifs des membres et les recettes réalisées par la
CBCA KATOYI.
Pour vérifier ces hypothèses, la méthode
analytique et la méthode synthétique soutenues par les techniques
documentaire, l'approche statistique et interview qui nous ont permis
d'analyser les données et interpréter les résultats de
notre investigation. Plus précisément l'approche statistique qui
nous a permis de calculer les tendances et les corrélations entre les
données récoltées.
L'application de ces méthodes et techniques nous a
conduits aux résultats suivants :
- Après analyse des données pour les 5
années en étude, nous avons constaté que la CBCA KATOYI
n'est pas performante en combinant ses efficacités et ses efficiences,
mais aussi elle n'a pas été capable de couvrir en 100% toutes ses
dépenses. C'est qui a infirmé notre première
hypothèse selon laquelle la CBCA KATOYI serait performante et capable de
couvrir ses dépenses ;
- En terme globale, après avoir effectué le
rapport entre les recettes propres et les totales des recettes perçus,
nous avons constaté que la CBCA KATOYI est indépendante
financièrement en terme de 88,46%, les 11,54% sont expliqués par
les différents emprunts et dons reçus de tierces personnes
(bailleurs). De ceci, nous avons infirmé notre deuxième
hypothèse selon laquelle la CBCA KATOYI peut être
indépendante financièrement en terme de 6O%.
- En revanche, nous avons effectué une analyse de la
corrélationpar sources de recettes et une corrélation globale
entre l'effectifs des membres de la CBCA KATOYI et les recettes reçues,
nous avons remarqué qu'il y a une corrélation négative
entre ces ultimes de en globalité et partiellement de 0,248720723, 0,2313794, 0,
61846187 et 0,11855804 successivement pour les offrandes ordinaires,
engagement, offrandes de services et les contributions des chapelles. Nous
avons découvert que plus les effectifs augmententplus les recettes ont
une tendance à la diminution. Ainsi, le fait que-0,87542706 (r)a
été inférieur à 0,766372537 soit 76,6% (r²),
il y a une forte corrélation négativede 0,87542706 entre les
effectifs de membres de la CBCA KATOYI et les recettes de ladite Paroisse. Les
23,4% seraient dit à la non-conformité aux différents
thèmes de prédications qui susciteraient aux effectifs membres de
donner les offrandes, honorerses engagements ; le non accomplissement de
tâches ou orientation des fonds qui auraient été
prévu pour l'accomplissement de certains travaux. C'est de ce fait que
nous avons infirmé notre troisième hypothèse qui stipule
qu'il y a une forte corrélation positive entre les effectifs des membres
et les recettes réalisées par la CBCA KATOYI. en globalité et partiellement de 0,248720723, 0,2313794, 0,
61846187 et 0,11855804 successivement pour les offrandes ordinaires,
engagement, offrandes de services et les contributions des chapelles. Nous
avons découvert que plus les effectifs augmententplus les recettes ont
une tendance à la diminution. Ainsi, le fait que-0,87542706 (r)a
été inférieur à 0,766372537 soit 76,6% (r²),
il y a une forte corrélation négativede 0,87542706 entre les
effectifs de membres de la CBCA KATOYI et les recettes de ladite Paroisse. Les
23,4% seraient dit à la non-conformité aux différents
thèmes de prédications qui susciteraient aux effectifs membres de
donner les offrandes, honorerses engagements ; le non accomplissement de
tâches ou orientation des fonds qui auraient été
prévu pour l'accomplissement de certains travaux. C'est de ce fait que
nous avons infirmé notre troisième hypothèse qui stipule
qu'il y a une forte corrélation positive entre les effectifs des membres
et les recettes réalisées par la CBCA KATOYI.
Partant d'une observation physique ou externe de la
multiplicité des effectifs de membres de la Paroisse CBCA KATOYI, l'on
conclurait que cette dernière entrainerait une augmentation des
recettes. Mais après analyse et enquête, nous avons pu constater
qu'il n'y a pas nécessairement une grande influence entre l'augmentation
des effectifs et les recettes.
- Pour éviter de
dépassementexagérés, nous souhaiterions que la CBCA KATOYI
se réfère souvent aux réalisations des exercices
passés en calculant la moyenne de ses réalisations pour qu'elle
maîtrise son budget et faire une fusion de certaines rubriques qui
leur permettra la minimisation des coûts ;
- Il serait honorifique que la CBCA KATOYI fasse une moyenne
de ses participants hebdomadairement, mensuellement soit annuellement pour
qu'elle sache la vraie statistique de ses fidèles et pour qu'elle soit
au service de son budget.
- Trouver des thèmes de prédication
appropriés au temps convenable pour inciter les membres à
participer à la réalisation du budget ;
- Montrer aux fidèles les bien-fondés
liés à leurs libérations ;
- Orienter les contributions des fidèles dans les
secteurs qui leurs avaient été prévues de financer.
Pour des raisons de commodité, nous avons
subdivisé le présent travail en trois chapitres :
- Le premier intitulé « Elucidation des
concepts »
- Le deuxième porte sur la présentation de notre
cible ; et
- Le dernier chapitre, point focal du présent travail
vient d'aborder l'analyse de résultat et l'interprétation des
résultats.
Pour clore ce travail, nous invitons les futurs chercheurs
d'aborder ce thème et nous compléter en vue de dénicher
nos lacunes et éclairer le monde scientifique à la manière
de gérer les ASBL dans leur mode de financement.
En fin, comme tout travail humain ne manque jamais
d'imperfections, le nôtre ne fait pas exception, nous restons très
attentive à l'égard de toute personne désireuse de
contribuer à l'amélioration de ce travail en y apportant une
remarque, une critique ou suggestion.
BIBLIOGRAPHIE
A.OUVRAGES
1. Alain RIVET, Gestion financière,
1ere Ellipses Edition marketing, Paris, 1986,
2. ALAZAR & Sépari, Contrôle de
Gestion, 2e éd, Dunod, Paris, 2010, p.16.
3. Aswath DAMODARAN, Finance d'entreprise,
2e éd. Boeck université, Paris, 2005.
4. BEAUD et al. Initiation aux méthodes de recherche
en sciences sociales, éd. Pivot, Toulouse, 2002.
5. Bernard Dionne : Guide méthodologique pour
les études et la recherche, 3e
éd.Montéal, Paris, 1998.
6. BERZILE, R., Analyse financière,
12eme éd. Dunod, Montréal, 1989, p.15
7. Francis Bornet & Olivier Degryse, le Management
associatif, de Boeck université, Bruxelles-Belgique, 1997.
8. GEORGES DE PALLENS, Gestion de l'entreprise,
5e éd Dunod., Paris, 1974.
9. Larousse de poche 2012,4800 définitions, 8000 noms
propres, Paris.
10. Larousse, dictionnaire de Français,
Paris/France, 2008.
11. LE ROBERT METHODOLOGIQUE, ouvrages édités
par les Dictionnaires LE ROBERT 107, Avenue Parmentier-75011 Paris(XIe),
1985.
12. Madeleine GRAWITZ, Lexique des sciences sociales,
8e éd., Paris, 1967 p.28
13. Martin du G., Souvenir. Autobiographe,
1955, Paris.
14. Michel Jura, Technique Financière
Internationale, 2e éd. Dunod, Paris, 2003.
15. Pascal Barneto, Georges GREGORIO, Finance, 10
éd.Dunod, Paris, 2007.
16. SAUVAGEOT G., La finance, Nathan, 1ere
éd. Cécile, France, 2005, p.20
17. SILEM Ahmen et MARTINET Alain Charles, Lexique de
gestion, Dalloz, 6eme éd., Paris, 2003.
18. Sol NIK B., Gestion financière, 5 éd
Dunod, Paris, 200.
19. TERRY LEURS, Gestion financière
stratégique gérée pour les ONG, gérée pour
la pérennité financière, 4 éd Donod, Paris,
1998.
20. VALEY A., Amortissement d'autofinancement et
d'évaluation, 2e édiction comptable, commerciale
et financière, Bruxelles, 1946.
21. VINCET F. Renforcer l'autonomie financière des
associations et ONG de développement du tiers monde, innovation et
raison pour le développement, 2eHRW, Genève, 1986
22. VIRNIMMENT P., Finance de l'entreprise,
2e éd. Dalloz, Paris, 1996.
B.TFC, MEMOIRE et COURS
1. CT BENGEYA& SEDRIC TAMBWE, contrôle de gestion,
cours inédit, isc-Goma, 2014-2015.
2. Jackson KASEREKA MBAVUMOJA, Analyse financière d'une
société de personne en responsabilité
limitée, mémoire inédit, ISC-GOMA, 2005-2006.
3. KAMBALE Benoit, Gestion financière, cours
inédit, G3 ISC-GOMA, 2013-2014
4. Michel MASUMBUKO MULUME, Analyse financière d'une
association sans but lucratif, mémoire inédit, ISC GOMA,
2006-2007.
C.REVUES et JOURNAUX
1. Basimwa Ntakabajira et Patient Lwanga, les Associations
sans But Lucratif du Sud-Kivu. Difficultés rencontrées et
solution légale, BUKAVU, éditions du CERPRU, 2003.
2. G TURNS BULL, Baker's dictionary of practical
theology, 2éd.B.BH.M.I. Belgique, 1967.
3. Journal officiel de la RDC, cabinet du Président de
la République, loi N° 004/2001 du 20 Juillet 2001 portant
dispositions générales applicables aux ASBL et aux Etablissements
d'utilité publique, Art I, 2001, Kinshasa
4. Loi N° 004/2001 du 20 Juillet 2001, portant
dispositions générales applicables aux Associations sans But
Lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, Art 35, Kinshasa,
2001.
5. Maître BISIMWA Ntakabijira & Mr BUGENE Zigashane,
Guide des acteurs de la société civile congolaise sur les
obligations associative et légales des Associations sans But Lucratif,
éd., Life&Peace INSTITUTE, RDC, 2010.
6. R.Minani et al, Regard sur la société civile
en RDC : défit durant la transaction, in revue Congo. Africaine,
N°380, Décembre 2003.
7. Règlement d'Ordre Intérieur de la CBCA,
inédit, Goma.
D.WEBOLOGIE
1. WWW. Bénéfices non distribués,
le 12/03/2015, 18h29
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
Erreur ! Signet non
défini.
REMERCIMENT
ii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
INTRODUCTION
1
1. ETAT DE LA QUESTION
1
2. PROBLEMATIQUE
3
3. HYPOTHESES
4
4. OBJECTIFS DU TRAVAIL
5
5. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
5
6. CHOIX ET INTERET DU SUJET
5
7. DELIMITATION DU SUJET
6
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
7
9. DIFFICULTES RENCONTREES
7
CHAPITRE I : LITTERATURE SUR LES CONCEPTS DE
BASE
8
I.1. DEFINITION D'ANALYSE ET ANALYSE FINANCIERE
8
I.2. HISTOIRE DE L'ANALYSE FINANCIERE
8
I.3. IMPORTANCE ET ETAPES DE L'ANALYSE
FINANCIERE
9
I.4. PLANIFICATION FINANCIERE
10
I.5. DIAGNOSTIC FINANCIER
11
I.6. LE RISQUE FINANCIER
11
I.7. L'INTERMEDIARE FINANCIER
11
I.8. LES MARCHES FINANCIERS
12
I.9. NOTION SUR LE FINANCEMENT
14
I.9.1 Définition du financement
14
I.9.2 Sortes de financement
15
I.10. PROCESSUS DU FINANCEMENT DES ASBLS
17
I.11. NOTION SUR LES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF
(ASBL)
19
I.11.1 Définition de l'ASBL
19
I.11.2 Typologies des ASBL
20
I.11.3 Les motivations
21
I.11.4. Indice de la mauvaise gestion dans les
associations
22
CHAPITRE II : PRESENTATION DU MILIEU
D'ETUDE
24
II.1. ASPECTS DOCTRINAUX ET CULTURELS DE LA
CBCA
24
II.2. RELATIONS INTER-RELIGIUESES
25
II.3. OBJECTIFS POURSUIVIS
25
II.4. PRESENTATION DE LA CBCA KATOYI
25
II.4.1. Situation géographique
25
II.4.2. Historique
25
CHAPITRE III : PRESENTATION, ANALYSE DES
DONNEES ET INTERPRETATION DES RESULTATS
40
III.1 PRESENTATION DES DONNEES
40
III.1.1 Effectifs de la CBCA KATOYI de
2010-2014
40
III.1.2 Tableau du budget de recettes
40
III.1.3. Tableau de l'exécution du budget de
recettes
41
III.1.4. Tableau du budget dépense
42
III.1.5. Tableau de la réalisation du budget
de dépenses
43
III.2 ANALYSE DES DONNEES ET INTERPRETATION DES
RESULTATS
43
III.2.1 Calcul de l'efficacité de la
Paroisse CBCA KATOYI
43
III.2.2 Calcul de l'efficience de la Paroisse CBCA
KATOYI
44
III.2.3 Calcul de l'indépendance
Financière
45
III.2.1 Calcul de de la corrélation par
source de recettes de la Paroisse CBCA KATOYI
48
CONCLUSION
59
BIBLIOGRAPHIE
62
A.OUVRAGES
62
B.TFC, MEMOIRE et COURS
62
C. REVUES et JOURNAUX
62
D.WEBOLOGIE
63
TABLE DES MATIERES
64

* 1 Michel MASUMBUKO MULUME,
Analyse financière d'une association sans but lucratif,mémoire
inédit, ISC GOMA, 2006-2007, pp 55-56,
* 2 Jackson KASEREKA MBAVUMOJA,
Analyse financière d'une société de personne en
responsabilité limitée, mémoire inédit, ISC-GOMA,
2005-2006, pp 60-61,
* 3 Bernard Dionne :
Guide méthodologique pour les études et la recherche,
3e éd.Montéal, Paris, 1998, p.190-196
* 4 B. Sol NIK, Gestion
financière, 5 éd Dunod, Paris, 2001, p.10
* 5 Larousse de poche
2012,4800 définitions, 8000 noms propres, Paris, p 402
* 6Martin du G.,
Souvenir. Autobiographe, 1955, Paris, p. 16
* 7 BEAUD et al. Initiation
aux méthodes de recherche en sciences sociales, éd. Pivot,
Toulouse, 2002, p.55
* 8 LE ROBERT METHODOLOGIQUE,
ouvrages édités par les Dictionnaires LE ROBERT 107, Avenue
Parmentier-75011 Paris(XIe), 1985, p.245.
* 9 G. SAUVAGEOT, La
finance, Nathan, 1ere éd. Cécile, France, 2005,
p.20
* 10 BERZILE, R., Analyse
financière, 12eme éd. Dunod, Montréal,
1989, p.15
* 11VIRNIMMENT P., Finance
de l'entreprise, 2e éd. Dalloz, Paris, 1996, p.174
* 12 GEORGES DE PALLENS,
Gestion de l'entreprise, 5e éd Dunod., Paris, 1974,
p.192
* 13 Alain RIVET, Gestion
financière, 1ere Ellipses Edition marketing, Paris, 1986,
p.239
* 14 G. SAUVAGEOT, op.cit.,
p.24
* 15 Idem
* 16 Michel Jura, Technique
Financière Internationale, 2e éd. Dunod, Paris,
2003, p.34
* 17 Michel Jura, op. Cit,
p.35
* 18 A. VALEY,
Amortissement d'autofinancement et d'évaluation, 2e
édiction comptable, commerciale et financière, Bruxelles,
1946, p.68
* 19 SILEM Ahmen et MARTINET
Alain Charles, Lexique de gestion, Dalloz, 6eme éd.,
Paris, 2003, p.349
* 20 VINCET F. Renforcer
l'autonomie financière des associations et ONG de développement
du tiers monde, innovation et raison pour le développement,2e
HRW, Genève, 1986, p.30
* 21 TERRY LEURS, Gestion
financière stratégique gérée pour les ONG,
gérée pour la pérennité financière, 4
éd Donod, Paris, 1998, p.7
* 22 Aswath DAMODARAN,
Finance d'entreprise, 2e éd. Boeck université,
Paris, 2005, p.114
* 23WWW.
Bénéfices non distribués, le 12/03/2015, 18h29
* 24 Pascal Barneto, Georges
GREGORIO, Finance, 10 éd.Dunod, Paris, 2007, p.360
* 25 KAMBALE Benoit, Gestion
financière, cours inédit, G3 ISC-GOMA, 2013-2014
* 26 R.Minani et al, Regard sur
la société civile en RDC : défit durant la
transaction, in revue Congo. Africaine, N°380, Décembre 2003,
p.85
* 27 Maître BISIMWA
Ntakabijira & Mr BUGENE Zigashane, Guide des acteurs de la
société civile congolaise sur les obligations associative et
légales des Associations sans But Lucratif, éd., Life&Peace
INSTITUTE, RDC, 2010 p.10
* 28 Journal officiel de la
RDC, cabinet du Président de la République, loi N° 004/2001
du 20 Juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux
ASBL et aux Etablissements d'utilité publique, Art I, 2001, Kinshasa
* 29 Larousse,
dictionnaire de Français, Paris/France, 2008, p.210
* 30Madeleine
GRAWITZ,Lexique des sciences sociales, 8e éd., Paris,
1967 p.28
* 31 Loi N° 004/2001 du
20 Juillet 2001, portant dispositions générales applicables aux
Associations sans But Lucratif et aux Etablissements d'utilité publique,
Art 35, Kinshasa, 2001, p.10
* 32 Basimwa Ntakabajira et
Patient Lwanga, les Associations sans But Lucratif du Sud-Kivu.
Difficultés rencontrées et solution légale, BUKAVU,
édutions du CERPRU, 2003, p.5
* 33 Rigoberta Minai et al,
op cit ; p.615
* 34 Francis Bornet &
Olivier Degryse, le Management associatif, de Boeck université,
Bruxelles-Belgique, 1997, p.6.
* 35Basimwa Ntakabajira et
Patient Lwanga, op cit, p.104
* 36 R. G TURNS BULL,
Baker's dictionary of practical theology, 2e
éd.B.BH.M.I., Belgique,1967, pp97-247
* 37 Règlement d'Ordre
Intérieur de la CBCA, inédit, Goma, p.32
* 38 CT BENGEYA& SEDRIGUE
TAMBWE, Contrôle de Gestion, cours inédit, isc-Goma, 2014-2015,
p.6
* 39 ALAZAR &
Sépari, Contrôle de Gestion, 2e éd,
Dunod, Paris, 2010, p.16.
|
|



