|
Dédicacé à mes
très chers parents
REMERCIEMENTS
Je remercie l'Eternel Dieu pour le soutient, le courage et
la santé qu'il m'a accordé durant toutes ces trois années
de formation.
Je tiens également à remercier tous ceux qui
de près ou de loin m'ont aidé à gravir les marches de mon
avenir pendant toutes ces années antérieurs :
Mr et Mme Terrenstra
Mme Vinatier Honorine
Mme Ndjock Marie Noelle
Nouck Maurice, mon encadreur.
Dr Foyet Ignace pour la création de ce cadre de
formation.
Mes frères et soeurs pour m'avoir toujours
donné la force de repousser sans cesse mes limites.
Et enfin, tous mes amis et camarades de cette
5ème promotion qui m'ont permis : de cerner les contours
de la complexité de la vie en société :
-Dikonguè Fanny Rose
-Ebogo luc
-Biboum michel
-Yomi bergeline
-Yemele yannick
-Nguetchueng albert
LISTE DES ENSEIGNANTS 3ème ANNEE
DSEP SOINS INFIRMIERS
|
N°
|
Noms et prénoms
|
Matières
|
Grade
|
|
1
|
Dr Diffo Collins
|
Endocrinologie
|
Doctorat en médecine
|
|
2
|
Dr Foyet Ignace
|
Economie de la santé
|
Doctorat en droit des affaires
|
|
3
|
Dr Kéné martin
|
Biostatistiques
|
Doctorat en entomologie
|
|
4
|
Dr Ntago
|
Pathologie chirurgicale/pathologie urinaire
|
Doctorat en medicine
|
|
5
|
Mr. Chang Saah joseph
|
Anglais general
|
Doctorant en Lettre anglaise
|
|
6
|
Mr. Dongho Léopold
|
Pathologie obstétriccale/Pharmacologie
obstétricale
|
Infirmier spécialisé en santé de
reproduction
|
|
7
|
Mr. Essoh Ngollo Ebenezer
|
Droit
|
Master de recherche en droit privé fondamental
|
|
8
|
Mr. Fifen Soulemanou
|
ORL
|
Master en ORL
|
|
9
|
Mlle Kameni Eve
|
Gériatrie
|
Licence en Science infirmier
|
|
10
|
Mr. Lembegue Bruno
|
Français
|
DEA en Lettre philosophie
|
|
11
|
Mlle. Nchuinjang Carile
|
Ophtamologie
|
Infirmière spécialisée en Ophtamologie
|
|
12
|
Mr. Nouck Maurice
|
Demarche des soins/Epidemiologie/Eps/Surveillance
infirmière/Vaccination
|
Bachelor degree in nursing
|
|
13
|
Mr. Ngeugoue Rodrigue
|
Informatique
|
Licence en réseaux et télécom
|
|
14
|
Mr. Nouteka philibert
|
Santé mentale
|
Infirmier spécialisé en santé mentale
|
|
15
|
Mr. Ottou Blaise
|
Médecine du travail/Médecine scolaire
|
Licence en Science en science infirmière
|
|
16
|
Mr. See justin
|
Imagerie médicale
|
Technicien radiologiste
|
|
17
|
Mr. Tabeu sébastien
|
Petite chirurgie/Technique de soins au bloc Opératoire
|
Technicien supérieur en soins infirmier
|
|
18
|
Mr.Takemegni Wandji jonas
|
Hémopathie
|
Infirmier médico-sanitaire
|
|
19
|
Dr. Kamga Eric
|
Stomatologie
|
Doctorat en médecine
|
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES
I- FIGURES
|
N°
|
Titres
|
Pages
|
|
1
|
Histogramme : Repartition selon l'age
|
11
|
|
2
|
Camembert : Repartition selon le sexe
|
12
|
|
3
|
Diagramme en bande : Repartition selon la profession
|
12
|
|
4
|
Camembert : Repartition selon la situation matrimoniale
|
13
|
|
1
|
Tableau 1 : préparation morale du patient
|
14
|
|
2
|
Tableau 2 : Respect des règles d'hygiène
|
14
|
|
3
|
Tableau 3 : Oublie du matériel
|
14
|
|
4
|
Tableau 4 : Caractère Ordonné ou non de
l'infirmier
|
15
|
|
5
|
Tableau 5 : Survenue d'un problème
|
15
|
|
6
|
Tableau 6 : Réduction de la douleur
|
16
|
|
7
|
Tableau 7 : Conversation avec les patients
|
16
|
|
8
|
Tableau 8 : Récapitulatif de la dimension tech.
|
17
|
|
9
|
Tableau 9 : Réconfort des patients
|
18
|
|
10
|
Tableau 10 : Respect et dignité des patients
|
18
|
|
11
|
Tableau 11 : Priorisation des plaintes
|
19
|
|
12
|
Tableau12 : Comportement des infirmiers et confiance
|
19
|
|
13
|
Tableau13 : Réalisation des soins
d'hygiènes
|
19
|
|
14
|
Tableau14 : Qualité du comportement envers les
patients
|
20
|
|
15
|
Tableau15 : Récapitulatif de la dimension
relationnelle
|
20
|
|
16
|
Tableau16 : Information sur l'origine de la maladie
|
21
|
|
17
|
Tableau17 : Participation à la guerison
|
21
|
|
18
|
Tableau18 : Information sur les facteurs favorisants
|
22
|
|
19
|
Tableau19 : Respect des membres de la famille
|
23
|
|
20
|
Tableau20 : Information sur la transmission de la maladie
|
23
|
|
21
|
Tableau21 : Récapitulatif de la dimension
éducationnelle.
|
24
|
LISTE DES ABREVIATIONS
D.S.E.P : Diplôme Supérieur d'Etude
Professionnelle
Dr : Docteur
E.F.P.S.A : Ecole Privée de Formation du Personnel
Sanitaire
I.S.A.M Institut Supérieur des Affaires et de
Management
Mr : Monsieur
Mlle : Mademoiselle
Mme : Madame
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
P : Page
Réf : Références
S.I : Soins Infirmiers
HDD : Hôpital de District de Deido
HDL : Hôpital de District de Longbaba
BAC : Baccalauréat
ONG : Organisation Non Gouvernementale
UNFPA: United Nations Fund for Population Activities
ESSEC : Ecole Supérieur des Sciences Economiques du
Cameroun
URSS : Union des Républiques Socialiste et
Sovietique
RESUME
En somme, nous avons observé à travers la
présente étude que le problème de la fréquentation
des hôpitaux en Afrique est une réalité, et serait
influencée par plusieurs facteurs parmi lesquels : la
qualité de l'accueil, le cout élevé des prestations
médicales, l'accès difficile aux formations sanitaires, et plus
précisément la qualité des soins sur la dimension
technique, relationnelle et éducationnelle qui ont constitués
l'objet de notre étude. Comme outil de travail, nous avons fait usage
d'un questionnaire centré sur les dimensions technique, relationnelle et
éducationnelle. Ce qui nous a permis de faire une collecte des
données au près des patients présent à l'HDD
pendant la durée de notre étude.
De la présente étude, il en ressort
que :
- La dimension technique des soins est un facteur de non
fréquentation à l'HDD. La validation de cette hypothèse
s'est affirmée par le calcul du Chi2 (49,15) qui s'est
avéré supérieur au chi2 seuil (11,1)
- La dimension relationnelle des soins est un facteur de non
fréquentation de l'HDD. La détermination du chi2 donne
une valeur de 5,82 supérieur au chi2 seuil (9,49)
- La dimension éducationnelle des soins, n'a pas une assez
grande influence sur la fréquentation hospitalière. Le chi2
(5,82) est inférieur au chi2 seuil (9,49).
Ce qui nous amène à formuler comme
recommandation :
- A l'endroit du Ministère de la santé
publique : des séminaires de formation sur le développement
des capacités personnelles impulsées par la dynamique des
sciences humaines (psychologie, sociologie...)
- A l'endroit des gestionnaires des systèmes de
santé : l'instauration des activités socio
thérapeutique, individuelle ou de groupe (lecture, activités
éducatives, sportives et relaxation).
- A l'endroit du personnel infirmier, l'application du respect de
la valeur humaine des patients, l'actualisation des connaissances liées
au service nursing.
ABSTRACT
In short, we have observed throughout this study that the
problem of attendance at hospitals in Africa is a reality, and would be
influenced by several factors including: the quality of the home, the cost high
medical benefits, difficult access to health facility, and more specifically
the quality of care on technical, relational and educational dimensions. Which
allowed us to make a collection of data to the near this patient to the DDH
during our study period. This study, a result that: - the technical dimension
of care is non-attendance to the DDH. The validation of this hypothesis is
asserted by the calculation of the chi2 (49,15) which proved greater
than the threshold chi2 (11,1).
- The relation dimension of care is factor of non-attendance to
the DDH. The determination of the chi2 gives a value of 5,82
superior chi2 thresholds (9,49).
- The education dimension of care, does not have a great
influence on hospital visitation. The chi2 (5,82) is less than the
threshold chi2 (9,49). Which brings us to formulate as
recommendation: A place of the Ministry of public health: the training seminars
on the development of personal skills with the dynamics of human sciences
(psychology, sociology...) the place of the managers of health systems: the
establishment of socio-therapeutic activities or group (reading, educational
and sports activities, relaxation) the place of nursing staff, the application
of the respect for the human value of the patients, the updating of knowledge
related to the nursing service individual.
INTRODUCTION
La recherche du bien-être des populations est une
préoccupation essentielle de tous les Etats du monde. Toutefois, il
transparait que l'atteinte de cet objectif nécessite : d'une part,
la contribution des gouvernements à la construction et
l'équipement des hôpitaux, à la formation du personnel, au
financement des grands projets de développement. D'autre part,
l'utilisation des infrastructures par les populations
bénéficiaires : soit pour se mettre à l'abri des
maladies (prévention), soit pour éviter les complications que
celles-ci pourraient induire (traitement curatif) ; et enfin, celle du
personnel dont l'accueil et la prise en charge devraient susciter une plus
grande fréquentation des formations hospitalières.
Les organismes internationaux et internationaux dont l'OMS
en chef, fixe à 80% le taux de fréquentation optimal de
fréquentation d'une formation hospitalière ; taux
au-delà duquel l'on dira d'une formation qu'elle est
saturée ; et à 50% le taux minimal, on dira alors que la
formation hospitalière est sous utilisée. Au Maroc, le taux de
fréquentation est de 17,4% en 2006 (rapport du ministère de la
santé du Maroc). En Cote d'Ivoire, ce taux est de 21% en l'an 2000 pour
les consultations en soins de santé primaire. Au Mali, ce taux est de
3,9% en 2004 selon le Ministère de la santé du Mali. A
l'hôpital de District de Bonassama, on a un taux de 12,7%( rapport ESSEC
2006).
La contribution infirmière dans la
fréquentation des formations hospitalières est l'objet de notre
étude, d'où la question suivante : quel est l'impact du
service nursing sur la fréquentation des centres hospitaliers ?
Cette interrogation soulève un questionnement sur les indicateurs
d'évaluation du nursing, et dont la détermination permet sans
doute de montrer comment l'activité infirmière influence la
fréquentation des formations hospitalières. Plusieurs
éléments semblent influencer la fréquentation des
formations hospitalières par les populations riveraines. Il pourrait
s'agir : du plateau technique, de la qualité de prise en charge, de
l'accueil des patients, de la relation soignant-soigné, de la pratique
technique infirmière, et enfin de l'éducation du patient.
CHAPITRE I :
REVUE DE LA LITTERATURE
CHAPITRE I : REVUE DE LA
LITTERATURE
Il est important pour une meilleure compréhension,
de définir certains termes clé de notre travail tel qu'il
suit.
I. CLARIFICATION DES CONCEPTS
Fréquentation : selon le
LAROUSSE(2), la fréquentation se
définie comme l'action de fréquenter un lieu, en particulier, du
point de vue de la fréquence et du nombre de personnes. Selon MARTINE
Audibiert(3), c'est la proportion de la population desservie qui a
effectivement utilisée une ou plusieurs fois les services d'une
formation sanitaire pendant une période donnée.
Prise en charge infirmière : d'après le
LAROUSSE, la prise en charge, c'est avoir l'obligation, le
devoir de s'occuper matériellement et moralement de quelqu'un. Prise en
charge pourrait donc se traduire comme un ensemble de soins holistique. Selon
``36 dictionnaire et recueil'' soigner a pour synonyme
« s'occuper de soit ». C'est dans ce sens que
CAROLE SIEBERT et KATY LE NEURES(4) (p.68) déclarent :
« soigner est un acte de vie ».
Profession infirmière : Le LAROUSSE
définit la profession infirmière comme une activité
rémunérée et régulière exercée pour
gagner sa vie. Dans le sens infirmier, LE CODE DE DEONTOLOGIE INFIRMIERE
(SAO POLO , brésil, 1953), déclare que :
« c'est un domaine d'activité spécifique qui place
l'infirmier au service de la santé de l'individu, de la famille, de la
société »,servir l'humanité est donc la
fonction essentielle de la profession infirmière.
Les soins infirmiers : Le LAROUSSE, définit
soins comme : « actes par lequel on veille au bien
être de quelqu'un ». Dans le sens infirmier, c'est
« l'ensemble d'activités assurées par le personnel
infirmier et les auxiliaires de santé ». Selon CAROL
SIEBERT, c'est « un ensemble de connaissances de
compétences et de techniques relatives à la conception et
à la mise en oeuvre d'actes de soins infirmiers. Ils contribuent
à répondre aux besoins de santé d'une personne et/ou d'une
collectivité... »
Holistique : Selon ENCARTA(5), c'est une
« médecine qui appréhende l'individu comme un tout
et traite le corps comme une entité unique et non pas par organes
distinct, en privilégiant les interactions qui unissent le physique et
le spirituel ».
Accueil du patient : « action et
manière d'accueillir, de recevoir quelqu'un » est la
définition que le LAROUSSE donne de l'accueil. Littéralement,
peut se définir comme étant le processus de prise en charge,
physique, psychologique, et administrative du patient ; visant à
lui accorder plus d'intérêt à son arrivée afin de
créer chez ce dernier un sentiment de satisfaction et de confiance,
accompagné d'un sourire réconfortant.
Qualité des soins : « ensemble
de caractères, des priorités qui font que quelque chose
correspondent bien ou mal à sa nature, à ce qu'on
attend ». Définition du LAROUSSE. D'après
BONABEDIAN, M.D (1995), fournir les soins de qualité consiste
à « appliquer la science médicale de manière
à maximiser les résultats qu'on en tire sans pour cela augmenter
les risques
II. ETUDE DE LA FREQUENTATION
La fréquentation des formations
hospitalières, selon qu'on se trouve en Europe, en Amérique, en
Asie ou en Afrique, est influencée par des facteurs qui varient selon
qu'on se trouve dans tel ou tel autre continent, selon qu'on se trouve en
campagne ou en milieu urbain. Les statistiques révèlent
que : - au Maroc 17,4%(rapport du Ministère de la santé
marocain 2006). En République Centrafricaine 12% (rapport
Ministère de la santé publique centrafricaine 2007). En
Tanzanie 35%(UNFPA) (1) en 2006. En Cote d'Ivoire 21% (rapport
Ministère de la santé, 2000). Au Mali 3,9%(rapport
Ministère de la santé malien 2004). Au Cameroun 48,6% en
1996 selon le Ministère de la santé camerounais, à
l'hôpital de District de Bonassama12, 7%(rapport de l'ESSEC
2006) ; à l'HDD 39%(étude mensuelle
rétrospective du mois de novembre 2011). Ce qui nous amène
à étayer davantage l'aspect de la fréquentation
hospitalière en définissant au préalable quelques termes
clés liés à notre étude.
II-1- FACTEURS INFLUENCANT LA FREQUENTATION DES
FORMATIONS HOSPITALIERES
La fréquentation hospitalière reste
assujettie par plusieurs facteurs qui selon qu'on se trouve dans un pays
développé ou sous développé, constituent soit un
facteur favorisant, soit un facteur défavorisant la fréquentation
hospitalière.
Selon le rapport du colloque scientifique qui a eu lieu
à ANTANANARIVO (Madagascar) (6), il en ressort que la
fréquentation des formations hospitalière est liée :
- à la distance à parcourir pour atteindre le centre de
santé, - à la qualité de l'accueil et des soins qu'on y
trouve. Bien que d'autres facteurs comme l'efficacité du système
de sécurité social (en France) tel que nous le montre
HOUNKPATI YARAM jean David (7), les thérapeutiques
traditionnelles et religieuse en Afrique prouvé par Ange-Erick
Kouamé-Assouan (Cote-d'Ivoire) (8) partagé par
RATSIFANDRI HAMANANA B. et TERRANOVA R. (9). Notre étude
accorde une attention particulière aux facteurs liés à la
qualité des soins que sur les dimensions techniques, relationnelle et
éducationnelle. C'est dans ce sens que, HounkpatiYaram J. D. dans sa
thèse de Doctorat dit de la qualité des soins que :
« c'est l'un des éléments qui poussent les patients
vers telle ou telle formation sanitaire est la quantité des
prestations ». L'auteur continu avec un exemple pris au Togo
où, nous citons : « les gens qualifient couramment le
CHU-Tokoin de ` mouroir' pour traduire l'inefficacité des soins qui
y sont délivrés », d'où la
nécessité du caractère holistique des soins comme nous le
montre FREDERIQUE AVET(10)
II-2- MODE D'EVALUATION DE LA FREQUENTATION
HOSPITALIERE
Selon l'OMS, l'évaluation de la
fréquentation hospitalière s'évalue par le rapport des
consultés sur la population total, multiplié par 1000.
III-3- LIMITE DE L'EVALUATION DE LA
FREQUENTATION
Selon MARTINE AUDIBIERT (11), le taux de
fréquentation quant à son évaluation connait un
problème : le double (voir plus) d'un même patient
qui peut venir à l'hôpital plusieurs fois pour une même
maladie ou différente. La conséquence direct est celui du nombre
de consulté est toujours supérieur au nombre de personne physique
qui ont utilisé les services de santé durant une certaine
période. Fort de ce qui précède, le même auteur
montre que le nombre de consultation par consultant, livre une information plus
précise que le taux de fréquentation. Pour lui, le taux de
fréquentation et de consultation traduisent l'influence quantitative de
l'offre des services de santé sur les populations.
CHAPITRE II : METHODOLOGIE
METHODOLOGIE
I. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU LIEU D'ETUDE
I-1 Critère du choix du lieu d'étude
La volonté d'orienter notre étude sur l'HDD
tient sur plusieurs mobiles. Parmi lesquels : la grande sollicitation de
cet hôpital par les patients du District de santé, le comportement
peut appréciable du corps infirmier envers les patients.
I-2- Description du lieu
d'étude
La présente étude s'est
déroulée à l'hôpital de District de Deido.
Situé au carrefour école publique de Deido, en face du
commissariat du 9ème arrondissement. Cette formation
hospitalière abrite comme services : le bloc administratif,
l'accueil, la petite chirurgie, le bloc opératoire, une morgue, une
maternité, un bloc opératoire, un service de médecine, de
chirurgie, le bloc opératoire, une morgue, une maternité, un
laboratoire, un service de médecine, de chirurgie et de
pédiatrie. Tout à coté, nous avons un réfectoire
destiné à ressourcer les forces tant du personnel que des
patients.
I-3- But de l'étude
Son est de stimuler la fréquentation accrue de
l'HDD par les populations ; et comme objectif, il sera question d'amener
le personnel infirmier à améliorer la qualité de l'accueil
et de la prise en charge infirmière sur la triple dimension
bio-psycho-sociale, afin de créer chez le patient un sentiment de
complet bien être.
II. MATERIEL ET METHODE
II-1- Durée de l'étude
Afin de mener à bien le processus de notre
étude, nous l'avons voulu réalisable dans un espace temps de
temps de 5mois (de novembre 2011 à mars 2012).
II-2- Type d'étude
Notre étude est de type quasi-expérimental
ou différentiel, dans la mesure où elle étudie les
différents comportements des individus et a pour outils de
travail : l'observation directe, l'entretien où le questionnaire en
fonction de la pertinence par rapport aux données à collecter et
en fonction du lieu et de l'Etat de l'enquête.
II-3- Critère d'inclusion
La population cible sur laquelle notre étude porte
était composée uniquement des patients âgés de 15ans
et plus rencontré à l'hôpital de District de Deido durant
notre étude.
II-4- Echantillonnage
Nous avons fait recourt à la méthode non
probabiliste accidentelle qui a fait intervenir principalement le
critère âge. La taille de notre échantillon est de 35
patients.
II-5- Respect de l'éthique de la
recherche
Pour le plus grand intérêt du respect de
l'éthique de la recherche, nous avons sollicité et obtenu par le
biais de notre administration académique :
- Une autorisation d'enquête visée par le
délégué régional de la santé publique du
littoral ;
- Une autorisation de pré-test paraphée par les
responsables de l'HDL ;
- Une autorisation d'enquête signée par le
surveillant général de l'HDD ;
- Une note adressée aux patients, justifiant non seulement
l'intérêt de l'étude, mais garantissant
simultanément l'anonymat des réponses par eux mises à
notre disposition.
II-6- Méthode d'analyse des
données
Le dépouillement des données a
été manuscrit et réalisé à l'aide du papier
format A4, d'un stylo et d'une calculatrice scientifique.
a)- Instrument de collecte des
données
Le principal instrument par nous utilisé pour la
collecte des données était un questionnaire
séquencé en quatre rubriques portant tour à tour sur
l'identification du patient, la dimension technique, relationnelle et
éducationnelle des soins. Après dépouillement, les
résultats sont présentés sous forme d'histogramme, de
diagramme en barre, tableaux et camembert.
b)- Validation des instruments de
collecte des données
A la suite de la rédaction de notre questionnaire,
nous l'avons soumis à l'appréciation de notre encadreur qui
après modifications nous a permis d'effectuer le pré-test
à l'hôpital de District de LONGBABA le 24 février 2012 cis
à Douala. Ce pré-test s'est effectué avec un
échantillon de 15 patients. A l'issus de ce dernier, des
améliorations ont été apportées à la
huitième question pour une amélioration portant sur la
procédure des soins. La collecte proprement dite s'est effectuée
du 27 février au 03 mars 2012.
c)- Communication des
résultats
A la fin de notre étude, nous avons rassuré
les patients que la quintessence des résultats seront publiées
lors de la présentation des projets tutorés dans l'enceinte des
locaux de l'Institut Supérieure des Affaires et de Management, en
présence d'un panel de jurys, qui pourront apprécier la valeur et
crédibilité de nos travaux et fort probablement apporter quelques
points d'améliorations à notre travail. Après soumission
à cette épreuve critique et cartésienne, des exemplaires
seront adressés :
- Au Ministère de l'Enseignement
Supérieur ;
- A la Délégation Régionale de la
Santé pour le Littoral ;
- A la direction de l'HDD ;
- A la Direction de l'INSAM.
CHAPITRE III :
PRESENTATION DES RESULTATS
I. PRESENTATION DES RESULTATS
Après dépouillement et analyse des
données collectées à l'hôpital de District de Deido,
les résultats se présentent ainsi qu'il suit :
- 17,14% d'individus appartiennent à la tranche
d'âge allant de 15 à 24 ans ;
- 31,42% appartiennent à la tranche 25 à 34
ans ;
- 25,71% de l'échantillon appartient à la tranche
35 à 44 ans ;
- 11,42% appartient à la tranche 45 à 54
ans ;
- 5,74% appartient à la tranche 55 à 64
ans ;
- 8,57% appartient à la tranche de 65 ans et plus, selon
la représentation suivante :

La répartition de notre échantillon en fonction
du sexe nous révèle qu'il est constitué de 60% de femmes
et de 40% d'hommes. Représentés selon le camembert
ci-dessous :

Figure 2 : Camembert illustrant la répartition de
la population en fonction du sexe.
CALCUL DU SEXE RATIO
Fixons : H= homme ; F= femme
Sex ratio = H/F; AN: Sex ratio =
40/60
= 0, 66
Sexé ratio ? 0, alors le sexe féminin est en effet
le plus représentatif de notre échantillon.
La répartition de notre échantillon en
fonction de leurs professions révèle que :
- 8,57% sont des fonctionnaires ;
- 25,71% sont des ménagères ;
- 11,42% sont des employés ;
- 2,85% sont des étudiants,
- 11,43% sont des élèves ;
- 20% sont des commerçants ;
- 5,74% sont des taximen ;
- Et 14,28% exercent d'autres fonctions. Cette
représentativité en fonction des activités menées
nous donne le diagramme suivant :
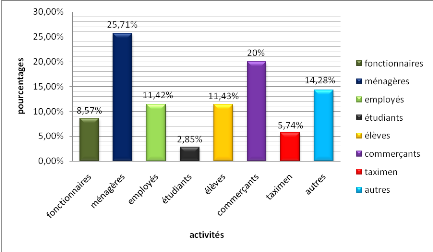
Figure 3 : diagramme en bande représentant la
répartition de l'échantillon en fonction des activités
menées.
La répartition de notre échantillon en fonction du
statu matrimoniale révèle que :
- 51,48% d'individus sont mariés ;
- 46% sont célibataires ;
- Et 3% d'individus sont veufs
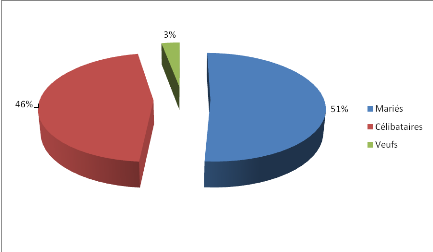
Figure 4 : Répartition de l'échantillon en
fonction du statu matrimonial
TABLEAUX RELATIFS A LA DIMENSION TECHNIQUE DES SOINS
Tableau 1 : relatif à la préparation
morale du patient.
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Préparation Morale
|
19
|
16
|
35
|
|
Fréquences
|
54,29%
|
45,71%
|
100%
|
Du tableau précédent, il en ressort que
54,29% de l'échantillon, soit 19 personnes, affirment que la
préparation morale avant chaque soin est effective. Tandis que 45,71%,
soit 16 personnes trouvent que la préparation morale avant chaque soins
n'est pas effective.
Tableau 2 : relatif au respect des règles
d'hygiènes
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Respect des règles d'hygiènes
|
15
|
20
|
35
|
|
Fréquences
|
43%
|
57%
|
100%
|
Le présent tableau révèle que 43% de
notre échantillon, soit 15 personnes trouvent que les règles
d'hygiènes sont respectés et appliquées. Par contre, 57%,
soit 20 personnes pensent le contraire.
Tableau 3 :Interruption des soins suite à un
matériel oublié par l'infirmier
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Interruption des soins
|
21
|
14
|
35
|
|
Fréquences
|
60%
|
40%
|
100%
|
De ce tableau, il en ressort que 60% on fait le constat
selon lequel,
L'infirmier interrompe souvent les soins pour aller chercher un
matériel qu'il aurait oublié. Et 40% ne partage pas cet avis.
Tableau 4 : relatif au caractère
ordonné ou non de l'infirmier dans l'application des soins.
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
L'infirmier est-il ordonné ?
|
10
|
25
|
35
|
|
Fréquences
|
28,58%
|
71,42%
|
100%
|
Il ressort du présent tableau que : 10
individus partage le point de vue selon lequel l'infirmier est ordonné
dans la procédure des soins ; et 25 individus trouvent que
l'infirmier n'est pas ordonné dans la procédure des soins.
Tableau 5 : Relatif à la survenance d'un
problème suite à un acte mal exécuté par
l'infirmier.
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Problème suite à un acte mal
exécuté
|
12
|
23
|
35
|
|
Fréquences
|
34,29%
|
65,71%
|
100%
|
De la présente préoccupation, 12 individus
soit 34,28% déclarent avoir eu un problème suite à un acte
mal exécuté par un infirmier. Et 23 personnes soit 65,71%
déclarent n'avoir jamais eu de complication suite à un acte mal
exécuté par un infirmier.
Tableau 6 : relatif à la réduction
maximale de la douleur par l'infirmier lors des soins.
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Réduction de la douleur
|
21
|
14
|
35
|
|
Fréquences
|
60%
|
40%
|
100%
|
L'interrogation des individus au sujet de la
réduction de la douleur lors des soins par l'infirmier illustre
d'après le tableau ci-dessus que : 80% d'individu trouve que la
réduction de la douleur lors des soins est un souci majeur pour
l'infirmier, alors que 20% ne partage pas cet avis.
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Disposition à converser
|
21
|
14
|
35
|
|
Fréquences
|
60%
|
40%
|
100%
|
Tableau 7 : relatif à la disposition de
l'infirmier à converser avec le patient lors d'un soin.
Il ressort du présent tableau que : 60% de
l'échantillon dit de l'infirmier qu'il est disposé à
converser avec le patient lors d'un soin. Et 40% trouve qu'il n'est pas
disposé.
Tableau 8 : récapitulatif des questions et
réponses liées à l'influence de la dimension technique des
soins administrés par les infirmiers sur la fréquentation dudit
hôpital.
Oui facteur favorisant la fréquentation facteur favorisant la fréquentation
Non facteur défavorisant la fréquentation facteur défavorisant la fréquentation
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Effectif marginal
|
|
Préparation morale
|
19
|
16
|
35
|
|
Respect des règles d'hygiènes
|
15
|
20
|
35
|
|
Interruption des soins
|
14
|
21
|
35
|
|
Caractère ordonné ou non de l'infirmier
|
10
|
25
|
35
|
|
Problème suite à un acte mal
exécuté
|
12
|
23
|
35
|
|
Réduction de la douleur
|
28
|
7
|
35
|
|
Disposition à converser
|
21
|
14
|
35
|
|
Total
|
119
|
126
|
245
|
De ce tableau, il en ressort que sur 245 points de vu, 119
point de vu, soit 17 personnes trouvent que la dimension technique des soins
les amène à fréquenter davantage la formation
hospitalière. Et 18 personnes, soit 126 points de vu trouvent que la
dimension technique des soins ne les encourage pas à fréquenter
l'hôpital.
Calcul du Chi2 relatif aux questions et
réponses liées à la dimension technique des soins afin de
confirmer l'hypothèse
Fixons : X2  Chi2 ; Ddl Chi2 ; Ddl  degré de liberté degré de liberté
Ddl  5 ; X2 seuil 5 ; X2 seuil  11,1 11,1
X2  49,15 49,15  X2 X2  X2 seuil, alors le test est
significatif. X2 seuil, alors le test est
significatif.
En conclusion, la dimension technique des soins constitue
un facteur qui amène les patients à ne pas fréquenter
davantage l'hôpital de district de Deido.
TABLEAUX RELATIFS A LA DIMENSION RELATIONNELLE DES
SOINS
Tableau 9 : relatif au confort des patients
par l'infirmier.
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Réconfort des patients
|
25
|
10
|
35
|
|
Fréquences
|
71,43
|
28,57
|
100%
|
Ce tableau révèle que : 71,43% soit 25
individus trouvent que le personnel infirmier converse
régulièrement avec eux pour les réconforter. Tandis que
28,57%, soit 10 individus trouvent que le personnel n'est pas disposé
à converser avec eux dans l'intérêt de les
réconforter.
Tableau 10 : relatif au respect et
préservation de la dignité des patients.
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Respect et préservation de la dignité
|
24
|
11
|
35
|
|
Fréquences
|
68,57%
|
31,43%
|
100%
|
Il résulte de ce tableau que 24 individus, soit 68,57%
affirme que le corps infirmier les traite avec respect et dignité. Par
ailleurs, 11 personnes soit 31,42% déclare que l'infirmier ne les traite
pas avec respect et dignité.
Tableau 11 : relatif à la priorisation des
plaintes des patients par l'infirmier.
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Priorisation des plaintes
|
11
|
24
|
35
|
|
Fréquences
|
31,43%
|
68,57%
|
100%
|
Il ressort du présent tableau que : 11
personnes, soit 31,42% trouve que l'infirmier fait des plaintes des patients
une préoccupation prioritaire. 24 individus soit 68,57% déclarent
que leurs plaintes ne constituent nullement une priorité pour
l'infirmier.
Tableau 12 : relatif au comportement des infirmiers
lié à la confiance des patients.
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Qualité du comportement
|
16
|
19
|
35
|
|
Fréquences
|
45,72%
|
54,28%
|
100%
|
16 individus, soit 45,71% trouve que le comportement
des infirmiers leur inspire confiance. Et 19 individus, soit 54,28% trouve que
le comportement des infirmiers ne leur inspire guerre confiance.
Tableau 13 : relatif à la réalisation
des soins d'hygiène des patients.
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Réalisation de l'hygiène
|
7
|
28
|
35
|
|
Fréquences
|
20%
|
80%
|
100%
|
En somme, il en ressort du tableau ci-dessus
que : 7 individus, soit 20% déclare que c'est l'infirmier qui
s'occupe de la réalisation de leur hygiène. 80%, soit 28
individus stipule que soit le garde malade soit le patient lui même qui
réalise ses soins d'hygiènes..
Tableau 14 : relatif au comportement de l'infirmier
à l'égard du patient.
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Comportement à l'égard du patient
|
20
|
15
|
35
|
|
Fréquences
|
57,14%
|
42,86%
|
100%
|
Il découle du présent tableau que : 20
individus, soit 57,14% trouve que le personnel se comporte dignement à
leur égard. Et 15 individus, soit 42,85% trouve que l'infirmier ne se
comporte pas bien à leur égard.
Tableau 15 : récapitulatif des questions et
réponses liées à l'influence de la dimension relationnelle
sur la fréquentation de l'HDD.
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Réconfort des patients
|
25
|
10
|
35
|
|
Respect et la préservation de la dignité
|
24
|
11
|
35
|
|
Priorisation des plaintes
|
11
|
24
|
35
|
|
Qualité du comportement
|
16
|
19
|
35
|
|
Réalisation de l'hygiène
|
20
|
28
|
35
|
|
Comportement à l'égard du patient
|
15
|
15
|
35
|
|
Total
|
103
|
107
|
210
|
Sur 210 points de vu, il ressort que 107 points de vu ne
concours pas à l'augmentation de fréquentation de l'HDD.
Calcul du Chi2, relatif aux questions et
réponses liées à la dimension relationnelle des
soins :
Ddl = 5  X2seuil = 11,1 X2seuil = 11,1
X2obs = 24,70636909,
X2obs > X2seuil ; donc
test significatif
Alors, vu les résultats du calcul du
Chi2, nous pouvons affirmer que la dimension relationnelle est un
facteur qui ne favorise pas la fréquentation de l'HDD.
TABLEAUX DES QUESTIONS RELATIVES A LA DIMENSION EDUCATIONNELLE
DES SOINS
Tableau 16 : relatif aux réponses
apportées sur l'information des patients sur l'origine de leurs
maladies.
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Information sur l'origine de la maladie
|
14
|
21
|
35
|
|
Fréquences
|
40%
|
60%
|
100%
|
Nous pouvons constater à l'aide du tableau
ci-dessus que : 14 individus, soit 40% ont été
informé sur l'origine de leurs maladies. Et 21 individus, soit 60%
disent n'avoir pas été informé sur l'origine de leurs
maladies.
Tableau 17 : relatif aux réponses
apportées sur l'information des patients sur leur participation dans le
processus de guérison.
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Information du patient quant à sa participation
|
17
|
18
|
35
|
|
Fréquences
|
48,58%
|
51,42%
|
100%
|
Le présent tableau montre que : 17 patients,
soit 48,57% ont été informé sur l'importance de leur
participation dans le processus de guérison. Et 18 individus, soit
51,42% n'ont pas reçu d'informations sur l'importance de leur
participation dans le processus de guérison.
Tableau 18 : relatif à l'information des
patients sur les facteurs favorisant la maladie dont-ils souffrent.
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Information sur les facteurs favorisants
|
13
|
22
|
35
|
|
Fréquences
|
37,14%
|
62,85%
|
100%
|
Le présent tableau illustre que : 13 patients,
soit 37,14% ont été informé sur les facteurs favorisant la
maladie dont-ils souffrent. Et 22 individus, soit 62,85% n'ont pas
été informé sur les facteurs favorisants la maladie
dont-ils souffrent.
Tableau 19 : relatif au traitement
réservé aux membres de la famille du patient.
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Qualité du traitement des membres de famille
|
22
|
13
|
35
|
|
Fréquences
|
62,85%
|
37,15%
|
100%
|
De ce tableau, il en ressort que : 22 individus, soit
62,85% déclarent que l'infirmier rassure les membres de la famille et
les traite avec respect. Et 13 individus soit 37,14%, ne partage pas cet
avis.
Tableau 20 : relatif à l'information des
patients sur la transmission ou l'origine de la maladie dont souffrent les
patients.
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Information sur la transmission ou l'origine de la maladie
|
15
|
20
|
35
|
|
Fréquences
|
42,86%
|
57,14%
|
100%
|
Il ressort du tableau ci-dessus que : 15 individus, soit
42,85% déclarent avoir été informé sur le mode de
transmission de la maladie dont ils souffrent. Et 20 individus, soit 57,14%
attestent n'avoir pas été informé sur le mode de
transmission ou l'origine de la maladie dont-ils souffrent.
Tableau 21 : récapitulatif des questions et
réponses liées à la dimension éducationnelle sur la
fréquentation de l'HDD.
|
Réponses
Questions
|
Oui
|
Non
|
Total
|
|
Information sur l'origine de la maladie
|
14
|
21
|
35
|
|
Information quant à sa participation
|
17
|
18
|
35
|
|
informations sur facteur favorisant
|
13
|
22
|
35
|
|
Qualité du traitement des membres de la famille
|
22
|
13
|
35
|
|
Information sur la transmission de la maladie
|
15
|
20
|
35
|
|
Total
|
81
|
94
|
100%
|
De ce tableau il en ressort que : 81 points de vu,
soit 16 personnes trouvent que la dimension éducationnelle est un
facteur qui les amène à fréquenter l'hôpital. En
outre, 94 points de vu soit 19 individus trouvent que la dimension
éducationnelle des soins ne les amène pas à
fréquenter l'hôpital.
Calcul du Chi2 relatif aux questions et
réponses liées à la dimension
éducationnelle.
X2 = 5,82 ; Ddl = 4 ? X2seuil =
9,49.
D'où, X2 < X2seuil. Alors,
la dimension éducationnelle des soins n'est pas un facteur de non
fréquentation de l'hôpital.
CHAPITRE IV :
SYNTHESE ET DISCUSSION
SYNTHESE ET DISCUSSION
La fréquentation des formations
hospitalières est un aspect de la santé qui nécessite une
attention pour que son accroissement soit une réalité en Afrique.
C'est du moins ce que nous révèlent les différents taux de
fréquentations dans la majorité des pays africains tel
qu'élucidé précédemment et prouvé par les
calculs du Chi2 dans le cadre de notre étude. En Europe,
l'assujettissement des sciences humaines au service des soins infirmiers est un
succès indéniable. D'où l'accent mis sur l'aspect
holistique de l'homme dans notre étude, de laquelle il ressort
que : La fréquentation de la dite formation hospitalière
augmenterais considérablement si le personnel infirmier octroyait une
attention particulière aux dimensions technique et relationnelle dans la
prise en charge des patients.
La non fréquentation des formations
hospitalières serait donc du à la mauvaise qualité
technique des soins, et au mauvais état des relations infirmiers et
patients. Point de vu qui évoque une similitude avec une étude
menée en Algérie à l'hôpital CHORFA en 2009, par
KHELIF HOURIA, dont les similitudes seront évoquées en cas de
nécessité
A la suite de notre enquête, l'interrogation des
patients fait ressortir une prédominance des classes d'âges
comprises entre 24 et 35 ans puis 36 à 45 ans. Et la répartition
de la population selon la profession révèle que la tranche des
ménagères (25,71%) et celle des commerçants (20%) sont les
tranches les plus représentatives de notre étude, pour un
pourcentage des mariés de 51%. Observation qui démontre la
fiabilité des réponses apportés aux différentes
questions relative à l'influence des dimensions techniques et
relationnelle sur la fréquentation de l'HDD.
Parlant du respect des règles d'hygiènes,
57% trouve que les règles d'hygiène ne sont pas
appliquées, 43% trouve qu'elles sont appliquées. Quelque soit la
place que l'on occupe dans la chaine de soins, le respect des règles
d'hygiènes est la théorie de base pour tous maintient
d'état de santé. La santé n'a pas de prix, mais elle a un
coût. L'étude menée par KHELIF HOURIA révèle
que 85% du personnel infirmier ne pratique pas les règles
d'hygiènes.
MICHAEL BALLE (12) déclare à propos que :
<< accroitre la qualité signifie améliorer
l'environnement global du patient de manière à prévenir
les problèmes plutôt que de les
résoudre>>.
En ce qui concerne les patients au sujet de l'interruption
des soins, par l'infirmier pour aller chercher un matériel qu'il aurait
oublié, 60% de notre échantillon affirme que l'infirmier
interrompe souvent les soins. Ce qui démontre que l'infirmier n'est pas
ordonné dans l'organisation des soins. Point de vu qui semble se
rapprocher de l'étude menée par KHELIF HOURIA qui montre que 77%
du personnel infirmier perd beaucoup de temps dans la réalisation des
soins. En milieu hospitalier, le temps est une ressource à capitaliser
au maximum, c'est du moins ce que traduisent MICHAEL BALLE et MARIE-NOELL
CHAMPION-DAVILLER(12) lorsqu'ils proposent la notion « zéro
défaut » qui recouvre en fait les écarts par rapport
à la meilleur manière de poser un acte. Dans le même sens,
ANNE Françoise PAUCHET-TRAVERSAT(13) fait comprendre que, l'infirmier
« clarifie les conditions, les principes : de la
préparation et de l'organisation du soin, décrire les
méthodes à employer et surtout l'attitude infirmière
à adopter ». Et ajoute que la durée d'une
séance de soin devrait être précisée,
respectée et devrait tenir compte du niveau de fatigabilité du
patient.
De plus, 68,57% déclarent que leurs plaintes ne
constituent guerre une priorité pour l'infirmier. A la page 245 de son
ouvrage, ANNE Françoise PAUCHET-TRAVERSAT montre qu'une bonne
planification des soins permet au personnel infirmier de prioriser les besoins
des patients.
Se rapportant à la préoccupation qui est
celle de savoir si le comportement de l'infirmier inspire confiance aux
patients, il en ressort que 54,29% disent que le comportement du personnel ne
leur inspire pas confiance. Sur cet aspect, ANNE Françoise
PAUCHET-TRAVERSAT (p.247) de son ouvrage, fait comprendre que l'infirmier doit
adopter « une attitude d'écoute bienveillante.
Créer un climat de confiance, instaurer les échanges et faciliter
les relations ». La véracité de ce point
de vu est mentionnée dans le code de déontologie publié
par le CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERS, 2006 :
« l'infirmière fait preuve en tout temps d'une
bonne conduite personnelle qui honore sa profession et renforce la confiance du
public dans le personnel infirmier ».
De plus, 80% stipule que c'est soit le garde malade, soit
le malade lui même qui assure ses soins d'hygiènes. A la page 73
de leur ouvrage, KATY LE NEURES et CAROL SIEBERT(4) illustrent que
« protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la
santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs
fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien,
leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou
social ».
En dépit du fait que le Chi2, de la
dimension éducationnelle, n'ait pas été significatif, nous
observons tout de même qu'elle a une valeur importante dans le maintient
de l'état de santé dans la mesure où les patients font
tout pour recouvrer la santé et bien peut pour conserver, tel que
rapporte Khelif Houria dans son mémoire de fin d'étude. C'est
dans ce sens qu'ANNE Françoise PAUCHET-TRAVERSAT (p.249) insiste sur
l'information du patient en tenant compte du niveau de compréhension,
afin d'impliquer le patient dans les différentes taches et le
responsabiliser.
CONCLUSION
CONCLUSION
En définitive, il ressort de notre étude que
le problème de la fréquentation des formations
hospitalières est vécu de manière différente
à travers le monde. A l'aide des statistiques et des données
recueillis au cours de notre étude, nous, nous sommes rendu compte que
l'HDD n'échappe pas à ce problème. Après
investigation, il s'avère que les dimensions technique et relationnelle
des soins seraient donc des facteurs influençant négativement la
sollicitation de l'HDD. Par ailleurs, il ya tout de même lieu de se
demander ce qui freine l'instauration d'un système de
sécurité social qui pourrait d'une part garantir la
fréquentation accrue des formations hospitalières, et d'autres
part, garantir l'essor de la croissance économique à tout
égard comme aux Etats-Unis et en France, surtout quand on sait que nous
avons les moyens de nous le procurer ?
Il convient tout de même de préciser que
notre étude comporte des points faibles et des points forts :
· Points forts :
- Identification des facteurs favorisant la fréquentation
inadéquate de l'HDD
- La proposition des solutions
- Opportunités : cette étude représente
une solution pour toute formation sanitaire voulant accroitre la
fréquentation de ses services.
· Points faibles :
- Rareté de la documentation concernant notre
étude,
- L'évaluation par les taux consultations des pays
étrangers,
- Le manque des données actualisées sur la
fréquentation hospitalière,
- Les moyens financiers limités pour une étude
approfondie.
· Contraintes :
- Le temps consacré à notre étude
était insuffisant vu la planification de nos cours, qui ne nous a pas
permis de traiter de tout les facteurs de la fréquentation
hospitalière.
RECCOMANDATIONS
Rendu au terme de notre étude, pour une
amélioration de la fréquentation des formations
hospitalières, nous suggérons :
· Au Ministère de la santé publique :
-L'organisation des séminaires de formations sur le
développement des capacités personnelles impulsées par la
nouvelle mouvance des sciences psychologique et sociologique au service de la
profession infirmière. Séminaires qui seront sanctionnés
par des attestations de formations afin que la ressource humaine
infirmière soit à la pointe de son ère.
· A l'administration de l'hôpital
-L'instauration des activités socio-
thérapeutique individuelle ou de groupe de (3- 12 personnes) telles
que : les causeries éducatives, l'arthérapie productive et
esthétique (dessin peinture, modelage), lecture, activités
éducatives et sportives.
-l'organisation des séances de rencontre avec le
personnel infirmier, pour sensibiliser et éduquer le personnel face
à la réaction des patients qui peuvent se montrer agressif, ou
s'introvertir.
-l'organisation des séances de recyclage au sein de
la formation hospitalière, en vu de redynamiser la force
intérieure et actualiser les connaissances liées aux
activités nursing.
· Au personnel infirmier
-de traiter les patients avec gentillesse et respect dans
la plus grande patience face parfois aux caprices des patients ou de la
nervosité du proche parent du patient.
-d'exercer la profession avec passion afin de
découvrir le bonheur qu'il ya de préserver la vie d'un patient,
même dans la plus profonde ingratitude dont font preuve les patients.
-la gestion rationnelle de la ressource temps dont
l'importance n'est plus à démontrer en milieu hospitalier.
-le respect scrupuleux des règles hygiènes
afin d'éviter d'être un vecteur ou une victime des infections
nosocomiale.
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
I-
BIBLIOGRAPHIE
Auteurs
Ouvrages ou sites
Pages
(3) Martine Audibiert ; L'hôpital et la
cité, paris, Editions Cosmos, 1965 p.163
(4) Katy Le Neurès & Carol Siebert ;
Raisonnement, démarche clinique et projet p.68 ;73
De soins Infirmiers, Editions Elsevier Masson, 2009
(5) Microsoft Encarta, 2009
(6) Colloque scientifique du 23-24 avril 2007 sur le thème
« DYNAMIQUES RURALES A MADAGASCAR : PERSPECTIVES SOCIALES,
ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES »
(7) Hounkpati Yaram jean David ; dans sa thèse :
Méthodes d'analyse des systèmes
De santé à l'université, Lyon,
France, 2007
(8) Ange -Erick Kouamé-Assouan n°2 Avril 2007
(9) Ratsifandri Hamanana B. et Terranova R ; Social
Psychiatric therapy in a hospital at Madagascar, 1967
(10) Frederique Avet; Psycho, Socio, Anthropo,
philo, p.165
Sciences humaines et soins infirmiers ; Edition
Med-line, 2004
(11) Martine Audibiert ; indicateur de santé,
tiers-monde, 1981 ; Tome 2 n°87 p.629-654
(12) Michael Balle ; Organiser les services de soins:
(13) le management par la qualité , Edition Masson, 2004
p.28
(14) Anne Francoise Pauchet-Traversat ; Soins infirmiers,
Fiches techniques, p.236 ;245
6ème édition, Maloine, 2009
I- Web graphie
(1) www.larousse.com
(2) www.unfpa.com
TABLE DES MATIERES
I- 1)
Dédicace........................................................................III
2)
Remerciements.................................................................IV
II- Liste des enseignants de 3ème Année
Soins Infirmiers.....................V-VI
III- Liste des tableaux et
figures...............................................VII-VIII
IV- Liste des abréviations et
acronymes.............................................IX
V-
Résumé............................................................................X-XI
VI-
Abstract..............................................................................XII
INTRODUCTION.............................................................................1
CHAPITRE I : REVUE DE LA
LITTERATURE.........................................2
CHAPITRE II :
METHODOLOGIE........................................................7
I- JUSTIFICATION DU LIEU ET MATERIELS D'ETUDE
I-1- Critère de
choix..............................................................7
I-2- Description du lieu
d'étude................................................7
I-3- But de
l'étude.................................................................7
II- MATERIEL ET
METHODE....................................................7
II-1- Durée de
l'étude.............................................................7
II-2- Type
d'étude.................................................................7
II-3- Critère
d'inclusion...........................................................8
Critère
d'exclusion....................................................................................8
II-4-
échantillonnage..............................................................8
II-5- respect de l'éthique et la
recherche.......................................8
II-6- méthode d'analyse des
données.............................................8
-communication des
résultats...............................................9
CHAPITRE III : PRESENTATION DES
RESULTATS..............................10
CHAPITRE IV- SYNTHESE ET
DISCUSSION.......................................25
a) Synthèse et
discussion.......................................................26
b)
Conclusion....................................................................29
-Point
fort/Opportunités.....................................................29
-Point
faible/Contraintes.....................................................29
RECCOMMANDATIONS................................................................30
BIBLIOGRAPHIE..........................................................................32
ANNEXE.....................................................................................34
![]()
| 


