REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET
POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ SAAD DAHLEB
DE BLIDA
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES ET
VÉTÉRINAIRES
DÉPARTEMENT
D'AGRONOMIE
Etude du comportement et selection de
quinze
variétés de triticales
cultivées en zone subhumide
A Oued Smar (El
Harrach)
Projet de fin
d'étude en vue de l'obtention
du diplôme
d'ingénieur d'état en Agronomie
Spécialité : Amélioration et production
végétales
HARIYONGABO Hormisdas
Devant le jury composé de :
M. AISSAT A. Maître de
conférences USDB Président
M. BENMOUSSA M. Professeur
USDB Promoteur
M. MEZIANI S.A. Maître
assistant CC USDB Examinateur
Mme ABDULHUSSEIN M.S. Maître de
conférences USDB Examinatrice
ANNEE UNIVERSITAIRE 2007/2008
Remerciements
Avant tout je remercie Dieu le Tout Puissant qui a eu la
bonté de me garder jusqu'à ce jour si spécial et me
permettre de faire part à la communauté scientifique cette
modeste contribution.
Ensuite je remercie ma famille qui se soucie sans cesse de ce
que je deviens.
Egalement, mon promoteur le Professeur BENMOUSSA qui a bien
voulu me proposer un sujet d'étude malgré les nombreuses
obligations dont il est en charge.
Je remercie par la même occasion M AISSAT qui a
accepté de présider le jury.
A M. MEZIANI et Mme ABDULHUSSEIN, je dis merci pour avoir
accepté d'examiner et de critiquer ce modeste travail.
Enfin, mes vifs remerciements à l'égard des
étudiants stagiaires avec qui j'ai travaillé
ainsi qu' à toute l'équipe de l'ITGC de Oued
Smar.
DÉDICACE
Je dédie ce travail
A toute ma famille
A tous mes amis
A tous les acteurs du secteur
agricole
A toute ma promotion
d'Agronomie
résume
Quinze variétés de triticales ont
été testées pour étudier leur comportement dans
les conditions pédoclimatiques de la zone subhumide de la station de
l'ITGC à Oued Smar.
Sur ces variétés dont deux (Clercal et Lamb2)
jouaient le rôle de témoins, on a pu étudier les
caractétistiques morphologiques, les stades phénologiques et les
performances agronomiques.
Les résultats portant sur des objectifs qui
intéressent les agriculteurs surtout la précocité et le
rendement réel ont prouvé que :
Ces variétés précoces ont de
donné les plus grands rendements dans l'ordre décroissant V1,
V7 et V10.
Des rendements intermédiaires ont été
obtenus avec les variétésV9, V13, V2 et V12.
Les rendements faibles sont crédités à la
variété V8 qui donne moins que le témoin V14.
Vu que l'essai porte sur la première année, un
deuxième essai devrait confirmer les performances agronomiques des
différentes variétés.
Mots clés : triticale, précocité,
rendement, essai, témoin,selection
SUMMARY
Fifteen varieties of triticales have been tested to study
their behavior in sub wet conditions in the ITGC station of Oued Smar.
On these varieties of which two (Clercal and Lamb2) were
control varieties, we studied the morphological characters, the phenological
stages and the agronomic performances.
The results carrying on objectives that especially interest
the farmers such as the forwardness and the real output proved that :
These following precocious varieties gave the biggest
outputs : V1 , V7 and V10.
There was obtention of medium outputs with the varieties V9,
V13, V2 and V12.
The weak outputs are credited in the V8 variety that gives
less that the control V14.
Since the test is about the first year, a second test should
confirm the agronomic performances of the different varieties.
Key words : triticale, forwardness, output, test,
control, selection
뇂̓
ÎãÓÉ ÚÔÑ
ÇÕäÇ ãät ÞÏ Êã
ÇÎÊÈÇÑåÇ
áÏÑÇÓÉ
Óáæßåã
ÇáÑÚíÉ í
ÇáÙÑæ
ÇáÑØÈå í ITGC
ãÍØÉ ãä
ÇáæÇÏí .
Úáì åÐå
ÇáÇÕäÇ ÇáÊí
ÇËäíä ÇáÔåæÏ
æÏÑÓäÇ
ÇáÔÎÕíÇÊ
ÇáãæÑæáæÌíå
ÇáãÑÇÍá
ÇáÒÑÇÚíÉ
æÇáãÓÑÍíÉ.
äÊÇÆÌ
ÇáÇåÏÇ ÇáÊí
ÊÍãá Úáì
ãÕáÍÉ
ÇáãÒÇÑÚíä
æÎÇÕÉ ãËá
ÞÏãÇ æÇËÈÊ
Çä ÇáäÇÊÌ
ÇáÍÞíÞí :
åÐå ÇáÇÕäÇ
ÇáÊÇáíÉ ÞÈá
ÇáÇæÇä
æÇáÞì ÇßÈÑ
ÇáãÎÑÌÇÊ : v1
ÇáÇÕÏÇÑ
ÇáÓÇÈÚ æv10.
æßÇä åäÇß
ãä ÇáÍÕæá
ÇáãÊæÓØÉ
ÇáäæÇÊÌ ãÚ
ÇÕäÇ v9 v13 v12 æV2.
ÖÚ
ÇáãÎÑÌÇÊ
áÍÓÇÈ V8
ãÊäæÚÉ í Çä
íÚØí ÇÞá Çä
ãÑÇÞÈÉ v14.
ÇÎÊÈÇÑ ãäÐ
ÍæÇáì ÇáÓäÉ
ÇáÇæáì
æÇáËÇäíÉ
ÊÄßÏ Çä
ÇÎÊÈÇÑ
ÇáÇÏÇÁ
ÇáÒÑÇÚí ãä
ãÎÊá ÇáÇÕäÇ.
ÇáßáãÇÊ
ÇáÏÇáå : ÞÏãÇ
æÇáäÇÊÌ
æÇáÇÎÊÈÇÑ
æÇáãÑÇÞÈÉ
æÇÎÊíÇÑ
INTRODUCTION

Liste des abréviations
BYDV : barley yellow dwarf virus
C : carbone
C/N : rapport glucides sur
protéines
Ca: calcium
CaCO3 : carbonate de calcium
CB :cellulose brute
CE :conductibilité
électrique
CIMMYT :centro internationale de
mejoramiento de maiz y trigo
CNCC :centre national de
certification des semences et des plants
CV :coefficient de variation
EB :énergie brute
(mégacalories/kg de Ms)
ED énergie
digestible (mégacalories /kg e MS)
EM énergie
métabolisable
ET écart type
FAOSTAT food and agriculture statistics
GsHs groupes homogènes
ITCF :institut technique des
cultures fourragères
ITGC :institut techniques des grandes
cultures
K2O5 hemioxyde de potassium
m.s :matière seche
MAD :matières
azotées digestibles
MAT :matières
aotées totales
Méq :milliéquivalent
MG matières
grasses
MO matière organique
MO matières organiques
N azote
OAIC :office algérien
interprofessionnel des céreales
ONAB office national des aliments du
betail
P phosphore
PEG :polyéthyle glycole
PH : potentiel
d'hydrogène
PMG : poids de mille grains
PNDAR :programme national du
développement agricole et rural
PPM : parties par milles
Qx quintaux
Ri root inducing
SAU surface agricole utile
SCE somme des carrées des
écarts
Ti tumor inducing
UFL : Valeur nutritive nette
exprimée en unité fourragère lait
UFV : Valeur nutritive nette
exprimée en unité fourragère viande

Introduction
Introduction
L'importance des céréales à
l'échelle tant mondiale que nationale est incontestable vu que c'est la
base de l'alimentation pour une grande partie de la population mondiale mais
également pour l'alimentation des animaux d'élevage.
L'Algérie s'inscrit également dans cette logique
du fait que les préparations culinaires de base font obligatoirement
recours aux céréales tel que le blé et d'un autre
côté le rationnement du bétail et des animaux de basses
cour se fait à base des céréales dont le maïs qui est
prépondérant.
A côté des céréales
séculaires qui ont été depuis longtemps
sélectionnés par l'homme pour ses différents besoins, la
recherche est parvenue à créer une autre espèce de
céréale à partir de deux parents préexistants. Il
s'agit du triticale qui est jusqu'à nouvel ordre une espèce
végétale créée par l'homme est qui a pu
connaître une diffusion plus ou moins importante.Cette
céréale a été obtenu à partir d'un
croisement entre le blé (Triticum) et le seigle (Secale), d'où
son nom triticosecale wittmack qui découle des racines latins de ses
deux parents
L'intérêt d'un tel croisement est bien
évidemment la combinaison au sein d'un même génotype des
caractères les plus intéressants chez les deux parents afin de
pouvoir les exprimer au sein du nouvel individu. Ainsi donc, on a pu combiner
la productivité du blé et la résistance aux maladies
à la rusticité du seigle (.SOLTNER, 2000)
Selon SOLTNER (2000), l'intérêt commercial du
triticale est sûrement dû à sa richesse en matières
azotées qui fait qu'il intéresse de plus en plus pour la
fabrication de certains pains et dans l'alimentation du bétail, il est
même parvenu à dépasser le seigle en terme de surface de
culture dans certains pays.
En Algérie, une vulgarisation à grande
échelle n'a pas encore été réalisée et c'est
pour cette raison que le triticale reste inconnu pour certains agriculteurs
alors que sa haute productivité, son utilisation pour les besoins
humains et comme fourrage ainsi que son adaptation aux climats semi arides
est un plus pour l'agriculture nationale qui peine à combler les
immenses importations céréalières dont dépend le
pays.
Pour parvenir à l'augmentation de la production de
cette culture, comme le stipule les objectifs fixés par l'ambitieux
PNDA, il faudrait arriver à une augmentation de la SAU par l'entremise
d'une approche adaptée de mise en valeur des terres, une bonne
maîtrise de l'itinéraire agronomique depuis le travail du sol
jusqu'à la sélection des variétés les plus
adaptées aux étages pédoclimatiques de production
(ANONYME, 2008).
C'est exactement dans le but de contribuer à la
détermination des variétés qui s'adaptent le plus à
notre environnement que s'inscrit notre travail : on cherchera
à étudier le comportement de 13 nouvelles variétés
de triticales face à deux variétés témoins,
cultivées dans la zone sub -humide au niveau de la station de l'ITGC
Oued Smar.
Bibliographie
Chapitre I : GENERALITES
I .1 Historique
Contrairement aux autres céréales courants, la
culture du triticale n'est pas mulitiseculaire.Il s'agit d'une espèce
créé par l'homme et qui a connu un succès agronomique
(SOLTNER, 1999)
L'histoire du triticale commence en 1876 lorsque l'Ecossais
A.S Wilson réalisa des croisements entre le blé et le seigle,
hybrides qui ne furent pas utilisés par le fait qu'ils étaient
stériles (ABDULHUSSEIN, 1987)
C'est pratiquement vers 1888 que l'Allemand Wilhelm Rimpau
obtient par l'hybridation du blé et du seigle ,une plante à 04
semences germinables,une seule des 04 plantes obtenues fut un hybride fertile
donnant ainsi naissance à la plus ancienne lignée de triticales
octoploÏdes du monde .
La première présentation botanique du triticale
a été réalisée en 1928 par Tiumiakov qui l'a
appelé triticum scalotriticum
Dans les années 1929-1931, Saratoviense, Meist,
Lenwitsky et Bentskaja ont réalisé des analyses cytologiques du
triticale et établi que 2n=56 chromosomes.Les chercheurs suédois
Muntzing et al. (1935) ont obtenus des formes octoploïdes et
tétraploïdes (2n=42) des triticales suite à des croisements
entre triticum turgidum×secale(×Triticum aestivum) (ABDULHUSSEIN
,1987)
Pour pouvoir différencier les deux lignées de
triticales obtenues, une appellation a été
proposée :
-Triticales Rimpau
-Triticales Meister
Le nom de triticale sera utilisée plus tard en 1935
par Lindchau et Ochler qui ont étudié la lignée de
triticale établie par Rimpau et réalisés qu'elle
été resté constante plusieurs dizaines d'années.
Avec la découverte de la colchicine,alcaloïde
extrait du colchique en 1937 commence ce qui peut s'appeler l'ère
moderne des triticales .En effet,Givendon découvre la technique de
dédoublement des chromosomes par la colchicine chez les hybrides
stériles
A partir des années 1950 commence le
développement des triticales. Des études poussées sont
effectuées sur la valeur biologique, la cytologie et l'obtention des
lignées plus performantes.En 1968 ,est obtenu au niveau du CIMMYT au
Mexique une souche de triticale appelé Armadillo
très performants.
Egalement, en Pologne cette fois, on isole une
variété d'hiver
« Lasko »,qui gagnera toute l'Europe par
après. Dans les années 1978 seront obtenues des lignées
très productives allant jusqu'à 75 qx /ha, fertiles et
résistantes à la verse (ABDULHUSEIN, 1987)
En France la première variété le
Clercal, sera cultivée en 1983 (INRA)
I.2 Situation du triticale
I.2.1 Au niveau mondial
Le triticale n'est pas cultivé à grande
échelle dans le monde. L'intérêt que suscite cette nouvelle
espèce est surtout dû à sa valeur alimentaire (très
bonne en protéines) (BELAID , 1986).
Cependant les caractéristiques des deux parents ont
incité les chercheurs à étudier la faisabilité
d'une culture de cette espèce sur des superficies importantes.
Les deux principaux types de triticales qui sont couramment
mis en culture correspondent le plus souvent à deux situations :
-types d'hiver dans le Nord de l'Europe
-types de printemps dans la zone aride (LAROCHE et al.
,1994)
Il faut noter cependant que dans certaines régions, le
triticale a tellement convaincu les agricultures qu'il est même parvenu
à dépasser son parent le seigle en terme de surface
consacrée à la culture comme en France (SOLTNER, 1999)
Actuellement, malgré son faible développement
face aux céréales classiques, le triticale occupe
néanmoins une superficie de plus de trois millions d'hectares avec en
tout une centaine de génotypes cultivés. (BERNARD ,1992)
Le tableau suivant reprend les superficies consacrées
à la culture du triticale par les principaux pays producteurs.
Tableau 01 .Distribution mondiale de la culture du triticale
|
Pays
|
Superficie en ha
|
|
France
|
300000
|
|
Etats-Unis
|
60000
|
|
Espagne
|
30000
|
|
Chine
|
25000
|
|
Belgique
|
5000
|
|
Mexique
|
8000
|
|
Canada
|
6500
|
|
Inde
|
500
|
|
Italie
|
15000
|
|
Argentine
|
10000
|
|
Portugal
|
7000
|
|
Tanzanie
|
400
|
|
Afrique du sud
|
15000
|
|
Tunisie
|
5000
|
(ANONYME,2006)
I.2.2 Au niveau national
Introduite en 1972 sous forme de matériel
génétique en disjonction, provenant de la souche
« Armadillo » du CIMMYT, certaines lignées de
triticales ont été isolées et conduites en essais. Ces
essais ont été réalisés au cours de la campagne
1974-1975 suivant la manière de blocs
randomisés, dans trois stations différentes d'Alger, Saida et
Sétif. (BELAID, 1986)
Actuellement, les variétés retenues ont
montré des performances d'adaptation plus élevées par
rapport à celles du blé ,de l'orge et du seigle à
condition qu'elles soient conduites dans des zones où la
répartition des pluies et leurs abondances sont satisfaisantes comme le
cas de la zone côtière . (BENBELKACEM, 1987)
Toujours selon BELAID (1987), au niveau des hauts plateaux
où les conditions climatiques sont déterminantes pour discerner
les capacités d'adaptation, les rendements des lignées
introduites sont sensiblement similaires à ceux des autres
espèces céréalières dans les meilleures conditions
de production et restent compétitives.
Vers 1992, suite à un problème des importations
de maïs,il fut retenu un programme de production du triticale avec comme
objectif 50000 ha à atteindre.Trois organismes avaient combinés
leurs efforts pour y arriver,il s'agit de l'Office National des Aliments du
Bétail(ONAB),l'ITGC,l'Office Algérien Interprofessionnel des
Céréales (OAIC).
Durant les deux années qu'a duré le
programme,une superficie maximale de 12.000 ha fut atteinte, par suite aux
problèmes liés surtout au prix à la production qui
était très faible (1000 DA),les agriculteurs
délaissèrent progressivement sa culture.
Les possibilités d'importer le maïs étant
devenues plus avantageuses ,le programme du triticale fut progressivement
abandonné et en 2004 aucune statistique ne parle plus de cette culture
en Algérie, sa production étant restée localisée
uniquement au niveau des stations de recherche ou dans de petites
exploitations isolées.
Tableau 02 Evolution de la superficie de la culture des
céréales en Algérie
|
Année
|
Blé dur
(ha)
|
Blé tendre
(ha)
|
Orge
(ha)
|
Avoine
(ha)
|
Triticale
(ha)
|
Totale
(ha)
|
|
2000
|
1112180
|
724230
|
515690
|
49700
|
10
|
2401810
|
|
2002
|
813890
|
584570
|
401400
|
44600
|
06
|
1844460
|
|
2003
|
126537
|
782200
|
782380
|
70870
|
0 ?
|
2900820
|
(ANONYME, 2004)
I.3 Importance économique
Selon BROUWER(1976), le triticale est une
céréale bien appréciée non seulement à cause
de la richesse nutritive de ses produits mais également sa
plasticité et sa rusticité lui conférant tout de
même des rendements satisfaisants dans des étages
pédoclimatiques difficiles.
Son importance économique est accentuée par la
variété de son utilisation que ce soit au niveau de
l'alimentation humaine ou animale comme fourrage, il pourrait participer
à combler le déficit de la production nationale afin de
réduire la facture des importations des céréales.
Egalement, les intérêts économiques du
triticale sont :
§ Une conduite économique en intrants ;
grâce à sa rusticité ;
§ Une productivité élevée (rendement
en grains)
§ Une production en paille plus élevée que
celle des autres céréales d'hiver ;
§ Une utilisation en alimentation animale pour
l'économie du tourteau ;
§ Une utilisation de la farine de triticale en
mélange avec la farine de blé tendre, contribue à la
réduction des importations de cette dernière ;
§ Une marge brute, dégagée par la culture
d'un hectare de triticale, plus élevée que celle de l'avoine et
de l'orge
(ANONYME, 2006)
Néanmoins ,bien que le monde ne soit pas près de
substituer l'un ou l'autre des céréales naturelles par le
triticale,l'emploi du grain de triticale au niveau de la meunerie et autres
usages reste un créneau intéressant à exploiter.
Tableau 03 Les échanges mondiaux du triticale
|
Exportations en M t et M $
|
Importations en Mt et M $
|
|
Pays
|
Quantité
|
Valeur (M$)
|
Pays
|
Quantité
|
Valeur (M$)
|
|
Allemagne
|
148472
|
21006
|
Pays Bas
|
135847
|
19448
|
|
Chine
|
59288
|
14315
|
Slovénie
|
24661
|
2820
|
|
France
|
22467
|
3837
|
Danemark
|
17395
|
2626
|
|
Hongrie
|
28789
|
3310
|
Belgique
|
10269
|
1584
|
|
Pays Bas
|
6262
|
6262
|
Lituanie
|
6776
|
985
|
(Base de données FAOSTAT ,2004)
I.4 Composition chimique du grain et utilisation des
triticales
I.4.1 Composition du grain
La composition des grains des triticales est comparée
à celle du blé, du seigle et de l'orge au niveau du tableau
suivant.
Tableau 04 Composition chimique moyenne du blé,
triticale, seigle et orge (g/kg de m.s)
|
Composition
|
Blé
|
Triticale
|
Seigle
|
Orge
|
|
MAT
|
132
|
122
|
100
|
111
|
|
Amidon
|
687
|
663
|
630
|
575
|
|
Cellulose brute
|
26
|
28
|
22
|
51
|
|
Fibres NDF
|
123
|
134
|
145
|
209
|
|
Matières grasses
|
24
|
21
|
19
|
26
|
|
Calcium
|
0.7
|
0.5
|
0.7
|
0.06
|
|
Phosphore
|
3.8
|
3.5
|
4.0
|
4.1
|
|
Lysine
|
3.7
|
4.7
|
3.9
|
4.3
|
|
Méthionine
|
2.1
|
2.1
|
1.6
|
1.6
|
|
Cystéine
|
3.2
|
3.8
|
2.3
|
-
|
|
Thionine
|
4
|
4
|
3.5
|
3.8
|
|
Tryptophane
|
1.66
|
1.5
|
0.9
|
1.5
|
(SOLTNER, 2000)
Les données de ce tableau montre clairement que pour
la plupart des composés, la teneur se trouvant dans le triticale est
pour la plupart des cas intermédiaire à celle se retrouvant au
niveau de ces géniteurs, le blé et le seigle. C'est le cas
notamment de la MAT, amidon, fibres, matières grasses, Ca, P, et
Tryptophane.
Ces teneurs sont légèrement supérieures
à celles que l'on retrouve dans l'orge.
Par contre, la richesse du triticale en Lysine par rapport
aux autres céréales est incontestable, cet acide aminé
atteint des teneurs jusqu'à 25% supérieur à celle du
blé.
La richesse en cet acide aminé explique le fait que le
triticale soit plus riche en protéines que les autres
céréales
Selon BROUWER (1976), la teneur en protéine au niveau
du gain de triticale peut atteindre les 22,4%, ce qui constitue un
critère de choix pour l'utilisation du triticale en tant que
fourrage.
I.4.2 Utilisation du triticale
Le triticale se prête à une multitude
d'utilisations que ce soit pour les besoins directs dans l'alimentation
humaine, fourrage pour les animaux et autres utilisations diverses.
I.4.2.1 Alimentation des animaux
Compte tenu de leur composition sensiblement proche dans
plusieurs composés chimiques, le triticale donné aux animaux
comme fourrage fournit des résultats comparables à ceux obtenus
avec le blé.
D'autre part, selon LAROCHE et al. (1994) le triticale
étant beaucoup plus riche en lysine que le blé, son emploi dans
une ration équilibré permet de réduire d'environ de 10 %
la ration de tourteaux et la réduction du taux azoté de
l'aliment.
v Pour les ruminants
Selon LAROCHE (1994), le triticale donne les même
résultats que le blé fourrager pour l'élevage de ruminants
en Europe.Les essais d'utilisation du triticale sous forme de grains pour les
élevages de ruminants en Algérie ont abouti à des
résultats plus satisfaisantes que dans le cas d'utilisation de l'orge ou
du seigle. (BENBELKACEM 1987). La concentration des efforts sur le
développement de la culture du triticale à grande échelle
du triticale comme c`est le cas de l'arboriculture dans le cadre de la PNDAR
serait sans doute une solution pour réduire le déficit en
fourrage et de là limiter les importations d'énormes
quantités de maïs qui sans parler de la lourde charge
financière qu'elles exigent apportent souvent des risques sanitaires
comme la contamination par des mycotoxines .
Tableau 05 Valeurs nutritives de quelques
céréales pour ruminants (par Kg de MS)
|
Aliments
Concentrés
|
Valeur énergétique (Unités)
|
Valeur azotée
|
constituants organiques
|
Constitu-
ants minéraux (g)
|
Energie (mcal)
|
|
UFL
|
UFV
|
MAD
|
MO
|
MAT
|
CB
|
MG
|
P
|
Ca
|
EB
|
EM
|
EM
|
|
Triticale
|
1.21
|
1.22
|
101
|
978
|
170
|
33
|
17
|
4,6
|
0,5
|
4,46
|
3,8
|
3,2
|
|
Blé
|
1,19
|
1,20
|
98
|
973
|
125
|
27
|
20
|
3,8
|
0,7
|
4,40
|
3,79
|
3,1
|
|
Seigle
|
1,18
|
1,19
|
88
|
980
|
120
|
26
|
16,2
|
4
|
0,7
|
4,34
|
3,75
|
3,1
|
|
Orge
|
1,12
|
1,11
|
86
|
953
|
122
|
63
|
18,5
|
3
|
0,6
|
4,34
|
3,62
|
3,0
|
(SOLTNER D ,2000)
UFL : Valeur nutritive nette exprimée en
unité fourragère lait
UFV : valeur nutritive nette exprimée en
unité fourragère viande
MAD : matières azotées digestibles
MO : matières organiques
CB : cellulose brute
MG : matières grasses
Ca: calcium
P: phosphore
EB : énergie brute (mégacalories/kg de
Ms)
ED : énergie digestible (mégacalories /kg e
MS)
EM : énergie métabolisable
(mégacalories kg /de MS)
v Pour les lapins
Les performances du triticales sont les mêmes que celles
du blé fourrager (VARUGHESE et al, 1994)
v Pour le taurillons
Les performances sont beaucoup plus élevées que
lors de l'utilisation du seigle. La masse augmente de 0,72
kg/jour contre 0,69 kg / jour pour le seigle. (VARUGHESE et al
,1985)
v Pour les poulets
Le taux limite de l'incorporation de triticale dans les
aliments pour les poules pondeuses est fixé à 40 % (LAROCHE et
al, 1994)
Le triticale peut être substitué au maïs
comme céréale dans l'alimentation des volailles.
I.4.2.2 Utilisation industrielle
Selon les travaux réalisés par l'ITGC en
Algérie, l'utilisation de la farine de triticale en boulangerie et en
pâtisserie n'est pas facile, cette farine donnant une pâte collante
qui gonfle difficilement .Pour cela, il faut la couper avec des farines dites
fortes comme celles tirées des blés tendres. Les bonnes
proportions étant de 70% de farines de triticale pour 30 % de
blé.
Avec ces coupages, les farines de triticales sont
utilisées pour la fabrication des pâtes alimentaires, des
bretzels, des pains et des biscuits.
Selon BENBELKACEM (1973), l'incorporation de 04 % de gluten
aux farines de triticales permet d'obtenir des pains de même
qualité que ceux à base de farines de blés tendres.
Malheureusement, le prix élevé de cette matière ne permet
pas son utilisation élargie en Algérie.
Les pays comme le Canada utilise la majeure partie de leur
production pour la brasserie.
I.4.2.3 Autres utilisations des triticales
Le triticale peut être cultivé en association
avec des plantes fourragères de la famille des légumineuses comme
la vesce ou le pois. En effet ces dernières étant fragiles
à la fin de leurs cycles à cause de leurs tiges courtes, elles
sont sensibles à la verse. Le triticale par sa vigueur constitue un bon
tuteur pour ces riches légumineuses qui s'enroulent sur lui grâce
à leurs vrilles. (ANONYME)
En pharmacie, le triticale constitue un substrat pour la
production de l'ergot : Claviceps purpurea dont
on extrait des alcaloïdes (principes actives) ; ces dernier sont
utilisées pour la production des médicaments antimigraineux
(SCHORDERET, 1989)
Egalement, la multiplication du mycélium de champignon
de Paris se fait sur un support céréalier en particulier le
seigle mais le triticale est en train de se substituer au seigle pour cet
usage. (LAROCHE et al, 1994).
La paille triticale peut intéresser l'industrie
à trois titres :
Pour son contenu énergétique, sa richesse en
fibres et en sucre, à la base d'une chimie verte comparable à
celle développée sous les hydrolyses d'amidon du blé.
Les valorisations possibles sont :
> Combustible pour chaudière collective ou
industrielle ;
> Matière pour l'artisanat (maquetterie, paillons
à fromage, chapellerie, paillage de chaises) ;
> Fabrication de pâte à papier ;
> Fabrication de matériaux plastiques et
construction (chaumes, panneaux,..)
Chapitre II : BIOLOGIE DE LA PLANTE
II.1
Caractéristiques botaniques
II.1.1
Systématique
Cette céréale est rattachée à la
grande famille des graminées .Il appartient a la tribu des
Triticées. On peut effectuer la classification suivante.
Classe Monocotylédones
Ordre Poales
Famille Poaceae ou graminea
S/Familles Festucoidea
(BONJEAN ,1992)
II.1.2 Nomenclature
Fruit de la recherche de l'homme, les différents
scientifiques qui ont travaillé sur l'amélioration du triticale
ont au fil du temps proposé leur appellations.
Mac Key (1991) cité par BACHIR et al (2000) proposera
les appellations triticum krolowi, triticum turgidosecale et
triticum rimpaui pour les trois souches en considérant les
niveaux de ploïdies.
Cependant le nom sur lequel la majorité des auteurs se
sont mis d'accord (BERNARD, 1992 ; CAUDERON, 1981 ; BONJEAN ,1992)
est celui qui souligne la double origine de cet hybride.
Ainsi de (Blé×seigle) on a obtenu
Triticosecale Wittmark comme nom scientifique et
comme nom commun ils ont gardé triticale avec
triti de Triticum et Cale de
secale.
II.1.3 Les ressources
génétiques
Céréale synthétique dérivant de
l'hybridation du blé cultivé (Triticum aestium ou
triticum durum), et du seigle (Secale cereale), les
triticales sont de plusieurs types. Depuis les premières formes fertiles
obtenues par Rimpau en 1891, plusieurs types ont étés obtenus par
la suite (BACHIR ,2000)
GUPKA cité par BACHIR (2000) distingue 4 groupes sur
la base du niveau de ploïdie. Les triticales tétraploïdes,
hexaploides, octoploïdes et décaploïdes.
En considérant le type de croisement, on distingue des
triticales primaires qui sont issus soit directement de
l'amphiploïdisartion des hybrides Triticum et Secale,
soit de l'intercroisement des hybrides entre deux triticales issus des
même espèces de triticum et de secale, des
triticales secondaires résultants du croisement de deux triticales de
même niveau de ploïdies ou de parents différents, avec un
génome de seigle complet ou partiel (BACHIR et al, 2000)
Les ressources génétiques des triticales sont
résumées dans le tableau suivant :
Espèce de départ
RR
AABB
RR
Seigle Aegilops squarrosa
Blé dur Seigle
DD
D
AB
R
Gamète Gamète
ABR
ABD
F1 Stérile
AABBRR
AABBDD
Triticale
Hexaploïde
Primaire
R
ABD
Gamète
ABDR
F1
stérile
Doublement
AABBDDRR
Triticale
Octoploïde primaire
ABR
ABDR
Gamète
Gamète
AABBDR
F1 partiellement retour
Hexaploïde
AABBRR
Triticale Hexaploïde
Secondaire
Figure 01 Hybridation interspécifique et
amphidiploïde (CAUDERON ,1981)
II.1.3.1 Le niveau de
ploïdies
§ Triticales
octoploïdes (2n=8x=56)
Le triticale octoploïde est représenté par
la structure génomiale AA BB DD RR et renferme dans les cellules
somatiques 56 chromosomes dont 42 appartiennent au type A ,B,et D et
proviennent donc du blé et 14 chromosomes de type R qui sont issus du
seigle.
Malheureusement, on remarque souvent des troubles de la
méiose et par conséquent une diminution de la fertilité
.L'amélioration s'attelle à trouver des lignées
octoploïdes riches en protéines .On peut citer à titre
d'exemples l'obtention des formes octoploïdes à contenu
élevé en gluten de type 102 HD 137 en Bulgarie (ABDULHUSSEIN,
1987)
§ Triticales
hexaploïdes (2n=6x=42)
Présentant quant à eux une structure
génomiale de type AABBRR et renferment dans leurs cellules somatiques
42 chromosomes parmi lesquels 28 proviennent du blé et 14 chromosomes
proviennent du seigle. Ce sont des formes de printemps ou d'automne. Le
premier triticale Hexaploïde a été obtenu en Russie par le
croisement du blé triticum durum et du Secale
montanum, seigle sauvage, cet hybride obtenu était pérenne
et utilisé comme fourrage vert.
Les premiers formes de triticales hexaploïdes de
printemps ont été obtenus par SADIHOV en 1945 (Russie)
après un croisement entre une variété riche de blé
dur Sark et Secale kuprejanovu ,qui est une seigle sauvage.
L'hybride se caractérise par une
hétérosis accentuée et par une bonne capacité de
tallage. On notera que plusieurs lignées de triticales hexaploïdes
ont étés obtenus dans plusieurs pays comme la Suède,
Hongrie, Canada, Mexique, Roumanie, Pologne et s'adaptent aux sols sableux
(ABDULHUSSEIN ,1987)
§ Triticales
tétraploïdes (2n=4x=28)
Les formes de triticales tétraploïdes ont une
structure génomiale de type AARR ou BBRR et ont au niveau de leurs
cellules somatiques 28 chromosomes dont 14 appartiennent aux génomes
A ou B du blé et 14 chromosomes sont issus du seigle avec le
génome R.
Le premier triticale tétraploïde fut obtenu par le
croisement du blé diploïde Triticum monoccum et
le Secale Cereale, seigle diploïde par KISS en 1968 suivi par
GUSTAFSON. (ANONYME, 2006)
§ Triticales
décaploïdes (2n=10x=70)
Ils présentent une structure génomiale de type
AABBDDRRRR et renferment au niveau de leurs cellules somatiques 70
chromosomes.
Ce type de triticale a été obtenu en 1955 par
MUNTZIG, mais n'est plus suivi depuis (CAUDERON ,1981).
Tableau 06 Différents types
de triticales et leurs génotypes
|
FORME
|
STRUCTURE
GENOMIALE
|
NOMBRE DE
CHROMOSOMES
|
POSSIBILITE DE REALISATION
|
|
Octoploïde
|
AABBDDRR
|
56
|
6 x blé (ABD) x 2 x seigle (R)
8 x triticale (ABDR) x 8 x triticale (ABD)
8 x triticale (ABDR) x6x blé (ABD)
8 x triticale (ABDR) x 6x triticale (ABRD)
4 x blé (AB) x 2 x seigle (R)
|
|
Hexaploïde
|
AA BB RR
|
42
|
6 x triticale (ABR) x 6x triticale (ABR)
8 x triticale (ABR) x 6x blé (ABD)
|
|
Tétraploïde
|
AA RR ou BB RR
|
28
|
6 x triticale (ABR) x 2 x seigle (R)
|
(GUSTAPHSON, 1976)
II.1.3.2 Le type de
croisement
Selon le type de croisement utilisé pour obtenir
l'hybride, on parvient à classifier les triticales en deux groupes: les
groupes primaires et le groupes secondaires.
o Les formes
primaires
Ce sont les résultats d'un croisement entre le
blé et le seigle, ce sont les triticales octoploïdes et
hexaploïdes qui résultent d'un dédoublement du nombre de
chromosomes chez les hybrides simples blés x seigle.
Le premier triticale primaire à voir le jour et
l'octoploïde issu du croisement Triticum aestivum x Secale
Cereale. Mais par la suite on a pu obtenir d'autres triticales primaires
avec d'autres espèces de blé : T. Spella et
T. compatum avec des espèces de seigle sauvage : S
Montanum.
Actuellement, les formes primaires de triticales sont obtenus
en utilisant des espèces de blé comme T Turgidum, T
Polonium, T Timopheevi, T Dicocoides,T
Dicococum avec des pollinisateurs du seigle comme S
Dalmaticum et S Aficanum.
Cependant, on constate qu'en général les formes
primaires de triticales octoploïdes et hexaploïdes manifestent
souvent des caractères négatifs dont les plus courants
sont : rachi, fertilité réduite, fragilité, grains
petits.
o Les formes
secondaires
Les triticales secondaires résultent du croisement
entre triticales de même niveau de ploïdie ou de parents
différents et ont un génome de seigle complet (triticales
secondaires vrais ou complets) ou partiel (triticales secondaires de
substitution) (GUPTA et al 1982)
Selon GUSTAPHSON (1976), ces triticales sont
généralement obtenus par le croisement de triticales
octoploïdes avec des triticales hexaploïdes ou des triticales
hexaploïdes avec des blés hexaploïdes.
Le hybrides obtenus par les croisements des octoploïdes
et hexaploïdes contiennent de nombreuses recombinaisons
génétiques entre les génomes A et B du blé,
recombinaisons qui par un bon processus de sélection peuvent donner des
variétés aux résultats satisfaisants.
II.1.4
Caractéristiques morphologiques
Etant l'hybride intrerspécifique entre le blé et
le seigle, le triticale présente des caractéristiques souvent
intermédiaires entre ses deux parents.
II.1.4.1 Appareil
végétatif
A Les racines
Le système racinaire des triticales est
fasciculé et est constitué par trois types de racines :
· Radicules : racines embryonnaires
· Racines adventices embryonnaires
· Racines adventices qui apparaissent au niveau du
premier ou du second entre noeud (GASPER et BUNATRU, 1985)
B La tige
La tige du triticale lui donne aspect robuste et vigoureux par
rapport à ses deux parents. La tige a une longueur intermédiaire
à celle de ces deux parents : 1,20 m à 1,30 m, mais son
diamètre est supérieur 2 à 6 cm chez les
variétés courantes et 5 à 8 cm chez les
variétés naines. (ZEMERLINE ,1990)
C Les
feuilles
Les feuilles des triticales sont semblables à celles
des autres céréales de sa tribu, leur longueur est égale
à celle de celles du blé, entre 15 à 25 cm mais leur
diamètre est supérieur à celle des deux parents (SIMON et
al, 1989)
A la base du limbe foliaire se trouvent la ligule et les
oreillettes qui sont en général grandes avec une bordure
plissée ; chez certaines variétés de triticales, la
ligule présente une bordure colorée en rouge (KISS et al,
1977)
II.1.4.2 Appareil
reproducteur
A
L'épi
Son épi, grand et barbu rassemble fortement à
celui du seigle (SIMON et al, 1989), il porte 30 à 40 épillets,
ces derniers portant 3 à 9 fleurs dont 3 à 5 sont
généralement fertiles.
La protection de chaque fleur est assurée par deux
glumelles , très dures et adhèrent fortement au grain (SIMON ,
1992).D'après BERNARD , le fleurs des triticales sont plus grosses que
celles des blés,les étamines plus importantes , plus largement
extrudée, fournissant davantage du pollen, ce qui explique le fait que
les triticales ne soient pas strictement autogames.
Les anthères sont au début de couleur verte et
à la maturité, ils se colorent en jaune ou en jaune
violacé.
B Le grain
D'après BERNARD (1970) ,le grain du triticale est un
caryopse qui rappelle la forme du grain de seigle alors que sa couleur
ressemble plutôt à celle du blé.
C'est un grain qui est très sensible à la
germination sur pied et est sujette à un échaudage
fréquent, caractère hérité surtout de la forte
activité de l'alpha amylase pendant la maturation,
l'hétérochromatine télomerique des chromosomes du seigle,
à l'aneuploïdie et à l'environnement cultural comme les
disponibilités du plateau de remplissage. (BACHIR et al 2000)
Son poids de mille grains est compris entre 32 et 61,4 g.
(ABDULHUSSEIN ,1987)
II.1.5 Les cycles
phénologiques
Sur le plan phénotypique, le triticale ressemble
fortement au blé, mise à part qu'ils présentent une
vigueur plus accentuée et qu'ils comportent de grands épis et de
nombreux épillets.
Le cycle végétatif des triticales passe par une
série d'étapes, à partir de la germination
jusqu'à la maturation des grains.
A La germination
Comparativement au blé et au seigle, la semence de
triticales germe beaucoup plus vite : dans les conditions optimales, elle
se situe autour de 22 °C à 25°C. C'est sans doute
l'activité de l'alpha amylase qui hydrolyse l'amidon dans la
période de repos séminale (ABDULHUSSEIN, 1987 ; ZILLINSKY et
BORLANG ,1971)
Comme tout autre culture, la possibilité de ce
phénomène et sa durée dépend à la fois des
facteurs :
-Intrinsèques : dépendant du grain
- Extrinsèques : liés au milieu
B La
levée
Un à deux jour après l'apparition de la
radicule ,on peut obtenir le bourgeon protégé par la
coléoptile.Dès que la coléoptile arrive à 6 ou 7
cm de hauteur , la première feuille se forme .(ABDULHUSSEIN ,1987)
C Le tallage
Au moment du tallage, la plantule émet plusieurs apex
susceptibles de donner plusieurs tiges. (BELAID, 1987).
Les triticales ont une capacité de tallage importante,
le nombre de talles est comparable à celui du seigle.
En général, les formes octoploïdes et
hexaploïdes des triticales développent plus de talles que les
blés. (ABDULHUSSEIN, 1987)
Plusieurs facteurs concourent par leur influence sur le
tallage :
-Epoque du semis
-La fertilité du sol
-L'espace de la nutrition
De même, le climat joue un rôle majeur dans le
processus de tallage :
-L'humidité
-Température
-Lumière
Le nombre de talles est variable de 1 à 6, mais il
augmente lorsque les conditions du milieu s'améliorent (ABDULHUSSEIN
,1987)
D La
montaison
L'aspect général de la culture reste
très semblable à celui des autres céréales à
ce stade, sauf que on remarque la vigueur des tiges des triticales ainsi que la
largeur des feuilles qui restent très significatives par rapport aux
autres céréales.
E
L'épiaison
La phase d'épiaison commence avec la sortie de
l'épi de la gaine de la dernière feuille, elle
dépend :
- Du génotype
- Du milieu
- Des conditions de culture (ABDULHUSSEIN ,1987)
Le triticale émet des épis plus tôt que le
blé, caractère hérité du seigle (LAROCHE et al
,1994)
F La
floraison
En conditions normales de culture, la floraison commence 7
à 15 jours après l'épiaison, soit à peu près
195 à 210 jours après le semis. Dans l'épi, la floraison
commence au niveau du 1/3 de la longueur de l'épi et continue vers les
deux extrémités.
La floraison d'un épi dure en général 3
à 5 jours et la floraison d'un plant avec plusieurs épis , 7
à 12 jours et parfois même 20 jours
Selon ABDULHUSSEIN (1987), le climat joue un rôle
important sur la floraison :
- La température
- Ensoleillent
G La
maturation
Les triticales atteignent la maturité physiologique
plus tardivement que le blé. La durée de ce stade est de 40 jours
à 45 jours (LAROCHE ,1984)
Le grain perd progressivement de son humidité, passant
ainsi du stade pâteux avec 45 % d'humidité au stade de
maturité complète ave 15 % d'humidité. (SOLTNER, 1980)
C'est à ce stade que le phénomène de
l'échaudage est très courant et cause énormément
de pertes au niveau des champs de triticales.
L'échaudage est certes dû aux caractères
génétiques du triticale, mais ce phénomène est sans
doute accentué par la durée de la maturité physiologique
très longue correspondant à l'arrivée des périodes
sèches de l'année sous notre climat
(BENBELKACEM 1991 ; ANONYME 2008)
II.2 Les exigences
écologiques
II.2.1 Les exigences
climatiques
II.2.1.1 La
température
Le triticale tolère le froid, sa culture est possible
dans les altitudes dépassant les 1000 mètres, il peut être
cultivé dans toutes les zones céréalières du Nord
du pays, en fin de cycle, le triticale supporte mieux que le blé et
l'orge les températures élevées. (ITGC, 2006)
Selon LAROCHE et al (1984), le triticale nécessite des
températures modérées pendant la phase de remplissage des
grains et c'est la raison pour laquelle elle donne de bons rendements et d'une
bonne qualité dans des zones froides .La température
élevée pendant cette phase entraîne l'échaudage du
grain.
II.2.1.2 L'eau
Le triticale est assez résistant à la
sécheresse, il se développe sous une pluviométrie
supérieure à 250 mm (ANONYME ,2006)
En plus, les triticales présentent un bon comportement
dans des conditions de déficit hydrique (-40 mm) pendant la phase de
maturité physiologique, les pertes en poids de milles grains
n'excèdent pas 3g, alors qu'au même stade avec des déficits
modérés (-15 à 30mm), les pertes sur l'orge atteignent en
moyenne 10 g, l'orge évite donc la sécheresse par sa
précocité tandis que le triticale la tolère.
Sa résistance à la sécheresse est
meilleure que celle du blé mais moins bonne que celle du seigle
(LAROCHE et al 1984)
II.2.1.3 Le
photopériodisme
Les triticales poussent aussi bien en conditions de jours
longs qu'en conditions de jours courts, sa faible réaction aux
variations du photopériodisme influence positivement
l'adaptabilité des différentes formes du triticale dans les
zones géographiques variées (GASPER et BUTRANU ,1985)
II.2.2 Les exigences
pédologiques
Le triticale est peu exigeant et supporte même
certains types particuliers de sols tels que les sols acides, les sols
à forte capacité de rétention et les sols à
salinité assez élevée. Cependant, il faut éviter
les sols peu profonds pour assurer une forte production en vert. (ANONYME
,2006)
Egalement dans les sols argileux, lourds où le travail
du sol n'est pas toujours bien réalisé et l'enracinement
des céréales souvent aléatoire en raison de l'asphyxie,
le triticale peut se développer (LAROCHE et al ; 1984)
II.3 Itinéraire
technique
II.3.1
Caractéristiques agronomiques
II.3.1.1 Assolement et
rotation
Comme pour les autres céréales, le triticale
n'est pas recommandé en tête d'assolement, mais il s'insère
facilement après le blé, dans une rotation en culture pure ou en
association avec les légumineuses et ce, en fonction des zones de
cultures et de la disponibilité en eau .Les différents types
d'assolement et rotation possible sont :
Tableau 07 Type d'assolement et rotation pour le triticale (ITGC,
2006)
|
Pluviométrie de la zone
|
Type d'assolement
|
Rotation
|
|
Zones à plus de 500mm
|
Triennal
|
Légumineuse fourragère/blé/triticale
|
|
Légumineuse alimentaire/Blé/ triticale
|
|
Quadriennal
|
Jachère
travaillée/blé /triticale/bersim
|
|
Jachère
travaillée/légumineuse/triticale
|
|
Zones semi-arides
entre 350 et 500mm
|
Biennal
|
Jachère travaillée/triticale
|
|
Triennal
|
Jachère travaillée/céréale
secondaire/triticale
|
|
Jachère travaillée/blé ou
légumineuse/triticale
|
|
Zones arides
moins de 350 mm
|
Biennal
|
Jachère travaillée /triticale
|
II.3.1.2
Préparation du sol
A Labour
Il est recommandé de faire un labour juste
après la récolte du précédent cultural ou en
automne. Cette opération consistera à retourner la terre sur une
profondeur comprise entre 25 et 30 cm avec une charrue à disques ou
à socs.
En conditions sèches, sur des sols légers et peu
profonds, le chisel peut remplacer la charrue. (ANONYME ,2006)
B Reprise du
labour
Cette opération succède aux labours, pour
compléter la préparation du sol et diminuer la taille des mottes.
Les outils utilisés sont des pulvériseurs (cover- crop) et les
cultivateurs à dents. Ces derniers sont préconisés dans
des conditions sèches et sur des sols peu profonds afin de limiter
l'émiettement excessif du sol.
(ANONYME ,2006)
C Façons
superficielles
Réalisées juste avant le semis avec des herses
à cages roulantes ou à lames, elles permettent un affinement et
un nivellement adéquat du lit de semences
(ITGC, 2006)
D Fumure de
fond
Les doses d'engrais phosphatées et potassiques
recommandés pour le triticale sont les même que ceux pour le
blé, tout en tenant compte du niveau de richesse du sol en ces
éléments.
Il est recommandé d'apporter 92 unités/ha de
phosphore en zone à pluviométrie supérieure à 600
mm et 46 unités /ha en zone entre 400 et 500 mm.
Il faudra également songer à apporter aussi 50
unités /ha de potasse. (ANONYME, 2006)
II.3.1.3 Le semis
A La date de
semis
Généralement, elle s'étale de novembre
à décembre, en fonction de la variété et de la zone
de culture. Pour les variétés tardives, la période
conseillée est la mi novembre et pour les variétés
précoces, le début décembre. (BENBELKACEM, 1987).
Dans la plupart des cas, le semis précoce de novembre
est recommandé, pour avoir une bonne installation de la culture et un
fourrage précoce car le semis tardif entraîne une faiblesse de
peuplement.
(ANONYME, 2006)
B Densité de
semis
Le rendement en grain est pénalisé par un
peuplement élevé (au delà de 260 plants/m2).Il
faut donc éviter le semis trop dense qui affecte négativement les
composantes du rendement et favorise la verse, ainsi que le semis clair qui
expose la culture à la compétition des adventices au cours des
phases levée et tallage.
Pour produire du grain , la densité de semis optimale
est comprise entre 200 et 240 graines/m2, ce qui correspond
à une dose de semis de 120 et 150 kg/ha, en fonction du poids de mille
grains.
Pour produire la biomasse pour ensilage la densité des
semis est beaucoup plus élevée. Elle peut aller jusqu'à
260 graines /m2 (160 kg/ha)
L'écartement entre les lignes de semis est de 20
à 25 cm. (ANONYME, 2006)
C Mode de
semis
Le triticale est couramment semé à l'aide d'un
semoir en lignes (ANONYME, 2006).
D Profondeur de
semis
Le profondeur de semis du triticale est de 3 à 6 cm
selon l'état du sol au moment du semis (frais ou sec) et il est
recommandé de semer profond en conditions sèches. (ANONYME,
2006).
E
Variétés
En ,Algérie il est recommandé de cultiver les
variétés de type printemps, semés en hiver (novembre).Par
les variétés dont le Centre National de Certification des
Semences et des plants a déjà autorisé à la
production et à la commercialisation , on cite le
Clercal,Asseret,Fascal,Tritano,Janillo,IFTT314,Trick,Magistral ,Torpedo,
Doc 7 et Beagle. (ITGC, 2006)
F Roulage
Après le semis, il est important d'effectuer le roulage
pour assurer un bon contact entre la graine avec le sol.
Cependant, il est déconseillé d'effectuer un
roulage en conditions humides. (ANONYME, 2006)
II.3.1.4 Fertilisation
azotée
D'après MOULE (1980), le fait d'apporter le phosphore
et le potassium en fumure de fond évite à ces deux fertilisants
une action antagoniste sur l'efficacité de l'azote.
Compte tenu du précédent cultural, les doses de
fertilisants apportées à une culture de triticale restent
semblables à celles apportées à une culture de
blé
Pour l'azote, le triticale prélève du sol des
quantités plus élevées que pour les autres fertilisants,
il est nécessaire pour le développement de la plante et pour
améliorer les composantes du rendement. (ANONYME ,2004)
Egalement, les apports d'azote tiennent compte du climat car
et élément est facilement lessivable et c'est pour cette raison
que sous certaines conditions de pluviométrie, on conseille un apport
fractionné d'azote
Les doses d'engrais azotées conseillées
sont :
Tableau 08 La distribution des
doses d'azote pour le triticale
|
Zone
de culture
|
Pluviométrie
(mm)
|
Unités d'azote/ha
|
Type d'apport
|
|
Sub-humide
|
>450
|
66
|
Apport fractionné :
- 1/3 après la levée
- 2/3 du tallage à la montaison
|
|
Plaines intérieures
|
400-450
200-250
|
33
-
|
Apport non fractionné
Pas d'apport d'azote
|
|
Hauts plateaux
|
300-400
250-300
|
60
33
|
Apport non fractionné
Apport non fractionné
|
(ANONYME, 2006)
II.3.1.5 Désherbage
Pour produire du grain, le triticale est assez sensible
à la présence de mauvaises herbes malgré la hauteur de sa
paille et la rapidité de son développement.
Pour assurer son bon rendement en grains, il est indispensable
de lutter contre les adventices monocotylédones et dicotylédones
le plus tôt possible, par un bon travail du sol et l'application de
désherbants à application précoce.
En général, les herbicides utilisés
contre les adventices des autres céréales sont valables pour le
triticale. (ANONYME, 2006)
II.3.2 L'état
phytosanitaire
II.3.2.1 Les maladies et
les ravageurs
Compte tenu de sa double origine, le triticale devrait avoir
une gamme plus élevée de maladies qui s'attaquent à lui,
heureusement, la sélection a au cours du temps éliminé les
variétés les plus sensibles et les cultivars actuels sont connus
pour être des céréales rustiques, peu sensibles aux
maladies. (ITCF, 1985)
Les maladies préjudiciables sont presque les même
que pour le blé tendre et les plus courants sont :
Ø La rouille brune
« Puccinia recondita », c`est la maladie la plus
fréquente chez le triticale ; elle apparaît au niveau des
feuilles.
Ø La rouille noire
« Puccinia graminis », elle pose moins de
problèmes mais la mutation des champignons la rende plus en plus
agressive vis-à-vis du triticale
Ø L'ergot « Claviceps
purpurea », elle affecte gravement le triticale en
engendrant des intoxications pour les animaux et
l'homme
Ø Le triticale présente une bonne
résistance à la
septoriose « Septoria
tritici »,aux caries et aux
charbons et il tolère mieux que le blé
l'oïdium « Erysiphe
gramini ».
Ø Les triticales ont une faible résistance aux
fusarioses et helminthosporioses (Pittium
sativum).
Ø La jaunisse nanisante de l'orge
(BYDV : Barley yellow dwarf virus) inoculée par les pucerons
à l'automne
(ANONYME, 2006)
II.3.2.2 Contrôle
des maladies et des ravageurs
Les moyens de lutte sont beaucoup plus préventifs que
curatifs, ils consistent en :
ü La destruction des hôtes intermédiaires en
particulier les renonculacées et les graminées
spontanées ;
ü L'utilisation des semences saines et
traitées ;
ü Le respect de la rotation (éviter la
monoculture) ;
ü L'élimination des chaumes de récolte et
les débris des végétaux ;
ü Le bon travail du sol ;
ü L'utilisation des variétés
tolérantes ;
ü Traitement contre les pucerons dans les mêmes
conditions que sur le blé.
II.3.2.3 Les
accidents de la culture
A La verse
La verse est l'une des principaux accidents car il peut
occasionner des pertes allant jusqu'à 5 à 10% à l'hectare.
(ANONYME, 1994).
Ce phénomène peut être physiologique ou
parasitaire
v La verse
physiologique
La verse physiologique est due à plusieurs facteurs
-Une alimentation en azote excédentaire : dans
ce cas, la partie végétative est extrêmement important au
détriment des autres composantes du rendement.
-Une densité de semis trop importante
entraînant une compétition pour la lumière et pour finir
un étiolement de la plante
D'après LAROCHE et al (1994), une densité de
300 plantes/m2 favorise la verse
-Les conditions climatiques : orage ou vents violents
(SIMON et al, 1989)
v La verse
parasitaire
La verse parasitaire est causée par des champignons de
type piétin verse, qui sont responsables d'une mauvaise alimentation de
la plante et de la fragilité de la tige.
B
L'échaudage
Ce phénomène est très fréquent
chez le triticale. Un coup de chaleur ou une attaque parasitaire peut
arrêter la migration des réserves vers le grain et donner à
ce dernier un aspect échaudé que l'on observe sur les
triticales.
Mise à part l'effet de l'environnement de culture sur
le déclenchement de ce phénomène, il apparaît aussi
que c'est une caractéristique génétique des triticales
d'être sensible à l'échaudage surtout à cause de la
présence des chromosomes des deux parents qui sont très
différent (ANONYME (2008) ; BENBELKACEM, (1991))
II.3.3 La
récolte
Le triticale est récolté en grain,
pâturé en vert, ensilé ou récolté en foin.
Pour la récolte en grain, il faut veiller au bon
réglage de la moissonneuse - batteuse, car le grain du triticale est
plus sensible à la casse que celui du blé. Il faut
récolter lorsque l'humidité du grain est de 12 %.
En tant que fourrage, le triticale est exploité au
stade tallage pour le pâturage, et au stade épiaison pour
l'ensilage.
(ANONYME,
2006)
Chapitre III : Les
techniques de l'amélioration
III.1
Introduction
L'objectif prioritaire dans un programme
d'amélioration variétale est la maximisation de la
productivité. Mais également on vise l'obtention d'un cycle
précoce ou tardif, la résistance à la verse, à la
sécheresse, aux maladies, l'adaptation aux conditions
pédoclimatiques ainsi qu'une bonne valeur technologique ou
alimentaire.
En amélioration des plantes, ces toutes ces
caractères qu'on cherche à améliorer que l'on va appeler
la variabilité.
III.2 Origine de la
variabilité
L'obtention de la variabilité dans
l'amélioration variétale consiste à rechercher un gain
génétique ; pour y arriver, trois sources de
variabilité sont utilisées
III.2.1 Variabilité
préexistante au niveau des populations
Cette variation génétique apparaît par la
suite de recombinaisons au niveau de la descendance, la recombinaison constitue
la principale source de variation génétique chez les
espèces, même si les facteurs crées dans ce cas sont le
résultat de la combinaison de caractères déjà
existants.(DEMARLEY, 1977)
III.2.2 Les mutations
naturelles
La mutation est un évènement
génétique qui induit un changement au niveau de l'information
transmise par les gènes. (ANONYME, 2007).
La mutation constitue ce qui est véritablement
nouveau en terme de variabilité même si son importance est minime
dans l'évolution des populations comparées aux recombinaisons.
Il y a lieu de distinguer trois types de mutations qui sont
à l'origine de la variabilité génétique :
A. La mutation
génique : On parle de mutation génique lorsqu'un gène
quelconque se transforme en gène allèle ayant une structure et
une fonction modifiée. La plupart des mutations ont un effet
néfaste et on tendance à être éliminé par la
sélection naturelle, mais ceux qui sont avantageux se conservent et
auront tendance à se reproduire dans la population d'après la
théorie de la sélection néo darwinienne. (ANONYME,
2007)
B. La mutation
chromosomique : Ce sont des modifications plus importantes puisqu'ils
affectent une portion plus ou moins grande d'un chromosome. On parle de
mutation de segments de chromosomes et elle peut même affecter le
chromosome entier.
Ce type de mutation peut concerner le chromosome de 2
façons :
La mutation affectant la structure du
chromosome : perte de matériel
génétique, réarrangement des gènes
entraînant des modifications dans les fonctions physiologiques
(délétion, addition, translocation)
La mutation affectant l'effectif
chromosomique : on parle dans ce cas d'aneuploïdie. Selon, les
variantes de cette aneuploïdie, il y a lieu de distinguer :
La nullisomie : Au cas des chromosomes
entiers sont perdus
La polysomie : Addition de un ou plusieurs
chromosomes dans la cellule.
C. La mutation
génomique
C'et la variation du degré de ploïdie ou stock
chromosomique. Ces mutations sont intéressantes sur le plan agronomique
et entraînent également des variations au niveau du dosage des
chromosomes et ce qui fait que le fonctionnement physiologique des individus
est changé. (ANONYME, 2007)
II.2.3 Création d'une
variabilité nouvelle
La variabilité génétique existante chez
une espèce peut être parfois insuffisante pour les objectifs
d'amélioration. Pour pouvoir obtenir des variétés plus
conformes aux besoins d'utilisation, on est amené à effectuer
des combinaisons d'un certain nombre de caractères dispersés chez
plusieurs variétés afin de les réunir au sein d'une seule
qui deviendra la variété nouvelle améliorée.
(ANONYME, 2007)
Les voies de la réaction d'une nouvelle
variabilité sont nombreuses :
1 La
mutagenèse
C'est la mutation provoquée. Selon DEMARLY (1977), le
perturbations induites dans le code génétique utilisent des
agents divers : les rayonnements physiques (X, issus de Cobalt 60, les
U.V), des substances chimiques divers (dont la plus utilisées est le
Méthane Sulfonate d'Ethyle (M S E)
Cette technique qui s'applique généralement sur
des structures comportant peu de cellule (pollen, zygote, cellules,..)
présente l'inconvénient de ne pas être spécifique
quant au criblage des mutants du fait qu'il touche aléatoirement la
structure traitée. (DEMARLY, 1977)
2 Polyploïdisation
ou changement de dosage chromosomique
On peut également opérer un
rééquilibrage des interactions alléliques en modifiant
les nombres chromosomiques. L'opération qui consiste à doubler le
stock chromosomique de départ et réalisée à l'aide
d'un alcaloïde, le colchicine est devenu aujourd'hui une
opération classique. (DEMARLY, 1977).
C'est une méthode incontournable dans
l'amélioration des espèces autogames car il permet de limiter le
temps de la sélection par l'haplodiploïsation des individus de la
F2.
3 Recombinaison
après hybridation intraspécifique
Selon DEMARLY (1989), les génotypes sont croisés
à l'intérieur d'une même espèce avec une ou
plusieurs partenaires qui apportent des qualités complémentaires
ou qui intensifient par l'effet cumulatif les performances.
4 Hybridation
interspécifique et amphiploïdisation
Selon DEMARLY (1977), l'hybridation interspécifique
réalisée par l'échange du matériel
génétique entre espèces, permet la réunion de
caractères se trouvant au niveau des espèces différentes
au sein d'une nouvelle espèce mais peut poser des problèmes
comme la réalisation d'un zygote fertile, et surtout la fertilité
de l'hybride.
Pour résoudre ce problème, on fait recours
à l'amphiploïdisation qui est le dédoublement du stock
chromosomique obtenu à l'aide de la colchicine, permettant ainsi
l'appariement de chaque génome à son double. (RILEY, 1962)
C'est par cette méthode que furent effectivement
créées les lignées actuelles de triticales par le
schéma suivant :
T aestivum x S cereale
ou T durum x S cereale
2n=42 2n=14
2n=28 2n=14
Hybride stérile + dédoublement
Hybride stérile + dédoublement
2=28
2n=21
Triticale
Triticale
2n=56
2n=42
Schéma simple de l'hybridation blé x
seigle.
5. Manipulations
génétiques
C'est l'ensemble des techniques basées sur les cultures
de tissus et de cellules et qui font intervenir les données de la
génétique moléculaire, biochimie etc.,...
Beaucoup de ces méthodes cherchent à faciliter
les croisements éloignés et augmenter les possibilités de
transfert du matériel génétique.
On peut citer :
+ La fusion des protoplastes : un
courant de faible intensité est passé dans une solution de
protoplastes ou cellules dépourvues de parois, l'agitation qui en
résulte permet la fusion aléatoire des cytoplasmes de ces
cellules
+ Culture d'embryons immatures : la
plupart des croisements interspécifiques est réussie mais les
embryons qui en résultent avortent. Pour remédier à
ça, les embryons immatures sont conduits par les techniques de culture
in vitro.
+La transgènese : Les techniques
relevant de la génie génétique permettent d'extraire et
d'insérer directement la séquence génétique porteur
de la variabilité d'un individu donneur à l'individu receveur qui
devient plante génétiquement modifiée ou PGM.
Les principales techniques les plus utilisées
sont :
*Les techniques biologiques :
elles utilisent des organismes vivants comme vecteur de transfert dont les
plasmides bactériens (Tumor inducing ou Ti d'A .Tumefaciens et
Root induicing ou Ri de A. rhizogenes) ainsi que des virus
désarmé.
* les techniques non
biologiques : font recours à des techniques chimiques
comme la Polyéthylène Glycole (PEG) ou
physiques comme l'électroporation pour créer
sur la parois des cellules des millipores par lesquelles va
pénétrer la séquence à transférer ou
insert.
* Biolistique et Macro
injection : Ce sont des techniques qui consistent à lancer
à l'aide de billes microscopiques les séquences de l'insert
directement au niveau de la cellule à transformer.
III.2 Les
méthodes de sélection
III.2.1 La
sélection massale
C'est la plus simple et peu coûteuse. D'après
XAVIER et al, (1989), on choisit dans une population de départ un
certains nombres de sujets à base de leurs critères
phénotypiques, on mélange leurs graines pour les semer la
campagne suivante.
Les limites de cette sélection restent que les
individus choisis sur la base de leur phénotype peuvent n'apporter
aucun gain génétique suite à la non
héritabilité du caractère (DEMARLY, 1977)
III.2.2 La
sélection généalogique
Dans celle-ci, on choisit les individus avec étude
préalable de leurs descendants. On peut choisir directement de la
population des individus têtes de lignées ou commencer la
sélection après une hybridation des lignées
présentant les caractères recherchés.
Cette méthode permet la création de 90% des
variétés de céréales à paille inscrites au
niveau des catalogues nationaux des variétés des pays producteurs
(BONJEAN et PICARD, 1990)
III.2.3 La
sélection par la méthode BULK
Après une série d'hybridations, les plantes sont
cultivées en mélange ; à la récolte, on
choisit un échantillon qui va constituer la génération
suivante (HERVE et al, 1989)
Cette méthode permet de conserver une grande
variabilité tout en augmentant le taux d'homozygotie.
III.2.4 La
sélection par la méthode SSD (single seed descendent)
Selon DEMARLY (1977), cette méthode s'apparente au
BULK sauf qu'après l'hybridation et l'autofécondation, une seule
graine est prélevée sur chaque individu pour être suivi sur
sa descendance. Elle est rapide mais entraîne la perte de la
variabilité
III.2.5 La
sélection assistée par des marqueurs moléculaires
(SAMM)
Ici, le caractère à sélectionner est
localisé au niveau du génome grâce à des marqueurs
moléculaires qui sont des séquences génomiques codant
pour le caractère spécifique selon l'intérêt
agronomique. Ils permettent de gagner du temps et introduisent la
stabilité du caractère. (ANONYME, 2008)
La détection de ces marqueurs moléculaires se
fait à l'aide des techniques de manipulation de l'ADN notamment le
profil de restriction , hybridation des acides nucléiques et
l'amplification des séquences génomiques .
III.2.6
L'haplodiploïdisation
Dans le but de réduire le temps de sélection,
les individus en autofécondation sont traités avec de la
colchicine pour pouvoir obtenir de nouvelles lignées à stock
chromosomique doublé sans devoir accomplir une sélection sur
plusieurs générations qui est longue et fastidieuse .(ANONYME,
2008)
Experimentation
Chapitre I Matériel et
méthodes
I.1 But de l'essai
L'expérimentation concernée par cette
étude vise à étudier le comportement de 13 nouvelles
variétés de triticales avec 2 témoins ; leur
adaptation dans des conditions subhumides au niveau de la station
expérimentale de l'ITGC d' Oued Smar à El Harrach.
On essaiera de comparer les principales performances
agronomiques par rapport à deux témoins et d' établir une
sélection des variétés les plus performantes pouvant
intéresser les utilisateurs.
I.2 Milieu d'expérimentation
L'essai se déroule au niveau de la station des grandes
cultures de l'ITGC à Oued Smar durant la campagne 2007/2008.
I.2.1 Localisation de la station
La station se trouve à Oued Smar dans la partie Nord
Est de la Mitidja à une altitude de 24 m, latitude 36°43' Nord,
longitude 30°84' Est.
I.2.2 Le climat de la station
La station est située au niveau de l'étage
bioclimatique subhumide à hiver doux et pluvieux, à
l'été chaud et sec.
I.2.2.1 La pluviométrie
La pluviométrie moyenne de longue durée est
autour de 709.7 mm par an
(ITGC, 2008).
Pour la campagne 2007/2008 les données
pluviométriques sont consignées dans le tableau suivant
Tableau 09 Pluviométrie de la campagne 2007/2008
|
Décades
|
Sept
|
Oct.
|
Nov.
|
Dec
|
Jan
|
Fev
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
|
1
|
08
|
00
|
73.6
|
00
|
17
|
00
|
17.5
|
22
|
15.8
|
4
|
|
2
|
00
|
17
|
20
|
34
|
05.1
|
06
|
4.5
|
00
|
27
|
|
|
3
|
26
|
86.5
|
187
|
55.5
|
00
|
16
|
44
|
00
|
33.3
|
|
|
Jrs de pluie
|
03
|
07
|
12
|
10
|
05
|
04
|
07
|
02
|
11
|
2
|
|
Total
|
34
|
103.5
|
280.6
|
89.5
|
22.1
|
22
|
66
|
22
|
76.1
|
4
|
.................................................. 719.8 mm
.........................................................
(Source ITGC, 2008)
Durant la campagne 2007/2008, la pluviométrie totale
du mois de septembre jusqu'à juin a atteint 719.8 mm .Alors que la
moyenne enregistrée sur la longue durée n'est que 709.7 mm ce qui
donne donc un excédent par rapport à la moyenne.
Cependant la répartition irrégulière
durant la campagne fait que la quantité disponible soit insuffisante
à certains stades de développement du végétal.
Ainsi les faibles précipitations enregistrées
pendant le mois d'Avril peuvent avoir un effet néfaste sur le
remplissage des grains.
I.2.2.2 Les températures
Les températures relevées sur la période
de septembre à mai pendant la campagne 2007/2008 sont inscrites dans le
tableau suivant.
Tableau 10 La températures maximales et minimales en
°C enregistrées pendant la campagne 2007/2008 comparées
à celles de la période 1975/84
|
Mois
T (°C)
|
Sep.
|
Oct.
|
Nov.
|
Déc.
|
Jan.
|
Fev.
|
Mar.
|
Avr.
|
Mai
|
|
T min
2007/2008
|
19,0
|
15,2
|
8,5
|
6,8
|
6,4
|
7,9
|
8,6
|
10,8
|
19,2
|
|
T max
2007/2008
|
28,9
|
25,8
|
17,5
|
16,2
|
17,8
|
18,3
|
19,1
|
21,6
|
22,2
|
|
T moy
2007/2008
|
23,9
|
20,5
|
13,2
|
11,5
|
12,1
|
13,1
|
14,8
|
16,2
|
17,6
|
|
T min
1975/1984
|
16,8
|
17.4
|
09,2
|
07,2
|
05,4
|
06,4
|
12,8
|
08,7
|
11,4
|
|
T max
1975/1984
|
28,8
|
24,8
|
20,3
|
17,6
|
16,5
|
17,1
|
20,3
|
20
|
22,6
|
|
T moy
1975/1984
|
22,8
|
18,9
|
14,7
|
12,4
|
10,9
|
12,6
|
16,5
|
14,3
|
17
|
(Source INA, 2008)
Les températures observées pendant la campagne
2007/2008 sont similaires aux températures moyennes de la
décennie 1974/85.
Seules quelques différences très marginales
peuvent être soulignées notamment au niveau du mois de mai
pendant lequel les températures minima sont sensiblement
supérieures à celles enregistrées sur la décennie
1974/1985 avec 19,2°C contre 11,4° C pour la décennie .
Le digramme ombrothermique de la station est porté
sur la page suivante.

Figure 02 Diagramme ombrothermique
I.2.2.3 Caractéristiques générales du
sol
Les données sur les caractéristiques du sol ont
été communiquées par l'équipe de l'ITGC et
concernent la texture de ce dernier, la topographie, la profondeur ainsi que
l'exposition du terrain.
I.3 Protocole expérimental
I.3.1 Matériel végétal
L'essai porte sur l'étude du comportement de 15
variétés de triticale au niveau d'un essai de première
année pendant la campagne agricole 2007/2008.Parmi les 15
variétés , deux jouent le rôle de témoins et sont
donc déjà inscrites au niveau du catalogue national des
céréales cultivées .
I.3.2 Dispositif expérimental
Nous avons adopté le dispositif expérimental en
bloc aléatoire complet avec 4 répétitions.
Chacun des quatre blocs comprend 15 parcelles
élémentaires, dont chacune correspond à une
variété et a pour dimensions 5 m de longueur sur 1,2 m de largeur
donc une superficie de 6 m2.
A cet effet, nous disposons de :
· Nombre de parcelles élémentaires :
60
· Nombre de niveaux : 15
· Nombre de répétitions : 4
· Nombre de facteurs : 1
« variété »
Le nombre de lignes par parcelle est de 6 espacées de
0,02 m
1.2 m
5 m
V2
V1
V 5
V 11
V8
V8
V 2
V10
1 m
V7
V2
V3
V3
V15
V13
V14
V12
V9
V9
V8
V11
V4
V6
V4
V5
V1
V4
V5
V7
V13
V14
V12
V15
V6
V11
V6
V7
V1
V10
V1
V3
V7
V9
V5
V2
V15
V12
V13
V14
V10
V4
V3
V8
V6
V11
V10
V9
V14
V13
V12
V15
Bloc 1 Bloc 2
Bloc 3 Bloc 4
Figure
n° 03 Schéma du dispositif
expérimental
I.3.3 Conduite de l'essai
I.3.3.1 Précédent cultural
Le précédent cultural est une
céréale dont la récolte a été
effectuée au mois de juin de 2007.En effet, le triticale s'insère
facilement dans une rotation après le blé dans une culture pure
ou en association avec des légumineuses à condition d'avoir une
bonne disponibilité de l'eau.
I.3.3.2 Préparation du sol
Les diverses opérations de préparation du sol
qui ont été réalisées durant la campagne sont les
suivantes :
Labour avec une charrue bisoc réversible en novembre
2007, la profondeur du labour est de 30 cm et le sol était dans de
bonnes conditions.
Les façons superficielles après le labour ont
été réalisées en date du 20 janvier 2008
avec le chisel.
Enfin, le passage du rouleau après le semis a
été effectué par l'utilisation du rouleau crosskill.
I.3.3.3 Fumure de fond
Elle a consisté en un apport d'engrais
phosphatés à raison de 2 quintaux à l'hectare au mois de
novembre 2007.
Il n'y a pas eu apport d'engrais potassiques car ils ont une
mauvaise influence sur le développement de la plante.
I.3.3.4 Le semis
Le semis a été réalisé en date du
30 janvier 2008, c'est donc un semis tardif.
Ce a été réalisé avec un semoir
expérimental. L'écartement entre les lignes de semis est de 0,20
cm et entre les blocs est de 1 m.
On a utilisé des variétés en provenance
de la France dont la faculté germinative est estimée à 90
%.
I.3.3.5 Fertilisation azotée
Il y a eu apport d'une fumure azotée à raison
de 2 quintaux à l'hectare en date du
28 février 2008.
I.3.3.6 Désherbage
Il n'y a pas eu de désherbage chimique. En effet, les
variétés mises en culture ne peuvent pas démontrer leurs
potentialités d'adaptation que si on les laisse en compétition
avec leurs mauvaises herbes.
I.3.4 L'état phytosanitaire
I.3.4.1 Les adventices
Pendant la pleine végétation, il n'y
pratiquement pas de mauvaises herbes à l'exception faite de quelques
pieds d'orge dans certaines parcelles qui peuvent entraîner un
mélange spécifique préjudiciable sur la pureté de
la récolte.
I.3.4.2 Ravageurs animaux
Les pertes causées par les moineaux après le
semis ont été très légères. De même,
l'attaque juste avant la récolte surtout pour les variétés
à pailles plus hautes et celles des bordures qui sont plus
exposées a été moindre.
I.3.4.3 Les maladies
Les maladies observées au niveau des parcelles sont
surtout des maladies cryptogamiques dont la rouille brune et
l'helminthosporiose ou tan spot.
Le degré d'infestation est estimé sur une
échelle de 0 à 9 établie par l'ITGC :
1 à 2 : Très résistantes
3 à 4 : Résistantes
5 à 6 : Tolérantes
7 à 8 : Sensibles
9 : Très sensibles
Le tableau suivant résume les observations
relevées au niveau des parcelles
Tableau 11 Notation des différentes maladies
observées selon l'échelle de l'ITGC
|
Variétés
Maladies
|
V1
|
V2
|
V3
|
V4
|
V5
|
V6
|
V7
|
V8
|
V9
|
V10
|
V11
|
V12
|
V13
|
V14
|
V15
|
|
|
Rouille brune
|
|
|
|
|
|
traces
|
traces
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Tan spot
|
|
|
|
|
|
2
|
1
|
|
|
|
1
|
2
|
|
1
|
1
|
|
Septoriose
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charbons
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Piétin verse
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oïdium
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.3.5 La récolte
La récolte a été réalisée
en date du 16/06/2008 à l'aide d'une moissonneuse batteuse
expérimentale de longueur de barre de coupe de 1,20 m ; la
récolte est réalisée à maturité
complète du céréale car on obtient une casse plus facile
de la tige et un détachement des grains par frottement. La teneur en
eau des grains ne doit pas être trop basse (<14 %) pour éviter
la brisure.
I.4 Les méthodes d'étude :
I.4.1 La détermination des différents stades
phénologiques
Les dates des différentes stades de
développement (levée, montaison, floraison,...) ont
été notées lorsque 50% du peuplement ont atteint ce stade
phénologique.
I.4.2 Les paramètres biométriques
I.4.2.1 Nombre de plants par mètre carré
A l'aide d'un mètre carré posé en
diagonale au niveau de chaque parcelle, on détermine la densité
du peuplement par dénombrement des plants contenus dans le mètre
carré.
I.4.2.2 Le nombre de talles par plant
On prend au hasard 10 plants au niveau de la parcelle et on
compte le nombre de talles par plant.
I.4.2.3 Hauteur des plants à la floraison
La hauteur des plants est mesurée sur 10 plants pris
au hasard au niveau de chaque parcelle élémentaire au stade
maturité.Les mesures sont réalisées à l'aide d'une
règle graduée de la base de la tige jusqu'au premier
épillet.
I.4.2.4 Longueur de l'épi
La longueur de l'épi a été
réalisée sur 10 plants pris au hasard au niveau de chaque
parcelle élémentaire. Les mesures partent de la base de
l'épi jusqu'au dernier épillet (barbes non incuses).
I.4.3 Les composantes du rendement
I.4.3.1 Le nombre d'épis au mètre
carré
A l'aide d'un cadre d'un mètre carré
placé en diagonale au niveau de la parcelle, on fait le
dénombrement du nombre d'épis au mètre carré.
I.4.3.2 Le nombre d'épillets total par épi
Le dénombrement des épillets par épi se
fait sur 10 épis pris au hasard au niveau de chaque parcelle
élémentaire.
I.4.3.3 Nombre d'épillets fertiles et
d'épillets stériles par épis
Sur les mêmes épis utilisés
précédemment, on relève les épillets ne contenant
pas de grains (stériles) et de la ceux qui sont fertiles (contenant des
grains).
I.4.3.4 Nombre de grains par épi
Chaque épi précédemment utilisé
est décortiqué à part, le nombre de grains qu'il contient
est alors compté à la main.
I.4.3.5 Le poids de milles grains
On prélève pour chaque parcelle un
échantillon après la récolte.On compte milles grains
après triage à l'aide d'un compteur automatique et ils sont
pesés à l'aide d'une balance de précision.
I.4.3.6 Le rendement en grains
I.4.3.6.1 Le rendement théorique
Il est calculé par la formule : nombre
d'épi/m2×nombre de grains par épi×poids de
milles grains×104 quintaux /ha
I.4.3.6.2 Le rendement réel
Après la récolte, les grains contenus dans les
sachets ont étés triés, nettoyés puis
pesés ; on a ainsi obtenu la quantité récoltée
en kg par parcelle qui va être convertie en quintaux à
l'hectare.
I.5 Méthodes d'analyse des résultats
L'interprétation des résultats est
effectuée par le biais de l'analyse de la variance qui est une
méthode statistique
Analyse de la variance
Dans cette analyse, il revient à déterminer si
les effets des traitements sont identiques ou non. En terme statistique, c'est
déterminer si l'effet d'un traitement est significatif ou non tout en
admettant un certain seuil d'erreur. (VILIAN, 1999)
Pour réaliser le test, on étudie le rapport
variance de traitement et variance résiduelle, ce rapport donne
(F) observé qui sera comparé au
(F) théorique donné par la table de
SN EDECCOR.
La signification des résultats exprimés en
fonction de la probabilité pour l'erreur réellement commise
si :
· P<0.001, la différence entre les traitements
est très hautement significative (THS).
· 0.001<P<0.01, la différence entre les
traitement et hautement significative (HS)
· 0.01<P<0.05, la différence entre les
traitements est significative(S).
· P>0.05, la différence entre les traitements
est non significative (NS).
Comme dans les autres sciences biologiques, nous avons
utilisé pour notre étude la probabilité d'erreur 5%.
Une fois que les différences significatives ont
été mises en évidence, on procède à la
constitution des groupes de traitements homogènes grâce au test
de NEWMAN KEULS. Ce dernier classe les
groupes de traitements homogènes en se basant sur les plus petites
amplitudes significatives (ppas).
Lorsque l'amplitude observée entre les moyennes
extrêmes d'un groupe de (K) moyennes est inférieure
à la ppas, alors on en déduit que les (K)
moyennes constituent des groupes homogènes.
Dans notre étude, nous avons fait recours au logiciel
statistique STATITCF.
Chapitre II résultats et discussions
II .1 Caractéristiques du sol
II.1.1 Propriétés physiques
La granulométrie du sol est résumée dans
le tableau suivant :
Tableau 12 Tableau granulométrique
|
Profondeur
|
|
Fraction
granulométrie
|
0 à 20 cm
|
20 à 40 cm
|
|
Argile %
|
46,85
|
48,14
|
|
Limon %
|
30,53
|
28,91
|
|
Sable %
|
17,30
|
17,05
|
(Source ALIA Y, 2004)
Le triangle des classes textuelles de HENIN (1969), montre que
le sol est de texture argilo limoneuse, ce qui lui permet une bonne
rétention de l'eau dans la période de déficit hydrique.
En plus, le terrain possède une topographie plate, une
bonne exposition et la profondeur du sol est généralement de
l'ordre de 30 cm (ITGC, 2008)
II.1.2 Propriétés chimiques
La composition chimique du sol est reproduite dans le tableau
suivant :
Tableau 13 Analyse chimique du sol
|
Profondeur
|
PH
|
CE
|
CaCO3
|
C%
|
MO%
|
P2O5
Méq
|
K2O
PPM
|
N%
|
C/N
|
|
0 - 20 cm
|
7,50
|
0.65
|
00
|
0.80
|
0.52
|
188
|
183
|
0.35
|
2.28
|
|
20 - 40 cm
|
7.90
|
0.65
|
00
|
0.10
|
0.20
|
159
|
172
|
0.70
|
0.04
|
(Source ALIA Y.,
2004)
D'après ce tableau
· Le sol est légèrement basique.
· La conductibilité électrique montre
qu'il n'est pas salin.
· Le taux de calcaire est nul.
· Le pourcentage de matière organique est
faible.
· Le sol présente des carences en
éléments minéraux
P2O5 et
K20, il faudra donc songer à un apport
d'engrais phosphatés et potassiques.
· La teneur en azote est élevée mais
celui-ci varie d'année en année selon les
précédents culturaux ; elle est élevée
après une légumineuse.
Selon SOLTNER (1988), un sol est riche en azote dès
que sa teneur atteint 0.05%.
· Le rapport C/N est faible du fait du faible taux de MO
et de sa faible décomposition.
II.2 La faculté germinative de la semence
Les variétés utilisées pour l'essai
avaient toute une faculté germinative de l'ordre de 90%.
Cette faculté est conforme à la
législation nationale qui fixe le seuil minimum de la faculté
germinative des semences à 85 %.
II.3 Etude morphologique de la plante
II.3.1 Les stades phénologiques des plantes
Les dates où on a observé les différents
stades phrénologiques des plantes sont reproduites dans le tableau
suivant.
Tableau 14 Dates des stades
phénologiques
|
Variétés
|
Semis
|
Levée
|
Epiaison
|
Floraison
|
Maturité
|
Récolte
|
Durée du
Cycle en jours
|
Précocité
en jours
|
|
V1
|
30.01.08
|
12.02.08
|
18.04.08
|
28.04.08
|
5.06.08
|
16.06.08
|
127
|
79
|
|
V2
|
30.01.08
|
12.02.08
|
20.04.08
|
1.05.08
|
3.06.08
|
16.06.08
|
125
|
81
|
|
V3
|
30.01.08
|
12.02.08
|
22.04.08
|
03.05.08
|
6.06.08
|
16.06.08
|
128
|
83
|
|
V4
|
30.01.08
|
12.02.08
|
23.04.08
|
02.05.08
|
5.06.08
|
16.06.08
|
127
|
84
|
|
V5
|
30.01.08
|
12.02.08
|
19.04.08
|
30.04.08
|
8.06.08
|
16.06.08
|
130
|
80
|
|
V6
|
30.01.08
|
12.02.08
|
25.04.08
|
07.05.08
|
5.06.08
|
16.06.08
|
127
|
86
|
|
V7
|
30.01.08
|
12.02.08
|
27.04.08
|
08.05.08
|
4.06.08
|
16.06.08
|
126
|
88
|
|
V8
|
30.01.08
|
12.02.08
|
24.04.08
|
04.05.08
|
3.06.08
|
16.06.08
|
125
|
85
|
|
V9
|
30.01.08
|
12.02.08
|
24.04.08
|
06.05.08
|
5.06.08
|
16.06.08
|
127
|
85
|
|
V10
|
30.01.08
|
12.02.08
|
18.04.08
|
30.04.08
|
1.06.08
|
16.06.08
|
123
|
79
|
|
V11
|
30.01.08
|
12.02.08
|
20.04.08
|
29.04.08
|
6.06.08
|
16.06.08
|
128
|
81
|
|
V12
|
30.01.08
|
12.02.08
|
17.04.08
|
20.04.08
|
8.06.08
|
16.06.08
|
130
|
78
|
|
V13
|
30.01.08
|
12.02.08
|
18.04.08
|
2.05.08
|
2.06.08
|
16.06.08
|
124
|
79
|
|
V14
|
30.01.08
|
12.02.08
|
24.04.08
|
06.05.08
|
4.06.08
|
16.06.08
|
126
|
85
|
|
V15
|
30.01.08
|
12.02.08
|
18.04.08
|
03.05.08
|
8.06.08
|
16.06.08
|
130
|
79
|
Les données du tableau 14 permettent d'affirmer que la
totalité des variétés sont précoces.
En effet en considérant la durée entre les
stades semis et épiaison ; on dira qu'une variété
est :
· Précoce si cette durée est
inférieure à 100 jours
· Semi précoce si elle est comprise entre 100 et
120 jours
· Tardive si cette durée est supérieure
à 120 jours.
Parmi les 15 variétés, il y en a qui sont plus
précoce que les autres avec une durée de la période semis
épiaison de 79 jours.Il s'agit de la V1, V10, V13 et V15.
Rappelons que la précocité est une
qualité très appréciée pour lutter contre les
aléas climatiques notamment le stress hydrique qui cause
l'échaudage. Il est donc conseillé de tenir compte dans le cadre
d'un programme de sélection de la précocité des
variétés pour éviter l'échaudage et les attaques
par les déprédateurs animaux qui diminuent les rendements des
variétés tardives
II.3.2 Nombre de plants au mètre carré
II.3.2.1 Les résultats
Les résultats concernant le nombre de plants
levés au mètre sont résumés dans le tableau
suivant puis illustrés par la figure n° 04
Tableau n°15 Nombre de plants levés
au mètre carré
0.0593 13,1%
NS

Nombre de plants au m2
Variétés

Figure
n° 04 Nombre de plants levés au m2
II.3.2.2 Discussion des résultats
L'analyse de la variance effectuée à l'aide des
résultats montre que la différence est non significative.
Les inégalités ne sont pas dues à l'effet
des traitements mais à une cause marginale
Indépendante des variétés.
II.3.3 Le nombre de talles par plant
II.3.3.1 Résultats
Le nombre de talles observées sur les plants des
différentes variétés est inscrit dans le tableau n°
16 et interprété par la figure n° 05
Tableau n° 16 Le
nombre de talles par plant
0,0047 16,8%
HS

Variétés
Nombre de talles

Figure n° 05 Le
nombre de talles par plant
II.3.3.2 Discussion des résultats
L'analyse de la variance a montré une différence
hautement significative.
Le test de NEWMAN KEULS donne trois groupes homogènes
avec un nombre de talles maximum de 4,42 atteint par la variété
V5 alors que le minimum qui est de 2,64 talles se retrouve chez la V14.
Le nombre de talles par plant est un critère important
de l'augmentation du rendement à l'unité de surface et il est
influencé par les conditions du milieu.
Ce caractère est également lié aux
caractéristiques variétales, la date de semis, la densité
de peuplement et la disponibilité de la fumure azotée (BELAID,
1986).
II.3.4 Hauteur des plants à la floraison (en
cm)
II.3.4.1 Résultats
Les résultats observés concernant la hauteur des
plants à la floraison sont reproduit dans le tableau n° 17 et
interprété par la figure n°06
Tableau n° 17 Hauteur des plants à la
floraison en cm
0.000 3.6%
THS

Variétés
Hauteur des plants en cm

Figure
n°06 La taille des plants à la floraison en cm
II.3.4.2 Discussion des résultats
L'analyse statistique de la variance montre une
différence très hautement significative.
Le test de NEWMAN KEULS donne quatre homogènes, la
variété la plus haute étant la V10 (114 cm) tandis que la
plus courte est la V5 avec 89,73 cm.
La hauteur de la plante est un caractère
variétal ; en effet après l'hybridation
blé x seigle, le caractère paille haute du
seigle est dominant.
Les avantages que procure une paille haute sont entre autre
la résistance à la sécheresse grâce aux
quantités d'assimilats stockés au niveau de la tige. Cependant,
une telle paille est sujette à la verse mécanique.
Enfin, les agriculteurs ont une préférence pour
les variétés à paille haute afin de pouvoir utiliser la
paille en tant que fourrage du bétail.
II.3.5 La longueur de l'épi
II.3.5.1 Les résultats
Les résultats des mesures prises pour estimer la
longueur des épis sont reproduit dans le tableau n°18 est
analysés par le biais du graphe de la figure n° 07.
Tableau n°18 La
longueur de l'épi (en cm)
0.000 4.4%
THS

Longueur de l'épi (cm)
Variétés

Figure
n° 07 La longueur de l'épi
II.3.5.2 Discussion des résultats
L'analyse de la variance a permis de montrer une
différence très hautement significative.
Le test de NEWMNA KEULS a constitué huit groupes
homogènes. Les épis les plus longs se rencontrent chez les
variétés V2, V12, v13, V14, V9 et V10 qui totalisent une longueur
de plus de 12 cm tandis que la longueur la plus petite est celle de la
variété V1 avec 9,6 cm.
II.4 L'étude des composantes du rendement
II.4.1 Nombre d'épis par mètre
carré
II.4.1.1 Résultats
Les résultats relatifs au nombre d'épis au
mètre carré sont compris dans le tableau n°18 et analyse
à l'aide du graphe de la figure n°08
Tableau n°19 Nombre d'épis au
mètre carré
0,000 8,7%
THS

Variétés
Nombre d'épis au m2

Figure
n°08 Le nombre d'épis au mètre
carré
II.4.1.2 Discussion des résultats
L'analyse de la variance montre une différence
très hautement significative.
Le test de NEWMAN KEULS permet de constituer 8 groupes
homogènes.
Le nombre d'épis au m2 le plus
élevé a été constaté chez la
variété V14 avec 283 épis au m2 tandis que la
plus petite valeur est celle de la variété V10 avec 197,5
épis au m2.
II.4.2 Le nombre d'épillets total par épi
II.4.2.1 Les résultats
Les résultats portant sur le nombre total
d'épillets par épis sont transcrit dans le tableau n° 20 et
interprétés par le graphique de la figure n°09.
Tableau n°20 Nombre
total d'épillets par épi
0,0000 2,9%
THS

Variétés
Nombre d'épillets par épi
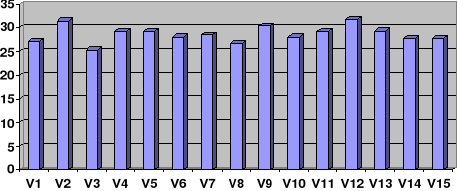
Figure
n°09 Le nombre total d'épillets par épi
II.4.2.2 Discussion des résultats
L'analyse de la variance donne un effet variétal
très hautement significatif.
Le test de NEWMAN KEULS permet de constituer six groupes
homogènes.
Le nombre d'épillets le plus élevé
revenant aux variétés V12 et V2 avec respectivement 31,70 et
31,35 épillets par épi tandis que le nombre d'épillets le
plus bas est celui de la variété V3 avec 25,40 épillets
par épi.
II.4.3 Nombre d'épillets fertiles par épi
II.4.3.1 Résultats
Les résultats des mesures portant sur le nombre
d'épillets fertiles par épi sont inscrits dans le tableau
n°21 puis interprété à l'ide de la figure
n°10
Tableau n°21 Nombre d'épillets fertiles
par épi
0,0000 3,3%
THS

Variétés
Nombre d'épillets

Figure
n°10 Le nombre d'épillets fertiles par épi
II.4.3.2 Discussion des résultats
L'analyse de la variance donne une différence
très hautement significative.
Le test de NEWMAN KEULS donne neuf groupes homogènes
avec le nombre d'épillets fertiles par épi le plus
élevé sur la variété V2 qui totalise 29.95
épillets fertiles.
Quant à la variété V3, elle a
présenté le plus petit nombre d'épillets fertiles par
épi avec 24,23 épillets.
II.4.4 Nombre d'épillets stériles par
épi
II.4.4.1 Résultats
Les résultats obtenus qui concernent le nombre
d'épillets stériles par épi sont inscrits dans le tableau
n°22 et analysé au niveau de la figure n°11
Tableau n° 22 Le nombre d'épillets
stériles par épi
0,0278 29,2%
S

Variétés
Nombre d'épillets

Figure
n°11 Le nombre d'épillets stériles par
épi
II.4.4.2 Discussion des résultats
L'analyse de la variance montre une différence
significative.
Le test de NEWMAN KEULS ne constitue qu'un seul groupe
homogène au sein duquel la variété présentant le
plus grand nombre d'épillets stériles par épi est le V5
avec 2,35 épillets stériles et celle ayant le plus petit nombre
d'épillets stériles est la variété V3 avec 1,17
épillets stériles.
D'après GATE (1995), un nombre d'épillets
stériles par épis peut être dû à la carence
d'azote en début de montaison ou à un stress climatique qui
empêche la fécondation.
II.4.5 Le nombre de grains par épi
II.4.5.1 Résultats
Les résultats qui concernent le nombre de grains par
épis sont reproduit dans le tableau n° 23 et analyse par le graphe
de la figure n° 12
Tableau n° 23 Le
nombre de grains par épi
0,0000 3 ,9%
THS

Variétés
Nombre de grains

Figure n°
12 Le nombre de grains par épi
II.4.5.2 Discussion des résultats
L'analyse de la variance donne une différence
très hautement significatif.
Le test de NEWMAN KEULS permet de constituer cinq groupes
homogènes au niveau desquels la variétés ayant le plus
grand nombre de grains par épi et la V2 avec un total de 59,72 grains
alors que le petit nombre de grains par épi est retrouvé sur la
variété V3 avec un peu moins de 46,8 grains par épi.
Le nombre de grains par épis est déterminant
dans la formation des composantes de rendement. Il est fonction du nombre
d'épillets par épi, u taux d'avortement des organes floraux et
de la réalisation de la fécondation .Il est donc lié
à la fertilité de l'épi et constitue un grand facteur du
rendement à l'unité de surface.
II.4.6 Le poids de mille grains (PMG)
II.4.6.1 Résultats
Les résultats de la mesure du PMG des
différentes variétés sont résumés dans le
tableau n° 24 et interprétés au niveau du graphe de la
figure n° 13
Tableau n°24 Le poids de mille grains
PMG
0,0000 6,9%
THS

Variétés
PMG en g

Figure n° 13
Le poids de mille grains
II.4.6.2 Discussion des résultats
De l'analyse de la variance ressort une différence
hautement significative.
Le test de NEWMAN KEULS permet de constituer sept groupes
homogènes.
La variété qui présente le PMG le plus
levé est la V9 avec 49,11 g suivie par la V12 et la V10 qui ont
respectivement 47,7 g et 47,5 g.
Par ailleurs le PMG le plus bas est celui de la
variété V14 qui totalise un peu plus de 35,3 g.
Pour les triticales, le PMG faible s'explique la plupart du
temps par le phénomène de l'échaudage très
fréquent en fin de cycle pour cette céréale. Une faible
disponibilité de l'alimentation hydrique causée par la
coïncidence de la maturation des grains avec la fin des
précipitations sous nos latitudes explique l'importance de la
proportion des grains échaudés à la récolte.
II.4.7 Le rendement théorique
II.4.7.1 Résultats
Les résultats de l'estimation du rendement
théorique sont inscrits dans le tableau n°25 et analysés
au niveau de la figure n° 14
Tableau n° 25 Le
rendement théorique
0,0000 9,8%
THS

Variétés
Rendement théorique (Qx)

Figure n° 14 Le
rendement théorique
II.4.7.2 Discussion des résultats
L'analyse de la variance dénote une différence
très hautement significative.
Le test de NEWMAN KEULS conduit à la formation de
quatre groupes homogènes.
Ainsi donc, on prévoit que le rendement sera la plus
élevé pour la variété V12 avec une
prévision de 67,75 quintaux à l'hectare ; suivi par les
variétés V11,V1 et V9 qui devraient donner respectivement 58,07
quintaux, 57,75 et 57,03 quintaux à l'hectare.
D'autre part, de faibles rendements ont été
obtenus par les variétés V5 et V15 qui ont donne respectivement
44,79 et 45,07 quintaux à l'hectare.
II.4.8. Le rendement réel
II.4.8.1 Résultats
Les résultats de la meure du rendement réel
sont rapporté au niveau du tableau n°26 et
interprété par le graphe de la figure n °15
Tableau n° 26 Le
rendement réel
0,0066 8,8%
HS

Variétés
Rendement réel en Qx

Figure n° 15 Le
rendement réel
II.4.8.2 Discussion des résultats
L'analyse de la variance montre une différence
variétale hautement significative.
Le test de NEWMAN KEULS forme trois groupes homogènes
parmi lesquels les rendement les plus élevés sont
réalisés par les variétés V1, V7 et V10 avec
respectivement 47,92 qx, 47,91 qx et 47,09 qx à l'hectare.
Les trois variétés sont suivies
par les variétés V9 (46.94 qx), V13 (46,87 qx),
V2 (46,66) et V12 (46,25).
Quant aux variétés les moins productives, on a
dans l'ordre la V8 avec un peu plus de 37,71 qx et la variété
témoins V14 avec 39,79 qx à l'hectare.
On remarque également une différence entre le
rendement théorique et le rendement réel. Une telle
différence peut s'expliquer d'une part par le choix de la date de
récolte dans le cas de la surmaturité qui entraîne
l'égrenage et les attaques par des déprédateurs mais
d'autre part on doit considérer les pertes subies lors des
opérations de la récolte et de la manutention.
Conclusion generale
CONCLUSION
GENERALE :
Au cours de l'essai réalisé dans les conditions
pédoclimatiques de la station expérimentale, nous avons
étudié les paramètres phénologiques, morphologiques
et agronomiques des variétés testées.
L'étude de ce travail nous a mené aux
conclusions suivantes :
. L'ensemble de variétés testées sont
précoces ; en effet la durée de la période semis-
épiaison n'a pas atteint les 100 jours pour la totalité des
variétés.
. Le nombre de plants levés a été assez
important pour les variétés V12 (146,00 plants) et la V11 (144,50
plants) tandis que ce nombre est faible pour la variété V10 qui
totalise 108 plants.
. Le nombre de talles par plant le plus élevé
a été enregistré sur la variété V5 avec 4,42
talles, alors que le plus faible se retrouve sur la variété V14
avec 2,61 talles.
. La hauteur des plants à la floraison confirme le
fait que les triticales ont en général une paille plus haute que
celle des blés .On a trouvé des valeurs allant de 89,76 cm (V5)
à 114 cm (V10).
Cette propriété est certes d'origine
génétique et explique la bonne résistance des triticales
à la sécheresse et leur sensibilité à la verse
mécanique.
. Le nombre d'épis au m2 est plus
élevé chez la variété V14 (283 épis au
m2) tandis que il est plus faible chez les variétés
V10 (197,00 épis), V2 (200,5 épis) et V5 (2001,75 épis)
. De même, ces épis sont d'une longueur assez grande avec des
valeurs allant de 9,6cm (V1) à 12,88 cm chez la variété
V2. Ceci aura une influence sur le rendement.
. Le nombre de grains par épi le plus
élevé est constaté sur la variété V2 avec
59,72 grains suivie par la variété V12 avec 56,15 grains. Ce
paramètre est plus faible sur la variété V3 avec un peu
moins de 46,8 grains par épi.
Ce paramètre est lié à la
fertilité, la longueur de l'épi et son taux de
stérilité qui sont eux même sous l'influence des conditions
climatiques notamment la nutrition hydrique.
Cependant on peut affirmer que le nombre de grains par
épi est élevé chez les variétés à
épis plus longs et dont le nombre d'épillets stériles par
épi est moindre comme le cas de la variété V2.
. Le PMG varie entre 33,5 g (V14) à 49,11g (V7). La
faiblesse du PMG est surtout due à l'échaudage qui
entraîne des pertes considérables dans des régions
où la fin du cycle correspond à l'avènement des hautes
températures estivales.
Il est important de sélectionner les
variétés en tenant compte de leur résistance à la
sécheresse afin de mieux lutter contre l'échaudage car une forte
proportion de grains échaudés au niveau de la
récolte ; au delà du fait qu'elle contribue à la
faiblesse du PMG, dissuade les agriculteurs de s'intéresser à la
culture du triticale.
.Le rendement réel qui est la principale
préoccupation de l'agriculteur montre une bonne performance des
variétés V1 (47,92 qx/ha), V7 (47,91 qx/ha) ainsi que la
variété V10 (47,08 qx/ha). Elles sont suivies par les
variétés V9 (46,94 qx), V13 (46,87 qx), V2 (46,66 qx) et V12
(46,25 qx)
Les rendements les moins élevés sont obtenus sur
les variétés V8 avec 37,71 qx et la variété V14
(39,79 qx/ha).
Compte tenu des critères
phénologiques, morphologiques et agronomiques qui ont fait l'objet de
cet essai, les variétés qui ont montré des meilleures
performances sont la variété V1, la V7 et V10.
Egalement, les variétés V9, V13, V2 et V12 ont
des résultats plus que raisonnables et sont à suivre de
près.
L'essai réalisé dans le cadre de cette
étude portait sur le comportement des variétés la
première année et donc n'est pas suffisant pour donner des
propositions sur des variétés à sélectionner et
celles à rejeter d'office, c'est pourquoi les variétés
devront être soumis à un essai de deuxième année
pour pouvoir confirmer ou infirmer les bonnes performances des unes et les
rendements médiocres des autres.
Le triticale est une plante qui connaît sur le plan
mondial une expansion rapide et dont les surfaces consacrées à
sa culture sont sans cesse en augmentation. Même si cette culture fut un
moment délaissée sur le plan national, elle reste une bonne
alternative dans la quête de l'autosuffisance de l'alimentation du
bétail vue qu'elle peut remplacer le maïs importé
massivement pour satisfaire les besoins du cheptel national.
Agronomiquement, il possède l'avantage de pouvoir
donner des rendements satisfaisant dans des zones semi arides à cause de
sa résistance à la sécheresse.
C'est pourquoi un travail de vulgarisation à grande
échelle devait être entrepris pour mieux faire connaître
cette culture aux différents acteurs du secteur agro pastoral et la
faire passer de son statut actuel de curiosité scientifique à
celui de culture couramment cultivée.
Sur le plan économique, sa conduite avec un minimum
d'intrants, sa productivité élevée en grains et en paille
permettrait à l'agriculteur de dégager une marge brute assez
conséquente.
Les références
bibliographiques :
A GALLAIS, BANNEROT H.,
1992, Amélioration des espèces végétales
cultivées, objectifs et critères de sélection. ED INRA
France 210 p.
ABDEL MOUTALEB D. 1990:
Etude biologique et variétale du triticale triticosecale w dans les
conditions écologiques de Blida, thèse d'ing. Agro. Inst. Agro.
Blida. 80p.
ABDUL HUSSEIN M.S, 1987 : La biologie et
la variabilité génétique de plusieurs lignées de
triticales cultivées en conditions agro climatiques de la wilaya de
Batna- Algérie. Thèse de doctorat d'Etat, Inst.Agro. Cley-Napoa
Roumanie, 115 p.
ALIA Y. 2005 : Etude de comportement
agro technologique de treize variétés de triticales
cultivées en zone sub humide (Oued Smar). Memo Ing USDB ,86 p.
ANONYME 1985 : Le triticale :
culture et utilisation. Edition ITCF.
ANONYME 2003 : Le triticale une culture
prometteuse. Edition ITGC pp 10-20.
ANONYME 2004 :
ANONYME 2006: La culture du triticale.Ed
ITGC
ANONYME 2007: Larousse agricole. Editions
Larousse.
ANONYME, a, 2008 : La culture du
triticale. Edition ITGC
ANONYME, b, 2008 : Le guide de la
gastronomie algérienne : utilisation du triticale.
BACHIR OUDJEHIH, AMAR BOUKABOUB,
2005 Etude cytogénétique du triticale cv Beagle in Jon
Lebey European studies, London pp 5-17
BELAID D., 1990 : Aspect de la
céréaliculture en Algérie. Edition OPU. Alger, 126 p.
BENBELKACEM A ,1991 :
Les céréales d'hiver. Céréaliculture n° 25
pp6-11
BENBELKACEM A, 1973 :
Les triticales.Thèse de doctorat .INA .El Harrach pp 73
BENBELKACEM A, Le triticale, une culture en
développement. Céréaliculture
n°217, pp 22-26
BERNAD M, GUEDES PINTOT H,
1999 : Etude comparative de quelques cultivars de blé,
seigle et triticale dans le nord du Portugal, .II Adaptation du matériel
végétal au milieu .Agronomie, 3(8) 723-733
BERNARD M, 1992: Le triticale. Edition INRA
.Alger pp 39-45
BERNARD S, BERNARD M, 1987 Creating new form
of 4x, 6x, and 8x primary triticale associating both complete R an D
genomes.Theor.appl.Gen. 74, 55_59
BONJEAN A., 1992 : Le triticale.Edition
Lavoisier. Paris pp 29-40
BOYD W.R.J, SISODIA N.S, LARTER E.N. A
comparative study of the cytological and reproductive behaviour of wheat and
triticale subjected to two temperature regimes. Euphytica
1970; 19: 470-97.
BROUWER J. 1976: PORC, first
austr. Poltry and stock feed convention. Melbourne, pp 10-25
CAUDERON Y., BERNARD M.,
1980; Yield improvement from (8x 6x) crosses, and genetic and
cytoplasmic diversification in triticale breeding problems.
Proc . of second Eucarpia Meeting of The Cereal Section on
Triticale Varsovie, (Pologne) 1970, 329-338
CAUDERON Y. 1993 : Le
triticale, première céréale crée par
l'homme :
Nature-sciences-société n° 1 pp 102-107
CAUDERON Y., 1981: Origine
et évolution des triticales.
Edition J.B
Baillère France pp 69-188.
CEAPAOUI N., 1972 :
Citogénetica applicata in ameliorarea gruelui, editura Academiei
Bucarest, pp 24-74
DEMARLY M ,1970 Amélioration
génétique des plantes cultivées
Editions : Masson et Cie. Paris,
332 p.
GASPER J, BUNATRU G., 1985 : Triticale
Onova cereale. Edition Académie Romania Bucaresti pp 11-120
GATE P, 1995 Ecophysiologie
du blé. Edition Lavoisier, 429 p.
GUPTA PK, PRIYADARSHAN PM.
1982: Triticale: present status and future prospects. Adv
Genet 1982 ; 21 : 255-345
HENINS, 1969 : Le
profil cultural : L'état physique du sol et ses conséquences
agronomiques. 152 p
HILL R.D, KLASSEN A.J, DEDIO W.;
1974: Metabolic factors influencing kernel development in triticale.
In: McIntyre R, Campbell M, eds. Triticale: Proceedings of an International
Symposium. El Batan (Mexico) : Int Develop Res Centre Monogr, 1974 :
149-54.
KHETTAL M., 1995 : Fertilisation
azotée du triticale en zone sub-humide.
Memoire Ing Agro Inst agro
Blida, 81 p
LAROCHE G., 1984 : Le
triticale : une céréale d'avenir.
In revue :
Perspective Agricole n° 81, pp
LAROCHE G., GROSJEAN F., GATE P. ET
BERNICOT M.H., 1994 : Le triticale Du
débouché à la culture In revue Perspective Agricole
N° 188 pp 1-24
LAROCHE G., 1981 : Le
triticale valeur agronomique et fourragère. In revue Perspectives
agricoles n° 51 pp 20-29
MONNEVEUX P. ET THIS
D.1980 : La génétique face au
problème de la tolérance des plantes cultivées à
la sécheresse : espoir et difficultés.Synthèse :
Sécheresse. Edition INRA, Paris, pp 29-36
MOULE C., 1980 :
Phytotechnie spéciale : Les céréales.
Edition, Maison rustique Paris
318 p
MUNTZING A, 1979.Triticale: results and
problems. Advance in plant breeding supplement n° 3 to Journal of plant
breeding Verlag Paul Parey, Berlin and Hamburg. Federal Republic of Gemany
RABHI A., 1995 : Etude
de comportement de dix variétés de triticales dans les
conditions pédologiques de la plaine du Haut Chélif.
Mémoire Ing Agro Blida 88p.
SEAL AG. 1986;Causes of
grain shrivelling in triticale. In : Darvey NL, ed. Triticale :
International Symposium. Sydney : Australian Institute of Agricultural
Science, 1986 : 31-4.
SCHORDERET M., 1989: Pharmacologie :Des
concepts fondamentaux aux applications thérapeutiques pp 225-238.
SOLTNER D., 1980 : Les
grandes productions végétales 11ème
édition coll Sc et Tech Agricole 44p
SOLTNER D., 1988 : Les
grandes productions végétales .16ème
Edition.
Collection
Sciences et techniques agricoles. Paris 109 p
SOLTNER D., 2000 : Les
bases de la production végétale. Tome I, Le sol et son
amélioration.Coll sc. et Techniques agricoles. 472 p
SOWA W. 1986:The effect of chromosome
substitution on grain yield and its structure in triticale. In: Darvey NL, ed.
Triticale: International Symposium. Sydney: Australian Institute of
Agricultural Science, 1986: pp 412-22.
VARUGHESE G, BARKER T, SAARI F.,
1987 : Le triticale Edition ITCF pp 1-30
VARUGHESE G., BARKER T., SAARI
F.,1987: Triticale .Edition : CIMMYT, Mexico,D.F,32
p.
VILIAN M.,1999 : Méthodes
expérimentales en agronomie.Pratique et analyse
Ed Technique et documentation.Paris
WEIPERT D. Triticale processing in milling
and baking. In : Darvey NL, ed. Triticale : International Symposium.
Sydney : Australian Institute of Agricultural Science, 1986 : 402-41.
ZEMERLINE F.,1990:
Substitution partielle et totale du mais par le triticale chez le poulet de
chair .mémoire Ing Agro .Inst. Agro. Blida 33p
ZILLINSKY FJ, 1979;
Development of triticale.Adv. Agr. 26, 315-349
ZILLINSKY FJ.,1984 Improving
seed formation in triticales. In : McIntyre R, Campbell M, eds. Triticale :
Proceedings of an International Symposium. El Batan (Mexico) : Int Develop
Res Centre Monogr, 1974 : 155-7.
ZILLINSKY J., BOURLAGNE
E.,1971 : Progress in developping triticale as
an economic crop . Research bulletin n° 25 pp 17-27
Annexes
ANNEXES
Tableau 01 : Analyse de la variance : le nombre
de plants au m2
|
Caractère
|
SCE
|
DDL
|
C.M
|
Test F
|
Proba
|
E.T
|
C.V
|
|
Var totale
|
20648,98
|
59
|
349,98
|
|
|
|
|
|
Var facteur 1
|
7489,73
|
14
|
534,98
|
1,87
|
0.0593
|
|
|
|
Var blocs
|
1142,72
|
3
|
380,91
|
1,33
|
0,2764
|
|
|
|
Var résiduelle 1
|
12016 53
|
42
|
286 11
|
|
|
16,91
|
13%
|
|
Caractère
|
SCE
|
DDL
|
C.M
|
Test F
|
Proba
|
E.T
|
C.V
|
|
Var totale
|
2354,51
|
59
|
39,91
|
|
|
|
|
|
Var facteur 1
|
1677,97
|
14
|
119,85
|
8,28
|
0,000
|
|
|
|
Var blocs
|
68,54
|
3
|
22,85
|
1,58
|
0,2076
|
|
|
|
Var résiduelle 1
|
608,00
|
42
|
14,48
|
|
|
3,80
|
3,6%
|
Tableau 02 Analyse de la variance : le nombre de
talles par plant
|
Caractère
|
SCE
|
DDL
|
C.M
|
Test F
|
Proba
|
E.T
|
C.V
|
|
Var totale
|
23,21
|
59
|
0,39
|
|
|
|
|
|
Var facteur 1
|
11,23
|
14
|
0,80
|
2,83
|
0,0047
|
|
|
|
Var blocs
|
0,07
|
3
|
0,02
|
0,08
|
0,9705
|
|
|
|
Var résiduelle 1
|
11,91
|
42
|
0,28
|
|
|
0,53
|
16,8%
|
Tableau 03 Analyse de la variance : Hauteur des
plants à la floraison
Tableau 04 : Analyse de la variance : longueur
des épis
|
Caractère
|
SCE
|
DDL
|
C.M
|
Test F
|
Proba
|
E.T
|
C.V
|
|
Var totale
|
60,19
|
59
|
1,02
|
|
|
|
|
|
Var facteur 1
|
47,19
|
14
|
3,37
|
13,77
|
0,000
|
|
|
|
Var blocs
|
2,72
|
3
|
0,91
|
3,70
|
0,0188
|
|
|
|
Var résiduelle 1
|
10,28
|
42
|
0,24
|
|
|
0,49
|
4,4%
|
Tableau 05 Analyse de la variance : Nombre
d'épis au m2
|
Caractère
|
SCE
|
DDL
|
C.M
|
Test F
|
Proba
|
E.T
|
C.V
|
|
Var totale
|
64040,94
|
59
|
1085,44
|
|
|
|
|
|
Var facteur 1
|
47022,94
|
14
|
3358,78
|
8,37
|
0,000
|
|
|
|
Var blocs
|
161,34
|
3
|
53,78
|
0,13
|
0,9384
|
|
|
|
Var résiduelle 1
|
16856,66
|
42
|
401,35
|
|
|
20,03
|
8,7%
|
Tableau 06 Analyse de la variance : le nombre
d'épillets par épi
|
Caractère
|
SCE
|
DDL
|
C.M
|
Test F
|
Proba
|
E.T
|
C.V
|
|
Var totale
|
193,14
|
59
|
3,27
|
|
|
|
|
|
Var facteur 1
|
164,20
|
14
|
11,73
|
17,61
|
0,0000
|
|
|
|
Var blocs
|
0,96
|
3
|
0,32
|
0,48
|
0,7007
|
|
|
|
Var résiduelle 1
|
27,98
|
42
|
0,67
|
|
|
0,82
|
2,9%
|
Tableau 07 Analyse de la variance : nombre
d'épillets fertiles par épi
|
Caractère
|
SCE
|
DDL
|
C.M
|
Test F
|
Proba
|
E.T
|
C.V
|
|
Var totale
|
175,11
|
59
|
2,97
|
|
|
|
|
|
Var facteur 1
|
140,96
|
14
|
10,07
|
12,98
|
0,0000
|
|
|
|
Var blocs
|
1,57
|
3
|
0,52
|
0,68
|
0,5749
|
|
|
|
Var résiduelle 1
|
32,58
|
42
|
0,78
|
|
|
0,88
|
3,3%
|
Tableau 08 Analyse de la variance : nombre
d'épillets stériles par épi
|
Caractère
|
SCE
|
DDL
|
C.M
|
Test F
|
Proba
|
E.T
|
C.V
|
|
Var totale
|
19,44
|
59
|
0,33
|
|
|
|
|
|
Var facteur 1
|
7,25
|
14
|
0,52
|
2,16
|
0,0278
|
|
|
|
Var blocs
|
2,10
|
3
|
0,70
|
2,92
|
0,0444
|
|
|
|
Var résiduelle 1
|
10,09
|
42
|
0,24
|
|
|
0,49
|
29,2%
|
Tableau 09 Analyse de la variance : le nombre de
grains par épi
|
Caractère
|
SCE
|
DDL
|
C.M
|
Test F
|
Proba
|
E.T
|
C.V
|
|
Var totale
|
694,15
|
59
|
11,77
|
|
|
|
|
|
Var facteur 1
|
464,28
|
14
|
33,16
|
7,66
|
0,0000
|
|
|
|
Var blocs
|
47,94
|
3
|
15,98
|
3,69
|
0,0190
|
|
|
|
Var résiduelle 1
|
181,92
|
42
|
4,33
|
|
|
2,08
|
3,9%
|
|
Caractère
|
SCE
|
DDL
|
C.M
|
Test F
|
Proba
|
E.T
|
C.V
|
|
Var totale
|
1323,21
|
59
|
22,43
|
|
|
|
|
|
Var facteur 1
|
950,06
|
14
|
67,86
|
8,32
|
0,0000
|
|
|
|
Var blocs
|
30,53
|
3
|
10,18
|
1,25
|
0,3045
|
|
|
|
Var résiduelle 1
|
342,61
|
42
|
8,16
|
|
|
2,86
|
6,9%
|
|
Caractère
|
SCE
|
DDL
|
C.M
|
Test F
|
Proba
|
E.T
|
C.V
|
|
Var totale
|
3142,62
|
59
|
53,26
|
|
|
|
|
|
Var facteur 1
|
1965,68
|
14
|
140,41
|
5,29
|
0,0000
|
|
|
|
Var blocs
|
61,15
|
3
|
20,38
|
0,77
|
0,5218
|
|
|
|
Var résiduelle 1
|
1115,79
|
42
|
26,57
|
|
|
5,15
|
9,8%
|
|
Caractère
|
SCE
|
DDL
|
C.M
|
Test F
|
Proba
|
E.T
|
C.V
|
|
Var totale
|
1422,75
|
59
|
24,11
|
|
|
|
|
|
Var facteur 1
|
573,23
|
14
|
40,95
|
2,70
|
0,0066
|
|
|
|
Var blocs
|
212,15
|
3
|
70,72
|
4,66
|
0,0068
|
|
|
|
Var résiduelle 1
|
63737
|
42
|
15,18
|
|
|
3,90
|
8,8%
|
Tableau 10 Analyse de la variance : le poids de
mille grains
Tableau 11 Analyse de la variance : le rendement
théorique
Tableau 12 Analyse de la variance : le rendement
réel



