I.2 CADRE THEORIQUE
I.2.1 METHODE
Dans le cadre de notre travail nous nous servirons de la
méthode d'analyse informatique dite MERISE.
I.2.2 HISTORIQUE DE LA MERISE
Le nom de Merise vient de l'analyse
faite avec le merisier, qui veut dire : qui ne peut porter de beaux fruits que
si on lui greffe une branche de cerisier. Ainsi en va=t=il des méthodes
informatiques bien conçues, qui ne produisent de bons résultats
que si la greffer sur l'organisation réussit.
La méthode MERISE, est le
résultat des travaux menées par Hubert Tardieu dans les
années 1970 et qui s'insérait dans le cadre d'une
réflexion internationale, autours notamment du modèle relationnel
d'Edgard Franck COLD. Elle est devenue un projet opérationnel au
début des années 1980 à la demande du Ministre de
l'industrie française et a surtout été utilisé en
France par SSII de ses membres fondateurs (Sema=mettra ainsi
que par la CGI informatique et principalement pour les projets
informatiques.3
I.2.3 DEFINITION DE LA MERISE
La méthode MERISE est une méthode d'étude et
de réalisation informatique par sous -ensemble.4
Cette méthode sépare les données et les
traitements et à effectuer en plusieurs modèles. D'où il
existe deux caractéristiques essentiellement dans MERISE.qui sont
:5
La séparation entre les données et les
traitements
Données : MCD MLD MPD
Traitement : MCT MOT MOPT
Représentation suivant le degré d'invariance
Niveau conceptuel
Niveau logique
Niveau physique
A. NIVEAU CONCEPTUEL
Le niveau conceptuel s'attache aux invariants de l'entreprise ou
de l'organisme du point de vue métier.
Le compte rendu de ce niveau est de matérialiser sous
formes des dessins normalisés, de modèles complètes par un
dossier explicatif.6·
1. INVENTAIRE DE RUBRIQUE
L'inventaire de rubrique nous permet d'étudier les
informations se trouvant sur les documents utilisée dans notre domaine.
Il sera présenté sous forme d'un tableau de ligne et de colonne,
sous la :
- Première colonne : Le numéro de la rubrique
- Deuxième colonne : Le lot des informations ou
rubrique
- La troisième colonne : le nom du document
Sur les lignes nous y mettrons le nombre de fois
qu'apparaît la rubrique sur les différents documents par une signe
d'Astérix.
3 Hubert Tardieu, Arnold Rochefeld,
RéneColletti ; La méthode Merise Tome 1 principe
et outils, Ed Paris 328 Pg
4Idem
5 Jean Luc Baptiste ; Merise Guide Pratique
modélisation de donnée et traitement ; Nouvelle édition 5
Pg 6Hubert Tardieu, Arnold Rochefeld, George Panet
;La méthode Merise Tome 2Démarche
Pratique, Ed Paris 24Pg
2. DICTIONNAIRE DES DONNEES
Le dictionnaire est un document qui permet de recenser, de
classer, de trier toutes les informations (données) collecter lors des
entretiens ou de l'étude des documents. Il est composer de colonne et
des lignes dont :
Première colonne : Le numéro de la
propriété ;
Deuxième colonne : le nom de la propriété
;
La troisième colonne : la taille de la
propriété ;
La quatrième : la signification de la
propriété ;
3. MATRICE DE DEPENDANCE FONCTIONNELLE A
SOURCE
SIMPLE
La matrice de dépendance fonctionnelle à source
simple, décrit les dépendances directes entre
propriété.
La dépendance fonctionnelle :
elle nous aider à comprendre les liens existant entre chaque
donnée.
Nous le remplissons moyennant deux signes : l'Astérix et
le chiffre arabe 1
L'Astérix : quant il est une clé qui
détermine
Le 1 : comme un déterminant ;
4. LA MATRICE DE DEPENDANCE FONCTIONNELLE A
SOURCE
COMPOSEE
La matrice est constituée des propriétés
sources de la matrice de dépendance fonctionnelle à source simple
et les propriétés non utilisées de la matrice de
dépendances fonctionnelles à sources simples. Elle est dite
composée quand elle comporte plusieurs attributs.
5. MATRICE DES CLES
Elle détermine les relations qui existent entre les
clés.
6. GRAPHE DES CLES
Est une représentation des dépendances à
source composée et les dépendances fonctionnelles à source
simple. Il nous sert à combiner deux identifiants pour déterminer
un autre identifiant.
7. STRUCTURES D'ACCES THEORIQUE
LE MCD : C'est un schéma
représentant la structure d'information du point de vue donné
c'est=à=dire les dépendances ou relation entre les
différentes données du système
d'information.7
Le MCD a comme concept :
Entités : est une représentation d'un
élément matériel ou immatériel ayant un rôle
dans le système que l'on désire décrire.
Client
NumCliAdressCli
Propriété : est une information
élémentaire, c'est=à=dire non déductible d'autres
information, qui présente un intérêt pour le domaine
étudier et chaque valeur prise par une propriété est
appelé occurrence, une propriété est dite simple atomique
si chacune de valeurs qu'elle regroupe n'est pas décomposable.
Adresse
105, Av du Moero
C/Lubumbashi
Identifiant : est un ensemble de propriétés (une
ou plusieurs) permettant de designer une et une seul entité. Ou il est
une propriété particulière d'un objet telle qu'il n'existe
pas deux occurrences de cet objet pour lesquelles cette propriété
pourrait prendre une même valeur.
Les attributs d'une classe d'entité permettent de
designer de façon unique chaque instance ce cette entité sont
appelé identifiant absolu, le modèle
conceptuel de données propose de souligner les identifiants parfois le
faire précéder d'un #
ARTICLE
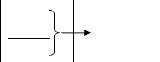
CodeArt NomArt
Les attributs
La cardinalité : elle exprime les nombres de fois ou
l'occurrence d'une entité participe aux occurrences de la relation, Elle
sera noté comme
7Fréderic DIGALLO, Méthodologie
Merise-Cours du Cycle B du Cnam.doc ; Edition paris, Pg 12

(1,n) Commander
Cardinalité Cardinalité
Article NumArt Désignation PrixAchat
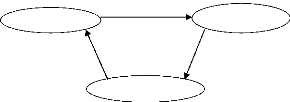
Acteur 1 Acteur 2
Flux Flux
Acteur N
Flux
La cardinalité minimale exprime le nombre de foi minimum
qu'une occurrence d'une entité participe aux occurrences d'une
relation.
La cardinalité maximale exprime le nombre de foi maximal
qu'une occurrence d'une entité participe aux occurrences d'une
relation.
| 


