|
UNIVERSITE DE YAOUNDE II
THE UNIVERSITY OF YAOUNDE
II

FACULTE DES SCIENCES ON
FACULTY OF ECONOMICS
B.P 1365 Yaoundé - AND MANAGEMENT
CAMEROUN P.O. Box: 1365 Yaoundé
www.univ-yde2.org CAMEROON
Tél. : (237) 22 06 26 98/ Fax (237) 22 23 84 28
fseg@.univ-ydé2.org
Tél. : (237) 22 06 26 98/ Fax (237) 22 23 84
28
UNITE DE FORMATION DOCTORALE PROFESSIONNELLE DE
GESTION
URBAINE PROGRAMME DESS DE GESTION URBAINE Vième
PROMOTION
Mémoire de DESS
THEME :

PROBLEMATIQUE DE LA CREATION DES AIRES
PROTEGEES AU
CAMEROUN : CAS DU PARCOURS VITA
DE DOUALA.
Soutenu publiquement en vue de l'obtention du
Diplôme d'Etude Supérieure Spécialisée
(DESS) en
Gestion Urbaine
Par :
NGOUONPE Luc
(Maîtrise en sciences économiques,
Diplômé de l'ENAM)
Option : Economie Internationale
Sous la direction de :
Dr. Jean Pierre
TCHANOU
Chargé de Cours à l'Université de
Yaoundé II -Soa
Année académique 2009-2010
DEDICACE
Amon épouse et nos enfants qui ont fait preuve de beaucoup
de sacrifices, d'amour et de compréhension pour la réussite de ce
travail.
REMERCIEMENTS
Au Docteur TCHANOU Jean -Pierre, enseignant à
l'Université de Yaoundé II à Soa qui a bien voulu assurer
la direction de ce mémoire. Il a fait preuve de disponibilité par
l'attention accordée à travers ses suggestions, ses
compléments et ses encouragements ;
Au Professeur Jean- Roger ESSOMBE EDIMO NYA BONABEBE pour son
soutien tout au long de la formation ;
Au Dr Christopher FUNWIE TAMASANG, Senior Lecturer in Law pour sa
déterminante contribution à ce travail;
A mes enseignants de Dess-Gestion Urbaine pour les connaissances
transmises ;
Mes remerciements vont également à l'endroit de
Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la
Communauté Urbaine de Douala et son personnel pour leur franche
collaboration et contribution.
J'adresse particulièrement mes sincères
remerciements :
A Monsieur PRISO Olivier de la Communauté urbaine de
Douala pour sa disponibilité ;
A Monsieur DJATCHO SIEFU Donald qui a accepté de
m'accorder un peu de son précieux temps pour la lecture et la
dynamisation de ce travail. Je le remercie sincèrement ;
A mon épouse et nos enfants pour avoir tant
supporté mes longues absences à la maison, pour m'avoir en tout
temps compris, encouragé dans des moments difficiles, surtout dans mon
choix de redevenir étudiant ;
A madame WOUBINWOU Lydie pour les soutiens multiples ;
A mes frères et soeurs pour les multiples encouragements
;
A mes amis, et tous ceux qui ont été proches de moi
pendant tous ces moments d'étude.
NOTE CONTEXTUELLE.
« Ce sont les concepts, les idées, les images,
et non plus les choses, qui ont une vraie valeur dans la nouvelle
économie (...). La production culturelle est le stade suprême de
la civilisation capitaliste, dont la mission a été d'introduire
un nombre de plus en plus grand d'activités humaines dans la
sphère marchande ».
J. Rifkin, 2000, P.12 et 18.
ABREVIATIONS.
APV : Association des Amis du Parcours Vita.
CEE : Communauté économique européenne.
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale. CFC : Gaz chlorofluorocarbures.
C I J : Cours Internationale de Justice.
CITES: Convention on international trade of endangered species
CRTV : Radio Télévision Camerounaise.
C U D : Communauté Urbaine de Douala.
HYSACAM : Hygiène et Salubrité du Cameroun.
I D I : Institut de Droit International.
INSERM : Institut Nationale de la Santé et Recherche
Médicale en France. MAB : Man and biosphère.
MAETUR : Mission d'Aménagement et d'Equipement des
Terrains Urbains et Ruraux.
OCDE : Organisation pour la Coopération et le
Développement Economique : Elle comprend notamment les Etats de l'Europe
occidentale ainsi que les Etats -Unis, le Japon, et le Canada,
constituée en vue de favoriser l'expansion économique de ces
Etats ainsi que celle des Pays en voie de développement.
O M M : Organisation Météorologique Mondiale.
ONU : Organisation des Nations Unies.
PIC : Prior Informed consent.
PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement.
P V : Parcours Vita.
S I C : Société Immobilière du Cameroun.
UE : Union Européenne.
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture. W.W.F: World Wildlife Fund.
LISTE DES SCHEMAS.
|
Schéma 1: mode d'approche distinct de la valeur du pv
|
92
|
|
Schéma 2 : analyse de la valeur du pv
|
.93
|
|
Schéma 3 : connaissance du parcours Vita et les
éléments spécifiques
|
94
|
RESUME
Longtemps considérer comme une affaire des Pays
développés, l'environnement s'impose aujourd'hui à nous
comme un élément, une composante de la vie, d'où la
nécessité de sa protection et de sa conservation. Cette prise de
conscience a suscité l'urgence de la communauté internationale
qui s'est mobilisée l'année dernière au dernier sommet de
Copenhague face aux multiples catastrophes et le réchauffement
climatique, pour conjuguer des efforts en vue de parer à cette menace
planétaire. Bien que les résultats restent mitigés.
Sur le plan national, le Cameroun s'est engagé dans ce
combat avec des instruments assez forts en menant des actions incitatives pour
protéger et conserver la biodiversité dont le fait clinquant
reste la lutte contre la désertification, la pollution et autres menaces
sur l'environnement. Loin de concerner seules les pouvoirs publics, parce que
nous sommes tous victimes, le danger reste imminent et précis. Il
requiert l'engagement de la population, de la Société civile et
des médias.
En même temps, l'environnement est un bien
économique, non pas un bien marchand, mais un bien qui peut procurer du
bien-être et d'énormes richesses pour le développement
local. Le gouvernement camerounais l'a compris avec la création du PV de
Douala. Bien que jusqu'à nos jours il n'a offert qu'une infirme partie
de ses atouts à la population (surtout les sportifs), la ville tout
entière ignore les capacités économiques,
environnementales et sociales qu'il regorge.
L'objectif de ce travail a été d'éclairer
la politique en vue de l'aider dans la prise de décisions dans le
domaine de la création des espaces naturels protégés comme
celui du PV de Douala.
Nous avons tout au long de ce travail montré que, un
Parcours Vita à l'instar de celui de Douala s'inscrit dans le registre
des biens économiques non marchands pouvant procurer du bien-être
et d'énormes richesses pour le développement local.
Enfin, nous sommes parvenu au fait que le Parcours Vita de
Douala ne peut favoriser cette logique de développement que si elle est
protégée et conservée pour être valorisée
avec ses lacs, la rivière Nkondi qui imprime ses pulsations sur l'espace
Vita, la forêt et le circuit de sport. Cette nature sauvage peut se
« vendre » à partir de la dynamique multifonctionnelle qui en
découle, en même temps qu'elle est un élément
d'attractivité pour la Cité et de promotion à la
protection de l'environnement.
ABSTRACT
Consider a long time like a business of the Countries
developed, the environment imposes itself today to us like an element, a
component of life, from where the necessity of his/her/its protection and its
conservation. This hold of conscience caused the emergency of the international
community that is mobilized itself last year to the last summit of Copenhagen
facing the multiple disasters and the climatic warming up, to conjugate some
efforts in order to deal with this global threat; although, the results remain
mitigated.
On the national plan, Cameroon entered into this fight with
strong enough instruments while leading some incitatives actions to protect and
to preserve biodiversity of which the flashy fact remained the struggle against
the desertification, the pollution and other threats on the environment. Far
from concerning alone the public powers, because we are all victims, the danger
remained imminent and precise. It requires the engagement the population, the
civil society and the medias.
At the same time, the environment is a very economic, not a
market good, but a good that can procure the well-being and enormous wealth's
for the local development. The Cameroonian government understood it with the
creation of the PV of Douala. Although until our days it offered an invalid
only left of its assets to the population (especially the sportsmen), the
entire city ignores the economic, environmental and social capacities that it
overflows.
The objective of this work was to illuminate the politics in
order to help it in the hold of decisions in the domain of the creation of the
natural spaces protected like the one of the PV of Douala.
We have all along this shown work that, a PV like the one of
Douala appears in the register of no market economics goods capable to procure
the well-being and enormous wealths for the local development.
Finally, we arrived to the fact that the Course Vita of Douala
cannot encourage this logic of development that if she is protected and is
preserved to be valorised with its lakes, the Nkondi River that prints its
throbbings on the Vita space, the forest and the circuit of sport.
SOMMAIRE
DEDICACE 2
REMERCIEMENTS 3
NOTE CONTEXTUELLE. 4
ABREVIATIONS. 5
LISTE DES SCHEMAS. 6
RESUME 7
SOMMAIRE 9
INTRODUCTION GENERALE 10
I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU SUJET 11
II- PROBLEMATIQUE 13
III - INTERET DE L'ETUDE 13
IV.- JUSTIFICATION DU CHOIX DU THEME 14
V- OBJECTIFS. 14
VI- METHODOLOGIE 15
VII- DEFINITION DES CONCEPTS OPERATIONNELS
17
PREMIERE PARTIE : L'OFFRE ET LA DEMANDE DES SERVICES
PUBLICS ET LA SPATIALITE : CAS DES ESPACES NATURELS URBAINS COMME LE PARCOURS
VITA.
18
INTRODUTION DE LA PREMIERE PARTIE 19
CHAPITRE 1 : APPROCHE DOCTRINALE DE GESTION DES AIRES
PROTEGEES DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 23
INTRODUCTION 23
SECTION 1 : ANALYSE ECONOMIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
23
SECTION II- L'ESPACE ET L'OFFRE DES SERVICES COLLECTIFS.
36
CONCLUSION 44
CHAPITRE 2 : LE PARCOURS VITA ET L'ESPACE DE DOUALA
VIEME. 45
INTRODUCTION 45
SECTION 1-LA COMMUNE DE DOUALA VIEME 45
SECTION II-LE PV DANS SON ENVIRONNEMENT. 49
CONCLUSION 56
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 57
SECONDE PARTIE : LA PROTECTION ET LA MULTIFONCTIONALITE.
58
INTRODUCTION DE LA SECONDE PARTIE 59
CHAPITRE 3 : LA NECESSITE DE LA PROTECTION DU PARCOURS
VITA. 60
INTRODUCTION 60
SECTION 1-TENTATIVES DE DEFINITION ET L'ARSENAL JURIDIQUE
DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 60
SECTION 2- LES ACTEURS 69
CONCLUSION 71
CHAPITRE 4 : LES RETOMBEES DE LA MULTIFONCTIONALITE DU
PARCOURS VITA
DE DOUALA. 72
INTRODUCTION 72
SECTION1 : L'OPERATIONNALITE DE LA MULTIFONCTIONNALITE
72
SECTION 2-L'INTERDEPENDANCE FONCTIONNELLE. 75
CONCLUSION 93
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 94
CONCLUSION GENERALE 95
QUELQUES PROPOSITIONS POUR L'EPANOUISSEMENT AU PARCOURS
VITA. 98
TABLES DES MATIERES 111
ANNEXES 114

INTRODUCTION GENERALE
I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU SUJET
Avec la résurgence des catastrophes écologiques
importantes, et au lendemain de l'échec du sommet sur les changements
climatiques de Copenhague, les préoccupations environnementales ont pris
une place prépondérante dans les débats politiques
nationaux et internationaux, suscité depuis le début des
années 1970, la prise de conscience universelle de la
détérioration de l'environnement.
Les problèmes environnementaux provoquent ainsi,
l'inquiétude de l'opinion publique, et favorisent l'action politique des
milieux écologiques, et corrélativement l'engagement
écologiste des milieux politiques dans le sens de la protection de
l'environnement. Cet objectif est désormais considéré sur
le plan international comme « une valeur fondamentale »,
élément d'un intérêt général »
reconnu par la communauté des humains dans son ensemble. C'est dans ce
sens que naissent les premières déclarations internationales sur
la protection de l'environnement.
Selon le Principe 2 de la Déclaration de Stockholm de
Juin 1972 « les ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau, la
terre, la flore et la faune et particulièrement les échantillons
représentatifs des écosystèmes naturels, doivent
être préservés, dans l'intérêt des
générations présentes et à venir »
Vers les années 1990, notamment avec la Convention de
RIO (1992) et le Protocole de Kyoto (1997), il va se soulever de
sérieuses inquiétudes et les incertitudes sur ce bien qui
jusqu'ici se voyait attribuer une valeur d'échange nulle mais aussi une
capacité illimitée : l'environnement. Ce qui posait
déjà le problème de sa protection, son utilisation. Mais
l'une des difficultés de la protection de l'environnement part de la
définition de son objet.
LE PETIT LAROUSSE présente « l'environnement
à la fois comme l'ensemble des éléments constitutifs du
milieu d'un être vivant » et comme l' « ensemble des
éléments constitutifs du paysage naturel ou du paysage
artificiellement créé par l'homme1 ». Ces deux
définitions décrivent l'environnement à travers des
éléments qui la constituent, mais les notions de « milieu
» et de « paysage » auxquelles elles ont recours ne sont pas
plus claires que celles
1 Dictionnaire Le Petit Larousse, 2008
d'environnement. Elles traduisent que la définition de
l'environnement ne peut être bien appréhendée qu'à
travers ses composantes : biosphère, écosystème, nature,
paysage.
Un avis de la Cours Internationale de Justice(C I J)
décrit l'environnement comme « l'espace où vivent les
êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et
leur santé, y compris pour les générations à venir
2» Plus simplement, l'environnement est l'ensemble des
conditions naturelles et culturelles dans lesquelles les organismes vivant se
développent.
La protection de l'environnement recouvre deux dynamiques :
l'action de protéger et le résultat attendu, le dispositif ou
l'institution qui protège. La protection de l'environnement peut se
faire par des moyens politiques, technologiques, scientifiques et juridiques
etc. Les moyens juridiques recouvrent les règles préventives qui
réglementent les rapports des différents acteurs avec
l'environnement, des règles dissuasives qui doivent sanctionner la
violation de la réglementation en matière de l'environnement, et
des règles de réparation des dommages causés à
l'environnement. Le droit met également en place des institutions en
passant par des accords et traités chargés de coordonner ou de
contrôler le respect des règles de protection instituées.
C'est dans ce cadre que se développe le droit international de
l'environnement.
La destruction de l'environnement peut s'opérer sous
les formes de pollution de l'air, de l'eau et même sonore, la congestion
des villes dangereuses, la destruction des espaces sauvages, la
dégradation des écosystèmes de grande valeur, les risques
des accidents, les poussées démographiques, etc.
La question de l'environnement n'a pas la même ampleur
partout, autant que sa protection créée des coûts
élevés. C'est ce qui explique le fait que certains pensent que la
protection de l'environnement est un luxe, d'autres par contre pensent que ce
n'est pas une vraie priorité. Pourtant, la protection de l'environnement
doit être intégrée sur le plan national dans les processus
économiques, et sociaux dans le cadre de la décentralisation.
L'identification de la problématique nous permet
d'insuffler des propositions utiles concernant la valorisation du PV.
2 Droit international public p1218.6è
édition.
II- PROBLEMATIQUE
La définition de la problématique est
perçue ici sous le prisme de la valorisation du Parcours Vita dans
l'option de donner à la ville de Douala ou du moins de créer une
autre image de son environnement. Dans ce cadre, nous nous posons la question
suivante : Quelles sont les techniques pouvant permettre la
valorisation de cet espace afin de donner à la ville une autre image de
son environnement ? Autrement dit, comment fédérer autour du
Parcours Vita la fonction sportive avec les fonctions touristiques,
économiques, et les intérêts environnementaux et sociaux?
Il s'agit de l'exigence de la protection de l'environnement qui
intègre la bonne gestion du patrimoine national. Cette protection
répond ainsi à des préoccupations précises
manifestées par la majorité des utilisateurs de cet espace
(chacun selon ses envies), de la nécessité d'avoir dans nos
cités un cadre de vie c'est- à- dire, un environnement
d'évasion dans un parc d'attraction multifonctionnel.
III - INTERET DE L'ETUDE
Nous comptons à travers cette étude montrer dans
le cadre de la décentralisation que, le Parcours Vita est un espace de
vie violé, agressé et qui risque de disparaître si rien
n'est fait. La multifonctionnalité dont les résultats englobent
dans le PV les retombées économiques, sociales et
environnementales lui permet ainsi de jouer un rôle important dans le
développement local.
Par ailleurs l'intérêt de cette étude
réside dans le fait que nous cherchons à montrer que cette nature
sauvage, espace de sport au départ peut fédérer autour de
lui le tourisme, la recherche du bien-être, la chasse, la pêche et
les autres activités ludiques dans un environnement conservé et
protégé.
Le PV aujourd'hui représente une chance pour la ville
de Douala. C'est un espace de vies sauvages à la recherche de son
sanctuaire, un espace de création des revenus, un environnement de
bien-être dont la survie doit interpeller la conscience collective.
L'enjeu se situerait dans la recherche et la conjugaison de plusieurs moyens
pour préserver ou du moins conserver le PV dans sa nature sauvage dans
l'option d'être profitable à l'homme.
Dans le cadre du DESS en Gestion Urbaine, Analyse et
Evaluation des Projets, nous nous sommes proposés de mener la
réflexion sur ce que le PV est, ce qu'il pourrait être afin de
susciter son apport et sa contribution à l'embellissement de la
cité.
Au passage, si le PV est resté fixé dans notre
pensée comme ce circuit de sport, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui
de part sa nature il engendrerait plusieurs autres fonctions marquées
par une certaine interdépendance d'une part, et qu'il pourrait d'autre
part faire partie du Patrimoine National dont la préservation interpelle
la conscience collective.
Ce mémoire nous permet de mettre en application les outils
d'analyse en environnement, en économie urbaine, en aménagement
du territoire et dans le domaine du tourisme.
La pertinence du mémoire réside bien
évidemment dans la cohérence de l'analyse, mais aussi et surtout
dans la pertinence des conclusions susceptibles.
IV.- JUSTIFICATION DU CHOIX DU THEME
Le choix du sujet s'inspire d'un intérêt
écologique à l'égard des questions de
l'environnement et de la préservation du patrimoine national, dont
l'inspiration a pris sa source de la Volonté du gouvernement camerounais
L'utilité pratique de cet exercice de réflexion a
été de sensibiliser sur les missions d'un environnementaliste,
partant de nos antécédents avec le Club des Amis de la
Nature3 à l'Université de Yaoundé, sur ses
inquiétudes et sa propre peur de ce que serait notre vie sans des
espaces naturels de vies, d'épanouissement, d'évasion et de
loisirs dans nos centres urbains. Cet intérêt suscite un autre
beaucoup plus économique lié aux retombéx de la
préservation de l'environnement.
V- OBJECTIFS.
L'objectif de ce travail est d'éclairer le politique en
vue de l'aider dans la prise de décisions dans le domaine de la
création des espaces naturels protégés. Cet objectif se
subdivise en deux objectifs spécifiques :
3 Ancien membre actif du Club des Amis de la Nature ;
Président de la commission des investissements (1984-
1985).Université de Yaoundé.
- montrer que la création des espaces naturels urbains
comme les forêts urbaines au Cameroun est source du développement
économique ;
- partir du cas du Parcours Vita de Douala pour mieux
étayer nos analyses
Plus simplement, ce travail servira à éclairer
et aider les pouvoirs publics à une prise de décisions en vue de
la création des espaces naturels protégés (on peut
à cet effet citer le Canada notamment avec la politique de
création, protection et conservation des zones et des parcs
protégés), des forêts urbaines dont l'absence constitue un
scandale pour un pays comme le Cameroun. Ceci afin de promouvoir un
développement économique viable, socialement équitable et
écologiquement rationnel. Un développement qui ne sacrifie ni les
générations présentes ni le bien-être des
générations future, mais qui allie efficacité,
propreté et sobriété dans l'usage des ressources puis
contribue à l'attractivité de la ville.
VI- METHODOLOGIE
Il n'y a actuellement pas de véritables ouvrages qui
traitent l'ensemble des problèmes réels du PV de Douala. Il y a
des ébauches de présentation du PV, des opinions dans la
presse4 des actions de sensibilisations de certains autres
visionnaires qui en fonction de l'objet du problème abordent
ponctuellement et partiellement certains aspects de ces derniers. Notre travail
de recherche essaye de dresser un panorama quelque peu général
des dangers auxquels cet espace naturel est exposé, et dont si rien
n'est fait il disparaîtra.
Nous cherchons dans ce travail, à comprendre la
synergie entre l'environnement et l'économie au sens de la
création de richesse via le tourisme, le sport et la santé que
recèle le Parcours Vita.
Nous mettons en perspective les intérêts
écologiques, l'importance de la biodiversité et les avantages de
cet environnement naturel et sauvage à travers la persuasion de cette
prise de conscience que nous nous proposons de réaliser. Nous comptons
ainsi apporter une contribution à la lute pour la protection et la
sauvegarde d'un patrimoine collectif.
4 Le Parcours Vita de Douala va (doit)-t-il mourir in
Le Front n°307 du 05 Février 2008.
Résident à Douala, animés par un amour
débordant pour la nature et la passion pour le bien public, nous avons
capté la nécessité d'agir, de parler. Mais avant de nous
nous sommes engagés dans multiples entretiens avec les différents
responsables de la CUD, la MAETUR, les moniteurs du PV. Plus
particulièrement nous nous sommes interrogés sur les approches de
viabilisation du PV.
La lecture préalable d'un certain nombre d'ouvrages
généraux sur l'environnement de façon globale nous a en
effet donné quelques idées sur le raisonnement à
adopter.
Notre analyse est partie de l'idée même du PV. En
fait, la profondeur de la motivation du gouvernement pour une telle donation au
peuple camerounais5, est fondée sur l'image que cet espace
présentait à ses premiers jours. Aussi, il nous revient de
montrer ce qu'il est demeuré, en passant par la réhabilitation et
ce qu'il pourrait devenir.
Notre travail de recherche a privilégié une
approche de présentation descriptive de l'état des lieux et
ouvrir quelques perspectives pour la postérité. Le PV aujourd'hui
risque de disparaître si des actions fortes ne sont pas engagées
pour le sauver. Ce constat amer, triste et mélancolique impose
actuellement et tout de suite une prise de conscience individuelle, un sursaut
patriotique et en ce qui concerne les autorités locales et nationales
des engagements forts pour sortir le PV du piteux état dans lequel il
est oublié.
Ainsi notre approche vise à apporter au gouvernement
des pistes à mobiliser avec l'aide des partenaires étrangers pour
apporter une réponse à ce besoin naturel, cette envie de doter
nos Cités (villes par extension) des espaces de vies sauvages
protégés. L'ampleur de la tâche est immense mais les
bénéfices sont inestimables.
Après la revue des théories économiques
notamment spatiales et environnementales dans notre travail, nous avons
montré la multifonctionnalité de cette espace si elle est
conservée et protégée. Ce travail est
présenté en deux grandes parties subdivisées chacune en
deux chapitres. Avant d'analyser la logique de la protection et la
multifonctionnalité du Parcours Vita à Douala (deuxième
partie), nous faisons une analyse critique de l'offre et la demande des
services publiques notamment ceux qu'offrent les espaces naturels urbains
(première partie). Mais avant nous avons trouvé nécessaire
de présenter les définitions de quelques concepts clés.
5 même s'il n'y a que Yaoundé et Douala
qui en sont aujourd'hui gratifiées,
VII- DEFINITION DES CONCEPTS OPERATIONNELS
L'écologie est l'étude des
relations qui existent entre les différents organismes vivants et le
milieu ambiant.
L'équilibre écologique est le
rapport relativement stable créé progressivement au cours du
temps entre l'homme, la faune et la flore, ainsi que leurs interactions avec
les conditions du milieu dans lequel ils vivent.
L'écosystème est le complexe
dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux, de
micro-organismes et de leur environnement vivant qui par leur interaction,
forment une unité fonctionnelle.
La biodiversité ou diversité
biologique, représente des espèces vivants présentes sur
la terre (plantes, animaux, micro-organismes, etc.), les communautés
formées par ces espèces et les habitats dans lesquels ils vivent.
La variété ici se situe à 3 niveaux : a)-la
diversité génétique au sein des espèces
(variétés des gènes) :
b)-la diversité des espèces
(variété des différentes espèces : plantes,
animaux, champignons, etc..) ;
c)-la diversité des écosystèmes (habitats
ou endroits qui existent sur la terre : forêts, déserts,
rivières, montagnes, etc.).
La pollution : C'est la dégradation de
l'environnement par l'introduction dans l'air, l'eau ou le sol de
matières n'étant pas présentes naturellement dans le
milieu. Elle entraîne une perturbation de l'écosystème dont
les conséquences peuvent aller jusqu'à la migration ou
l'extinction de certaines espèces incapables de s'adapter au
changement.
Ressource génétique : Le
matériel animal ou végétal d'une valeur réelle ou
potentielle.
Par ailleurs les entretiens avec les fonctionnaires de la CUD
ont permis de comprendre la sensibilité du problème foncier dans
la vile de Douala et dans la zone de Douala 5ième en particulier.
Développement durable :La
définition de ces notions nous conduit dans la première partie
à faire une analyse critique de l'offre et la demande des services
publics à l'instar des espaces naturels urbains.

PREMIERE PARTIE
L'OFFRE ET LA DEMANDE DES SERVICES PUBLICS ET
LA
SPATIALITE : CAS DES ESPACES NATURELS
URBAINS COMME LE PARCOURS VITA.
INTRODUTION DE LA PREMIERE PARTIE
Les lois de la décentralisation de 19966ont
attribué aux collectivités territoriales (régions,
communes) des pouvoirs importants en matière d'aménagement du
territoire, de la planification, d'enseignement et d'intervention
économiques. La nouvelle répartition des compétences entre
l'Etat et les collectivités décentralisées a
modifié l'équilibre des pouvoirs entre l'Administration centrale
et locale et les populations sont plus que jamais sollicitées et
impliquées dans les projets qui concernent leur devenir.
En effet les libéraux7 affirment d'une part
que seul le marché de concurrence pure et parfaite assure l'allocation
optimale des ressources et d'autre part, ils trouvent nécessaire
l'intervention de l'Etat de plus en plus dans la fourniture des services
indispensables à la population, et des services que le marché ne
pourrait pas fournir. D'où la nécessité pour ces adeptes
du marché de reconnaître les vertus de la théorie de
l'Etat8, théorie qui ne remette pourtant pas en cause la
suprématie du marché. Le point de départ sera la
théorie de l'équilibre général
Walraso-Parétien construite pour un marché de concurrence pure et
parfaite et dans lequel il faut intégrer les biens collectifs.
Si au niveau d'un marché de biens privés tout se
règle par la confrontation entre l'offre et la demande aboutissant
à un prix d'équilibre, la question des biens collectifs trouvera
alors une solution dans la confrontation entre une offre de services publics de
la part de l'Etat et une demande de la part des citoyens, le point
d'équilibre étant le prix fiscal (impôt) que les citoyens
consentent à payer. Ce parallélisme entre le marché de
biens privés et le marché de biens collectifs pose
néanmoins un sérieux problème à la pensée
des libéraux ; c'est celui de la révélation des
préférences collectives.
6 La décentralisation au Cameroun est
prévue par la loi n° 96/06 du 18 Janvier 1996 relative à la
révision de la Constitution de Juin 1972. Elle consacre un titre entier
aux Collectivités territoriales de la République et fixe de ce
fait le cadre autour duquel s'articulent les lois décentralisatrices du
22 Juillet 2004 ou loi d'orientation de la décentralisation. Cette
dernière définit la décentralisation comme « un
transfert par l'Etat aux collectivités territoriales
décentralisées de compétences particulières et de
moyens appropriés ».Pour le Législateur, » la
décentralisation constitue l'axe fondamental de promotion du
développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au
niveau local ».Au 1er Janvier 2010 a débuté le
transfert de compétences et de ressources aux Communes et aux
communautés Urbaines. L'un des atouts essentiels du processus
étant de répondre à un besoin sans cesse exprimé
par les populations de la base de participer à la prise de
décision et à la gestion des affaires les concernant, d'où
toute l'attention portée au suivi des activités des élus
locaux dans l'exercice de leurs fonctions où le moindre faux pas ne leur
sera pas pardonné.
7 Par exemple J B Say, Quesnay, S Jevons, L. Walras
etc....
8 Ce ne sont pas ces derniers qui
légifèrent quant à la théorie de l'Etat mais J M
Keynes (1936)
Pour résoudre ce problème, plusieurs solutions
sont possibles, notamment celles qui prennent en compte le mécanisme de
vote parce qu'il serait utopique d'avoir une unanimité dans la
société. Or pour les libéraux, il n'existe que des
préférences individuelles ou alors pour être plus
précis une préférence collective ne peut être que
l'agrégation de préférence individuelles .A ce point, on
aboutit au paradoxe de CONDORCET ou Théorie d'impossibilité de
ARROW (1963 ; 1974)9 qui démontre que la transitivité
des choix individuels aboutit à une intransitivité des choix
collectifs.
Une solution avancée par l'école du public
choice (BUCHANAN, 1969)10 est de considérer le
marché des biens collectifs comme un marché politique dans lequel
les coalitions vont se former pour obtenir les services collectifs qu'elles
désirent. On en arrive à une situation de marchandage de voix
à deux niveaux : entre les membres de la société civile
(échange des votes pour une route contre celui pour une piscine) entre
la société civile et la société politique
(échange de votes contre échange de promesse de services
collectifs).
Dans ce modèle, les hommes politiques sont des
entrepreneurs de la production de services collectifs, ils sont une classe
politique face aux électeurs-consommateurs. Ils ne sont pas
considérés comme les représentants de la
société civile dans laquelle il n'y a plus de rapport du
politique. Ces deux catégories, société civile et
société politique vont se rencontrer sur un marché, celui
de bien social.
Par ailleurs les électeurs sont d'abord des
consommateurs et leurs objectifs est d'optimiser leur satisfaction y compris en
accédant à des services publics dont ils vont essayer de ne pas
payer la contre partie que ce soit sous forme de prix d'accès ou
d'impôt. C'est la question de « free rider », le
cavalier libre, chacun a tendance à tenter de devenir un cavalier libre
qui jouit d'un bien ou d'un service à consommation jointe sans en
partager les coûts. Peut -on faire autrement par l'éviction de
la question qui consisterait à rendre au secteur privé la gestion
des services collectifs des parcs , de la culture, ou des lieux publics de
loisirs...Comment y parvenir tout en excluant pas les personnes à
faibles revenus ?
9 ARROW K.J. «limited knowledge and economic
analysis» American Economic Review, 1-10 march, 1974.
10 Buchanan J.M « External Diseconomies,
Corrective Taxes and Market Structure» American Economic Review; 1969.
Tout d'abord soit en privatisant tous les services collectifs
pou rendre la production et la gestion des services collectifs au secteur
privé ; soit en établissant un standard de coûts
d'accès à ces services ou alors en établissant un «
voucher » autrement dit un bon, un chèque qui permet
l'accessibilité à tous les services au standard défini.
Une autre question est celle de la localisation de ces
services collectifs dans un espace, sur un territoire pour pouvoir être
utilisé par la population dans le but de satisfaire leurs besoins et
permettre le développement local. Cette question trouve les solutions
dans l'économie notamment l'économie territoriale.
CHAPITRE 1 : APPROCHE DOCTRINALE DE GESTION DES
AIRES
PROTEGEES DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
INTRODUCTION
L'environnement a été pendant longtemps partie
intégrante des préoccupations des hommes, quittant des simples
discours à la matérialisation. Au niveau des relations
internationales contemporaines, la protection de l'environnement constitue une
problématique globale .Tantôt considéré comme un
bien économique, comme un espace de valeur, un paysage, l'environnement
a été au centre de nombreuses pensées.
En partant de l'appréciation du public, de nombreux
auteurs ont toujours pensé que le succès enregistré au
niveau de l'offre du service public doit être soutenu par la
qualité du service offert. En considérant l'environnement comme
un service conjointement offert par les opérateurs privés et
l'Etat, la pertinence du rôle de ce dernier dans la facilitation de
l'accès au service des aires protégées par le plus grand
nombre a été pendant longtemps abordé dans la
littérature sous le prisme de l'économie de l'environnement,
l'aménagement du territoire et la spatialité de l'offre et la
demande des services collectifs.
SECTION I -ANALYSE ECONOMIQUE DE L'ENVIRONNEMENT.
Le cadre d'intelligibilité théorique de la
localisation retient particulièrement dans cette partie, le
modèle standard de « l'économie urbaine » (avec son
analyse centre /périphérique) et l'approche en termes de «
firmes », « d'acteurs » ou de « prise de décision
».
La trame centrale de cette sous partie repose sur les faits que
:
- pendant longtemps considérés comme la
résultante de l'investissement privé étranger, la
création du PV à Douala est, depuis quelques décennies,
l'oeuvre du gouvernement camerounais.
- Si pour les promoteurs étrangers le calcul en
matière de localisation est un facteur décisif, les promoteurs
nationaux tout comme les pouvoirs publics intègrent davantage des us et
pratiques en interaction dynamique avec le milieu local (J.R. ESSOMBE,
2007a).
En nous basant sur l'idée de L. DAYAN11
(2004) selon laquelle : « ni l'industrie
environnementale, ni la tentation réglementaire, ni la fiscalité
écologique, ni le marché considéré isolement et
sans perspective d'ensemble, l'approche « end of pipe » de
la durabilité ne sauraient nourrir une stratégie et entretenir le
rêve d'un développement durable ».12 Ce contexte est
aujourd'hui enrichi avec la création du PV au Cameroun dans ces deux
grandes villes notamment Douala et Yaoundé.
La mise en oeuvre de la durabilité dans le cadre de la
mondialisation des économies, de la dépersonnalisation de
l'information et de la globalisation des développements, requiert de
modifier les stratégies de développement et les modes
d'organisation en y intégrant les sources de loisir et de tourisme tel
que le requiert de Parcours Vita de Douala.
Cette durabilité concerne directement autant les modes
de gouvernance que les domaines de gestion, du management, de la communication,
des technologies de fabrication, du design des produits et les politiques
d'achat et vente des entreprises. Et de ce fait, dans une économie
mondialisée, la ressource critique devient le savoir-faire et
l'intelligence de l'information.
La compétitivité d'une ville à l'instar
de celle de Douala, repose alors sur la qualification et la polyvalence de son
réseau relationnel d'échanges, la qualité de ses
coopérations interpersonnelles et commerciales stratégiques, ses
déclinaisons relationnelles et informationnelles locales et la
flexibilité de son organisation et les compétences du management
donnant ainsi une marge importante à l'attractivité de
l'environnement de la ville de Douala.
I.1. L'émergence du concept de l'environnement
De l'effet de serre au recul de la biodiversité en
passant par la pollution sous ces formes multiples, la question
environnementale a aujourd'hui totalement investi le champ de la discipline
économique. Cette révolution culturelle débute dans les
années 1970 avec la prise de conscience écologique qui suit la
médiatisation des premières grandes pollutions.
11 Dayan Léo «
stratégie du développement durable ; l'écologie
industrielle : une des clés de la durabilité » in revue
d'économie rurale et urbaine (RERU), 2004, p 28.
13 Maurice Allais « Traité
d'économie pure », publié avec le concours du Centre
national de la Recherche scientifique ; 5 vol in 4°, 1952, 984 p.
Les économistes mondiales prennent progressivement la
mesure du coût environnemental de la croissance : il s'agit d'une
mutation profonde de la perception de l'environnement jusqu'alors peu
concernée par les impacts environnementaux. L'environnement biophysique
par le biais des sciences de l'écologie et de l'activité
terrestre est associé à des systèmes et des cycles dans
l'habitat. Ceux-ci indiquent des seuils et des limites tant en
approvisionnement (surexploitation des ressources naturelles comme le
pétrole ou les réserves halieutiques) qu'en
débouchées (pollution des nappes phréatiques, par
exemple).
Des modèles de croissance en tant que
conséquence de l'activité humaine, ont manifestement un impact
négatif démontré sur l'environnement. Cette prise de
conscience est récente dans les cultures modernes. L'étymologie
du terme économie de l'environnement vient d'oikos, c'est-à-dire,
la maison et de nomos c'est-à-dire, la règle. Ceci
témoigne d'une volonté de gestion efficace de la maison,
c'est-à-dire de l'habitat dans la biosphère et renvoie à
celle de l'écologie qui étymologiquement vient d'oikos,
c'est-à-dire, la maison et de logos, c'est-à-dire
l'étude.
Si la pensée des Physiocrates et des classiques liait
sans ambiguïté l'économie à la rareté des
ressources naturelles, la théorie néo-classique n'a retenu de la
rareté que sa dimension financière et a occulté son
possible épuisement. Ainsi la première rencontre de
l'économie et de l'écologie (constituée en science)
intervient probablement en 1968 au sein du rapport du Cercle de Rome,
intitulé « les limites de la croissance ».Ce texte alarmiste
sur les limites des réserves énergétiques marque la
redécouverte du concept environnemental par la théorie
néoclassique.
I.1.1.L'homme, la nature et la technique.
En réalité les rapports entre l'homme et la
nature ont connu une certaine évolution culturelle qui passe d'une
totale dépendance de ce dernier à la nature par les fruits et la
crainte des aléas climatiques pour les tributs de chasseur-cueilleur,
à l'apparente indépendance de l'homme moderne par l'exploitation
des ressources naturelles. Ce dernier a cru pouvoir totalement s'affranchir de
son milieu en le transformant, en le domestiquant, voire en l'asservissant,
grâce au développement d'idéologies, grâce aux
progrès techniques.
De ce point de vue l'environnement devient ce qui est au tour
et nécessaire à l'humain, ce qui lui est étranger et par
un glissement de sens, ce sur quoi l'homme ne peut agir. Comme nous l'avons dit
plu haut, n'est-il pas illusoire de croire que l'activité humaine
n'interagit pas avec l'environnement ? Source et débouché de
l'activité économique, la nature existe avec l'espèce
humaine et non pas malgré l'homme. En s'excluant de la nature, l'humain
fausse sa perception, sa pensée, ses valeurs, son rôle, son
analyse de la situation et perturbe profondément l'habitat.
I.1.2.Objectif de l'économie de
l'environnement.
L'objectif de l'économie de l'environnement est
d'intégrer les valeurs écologiques de l'environnement dans le
cadre particulier de l'économie et plus précisément des
Sciences économiques et sociales. Ce que les économistes
néo-classiques avaient rejeté hors de leur champ de vision,
probablement inconsciemment, l'économie de l'environnement cherche
à inclure.
L'économie de l'environnement est la recherche d'une
efficacité nouvelle et réelle qui intègre les interactions
entre les intervenants, mais aussi entre les interventions humaines et
l'environnement. Cette nouvelle orientation n'est pas exclusive de l'ancienne
vision économique : il s'agit au contraire de bâtir avec
l'économie traditionnelle un édifice qui tienne compte de la
valeur écologique et des variables environnementales.
Cette évolution n'est pas neutre, elle suppose un
certain nombre d'hypothèses de base et surtout elle nécessite de
redéfinir des notions centrales de l'économie : le
bien-être des individus, la production et l'utilisation des ressources.
Dans l'économie néo-classique, le bien-être tient compte de
la consommation de biens marchands.
En économie de l'environnement, il faut y ajouter la
valeur que les individus confèrent à leur environnement dans un
cadre de vie, et finalement sa valeur réelle et symbolique souvent
impossible à monétiser. La production et l'utilisation globale
des ressources biotiques et abiotiques est aussi une corrélation
à inclure dans l'évolution de l'architecture économique
bâtie.
I.2 .Théorie économique et environnement.
Les néo-classiques s'intéresse aux optimums,
c'est-à-dire la meilleure allocation des ressources rares à
usages alternatifs, compte tenu des préférences des agents
économiques, résumées dans une fonction d'utilité.
L'optimum de Pareto, consiste à se trouver dans une situation telle que
toute amélioration de bien-être d'un individu (ou d'une
catégorie d'individu) ne peut se faire qu'au détriment d'un autre
individu (ou d'une autre catégorie d'individus).
Autrement dit, l'optimum de Pareto est une situation où
toute allocation initiale a été répartie. A ce titre,
c'est une situation de référence de la théorie
économique dans la mesure où il est possible de déterminer
un optimum de Pareto, à condition de respecter la concurrence dans les
marchés et de laisser le système des prix s'ajuster. Pourtant
l'équilibre marchand n'est pas nécessairement optimal d'un pont
de vue social ou environnemental.
La recherche de l'optimum se déroule dans le cadre
strict des échanges marchands. Certains effets qui ne sont pas
affectés d'une valeur sont complètement écartés de
la recherche d'efficacité alors même qu'ils sont susceptibles
d'affecter l'utilité des agents économiques. C'est
précisément le cas lorsqu'on occulte la dimension
particulière que constitue l'environnement : ce sont les effets
externes ou externalités qui peuvent être positives et
améliorer le bien-être des agents ou alors elles peuvent aussi
avoir une valeur négatives si elles réduisent le bien-être
sans compensations financières(cas des riverains d'une voie
ferrée, ils souffrent de la pollution sonore et atmosphérique et
de la baisse marchande de leurs biens immobiliers s'il y a une croissance du
trafic qui génère des revenus d'exploitation
supplémentaire). Autrement dit, il est nécessaire d'inclure dans
les prix les dégradations environnementales (pollutions,
surexploitation) qui, sinon seraient ignorés.
En claire, internaliser les effets environnementaux, revient
à trouver un équilibre tel qu'en tenant compte de la variable
environnemental, on obtient un équilibre de Pareto. Où alors
l'amélioration du bien-être des individus sensibles à la
variable environnementale va lasser un autre groupe d'individus. Cet optimum de
pollution (qui débouche sur les marchés de droits à
polluer) est souvent la critique la plus importante formulée par les
écologiques contre l'économie de l'environnement.
L'économie de l'environnement est intimement
liée aux politiques économiques et aux choix qui en
écoulent, choix qui doivent se formuler de la façon la plus
objective possible et doivent à ce titre se fonder sur des principes
indéniables.
I.2.1.Evaluation monétaire : la valeur de
l'environnement.
L'évaluation monétaire de l'environnement
viendrait à considérer l'environnement comme un bien
économique qui peut s'échanger sur un marché. En
économie la notion de valeur est centrale. Affecter une valeur à
l'environnement est donc indispensable pour sa parfaite prise en compte dans
les équations. A ce titre l'environnement est un bien économique.
Tout bien économique est un bien rare et ce serait un truisme de dire
que la qualité de l'environnement est devenue « rare ».c'est
-à -dire insuffisante par rapport aux besoins ou aux désirs que
l'on éprouve à son égard. Il en résulte que
l'environnement est manifestement un objet de raisonnement économique,
à savoir celui de l'allocation judicieuse de ressources à
affecter à sa protection et à sa gestion.
Le concept de bien-être en économie et par
conséquence dans la pratique de l'économie appliquée, est
une chose pas simple. Beaucoup de bons traités d'économie n'y
consacrent qu'une attention superficielle ou alors dans des termes sans aucune
liaison avec l'environnement.
Pourtant le traité d'économie pure de Maurice
ALLAIS13 traite les divers aspects de la notion de bien. Dès
1970, K. ARROW14 (1974) et DEBREU15 (1959) mettent au
point un outil d'analyse qu'ils ont appelé l'espace des biens, chacun de
ceux -ci étant défini par sa quantité, ses
caractéristiques physiques, sa date et sa localisation. Cette
formulation des choses à la fois simple et précise, n'est
passée dans l'enseignement courant qu'avec les leçons de
théorie micro-économique de MALINVAUD16 parues en
1969.
13 Maurice Allais « Traité
d'économie pure », publié avec le concours du Centre
national de la Recherche scientifique ; 5 vol in 4°, 1952, 984 p.
14 Arrow K.J « Limited knowledge and economic
analysis » American Economic Review; 1974.
15 Debreu G «Théorie de la valeur, trad.
frse Dunod, Paris 1959.
16 Malinvaud E « Leçon des théories
microéconomiques » Dunod, Paris 1969 ; Pp 27.
Quoi qu'il n'y ait rien d'environnemental dans la formulation
de l'espace des biens proposés par Arrow et Debreu, mais l'introduction
du concept d'externalité comme un élargissement de ce même
concept de bien, et l'incorporation de celui du bien collectif.
Les notions d'externalités et de biens collectifs sont
évidemment antérieures à la classification D'ARROW et
DEBREU. Mais c'est la représentation des biens que ces derniers ont
fournie qui a pu être ensuite généralisée au cas des
externalités et des biens collectifs. Ces deux étapes ont permis
de faire entrer externalités et biens collectifs dans l'analyse des
économies de marchés autant que de la planification (que
développaient par ailleurs en parallèle ARROW et
HURWICZ17 (1930) ainsi que MALINVAUD).
La portée environnementale de l'extension du concept de
bien aux externalités et aux biens collectifs est considérable
d'une part, en ce qui concerne les externalités, celles-ci visent
à rendre compte d'interdépendances entre agents
économiques qui ne s'établissent pas par l'intermédiaire
du système des prix. C'est ce qui se passe en présence des
phénomènes de pollution : des quantités physiques d'objets
dits polluants accompagnent l'activité productive et affectent d'autres
agents de l'économie sans que ce phénomène ne soit
justiciable d'une analyse en termes d'échanges. L'effet positif ou
négatif est imposé au récepteur au lieu d'être le
résultat d'une décision de sa part.
L'intuition fructueuse D'ARROW (1974) est d'y avoir
néanmoins appliqué le concept de bien, et de le faire ainsi
rentrer dans l'analyse des comportements économiques : comportements
volontaires des auteurs des externalités et comportements passifs des
récepteurs. Par cette démarche il permettrait d'appliquer aux
premiers l'analyse classique des producteurs de n'importe quel bien tout en
laissant à des analyses nouvelles les comportements passifs des
récepteurs de ces biens indésirables.
Intervient alors le concept de bien collectif, modification de
ce que S.KOLM18 (1968) a justement appelé le «
concernement » simultané de plusieurs agents économiques par
l'existence ou la production de certains biens. Les phénomènes
environnementaux sont non seulement des externalités, mais ils
concernent plusieurs individus à la fois.
17 Hurwicz «La Planification Economique
Collectiviste», 1930.
18 S.Kolm : « La théorie économique
générale de l'encombrement » ;Paris,Futuribles,1968.
Le PV est déjà une composante du paysage urbain
de la ville de Douala dont l'abandon ou l'aménagement influe et influera
durablement sur son image. D'où la problématique de
l'aménagement du territoire visant avant tout à bâtir dans
les villes une armature spatiale durable qui doit intégrer une structure
spatiale de préservation et de conservation de la nature sous formes de
réserves naturelles, sites classés, forêts urbaines,
espaces verts de haute valeur biologique.
I.2.2. Aménagement du territoire : une affaire
d'origine ancienne
L'aménagement du territoire est une expérience
ancienne. En effet l'homme a toujours aménagé l'espace au
gré de ses besoins. Au début il s'agissait de domestiquer la
nature et de la dominer. La répartition des activités sur le
territoire était perçue comme un phénomène naturel.
Mais les incidences de ces pratiques furent désastreuses car elles ont
donné lieu à la dégradation des ressources naturelles. Par
la suite, les Etats modernes ont senti la nécessité de
procéder à l'aménagement consciente et
réfléchi du territoire en tant qu'acte volontariste et non
spontané.
En Europe, la fin du 20ième siècle a
vu progressivement émerger la question du paysage comme enjeu
sociétal de gestion de l'environnement et d'aménagement du
territoire. Dans le même temps s'est développée une demande
sociale et politique pour une plus grande participation de la population
à la gestion du paysage et de son cadre de vie en général,
ce qui a entraîné de nouvelles exigences.
En effet, le paysage est encore trop souvent
appréhendé à travers des définitions disciplinaires
(le paysage comme structure expressive du territoire en géographie,
l'éco-paysage fonctionnel en écologie, le paysage comme l'objet
de composition en architecture du paysage, etc....) qui rendent difficile une
conception pluridisciplinaire de sa gestion.
Pour se généraliser, la question du paysage a eu
la contribution de la mobilité des personnes, la démocratisation
du tourisme et la diffusion de la photographie. Ainsi le paysage est depuis
convoqué dans divers discours touristique, politique, scientifique,
etc., pour parler de lieux sous un nouvel angle de vue.
En Afrique et particulièrement au Cameroun, le
développement des villes s'est fait sans prise en compte
véritable des enjeux de l'aménagement du territoire. Pour les uns
et les autres les constructions des villes guidées par le hasard, sous
les séquelles de la colonisation, s'est faite en absence d'une politique
d'urbanisation, la politique d'aménagement urbain n'a pas
intégré des aires de loisirs des parcs d'attractions et les aires
ou sites protégés, des espaces verts, etc. qui participent par
leur implantation réfléchie à l'attractivité du
territoire.
Dans les années 1960, le constat alarmant des
scientifiques a contribué certes à modifier les us et les
coutumes des uns et des autres. , au point où de nos jours la gestion
durable et efficace de l'environnement nécessite une planification
impliquant les notons de révisions et d'anticipation, gestion qui
utilise des outils classiques appropriés à l'aménagement
du territoire.
I.2.3. Le paysage, un enjeu de gestion de
l'environnement et d'aménagement du
territoire.
Depuis la seconde guerre mondiale les mutations
paysagères ont atteint une vitesse et une ampleur jamais
observées auparavant selon ANTROP19 (1997) qui
considère en effet l'urbanisation, la rationalisation de l'agriculture
et le développement des infrastructures de communication comme les trois
principales causes de changement dans les paysages ruraux traditionnels.
Intervenant dans les paysages tant du quotidien que des
loisirs, ces modifications ont contribuées à faire prendre
conscience, aux populations et à leurs représentants de
l'existence et de la valeur des paysages. Ceux -ci sont maintenant reconnus
comme constitutifs du cadre de vie, comme composantes de la diversité
culturelle et écologique des territoires, ainsi que comme supports de la
mémoire et de l'identité des habitants (PINCHEMEL20
1992 ; JACOBS21 2000).
19 Antrop « The concept of Traditional Landscapes
as abase for Landscape evaluation and planning. The example of Flanders Region
Landscape Urban Plann.»; 1997.Pp 38, 105-107.
20 Pinchemel: «La face de la terre,
éléments de géographie » Armand Colin ; Paris,
Review, 1-10 march ,1992.
21 Jacobs «Landscape prospects of the next
millennium»Landscape Urban Plan, 2000, Pp 47,129-133.
D'ailleurs, SCAZZOSI22 (2003) constate qu'à
travers les revendications pour le paysage, les gens expriment leurs
aspirations pour la qualité des lieux et la sauvegarde de leur
identité culturelle. En tant que ressources et parfois emblème de
la promotion touristique, les paysages peuvent également endosser une
valeur marchande.
Pour BRIFFAUD23 (2001), l'origine de la
volonté de « paysagement » c'est -à -dire « de
contrôle et d'intervention sur les formes paysagères » se
manifeste par la multiplication d'initiatives et par l'émergence de
nouvelle échelles de planification paysagère (élaboration
des politiques paysagères locales, régionales et même
internationales).
I.3. L'aménagement du territoire face à
l'attente et l'exigence de gestion du paysage ou
les objectifs de
l'aménagement du territoire.
Discipline scientifique et technique d'administration publique
visant l'organisation volontaire des territoires au bénéfice des
sociétés qui les occupent, l'aménagement du territoire
peut jouer un rôle spécifique important en réponse à
la demande sociale et politique de gestion du paysage. Très
récemment, avec l'émergence de la prise de conscience
environnementale, l'aménagement du territoire a progressivement dans sa
réflexion et sa pratique la protection de la nature d'abord et de
l'environnement ensuite. Alors que les objectifs de l'aménagement du
territoire dépendent de la problématique à laquelle est
confrontée le territoire en question, J. LAJUGIE24 (1979)
voit une convergence des points de vue autour de la définition de
l'aménagement du territoire.
I.3.1. Définition de l'aménagement du
territoire.
La notion d'aménagement du territoire couvre des
réalités diverses. Sa définition dépend du contexte
et des problèmes à résoudre. L'aménagement du
territoire est présenté comme « un ensemble de mesures
destinées à assurer un développement
équilibré des régions par une meilleure répartition
des populations et des activités ».
22 Scazzosi «Landscape and cultural Landscape
European landscape Convention UNESCO Policy». In: UNESCO, éd;
Cultural landscapes: the Challenge of Conservation.Paris: UNESCO,
2003.Pp55-59.
23 Briffaud : « Sauver les apparences? Questions
aux politiques du paysage? » in :Actes du Colloque International de Saint
- Emilion ,Patrimoine et Paysages Culturels,3,Bordeaux,France ; Mai -
1er Juin 2001.
24 Lajugie J. « Espace régional et
aménagement du territoire » .Dalloz. 1979.
En outre, dans le contexte de la décentralisation, la
politique d'aménagement du territoire doit toutefois être le
développement de la compétitivité des territoires et la
recherche de l'excellence.
Eugène CLAUDIUS PETIT25 (2003) affirme que
l'aménagement de territoire est la recherche dans le cadre
géographique d'une meilleure répartition des hommes en fonction
des ressources naturelles et de l'activité économique.
Dans le même ordre d'idées,
DELAUBADERE26 (1993 ; P.487) disait que «
l'aménagement de territoire est la recherche de la meilleure
répartition géographique des hommes en fonction des conditions
économiques territoriales ». Alors que Michel MIGEOT (1975 ;
P.1) avance que « l'aménagement du territoire est une
affirmation du développement harmonieux de l'ensemble des régions
en fonction de leur vocation propre. L'aménagement de l'espace est
rarement fondé sur un calcul d'efficacité économique. La
politique d'aménagement du territoire conserve sa vocation à
réduire les inégalités entre les territoires. Elles place
par exemple parmi ses objectifs l'accès de la plus grande partie
possible du territoire national à des réseaux haut débit
».
Pour Hassane IDE ADAMOU27 (1994 ; P55),
l'aménagement du territoire « est un système d'actions
cohérentes volontaires multidisciplinaires par lequel une organisation
vise une meilleure répartition spatiale des activités
économiques. Mais cette politique peut ne pas prendre la même
forme aussi bien dans les pays développés que les pas
sous-développés ».
L'aménagement du territoire a pour fin à la fois
de promouvoir la mise en valeur des ressources locales et d'améliorer le
cadre de vie et les conditions d'existence des habitants en atténuant
les disparités de développement économiques et sociales
entre les régions (territoires) par une organisation prospective de
l'espace reposant sur une orientation volontariste et concertée des
équipements et des activités. Pour dire autrement,
l'aménagement du territoire s'impose comme un instrument de
rétablissement des équilibres
25 Claudius Petit E : « La politique
d'aménagement du Territoire », Revue d'Histoire 3 - n°79,
2003, Pp 43 - 52,2003.
26 Délaubadère : « Droit Public
Economique ». Précis Dalloz, réed. 1993, Paris.1987.
27 Hassane Idé Adamou : « Analyse de la
stratégie du Développement Rural par l'Approche
Aménagement et Gestion des Territoires dans les Pays du Sahel : Cas du
Burkina - Faso et du Niger. »Thèse de Doctorat de 3ième
Cycle, Université de Ouagadougou. Mai 1994 , P 55.
socio-économique et environnemental et un outil de
correction des disparités régionales dues à une quelconque
croissance.
I.3.2.Les objectifs de l'aménagement du
territoire.
De manière opérationnelle, en matière
d'aménagement du territoire, on retrouve diverses formes d'objectifs.
Objectifs économiques : Assurer la
croissance économique des régions et partant de l'économie
nationale dans son ensemble (support de la croissance), assurer une utilisation
optimale de l'espace et des ressources naturelles et humanitaires ;
Objectifs sociaux : Rechercher la justice
sociale par une meilleure répartition des fruits de la croissance, des
équipements, des équipements et des infrastructures
socio-collectifs, corriger les disparités intra et inter spatiales de
développement
Objectifs politiques : Résoudre des
problèmes de cohésion nationale, éviter les
problèmes de dislocation de l'ensemble nationale, intégrer les
localités (régions, communes) à l'ensemble national.
Objectifs environnementaux et écologiques
: Maîtriser les problèmes de dégradation de
l'environnement, améliorer le cadre de vie, l'espace de vie.
Pour le Cameroun en général, et de la ville de
Douala en particulier, tous ces objectifs nous semblent pertinents dans le
cadre de l'aménagement du territoire pour la recherche du
développement économique. Ainsi l'aménagement du
territoire doit donc intégrer de façon progressive par une
approche globale du territoire la gestion environnementale et
paysagère.
L'aménagement du territoire assure en effet un
rôle de mise en cohérence des différentes dimensions du
territoire en vue d'assurer la compatibilité entre ses diverses
fonctions. En mobilisant diverses disciplines (géographie,
l'économie, l'histoire, la sociologie, l'écologie, le droit,
etc.) il cherche à proposer une réponse coordonnée
à une problématique, et non autant de réponses que de
regards disciplinaires.
En tant que processus de décisions publiques,
l'aménagement du territoire doit intégrer l'information de la
population, sa participation, la concertation entre les acteurs, etc. pour
élaborer des politiques et modalités consensuelles de gestion du
territoire. Face à la demande de gestion du paysage,
l'aménagement du territoire se positionne donc comme une discipline et
une technique ouverte aux divers regards scientifiques et sociétaux,
à travers une démarche pluridisciplinaire et concertée.
I.3.3. Le concept de paysage opérationnel en
aménagement du territoire.
L'ensemble des définitions géographiques qui
s'accordent à considérer, le paysage comme produit de
l'interaction entre l'environnement naturel et les hommes, ne font pas encore
l'unanimité quand à sa nature : le paysage est-il l'objet du
territoire ou son image perçue ? AUZANNEAU28 (2001) constate,
en effet, que « s'interroger sur la nature du paysage conduit
inévitablement à articuler les notions de territoire et de pays
avec celles de regard et de perception ».
En fait, les définitions qui n'intègrent pas la
dimension visuelle du paysage instaurent une confusion entre le terme «
paysage » et des vocables comme « espace », « territoire
» et «géosystème » etc. Cette dimension permet en
effet de distinguer les notions de « pays » de celle de «
paysage » : alors que le pays est notre milieu de vie, le paysage est ce
que l'on en voit. La définition établie par la Convention
européenne du paysage va même au-delà en introduisant la
dimension de la perception : le paysage y est présenté comme une
« partie du territoire telle que perçue par la population »
(Conseil de l'Europe, 2000). Le paysage est ainsi défini comme la
dimension perceptible de l'espace (COLLOT29, 1995).
Pour DOMON30 (2000), le paysage ne peut pas non
plus être réduit à la stricte configuration des champs
visuels car le caractère essentiel du paysage réside dans «
l'assemblage d'éléments disjoints et informes que le regard
c'est-à-dire en fait l'esprit, réunit dans un ensemble signifiant
à parti de présupposés culturels »
(CHENET-FAUGERAS31,1995).
28 Auzanneau : « Le paysage, expression d'une
culture plurielle », in : Actes du colloque international de Saint -
Emilion, Patrimoine et Paysages culturels, 3, Bordeaux, France, Mai-
1er Juin 2001.
29 Collot : Point de vue sur la perception des
paysages in : Robert A, édition la théorie du paysage en France
(1974-1994
30 Domon : « Evolution du territoire laurentidien
: caractérisation et gestion des paysages »2000
31 Chenet - Faugeras : « le paysage comme parti
pris. » in Roger A, édition de la théorie du paysage en
France, (1974-1994).
Cette perception du paysage fait apparaître la
dichotomie entre la dimension objective (objet -territoire) et la dimension
subjective (image perçue) qui ne doit cependant pas conduire, selon
DEWARRAT32 (2003) à exclure une pour l'autre, sans quoi on
obtient selon les cas « des approches uniquement objectivant et techniques
des territoires (géologie, biodiversité, etc.) perdant toute
relation avec les paysages tels que les entend le sens des populations
concernées » ou au contraire, des approches très subjectives
(esthétiques, poétiques, etc.), « bases insuffisantes pour
forger les consensus politiques et sociaux nécessaires à l'action
». Ces deux dimensions constituent les deux faces indissociables de la
même réalité : le paysage.
Parce que, particulièrement accessibles au public,
émotionnellement et intellectuellement, le paysage est ce que les gens
voient, imaginent ou comprennent quand ils regardent leur environnement
(FAIRCLOUGH33, 2002).En aménagement du territoire, le paysage
peut donc être mobilisé pour « donner à voir » le
territoire et sensibiliser les populations aux enjeux territoriaux qui s'y
transcrivent visuellement.
Le paysage fin perçu comme moyen de
l'aménagement du territoire fait face à une multitude de
définitions scientifiques. Devant la demande politique et sociale d'une
gestion paysagère démocratique, le concept de paysage tel que
nous l'avons défini tient une double position en aménagement du
territoire. Il est tantôt un objet commun à aménager,
tantôt un support de discussion et de visualisation des problèmes
(GUISEPELLI34, 2005). Il est donc, aussi bien un des enjeux de
l'aménagement du territoire - dont les caractéristiques
s'accordent à l'élaboration d'une politique de gestion
respectueuse des divers regards paysagers existant qu'un instrument
d'interpellation et de sensibilisation des différents acteurs du
territoire sur les questions de son aménagement, contribuant à
l'élaboration d'une gestion concertée du territoire.
32 Dewarrat : « Paysages Ordinaires : de la
protection au projet ». Sprimont. 2003.
33 Fair Clough : « Aspects of landscape
characterisation and assessment in the
UK.in : Conseil de l'Europe, édition
Première réunion des ateliers de la mise en oeuvre de la
Convention européenne du paysage. Conseil de l'Europe, Strasbourg,
France, 2002 ,42 - 44.
34 Guisepelli : « Représentations sociale
du paysage, négociation locale et outils de débat sur le paysage
»,2005
SECTION II- L'ESPACE ET L'OFFRE DES SERVICES
COLLECTIFS.
Les travaux historiques de Von THUNEN (1827)35 et
CHRISTALLER (1933)36 vont favoriser peu à peu la
compréhension des conséquences économiques de l'espace.
Initié par Walter ISARD (1956)37, en Science Régionale
et W. ALONSO (1964) en Economie urbaine, un nouveau programme de recherche se
développe.
On distingue progressivement une approche (incarnée en
France par François PERROUX (1950)38 ou Jacques
BOUDEVILLE39 (1965) dont les problématiques se rapprochent de
la Théorie de la croissance -avec la contribution de Robert SOLOW- d'une
approche urbaine qui se développe plutôt aux Etats - unis autour
de William ALONSO40 (1964), Edwin MILLS41 (1967) et
Richard MUTH42 (1969). Sous l'intrusion de la nouvelle
théorie du commerce internationale, Paul KRUGMAN43 (1991)
redynamise la Science régionale qui devient au cous des années
1990 la nouvelle Economie géographique qui ne tient plus compte des
avantages comparatifs comme les ressorts de base de cette théorie, mais
les économies d'agglomération ou économies produites entre
autres par l'accumulation dans la même région d'une forte demande
et offre.
Au courant des années 2000 les travaux de Paul KRUGMAN
et Masahisa FUJITA44 (1999) introduisent la
question des externalités d'agglomération et d'urbanisation. Le
développement d'une économie urbaine est aussi allé avec
le développement des travaux en fiscalité locale, essayant de
comprendre et formaliser les mécanismes et les conséquences
économiques des biens publiques locaux.
35 THÜNEN VON J.H., 1827, Der isolierte Staat in Beziehung
auf Landwirtschaft und National Okonomie, Hambourg. Perthes. Voir aussi J.H.
Von Thünen, (1826), L'Etat Isolé, Ed. Guillaumin, Paris 1851.
36 CHRISTALLER, W. (1933), Die zentralen Orte in
Süddeutschland, Iena: G. Fischer (trad. ang. partielle par Ch.W.
Baskin (1966), Central Places in Southern Germany, Englewood Cliffs
Prentice Hall).
37 ISARD W., (1956), «Location and Space Economy: A General
Theory Relating to Industrial Location, Market Areas, Land Use, Trade and Urban
Structure». New York, MIT and J. Wiley and sons.
38 PERROUX F. : « Les espaces économiques
», Economie appliquée, tome 3, n°1,1950.
39 Boudeville J. : «
Région géographique,région économique »
;n°406, 1965,p 738 - 739.
40 ALONSO, W. (1964), Location and Land Use-
Toward a General Theory of Land Rent, Cambridge: Harvard University
Press.
41 MILLS, E. S. (1967), An aggregative model of
resource allocation in a metropolitan area, American Economic Review,
57, 197-210
42 MUTH, R. (1969), Cities and Housing: The
Spatial Pattern of Urban Residential Land Use,
43 Paul KRUGMAN : « Rendements croissants et
géographie économique », journal of political economy vol.
3,n° 99, 1991,page 483-499.
44 Paul KRUGMAN et Masahisa FUGITA : « The
Spatial Economy :Cities, Regions and International Trade ,Cambridge ,MIT
Press,1999.
II.1. Economie Régionale : le rôle des
avantages compétitifs et des avantages comparatifs
L'économie régionale s'appuie sur le fait que la
mondialisation économique, loin de conduire à une dispersion des
activités tend à les concentrer sur des territoires,
généralement urbains, disposant d'un avantage compétitif
sur le plan mondial, régional, sous régional ou local en
particulier. De nos jours, les avantages dont peut disposer un territoire sont
souvent liés à l'existence de ressources naturelles, mais
à la maîtrise de savoirs et technologies, à l'existence
d'un capital humain particulier, dans un environnement propice à la
production. On parle à ce sujet de compétitivité. On parle
aussi de guerre des territoires, l'attractivité d'un territoire
basée sur le capital humain plutôt que d'avantages naturels
supposant une stratégie, face à d'autres territoires plus ou
moins éloignés disposant ou étant prêts à
développer, des atouts comparables pour attirer les investissements et
les investisseurs.
II.1.1. La nouvelle économie géographique
: anticipation et effets boule de neige
La croissance des territoires, basée sur la
capacité de ceux-ci à augmenter leur production de biens et
services, ne doit pas uniquement être pensée de manière
statique, comme c'est le cas dans les modèles comparatifs. Dès
lors qu'il y a des coûts de transport ou de transaction, que la main
d'oeuvre n'est pas totalement mobilisée entre les pays ou entre les
secteurs, les arbitrages ne font plus suivant les mêmes logiques que dans
le cas Ricardien. La région la plus importante offre par exemple des
débouchés plus importants, si les coûts de transport entre
les deux régions sont élevées, les entreprises auront
tendances à se localiser à proximité de ce marché
final, en dépit de coût de travail souvent plus importants.
Mécaniquement, cela accroît le nombre de fournisseurs ayant
intérêt à se localiser eux aussi dans cette
région.
Au final, l'agglomération nourrit
l'agglomération : il y a un effet boule de neige. Celui ci est
alimenté par les conditions de coûts et de débouchés
objectives ou anticipées. L'accumulation d'entreprises et e
salariés dans une même région y fera augmenter les
coûts du travail. Dès lors que le différentiel de
coût de travail entre la région dynamique et les autres
régions dépasse le différentiel de coûts de
transport, les entreprises peuvent faire le choix alternatif de se
(re-)localiser dans la région périphérique .Mais aussi si
les salaires ne sont pas totalement mobiles d'une région à
l'autre ou d'un secteur à l'autre, ces simples changements de choix de
localisation peuvent induire un chômage important.
II.1.2- Proximité géographique et
proximité organisée
Le développement des analyses de la proximité
à donné lieu, depuis le début des années 1990,
à une pluralité de définition de formes de
proximité, qui s'articulent toujours autour deux dimensions :
- une dimension liée à l'espace,
- une dimension ne tenant pas à l'espace.
Le débat repose aujourd'hui sur une distinction entre deux
catégories de proximités : géographique et
organisée (TORRE, RALLET45, 2005).
La proximité géographique s'intéressera
à la distance kilométrique entre deux entités (individus,
organisations, villes...) pondérée par le coût temporel et
monétaire de son franchissement. Elle a deux propriétés
essentielles : elle est tout d'abord de type binaire (il existe naturellement
d'infinies graduation (plus ou moins loin de, plus ou moins près de),
mais l'examen de la proximité géographique a pour objet de savoir
si on est « loin de »ou « près de ».Elle est ensuite
relative, doublement relative. La distance géographique qui traduit le
partage entre proximité et éloignement est relative aux moyens de
transport. La distance kilométrique est pondérée par le
temps et /ou le coût de transport.
La proximité n'est pas considérée comme
une donnée objective, elle procède en dernier ressort d'un
jugement porté par les individus ou les groupes sur la nature de la
distance géographique qui les sépare. Le jugement ici consiste
à traiter l'ensemble des paramètres qui influent sur la distance
pour les réduire à l'énoncé selon lequel on est
près ou loin de. Cet ensemble de paramètres comprend des
données objectives (kilomètre, temps, prix) mais aussi la
perception que les individus en ont. Cette perception est variable selon
l'âge, le groupe social, le sexe, la profession... (Par exemple, la
possibilité de se rencontrer une fois par jour peut être
perçue différemment selon les personnes).
Toutefois bien qu'elle soit de nature sociale
(déterminée par les moyens de transport) et subjective (relevant
d'un énoncé), la proximité géographique peut
être à un moment t considérée comme une
donnée de l'espace physique représentant une contrainte qui
s'impose, en cet instant, aux agents pour développer les actions.
45 Torre et Rallet : « Proximity and localization
» . Region Studies,vol 39,n°1, 2005. P47-60.
La proximité organisée est plus relationnelle
que géographique. On entend par proximité organisée, la
capacité qu'offre une organisation de faire élargir ses membres.
L'organisation facilite les interactions en son sein, en tout cas, les rend
à priori plus faciles qu'avec des unités situées à
l'extérieur de l'organisation. Deux raisons majeures l'expliquent.
D'une part, l'appartenance à une organisation se
traduit par l'existence d'interaction entre ses membres. C'est la logique
d'appartenance de la proximité organisée : deux membres d'une
organisation sont proches l'un de l'autre parce qu'ils interagissent et que
leurs interactions sont facilités par les règles ou routines de
comportement (explicites ou tacites) qu'ils suivent.
D'autre part, les membres d'une organisation peuvent partager
un même système de représentation, ou ensemble de
croyances, et les mêmes savoirs. Ce lien social est principalement de
nature tacite. C'est ce qu'on appelle la logique de la similitude de la
proximité organisée. Deux individus sont dits proches parce
qu'ils « se ressemblent » ou du moins partagent un même
système de représentation, ce qui facilite leur capacité
à interagir.
II.2 Territoires et réseaux, une nouvelle
géographie économique
II.2.1. Les territoires dans les chaînes de
valeur mondialisées.
La mondialisation de l'économie produit une
géographie profondément différente qui a une traduction
rapide sur les ressources des territoires. Ce qui fait que les territoires
doivent s'inscrire dans des réseaux. Ainsi, la notion de
proximité doit être rediscutée. L'accent mis sur la
capacité d'un territoire à attirer des investisseurs
étrangers est de plus en plus important. Paradoxalement, cela
témoigne pleinement du fait qu'aucun développement n'est
véritablement exogène. Les investisseurs alimentent
généralement des concentrations sectorielles
préexistantes.
II.2.2-L'économie résidentielle, nouveau
ressort du développement territorial
A la pensée de KRUMMER46 (1968) et de Werner
SOMBART47 (1916), généralisée par des auteurs
comme HOYT48 (1954), Douglass NORTH49 (1955) ou
TIEBOUT50 (1956), la variable décisive du
développement territorial est le revenu monétaire capté de
l'extérieur par les territoires (qui est appelé revenu basique).
La rémunération des facteurs locaux de production de la valeur
ajoutée créée localement n'est qu'une modalité
parmi d'autres de captation de ces revenus. Cette base productive est
désormais moins importante que les autres sources de revenu que sont
devenus les salaires associés aux emplois publics, les pensions de
retraite, les prestations sociales ou le revenu des « résidents non
recensés » (résidents secondaires, touristes...).
Les travaux de Laurent DAVEZIES51 (2004-2003)
basés sur un constat macroéconomique : l'augmentation du temps
libre, le développement technologique (Internet, portable...)
participant de plus en plus au découplage entre lieux de production et
lieux de consommation, attestent ainsi de l'importance d'une base
économique résidentielle qui permet de comprendre le
développement de certains territoires. Il en découle que le
véritable enjeu du développement d'un territoire n'est pas de
créer le plus de richesses possible mais d'en capter le plus
possible.
Le mécanisme du « développement basique est
simplifié, le territoire attire de diverses façon des revenus de
l'extérieur qui constituent la base économique, ce revenu stimule
l'activité locale, l'emploi national ou local qui produit des biens de
consommation ou d'équipement et des services vendus localement d'une
part, et détermine ainsi le niveau de revenu, d'emploi et de
cohésion du territoire.
46 Krummer : « Das Urheberrechlich Sschutzbare
verk ( l'oeuvre protégéable en droit d'auteur),Berne,
Stâmpfli et Cie,1968,226 pages.
47 Sombart W. : « Müchen und Leipzig
».Der moderne kapitalismus, 1916.
48 Hoyt : « Economie Résidentielle et
Compétitivité des territoires », 1954.
49 North: « Location Theory and Regional Economic
Growth »journal of Political Economy 63, (Juin 1955), p.243-258.
50 Thiebout : « A pure theory of local
expenditures».Journal of Political Economy,64 ,1956,p.416-424.
51 Davezies L : « Temps de la production et
temps de la consommation, les nouveaux aménageurs des territoires ?
» in Futuribles, Novembre 2003. « Les transferts publics et
privés de revenu au secours du développement territorial »in
l'Etat des Régions, éd.2004, 2004.
Mais alors est il possible de définir
l'intérêt général à partir des
préférences individuelles ?les économistes ont pendant
longtemps comparer le marché et ses défaillances avec
l'intervention d'un Etat présumé parfait. Les travaux de Jan
TINBERGEN (mathématicien) et Ragnard FRISCH
(économiste) tous deux prix Nobel de Sciences économiques en
1969, partisans de la planification se situaient dans cette mouvance. Mais
c'est la théorie du bien être qui s'était surtout
donné pour mission d'explorer la défaillance du marché
justifiant l'intervention de l'Etat. On ignorait une question qui semble
aujourd'hui évidente : qu'advient il de la comparaison si on abandonne
l'hypothèse d'un Etat parfait, si on essaie de voir comment il se
comporte dans la réalité ? C'est la question qu'ont posée,
à partir des années 1950, les économistes fondateurs de
l'Ecole des « Choix Publics ». L'un des plus importants d'entre eux
James BUCHANAN52 (Prix Nobel d'économie 1986) et Gordon
TULLOCK53 (1967)
Ces auteurs expliquent la politique ici à l'aide des
outils développés par la microéconomie. Les hommes
politiques et les fonctionnaires se conduisent comme le ferraient les
consommateurs et les producteurs de la théorie économique dans un
contexte institutionnel différent. La motivation du personnel politique
est de maximiser son propre intérêt, ce qui inclut
l'intérêt collectif. L'hypothèse étant que les choix
individuels sont motivés par l'intérêt personnel dans un
sens plus ou moins large.
II.2.3. Vision libérale du rôle de
l'Etat
Partant du principe que les hommes politiques et les
fonctionnaires sont motivés par la même recherche de
l'intérêt personnel qui fonde l'analyse néoclassique, la
théorie des choix publics suppose qu'ils cherchent alors à
maximiser leur utilité personnel (utilité qui peut contenir des
composantes plus complexes que simplement leur revenu : l'intérêt
collectif, l'altruisme, la recherche du pouvoir, etc.).Elle utilise ensuite les
outils de l'analyse néoclassique pour expliquer le processus de prise de
décision politique, afin d'exposer les dérives
systématiques en faveur des politiques gaspilleuses.
Par contraste avec la pensée économique classique
qui cherche à savoir quelles politiques
seraient les plus efficaces
si elles étaient mises en places, les libéraux traitent de la
question de
52 Buchanan J. « External Diseconomies,Corrective
Taxes and Market Structure » American Review, 1969.
53 TULOCK G. (1967): « The general irrelevance of
the general impossibility theorem» Quaterly Journal of Economics,
81, p 256-270.
savoir quelles décisions ont le plus de chance
d'être prises étant donné le contexte politique ? A partir
de là, et dans un second temps, elle traite la question de comment faire
en sorte que les politiques les plus efficaces gagnent les meilleures chances
d'être mises en oeuvre.
Egalement dans le processus de choix publics, on doit tenir
compte d'autres intermédiaires que sont les groupes
d'intérêt formés par les citoyens qui ne sont pas vraiment
des intermédiaires. Toutefois, il est clair que ce ne sont pas tous les
intérêts qui s'organisent de manière aussi efficace et que
les groupes d'intérêt les mieux organisés deviennent un
interlocuteur privilégié du Gouvernement et de l'Administration,
dressant une barrière entre les préférences des citoyens
et les choix publics.
D'une part Mancur OLSON pense que les petits groupes ont moins
de difficultés de s'organiser que les groupes plus nombreux. Dans les
grands groupes en effet, le passager clandestin, celui qui profite des
avantages des autres sans participer aux coûts, risque d'avantage de
faire dérailler l'action collective. Chaque individu se dit que l'impact
de sa propre participation, qu'il s'agisse de manifester ou de payer une
cotisation, sera négligeable, alors qu'il devra supporter des
coûts bien tangibles. D'autre part, il est plus difficile de
contrôler les passagers clandestins, en les intimidant ou en les
boycottant, dans un grand groupe impersonnel que dans un petit groupe. Donc les
petits s'organiseront mieux pour exploiter les grands que l'inverse. Le fait
que les petits groupes ont souvent des intérêts concentrés
(chaque membre retire beaucoup de l'action collective du groupe) alors que les
grands groupes ont fréquemment des intérêts diffus (par
exemple chaque contribuable paie une partie infime d'une subvention) ajoute
à la surreprésentation des petits groupes dans l'action
collective.
Il importe alors de comprendre que la force des
intérêts organisés vient essentiellement du pouvoir de
l'Etat d'accorder des mesures protectionnistes, monopoles, subvention et autres
privilèges. C'est pour obtenir ces avantages que les groupes
d'intérêt s'engagent dans le lobbying, les campagnes d'opinions
publiques et d'autres moyens de pression. C'est ce que les économistes
appellent la course aux rentes ou le rent seeking.
II.2.4. Défaillance de l'Etat.
L'une des pensées des libéraux est que les
démocraties produisent moins de bonnes décisions que l'optimum en
raison de l'ignorance et de l'indifférence rationnelles des
électeurs. En effet, aucun électeur singulier ne peut s'attendre
à ce que sa voix ait un poids sensible sur le résultat des
élections, tandis que l'effort nécessaire pour s'informer afin de
voter en toute connaissance est, lui, considérable. Les bonnes
décisions politiques peuvent être considérées comme
un bien public pour la plus part des électeurs, puisqu'ils en
bénéficient quoiqu'ils fassent, et qu'ils n'en privent personne
d'autre.
Cependant, il existe un grand nombre de factions ou
d'intérêts particuliers qui pourraient tirer un avantage en
obligeant le gouvernement à adopter des décisions
généralement nuisibles mais profitables pour eux. Par exemple les
sportifs peuvent avoir intérêt à faire interdire la chasse
aux petits gibiers dans le Parcours Vita, ce qui leur permettrait de voir ces
animaux dans leur nature. Il s'agit d'une mesure protectionniste dont le
coût se retrouve diffusé dans l'ensemble de la population de
chasseurs et le préjudice subi par les chasseurs eux -mêmes et les
consommateurs de ces gibiers, est invisible, tellement il est minime. Les
bénéfices, eux, sont partagés par une minorité,
dont la préoccupation majeure devient de faire perdurer ce type de
décision.
Les libéraux pensent encore que de nombreuses
décisions nuisibles à la majorité seront prises quand
même .Ils parlent alors de « défaillance de l'Etat»,
comme miroir de l'expression « défaillance du marché
».
Les choix publics sont -ils indispensables ? Y a-t-il des
domaines où les choix individuels sont incapables de répondre de
manière satisfaisante aux préférences des individus ? Si
cela est fort possible, il faut convenir que ce domaine est petit .Plus on
étend le domaine des choix publics, plus la politique prend de l'ampleur
.La démocratie est un bon système pour changer les gouvernements,
mais un mauvais système pour décider de tout. Qu'en est- il de la
valeur à accorder à l'environnement ?
Tout bien économique est un bien rare, et c'est un
truisme aujourd'hui de dire que la qualité de l'environnement est
devenue rare c'est-à-dire insuffisante par rapport aux besoins ou aux
désirs que nous éprouvons à son égard. Les
relations qui lient les sociétés humaines et l'environnement
doivent également être traitées d'un point de vue
économique.
CONCLUSION
Le principe fondamental de la décentralisation est
basé sur le transfert aux collectivités territoriales de
certaines compétences et des ressources nécessaires. Il s'agit
d'un transfert où l'Etat garde encore son droit de regard de
façon permanente quant à la gestion. Ce qui tranche avec la
position des libéraux qui considèrent que seul un marché
de concurrence pure et parfaite assure l'allocation optimale des ressources.
Toutefois c'est l'Etat qui pilote la décentralisation
par la fourniture entre autre des services indispensables à la
population lesquels ne peuvent être fournis par le marché. Cette
logique ne remet pas en cause le rôle du marché dans une
économie, mais amplifie le fonctionnement de celui par la prise en
compte du rôle fondamental de l'Etat. La fourniture desdits services doit
se faire dans un espace de proximité pour tenir compte de son
utilisation maximum par la grande majorité de la population dans le but
de satisfaire les objectifs de développement local par la dynamique de
captation des ressources possibles.
Ainsi, si la croissance économique et le
développement repose sur la production des biens et des services, un
autre élément y participe : l'environnement non pas au même
titre, mais par ses multiples avantages. C'est la raison pour laquelle
l'environnement apparaît comme un bien économique procurant une
satisfaction (bien-être) par sa qualité en même temps qu'il
participe à l'aménagement des territoires dont les objectifs
multiples contribuent à l'attractivité des villes.
CHAPITRE 2 : LE PARCOURS VITA ET L'ESPACE DE DOUALA
VIEME.
INTRODUCTION
Créé depuis les années 1990, le PV est
logé dans la Région du Littoral dont Douala est le Chef lieu,
plus précisément dans l'arrondissement de Douala
Vième. Cette unité administrative voit le jour suivant
la Constitution du 18 Janvier 1996 qui reconnaît en son Article 55 (1),
Titre 10, les Collectivités Territoriales Décentralisées
du Cameroun qui sont les Régions et les Communes. C'est une unité
née de l'extension par les périphéries de la ville de
Douala, qui compte six arrondissements regroupant au moins 120 quartiers ;
chaque quartier étant en soi une ville dans une ville.
SECTION 1-LA COMMUNE DE DOUALA VIEME
1.1-Le territoire de l'arrondissement de Douala
Vième
La commune de Douala Vième s'étend
sur la zone communément désignée AKWA-NORD dont les plus
grands et principaux quartiers sont Bonamoussadi, Maképè, Logpom,
Bonangang, Kotto, Bépanda. Bien entendu c'est l'action
combinée54 de la MAETUR (Mission d'Aménagement et
d'Equipement des Terrains Urbains) et de la SIC (Société
Immobilière du Cameroun) qui a déclenché l'afflux des
populations vers ces périphéries qui jadis étaient des
zones vierges, inhabitées ou du moins non mises en valeur. Ces deux
sociétés ont mis à la disposition des populations pour
l'une des terrains viabilisés pour constructions des habitations, et des
maisons à louer ou en location- vente pour l'autre.
Cette action n'a pas seulement permis l'occupation de
l'espace, mais a déclenché chez certains propriétaires
fonciers privés la nécessité d'aménager leurs
espaces avant de les rétrocéder aux particuliers ; Ce qui a
été à l'origine du changement de l'image de cette zone qui
hier était inculte, inoccupée, en une cité moderne avec
des bâtisses épousant la modernité et s'étend
aujourd'hui aux portes de la localité de Japoma avec la naissance des
quartiers Lendi et autres. Bien que les constructions soient de type moderne,
en matériaux définitifs
54 La MAETUR a mis en valeur les terrains avant de les
vendre aux particuliers. La Sic a construit des logements dont certains sont en
location simple et d'autres en location vente.
pour la plupart, avec des plans architecturaux, l'image de ces
quartiers tranche avec les cannons d'une urbanisation pensée et
maîtrisée.
Ainsi donc l'étude synoptique de la population de cet
arrondissement et de son environnement, l'analyse de son importance, ses
caractéristiques sociodémographiques et son habitat nous
permettra de mesurer la valeur du PV et son attrait pour les populations des
autres quartiers de Douala.
1.2-La structure de la population.
Sans se laisser contredire par les regards des
démographes et des statisticiens, l'arrondissement de Douala
Vième est habité par une population
jeune : 83,1% des habitants ont moins de 40 ans55, la moyenne
d'âge se situant à 24,1 ans56. Soit 23,4 ans chez les
femmes57 et 24,7ans chez les hommes58. A
côté, la proportion de la population ayant moins de 25 ans est
assez importante, plus de la moitié de la population à moins de
25 ans59.
Il s'agit d'une population cosmopolite de différentes
catégories sociales et de différents niveaux
d'analphabétisation repartie entre les agents publics et parapublics,
les travailleurs des Secteurs privés industriels, privés de
services ,privés de commerce, et les élèves ou
étudiants. Le taux de scolarisation avoisine près de
97%60.Ce qui dénote l'importance de la tranche d'âge
juvénile qui soufre du manque des espaces de jeux, et autres parcs de
loisirs qui participent également à l'attractivité du
territoire
Cette répartition connaît des disparités
entre ceux qui sont occupées et une bonne frange de la population qui
est en chômage. D'un autre côté, on notera que
l'arrondissement de Douala 5ième a exercé un attrait sur une
certaine frange de la population, les ouvriers de différentes
spécialités qui pour certains ce sont installés ici de
façon plus ou moins provisoire et ceux qui doivent y arriver chaque jour
à la recherche du travail soit dans le domaine du bâtiment, soit
dans les services ou les ménages...
55 Enquête sur le cadre de vie des populations
de Yaoundé et de Douala en 2002(CAVIE).p 7
56 Idem
57 Idem
58 Idem
59 Idem
60 Idem
Un autre élément est qu'à
l'intérieur de cette localité, un peu plus de 59,4%61
de la population vivent au dépend des revenus de l'ensemble de
l'arrondissement sans pour autant y contribuer à la formation de ce
revenu total. C'est une dépendance qui se traduit par le fait qu'on a un
peu plus de trois personnes sans revenu pour deux personnes avec revenu.
Concernant la population active, la répartition selon les tranches de
revenu annuel professionnel montre que toute la population en âge de
travailler et ayant déjà travaillé a au moins un revenu.
Mais 3,1% de cette population a un revenu inférieur au
SMIG62.
1.3-Environnement et logements.
1.3.1-Environnement.
Douala 5ième est bâti dans une zone
récemment aménagée. Les lotissements récents ont
permis ici la sortie de terre comme des champignons des constructions au fil
des années, des bâtisses élevées dans des plans
révolutionnaires dans un plan d'urbanisation quelconque.
Les maisons SIC qui faisaient jadis la beauté de cette
partie de la cité de Douala et y exerçait un certain attrait sont
aujourd'hui gagnées par la désuétude, créant ainsi
des externalités négatives. A côté certains
lotissements se font dans une certaine confusion par des propriétaires
fonciers avides de gain et au mépris de la réglementation :
absences des servitudes, terrains de jeux, aires protégés, et
voies d'accès non standard. Mais il faut relever que l'action de la
MAETUR et de la SIC63 a contribué à donner une autre
image à cette localité en la propulsant sur les chemins de la
modernité bien que certaines infrastructures de base (routes, espaces
vert, etc.) connaissent aujourd'hui une dégradation très
avancée. Au point de vue du service public minimum et en matière
d'éclairage et ramassage des ordures, l'arrondissement est
éclairé à plus de 77%64 ; le ramassage des
ordures est réalisé dans près de 62%65 des
quartiers et se fait par HYSACAM66
Toutes ces analyses sont très souvent ternies par
certaines nuisances du fait des pollutions, des
odeurs résultant des
bruits, l'irrégularité du ramassage des ordures, bouchage des
61 Op cit p 34.
62 SMIG : salaire minimal garanti, fixé
officiellement à 23500FCFA par mois, CAVIE p15
63 Op cit p.34
64 Idem
65 Idem
66 Hysacam : p .25
canalisations d'évacuation des eaux usées des
ménages et des fosses sceptiques entraînant des
externalités.
Un autre aspect particulier de l'arrondissement de Douala
Vième est que c'est une zone presque immergée comme
une certaine frange des quartiers de Douala ; soit près de
67%67 des quartiers ici sont de temps en temps inondés en
saison des pluies ; 17%68 le sont régulièrement et
sauf 12%69 le sont rarement ou moins d'où la justification
naturelle de la présence permanente d'eau dans le PV. Mais aussi ceci
trouverait peut être une autre explication dans la proximité avec
le fleuve Wouri, l'abondance des pluies dans la région
côtière de Douala et la qualité des sols meubles qui
retiennent de l'eau.
1.3.2-Les logements
Les logements ou les maisons sont pour la plupart faits en
matériaux définitifs dans des styles variés au goût
des habitants. Ce qui donne à dire que les plans ont été
pensés et réfléchis. Ce sont soit des immeubles à
plusieurs niveaux, des hôtels, soit des villas et autres duplex qui
donnent fière allure à l'arrondissement de Douala
Vième où certains quartiers portent des noms de
certaines villes occidentales du fait de leur beauté (Santa - Barbara,
Denver, Saint-Tropez ,etc..). Il serait important de le noter pour le
déplorer que ces beaux quartiers avec des belles bâtisses sont
malheureusement pris en étau par des habitats spontanés et
précaires qui donnent l'illusion d'une urbanisation inachevée.
1.4-la couverture administrative et commerciale de Douala
5ième
L'arrondissement de Douala Vième est en
même temps un territoire déconcentré (Sous-
Préfecture de Douala Vième) et une collectivité
territoriale décentralisée (Commune d'arrondissement de Douala
Vième). Les services de maintien de l'ordre sont
assurés ici par la Gendarmerie, la Police et les Services privés
de gardiennage chez les particuliers.
Un centre commercial, et certains commerces qui jadis
étaient concentrés dans le quartier des
affaires à
Akwa, nouvellement installés ici assurent l'approvisionnement des
ménages, ce qui
limite là les déplacements vers le
Centre Urbain et permet un gain de temps et de coûts. Les
67 Op. cit p 34
68 Idem
69 Idem
banques, les établissements de micro-finances, les
assurances et les stations de service modernisées, les infrastructures
d'éducation privées et publiques, les infrastructures de
santé, de transport et des salles d'Internet ont déjà
trouvé ici des espaces
.
SECTION II-LE PV DANS SON ENVIRONNEMENT.
C'est une représentation qui englobe le circuit de sport,
le milieu biogéographique et les fleuves et les lacs, et les
intérêts naturels du PV.
2 .1-Le circuit et les ateliers de sport.
Uniquement destiné à l'origine au sport, le PV
de Douala vieux de plusieurs décennies a été
créé après celui de Yaoundé .Par la suite, bien
qu'ayant survécu au temps, il n'a de cesse de susciter des sentiments
mitigés.
Logé dans un espace vert, il est situé dans la
commune de l'Arrondissement de Douala 5ième zone
périphérique de fortes concentrations de la population de
diverses catégories sociales. Mais par sa configuration le PV est
coincé à la fois entre les quartiers Bonamoussadi et
Maképè. A l'origine il s'étendrait sur près de 64
ha70 qui serait réduit aujourd'hui à 20 ha. Terrain
appartenant à la MAETUR71, et rétrocédé
à l'Etat72, il occupe le domaine public et fait partie des
biens publics ou patrimoine collectif national.
Cette rétrocession trouverait son explication peut
être dans les difficultés d'exploitation pour habitations. Ces
raisons et difficultés réelles de ne pas l'exploiter à ces
fins d'habitations ont peut être pendant longtemps focalisé
l'attention des uns et des autres sur l'unique destination originelle sportive
du PV.
70 Opcit p 33.
71 Idem
72 Le PV créé le 13 Avril 1990 par le
Président de la république a été
rétrocédé le 5 Juin 1993 à la Communauté
urbaine de Douala à travers un Protocole d'accord conjoint entre le
Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Chef d'état major
particulier de la Présidence de la République et le
Délégué du Gouvernement .Il prévoyait une piste de
2650 m avec entre autres ateliers deux escaliers de 140m et 80m, un parking
d'une superficie de 8400m2.
Au début de sa création le circuit
équipé de différents ateliers donnaient une fière
allure au PV justifiant sa destination première .Construits tout le long
du circuit long de près de 3 km la disposition des ateliers
obéissait au rythme et à l'intensité des activités
sportives. Le circuit lui-même protégé entre temps par une
mince couche d'asphalte a rajouté à la magnificence de cette aire
de sport.
Cette image aujourd'hui tranche avec ce qu'il était
à l'origine et contraste avec sa localisation même dans le bassin
de Douala. Ce paradoxe trouverait son explication dans les multiples attaques,
agressions, destructions, violations par lui subit qui ont modifiées sa
nature .Il n'y aurait pas de comportement amnésique pour affirmer que le
PV, cet espace naturel fut longtemps abandonné. Meurtri par l'agression
des hommes, le PV est très menacé au point d'avoir perdu son
charme. Les coupes sauvages ont eu raison de la maigre végétation
sauvage qui y pousse pour faire des champs ou rechercher du bois de chauffe.
Autrement dit le PV est entrain de subir sans ménagement une violente et
impitoyable dégradation qui le rapproche de si peu du désert,
grand paradoxe en plein coeur de l'Afrique équatoriale. Les quelques
distances couvertes par une végétation d'arbustes ne sont plus
que l'ombre d'elles mêmes dont les feux de brousse ont été
sans excuse.
Cette dégradation, ces agressions
répétées sur la végétation du PV,
entraînent nécessairement des conséquences dommageables sur
l'écosystème et la biosphère comme la disparition de
nombreuses espèces d'animaux et végétaux. Si les ateliers
de sport sont entrain d'être réhabilités aujourd'hui, le
milieu physique naturel du PV se meurt. Ce milieu de vie malgré tout
abrite encore quelques varanidés, des chéloniens, des rongeurs
des variétés d'espèces d'oiseaux et autres petits gibiers
qui font de la résistance, mais pour combien de temps encore ! Plusieurs
troupeaux de singes (simiens) ont longtemps habité ces lieux. Les lacs
regorgent des variétés de poissons Mais ce sanctuaire de vie
risque de disparaître complètement si des mesures radicales
d'urgence ne sont pas prises ; ce sera la mort de nombreuses espèces
faunique, florale
etc. et une grande perte pour la Cité
de Douala en particulier.
A côté de ce qui précède, il se
passe un autre phénomène le plus dangereux, et qu'aucune
justification ne tolérait. Des constructions pour habitations
s'élèvent à l'intérieur du PV, domaine de l'Etat,
certaines prennent même leur fondation dans l'un des lacs, d'autres
empiètent ce qui reste du tracé du circuit de sport, sans
susciter la moindre réaction des
autorités de la ville de Douala qui sont pourtant tous
informées parce que pratiquant le sport ici. Ce silence cache mal «
une collusion » entraînant d'énormes risques quand on sait
que cette zone est méconnaissable en pleine saison des pluies
doublée de la montée des eaux du lac. « L'illusion » de
collusion avec les autorités en charge des questions foncières
trouve sa justification dans tout le secret entretenu autour des noms et titres
de propriété, autorisations de bâtir.
Ce qui précède soulève de notre part le
problème de l'occupation du domaine privé de l'Etat et la
construction des habitats dans des zones à risque ; des questionnements
qui trouveront des orientations adéquates dans l'arsenal juridique en
matière foncière ou alors faut-il une charte du PV ? Pourtant
dans sa diversité physique, son hydrologie, son environnement, il
présente d'autres atouts riches et aussi attractifs que ludiques.
2.2-Le milieu biogéographique, les lacs et les
rivières.
2.2.1-Le relief, la végétation et le
sol.
La superficie du PV flottant entre une plaine et une colline
appartient à l'ensemble du relief de la région
côtière du Cameroun dominée par une plaine
côtière plus ou moins étroite qui n'a pas partout la
même ampleur ; une plaine côtière qui est assez remarquable
par sa faible altitude et les grandes découpures enroulées de
mangroves. L'altitude ne dépasse pas 100mètres.
De l'entrée principale la vaste esplanade plonge le
visiteur dans une cour sans façon, qui cache mal la splendeur du paysage
au fur et à mesure que l'on longe le circuit du sport. Ce prolongement
traverse deux collines d'environ 10 à 15 % de pente
séparée par une zone plate .Plus loin, la présentation le
trait caractéristique de l'autre versant donne l'impression de
l'occurrence d'un mouvement tectonique qui a laissé la place à
une faille dont le miroir peut avoisiner près d'un kilomètre de
long, avec des hauteurs variables ; mais rien n'exclut que l'action de l'homme
soit à l'origine de cette création. Cet ensemble s'arrête
brusquement pour donner place à une zone plate qui se poursuit jusqu'au
point d'entrée en côtoyant les lacs et les cours d'eaux.
Sur le plan phytogéographie, le PV est partagé
entre la savane et la forêt. Des zones boisées, épaisses,
sous des arbres de taille moyenne, le PV présente un paysage verdoyant
aéré, aux allures pittoresques composé de
palétuviers, les parasoliers, les palmiers, etc. C'est une caricature de
végétation clairsemée où subsiste des arbres
isolés du fait de l'action répétée des feux de
brousse.
Les sols sont toujours gorgés d'eau et peu
perméables. Ce sont des sols latéritiques argileux, sablonneux
épais. Il n'en faut pas plusieurs mètres de profondeur pour
atteindre l'eau .Ce sont des sols plus ou moins riches, meubles, plus profonds
et contiendraient moins d'herbes concurrentes des cultures. Ce qui a
suscité les convoitises de certaines populations qui ont
transformé certains endroits en zone de culture.
2.2.2- Les lacs et la rivière
Le fleuve Wouri encore appelé Nkam dans son cours
supérieur73 inonde Douala (4147mm d'eau par an74)
et reçoit en aval le Mungo et la Dibamba pour atteindre la mer par le
large estuaire des bouches du Cameroun75. Les criques de la
région sont couvertes de mangroves. C'est encore ce fleuve qui
détermine l'hydrologie dans la région de Douala et assure une
certaine permanence de l'eau couvrant les 3/4 du PV pour le faire
considérer peut être à tort ou à raison comme une
zone humide. Compte tenu de la grande pluviométrie dans le bassin de
Douala le PV est toute l'année humide, irrigué par le cours d'eau
le Nkondi, au débit très faible suivant les saisons, les
écarts sont très forts entre les crues et les étiages
caractéristiques des fleuves côtiers.
L'étiage a lieu en saison sèche avec un maximum
en Février Mars. La montée des eaux commence en Avril- Mai pour
atteindre le maximum en Septembre. La décrue s'amorce vers la fin
Octobre, elle accompagne le fléchissement des précipitations de
Novembre à Mai, le débit minimum survenant en Janvier. Dans leur
lit ou en dehors, ce cours d'eau traversant le PV de bout en bout offre
à la végétation une bonne quantité d'eau pour
entretenir sa verdure. Dans son mouvement il charrie des masses de
débris, de déchets vers le cours d'eau Banya.
73 Nouvelle géographie 3è p.80
74 Idem.p.76
75 Idem.p.80
Les lacs76 de superficie variable entre 5000 et
15000 m2 sont plus calmes. Ce sont d'immenses flaques bleues,
inertes, dont un seul, celui qui se trouve au départ du circuit de sport
est animé par un léger mouvement de rejet du trop plein qui va
alimenter au loin un petit cours d'eau. Deux de ces lacs poissonneux faisaient
le bonheur de certains pêcheurs traditionnels, mais au jour d'aujourd'hui
seul un seul continue d'offrir cette faveur, l'autre étant depuis envahi
par de la jacinthe d'eau douce qui annihile toute vie.
2.3-Intérêts écologiques du PV.
Le PV de Douala tire sa particularité de sa
localisation dans une zone ou une région où l'eau est le
principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie animale et
végétale associées. Ce qui peut nous faire affirmer que la
nappe phréatique ici affleure au point que les eaux peu profondes
recouvrent les terres. Ce qui lui confère une importance
singulière.
L'atout écologique du PV ne peut s'observer qu'au
travers de la spécificité de son milieu. Zone humide
gorgée d'eau (le PV embrasse les caractéristiques des zones
humides77), il pourrait contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité de l'eau en agissant comme un filtre
épurateur :
76 Le nombre de ces lacs dépasserait quatre.
Voir carte.
77 Sur le plan juridique, on définit une
zone humide comme les terrains, exploitées ou non, habituellement
inondées ou gorgées d'eau douce ,salée ou saumâtre
de façon permanente ou temporaire ;la végétation, quand
elle existe y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins
une partie de l'année. Mais selon la Convention de Ramsar une optique
plus large a été adoptée et reconnaît les zones
humides comme des étendues de marées, de fagnes, de
tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles permanentes ou
temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce ou saumâtre
ou salée, y compris des étendus d'eau marine dont la profondeur
n'excède pas six mètres. La Convention de Ramsar sur les zones
humides est un traité intergouvernemental adopté le 2
Février 1971à Ramsar en Iran dont le but est de protéger
les zones humides d'importance internationale. C'est également un label
de reconnaissance internationale et non une protection règlementaire ou
une mesure contraignante. Elle est entrée en vigueur en 1975 et regroupe
aujourd'hui 158 pays. La désignation de sites au titre de la Convention
de Ramsar constitue un label international qui récompense et valorise
les actions de gestion durable de ces zones et encourage ceux qui les mettent
en oeuvre. La liste des zones humides d'importance internationale comporte
à ce jour environ 1828 sites pour une superficie de 168 millions
d'hectares. Le Cameroun a adhéré à la Convention relative
aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme
habitats des oiseaux d'eau adoptée en 1971 et amendée en 1982 et
1987.Le 20 Mars 2006,le Cameroun a déposé auprès du
Directeur Général son instrument d'adhésion à la
Convention relative aux zones humides d'importance internationale
particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, telle
qu'amendée en 1982 et 1987.Conformément à l'article 2 de
la Convention, la zone humide « the Waza Logone Flood Plain » a
été désigné par le Cameroun pour figurer sur la
liste des zones humides d'importance internationale établie en vertu de
cette Convention. En application de son article 10 (2), la Convention telle
qu'amendée en 1982 et 1987 entrera en vigueur à l'égard du
Cameroun quatre mois après le dépôt de cet instrument
d'adhésion, c'est -à - dire le 20 Juillet 2006.
2.3.1-filtre physique : dépôts de
sédiments, piégeage d'éléments toxiques,
rétention des matières en suspension...
2.3.2-filtre biologique : de par sa
végétation le PV jouerait le rôle de siège
privilégié de dégradation biochimique, dues (grâce
notamment aux bactéries, de désinfection par destructions des
gênes pathogènes grâce aux ultraviolets, d'absorption et de
stockage par les végétaux de substances indésirables ou
polluantes...). Par les jeux de ruissellement et d'infiltration des eaux, le PV
en ce qu'il peut jouer à son mini- échelon le rôle
d'éponge, contribuerait à la régulation du régime
des eaux dans le bassin de Douala en favorisant la réalimentation des
nappes souterraines..
En période des crues, les eaux superficielles sont
transférées par le cours d'eau le Nkondi qui retrouve la
rivière Banya vers le fleuve Wouri. Autrement dit le PV absorbe
momentanément l'excès d'eau puis le restitue progressivement lors
des périodes de sécheresse. Ce rôle, cette fonction
participe tout simplement aussi à l'action de régulation des
régimes hydrauliques en ce qu'il diminue l'intensité des crues et
soutient les débits des cours d'eaux en période d'étiage
(basses eaux) ou alimente en eau certaines nappes phréatiques
superficielles.
2.4-L'intérêt lié à la
biodiversité.
Sans aucune exagération, le PV de Douala est un
réservoir de biodiversité qui à
plusieurs occasions aurait servi de cadre d'étude et de recherche
scientifiques. C'est un espace de vie animale et végétale ou tout
simplement un espace de vie des organismes qui y sont inféodée.
La vie ici tourne autour des fonctions de reproduction, d'alimentation et la
fonction d'abri, de refuges et de repos.
2.4.1-La reproduction
Favorisée ici par le rôle biologique
(siège de dégradations biochimiques) qu favorise à son
tour la présence de ressources alimentaires variées et à
la diversité des habitats constituent des éléments
essentiels conditionnant la reproduction des organismes vivants.
2.4.2-L'alimentation
Bien soutenue par la richesse et la concentration en
éléments nutritifs résultant des
dégradations
biochimiques, les marais assurent ainsi une mise à disposition de
ressources
alimentaires pour de nombreuses espèces animales
localement et à distance par exportation de matières organiques.
Certaines espèces végétales de surface constituent la base
alimentaire de certains autres animaux.
2.4.3- la végétation
Avec une végétation dense, bien que
menacée, ses lacs envahis par des constructions, le PV offre les
caractéristiques d'un abri, de refuge et de repos pour de nombreux
espaces animales dont certains ont été souvent rencontrés
tels les singes, les varans, les tortues, les hérissons et autres grands
rongeurs, des variétés d'oiseaux et seules des études
pourraient déterminer les proportions avec précision. A
côté de ces espèces de grande taille vivent d'autres
espèces tels les insectes et autres êtres vivants, les
variétés de poissons qui peuplent les lacs et les cours d'eau et
dont les recherches et autres études pourraient étaler au grand
jour cette richesse du PV qui à plusieurs occasions a offert sa
splendeur à des études et recherches universitaires.
2.4.4- le climat
Dans le domaine climatique les climatologues conviendraient
que le PV contribuerait à son échelle à la
régulation des microclimats .Les précipitations et la
température atmosphérique peuvent être influencées
localement par les phénomènes d'évaporation intense d'eau
au travers des terrains et de la
végétation(évapotranspiration).Avec sa
végétation et ses eaux ,le PV jouerait ainsi un rôle tampon
des effets des sécheresses et de la chaleur, bénéfique
pour la région de Douala(littoral) en général et des
quartiers de la zone d'Akwa Nord en particulier surtout quand on sait le
degré de chaleur qui s'abat sur Douala pendant une longue durée
de l'année.
CONCLUSION
L'objectif de ce chapitre 2 était de présenter
l'aspect de la localisation du parcours vita de
Douala. Ainsi en s'en est ressortie que celui-ci est
Logé au coeur de la zone d'Akwa -Nord, principalement entre les
quartiers Bonamoussadi et Maképè. C'est un espace de sport
longtemps abandonné qui renaît de ses cendres par les travaux de
réhabilitations. Zone par excellence gorgée d'eau avec ses lacs,
la rivière Nkondi qui le serpente dans une végétation
quasi aquatique, elle présente à la fois d'énormes
intérêts liés à la fois à la
biodiversité et des intérêts écologiques
d'importance patrimoniale.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Nous avons tout au long de cette partie analyser les
différentes approches doctrinales montrant l'importance de
l'environnement non seulement comme un espace abstrait et subjectif, mais comme
un bien économique à vendre. Ces approches théoriques nous
ont permis de comprendre que la création des espaces naturels urbains
peut jouer le rôle de boussole dans les politiques d'aménagement
des territoires et contribuer ainsi à la promotion de ces derniers et de
l'environnement en général.
Aussi nous avons au cours de notre développement
montrer que la cité de Douala en général reconnue comme le
poumon économique de la sous régions CEMAC, doit continuer
à occuper sa place de leader incontestable par la diversification de ses
atouts dont le parcours Vita protégé et conservé peut
constituer un élément. De ce point de vue, l'espace Vita
longtemps considéré comme espace de sport, est logé dans
une nature sauvage au coeur de la zone résidentielle de Douala
5ième et répond mieux à cet objectif
d'aménagement des territoires si nous nous en tenons à ses
fréquentations, à son environnement biogéographique
à ses lacs et à sa rivière Nkondi.

MULTIFONCTIONALITE.
LA PROTECTION ET LA
SECONDE PARTIE :
INTRODUCTION DE LA SECONDE PARTIE
Dans un environnement naturel, de forêt, avec ses lacs,
la rivière qui le sillonne pour l'arroser à longueur de
l'année, le Parcours Vita offre d'énormes potentialités
économiques, touristiques, de production, de prévention et
écologique, et dans une certaine mesure thérapeutiques. Ces
éléments pour révéler leur plénitude
fonctionnelle dans un enchevêtrement dynamique doivent agir dans une
certaine interdépendance dans un espace unique qui doit être
protégé et conservé. Malheureusement, parce que
situé dans la zone côtière du littoral camerounais,
où les densités de population s'accroissent, cette nature est
fréquemment altérée pour favoriser des activités
comme la pêche, l'agriculture, la chasse, et le développement
urbain.
CHAPITRE 3 : LA NECESSITE DE LA PROTECTION DU PARCOURS
VITA.
INTRODUCTION
La protection et la conservation du PV en même temps
pour la génération présente et future ne peuvent mieux
être perceptibles aujourd'hui que dans une certaine dynamique englobant
l'action des ONG, de la Société Civile d'une part, et par
l'arsenal juridique national qui tire sa source dans le Droit International de
l'Environnement, de l'arsenal juridique national en matière de
protection de l'environnement et du droit coutumier. Mais alors qu'est ce que
l'environnement ?
SECTION 1-TENTATIVES DE DEFINITION ET L'ARSENAL
JURIDIQUE DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT.
1.1-Définition.
En réalité y a-t-il une définition simple
de l'Environnement ? La définition de l'environnement se heurterait
à de nombreuses difficultés. La plupart des traités et des
autres instruments juridiques pertinents, à commencer par la
Déclaration de Stockholm et celle de Rio de 1992, et la grande
majorité des auteurs s'abstiennent de toute définition. Cependant
des exceptions existent.
La Convention du Conseil de l'Europe de 1993, article 2,
paragraphe 11, sur la responsabilité civile des dommages
résultants d'activités dangereuses pour l'environnement, la
résolution de l'IDI78 du 4 Septembre1997 définit
l'environnement comme englobant « les ressources naturelles abiotiques et
biotiques, notamment l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore ainsi que
l'interaction entre ces mêmes facteurs. Il comprend aussi les aspects
caractéristiques du paysage79 »
Selon M. KAMTO dans son ouvrage intitulé Droit de
l'Environnement en Afrique : « on
entend par environnement le
patrimoine culturelle des ressources humaines indispensables
pour les
activités socio-économiques et pour le meilleur cadre de vie
». Cette définition prend
78 Institut de Droit International.
79 NGUYEN QUOC DINH (2001) Droit International
Public, 6è édition. Op cit p.40.
en compte les composantes additionnelles de l'environnement
telles que la nature(constituée des espèces animales et
végétales et des équilibres biologiques animales) et des
ressources naturelles(eau, mer, sol, air) et rejoint celle reprise par la Loi
n°96/12 du 5 Août 1996 qui considère
l'environnement comme l'ensemble des éléments naturels ou
artificiels et des équilibres biogéochimiques auxquels ils
participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels
qui favorisent le développement du milieu, des organismes vivants et des
activités humaines80 .
En claire l'environnement ne peut en effet sans doute
être défini que par l'addition des différents
éléments qui le composent et qu'il intègre en un concept
unique81. D'une façon synthétique on peut
définir l'environnement comme l'ensemble des éléments
nécessaires à la vie ( d'où les termes de «
biosphères » ou d' »écosystèmes » auxquels
on peut l'assimiler) ; l'environnement humain étant circonscrit aux
éléments nécessaires à la vie des êtres
vivants.
La survie du PV devrait interpeller la conscience collective
nationale, non pas seulement des « doualais ». Selon certains
rapports de L'ONU, 10%des aires seulement sont protégées et le
reste 90% livrées à l'agression des hommes. Ce qui montre la
fragilité de la vie sur notre planète terre qui ne tiendrait
qu'à un minimum des zones vertes. Ramené à
l'échelle du Cameroun, que représenterait Douala sinon pas
grand-chose. En claire, la protection de l'Environnement s'apparente à
un combat dans lequel aucune mesure forte ne doit être
négligée tant les défis sont énormes et parfois
diffus.
1.2-L'Arsenal Juridique pour la Protection de
l'environnement du PV.
La réglementation nationale, émanation du Droit
International en matière de protection de l'environnement participe des
dispositions plus ou moins contraignantes pour sauver le PV en même temps
que les dispositions du droit coutumier.
1.2.1-Sur le plan international
Le droit à un environnement sain est très
récent dans la culture moderne (il s'est
surtout
développé dans les années 1970).Mais dans les
années 1990, s'est cristallisée autour du
80 In Le Cadre Juridique des Forêts et de
l'Environnement au Cameroun.p.207.
81 Droit International public p.1218.
sommet de Rio et de ses Conventions et Déclarations
internationales la problématique de la nécessaire mise en oeuvre
du Droit International de l'Environnement
Bien que récent, le Droit International de l'Environnement
fait appel aux institutions juridiques internationales habituelles et concerne
différentes sous -branches telles que :
celles liées aux éléments qui composent
l'environnement (droit de l'air, droit de l'eau et de la mer, droit des sols,
droit de la biodiversité et des biotopes) ;
celles liées à des activités humaines
(droit de la chasse, de la pêche, de l'énergie) ;
celles liées à des activités nuisibles ou
polluantes (droit du bruit, droit des installations
classées, droit
de l'assainissement, droit des risques majeurs industriels ou naturels) ;
celles liées à un objet particulier (droit de la
protection de la nature..).
Dans cet ordre d'idées, le droit de l'environnement a
pour objet l'étude ou l'élaboration des règles juridiques
concernant la compréhension, la protection, l'utilisation, la gestion ou
la restauration de l'environnement sous toutes ses formes : terrestres,
aquatiques et marines, naturelles et culturelles, voire non terrestres (droit
spatial). C'est un droit technique et complexe en pleine expansion, en somme
dont les champs tendent à se densifier au fur et à mesure des
avancées sociales, scientifiques et techniques matérialiser au
Cameroun dans la loi 96/12 du 5 Août 1996 portant Loi Cadre relative
à la gestion de l'environnement mais sans juridiction
spécialisée82. En partie transfrontière par
nature et comparé à du hard law ou « droit dur
», et parce que imposant des obligations d'ordre public, le Droit de
l'environnement peut également prendre le caractère de droit
mou83.En somme « c'est un atelier d'expérimentation
juridique84 ».
82 Il n'y a pas de tribunal
spécialisé en droit de l'Environnement au Cameroun à
l'instar de la plus part des pays. Les juges et les cours ne peuvent alors que
s'appuyer sur des experts agréés, et des laboratoires
également agréés et se référer aux
conventions ratifiées et traités pour rendre les
décisions.
83 Les traités sont obligatoires, les actes
concertés non conventionnels ne le sont pas. Le traité est
obligatoire en tant que source ; mais il peut contenir des normes incertaines
dont l'application est largement laissée à l'appréciation
de leurs destinataires, alors que les actes concertés non conventionnels
peuvent contenir des « normes » très précises ; tel est
le cas des gentlemen's agreements. L'ensemble de ces normes incertaines du fait
soit de leur contenu, soit de leur inclusion dans une source non susceptible de
créer des obligations juridiques (actes concertés non
conventionnels et recommandations des organisations internationales)
constituent ce que l'on appelle le droit mou ou soft law. Parce qu'il est un
des champs d'application anticipatoire du principe de prévention et du
principe de précaution ainsi que des notions d'études d'impact,
de mesures conservatoires, mesures compensatoires et responsabilité
environnementale etc. le Droit International de l'environnement est un «
atelier d'expérimentation juridique ».
84 NGUYEN QUOC DINH (2001) Droit International
Public, 6è édition.Op cit p1221
Certes il existe des pollutions qui peuvent rester
circonscrites au territoire d'un seul Etat, mais d'une façon
générale, toute atteinte à la l'environnement qui se
produit dans un Etat a des répercussions sur le territoire d'autres
voisins ; les pollutions qui se produisent dans une zone marine peuvent gagner
,souvent lentement et insidieusement, d'autres espaces marins, parfois
très éloignés (la récente catastrophe de pollution
par le déversement du pétrole sur les côtes
américaines et dont les conséquences sur
l'écosystème sont des plus graves que ce pays n'ait jamais
connues et les réparations se chiffreraient à plus de 20
milliards de dollars USA). Les atteintes à un élément
particulier de l'écosystème ont souvent des répercussions
graves sur les autres. La pollution atmosphérique a des retombées
maritimes et est à l'origine de l'appauvrissement de la couche d'ozone
et des phénomènes de l'effet de serre, lui-même source de
modifications climatiques aux conséquences imprévisibles.
Il revient alors à chaque Etat de protéger au
mieux dans son espace, l'environnement tout court. C'est de ce principe que
découle « le Principe de l'Utilisation Non Dommageable du
Territoire 85». Il n'en reste pas moins que l'environnement est
de plus en plus perçu comme une valeur commune à
l'humanité toute entière dont la préservation est
l'affaire de la Communauté Internationale dans son ensemble, et que l'on
retrouve dans les règles qui lui sont applicables ; la plupart des
principes relatifs au patrimoine commun de l'humanité : absence de
réciprocité, obligation de conservation et de gestion
rationnelle, non appropriation. Toutefois, la responsabilité
première des Etats et les compétences quasi exclusives qu'ils
conservent pour la mise en oeuvre de ces principes conduit à voir dans
la biosphère davantage une ressource partagée.
En claire c'est du devoir de l'Etat de protéger
l'espace du PV dont La violation constitue sur le plan national une double
infraction : la violation du domaine publique (habitations) et la destruction
de l'environnement (destruction de la flore, de la faune,
etc.)86.
1.2.2-Sur le plan national
La législation nationale abondante et féconde
prévoit un ensemble de dispositions pour protéger l'environnement
mais dont l'application souffrirait d'un manque de dynamisme et dont les
symboles sont :
85 NGUYEN QUOC DINH (2001) Droit International
Public, 6è édition.Op cit p. 1230.
86 Les infractions en matière environnementale
sont prévues et réprimées conformément aux
dispositions contenues dans le Cadre juridique des forêts et
l'Environnement au Cameroun qui est un recueil de textes
> l'Observatoire National sur les Changements Climatiques
(ONACC) créé par le
Président de la République suivant le Décret
n° 2009/410 du 10 Décembre 2009,
> le Cadre Juridique des Forêts et l'Environnement au
Cameroun, recueil de textes traduisant l'engagement de principe du Gouvernement
Camerounais en faveur d'un mode de développement conciliant
progrès économique et social et respect de l'environnement.
De plus, une bonne frange de la population camerounaise vit du
secteur primaire ; en même temps le Cameroun fait partie du Bassin du
Congo,2ième réserve de forêts tropicales
après l'Amazonie, justification que les enjeux d'une gestion durable et
équitable des ressources naturelles demeurent considérables.
Des lois de Janvier 1994 sur les forêts et d'Août
1996 sur la gestion de l'environnement qui marquent un changement dans les
politiques forestières et environnementales au Cameroun, jusqu'à
la loi 2006/002 du 25 Avril 2006, autorisant le Chef de l'Etat à
ratifier le Traité relatif à la Conservation et à la
Gestion durable des écosystèmes forestières d'Afrique
Centrale, constituent l'essentiel des dispositifs juridiques actuels en
matières de forêts et d'environnement87. C'est
là le Cadre juridique dont dispose le Cameroun et qui permet en
théorie d'une part de faire face à la dégradation de
l'environnement et de lutter contre les pratiques d'exploitation frauduleuse et
abusive des ressources naturelles, d'autre part il contient des dispositions
intéressantes mais surtout méconnues qui permettent de contribuer
à l'amélioration des bénéfices sociaux et
économiques que les communautés locales et les populations de
Douala en général sont en droit d'attendre de leurs ressources
dans le cadre de la décentralisation. Ces lois intègrent
très souvent des mesures coercitives permettant de réprimer les
atteintes à l'environnement, les infractions forestières et les
atteintes à la biodiversité.
Pourtant et paradoxalement, l'effort d'adoption de nouvelles
législations environnementales et forestières, et leurs
publicités, n'a pas enrayé l'accentuation de la
dégradation des écosystèmes forestières :
l'occupation illégale du PV, les destructions de sa
végétation, sa pollution à ciel ouvert et son abandon. Ce
qui d'une part pose le problème de l'effectivité du
87 Le Cadre Juridique des Forêts et de
l'Environnement au Cameroun.p.5 ,6.
respect des lois en la matière, et d'autre part l'un des
préalables à l'application du droit des forêts et de
l'environnement est la maîtrise de celui-ci par les acteurs et
citoyens.
L'illustration les plus patents sont ces habitations
élevées en plein PV en violation des exigences de l'environnement
et de la sécurité pourtant les marécages, les fleuves ,les
zones gorgées d'eau, les rivières jusqu'à la limite des
grands crues, les flancs de collines sont pris en ligne de compte dans la
vérification sourcilleuse de la constructibilité du terrain et
doivent être spontanément écartés de l'appropriation
si les Services du Cadastre constatent qu'ils présentent des dangers
(glissement de terrain, écoulement d'eau, ravinement, etc....). Pourtant
des constructions sur des terrains n'ayant pas fait l'objet d'une quelconque
normalisation par les services compétents trônent en plein coeur
du PV et que le douloureux spectacle mais salutaire des destructions des
maisons construites sur les zones non « edificandi »
présentées comme tel par le Plan d'Urbanisation de l'Etat ne
devrait effleurer notre conscience.
1.2.3-Sur le plan traditionnel.
En réalité le Droit coutumier est la
première source du Droit de l'environnement au Cameroun parce que la
protection de la nature et le souci de préserver l'équilibre du
milieu ont été toujours une préoccupation constante des
sociétés traditionnelles du Cameroun en particulier et de
l'Afrique en général. Dans la mesure où l'homme y vit
généralement en harmonie avec la nature. Autrement dit c'est une
vie en symbiose dont l'homme se conçoit comme un des
éléments. Cette préoccupation se traduit sur le plan
juridique par les prescriptions du Droit Coutumier réglementant selon
les zones considérées la coupe des arbres c'est-à-dire
l'exploitation forestière qui se fait de façon organisée,
loin de toute anarchie, l'utilisation des cours d'eau, la chasse, les feux de
brousse, l'affectation et l'utilisation des sols.
Outre la fonction de maintien de la biodiversité, la
contribution à la prévention des aléas climatiques est un
autre service écologique important. Les mangroves piègent le
limon dû à l'érosion en amont. Selon la FAO, le rôle
des mangroves dans la prévention et la réduction de
l'érosion du littoral, dans la protection contre les effets du vent, des
vagues et des courants, ont pour effets que là où existent de
vastes étendus de mangroves préservées, les villages
côtiers endurent moins de dégâts.
En claire la législation foncière est mal
appliquée à cause de l'incivisme et de la cupidité de
certains citoyens. Aux facteurs institutionnels, politiques et sociaux, qui ne
favorisent pas une gestion durable et équitable des ressources
naturelles, s'ajoute cette ignorance par le public des normes juridiques en
matière de forêt et l'environnement d'une façon
générale.
La protection et la conservation du PV justifieraient la
préoccupation des pouvoirs publics, les amis de la nature d'une
manière générale concernant la lutte contre la pollution,
les effets de la désertification et la sécheresse avec son
corollaire le réchauffement climatique d'une part et participeraient
à un début de création des forêts urbaines comme des
zones tampons pour harmoniser la vie et la nature dans nos villes à
l'orée de la décentralisation.
Il s'agirait de donner aussi une réponse à la
satisfaction des besoins des populations urbaines qui ont envie de voir en
plein coeur du centre urbain autres choses, autres paysages naturels, doux,
plus reposants et moins choquants que des buildings et autres artifices qui
dépeignent l'environnement. En d'autres termes, il s'agit de transporter
la forêt de la forêt pour l'implanter en ville dans un espace
réduit pour en créer des conditions de vie meilleure en
contribuant à l'attractivité de cette dernière.
Le PV doit être compris ici comme cet ensemble naturel
géographique englobant la forêt, les lacs, des cours d'eau dans un
relief sauvage et dont la protection, la conservation, l'aménagement
relèveraient beaucoup plus de l'initiative publique et participe de
l'une des missions des collectivités territoriales
décentralisées. Egalement l'action privée dans ce domaine,
portée sur la vision que l'autorité publique se fait, et les
objectifs à atteindre pour porter sa localité dans les champs de
la compétitivité en matière de développement
économique, touristique, sociale et du respect de l'environnement
obéissent à d'autres réglementations. Le parc Luna-Park
dans la localité d'Obala, bien que abandonné aujourd'hui a
été en son temps dans la décennie 1980 le miroir de cette
localité, fruit de la manifestation de l'amour d'un privé pour la
nature. Le parc « Sainte ANASTHASIE » à
Yaoundé n'aurait jamais de vie sans la volonté des pouvoirs
publiques.
Ceci dit de ces deux espaces rapprochés bien que
situées à différents lieux, leurs
fréquentations
respectives des différentes époques, leurs attractions, il est
évident qu'ils
représenteraient pour leur localité
respective des centres d'intérêts capitaux sous le prisme de
la décentralisation. Dans cette perspective, le PV
apparaît comme « le fruit de l'inventivité du milieu et
répond aux besoins de développement local88 ».
1.3 -Protection et Conservation pour un
développement durable.
La protection de l'espace Vita doit nous engager en faveur du
développement durable dont l'interdépendance fonctionnelle est la
schématisation évidente. Il s'agit de prendre
simultanément en compte les trois dimensions économique, sociale
et environnementale .Toute la collectivité nationale est
concernée : gouvernement, collectivités, territoriales, acteurs
économiques, associations, institutions publiques ou privées,
etc. ayant chacun son rôle à jouer.
1.3 .1-Définition du développement
durable.
En 1987, lors de la réunion de la Commission Mondial
sur l'Environnement et le Développement, Our Commun Future le
«Rapport Brundtland », du nom du Premier Ministre Norvégien
Gro Harlem Brundtland qui présidait la séance, proposait une
définition du développement durable : « Sustainable
development is development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generationsto meet their own needs
».
En français, c'est un développement qui permet
la satisfaction des besoins présents, sans compromettre la
capacité des générations futures à satisfaire les
leurs. Cette définition est traduite par la règle de Hartwick ou
règle de Solow (1974,1986) sous la dénomination de
soutenabilité qui sera soit forte ou faible selon le cas .La
différence entre les deux niveaux de soutenabilité réside
d'une part, dans la forme du stock de capital à conserver et d'autre
part, dans la confiance que l'une ou l'autre accorde à la technologie
pour constituer la solution durable. Pour les partisans de la
soutenabilité faible, il faut garder constant le stock de capital total,
alors que pour les autres, c'est le capital naturel qui doit rester non
-décroissant. Ainsi la question de la complémentarité ou
substituabilité entre capital naturel et artificiel est très
importante dans le cadre du développement durable de sorte que :
Kt = Kn + Kp
Stock de capital total = Stock de capital naturel +stock
de capital physique.
88 Edimo in Spatialité et développement
économique à Douala entre le hasard et la nécessité
.p .58 .
Avec :
Kt : Capital total.
Kn : Capital naturel composé des ressources naturelles
(pétrole, gaz, ressources minières, forêts, etc.).
Kp : Capital physique regroupe l'ensemble des infrastructures,
les bâtiments, les installations hydro-électriques, etc.
Utilisé comme référent essentiel, le
développement durable insiste sur le fait que la terre est un
système interdépendant qu'il faut se préoccuper des effets
à long terme des actions humaines car nous sommes tous embarqués
dans le même bateau.
1.3.2-Les trois piliers du développement
durable.
Le développement durable participe d'une trilogie
égalitaire où l'économique (produire au service du plus
grand nombre) s'allie au social (le bien-être, lutter contre la
pauvreté) dans le respect de l'environnement (préserver la
nature) :
· Ecologique : Utilisation raisonnée de
l'énergie ; attention portée à l'innovation dans les
produits et les services ; réflexion sur l'effet des usages actuels sur
le futur.
· Economique : Evitement de la surproduction ; recours
restreint à l'endettement ; prise en compte des problèmes de
transport, de mobilité... ; attention portée aux risques du
progrès technologique sur la santé, choix d'une croissance
économique compatible avec le développement durable.
· Social : Lutte contre la pauvreté ; prise en
compte du vieillissement de la population ; information du consommateur ;
responsabilisation du consommateur ; adhésion aux principes du
développement durable.
Le territoire devient ici un élément
stratégique, car il constitue la base commune de ces trois «
piliers » et forme le cadre décentralisé le plus favorable
à leur réconciliation. Il est le niveau où se situent les
acteurs locaux responsables et où émergent les initiatives
locales.
La protection et la conservation du Parcours Vita dans
l'option d'en faire une aire protégée doit susciter chez la
collectivité locale en particulier et de nombreuses collectivités
nationales en général à s'investir dans des
démarches d'éco-responsabilité et qu'au-delà de la
diminution de leurs propres impacts, elles conduisent par leur
exemplarité leurs citoyens à contribuer
efficacement contre la pollution, les émissions de gaz
à effet de serre, à la préservation des ressources et de
la biodiversité et à agir ensemble pour un développement
durable.
SECTION 2- LES ACTEURS
2.1-L'Etat ou les Pouvoirs Publics
Il se situe au fronton de toute action de protection de
l'environnement en général et du PV en particulier au travers des
collectivités territoriales décentralisées. L'abandon du
PV a fait pendant longtemps croire à tort ou à raison au manque
d'intérêt à l'égard de cette nature sauvage. Mais
avec les travaux de réhabilitation depuis le mois de Mai 2010, les
pouvoirs publics ont réaffirmé leur rôle en matière
de protection de l'environnement en général et du PV en
particulier, et confirmé ainsi sa valeur (économique, sociale et
environnementale).
2.2- l'Association des Amis du PV (APV)
La protection du PV connaît un acteur dénommé
« Association des Amis du PV » et des individuels dont les actions
sont non moins négligeables.
L'Association des Amis du PV est un regroupement formé
des sportifs animés du désire de protéger cet espace de
sport. Parce que c'est un groupe d'autosuggestion, une organisation de
propositions et non politique, les résultats s'avèrent
très mitigés. Son action se limite uniquement à des
alertes des autorités, elle ne peut mener une action punitive ou
répressive à l'endroit de tous ceux qui violeraient l'espace du
PV.
Pourtant certains de ses actions ont permis de sensibiliser
les pouvoirs publics au niveau local et national de la violation, agression du
PV. Mais d'une façon générale leurs actions
(activités) devraient revêtir des formes multiples, y compris de
véritables actions commandos comme certaines campagnes de GREENPEACE
contre les essais nucléaires français qui ont eu des
prolongements juridictionnels. L'activisme des APV devrait être plus
visible et massive pour porter au firmament la menace qui pèse sur le
PV, partant sur la vie des êtres humains pour favoriser ainsi leur prise
en compte dans toute décision le concernant. L'APV peut ester en justice
toute personne reconnue coupable de violation de l'espace Vita.
2.3-L'Association mieux -être
L'Association mieux -être une ONG installée
à Douala qui compte parmi les défenseurs actifs. Elle a
participé à des occasions diverses au reboisement, et à
faire connaître aux nationaux et étrangers le PV.
2.4-Les individuels ou les autres
Les individuels ou les tiers qui ne sont pas nombreux mais
dont les publications dans les journaux, les interviews à la CRTV ont
permis de sensibiliser l'opinion publique sur la menace (feux de brousse,
pollution, violation de son espace du fait des hommes et son abandon.) qui
pèserait sur le PV.
Les actions de ces différents acteurs doivent se
traduire au niveau du citoyen par des gestes quotidiens qui préservent
son environnement, une implication dans la vie sociale et politique de la
cité et une contribution à la richesse de l'économie.
CONCLUSION
L'environnement étant une ressource épuisable,
il est urgent de mobiliser les intelligences et les énergies en passant
par la communication, l'éducation pour assurer sa protection et sa
conservation. Le droit coutumier, la législation nationale et le droit
international offrent aux acteurs locaux des moyens assez forts pour
réaliser ces objectifs aussi bien dans l'intérêt des
générations à venir.
CHAPITRE 4 : LES RETOMBEES DE LA MULTIFONCTIONALITE DU
PARCOURS VITA
DE DOUALA.
INTRODUCTION
La multifonctionnalité ici découle de la
caractéristique et de la particularité du milieu. Outre le sport
en pleine nature, la forêt sert au piégeage du carbone et d'abri,
de refuge et d'habitat aux nombreuses espèces, les lacs et les
rivières peuvent permettre la pisciculture, des activités
nautiques, pour développer (favoriser) un tourisme vert dans le PV et
contribuer ainsi à l'attractivité et au développement
local de la Cité.
SECTION1 : L'OPERATIONNALITE DE LA
MULTIFONCTIONNALITE
1.1-La démarche multifonctionnelle.
Le Parcours Vita malgré son état actuel a servi
depuis sa création pour de nombreux usagers d'espace de sport sa
destination principale, faisant fi des « autres fonctions ». Ce qui
peut être justifiait la préoccupation de l'époque des
autorités concernant cette activité parce que l'idée
était aussi de doter chaque Région d'un Parcours Vita. Mais la
particularité de celui de Douala permet de comprendre qu'autour d'une
activité sportive peut se fédérer bien d'autres
activités très rentables tels les tourismes, la promenade, la
chasse et la pêche, etc. dans un espace protégé.
Pourtant les hommes ont toujours eu des relations
particulières avec ces activités mais dans des aires
isolées, sans connexions existantes si elles ne sont pas souvent rompues
soit par l'aménagement urbain, la destruction de la forêt, la
faune et la flore, ou l'occupation abusive des espaces d'une part, ou bien
alors l'intérêt porté par l'Etat, mais aussi par
l'initiative privée n'était pas centré sur la mise en
oeuvre ou le renforcement de quelques jointures pour créer la
multifonctionnalité spatiale d'autre part.
La végétation assure une fonction triple :
productive, écologique et préventive : productive parce qu'elle
pourrait fournir le bois de feu et le charbon de bois, les bois de construction
des logements et des embarcations sans oublier son apport à la
pharmacopée traditionnelle.
Le milieu du PV assure des fonctions écologiques
remarquables et s'avère indispensable à la survie des
écosystèmes marins. Un rôle prépondérant des
forêts de mangrove est de servir de lieux de ponte et de zones
d'alevinage pour de nombreuses populations de poissons et de crustacés,
qui entrent dans la chaîne alimentaire d'autres animaux et des hommes. De
plus les mangroves fournissent des feuilles au réseau trophique
marin.
1.2-La dynamique multifonctionnelle.
La notion de la multifonctionnalité, surtout le sujet
qui en découle, c'est-à-dire la jointure existante entre le sport
et les autres activités susceptibles d'être créées
dans l'espace Vita, aurait du être un nouvel enjeu dans la gestion de
l'environnement pour en tirer le maximum de bénéfice dans le
cadre de la décentralisation.
La multifonctionnalité suppose alors la reconversion de
site originel en espaces ou zones thématiques et « la
réduction89 » de sa fonction sport en d'autres fonctions
consommables. L'axe de cet enjeu peut être également dirigé
au niveau de la recherche scientifique dans les différentes propositions
qui engendrent une politique à adopter en matière
environnementale. Cette jointure suppose la nécessité de
travailler en faveur de la protection et de la préservation du PV,
mettant pleinement en valeur l'ensemble des fonctions (fonctions
économiques et touristiques, fonctions sociales et services
environnementaux) pour assurer une rentabilité suffisante.
La protection et la préservation de la nature et de
l'écosystème pour des raisons surtout touristiques mais à
travers une politique d'harmonisation urbaine, la promotion des tourismes et du
tourisme sportif (randonnées, la chasse, la pêche) peuvent
contribuer à la solution principale pour le développement de
l'espace urbaine et le soutien de la pluriactivité en tant que
nécessité pour attirer les investissements et les investisseurs,
le tout fonctionnant dans une dynamique spatiale.
Les estimations de fréquentations hebdomadaires sont de
l'ordre de 16000 personnes de
toutes les couches d'âge, et constituent
un potentiel économique important dans le cadre de
la
décentralisation pour le développement de
l'écotourisme qui résulte de l'observation du
89 D'autres activités peuvent être
développées dans le Parcours Vita et susciter un
intéressement autant que le sport.
monde vivant. Ce qui montre le rôle déterminant
du facteur spatial qui doit être à la base de l'application de
tout projet de développement qui doit tenir compte des autres
paramètres qui synthétisent l'ensemble de l'espace.
En claire, la forêt, l'air, l'eau ainsi que les
possibilités de randonnées et de chasse ne devraient pas entrer
en conflit avec les fréquentations sportives ou touristiques si bien
agencés dans l'espace Vita. Outre la fonction de maintien de la
biodiversité, la contribution à la prévention des
aléas climatiques est un autre service écologique important.
Les mangroves piègent le limon dû à
l'érosion en amont. Selon la FAO, le rôle des mangroves dans la
prévention et la réduction de l'érosion du littoral, dans
la protection contre les effets du vent, des vagues et des courants, ont pour
effets que là où existent de vastes étendus de mangroves
préservées, les villages côtiers endurent moins de
dégâts.
La jointure entre le sport, la santé, le tourisme,
l'environnement et la rentabilité économique témoigne de
ce que l'on peut « vendre » l'espace aussi d'une autre façon
que par le moyen de la rente foncière, et peut être « sauver
» les espaces par de nouvelles formes de mise en valeur bien que de
façon générale, l'une des caractéristiques des
biens et services environnementaux sont que leur fourniture n'est pas
réglée par des mécanismes du marché et des prix. Il
s'agit alors clairement des biens et services d'intérêt public qui
ne sont pas caractérisés directement par la loi de l'offre et de
la demande.
En conséquence tout projet d'investissement au PV ou de
réhabilitation impose une réflexion globalisante qui prendrait en
compte et de façon conjointe l'intégration des dimensions
paysagères et des autres activités éventuelles pour
s'inscrire dans une perspective de développement durable. Le champ de
développement de la ville de Douala s'en trouve ainsi élargi,
avec le traitement de la nature en ville, le positionnement de la commune
périurbaine de Douala 5ième comme un lieu de tourisme
de proximité et parce que les citadins (les urbains) manifestent les
besoins forts du développement des espaces verts à la fois comme
lieux récréatifs, ludiques et patrimoniaux (bien que) dans un
contexte d'urbanisation très mal maîtrisée. L'illustration
nous est donnée à travers les fréquentations sur les rives
du Wouri aux lieux dits Base Elf et Base naval à Douala et de la Place
du monument Charles ATANGANA à Yaoundé.
Une bonne organisation des activités possibles au PV
dans un maillage multifonctionnel et en assurant au mieux la conservation et la
protection de cet espace s'avèrent urgentes, en plus que cet
écosystème offre un contexte remarquable pour l'application des
méthodes d'évaluation de la valeur des services
écologiques.
SECTION 2-L'INTERDEPENDANCE FONCTIONNELLE.
De part sa nature, le PV offre à la fois dans une synergie
divers atouts et possibilités fonctionnels sur les plans
économiques, sociaux et environnementaux.
2.1-Fonctions économiques.
Ce sont les fonctions de production que le PV est susceptible de
générer.
2.1.1-Approche de l'analyse de la valeur des produits
issus du PV.
Elle découle directement de l'absolue
nécessité de la préservation du PV pour la production des
biens marchands et non marchands, la valeur touristique ainsi que d'autres
activités créatrices de richesses dans le cadre de la
décentralisation. Pourtant ces avantages réels susceptibles sont
rarement reconnus, parce qu'il apparaît difficile de déterminer un
bon équilibre entre les coûts et avantages d'une part et, l'apport
d'une intensification des investissements pour le grand public d'autre part ;
nombre de ces avantages sortent du cadre des concepts économiques
habituels en ce sens que la répartition des avantages est une question
particulièrement importante qui n'est pas suffisamment pris en compte
par les modèles économiques courantes.
La valorisation monétaire permettant ici,
ultérieurement, de rentrer les bénéfices apportés
par le PV dans une analyse de coûts-bénéfices qui sera
focalisée soit sur le bilan financier de l'effort de protection, soit
sur les conséquences d'un aménagement qui peut à son tour
altérer les services rendus par les écosystèmes. En
réalité, un fort accroissement des investissements dans le PV ne
serait utile que s'il s'inscrit dans un ensemble de mesures de
développement.
Divers types de biens et services marchands ou non susceptibles
d'être valorisés peuvent être
cumulés pour aboutir
à l'estimation d'une valeur économique totale prenant en compte
le plus
grand nombre des registres de valeurs identifiées, mais
aussi l'autre démarche consisterait à prendre en compte des
retombées directes, des retombées indirectes et des
retombées induites en incluant des avantages liés à
l'utilisation ou non par les populations.
Dans la cité de Douala, chef lieu de la Région
du Littoral avec ses 2,5 millions90 d'habitants, le PV, une chance de la nature
participerait au changement de la vie, à recréer un climat de vie
ou du moins lui donner une autre image propice pour attirer les investisseurs,
les investissements et booster son économie non sans la rendre encore
compétitive d'avec ses homologues de la sous-région car « il
s'agit surtout de voir comment la ville pourrait reconstruire son
attractivité et sa compétitivité. Dans un contexte
où, même sur la côte ouest- africaine, l'horizon
économique est désormais plus mouvant et la
compétitivité territoriale plus accrue que jamais. Avec
l'apparition de nouveaux «Eldorados » de pétrole (cas de la
Guinée Equatoriale) et qui désormais attirent également de
nombreux investisseurs91 ».
Les capacités possibles de production de biens sont
appréciables sous deux angles :
2.1.1.1.- Production de biens marchands.
Il existerait une diversité plus ou moins grande de
biens susceptibles d'être produits au sein de l'espace
protégé Vita, qui dépendrait de l'importance du
système d'activités : on peut citer la chasse, la pêche,
les cueillettes. La production de biens marchands est valorisable directement
par le biais des quantités commercialisées et des prix de mise en
marché. Mais en cas d'interdictions de vente des biens naturels, la
conservation de biens devenus non marchands peut néanmoins être
valorisée au titre des externalités positives qu'elle
engendre.
2.1.1.2- Production des biens naturels non
marchands.
L'identification des biens non marchands part des usages du
milieu par la population. Les biens non marchands acquièrent de la
valeur à travers les activités récréatives, tels
que les sports de nature (sports nautiques, escalades, pêche, chasse,
observation d'oiseaux, navigation de plaisance, marche...) et dont elle peut
être déterminée à travers le degré
d'attractivité des différentes composantes. De façon
particulière elle peut être appréhendée, par le
consentement à payer des publics concernés par la pratique des
différentes activités valorisant
91 ESSOMBE EDIMO (2007 Op cit p
50).
91 ESSOMBE EDIMO (2007 Op cit p 50).
les ressources naturelles du PV. Les aménités
engendrées par l'existence d'un espace de production de biens naturels
protégés (poissons, gibiers, oiseaux, flore, forêts) sont
évaluées à l'impact de cette protection sur les zones
environnantes ; les indicateurs tels que la qualité et la
quantité des biens naturels essaimant dans les zones alentours,
permettent alors d'apprécier la valeur de ces aménités.
2.1.2- Les retombées économiques.
A l'exemple du Bois Sainte Anastasie à Yaoundé
dont l'existence aujourd'hui tient de la volonté forte des pouvoirs
publics il faut investir au PV pour en attendre les retombées. De la
dynamique de protection conférant au PV une qualité
spécifique, qui peut se trouver ainsi valoriser économiquement du
fait de son attractivité, on évaluera les retombées
économiques induites bien que cette approche (par les retombées
économiques) donne assez de limites quant aux éléments de
valeur qu'elle prend en compte.
Tous les bénéfices potentiels que recèle
un espace naturel ne sont pas valorisés. On se limitera alors à
ce qui engendre des bénéfices économiques en termes de
productions mises sur le marché et en termes d'emplois. L'espace de
référence n'est pas l'écosystème mais le territoire
qui est l'objet d'une politique publique de protection.
L'approche par les retombées économiques vise
avant tout à évaluer la plus value qui résulte d'un mode
de gestion qui peut être perçu par ailleurs comme contraignante
pour le développement économique local d'où la
construction d'un bilan coûts-bénéfices qui sert à
justifier le bien fondé de la politique de protection. Les
retombées économiques ici viennent alors justifier et valoriser
le dispositif ou la politique publique qui promeut un certain mode de gestion
de l'espace. La démarche pour être complète prend alors en
compte des retombées directes, des retombées indirectes et des
retombées induites.
2.1.2.1- Les retombées directes.
Ce sont les emplois directs intégrant à la fois
les emplois directs92 permanents et saisonniers que le PV est
susceptible d'engendrer, conséquence directe de la mise en place du
dispositif de protection. Donc il s'agit de donner une lecture pertinente de la
plus-value en termes d'emplois de l'investissement public pour la protection du
PV. Les retombées directes correspondent aux sommes
dépensées par les touristes dans les établissements
dépendant directement ou non du PV pour l'essentiel dans la zone
protégée (visites et activités payantes, boutiques,
restaurants, parkings).
Les charges de fonctionnement ici ne comprendront que les
coûts associés à la gestion des actions et dispositifs de
protection. Mais d'autres coûts nécessaires, à prendre en
compte, découlent de l'animation et de l'accueil des visiteurs
(organisation de visite, gestion de matériel, etc.).Les recettes
annuelles susceptibles (fonctionnement et investissement) auront un impact
direct sur l'économie locale à travers la consommation des
ménages des personnels, tandis qu'une partie sera
réinjectée dans le circuit économique à travers des
opérations structurantes pour le PV ou par le biais d'achats et de
prestation diverses.
2.1.2.2-Les retombées indirectes.
Les retombées indirectes renvoient à l'impact de
la protection sur les dynamiques économiques locales, certaines
activités se trouvant stimulées, d'autres limitées par la
protection. Elles correspondent également à la totalité
des dépenses réalisées par les touristes dans les
commerces, services et établissements situés à
proximité du PV ou bénéficiant de son
attractivité.
Ici dans le cadre de décentralisation, l'option pour
l'écotourisme en favorisant la protection des zones naturelles, et
veillant au bien être des populations locales :
92 Une étude réalisée aux
Etats-Unis révèle que l'activité récréative
dans les forêts nationales avait injecté pour la même
période 100 milliards de dollars dans l'économie
américaine en l'an 2000.Ceci exprime toute l'importance
économique des aires protégées. Dans la décennie
1990, le montant des dépenses annuelles associées à
l'existence des parcs du Québec avait été estimé
à 221,6millions de dollars dont 168,4 millions de dollars par les
visiteurs des parcs soit près de 80%.Ces dépenses ont permis de
soutenir 4614 emplois-année directs et ont engendré annuellement
des salaires et autres revenus avant impôts de plus de 193,8 millions de
dollars. Les revenus fiscaux et parafiscaux touchés par le Gouvernement
du Québec se sont élevés à plus de 45 millions de
dollars, dont plus de 32 millions de dollars en impôts sur les salaires
et en taxes indirectes. Les revenus fiscaux et parafiscaux perçus par le
Gouvernement Fédéral se sont pour leur part établis
à plus de 35 millions de dollars, dont plus des trois quarts en
impôts sur les salaires et taxes indirectes.
+ procure des avantages économiques aux
collectivités territoriales décentralisées, et aux
administrations qui veillent à la préservation des zones
naturelles;
+ créé des emplois et des sources de revenus pour
les populations locales;
+ favorise une prise de conscience chez les « doualais
» en particulier comme chez les touristes de la nécessité de
préserver le capital naturel et culturel.
Ainsi les bénéfices peuvent concernés les
retombées issues du tourisme93, de l'immobilier à
travers une augmentation de la demande résidentielle liée
à un cadre de vie préservé et des activités
économiques traditionnelles auxquelles la protection est favorable : le
tourisme peut être regardé comme une retombée positive
directe de la protection de cet espace qui peut drainer tout autour une demande
résidentielle importante saisonnière -résidences
secondaires, locations de vacances- ou plus rarement permanente, sans oublier
les impacts sur le prix du foncier. La valeur de ces retombées peut
être appréhendée en chiffre d'affaire, en emplois, voire en
retombées fiscales quand cela est pertinent.
Le Parcours Vita de Douala présente des
intérêts touristiques énormes avec des richesses
importantes, une biodiversité exceptionnelle formée d'une faune
ayant un fort taux d'endémicité, et d'une flore très
diversifiée à côté d'importants
écosystèmes. Parce que les relations très étroites
entre le tourisme, la ville et l'architecture sont de nature complexe et
multiple, l'art de voyager, de visiter et de se promener (en ville comme en
montagne ou dans une forêt urbaine) est intrinsèquement lié
à l'expérience architecturale et urbaine. En plus des facteurs
climatiques, topographiques, culturels, ou environnementaux, les attractions
touristiques dépendent surtout de signes et de repères
distinctifs.
Selon le Dictionnaire Le Petit Larousse 2008, le tourisme ou
« le fait de voyager, visiter un
pays, un lieu, un monument, etc. pour
son plaisir » recouvre plusieurs facettes présentant
des
avantages multiples et divers tant pour la collectivité que pour
le touriste lui-même. Le
93Dans les approches cherchant à
établir la valeur d'un site, la mesure de l'attractivité
touristique est la démarche la plus courante. Elle dérive des
études sur les sites classés pour leur valeur naturelle et
culturelle. Concernant le PV et dans le cadre de la décentralisation, la
démarche de valorisation la plus courante consisterait à
évaluer les sommes dépensées par les visiteurs, en
particulier les non-résidents de Douala 5ième ou de
Douala en général.. Cette évaluation doit prendre en
compte les retombées directes et indirectes.
tourisme concerne également les structures d'accueil, les
moyens de transport et recouvre plusieurs facettes94.
94
De façon globale les formes de tourismes sont :
a- Le tourisme responsable : C'est une
activité de tourisme ou de loisir qui met en place des pratiques
respectueuses de l'environnement naturel et culturel et qui participe de
manière éthique au développement économique local.
Cette forme de tourisme responsabilise et favorise ainsi la prise de conscience
du touriste vis -à -vis des impacts qu'il peut avoir sur le territoire
et le rend acteur de sa consommation.
b- Le tourisme durable désigne toute
forme de développement, d'aménagement ou d'activité
touristique qui respecte et préserve à long terme les ressources
naturelles, culturelles et sociales et contribue de manière positive et
équitable au développement et à l'épanouissement
des individus qui vivent, travaillent et séjournent dans ces espaces.
c- Le tourisme solidaire a pour
finalité d'amener le touriste à une forme de solidarité
concrète avec les populations visitées. Il peut prendre plusieurs
aspects, comme par exemple, le soutien à un projet de
développement (construction d'un pont, d'une école, d'un forage
etc.), et s'inscrit dans la durée, garante de l'accomplissement et de la
pérennité des actions de solidarité. Ainsi cette forme de
tourisme se place comme un facteur de développement et un
précieux apport financier (son action permet d'orienter certaines
dépenses vers le financement de certains projets) pour les
localités qui reçoivent ces touristes.
d- L'écotourisme : Le mot
écotourisme est souvent utilisé de manière abusive. C'est
un concept créé par des biologistes au Costa Rica dans les
années 80 afin de protéger la nature en utilisant les revenus du
tourisme. Il est fréquemment assimilé à tourisme «
nature ».L'écotourisme s'est développé dans la
foulée du mouvement environnemental qui est apparu au début des
années 1970. L'intérêt croissant du public pour
l'environnement et les voyages orientés vers le plein air,
associé avec (à) l'insatisfaction sans cesse
croissante envers le tourisme de masse, a montré à l'industrie du
tourisme qu'il y avait une place pour l'écotourisme. De même, la
compréhension et l'acceptation des principes de conservation de la
nature et de durabilité par une fraction grandissante de la population
ont également contribué à l'évolution du terme
écotourisme. En réalité il n'y a pas de définition
universelle de l'écotourisme, généralement
considéré comme « un tourisme favorable à
l'environnement ».Cette définition est diversement
interprété selon les pays ! Pour la Société
Internationale de l'Eco-tourisme (1991) c'est « un tourisme responsable en
milieux naturels qui préserve l'environnement et participe au bien
-être des populations locales. Selon l'Union Mondiale de la Conservation
(World Conservation Union) (1996) c'est la « visite de milieux naturels
relativement intacts à faible impacts négatifs comportant une
implication socioéconomique des populations locales qui est à la
fois active et bénéfique ».Autrement dit c'est un sous
ensemble du tourisme nature, qui respecte une certaine éthique dont les
composantes sont la protection de la nature et les retombées directes
aux populations locales. C'est à dire qu'il tend à minimiser
l'impact sur l'environnement naturel pour sa préservation à long
terme, mais il ne se contente pas d'une approche écologique passive
(économie d'énergie, utilisation d'énergies renouvelables,
traitements des rejets.)Il implique également une participation active
des populations locales et des touristes à des actions de sauvegarde et
d'éducation à la sauvegarde de la biodiversité
(reforestation, protection de la faune et de la flore, réintroduction
d'espèces, etc.).Il s'identifie aussi à une forme de voyage
responsable dans les espaces naturels qui contribue à la protection de
l'environnement et au bien-être des populations locales.
e- Le tourisme équitable s'inspire
des principes du commerce équitable. Il insiste plus
particulièrement sur la participation des communautés d'accueil,
sur les prises de décisions démocratiques, sur des modes de
production respectueux de l'environnement et sur une juste
rémunération des prestations locales.
f- Le tourisme intégré et diffus.
C'est une initiative locale de développement qui s'appuie sur
la volonté des populations de faire partager aux touristes la vie au
village, et de participer, ensemble, au développement du territoire.
Cette forme de tourisme permet aux populations de prendre en charge leur destin
à partir d'activités lucratives saines.
g- Le tourisme communautaire inclut des
activités variées, depuis l'entreprise privée
désireuse d'augmenter ses relations avec les communautés les plus
pauvres, au programme national visant la participation de ces
communautés à tous les niveaux. Les stratégies mises en
place dans cette forme de tourisme sont de trois grands types : l'extension des
avantages économiques pour
Parce que le tourisme revêt plusieurs facettes et ne se
réduit pas seulement à des activités de consommation, de
divertissement ou de spectacles, au sens large, le regard touristique au Pv
fait également référence à cette attitude de
distraction perceptuelle. Ce regard inattentif qui résulte de
l'observation du monde vivant sur le quotidien de cette nature verte
étouffe toute aptitude au discernement critique d'un
écotourisme.
On admet actuellement que l'écotourisme englobe les
principes du tourisme durable en ce qui concerne les impacts de cette
activité sur l'économie, la société et
l'environnement et qu'en outre, il comprend les principes particuliers qui le
distinguent de la notion plus large de tourisme durable.
L'écotourisme se pratique dans la nature, en petits
groupes au sein de petites structures, alors que le tourisme durable est une
notion plus large qui veut dire«développement durable du
tourisme», et qui concerne également les hôtels en villes ou
les compagnies de transport par exemple... L'écotourisme se distingue
aussi du tourisme de nature par son côté militant : la
responsabilité vis à vis de l'environnement naturel et culturel
et la volonté de contribuer à l'économie locale
.Généralement moins cher, l'écotourisme est plus souvent
sollicité sur le plan international.
Aujourd'hui, le touriste ne se comporte plus comme un
consommateur de masse désabusé en quête
d'authenticité, mais semble se réjouir de sa propre
expérience inauthentique post - touristique, qu'il pratique comme une
série de jeux à multiples textes. Le post -tourisme hésite
entre culture populaire et élitaire, authenticité et
inauthenticité, production et consommation, participation et
voyeurisme.
Avec la globalisation du regard touristique, la pratique
touristique a perdu son statut d'expérience culturelle à part
entière et s'entremêle de plus en plus à d'autres
phénomènes sociaux comme le travail, le commerce,
l'éducation, les sports ou le divertissement. Ce qui peut conduire
(conduirait) au croisement du lieu de sport- PV- avec des activités
attractives ou des parcs (espaces) à plusieurs thèmes ou la
commercialisation des espaces publicitaires. Le
lescommunautés les plus pauvres, l'augmentationdes impacts
non économiques, le développement des politiques, partenariats et
processus en faveur de ces communautés.
PV se trouve ainsi dans une logique où un linkage noble
s'établit entre le sport, la société, le tourisme,
l'environnement et l'économie.
Alors un espace se créé, se construit et
s'organise autour des dynamiques spatiales complémentaires et parfois
contradictoires. Ceci montre alors les conséquences spatiales des
idées en faveur de la protection de l'environnement et
révèle que les pratiques touristiques au PV doivent être
envisagées non sans contrôle.
Ainsi dans sa forêt toujours verte sur fond
marécageux, témoin d'une grande diversité et d'une
abondance d'espèces, le PV dans ses allures pittoresques,
protégé et conservé dans sa nature sauvage en
intégrant quelques aménagements pour le rendre attractif pour
développer ainsi en plein centre urbain le tourisme vert ou
l'écotourisme parce qu'il :
V' rassemble toutes les formes de tourisme axées sur la
nature et dans lesquelles la principale motivation du tourisme est d'observer
et d'apprécier la nature ainsi que les cultures traditionnelles qui
règnent dans les zones naturelles ;
V' comporte une part d'éducation et
d'interprétation de l'environnement ;
V' est généralement organisé pour des
groupes restreints.
BUDOWSKI (1976)95 cité comme le pionnier du
concept d'écotourisme, reconnaît que la relation entre le tourisme
et l'environnement naturel tend à être conflictuel, mais que le
potentiel existe pour une relation basée sur des bénéfices
mutuels. Sa description de la relation symbiotique qui pourrait s'en suivre
ressemble à l'idée contemporaine que l'on se fait de
l'écotourisme.
De nos jours, la politique Québécoise sur le
tourisme est axée sur la grande nature et sur les bienfaits qu'elle
procure. James Bernard HARKIN (1923)96, faisait la promotion de la
conservation et de l'appréciation des parcs, et il encourageait les
visiteurs à profiter de la nature qui les entourait. Il était
d'avis que les parcs favorisaient la santé et la vitalité, et il
les présenta comme des endroits où l'on pouvait admirer les plus
beaux paysages du Canada et qui pouvaient avoir d'importantes retombées
économiques. On ne tarda pas à aménager des
95 Budowski (1976) dans son article Tourism and
Environnemental Conservation Conflict, Coexistence or Symbiosis?
96 Personne d'importance historique au Canada
routes de même que des installations nécessaires
pour attirer les touristes, ce qui à son tour
permit d'obtenir des
crédits du Gouvernement. En 1923, HARKIN inaugura la première
route.
Aux Etats-Unis, l'activité récréative
dans les forêts nationales connaît depuis la décennie 1970
un fort accroissement. En claire, l'urgence d'une bonne adaptation du PV pour
répondre aux attentes de nombreux touristes éventuels,
très souvent sophistiqués et exigeants, de vivre des
expériences passionnantes et épanouissantes du point de vue
personnel consisterait (serait le) au dévoilement de l'orientation des
différents produits touristiques dans le PV.
2.1.3-Les retombées induites.
Elles impliquent la somme des effets dérivant,
très indirectement, de l'action de protection du PV .La notion d'effet
induit concerne avant tout l'emploi. L'évaluation de la création
d'emplois procédant de la gestion du PV devrait intégrer la
quantification des emplois induits dans tous les secteurs de l'économie
locale (commerces et services).
Les emplois induits sont évalués à
travers le multiplicateur de l'économie qui décline que la
création d'emplois primaires à l'occasion de nouveaux
investissements engendre dans différents secteurs d'activités un
accroissement cumulatif d'emplois secondaires, le multiplicateur d'emploi
mesurant le rapport des uns et des autres, ce qui permet aussi la
quantification de la plus -value de l'action publique.
D'autres effets induits envisageables relèvent de
richesses immatérielles telles que la valorisation des savoir-faire et
des images positives associées à l'espace Vita, les avantages que
retirent les personnes de savoir qu'elles ont la possibilité d'utiliser
une aire protégée, la satisfaction de savoir qu'une aire
protégée existe dans leur territoire même si elles ne
l'utilisent pas ou ne l'utiliseront sans doute jamais97.
97 Ces objectifs dans le cas du PV ne sont pas hors
de portée, loin s'en faut. Les investissements en faveur de la
conservation, de la protection et de la valorisation du PV sont tout aussi
essentiel au plan national pour le bien- être de la société
et tout aussi légitimes que les dépenses de défense, de
communications de justice, de santé, d'éducation, etc. La
labellisation d'un produit au PV, le renforcement de la notoriété
par les indications d'origine (les AOC ou autres formes
d'indication géographique permettent d'associer un territoire d'origine
et d'identification à un produit) permettraient de créer de la
valeur grâce à un effet de différenciation.
2.2-Les fonctions sociales du PV.
Elles découlent des activités sportives pour un
bien-être, pour se sentir bien, pour améliorer la qualité
de vie et des activités récréatifs et de recherche dans
une aire naturelle protégée.
2.2.1-L'amélioration de la qualité de vie
et de la santé par le sport.
Le football, la gymnastique, la natation, le footing, le
stretching, bref les sports collectifs ou individuels, en même temps
qu'ils participent des activités de loisirs, contribuent à
l'amélioration de la santé.
2.2.1.1-Les intérêts
généraux des activités sportives.
Depuis la nuit des temps le sport a été une
activité, un jeu de société dans l'Egypte ancienne et dans
la Grèce antiques98.Il a été à l'origine
de la création du PV et participe à sa manière à
faire connaître cet espace dont la nature sauvage contribue davantage
à son attractivité. Ses fréquentations sans cesse
croissantes témoignent de son importance auprès des populations
de la cité qui s'y retrouvent pour partager et échanger. Pour
généraliser, le sport au PV intéresse autant le sportif
lui-même que le simple spectateur.
98 Dans l'Egypte antique le sport était une pratique
régulière : lutte, saut, tir à l'arc, aviron..., mais
aussi des jeux d'adresse étaient pratiqués comme l'attestent les
tombes. Certains pharaons furent célèbres pour leurs exploits
sportifs qui grandissaient leur aura et plus encore leur dimension divine, en
particulier Aménophis II. Les nobles, pratiquaient la chasse pour se
divertir. La plus périlleuse d'entre elle, était la chasse
à l'hippopotame. Pharaon chassait aussi le lion, le taureau sauvage,
l'antilope.
De nombreux témoignages (décorations des tombes,
des vases, ostraca, etc.) laissent à penser que les activités
sportives occupaient une part importante des loisirs des jeunes
égyptiens de l'Antiquité. Bien que certaines
activités(notamment les activités martiales) soient plutôt
réservées aux aristocrates, il semble que les gens de toutes
classes s'adonnaient à la pratique d'une multitude de sport
:Athlétisme, boxe, course de chars(sport de combat avec des
cannes),lutte, sports nautiques(Nil oblige), tir à l'arc.
Dans la Grèce antique, le sport fut et l'est encore de
nos jours l'une des caractéristiques de la civilisation grecque antique.
Le premier livre des Macchabées appelle « usages des gentils
»le fait de s'exercer au gymnase .Le bâtiment apparaît partout
où les Grecs s'installent : Dion Chrysostome le cite comme l'une des
caractéristiques de la cité grecque avec l'agora, le
théâtre et la stoa. Pour le philosophe barbare ANACHARSIS, «
il y a dans chaque cité grecque un endroit où, chaque jour, la
folie s'empare des grecs-le gymnase ».Les jeux sportifs occupent une place
importante pour les Grecs. Ils apparaissent dans leurs deux premiers textes
littéraires, L'Iliade et l'Odyssée : ce sont les jeux
funéraires organisés par Achille après la mort de Patrocle
et les jeux organisés par le roi Alcinoos pour honorer Ulysse. Ils sont
étroitement liés à un culte religieux :les jeux olympiques
ont pour but d'honorer Zeus, de même que les jeux pythiques
célèbrent Apollon et les jeux Isthmiques Poséidon et dont
les disciplines les plus en vue ou du moins les plus pratiquées sont
celles qui figurent au programme des concours sportifs, essentiellement les
sports gymniques :courses à pieds, saut en longueur lancer du disque,
lancer du javelot, lutte, boxe et pancrace, la course montée introduite
aux jeux olympiques en 680 av JC et à Delphes en 586 av JC, la nage, le
hockey, les jeux de balle et de ballon, dont Hérode attribue l'origine
aux Lydiens. L'activité physique regroupe à la fois les exercices
pratiqués dans la vie quotidienne (tâches domestiques, trajets
pour se rendre au travail...) et les activités sportives de loisir ou de
compétition. Son intensité (faible, modérée ou
soutenue) engendre une dépense énergétique en rapport.
Elle doit être pratiquée pendant une durée minimale, qui
peut être fractionnée au cours de la journée, sans
être inférieure à 10 minutes (au-dessous de 10 minutes,
elle ne compte pas sur le plan physiologique).
Le spectateur d'une activité sportive profitera des
biens faits du spectacle pour chasser le stress et certaines angoisses. En
claire une activité sportive déclenche toujours chez le
spectateur des réactions des multiples fonctions biologiques pour
remettre en synergie le coeur, le cerveau, les nerfs, etc. pour produire des
effets psychiques positifs.
Le sportif pratiquant tire également un grand
bénéfice, se fait plaisir et fait l'expérience de
nouvelles sensations corporelles :en effet des études montrent que le
plaisir est la première motivation chez ceux qui pratiquent le sport et
beaucoup plus chez les jeunes ; cela est prouvé scientifiquement puisque
le plaisir que l'on prend lors d'une activité physique se traduit
physiologiquement par la sécrétion d'endorphines,
l'activité physique a donc une activité calmante grâce
à ces substances produites par le cerveau.
Au PV, parce que ce sont des activités qui connaissent
de brassages de nombreuses personnes (16000 fréquentations
hebdomadaires), le sport permet de faire l'expérience de relations
sociales différentes. Ce sont d'autant d'occasions d'entrer en contact
avec des gens dans un cadre différent de celui habituel, parfois loin de
chez soi, et où on peut se sentir plus libre : on rencontre des gens
avec qui on a des intérêts communs, on vit des moments
d'échange et de partage, et on se fait des amis différents de
ceux habituels, de tous les jours.
On découvre des personnes issues de milieux
différents, ce qui ouvre l'esprit à d'autres cultures, à
d'autres valeurs, à d'autres références que celles qui
viennent des parents, voire à d'autres philosophies. Aujourd'hui le
sport fait partie intégrante des manifestations populaires qui prennent
une place de plus en plus importante et favorisent la convivialité et le
partage des valeurs communes. Et on ne vit pas un évènement
sportif de la même manière si on pratique un sport.
Faire du sport peut amener à se dépasser
soi-même, à faire l'expérience de l'effort, qui peut servir
dans la vie tout court99. Un des esprits du sport étant de
participer et de donner le meilleur de soi-même, quel que soit le
résultat : c'est un défit qu'on se lance à soi -
même et qu'on essaie de relever.
99 Il est souvent organisé des marches sur
près de 15 km à travers les artères d'Akwa Nord,
l'exploitation des espaces des quartiers riverains pour des exercices, les
montées des escaliers dans le cadre du sport au PV.
Une bonne condition musculaire s'entretient par des exercices
d'endurance comme la randonnée, accompagnés de séances de
gymnastique de 20 minutes, intéressant tous les groupes musculaires
(épaules, cuisses), deux fois par semaine (associée à un
apport protidique de 0,8g/jour).Les contraintes mécaniques
engendrées par l'exercice, associées à l'apport en calcium
(1g/j), stimulent la formation du tissu osseux. D'où
l'intérêt de l'activité physique pour les jeunes en pleine
croissance (qui constituent leur capital osseux) et les moins jeunes pour le
maintien de leur structure osseuse.
Au PV l'activité physique conserve leur souplesse aux
ligaments et tendons, évitant même certaines ruptures par la
mobilisation des articulations, ce sont généralement des
exercices modérés, ne déclenchant pas l'arthrose comme le
fait l'activité intensive (surtout à la suite d'une blessure). Du
moins, elle diminue les douleurs et maintient la force musculaire, lorsque
l'arthrose s'est installée. L'autre intérêt du sport est de
se confronter à d'autres, de gérer les rivalités avec les
autres. Dans un sport collectif par exemple on apprendra à trouver sa
place dans un groupe, ou à ne pas être démoli quand on
perd. Le sport apparaissant donc comme une expérience qui aide à
aborder des conflits dans d'autres domaines.
Une forêt protégée des pollutions et
autres multiples agressions est un sanctuaire de vie .Alors y pratiquer le
sport n'aura que des avantages. Le PV, avec ses lacs, ses rivières et sa
petite forêt s'y prêterait abondamment puisqu'on y respirerait un
air de moins mauvaise qualité.
2.2.1.2-L'apport du sport sur la santé.
La pratique du sport n'a que des effets
bénéfiques pour l'individu. Il est démontré qu'une
pratique modérée de sport comme la randonnée renforce les
défenses immunitaires. Par une meilleure oxygénation,
l'activité physique participe au bon fonctionnement du cerveau :
récupération après lésion, lutte contre les
maladies dégénératives.
Selon certaines études, il existerait un lien direct
entre la qualité de sport effectuée et le niveau de protection
vis-à-vis de nombreuses maladies. Une activité physique
modérée comme la randonnée renforce l'estime de soi,
redonne éventuellement confiance et permet une meilleure
intégration dans la vie sociale. Avoir une meilleure qualité de
la vie c'est pratiquer le sport pour se sentir davantage bien et être en
bonne santé.
Pratiquer une activité physique permet de mieux se
protéger contre certaines maladies comme le diabète,
l'obésité et les problèmes cardio-vasculaires qui peuvent
en découler, et même les maux de dos. Même une demi-heure de
marche suffit pour donner au corps une activité physique minimale. En
protégeant les vaisseaux, l'activité physique prévient et
participe au traitement des maladies cardiovasculaires. Elle diminue :
· le risque de faire un diabète de type 2, de
60%,
· l'angoisse et la dépression,
génératrices de maladies cardiovasculaires,
· e taux de triglycérides, de mauvais
cholestérol et elle augmente le bon ;
· la tension artérielle de façon modeste mais
sensible ;
· la mortalité de 25 à 35% en cas de maladie
coronarienne déclarée100.
Sur autre plan, des milliers d'études prouvent que le
sport est bon pour la santé en général, en même
temps pour le pratiquant que pour le spectateur. On dira que le sport ne donne
pas que la forme, mais les formes physiques, morales, mentales, psychiques,
etc.
L'activité physique réduirait sensiblement le
risque de cancer du sein ou du colon. L'intérêt du sport pour la
santé et en particulier pour protéger contre le cancer du sein
s'est récemment vu conforter par une nouvelle étude menée
par une équipe de l'INSERM et dont les conclusions ont montré que
la pratique régulière d'activités physiques
entraînerait une diminution du risque. Par exemple, une femme qui ferait
cinq fois du sport par semaine verrait son risque relatif du cancer de sein
diminuer de 38%, le bénéfice est moindre pour celle qui se
contente de faire le ménage Il reste qu'à raison de 14 heures de
sport par semaine, on obtient une réduction du risque de 18%.Pour dire
autrement, plus elle se dépense, mieux la femme est
protégée101. Cette relation résiste même
à l'influence des autres facteurs de risque : surpoids, traitement
hormonal substitutif, génétique. Pratiquée de
manière judicieuse, la randonnée devient un atout majeur dans le
traitement des bronchites chroniques et l'asthme.
La randonnée ne fait pas maigrir, elle remplace de la
graisse par du muscle. Associée à un
régime, elle en
renforce les effets. L'individu en surpoids actif court beaucoup moins
de
risques que celui qui a une corpulence normale mais qui reste
sédentaire. Faire du sport est
100 Pour prévenir une récidive de la maladie,
on recommande une pratique modérée, régulière et
progressive : 30 minutes 5 fois par semaine, avec 2 séances de 20
minutes de renforcement musculaire sous couvert de l'accord du cardiologue.
101 Confère Maxi sciences : quelques conseils pour
réduire le risque de cancer de sein, http/www. Yahoo
actualité.com
bon pour les seins. Le sport contribuerait à la perte
de poids, la réorganisation hormonale, et au renforcement des
mécanismes de défense immunitaire : un corps plus aguerri,
détecte et élimine les petits cancers avec une plus grande
efficacité. Au mieux pratiquer le sport dans un environnement naturel
sain, accroîtrait les mesures de protection contre certaines maladies, en
renforçant les capacités réactives de l'organisme.
Faire du sport est bon pour les seins. Le sport contribuerait
à la perte de poids, la réorganisation hormonale, et au
renforcement des mécanismes de défense immunitaire : un corps
plus aguerri, détecte et élimine les petits cancers avec une plus
grande efficacité. Au mieux pratiquer le sport dans un environnement
naturel sain, accroîtrait les mesures de protection contre certaines
maladies, en renforçant les capacités réactives de
l'organisme.
Avec les flots d'informations diverses relatant les
catastrophes dans de nombreuses régions du globe, les crises
financières qui n'en finissent pas, le chômage, les faillites des
entreprises, les délocalisations plongeant au passage les Hommes dans le
chômage, l'angoisse, la peur, dont les effets directs sur la santé
entraîneraient entre autres le stress, le sport récréatif
serait un bon palliatif. Le PV peut jouer également un rôle de
milieu naturel de foisonnement de recherche biologique et autre.
2.2.2-Le PV comme lieu récréatif et
milieu de recherches éducatifs.
2.2.2.1-L'offre des possibilités de recherches
scientifiques.
L'une des principales fonctions de la préservation de
la biodiversité du PV est d'offrir une grande richesse de biens naturels
favorables à l'étude et à l'observation. En ce qui
concerne l'offre de sujets d'études pour la recherche au PV, les
espèces protégés ou non représentent des contextes
privilégiés du fait probablement du faible degré de
perturbation du milieu. La forêt, les eaux, les lacs, les sols et
l'exubérance des manifestations biologiques du PV constitueraient un
excellent support pédagogique pour faire prendre conscience de la
diversité, de la dynamique et du fonctionnement des
écosystèmes bien que d'un point de vue scientifique, il reste
encore biens des aspects fonctionnels à élucider.
2.2.2.2-Le PV, espace récréatif.
Dans le même ordre d'idées, nous
évoquerons l'importance culturelle du PV pour faire
référence aux bénéfices immatériels
attachés à ce milieux comme la spiritualité et le
religieux, l'esthétique, le récréatif et l'éducatif
sans oublier l'ensemble des services d'auto entretien c'est-à-dire des
services nécessaires pour tous les autres services fournis par les
écosystèmes, comme la biodiversité, la formation des sols,
le cycle nutritif et la pollinisation. Il peut être aussi un lieu de
concentration, d'inspiration artistique102 et de jeux d'animation
culturelle.
Autrement dit, intégré dans le patrimoine
paysager et culturel de la ville de Douala en particulier, le PV formerait en
quelque sorte la vitrine dont la protection viendrait donner une réponse
magistrale à la folie destructive des hommes permettant à la
ville en particulier et au pays en général de faire
connaître au reste du monde son attachement à la nature et de
rehausser son image sur les scènes nationale et internationale.
En affirmant ainsi sa contribution à la sauvegarde de
la biodiversité, Douala se fait le promoteur d'un territoire vert et en
santé où il fait bon vivre, travailler, investir et voyager, ce
qui est fondamental dans un contexte mondial où le maintien de la
biodiversité prend de plus en plus d'importance dans un processus
d'exploitation des ressources naturelles.
2.3-Les services environnementaux du PV.
Les retombées économiques directes et
indirectes, ainsi que les aménités à caractère
social (au sens large), n'épuisent pas tous les bénéfices
susceptibles d'être rendus par le PV. Il faut y ajouter les services plus
proprement environnementaux( les services environnementaux maximisés au
PV comprennent la protection des sols, la rétention d'eau, l'absorption
des inondations, la limitation des inondations, la fixation de carbone, la
production d'oxygène, la diversité génétique, le
potentiel de recherche, des avalanches, etc. .) rendus par les
écosystèmes et qui bénéficient directement et
indirectement aux populations locales et à la collectivité
régionale et /ou nationale dans son ensemble.
102 Il a été produit ici un album musical dont les
chansons rythment le sport au PV.
2.3.1-Préservation de la biodiversité
et services fournis par les espèces.
La valeur de la biodiversité est la dimension à
priori la plus importante, pourtant la plus difficile à évaluer,
mais facile à quantifier quand on focalise l'analyse sur des
espèces naturelles qui ont ou acquièrent une valeur
économique. La valeur de la biodiversité ne se réduit pas
à la valeur d'existence et de legs pour les générations
futures. La biodiversité rend des services écologiques qui ont un
intérêt économique direct. Le plus emblématique est
la pollinisation assurée par les insectes, processus essentiel à
la réussite de certaines cultures. Les insectes constituent une
ressource alimentaire essentielle pour la faune sauvage, source
d'activités récréatives telles que la chasse, la
pêche ou encore l'observation.
Aux Etats -Unis, les services écologiques fournis par
les insectes sont estimés à près de 57milliards de
dollars. La poussée démographique entraînant l'urbanisation
a contribué à la destruction d'une grande surface de la
forêt, affectant ainsi une autre partie importante des retombées
environnementales du PV découlant d'une part de sa conservation et
préservation dans l'intérêt de la pharmacopée
traditionnelle qui puise la quasi totalité de sa matière
première dans la flore et la faune sauvage, d'autre part le PV est le
logis d'une grande diversité biologique avec des espèces
endémiques de faune et de flore, de nombreuses espèces d'oiseaux
en dépendent.
Le PV s'avère indispensable à la reproduction
des batraciens et de certains poissons. En tant que laboratoire naturel de
recherche, le PV permettrait aussi de développer (du moins
potentiellement) des produits économiquement rentables, comme des
produits pharmaceutiques ou alimentaires ou encore de contribuer au
développement des biotechnologies.
2.3.2-Piégeage du carbone.
La vie étant intimement liée à
l'environnement qui influe directement sur elle, il est évident que la
destruction de la micro-forêt du PV conduirait automatiquement à
une décomposition de la biomasse qui s'accompagne d'émissions de
dioxyde de carbone (CO2). Dans sa microstructure, la protection du PV et la
gestion des ressources qu'il offre à la vie humaine des citadins de
Douala sont capitales parce que la richesse et la diversité des
bénéfices sont étroitement liées à la
qualité des écosystèmes.
Le PV se présente comme un élément de
lute contre le changement climatique à Douala en
même temps
qu'il jouerait le rôle d'espace de transition entre la terre et l'eau.
Parce qu'il
constitue un microréservoir de biodiversité, un
patrimoine naturel irremplaçable remplissant des fonctions «
d'infrastructures naturelles » inégalables.
Du point de vue des changements climatiques, le PV est un
grand réservoir de stockage des quantités importantes de carbone
.A l'inverse, sa dégradation le transformerait en une importante source
additionnelle de carbone atmosphérique. C'est dire que arrêter la
déforestation, le dessèchement, les feux de brousse et autres
constructions sauvages ,bref prendre soin du PV participerait à la
solution au changement climatique dont les effets négatifs affecteraient
la santé humaine :maladies respiratoires dues à l'augmentation
des gaz à effets de serre, mortalité des jeunes enfants et des
personnes âgées pendant les vagues de chaleur ou encore
accélération des réactions chimiques et physiques comme
les cancers de la peau à cause de l'appauvrissement de l'ozone
atmosphérique.
2.2.3-Les dangers de la diminution de la
biodiversité du fait de la déforestation du
PV
L'article 2 de la Convention de RIO définit la
biodiversité comme une contraction de « diversité biologique
», expression désignant la variété et la
diversité du monde vivant. Dans son sens le plus large, ce mot est quasi
synonyme de « vie sur terre ». La biodiversité forme un
réseau complexe qui assure le fonctionnement naturel et procure une
multitude de services à l'homme (médicaments, matières
premières, tout ce que nous mangeons -cultures vivrières,
bétail, poissons..., filtrage de l'eau, production
d'oxygène,...).
A COPENHAGUE en 2009 la sirène d'alarme a
été tirée en vain. Et pourtant les craintes en tout temps
sont aujourd'hui fondées.
Le 11 Mai 1971 à Menton103 en France, 2200
scientifiques de 23 pays criaient déjà dans le désert,
mettant en garde la communauté internationale « contre le danger
sans précédent que fait courir à l'humanité la
civilisation industrielle ».René Dumont, premier Candidat
présidentiel écolo demandait déjà il y a 40 ans
« quelle terre laisserons-nous à nos enfants ? Aujourd'hui les
sarcasmes ont fait place à l'inquiétude, et tout le monde
commence à redouter les conséquences du réchauffement
planétaire.
103 Petite ville du sud-est de la France où culture et
nature se conjuguent harmonieusement ; C'est aussi la cité des jardins,
ville d'art et d'histoire.
Une étude parue dans la Revue « Nature » en
Janvier 2004 estime que 15 à 37%de l'ensemble des espèces sont
menacées d'extinction à cause de la modification de leur habitat
naturel si la température s'élève de 1,8°
à 2° Celsius, ce qui représente près d'un
million d'espèces végétales et animales. Une augmentation
moyenne de 2 degré est suffisante pour provoquer une montée des
eaux jusqu'à 70 à 80 mètres s'il y a fonte des calottes
glaciaires et des glaciers.
L'OMM s'inquiète : « le nombre de ces
phénomènes n'a cessé de croître ces dernières
années » évoquant la canicule, la pénurie d'eau
douce, les tempêtes et inondations un peu partout dans le monde et les
562 tornades qui ont touché les USA.
Le Cameroun n'est pas du reste ; autant concerné qu'il
doit partager les inquiétudes de René Dumont en même temps
que les préoccupations de l'OMM. Ces préoccupations sont d'autant
plus urgentes que l'Observatoire National sur l'Environnement se
présente comme un instrument fort pour susciter un comportement
responsable104 .
104 La pertinence de cette responsabilité à la
fois individuelle et collective trouve davantage son cadre dans la loi
N°96/12 du 5 Août 1996 portant Loi Cadre relative à la
gestion de l'environnement. Au titre 1 des dispositions générales
: Article2 (1) :l'environnement constitue en République du Cameroun un
patrimoine commun à la nation. Il est une partie intégrante du
patrimoine universel (2)-Sa protection et la gestion rationnelle des ressources
qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt
général. Celles-ci visent en particulier la
géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur
contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et
culturels qu'ils comprennent
CONCLUSION
Hier espace de sport l'espace Vita protégé et
conservé dans sa nature sauvage allierait aux fonctions
économiques, dans une dynamique multifonctionnelle les fonctions
sociales et les services environnementaux qui en découlent. Cette
interdépendance fonctionnelle dans une aire protégée peut
dans le cadre de la décentralisation, constitué un
précieux outil de développement local.
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
L'analyse dans cette deuxième partie fait ressortir la
nécessité de protéger le parcours vita de Douala pour en
tirer le meilleur profit. L'environnement bien qu'étant un bien
économique particulier est aussi épuisable. Ses capacités
diminuent au fur et à mesure de son utilisation non conséquente
réduisant ainsi la satisfaction des besoins des populations. Cette
situation expose notre planète à des catastrophes destructrices
dont les conséquences n'échappent guère à la
communauté internationale.
Pourtant des mesures de protection et de conservation
existent à travers l'arsenal juridique traditionnel national et
international dont la mise en oeuvre implique non seulement les pouvoirs
publics, la communauté internationale, la société civile
et les organisations non gouvernementales. L'implémentation de cette
dynamique au parcours vita de Douala dans le but de sa transformation en une
aire protégée, valorise cet espace pour en faire un outil de
développement local dans le cadre de la décentralisation. Cette
implémentation se fait en tenant compte de ses fonctions
économiques et touristiques, de son intérêt social et de
ses avantages environnementaux.
CONCLUSION GENERALE
Tout au long de ce mémoire, nous avons voulu montrer
que bien que bien que le sport ait été à l'origine de la
création du PV de Douala, il n'en reste pas moins la seule
activité possible dans cette espace de vie sauvage.
A l'issu de nos travaux, nous avons dans un premier temps
montrer que nonobstant sa violation, la dégradation de sa flore et de sa
faune, des menaces sur l'ensemble de l'écosystème et l'abandon du
circuit du sport (jusqu'à très récemment où
grâce aux travaux de réhabilitation le circuit et les ateliers ont
refait surface), espace gorgé d'eau qui l'apparente à une zone
humide avec ses lacs, ce qui reste de la faune et de sa flore, la
rivière Nkondi qui l'inonde pendant toute l'année et imprime ses
pulsations au paysage, il demeure une nature d'importance capitale du fait des
fonctions naturelles découlant de l'absolue nécessité de
sa préservation qu'il remplit, sa contribution à la
régulation du régime des eaux en favorisant la
réalimentation des nappes souterraines, zone de résilience par
excellence face aux risques naturels ainsi que des bassins naturels d'expansion
des crues et des milieux épurateurs performants capable d'absorber de
grande quantité d'azote.
Dans un second temps, nous avons analysé les autres
fonctions que le PV pourrait générer. Des fonctions
dépendant directement de la protection et de la conservation qui
pourraient se fédérer au sport dans une dynamique
multifonctionnelle. Activité centrale au PV, le sport de façon
automatique entraîne l'individu dans une nature où pourraient se
développer le tourisme, la promenade et d'autres activités
ludiques.
Notre souci quand nous abordions ce sujet nous a donné
l'occasion de formuler plusieurs questions dont la principale est comment
fédérer autour du sport les fonctions économiques,
touristiques, sociales et environnementales et parvenir ainsi à redonner
une autre image au PV pour jouer un rôle dans le développement
local ou du moins être un élément d'attraction pour la
ville de Douala ?
Reconnaissant que l'environnement n'étant pas une
marchandise à valeur marchande, il peut « se vendre » et
procurer d'importantes ressources pour la collectivité locale dans le
cadre de la décentralisation, en même temps que bien
protégé et conservé il peut auréoler une
région, une nation au niveau international comme partenaire à la
protection de
l'environnement. En réalité, la question de
l'environnement semble ne pas être perçu par bon nombre de
citoyens et si elle est perçue, cela est fait de façon aussi
négligeable c'est-à-dire que les dangers liés à
l'environnement demeurent grands mais mal perçus. Ces dangers au PV sont
énormes et évidents du fait de son engorgement. Par ailleurs le
législateur Camerounais n'a pas encore fait de l'environnement sa
priorité car il ne suffit pas d'édicter les règles
protectrices, mais aussi de rendre la répression effective.
La législation existe, mais aucun mécanisme de
suivi n'est mis en place. Parce que la question de l'environnement est
aujourd'hui une notion interplanétaire étant donné la
gravité des dangers liés à l'environnement et de ses
implications qui sont du reste majeurs, il revient aux Pouvoirs publics de
disposer suffisamment des moyens juridiques forts, coercitifs afin de faire
face à ces questions car l'environnement est un partenaire involontaire
et obligatoire pour faire l'objet d'une question importante et envisager ainsi
l'avenir avec optimisme.
Les menaces (du fait des populations ayant
empiété, violé et dégradé l'environnement)
qui pèsent sur le PV sont évidentes au point de menacer son
existence. Et pourtant il est nécessaire de protéger pour mieux
gérer le PV dans un souci de conservation de son espace naturel et des
espèces animales et végétales, et de lui permettre de
participer ainsi à son échelle sur le plan mondial à la
lutte contre le réchauffement climatique d'une part et les
bénéfices à la fois matériels et immatériels
qui en résultent étant énormes, contribuent d'autre part
au budget de sa localité.
Ces objectifs à la fois économiques, sociaux et
environnementaux intègrent un secteur de plus en plus important à
l'échelle mondiale, celui du tourisme de nature. L'écotourisme se
présentant aujourd'hui comme le secteur d'activité fleuron,
à terme devrait se substituer à la manne des capitaux qui ont
contribué à la protection et la réhabilitation du PV pour
en faire une véritable aire protégée, d'attraction du fait
de ce que ce secteur est un réservoir de nombreuses opportunités
d'emploi, ainsi qu'une source d'apport de devises à même de
favoriser les autres activités génératrices de revenus.
Sur le plan de la recherche scientifique, les richesses dont
regorge le PV n'ont jusqu'alors été explorées, or le
développement de l'écotourisme, des randonnées
pédestres,
etc. ne saurait se faire sans une meilleure
connaissance des espèces aussi bien de la faune que de la flore.
La protection et la conservation de l'espace Vita dans la
perspective de remplir ses fonctions sportive, touristique, environnemental et
économique, dans une dynamique spatiale d'attractivité exige de
la part des pouvoirs publics locaux/nationaux une appropriation totale des
enjeux dont il est l'objet.
Aussi ces enjeux de valorisation et de protection du PV
passent également par sa promotion auprès des populations locales
et de la communauté internationale sans oublier les investisseurs
privés. Cette promotion doit découler de ce que les pouvoirs
donnent au PV pour en attendre les retombées telle la création
ici de nombreuses activités thématiques pour meubler son
tourisme.
Il s'agit de réaffirmer le rôle de cette nature
sauvage comme l'un des facteurs importants de conservation tant de la
diversité culturelle que biologique en même temps qu'un outil de
développement local dans le cadre de la décentralisation. Sous
cet angle les pouvoirs publics loin d'être des acteurs passifs doivent
s'affirmer dans leur rôle « comme un des éléments
essentiels et partie prenante du système local de production. Leur
rôle est donc, pour ainsi dire, permanente et dynamique 105»
En effet, les regards prospectifs sur le PV nous imposent une
démarche sur trois axes : -Les principes généraux,
-Les fixations sur le concret ou la valorisation du PV par
rapport à son espace, -Les « attendus » de la
réhabilitation106
105 ESSOMBE EDIMO J.R. : « spatialité et
développement économique : Douala entre le hasard et la
nécessité», éd. L'Harmattan, Coll. « Etudes
Africaines », Paris, 2007
106 Les travaux de réhabilitation ont été
initiés par les Pouvoirs publics et se chiffreraient à plus de
500 millions de francs CFA avec entre autre la restitution du PV dans ses
limites originelles.
QUELQUES PROPOSITIONS POUR L'EPANOUISSEMENT AU
PARCOURS VITA.
Elles concernent l'ensemble des actions à mener par
les pouvoirs publics, la Société civile, les particuliers et
autres anonymes, dans la quotidienneté et visant à la
conservation et la préservation de l'environnement en
général et du PV en particulier pour en tirer les meilleurs
conditions de vie. C'est aussi un ensemble d'engagements éventuels
susceptibles d'orienter davantage le PV vers un rôle quelque minime de
micro poumon vert dans une dynamique spatiale qui s'appuie sur un arsenal
juridique plus étoffé mettant en oeuvre des moyens de
défendre une politique de préservation (protection sans
exploitation des ressources ) pendant une période donnée. Ces
engagements doivent porter sur la valorisation du PV, de son espace naturel
(paysages, lacs, forêts, végétation, etc.) qui sert de
point d'appui à une politique patrimoniale à l'effet de susciter
l'attribution d'une valeur effective et symbolique à l'espace Vita (qui
induit une partie du reflux des activités).
Parce que la forte croissance de la population urbaine pose
des problèmes pour la préservation de l'environnement, il
faudrait adopter, selon que de besoin en faisant une fixation sur l'homme ,des
politiques et des mesures appropriées pour régler ces
problèmes; C'est la population qui anime le progrès social et
créé la richesse de la société, qui
développe la science et la technique et par son dur travail ,transforme
sans cesse l'environnement d'où le renforcement grandissant de
l'aptitude de l'Homme à améliorer et protéger son
environnement.
La Société Civile, la collectivité
« doualaise » doivent reconnaître leur responsabilité
particulière dans la sauvegarde du patrimoine Vita constitué par
la flore, la faune sauvage qui sont aujourd'hui menacées par un concours
de facteurs défavorables. Ceci interpelle aussi les autorités
locales d'une part et montre d'autre part que la protection et la conservation
de la nature et notamment de la flore et de la faune sauvages dans l'espace
Vita devrait donc tenir une place importante dans la planification pour le
développement de la ville de Douala, principal foyer industriel du
Cameroun et de la sous- Région CEMAC (devant les villes comme
Yaoundé, Libreville, Brazzaville Malabo), Douala concentre à lui
tout seul plus des trois quart des Entreprises du pays, produit plus de 60% de
son PIB et en représente un peu moins de 11% de la
population107
107 ESSOMBE EDIMO in Spatialité et développement
économique Douala entre le hasard et la nécessité p
121.
Egalement les pouvoirs publics doivent s'impliquer et prendre
toutes les mesures possibles pour empêcher la dégradation, la
destruction et la pollution du PV mettant ainsi en danger la santé de
l'homme et de nuire aux ressources biologiques et la vie des autres organismes.
Dans cette lutte, les uns et les autres doivent d'une part assurer leurs
responsabilités et se partager équitablement les tâches,
d'autre part les hommes de toutes les conditions et les Organisations les plus
diverses pourraient, par les valeurs qu'ils admettent et par l'ensemble de
leurs actes déterminer l'environnement de demain.
Par ailleurs, il serait essentiel de dispenser de
façon générale un enseignement sur les questions
d'environnements aux jeunes générations aussi bien qu'aux adultes
en tenant dûment compte des moins favorisés, afin de
développer les bases nécessaires pour éclairer l'opinion
publique et donner aux individus, aux Organisations privées et aux
collectivités le sens de leurs responsabilités en ce qui concerne
la protection de l'environnement en général et du PV en
particulier.
La masse populaire sportive du PV pourrait être
utilisée comme un moyen d'information pour la sensibilisation du grand
public, et surtout des populations riveraines des conséquences de leurs
actes (travaux, constructions des habitations, activités affectant la
nature sauvage du PV, rejets etc. ;) qui nuiraient à la conservation et
la préservation de ce poumon vert, sanctuaire de vie sauvage.
Avec la permanence des eaux, qui favorise une
végétation d'arbres aquatiques, endémiques, les lacs qui
débordent, les caractéristiques du milieu et les nombreux
avantages économiques, touristiques et environnementaux qui en
découlent, interpellent les autorités nationales à
désigner la zone du PV « zone humide » pour figure sur la
liste des zones humides d'importance internationale établie en vertu de
la Convention de RAMSAR pour en bénéficier les nombreux
avantages.
Sur le plan International les questions internationales se
rapportant à la protection et à l'amélioration de
l'environnement devraient être abordées dans un esprit de
coopération. Il revient alors surtout à l'Etat de veiller
à ce que les Organisations gouvernementales ou non gouvernementales
jouent un rôle coordonné, efficace et dynamique dans la
préservation et l'amélioration de l'environnement.
Autrement dit, parce que les déficiences de
l'environnement imputables à des conditions défavorables de
sous-développement et à des catastrophes naturelles posent des
problèmes graves, le meilleur moyen d'y remédier est
d'accélérer le développement par transfert d'une aide
financière et technique substantielle pour compléter l'effort
national des pays en voie de développement et l'assistance fournie en
tant que de besoin.
REFLEXION SUR LA VALORISATION DE L'ESPACE.
VITA
Il s'agit ici de trouver les combinaisons possibles et
susceptibles qui permettent de tirer le meilleur profit de la
multifonctionnalité en tenant dûment compte des exigences
environnementales. Ceci ne serait possible que si au préalable l'espace
Vita reprend ses limites originelles encore occupées par des
populations, produites de l'exode rural par exemple, qui s'installent selon
leur « bon vouloir ».
La bonne compréhension des divers enjeux revient
à fixer ou du moins matérialiser les différentes
combinaisons possibles dans un plan qui prend en compte le génie civil
et les autres travaux dans un espace construit à la fois par l'existence
des lacs, de la rivière Nkondi et par la présence d'une
forêt :
· Nettoyer le PV de tout ce qui lui est étranger :
fondations des constructions, les déchets résultants de la
combustion des vieux pneus, les baraquements, etc. ;
· Nettoyer et débarrasser au préalable les
lacs des salissures et de la jacinthe qui encombrent les surfaces ;
· Elaborer une législation en soutien à la
conservation et à la gestion du PV ;
· Préserver et restaurer la strate arbustive : le
milieu buissonnier a presque disparu au
PV, les quelques zones de bocages
encore existants doivent être protégés d'urgence.
Ces milieux sont biologiquement très riches et
nécessaires à l'avifaune. Leur disparition sonne le glas des
espèces de ces milieux semi-ouverts. Il faut cependant encourager une
replantation des strates arbustives en variétés locales ;
Les arbres doivent être mieux protégés,
du fait de leur valeur intrinsèque comme patrimoine naturel et utile
à la biodiversité ; Favoriser les espèces indigènes
de végétation (c'est une priorité) utiles à la
flore et à la faune locales et qui peuplent nos forêts et
éviter les espèces ornementales. La misse en oeuvre au niveau du
PV d'un
plan de développement de la nature comprenant un plan
d'amélioration et de conservation des habitats de l'avifaune, de la
botanique, des insectes, champignons et bryophytes ;
O L'utilisation ou l'inclusion des briques creuses pouvant
servir de cavités nichoirs pour des espèces cavernicoles
(moineau, rouge-queue, martinets, etc.).
O L'aménagement de la forêt par le reboisement
permettrait l'introduction ici du petit gibier (hérissons,
lièvres, écureuils, porcs-épics...) dont la
chasse108 organisée procurerait des ressources en même
temps que l'activité touristique grevée autour ;
O Le peuplement de certains lacs suivant des techniques
modernes de pisciculture par des variétés de poissons, et
l'introduction dans les autres de certains animaux et oiseaux aquatiques
(crocodiles, tortues, canards..) dont la pêche109 et la
fréquentation payantes contribueraient au budget des
collectivités décentralisées.
O A côté de cet ensemble, le sport nautique, les
promenades sur pirogue à moteur ou les canoës sur les lacs,
l'aménagement des espaces de café apporteraient à
l'économie locale d'importantes ressources et permettraient de financer
de nombreux emplois permanents et temporaires ;la dédicace temporaire,
payante de certains ouvrages(bancs, tableaux d'affichage..)
édifiés au PV à la demande des particuliers pour
commémorer des évènements de leur vie (fiançailles,
mariages, anniversaires, baptêmes etc.) serait aussi à coup
sûr une source de recettes ;
O La construction des ateliers de sport doit prendre en compte
la charge des sollicitations et prévoir leur solidité ; il serait
également loisible de construire le long du circuit de sport (tous les
200-300m) des bancs disposés de façon quelconque pour permettre
le repos de certains et éviter ainsi les éventuels accidents ;
O L'Aménagement de la promenade110 verte
dont la conception devra non seulement viser les fonctions
récréatives et sociales mais également, de façon
équilibrée et indispensable, la fonction écologique. A
terme cette promenade verte pourrait devenir
108 La chasse constitue également une activité
sportive. Son organisation dans le PV implique des dispositions
spéciales pour éviter des accidents. Dans cet ordre
d'idées, il s'agira d'une chasse à la criée avec des
filets différente de la chasse au tir ou à l'arme à feu,
en privilégiant la protection des espèces. Le gibier sera vendu
à un prix concurrentiel et attractif. La chasse s'ouvrira par
très courte période de l'année.
109 Il ne s'agit pas ici d'une pêche aux filets, encore
moins du type industrielle. Pour intéresser le touriste et le tourisme,
la pêche à la ligne serait indiquée .Chacun pourra apporter
sa canne à pêche ou alors le PV disposera des cannes à
pêche à louer. Le prix à payer pour le poisson
pêché serait au kilogramme. Ce serait un prix concurrentiel,
attractif dans le but de maximiser la fréquentation par le plus grand
nombre. Pour ce faire les lacs doivent être protégés
(bordés) des infrastructures de génie civil. Elle peut
s'étendre sur une période de l'année (6 mois).Pour
compléter l'attraction et vivre l'instantanée des postes de
braise de poisson peuvent être installés en dehors du PV.
L'essentiel est de préserver la propreté des lieux.
110 Pour la promenade verte, la réhabilitation doit
aménager à l'intérieur du PV des pistes reliant les
différents thèmes touristiques en y incorporant des points de
repos à l'instar des bancs et des abris.
un véritable maillon du maillage vert. Mais avant tout il
faut conserver et réhabiliter cette zone de hautes valeurs biologiques
existantes. ;
O Abandon des pesticides de toutes formes au PV ;
O Eviter de transformer l'espace Vita en un marché avec
comme conséquence directe la pollution par les déchets des
commerces ;
O Imposer aux riverains des actions en faveur de la
salubrité dans le but de protéger les lacs, les eaux et
l'environnement Vita contre la pollution domestique (par les eaux usées,
les déchets de ménage, etc. .) ;
O Construire des postes de surveillance ou miradors d'hauteur
suffisante à chaque 200m le long de la clôture et doter les
gardiens de lunettes jumelles pour une surveillance efficace ;
O Etablir en concertation avec les collectivités
territoriales décentralisées, les associations
agréées de protection de la nature, un programme d'actions visant
à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de
façon durable le PV ;préciser dans ce programme les pratiques
à promouvoir ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur
généralisation, rendre obligatoires certaines de ces pratiques et
préciser les modalités selon lesquelles ces pratiques peuvent ,le
cas échéant ,bénéficier d'aides lorsqu'elles
induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.
O La transformation par des dynamiques d'adaptation des PV
existants et ceux à créer en aires protégées ;
O Les collectivités territoriales
décentralisées, les organisations non gouvernementales et les
organismes gouvernementaux doivent tous de concert, élaborer de
nouvelles formes de collaboration pour la protection et la conservation en vue
de sa transformation du PV en une aire protégée d'une part et la
création d'autres parcs ou aires protégées dans les
centres urbains ; il s'agit d'adopter des initiatives de collaboration qui
stimulent et récompensent les mesures d'aménagement axées
sur la conservation.
Tout ceci est résumé dans le schéma1
ci-dessous.
MODE D'APPROCHE DISTINCT DE LA VALEUR DU PV
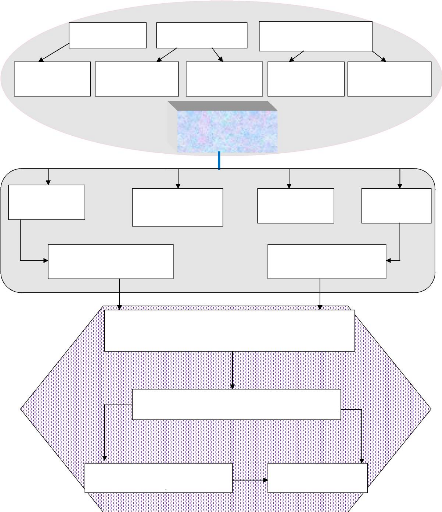
Production de la
valeur touristique
Production des biens naturels marchands et non
marchands
.
Retombées économiques de la
protection
du PV.
FONCTIONS
ECONOMIQUE
Bénéfices sociaux
services
récréatifs
Evaluation des coûts et
des
bénéfices engendrés par la
Distinction entre la valeur d'usage direct
(retombés économiques), la valeur d'usage indirect (services
rendus par l'éco système) et la valeur hors usage.
Services récréatifs
et
éducatifs et
recherches
Valeurs économiques totales accordés aux
biens
publics protégés.
FONCTIONS
SOCIALES
Gouvernance et
développement local
partant
du PV de Douala
Santé, bien être,
et qualité de
vie
SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX
Protection des
ressources en
eaux
Bilan coût - bénéfice de
la
protection du PV.
Biens et services rendus par
l'éco
système.
Préservation de
la
biodiversité
Protection contre
les risques naturels
Piégeage du
carbone
Schéma 1: mode d'approche distinct de la valeur
du PV
Source : Rapport centre de recherche pour études et
l'observation des conditions de vie ; Paris France n° 255 Nov. 2008
ANALYSE DE LA VALEUR DU PV.
Trois types de valeurs découlant de la
multifonctionnalité (schéma 2) peuvent
être attachés au PV de Douala :
-La valeur économique qui comprend les retombées
économiques en termes d'emplois,la production des biens naturels
marchands et des services touristiques,l'accumulation des compétences
conséquentes à la protection et les synergies économiques
résultants des multiplicateurs de l'activité économique
;
-Les usages récréatifs, scientifiques,
éducatifs et sportifs sont rassemblés au sein de la valeur
sociale du PV, auxquels s'ajoutent les bénéfices sur la
santé et la qualité de vie ainsi que la valeur patrimoniale ;
-Enfin, les services écologiques regroupent l'ensemble
des services fournis par l'écosystème et comprennent : la
régulation naturelle des écosystèmes (climat, sols,
végétation, eau), la protection contre les risques climatiques,
les services fournis par les espèces (pollinisation, équilibre de
la faune et de la flore, plantes médicinales) maintien de la
biodiversité et du patrimoine génétique.
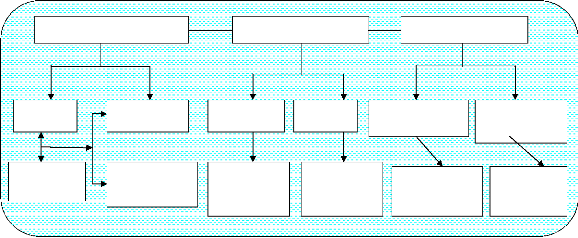
Compétences
Emplois
Valeurs Economiques
Productions
Dévelop-
pement local
Valeurs du
patrimoine
Usages
scientifiques
et
éducatifs
Valeurs Sociales
Usages
récréatifs
Santé, et
qualité de
vie,
sport
Services rendus
par les milieux
Sces fournis
par les espèces
Services Ecologiques
Protections
contre les
risques
Biodiversité/
patrimoine
génétique
Schéma 2 : analyse de la valeur du PV.
Source : Rapport centre de recherche pour études et
l'observation des conditions de vie ; Paris France n° 255 nov 2008.
CONNAISSANCE DU PV ET LES ELEMENTS SPECIFIQUES NON
EXHAUSTIFS.
Le schéma 3 suivant est
représenté à partir des analyses sur la connaissance du PV
et des
éléments spécifiques non exhaustifs
présentés plus haut dans ce travail.
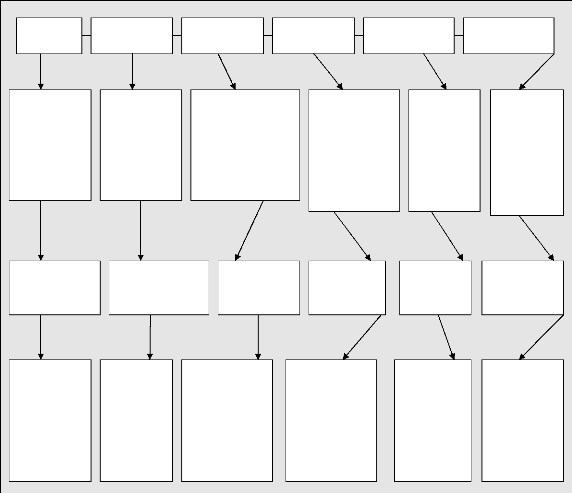
Emplois
Valeur du
Patrimoine
Productions
Usages
récréatifs
Sces rendus
par les milieux
-Touristiques - Sécurité
- Gardiens
- Sportifs
- Pagayeur
- Agents eaux et forêts
-Touristiques
- Artisanales
- Labels - Chasse - Pêches -
Cueillettes
- Espace vierge
non habité
- Espèces emblématiques
- Cultures locales
- Valeur des
littoraux
- sport de
nature
-Chasse et
pêche de loisirs -Randonnées,
- promenades à pirogue sur les lacs
- Aménageur du territoire - Guide
- Animateur
- Sécurité civile - Secours en
mer
- Moniteur
sportif
-Eco
tourisme
- tourisme
- Eco système
- Observatoire météorologique -
réserve
intégrale
-Accueil éducatif
-Sentiment de santé et de
sécurité
-Faible densité de la population Qualité
de l'air -Qualité sonore - Aires naturelles
protégées
-
Pollinisation - Faune
pour chasse et pêche
- Plantes mellifères
- Plantes médicinales
- Espèces
menacées -Espèces
endémiques
Sces
fournis par
les espaces
Biodiversité/
patrimoine
génétique
|
Compétences
|
Développement
local
|
|
Usages
scientifique
et
éducatif
|
|
Santé,
qualité de
vie et
sport
|
Protection contre
les risques
-Piégeage du carbone - dilution de la
pollution
- régulation du climat
-Inondations -Protections contre les
aléas
climatiques - Limitation contre la pollution des
sols
Schéma 3 : connaissance du parcours Vita et les
éléments spécifiques non exhaustifs.
Source : Rapport centre de recherche pour études et
l'observation des conditions de vie ; Paris France n° 255 nov 2008
LES ATTENDUS DE LA REHABILITATION GLOBALE DU PARCOURS
VITA.
Aujourd'hui la réhabilitation doit redonner un espoir
de vie à cette espace .Il ne s'agit pas seulement de réhabiliter
les ateliers de sport ou du moins l'essentiel de la destination sportive du PV,
au quel cas un pan des atouts et des avantages qui en découlent seraient
inexploités .Elle doit prendre en compte toute les composantes
fonctionnelles du PV.
Comment mieux appréhender l'importance du PV en
l'absence de certaines actions d'envergure à l'instar des
infrastructures artificielles, les ouvrages de génie civil, le
reboisement pour contrer les effets néfastes de la dégradation et
de la destruction, de l'organisation et la création des activités
qui relèvent du tourisme, mais sources de revenus et de ressources pour
les Collectivités locales ?
Autrement dit il faut investir au PV pour rendre cet espace de
vie sauvage fonctionnel et en attendre les retombées. Investir pour la
protection et la conservation du PV. Parce que les différentes
formations végétales présentes ici constituent un abri
sûr et parfait pour de nombreuses espèces animales dont les
groupes les plus notables sont les reptiles, les tortues, les rongeurs, les
varanidés, les caméléons et des espèces d'oiseaux
importantes, les amphibiens, comme les insectes, occupent une place importante
dans l'écosystème du PV et représentent des attraits
touristiques appréciables qui feraient partie des motivations de
déplacement de très nombreux touristes et contribueraient
à la promotion de la ville de Douala en particulier et du Cameroun en
général sur les marchés internationaux.
Il reviendrait également pour ce faire de valoriser les
lacs pour y créer des activités attractives (pêche, courses
de pirogues, ballades en pirogue sur les lacs, chasse etc.), redonner à
la flore et à la faune une certaine fascination, aménager en plus
de la piste de sport avec ses ateliers, des sites et des pistes pour faire des
randonnées pédestres et des excursions, repeupler la forêt
en espèces d'arbres de nos forêts, et avec des espèces de
petits rongeurs et d'oiseaux aquatiques en élaborant des dispositifs de
protection pour favoriser ainsi le développement de l'écotourisme
qui doit maintenant faire l'objet d'une attention toute particulière des
autorités de la Communauté Urbaine de Douala en
général et de la Mairie de Douala 5ième en particulier et
dont les retombées contribueraient au budget de ces dernières au
lendemain de la crise financière mondiale .
Ceci peut être le fait des Organisations non
gouvernementales, du Secteur privé ou alors de la Collectivité
territoriale décentralisée. Cependant ce sont les pouvoirs
publics qui ont la responsabilité première de la gestion du PV,
élément du patrimoine national car dans l'exigence de la
manifestation de leur volonté de promouvoir des zones de loisirs et
d'activités culturelles « la dynamique d'aptitude
commande à la ville d'innover en permanence et non seulement de
s'adapter. D'anticiper les changements et les mutations et non seulement de
chercher à les contrôler111 ». Nous le signalons
déjà plus haut, le Bois Sainte Anastasie à Yaoundé,
tient son existence aujourd'hui de la volonté forte des pouvoirs
publics.
Il est clair que pour la réalisation de certains
aspects de cette politique, des moyens financiers accrus devraient être
consacrés à la préservation et la conservation de la
biodiversité au PV.
A ce propos la réponse à la question de savoir
à qui incombe cette responsabilité mérite d'être
trouvée. Or très souvent ou pas la préservation de la
biodiversité n'a pratiquement pas de place dans l'agenda politique des
collectivités locales décentralisées. Pourtant cette
situation doit changer. La région et les Communes doivent se doter de
moyens financiers suffisants pour pouvoir mener une politique plus dynamique et
plus responsable de conservation et protection du PV.
Par ailleurs, la biodiversité est aussi l'affaire de
tous, comme le réchauffement climatique, mais ici il faut des incitants,
des modèles. Un cadre règlementaire, des incitants financiers
comme pour la politique agricole, la sensibilisation et l'information du public
en général et des riverains en particulier peuvent faire changer
les mentalités.
111 Essombe Edimo, p.162. op. cit.
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGEALLAIS M. (1952):
Traité d'économie pure, publié avec le concours
du Centre National de la Recherche Scientifique. Imprimerie nationale, 5 vol.
in 4°,984 p.
LONSO, W. (1964), Location and Land Use-
Toward a General Theory of Land Rent, American Economic Review,
57, 197-210
ANTROP (1997): The Concept of Traditional
Landscapes as abase for Landscape evaluation and planning. The example of
Flanders Region Landscape Urban Plann.38, 105-107
ARROW K.J. (1963): Social Choice and
Individuals Values, 2nd ed., Willey, New York.
BOUDEVILLE J.R. (1965) : région géographique,
région économique ; n°406, P738-739
BUDOWSKI (1976): « Tourism and Environnemental
Conservation Conflict, Coexistence or Symbiosis?
».Cambridge: Harvard University Press.
CAVIE (2002) : Etude sur le Cadre de vie des
Populations de Yaoundé et de Douala ; Arrondissement de Douala V.
CHENET-FAUGERAS (1995) : Le paysage comme parti
pris. in Roger A, édition de la théorie du paysage en France
(1974-1994).
CHRISTALLER, W. (1933), Die zentralen
Orte in Süddeutschland, Iena: G. Fischer (trad. ang. partielle par
Ch.W. Baskin (1966), Central Places in Southern Germany, Englewood
Cliffs Prentice Hall).
COLLOT (1995) : Point de vue sur la perception
des paysages in : Robert A, édition la théorie du paysage en
France (1974-1994).
DAVEZIES L. (2004) : « Les transferts
publics et privés de revenu au sécours du développement
territorial » in l'Etat des Régions, édition 2004.
DEBEL A. (2001), « Le Cameroun Aujourd'hui
», les éditions du Jaguar.223 p. DEBREU G. (1959) :
Théorie de la valeur, trad frse, Dunod, Paris.
DELAUBADERE (1987) : Droit public
économique. Précis Dalloz. Paris réed.1993
DEWARRAT (2003) : Paysages Ordinaires : de la protection au
projet. Sprimont.
DOMON (2000) : Evolution du territoire
laurentidien : caractérisation et gestion des paysages.
ESSOMBE EDIMO J.R. (2007a) :
«localisation périphérique des entreprises
industrielles et création de nouvelles centralités à
Douala », Monde en développement. Vol 35, n°137, pp
1- 14.
ESSOMBE EDIMO J.R. (2007b) : «
spatialité et développement économique : Douala entre le
hasard et la nécessité», éd. L'Harmattan, Coll.
« Etudes Africaines », Paris.
FUJITA M., P. KRUGMAN et A.J. VENABLES (1999):
The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade,
Cambridge, MIT Press.
GUISEPELLI (2005) : Représentations
sociale du paysage, négociation locale et outils de débat sur le
paysage.
HOYT (1954), « Economie
Résidentielle et compétitivité des Territoires ».
HURWICZ (1930). « La Planification
Economique Collectiviste »
ISARD W., (1956), «Location and Space
Economy: A General Theory Relating to Industrial Location, Market Areas, Land
Use, Trade and Urban Structure». New York, MIT and J. Wiley and
sons.
JACOBS (2000):»Landscape prospects of the
next millennium». Landscape Urban Plan 47,129-133
JOURNAUX A ; BRUNET P ; DIARRA S ; PASDELOUP B ;
PELISSIER P., (1991), Géographie générale humaine
et économique 1er, Collection André Journaux, Hatier.
Paris, 191p.
KAMTO M (1995) : Droit de l'Environnement en
Afrique, édicef, Paris, 416p.
KEYNES J M (1936) : Theorie
générale de l'emploi de l'intérêt et de la
monnaie, éd Gallimard .
KRUMMER (1968) : Das Urheberrechlich Schutzbare
verk (L'oeuvre protégéable en droit d'auteur), Berne,
Stämpfli et Cie, 226 pages.
KUETE M, MELINGUI A, MOUKAM J, NGUOGHIA J et NOFIELE :
(1993). Nouvelle géographie 3è, Edicef,
Edition Cameroun, Chine, 207p.
LAJUGIE J. (1979) : Espace régional et
aménagement du territoire. Dalloz.
MALINVAUD E., (1969) : leçon des
théories microéconomiques, paris Dunod, pp 27
MILLS, E. S. (1967), An aggregative model of resource
allocation in a metropolitan area, Chicago, IL: University of Chicago Press
MOUGEOT M. (1975) : Théorie et
politiques économiques régionales, Paris, Economica.
MUTH, R. (1969), Cities and Housing: The Spatial
Pattern of Urban Residential Land Use, NGUYEN QUOC DINH
(2001) Droit International Public, 6è
édition.
PERROUX F. (1950), « Les espaces
économiques », Economie appliquée, tome 3, n°1
PINCHEMEL (1992) : La face de la terre, éléments
de géographie. Paris: Armand Colin. SOMBART W. (1916), «
Müchen und Leipzig ». Der moderne Kapitalismus.
THÜNEN VON J.H., (1827), Der isolierte
Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und National Okonomie, Hambourg. Perthes.
Voir aussi J.H. Von Thünen, (1826), L'Etat Isolé, Ed. Guillaumin,
Paris 1851.
REVUES ET ARTICLES
ARROW K.J. (1974): «limited knowledge and
economic analysis» American Economic Review
AUZANNEAU (2001) : Le paysage, expression
d'une culture plurielle, in : Actes du colloque international de
Saint-Émilion, Patrimoine et paysages culturels, 3, Mai-1er
Juin 2001, Bordeaux, France.
BRIFFAUD (2001) : Sauver les apparences ?
Questions aux politiques du paysage ? In : Actes du colloque international de
Saint-Émilion, Patrimoine et paysages culturels 30 Mai-1er
Juin 2001.Bordeaux, France.
BUCHANAN J.M. (1969): « External
Diseconomies, Corrective Taxes and Market Structure» American Economic
Review.
CLAUDIUS PETIT E (2003) ; « la politique
d'aménagement du territoire », Revue d'Histoire 3-n°79
p43-52.
CONSEIL DE L'EUROPE (2000) : Convention
européenne du paysage et rapport explicatif. Strasbourg, France :
conseil de l'Europe.
DAVEZIES L. (2003) : « Temps de la
production et temps de la Consommation, les nouveaux aménageurs des
territoires ? » in Futuribles, Novembre.
DAYAN L. (2004) : «
stratégie du développement durable ; l'écologie
industrielle : une des clés de la durabilité » in revue
d'économie rurale et urbaine (RERU), 2004, p 28. DOUGLASS
NORTH (1955): »Location Theory and Regional Economic Growth
».Journal of Political Economiy 63 (Juin) 243-258.
FAIR CLOUGH (2002) : Aspects of landscape
characterisation and assessment in the UK.in:Conseil de l'Europe,
édition Première réunion des ateliers de la mise en oeuvre
de la Convention européenne du paysage. Strasbourg, France, Conseil de
l'Europe, 42-44.
KOLM (1968) S: la théorie
économique générale de l'encombrement. Paris,
Futuribles.
KOLM S. (1997) « The fields of modern
social ethics» n° 14, CREME
KRUGMAN P., (1991a), « rendements
croissants et géographie économique », journal of
political economy vol.3, n°99, pp 483 - 499.
KRUGMAN P., (1991b): geography and
trade, MIT Press, Cambridge Ma.
La tribune du citoyen n°50, (Avril
2010) : interview du Dr. Siméon Ombiono, Coordinateur du
Service National Justice et Paix, Enseignant à l'Université de
Yaoundé II.
NAMA R. (2004) «L'aménagement de
l'espace» in acte du colloque sur l'aménagement du territoire tenu
à Niamey au Niger en 2004. p.7.
NGOUONPE L : « Le Parcours Vita de Douala
va (doit)-t-il mourir » journal le front n°307 du 05
Février 2008.
SCAZZOSI (2003). «Landscape and Cultural
Landscape European landscape Convention UNESCO Policy. in: UNESCO, éd;
Cultural landscapes: the Challenge of Conservation.Paris: UNESCO,55-59.
TIEBOUT (1956), «A pure Theory of local
expenditures, Journal of Political Economy, 64((), pp416-424.
TULOCK G. (1967): « The general irrelevance
of the general impossibility theorem» Quaterly Journal of
Economics, 81, p 256-270.
THESES ET COURS
NTONGA BOMBA S. (2010), Cours de Droit de
l'Environnement : Enseignant à l'Université de Yaoundé
II.
TAMASANG (2010) Cours de Doit de l'Environnement
:, Enseignant à l'Université de Yaoundé II.
IDE ADAMOU H. (1994) : Analyse de la
Stratégie du Développement Rural par l'Approche
Aménagement et Gestion des Territoires dans les Pays du Sahel : Cas du
Burkina -Faso et du Niger. Thèse de Doctorat de 3ième
Cycle, Université de Ouagadougou, Mai 1994.
SITES INTERNET
http : //
ww.parcsdeloisirs.haye.com.
http: //www. notre-planete.info http: //
www. amb-grece.fr
http: //
www.cereq.fr
http: //
www.e-santé.fr
http: //www.e-sante-be
http: //
www.guidenaturabio.com http:
//
www.kelformation.com http: //
www.parks-parcs.ca
TABLES DES MATIERES
DEDICACE 2
REMERCIEMENTS 3
NOTE CONTEXTUELLE. 4
ABREVIATIONS. 5
LISTE DES SCHEMAS. 6
RESUME 7
SOMMAIRE 9
INTRODUCTION GENERALE 10
I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU SUJET 11
II- PROBLEMATIQUE 13
III - INTERET DE L'ETUDE 13
IV.- JUSTIFICATION DU CHOIX DU THEME 14
V- OBJECTIFS. 14
VI- METHODOLOGIE 15
VII- DEFINITION DES CONCEPTS OPERATIONNELS
17
PREMIERE PARTIE 18L'OFFRE ET LA DEMANDE DES SERVICES
PUBLICS ET LA
SPATIALITE : CAS DES ESPACES NATURELS URBAINS COMME LE
PARCOURS VITA.
18
INTRODUTION DE LA PREMIERE PARTIE 19
CHAPITRE 1 : APPROCHE DOCTRINALE DE GESTION DES AIRES
PROTEGEES DANS
LE CADRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
23
INTRODUCTION 23
SECTION 1 : ANALYSE ECONOMIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
2
I.1. L'émergence du concept de l'environnement 23
I.1.1.L'homme, la nature et la technique. 24
I.1.2.Objectif de l'économie de l'environnement. 25
I.2 .Théorie économique et environnement. 26
I.2.1.Evaluation monétaire : la valeur de l'environnement.
27
I.2.2. Aménagement du territoire : une affaire d'origine
ancienne 29
I.2.3. Le paysage, un enjeu de gestion de l'environnement et
d'aménagement du territoire. 30
I.3. L'aménagement du territoire face à l'attente
et l'exigence de gestion du paysage ou les objectifs de l'aménagement du
territoire. 31
I.3.1. Définition de l'aménagement du territoire.
31
I.3.3. Le concept de paysage opérationnel en
aménagement du territoire. 34
SECTION II- L'ESPACE ET L'OFFRE DES SERVICES COLLECTIFS.
36
II.1. Economie Régionale : le rôle des avantages
compétitifs et des avantages comparatifs 37
II.1.1. La nouvelle économie géographique :
anticipation et effets boule de neige 37
II.1.2- Proximité géographique et proximité
organisée 38
II.2 Territoires et réseaux, une nouvelle
géographie économique 39
II.2.1. Les territoires dans les chaînes de valeur
mondialisées 39
II.2.2-L'économie résidentielle, nouveau
ressort du développement territorial 40
II.2.3. Vision libérale du rôle de l'Etat 41
II.2.4. Défaillance de l'Etat. 43
CONCLUSION 44
CHAPITRE 2 : LE PARCOURS VITA ET L'ESPACE DE DOUALA
VIEME. 45
INTRODUCTION 45
SECTION 1-LA COMMUNE DE DOUALA VIEME 45
1.1-Le territoire de l'arrondissement de Douala Vième
45
1.2-La structure de la population. 46
1.3.1-Environnement. 47
1.3.2-Les logements 48
1.4-la couverture administrative et commerciale de Douala
5ième 48
SECTION II-LE PV DANS SON ENVIRONNEMENT. 49
2 .1-Le circuit et les ateliers de sport. 49
2.2-Le milieu biogéographique, les lacs et les
rivières. 51
2.2.1-Le relief, la végétation et le sol. 51
2.2.2- Les lacs et la rivière 52
2.3-Intérêts écologiques du PV. 53
2.4-L'intérêt lié à la
biodiversité. 54
2.4.1-La reproduction 54
2.4.2-L'alimentation 54
2.4.3- la végétation 55
2.4.4- le climat 55
CONCLUSION 56
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 57
SECONDE PARTIE : LA PROTECTION ET LA MULTIFONCTIONALITE.
58
INTRODUCTION DE LA SECONDE PARTIE 59
CHAPITRE 3 : LA NECESSITE DE LA PROTECTION DU PARCOURS
VITA. 60
INTRODUCTION 60
SECTION 1-TENTATIVES DE DEFINITION ET L'ARSENAL JURIDIQUE
DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 60
1.1-Définition 60
1.2-L'Arsenal Juridique pour la Protection de l'environnement du
PV. 61
1.2.1-Sur le plan international 61
1.2.2-Sur le plan national 63
1.2.3-Sur le plan traditionnel. 65
SECTION 2- LES ACTEURS 69
2.1-L'Etat ou les Pouvoirs Publics 69
2.2- l'Association des Amis du PV (APV) 69
2.3-L'Association mieux -être 70
2.4-Les individuels ou les autres 70
CONCLUSION 71
CHAPITRE 4 : LES RETOMBEES DE LA MULTIFONCTIONALITE DU
PARCOURS VITA
DE DOUALA. 72
INTRODUCTION 72
SECTION1 : L'OPERATIONNALITE DE LA MULTIFONCTIONNALITE
72
1.1-La démarche multifonctionnelle. 72
1.2-La dynamique multifonctionnelle. 73
SECTION 2-L'INTERDEPENDANCE FONCTIONNELLE. 75
2.1-Fonctions économiques. 75
2.1.1-Approche de l'analyse de la valeur des produits issus du
PV. 75
2.1.1.1.- Production de biens marchands. 76
2.1.1.2- Production des biens naturels non marchands. 76
2.1.2- Les retombées économiques. 77
2 .1.2.1- Les retombées directes. 78
2.1.2.2-Les retombées indirectes. 78
2.1.3-Les retombées induites. 83
2.2-Les fonctions sociales du PV. 84
2.2.1-L'amélioration de la qualité de vie et de la
santé par le sport. 84
2.2.1.1-Les intérêts généraux des
activités sportives. 84
2.2.1.2-L'apport du sport sur la santé. 86
2.2.2-Le PV comme lieu récréatif et milieu de
recherches éducatifs. 88
2.2.2.1-L'offre des possibilités de recherches
scientifiques. 88
2.2.2.2-Le PV, espace récréatif.
89
2.3-Les services environnementaux du PV. 89
2.3.1-Préservation de la biodiversité et services
fournis par les espèces. 90
2.3.2-Piégeage du carbone. 90
2.2.3-Les dangers de la diminution de la biodiversité du
fait de la déforestation du PV
91
CONCLUSION 93
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 94
CONCLUSION GENERALE 95
QUELQUES PROPOSITIONS POUR L'EPANOUISSEMENT AU PARCOURS
VITA. 98
REFLEXION SUR LA VALORISATION DE L'ESPACE. VITA
100
ANALYSE DE LA VALEUR DU PV. 104
CONNAISSANCE DU PV ET LES ELEMENTS SPECIFIQUES NON
EXHAUSTIFS. 105
LES ATTENDUS DE LA REHABILITATION GLOBALE DU PARCOURS
VITA. 106
BIBLIOGRAPHIES 110
TABLES DES MATIERES 111
ANNEXES 114
ANNEXES
ANNEXE 1.
Chronologie générale du droit
international de l'environnement.
Le droit international de l'environnement comprend plus de 300
conventions ou traités multilatéraux sans compter les accords
bilatéraux. Il est le fruit d'une longue histoire qui est
retracée par quelques points de repère.
-2 Décembre : Convention internationale pour la
régulation de chasse à la baleine et aux grands
cétacés-creation de la commission baleinière
internationale ;
-1948 : Création de l'Union internationale pour la
Conservation d la nature (UICN) qui regroupe 68 Etats, 103 Organismes publics
et des ONG dont les objectifs consistent à favoriser la
biodiversité, l'utilisation rationnelle et équitable des
ressources naturelles, le développement durable par des activités
de lobbying,et en faisant des études ,rapports ;
-1951 : Convention Internationale pour la protection des
végétaux ;
-1961 :Union pour la protection des obtentions
végétales protège le certificat d'obtention
végétale (COV),contreversé par les pays africains
notamment,et pose quelque contradictions avec la convention sur la
diversité biologique de 1992 ;
-1961 : Création du World Wildlife Fund ou WWF devenu
en 1986 le FONDS Mondial pour la Nature ;
-Décembre 1970 : Création de l'Environmental
Protection Agency ;
- En 1971 :1)-Programme Man and Biosphère : lancement
du programme MAB par l'UNESCO, donnant lieu à la création de
Réserves de Biosphère (1976), Coordination mondiale d'aires
protégées (parcs, réserves...),
2)-Premier ministère de l'environnement en France,
-2-3 Février 1971 : Convention de Ramsar (en Iran)
concerne les zones humides d'importance particulièrement comme habitats
de la sauvagine : dans le cadre du programme MAB (Man and Biosphère) de
l'UNESCO entrée en vigueur en 1975 ;
ANNEXE 2.
Le premier sommet de la Terre.
-1 Juin 1972 : a)-Conférence mondiale sur
l'Environnement à Stockholm qui aboutit à la Déclaration
de Stockholm « l'homme a un droit fondamental à la liberté,
à l'égalité et à des conditions de vie
satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permettra de
vivre dans la dignité et le bien-être.Il a le devoir solennel de
protéger et d'améliorer l'environnement pour les
générations présentes et futures » ;
b)-Mise en place du Programme des Nations Unies pour
l'Environnement : le PNUE ;
-23 Novembre 1972 : Convention sur le Patrimoine mondial ou
Convention de Paris sous l'égide de l'UNESCO. Elle vise à la
protection du patrimoine culturel et naturel à valeur universelle, les
sites sont inscrits sur la « Liste du patrimoine mondial ».L'Etat
signataire s'engage alors à ne pas les détruire. Il s'agit
simplement d'un label ;
-1972 : Convention sur la prévention de la pollution
des mers résultant de l'immersion des déchets, communément
appelée Convention de Londres ;
-3 Mars 1973 : Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ou
Convention de Washington, parfois appelée CITES qui réglemente le
commerce des végétaux et d'animaux vivants ou morts par 3 annexes
:a)- espèces ne pouvant pas faire l'objet de mouvements commerciaux,
b)-espèces pouvant faire l'objet de mouvements
commerciaux avec permis d'exportation CITES et population
contrôlée,
c)- espèces pouvant faire l'objet de mouvements
commerciaux avec seulement un permis d'exportation ;
-1975 : Traité du Rio Uruguay qui établit un
mécanisme d'information et de consultation publique,parfois
présenté comme précurseur de l'instauration de ces
mécanismes de démocratie participative dans le droit de
l'environnement ;
-1976 : Conseil de l'Europe : Réseau européen de
réserves biogénétiques ;
-2 Avril 1979 :L'Union européenne adopte la Directive
CEE 79/409 dite Directive oiseaux qui désigne les zones de protection
spéciale pour les oiseaux rares ou menacés ;
-23 Juin 1979 : Convention de Bonn sur les espèces
migratrices regroupées en une liste annexée. Les Etats
signataires doivent promouvoir la recherche sur les espèces migratrices,
accorder une protection immédiate aux espèces de l'annexe I
(exemple baleinoptères) et enfin conclure des accords internationaux
pour les espèces de l'annexe II (exemple la gazelle) ;
-19 Septembre 1979 : Conseil de l'Europe adopte la Convention
relative à la Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de
l'Europe encore appelée Convention de Berne. Elle concerne l'UE et
d'autres Etats européens ainsi que des états non membres mais
concernés par certaines espèces migratrices tels le
Sénégal, le Burkina -Faso, et vise la Conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Elle dénombre près de
500 espèces végétales et 580 espèces animales
protégées. Dans le domaine de la flore, interdiction de coupe,
cueillette et déracinage intentionnels et protection des habitats.
Concernant la faune, interdiction de capture, de destruction de l'habitat, de
perturbation, de commercialisation, sauf les espèces seulement
protégées. Cette Convention comporte 4 annexes listant le
degré de protection des espèces fauniques et florales ;
-10 Décembre 1982 : Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, entrée en vigueur en 1994 ;
- 22 Mars 1985 : Convention de Vienne relative à la
protection de la couche d'ozone ratifiée en 1986, établissant un
cadre préparant le protocole de Montréal au Canada ;
- 1986 : Moratoire sur la chasse à la baleine ;
-Septembre 1987 : Protocole de Montréal
édicté pour éliminer les substances qui appauvrissent la
couche d'ozone, les Etats s'engageant à interdire l'utilisation des CFC
à une date butoir ;
-1988 : Création par les Nations Unies du Groupe
d'Experts intergouvernemental sur l'Evolution du Climat ;
-22 Mars 1989 :Convention de Bâle sur le Contrôle
des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur
élimination ,entée en vigueur en 1992 .Elle concerne la
réduction de la circulation des déchets dangereux entre ls pays
,en particulier vers les pays en voie de développement.
ANNEXE 3.
Sommet de la Terre à Rio.
-22 Mai 1992 : Conférence des Nations Unies sur
l'Environnement et le développement (sommet de la Terre) à Rio de
Janeiro (Brésil) organisé par l'ONU. Ce fût la plus grande
Conférence intergouvernementale jamais organisée qui a
consacré des principes généraux qui sont désormais
partie du langage courant comme le développement durable et qui a abouti
notamment à :
a)- la convention sur la diversité biologique,
b) -l'Agenda 21,
c)- l'Adoption d'une Convention cadre sur les changements
climatiques (cadre du futur protocole de Kyoto) ;
-17 Juin 1994 : Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification entée en vigueur en 1996 ;
-22 Septembre 1995 : Ban Amendment de la Convention de
Bâle qui interdit l'exportation des déchets dangereux des pays de
l'OCDE vers les pays en développement. Elle n'est pas encore
entrée en vigueur mais a inspiré la création de
Conventions régionales, telles la Convention de Bamako de 1996.
-1996 : Convention sur la responsabilité et
l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de
substances nocives et potentiellement dangereuses,convention dite «
Convention SNPD » non entrée en vigueur.
-25 Juin 1998 : Convention d'Aarbus ou Convention sur
l'accès à l'information, la participation du public au processus
décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement ;
-10 Septembre 1998 : Convention de Rotterdam sur la
procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui
font l'objet d'un commerce international (dite convention PIC) ;
-12 Avril 19991 : Convention internationale pour la protection
du Rhin. Elle élargit l'action de dépollution à la gestion
durable de l'eau, aux actions préventives de crues et d'inondations...
;
-2000 : Protocole de Carthagène sur la prévention
des risques biotechnologiques ;
-22 Mai 2001 : Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants visant à interdire certains produits polluants
;
-Février 2005 : Entrée en vigueur du Protocole de
Kyoto.
| 


